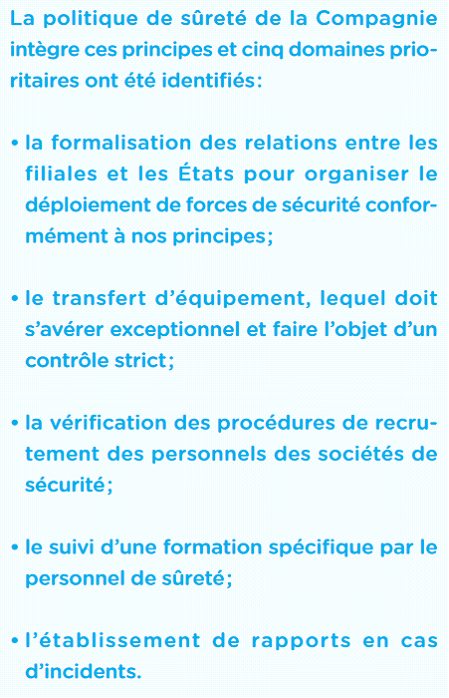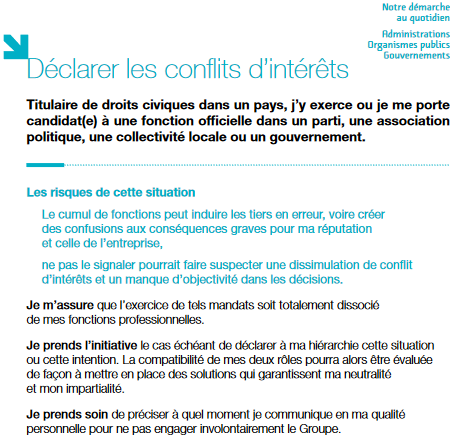F. LA POLITIQUE D'INFLUENCE DE TOTALENERGIES ET SON ENCADREMENT
TotalEnergies s'est dotée de plusieurs documents de référence qui ont l'ambition d'en faire une entreprise responsable. Selon la contribution écrite de TotalEnergies transmise à la commission d'enquête, « Force est de relever que son code de conduite, ses normes de référence ou sa stratégie présentent de nombreux points de convergence avec les orientations mentionnées dans certains documents publics officiels, dont le respect des droits humains n'est pas des moindres ».
TotalEnergies définit son code de conduite comme « le document de référence destiné à l'ensemble des collaborateurs à travers le monde. En interne, les comportements de chacun doivent démontrer que ce code de conduite est respecté et concrètement mis en oeuvre. Nul n'est censé l'ignorer ». Il est également adressé aux fournisseurs et prestataires du groupe auxquels il revient de vérifier qu'ils appliquent des standards équivalents.
Le code de conduite de l'entreprise repose sur cinq valeurs : la sécurité, le respect de l'autre, l'esprit pionnier, la force de la solidarité et le goût de la performance.
Le groupe revendique en particulier refuser toute forme de corruption ou de trafic d'influence et toute forme de comportement relevant d'un manque de neutralité ou relevant d'un conflit d'intérêts. Il décrit divers comportements à proscrire comme « Accepter, lors du rachat d'actifs ou de l'entrée dans une joint-venture, une association avec une société inconnue au motif qu'elle prendra en charge certains risques locaux liés à l'opération » au motif que cela risquerait d'« engager les biens et la réputation de l'entreprise avec un partenaire peu honnête qui poursuit des objectifs divergents ou même illicites » et de « se trouver associé(e) à des opérations répréhensibles pouvant exposer à des risques de corruption ».
Extrait du code de conduite de TotalEnergies
TotalEnergies revendique également respecter scrupuleusement les droits de l'homme et a identifié des domaines prioritaires afin de concrétiser cet engagement (voir image ci-dessus). Un comité d'éthique de la compagnie, composé de salariés du groupe, est le garant de ces principes et du respect du code de conduite.
Ces principes sont déclinés au sein d'un guide pratique d'intégrité, qui formule des conseils pratiques pour les collaborateurs du groupe afin de prévenir les situations à risque, par exemple les risques de corruption.
Il présente des situations concrètes et la conduite qu'il faut alors tenir. Ainsi, lorsque des élus locaux sont invités sur le site d'une entreprise, les collaborateurs du groupe doivent préciser clairement par écrit les conditions de cette invitation et son objectif. Ils doivent également refuser d'assumer les frais supplémentaires occasionnés par la présence éventuelle de leur famille sur certains évènements non professionnels. Le guide appelle aussi à la prudence quant aux partenariats locaux et à la prise en charge des frais en cas d'immersion sur un site de collaborateurs d'un partenaire public étranger. Il fournit également des conseils spécifiques de déclaration des conflits d'intérêts (voir image ci-dessous).
Source : Extrait du guide pratique d'intégrité de TotalEnergies
La compagnie affirme également refuser toute forme de « paiement de facilité » pour mener ses démarches administratives.
Ces documents internes publics relatifs aux engagements de TotalEnergies en matière de droits de l'homme et de conflits d'intérêts montrent que le groupe a conscience de l'importance de ces enjeux. Toutefois, ces documents comportent peu de dispositions contraignantes, et se contentent souvent d'appeler les collaborateurs du groupe à respecter le droit du pays dans lequel ils interviennent.
Par exemple, si les paiements d'intermédiaires en espèce doivent être refusés par ceux-ci, en revanche, les versements vers des comptes offshore ne sont à éviter que « dans la mesure du possible »282(*).
En outre, si ces documents précisent la conduite à suivre en cas de conflit d'intérêts préjudiciables à la compagnie, ils n'indiquent pas de règles relatives à de possibles conflits d'intérêts liés à la présence au sein du groupe de collaborateurs qui étaient ou souhaitent devenir dans un futur proche des agents publics.
Or, les mobilités entre le secteur public et des entités du groupe TotalEnergies peuvent en effet amener à des situations de conflits d'intérêts et de prise illégale d'intérêts si elles ne font pas l'objet de règles d'encadrement strictes. C'est d'ailleurs pourquoi l'administration ou des autorités indépendantes -- en France la HATVP -- sont chargées de vérifier l'absence de risques pénaux et déontologiques attachés à ces mobilités. Ces situations éventuelles sont d'autant plus problématiques que les politiques relatives aux enjeux énergétiques et de transition écologique exigent une action publique rigoureusement indépendante des intérêts particuliers ou sectoriels, qui pourraient porter atteinte à la neutralité de l'administration.
Plus largement, Olivier Petitjean, cofondateur et coordinateur de l'Observatoire des multinationales, a souligné devant la commission d'enquête qu'il existait des risques vis-à-vis des mobilités public-privé « qui se déroulent dans un même secteur. Par exemple, les gens qui travaillent dans des services financiers à Bercy ou à la Commission européenne vont migrer dans des banques ou à la Fédération bancaire française. (...) Ces portes tournantes sont, à notre avis, problématiques, essentiellement car elles contribuent à entretenir des phénomènes d'entre-soi, d'insuffisance du respect du contradictoire et de prises de contact non publiques. Tout ceci contribue à restreindre un peu le champ des possibles et de l'imaginaire si bien que, schématiquement, les décideurs publics sont amenés à n'entendre qu'un seul son de cloche, ce qui est contestable du point de vue démocratique ».
Comme l'a souligné Jean-Claude Mallet, directeur des affaires publiques de TotalEnergies il est donc nécessaire « d'être vigilant sur les conflits d'intérêts ». Cela ne signifie pas qu'il ne faille pas prendre en compte les effets bénéfiques liés à ces mobilités. Jean-Claude Mallet a rappelé à cet égard qu'il est indispensable que « les parcours entre le service public et les entreprises privées ne soient pas découragés, bien au contraire, lorsqu'ils apportent de l'expérience ». Jean-Yves Le Drian a également déclaré devant la commission d'enquête qu'« il est intéressant pour l'État de disposer de personnels d'encadrement de haut niveau qui ont vécu l'expérience du privé et la réalité de l'entreprise ». Un équilibre doit donc être trouvé entre les risques d'entre-soi auxquels peuvent mener ces mobilités et, au contraire, les possibilités d'ouverture dont peuvent bénéficier l'État et les entreprises grâce à ces parcours.
Selon les éléments écrits fournis par TotalEnergies à la commission d'enquête, « Au 31 décembre 2023, la Compagnie comptait 265 cadres dirigeants. Nous avons identifié 25 cadres dirigeants ayant au cours de leur carrière occupé des fonctions dans le secteur public, soit moins de 10 % des cadres dirigeants de TotalEnergies ». Ces données prennent en compte des personnes ayant effectué des mobilités dans le secteur public qui peuvent remonter à plusieurs dizaines d'années. Selon les éléments qu'elle a fournis au rapporteur, depuis 2020, la HATVP a eu à se prononcer sur neuf projets, concernant sept agents publics, de mobilités vers ou depuis le groupe TotalEnergies, quatre concernant des personnes en provenance du groupe TotalEnergies et cinq concernant des mobilités d'anciens responsables publics vers le groupe TotalEnergies. Selon elle, « Ces cas n'ont donné lieu à aucun avis d'incompatibilité. Tous, en revanche, ont fait l'objet d'un avis de compatibilité avec réserves ». Cette situation est cohérente avec l'ensemble des avis rendus par la HATVP, dont 77 % des avis étaient des avis de compatibilité avec réserves en 2023.
Plus généralement, la construction des politiques climatiques pose des questions de conflits d'intérêts structurels des entreprises des secteurs les plus émissifs en gaz à effet de serre, et en particulier des entreprises du secteur des énergies fossiles. À cet égard, la présence d'entreprises de ce secteur aux COP, au sein desquelles se crée le consensus politique sur les mesures prises pour répondre au réchauffement climatique a fait l'objet de nombreuses critiques. Laurence Tubiana, représentante spéciale du gouvernement français pour la conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques (COP21), aujourd'hui membre du Haut Conseil pour le climat souligne que « la présence croissante des acteurs économiques dans les négociations internationales est un phénomène observé depuis longtemps. La philosophie de l'Accord de Paris était d'ailleurs de leur réserver une place, pour qu'ils puissent contribuer à changer l'économie ». Cependant, étant donné qu'il « n'y a pas de solution viable avec les énergies fossiles dans la lutte contre le changement climatique », Mme Tubiana estime qu'il y a une contradiction entre les intérêts des entreprises de ce secteur des énergies fossiles et l'intérêt des États. Le Haut Conseil pour le climat constate en effet dans des éléments écrits transmis à la commission d'enquête qu'« il existe un conflit d'intérêt de fait : d'un côté, l'objectif est de lutter contre le changement climatique et de parvenir à un zéro carbone net d'ici 2050 en moyenne pour la planète, tandis que de l'autre côté, les entreprises souhaitent continuer à produire des énergies fossiles. Ce conflit d'intérêts n'a pas été suffisamment traité jusqu'à présent, mais à Dubaï, il est devenu particulièrement évident. Une réflexion plus poussée sur cette question est nécessaire ».
Enfin, la question du financement d'études relative au changement climatique et à l'environnement par des entreprises du secteur des énergies fossiles comme TotalEnergies pose des difficultés. De tels financements ont été utilisés par certains acteurs de l'industrie pétrolière et gazière dans les années 1990 pour tenter de semer le doute sur l'origine anthropique du réchauffement climatique et son ampleur.
Compte tenu de cette situation historique, une insuffisante transparence de ces financements est de nature à créer des risques quant à l'indépendance des chercheurs. Or, selon l'historien Christophe Bonneuil, « les meilleurs laboratoires de climatologie bénéficient de financements de la part de TotalEnergies pour leurs recherches. L'entreprise passe des conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre) et est associée à des chaires d'excellence dans les meilleurs laboratoires français de climatologie, tels que le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE). Les climatologues liés à TotalEnergies comptent parfois parmi les experts du Giec ». Cette situation peut même poser un « problème de non-séparation clinique entre les besoins d'une expertise publique indépendante et la présence de cette grande multinationale dans nos laboratoires. L'université de Pau dépend pour une grande partie de ses revenus propres du financement de TotalEnergies. Il y a une vigilance à avoir sur cette question de l'indépendance de la recherche ».
* 282 Le recours à des intermédiaires est une pratique légale tant qu'il ne s'apparente pas à de la corruption. Le guide invite donc les collaborateurs de TotalEnergies à définir précisément les prestations demandées et à fixer une rémunération raisonnable sur la base de résultats variables.