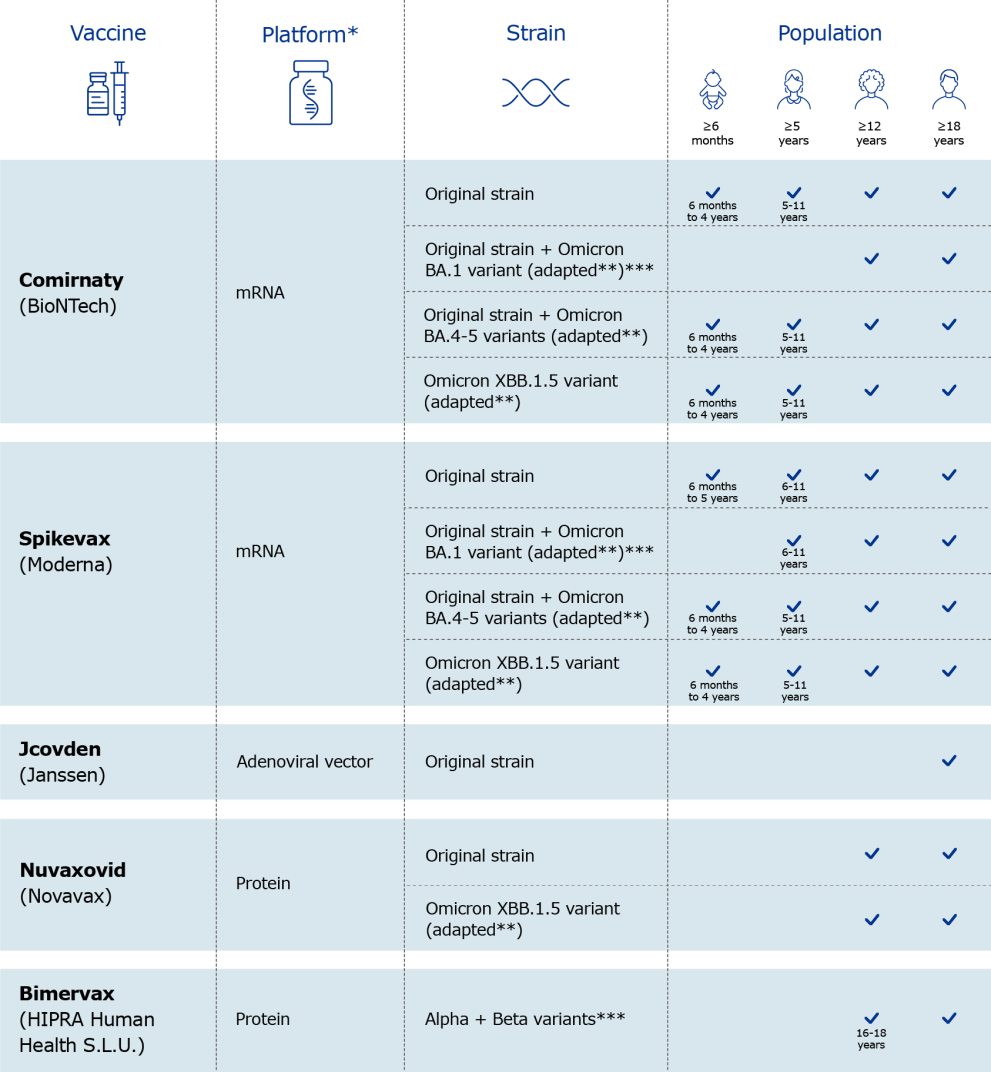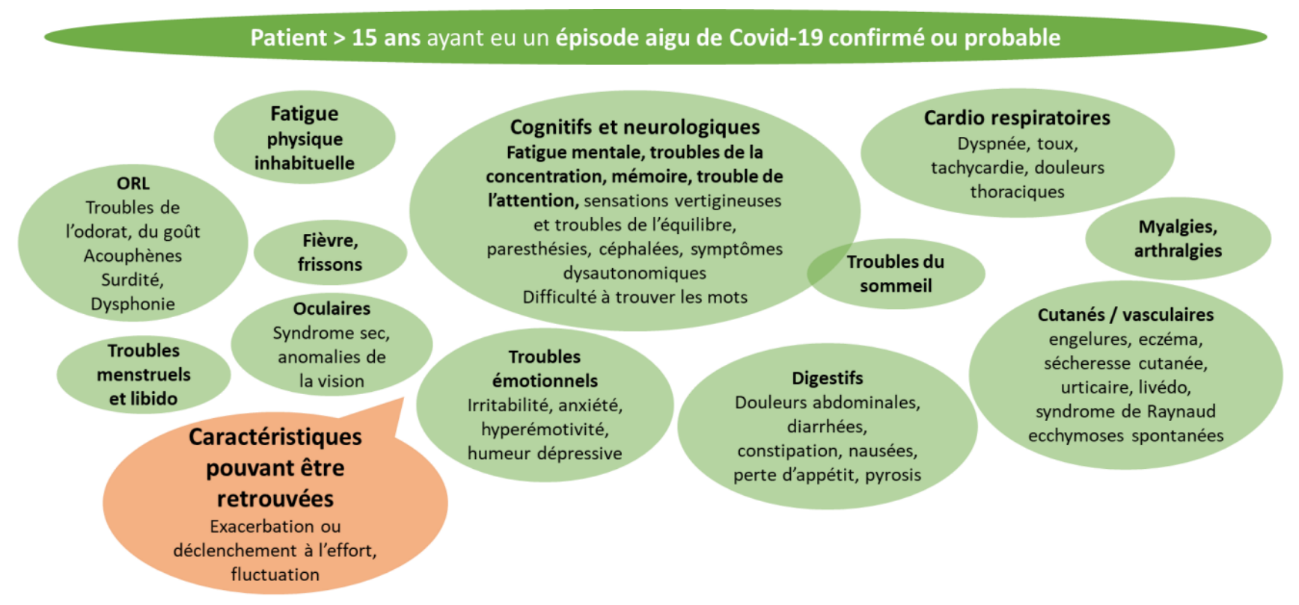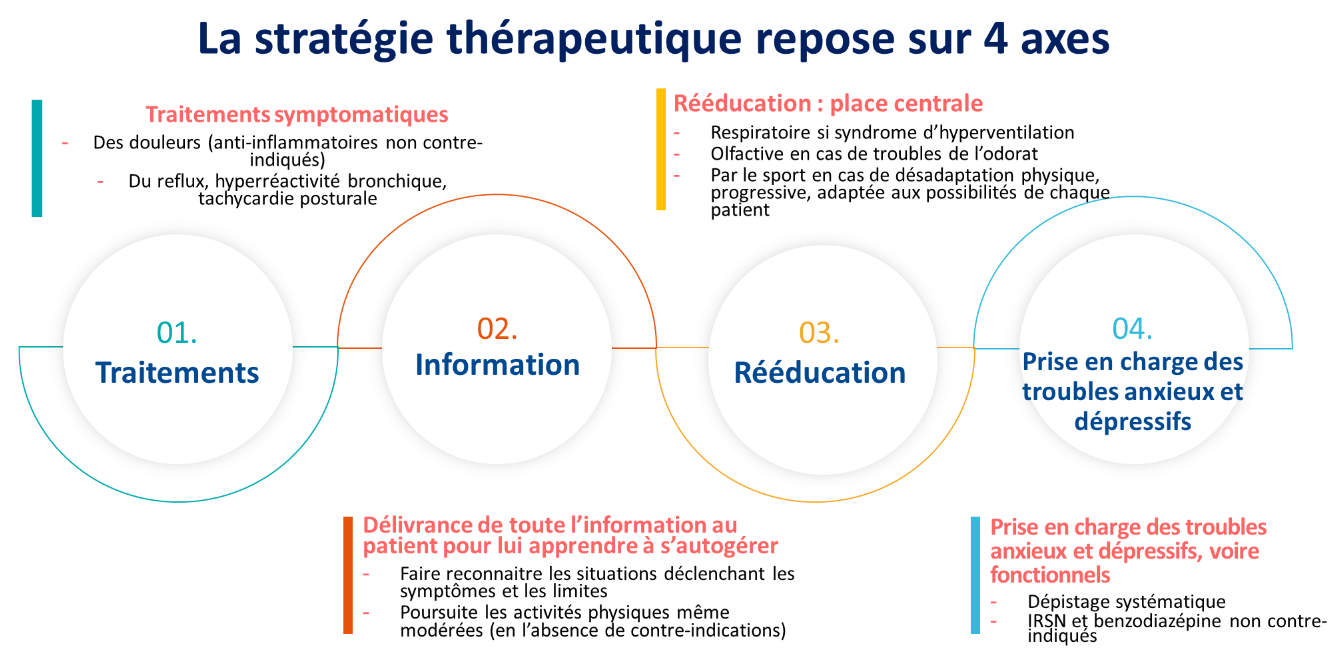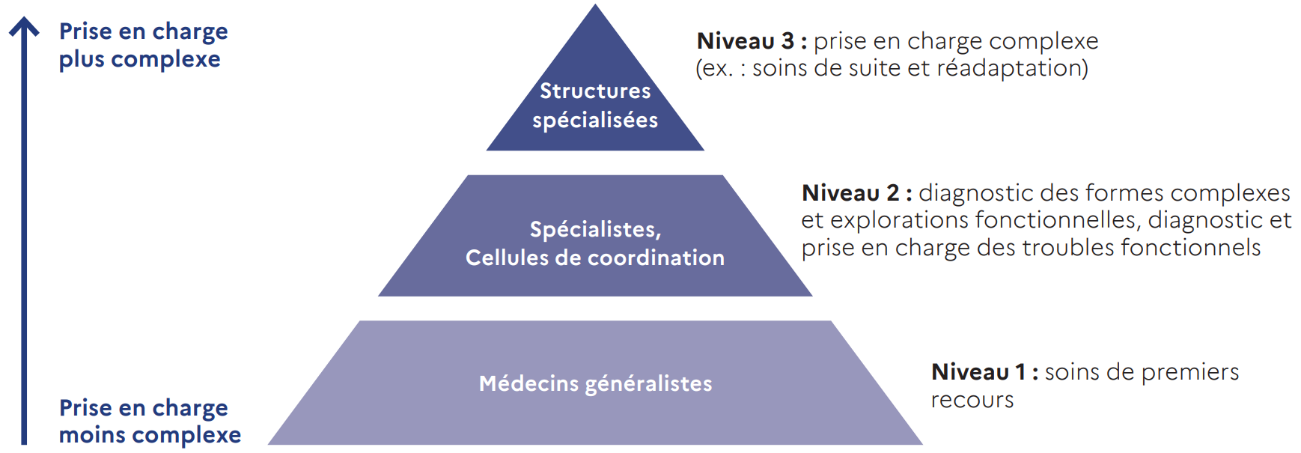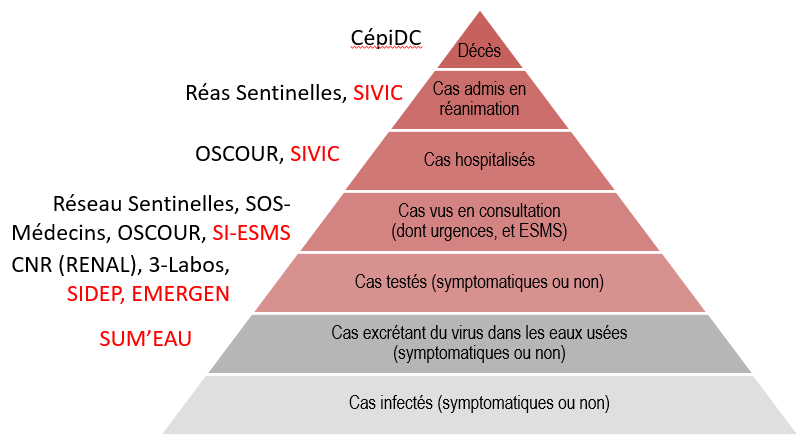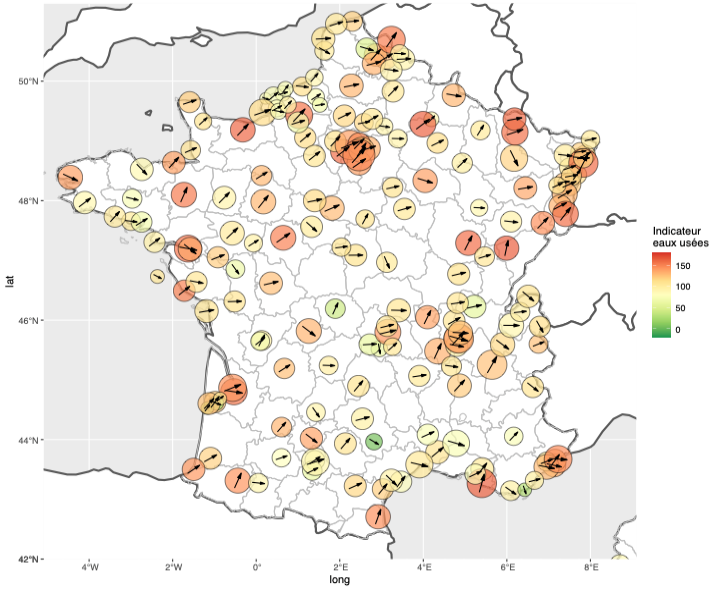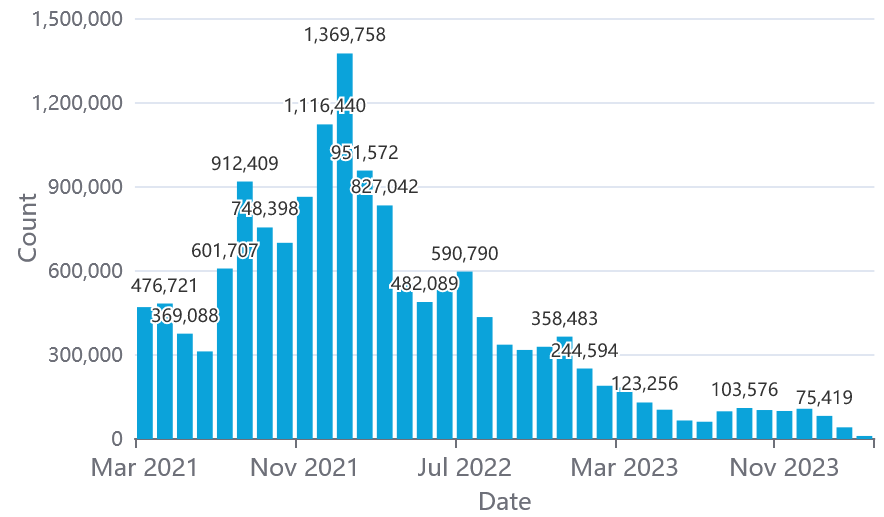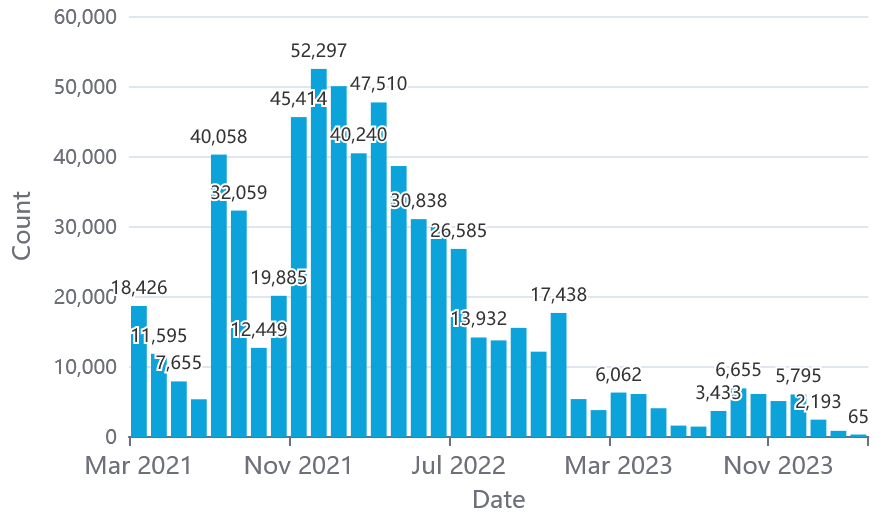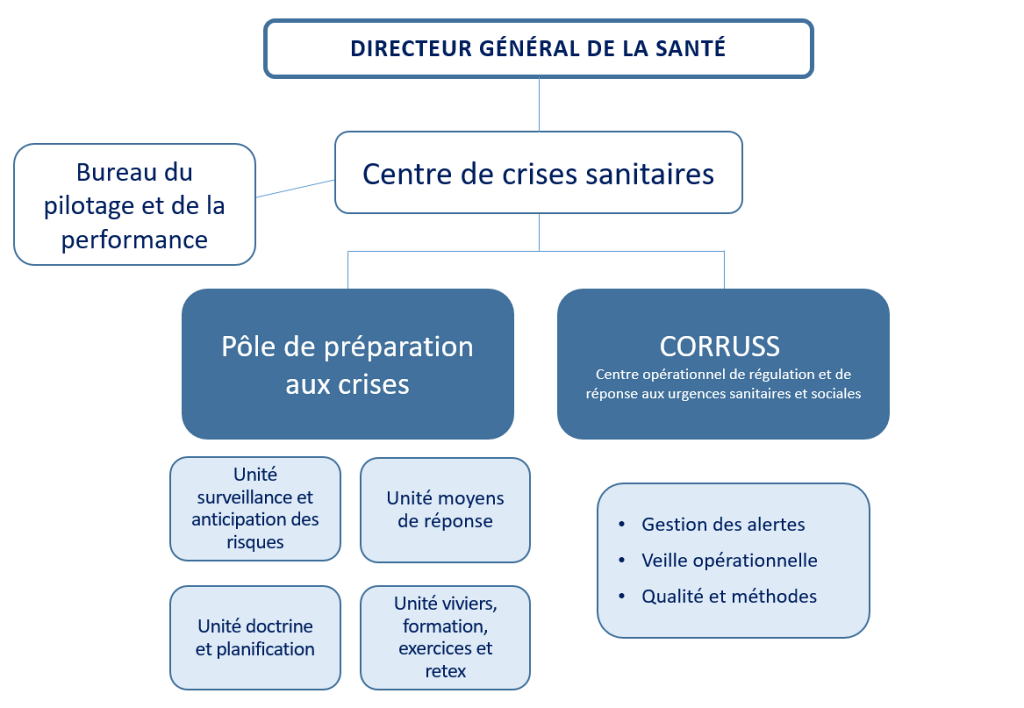- SYNTHÈSE
- LISTE DES RECOMMANDATIONS
- AVANT-PROPOS
- PREMIÈRE PARTIE
LES EFFETS INDÉSIRABLES DES VACCINS CONTRE LA COVID-19 ET LE SYSTÈME DE PHARMACOVIGILANCE FRANÇAIS
- I. INTRODUCTION
- II. ÉVOLUTION DE LA STRATÉGIE
VACCINALE ET DE LA PHARMACOVIGILANCE DEPUIS JUIN 2022
- III. EFFETS INDÉSIRABLES ASSOCIÉS AUX
VACCINS NOUVELLEMENT UTILISÉS DEPUIS L'AUTOMNE 2022
- IV. POINT SUR CERTAINS EFFETS INDÉSIRABLES
ÉTABLIS OU SUSPECTÉS PRÉCÉDEMMENT MIS EN EXERGUE
PAR L'OFFICE
- V. POINT SUR CERTAINS SOUS-GROUPES DE LA
POPULATION
- VI. LE SYSTÈME DE PHARMACOVIGILANCE DANS LE
CADRE DE LA CAMPAGNE VACCINALE
- VII. IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA
PERCEPTION DES VACCINS PAR LA POPULATION
- VIII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
- I. INTRODUCTION
- DEUXIÈME PARTIE
LE COVID LONG
- I. INTRODUCTION
- II. UNE DÉFINITION NON HARMONISÉE ET
UN DIAGNOSTIC TOUJOURS DIFFICILE
- III. UNE ÉPIDÉMIOLOGIE QUI RESTE MAL
CONNUE
- A. DES DIFFICULTÉS
MÉTHODOLOGIQUES
- B. DES RÉSULTATS DIVERGENTS
- C. DES FACTEURS DE RISQUE QUI DIFFÈRENT DE
CEUX DE LA PHASE INITIALE DE LA MALADIE
- D. UNE ÉVOLUTION DE LA PRÉVALENCE
AVEC LA SUCCESSION DES VARIANTS ET LE DÉVELOPPEMENT DE
L'IMMUNITÉ
- E. UNE PROTECTION FOURNIE PAR LES TRAITEMENTS
PRÉVENTIFS
- A. DES DIFFICULTÉS
MÉTHODOLOGIQUES
- IV. UN TABLEAU CLINIQUE COMPLEXE DONT
L'ÉVOLUTION RESTE INCERTAINE
- V. UNE ORIGINE DE LA MALADIE QUI RESTE À
DÉTERMINER
- VI. UNE PRISE EN CHARGE À PARFAIRE
- VII. DES CONSÉQUENCES IMPORTANTES SUR LA
VIE DES PATIENTS
- VIII. UNE RECHERCHE QUI DOIT ÊTRE
SOUTENUE
- IX. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
- I. INTRODUCTION
- TROISIÈME PARTIE
LES NOUVEAUX OUTILS DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET D'ANTICIPATION SANITAIRE
- I. INTRODUCTION
- II. LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE
ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET SON ÉVOLUTION FACE À LA
COVID-19
- III. DE NOUVELLES STRUCTURES POUR FAIRE FACE AUX
CRISES SANITAIRES
- IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
- I. INTRODUCTION
- QUATRIÈME PARTIE
LA DÉSINFORMATION EN SANTÉ
- I. INTRODUCTION
- II. LES RÉSEAUX SOCIAUX À LA SOURCE
DU PROBLÈME ?
- A. UNE NOUVELLE MODALITÉ DE
DÉSINFORMATION
- B. UN RÔLE DES RÉSEAUX SOCIAUX
TOUTEFOIS RELATIVISÉ
- 1. Un regard nuancé sur le rôle des
réseaux sociaux dans la diffusion et le partage des fausses
informations
- 2. Une contribution relativement limitée
des fausses informations pour l'information du public
- 3. Des acteurs qui peinent à élargir
leur cible
- 4. Un recul critique qui limite la portée
des fausses informations
- 1. Un regard nuancé sur le rôle des
réseaux sociaux dans la diffusion et le partage des fausses
informations
- C. UN IMPACT À REPLACER DANS UN
ÉCOSYSTÈME PLUS LARGE
- A. UNE NOUVELLE MODALITÉ DE
DÉSINFORMATION
- III. LES MOTEURS À L'ORIGINE DES FAUSSES
CROYANCES
- IV. COMMENT FAIRE FACE À LA
MÉSINFORMATION ET À LA DÉSINFORMATION ?
- A. LA CONSTRUCTION D'UNE INFORMATION ACCESSIBLE ET
DE QUALITÉ, DÉLIVRÉE PAR DES MESSAGES
ADAPTÉS
- B. UNE ACTION VIGOUREUSE POUR PROMOUVOIR LES
CULTURES SCIENTIFIQUE ET SANITAIRE
- C. DES ACTIONS EN DIRECTION DES RÉSEAUX
SOCIAUX
- D. BÂTIR LA CONFIANCE DE LA
POPULATION
- E. UN TRAVAIL DE RECHERCHE
NÉCESSAIRE
- A. LA CONSTRUCTION D'UNE INFORMATION ACCESSIBLE ET
DE QUALITÉ, DÉLIVRÉE PAR DES MESSAGES
ADAPTÉS
- V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
- I. INTRODUCTION
- EXAMEN DU RAPPORT PAR L'OFFICE
- LISTE DES SIGLES
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
|
N° 2707 |
N° 651 |
|
|
ASSEMBLÉE NATIONALE |
SÉNAT |
|
|
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 SEIZIÈME LÉGISLATURE |
SESSION ORDINAIRE 2023 - 2024 |
|
|
Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale |
Enregistré à la présidence du Sénat |
|
|
le 30 mai 2024 |
le 30 mai 2024 |
RAPPORT
au nom de
L'OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
sur
les effets indésirables des vaccins et les
dernières évolutions
des connaissances scientifiques sur la
covid-19
par
MM. Philippe BERTA et Gérard LESEUL,
députés,
et Mmes Sonia de LA PROVÔTÉ et Florence
LASSARADE, sénatrices
|
Déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale par M. Pierre HENRIET, Premier vice-président de l'Office |
Déposé sur le Bureau du Sénat par M. Stéphane PIEDNOIR, Président de l'Office |
Composition de l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques
et technologiques
Président
M. Stéphane PIEDNOIR, sénateur
Premier vice-président
M. Pierre HENRIET, député
Vice-présidents
|
M. Jean-Luc FUGIT, député M. Victor HABERT-DASSAULT, député M. Gérard LESEUL député |
Mme Florence LASSARADE, sénatrice Mme Anne-Catherine LOISIER, sénatrice M. David ROS, sénateur |
|
DÉPUTÉS |
SÉNATEURS |
|
Mme Christine ARRIGHI M. Philippe BERTA M. Philippe BOLO Mme Maud BREGEON M. Hendrik DAVI Mme Olga GIVERNET M. Maxime LAISNEY M. Aurélien LOPEZ-LIGUORI M. Yannick NEUDER M. Jean-François PORTARRIEU Mme Mereana REID ARBELOT M. Alexandre SABATOU M. Jean-Philippe TANGUY Mme Huguette TIEGNA |
M. Arnaud BAZIN Mme Martine BERTHET Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP M. Patrick CHAIZE M. André GUIOL M. Ludovic HAYE M. Olivier HENNO Mme Sonia de LA PROVÔTÉ M. Pierre MÉDEVIELLE Mme Corinne NARASSIGUIN M. Pierre OUZOULIAS M. Daniel SALMON M. Bruno SIDO M. Michaël WEBER |
SYNTHÈSE
Saisi en février 2022 par la Commission des affaires sociales du Sénat d'une étude sur les effets indésirables des vaccins contre la covid-19 et le système de pharmacovigilance français, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a adopté le 9 juin 2022 un rapport d'étape établissant une première analyse du sujet sur la base des éléments scientifiques alors disponibles1(*).
Lors de sa réunion du 26 octobre 2023, le bureau de l'Office a confié à quatre rapporteurs le soin d'établir un rapport conclusif, incluant notamment les éléments nouveaux ayant pu émerger sur la covid-19. Les rapporteurs ont décidé d'aborder quatre thématiques : les effets indésirables des vaccins, l'évolution des connaissances sur le covid long, les nouveaux outils de surveillance épidémiologique et d'anticipation sanitaire, et la désinformation en santé. Chaque partie comporte des éléments recueillis dans le cadre d'une revue de la littérature scientifique et d'auditions ayant permis d'entendre de nombreux spécialistes. Comme à son habitude, l'Office en tire des enseignements et effectue une série de recommandations.
I. LES EFFETS INDÉSIRABLES DES VACCINS CONTRE LA COVID-19
L'ÉVOLUTION DE LA STRATÉGIE VACCINALE DEPUIS JUIN 2022
Grâce à la démonstration de leur efficacité et de leur sécurité, les vaccins contre la covid-19 disponibles lors de la rédaction du rapport d'étape de l'Office en juin 2022 ont vu leur autorisation de mise sur le marché conditionnelle convertie en autorisation standard. Comme l'a montré une étude française, la disponibilité rapide de ces vaccins - notamment liée à l'utilisation de la procédure conditionnelle - a permis de sauver un nombre considérable de vies.
En parallèle, de nouvelles versions de certains de ces vaccins - Comirnaty, Spikevax et Nuvaxovid -, adaptées aux souches circulantes de la covid-19, ont été approuvées par l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour permettre une meilleure protection de la population face à l'évolution du virus. Enfin, de nouveaux vaccins, développés par les laboratoires Valneva, Sanofi-GSK et Hipra, ont également été autorisés.
Si la période pandémique est aujourd'hui révolue et le virus ne fait plus l'actualité, ce dernier continue de circuler et de faire de nouvelles victimes, rendant essentiel le maintien d'une certaine couverture vaccinale. L'évolution du virus et l'amélioration des connaissances sur l'efficacité vaccinale se sont toutefois traduites par plusieurs évolutions de la stratégie vaccinale, aujourd'hui entrée dans un processus de normalisation. La primovaccination en population générale n'est plus recommandée et seules les personnes âgées et à risque de formes graves sont invitées à se faire administrer une dose de rappel annuelle (ou biannuelle, pour les plus vulnérables). La Haute Autorité de santé recommande l'utilisation d'un vaccin adapté aux dernières souches circulantes du SARS-CoV-2, de préférence à ARNm ou, en seconde intention, avec le vaccin Nuvaxovid pour les personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas en bénéficier en raison d'une contre-indication.
La poursuite de la campagne vaccinale et l'introduction de ces nouveaux vaccins ont naturellement continué d'être accompagnées par la collecte et l'évaluation régulière par les autorités sanitaires de l'ensemble des déclarations d'événements indésirables survenus après ces vaccinations. Toutefois, en raison d'un rythme de vaccination désormais plus faible, ne justifiant plus un dispositif renforcé, la surveillance est elle aussi entrée dans un processus de normalisation et est aujourd'hui réalisée comme pour les autres médicaments.
L'ÉVOLUTION DES CONNAISSANCES SUR LES EFFETS INDÉSIRABLES
Comme cela était souligné dans le rapport de l'Office de juin 2022, l'importance de la campagne de vaccination - plus de 13,5 milliards de doses administrées dans le monde à ce jour - a permis de disposer d'un nombre de données sans précédent pour évaluer le profil de sécurité des vaccins contre la covid-19.
Depuis l'adoption du rapport d'étape de l'Office, les travaux menés par les organismes de pharmacovigilance et de pharmaco-épidémiologie des différents pays ont entraîné quelques ajouts aux listes des effets indésirables des différents vaccins, sans toutefois impacter leur balance bénéfices/risques. Les principales évolutions concernent l'ajout des saignements menstruels abondants - de nature temporaire et sans gravité dans leur grande majorité - pour les vaccins Comirnaty et Novavax, ainsi que les myocardites et péricardites - déjà identifiées comme effets indésirables des vaccins à ARNm - pour les vaccins Nuvaxovid et Jcovden. Différents signaux potentiels restent surveillés par les autorités sanitaires.
Aucun signal de pharmacovigilance n'a émergé auprès des autorités françaises en lien avec le vaccin VidPrevtyn Beta de Sanofi-GSK, qui n'a été que très peu utilisé et ne l'est plus aujourd'hui, limitant le recul disponible. Le profil de sécurité des vaccins adaptés aux souches circulantes du SARS-CoV-2, qu'ils soient mono- ou bivalents, n'a pas montré de différence par rapport à celui des vaccins originaux dont ils sont issus.
La surveillance des vaccins en vie réelle a permis d'acquérir des données sur des populations généralement exclues des essais cliniques. Plusieurs études ont par exemple montré la bonne tolérance de ces différents vaccins chez les femmes enceintes, les enfants ou les personnes vulnérables.
L'ADAPTATION DU SYSTÈME DE PHARMACOVIGILANCE
Le développement des vaccins contre la covid-19 en un temps record a été une véritable prouesse. La performance des systèmes de pharmacovigilance et de pharmaco-épidémiologie mondiaux doit également être soulignée. Ils ont permis d'accompagner cette campagne de vaccination sans précédent, en évaluant les risques associés et en permettant, le cas échéant, l'adaptation rapide des recommandations vaccinales. Le système français s'est notamment distingué avec l'identification de nombreux signaux potentiels.
Outre ce succès, la mise en lumière du travail de suivi des vaccins a produit des bénéfices indirects pour la pharmacovigilance, aujourd'hui plus sollicitée par les professionnels de santé libéraux et dont les concepts sont mieux compris par la population.
Ces résultats ne doivent toutefois pas masquer les difficultés auxquelles font face les structures chargées de cette surveillance. Ils doivent, au contraire, constituer une invitation à les conforter, notamment par l'attribution de moyens humains et financiers à la hauteur de leur activité et de l'importance de leur mission pour la protection de la santé publique. Un affaiblissement de ces structures risquerait d'amoindrir la confiance du public dans les médicaments et ferait courir un véritable risque en cas de nouvelle crise sanitaire. Les efforts permettant d'améliorer la quantité et la qualité des déclarations doivent également être poursuivis pour permettre d'identifier le plus précocement possible les signaux de pharmacovigilance.
L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA VACCINATION
Malgré les réserves de la population française à l'égard des vaccins, la campagne de vaccination contre la covid-19 a globalement été un succès. Récemment toutefois, on a noté une érosion de l'adhésion aux campagnes de rappel, probablement liée à une sous-estimation des risques encore représentés par le SARS-CoV-2. Bien que l'adhésion vaccinale soit restée stable au cours de la pandémie, elle demeure un sujet de préoccupation, comme le montre le faible succès de la récente campagne de vaccination contre le HPV.
Comme le soulignait le rapport de l'Office de juin 2022, la communication autour des vaccins contre la covid-19 a souffert de diverses insuffisances. Si des rapports réguliers et détaillés ont bien été publiés par le système de pharmacovigilance, la diffusion de ces informations vers le grand public, au travers d'une communication adaptée et efficace permettant une bonne appropriation des messages sanitaires, a fait défaut. Il est en conséquence important de tirer les enseignements de ces échecs et de repenser la communication autour des campagnes vaccinales et des médicaments, en construisant une communication claire, lisible et pédagogique, permettant une bonne appréhension de la balance bénéfices/risques par la population.
RECOMMANDATIONS
- Poursuivre la surveillance des vaccins contre la covid 19.
- Organiser le dispositif de surveillance de façon à pouvoir le renforcer lors de la mise sur le marché de médicaments innovants susceptibles d'entraîner des craintes excessives parmi la population ou un risque important d'effets indésirables.
- Poursuivre la démarche d'amélioration de la quantité et de la qualité des déclarations de pharmacovigilance afin d'optimiser la détection des signaux, en sensibilisant les professionnels de santé et la population à l'intérêt de la pharmacovigilance.
- Maintenir l'organisation actuelle du réseau des CRPV et d'EPI-PHARE et les doter de moyens suffisants pour mener leurs missions et répondre avec efficacité à une prochaine crise.
- Améliorer la communication sur les effets indésirables, qui doit être claire, lisible et pédagogique, afin de permettre une appréciation juste de la balance bénéfices/risques des médicaments par la population. Mener des campagnes de communication destinées aux personnes hésitantes, en analysant leurs besoins et attentes. Parallèlement, lutter contre les fausses informations.
- Expliquer de manière pédagogique les éventuelles évolutions des stratégies vaccinales afin de permettre leur bonne compréhension et garantir leur acceptabilité.
II. LE COVID LONG
Dès les premiers cas de covid-19, de nombreux patients ont témoigné de symptômes persistants après la phase aiguë de la maladie. Malgré un impact significatif en termes de santé publique, du fait de symptômes parfois handicapants et d'une prévalence importante, une attention relativement faible a été portée à cette condition, qualifiée de covid long.
Plus de quatre ans après l'émergence de la covid-19, et alors qu'il s'est déjà intéressé à cette problématique à deux reprises, l'Office a souhaité faire un point sur l'évolution des connaissances concernant cette maladie, son suivi et sa prise en charge.
UN DIAGNOSTIC DIFFICILE
Un des premiers constats est que le covid long demeure, aujourd'hui encore, une affection mal comprise ne bénéficiant pas d'une définition harmonisée. Faute de l'identification d'un symptôme ou d'un marqueur spécifique, le diagnostic continue de reposer sur un processus différentiel. La complexité de cette démarche associée à la méconnaissance de cette maladie induit, encore trop souvent, une prise en charge retardée et un sous-diagnostic.
UNE ÉPIDÉMIOLOGIE MAL CONNUE
Cette absence de définition et ces difficultés de diagnostic rendent particulièrement complexe l'acquisition de connaissances sur les dimensions épidémiologiques, physiopathologiques, thérapeutiques, médico-économiques et sociales de cette maladie, qui continue de faire l'objet de nombreuses interrogations. En effet, les travaux de recherche utilisent des méthodologies et des définitions du covid long qui peuvent varier, notamment en lien avec la documentation de l'infection, les symptômes et la temporalité postérieure à la phase aiguë, et ainsi aboutir à des résultats divergents.
Il en résulte d'importantes incertitudes sur la prévalence de la maladie, en raison d'une grande variabilité des données. Il est toutefois généralement estimé que celle-ci touche, chez les adultes, entre 10 et 30 % des cas non hospitalisés et entre 50 et 70 % des cas hospitalisés. Chez les enfants et adolescents, bien que les données soient moins nombreuses et sans doute impactées par un fort sous-diagnostic, les dernières études suggèrent des proportions similaires.
Si dans la majorité des cas l'état des patients semble s'améliorer au cours du temps, avec une diminution de la prévalence et de l'intensité des symptômes, la dynamique de cette évolution et les facteurs sous-jacents demeurent encore largement méconnus. Le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars), considère qu'en France plusieurs centaines de milliers de personnes seraient actuellement affectées dans leur quotidien par cette maladie.
Avec l'évolution de la pandémie, la prévalence de cette maladie aurait cependant baissé, potentiellement en raison des caractéristiques intrinsèques des nouveaux variants, moins pourvoyeurs de covid long, et de l'immunité accrue de la population, acquise par infection ou par vaccination.
DES SYMPTÔMES DIVERS
Les travaux de recherche ont permis d'identifier plus de 200 symptômes potentiels associés à cette maladie. Ils touchent de très nombreux organes, sont relativement hétérogènes selon les patients et caractérisés par une grande fluctuation dans le temps. La sévérité de la phase aiguë de la maladie (nombre et intensité des symptômes, nécessité d'une hospitalisation ou de soins intensifs), un indice de masse corporelle élevé, le tabagisme, des pathologies préexistantes (notamment les maladies pulmonaires chroniques) ou des prédispositions (terrain allergique ou auto-immun) et le sexe sont apparus comme des facteurs de risque significatifs du covid long.
UNE ORIGINE DE LA MALADIE ENCORE INCONNUE
Malgré de nombreuses recherches, le mécanisme à l'origine du covid long reste aujourd'hui inconnu et diverses hypothèses continuent d'être explorées. Toutefois, l'explication « somatoforme », c'est-à-dire celle d'une maladie qui résulterait d'une psychosomatisation, semble aujourd'hui récusée par une majeure partie de la communauté scientifique.
Cette absence de compréhension du mécanisme ne permet pas d'identifier une cible thérapeutique et rend plus complexe le développement de traitements curatifs, qui continuent de faire défaut malgré plusieurs essais cliniques en cours. Aussi, la stratégie thérapeutique recommandée par la Haute Autorité de santé vise à prendre en charge les conséquences cliniques, physiques et psychologiques de la maladie, tout en l'adaptant aux besoins de chaque patient. Elle repose sur quatre axes : des traitements symptomatiques pour atténuer les symptômes qui peuvent l'être, une éducation des patients afin qu'ils puissent adapter leurs activités et leur environnement en fonction de leurs symptômes, une approche rééducative dans les différents domaines fonctionnels touchés par la maladie et une prise en charge des troubles anxieux et dépressifs pour les patients qui le nécessitent.
UNE PRISE EN CHARGE À PARFAIRE
Si un effort de structuration de l'offre de soins a été entrepris, avec la définition de plusieurs niveaux de prise en charge assistés par des cellules de coordination, les parcours de soins restent dans de nombreux cas mal organisés, avec une offre trop peu lisible, tant pour les patients que pour les professionnels de santé, dont la formation et l'information sur cette nouvelle maladie sont insuffisantes. Cette situation entraîne un manque de reconnaissance des souffrances rencontrées par les patients et une certaine errance médicale, qui génèrent des sentiments d'abandon et de stigmatisation.
Le covid long s'accompagne également parfois de conséquences invalidantes pour la vie quotidienne des personnes qui en sont atteintes, avec non seulement un impact individuel et familial mais aussi des répercussions sur la vie professionnelle. Les études menées chez les enfants et adolescents suggèrent également des conséquences du point de vue scolaire. Aussi, les médecins du travail et scolaires ont un rôle crucial à jouer pour accompagner ces patients afin d'éviter toute désinsertion sociale et précarisation. En parallèle, des dispositifs de prise en charge sanitaire et sociale adaptés et facilement accessibles doivent être mis en place.
Alors que l'attention de la société se détourne peu à peu de la covid-19, il paraît impératif de continuer à se pencher sérieusement sur le covid long, dont l'étude et la prise en charge ont été trop souvent négligées. Deux ans après la publication de son dernier rapport, l'Office constate que les quatre leviers qu'il avait identifiés - un parcours de soins organisé et structuré, une formation et un accompagnement des professionnels de santé, une information pour les patients et des dispositifs de reconnaissance adaptés - restent prioritaires. Outre l'évidente nécessité de campagnes d'information à destination des communautés médicale et paramédicale, concernant la prise en charge et l'accompagnement des patients, il est essentiel de sensibiliser l'ensemble de la population à la réalité du covid long et aux risques et difficultés qu'il entraine, afin d'éviter toute discrimination des patients touchés et de mettre en place une démarche de prévention.
Les recherches sur le covid long doivent également être poursuivies et encouragées afin de pouvoir mieux le comprendre, le suivre et le traiter.
RECOMMANDATIONS
- Développer et harmoniser les parcours de soins pour covid long sur l'ensemble du territoire.
- Mettre en place la plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19, prévue par la loi du 24 janvier 2022.
- Former et informer les professionnels médicaux et paramédicaux sur le covid long et sur les méthodes de diagnostic et de prise en charge médicale et sociale. Renforcer le rôle des cellules de coordination post-covid pour l'accompagnement des soignants.
- Créer une ALD et un tableau de maladie professionnelle spécifiques pour les formes prolongées de la covid-19, afin de favoriser leur prise en charge sanitaire et sociale.
- Mener une campagne nationale d'information, de sensibilisation et de prévention sur le covid long.
- Poursuivre les recherches transdisciplinaires sur cette maladie, en finançant notamment de nouveaux appels à projets dédiés.
III. LES NOUVEAUX OUTILS DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET D'ANTICIPATION SANITAIRE
La gestion de la crise sanitaire de la covid-19 a entraîné une mobilisation scientifique mondiale sans précédent, aboutissant à une série d'innovations venues en soutien des mesures de santé publique, notamment dans le domaine de la surveillance épidémiologique.
La surveillance épidémiologique vise à suivre l'émergence et l'évolution spatio-temporelle des épidémies et des problèmes de santé, ainsi qu'à acquérir des connaissances sur leurs caractéristiques. Elle repose sur un ensemble d'indicateurs permettant de dresser une image globale de la situation sanitaire et d'anticiper les risques à venir. Elle s'est donc avérée déterminante dans la lutte contre le virus, pour suivre et contenir sa propagation, grâce à la mise en oeuvre et à l'évaluation de mesures d'alerte, de prévention et de contrôle appropriées.
DE NOUVEAUX FICHIERS
Dans le cadre de la covid-19, de nouveaux fichiers ont été mis en place - ou adaptés - afin de suivre la propagation du virus, son impact hospitalier et la couverture vaccinale - au travers des fichiers SI-DEP (système d'information national de suivi du dépistage), SI-VIC (système d'information pour le suivi des victimes) et SI-VAC (système d'information sur les vaccinations covid-19) - ainsi que pour suivre les chaînes de contamination, grâce au fichier Contact-Covid.
La phase aiguë de la pandémie étant aujourd'hui révolue, certains de ces systèmes ont été interrompus tandis que d'autres ont évolué afin de s'adapter à la situation sanitaire actuelle. Ainsi, une plateforme simplifiée néoSI-DEP a vu le jour en 2023, dans l'attente d'un système plus exhaustif - Laboé-SI - qui permettra de suivre un plus grand nombre de maladies et aura une forme évolutive pour pouvoir s'adapter aux crises sanitaires futures. De la même manière, le projet Orchidée (Organisation d'un réseau de centres hospitaliers impliqués dans la surveillance épidémiologique et la réponse aux émergences) instaurera un outil tirant les leçons des limites et imperfections du fichier SI-VIC pour la remontée des données hospitalières, en ne les limitant pas à la covid-19.
LA SURVEILLANCE VIA LES EAUX USÉES
Une autre innovation importante en termes de surveillance épidémiologique développée au cours de la pandémie est l'utilisation de méthodes de suivi à partir des eaux usées. Cette technique avait été développée antérieurement à la crise mais, pour la première fois, des dispositifs ont été déployés à une large échelle. Cet outil fournit un nouvel indicateur permettant de détecter les tendances épidémiques de manière précoce, en comparaison des données plus classiquement utilisées, et de suivre la population à un coût réduit et indépendamment de son état de santé et de la stratégie de dépistage mise en oeuvre. Toutefois, en l'état actuel des connaissances, il reste difficile d'estimer le nombre de personnes infectées sur la seule base des concentrations virales détectées dans les eaux usées.
En France, dès le début de la crise sanitaire, le consortium Obépine a mené des travaux de recherche et démontré les opportunités que représentait cet outil pour suivre l'épidémie de manière quantitative et dans une temporalité pertinente pour une approche de surveillance épidémiologique. Soutenu financièrement par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ce consortium a pu exploiter de manière expérimentale un réseau de surveillance reposant sur plus de 200 stations pendant plus d'un an.
Aujourd'hui, un dispositif pérenne, dénommé SUM'Eau, porté par Santé publique France et l'Anses, est chargé de la surveillance microbiologique des eaux usées. Opérationnel depuis octobre 2023, ce système doit encore connaître plusieurs phases de développement. Il ne s'appuie en effet actuellement que sur 12 stations de traitement des eaux usées et ne permet pas encore de séquencer les échantillons prélevés pour suivre les variants en circulation.
Au regard des connaissances acquises au cours de la crise et des perspectives en termes de surveillance épidémiologique, il apparaît essentiel de continuer à soutenir et à perfectionner les dispositifs de suivi des eaux usées. Alors que le nombre de tests de dépistage est aujourd'hui relativement faible, cette méthode apparaît plus pertinente que jamais pour surveiller et anticiper la propagation du SARS-CoV-2. Son extension à d'autres maladies ou problèmes de santé pourrait également apporter des bénéfices importants. Dans ces perspectives, la construction d'une plateforme de recherche et d'innovation Obépine+, destinée à soutenir les réseaux de surveillance à partir des eaux usées, en développant, validant et assurant le transfert rapide de méthodes performantes, doit être soutenue.
LA SURVEILLANCE GÉNOMIQUE
La surveillance génomique a pour objet de suivre l'évolution du virus et, ainsi, d'anticiper les conséquences associées à ses mutations. Un développement important des capacités de séquençage a été entrepris pendant la crise sanitaire. La création du consortium Emergen, en janvier 2021, a permis d'identifier l'émergence de nouveaux variants et la répartition relative des différents variants circulant sur le territoire français. Ce consortium a adapté ses activités au niveau actuel de circulation du virus. Il se prépare à évoluer, à l'instar des systèmes d'information, pour inclure de nouveaux agents pathogènes susceptibles de représenter de futures menaces pandémiques.
Les différents outils dont le développement a été catalysé par la crise sanitaire permettent donc de continuer à suivre le SARS-CoV-2, afin d'anticiper les risques qu'il est encore susceptible de représenter, mais également de renforcer le système de surveillance épidémiologique, en bénéficiant au suivi d'autres pathologies et aux éventuelles futures menaces sanitaires.
DE NOUVELLES STRUCTURES
Parallèlement, en mettant en lumière les lacunes de notre capacité de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, des leçons ont également pu être tirées de la crise sur le plan organisationnel. De nouvelles structures ont ainsi été créées : en France, un Centre de crises sanitaires a été institué au sein de la direction générale de la santé, tandis que l'Union européenne a créé une Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA).
Ces démarches de retours d'expérience, tant sur le plan sanitaire que politique et organisationnel, doivent être encouragées et poursuivies. Face au risque d'émergence ou de réémergence de divers virus qui pèse sur notre société, il apparaît crucial de tirer toutes les leçons des échecs et des succès de notre gestion de la pandémie. La période post-pandémique doit être utilisée pour réévaluer notre organisation et accroître nos efforts en matière d'anticipation et de préparation, afin d'être capables de répondre rapidement et avec résilience aux crises futures, dont l'origine est aujourd'hui imprévisible.
LE RÔLE DE LA RECHERCHE
La recherche, qui s'est avérée cruciale dans la réponse à la crise sanitaire, doit faire l'objet d'un soutien public important. Les principaux axes des travaux à mener concernent les menaces susceptibles d'entraîner des crises sanitaires majeures, les facteurs d'émergence de ces crises, les solutions de prévention qui doivent être encouragées, ainsi que les mesures et contre-mesures médicales à mettre en place pour y faire face.
RECOMMANDATIONS
- Maintenir une surveillance approfondie du SARS-CoV-2 pour anticiper les risques qui pourraient résulter de sa circulation persistante.
- Définir et déployer une stratégie de recherche sur les menaces sanitaires, fondée sur le continuum fondamental/appliqué, afin de disposer des outils et connaissances permettant d'y répondre rapidement et efficacement.
- Renforcer le système de surveillance pour pouvoir détecter précocement et suivre l'évolution de toute menace sanitaire ; veiller à ce que ce système reste étroitement articulé avec l'effort de recherche sur les outils de surveillance développés au cours de la crise.
- Poursuivre le retour d'expérience sur la crise de la covid 19 et investir pour améliorer les capacités d'anticipation, de préparation et de réponse aux futures crises sanitaires.
IV. LA DÉSINFORMATION EN SANTÉ
L'émergence de maladies nouvelles et le développement de crises sanitaires, marquées, d'une part, par un déficit d'informations fiables, d'autre part, par un sentiment d'anxiété de la population, sont particulièrement propices à la circulation de fausses informations. La pandémie de covid-19 n'y a pas fait exception, générant, comme l'a indiqué l'OMS, une « infodémie », c'est-à-dire une surabondance d'informations rendant difficile l'identification de sources fiables.
Cette situation a nui à la compréhension et à l'adoption des mesures sanitaires, affectant ainsi la santé publique. Aussi, rapidement, les fausses informations sont apparues, à l'instar du virus, comme un ennemi contre lequel il était nécessaire de lutter.
LE RÔLE DES RÉSEAUX SOCIAUX
Au cours des dernières années, l'essor des technologies de l'information et de la communication a profondément modifié les mécanismes de production, de diffusion et de consommation de l'information et notamment engendré une surcharge informationnelle. En permettant à tout un chacun de s'exprimer avec une liberté quasi totale, les réseaux sociaux contribuent à cette cacophonie et fournissent un mode d'expression aux désinformateurs, qui n'avaient jusqu'alors que peu voix au chapitre. S'emparant particulièrement de cette opportunité, ces derniers sont à l'origine d'une part importante du contenu disponible sur ces réseaux, ce qui leur permet de bénéficier d'une visibilité et d'un pouvoir d'influence disproportionnés au regard de leur légitimité.
Cette surexpression des désinformateurs est accentuée par l'éditorialisation des contenus effectuée par les plateformes qui privilégient les contenus sensationnels et clivants, plus à même de créer de l'engagement parmi leurs utilisateurs. Les réseaux sociaux agissent alors comme un miroir déformant qui renforce la visibilité d'individus aux positions extrêmes, pourtant peu représentatifs de la société dans son ensemble.
Enfin, en proposant principalement des contenus en accord avec nos préférences individuelles, les algorithmes des réseaux sociaux ne permettent pas la confrontation des idées et la remise en question critique des informations rencontrées mais sont, au contraire, susceptibles d'enfermer les utilisateurs dans des bulles numériques qui peuvent laisser croire à l'existence d'un consensus et agissent comme des chambres d'écho idéologiques.
Les réseaux sociaux ont donc probablement contribué à la désinformation pendant la crise sanitaire. Mais s'il est indubitable que les fausses informations peuvent y être relativement répandues sur certaines thématiques liées à la santé, celles-ci peinent généralement à atteindre un large public et touchent principalement des personnes déjà convaincues ou enclines à les accepter. Aussi, les fausses informations ne représenteraient in fine qu'une faible part des informations consommées par les internautes, qui consultent principalement des sources fiables et conservent une bonne capacité de discernement à leur égard.
Aussi, si la contribution des réseaux sociaux à la désinformation est indéniable, il est nécessaire de nuancer le rôle que ceux-ci jouent réellement et de reconnaître l'implication d'autres acteurs, tels que les médias traditionnels et les autorités politiques, ainsi que l'importance d'autres facteurs, qui motivent l'adhésion à ces fausses informations.
LES MOTEURS À L'ORIGINE DES FAUSSES CROYANCES
En effet, plus que la circulation de fausses informations sur les réseaux sociaux, c'est la légitimation de ces discours par des acteurs bénéficiant d'une plus forte audience qui est susceptible d'avoir un impact important en termes de désinformation. Dans ce contexte, les médias traditionnels, les scientifiques et les professionnels de santé, qui bénéficient d'une forte confiance de la population, jouent un rôle important au travers de la parole qu'ils portent.
Les travaux de recherche portant sur la désinformation montrent que l'acceptation des fausses informations se bâtit sur un terreau alimenté par un déficit d'information et une méfiance envers les sources officielles. Le manque de connaissances scientifiques et médicales augmente la sensibilité aux fausses informations, également corrélée à la sensibilité aux croyances ésotériques et paranormales et aux médecines alternatives. Divers moteurs psychologiques, incluant des facteurs cognitifs et socio-affectifs, accroissent aussi la susceptibilité à la désinformation. Les désinformateurs instrumentalisent ces moteurs psychologiques en faisant appel à une certaine démagogie cognitive, en proposant des récits en accord avec les prédispositions individuelles naturelles et en mobilisant les facteurs et biais susceptibles d'encourager leur acceptation.
LA LUTTE CONTRE LA DÉSINFORMATION
Pour lutter contre la désinformation, il apparaît crucial de développer la communication scientifique et sanitaire à destination du plus grand nombre, en fournissant des informations à la fois claires, fiables et adaptées. Afin que cela puisse être suivi d'effet, il est important de construire une certaine confiance envers les institutions et les sources fiables d'information. La construction d'une telle confiance ne pouvant passer que par la diffusion d'une information de confiance, les acteurs influents en termes d'information, comme les scientifiques, les professionnels de santé, les médias et les décideurs politiques, doivent être formés afin de communiquer de manière pédagogique et rigoureuse les connaissances scientifiques.
Ces actions d'information doivent être déclinées, avec des messages différenciés, pour cibler les sous-groupes de population susceptibles d'être particulièrement touchés par les fausses informations et faire l'objet d'un portage au travers des médias et des réseaux sociaux. Les différentes plateformes doivent également être encouragées à mieux faire face à cette problématique, en modifiant leurs algorithmes, en modérant plus sévèrement leurs contenus et en sensibilisant à la littératie numérique.
Enfin, les actions d'information ne doivent pas s'inscrire uniquement en réaction aux fausses informations mais également inclure des actions préventives et de fond afin de former la population et la doter des outils lui permettant d'acquérir une plus grande résilience vis-à-vis des fausses informations. À cet effet, il est essentiel de renforcer la formation de la population à l'esprit critique, à travers l'éducation aux médias et à l'information, ainsi qu'à la littératie sanitaire et à la culture scientifique, à l'aide de politiques publiques claires et ambitieuses.
RECOMMANDATIONS
- Améliorer la communication scientifique. Développer des canaux fiables d'information en lien avec les organismes de recherche, les sociétés savantes et les Académies. Encourager la mise au point de supports pédagogiques clairs et d'initiatives destinées aux publics les plus susceptibles d'être touchés par les fausses informations. Fournir des informations fiables aux journalistes, acteurs clés dans l'information de la population.
- Former les scientifiques et les professionnels de santé à la communication scientifique vers le grand public et à la réponse aux fausses informations. Encourager et accompagner les volontaires à s'exprimer dans les médias, dans leur seul domaine d'expertise, à travers une approche rigoureusement scientifique.
- Lorsque des questions scientifiques apparaissent dans le débat public, encourager une communication politique transparente, pédagogique et clairement séparée de la communication scientifique.
- Mettre en place des politiques éducatives visant à promouvoir la culture scientifique et le sens critique à l'égard des médias et de l'information.
- Améliorer le traitement médiatique des sujets scientifiques et encourager les réseaux sociaux à mener des actions pour limiter la diffusion de fausses informations. Sanctionner les dérives susceptibles d'avoir des conséquences dommageables pour la santé publique.
- Encourager les recherches sur la mésinformation et la désinformation.
LISTE DES RECOMMANDATIONS
I. LES EFFETS INDÉSIRABLES DES VACCINS CONTRE LA COVID-19
1. Poursuivre la surveillance des vaccins contre la covid-19.
2. Organiser le dispositif de surveillance de façon à pouvoir le renforcer lors de la mise sur le marché de médicaments innovants susceptibles d'entraîner des craintes excessives parmi la population ou un risque important d'effets indésirables.
3. Poursuivre la démarche d'amélioration de la quantité et de la qualité des déclarations de pharmacovigilance afin d'optimiser la détection des signaux, en sensibilisant les professionnels de santé et la population à l'intérêt de la pharmacovigilance.
4. Maintenir l'organisation actuelle du réseau des CRPV et d'EPI-PHARE et les doter de moyens suffisants pour mener leurs missions et répondre avec efficacité à une prochaine crise.
5. Améliorer la communication sur les effets indésirables, qui doit être claire, lisible et pédagogique, afin de permettre une appréciation juste de la balance bénéfices/risques des médicaments par la population. Mener des campagnes de communication destinées aux personnes hésitantes, en analysant leurs besoins et attentes. Parallèlement, lutter contre les fausses informations.
6. Expliquer de manière pédagogique les éventuelles évolutions des stratégies vaccinales afin de permettre leur bonne compréhension et garantir leur acceptabilité.
II. LE COVID LONG
1. Développer et harmoniser les parcours de soins pour covid long sur l'ensemble du territoire.
2. Mettre en place la plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19, prévue par la loi du 24 janvier 2022.
3. Former et informer les professionnels médicaux et paramédicaux sur le covid long et sur les méthodes de diagnostic et de prise en charge médicale et sociale. Renforcer le rôle des cellules de coordination post-covid pour l'accompagnement des soignants.
4. Créer une ALD et un tableau de maladie professionnelle spécifiques pour les formes prolongées de la covid-19, afin de favoriser leur prise en charge sanitaire et sociale.
5. Mener une campagne nationale d'information, de sensibilisation et de prévention sur le covid long.
6. Poursuivre les recherches transdisciplinaires sur cette maladie, en finançant notamment de nouveaux appels à projets dédiés.
III. LES NOUVEAUX OUTILS DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET D'ANTICIPATION SANITAIRE
1. Maintenir une surveillance approfondie du SARS-CoV-2 pour anticiper les risques qui pourraient résulter de sa circulation persistante.
2. Définir et déployer une stratégie de recherche sur les menaces sanitaires, fondée sur le continuum fondamental/appliqué, afin de disposer des outils et connaissances permettant d'y répondre rapidement et efficacement.
3. Renforcer le système de surveillance pour pouvoir détecter précocement et suivre l'évolution de toute menace sanitaire ; veiller à ce que ce système reste étroitement articulé avec l'effort de recherche sur les outils de surveillance développés au cours de la crise.
4. Poursuivre le retour d'expérience sur la crise de la covid-19 et investir pour améliorer les capacités d'anticipation, de préparation et de réponse aux futures crises sanitaires.
IV. LA DÉSINFORMATION EN SANTÉ
1. Améliorer la communication scientifique. Développer des canaux fiables d'information en lien avec les organismes de recherche, les sociétés savantes et les Académies. Encourager la mise au point de supports pédagogiques clairs et d'initiatives destinées aux publics les plus susceptibles d'être touchés par les fausses informations. Fournir des informations fiables aux journalistes, acteurs clés dans l'information de la population.
2. Former les scientifiques et les professionnels de santé à la communication scientifique vers le grand public et à la réponse aux fausses informations. Encourager et accompagner les volontaires à s'exprimer dans les médias, dans leur seul domaine d'expertise, à travers une approche rigoureusement scientifique.
3. Lorsque des questions scientifiques apparaissent dans le débat public, encourager une communication politique transparente, pédagogique et clairement séparée de la communication scientifique.
4. Mettre en place des politiques éducatives visant à promouvoir la culture scientifique et le sens critique à l'égard des médias et de l'information.
5. Améliorer le traitement médiatique des sujets scientifiques et encourager les réseaux sociaux à mener des actions pour limiter la diffusion de fausses informations. Sanctionner les dérives susceptibles d'avoir des conséquences dommageables pour la santé publique.
6. Encourager les recherches sur la mésinformation et la désinformation.
AVANT-PROPOS
Saisi en février 2022 par la commission des affaires sociales du Sénat d'une étude sur les effets indésirables des vaccins contre la covid-19 et le système de pharmacovigilance français, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a adopté le 9 juin 2022 un rapport d'étape établissant une première analyse du sujet sur la base des éléments scientifiques alors disponibles2(*).
Lors de sa réunion du 26 octobre 2023, le bureau de l'Office a décidé que le temps était venu d'établir un rapport définitif sur le sujet et a confié à quatre rapporteurs, les députés Philippe Berta et Gérard Leseul et les sénatrices Sonia de La Provôté et Florence Lassarade3(*), une nouvelle mission afin d'établir un rapport conclusif, incluant notamment les éléments nouveaux ayant pu émerger au cours des derniers mois sur la covid-19.
Ce rapport aborde quatre thématiques : les effets indésirables des vaccins contre la covid-19 et le système de pharmacovigilance français (objet du rapport d'étape de juin 2022), l'évolution des connaissances en matière de covid long, les nouveaux outils de surveillance épidémiologique et d'anticipation sanitaire, et la désinformation en santé. Chaque partie comporte des éléments recueillis dans le cadre d'une revue de la littérature scientifique et d'auditions ayant permis d'entendre une trentaine de spécialistes. Comme à son habitude, l'Office en tire des enseignements et effectue une série de recommandations.
PREMIÈRE
PARTIE
LES EFFETS INDÉSIRABLES DES VACCINS CONTRE LA COVID-19 ET LE
SYSTÈME DE PHARMACOVIGILANCE FRANÇAIS
I. INTRODUCTION
Avec plus de 13,5 milliards de doses administrées dans le monde et 158 millions en France4(*), la campagne de vaccination contre la covid-19 est indéniablement la plus importante de l'histoire. Elle a considérablement modifié l'évolution de la pandémie, en sauvant des dizaines de millions de vies5(*) et en contribuant à mettre fin à l'urgence sanitaire de portée internationale déclarée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS)6(*). Selon cette dernière, la vaccination aurait permis d'éviter près de 120 000 décès en France entre décembre 2020 et mars 2023, soit une réduction du taux de mortalité de la covid-19 de 55 %7(*). La disponibilité rapide des vaccins a été particulièrement salutaire ; d'après une étude française, 159 000 décès supplémentaires seraient survenus si les vaccins n'avaient été disponibles qu'à partir de novembre 20218(*).
Si la période pandémique est aujourd'hui révolue, il est nécessaire de rappeler que le SARS-CoV-2 continue de circuler et de faire de nouvelles victimes. À titre d'exemple, en France, la covid-19 était mentionnée comme affection morbide dans 7,4 % des 6 096 décès certifiés par voie électronique lors de la semaine du 18 au 24 décembre 2023, correspondant au dernier pic hivernal9(*). Le maintien d'une bonne couverture vaccinale parmi les publics vulnérables reste donc primordial. Or, lors de cette même semaine du 18 au 24 décembre, seuls 28,5 % des personnes âgées de 65 ans et plus s'étaient vu administrer une dose de rappel dans le cadre de la campagne automnale.
II. ÉVOLUTION DE LA STRATÉGIE VACCINALE ET DE LA PHARMACOVIGILANCE DEPUIS JUIN 2022
A. DE NOUVEAUX VACCINS ADAPTÉS AUX VARIANTS CIRCULANT ET DE NOUVELLES PLATEFORMES VACCINALES
Comme cela était indiqué dans le rapport d'étape de l'Office de juin 2022, les premiers vaccins contre la covid-19 ont bénéficié d'autorisations de mise sur le marché (AMM) conditionnelles, procédure permettant leur commercialisation sur la base de données cliniques incomplètes en raison du bénéfice apporté par leur disponibilité immédiate, dépassant le risque représenté par les données manquantes.
Grâce aux données fournies par les industriels, démontrant l'efficacité et la sécurité des différents vaccins, ces autorisations conditionnelles ont été transformées en AMM standards : le 3 octobre 2022 et le 10 octobre 2022 pour les vaccins à ARNm Spikevax de Moderna et Comirnaty de Pfizer-BioNTech, le 31 octobre 2022 et le 10 janvier 2023 pour les vaccins à vecteur adénoviral Vaxzevria d'AstraZeneca et Jcovden de Janssen et le 4 juillet 2023 pour le vaccin à protéine recombinante Nuvaxovid de Novavax.
Pour faire face à l'évolution du virus, des vaccins adaptés aux nouvelles souches circulantes du SARS-CoV-2 ont été autorisés par l'Agence européenne des médicaments (EMA). Ces autorisations ont été accordées selon une approche réglementaire similaire à celle utilisée pour les mises à jour saisonnières des vaccins contre la grippe, appelée procédure de variation, qui permet une adaptation rapide de vaccins déjà autorisés. Des vaccins bivalents ciblant, en plus de la souche originale, les variants Omicron BA.1 puis Omicron BA.4-5 ont ainsi été autorisés : le 1er septembre 2022 pour Comirnaty et Spikevax ciblant BA.1, le 12 septembre 2022 pour Comirnaty et le 20 octobre 2022 pour Spikevax ciblant BA.4-5. Plus récemment, des vaccins monovalents adaptés au variant Omicron XBB.1.5 ont également été autorisés selon cette même procédure : le 31 août 2023 pour Comirnaty, le 15 septembre 2023 pour Spikevax et le 31 octobre 2023 pour Nuvaxovid. Des versions adaptées aux enfants, contenant une plus faible dose de substance active, ont également été autorisées postérieurement (voir figure ci-après).
De nouveaux vaccins se sont également vu octroyer des autorisations de mise sur le marché par l'EMA : le vaccin à virus entier inactivé VLA2001 de Valneva en primovaccination, le 24 juin 2022, et les vaccins à protéine recombinante VidPrevtyn Beta de Sanofi-GSK, le 10 novembre 2022, et Bimervax de Hipra, le 30 mars 2023, en tant que dose de rappel (ces deux derniers vaccins ciblant respectivement le variant Beta et les variants Alpha et Beta).
Vue d'ensemble des vaccins contre la covid-19 autorisés par l'Agence européenne des médicaments
Source : Reproduction à partir du site de l'EMA10(*)
En France, la Haute Autorité de santé (HAS) a estimé fin décembre 2022 que, compte tenu des données d'efficacité disponibles, du contexte épidémique et de la disponibilité d'alternatives vaccinales, l'intégration du vaccin VLA2001 dans la stratégie de primovaccination n'était pas justifiée11(*).
De même, en raison d'un potentiel risque de péricardite détecté au cours des essais cliniques et de la disponibilité d'alternatives vaccinales, la HAS a décidé en juin 2023 de ne pas recommander l'utilisation du vaccin Bimervax en tant que dose de rappel12(*). Enfin, préférant privilégier les vaccins adaptés aux souches circulantes majoritaires, la HAS ne recommande plus le vaccin Vidprevtyn Beta depuis la mise à disposition du vaccin Nuvaxovid adapté à la souche XBB.1.5 du variant Omicron, celui-ci pouvant servir d'alternative pour les personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas recevoir un vaccin à ARNm13(*).
Aussi, la stratégie vaccinale de rappel actuelle recommande l'utilisation préférentielle d'un vaccin à ARNm (uniquement Comirnaty pour les personnes de moins de 30 ans éligibles, en raison du risque de myocardite et de péricardite lié au vaccin Spikevax) et, en seconde intention, le vaccin Nuvaxovid pour les personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas en bénéficier en raison d'une contre-indication.
B. ÉVOLUTION DE LA STRATÉGIE VACCINALE
L'évolution du virus et l'amélioration des connaissances sur l'efficacité vaccinale se sont traduites par plusieurs évolutions de la stratégie vaccinale14(*).
Dans un premier temps, la stratégie vaccinale a visé à couvrir une part importante de la population adulte - en priorisant les personnes vulnérables du fait du nombre limité de doses disponibles - puis adolescente avec un cycle de primovaccination. Outre l'objectif de protection individuelle par une diminution de la morbi-mortalité associée à la covid-19, cette stratégie visait à limiter la pression sur le système hospitalier afin d'éviter de nouveaux confinements et était portée par l'espoir de ralentir, voire d'arrêter, la circulation du virus par l'instauration d'une immunité collective. Face au constat de la diminution de l'efficacité vaccinale contre l'infection dans le temps, l'administration d'une première dose de rappel a été préconisée à l'été 2021. Initialement ouverte aux personnes vulnérables, elle a ensuite été élargie à l'ensemble de la population adulte, toujours dans l'espoir de contenir la propagation virale grâce à une large couverture vaccinale.
À la fin de l'année 2021, l'émergence du variant Omicron, présentant un fort échappement immunitaire, a induit une forte baisse de l'efficacité vaccinale contre l'infection - jusqu'ici relativement conservée face aux précédents variants - et n'a plus permis d'envisager un contrôle des infections grâce à la vaccination. La stratégie vaccinale a alors été réorientée : la recommandation d'une deuxième dose de rappel ne cible plus la population générale mais uniquement les personnes âgées et vulnérables, ainsi que les professionnels de santé, afin de protéger ces populations contre les formes sévères de la maladie et préserver les hôpitaux du risque de débordement.
La stratégie vaccinale est désormais entrée dans un processus de normalisation15(*). La Haute Autorité de santé ne recommande plus la primovaccination en population générale mais uniquement l'administration d'une dose de rappel annuelle automnale pour les personnes âgées et à risque de formes graves16(*), de manière à recouper le schéma d'indication et la saisonnalité de la vaccination contre la grippe et coupler l'administration de ces deux vaccins17(*).
La dernière campagne de rappel automnale18(*), qui devait débuter le 17 octobre 2023, a été ouverte dès le 2 octobre face à l'intensification de la circulation du virus, sur recommandation du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars)19(*). Si 74 % des personnes éligibles déclaraient avoir l'intention de recevoir la dose de rappel en septembre20(*), cette campagne a rencontré in fine peu de succès avec une couverture vaccinale à son issue, en février 2024, de 30,2 % chez les personnes âgées de 65 ans et plus (et entre 9,9 et 12,2 % chez les professionnels de santé selon leur lieu d'exercice)21(*), contre 70,4 % en Angleterre pour cette même tranche d'âge22(*).
C. ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE PHARMACOVIGILANCE
Depuis l'adoption du rapport d'étape de l'Office, les déclarations des événements indésirables survenus après la vaccination contre la covid-19 ont continué d'être collectées et évaluées régulièrement par les autorités sanitaires23(*). Ces déclarations étant parallèles à la dynamique des vaccinations, leur nombre est aujourd'hui plus limité. Depuis octobre 2022, le suivi des vaccins est réalisé comme pour les autres médicaments, avec une évaluation collective mensuelle des cas considérés comme « marquants » et des signaux potentiels.
Le dernier point de situation sur la surveillance des vaccins contre la covid-19, publié par l'ANSM en août 2023, faisait état de 193 934 déclarations d'événements indésirables (non nécessairement imputables au vaccin), dont 25 % de cas graves, pour plus de 156 788 000 injections24(*), contre 153 452 déclarations d'événements indésirables recensées en février 2022 lors de la rédaction du rapport d'étape.
Au total, depuis le lancement de la campagne vaccinale, le dispositif de surveillance des vaccins contre la covid-19 s'est accompagné de la publication de plus de 200 documents : 88 rapports des centres régionaux de pharmacovigilance, 65 points d'information et 61 fiches de synthèse de l'ANSM, et 32 rapports d'EPI-PHARE.
D. POINT SUR LES INDEMNISATIONS
En juin 2022, l'Office avait fait état d'un nombre relativement faible de demandes adressées à l'Oniam au regard du nombre de déclarations faites dans le cadre de la pharmacovigilance : au 31 mars 2022, l'Oniam avait reçu 440 demandes amiables d'indemnisation. Parmi celles-ci, 54 % des dossiers étaient au stade de l'instruction avant expertise, 23 % en cours d'expertise, 3 % en cours de finalisation de la décision et 9 % avaient fait l'objet d'une décision. Parmi ces décisions, 10 % correspondaient à des clôtures de dossier à la suite du refus du demandeur de transmettre les documents nécessaires à l'instruction, 10 % à des offres d'indemnisation et 80 % à des rejets.
Entendu par le Sénat et par l'Assemblée nationale début octobre 2023 à l'occasion de son renouvellement aux fonctions de directeur général de l'Oniam25(*), Sébastien Leloup a indiqué que 1 246 demandes d'indemnisation avaient été reçues par l'Oniam en lien avec la vaccination contre la covid-19, parmi lesquels 279 dossiers liés à des troubles cardiaques, dont 202 au titre de myocardites et péricardites, et 229 liés à des troubles neurologiques. Au total, l'Oniam s'est prononcé sur le droit d'indemnisation des demandeurs dans 319 dossiers dont 29 % ont fait l'objet d'un avis positif. Ainsi, 91 personnes ont été indemnisées à l'amiable : 48 % pour des péricardites ou myocardites, 11 % pour des troubles neurologiques, 9 % pour un AVC, des thromboses ou des embolies pulmonaires, 4 % pour des troubles articulaires et 4 % pour des troubles dermatologiques. Le montant moyen de l'indemnisation est d'environ 8 000 euros. Par ailleurs, 114 missions d'expertise médicale restaient en cours. Concernant les actions contentieuses engagées devant les tribunaux, seules 53 procédures avaient été lancées au 30 septembre dernier, démontrant selon M. Leloup le bon fonctionnement de la procédure amiable.
III. EFFETS INDÉSIRABLES ASSOCIÉS AUX VACCINS NOUVELLEMENT UTILISÉS DEPUIS L'AUTOMNE 2022
A. VACCINS À ARNm ADAPTÉS AUX VARIANTS OMICRON
Aux États-Unis, un signal préliminaire de pharmacovigilance est apparu en janvier 2023 sur un risque d'AVC ischémique pour le vaccin bivalent de Pfizer-BioNTech (souche originale/Omicron BA.4-5) chez les personnes de 65 ans et plus26(*). Une analyse rétrospective a finalement montré que ce risque était similaire à celui observé chez les personnes ayant reçu le vaccin bivalent de Moderna et inférieur à celui constaté chez les personnes ayant reçu les versions monovalentes initiales des vaccins de Pfizer ou de Moderna27(*). En France, une analyse conduite par EPI-PHARE a montré que, 21 jours après la seconde dose de rappel, le risque d'événements cardiovasculaires (AVC ischémique, AVC hémorragique, infarctus du myocarde, embolie pulmonaire) chez les personnes ayant reçu le vaccin bivalent de Pfizer-BioNTech (ayant toutes 50 ans ou plus) n'était pas accru par rapport à celles ayant reçu la version monovalente originale28(*).
Le suivi de pharmacovigilance réalisé en France n'a fait émerger aucun signal spécifique à la suite de l'utilisation de ces nouveaux vaccins. En Israël, en comparant les 42 jours précédant et suivant l'injection, la seconde dose de rappel avec le vaccin bivalent de Pfizer-BioNTech n'a été associée à aucun des 25 potentiels événements indésirables considérés29(*). De même, une étude danoise a montré que, dans les 28 jours suivant la vaccination, l'utilisation de vaccins à ARNm bivalents pour la seconde dose de rappel chez les adultes âgés de 50 ans ou plus n'était pas associée à une augmentation du risque pour 27 événements indésirables potentiels30(*).
En l'état actuel des connaissances, le profil de sécurité associé à l'administration d'une dose de rappel bivalente semble similaire à celui associé à l'administration d'une dose de rappel monovalente. Une étude états-unienne a montré que cela était également le cas chez les enfants âgés de 5 à 11 ans31(*).
De même, il n'a pas été observé de différence concernant le profil de sécurité des vaccins monovalents adaptés au variant Omicron XBB.1.5, disponibles depuis l'automne 2023. Dans une cohorte danoise de plus d'un million d'adultes, aucune augmentation du risque n'a été observée pour 28 événements indésirables potentiels32(*).
B. VACCINS NUVAXOVID DE NOVAVAX ET VIDPREVTYN BETA DE SANOFI-GSK
Le dernier point de situation sur la surveillance des vaccins contre la covid-19, publié le 28 août 2023, recense environ 40 800 doses du vaccin Nuvaxovid et 6 900 doses du vaccin VidPrevtyn Beta utilisées en France33(*). Cette faible utilisation n'offre qu'un recul limité en vie réelle pour ces vaccins34(*) ; 104 cas d'événements indésirables ont été déclarés à la suite d'une injection du vaccin Nuvaxovid et 4 cas après une injection du vaccin VidPrevtyn Beta.
Après évaluation par le Comité d'évaluation des risques en pharmacovigilance (PRAC) de l'EMA, plusieurs événements ont été ajoutés au résumé des caractéristiques du produit du vaccin Nuvaxovid35(*) : l'anaphylaxie, la paresthésie (sensations de fourmillements ou de brûlures), l'hypoesthésie (perte de sensibilité de la peau) et les myocardites et péricardites (signal qui avait été initialement évoqué aux États-Unis sur la base des données des essais cliniques36(*)). En France, où le vaccin Nuvaxovid a fait l'objet de deux rapports d'enquête de pharmacovigilance (publiés en août 202237(*) et en avril 202338(*)), on ne recense que 2 cas d'anaphylaxie, 3 cas de myocardite ou péricardite et 8 cas d'hypoesthésie et de paresthésie. Les troubles menstruels (17 cas signalés) et les acouphènes (3 cas signalés) sont actuellement sous surveillance.
Concernant le vaccin VidPrevtyn Beta, aucun signal de pharmacovigilance n'a pour l'instant émergé en France.
IV. POINT SUR CERTAINS EFFETS INDÉSIRABLES ÉTABLIS OU SUSPECTÉS PRÉCÉDEMMENT MIS EN EXERGUE PAR L'OFFICE
Le rapport d'étape de l'Office avait mis en exergue plusieurs effets indésirables - établis ou suspectés - qui avaient fait l'objet d'un certain intérêt, en raison de leur gravité ou de leur caractère médiatique. Près de deux ans après ce premier rapport, de nouvelles données permettent de revenir sur les cas les plus significatifs.
Sans prétendre à l'exhaustivité, cette partie dresse un état des lieux des connaissances actuelles sur ces effets - ou suspicions d'effets - indésirables, que le lien avec la vaccination ait été prouvé, réfuté ou reste à établir.
La liste des effets indésirables avérés et bien établis figure dans les résumés des caractéristiques des différents vaccins, disponibles sur le site de l'EMA.
A. TROUBLES MENSTRUELS
Lors de la publication du rapport d'étape, en juin 2022, le réseau français des CRPV avait produit plusieurs analyses détaillées des notifications de troubles menstruels à la suite de la vaccination contre la covid-1939(*) et avait conclu à l'existence d'un signal potentiel. Cette information était indiquée sur le site de l'ANSM depuis l'été 2021 et avait été complétée par des indications sur les conduites à tenir à destination des femmes et des professionnels de santé, élaborées avec le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF). Saisie de ce signal potentiel, l'EMA avait considéré, dans un premier temps, que les preuves recueillies n'étaient pas suffisamment convaincantes pour conclure à l'existence d'un lien avec l'administration des vaccins40(*).
Afin d'étayer ce signal potentiel, l'ANSM a réuni en juillet 2022 des représentants d'associations de patients et de professionnels de santé et co-élaboré des tutoriels d'aide à la déclaration « pas-à-pas » - à destination des patientes41(*) et des professionnels de santé42(*) - ainsi qu'un guide d'aide à la déclaration43(*), dans le but d'améliorer le recueil des renseignements lors du signalement de ces troubles. Cette campagne d'information encourageant le signalement s'est traduite par un nombre important de déclarations, s'ajoutant aux plus de 10 000 signalements déjà reçus44(*).
L'ensemble de ces notifications a permis un réexamen des signaux potentiels au niveau européen et conduit le PRAC à conclure, en octobre 2022, qu'il existait une possibilité raisonnable que l'apparition de saignements menstruels abondants soit associée de manière causale aux vaccins à ARNm contre la covid-19 et que cette information devait être ajoutée aux résumés des caractéristiques de ces vaccins45(*). Le PRAC soulignait toutefois que ces cas étaient principalement de nature temporaire, sans gravité et sans impact sur la reproduction et la fertilité. En revanche, le risque d'aménorrhées n'a quant à lui pas été retenu. À l'heure actuelle, ce signal reste en cours d'évaluation pour Comirnaty, tandis qu'il a été clos et non validé pour Spikevax46(*).
La dernière enquête de pharmacovigilance réalisée par les Centres régionaux de pharmacovigilance français pour le vaccin Comirnaty, publiée en août 2023, indique, qu'outre les ménorragies et les aménorrhées, les syndromes et symptômes suivants pourraient constituer des signaux potentiels : dysménorrhées, douleurs pelviennes inter-menstruelles, métrorragies post-ménopausiques et recrudescence de la symptomatologie liée à l'endométriose chez les patientes atteintes par cette maladie47(*).
De même, pour le vaccin Spikevax, l'analyse des cas signalés révélerait des signaux potentiels pour les troubles du cycle (retard ou raccourcissement de cycle, règles prolongées) et les douleurs menstruelles, mais pas pour la ménopause précoce et la résurgence d'endométriose48(*). Si l'ensemble de ces événements restent sous surveillance au niveau français, seuls les saignements chez les femmes ménopausées font actuellement l'objet d'un signal spécifique en cours d'évaluation par l'Agence européenne49(*).
Concernant les autres vaccins, les troubles menstruels restent en cours d'évaluation par l'EMA pour le vaccin Vaxzevria et, uniquement pour saignements abondants, pour le vaccin VidPrevtyn Beta. En revanche, aucun signal n'a été retenu pour le vaccin Jcovden et le vaccin Nuvaxovid.
Depuis la publication du rapport d'étape de l'Office, plusieurs travaux académiques se sont intéressés à la fréquence de ces troubles, qui reste cependant difficile à estimer du fait de résultats divergents dans la littérature50(*). Une étude publiée en juillet 2022 a observé sur un échantillon de plus de 39 000 femmes que, parmi celles ayant des cycles menstruels réguliers, 42 % avaient eu des saignements plus abondants qu'habituellement après la vaccination51(*). En mai 2023, une étude néerlandaise a estimé sur la base d'une étude de cohorte prospective que l'incidence des troubles menstruels chez les femmes âgées de 54 ans ou moins était de 41,4 pour 1 000 femmes et que ceux-ci consistaient principalement en des cas de ménorragies et d'aménorrhées ou oligoménorrhées52(*). Enfin, une étude franco-britannique publiée en avril 2023 a montré que, si près d'une femme en âge d'avoir ses règles sur cinq avait signalé des troubles menstruels après avoir été vaccinée, la seule vaccination contre la covid-19 n'était pas associée à des paramètres anormaux du cycle menstruel lors de la comparaison avec un groupe contrôle non-vacciné53(*).
L'étude précitée portant sur plus de 39 000 femmes a constaté, chez celles n'ayant plus leurs règles (personnes sous contraceptifs réversibles à action prolongée, sous hormones d'affirmation de genre et ménopausées), des saignements relativement fréquents à la suite de la vaccination. En mai 2023, une étude suédoise s'intéressant aux conséquences de la vaccination chez près de 3 millions de femmes âgées de 12 à 74 ans a également montré une augmentation des contacts avec les services de santé pour métrorragie à la suite de la vaccination chez les femmes ménopausées, notamment après la troisième dose54(*).
Cette tendance a été confirmée par une étude norvégienne montrant une augmentation du risque de saignements à la suite de la vaccination chez les femmes ménopausées, périménopausées et préménopausées55(*), conduisant l'Agence européenne du médicament à étudier ce signal pour les vaccins à ARNm.
Concernant la sévérité des troubles menstruels, l'étude suédoise précitée ne démontrait aucun lien clair entre le fait d'avoir été vaccinée et celui d'avoir consulté un professionnel de santé pour un trouble du cycle menstruel chez les femmes en âge d'avoir leurs règles, suggérant que, si des troubles existaient, ils ne semblaient pas assez graves pour que les femmes consultent un médecin. Ces résultats rejoignent ceux d'une étude française récemment publiée par EPI-PHARE s'intéressant aux cas d'hospitalisation pour saignements menstruels abondants à la suite de la vaccination56(*) : à partir des données du SNDS, elle fait état d'un nombre d'hospitalisations attribuables à la vaccination de 8 par million de femmes vaccinées, avec une hospitalisation de moins d'un jour dans plus de 75 % des cas. On peut également signaler une analyse rétrospective sur plus de 19 000 femmes qui a constaté qu'en moyenne les femmes vaccinées avaient connu une augmentation de moins d'un jour de la durée de leur cycle menstruel à la suite de l'administration de la première et de la seconde dose de vaccin contre la covid-19 et que la durée des règles n'était pas affectée par la vaccination57(*).
Le mécanisme causant ces troubles n'est toujours pas élucidé. Plusieurs hypothèses ont été proposées et continuent d'être investiguées : une réaction immunitaire induite par la vaccination qui influerait sur les hormones impliquées dans le cycle menstruel, un stress ou une anxiété importante engendrés par l'acte de vaccination ou d'autres facteurs comme une maladie gynécologique sous-jacente ou une interaction avec les traitements contraceptifs.
Si la crainte d'un effet sur la fertilité était particulièrement prégnante lors de la rédaction du rapport d'étape en juin 2022, une revue de la littérature publiée en octobre 2022 a souligné qu'il n'existait aucun élément scientifique suggérant une association entre les vaccins contre la covid-19 et les troubles de la fertilité, que ce soit chez la femme ou chez l'homme58(*).
B. TROUBLES CARDIOVASCULAIRES
Dans le précédent rapport de l'Office, il était fait état de l'existence d'un risque accru de myocardites et péricardites dans les 7 jours suivant la vaccination avec un vaccin à ARNm chez les personnes âgées de 12 à 50 ans59(*). Les données d'EPI-PHARE montraient des associations particulièrement prononcées après la deuxième dose chez les jeunes adultes. Cependant, dans la grande majorité des cas, la symptomatologie de ces myocardites et péricardites était modérée.
Chez les jeunes de 12 à 29 ans, une étude britannique publiée en mars 2023 a montré que, bien que la vaccination contre la covid-19 soit associée à un risque accru de myocardite et d'autres événements cardiovasculaires, il n'y avait pas d'augmentation substantielle du risque de la mortalité - que ce soit en raison d'événements cardiaques ou de manière générale - due aux vaccins à ARNm60(*), confortant l'idée de symptômes peu graves dans la grande majorité des cas. Une étude d'EPI-PHARE s'intéressant aux pronostics à moyen-long terme des myocardites post-vaccinales est actuellement en cours.
Depuis l'adoption du rapport d'étape, le PRAC a recommandé l'ajout des myocardites et péricardites à la liste des effets indésirables du vaccin Nuvaxovid en août 202261(*). D'après les données publiées en juin 2023 par l'autorité australienne de régulation des produits thérapeutiques, les incidences seraient de 3 à 4 cas de myocardite et de 13 cas de péricardite pour 100 000 doses de Nuvaxovid administrées62(*) - soit des taux similaires à ceux observés avec les vaccins à ARNm -, résultats concordants avec l'analyse des cas répertoriés dans la base de pharmacovigilance de l'OMS (VigiBase) en février 202363(*). En juin 2023, les myocardites et péricardites ont également été ajoutées à la liste des effets indésirables du vaccin Jcovden64(*).
Concernant les autres risques cardiovasculaires chez les personnes âgées de moins de 75 ans, une analyse menée par EPI-PHARE n'a trouvé aucune association entre les vaccins Comirnaty et Spikevax et une hospitalisation pour plusieurs événements cardiovasculaires graves (infarctus du myocarde, embolie pulmonaire et accident vasculaire cérébral)65(*). En revanche, pour cette même tranche d'âge, la première dose du vaccin Vaxzevria serait associée à des risques accrus d'infarctus du myocarde et d'embolie pulmonaire et la dose unique du vaccin Jcovden pourrait être potentiellement associée à un risque accru d'infarctus du myocarde. Chez les personnes âgées de 75 ans ou plus, EPI-PHARE n'a détecté aucune augmentation de l'incidence de ces trois événements graves (infarctus du myocarde, embolie pulmonaire et accident vasculaire cérébral) à la suite du vaccin Comirnaty, comme de précédentes études israélienne et états-unienne66(*).
Publiée en novembre 2022, une méta-analyse portant sur 42 études s'intéressant aux conséquences cardiovasculaires des vaccins contre la covid-19 a constaté - comme l'avait montré EPI-PHARE67(*) - que le risque de myocardite était principalement observé après la deuxième et la troisième dose de vaccin et qu'il n'existait pas d'augmentation significative du risque d'infarctus du myocarde ou d'arythmie cardiaque après la vaccination68(*). Elle soulignait en outre que le risque d'événements cardiovasculaires était beaucoup plus élevé après une infection par le SARS-CoV-2 qu'après la vaccination.
C. TROUBLES VASCULAIRES
Dès le début de la campagne vaccinale, des événements thrombotiques atypiques ont été observés à la suite des vaccins à vecteur adénoviral (Vaxzevria et Jcovden). Le rapport d'étape de l'Office faisait état d'une incidence difficile à estimer, en raison de résultats relativement différents dans la littérature. Une étude internationale comparant les bases de données de cinq pays et publiée en octobre 2022 a fait état d'un risque de thrombocytopénie après une première dose du vaccin Vaxzevria de 33 % plus élevé qu'après une première dose du vaccin Comirnarty et d'un risque de syndrome thrombotique thrombocytopénique de 126 % plus élevé après une dose de Jcovden qu'après une dose de Comirnaty69(*).
En juin 2023, une étude longitudinale suivant des patients atteints d'un syndrome thrombotique thrombocytopénique à la suite de la vaccination contre la covid-19 a montré qu'une fois l'épisode aigu passé, les patients étaient à faible risque de récidive et qu'il était possible d'effectuer une nouvelle vaccination contre la covid-19 avec un vaccin à ARNm70(*).
Les vascularites cutanées et les thromboses veineuses ont été ajoutées à la liste des effets indésirables du vaccin Vaxzevria en 202371(*).
D. TROUBLES NEUROLOGIQUES
Plusieurs troubles neurologiques ont été rapportés et discutés dans des revues de la littérature72(*). Les symptômes les plus fréquemment rapportés sont les maux de tête, l'anosmie, la dysgueusie, la myalgie, la paresthésie, les faiblesses et les vertiges, tandis que les complications plus graves - bien plus rarement observées - incluent notamment la myélite transverse, le syndrome de Guillain-Barré et la paralysie de Bell.
1. Myélite transverse
La myélite transverse est une inflammation de la moelle épinière entraînant d'importants déficits sensitivo-moteurs. Par le passé, elle avait déjà été observée à la suite de diverses vaccinations. Dans le cas de la vaccination contre la covid-19, la myélite transverse a été ajoutée à la liste des effets indésirables du vaccin Jcovden73(*) et à celle du vaccin Vaxzevria74(*) en janvier et mars 2022.
En août 2022, une étude utilisant la base de données de pharmacovigilance de l'OMS (VigiBase) a montré un excès de cas de myélite transverse observé dans les 28 jours suivant la vaccination contre la covid-19, pour les vaccins à vecteur adénoviral comme pour ceux à base d'ARNm, suggérant une potentielle association75(*). Toutefois, plus récemment, une étude portant sur plus de 99 millions d'individus vaccinés dans huit pays a mis en évidence un excès de cas statistiquement significatif uniquement pour le vaccin Vaxzevria, et pas pour les vaccins à ARNm76(*). En tout état de cause, la myélite transverse reste un événement rare, dont l'incidence est plus élevée après une infection par le SARS-CoV-2 qu'après la vaccination.
2. Syndrome de Guillain-Barré (SGB)
Le syndrome de Guillain-Barré est une affection rare qui se caractérise par une attaque des nerfs périphériques du patient par son système immunitaire, provoquant une faiblesse musculaire. Dans certains cas, une paralysie des muscles thoraciques peut entraîner une insuffisance respiratoire. Des cas de syndrome de Guillain-Barré avaient déjà été observés chez des personnes ayant reçu d'autres vaccins, notamment le vaccin antigrippal.
Au Royaume-Uni, une étude avait estimé qu'entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, sur les 46 millions de doses du vaccin Vaxzevria administrées, un lien avec la vaccination pouvait être considéré comme « probable » pour 56 cas de syndrome de Guillain-Barré (et « possible » pour 12 cas)77(*). L'excès de cas de syndrome de Guillain-Barré avait alors été évalué à 38 pour 10 millions de doses de vaccin Vaxzevria administrées78(*). Similairement, à la suite de l'administration du vaccin Jcovden, un plus grand nombre de cas de syndrome de Guillain-Barré a été observé par rapport à ce qui était attendu79(*). Aussi, le Comité européen d'évaluation des risques en pharmacovigilance (PRAC) a recommandé l'ajout de cette complication très rare - moins d'un cas sur 10 000 personnes vaccinées - à la liste des effets indésirables de ces deux vaccins en septembre et décembre 202180(*).
En février 2023, une étude états-unienne a montré que, dans les 21 jours suivant la vaccination, les taux de notification de syndrome de Guillain-Barré par million de doses administrées étaient de 3,29 pour le vaccin Jcovden, de 0,29 pour le vaccin Cormirnaty et de 0,35 pour le vaccin Spikevax, confortant l'absence d'association avec les vaccins à ARNm81(*). Les résultats issus de la base de données de l'OMS (VigiBase)82(*), des données françaises exploitées par EPI-PHARE83(*) et de celles du Global Vaccine Data Network84(*) sont concordants avec cette tendance : une faible augmentation du risque de syndrome de Guillain-Barré est constatée après l'administration des vaccins vectorisés par un adénovirus, tandis qu'aucune augmentation statistiquement significative n'est observée après l'administration de vaccins à ARNm.
D'après une étude publiée en octobre 2023, les personnes infectées par le SARS-CoV-2 ont six fois plus de risques d'être touchées par un syndrome de Guillain-Barré que les autres. Aussi, par son effet protecteur, la vaccination contre la covid-19 diminuerait le risque de survenue de ce syndrome85(*).
3. Paralysie de Bell
La paralysie de Bell correspond à une faiblesse ou une paralysie soudaine des muscles d'un côté du visage. Plusieurs vaccins, notamment les vaccins contre la grippe, l'hépatite B et les vaccins conjugués contre le méningocoque, lui ont été associés.
Parmi les 8 cas de paralysie de Bell observés au cours des essais cliniques de phase 3 évaluant les vaccins à ARNm, 7 cas se sont produits chez les patients vaccinés (contre 1 cas dans les groupes placebo)86(*). Du fait de ce déséquilibre, cet effet indésirable est mentionné dans les résumés des caractéristiques des vaccins Comirnaty et Spikevax. Toutefois, une revue de la littérature publiée lors de l'été 2022 par le réseau de pharmacovigilance français indique que la plupart des études épidémiologiques disponibles n'ont pas montré d'augmentation significative du risque de paralysie de Bell à la suite de la vaccination par un vaccin à ARNm87(*). Une revue de la littérature plus récente, parue en avril 2023, vient à l'appui de ce résultat : mis à part le déséquilibre observé dans le cadre des essais cliniques pour les vaccins à ARNm, les études observationnelles ne montrent pas une incidence significativement différente de la paralysie de Bell après l'administration d'un vaccin à ARNm, en comparaison de personnes n'ayant reçu aucun vaccin88(*).
Concernant les autres vaccins, le PRAC a recommandé d'ajouter la paralysie faciale à la liste des effets indésirables du vaccin Jcovden en octobre 202289(*).
E. TROUBLES DE TYPE COVID LONG
Le rapport d'étape de l'Office de juin 2022 avait fait état d'événements indésirables complexes dont la symptomatologie était proche de celle du covid long90(*). Cependant, en l'état des connaissances, ceux-ci étaient difficilement imputables à la vaccination, en raison de la potentielle responsabilité d'une infection par SARS-CoV-2 qui n'aurait pas été identifiée, d'une part, et du manque de connaissances sur le covid long et ses mécanismes, d'autre part.
Si l'on peut citer la publication d'une étude en juin 2023 s'intéressant à ce phénomène et proposant le terme de « syndrome post-vaccination contre la covid-19 » pour qualifier ces effets91(*), ceux-ci restent encore aujourd'hui très faiblement évoqués dans la littérature scientifique. En France, bien que ce phénomène ait connu une certaine médiatisation, un nombre très limité de cas ont été rapportés aux CRPV, ne permettant pas d'identifier un signal potentiel. Pour le réseau des CRPV, ce très faible nombre de déclarations laisse entendre que, s'il existait une responsabilité causale de la vaccination, les cas seraient exceptionnellement rares. Les systèmes de pharmacovigilance étrangers n'ont pas non plus identifié de signal potentiel à ce sujet92(*).
F. SURMORTALITÉ
Dans la très grande majorité des pays, une surmortalité - un excédent de décès par rapport à ceux attendus - a été observée depuis le début de la pandémie. En France, la surmortalité a été plus forte en 2022 (8,7 %) qu'en 2021 (6,9 %) et en 2020 (7,8 %) alors que l'épidémie de la covid-19 a été moins meurtrière au cours de cette dernière année (38 300 décès de personnes atteintes de la covid-19 dans les hôpitaux et les établissements pour personnes âgées en 2022, contre 59 100 en 2021)93(*), encourageant certaines personnes à incriminer la vaccination contre la covid-19.
D'après l'Insee, cette hausse de la surmortalité en 2022 s'expliquerait par l'occurrence de deux épisodes de grippe (une épidémie tardive en mars-avril et une autre précoce en décembre), des épisodes de fortes chaleurs et des effets indirects de l'épidémie de la covid-19 (reports d'opérations, baisse des dépistages d'autres maladies, etc.)94(*).
Une étude menée aux États-Unis entre décembre 2020 et juillet 2021 a montré que le taux de mortalité d'une cause autre que la covid-19 des personnes vaccinées était plus faible que celui des personnes non vaccinées95(*), contredisant l'idée d'une surmortalité induite par la vaccination. De même, une étude indienne portant sur les morts subites inexpliquées chez les adultes âgés de 18 à 45 ans a montré que la vaccination réduisait le risque de ce type d'événement, alors qu'au contraire une récente hospitalisation pour covid-19 l'augmentait96(*).
G. AUTRES EFFETS INDÉSIRABLES
Depuis l'adoption du rapport de l'Office de juin 2022, plusieurs ajouts ont été effectués aux listes des effets indésirables des différents vaccins. On peut citer les gonflements importants du membre vacciné97(*), l'urticaire chronique98(*) et l'urticaire mécanique99(*) pour le vaccin Spikevax et les acouphènes, la paresthésie et l'hypoesthésie pour le vaccin Vaxzevria100(*).
V. POINT SUR CERTAINS SOUS-GROUPES DE LA POPULATION
Les essais cliniques sont menés sur des populations restreintes, tant en nombre qu'en diversité, puisqu'ils excluent généralement certains sous-groupes spécifiques tels que les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes atteintes de maladies chroniques. La surveillance des vaccins en vie réelle, grâce à la pharmacovigilance et à la pharmaco-épidémiologie, est alors essentielle pour étudier l'efficacité et la sécurité des vaccins auprès de patients plus divers, parmi lesquels des effets indésirables spécifiques sont susceptibles d'apparaître. Ces données apparaissent d'autant plus indispensables pour les vaccins contre la covid-19 que certains sous-groupes de population ont fait l'objet de craintes particulières (femmes enceintes, enfants) et que la vaccination n'est aujourd'hui recommandée que pour les personnes les plus vulnérables (personnes âgées, personnes immunodéprimées, etc.).
A. FEMMES ENCEINTES ET ALLAITANTES
En juin 2022, plusieurs études montraient que le profil de sécurité des vaccins contre la covid-19 chez les femmes enceintes était similaire à celui des femmes non enceintes. Ce constat a depuis été conforté par plusieurs études.
Une récente revue de la littérature incluant 30 études - soit un échantillon de 862 272 femmes - a montré que la vaccination contre la covid-19 pendant la grossesse diminuait le risque d'infection par le SARS-CoV-2, d'hospitalisation et de mortalité pour la mère, ainsi que le risque de naissance prématurée et d'admission en soins intensifs pour le nouveau-né101(*). Parallèlement, cette étude n'a relevé aucune preuve d'effet indésirable spécifique associé à la vaccination pendant la grossesse, pour la mère comme pour l'enfant. En outre, des études portant spécifiquement sur la vaccination de rappel ont montré que son administration était sûre chez les femmes enceintes et allaitantes102(*) et n'était pas associée à un risque accru d'avortement spontané103(*). Enfin, une récente étude néerlandaise a confirmé que la vaccination en début de grossesse n'était pas associée à un risque d'anomalie congénitale non génétique majeure104(*), comme l'avait précédemment montré la cohorte française COVI-PREG105(*).
En France, une enquête de pharmacovigilance consacrée spécifiquement aux effets indésirables des vaccins contre la covid-19 chez les femmes enceintes et allaitantes a été publiée en août 2023 par le réseau des CRPV106(*). D'après celle-ci, les données de la littérature et du suivi de pharmacovigilance continuent de ne mettre en évidence aucun risque de la vaccination chez les femmes enceintes et allaitantes, contrairement à l'infection maternelle au SARS-CoV-2 qui, comme le montrent les données concordantes de la littérature internationale, augmente le risque de complications foetales, maternelles, et néonatales.
B. ENFANTS
Si des cas de syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS) avaient été observés chez des enfants à la suite d'une infection par le SARS-CoV-2, très peu de cas ont été observés après l'administration d'un vaccin contre la covid-19 : 12 cas pour 8 113 058 doses de vaccin à ARNm administrées en France à des enfants de 12 à 17 ans en janvier 2022, soit 1,5 cas pour un million de doses injectées107(*).
Aux États-Unis, une étude portant sur plus de 3 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans ayant reçu le vaccin Comirnaty et s'intéressant à 20 potentiels effets indésirables graves a uniquement mis en évidence un signal de sécurité pour les myocardites et péricardites pour les enfants de 12 à 17 ans108(*). Celles-ci seraient plus fréquentes parmi les adolescents de 16 à 17 ans que chez ceux de 12 à 15 ans mais resteraient relativement rares109(*).
De même, d'après une étude publiée en avril 2023, menée sur une cohorte prospective regroupant des enfants de plusieurs pays européens ainsi que sur les résultats des essais cliniques et la base de données EudraVigilance, on a constaté une fréquence élevée d'événements indésirables locaux mais presque aucun événement indésirable grave. Les effets indésirables bénins étaient plus fréquemment signalés à la suite de la première dose que de la deuxième dose et chez les enfants âgés de 12 à 17 ans plus que chez ceux âgés de 5 à 11 ans110(*). Ce constat a été confirmé par plusieurs revues systématiques de la littérature portant spécifiquement sur la sécurité et l'efficacité des vaccins contre la covid-19 chez les enfants âgés de 5 à 11 ans111(*).
Chez les enfants de moins de 5 ans, qui ont été très faiblement vaccinés en France, les vaccins à ARNm semblent également bien tolérés avec des effets indésirables graves rares112(*).
Aussi, comme pour les adultes, les vaccins contre la covid-19 semblent bien tolérés par les enfants, quel que soit leur âge.
C. POPULATIONS VULNÉRABLES
1. Personnes immunodéprimées
Les personnes immunodéprimées présentent à la fois un risque élevé de forme grave de la covid-19 en cas d'infection et une réponse altérée à la vaccination, nécessitant une multiplication des doses de rappel. D'après une étude portant sur la sécurité des vaccins contre la covid-19 chez les patients atteints de maladies inflammatoires et auto-immunes systémiques, les risques de maux de tête, de douleurs abdominales et de vertiges sont légèrement plus fréquents que chez les individus immunocompétents113(*). Concernant les événements indésirables graves, le risque est également plus élevé chez les patients atteints de troubles inflammatoires et auto-immuns systémiques que chez les autres, bien que le risque absolu demeure faible.
2. Personnes âgées
Une méta-analyse portant sur 22 études consacrées aux personnes âgées de 60 ans ou plus, a montré que, comme pour le reste de la population, les vaccins étaient bien tolérés, avec des effets indésirables majoritairement modérés et transitoires114(*). De même, d'après une étude de cohorte rétrospective, publiée en août 2023 et portant sur plus de 6 millions d'adultes états-uniens âgés de 66 ans ou plus, le risque d'événements indésirables après l'administration des vaccins Comirnaty et Spikevax apparaît faible.
3. Patients atteints de cancer
Il est établi que les patients atteints d'un cancer présentent des taux de mortalité liée à la covid-19 plus élevés que le reste de la population115(*). D'après une revue de la littérature publiée en 2022, si les vaccins contre la covid-19 entraînent une réponse vaccinale significativement plus faible chez ces patients, ils apparaissent sûrs et bien tolérés116(*).
VI. LE SYSTÈME DE PHARMACOVIGILANCE DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE VACCINALE
Plusieurs travaux ont tenté de tirer les leçons de la crise en termes de pharmacovigilance. L'efficacité des systèmes mis en place au niveau européen et mondial et la collaboration entre les différents pays ont été saluées117(*). On peut également souligner que les signaux de pharmacovigilance mis en évidence rétrospectivement par des suivis de cohortes à grande échelle118(*) avaient, dans leur grande majorité, déjà été détectés par les systèmes de pharmacovigilance et pris en compte par les autorités sanitaires, démontrant leur efficacité. Le système français s'est montré particulièrement efficace avec la communication aux autorités européennes de plus de 50 signaux potentiels, renforçant ou initiant un signal de sécurité.
La crise sanitaire a également permis la découverte des CRPV par de nombreux professionnels de santé libéraux119(*), qui les sollicitent aujourd'hui plus fréquemment pour des demandes d'avis. Elle a permis une acculturation de la population à la pharmacovigilance ; l'ANSM a relevé une meilleure compréhension des concepts de pharmacovigilance lors de ses communications et on peut noter une augmentation de la part des déclarations effectuées par des patients, qui atteint aujourd'hui 17 % des déclarations hors vaccins contre 13 % en 2019 et 6 % en 2016.
Au cours de la crise sanitaire, des tutoriels et un guide d'aide à la déclaration ont été mis à disposition pour améliorer la qualité des déclarations effectuées au sujet des troubles menstruels120(*). D'après les pharmacologues des CRPV, si la mise en ligne de ces documents a stimulé le nombre de déclarations, elle ne se serait pas traduite par une amélioration de leur qualité. Les efforts doivent donc être poursuivis et notamment porter sur le portail de déclaration en ligne.
Comme l'a montré une publication consacrée aux déclarations de myocardites post-vaccinales effectuées via ce portail121(*), les professionnels n'y sont pas suffisamment encouragés à détailler leurs observations cliniques et seule une faible part des déclarations sont jugées bien documentées et exploitables pour une expertise. L'action engagée en ce sens par l'ANSM, qui a déployé une nouvelle version du portail en avril 2023, doit ainsi être prolongée, grâce à une discussion collégiale impliquant les pharmacovigilants et les professionnels de santé. À cet égard, les initiatives locales, telles que le dispositif de déclaration simplifiée122(*) ou la formation des délégués de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche123(*) mis en place par le CRPV de Caen Normandie, qui ont permis d'augmenter le nombre de déclarations, doivent être sources d'inspiration.
Si la crise sanitaire a « renforcé les liens du [réseau français des CRPV] avec l'ANSM grâce à la mise en place d'échanges en circuit court et le développement d'un partenariat réel »124(*), le réseau des CRPV regrette que cette organisation collaborative et non cloisonnée, qui a permis de gagner en fluidité, en agilité et, par conséquent, en efficience, ait été limitée à la situation de crise. C'est pourquoi, comme cela était déjà indiqué dans le rapport de l'Office de juin 2022, le réseau des CRPV continue de juger nécessaire de rétablir les comités techniques de pharmacovigilance, qui réunissaient chaque mois l'ensemble des CRPV au sein de l'ANSM jusqu'en 2019.
Enfin, si la surveillance des vaccins contre la covid-19 a été menée avec succès, ce résultat ne doit pas occulter les défis auxquels le système de pharmacovigilance est actuellement confronté. La crise sanitaire - et la hausse d'activité correspondante - est survenue alors que l'activité du réseau des CRPV était déjà en augmentation depuis plusieurs années125(*) et malgré des moyens humains insuffisants et en diminution126(*). Par conséquent, la crise a entraîné une saturation des services de pharmacovigilance, qui a perturbé ses activités de fond et conduit à un épuisement de ses équipes.
Aussi, faute d'un soutien permettant de faire face à la dynamique actuelle de l'activité, il existe un réel risque que le réseau ne soit pas en capacité de répondre à une prochaine crise avec la même efficacité, voire tout simplement à assurer ses missions - pourtant essentielles - en dehors de toute situation de crise. Similairement, les moyens financiers et humains d'EPI-PHARE restent aujourd'hui bien en deçà des objectifs estimés nécessaires pour remplir pleinement les missions inscrites dans son plan stratégique127(*).
En outre, comme cela était indiqué dans le rapport de juin 2022, la réforme des vigilances, en cours de déploiement depuis le début d'année 2023, suscite des inquiétudes au sein du réseau des CRPV. Ceux-ci craignent une déstabilisation de leur maillage actuel, puisque les ARS ont dorénavant la possibilité de réviser le schéma d'organisation territorial, et un risque de fragilisation financière, en raison d'une mutualisation des ressources avec les autres structures de vigilance.
VII. IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LA PERCEPTION DES VACCINS PAR LA POPULATION
A. ÉVOLUTION DE LA PERCEPTION DES VACCINS CONTRE LA COVID-19
Malgré les réserves de la population française à l'égard des vaccins, la couverture vaccinale contre la covid-19 a été relativement élevée. Les attitudes et comportements à l'égard des vaccins contre la covid-19 ont suivi les perceptions concernant la dangerosité de la maladie, d'une part, et l'efficacité et la sécurité des vaccins, d'autre part. Ce constat suggère une bonne compréhension générale du principe de la balance bénéfices/risques par la population128(*). En effet, pendant le premier confinement, alors qu'aucun vaccin n'était disponible mais que l'impact de la pandémie était manifeste, les intentions de vaccination étaient relativement importantes. Au cours du second semestre 2020, les discours évoquant la fin de la pandémie ainsi que les premières prises de parole exprimant des doutes quant à l'efficacité ou la sécurité des candidats vaccins ont entraîné une nette baisse de ces intentions129(*). Enfin, la résurgence de vagues épidémiques avec l'apparition des premiers variants et la confirmation progressive de l'efficacité et de la sécurité des vaccins au fur et à mesure du déploiement de la campagne vaccinale se sont traduites par un renforcement des intentions de vaccination et l'atteinte d'une importante couverture vaccinale en population générale130(*) : en septembre 2022, environ 79 % de la population française avait reçu le schéma vaccinal initial, soit plus de 90 % de la population éligible (adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus)131(*).
L'érosion de l'adhésion aux campagnes de rappel contre la covid-19 observée aujourd'hui en France est probablement liée à une sous-estimation des risques encore représentés par le SARS-CoV-2 - qui ne fait plus l'actualité et dont la mortalité a été fortement diminuée par la vaccination -, plutôt qu'à un scepticisme vis-à-vis de la vaccination132(*). Celle-ci est en effet sujette à un paradoxe : son efficacité efface la perception du risque de la maladie associée, qui est pourtant l'objet du vaccin et de son acceptabilité. La différence entre les volontés déclarées de vaccination et le nombre de vaccinations effectives133(*) conforte l'idée que, bien que perçue comme utile, la vaccination ne serait pas nécessairement vue comme prioritaire et donc pas toujours effectuée si le suivi médical ne permet pas de transformer cette disposition positive en acte vaccinal.
Aujourd'hui encore, des doutes sur ces vaccins subsistent dans la population : d'après une enquête menée en France lors de l'été 2023, 62 % des personnes interrogées considèrent que l'on ignore encore beaucoup de choses sur les effets indésirables à long terme des vaccins à ARNm et 47 % des enquêtés vaccinés contre la covid-19 (tous vaccins confondus) disent avoir des doutes ou des réticences concernant le vaccin qu'ils ont reçu (contre 46 % à l'été 2022)134(*). Si pour 51 % des enquêtés l'ARN messager est une technologie prometteuse pour la médecine de demain, 31 % assimilent les vaccins utilisant cette technologie à des thérapies géniques et 20 % pensent qu'ils modifient notre ADN.
Ces résultats font écho aux jugements des Français sur la qualité de l'information fournie par les autorités publiques dans le cadre de la campagne vaccinale. D'après une enquête de suivi longitudinal des attitudes à l'égard d'un vaccin contre la covid-19, on observe une insatisfaction et une défiance assez généralisée de la population : 33,7 % des Français estimaient ne pas avoir été bien informés sur les vaccins contre la covid-19 au printemps 2022 et 56,1 % pensaient que certaines informations scientifiques sur les vaccins avaient été dissimulées à l'été 2022 (20,9 % ne savaient pas si c'était le cas)135(*).
Outre ce manque perçu de transparence, l'étude a révélé un défaut de clarté des explications fournies : 52 % des répondants estimaient que les informations sur les vaccins étaient trop compliquées. Indéniablement, les évolutions successives de la stratégie vaccinale, souffrant parfois de recommandations divergentes entre le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale et la Commission technique des vaccinations de la HAS, ont manqué de lisibilité. De même, si la surveillance des vaccins s'est accompagnée de la publication de rapports réguliers et détaillés par le système de pharmacovigilance, la transposition vers le public de ces informations, au travers d'une communication coordonnée permettant leur bonne appropriation, a fait défaut, ce qui s'est révélé problématique au regard du contexte de désinformation qui a entouré la crise sanitaire. En effet, il a été montré que les récits « anti-vaccins » faisaient souvent référence à des rapports véridiques sur les problèmes de santé et les décès consécutifs à la vaccination mais de manière déformée, biaisée ou grossièrement exagérée136(*).
B. IMPACT DE LA CRISE SUR LES AUTRES VACCINATIONS
La campagne de vaccination contre la covid-19 avait suscité des craintes concernant de potentielles conséquences délétères sur l'adhésion à la vaccination, une augmentation considérable de l'hésitation vaccinale ayant été notamment observée à la suite de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) de 2009. Aussi, le rapport d'étape de l'Office de juin 2022 préconisait une vigilance sur l'adhésion des Français à la vaccination - notamment vis-à-vis des vaccinations pédiatriques - dans les mois et années suivant la crise sanitaire.
À l'échelle internationale, la confiance dans la vaccination a pu être vue comme une victime de la pandémie137(*). Cependant, en France, l'adhésion vaccinale a continué de progresser en métropole au cours de la pandémie138(*) : le dernier bulletin de santé publique sur la vaccination139(*) indiquait qu'en 2023, 83,7 % des personnes interrogées en France métropolitaine déclaraient être favorables à la vaccination en général (contre 74,2 % en 2019, 80,0 % en 2020, 82,5 % en 2021 et 84,6 % en 2022) et 37 % être défavorables à certaines vaccinations (contre 53 % en 2010, 42 % en 2016, 33 % en 2019 et 36 % en 2022).
Cette tendance est conforme aux résultats d'une récente étude conduite par la Fondation Descartes qui montre que le refus du vaccin contre la covid-19 ne serait que modérément corrélé au refus vaccinal hors covid140(*). Une situation plus contrastée est toutefois constatée dans les départements et régions d'outre-mer, où la confiance en la vaccination semble s'être significativement détériorée au cours de la crise sanitaire. D'une manière générale, l'acceptation de la vaccination reste aujourd'hui encore inférieure à celle observée avant 2009 et la campagne de vaccination contre la grippe A. En outre, depuis cette date, on peut noter un accroissement de la différence d'acceptabilité entre les personnes ayant les plus bas revenus et les plus aisées, contribuant aux inégalités sociales de santé141(*).
Si la couverture vaccinale pédiatrique n'a pas été impactée par la pandémie en France142(*), elle l'a été au niveau mondial143(*), en raison de campagnes de vaccination perturbées mais également d'une confiance dans l'utilité des vaccins qui a diminué dans de nombreux pays144(*).
Cette baisse de couverture a déjà entraîné une recrudescence d'épidémies de maladies infectieuses telles que la fièvre jaune, le choléra, la diphtérie et la poliomyélite145(*).
Alors que le caractère inédit de la technologie utilisée par les nouvelles plateformes vaccinales - vaccin à ARNm ou à vecteur viral avec adénovirus - semblait être à l'origine des craintes d'une partie de la population146(*), il est intéressant de noter que le nirsevimab (Beyfortus®) - nouveau traitement préventif147(*) contre l'infection au virus respiratoire syncytial (VRS) à l'origine de 80 % des bronchiolites - n'a récemment pas connu de méfiance similaire148(*). Ce résultat pourrait être lié au risque représenté par la bronchiolite, bien perçu par la population, qui conduirait à une appréciation favorable de la balance bénéfices/risques associée à ce nouveau traitement par les parents de nourrissons. À l'inverse, le vaccin contre le HPV, qui protège contre un risque moins immédiat, pâtirait d'une moins bonne appréciation de sa balance bénéfices/risques. La récente campagne de vaccination au collège n'a pas rencontré le succès escompté149(*).
VIII. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Le dispositif national de surveillance renforcée des vaccins contre la covid-19, reposant de manière complémentaire sur la pharmacovigilance et la pharmaco-épidémiologie, a su accompagner efficacement la campagne vaccinale en permettant la remontée rapide des signaux de pharmacovigilance, l'évaluation des risques associés et, le cas échéant, une adaptation réactive des recommandations vaccinales. Appuyé par les données issues de la surveillance mise en oeuvre au niveau mondial, ce dispositif a permis de confirmer le profil de sécurité favorable des vaccins aujourd'hui disponibles sur le territoire national.
Ces résultats ne doivent toutefois pas éclipser les difficultés auxquelles font face les structures chargées de cette surveillance mais, au contraire, être perçus comme une invitation à les conforter, notamment en leur accordant des moyens humains et financiers à la hauteur de leur activité et de leur importance pour la santé publique. Un affaiblissement de ces structures risquerait de menacer la confiance du public dans les médicaments et ferait courir un véritable risque en cas de nouvelle crise sanitaire.
Enfin, une attention toute particulière doit être portée à la communication claire, lisible et pédagogique des données - et des incertitudes - sur les effets indésirables des médicaments afin de permettre leur bonne appréhension par la population.
RECOMMANDATIONS
1. Poursuivre la surveillance des vaccins contre la covid 19.
2. Organiser le dispositif de surveillance de façon à pouvoir le renforcer lors de la mise sur le marché de médicaments innovants susceptibles d'entraîner des craintes excessives parmi la population ou un risque important d'effets indésirables.
3. Poursuivre la démarche d'amélioration de la quantité et de la qualité des déclarations de pharmacovigilance afin d'optimiser la détection des signaux, en sensibilisant les professionnels de santé et la population à l'intérêt de la pharmacovigilance.
4. Maintenir l'organisation actuelle du réseau des CRPV et d'EPI-PHARE et les doter de moyens suffisants pour mener leurs missions et répondre avec efficacité à une prochaine crise.
5. Améliorer la communication sur les effets indésirables, qui doit être claire, lisible et pédagogique, afin de permettre une appréciation juste de la balance bénéfices/risques des médicaments par la population. Mener des campagnes de communication destinées aux personnes hésitantes, en analysant leurs besoins et attentes. Parallèlement, lutter contre les fausses informations.
6. Expliquer de manière pédagogique les éventuelles évolutions des stratégies vaccinales afin de permettre leur bonne compréhension et garantir leur acceptabilité.
DEUXIÈME
PARTIE
LE COVID LONG
I. INTRODUCTION
Dès le début de la pandémie, de nombreux patients ont témoigné de symptômes persistants à l'issue de la phase aiguë de la covid-19. Cet état de santé a été qualifié de « covid long » - terme initialement créé par les patients150(*) puis repris par la communauté scientifique - ou de « syndrome post-covid »151(*), à l'instar des syndromes post-infectieux décrits à la suite de l'infection par divers pathogènes152(*).
Si la pandémie de la covid-19 a entraîné une mobilisation politique et scientifique sans précédent, permettant notamment de réduire considérablement la morbi-mortalité associée grâce au développement de vaccins, une plus faible attention a été portée au covid long, qui entraîne pourtant un impact significatif sur la santé des individus qui en sont affectés153(*) et représente un enjeu majeur de santé publique154(*). Aussi, plus de 4 ans après l'émergence de la covid-19, les connaissances sur le covid long, son suivi et sa prise en charge restent lacunaires. Dans un récent avis, le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) a estimé que la France n'avait pas suffisamment « pris la mesure de la réalité du syndrome post-covid (SPC) »155(*). Alors que l'attention de la société se détourne peu à peu de la covid-19, il apparaît impératif de se pencher sérieusement sur cette problématique, trop souvent négligée jusqu'à présent.
L'Office s'est intéressé à deux reprises au covid long, au travers d'auditions publiques organisées le 8 avril et le 16 décembre 2021, dont les conclusions ont été respectivement intégrées dans les rapports parus en juillet 2021156(*) et en février 2022157(*). Deux années après ce dernier rapport, l'Office a souhaité faire un point sur l'évolution des connaissances sur ce sujet.
II. UNE DÉFINITION NON HARMONISÉE ET UN DIAGNOSTIC TOUJOURS DIFFICILE
Entité nouvelle et encore mal comprise, le covid long n'a pas de définition harmonisée. En 2021, un processus de décision collective a amené l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) à définir cette maladie comme survenant « chez les personnes ayant des antécédents d'infection probable ou confirmée par le SARS-CoV-2, généralement trois mois après l'apparition de la maladie, avec des symptômes qui durent au moins deux mois et qui ne peuvent être expliqués par un autre diagnostic ». Cette définition précise que les symptômes peuvent se manifester après la phase d'infection initiale ou persister depuis celle-ci, qu'ils peuvent être fluctuants et entraîner des rechutes, et qu'ils sont susceptibles d'affecter la vie quotidienne des patients158(*).
En France, la Haute Autorité de santé (HAS) a fait le choix d'une définition fondée sur trois critères : un « épisode initial symptomatique de la covid-19 », la « présence d'au moins un des symptômes initiaux au-delà de 4 semaines suivant le début de la phase aiguë de la maladie » et des « symptômes initiaux et prolongés non expliqués par un autre diagnostic sans lien connu avec la covid-19 »159(*). Le choix d'un délai raccourci, fixé à 4 semaines au lieu des 2 mois retenus par l'OMS, a pour objectif de reconnaître les patients à un stade plus précoce et de pouvoir leur offrir une prise en charge plus rapide.
Le principal obstacle à une définition standardisée est que, malgré de nombreuses recherches poursuivant cet objectif, il n'a pas été possible d'identifier de symptôme spécifique ou un marqueur biologique ou radiologique qui pourrait servir de critère de diagnostic. Aussi, le diagnostic du covid long continue de reposer sur un processus différentiel, qui nécessite l'exclusion d'autres diagnostics pouvant expliquer les symptômes rapportés par le patient, éventuellement parasité par d'autres étiologies. Les conséquences de cette complexité sont un diagnostic tardif, qui conduit à une prise en charge retardée, ainsi qu'un sous-diagnostic. Comme le souligne le Covars dans son avis, ce risque serait particulièrement important chez les personnes âgées et celles souffrant de comorbidités, pour lesquelles les symptômes du covid long peuvent être attribués à leur état de santé, et chez les enfants, perçus comme faiblement touchés par la covid et pour lesquels des explications alternatives sont susceptibles d'être proposées (par exemple, la santé mentale ou la surexposition aux écrans, qui peuvent causer des troubles de l'humeur, de la fatigue et des troubles du sommeil).
Le lien étiologique avec une infection issue du SARS-CoV-2 représente également un défi pour l'établissement d'un diagnostic de covid long, en raison des nombreux cas peu - ou pas - symptomatiques et des infections n'ayant pas été diagnostiquées160(*). Pour faire face à cette difficulté, la définition de la HAS inclut les cas d'infection probable, définie par la survenue brutale de trois des symptômes suivants : fièvre, céphalée, fatigue, myalgie, dyspnée, toux, douleurs thoraciques, diarrhée, odynophagie.
III. UNE ÉPIDÉMIOLOGIE QUI RESTE MAL CONNUE
A. DES DIFFICULTÉS MÉTHODOLOGIQUES
Les études épidémiologiques conduites sur le covid long se heurtent aux difficultés de diagnostic : certains patients risquent d'être exclus de ces études faute de reconnaissance de leur maladie, tandis que d'autres, souffrant potentiellement d'affections sans lien avec la covid-19, peuvent être inclus par erreur. Faute d'une définition harmonisée, les études portant sur cette maladie utilisent des critères qui peuvent différer, notamment concernant la documentation de l'infection, les symptômes considérés et la temporalité par rapport à la phase aiguë.
Il en résulte une difficulté à comparer les résultats, qui peut être accentuée par des facteurs de confusion et des biais de sélection liés au mode de recrutement des participants (à l'hôpital ou en population générale, par échantillonnage aléatoire ou par participation volontaire, en personne ou à distance, etc.). Dans de nombreux cas, l'absence ou la mauvaise construction du groupe de contrôle rend difficile de déterminer si les symptômes sont directement liés à la covid-19 ou s'ils auraient pu se manifester en l'absence d'infection161(*).
B. DES RÉSULTATS DIVERGENTS
En raison de ces obstacles et biais méthodologiques, il existe une grande variabilité des données épidémiologiques concernant l'incidence du covid long et une difficulté d'aboutir à des résultats concordants162(*).
Plusieurs méta-analyses ont récemment tenté de dresser une tendance sur la base des résultats de la littérature. Ainsi, une méta-analyse incluant 41 études a relevé des taux de prévalence de symptômes après 28 jours allant de 9 à 81 %, avec une prévalence globale de 43 % (54 % chez les patients hospitalisés et 34 % chez les non-hospitalisés)163(*), tandis qu'une autre étude portant sur 1,2 million d'individus a évalué la prévalence des principaux symptômes évocateurs d'un covid long 12 semaines après l'infection à 5,7 % pour les patients n'ayant pas nécessité d'hospitalisation, 27,5 % pour les patients hospitalisés et 43,1 % pour les patients pris en charge en unité de soins intensifs164(*). Dans son avis, le Covars fait état de plusieurs études relevant une incidence supérieure à 30 % à la suite d'une infection symptomatique et jusqu'à plus de 50 % pour les cas ayant nécessité une hospitalisation165(*). Au regard de ces différentes données, le consensus scientifique estime l'incidence de cette maladie entre 10 et 30 % des cas non hospitalisés et entre 50 et 70 % des cas hospitalisés166(*).
En mars 2023, une publication a estimé, en utilisant l'hypothèse prudente d'une incidence de 10 %, que, dans le monde, au moins 65 millions de personnes auraient été concernées, à un moment donné, par un diagnostic de covid long167(*). Néanmoins, directement liée au taux d'incidence retenu et au nombre estimé de cas de covid, cette évaluation est empreinte d'une grande incertitude et certaines estimations proposent des nombres plus de 2 fois supérieurs168(*).
En novembre 2022, Santé publique France a mené une enquête afin d'évaluer le nombre de personnes touchées par cette maladie169(*). Parmi l'échantillon de plus de 10 000 personnes âgées de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine interrogées, 48 % déclaraient une infection confirmée ou probable par le SARS-CoV-2 plus de 3 mois auparavant. Parmi celles-ci, 8 % présentaient les critères d'une affection post-covid-19 selon la définition de l'OMS, soit 4 % de la population d'étude170(*). Aussi, Santé publique France estimait le nombre d'adultes concernés par un covid long à plus 2 millions en France métropolitaine. Du point de vue de la gravité de l'affection, un impact sur les activités quotidiennes au moins modéré était déclaré par 2,4 % des personnes interrogées et un impact fort ou très fort par 1,2 % de celles-ci. Sur la base de ces résultats, le Covars estime, dans son avis, que plusieurs centaines de milliers de Français seraient encore aujourd'hui invalidés dans leur quotidien par un covid long.
Ces résultats sont concordants avec ceux d'autres études populationnelles menées à l'étranger. À l'automne 2022, soit à la même période que l'enquête de Santé publique France, 3,3 % de la population adulte britannique présentait des symptômes persistants depuis plus de 4 semaines171(*). Ces symptômes avaient un impact négatif sur les activités quotidiennes dans 73 % des cas, avec une capacité « fortement limitée » à mener ces activités pour 16 % d'entre eux. De même, au cours de cette même année 2022, la prévalence du covid long a été estimée à 4,6 % dans la population adulte canadienne172(*) et à 6,0 % chez les adultes états-uniens173(*).
Chez les enfants et adolescents, les premières données disponibles ont suggéré que l'incidence du covid long serait plus faible que chez les adultes. En 2021, une analyse de la littérature avait estimé que 2 à 5 % des enfants ayant été infectés par le SARS-CoV-2 auraient développé un covid long174(*). Cependant, des méta-analyses plus récentes ont abouti à des proportions supérieures, plus proches de celles observées en population adulte : la prévalence du covid long serait de 25,24 % après 4 semaines175(*) et de 16,2 % après 3 mois176(*). À nouveau, on peut observer des résultats qui varient fortement selon les études et un manque récurrent de groupe de contrôle permettant de conclure quant à la responsabilité causale de l'infection et de dresser des conclusions robustes177(*). Pour le Covars, le taux d'incidence de cette maladie chez les enfants, marqué par une forte sous-détection, serait compris entre 10 et 25 %, soit un intervalle de proportion similaire à celui observé dans la population adulte.
C. DES FACTEURS DE RISQUE QUI DIFFÈRENT DE CEUX DE LA PHASE INITIALE DE LA MALADIE
Dès le début de la pandémie, comme le montrent les résultats épidémiologiques présentés ci-dessus, la sévérité de la phase aiguë de la maladie (nombre et intensité des symptômes, nécessité d'une hospitalisation ou de soins intensifs) a été identifiée comme l'un des principaux facteurs de risque du covid long.
Il est toutefois nécessaire de souligner que la maladie peut également survenir à la suite de formes légères de la covid-19, voire de formes asymptomatiques178(*), et que la plupart des cas de covid long concerneraient des personnes ayant présenté une phase aiguë bénigne, celles-ci représentant la majorité des cas de covid-19179(*).
Outre cette première caractéristique, plusieurs études ont mis en évidence d'autres facteurs significativement associés au développement du covid long180(*) : un indice de masse corporelle élevé, le tabagisme, des pathologies préexistantes (notamment les maladies pulmonaires chroniques) ou des prédispositions (terrain allergique ou auto-immun). Le sexe semble également jouer un rôle notable, les femmes étant deux fois plus susceptibles de développer un covid long que les hommes181(*).
S'agissant de l'âge, une revue de la littérature a conclu que les personnes âgées de 40 à 69 ans et celles de 70 ans ou plus présentaient un risque de covid long similaire182(*). L'analyse de la littérature réalisée par la Haute Autorité de santé relève plusieurs études observant un risque de covid long accru chez les personnes âgées de 50 à 66 ans pour l'une183(*), de 35 à 69 ans pour une autre184(*) et de 20 à 60 ans pour une troisième185(*), résultats concordants avec ceux de l'enquête de Santé publique France qui observe la plus forte prévalence chez les personnes âgées de 45 à 54 ans186(*). Ces différences pourraient néanmoins provenir du sous-diagnostic existant chez les personnes âgées, pour lesquelles les symptômes du covid long peuvent avoir été attribués à une autre étiologie.
Chez les enfants, les sous-populations à risque sont les plus jeunes enfants (0 à 3 ans)187(*) et les adolescents (12 à 17 ans)188(*) et, comme pour les adultes, les principaux facteurs prédictifs sont le sexe féminin et les problèmes de santé préexistants, en particulier l'asthme et le surpoids.
D. UNE ÉVOLUTION DE LA PRÉVALENCE AVEC LA SUCCESSION DES VARIANTS ET LE DÉVELOPPEMENT DE L'IMMUNITÉ
L'émergence du variant Delta a entraîné une baisse de la prévalence des symptômes prolongés à la suite d'une infection par SARS-CoV-2189(*). L'arrivée du variant Omicron s'est traduite par une nouvelle diminution du risque de covid long190(*), estimé jusqu'à 88 % inférieur au risque associé à la souche originale191(*). Au Canada, la proportion d'adultes déclarant avoir eu des symptômes persistants 3 mois après une infection ou une suspicion d'infection est passée de 25,8 % avant l'arrivée d'Omicron BA.1 à 10,5 % après192(*). De même, au Royaume-Uni, la probabilité de déclarer un covid long quatre à huit semaines après une première infection par SARS-CoV-2 était deux fois plus faible pour les infections susceptibles d'avoir été causées par le variant Omicron BA.1 que pour celles susceptibles d'avoir été causées par le variant Delta chez les personnes doublement vaccinées193(*).
Cette plus faible prévalence est probablement due aux caractéristiques intrinsèques du variant Omicron, moins susceptibles de provoquer des covid longs, mais aussi à l'immunité accrue de la population, acquise par infection ou par vaccination, qui permet de diminuer l'intensité de la réponse immune lors de la phase initiale de la maladie.
Certaines études ont même constaté une prévalence des symptômes persistants 12 semaines après l'infection ne différant pas significativement entre les individus infectés par Omicron BA.1 et un groupe de contrôle non infecté, suggérant que le risque de covid long serait devenu relativement faible194(*). Pour autant, ce risque diminué ne s'est pas traduit par une disparition du covid long. Au contraire, le nombre élevé d'infections dues à ce variant, résultant de son fort échappement immunitaire et de sa forte contagiosité, s'est traduit par une augmentation du nombre de personnes touchées par ce syndrome. Au Royaume-Uni, selon les enquêtes régulières de l'Office for National Statistics, le nombre de personnes affectées par un covid long est passé de 1,332 million en décembre 2021 à 1,988 million en avril 2022195(*). En outre, cette baisse de la prévalence ne semble pas être inhérente à la dynamique évolutive du virus puisque, au Royaume-Uni, le risque de développer un covid long à la suite d'une infection causée par Omicron BA.2 était 21,8 % plus élevé qu'après une infection causée par Omicron BA.1196(*).
Si les infections causées par Omicron se sont traduites par une hausse du nombre de covid longs au cours du premier semestre 2022, les données des Centers for Disease Control and Prevention états-uniens et de l'Office for National Statistics britannique montrent une diminution de la prévalence du covid long entre 2022 et 2023197(*). Cette tendance pourrait résulter de plusieurs facteurs : une réduction du nombre d'infections par SARS-CoV-2, des phases aiguës de la maladie moins sévères et mieux prises en charge, ainsi qu'un effet de l'immunité naturelle et vaccinale. Toutefois, il ne peut être exclu que la moindre attention portée à la covid-19 et le faible niveau de dépistage aient également induit un plus faible diagnostic du nombre de covid longs.
Enfin, bien que l'immunité semble offrir une protection contre le risque de covid long, les réinfections successives accroissent ce risque et pourraient aggraver les symptômes chez les patients déjà atteints par cette maladie198(*). Au Canada, les personnes ayant été infectées deux ou trois fois par le SARS-CoV-2 étaient respectivement 1,7 et 2,6 fois plus susceptibles de signaler des symptômes prolongés par rapport à celles n'ayant signalé qu'une seule infection199(*).
E. UNE PROTECTION FOURNIE PAR LES TRAITEMENTS PRÉVENTIFS
1. L'utilisation de traitements lors de la phase aiguë
Comme évoqué précédemment, la gravité de la phase aiguë de la covid-19 est un facteur de risque majeur de développer un covid long. De ce fait, les traitements antiviraux permettant de limiter la sévérité de cette phase sont apparus comme des possibilités de prévenir l'apparition des symptômes persistants.
Une étude de cohorte récente a montré que le traitement précoce par Paxlovid chez des patients infectés, présentant au moins un facteur de risque de développement d'une forme grave de la covid-19, entraînait une réduction du risque de covid long de 26 % par rapport à des patients n'ayant reçu aucun traitement antiviral ou par anticorps200(*). Si une étude plus récente n'a pas constaté le même effet, une réduction de l'incidence de certains clusters de symptômes serait tout de même observée201(*). En outre, un récent essai randomisé contrôlé par placebo a montré qu'un traitement ambulatoire précoce par la metformine - un antidiabétique - entraînait une diminution relative de 42 % de l'incidence du covid long chez les patients atteints de surpoids ou d'obésité202(*).
2. Le rôle des vaccins
En raison de leur efficacité à prévenir les formes graves de la covid-19, plusieurs études se sont intéressées à la protection que les vaccins pourraient procurer contre le covid long, outre la protection directe qu'ils offrent en diminuant le risque d'infection.
Plusieurs analyses de la littérature montrent ainsi qu'en cas d'infection par le SARS-CoV-2, le risque de covid long serait diminué d'environ 30 à 40 % par le cycle de primovaccination203(*) et d'environ 70 % après la troisième dose204(*). Cet effet protecteur n'aurait été que faiblement diminué avec l'apparition du variant Omicron, malgré son fort échappement immunitaire, et serait également observé, dans un ordre de grandeur similaire, chez les enfants et adolescents, avec une efficacité qui serait plus élevée chez ces derniers205(*).
Une étude épidémiologique française a suggéré que la vaccination de patients affectés par un covid long permettait de diminuer le nombre de leurs symptômes et d'augmenter le nombre de guérisons206(*). Cette tendance a également été observée dans d'autres études internationales207(*) : dans la majorité des cas, une amélioration de la qualité de vie et une diminution des symptômes sont constatées à la suite de la vaccination, bien que des cas d'aggravation puissent également survenir.
IV. UN TABLEAU CLINIQUE COMPLEXE DONT L'ÉVOLUTION RESTE INCERTAINE
A. DES SYMPTÔMES DIVERS
Le covid long est une maladie multi-symptomatique, avec plus de 200 symptômes potentiels identifiés208(*). Ceux-ci touchent de très nombreux organes - on relève notamment des symptômes pulmonaires, cardiovasculaires, neurologiques, digestifs, dermatologiques, vasculaires, ORL et ophtalmologiques - qui peuvent être apparus au cours de la phase aiguë de la maladie comme se déclarer dans un second temps. Ces symptômes sont relativement hétérogènes selon les patients209(*) et caractérisés par une grande fluctuation dans le temps210(*), les rendant à la fois déroutants à décrire pour les patients et difficiles à appréhender pour les médecins.
S'il n'existe pas de symptôme pathognomonique - c'est-à-dire qui caractérise spécifiquement la maladie -, on peut relever un trépied de symptômes caractéristiques : la fatigue sévère, les troubles neurocognitifs (brouillard cérébral, maux de tête, troubles de l'attention et de la mémorisation, etc.) et sensoriels (sensation de brûlures, paresthésies, etc.), et la dyspnée (syndrome d'hyperventilation inappropriée, intolérance systémique à l'effort).
L'analyse de la littérature effectuée par la Haute Autorité de santé en avril 2023211(*) fournit des données quant à la prévalence des principaux symptômes : fatigue (5 à 37 %), dyspnée (6 à 21 %), anosmie-agueusie (5 à 25 %), troubles de la concentration (5 à 26 %), troubles mnésiques (6 à 24 %), céphalées (3,5 à 10 %), arthralgies (9 à 11 %), myalgies (3 à 8 %), troubles du sommeil (6 à 9 %), anxiété (7 %), dépression (4 %), oppression thoracique (2,5 à 6 %)212(*). Contrairement à la prévalence de la maladie, la succession des différents variants ne semble pas s'être traduite par une importante évolution de la typologie des symptômes213(*).
Panorama des symptômes observés chez les patients ayant des symptômes prolongés à la suite d'une covid-19
Source : Haute Autorité de santé, Réponses rapides dans le cadre de la COVID-19 : Symptômes prolongés à la suite d'une covid-19 de l'adulte - Diagnostic et prise en charge - Synthèse214(*), 2023
Chez les enfants, si une méta-analyse conduite en 2021 avait identifié une typologie de symptômes relativement similaire à celle des adultes215(*), une étude plus récente suggère de légères différences du tableau clinique : les troubles de l'humeur, la fatigue et les troubles du sommeil seraient les symptômes les plus fréquemment signalés en population pédiatrique216(*).
B. DONT L'ÉVOLUTION EST ENCORE MAL DÉCRITE
Les connaissances actuelles font état d'une diminution de la prévalence des symptômes au cours du temps217(*) mais la dynamique de cette évolution et les facteurs sous-jacents demeurent encore largement méconnus. Les exemples fournis par les autres syndromes post-infectieux, notamment le syndrome post-SRAS qui partage de nombreuses similitudes avec le covid long, montrent que les symptômes pourraient perdurer plusieurs années voire, dans certains cas, être permanents218(*).
Une analyse internationale, impliquant plus de 1,2 million de personnes et portant sur les principaux symptômes évocateurs du covid long, a estimé que la durée moyenne du maintien de ces symptômes était de 4 mois pour les patients non hospitalisés et de 9 mois pour ceux ayant nécessité une hospitalisation, avec environ 15 % de patients qui continuaient de subir au moins un symptôme après 12 mois219(*). En France, une étude transversale portant sur 3 cohortes de patients a estimé que la prévalence des symptômes persistants chez les individus ayant déclaré une infection symptomatique par le SARS-CoV-2 était de 32,5 % après 2 mois, de 18,4 % à 6 mois, de 10,1 % à 12 mois et de 7,8 % à 18 mois220(*).
D'autres études dressent toutefois des conclusions moins encourageantes. En France, l'étude de cohorte ComPaRe fait valoir que 85 % des personnes interrogées déclarent encore des symptômes un an après leur apparition221(*). Des recherches indiquent que, même deux ans après l'infection, les guérisons complètes seraient rares222(*) et que plus de la moitié des patients présenteraient encore au moins un symptôme223(*), avec des conséquences en termes d'espérance de vie en bonne santé224(*). Cependant, il est à noter que si les rétablissements complets semblent relativement rares à moyen terme, les résultats de l'étude ComPaRe témoignent d'une amélioration des symptômes dans la majorité des cas (rapidement pour 5 % des patients suivis et lentement pour 91 % d'entre eux)225(*).
On remarque une évolution différenciée selon la typologie des symptômes : les symptômes généraux, gastro-intestinaux et respiratoires auraient tendance à disparaître plus rapidement que les troubles neurocognitifs et la fatigue qui persisteraient plus longtemps et seraient même susceptibles de s'aggraver226(*). Dans certains cas, de nouveaux symptômes pourraient apparaître et augmenter en prévalence au cours du temps : c'est notamment le cas de la paresthésie et des douleurs au niveau du cou et du dos, selon les résultats de l'étude ComPaRe227(*).
Certains facteurs de risque, enfin, conduisent à une plus lente guérison : un âge avancé (plus de 60 ans), le sexe féminin, un antécédent de cancer, un indice de masse corporelle élevé (supérieur à 30) et un plus grand nombre de symptômes lors de la phase aiguë de la maladie228(*).
V. UNE ORIGINE DE LA MALADIE QUI RESTE À DÉTERMINER
Plusieurs médecins ont avancé l'hypothèse selon laquelle les symptômes aspécifiques observés dans le cadre du covid long pourraient relever des troubles dits « somatiques fonctionnels » ou « somatoformes », c'est-à-dire résultant d'une psychosomatisation et ne relevant pas d'une explication organique. Bien qu'elle ait suscité de nombreux débats au sein de la communauté scientifique, cette hypothèse est aujourd'hui récusée par le Covars qui affirme qu'il existe désormais « suffisamment d'arguments inflammatoires, immunologiques, neurologiques ou endocrines pour considérer que l'origine du [covid long] repose sur des anomalies organiques » et par les récentes revues de la littérature internationale concernant les origines de cette maladie229(*). Cette reconnaissance n'exclut pas pour autant l'existence de troubles somatoformes pouvant être assimilés à des covid longs et l'éventuelle contribution de facteurs psychologiques et sociaux à certains symptômes.
Plusieurs hypothèses, éventuellement complémentaires, restent émises sur les mécanismes physiopathologiques du covid long. Aussi, des recherches plus approfondies sont nécessaires. La grande diversité des symptômes et l'observation de différents phénotypes cliniques permettent de penser qu'il existerait plusieurs types de covid long et, potentiellement, plusieurs causes sous-jacentes230(*), ce qui rend plus complexes ces recherches.
Parmi les principales hypothèses, on peut d'abord citer la persistance virale - ou de parties de virus - dans l'organisme. La large expression du récepteur ACE2, porte d'entrée du SARS-CoV-2 dans les cellules, dans de nombreux organes, est particulièrement susceptible d'entraîner une persistance du virus à bas bruit dans certains réservoirs231(*). Des études ont signalé la présence de fragments de virus dans le sang, les selles et les urines232(*), ainsi que dans divers organes233(*), et une persistance virale a été associée à un risque accru de covid long234(*).
Il est également possible que la stimulation virale induite par le SARS-CoV-2 entraîne une dérégulation du système immunitaire. Plusieurs études suggèrent que les patients atteints de covid long présenteraient un manque de lymphocytes T et B naïfs235(*), une réponse humorale exagérée dirigée contre le SARS-CoV-2236(*) et une activation du système immunitaire inné, avec notamment l'observation de troubles de l'activation mastocytaire237(*) et une dérégulation du système du complément238(*). La réactivation d'autres virus latents, tels que ceux d'Epstein-Barr (EBV), de l'herpès ou de la varicelle, a également été évoquée comme mécanisme potentiel, des niveaux plus élevés d'anticorps anti-EBV ayant notamment été mis en évidence chez les personnes souffrant de covid long239(*). Enfin, un mécanisme reposant sur l'auto-immunité - c'est-à-dire un dysfonctionnement du système immunitaire qui s'attaquerait aux tissus normaux de l'organisme - a également été proposé, à la suite de l'observation de divers auto-anticorps chez des patients atteints de covid long240(*).
Une autre hypothèse repose sur l'inflammation persistante de certains organes qui pourrait être provoquée par le virus. Des atteintes endothéliales pourraient notamment conduire à la formation de caillots sanguins et provoquer une hypoxie dans certains tissus241(*), en particulier cérébraux242(*).
Le SARS-CoV-2 pourrait enfin avoir un impact sur le microbiote intestinal : une étude de cohorte a montré qu'une telle perturbation était observée chez les patients hospitalisés pour covid-19 et se résolvait pour ceux sans symptôme prolongé mais perdurait pour ceux atteints par un covid long243(*). Un essai randomisé, contrôlé par placebo et en double aveugle, a par ailleurs montré que le traitement par des probiotiques permettait un soulagement de la plupart des symptômes courants du covid long (fatigue, troubles de la mémoire, difficultés de concentration et troubles gastro-intestinaux)244(*).
Outre ces principales hypothèses, des dérégulations au niveau du système nerveux central, des modifications épigénétiques ou des dysfonctionnements des mitochondries ont également été évoqués comme causes potentielles mais constituent, au regard des connaissances actuelles, des pistes moins probables pour le Covars.
Les recherches doivent être poursuivies, la compréhension de l'étiologie et de la physiopathologie du covid long étant une étape essentielle pour le développement de biomarqueurs de diagnostic et de solutions thérapeutiques.
VI. UNE PRISE EN CHARGE À PARFAIRE
A. UNE ABSENCE DE TRAITEMENT CURATIF
En l'absence d'un mécanisme physiopathologique reconnu et malgré de nombreuses recherches et essais cliniques en cours245(*), il n'existe pas de traitement curatif contre le covid long. Aussi, la stratégie thérapeutique recommandée par la Haute Autorité de santé repose sur 4 axes visant à prendre en charge les conséquences cliniques, physiques et psychologiques de la maladie (voir figure ci-après).
Organisation de la stratégie thérapeutique pour les patients ayant des symptômes prolongés à la suite d'une covid-19
Source : Haute Autorité de santé, Réponses rapides dans le cadre de la COVID-19 : Symptômes prolongés à la suite d'une covid-19 de l'adulte - Diagnostic et prise en charge246(*), 2023
Des traitements symptomatiques peuvent d'abord être prescrits pour atténuer certains symptômes du covid long, tels que des analgésiques pour les douleurs, des antihistaminiques pour certains troubles gastro-intestinaux et cutanés, ou des bêtabloquants en cas de certains troubles cardiaques.
Il est ensuite crucial d'apprendre aux patients à analyser leurs symptômes et à reconnaître les seuils d'activité et éventuels facteurs déclenchant associés, dans une perspective d'« autogestion » permettant la poursuite des activités quotidiennes. Ces informations permettent en effet la mise en place d'une stratégie de « pacing », c'est-à-dire une adaptation des activités et un aménagement de l'environnement, afin d'éviter les seuils critiques susceptibles de provoquer l'exacerbation des symptômes et de potentielles rechutes.
En parallèle, une approche rééducative douce, progressive et individualisée doit être définie dans les différents domaines fonctionnels touchés par la maladie247(*) : réadaptation à l'effort, rééducation respiratoire en cas de syndrome d'hyperventilation ou de dyspnée, rééducation olfactive en cas de troubles de l'odorat, rééducation neuropsychologique en cas de troubles cognitifs, etc.
Enfin, pour les patients qui le nécessitent, l'approche thérapeutique doit inclure la prise en charge des troubles anxieux et dépressifs, susceptibles d'être exacerbés par la variabilité et l'imprévisibilité des symptômes et par l'absence de réponses diagnostique et curative satisfaisantes. À cet égard, la Haute Autorité de santé recommande une prise en charge psychothérapeutique, par exemple via une thérapie cognitivo-comportementale - qui a également montré son efficacité sur les patients touchés par une fatigue extrême248(*) - ou pharmacologique, si la situation le requiert.
B. UN DISPOSITIF DE PRISE EN CHARGE BIEN DÉFINI MAIS PAS SUFFISAMMENT DÉPLOYÉ ET MOBILISÉ
Au regard du nombre important de symptômes associés au covid long, la prise en charge doit être multidisciplinaire. La Haute Autorité de santé propose ainsi une structuration en trois niveaux permettant une prise en charge holistique et adaptée aux besoins de chaque patient (voir figure ci-après).
Le premier niveau repose sur les médecins généralistes qui occupent une place centrale en tant que premier recours aux soins. Outre la prise en charge initiale, ils ont un rôle essentiel d'orientation et de coordination de l'offre de soins. Face aux cas médicaux complexes, il est nécessaire de faire appel à la communauté médicale de proximité, qui constitue le second niveau du réseau de prise en charge, afin de mettre en place d'une offre de soins comprenant, comme le recommande la HAS, une approche clinique (en recourant aux médecins spécialistes pour les explorations fonctionnelles et les éventuels avis de second recours), une approche physique (grâce aux kinésithérapeutes et rééducateurs) et une approche psychologique (à l'aide des psychologues et psychiatres). Les centres de référence et les structures spécialisées assument le dernier niveau de prise en charge qui peut être mobilisé pour les tableaux cliniques les plus sévères. Saisie par le ministre de la santé, la Haute Autorité de santé a publié en mai 2024 un guide de parcours de soins afin de préciser les rôles des différents acteurs et leur articulation249(*).
Afin d'assister les médecins généralistes et l'ensemble des professionnels de santé dans ces missions, plusieurs initiatives ont été prises.
Tout d'abord, les recommandations et fiches techniques publiées par la HAS250(*) constituent une ressource précieuse, offrant l'ensemble des informations nécessaires pour réaliser l'évaluation initiale et les diagnostics différentiels et explicitant les modalités de prise en charge et d'orientation des patients. En outre, un auto-questionnaire a été élaboré par l'Assurance maladie, en partenariat avec l'association TousPartenairesCovid, afin d'aider les patients à décrire leurs symptômes et les médecins généralistes à identifier les solutions de prise en charge adaptées251(*). Enfin, des cellules de coordination post-covid ont été mises en place par les Agences régionales de santé afin de structurer les réseaux de prise en charge. Ces cellules peuvent être saisies par les professionnels de santé ou les patients afin de les informer, de les orienter et de faciliter les parcours des soins, en assurant le lien entre l'ensemble des acteurs et en coordonnant les différentes évaluations et interventions. D'après le ministère des solidarités et de la santé, 130 cellules auraient été mises en place sur l'ensemble du territoire métropolitain en janvier 2022252(*).
Organisation du réseau de prise en charge des patients ayant des symptômes prolongés à la suite d'une covid-19
Source : Ministère des solidarités et de la santé253(*)
Malgré ces efforts de structuration, et alors que la loi n° 2022-53 du 24 janvier 2022 recommandait la mise en oeuvre d'unités de soins post-covid pour prendre en charge les pathologies les plus lourdes254(*), le Covars regrette dans son avis de novembre 2023 un « parcours de soins chaotique dont la déclinaison territoriale est hétérogène » : si certaines régions ont mis en place des parcours de soins adaptés et novateurs avec des filières de prise en charge coordonnées, de nombreux territoires souffrent en revanche d'un réseau sous-doté. La situation serait encore plus préoccupante pour la prise en charge pédiatrique avec un très faible nombre de centres spécialisés avec une expertise spécifique sur les défis liés au covid long chez l'enfant. Pour faire face à ce constat, il a été entrepris de créer un cahier des charges commun entre les cellules de coordination post-covid, afin de partager les bonnes pratiques et tenter de résoudre les inégalités.
La feuille de route « Comprendre, informer, prendre en charge » du ministère des solidarités et de la santé prévoyait bien un financement de 20 millions d'euros au titre du Fonds d'investissement régional 2022-2025 pour soutenir les cellules de coordination et la structuration des filières de prise en charge mais, selon le Covars, seuls 5 millions auraient été utilisés sans assurance que ces crédits aient bénéficié au covid long en raison du caractère fongible de ce fonds. La mobilisation de ces financements apparaît dès lors prioritaire pour garantir un parcours de soins complet et facilement accessible à l'ensemble des patients, trop souvent sujets à l'errance médicale.
Pour le Covars, l'offre de soins est également « trop peu lisible » pour les patients et les médecins de premier recours, qui méconnaissent l'existence des cellules de coordination et des structures de prise en charge mises en place255(*). Or, si une trop faible proportion des patients est orientée par les médecins généralistes vers les structures adaptées, celles-ci risquent de pâtir d'un certain désengagement.
À cette méconnaissance des dispositifs de prise en charge, s'ajoute l'insuffisance de la formation et l'information des professionnels de santé sur cette maladie nouvelle256(*). La complexité du diagnostic, qui ne repose pas sur des lésions objectives mais nécessite des investigations longues et approfondies afin d'éliminer les diagnostics alternatifs257(*), conduit à un important sous-diagnostic et à des défauts de prise en charge. La controverse autour de la nature des troubles, parfois présentés comme somatiques, a également entraîné un défaut de reconnaissance du covid long par de nombreux professionnels de santé et une « psychiatrisation » des symptômes, en particulier lorsqu'un lien étiologique avec une infection passée ne pouvait être établi. Par conséquent, de nombreux patients atteints de covid long ont souffert d'un manque d'écoute et de relations parfois difficiles avec le corps médical, générant des sentiments d'abandon et de stigmatisation. La détresse engendrée - qui s'ajoute à celle inhérente à l'affection par une maladie persistante, fluctuante, pour laquelle il n'existe pas de traitement curatif et dont l'évolution et les conséquences à long terme sont mal connues - est en outre susceptible d'accentuer les conséquences psychologiques de la maladie et de conduire certains patients à s'orienter vers des médecines alternatives et des traitements prédateurs n'ayant pas fait preuve de leur efficacité258(*).
Aussi, en parallèle des efforts de structuration de l'offre de soins, il paraît essentiel de mieux former et informer les professionnels de santé sur cette maladie et de leur fournir du matériel pédagogique pour améliorer l'identification, la prise en charge et le suivi des patients qui en sont atteints. Les documents élaborés par la Haute Autorité de santé doivent faire l'objet d'une vaste campagne de communication et être régulièrement actualisés pour prendre en compte l'évolution des connaissances.
À la suite du vote de la loi du 24 janvier 2022 visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19259(*), un espace d'information a été récemment mis en place sur le site internet sante.fr afin d'informer le grand public et les médecins généralistes260(*). Enfin, si des formations existent, il est primordial d'inciter les médecins à les suivre afin de les sensibiliser à cette problématique nouvelle.
VII. DES CONSÉQUENCES IMPORTANTES SUR LA VIE DES PATIENTS
A. DES DIFFICULTÉS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELLES
Dans de nombreux cas, les symptômes associés au covid long ont un aspect invalidant et un large retentissement sur la vie quotidienne des patients qui en sont atteints, notamment en raison de malaises post-efforts à la suite d'activités physiques ou intellectuelles. Comme l'évoque le Covars, la pandémie de « grippe russe » en 1890 - probablement causée par un coronavirus - avait déjà conduit à un nombre élevé de formes prolongées de la maladie et amené la presse britannique à parler d'« une nation de convalescents incapables de retourner au travail ».
Ainsi, l'étude de Santé publique France a montré que, chez les 4 % des adultes touchés par un covid long, un impact « au moins modéré sur les activités quotidiennes » était déclaré dans plus de la moitié des cas et un impact « fort ou très fort sur les activités quotidiennes » pour un tiers de ceux-ci261(*). Ces données rejoignent celles de l'Office for National Statistics britannique, qui estime que 79 % des personnes ayant déclaré un covid long sont affectées négativement dans leurs activités quotidiennes et que 20 % d'entre elles se considèrent « fortement limitées » dans celles-ci262(*), ou de l'étude de cohorte française ComPaRe, qui fait état de symptômes décrits comme « insoutenables » par 77 % des patients et d'un empêchement dans la réalisation des tâches de la vie quotidienne pour près de la moitié d'entre eux (48 %)263(*).
Ces difficultés ne se limitent pas à un impact individuel et familial mais se traduisent également par des répercussions sur la vie professionnelle des patients, avec une baisse de productivité, une hausse des arrêts maladie et, pour les cas les plus graves, un risque de licenciement ou de démission. En France, parmi les patients suivis dans le cadre du programme de prise en charge du covid long à l'Hôtel Dieu, seuls 30 % avaient repris un emploi à temps partiel et 50 % à temps plein un an après avoir contracté l'infection264(*). Une enquête menée en ligne a également montré que près de la moitié des répondants atteints par un covid long travaillaient à temps réduit, tandis qu'un quart d'entre eux ne travaillaient plus en raison de leur maladie (à la suite d'arrêts maladie, de congé d'invalidité, de licenciement ou de démission)265(*).
Ces impacts, associés à l'importante prévalence du covid long, se traduisent par des conséquences notables sur le marché du travail. Dans l'Union européenne, l'impact négatif du covid long sur l'offre de main-d'oeuvre a été estimé entre 0,3 et 0,5 % de celle-ci en 2022 (soit entre 621 000 et 1 112 000 équivalents temps plein)266(*).
De la même manière, il a été estimé que le covid long avait entraîné la perte de l'équivalent de 80 000267(*) à 110 000268(*) travailleurs au Royaume-Uni et de 1,8 à 4,1 millions269(*) aux États-Unis, avec des conséquences importantes en termes de pertes de revenus (1,5 milliard de livres sterling par an au Royaume-Uni et entre 105 et 235 milliards de dollars américains par an aux États-Unis).
Pour les patients ayant repris une activité professionnelle, un déficit de reconnaissance des difficultés rencontrées et un risque important de discrimination ont pu être constatés. Au Royaume-Uni, deux tiers des patients interrogés dans le cadre d'une enquête menée par un syndicat et une association de patients ont déclaré avoir subi des traitements injustes en raison de leur maladie (brimades, harcèlement, menaces de mesures disciplinaires, remise en cause de leur maladie, etc.)270(*). Aussi, plus de 90 % des patients touchés par un covid long vivraient dans la crainte des préjugés liés à leur maladie271(*).
Les études portant sur l'impact du covid long chez les enfants et adolescents sont moins nombreuses mais suggèrent des conséquences analogues. La fatigue et les troubles cognitifs peuvent affecter de manière significative les résultats et la fréquentation scolaires. Selon une revue de la littérature, les différentes études disponibles rapportent un effet sur l'assiduité scolaire dans 10,5 à 58,9 % des cas272(*). Une étude espagnole a montré que, parmi 50 enfants et adolescents touchés par un covid long, outre les 18 % qui ne pouvaient plus aller à l'école et 34 % qui nécessitaient un emploi du temps réduit en raison de leurs symptômes, 66 % avaient vu leurs résultats scolaires diminuer et 68 % avaient dû arrêter leurs activités extrascolaires273(*).
Les efforts pédagogiques sur le covid long doivent donc également inclure les médecines du travail et scolaire, qui ont un rôle crucial à jouer dans l'accompagnement des patients. Un travail de formation doit être entrepris pour promouvoir la mise en place de plans de retour au travail ou à l'école adaptés et d'actions de sensibilisation dans les milieux professionnels et scolaires afin d'éviter tout risque de stigmatisation.
B. UNE PRISE EN CHARGE SANITAIRE ET SOCIALE LIMITÉE
Ces répercussions professionnelles peuvent se traduire par des difficultés économiques pour les patients, comme cela a été observé au Royaume-Uni274(*) et aux États-Unis275(*). Ces difficultés peuvent en outre être aggravées par les frais de santé liés à la prise en charge de la maladie, susceptibles d'être élevés en raison de la multiplicité des symptômes. Aussi, il est primordial de disposer d'un dispositif de prise en charge sociale adapté afin d'éviter tout risque de précarisation des patients les plus gravement touchés.
Le dispositif d'ALD (affection longue durée) exonérante semble bien adapté au covid long puisqu'il permet une prise en charge intégrale des soins et traitements, dans la limite du plafond de remboursement de l'Assurance maladie, et de bénéficier du dispositif du tiers payant et d'une indemnisation prolongée des arrêts de travail.
Or, malgré les demandes portées par les associations de patients, il n'existe à ce jour pas d'ALD exonérante spécifique pour le covid long276(*). Les patients touchés par cette maladie peuvent toutefois bénéficier du dispositif ALD sous certaines conditions :
- si le patient bénéficie déjà d'une ALD pour une autre maladie et que celle-ci s'aggrave à la suite d'une infection par le SARS-CoV-2, l'aggravation est prise en charge par l'ALD existante ;
- si les séquelles associées au covid long correspondent à une maladie inscrite dans la liste des ALD, le patient peut bénéficier du dispositif au titre de cette maladie ;
- si la maladie est grave ou évolutive ou invalidante, que la durée prévisible du traitement est supérieure à 6 mois et que celui-ci est particulièrement coûteux277(*), le patient peut bénéficier d'une ALD hors liste.
Selon les chiffres communiqués par Dominique Martin, médecin-conseil national de la Caisse nationale de l'Assurance maladie, 6 430 personnes ont été admises en ALD pour covid long de mars 2020 à décembre 2023.
En 2020, un tableau de maladie professionnelle avait été créé pour les formes respiratoires sévères de la covid-19278(*). Parallèlement, pour les formes respiratoires graves de la maladie ne remplissant pas les conditions médico-administratives exigées par ce tableau (délai de prise en charge dépassé ou professionnels non désignés dans la liste limitative des travaux du tableau), ainsi que pour les formes graves non-respiratoires non couvertes par celui-ci (comme les cas de covid long), un comité unique avait été mis en place pour examiner les demandes279(*).
Les informations communiquées par la Caisse nationale de l'Assurance Maladie indiquent que, parmi les 6 051 dossiers de demandes de reconnaissance de maladie professionnelle reçus fin 2023 - dans le cadre du tableau ou du système complémentaire -, 3 421 avaient fait l'objet d'un refus et 2 630 d'une reconnaissance. Parmi ces dernières, 974 reconnaissances l'avaient été au titre de la voie complémentaire, dont 267 pour des symptômes persistants.
Ces chiffres contrastent nettement avec les estimations du nombre de personnes fortement invalidées par un covid long. Il apparaît dès lors nécessaire de résoudre les difficultés d'accès à ces dispositifs de prise en charge. Le Covars observe une certaine hétérogénéité dans les décisions d'accès à l'ALD, qui dépendraient du médecin-conseil chargé de l'examen du dossier. Cependant, le faible taux de prise en charge semble avant tout découler d'une insuffisance de demandes plutôt que d'un nombre élevé de refus. Il en est de même pour la reconnaissance du covid long en maladie professionnelle, une proportion élevée des demandes reçues par le comité unique faisant l'objet d'une reconnaissance. Par conséquent, il est crucial d'améliorer l'information des médecins généralistes sur ces possibilités de prise en charge et de leur proposer un accompagnement dans la construction des demandes grâce aux cellules de coordination post-covid.
VIII. UNE RECHERCHE QUI DOIT ÊTRE SOUTENUE
Les connaissances disponibles sur cette maladie émergente sont réduites. Il est donc impératif de mener des recherches afin de mieux la comprendre, la suivre et la prendre en charge. En particulier, développer un cadre adapté susceptible de stimuler les travaux sur cette thématique paraît nécessaire. À cet égard, on peut saluer l'action coordonnée « covid long » créée au sein de l'ANRS-MIE, en janvier 2021, pour animer la communauté scientifique et fournir une aide et un accompagnement pour la mise en place de collaborations et la construction de projets. Cet effort de coordination est d'autant plus nécessaire que la complexité du sujet et la multiplicité des hypothèses physiopathologiques peuvent rendre difficiles les recherches, faute de piste claire à prioriser.
Par ailleurs, afin d'encourager la recherche sur les aspects épidémiologiques, physiopathologiques, thérapeutiques, médico-économiques et sociaux du covid long, un appel à projets a été lancé par l'ANRS-MIE. Organisé en deux vagues - une première en novembre 2021 puis une seconde en février 2022 - avec un budget de 10 millions d'euros, provenant du ministère de la santé et de la prévention (48 %), du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (35%) et de la Fondation pour la recherche médicale (17 %), il a permis le financement de 26 projets, se répartissant équitablement entre recherche clinique, recherche fondamentale et recherche en santé publique et sciences humaines et sociales.
D'autres travaux ont également pu bénéficier de financements provenant de sources non spécifiquement dédiées au covid long. Ainsi, le Covars mentionne un total de 43 projets de recherche sur le covid long, pour un montant de 17,1 millions d'euros, dont 15,5 millions de financement de l'État.
Bien que notable, cette enveloppe s'avère nettement inférieure aux meilleurs standards internationaux, comme en témoignent les exemples britannique (plus de 50 millions de livres sterling)280(*) et états-unien (plus d'un milliard de dollars américains)281(*).
Il est essentiel de continuer l'effort de recherche transdisciplinaire sur cette maladie et de la doter de moyens ambitieux. Les projets de recherche financés par l'ANRS-MIE devant prochainement parvenir à leur terme, il apparaît indispensable de flécher de nouveaux financements vers cette thématique, pour laquelle il subsiste de nombreuses incertitudes et qui représente un enjeu majeur de santé publique.
Les rapporteurs soulignent que la poursuite du dérèglement climatique, conjugué à la globalisation, devrait favoriser l'émergence de nouvelles maladies infectieuses, notamment d'arboviroses, connues pour être de grandes pourvoyeuses de syndromes post-infectieux. Les recherches sur le covid long constituent une opportunité de porter un nouveau regard sur ces maladies, actuellement mal comprises, et d'éviter de se trouver démuni face à de tels troubles dans le cadre d'une crise sanitaire future.
IX. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Malgré le nombre élevé de personnes affectées depuis le début de la pandémie et la lourdeur des conséquences engendrées, le covid long demeure une affection mal comprise. Aujourd'hui encore, les dimensions épidémiologiques, physiopathologiques, thérapeutiques, médico-économiques et sociales du covid long font l'objet de nombreuses interrogations qui expliquent le manque de reconnaissance et d'attention envers cette maladie, au regard des enjeux représentés.
Aussi, deux ans après la publication de son dernier rapport, l'Office réaffirme que les quatre leviers qu'il avait identifiés doivent faire l'objet d'un engagement soutenu : un parcours de soins organisé et structuré, une formation et un accompagnement des professionnels de santé, une information pour les patients et des dispositifs de reconnaissance adaptés.
Des efforts doivent donc encore être menés afin que l'ensemble des patients se voient proposer un parcours de prise en charge efficace et organisé, traitant les dimensions cliniques, physiques, psychologiques et sociales de la maladie. Une vaste campagne d'information doit être déployée sur le covid long à l'intention de l'ensemble de la communauté médicale et paramédicale, afin de communiquer les dernières connaissances disponibles et de fournir l'ensemble des ressources nécessaires à la bonne prise en charge des patients. Il est également impératif de mobiliser les services de médecine du travail et scolaire et d'éduquer les patients sur leur propre maladie, de manière à ce qu'ils puissent adapter leurs activités et leur environnement en fonction des symptômes et éviter tout risque d'isolement social et de précarisation. Enfin, il est nécessaire d'informer et de sensibiliser l'ensemble de la population sur la réalité de cette maladie, sur les risques et difficultés qui lui sont associés, et sur les actions de prévention susceptibles d'être mises en oeuvre pour éviter ses complications (c'est-à-dire principalement la prévention des infections par le SARS-CoV-2). En parallèle, il convient de continuer à soutenir et à promouvoir les recherches afin d'accroître les connaissances sur cette maladie et sur les solutions susceptibles d'être déployées pour y faire face.
RECOMMANDATIONS
1. Développer et harmoniser les parcours de soins pour covid long sur l'ensemble du territoire.
2. Mettre en place la plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19, prévue par la loi du 24 janvier 2022.
3. Former et informer les professionnels médicaux et paramédicaux sur le covid long et sur les méthodes de diagnostic et de prise en charge médicale et sociale. Renforcer le rôle des cellules de coordination post-covid pour l'accompagnement les soignants.
4. Créer une ALD et un tableau de maladie professionnelle spécifiques pour les formes prolongées de la covid-19, afin de favoriser leur prise en charge sanitaire et sociale.
5. Mener une campagne nationale d'information, de sensibilisation et de prévention sur le covid long.
6. Poursuivre les recherches transdisciplinaires sur cette maladie, en finançant notamment de nouveaux appels à projets dédiés.
TROISIÈME
PARTIE
LES NOUVEAUX OUTILS DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET
D'ANTICIPATION SANITAIRE
I. INTRODUCTION
Une mobilisation mondiale sans précédent de la science et des scientifiques a permis de répondre avec succès à la crise sanitaire. De nombreuses connaissances ont été rapidement acquises, à commencer, dès début janvier 2020, par la séquence complète du génome du SARS-CoV-2, puis sur les mécanismes et la physiopathologie de l'infection. Parallèlement, de nombreuses innovations sont venues en soutien des mesures de santé publique mises en place, notamment pour suivre et limiter la circulation du virus et, en conséquence, réduire le nombre de décès282(*). Le développement de vaccins efficaces en moins d'une année a indéniablement constitué la plus grande prouesse, ceux-ci ayant permis d'atténuer l'impact de la covid-19 et de mettre fin à l'urgence de santé publique de portée internationale. Mais on peut également citer le développement de tests antigéniques rapides, de bases de données interconnectées, d'applications de suivi des contacts, de systèmes de surveillance des eaux usées, etc. À titre de comparaison, le développement des trithérapies pour faire face au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et celui des antiviraux à action directe pour le traitement de l'hépatite C avaient nécessité plus de 15 ans. Il est aujourd'hui nécessaire de tirer les enseignements de la crise alors que la phase aiguë de la pandémie est désormais révolue, et de capitaliser sur les succès scientifiques obtenus afin de repenser le suivi et la gestion des urgences sanitaires et de se préparer au mieux aux probables crises futures.
II. LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET SON ÉVOLUTION FACE À LA COVID-19
A. UN MODÈLE MULTI-SOURCES
La surveillance épidémiologique vise à suivre l'émergence et l'évolution spatio-temporelle des épidémies et autres problèmes de santé. Elle permet d'acquérir des connaissances sur les caractéristiques des maladies, telles que leur transmissibilité ou les facteurs de risque, tout en suivant leur impact sur la santé de la population. L'ensemble des données acquises permet d'orienter la mise en oeuvre de mesures d'alerte, de prévention et de contrôle appropriées, et d'évaluer leur efficacité une fois celles-ci déployées.
En France, cette surveillance est coordonnée par Santé publique France qui compile des données de différentes natures (résultats de dépistage, taux de consultation en médecine de ville, nombre de patients en hospitalisation et en réanimation, nombre de décès, etc.) issues de différents outils (registres, bases médico-administratives, enquêtes spécifiques, etc.) et provenant de différentes sources (laboratoires, médecine de ville, médecine hospitalière, etc.). L'interprétation de l'ensemble de ces indicateurs permet de mesurer la prévalence des maladies suivies, de suivre leur évolution et d'évaluer leur impact sur le système de santé, fournissant ainsi une image globale de la situation sanitaire et permettant d'anticiper les risques à venir.
Dans le cadre de la covid-19, la surveillance épidémiologique s'est avérée cruciale pour suivre et contenir la propagation du virus ainsi que les charges de morbidité et de mortalité associées. Plusieurs nouveaux outils ont été déployés afin de renforcer le dispositif existant. Des systèmes d'information ont été mis en place pour suivre la propagation du virus, grâce aux données de dépistage (SI-DEP) et aux cas d'infections respiratoires aiguës dans les établissements et services médico-sociaux (SI-ESMS), pour suivre la gravité de l'épidémie et son impact sur le système de soins, au travers du nombre de cas en hospitalisation et en réanimation (SI-VIC), et pour suivre la couverture vaccinale (SI-VAC). La structuration du consortium Emergen (surveillance et recherche sur les infections à pathogènes émergents via la génomique microbienne) a permis d'augmenter considérablement les capacités de séquençage françaises et d'assurer un suivi génomique de l'évolution du virus. L'analyse des eaux usées, réalisée à travers le consortium Obépine puis le réseau SUM'Eau, a offert un moyen de suivi complémentaire de la circulation du virus, indépendant de la stratégie de dépistage.
Dispositif de surveillance intégrée des infections aiguës respiratoires avant et pendant la covid-19
Note : en rouge, les
dispositifs nouvellement déployés
Source : Santé publique France
Bien qu'il ne s'agisse plus d'une urgence sanitaire de portée internationale, la covid-19 continue de circuler et d'entraîner des décès283(*). Il convient donc de pérenniser les outils développés, afin de suivre le nombre d'infections et l'évolution du virus, tout en les adaptant au niveau de circulation actuel du SARS-CoV-2 et à la menace plus limitée qu'il représente désormais. Dans cette perspective, Santé publique France a récemment fait évoluer son mode de restitution de la surveillance des principales infections respiratoires aiguës (grippe, covid-19 et bronchiolite)284(*). Les indicateurs produits pour ces infections qui étaient jusqu'alors dispersés dans des bulletins distincts - ce qui se justifiait lors de la phase aiguë de la crise de la covid-19 qui nécessitait un suivi dédié - sont dorénavant combinés dans un bulletin hebdomadaire commun, permettant d'offrir une vision plus globale et de mieux apprécier l'impact cumulé de ces maladies sur le système de soins, paramètre essentiel pour guider les décisions de santé publique.
B. DE NOUVEAUX FICHIERS
Afin d'appréhender au mieux la situation épidémique et éclairer les décisions publiques, plusieurs systèmes d'information ont été mobilisés au cours de la crise sanitaire. Créé en 2016 pour le suivi des victimes d'attentats, le fichier SI-VIC (système d'information pour le suivi des victimes d'attentats et de situations sanitaires exceptionnelles) a été adapté pour centraliser les informations relatives aux patients faisant l'objet d'une prise en charge hospitalière. En complément, plusieurs systèmes ont été créés spécifiquement pour répondre à la crise sanitaire : le fichier SI-DEP (système d'information national de suivi du dépistage) regroupant les résultats des tests RT-PCR et antigéniques, le fichier SI-VAC (système d'information vaccin covid) rassemblant les données relatives à la vaccination et le fichier Contact-Covid permettant d'assurer le suivi des cas positifs et la remontée des chaînes de contamination.
Parmi ces différents fichiers, les systèmes SI-DEP et Contact-Covid ont été autorisés par la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions285(*). Puis, avec l'amélioration du contexte sanitaire, la loi du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19286(*) a interrompu le traitement des données personnelles issues de ces systèmes à compter du 31 janvier 2023 pour le fichier Contact-Covid et du 30 juin 2023 pour le fichier SI-DEP. Les consignes de saisie dans SI-VIC, permettant la surveillance hospitalière des patients atteints par la covid-19, ont également été levées à compter du 30 juin 2023.
La surveillance de la covid-19 a donc évolué. Une version simplifiée du fichier SI-DEP, dénommée néoSI-DEP, permise juridiquement par l'ajout de la covid-19 à la liste des maladies à déclaration obligatoire287(*), est désormais utilisée. Ce système recense uniquement les résultats des tests RT-PCR et antigéniques réalisés par les laboratoires de biologie médicale - et non ceux effectuées par les professionnels de santé - et n'inclut aucune information sur le profil des patients et les circonstances de l'infection288(*). Cette solution n'est toutefois utilisée que de manière transitoire dans l'attente d'un nouveau système plus exhaustif, construit sur la base de SI-DEP et dénommé Laboé-SI, qui devrait voir le jour en juin 2024 afin de recueillir les résultats des tests covid mais également des tests grippe et VRS.
En anticipation de futures crises sanitaires, ce nouveau fichier bénéficiera de fonctionnalités activables en cas de nécessité, afin par exemple d'étendre la remontée des tests aux professionnels de santé pour répondre plus efficacement à des besoins accrus en matière de surveillance. À l'avenir, ce nouvel outil pourra également être étendu à d'autres agents pathogènes (au VIH, aux arboviroses, aux hépatites, à la tuberculose, etc.), et même à des données non-infectieuses (cholestérol, glycémie, etc.), dans le but d'améliorer le suivi de ces problèmes de santé et de guider et évaluer les politiques de santé publique.
Le suivi des indicateurs hospitaliers repose aujourd'hui sur les données non-exhaustives fournies par le réseau Oscour (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences), qui recense le nombre de passages aux urgences et d'hospitalisations subséquentes pour covid-19 ou suspicion de covid-19, ainsi que sur le réseau Sentinelles, qui procure des informations sur le nombre et les caractéristiques de cas admis en réanimation. Un projet dénommé Orchidée (Organisation d'un réseau de centres hospitaliers impliqués dans la surveillance épidémiologique et la réponse aux émergences), tirant les leçons des limites et imperfections du fichier SI-VIC289(*), est en cours de développement par Santé publique France. Il vise à fournir un système d'information, plus robuste et pérenne, pour des pathologies susceptibles de conduire à une hospitalisation grâce aux entrepôts de données de santé hospitaliers. Outre les infections respiratoires aigües, ciblées en priorité, ce système pourra également permettre de surveiller d'autres pathologies, à l'instar du fichier Laboé-SI.
En plus de ces premières initiatives, d'autres projets, inspirés des solutions mises en oeuvre pendant la crise ou dont la nécessité a été mise en exergue par celle-ci, ont été évoqués comme perspectives de travail par Santé publique France lors de son audition. On peut citer la nécessité d'une unification des réseaux de surveillance en médecine ambulatoire pour assurer une meilleure couverture territoriale, la généralisation de la certification électronique des décès pour permettre un suivi plus réactif des décès et causes de décès, et le développement d'un carnet de vaccination électronique pour suivre l'ensemble des couvertures vaccinales et évaluer les politiques de vaccination.
C. LA STRATÉGIE DE DÉPISTAGE ET LA PLACE DES TESTS ANTIGÉNIQUES
Les tests de dépistage du SARS-CoV-2 remplissent plusieurs objectifs. Premièrement, ils contribuent à surveiller la progression de l'épidémie et à fournir des informations sur ses caractéristiques : sa gravité et les facteurs de risque associés grâce aux taux d'hospitalisation et de décès des personnes dépistées positives et à leurs profils, la transmissibilité du virus grâce à l'évolution du nombre de cas déclarés, son évolution grâce au séquençage des échantillons, etc. Ils jouent un rôle crucial dans le contrôle de l'épidémie en permettant la mise en place des mesures individuelles de précaution (isolement, gestes barrières, etc.) et l'identification des éventuels cas contacts290(*) pour les personnes dépistées positives. Enfin, à l'échelle individuelle, ils permettent d'orienter la prise en charge des patients.
Grâce à la publication rapide de la séquence génétique du virus, des tests RT-PCR, détectant son matériel génétique, ont pu être développés et utilisés dès le début de la crise. Si ces tests ont l'avantage d'être relativement sensibles, ils ne permettent d'obtenir un résultat qu'après plusieurs heures - généralement entre 24 et 72 heures -, ce qui empêche la mise en place de mesures de distanciation rapides ; par ailleurs, leur déploiement est freiné par les capacités d'analyse limitées des laboratoires291(*). Après la première vague, des tests antigéniques, qui ne détectent pas le génome viral mais des protéines du virus, ont également été développés. Bien que moins fiables que les tests RT-PCR, ils ont l'avantage de ne pas nécessiter de traitement en laboratoire et donc de fournir des résultats rapides à un plus faible coût, leur permettant d'être facilement utilisés à grande échelle. Ils ont notamment permis une stratégie de dépistage basée sur des tests réguliers et préventifs - non limitée aux personnes présentant des symptômes ou identifiés comme cas contact - et, ainsi, de détecter plus précocement les individus infectés292(*). Si la valeur ajoutée de ces tests en termes de surveillance épidémiologique est réduite, notamment en raison du risque relativement important de faux négatifs, ils ont toutefois pu servir de source complémentaire de données afin de renforcer l'exhaustivité de la surveillance.
Aujourd'hui, alors que la crise est entrée dans un « nouvelle normalité », on constate une forte diminution du taux de dépistage. Pour Santé publique France, cela ne remet toutefois pas en cause le caractère adapté et satisfaisant de la surveillance virologique du SARS-CoV-2, qui a principalement un intérêt en termes de tendance et est complétée par d'autres indicateurs disponibles.
Récemment, des tests rapides détectant simultanément les principaux virus responsables des infections respiratoires aiguës - SARS-CoV-2, influenza et VRS, on parle alors de tests « triplex » - ont été développés et offrent une nouvelle opportunité pour la prise en charge de ces épisodes infectieux, en identifiant leur étiologie et en favorisant la mise en place des mesures thérapeutiques ou prophylactiques adaptées. Par exemple, ils permettraient de réduire la prescription d'antibiotiques alors qu'une origine virale a été identifiée293(*), à l'instar des tests rapides d'orientation diagnostique de l'angine, disponibles en officine, qui permettent de détecter une origine bactérienne.
Saisie par la Direction générale de la Santé (DGS), la Haute Autorité de santé a publié en juin 2023 un rapport d'évaluation technologique sur l'intérêt des tests recherchant un ou plusieurs des virus responsables des infections respiratoires aiguës294(*). Elle conclut que « la recherche antigénique rapide combinée des virus grippaux et/ou du VRS en réalisation conjointe avec celle du SARS-CoV-2 par des TROD [...] ne présent[e] pas à l'heure actuelle, à l'échelon individuel, d'intérêt médical démontré dans le diagnostic des infections respiratoires aiguës en ville », notamment en raison d'une sensibilité moyenne des tests grippe et VRS, qui crée un risque élevé de faux négatifs295(*), et d'une utilité clinique limitée en termes de prévention de nouvelles contaminations de personnes à risque. Si un intérêt médical à l'échelon populationnel est potentiellement évoqué, du fait d'une baisse des consultations pour des infections sans gravité et du mésusage d'antibiotiques, la Haute Autorité de santé recommande de conduire des études pour mesurer l'impact que ces tests sont susceptibles d'avoir et de définir les indications qui justifieraient leur utilisation.
D. LA SURVEILLANCE VIA LES EAUX USÉES
1. L'intérêt de l'épidémiologie à partir des eaux usées
Les eaux usées sont le réceptacle des matières fécales et des fluides corporels excrétés par les humains. Elles contiennent ainsi une large variété de contaminants, comme des métabolites de médicaments ou des agents pathogènes (bactérie, virus, parasite), et leur analyse permet de mener diverses études épidémiologiques.
Le suivi des eaux usées présente plusieurs avantages significatifs en termes de suivi des maladies infectieuses. Tout d'abord, il fournit des résultats indépendamment de l'état de santé des individus, que ceux-ci soient symptomatiques ou asymptomatiques, tant qu'ils excrètent une quantité de matériel viral suffisamment importante pour que celui-ci puisse être caractérisé. Il permet de suivre l'ensemble d'une population sans être influencé par la stratégie de dépistage mise en oeuvre, l'efficacité de celle-ci dépendant de la sensibilité et de la spécificité des tests, variables selon la maladie, de leur disponibilité, qui peut être limitée, et du recours à ceux-ci, susceptible d'induire des biais. Il ne dépend pas non plus de l'accès à l'offre de soins, également susceptible de souffrir de limitations, comme les indicateurs issus de la médecine de ville ou hospitalière.
Cette méthode permet d'obtenir des informations relativement rapides pour suivre la dynamique d'une maladie infectieuse dans une temporalité proche du réel296(*), contrairement à la plupart des indicateurs traditionnellement utilisés. Cela la rend particulièrement efficace pour détecter précocement l'émergence de nouveaux foyers épidémiques et pour mettre en oeuvre rapidement des mesures de santé publique adaptées (mesures d'atténuation, déploiement d'une stratégie de dépistage, etc.). L'intérêt est donc particulièrement marqué pour les maladies dont les symptômes ne sont pas spécifiques ou tardifs, susceptibles d'entraîner des consultations médicales retardées, et celles pour lesquelles les outils diagnostiques sont peu disponibles ou faiblement efficaces. Enfin, cette approche permet de suivre de vastes groupes de population à des coûts relativement limités par rapport aux méthodes de suivi traditionnelles basées sur des tests de dépistage. En revanche, elle ne fournit qu'un suivi communautaire, qui ne permet pas d'estimer avec précision le nombre de personnes infectées, de localiser les clusters de manière précise297(*) ou de recueillir des informations sur les caractéristiques des personnes contaminées ou sur la gravité de la maladie.
Initialement développée aux États-Unis pour suivre la poliomyélite, cette technique reste aujourd'hui utilisée dans certains pays où cette maladie est endémique298(*) ou, de façon ponctuelle, en cas de résurgence299(*). Cette approche a également été utilisée pour détecter les bactéries du choléra300(*) ou de la fièvre typhoïde301(*), ainsi que plusieurs virus entériques302(*). Dans certains cas, les eaux usées ont également servi à obtenir des informations collectives sur la consommation de drogues, comme dans le cadre du réseau Score (Sewage analysis Core group) de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies303(*), ou de médicaments, comme les antidépresseurs304(*).
2. L'utilisation dans le cadre de la covid-19
a) Un intérêt confirmé pour le suivi du SARS-CoV-2
Grâce aux connaissances acquises à partir des précédents coronavirus, il a été envisagé dès le début de la crise sanitaire que le SARS-CoV-2 puisse être présent dans le tube digestif et excrété dans les matières fécales, ouvrant la voie à un suivi de l'épidémie par l'intermédiaire des eaux usées. Dans un contexte de capacités de dépistage limitées, cette méthode offrait une formidable opportunité de surveiller la propagation du virus de manière exhaustive, en tenant compte des personnes asymptomatiques et pré-symptomatiques305(*).
Dès le début de l'année 2020, des recherches menées aux Pays-Bas ont mis en évidence la possibilité de quantifier le SARS-CoV-2 dans les eaux usées et l'intérêt de cette méthode pour détecter la circulation du virus avant même que les premiers cas soient déclarés306(*). De manière similaire, en France, le consortium Obépine (Observatoire épidémiologique dans les eaux usées) a montré dès mars 2020 la présence du virus dans les stations d'épuration d'Île-de-France et la possibilité d'observer l'effet du premier confinement sur la réduction de la charge virale307(*). Ces travaux séminaux ont ainsi démontré la faisabilité d'utiliser l'analyse des eaux usées pour suivre l'épidémie, de manière quantitative et dans une temporalité pertinente pour une approche de surveillance épidémiologique.
De multiples travaux académiques conduits alors ont montré la possibilité de construire, à partir du suivi des eaux usées, des indicateurs dont la dynamique est corrélée à la circulation du virus en population humaine et qui permettent d'anticiper les tendances épidémiologiques, afin de fournir une information précoce aux pouvoirs publics, à la population et aux professionnels de santé308(*). Portée par ces résultats encourageants, cette approche a rapidement suscité un vif intérêt à l'échelle mondiale, entraînant la mise en place de nombreuses initiatives309(*). Principalement utilisée dans les stations de traitement des eaux usées, cette méthode a également pu être mise en place à l'échelle d'un bâtiment310(*) ou d'un quartier311(*), permettant une identification plus précise des éventuels foyers de contagion et des situations de reprise épidémique.
Les travaux de recherche menés au cours de la crise ont démontré que les données issues des eaux usées étaient susceptibles d'avoir une avance allant de 0 à 14 jours par rapport à celles issues des tests individuels312(*). Ce délai peut toutefois considérablement varier au sein d'un même réseau de surveillance, selon la station considérée313(*) et en fonction de l'efficacité de la stratégie de dépistage parallèlement mise en place314(*). Il a par exemple été montré dans le Massachusetts que, si le suivi des eaux usées avait précédé les cas cliniques déclarés lors de la première vague de la pandémie, un tel effet n'avait pas été observé au cours de la deuxième vague, en raison de l'augmentation des capacités de dépistage permettant de détecter et de déclarer les cas plus rapidement315(*). De plus, la succession des différents variants est également susceptible d'affecter les paramètres de l'excrétion virale et d'avoir un impact sur la précocité du suivi. À titre d'exemple, en Californie, l'avance du suivi des eaux usées a diminué avec l'apparition du variant Delta et même disparu avec l'émergence du variant Omicron316(*). Enfin, la couverture vaccinale de la population et l'immunité naturelle influent également sur l'excrétion virale, ajoutant ainsi une nouvelle source de variation dans le suivi des eaux usées, tant sur le plan spatial - l'immunisation n'étant pas nécessairement homogène - que temporel.
De manière similaire, le rapport entre les concentrations virales mesurées dans les eaux usées et le nombre de personnes infectées varie, à la fois dans l'espace et dans le temps. Du fait d'un manque de connaissances sur le taux et la dynamique d'excrétion du virus, qui dépendent de nombreux facteurs (âge, sexe, statut immunitaire, variant contracté, gravité de la maladie, etc.), mais du fait également de l'influence potentielle des précipitations, des infiltrations ou des rejets d'eau industriels, qui peuvent induire une certaine dilution317(*), il apparaît aujourd'hui impossible, compte tenu des connaissances disponibles, d'estimer précisément le nombre de personnes infectées en se basant uniquement sur la quantité virale détectée dans les eaux usées. Il en résulte une certaine incertitude qui relativise l'interprétation épidémiologique des indicateurs issus des eaux usées ; un variant associé à une excrétion virale plus élevée - comme cela semble être le cas du récent variant JN.1318(*) - peut ainsi conduire à une surestimation de la reprise épidémique.
En complément du suivi des tendances épidémiques, l'analyse par séquençage des échantillons prélevés dans les eaux usées permet de suivre la diversité génétique virale en circulation. En France, des travaux exploratoires ont montré, dès 2021, la possibilité de suivre les dynamiques de circulation des variants dans la population à partir des eaux usées319(*). Cette approche a l'avantage de pouvoir analyser l'ensemble des variants en circulation et, ainsi, de s'abstraire du biais induit par le recours au dépistage. Cela permet d'observer des variants dits « cryptiques », rarement identifiés parmi les échantillons cliniques320(*). À l'échelle internationale, plusieurs travaux ont montré que cette approche pouvait offrir des résultats comparables à ceux obtenus par l'usage de tests individuels321(*) et permettre de détecter les futurs variants d'intérêt322(*) avec une certaine précocité, comme pour les tendances épidémiologiques.
À l'heure actuelle, alors que le nombre de tests a considérablement diminué, l'intérêt du suivi des eaux usées apparaît, malgré les limites soulignées, plus pertinent que jamais pour surveiller et anticiper la circulation et l'évolution du SARS-CoV-2. De plus, le caractère coût-efficient de cette approche323(*) la rend particulièrement adaptée pour assurer un suivi continu de la population au long terme, contrairement à une stratégie de dépistage à grande échelle324(*).
b) Évolution du dispositif français
Le consortium de recherche Obépine s'est formé dès le début de l'année 2020 autour de virologues, microbiologistes, hydrologues et modélisateurs, afin d'évaluer le potentiel d'un suivi épidémiologique du SARS-CoV-2 via les eaux usées325(*). De premiers travaux encourageants sur l'intérêt de cette méthode ont permis au Comité analyse, recherche et expertise covid-19 (CARE) d'identifier cette stratégie comme un axe de recherche prioritaire. Le consortium Obépine a ainsi pu bénéficier d'un financement de 3,5 millions d'euros du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour mettre en oeuvre un réseau expérimental à l'échelle nationale, afin d'étudier la faisabilité d'une telle surveillance pendant un an. Les recherches ont permis de mettre au point des protocoles d'analyse et d'exploitation des données, d'identifier une stratégie d'échantillonnage et de construire un réseau de laboratoires pour suivre en routine la dynamique de circulation du virus dans plus de 200 stations. Les résultats de ces travaux ont été présentés en accès libre sur un site internet dédié326(*).
Exemple de synthèse des tendances de l'évolution de l'indicateur Obépine sur 7 jours
Note : La couleur du disque correspond à la valeur de l'indicateur, l'orientation de la flèche à la tendance de l'indicateur et la taille du disque à la taille de la station.
En 2021, à la lumière des résultats des diverses initiatives déployées dans le monde, la Commission européenne a recommandé aux États membres de mettre en place un système national de surveillance des eaux usées pour recueillir des données sur la présence du SARS-CoV-2 et des variants dans les eaux usées327(*). En France, le ministère des Solidarités et de la Santé a annoncé la création d'un dispositif national pérenne de surveillance microbiologique des eaux usées, dénommé SUM'Eau (Surveillance microbiologique des eaux usées), sous le pilotage de la Direction générale de la santé et la Direction de l'eau et de la biodiversité. Ce nouveau dispositif mobilise Santé publique France, chargé de produire et d'interpréter un indicateur de suivi des résultats, et l'Anses, chargée d'harmoniser les méthodes utilisées pour garantir la qualité des analyses.
Dans l'attente du déploiement de ce nouveau réseau, Obépine a bénéficié d'un prolongement de son financement pour poursuivre son activité de surveillance jusqu'en avril 2022328(*), soit avant la mise en fonctionnement de SUM'Eau, ce qui a entraîné une interruption dans la surveillance des eaux usées. Selon Santé publique France, ce délai de mise en oeuvre s'explique par la phase d'appropriation nécessaire et les multiples étapes requises pour rendre ce nouveau réseau opérationnel (définition d'une stratégie d'échantillonnage, validation des méthodes d'analyses et de traitement de données, identification et sélection des laboratoires d'analyse, construction, validation et production automatisée d'indicateurs de suivi, acquisition de l'expertise nécessaire, etc.).
Depuis octobre 2023, les données de surveillance issues du système SUM'Eau, qui repose sur 12 stations de traitement des eaux usées, sont accessibles sur le site data.gouv.fr et intégrées au bulletin hebdomadaire de suivi des infections respiratoires aiguës. Les premiers mois d'exploitation ont révélé une bonne corrélation entre l'indicateur établi et les résultats des tests biologiques ou les passages aux urgences mais n'ont pas montré de précocité significative concernant les changements de tendances. Une phase d'expansion est prévue en 2024 pour atteindre 54 stations surveillées, avec un objectif final de 126 stations. Le réseau SUM'Eau ne permet pas actuellement de séquencer le matériel génétique trouvé dans les eaux usées, mais des travaux exploratoires sont en cours en ce sens. Il est également envisagé d'étendre, à terme, la surveillance à d'autres agents pathogènes tels que la grippe, le VRS ou le poliovirus, sous réserve d'un financement pérenne.
En parallèle de ce nouveau réseau, Obépine poursuit ses activités de recherche, notamment au travers d'un projet collaboratif, dénommé SISP&EAU, financé par l'ANRS-MIE, visant à croiser les données des cas cliniques et celles issues des eaux usées afin d'améliorer la surveillance des virus respiratoires (influenza, VRS, etc.)329(*). Un projet Obépine+, ayant pour objectif de construire une plateforme de recherche et d'innovation destinée à soutenir les réseaux de surveillance à partir des eaux usées en développant, validant et assurant le transfert rapide de méthodes performantes, a été déposé à l'ANR - sur sollicitation du Secrétariat général pour l'investissement - et est actuellement en attente de financement. Afin de construire des liens forts et d'assurer des échanges réguliers permettant une articulation adaptée de la recherche et de la surveillance - qui ont pu faire défaut lors de la construction du réseau SUM'Eau, empêchant de capitaliser pleinement sur l'expérience du réseau Obépine -, il est prévu que les acteurs de SUM'Eau siègent au Comité stratégique d'Obépine+.
L'intérêt pour l'épidémiologie des eaux usées pendant la crise de la covid-19 a permis d'accumuler un corpus de connaissances important et de développer des méthodes offrant de nombreuses perspectives pour la surveillance des maladies humaines ou animales via cette approche330(*). En plus des maladies infectieuses émergentes, la surveillance des eaux usées pourrait à l'avenir être élargie à de nombreux autres champs pour mieux appréhender la santé des populations : suivi de marqueurs biologiques, des usages pharmaceutiques, de l'exposition aux pesticides ou aux produits chimiques, etc.331(*)
E. LA SURVEILLANCE GÉNOMIQUE
S'il existait des doutes quant à la capacité d'adaptation du SARS-CoV-2 au début de la pandémie, le virus a rapidement montré sa capacité à évoluer génétiquement, avec des conséquences sur sa transmissibilité, sur les populations touchées, la gravité de la maladie et sur l'efficacité des thérapies, des vaccins et des tests diagnostiques332(*). Le suivi de l'évolution génomique du virus revêt une importance cruciale, au même titre que la surveillance de la dynamique épidémique. Ce suivi permet de détecter l'émergence et la propagation des variants d'intérêt, susceptibles d'entraîner une recrudescence d'infections, et d'étudier leurs caractéristiques (transmissibilité, pathogénicité, etc.) afin de prendre les mesures appropriées pour limiter leur diffusion et leurs impacts en termes de santé. C'est sur la base de cette surveillance génomique que les vaccins contre la covid-19 ont pu être adaptés aux souches circulantes du virus, pour une meilleure protection de la population. Au regard de l'importance de cette surveillance génomique, la Commission européenne a appelé dès janvier 2021 - soit peu après la propagation du variant Alpha en fin d'année 2020 - les États membres à développer une capacité de séquençage d'au moins 5 % - et de préférence 10 % - des échantillons de dépistage positifs333(*).
Au début de la crise, la France accusait un certain retard en la matière, avec moins de 3 000 séquences publiées en 2020, contre plus de 140 000 par le Royaume-Uni334(*). Aussi, en janvier 2021, Santé publique France et l'ANRS-MIE ont lancé le consortium Emergen (surveillance et recherche sur les infections à pathogènes émergents via la génomique microbienne), à l'instar du consortium britannique COG-UK, afin d'identifier l'émergence de nouveaux variants et les proportions des différents variants circulant sur le territoire français. Dans ce cadre, un réseau de collecte d'échantillons a été établi, en s'appuyant sur des laboratoires de ville et hospitaliers, les capacités de séquençage ont été augmentées, grâce à un investissement matériel et au recours à des laboratoires privés, et une plateforme informatique dédiée, permettant de collecter, traiter et contrôler l'ensemble des données recueillies, a été développée. Afin de rendre disponibles les résultats obtenus pour la surveillance sanitaire et la recherche, l'ensemble des séquences étaient notamment déposées dans les entrepôts de données internationaux, tels que GISAID (Global Initiative on Sharing All Influenza Data). Grâce à ce consortium, l'activité de séquençage française a été considérablement multipliée, passant de 3 000 séquences en 2020 à 300 000 en 2021, pour un total de 750 000 séquences génomiques virales produites de janvier 2021 à juin 2023, permettant à la France de se placer au quatrième rang mondial des contributeurs à GISAID.
L'évolution de la pandémie nécessitant moins de données, le consortium a évolué et ajusté ses activités en début d'année 2023, poursuivant l'effort de séquençage à un rythme plus modéré à partir des seules ressources du Centre national de référence (CNR) des Virus des infections respiratoires et de ses laboratoires associés. L'évolution de la stratégie de dépistage et le plus faible recours actuel aux tests ont un impact sur la surveillance génomique, en France comme dans le reste du monde, comme le montre l'évolution du nombre de séquences déposées sur GISAID (voir figure ci-après). Pour répondre à cette situation, de nouveaux laboratoires ont été récemment mobilisés pour la collecte d'échantillons biologiques positifs, en complément du réseau déjà actif. Selon Santé publique France, cette diminution ne représentait pas, lors de son audition, un obstacle à une bonne surveillance des variants en raison d'un nombre de séquences - entre 100 et 500 par semaine - qui restait suffisant pour disposer d'une vision satisfaisante des souches circulantes et de leurs tendances. Toutefois, dans un contexte de faible circulation du SARS-CoV-2, on peut noter une récente baisse du nombre de séquences disponibles, parfois inférieur à 100 par semaine, depuis mars 2024335(*).
Nombre de séquences déposées sur GISAID dans le monde (gauche) et en France (droite)336(*)
Le projet Emergen se prépare désormais à une nouvelle étape au travers de deux initiatives : le projet Emergen 2.0, en attente de financement par l'ANR, et le projet SEQ4EPI337(*), qui bénéficie du soutien financier de l'Union européenne via le programme EU4Health. Ces projets visent à consolider et élargir le système établi en soutenant la surveillance d'autres maladies infectieuses et en élargissant le suivi à de nouveaux agents pathogènes pouvant représenter des menaces pandémiques potentielles. L'augmentation des capacités résultant de la structuration du consortium Emergen a déjà permis au CNR des Virus des infections respiratoires de se fixer des objectifs plus ambitieux pour la surveillance génomique des virus influenza et de démarrer le séquençage du VRS. Dans la perspective d'une approche « une seule santé », il est également prévu d'élargir les analyses à la surveillance animale pour identifier les risques de futures zoonoses, en collaboration avec l'Anses.
III. DE NOUVELLES STRUCTURES POUR FAIRE FACE AUX CRISES SANITAIRES
En parallèle de ces évolutions du système de surveillance, la crise de la covid-19 et les retours d'expérience qui l'ont suivie ont conduit à faire évoluer les organes de préparation et de gestion des urgences sanitaires.
A. UN NOUVEAU CENTRE DE CRISES SANITAIRES
L'une des traductions concrètes des retours d'expérience conduits par le ministère chargé de la santé est la révision de la gestion de crise en interne avec la création, le 1er mars 2024, d'un « Centre de crises sanitaires » au sein de la direction générale de la santé338(*). Cette nouvelle structure a pour rôle de renforcer les capacités d'anticipation, de préparation et de gestion opérationnelle des alertes et des crises sanitaires, en favorisant une approche intégrée et continue, afin d'éviter les cloisonnements qui ont pu être observés au cours de la crise.
Ce nouveau centre de crise rassemble, d'une part, le Centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales (Corruss), d'autre part, un pôle de préparation aux crises (voir figure ci-après).
Le Corruss, créé en 2007339(*), est renforcé dans le cadre de cette nouvelle organisation. Il est chargé d'assurer une veille opérationnelle des alertes sanitaires et d'analyser les signalements provenant de diverses sources, telles que les ministères, les agences sanitaires et les instances internationales, afin d'apporter une réponse coordonnée à l'échelle nationale, en mobilisant son réseau d'expertise, en diffusant des instructions et des messages d'alerte, en activant la réserve sanitaire ou les stocks stratégiques de produits de santé, en mettant en oeuvre des systèmes d'information pour l'identification et le suivi des victimes. Afin de faire face à toute situation de manière proportionnée, le Corruss est organisée de manière graduée, avec quatre niveaux opérationnels - contre trois auparavant -, permettant la mobilisation de ressources et de moyens adaptés.
Le pôle de préparation aux crises a vocation à assurer, en amont des crises, la préparation des moyens de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles. Il est, pour cela, constitué de quatre unités respectivement consacrées à la surveillance et l'anticipation des risques, aux moyens de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles, à la doctrine et la planification des réponses, enfin à l'animation des équipes, la formation, les entraînements et les retours d'expérience.
Organigramme fonctionnel du Centre de crises sanitaires
Source : Direction générale de la santé
B. UNE NOUVELLE AUTORITÉ EUROPÉENNE DE PRÉPARATION ET DE RÉACTION EN CAS D'URGENCE SANITAIRE
À l'échelle européenne, la Commission a créé le 16 septembre 2021 une Autorité de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (Health Emergency Preparedness and Response Authority, HERA) sur le modèle de la BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) états-unienne, dans le but de « renforcer la capacité de l'Europe à prévenir et à détecter les urgences sanitaires transfrontières, ainsi qu'à y réagir rapidement, en garantissant le développement, la fabrication, l'acquisition et la répartition équitable des contre-mesures médicales essentielles »340(*), c'est-à-dire des produits qui peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prévention, la protection ou le traitement.
Les principales missions de cette nouvelle structure consistent à renforcer la coordination en matière de sécurité sanitaire au sein de l'Union et avec les instances mondiales de préparation et de réaction aux situations d'urgence sanitaire341(*), ainsi que de remédier aux vulnérabilités et dépendances stratégiques susceptibles d'exister dans le domaine des contre-mesures médicales. À cette fin, la nouvelle autorité est appelée à collaborer étroitement avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), chargé d'identifier et d'évaluer les menaces liées aux maladies infectieuses, et l'Agence européenne des médicaments (EMA), chargée de l'évaluation scientifique, de la surveillance et du contrôle de la sécurité des médicaments.
L'organisation de cette nouvelle structure est pensée pour se décliner entre des « phases de préparation », où elle aura pour but de définir, évaluer et anticiper les menaces ainsi que de préparer les capacités de réaction nécessaires en termes de contre-mesures médicales (promotion de la recherche et de l'innovation, définition de plans clairs de production et de déploiement, recensement et garantie de disponibilité des matériaux et technologies critiques et de capacités de production industrielle, constitution de stocks et de marchés publics, etc.), et des « phases de crise », où elle pourra bénéficier de ressources et de moyens renforcés pour prendre des décisions et activer rapidement des mesures d'urgence, afin de mettre au point, produire et distribuer des contre-mesures médicales.
Pour remplir ces missions, l'HERA devait disposer d'un budget de 6 milliards d'euros sur une durée de 6 ans (2022-2027) - soit un budget similaire à celui de la BARDA avant la crise de la covid-19 -, notamment en provenance des programmes EU4Health, Horizon Europe et rescEU. Cependant, une récente révision du cadre financier pluriannuel par le Conseil européen a redéployé un milliard d'euros du programme EU4Health vers d'autres politiques de l'Union342(*), entraînant une coupe conséquente dans le budget de l'HERA.
Dans le cadre de l'évaluation des menaces et de la collecte de renseignements, l'HERA a notamment financé un réseau de laboratoires, dénommé Durable (Delivering a Unified Research Alliance of Biomedical and public health Laboratories against Epidemics), piloté par l'Institut Pasteur, qui doit fournir rapidement des informations scientifiques fiables pour la préparation et la réaction aux menaces sanitaires transfrontalières343(*), ainsi que l'action conjointe EU-WISH (EU-Wastewater Integrated Surveillance for Public Health), qui vise à renforcer et améliorer les capacités nationales de surveillance grâce aux eaux usées, en promouvant l'échange de connaissances et le partage de pratiques344(*). Une plateforme informatique, dénommée Athina (Advanced Technology for Health Intelligence and Action), est actuellement en cours de développement afin de collecter et combiner les renseignements sur les menaces sanitaires et la disponibilité des contre-mesures médicales associées, dans un objectif d'aide à la prise de décision.
Dans un travail de hiérarchisation, l'HERA a également identifié les agents pathogènes à fort potentiel pandémique, les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC) et les menaces liées à la résistance aux antimicrobiens, comme les trois principales menaces pour la santé auxquelles il est nécessaire de se préparer345(*). Un travail d'identification des contre-mesures médicales nécessaires et des besoins en termes de recherche et développement, de capacités de production et de stocks a été entrepris pour chacune de ces menaces afin de combler les éventuelles lacunes existantes.
Dans le cadre de la réserve de capacités rescEU, l'HERA a financé des stocks de contre-mesures médicales pour une valeur de 1,2 milliard d'euros, afin de pouvoir apporter des réponses rapides et efficaces aux crises sanitaires liées à ces trois menaces. En parallèle, plusieurs projets de recherche ont été financés par le biais des programmes Horizon Europe et EU4Health afin d'élargir l'arsenal de contre-mesures médicales disponibles vis-à-vis de celles-ci. On peut par exemple citer la stratégie « Vaccins 2.0 », qui encourage le développement de vaccins de nouvelle génération ou le soutien à l'initiative internationale CEPI (Coalition for Epidemics Preparedness Initiative)346(*). Afin de pallier les défaillances de marché et renforcer l'autonomie stratégique de l'Union, l'HERA a également mis en place un mécanisme de financement, dénommé HERA Invest, afin de stimuler l'innovation dans le domaine des contre-mesures médicales pour lesquelles les incitations de marché sont actuellement insuffisantes. Enfin, le projet EU-FAB, mené par l'HERA, a pour but de maintenir, au niveau européen, des capacités de production opérationnelles pouvant être activées rapidement en cas d'urgence de santé publique pour la fabrication de vaccins et de médicaments.
IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
L'époque contemporaine est témoin de l'émergence - ou de la réémergence - de divers virus (VIH, Nipah, SARS-CoV, H1N1, MERS-CoV, Ebola, etc.), qui pourraient se multiplier au cours des prochaines années en raison des changements climatiques et des évolutions des modes de vie347(*). Si la récente pandémie de la covid-19 a mis en lumière des lacunes dans notre préparation aux urgences sanitaires majeures, elle a également été marquée par le développement - en un temps record - de multiples innovations.
Mener des retours d'expérience approfondis, tant sur le plan sanitaire que politique et organisationnel, est essentiel pour tirer les leçons des échecs et des succès rencontrés dans la gestion de cette pandémie. La période post-pandémique ne doit pas se traduire par une amnésie mais être, au contraire, utilisée pour réévaluer notre organisation et accroitre nos efforts d'anticipation et de préparation, afin d'être capables de répondre rapidement et efficacement aux crises futures.
Dans cette perspective, les structures et dispositifs instaurés pendant la crise et ayant montré leur efficacité doivent être maintenus et renforcés, dans un cadre souple et polyvalent, afin d'être disponibles - ou facilement mobilisables - en cas de nouvelle crise. Du point de vue de la surveillance virologique et génomique, il apparaît à la fois nécessaire de continuer à suivre le SARS-CoV-2, afin d'anticiper les risques que ce virus continue de représenter, mais également de poursuivre le développement des systèmes mis en place afin qu'ils puissent bénéficier au suivi d'autres pathogènes et être capables de s'adapter rapidement à une nouvelle menace.
Parallèlement, il est essentiel de développer des stratégies d'anticipation, de prévention et de réponse qui puissent facilement être adaptées aux futures menaces, dont l'origine est aujourd'hui imprévisible. Enfin, un important effort de recherche, portant notamment sur les menaces pouvant entraîner des crises sanitaires majeures, les facteurs de leur émergence et les instruments de prévention associées, ainsi que sur les contre-mesures médicales à mettre en place, doit être entrepris en amont des crises afin de pouvoir innover et répondre efficacement le moment venu.
RECOMMANDATIONS
1. Maintenir une surveillance approfondie du SARS-CoV-2 pour anticiper les risques qui pourraient résulter de sa circulation persistante.
2. Définir et déployer une stratégie de recherche sur les menaces sanitaires, fondée sur le continuum fondamental/appliqué, afin de disposer des outils et connaissances permettant d'y répondre rapidement et efficacement.
3. Renforcer le système de surveillance pour pouvoir détecter précocement et suivre l'évolution de toute menace sanitaire ; veiller à ce que ce système reste étroitement articulé avec l'effort de recherche sur les outils de surveillance développés au cours de la crise.
4. Poursuivre le retour d'expérience sur la crise de la covid-19 et investir pour améliorer les capacités d'anticipation, de préparation et de réponse aux futures crises sanitaires.
QUATRIÈME
PARTIE
LA DÉSINFORMATION EN SANTÉ
I. INTRODUCTION
A. UN PROBLÈME ANCIEN SUSCEPTIBLE D'AVOIR D'IMPORTANTES RÉPERCUSSIONS
La circulation de fausses informations médicales n'est pas récente348(*), mais elle a été particulièrement mise en lumière et a pris une importance nouvelle au cours de la pandémie de la covid-19349(*), comme cela avait déjà été constaté lors d'épisodes épidémiques et de crises sanitaires antérieurs350(*).
Parmi les différents domaines pouvant être touchés par la désinformation, la santé occupe en effet une place singulière. Les états de vulnérabilité et d'anxiété dans lesquels sont susceptibles de se trouver les patients et la population favorisent leur inclination pour les fausses informations, notamment lorsque celles-ci sont porteuses d'espoir, proposent des explications ou désignent des responsables. Ces informations erronées peuvent concerner les symptômes et les origines de la maladie, l'efficacité et la pertinence des éventuelles mesures et interventions mises en place, ou encore les traitements susceptibles d'être utilisés, avec des répercussions sanitaires considérables.
Les incertitudes qui accompagnent l'émergence d'une maladie nouvelle et le processus de construction des connaissances scientifiques, comprenant nécessairement des essais et des erreurs, constituent un terrain propice à l'apparition de fausses informations. En plaçant les explications scientifiques au coeur du débat public, les crises sanitaires conduisent à une politisation de la science, une instrumentalisation de ses résultats et alimentent la circulation de fausses informations.
B. UN NOUVEAU CADRE INFORMATIONNEL QUI SE TRADUIT PAR UNE EXPLOSION D'INFORMATIONS
Par rapport aux pandémies précédentes, la crise de la covid-19 est intervenue dans un cadre informationnel nouveau. Le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication au cours des dernières années a radicalement changé la manière dont les informations sont produites, diffusées et consommées. L'augmentation rapide et massive du volume d'informations échangées aboutit à une cacophonie inédite, parfois qualifiée d'« infobésité »351(*). Face à cette avalanche d'informations, il devient difficile pour la population d'identifier les sources fiables de connaissances vérifiées, si bien que la mésinformation352(*) et la désinformation suscitent de plus en plus d'inquiétudes, jusqu'à être perçues comme l'une des menaces majeures auxquelles doit faire face notre société353(*).
Dans le cadre de la crise de la covid-19, l'explosion de données a également concerné les informations scientifiques. La plateforme LitCovid, qui recense les publications scientifiques portant sur la covid-19, compte plus de 400 000 articles scientifiques publiés depuis l'émergence du SARS-CoV-2, dont plus de 88 000 au cours de l'année 2020354(*). Le développement du système de « pré-publication », qui permet de rendre disponible des articles avant l'étape de relecture par les pairs, a notamment facilité l'accélération du rythme de publication. Si cette intensification de la production scientifique a permis une acquisition rapide de connaissances pour faire face à la crise, elle soulève également des interrogations quant à la qualité de certains de ces travaux, qui pouvaient reposer sur des bases scientifiques fragiles, et à la confusion qui a pu en découler355(*). Cette préoccupation apparaît d'autant plus prégnante que la levée des restrictions d'accès par les éditeurs scientifiques, dans une démarche de science ouverte, et l'usage des réseaux sociaux par certains scientifiques comme nouvelle modalité d'échange et de communication ont permis une accessibilité sans précédent à l'ensemble des travaux, notamment par un public ne disposant pas des connaissances nécessaires à leur bonne interprétation. Cette accessibilité a en outre mis en exergue ce qui est habituel en sciences, mais méconnu du grand public, à savoir que les analyses peuvent diverger d'un scientifique à l'autre et évoluer au fil du temps, ce qui a pu entraîner dans la population une impression de cacophonie.
C. UNE PANDÉMIE QUI CRÉE UNE « INFODÉMIE »
Dans ce contexte, Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a évoqué, dès février 2020, la nécessité de lutter contre une « infodémie »356(*). Ce mot-valise fusionnant « information » et « épidémie » - qui sera repris par António Guterres, secrétaire général de l'ONU, au cours du mois suivant357(*) - correspond, pour l'OMS, à une « surabondance d'informations [...] qui se propage lors d'une épidémie » et qui « rend difficile l'identification de sources et de conseils fiables par la population »358(*). Face aux fausses nouvelles qui se propagent « plus rapidement et plus facilement » que le virus, tout en étant « tout aussi dangereuses » que celui-ci, l'Organisation mondiale de la santé appellera à « aplatir la courbe de l'infodémie »359(*), de manière similaire à l'impératif d'« aplatir la courbe épidémique ».
Cette « infodémie » serait en effet responsable d'une défiance accrue de la population et d'un affaiblissement de la cohésion sociale. Elle a gêné la compréhension des informations sanitaires et l'adoption des mesures mises en place et a eu, par conséquent, un impact direct sur la santé des populations360(*).
La pandémie de covid-19 est donc l'occasion de réexaminer la problématique des fausses informations en santé, en identifiant ses causes et les stratégies de lutte susceptibles d'être déployées, afin de mieux se préparer pour les crises sanitaires à venir361(*).
II. LES RÉSEAUX SOCIAUX À LA SOURCE DU PROBLÈME ?
A. UNE NOUVELLE MODALITÉ DE DÉSINFORMATION
1. Un espace d'expression pour les désinformateurs
Les réseaux sociaux ont radicalement transformé la manière dont l'information est diffusée et partagée. Contrairement aux médias traditionnels, qui ne permettent qu'à un nombre restreint d'acteurs sélectionnés de s'exprimer, ces plateformes offrent à tous une liberté d'expression quasi totale. Quel que soit son niveau d'expertise, chacun peut y exprimer sa propre vision des faits sur un même pied d'égalité et accéder à un auditoire large. Aussi, les réseaux sociaux offrent un mode d'expression aux désinformateurs, qui n'avaient auparavant que faiblement voix au chapitre dans les médias traditionnels. Ils peuvent toucher de nouveaux publics mais également identifier des personnes partageant les mêmes idées afin de s'organiser sous forme de réseaux.
2. Un mode d'expression surexploité par les désinformateurs
Si les réseaux sociaux offrent une possibilité d'expression équitable à tout internaute, le recours à cette opportunité fait apparaître de fortes disparités.
La motivation à s'exprimer sur les réseaux sociaux sur une thématique donnée est davantage liée à la force des convictions que l'on est susceptible d'avoir qu'à la connaissance de celle-ci. L'effet Dunning-Kruger entraînerait même, chez les personnes les moins qualifiées, une surestimation de leurs compétences et, par conséquent, une surexpression, à l'opposé des experts appréciant plus justement les limites de leurs savoirs.
On voit ainsi émerger des « super contributeurs »362(*), qui vont être à l'origine d'une part importante du contenu disponible et bénéficier d'un important pouvoir d'influence, en dépit de leur faible légitimité. Une étude académique portant sur un échantillon de 2,7 millions de tweets a montré que 75 % des liens dirigeant vers des sites web connus pour publier des informations erronées n'avaient été partagés que par 1 % des contributeurs363(*).
De même, une analyse du contenu anti-vaccin publié sur Facebook et Twitter pendant la pandémie a identifié que 65 % de celui-ci proviendrait de douze personnes seulement364(*). On observe une situation similaire sur la thématique climatique, où un faible nombre d'acteurs produisent une part importante des contenus climatosceptiques365(*).
Ces sur-contributions se traduisent par une sur-représentation de certains points de vue. Avant la pandémie, une étude avait montré que les pages anti-vaccins occupaient une place disproportionnée sur Facebook366(*), une tendance qui serait également observée sur d'autres sujets de santé et sur d'autres plateformes367(*). Les réseaux sociaux agissent donc comme un miroir déformant, accentuant la visibilité d'individus aux positions extrêmes, pourtant peu représentatifs de la société dans son ensemble.
3. Des mécanismes qui favorisent certains contenus et n'encouragent pas à la vigilance
Cette asymétrie d'expression est accentuée par l'éditorialisation des contenus effectuée par les plateformes. La manière dont les informations se propagent sur les réseaux sociaux est en effet dictée par leur architecture : face au nombre important de contributions, ce sont les algorithmes de ces plateformes qui déterminent les contenus mis en avant.
Or, cette éditorialisation répond à des enjeux économiques et a pour principal objectif d'encourager l'attention et l'engagement des utilisateurs. Aussi, les algorithmes tendent à promouvoir les contenus sensationnels et clivants, susceptibles de susciter des émotions négatives comme l'indignation ou la colère et d'entraîner de l'engagement368(*), plutôt que des informations mesurées et vérifiées. Une étude menée sur Facebook lors de l'élection présidentielle américaine de 2020 a ainsi montré que les messages de mésinformation entraînaient six fois plus d'engagement que les autres369(*).
En France, les publications Facebook contenant des liens vers des sites d'information non fiables représentaient 23 % de tous les engagements avec des médias entre 2017 et 2021, alors que ces sites représentaient moins de 5 % des visites de sites d'information sur cette même période370(*). De même, d'après le Center for Countering Digital Hate (Centre de lutte contre la haine numérique), les messages critiques à l'égard des vaccins bénéficieraient d'une visibilité importante et croissante sur les réseaux sociaux371(*). Plusieurs études ont également montré que les plateformes avaient tendance à favoriser des contenus climatosceptiques372(*).
En outre, les algorithmes sont conçus pour proposer des contenus en accord avec nos préférences individuelles, favorisant l'homophilie et enfermant dans des bulles numériques qui agissent comme des chambres d'écho idéologiques373(*). L'absence de contradiction qui en découle ne favorise pas une remise en question critique des informations rencontrées et peut laisser croire à l'existence d'un consensus sur des sujets pourtant controversés. En renforçant les opinions préconçues à l'intérieur de communautés virtuelles, les plateformes peuvent encourager une sorte de radicalisation374(*).
Enfin, les réseaux sociaux seraient susceptibles de troubler notre système de traitement de l'information. D'après Laurent Cordonier, les réseaux sociaux, qui seraient fréquentés principalement dans une optique récréative pour consommer du divertissement, encourageraient un traitement de l'information « intuitif » qui se traduirait par un défaut de vigilance vis-à-vis des informations rencontrées. Il a notamment été montré que les internautes avaient tendance à partager des contenus sans nécessairement juger de l'exactitude de l'information375(*), renforçant la circulation de fausses informations.
B. UN RÔLE DES RÉSEAUX SOCIAUX TOUTEFOIS RELATIVISÉ
Ces différents éléments ont conduit à faire émerger l'idée d'un rôle prépondérant des réseaux sociaux dans le développement des fausses informations. Toutefois, malgré des effets indéniables, la littérature scientifique a récemment relativisé cette vision qui a pu être qualifiée de « panique morale » et nécessiterait plus de nuances376(*).
1. Un regard nuancé sur le rôle des réseaux sociaux dans la diffusion et le partage des fausses informations
L'idée d'un rôle majeur des réseaux sociaux dans le développement des fausses informations a été alimentée par une étude publiée en 2018 dans le journal Science377(*), suggérant que les fausses informations s'y répandaient plus rapidement et plus largement que les informations vérifiées, mais dont les conclusions ne pourraient être généralisées à l'ensemble des fausses informations378(*). Des travaux ultérieurs, notamment menés au cours de la pandémie, ont montré que les informations ne suivaient pas nécessairement des schémas de diffusion différents selon leur véracité379(*) et que les informations fiables pouvaient même être plus largement partagées que les fausses informations380(*).
De plus, si les contenus de mésinformation et de désinformation peuvent parfois être très largement partagés, cette action ne doit pas nécessairement être perçue comme une marque d'approbation mais peut répondre à d'autres intentions, comme celle de corriger l'information ou l'expression d'un scepticisme ou d'une moquerie381(*).
2. Une contribution relativement limitée des fausses informations pour l'information du public
Il est aujourd'hui extrêmement difficile d'évaluer avec précision la proportion exacte de fausses informations présentes sur les réseaux sociaux, notamment parce que cela nécessite de reconnaître leur inexactitude382(*). Cette évaluation est en outre rendue plus difficile dans le cas de formats non textuels, comme sur Instagram, YouTube ou TikTok. Cette part est également susceptible de varier considérablement en fonction de la plateforme, du sujet, du moment et du pays considérés.
L'étude préalablement citée portant sur 2,7 millions de tweets a fait valoir que 4 % des liens partagés renvoyaient vers des sites internet connus pour diffuser de fausses informations383(*). Une analyse systématique des fausses informations liée à la covid-19 sur diverses plateformes a, quant à elle, estimé une prévalence allant de 0,2 % à 28,8 %384(*).
Toutefois, l'utilisation des réseaux sociaux doit être considérée dans la perspective plus large du régime informationnel dans sa globalité. Plusieurs études ont montré que les individus souhaitant s'informer ont peu recours aux réseaux sociaux385(*) et qu'ils consultent prioritairement des sites d'information reconnus comme fiables386(*). Aussi, les fausses informations ne représenteraient qu'une faible part de l'ensemble des informations consommées : entre 4 et 5 % du temps consacré par les Français à consulter des informations en ligne concernerait des sources non fiables387(*).
En outre, si la crise a été marquée par une « infodémie », il est à noter que l'augmentation de la consommation d'informations pendant cette période a principalement bénéficié aux sites d'information dignes de confiance388(*).
3. Des acteurs qui peinent à élargir leur cible
Corollaire des bulles épistémiques présentées précédemment, les fausses informations ont une faible capacité à atteindre un large public. D'après une étude menée sur la thématique vaccinale entre janvier 2020 et octobre 2021 sur Twitter, le public touché par les contenus critiques aurait été principalement celui des utilisateurs déjà particulièrement défiants à l'égard des vaccins389(*).
En effet, les individus ont tendance à privilégier les informations qui correspondent à leurs convictions ou qu'ils sont enclins à accepter. Aussi, les visites des sites connus pour publier de fausses informations seraient principalement le fait de citoyens qui douteraient des médias traditionnels et dont les points de vue seraient déjà fortement polarisés390(*).
Par conséquent, les fausses informations seraient susceptibles de n'avoir qu'un faible impact sur les attitudes et comportements, en dehors d'un potentiel renforcement de croyances préexistantes391(*).
4. Un recul critique qui limite la portée des fausses informations
L'exposition à une fausse information ne conduit pas nécessairement à y croire - ce serait même plutôt rare392(*). Plusieurs études ont montré que les internautes détenaient une bonne capacité de discernement quant à la véracité des informations rencontrées sur les réseaux sociaux393(*) qui bénéficient d'une faible confiance394(*).
En France, une étude expérimentale portant sur les vaccins contre la covid-19 a montré que l'exposition à de fausses informations n'avait qu'un effet limité sur les intentions vaccinales395(*). On peut également souligner une certaine divergence entre la dynamique de la circulation des discours critiques à l'égard des vaccins sur Twitter - restée relativement constante au cours de la pandémie - et l'évolution des intentions vaccinales, suggérant un impact limité des mobilisations critiques sur ce réseau social396(*).
C. UN IMPACT À REPLACER DANS UN ÉCOSYSTÈME PLUS LARGE
Si ces résultats invitent à relativiser l'influence délétère que peuvent jouer les réseaux sociaux en termes de mésinformation et de désinformation, celle-ci ne doit pas être niée. Bien qu'elle n'induise pas nécessairement une croyance ou un changement de comportement, l'exposition à une fausse information - notamment lorsqu'elle est répétée397(*) - est susceptible d'instiller des doutes et d'induire sur le long terme une défiance envers les médias traditionnels, la science, la médecine et les autorités398(*).
Les fausses informations sont également susceptibles de détourner l'attention des informations fiables399(*) et d'encourager une certaine radicalisation pouvant conduire à des attitudes et comportements violents400(*).
On peut souligner l'existence d'une corrélation entre l'adoption de comportements de santé à risque (refus vaccinal et renoncement médical) et la fréquence d'information sur l'actualité médicale par le biais des réseaux sociaux, de YouTube et de groupes de messageries instantanées401(*). On peut citer l'observation de plusieurs pratiques dangereuses, comme la consommation d'eau de Javel diluée ou de méthanol pour lutter contre le SARS-CoV-2, à la suite d'informations fausses ayant circulé sur les réseaux sociaux au cours de la pandémie402(*). Si ces constatations ne permettent pas de conclure quant à une responsabilité causale des réseaux sociaux, ils mettent en évidence la probable contribution qu'ils peuvent apporter.
Cependant le rôle des réseaux sociaux doit être replacé dans un écosystème plus large403(*) où doivent être prises en compte l'implication d'autres acteurs, notamment médiatiques et politiques, ainsi que l'importance des facteurs sous-jacents qui encouragent l'adhésion aux fausses informations.
III. LES MOTEURS À L'ORIGINE DES FAUSSES CROYANCES
De nombreuses études se sont intéressées aux facteurs susceptibles de favoriser l'adhésion aux fausses informations et leur partage. Outre des facteurs sociodémographiques, le rôle des comportements informationnels, des connaissances, des croyances, de facteurs cognitifs et socio-affectifs mais aussi de la confiance dans la science, les institutions et les gouvernements a été mis en évidence404(*).
A. UN MANQUE D'INFORMATION ET DE CONNAISSANCES
La mésinformation et la désinformation se bâtissent sur un terreau d'acceptation alimenté notamment par un déficit d'information. Les questionnements restés sans réponse, particulièrement nombreux lors de l'émergence d'un nouveau pathogène, peuvent se traduire en inquiétudes, qui constituent autant d'opportunités à exploiter par les désinformateurs. Or, la crise sanitaire a été marquée par un sentiment de manque d'information chez la population, résultant notamment d'un décalage entre les temporalités médiatique et scientifique. À titre d'exemple, 33,7 % des Français estimaient au printemps 2022 ne pas avoir été bien informés sur les vaccins contre la covid-19405(*).
L'étude sur la désinformation en santé menée par Laurent Cordonier pour la Fondation Descartes a montré que le recours fréquent à des sources réputées fiables pour s'informer sur l'actualité médicale était corrélé à une plus faible adoption de comportements de santé à risque.
De même, à l'échelle internationale, il a été constaté que le bon fonctionnement des médias traditionnels est l'un des paramètres liés à une meilleure résilience face aux fausses informations406(*).
En termes d'information médicale, les professionnels de santé - qui jouissent d'une confiance importante - jouent un rôle essentiel. L'étude de la Fondation Descartes a montré une forte corrélation entre le fait de disposer d'un médecin traitant et la possession de bonnes connaissances en santé, soulignant le rôle majeur de cet interlocuteur dans la lutte contre les fausses informations.
Parallèlement au manque d'information, le manque de connaissances scientifiques et médicales augmente la sensibilité aux fausses informations. Des travaux expérimentaux ont montré que les personnes ayant un faible niveau de connaissances scientifiques étaient plus susceptibles de croire à de fausses informations sur la covid-19407(*). De même, au cours de la crise, de plus grandes compétences en littératie médicale408(*) et en numératie409(*) se sont montrées protectrices contre les fausses informations.
Enfin, outre les connaissances purement scientifiques, une bonne compréhension de la démarche scientifique protège également contre les fausses informations410(*) : l'acceptation des incertitudes et des éventuelles controverses inhérentes à la construction des savoirs permet de se prémunir contre les explications simplistes proposées comme alternatives par la désinformation.
B. DES CADRES DE CROYANCE ALTERNATIFS
La littérature scientifique suggère un impact important des croyances alternatives dans l'acceptation des fausses informations en santé. L'étude de la Fondation Descartes a ainsi montré que les personnes ayant une plus grande sensibilité aux croyances ésotériques, paranormales ou complotistes avaient de moins bonnes connaissances en santé et adoptaient plus largement des comportements à risque. En Angleterre, les croyances conspirationnistes à propos de la pandémie étaient associées à une moindre adhésion aux directives gouvernementales et à une plus faible volonté de se faire tester ou vacciner411(*).
Parmi les résultats obtenus par Laurent Cordonier, on observe de moins bonnes connaissances en santé et une plus grande adoption de comportements de santé à risque chez les personnes démontrant une importante sensibilité aux médecines alternatives. En effet, si les médecines alternatives correspondent avant tout à des pratiques, elles s'accompagnent d'un univers de croyances proches de celles observées dans le cadre de l'ésotérisme et du paranormal. Si le recours aux pratiques largement répandues, comme l'homéopathie ou l'ostéopathie, utilisées par des personnes n'ayant pas nécessairement conscience de ces croyances - voire du caractère alternatif de ces pratiques -, n'est pas corrélé avec de plus faibles connaissances en santé, en revanche, le recours à des pratiques plus confidentielles, telles que la lithothérapie ou la naturopathie, plus susceptibles d'attirer des personnes sensibles à ce cadre de croyances, est corrélé à un niveau moindre de connaissances en santé.
Une autre étude française, menée en juillet 2021, fait valoir que les attitudes favorables à l'égard des médecines alternatives ne fourniraient qu'une explication limitée de l'hésitation vaccinale et qu'une forte adhésion aux médecines alternatives doit être combinée à d'autres facteurs, tels que la méfiance à l'égard des autorités sanitaires ou des conditions sociales difficiles, pour se traduire par une attitude négative à l'égard des vaccins412(*). En effet, même parmi les personnes les plus favorables aux médecines alternatives, la philosophie et les discours entourant ces pratiques sont considérés avec un certain recul.
C. DES MOTEURS PSYCHOLOGIQUES
Plusieurs moteurs psychologiques, incluant des facteurs cognitifs et socio-affectifs, influent sur la susceptibilité aux fausses informations413(*).
Un de ces principaux facteurs réside dans le style de pensée414(*) : un style dit « intuitif », encourageant à suivre ses premières impressions, serait associé à une plus forte sensibilité aux fausses informations qu'un style dit « analytique », qui appellerait à une posture plus réflexive. Une étude états-unienne a montré, au début de la pandémie, que les personnes les moins susceptibles d'adopter un style de pensée analytique avaient été plus nombreuses à considérer la pandémie comme un canular et à ne pas adopter les gestes barrières415(*). De même, les résultats de Laurent Cordonier montrent qu'un style de pensée moins analytique est associé à de moins bonnes connaissances en santé et à une plus grande adoption de comportements de santé à risque.
Les émotions comme l'anxiété et la colère peuvent entraver la réflexion critique et favoriser une pensée rapide et intuitive, ce qui accroît la propension à croire et à partager les fausses informations. Le sentiment d'exclusion et les importantes frustrations sociales favorisent également l'accroissement de la susceptibilité aux contenus conspirationnistes416(*) et la diffusion volontaire de fausses informations417(*).
On peut également souligner la problématique liée au biais de confirmation, qui pousse à privilégier les informations qui vont dans le sens de nos croyances préétablies418(*). Plusieurs études ont montré qu'en plus de rechercher préférentiellement des informations conformes à nos motivations politiques et sociales, il existe une motivation accrue à croire et à promouvoir les fausses informations qui s'inscrivent dans ce cadre419(*).
Ces différents moteurs psychologiques sont instrumentalisés par les désinformateurs, qui font appel à une certaine démagogie cognitive en proposant des récits en accord avec nos prédispositions naturelles et en mobilisant les facteurs et biais susceptibles d'encourager leur acceptation420(*). À titre d'exemple, la difficulté à appréhender les risques de manière proportionnée à leur gravité effective - la représentation sociale des risques faibles est souvent surestimée, lorsque celle des risques fréquents est à l'inverse sous-estimée - est particulièrement propice à la diffusion de fausses croyances et est régulièrement instrumentalisée par les propagateurs de fausses informations, par exemple au sujet des effets indésirables des vaccins.
D. UN MANQUE DE CONFIANCE
La croyance et la diffusion d'informations erronées sont souvent corrélées à une importante méfiance et à un certain scepticisme à l'égard des sources officielles et des institutions. Chez les individus présentant une forte défiance envers les médias, les institutions et le gouvernement, on observe une plus grande fréquentation de sources d'information non fiables ainsi qu'une plus forte adhésion aux théories du complot421(*), facteurs eux-mêmes associés à une plus grande susceptibilité vis-à-vis des fausses informations.
L'étude de Laurent Cordonier a montré qu'un niveau de confiance élevé en la science, à l'égard des communautés médicale et scientifique, ainsi qu'envers les institutions, le gouvernement et les médias, était associé à une plus faible adoption de comportements de santé à risque. On peut également noter qu'à l'échelle internationale la confiance dans les scientifiques est apparue au cours de la crise comme le principal déterminant de l'adhésion aux politiques sanitaires et d'un comportement respectueux des gestes barrières422(*) et que la confiance dans les institutions publiques a été identifiée comme l'un des principaux facteurs prédictifs du nombre de décès attribués à la covid-19423(*).
De même, plusieurs travaux ont montré que la confiance dans les institutions, dans les sciences et dans les autorités sanitaires constituait un facteur prédictif de l'attitude à l'égard des vaccins424(*). Pour Jérémy Ward, ce facteur serait même l'un des éléments les plus déterminants de l'adhésion vaccinale : la réticence vaccinale ne reposerait pas sur la remise en cause du principe de la vaccination mais plutôt sur un manque de confiance dans les différents acteurs chargés de s'assurer de leur innocuité.
Cette défiance peut être accentuée par une certaine colère sociale, comme en témoigne le rapport aux vaccins des professionnels de santé. Chez les infirmières et aides-soignantes, la défiance à l'égard des autorités sanitaires, qui se traduirait par des réticences vaccinales, serait associée à des sentiments de manque de reconnaissance et d'insatisfaction à l'égard des conditions de travail, des rémunérations et des perspectives de carrière425(*).
E. LE PROCESSUS DE LÉGITIMATION DES FAUSSES INFORMATIONS
L'adhésion aux fausses informations est souvent considérée comme résultant de la mobilisation d'acteurs critiques marginaux. Mais l'impact direct de ces acteurs est relativement limité, en raison de leur faible capacité à toucher un public large, et c'est la légitimation des discours critiques par des acteurs bénéficiant d'une plus forte audience qui a un impact important.
Pour Jérémy Ward, l'augmentation de l'hésitation vaccinale observée au cours des dernières années proviendrait d'une hausse de la légitimation des discours associés, consécutive à une recomposition du milieu de la critique vaccinale. Le développement de discours moins radicaux, bénéficiant d'une crédibilité scientifique apparente, d'une certaine plausibilité et du soutien d'acteurs pouvant se prévaloir d'un capital scientifique, leur a permis d'être portés dans des médias d'information généralistes et de bénéficier, ainsi, d'une large visibilité.
Aussi, les médias traditionnels jouent un rôle important au travers des informations qu'ils choisissent de traiter et de la manière dont ils le font, en raison de la tribune qu'ils offrent aux discours critiques426(*). Cela est d'autant plus vrai sur les sujets scientifiques, où la rigueur est de mise et où toute manipulation à des fins politiques doit être évitée. Les scientifiques et professionnels du monde médical, qui bénéficient d'une forte confiance de la population, jouent un rôle clef à ce titre. Ils se doivent d'adopter une parole particulièrement responsable, circonscrite à leur domaine de compétence et en accord avec les données scientifiques, et condamner fermement les prises de position qui s'écartent de ces principes. En effet, la littérature scientifique montre que les désaccords entre experts - dont les différences de légitimité ne sont que difficilement perceptibles par la population - sont particulièrement susceptibles d'induire des doutes sur les recommandations officielles et des croyances allant à l'encontre du consensus scientifique427(*). De la même manière, les individus pouvant endosser un rôle de relais d'influence auprès de la population, comme les sportifs ou les artistes, doivent être particulièrement prudents dans leurs propos.
IV. COMMENT FAIRE FACE À LA MÉSINFORMATION ET À LA DÉSINFORMATION ?
A. LA CONSTRUCTION D'UNE INFORMATION ACCESSIBLE ET DE QUALITÉ, DÉLIVRÉE PAR DES MESSAGES ADAPTÉS
Une des causes principales des fausses croyances résidant dans le manque d'information de la population, il semble essentiel de lui fournir des informations adaptées et pouvant être identifiées comme fiables.
À la suite de la crise sanitaire, plusieurs instances ont appelé à renforcer la communication sur les sujets scientifiques et de santé. Dans son avis sur le futur des vaccins à ARNm, le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires estimait indispensable de mener des efforts de pédagogie afin d'informer la population « de façon claire, didactique et transparente »428(*). Dans son retour d'expérience sur la campagne vaccinale, le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale a quant à lui proposé la création de « cellules scientifiques de crise » par les organismes de recherche afin de disposer de sources d'informations de référence à destination des décideurs, des professionnels de santé, des journalistes et du grand public. Enfin, on peut également souligner la recommandation provenant d'un groupe de travail issu des Ateliers de Giens429(*) appelant à la création d'une plateforme collaborative centralisant les ressources d'informations sur les produits de santé, estimant que celles-ci sont aujourd'hui « existante[s] mais [...] dispersée[s], non structurée[s], peu harmonisée[s] »430(*). Cette plateforme, qui serait alimentée par la communauté scientifique avec une procédure de relecture par les pairs, aurait pour objectif d'apporter des réponses fiables et faciles d'accès aux questions des citoyens et journalistes, de manière objective, transparente et indépendante.
De telles initiatives n'auront qu'un impact limité sur les individus les plus militants, ou les plus méfiants à l'égard des canaux d'information officiels et des médias traditionnels431(*), mais elles peuvent contrecarrer l'influence des fausses informations sur les individus moins engagés.
Au cours des dernières années, plusieurs travaux académiques se sont intéressés aux résultats des processus de vérification des faits (qualifiés de « fact-checking » ou de « debunking »). Globalement, ils montrent que ces interventions parviennent à réduire l'adhésion aux fausses informations432(*), notamment au cours de la crise sanitaire433(*), mais ont parfois l'effet inverse434(*). Cette approche a toutefois plusieurs limites : les effets peuvent être relativement faibles, limités dans le temps et aux personnes n'ayant pas d'avis ou se fourvoyant de bonne foi. En outre, son efficacité est hautement dépendante de la confiance accordée au média ou à l'instance qui effectue la vérification. Enfin, le principal obstacle de cette approche est l'évidente impossibilité de démystifier l'ensemble des fausses informations en circulation, plus rapides à produire qu'à réfuter.
Les actions d'information ne doivent donc pas se limiter à cette approche mais inclure également des actions préventives (qualifiées de « prebunking »), visant à mettre en garde les individus contre les fausses informations avant qu'ils n'y soient exposés, notamment en réfutant les arguments erronés les plus utilisés et en expliquant les stratégies employées435(*). Ces interventions peuvent être plus ou moins spécifiques et prendre la forme d'interventions ludiques436(*), à l'instar du jeu en ligne « Go Viral »437(*) conçu pour lutter contre la désinformation liée à la covid-19. Cette approche, qui permet à chacun d'apprendre à discerner les fausses informations et de devenir son propre « fact-checker », réduit la nécessité de placer sa confiance dans une tierce partie, comme le requièrent les interventions de « debunking ». Le récent développement d'outils d'écoute des réseaux sociaux438(*) devrait permettre d'identifier les fausses informations dès leur émergence et d'y répondre précocement, avant qu'une part importante de la population n'y soit exposée.
La mise à disposition d'informations n'est pas suffisante. Dans le cadre de la crise sanitaire, les effets indésirables des vaccins contre la covid-19 en fournissent un exemple éloquent : la mise en ligne de rapports réguliers de pharmacovigilance n'a pas suffi à leur appropriation par la population. Construire des supports pédagogiques et assurer leur portage vers la population, notamment au travers des médias et des réseaux sociaux, est essentiel. À cet effet, Laurent Cordonier propose de mettre en réseau les créateurs de contenus engagés dans la communication scientifique et de leur fournir les ressources nécessaires. La communauté Fides mise en place par l'OMS439(*), qui regroupe des influenceurs engagés dans le domaine de la santé, et l'alliance CoronaVirusFacts mise en place par l'International Fact-Checking Network440(*), qui regroupe des vérificateurs de faits, sont à cet égard des exemples à suivre.
Les campagnes de communication doivent également être déclinées pour cibler, avec des messages différenciés, les sous-groupes de population susceptibles d'être particulièrement touchés par une fausse information. Pour ce faire, elles doivent être construites à partir des besoins des populations visées et s'appuyer sur des médiateurs de confiance, souvent plus à même de porter des messages et de permettre leur appropriation que les institutions. S'il existe donc un besoin d'une base de ressources centralisée pouvant servir de référence, les actions de communication doivent s'appuyer sur un foisonnement d'initiatives afin de répondre au mieux aux attentes de la population.
Il est important de souligner que l'« infodémie » affecte l'ensemble de la société, y compris les professionnels de santé qui n'ont pas les moyens de se tenir informés de la masse d'articles scientifiques publiés quotidiennement. Au cours de la crise sanitaire, ces professionnels ont dû faire face aux inquiétudes de leurs patients alors qu'ils ne disposaient eux-mêmes que d'informations parfois contradictoires. Selon une étude française, les lacunes dans la communication envers les médecins généralistes au cours de la première vague pandémique ont constitué une difficulté et un facteur de stress pour ceux-ci441(*). Il apparaît donc essentiel de développer des canaux d'information dédiés afin de communiquer efficacement et en temps utile les informations et ressources pertinentes aux professionnels de santé, de manière à ce qu'ils puissent prendre en charge et répondre au mieux aux questions et inquiétudes de leur patientèle442(*).
Comme cela était souligné dans le rapport d'étape de l'Office, la crise sanitaire a été marquée par une abondance de messages « DGS-urgent », parfois pluriquotidiens, démontrant les limites de cet outil. Un travail doit être mené afin de recentrer ces messages sur les situations d'alerte sanitaire, d'améliorer leur compréhensibilité443(*) et de mieux cibler les professionnels de santé. En parallèle, un canal alternatif consacré aux informations qui, bien qu'utiles, ne relèveraient pas de l'urgence doit être développé. Pour le groupe de travail issu des Ateliers de Giens, ce pourrait être le rôle de la plateforme d'information sur les produits de santé proposée.
B. UNE ACTION VIGOUREUSE POUR PROMOUVOIR LES CULTURES SCIENTIFIQUE ET SANITAIRE
Parallèlement aux actions d'information, il apparait nécessaire de mener des actions de fond afin de former la population et la doter des outils lui permettant d'acquérir une plus grande résilience vis-à-vis des fausses informations.
Comme l'a montré une étude du Conseil d'analyse économique conduite au cours de la crise, une meilleure éducation scientifique est corrélée à une plus grande confiance des citoyens dans les scientifiques et à une plus grande résilience face aux pandémies444(*). Or, d'après la dernière enquête PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) conduite en 2022, la France ne se classe que juste au-dessus de la moyenne de l'OCDE sur ce critère (score de 487 contre 485), en légère baisse (2 points) par rapport à l'enquête PISA de 2018445(*). Le groupe de travail des Ateliers de Giens dresse le bilan d'un cruel manque de culture et de littératie sanitaire de la population française. Il est donc primordial de développer une politique publique claire et ambitieuse pour promouvoir la culture scientifique à tous les échelons de la société446(*). Une attention particulière doit être accordée aux sujets médicaux, susceptibles d'emporter de lourdes conséquences sanitaires, avec la mise en place d'initiatives de prévention et d'éducation dès le milieu scolaire.
Outre l'enseignement d'un socle solide de connaissances scientifiques, cette politique publique doit viser à ce que la population comprenne - voire s'approprie - la démarche scientifique, y compris l'incertitude qui lui est inhérente.
En effet, pour plusieurs des personnalités auditionnées, les défauts d'appréhension de cette notion encourageraient les décideurs et les médias à simplifier leurs propos, au risque de devenir eux-mêmes des propagateurs de mésinformation.
Parallèlement, il est nécessaire de former l'ensemble des citoyens à l'esprit critique, à travers une éducation aux médias et à l'information, notamment vis-à-vis des ressources numériques. Plusieurs travaux académiques montrent les bénéfices de telles actions vis-à-vis de la susceptibilité aux fausses informations447(*). Comme le préconise une récente mission « flash » sur l'éducation critique aux médias menée par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, cette formation doit commencer dès le plus jeune âge, en s'appuyant notamment sur les professeurs documentalistes, mais doit également s'adresser à l'ensemble de la population448(*). En effet, selon une étude parue en 2019, les personnes âgées de 65 ans et plus auraient une propension plus élevée à partager de fausses informations sur Facebook que le reste de la population449(*). En outre, ces actions doivent être construites de manière à ne pas simplement encourager le scepticisme - au risque d'induire des doutes à l'égard d'informations qui se révéleraient pourtant vraies450(*) - mais à enseigner les outils d'une réelle pensée analytique.
Les actions de formation doivent également cibler spécifiquement les acteurs susceptibles d'avoir un fort pouvoir d'influence. Comme indiqué précédemment, en raison d'une capacité à légitimer de fausses informations, les médias jouent un rôle de pierre angulaire dans la lutte contre celles-ci. Par conséquent, il est impératif que les écoles de journalisme se saisissent de cette problématique et forment des journalistes compétents au traitement des sujets scientifiques. Cela implique notamment d'apprendre à identifier les experts scientifiques pertinents et les interlocuteurs de confiance, à leur offrir des conditions d'expression adaptées à la complexité de ces sujets et à retranscrire avec rigueur et précision leur parole et l'état des connaissances, dont les nuances et incertitudes peuvent être difficiles à restituer. Il est primordial de ne pas simplifier à outrance les subtilités de la science et de ne pas céder à une volonté de sensationnalisme, sous peine de propager non intentionnellement des informations inexactes, susceptibles d'induire des incompréhensions et d'être exploitées par les désinformateurs. Parallèlement, il est nécessaire de former les scientifiques et professionnels médicaux à communiquer efficacement et de manière accessible, en les incitant à ne s'exprimer que dans leur domaine de compétence et en excluant les opinions personnelles.
C. DES ACTIONS EN DIRECTION DES RÉSEAUX SOCIAUX
Le rôle potentiellement néfaste des réseaux sociaux dans la propagation de fausses informations justifie que des actions spécifiques soient menées en direction de ces plateformes. Au cours de la crise, plusieurs réseaux - notamment Facebook, YouTube et Twitter - ont utilisé des stratégies de « nudging », incitant les utilisateurs à une certaine vigilance quant à la véracité des informations rencontrées ou partagées, dont l'efficacité a été confirmée par plusieurs travaux académiques expérimentaux451(*). Ces initiatives doivent être encouragées et accompagnées d'actions visant à fournir des conseils en littératie numérique, qui ont également montré leur efficacité452(*).
L'architecture des réseaux sociaux détermine l'éditorialisation des contenus mis en ligne et est, à cet égard, susceptible d'engendrer de lourdes conséquences en termes de mésinformation et de désinformation. Récemment, le règlement européen sur les services numériques (Digital Services Act)453(*) a exigé des plateformes numériques qu'elles informent leurs utilisateurs sur les modalités selon lesquelles elles personnalisent les contenus et, pour les plus grandes d'entre elles (utilisées par plus de 45 millions de citoyens européens par mois), qu'elles offrent la possibilité d'utiliser un système de recommandation ne reposant pas sur du profilage. En outre, ces très grandes plateformes doivent analyser annuellement les risques systémiques qu'elles génèrent et prendre les mesures nécessaires pour les atténuer. Dans ce cadre, un dialogue doit être entrepris avec ces plateformes afin de faire évoluer leurs algorithmes pour qu'ils minimisent la diffusion et les éventuels impacts des fausses informations. Pour ce faire, les contenus provenant de créateurs de contenus et d'institutions fiables pourraient notamment être promus, comme le recommande Laurent Cordonier.
Des efforts doivent également être menés pour améliorer la modération des contenus sur ces plateformes, aujourd'hui fortement automatisée et relativement défaillante. Cette ambition est portée par le règlement européen sur les services numériques qui impose aux plateformes la mise en oeuvre d'une modération effective, en proposant des outils de signalement simples d'accès et d'utilisation et en coopérant avec des « signaleurs de confiance »454(*) dont les signalements sont traités en priorité.
D. BÂTIR LA CONFIANCE DE LA POPULATION
La mésinformation et la désinformation sont étroitement liées à la confiance de la société envers les institutions et les sources fiables d'information. Le renforcement de cette confiance, qui apparaît comme une priorité, doit être mené en amont des situations de crise, au cours desquelles elle est difficile à gagner et a plutôt tendance à s'éroder. En effet, puisque les individus sont plus fréquemment exposés à des informations fiables qu'à de fausses informations, renforcer la confiance dans les premières offrirait de plus grands bénéfices qu'augmenter la méfiance envers les secondes455(*).
La construction d'une confiance dans l'information ne peut passer que par la diffusion d'une information de confiance. Celle-ci se doit d'être bâtie sur la base de l'état des connaissances scientifiques et ne pas céder aux sirènes de la sur-simplification, sous peine de générer des imprécisions s'éloignant de la réalité scientifique. Les institutions doivent s'exprimer de manière coordonnée et cohérente, afin de ne pas créer ce sentiment de cacophonie ou de dissensus qui a malheureusement pu être observé pendant la crise sanitaire456(*).
La communication politique apparaît également comme un facteur clef dans la construction de cette confiance. Celle-ci doit faire preuve de transparence et reconnaître la responsabilité et la capacité de discernement de la population. Au début de la crise sanitaire, la communication gouvernementale sur l'usage des masques a pu faire prospérer l'idée d'une communication insincère. Aussi, au cours de l'été 2022, 60,5 % des répondants à une enquête française estimaient que les autorités avaient volontairement caché certaines informations au public457(*). L'adhésion de la société aux décisions politiques dépend de la qualité des informations et des justifications qui lui sont apportées, notamment en cas de divergences - qui peuvent être légitimes - avec d'éventuels avis d'expertise.
Or, selon cette même enquête, seuls 42,6 % des déclarants estimaient que les raisons scientifiques des décisions prises pour gérer la pandémie avaient été bien expliquées. A posteriori, la reconnaissance des erreurs commises, compréhensibles dans un contexte d'urgence et de connaissances mouvantes, est aussi primordiale pour instaurer un lien de confiance. Il est enfin essentiel de maintenir une distinction claire entre les discours scientifique et politique, afin d'éviter une vision partisane de la science et de provoquer une perte de confiance tant dans la science que dans la politique.
E. UN TRAVAIL DE RECHERCHE NÉCESSAIRE
Promouvoir les recherches sur les fausses informations est primordial. Comme le propose l'agenda pour la recherche construit par l'Organisation mondiale de la santé458(*), il est nécessaire d'acquérir de plus amples connaissances sur les pratiques de la population en matière d'information, l'écosystème et la propagation des fausses informations, les mécanismes et facteurs qui conduisent à leur adhésion, les conséquences qu'elles sont susceptibles d'entraîner et les méthodes et outils les plus appropriés pour lutter efficacement contre ce fléau. Ces recherches doivent être encouragées à l'échelle française, en raison du rôle central des contextes informationnel et culturel qui ne permettent pas de transposer systématiquement les résultats obtenus à l'étranger.
V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
L'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication a profondément modifié les mécanismes de production, de diffusion et de consommation de l'information et engendré une surcharge informationnelle. Dans le cadre de la pandémie de la covid-19, ce contexte s'est traduit par une « infodémie » aux conséquences sanitaires parfois lourdes, invitant à porter un regard nouveau sur la circulation des fausses informations. À cet égard, le rôle des réseaux sociaux a été mis en avant, grâce à l'opportunité d'expression et à la forte visibilité qu'ils offrent aux désinformateurs. Si cette contribution est indéniable, il est essentiel de reconnaître les rôles d'autres acteurs, tels que les médias traditionnels et les autorités politiques, qui bénéficient d'un fort pouvoir d'influence, ainsi que l'importance des différents facteurs qui motivent l'adhésion à ces fausses informations, susceptibles d'être instrumentalisés par les désinformateurs. De nombreuses actions doivent être menées afin de mieux informer, éduquer et restaurer la confiance de la population. Un effort doit être entrepris pour cibler les publics les plus sensibles aux fausses informations et les acteurs jouant un rôle important vis-à-vis de cette problématique : les scientifiques, les médias, les décideurs et les réseaux sociaux.
RECOMMANDATIONS
1. Améliorer la communication scientifique. Développer des canaux fiables d'information en lien avec les organismes de recherche, les sociétés savantes et les Académies. Encourager la mise au point de supports pédagogiques clairs et d'initiatives destinées aux publics les plus susceptibles d'être touchés par les fausses informations. Fournir des informations fiables aux journalistes, acteurs clés dans l'information de la population sur les sujets de santé.
2. Former les scientifiques et les professionnels de santé à la communication scientifique vers le grand public et à la réponse aux fausses informations. Encourager et accompagner les volontaires à s'exprimer dans les médias, dans leur seul domaine d'expertise, à travers une approche rigoureusement scientifique.
3. Lorsque des questions scientifiques apparaissent dans le débat public, encourager une communication politique transparente, pédagogique et clairement séparée de la communication scientifique.
4. Mettre en place des politiques éducatives visant à promouvoir la culture scientifique et le sens critique à l'égard des médias et de l'information.
5. Améliorer le traitement médiatique des sujets scientifiques et encourager les réseaux sociaux à mener des actions pour limiter la diffusion de fausses informations. Sanctionner les dérives susceptibles d'avoir des conséquences dommageables pour la santé publique.
6. Encourager les recherches sur la mésinformation et la désinformation.
EXAMEN DU RAPPORT PAR L'OFFICE
L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques s'est réuni le jeudi 30 mai 2024 afin d'examiner le projet de rapport sur les effets indésirables des vaccins et les dernières évolutions des connaissances scientifiques sur la covid-19, présenté par MM. Philippe Berta et Gérard Leseul, députés, et Mmes Sonia de La Provôté et Florence Lassarade, sénatrices, rapporteurs.
M. Stéphane Piednoir, sénateur, président de l'Office. - Dès le début de la pandémie, l'Office s'est attentivement penché sur le virus du covid et sa propagation, sur la mise au point des tests, des vaccins, de la stratégie vaccinale ou encore sur les conséquences de la pandémie dans différents domaines.
Ces travaux ont donné lieu à plusieurs auditions et à la publication de rapports et notes scientifiques. Le dernier rapport sur le sujet date de juin 2022 et portait sur les effets indésirables des vaccins contre la covid-19. Il s'agissait de répondre à une saisine de la commission des affaires sociales du Sénat, provoquée par une pétition qui avait recueilli près de 100 000 signatures sur le site internet du Sénat.
Pour ceux qui ont rejoint l'Office après cette date, j'indique que l'élaboration du rapport s'était déroulée dans une ambiance délétère, marquée par la réception d'une avalanche d'emails et des menaces sur les réseaux sociaux, jusqu'à l'envoi d'un huissier pour que l'Office convoque de soi-disant spécialistes. Je peux attester que l'Office, conformément à ses habitudes, avait consulté très largement et entendu toutes les voix scientifiques, plus ou moins sérieuses.
À l'époque, nous avions décidé que le rapport serait un rapport d'étape pour laisser la possibilité aux rapporteurs d'effectuer un nouveau point sur les effets indésirables des vaccins à moyen terme. Les rapporteurs, Gérard Leseul, Sonia de La Provôté et Florence Lassarade, rejoints par Philippe Berta, ont décidé d'élargir le périmètre de ce nouveau rapport. Je leur donne la parole.
M. Gérard Leseul, député, vice-président de l'Office, rapporteur. - En février 2022, la commission des affaires sociales du Sénat avait saisi l'Office pour étudier les effets indésirables de la vaccination contre la covid-19 et le système français de pharmacovigilance. Avec mes collègues rapporteurs, nous avions alors établi un rapport d'étape dressant une première analyse sur la base des éléments scientifiques disponibles.
Le 26 octobre 2023, le bureau de l'Office nous a confié le soin d'établir un rapport conclusif au périmètre élargi, incluant notamment les éléments nouveaux ayant pu émerger sur la covid-19. Nous avons été rejoints par Philippe Berta et en avons profité pour effectuer un point plus large sur l'évolution des connaissances autour du covid long et nous intéresser aux nouveaux outils de surveillance épidémiologique et d'anticipation sanitaire et à la désinformation en santé.
Nous vous présentons aujourd'hui les principaux enseignements tirés de ces travaux. Je débuterai par l'évolution des connaissances sur les effets indésirables des vaccins contre la covid-19 et le système de pharmacovigilance français.
Les vaccins utilisés au début de la campagne vaccinale bénéficiaient d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, depuis convertie en autorisation standard. De nouvelles versions de certains vaccins, adaptées aux souches circulantes, ont également été approuvées pour améliorer la protection face à l'évolution du virus. Enfin, de nouveaux vaccins développés par les laboratoires Valneva, Sanofi-GSK et Hipra ont été autorisés.
La période pandémique est aujourd'hui terminée, mais le virus continue de circuler et de faire de nouvelles victimes, rendant essentiel le maintien d'une certaine couverture vaccinale. La stratégie de vaccination est entrée dans un processus de normalisation. La primo-vaccination en population générale n'est plus recommandée ; seules les personnes âgées et à risque de formes graves sont invitées à se faire administrer une dose de rappel annuelle ou biannuelle. La Haute Autorité de santé (HAS) recommande l'utilisation d'un vaccin adapté aux dernières souches circulantes, de préférence à ARNm.
La campagne vaccinale s'est accompagnée de la collecte et de l'évaluation des déclarations d'événements indésirables. La surveillance est entrée dans un processus de normalisation et elle est aujourd'hui réalisée comme pour les autres médicaments. L'importance de la campagne de vaccination a permis de disposer d'un volume de données inédit et de faire des vaccins contre la covid-19 l'un des produits de santé les mieux surveillés.
Depuis l'adoption du rapport d'étape, les travaux menés par les organismes de pharmacovigilance et de pharmaco-épidémiologie ont entraîné des ajouts aux listes des effets indésirables, dont des saignements menstruels abondants temporaires, souvent sans gravité, pour les vaccins Comirnaty et Novavax et des myocardites et péricardites - déjà identifiées comme des effets indésirables des vaccins ARNm - pour les vaccins Nuvaxovid et Jcovden. Ces effets impactent toutefois peu la balance bénéfice/risque. Différents signaux potentiels restent surveillés par les autorités sanitaires.
Le profil de sécurité des vaccins adaptés aux souches circulantes n'a pas montré de différence par rapport à celui des vaccins originaux.
Malgré un moindre recul, les vaccins plus récemment autorisés semblent bien tolérés. La surveillance en vie réelle a permis d'acquérir des données sur des populations généralement exclues des essais cliniques. Plusieurs études montrent une bonne tolérance chez les femmes enceintes, les enfants et les personnes vulnérables.
Le développement des vaccins contre la covid-19 en un temps record a été une véritable prouesse. Nous souhaitons aussi souligner la performance des systèmes de pharmacovigilance et de pharmaco-épidémiologie mondiaux, qui ont accompagné cette campagne sans précédent en évaluant les risques associés et en permettant l'adaptation rapide des recommandations vaccinales. Le système français s'est notamment distingué avec l'identification de nombreux signaux potentiels. En outre, la mise en lumière du travail de suivi et d'évaluation des vaccins a produit des bénéfices indirects pour la pharmacovigilance, aujourd'hui davantage sollicitée par les professionnels de santé libéraux, et ses concepts sont mieux compris par la population.
Ces résultats ne doivent toutefois pas masquer les difficultés auxquelles font face les structures chargées de la surveillance. Au contraire, ils doivent inviter à les conforter, notamment par l'attribution de moyens humains et financiers à la hauteur de leur mission pour la protection de la santé publique. Un affaiblissement de ces structures pourrait amoindrir la confiance du public dans les médicaments et ferait courir un risque en cas de nouvelle crise sanitaire.
Nous avions émis des craintes concernant les conséquences que pourrait avoir la crise sur l'adhésion à la vaccination. Il apparaît que la campagne a globalement été un succès. Nous notons toutefois une érosion de l'adhésion aux campagnes de rappel. L'adhésion vaccinale demeure un sujet de préoccupation, comme le montre le faible succès de la campagne contre le HPV.
La communication des autorités sanitaires est essentielle. Si des rapports réguliers et détaillés sur les vaccins ont été publiés par le système de pharmacovigilance, la diffusion de ces informations vers le grand public a fait défaut. Il est important d'en tirer les enseignements et de repenser la communication autour des campagnes vaccinales et des médicaments, en construisant une communication claire, lisible et pédagogique permettant une bonne appréciation de la balance bénéfice/risque par la population.
Nous recommandons de :
· poursuivre la surveillance des vaccins ;
· organiser le dispositif de surveillance de manière à pouvoir le renforcer lors de la mise sur le marché de médicaments innovants susceptibles d'entraîner des craintes excessives parmi la population ou un risque important d'effets indésirables ;
· poursuivre la démarche d'amélioration de la quantité et de la qualité des déclarations de pharmacovigilance pour optimiser la détection des signaux, en sensibilisant les professionnels de santé et la population à l'intérêt de la pharmacovigilance ;
· maintenir l'organisation actuelle du réseau des CRPV et d'EPI-PHARE et de les doter de moyens suffisants ;
· améliorer la communication sur les effets indésirables, de diffuser des campagnes destinées aux personnes hésitantes et de lutter contre de fausses informations ;
· expliquer de manière pédagogique les éventuelles évolutions des stratégies vaccinales afin de permettre leur bonne compréhension et garantir leur acceptabilité.
Mme Florence Lassarade, sénatrice, vice-présidente de l'Office, rapporteure. - Je vais à présent évoquer la thématique du covid long.
Bien que cette maladie ait été identifiée dès la première vague épidémique et qu'elle soit associée à un lourd impact en termes de santé publique, elle demeure mal comprise et continue de pâtir d'une faible attention. Aujourd'hui, aucune définition harmonisée n'existe. Faute d'identification d'un symptôme ou d'un marqueur spécifique, le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments ou un processus différentiel. Plus de 200 symptômes potentiels sont associés à cette maladie. Ils touchent de nombreux organes, sont relativement hétérogènes et caractérisés par une grande fluctuation dans le temps. Outre les risques de sous-diagnostic et de retard de prise en charge, cette situation complexifie l'acquisition des connaissances sur les dimensions épidémiologiques, physiopathologiques, thérapeutiques, médico-économiques et sociales de la maladie.
La prévalence du covid long continue de faire l'objet d'incertitudes. On estime qu'il touche, chez les adultes, 10 à 30 % des cas non hospitalisés et 50 à 70 % des cas hospitalisés. Les dernières études suggèrent des proportions similaires chez les enfants et adolescents. Si dans la majorité des cas, l'état des patients semble progressivement s'améliorer, la dynamique de cette évolution et les facteurs sous-jacents demeurent encore largement méconnus.
Le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) considère qu'en France, plusieurs centaines de milliers de personnes seraient actuellement affectées dans leur vie quotidienne. Avec l'évolution de la pandémie, la prévalence de cette maladie aurait baissé, sans doute en raison de ses caractéristiques intrinsèques, des nouveaux variants et de l'immunité de la population. En effet, la vaccination permettrait de diminuer significativement le risque de covid long en cas de contamination.
Malgré de nombreuses recherches, le mécanisme à l'origine du covid long reste inconnu ; plusieurs hypothèses sont explorées. L'explication « somatoforme » - c'est-à-dire d'une maladie qui résulterait d'une psychosomatisation - semble récusée par la majorité de la communauté scientifique.
La mauvaise compréhension du mécanisme de la maladie ne permet pas d'identifier de cible thérapeutique et complexifie le développement de traitements curatifs. Plusieurs essais cliniques sont toutefois en cours. La stratégie thérapeutique recommandée par la HAS repose actuellement sur quatre axes : des traitements symptomatiques pour atténuer les symptômes qui peuvent l'être ; l'éducation des patients afin qu'ils adaptent leurs activités et leur environnement à leurs symptômes ; une approche rééducative dans les différents domaines fonctionnels touchés par la maladie ; la prise en charge des troubles anxieux et dépressifs des patients concernés.
Malgré l'effort de structuration de l'offre de soins, les parcours restent souvent mal organisés. L'offre est trop peu lisible, tant pour les patients que pour les professionnels de santé, dont la formation et l'information sur le covid long sont insuffisantes.
Cette situation entraîne un manque de reconnaissance des souffrances, une certaine errance médicale qui génère un sentiment d'abandon, voire de stigmatisation. Le covid long s'accompagne parfois de conséquences invalidantes pour la vie individuelle, familiale et professionnelle des malades. Les études menées chez les enfants et les adolescents suggèrent également des conséquences du point de vue scolaire. Dans ce contexte, les médecins du travail et scolaires ont un rôle crucial à jouer pour accompagner ces patients.
Des dispositifs de prise en charge sanitaire et sociale adaptés et facilement accessibles doivent être mis en place. Alors que l'attention de la société se détourne progressivement de la covid-19, il paraît impératif de continuer à étudier le covid long. Deux ans après la publication de notre dernier rapport, nous constatons que les quatre leviers que nous avions identifiés - parcours de soins organisés et structurés, formation et accompagnement des professionnels de santé, information pour les patients et dispositifs de reconnaissance adaptés - restent prioritaires.
Outre la nécessité de campagnes d'information à destination des communautés médicales et paramédicales, il est essentiel de sensibiliser l'ensemble de la population à la réalité du covid long afin d'éviter toute discrimination des patients et de mettre en place une démarche de prévention. Les recherches sur cette maladie doivent être poursuivies et encouragées afin de pouvoir mieux la comprendre, la suivre et la traiter.
Aussi, nous recommandons de :
· développer et harmoniser les parcours de soins pour covid long sur l'ensemble du territoire ;
· mettre en place la plateforme de référencement et de prise en charge des maladies chroniques contre la covid-19, prévue par la loi du 24 janvier 2022 ;
· former et informer les professionnels médicaux et paramédicaux sur le covid long et les méthodes de diagnostic et de prise en charge médicale et sociale ;
· renforcer le rôle des cellules de coordination post-covid pour l'ensemble des soignants ;
· créer une infection de longue durée et un tableau de maladies professionnelles spécifiques pour les formes prolongées de la covid-19 ;
· mener une campagne nationale d'information, de sensibilisation et de prévention ;
· poursuivre les recherches transdisciplinaires en finançant notamment de nouveaux appels à projets dédiés.
Mme Sonia de La Provôté, sénatrice, rapporteure. - Le troisième volet de notre rapport concerne la surveillance et les outils de surveillance épidémiologique.
La crise sanitaire a entraîné une mobilisation scientifique sans précédent et internationale. Si le développement de vaccins efficaces en moins d'une année a constitué la plus grande prouesse, de nombreuses autres innovations sont venues en soutien des mesures de santé publique. Nous avons fait le choix de revenir ici sur les outils de surveillance épidémiologique et d'anticipation sanitaire développés pendant la crise, dans la continuité des débats soulevés lors de nos rapports précédents.
La surveillance épidémiologique coordonnée par Santé publique France vise à suivre l'émergence et l'évolution des épidémies et problèmes de santé et à acquérir des connaissances sur leurs caractéristiques. Elle permet de dresser une image globale de la situation sanitaire et d'anticiper les risques à venir. Cette surveillance s'est avérée déterminante pour suivre et contenir la propagation du virus grâce au déploiement de mesures d'alerte, de prévention et de contrôle.
Les nouveaux fichiers mis en place ont permis de suivre la propagation du virus, son impact hospitalier et la couverture vaccinale au travers des fichiers SI-DEP (suivi du dépistage), SI-VIC (suivi des victimes) et SI-VAC (vaccinations covid-19). Le fichier Contact-covid a, pour sa part, permis de suivre les chaînes de contamination.
Ces dispositifs ont été source de débats en termes de suivi, de surveillance, de protection des données et de protection individuelle. La phase aiguë de la pandémie étant révolue, certains de ces fichiers ont été interrompus, tandis que d'autres ont évolué pour s'adapter à la situation sanitaire. Une forme simplifiée du fichier de suivi du dépistage néoSI-DEP a ainsi vu le jour en 2023, dans l'attente d'un système plus exhaustif (Laboé-SI) qui permettra de suivre un plus grand nombre de maladies et pourra s'adapter aux crises sanitaires futures. De même, le projet Orchidée (Organisation d'un réseau de centres hospitaliers impliqué dans la surveillance épidémiologique et la réponse aux émergences) doit mettre au point un outil tirant les leçons des limites et imperfections du fichier SI-VIC pour la remontée des données hospitalières en ne les limitant pas à la covid-19 et en permettant de suivre l'émergence de risques sanitaires nouveaux.
Une autre innovation importante a été développée : l'utilisation de méthodes de suivi du virus à partir des eaux usées. Cette technique, développée antérieurement à la crise, a été déployée pour la première fois à large échelle. L'outil permet de détecter les tendances épidémiques de manière précoce et de suivre la population, pour un coût réduit, indépendamment de son état de santé et de la stratégie de dépistage. Dès le début de la crise sanitaire, le consortium Obépine a démontré les opportunités de l'outil pour suivre l'épidémie de manière quantitative et dans une temporalité pertinente. Soutenu financièrement par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ce consortium a pu exploiter de manière expérimentale un réseau de surveillance reposant sur plus de 200 stations pendant plus d'un an. Aujourd'hui, un dispositif pérenne (SUM'Eau) est chargé de la surveillance microbiologique des eaux usées. Opérationnel depuis octobre 2023, ce système doit encore connaître des développements - il ne s'appuie que sur douze stations de traitement des eaux usées et ne permet pas encore de suivre les variants en circulation par séquençage des échantillons prélevés.
Au regard des connaissances acquises et des perspectives en matière de surveillance épidémiologique, il apparaît essentiel de continuer à soutenir et perfectionner les dispositifs de suivi des eaux usées. Cette méthode apparaît très pertinente pour surveiller et anticiper la propagation du SARS-CoV-2, mais aussi d'autres germes. Son extension à d'autres maladies ou problèmes de santé pourrait apporter des bénéfices importants.
Dans cette optique, la construction d'une plateforme de recherche et d'innovation Obépine+, destinée à soutenir les réseaux en développement, doit être bien soutenue.
La surveillance génomique, quant à elle, a pour objet de suivre l'évolution du virus pour anticiper les conséquences associées à ses mutations. Un développement important des capacités de séquençage a été entrepris pendant la crise sanitaire, rattrapant le retard que nous avions accumulé.
Créé en janvier 2021, le consortium Emergen a permis d'identifier l'émergence de nouveaux variants et la répartition des variants circulant sur le territoire. Aujourd'hui, ce consortium a adapté ses activités au niveau de circulation actuel du virus et évoluera prochainement pour inclure de nouveaux agents pathogènes.
En mettant en lumière les lacunes de notre capacité de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, des leçons ont pu être tirées de la crise sur le plan organisationnel. De nouvelles structures ont ainsi été créées. En France, un centre de crise sanitaire a été institué au sein de la direction générale de la santé tandis que l'Union européenne a créé une Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire.
Ces démarches de retour d'expérience doivent être encouragées. Face au risque d'émergence ou de réémergence de virus, il apparaît crucial de tirer toutes les leçons des échecs et des succès de notre gestion de la pandémie. La période post-pandémique doit être utilisée pour réévaluer notre organisation et accroître nos efforts en matière d'anticipation et de préparation.
La recherche, cruciale dans la réponse à la crise sanitaire, doit faire l'objet d'un soutien public important. Les principaux axes de travail concernent les menaces susceptibles d'entraîner des crises sanitaires majeures, les facteurs d'émergence de ces crises, les solutions de prévention à encourager et les mesures médicales à mettre en place.
Ainsi, nous recommandons de :
· maintenir une surveillance approfondie du SARS-CoV-2 pour anticiper les risques pouvant résulter de sa circulation persistante ;
· définir et déployer une stratégie de recherche sur les menaces sanitaires, fondée sur le continuum recherche fondamentale/recherche appliquée ;
· renforcer le système de surveillance pour détecter précocement et suivre l'évolution de toute menace sanitaire ;
· veiller à ce que le système de surveillance soit étroitement articulé avec l'effort de recherche sur les outils de surveillance développés ;
· poursuivre le retour d'expérience sur la crise de la covid-19 et investir pour améliorer les capacités d'anticipation, de préparation et de réponse aux futures crises sanitaires.
M. Philippe Berta, député, rapporteur. - Je termine cette présentation avec le sujet de la désinformation en santé.
La circulation de fausses informations n'est pas une problématique récente. Elle a toutefois pris une importance nouvelle au cours de la pandémie. En raison du déficit d'informations fiables et du sentiment d'anxiété de la population, les crises s'avèrent particulièrement propices à la circulation de fausses informations qui sont, du fait du contexte, à même d'emporter de lourdes conséquences sanitaires.
La pandémie de covid-19 est intervenue dans un cadre informationnel nouveau. Le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication a entraîné une augmentation rapide et massive du volume d'informations échangées. L'OMS évoque une « infodémie », c'est-à-dire une surabondance d'informations rendant difficile l'identification des sources fiables. Cette situation a nui à la compréhension et à l'adoption des mesures sanitaires et, par conséquent, à la santé publique. En permettant à tout un chacun de s'exprimer avec une liberté quasi totale, les réseaux sociaux contribuent à cette cacophonie et fournissent un mode d'expression aux désinformateurs qui n'avaient jusqu'alors que peu voix au chapitre. S'emparant de cette opportunité, ces derniers sont à l'origine d'une part importante du contenu disponible sur ces réseaux. Ils bénéficient d'une visibilité et d'un pouvoir d'influence disproportionnés au regard de leur légitimité.
Cette surexpression des désinformateurs est accentuée par l'éditorialisation des contenus par les plateformes, qui privilégient des contenus sensationnels et clivants, plus à même de créer de l'engagement parmi les utilisateurs. Les réseaux sociaux agissent alors comme un miroir déformant qui renforce la visibilité d'individus aux positions extrêmes, pourtant peu représentatifs de la société dans son ensemble.
En proposant principalement des contenus en accord avec les préférences individuelles, les algorithmes des réseaux sociaux ne permettent pas la confrontation d'idées et la remise en question critique des informations rencontrées. Au contraire, ils sont susceptibles d'enfermer les utilisateurs dans des bulles numériques qui peuvent laisser croire à l'existence d'un consensus.
Les réseaux sociaux ont donc probablement contribué à la désinformation pendant la crise sanitaire. Pour autant, ces fausses informations peinent généralement à atteindre un large public et touchent principalement des personnes déjà convaincues ou enclines à les accepter. Les fausses informations ne représenteraient finalement qu'une faible part des informations consommées par les internautes, qui consultent principalement des sources fiables et conservent une bonne capacité de discernement. Si la contribution des réseaux sociaux à la désinformation est indéniable, il est nécessaire de nuancer leur rôle et de reconnaître l'implication d'autres acteurs, tels que les médias plus traditionnels et les autorités politiques.
Plus que la circulation de fausses informations sur les réseaux sociaux, c'est la légitimation de ces discours par des acteurs bénéficiant d'une plus forte audience qui est susceptible d'avoir un impact important en termes de désinformation. Les médias traditionnels, les scientifiques et les professionnels de santé qui bénéficient d'une forte confiance de la population jouent un rôle important au travers de la parole qu'ils portent.
Les travaux de recherche sur la désinformation montrent que l'acceptation des fausses informations se bâtit sur un terreau alimenté par un déficit d'informations et une méfiance envers les sources officielles. Le manque de connaissances scientifiques et médicales - très prononcé en France - augmente la sensibilité aux fausses informations, qui est également corrélée à la sensibilité aux croyances ésotériques et paranormales et aux médecines alternatives. Divers moteurs psychologiques, incluant des facteurs cognitifs et socio-affectifs, accroissent la susceptibilité à la désinformation. Les désinformateurs instrumentalisent ces moteurs psychologiques en faisant appel à une démagogie cognitive, en proposant des récits en accord avec les prédispositions individuelles et en mobilisant les facteurs et biais susceptibles d'encourager leur acceptation.
Pour lutter contre cette désinformation, il apparaît donc crucial de développer la culture scientifique et sanitaire à destination du plus grand nombre, en fournissant des informations claires, fiables et adaptées. Il est important de construire une confiance envers les institutions et les sources fiables d'information, ce qui suppose de diffuser une information de confiance. Les acteurs influents en termes d'information, les scientifiques, les professionnels de santé, les médias et les décideurs politiques doivent être formés afin de communiquer de manière pédagogique et rigoureuse les connaissances scientifiques.
Ces actions d'information doivent être déclinées pour cibler les sous-groupes de population susceptibles d'être touchés par ces fausses informations. Les différentes plateformes doivent également être encouragées à mieux faire face à cette problématique en modifiant leurs algorithmes, en modérant plus sévèrement leurs contenus et en sensibilisant à la littératie numérique.
Les actions d'information ne doivent pas s'inscrire qu'en réaction aux fausses informations, mais inclure des actions d'éducation préventives et de fond. À cet effet, il est essentiel de renforcer la formation de la population à l'esprit critique et à la démarche scientifique, à travers l'éducation aux médias, à l'information, à la littératie sanitaire et à la culture scientifique, à l'aide de politiques publiques claires et ambitieuses.
Nous recommandons donc :
· d'améliorer la communication scientifique :
- en développant des canaux fiables d'information, en lien avec les organismes de recherche, les sociétés savantes et les académies ;
- en encourageant la mise au point de supports pédagogiques clairs et des initiatives destinées aux publics les plus susceptibles d'être touchés par ces fausses informations ;
- en fournissant des informations et des formations fiables aux journalistes ;
· de former les scientifiques et les professionnels de santé à la communication scientifique grand public et à la réponse aux fausses informations, d'encourager et d'accompagner les volontaires à s'exprimer dans les médias dans leur seul domaine d'expertise, à travers une approche rigoureusement scientifique ;
· lorsque des questions scientifiques apparaissent dans le débat public, d'encourager une communication transparente, pédagogique et clairement séparée de la communication scientifique ;
· de mettre en place des politiques éducatives dès l'école primaire pour promouvoir la culture scientifique et le sens critique à l'égard des médias et de l'information ;
· d'améliorer le traitement médiatique des sujets scientifiques, d'encourager les réseaux sociaux à mener des actions pour limiter la diffusion des fausses informations et de sanctionner les dérives susceptibles d'avoir des conséquences dommageables pour la santé publique ;
· d'encourager les recherches sur la mésinformation et la désinformation.
M. Stéphane Piednoir, sénateur, président de l'Office. - Le 17 mars 2020, nous entrions dans une période d'incertitude sur ce qu'était cette nouvelle maladie. Comme souvent, nous sommes passés « du tout au tout », en ne sachant pas faire le tri parmi la surabondance d'informations. La formation académique, dès le plus jeune âge, à l'esprit critique et à l'information scientifique aiderait à faire le tri dans ce magma. La culture et l'esprit critique ne se construisent pas sur TikTok.
En tant que politiques, nous sommes régulièrement amenés à prendre position sur des sujets scientifiques, soit en tant que législateur, soit dans des débats. Il est du rôle de l'OPECST d'orienter les choix et les décisions de nos collègues parlementaires. Tous nos rapports sont à disposition des députés et des sénateurs, qui peuvent s'en saisir et en faire l'usage qu'ils souhaitent.
Vous connaissez la formule : « La première victime d'une guerre, c'est toujours la vérité. » Étymologiquement, et par définition, la crise est un catalyseur de prises de décisions. Cela est vrai en temps de guerre comme en temps d'épidémie. Ces décisions doivent conduire à un soutien à la recherche. Au-delà d'une hausse des moyens, la constitution de grands établissements et la proximité de l'industrie et des universitaires sont des éléments importants.
Il s'agit aussi d'un moment de décision pour le développement des réseaux de surveillance. Nous avons découvert comment l'analyse des eaux usées pouvait révéler l'apparition de nouveaux variants.
Vous évoquiez le covid long. La science, c'est aussi parfois être capable de dire que nous ne savons pas. Il existe une forme d'incompréhension générale sur la persistance de ce covid long. Les troubles psychosomatiques semblent écartés. Théoriquement, les scientifiques se réunissent et aboutissent à un consensus scientifique, qui n'est pas synonyme d'unanimité scientifique. La science bute jusqu'à ce qu'elle trouve des réponses à ces questionnements.
Je vous remercie pour ce travail.
Mme Martine Berthet, sénatrice. - J'ai été membre de la commission des affaires sociales lors de la crise. Nous avions auditionné plusieurs experts, qui nous invitaient à porter un masque, y compris à l'extérieur. Initialement, ce discours n'était pas celui des autorités et du Gouvernement. Parmi vos propositions, quelles seraient celles qui permettraient de mieux prendre en compte les recommandations des scientifiques dès le départ ?
Vous proposez d'inscrire le covid long sur la liste des affectations de longue durée. Des démarches sont-elles en cours au sein de la Cnam ?
M. Philippe Berta, député, rapporteur. - Il convient de distinguer les scientifiques et les médecins. En France, la formation de ces deux populations n'est pas mixte. J'étais président de la commission de l'Assemblée nationale pour le suivi de la pandémie. Au début, nous avons entendu les scientifiques. Cela n'a pas duré longtemps, car leur position scientifique est une position de doute. Pour les journalistes, il n'est pas intéressant d'entendre « Je ne sais pas ». Or, nous ne pouvions rien dire d'autre pendant les premiers mois. Les scientifiques ont donc très rapidement été remplacés par des médecins. J'ai découvert à la télévision des infectiologues inconnus du sérail de la bactériologie ou de la virologie. Nous devons nous interroger sur les personnes à qui nous donnons la parole.
Je me souviens de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Nous étions deux à prendre la parole face à Didier Raoult, dont la dérive morale et intellectuelle était connue depuis longtemps, dans une indifférence générale. Les plus hautes autorités de l'État se sont rendues à son chevet. Nous l'avons laissé vendre son hydroxychloroquine, alors que nous savions depuis longtemps qu'il se passait des choses peu claires à l'IHU de Marseille. Cela a fait beaucoup de mal. Nous sommes beaucoup de scientifiques à avoir souffert de cette situation. Notre parole de sachant portait de moins en moins.
Je reste inquiet pour l'avenir lorsque je constate l'effondrement de l'intérêt pour la science, les technologies et l'industrie. Les études d'opinion sont dramatiques. À l'entrée en 6e, la France est l'avant-dernier pays de l'OCDE en matière de culture scientifique. Pourquoi ne comprenons-nous pas que la science et la santé constituent une porte d'entrée massive pour les complotistes et les extrémistes ? Nous devons avoir une réaction à la hauteur.
M. Gérard Leseul, député, vice-président de l'Office, rapporteur. - Le sujet des masques a été largement détaillé dans notre premier rapport.
Mme Sonia de La Provôté, sénatrice, rapporteure. - La troisième proposition présentée par Philippe Berta traite du point soulevé par notre collègue. L'enjeu est celui de la confiance dans la parole publique. Le ministre de la santé ne doit pas être un médecin qui s'exprime, sous peine d'introduire une confusion de la parole publique. Le ministre donne les orientations des politiques publiques.
L'ambiguïté a existé dès le début sur le sujet des masques. Une référence a été faite à une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association (JAMA) relative au virus de la grippe et dont le protocole scientifique a été contesté. Nous avons adossé à cette étude la réponse à la non-distribution des masques aux médecins généralistes. Ce n'est pas une réponse de scientifique car un tel parallèle n'est pas possible scientifiquement. La parole publique aurait dû expliquer que les hôpitaux étaient prioritaires du fait de la surexposition de leur personnel, et que la médecine de ville serait fournie dans un second temps.
Mme Florence Lassarade, sénatrice, vice-présidente de l'Office, rapporteure. - Le confinement a permis de faire émerger des solutions car les scientifiques étaient alors disponibles. Ce facteur temps a permis des avancées. Il convient également de souligner la collaboration internationale qui s'est mise en oeuvre.
À l'heure actuelle, le covid long n'est pas une ALD. Nous préconisons cette reconnaissance. En tant que médecin, je reste sollicitée par des personnes qui souffrent de covid long. Les cas chez les enfants restent sous-estimés. Ces derniers ont été moins vaccinés, car la pathologie était bénigne. Certains ont toutefois été victimes d'un covid long. Nous observons chez beaucoup des chutes brutales de résultats scolaires, parfois pendant plusieurs années. Ils présentent des signes de grande fatigabilité, des troubles de mémoire. Rétrospectivement, nous devons nous interroger sur la pertinence de la décision prise en matière de vaccination.
Mme Sonia de La Provôté, sénatrice, rapporteure. - La difficulté est de caractériser la maladie. À ce stade, il n'existe pas de consensus. Nous observons néanmoins des avancées. Le recensement des cas reste difficile. Nous avons l'opportunité de disposer de données répertoriées à l'international, mais nous n'avons pas encore complètement exploité ces données massives.
Nous devons avancer sur la recherche autour du covid long. Ces travaux ouvriront probablement les connaissances sur des mécanismes que nous ignorons.
Mme Florence Lassarade, sénatrice, vice-présidente de l'Office, rapporteure. - Un premier exemple : la vaccination des canards landais au cours de l'hiver a permis de stopper l'épidémie de grippe aviaire.
M. Philippe Berta, député, rapporteur. - Il est dommage que cette stratégie n'ait pas été étendue outre-Atlantique, où des cas de H5N1 chez les bovidés ont été recensés et où l'on déplore deux morts humaines.
M. Philippe Bolo, député. - Vous indiquez qu'il faudrait « encourager » les réseaux sociaux à mener des actions pour limiter la diffusion de fausses informations. Il me semblerait plus opportun de les contraindre, d'exiger ou de leur imposer, sous peine que ces demandes ne soient jamais suivies d'effets.
M. Jean-François Portarrieu, député. - En avril 2023, l'Ipsos a publié les résultats d'une grande étude sur la relation entre les Français et les vaccins, indiquant que les trois quarts environ étaient favorables à la vaccination obligatoire. Or, 43 % des personnes interrogées ignoraient si elles étaient à jour de leurs vaccins. Ces résultats vous inquiètent-ils ?
M. Philippe Berta, député, rapporteur. - La relation des Français aux vaccins est très ambiguë. Malgré quelques soubresauts, nous avons rendu onze vaccins obligatoires pour les enfants. Dans le même temps, je suis effrayé par notre incapacité à vacciner les adolescents contre le papillomavirus. Chaque année, 4 000 femmes meurent d'un cancer de l'utérus. En Australie, le taux de vaccination dépasse 80 %, ce qui a permis d'éradiquer le virus. L'OMS a récemment relevé nos faiblesses dans la médecine préventive en oncologie. N'oublions pas que les progrès en matière de longévité sont liés à la vaccination et aux médicaments.
Mme Florence Lassarade, sénatrice, vice-présidente de l'Office, rapporteure. - Je vous renvoie à un rapport de l'OPECST sur l'hésitation vaccinale, établi avec Cédric Villani lorsqu'Agnès Buzyn a rendu certains vaccins obligatoires. J'ai constaté dans le cadre de mon activité de pédiatre que beaucoup de parents attendaient que le vaccin soit obligatoire pour le faire.
Lorsque nous avons commencé à vacciner tous les enfants de 6e contre l'hépatite B, un doute était apparu sur un lien entre ce vaccin et la sclérose en plaques. Ce rapport a depuis été infirmé. Le ministre de la santé de l'époque avait fait interrompre les vaccins en milieu scolaire. Ces hésitations, tout comme le sang contaminé, ont encore un retentissement aujourd'hui.
Mme Sonia de La Provôté, sénatrice, rapporteure. - Il y a cinq ou six ans, nous avons connu une recrudescence des cas de rougeole, parce qu'une génération d'enfants n'avait pas été vaccinée. La vaccination obligatoire permettra de traiter cette problématique. Les médecins généralistes constatent que les enfants sont mieux suivis. Les vérifications faites avant l'entrée en milieu scolaire apportent une sécurité supplémentaire.
Une difficulté demeure sur le HPV. Il convient de déminer le sujet. La problématique était différente pour la vaccination covid, car les hésitations étaient liées à l'introduction de vaccins à ARNm.
M. Philippe Berta, député, rapporteur. - Les hésitations autour du Gardasil sont incompréhensibles. Le vaccin a bientôt 30 ans. S'agissant du covid, beaucoup évoquaient l'absence d'essais cliniques autour de l'ANRm. Or, Pfizer a inclus 457 000 patients dans son essai. Cette ampleur est quasiment inédite.
M. Stéphane Piednoir, sénateur, président de l'Office. - Les parents d'une jeune fille ont entendu parler d'un risque d'infertilité avec le HPV. Sur cette base, ils refusent de la vacciner. Tous les autres messages sont éclipsés par cette seule voix.
Mme Florence Lassarade, sénatrice, vice-présidente de l'Office, rapporteure. - Malheureusement, la campagne HPV a été lancée en janvier 2020, juste avant le covid.
M. Stéphane Piednoir, sénateur, président de l'Office. - Le vaccin, comme tout médicament, peut avoir des effets secondaires exceptionnels.
M. Philippe Berta, député, rapporteur. - La vente de paracétamol pourrait bientôt être interdite aux moins de 18 ans, car il s'agit de la drogue la plus utilisée par les jeunes qui tentent de se suicider. Même le paracétamol, dont on peut penser qu'il présente une certaine innocuité, est mortel à forte dose.
Mme Sonia de La Provôté, sénatrice, rapporteure. - Une campagne de Santé publique France sur la vaccination disait en substance : « Si vous avez des crampes, c'est à cause du pédalo. » Ce message est très mauvais. Oui, la vaccination entraîne souvent un syndrome post-grippal dont la fièvre et les crampes musculaires sont des symptômes. Il aurait été préférable de l'assumer. La communication fait partie de la crise ; elle ne doit pas être à la main d'agences de communication ignorantes de la question scientifique.
L'Office adopte à l'unanimité le rapport sur « Les effets indésirables des vaccins et les dernières évolutions des connaissances scientifiques sur la covid-19 » et autorise sa publication.
M. Stéphane Piednoir, sénateur, président de l'Office. - Je vous invite à aller présenter ce rapport devant la commission des affaires sociales du Sénat, à l'origine de la saisine.
LISTE DES SIGLES
|
A |
|
|
ACE2 |
Enzyme de conversion de l'angiotensine 2 |
|
ADN |
Acide désoxyribonucléique |
|
ALD |
Affection longue durée |
|
ANR |
Agence nationale de la recherche |
|
ANRS-MIE |
Agence nationale de recherches sur le sida, les hépatites, et les maladies infectieuses émergentes |
|
ANSM |
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé |
|
Arcom |
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique |
|
ARNm |
Acide ribonucléique messager |
|
ARS |
Agence régionale de santé |
|
Athina |
Advanced Technology for Health Intelligence and Action |
|
AVC |
Accident vasculaire cérébral |
|
B |
|
|
BARDA |
Biomedical Advanced Research and Development Authority |
|
C |
|
|
CARE |
Comité analyse, recherche et expertise covid-19 |
|
CEPI |
Coalition for Epidemics Preparedness Initiative |
|
CepiDC |
Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès |
|
CNR |
Centre national de référence |
|
COG-UK |
COVID-19 Genomics United Kingdom |
|
Compare |
Communauté de patients pour la recherche |
|
Corruss |
Centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales |
|
Covars |
Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires |
|
CNGOF |
Collège national des gynécologues et obstétriciens |
|
CNRS |
Centre national de la recherche scientifique |
|
CPAM |
Caisse primaire d'assurance maladie |
|
CRPV |
Centre régional de pharmacovigilance |
|
D |
|
|
DGS |
Direction générale de la santé |
|
Durable |
Delivering a Unified Research Alliance of Biomedical and public health Laboratories against Epidemics |
|
E |
|
|
EBV |
Virus d'Epstein-Barr |
|
ECDC |
European Centre for Disease Prevention and Control |
|
Ehpad |
Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes |
|
EMA |
European Medicines Agency |
|
Emergen |
Consortium pour la surveillance et recherche sur les infections à pathogènes émergents via la génomique microbienne |
|
EPAR |
European Public Assessment Report |
|
G |
|
|
GISAID |
Global Initiative on Sharing All Influenza Data |
|
H |
|
|
HAS |
Haute Autorité de santé |
|
HERA |
Health Emergency Preparedness and Response Authority |
|
HPV |
Papillomavirus humain |
|
I |
|
|
Insee |
Institut national de la statistique et des études économiques |
|
M |
|
|
MERS-CoV |
Coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient |
|
O |
|
|
OCDE |
Organisation de coopération et de développement économiques |
|
OMS |
Organisation mondiale de la Santé |
|
Oniam |
Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales |
|
ONU |
Organisation des Nations unies |
|
ORL |
Otorhinolaryngologie |
|
ORS |
Observatoire régional de la santé |
|
Oscour |
Organisation de la surveillance coordonnée des urgences |
|
P |
|
|
PISA |
Programme international pour le suivi des acquis des élèves |
|
PRAC |
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee |
|
R |
|
|
RT-PCR |
Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction |
|
S |
|
|
SFPT |
Société française de pharmacologie et de thérapeutique |
|
SGB |
Syndrome de Guillain-Barré |
|
SI-DEP |
Système d'information national de suivi du dépistage |
|
SI-ESMS |
Système d'information des établissements sociaux et médico-sociaux |
|
SI-VAC |
Système d'information sur les vaccinations covid-19 |
|
SI-VIC |
Système d'information pour le suivi des victimes |
|
Slavaco |
Suivi longitudinal des attitudes à l'égard d'un vaccin contre la covid-19 |
|
SNDS |
Système national des données de santé |
|
SPC |
Syndrome post-covid |
|
SRAS |
Syndrome respiratoire aigu sévère |
|
SUM'Eau |
Surveillance microbiologique des eaux usées |
|
T |
|
|
TROD |
Test rapide d'orientation diagnostique |
|
U |
|
|
UNICEF |
United Nations International Children's Emergency Fund |
|
USLD |
Unité de soins de longue durée |
|
V |
|
|
VIH |
Virus de l'immunodéficience humaine |
|
VRS |
Virus respiratoire syncytial |
|
W |
|
|
WISH |
Wastewater Integrated Surveillance for Public Health |
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
· Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
Christelle Ratignier-Carbonneil, directrice générale
Mehdi Benkebil, directeur de la surveillance
Alban Dhanani, directeur adjoint de la direction médicale
Carole Le Saulnier, directrice de la réglementation et de la déontologie
Céline Mounier, directrice adjointe à la direction générale en charge des opérations
· Groupement d'intérêt scientifique EPI-PHARE
Mahmoud Zureik, directeur
· Fondation Descartes
Laurent Cordonier, directeur de la recherche
· Réseau français des centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV)
Annie-Pierre Jonville-Bera, présidente
Sophie Gautier, directrice du CRPV de Lille
Joëlle Micallef, directrice du CRPV Marseille-Provence-Corse
· Haute Autorité de santé
Anne-Claude Crémieux, présidente de la commission technique des vaccinations
· Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires
Xavier Lescure, infectiologue, professeur des universités-praticien hospitalier à l'Université Paris cité et l'hôpital Bichat - Claude-Bernard
Yvanie Caillé, fondatrice et vice-présidente de l'Association de patients Renaloo
· Santé publique France
Laetitia Huiart, directrice scientifique
Bruno Coignard, directeur des maladies infectieuses
Alima Marie-Malikité, directrice de cabinet à la direction générale
· Ateliers de Gien
Hervé Maisonneuve, consultant en rédaction et intégrité scientifique
Mathieu Molimard, professeur des universités-praticien hospitalier à l'Université et au CHU de Bordeaux
Joëlle Micaleff, directrice du CRPV Marseille-Provence-Corse
· Caisse nationale de l'assurance maladie
Dominique Martin, médecin-conseil national
Karine Lecamus-Allart, directrice de mission
· Vincent Maréchal, professeur de virologie, Sorbonne Université
· Action coordonnée « covid long » de l'ANRS-MIE
Marc Bardou, professeur des universités-praticien hospitalier à l'Université de Bourgogne et au CHU de Dijon
Olivier Robineau, maître de conférences des universités-praticien hospitalier à l'Université de Lille et au Centre hospitalier Tourcoing
· Jérémy Ward, sociologue, chargé de recherche Inserm au Centre de recherche Médecine, sciences, santé, santé mentale, société (Cermes3)
· Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé
Jean-François Delfraissy, président
· Académie des sciences
Alain Fischer, président
· Direction générale de la santé (DGS)
Grégory Emery, directeur général de la Santé
Clément Lazarus, sous-directeur adjoint Veille et sécurité sanitaires
· Cour des comptes
Véronique Hamayon, présidente de la sixième chambre
· Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire (HERA)
Laurent Muschel, directeur général
· Xavier Humbert, médecin généraliste et maître de conférences à l'Université de Caen Normandie
· Sophie Fedrizzi, directrice du CRPV de Caen
* 1 Rapport fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur « les effets indésirables des vaccins contre la covid-19 et le système de pharmacovigilance français » par M. Gérard Leseul, député, et Mmes Sonia de La Provôté et Florence Lassarade, sénatrices - Assemblée nationale n° 5263 (XVe législature), Sénat n° 659 (2021-2022) ( https://www.senat.fr/rap/r21-659/r21-659.html).
* 2 Rapport fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur « les effets indésirables des vaccins contre la covid-19 et le système de pharmacovigilance français » par M. Gérard Leseul, député, et Mmes Sonia de La Provôté et Florence Lassarade, sénatrices - Assemblée nationale n° 5263 (XVe législature), Sénat n° 659 (2021-2022) ( https://www.senat.fr/rap/r21-659/r21-659.html).
* 3 Il s'agit des trois auteurs du rapport d'étape de juin 2022 auxquels le député Philippe Berta a été adjoint.
* 4 OMS, WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard ( https://covid19.who.int/).
* 5 O. J. Watson et al., Lancet Infect. Dis. 2022, 22, 1293 ( https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00320-6).
* 6 ONU Info, COVID-19 : le chef de l'OMS déclare la fin de l'urgence sanitaire mondiale, 2022 ( https://news.un.org/fr/story/2023/05/1134842?_gl=1*1fgq3du*_ga*ODM0NTM3OTQuMTY5NzcyNDQ3Nw..*_ga_TK9BQL5X7Z*MTY5NzgxMzcyMi4yLjEuMTY5NzgxMzc0OS4wLjAuMA).
* 7 The WHO European Respiratory Surveillance Network, medRxiv 2024 ( https://doi.org/10.1101/2024.01.12.24301206).
* 8 I. Ganser et al., Epidemics 2024, 46, 100744 ( https://doi.org/10.1016/j.epidem.2024.100744).
* 9 Santé publique France, Infections respiratoires aiguës (grippe, bronchiolite, COVID-19). Bulletin du 27 décembre 2023, 2023 ( https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/grippe/documents/bulletin-national/infections-respiratoires-aigues-grippe-bronchiolite-covid-19-.-bulletin-du-27-decembre-2023 ).
* 10 EMA, COVID-19 vaccines: strains, use and age ranges ( https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/covid-19-medicines).
* 11 HAS, Stratégie de vaccination contre la covid-19 : Place du vaccin VLA2001, 2022 ( https://www.has-sante.fr/jcms/p_3394248/fr/strategie-de-vaccination-contre-la-covid-19-place-du-vaccin-vla2001).
* 12 HAS, Stratégie de vaccination contre la covid-19 : Place du vaccin Bimervax (PHH-1V), 2023 ( https://www.has-sante.fr/jcms/p_3444521/fr/strategie-de-vaccination-contre-la-covid-19-place-du-vaccin-bimervax-phh-1v).
* 13 Direction générale de la Santé, Covid-19 : mise à disposition du vaccin adapté Nuvaxovid® XBB.1.5 du laboratoire Novavax, DGS-URGENT N°2023-24, 2023 ( https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_2023_24_covid-19_novavax.pdf). Les vaccins Jcovden et Vaxzevria avaient été préalablement écartés de la stratégie vaccinale. Voir : HAS, Stratégie vaccinale de rappel contre la covid-19, 2022 ( https://www.has-sante.fr/jcms/p_3367885/fr/strategie-vaccinale-de-rappel-contre-la-covid-19).
* 14 Bien que nécessaires, ces évolutions ont souffert d'un manque d'explications, complexifiant la lisibilité de la stratégie mise en place et menaçant sa légitimité aux yeux d'une part de la population.
* 15 Si l'objectif actuel est de conserver cette stratégie à moyen terme, une réévaluation pourrait s'avérer nécessaire en fonction de l'évolution du virus (notamment si un nouveau variant plus virulent ou présentant un fort échappement immunitaire venait à émerger) et de l'apparition d'éventuels nouveaux vaccins (notamment si un vaccin avec une forte protection contre l'infection était mis au point).
*
16 Pour les personnes les plus vulnérables
(personnes âgées de 80 ans et plus, résidents
d'Ehpad/USLD et personnes immunodéprimées), une vaccination
supplémentaire peut avoir lieu au printemps.
Ce nouveau rappel est
recommandé même en cas d'infection covid intercurrente, en
respectant un délai de 6 mois depuis la dernière infection
ou injection (à l'exception des personnes immunodéprimées
pour lesquelles ce délai est réduit à
3 mois).
* 17 Saisie par la DGS, la HAS a estimé pertinent de recommander l'administration concomitante des vaccins contre la covid-19 et contre la grippe saisonnière. Voir : Haute Autorité de santé, Stratégie de vaccination contre la covid-19. Actualisation des recommandations relatives à l'administration concomitante des vaccins contre la covid-19 et contre la grippe saisonnière, 2023 ( https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-07/strategie_de_vaccination_contre_la_covid-19_actualisation_des_recommandations_relatives_a_ladministration_concomitante_des_v.pdf).
* 18 Depuis le 15 avril et jusqu'au 16 juin, une campagne de renouvellement vaccinal est ouverte pour les personnes les plus vulnérables (personnes âgées de 80 ans et plus, résidents d'Ehpad/USLD et personnes immunodéprimées).
* 19 Ministère de la santé et de la prévention, La campagne de vaccination contre le covid-19, avancée de 15 jours, commencera le 2 octobre pour protéger les personnes les plus fragiles, 2023 ( https://sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/la-campagne-de-vaccination-contre-le-covid-19-avancee-de-15-jours-commencera-le).
* 20 Santé publique France, Comment évolue l'adhésion des Français aux mesures de prévention contre les virus de l'hiver ?, Résultats de la vague 37 de l'enquête CoviPrev (11-18 septembre 2023), 2023 ( https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/enquetes-etudes/comment-evolue-l-adhesion-des-francais-aux-mesures-de-prevention-contre-les-virus-de-l-hiver-resultats-de-la-vague-37-de-l-enquete-coviprev).
*
21 Santé publique France, Bulletin
vaccination. Édition nationale. Avril 2024, 2024 (
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/documents/bulletin-national/vaccination-en-france.-bilan-de-la-couverture-vaccinale-en-2023).
Cette
couverture est similaire à celle qui avait été
observée pour la deuxième dose de rappel qui était de
33,6 % chez les personnes de 60 ans et plus au 2 novembre 2022.
Voir : Cour des comptes, La vaccination contre la covid-19. Des
résultats globaux favorables, des disparités persistantes,
2022 (
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2023-10/20221214-politique-vaccinale-covid-19.pdf).
* 22 UK Health Security Agency, National Influenza and COVID-19 surveillance report. Week 7 report (up to week 6 2024 data), 2023 ( https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65d5e0952ab2b3001a759619/Weekly_flu_and_COVID-19_report_week_7.pdf).
* 23 ANSM, Effets indésirables des vaccins contre le covid-19 ( https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/covid-19-suivi-hebdomadaire-des-cas-deffets-indesirables-des-vaccins).
* 24 ANSM, Suivi des cas d'effets indésirables des vaccins COVID-19. Actualisation au 8/6/2023, 2023 ( https://ansm.sante.fr/uploads/2023/08/28/2023-06-08-fiche-de-synthese-61-vaccins-covid.pdf).
* 25 a) Audition de M. Sébastien Leloup, candidat aux fonctions de directeur général de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, par la Commission des affaires sociales du Sénat, le 10 octobre 2023 ( https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20231009/soc.html) ; b) Audition de M. Sébastien Leloup, dont la reconduction aux fonctions de directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est envisagée, par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale le 11 octobre 2023 ( https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/cion-soc/l16cion-soc2324006_compte-rendu#).
* 26 a) APMnews, USA : « signal préliminaire » de pharmacovigilance sur le vaccin anti-covid-19 bivalent de Pfizer et BioNTech, 2023 ( https://www.apmnews.com/depeche/165604/391753/usa-signal-preliminaire-de-pharmacovigilance-sur-le-vaccin-anti-covid-19-bivalent-de-pfizer-et-biontech) ; b) T. T. Shimabukuro et al., COVID-19 mRNA bivalent booster vaccine safety. Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee meeting, 2023 ( https://www.fda.gov/media/164811/download).
* 27 M. P. Gorenflo et al., medRXiv 2023 ( https://doi.org/10.1101/2023.02.11.23285801).
* 28 M.-J. Jabagi et al., N. Engl. J. Med. 2023, 388, 1431 ( https://doi.org/10.1056/NEJMc2302134).
* 29 M. Yechezkel et al., Lancet Respir. Med. 2023, 11, 139 ( https://doi.org/10.1016/S2213-2600(22)00407-6).
* 30 N. W. Andersson et al., BMJ 2023, 382, e075015 ( https://doi.org/10.1136/bmj-2023-075015).
* 31 A. M. Hause et al., Morb. Mortal. Wkly Rep. 2023, 72, 39 ( http://doi.org/10.15585/mmwr.mm7202a5).
* 32 N. W. Andersson et al., JAMA 2024, sous presse ( https://doi.org/10.1001/jama.2024.1036).
* 33 APMnews, Covid-19 : le vaccin Sanofi/GSK fait flop (infographies), 2023( https://www.apmnews.com/depeche/165604/392461/covid-19-le-vaccin-sanofi-gsk-fait-flop-%28infographies%29).
* 34 Contrairement aux vaccins autorisés auparavant pour lesquels le nombre considérable de doses injectées a permis d'identifier des effets indésirables extrêmement rares.
* 35 EMA, Nuvaxovid: EPAR - Procedural steps taken and scientific information after the authorisation, 2022 ( https://www.ema.europa.eu/en/documents/procedural-steps-after/nuvaxovid-epar-procedural-steps-taken-and-scientific-information-after-authorisation_en.pdf).
* 36 FDA, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee Meeting, 2022 ( https://www.fda.gov/media/158912/download).
* 37 CRPV de Grenoble et Lyon, Enquête de pharmacovigilance du vaccin Nuvaxovid - Rapport n°1 - Période du 01 mars au 14 juillet 2022, 2022 ( https://ansm.sante.fr/uploads/2022/08/08/20220728-rapport-1-pv-vaccins-nuvaxovid-2.pdf).
* 38 CRPV de Grenoble et Lyon, Enquête nationale de pharmacovigilance - Vaccins contre le covid-19 - Nuvaxovid - Rapport semestriel n° 2 - Période du 15/07/2022 au 12/01/2023, 2023 ( https://ansm.sante.fr/uploads/2023/04/24/20230413-rapport-2-enquete-pv-vaccin-nuvaxovid-vfa.pdf).
* 39 Des troubles menstruels ont également pu être observés à la suite de l'infection par SARS-CoV-2 et peuvent être spontanés, complexifiant l'établissement d'un lien de causalité avec la vaccination. Voir : J. A. Maybin et al., Clin. Sci. 2024, 138, 153 ( https://doi.org/10.1042/CS20220280).
*
40 Pour une description détaillée de
la temporalité des événements, voir : M.-B.
Valnet-Rabier et al., Therapies 2023, sous presse (
https://doi.org/10.1016/j.therap.2023.03.005).
Les
différences de sensibilité et de culture du risque qui peuvent
exister entre les différents États membres peuvent avoir des
conséquences sur l'appréciation des signaux potentiels au niveau
européen. Pour certains pays, la faible gravité des troubles
menstruels n'en faisait pas une préoccupation, alors que cela
l'était en France en raison des conséquences que cela pouvait
avoir vis-à-vis de l'adhésion à la vaccination.
* 41 ANSM, Troubles menstruels et vaccination covid-19. Tutoriel d'aide à la déclaration « pas-à-pas » pour les patientes, 2022 ( https://ansm.sante.fr/uploads/2022/08/01/20220801-covid-19-troubles-menstruels-tutoriel-patiente-26-07-2022.pdf).
* 42 ANSM, Troubles menstruels et vaccination covid-19. Tutoriel d'aide à la déclaration « pas-à-pas » pour les professionnels de santé, 2022 ( https://ansm.sante.fr/uploads/2022/08/01/20220801-covid-19-troubles-menstruels-tutoriel-pds-26-07-2022.pdf).
* 43 ANSM, Troubles menstruels et vaccination covid-19. Guide d'aide à la déclaration de pharmacovigilance, 2022 ( https://ansm.sante.fr/uploads/2022/08/01/20220801-covid-19-guide-troubles-menstruels-patientes-et-ps-26-07-2022.pdf).
* 44 APMnews, Vaccins covid et troubles menstruels : les CRPV débordés, l'ANSM précise les troubles à déclarer, 2022 ( https://www.apmnews.com/depeche/165604/385219/vaccins-covid-et-troubles-menstruels-les-crpv-debordes%2C-l-ansm-precise-les-troubles-a-declarer).
* 45 EMA, COVID-19 vaccines safety update, 2022 ( https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccines-safety-update-10-november-2022_en.pdf).
* 46 Cette clôture résulte du plus faible nombre de cas reportés avec ce vaccin. Cependant, pour le réseau français des CRPV, il est possible que cette plus faible déclaration soit uniquement liée à la moindre utilisation de ce vaccin car, jusqu'à maintenant, les effets indésirables observés avec les deux vaccins à ARNm sont similaires.
* 47 CRPV de Bordeaux, Marseille, Toulouse et Strasbourg, Enquête de pharmacovigilance du vaccin Pfizer - BioNTech Comirnaty, Rapport n° 21 : période du 26/08/2022 au 23/02/2023, 2023 ( https://ansm.sante.fr/uploads/2023/08/28/2023-05-rapport-21-enquete-pv-comirnaty.pdf).
* 48 CRPV de Besançon et Lille, Enquête nationale de pharmacovigilance relative aux vaccins contre la covid-19. Rapport semestriel n° 18, 2023 ( https://ansm.sante.fr/uploads/2023/08/28/2023-05-rapport-enquete-pv-vaccin-spikevax.pdf).
* 49 En plus du signal pour aménorrhées pour le vaccin Comirnaty évoqué précédemment.
* 50 Pour une revue des études publiées sur ce sujet jusqu'à mai 2022, voir : M. Nazir et al., Vacunas 2022, 23, S77 ( https://doi.org/10.1016/j.vacun.2022.07.001).
* 51 K. M. N. Lee et al., Sci. Adv. 2023, 8, eabm7201 ( https://doi.org/10.1126/sciadv.abm7201).
* 52 J. W Duijster et al., Br. J. Clin. Pharmacol. 2023, 89, 3126 ( https://doi.org/10.1111/bcp.15799).
* 53 A. Alvergne et al., iScience 2023, 26, 106401 ( https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.106401).
* 54 R. Ljung et al., BMJ 2023, 381, e074778 ( https://doi.org/10.1136/bmj-2023-074778).
* 55 K. Blix et al., Sci. Adv. 2023, 9, eadg1391 (https://doi.org /10.1126/sciadv.adg1391).
* 56 J. Botton et al., Risque de saignements menstruels abondants ayant nécessité une prise en charge à l'hôpital au décours de la vaccination contre le COVID-19 : étude cas-témoins à partir du système national des données de santé (SNDS), 2024 ( https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/vaccins-covid%E2%80%9119-saignements-menstruels/).
* 57 A. Edelman et al., BMJ Med. 2022, 1, e000297 ( https://doi.org/10.1136/bmjmed-2022-000297).
* 58 D. Zaçe et al., Vaccine 2022, 40, 6023 ( https://doi.org/10.1016%2Fj.vaccine.2022.09.019).
* 59 Pour une revue de la surveillance de ce signal, voir : P.-P. Piché-Renaud et al., Br. J. Clin. Pharmacol. 2023, 89, 967 ( https://doi.org/10.1111/bcp.15625).
* 60 V. Nafilyan et al., Nat. Commun. 2023, 14, 1541 ( https://doi.org/10.1038/s41467-023-36494-0).
* 61 EMA, COVID-19 vaccines safety update, 2022 ( https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccines-safety-update-14-july-2022_en.pdf). L'ajout a été confirmé en janvier 2023. Voir : EMA, Nuvaxovid: EPAR - Procedural steps taken and scientific information after the authorisation, 2022 ( https://www.ema.europa.eu/en/documents/procedural-steps-after/nuvaxovid-epar-procedural-steps-taken-and-scientific-information-after-authorisation_en.pdf ).
* 62 Therapeutic Goods Administration, COVID-19 vaccine safety report - 29-06-2023, 2023( https://www.tga.gov.au/news/covid-19-vaccine-safety-reports/covid-19-vaccine-safety-report-29-06-2023#nuvaxovid-novavax-vaccine).
* 63 D. Macías Saint-Gerons et al., Drugs Real World Outcomes 2023, 10, 263 ( https://doi.org/10.1007/s40801-023-00355-5).
* 64 EMA, COVID-19 Vaccine Janssen: EPAR - Procedural steps taken and scientific information after authorisation, 2023 ( https://www.ema.europa.eu/en/documents/procedural-steps-after/covid-19-vaccine-janssen-epar-procedural-steps-taken-and-scientific-information-after-authorisation_en.pdf).
* 65 J. Botton et al., Ann. Intern. Med. 2022, 175, 1250 ( https://doi.org/10.7326/M22-0988).
* 66 M.-J. Jabagi et al., JAMA 2022, 327, 80 ( https://doi.org/10.1001/jama.2021.21699).
* 67 D'après EPI-PHARE, le risque de myocardite après la troisième dose de vaccin (ou première dose de rappel) est plus faible qu'après la deuxième dose et diminue avec l'allongement du délai entre les doses successives : l'excès de cas de myocardites associé à la troisième dose est estimé globalement à 0,25 cas pour 100 000 doses du vaccin Comirnaty et 0,29 cas pour 100 000 doses du vaccin Spikevax. Voir : S. Le Vu et al., Vaccins covid-19 à ARN messager et risque de myocardite : effets de la troisième dose et du délai entre les doses, 2022 ( https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/myocardite-rappel-vaccin-covid19/).
* 68 Y. Chang et al., Expert Rev. Vaccines 2023, 22, 25 ( https://doi.org/10.1080/14760584.2023.2150169).
* 69 X. Li et al., BMJ 2022, 379, e071594 ( https://doi.org/10.1136/bmj-2022-071594).
* 70 L. Schönborn et al., J. Thromb. Haemost. 2023, 21, 2519 ( https://doi.org/10.1016/j.jtha.2023.06.027).
* 71 EMA, Vaxzevria (previously COVID-19 Vaccine AstraZeneca): EPAR - Procedural steps taken and scientific information after autorisation, 2023 ( https://www.ema.europa.eu/en/documents/procedural-steps-after/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-procedural-steps-taken-and-scientific-information-after-authorisation_en.pdf ).
*
72 a) R. Hosseini et al., Eur.
J. Med. Res. 2023, 28, 102 (
https://doi.org/10.1186/s40001-023-00992-0) ;
b) Z. Mohseni Afshar et al., Acta Neurol. Belg. 2023,
123, 9 (
https://doi.org/10.1007/s13760-022-02137-2) ;
c) M. Salcone et al., Vaccines 2023, 11, 1621 (
https://doi.org/10.3390/vaccines11101621).
Des
cas de surdité ont également été
déclarés à la suite de l'administration des vaccins
Comirnaty et Spikevax et constituent actuellement un signal potentiel.
Voir : H. Thai-Van et al., JMIR Public Health Surveill.
2023, 9, e45263 (
https://doi.org/10.2196/45263).
* 73 EMA, COVID-19 Vaccine Janssen: EPAR - Procedural steps taken and scientific information after authorisation, 2023 ( https://www.ema.europa.eu/en/documents/procedural-steps-after/covid-19-vaccine-janssen-epar-procedural-steps-taken-and-scientific-information-after-authorisation_en.pdf).
* 74 EMA, Vaxzevria (previously COVID-19 Vaccine AstraZeneca): EPAR - Procedural steps taken and scientific information after authorisation, 2023 ( https://www.ema.europa.eu/en/documents/procedural-steps-after/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-procedural-steps-taken-and-scientific-information-after-authorisation_en.pdf ).
* 75 S. Nguyen et al., Ann. Neurol. 2022, 92, 1080 ( https://doi.org/10.1002/ana.26494).
* 76 K. Faksova et al., Vaccine 2024, sous presse ( https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2024.01.100).
* 77 A. Tamborska et al., BMJ Neurology Open 2022, 4, e000309. ( https://doi.org/10.1136/bmjno-2022-000309).
* 78 M. Patone et al., Nat. Med. 2021, 27, 1 ( https://doi.org/10.1038/s41591-021-01556-7).
* 79 E. J. Woo et al., JAMA 2021, 326, 1606 ( https://doi.org/10.1001/jama.2021.16496).
* 80 a) EMA, COVID-19 vaccine safety update, 2021 ( https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-8-september-2021_en.pdf) ; b) EMA, COVID-19 vaccine safety update, 2021 ( https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccine-safety-update-covid-19-vaccine-janssen-9-december-2021_en.pdf).
* 81 W. E. Abara et al., JAMA Netw. Open 2023, 6, e2253845 ( https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.53845).
* 82 M. Atzenhoffer et al., Clin. Drug Investig. 2022, 42, 581 ( https://doi.org/10.1007/s40261-022-01164-4).
* 83 S. Le Vu et al., Neurology 2023, sous presse ( https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000207847).
* 84 K. Faksova et al., Vaccine 2024, sous presse ( https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2024.01.100).
* 85 H. Bishara et al., Neurology 2023, sous presse ( https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000207900).
* 86 T. Soeiro et al., Therapies 2021, 76, 365 ( https://doi.org/10.1016/j.therap.2021.03.005).
* 87 B. Bertin et al., Therapies 2023, 78, 279 ( https://doi.org/10.1016/j.therap.2022.07.009).
* 88 A. Rafati et al., JAMA Otolaryngol. Head Neck Surg. 2023, 149, 493 ( https://doi.org/10.1001/jamaoto.2023.0160).
* 89 EMA, COVID-19 vaccines safety update, 2022 ( https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccines-safety-update-6-october-2022_en.pdf).
* 90 J. Couzin-Frankel et al., Science 2022, 375, 364 ( https://doi.org/10.1126/science.ada0536).
* 91 F. Scholkmann et al., Pathol. Res. Pract. 2023, 246, 154497 ( https://doi.org/10.1016/j.prp.2023.154497).
* 92 a) Paul-Ehrlich-Institut, Statement from the Paul-Ehrlich-Institut on « Post-Vac Syndrome » after COVID-19 Vaccination, 2023 ( https://www.pei.de/EN/newsroom/positions/covid-19-vaccines/statement-postvac.htm) ; b) Netherlands Pharmacovigilance Centre Lareb, Long COVID-like symptoms following immunization with COVID-19 vaccines, 2024 ( https://www.lareb.nl/media/g54d3xrc/signals_2024_long-covid-like-symptoms-after-covid-19-vaccination_website.pdf).
* 93 N. Blanpain, 53 800 décès de plus qu'attendus en 2022 : une surmortalité plus élevée qu'en 2020 et 2021, Insee Première n° 1951, 2023 ( https://www.insee.fr/fr/statistiques/7628176).
* 94 Ibid.
* 95 S. Xu et al., Morb. Mortal Wkly Rep. 2021, 70, 1520 ( https://doi.org/10.15585/mmwr.mm7043e2).
* 96 M. Ponnaiah et al., Indian J. Med. Res. 2023, 158, 351 ( https://doi.org/10.4103/ijmr.ijmr_2105_23).
* 97 EMA, COVID-19 vaccines safety update, 2022 ( https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccines-safety-update-14-july-2022_en.pdf).
* 98 EMA, Spikevax (previously COVID-19 Vaccine Moderna): EPAR - Procedural steps taken and scientific information after autorisation, 2024 ( https://www.ema.europa.eu/en/documents/procedural-steps-after/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-procedural-steps-taken-scientific-information-after-authorisation_en.pdf).
* 99 Committee for Medicinal Products for Human Use, Spikevax (previously COVID-19 Vaccine Moderna)-H/C/PSUSA/00010897/202212: EPAR - Scientific conclusions and grounds for the variation to the terms of the marketing autorisation, 2024 ( https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-conclusion/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-h-c-psusa-00010897-202212-epar-scientific-conclusions-and-grounds-variation-terms-marketing-authorisation_en.pdf).
* 100 EMA, COVID-19 vaccines safety update, 2022 ( https://www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccines-safety-update-14-july-2022_en.pdf).
* 101 M. Rahmati et al., Rev. Med. Virol. 2023, 33, e2434 ( https://doi.org/10.1002/rmv.2434).
* 102 A. Kachikis et al., JAMA Netw Open 2022, 5, e2230495 ( https://10.1001/jamanetworkopen.2022.30495).
* 103 E. O. Kharbanda et al., JAMA Netw Open 2023, 6, e2314350 ( https://10.1001/jamanetworkopen.2023.14350).
* 104 P. J Woestenberg et al., Birth Defects Res. 2023, 1 ( https://doi.org/10.1002/bdr2.2251).
* 105 G. Favre et al., Clin. Microbiol. Infect. 2023, 29, 1306 ( https://doi.org/10.1016/j.cmi.2023.06.015).
* 106 CRPV de Lyon et Toulouse, Enquête de pharmacovigilance sur les effets indésirables des vaccins COVID-19 chez les femmes enceintes et allaitantes, 2023 ( https://ansm.sante.fr/uploads/2023/08/28/2023-06-rapport-12-enquete-rga.pdf).
* 107 L'infection par SARS-CoV-2 conduit quant à elle à 113 cas pour un million d'enfants de 12 à 17 ans infectés. Voir : N. Ouldali et al., Lancet Reg. Health Eur. 2022, 17, 100393 ( https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2022.100393).
* 108 M. Hu et al., JAMA Pediatr. 2023, 177, 710 ( https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2023.1440).
* 109 S. A. Buchan et al., JAMA Pediatr. 2023, 177, 410 ( https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2022.6166).
* 110 F. Ahmadizar et al., Drug Saf. 2023, 46, 575 ( https://doi.org/10.1007/s40264-023-01304-5).
* 111 a) A. Watanabe et al., JAMA Pediatr. 2023, 177, 384 ( https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2022.6243) ; b) V. Piechotta et al., Lancet Child Adolesc. Health 2023, 7, 379 ( https://doi.org/10.1016/S2352-4642(23)00078-0).
* 112 a) A. M. Hause et al., Morb. Mortal Wkly Rep. 2022, 71, 1115 ( https://doi.org/10.15585/mmwr.mm7135a3) ; b) A. M. Hause et al., Morb. Mortal Wkly Rep. 2023, 72, 621 ( https://doi.org/10.15585/mmwr.mm7223a2) ; c) K. Goddard et al., Pediatrics 2023, 152, e2023061894 ( https://doi.org/10.1542/peds.2023-061894) ; d) V. Nikitina et al., Acta Paediatrica 2023, 112, 2426 ( https://doi.org/10.1111/apa.16954).
* 113 P. Sen et al., Rheumatology 2023, 62, 65 ( https://doi.org/10.1093/rheumatology/keac305).
* 114 K. Xu et al., Front. Immunol. 2023, 14, 1113156 ( https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1113156).
* 115 J. Ofer et al., JAMA Oncol. 2023, sous presse ( https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2023.5042).
* 116 H. Sun et al., Front. Public Health 2022, 10, 1072137 ( https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1072137). Voir également : N. Ivanov et al., World J. Clin. Oncol. 2023, 14, 343 ( https://doi.org/10.5306%2Fwjco.v14.i9.343).
* 117 a) S. B. Black et al., Vaccine 2023, 41, 3790 ( https://doi.org/10.1016%2Fj.vaccine.2023.04.055) ; b) J. Durand et al., Clin. Pharmacol. Ther. 2023, 113, 1223 ( https://doi.org/10.1002/cpt.2828).
* 118 a) M. Raethke et al., Drug Saf. 2023, 46, 391 ( https://doi.org/10.1007%2Fs40264-023-01281-9) ; b) M. Sturkenboom et al., medRXiv 2022 ( https://doi.org/10.1101/2022.08.17.22278894) ; c) K. Faksova et al., Vaccine 2024, sous presse ( https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2024.01.100).
* 119 A.-P. Jonville-Béra et al., Therapies 2023, 78, 477 ( https://doi.org/10.1016/j.therap.2023.02.009).
* 120 D'autres initiatives ont également été menées récemment par l'ANSM : une vidéo d'aide à la déclaration a été réalisée pour les déclarations concernant le finastéride et un formulaire complémentaire a été ajouté pour les déclarations relatives à l'utilisation d'antiépileptiques pendant la grossesse.
* 121 A. Grandvuillemin et al., Therapies 2023, sous presse ( https://doi.org/10.1016/j.therap.2023.10.006).
* 122 Cet outil, développé avec le Département de médecine générale de l'Université de Caen Normandie, a permis d'augmenter le nombre de déclarations faites par les médecins généralistes sans en diminuer la qualité. Voir : A. Trenque et al., Sci. Rep. 2024, 14, 1766 ( https://doi.org/10.1038/s41598-024-51753-w).
* 123 Cette formation a permis aux délégués de la CPAM de rappeler aux médecins généralistes le mode de fonctionnement et l'intérêt de la pharmacovigilance, avec un effet positif sur le nombre de déclarations. Voir : Fedrizzi et al., Santé publique 2022, 34, 795 ( https://doi.org/10.3917/spub.226.0795 ).
* 124 A.-P. Jonville-Béra et al., Therapies 2023, 78, 477 ( https://doi.org/10.1016/j.therap.2023.02.009).
* 125 Le nombre de déclarations de pharmacovigilance a augmenté de plus de 20 % entre 2015 et 2023. Cette hausse serait notamment due à la stimulation des déclarations par les autorités, au désengagement des industriels vis-à-vis de la pharmacovigilance et aux dispositifs d'accès précoce et compassionnel qui nécessitent un suivi de pharmacovigilance accru. Les demandes d'avis de professionnels ont également augmenté sur cette période, en raison de l'apparition de nombreux traitements innovants.
* 126 En raison de moyens financiers constants ne permettant pas de couvrir l'augmentation des coûts de personnel, le réseau des CRPV estime avoir perdu 12 équivalents temps plein entre 2015 et 2023.
* 127 Élaboré avec son conseil scientifique et ses tutelles, ce plan estimait que, pour accomplir pleinement ses missions, EPI-PHARE devait disposer d'un effectif de 80 personnes et d'un budget global de 15 millions d'euros.
*
128 Cette compréhension ne signifie pas
pour autant que celle-ci est bien appréciée et n'exclut pas les
doutes qui peuvent exister quant aux informations fournies par les
autorités de santé.
Cette tendance s'observe également
au travers de l'attitude plus favorable des personnes âgées et
immunodéprimées envers la vaccination et de la faible couverture
vaccinale des enfants âgés de 5 à 11 ans
(inférieure à 5 %). Cette dernière a en outre
été ouverte simultanément à la levée des
mesures restrictives, diminuant la perception de sa pertinence.
* 129 La baisse de la confiance dans le gouvernement observée à cette période a potentiellement également contribué à cette tendance. Voir : J. K. Ward et al., La recherche sur les aspects humains et sociaux de la vaccination en France depuis le covid-19 - 1ère édition, 2024 ( https://shs-vaccination-france.com/la-recherche-sur-les-aspects-humains-et-sociaux-de-la-vaccination-en-france-depuis-le-covid-19-1ere-edition/).
*
130 Il est également nécessaire de
souligner le rôle joué par la mise en place du passe sanitaire,
puis vaccinal, qui ont contribué à l'atteinte de cette bonne
couverture. Voir : M. Oliu-Barton et al., Nat. Commun.
2022, 13, 3942 (
https://doi.org/10.1038/s41467-022-31394-1).
Pour
une description détaillée des attitudes et comportements de
vaccination et des moteurs sous-jacents, voir : J. K. Ward et
al., La recherche sur les aspects humains et sociaux de la vaccination
en France depuis le covid-19 - 1ère édition,
2024 (
https://shs-vaccination-france.com/la-recherche-sur-les-aspects-humains-et-sociaux-de-la-vaccination-en-france-depuis-le-covid-19-1ere-edition/).
* 131 En septembre 2022, le premier rappel avait également été effectué par plus de 90 % de la population éligible. Cependant, malgré diverses initiatives « d'aller-vers », des inégalités de couverture vaccinale, en fonction des territoires et des conditions sociales, restent à déplorer. Voir : Cour des comptes, La vaccination contre la covid-19. Des résultats globaux favorables, des disparités persistantes, 2022 ( https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2023-10/20221214-politique-vaccinale-covid-19.pdf).
* 132 La baisse de l'efficacité vaccinale contre l'infection et la faible efficacité contre la transmission sont toutefois susceptibles de jouer également un rôle dans cette érosion.
* 133 Comme indiqué précédemment, alors que 74 % des personnes éligibles déclaraient avoir l'intention de recevoir la dose de rappel en septembre, seuls 30,1 % des personnes âgées de 65 ans et plus s'étaient vues administrer cette nouvelle dose en février 2024.
* 134 P. Peretti-Watel et al., Enquête ICOVAC Vague 1 : retour sur la crise sanitaire et la vaccination contre la covid-19, 2023 ( http://www.orspaca.org/notes-strategiques/enqu%C3%AAte-icovac-vague-1-retour-sur-la-crise-sanitaire-et-la-vaccination-contre-la).
* 135 a) ORS PACA, Enquête COVIREIVAC Vague 2 - SLAVACO Vague 4 : Rappels et vaccination des enfants en période de décrue de l'épidémie, 2022 ( http://www.orspaca.org/sites/default/files/note-covireivac-v2-slavaco-v4.pdf) ; b) ORS PACA, Enquête SLAVACO Vague 5 : Qui a (encore) peur de la covid-19 et jugements sur l'action des pouvoirs publics durant l'épidémie, 2022 ( http://www.orspaca.org/sites/default/files/note-slavaco-n5.pdf).
* 136 B. Kotseva et al., PLoS ONE 2023, 18, e0291423 ( https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291423).
* 137 A. Siani et al., Vaccine 2022, 40, 726 ( https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.10.061).
* 138 Une étude française conduite entre avril et mai 2022 avait toutefois constaté une perte de confiance dans la vaccination pour environ 30 % des enquêtés, tandis qu'un gain de confiance était rapporté par environ 13 % des personnes interrogées. Voir : A. Gagneux-Brunon et al., Health Policy Technol. 2023, sous presse ( https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2023.100812).
* 139 Santé publique France, Bulletin vaccination. Édition nationale. Avril 2024 ( https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/documents/bulletin-national/vaccination-en-france.-bilan-de-la-couverture-vaccinale-en-2023).
* 140 L. Cordonier, Information et santé. Analyse des croyances et comportements d'information des Français liés à leur niveau de connaissances en santé, au refus vaccinal et au renoncement médical, Étude de la Fondation Descartes 2023 ( https://www.fondationdescartes.org/2023/10/information-et-sante/).
* 141 S. Vaux et al., Vaccine 2023, 41, 6281 ( https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2023.08.062).
* 142 Santé publique France, Bulletin vaccination. Édition nationale. Avril 2024 ( https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/vaccination/documents/bulletin-national/vaccination-en-france.-bilan-de-la-couverture-vaccinale-en-2023).
* 143 a) OMS, Global partners announce a new effort - « The Big Catch-up » - to vaccinate millions of children and restore immunization progress lost during the pandemic, 2023 ( https://www.who.int/news/item/24-04-2023-global-partners-announce-a-new-effort-the-big-catch-up-to-vaccinate-millions-of-children-and-restore-immunization-progress-lost-during-the-pandemic) ; b) OMS, COVID-19 pandemic fuels largest continued backslide in vaccinations in three decades, 2023 ( https://www.who.int/news/item/15-07-2022-covid-19-pandemic-fuels-largest-continued-backslide-in-vaccinations-in-three-decades).
* 144 United Nations Children's Fund, The State of the World's Children 2023: For every child, vaccination, UNICEF Innocenti - Global Office of Research and Foresight, 2023 ( https://www.unicef.org/media/108161/file/SOWC-2023-full-report-English.pdf).
* 145 OMS, Meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, March 2023: conclusions and recommendations, 2023 ( https://www.who.int/publications/i/item/who-wer9822-239-256).
* 146 Lors de la première vague de l'enquête COVIREIVAC (mai 2021), les vaccins à ARNm étaient moins l'objet de craintes que le vaccin Vaxzevria d'AstraZeneca pour lequel une alerte de pharmacovigilance avait émergé. Voir : ORS PACA, Enquête COVIREIVAC : les français et la vaccination, 2021 ( http://www.orspaca.org/sites/default/files/enquete-COVIREIVAC-rapport.pdf). Cette confiance a toutefois diminué au cours de la campagne vaccinale. Voir : ORS PACA, Enquête COVIREIVAC Vague 2 - SLAVACO Vague 4 : Rappels et vaccination des enfants en période de décrue de l'épidémie, 2022 ( http://www.orspaca.org/sites/default/files/note-covireivac-v2-slavaco-v4.pdf).
* 147 Ce traitement n'est pas un vaccin mais un anticorps monoclonal administré par voie intramusculaire à l'aide d'une seringue préremplie.
* 148 APMnews, Bronchiolite : face au « succès » de Beyfortus, le ministère priorise les nouveau-nés », 2023 ( https://www.apmnews.com/depeche/165604/400933/bronchiolite-face-au-succes-de-beyfortus%2C-le-ministere-priorise-les-nouveau-nes).
* 149 Le Monde avec AFP, Papillomavirus : seuls 10 % des collégiens de 5? ont été vaccinés pour le moment, 2024 ( https://www.lemonde.fr/sante/article/2024/02/08/papillomavirus-seuls-10-des-collegiens-de-5-ont-ete-vaccines-pour-le-moment_6215427_1651302.html).
* 150 F. Callard et al., Soc. Sci. Med. 2021, 268, 113426 ( https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113426).
* 151 Les termes « formes prolongées de la covid-19 », « séquelles tardives [ou post-aiguës] de la covid-19 » ou « symptômes prolongés de la covid-19 » sont également utilisés.
* 152 De telles complications ont été observées avec les virus Ebola, d'Epstein-Barr, du chikungunya ou du Nil occidental mais également avec des coronavirus comme le SRAS ou le MERS. Voir : a) J. Choutka et al., Nat. Med. 2022, 28, 911 ( https://doi.org/10.1038/s41591-022-01810-6) ; b) M. Parotto et al., Lancet Respir. Med. 2023, 11, 739 ( https://doi.org/10.1016/S2213-2600(23)00239-4).
* 153 L'impact du covid long a été qualifié de « dévastateur » par Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l'OMS. Voir : Tedros Adhanom Ghebreyesus, The data is clear: long Covid is devastating people's lives and livelihoods, 2022 ( https://www.theguardian.com/society/2022/oct/12/long-covid-who-director-general-oped-tedros-adhanom-ghebreyesus).
* 154 Dans un éditorial du journal scientifique The Lancet Respiratory Medicine publié en août 2023, le covid long a été présenté comme « une crise de santé publique croissante à l'échelle mondiale ». Voir : The Lancet Respiratory Medicine, Lancet. Respir. Med. 2023, 11, 663 ( https://doi.org/10.1016/S2213-2600(23)00268-0).
* 155 Covars, Avis du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) du 7 novembre 2023 sur le syndrome post-covid, ses enjeux médicaux, sociaux et économiques et les perspectives d'amélioration de sa prise en charge, 2023 ( https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-11/avis-du-covars-du-7-novembre-2023---syndrome-post-covid-29943.pdf).
* 156 Rapport de MM. Jean-François Eliaou et Gérard Leseul, députés, et Mmes Sonia de La Provôté et Florence Lassarade, sénatrices, sur « Les aspects scientifiques et techniques de la lutte contre la pandémie de la covid-19 », Assemblée nationale n° 4315 (15e législature) - Sénat n° 741 (2020-2021) ( https://www.senat.fr/rap/r20-741/r20-7411.pdf).
* 157 Rapport de MM. Jean-François Eliaou et Gérard Leseul, députés, et Mmes Sonia de La Provôté et Florence Lassarade, sénatrices, sur « La lutte contre la pandémie de la covid-19 : Aspects scientifiques et techniques - Conséquences indirectes », Assemblée nationale n° 5064 (15e législature) - Sénat n° 531 (2021-2022) ( https://www.senat.fr/rap/r21-531/r21-5311.pdf).
* 158 OMS, A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus, 2021 ( https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/345824/WHO-2019-nCoV-Post-COVID-19-condition-Clinical-case-definition-2021.1-eng.pdf).
* 159 Haute Autorité de santé, Réponses rapides dans le cadre de la COVID-19 : Symptômes prolongés à la suite d'une covid-19 de l'adulte - Diagnostic et prise en charge - Synthèse, 2023 ( https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-01/synthese_symptomes_prolonges_a_la_suite_d_une_covid_19_de_l_adulte_diagnostic_et_pec.pdf).
* 160 La prévalence de cette situation pourrait s'accroître en raison du faible niveau de dépistage actuel.
* 161 Pour une vision critique des méthodologies employées, voir notamment : T. B. Høeg et al., BMJ Evid. Based Med. 2023, sous presse ( https://doi.org/10.1136/bmjebm-2023-112338).
* 162 Pour des revues de la littérature, voir les analyses publiées par la Haute Autorité de santé et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies : a) Haute Autorité de santé, Symptômes prolongés à la suite de la covid-19 : état des lieux des données épidémiologiques (avril 2023), 2023 ( https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-04/reco445_analyse_litterature_epidemio_mel.pdf) ; b) Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, Prevalence of post COVID-19 condition symptoms: a systematic review and meta-analysis of cohort study data, stratified by recruitment setting, 2022 ( https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Prevalence-post-COVID-19-condition-symptoms.pdf).
* 163 C. Chen et al., J. Infect. Dis. 2022, 226, 1593 ( https://doi.org/10.1093/infdis/jiac136).
* 164 Global Burden of Disease Long COVID Collaborators, JAMA 2022, 328, 1604 ( https://doi.org/10.1001/jama.2022.18931).
* 165 Covars, Avis du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) du 7 novembre 2023 sur le syndrome post-covid, ses enjeux médicaux, sociaux et économiques et les perspectives d'amélioration de sa prise en charge, 2023 ( https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-11/avis-du-covars-du-7-novembre-2023---syndrome-post-covid-29943.pdf).
* 166 H. E. Davis et al., Nat. Rev. Microbiol. 2023, 21, 133 ( https://doi.org/10.1038/s41579-022-00846-2). Pour l'OMS, 10 à 20 % des personnes infectées par le SARS-CoV-2 seraient concernées par un covid long. Voir : OMS, Maladie à coronavirus (COVID-19) : affection post-COVID-19, 2023 ( https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-(covid-19)-post-covid-19-condition).
* 167 H. E. Davis et al., Nat. Rev. Microbiol. 2023, 21, 133 ( https://doi.org/10.1038/s41579-022-00846-2).
* 168 La méta-analyse précédemment citée ayant identifié une incidence du covid long de 43 % avait par exemple estimé ce nombre à 200 millions. Voir : C. Chen et al., J. Infect. Dis. 2022, 226, 1593 ( https://doi.org/10.1093/infdis/jiac136).
* 169 Santé publique France, Enquête « COVID long - Affection post-COVID-19, France métropolitaine », septembre - novembre 2022. Premiers résultats, 2023( https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/enquetes-etudes/enquete-covid-long-affection-post-covid-19-france-metropolitaine-septembre-novembre-2022-premiers-resultats).
* 170 On peut noter une variation importante selon la définition retenue, avec une prévalence pouvant aller jusqu'à 13,1 % en utilisant la définition de l'Office for National Statistics britannique. Voir : J. Coste et al., Clin. Microbiol. Infect. 2024, sous presse ( https://doi.org/10.1016/j.cmi.2024.03.020).
* 171 Office for National Statistics, Prevalence of ongoing symptoms following coronavirus (COVID-19) infection in the UK: 3 November 2022, 2022 ( https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/3november2022).
* 172 Statistique Canada, Symptômes à long terme chez les adultes canadiens ayant obtenu un résultat positif à la covid-19 ou ayant soupçonné une infection, janvier 2020 à août 2022, 2022 ( https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/221017/dq221017b-fra.htm).
* 173 N. D. Ford et al., Morb. Mortal. Wkly Rep. 2023, 72, 866 ( https://doi.org/10.15585/mmwr.mm7232a3).
* 174 P. Zimmermann et al., Pediatr. Infect. Dis J. 2021, 40, e482 ( https://doi.org/10.1097/inf.0000000000003328).
* 175 S. Lopez-Leon et al., Sci. Rep. 2022, 12, 9950 ( https://doi.org/10.1038/s41598-022-13495-5).
* 176 L. Jiang et al., Pediatrics 2023, 152, e2022060351 ( https://doi.org/10.1542/peds.2022-060351).
*
177 J. Hirt et al., Arch. Dis. Child
2023, 108, 498 (
https://doi.org/10.1136/archdischild-2022-324455).
Il
est nécessaire de souligner la difficulté de construire des
groupes de contrôle en population pédiatrique, en raison d'une
part importante de formes asymptomatiques de la covid-19 et du faible nombre de
tests réalisés dans cette population.
D'après certaines
études de cohorte, l'augmentation des symptômes chez des enfants
infectés par rapport à un groupe de contrôle ayant
été testé négativement serait relativement faible.
Voir : S. Rao et al., JAMA Pediatr. 2022, 176, 1000
(
https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2022.2800).
* 178 Y. Huang et al., Clin. Nurs. Res. 2022, 31, 1390 ( https://doi.org/10.1177/10547738221125632).
* 179 FAIR Health, Patients diagnosed with post-COVID conditions: an analysis of private healthcare claims using the official ICD-10 diagnostic code, 2022 ( http://resource.nlm.nih.gov/9918504887106676).
* 180 V. Tsampasian et al., JAMA Intern. Med. 2023, 183, 566 ( https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2023.0750).
* 181 a) Global Burden of Disease Long COVID Collaborators, JAMA 2022, 328, 1604 ( https://doi.org/10.1001/jama.2022.18931) ; b) Santé publique France, Enquête « COVID long - Affection post-COVID-19, France métropolitaine », septembre - novembre 2022. Premiers résultats, 2023 ( https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/enquetes-etudes/enquete-covid-long-affection-post-covid-19-france-metropolitaine-septembre-novembre-2022-premiers-resultats).
* 182 V. Tsampasian et al., JAMA Intern. Med. 2023, 183, 566 ( https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2023.0750)
* 183 M. S. Petersen et al., Clin. Infect. Dis. 2020, 73, e4058 ( https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1792).
* 184 Office for National Statistics, Prevalence of ongoing symptoms following coronavirus (COVID-19) infection in the UK: 30 March 2023, 2023 ( https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/30march2023).
* 185 B. Mizrahi et al., BMJ 2023, 380, e072529 ( https://doi.org/10.1136/bmj-2022-072529).
* 186 Santé publique France, Enquête « COVID long - Affection post-COVID-19, France métropolitaine », septembre-novembre 2022. Premiers résultats, 2023 ( https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/enquetes-etudes/enquete-covid-long-affection-post-covid-19-france-metropolitaine-septembre-novembre-2022-premiers-resultats).
* 187 S. K. Berg et al., Lancet Child Adolesc. Health 2022, 6, 614 ( https://doi.org/10.1016/S2352-4642(22)00154-7).
* 188 a) R. Dumont et al., Nat. Commun. 2022, 13, 7086 ( https://doi.org/10.1038/s41467-022-34616-8) ; b) T. Stephenson et al., Glob. Pediatr. 2024, 7, 100133 ( https://doi.org/10.1016/j.gpeds.2024.100133).
* 189 M. Gottlieb et al., Clin. Infect. Dis. 2023, 76, 1930 ( https://doi.org/10.1093/cid/ciad045).
* 190 a) M. Antonelli et al., Lancet 2022, 399, 2263 ( https://doi.org/10.1016/s0140-6736(22)00941-2) ; b) C. R. Kahlert et al., Clin. Infect. Dis. 2023, 77, 194 ( https://doi.org/10.1093/cid/ciad143) ; c) S. Diexer et al., Int. J. Infect. Dis. 2023, 136, 14 ( https://doi.org/10.1016/j.ijid.2023.08.019).
* 191 C. J. Atchison et al., Nat. Commun. 2023, 14, 6588 ( https://doi.org/10.1038/s41467-023-41879-2).
* 192 Statistique Canada, Symptômes à long terme chez les adultes canadiens ayant obtenu un résultat positif à la COVID-19 ou ayant soupçonné une infection, janvier 2020 à août 2022, 2022 ( https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/221017/dq221017b-fra.htm).
* 193 En revanche, il ne semblait pas exister de différence chez les personnes triplement vaccinées. Voir : Office for National Statistics, Self-reported long COVID after infection with the Omicron variant in the UK: 6 May 2022, 2022 ( https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/selfreportedlongcovidafterinfectionwiththeomicronvariant/6may2022).
* 194 a) M. Nehme et al., Clin. Infect. Dis. 2023, 76, 1567 ( https://doi.org/10.1093/cid/ciac947) ; b) C. R. Kahlert et al., Clin. Infect. Dis. 2023, 77, 194 ( https://doi.org/10.1093/cid/ciad143).
* 195 Office for National Statistics, Prevalence of ongoing symptoms following coronavirus (COVID-19) infection in the UK: 4 August 2022, 2022 ( https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/4august2022).
* 196 Office for National Statistics, Self-reported long COVID after infection with the Omicron variant in the UK: 6 May 2022, 2022 ( https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/selfreportedlongcovidafterinfectionwiththeomicronvariant/6may2022).
* 197 a) N. D. Ford et al., Morb. Mortal. Wkly Rep. 2023, 72, 866 ( https://doi.org/10.15585/mmwr.mm7232a3) ; b) Office for National Statistics, Prevalence of ongoing symptoms following coronavirus (COVID-19) infection in the UK: 30 March 2023, 2023 ( https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/30march2023).
* 198 B. Bowe et al., Nat. Med. 2022, 28, 2398 ( https://doi.org/10.1038/s41591-022-02051-3) ; b) Long Covid Support et Long Covid Kids, How do covid reinfections affect long Covid ? Results from an Internet survey of people with long Covid, 2022 ( https://www.longcovid.org/images/Documents/Reinfections_in_Long_Covid_Survey_Report_by_Long_Covid_Support_and_Long_Covid_Kids_080922.pdf).
* 199 S. Kuang et al., Experiences of Canadians with long-term symptoms following COVID-19, 2023 ( https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2023001/article/00015-eng.htm).
* 200 Y. Xie et al., JAMA Intern. Med. 2023, 183, 554 ( https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2023.0743).
* 201 A. Preiss et al., medRXiv 2024 ( https://doi.org/10.1101/2024.01.20.24301525).
* 202 C. Bramante et al., Lancet Infect. Dis. 2023, 23, 1119 ( https://doi.org/10.1016/S1473-3099(23)00299-2).
* 203 a) V. Tsampasian et al., JAMA Intern. Med. 2023, 183, 566 ( https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2023.0750) ; b) A. Watanabe et al., Vaccine 2023, 41, 1783 ( https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2023.02.008).
* 204 a) A. R. Marra et al., Antimicrob. Steward. Healthc. Epidemiol. 2023, 3, e168 ( https://doi.org/10.1017/ash.2023.447) ; b) L. Lundberg-Morris et al., BMJ 2023, 383, e076990 ( https://doi.org/10.1136/bmj-2023-076990).
* 205 H. Razzaghi et al., Pediatrics 2024, e2023064446 ( https://doi.org/10.1542/peds.2023-064446).
* 206 V.-T. Tran et al., BMJ Medicine 2023, 2, e000229 ( https://doi.org/10.1136/bmjmed-2022-000229).
* 207 a) S. A. Richard et al., JAMA Netw. Open. 2023, 6, e2251360 ( https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.51360) ; b) M. Nayyerabadi et al., Int. J. Infect. Dis. 2023, 136, 136 ( https://doi.org/10.1016/j.ijid.2023.09.006) ; c) C. B. Grady et al., medRXiv 2024 ( https://doi.org/10.1101/2024.01.11.24300929)
* 208 H. E. Davis et al., Nat. Rev. Microbiol. 2023, 21, 133 ( https://doi.org/10.1038/s41579-022-00846-2).
* 209 a) H. Zhang et al., Nat. Med. 2023, 29, 226 ( https://doi.org/10.1038/s41591-022-02116-3) ; b) J. T. Reese et al., eBioMedicine 2023, 87, 104413 ( https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2022.104413) ; c) C. Zang et al., Nat. Commun. 2023, 14, 1948 ( https://doi.org/10.1038/s41467-023-37653-z).
* 210 C. H. Sudre et al., Nat. Med. 2021, 27, 626 ( https://doi.org/10.1038/s41591-021-01292-y).
* 211 Haute Autorité de santé, Symptômes prolongés à la suite de la covid-19 : état des lieux des données épidémiologiques, 2023 ( https://www.has-sante.fr/jcms/p_3427623/fr/symptomes-prolonges-a-la-suite-de-la-covid-19-etat-des-lieux-des-donnees-epidemiologiques-et-des-mecanismes-physiopathologiques).
* 212 D'autres revues de la littérature sont parvenues à des estimations globalement cohérentes avec ces résultats. Voir : C. Chen et al., J. Infect. Dis. 2022, 226, 1593 ( https://doi.org/10.1093/infdis/jiac136).
* 213 J. Agergaard et al., Int. J. Infect. Dis. 2023, 137, 126 ( https://doi.org/10.1016/j.ijid.2023.10.022). Une étude a toutefois observé un impact sur la prévalence de certains symptômes neurocognitifs. Voir : M. Spinicci et al., Viruses 2022, 14, 2367 ( https://doi.org/10.3390/v14112367).
* 214 https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-01/synthese_symptomes_prolonges_a_la_suite_d_une_covid_19_de_l_adulte_diagnostic_et_pec.pdf.
* 215 S.A. Behnood et al., J. Infect. 2022, 84, 158 ( https://doi.org/10.1016/j.jinf.2021.11.011).
* 216 S. Lopez-Leon et al., Sci. Rep. 2022, 12, 9950 ( https://doi.org/10.1038/s41598-022-13495-5).
* 217 a) B. Mizrahi et al., BMJ 2023, 380, e072529 ( https://doi.org/10.1136/bmj-2022-072529) ; b) V.-T. Tran et al., Nat. Commun 2022, 13, 1812 ( https://doi.org/10.1038/s41467-022-29513-z).
* 218 J. Choutka et al., Nat. Med. 2022, 28, 911 ( https://doi.org/10.1038/s41591-022-01810-6).
* 219 Global Burden of Disease Long COVID Collaborators, JAMA 2022, 328, 1604( https://doi.org/10.1001/jama.2022.18931).
* 220 O. Robineau et al., JAMA Netw Open 2022, 5, e2240985 ( https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.40985).
* 221 V.-T. Tran et al., Nat. Commun 2022, 13, 1812 ( https://doi.org/10.1038/s41467-022-29513-z).
* 222 L. Mateu et al., Lancet Reg. Health - Eur. 2023, 33, 100724 ( https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2023.100724).
* 223 C. Fernández-de-las-Peñas et al., JAMA Netw. Open 2022, 5, e2242106 ( https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.42106).
* 224 B. Bowe et al., Nat. Med. 2023, 29, 2347 ( https://doi.org/10.1038/s41591-023-02521-2).
* 225 C. Servier et al., Int. J. Infect. Dis. 2023, 133, 67 ( https://doi.org/10.1016/j.ijid.2023.05.007).
* 226 a) D. Salmon-Céron et al., MMI Formation 2022, 1, 24 ( https://doi.org/10.1016/j.mmifmc.2021.12.001) ; b) H. E. Davis et al., Nat. Rev. Microbiol. 2023, 21, 133 ( https://doi.org/10.1038/s41579-022-00846-2) ; c) L. Mateu et al., Lancet Reg. Health - Eur. 2023, 33, 100724 ( https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2023.100724) ; d) L. Huang et al., Lancet Respir. Med. 2022, 10, 863 ( https://doi.org/10.1016/s2213-2600(22)00126-6).
* 227 V.-T. Tran et al., Nat. Commun 2022, 13, 1812 ( https://doi.org/10.1038/s41467-022-29513-z).
* 228 O. Robineau et al., JAMA Netw Open 2022, 5, e2240985
( https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.40985).
* 229 a) H. E. Davis et al., Nat. Rev. Microbiol. 2023, 21, 133 ( https://doi.org/10.1038/s41579-022-00846-2) ; b) Y. Liu et al., CMJ PCCM 2023, 1, 231 ( https://doi.org/10.1016/j.pccm.2023.10.003).
* 230 G. Kenny et al., Front. Mol. Biosci. 2023, 10, 1157651 ( https://doi.org/10.3389/fmolb.2023.1157651).
* 231 M. Gheblawi et al., Circ. Res. 2020, 126, 1456 ( https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.120.317015).
* 232 F. Tejerina et al., BMC Infect. Dis. 2022, 22, 211 ( https://doi.org/10.1186/s12879-022-07153-4).
* 233 S. R. Stein et al., Nature 2022, 612, 758 ( https://doi.org/10.1038/s41586-022-05542-y).
* 234 a) Z. Swank et al., Clin. Infect. Dis. 2023, 76, e487 ( https://doi.org/10.1093/cid/ciac722) ; b) M. Ghafari et al., Nature 2024, 626, 1094 ( https://doi.org/10.1038/s41586-024-07029-4).
* 235 C. Phetsouphanh et al., Nat. Immunol. 2022, 23, 210 ( https://doi.org/10.1038/s41590-021-01113-x).
* 236 J. Klein et al., Nature 2023, 623, 139 ( https://doi.org/10.1038/s41586-023-06651-y).
* 237 L. B. Weinstock et al., Int. J. Infect. Dis. 2021, 112, 217 ( https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.09.043).
* 238 C. Cervia-Hasler et al., Science 2024, 383, 273 ( https://doi.org/10.1126/science.adg7942).
* 239 a) J. E. Gold et al., Pathogens 2021, 10, 763. ( https://doi.org/10.3390/pathogens10060763) ; b) M. J. Peluso et al., J. Clin. Invest. 2023, 133, e163669 ( https://doi.org/10.1172/JCI163669).
* 240 a) J. Klein et al., Nature 2023, 623, 139 ( https://doi.org/10.1038/s41586-023-06651-y) ; b) F. Sotzny et al., Front. Immunol. 2022, 13, 981532 ( https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.981532) ; c) L. Thurner et al., J. Transl. Autoimmun. 2022, 5, 100171 ( https://doi.org/10.1016/j.jtauto.2022.100171) ; d) G. Wallukat et al., J. Transl. Autoimmun. 2021, 4, 100100 ( https://doi.org/10.1016/j.jtauto.2021.100100) ; e) J. M. Arthur et al., PLoS ONE 2021, 16, e0257016 ( https://doi.org/10.1371/journal.pone.0257016).
* 241 a) S. Charfeddine et al., Front. Cardiovasc. Med. 2021, 8, 745758 ( https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.745758) ; b) M. Haffke et al., J. Transl Med. 2022, 20, 138 ( https://doi.org/10.1186/s12967-022-03346-2).
* 242 C. Greene et al., Nat. Neurosci. 2024, 27, 421 ( https://doi.org/10.1038/s41593-024-01576-9).
* 243 Q. Liu et al., Gut 2022, 71, 544 ( https://doi.org/10.1136/gutjnl-2021-325989).
* 244 R. I. Lau et al., Lancet Infect. Dis. 2024, 24, 256 ( https://doi.org/10.1016/S1473-3099(23)00685-0).
* 245 S. J. Yong et al., Expert Opin. Investig. Drugs 2023, 32, 655 ( https://doi.org/10.1080/13543784.2023.2242773).
* 246 https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/symptomes_prolonges_a_la_suite_d_une_covid_19_de_l_adulte_diagnostic_et_prise_en_charge.pdf.
* 247 Une rééducation physique trop intensive est susceptible d'être contre-productive. Voir : OMS, Support for rehabilitation: self-management after COVID-19-related illness, second edition, 2021 ( https://www.who.int/europe/publications/i/item/WHO-EURO-2021-855-40590-59892).
* 248 T. A. Kuut et al., Clin. Infect. Dis. 2023, 77, 68 ( https://doi.org/10.1093/cid/ciad257).
* 249 Haute Autorité de santé, Parcours de soins de l'adulte avec des symptômes prolongés de la covid-19, 2024 ( https://www.has-sante.fr/jcms/p_3507843/fr/parcours-de-soins-de-l-adulte-avec-des-symptomes-prolonges-de-la-covid-19).
* 250 a) Ibid ; b) Haute Autorité de santé, Symptômes prolongés suite à une covid-19 de l'adulte - Diagnostic et prise en charge, 2023 ( https://www.has-sante.fr/jcms/p_3237041/fr/symptomes-prolonges-suite-a-une-covid-19-de-l-adulte-diagnostic-et-prise-en-charge).
*
251 Cette initiative fait suite à la loi du
24 janvier 2022 visant à la création d'une plateforme de
référencement et de prise en charge des malades chroniques de la
covid-19. Voir :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045067964/
Ce
questionnaire se décline en 3 versions : pour les adultes, les
adolescents de 12 à 17 ans et les enfants de 11 ans et moins.
Voir :
https://touspartenairescovid.org/orientation-covid-long.
* 252 Ministère des solidarités et de la santé, Covid long : Comprendre - Informer - Prendre en charge, 2022 ( https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/220317_-_dp_covid_long__mars_2022.pdf).
* 253 Ibid.
* 254 Loi n° 2022-53 du 24 janvier 2022 visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19 ( https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045067964/).
* 255 Selon le Covars, seul un quart des médecins généralistes connaîtraient l'existence des cellules de coordination.
* 256 Selon le Covars, seuls 30 % des médecins généralistes connaîtraient les fiches de réponse rapide de la Haute Autorité de la santé sur le covid long.
* 257 Comme le relève le Covars, le diagnostic du covid long nécessite « du temps, de l'expérience, une certaine disponibilité psychique, une bonne acuité diagnostique et une bonne dose d'empathie ».
* 258 a) M. Davies et al., BMJ 2022, 378, o1671 ( https://doi.org/10.1136/bmj.o1671) ; b) L. Turner et al., Stem Cell Reports 2024, 18, 2010 ( https://doi.org/10.1016/j.stemcr.2023.09.015).
* 259 Loi n° 2022-53 du 24 janvier 2022 visant à la création d'une plateforme de référencement et de prise en charge des malades chroniques de la covid-19 ( https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045067964/).
* 260 https://www.sante.fr/covid-long.
* 261 Santé publique France, Enquête « COVID long - Affection post-COVID-19, France métropolitaine », septembre - novembre 2022. Premiers résultats, 2023 ( https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/enquetes-etudes/enquete-covid-long-affection-post-covid-19-france-metropolitaine-septembre-novembre-2022-premiers-resultats).
* 262 Office for National Statistics, Prevalence of ongoing symptoms following coronavirus (COVID-19) infection in the UK: 30 March 2023, 2023 ( https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/30march2023).
* 263 V.-T. Tran et al., Clin. Infect. Dis. 2022, 74, 278 ( https://doi.org/10.1093/cid/ciab352).
* 264 D. Salmon-Céron et al., MMI Formation 2022, 1, 24 ( https://doi.org/10.1016/j.mmifmc.2021.12.001)
* 265 H. E. Davis et al., eClinicalMedicine 2021, 38, 10 ( https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101019).
* 266 S. C. Ramos et al., Long COVID: A Tentative Assessment of Its Impact on Labour Market Participation & Potential Economic Effects in the EU, 2024 ( https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2024-01/eb077_en.pdf).
* 267 D. Reuschke et al., Appl. Econ. Lett. 2023, 30, 2510 ( https://doi.org/10.1080/13504851.2022.2098239).
* 268 lnstitute for Fiscal Studies, Long COVID and the labour market, IFS Briefing Note BN246, 2022 ( https://ifs.org.uk/publications/long-covid-and-labour-market).
* 269 K. Bach, New data shows long Covid is keeping as many as 4 million people out of work, 2022 ( https://www.brookings.edu/articles/new-data-shows-long-covid-is-keeping-as-many-as-4-million-people-out-of-work/).
* 270 Long Covid Support Employment Group, Workers' experience of Long Covid, 2023 ( https://www.tuc.org.uk/research-analysis/reports/workers-experience-long-covid).
* 271 M. Pantelic et al., PLoS ONE 2022, 17, e0277317 ( https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277317).
* 272 R. Pellegrino et al., Eur. J. Pediatr. 2022, 181, 3995 ( https://doi.org/10.1007/s00431-022-04600-x).
* 273 A. Gonzalez-Aumatell et al., Children 2022, 9, 1677 ( https://doi.org/10.3390/children9111677).
* 274 Office for National Statistics, Coronavirus and the social impacts of `long COVID' on people's lives in Great Britain: 7 April to 13 June 2021, 2021 ( https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/coronavirusandthesocialimpactsoflongcovidonpeopleslivesingreatbritain/7aprilto13june2021#household-finances-and-long-covid).
* 275 N. L. Hair et al., JAMA Network Open 2023, 6, e2347318 ( https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.47318).
* 276 Dans son avis, le Covars propose d'engager une réflexion sur la mise en place d'une ALD spécifique concernant l'ensemble des syndromes post-infectieux.
* 277 Un traitement est considéré comme couteux s'il implique un traitement médicamenteux ou appareillage régulier, ainsi qu'au moins deux éléments dans la liste suivante : hospitalisation, actes techniques médicaux répétés, actes biologiques répétés, soins paramédicaux répétés.
* 278 Tableau n° 100 : Affections respiratoires aigües liées à une infection au SARS-CoV2, Tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3, Code de la sécurité sociale ( https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042329374).
* 279 Les analyses de ce comité s'appuient sur les travaux d'un groupe d'experts, réalisés à la suite d'une saisine de la Direction de la Sécurité sociale et de la Direction générale du travail. Voir : INRS, Recommandations pour la reconnaissance, au titre de la voie complémentaire, de la covid-19 en maladie professionnelle, 2022 ( https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TM%2070).
* 280 National Institute for Health and Care Research, Researching long COVID, 2022 ( https://www.nihr.ac.uk/about-us/our-key-priorities/covid-19/researching-the-long-term-impact.htm).
* 281 National Institutes of Health, NIH launches new initiative to study « Long COVID », 2021 ( https://www.nih.gov/about-nih/who-we-are/nih-director/statements/nih-launches-new-initiative-study-long-covid).
*
282 En France, l'excès de
décès dus à la covid-19 au cours des années 2020 et
2021 a été estimé à 155 000, soit un taux
de 124,2 décès en excès pour
100 000 personnes (contre 120,5 en Allemagne, 126,8
au Royaume-Uni et 179,3 aux États-Unis). Voir : COVID-19
Excess Mortality Collaborators, Lancet 2022, 399, 1513 (
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02796-3).
On
peut également souligner une perte d'espérance de vie entre 2019
et 2021 relativement limitée en France (1,2 mois) en comparaison
d'autres pays (5,7 mois pour l'Allemagne, 9,3 mois pour l'Angleterre
et le Pays de Galle et de 28,2 mois pour les États-Unis).
Voir : J. Schöley et al., Nat. Hum. Behav.
2022, 6, 1649 (
https://doi.org/10.1038/s41562-022-01450-3).
* 283 OMS, WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard ( https://covid19.who.int/).
* 284 Santé publique France, Surveillance intégrée des infections respiratoires aiguës, 2023 ( https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2023/surveillance-integree-des-infections-respiratoires-aigues).
* 285 Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ( https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041865244).
* 286 Loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19 ( https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046114630).
* 287 Décret n° 2023-700 du 31 juillet 2023 relatif à la transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire et à la création du traitement de données à caractère personnel « LABOé-SI » ( https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047911698).
* 288 Les données collectées sont limitées aux informations démographiques sur le patient et à la nature, la date et le résultat du test.
* 289 Adapté rapidement pour faire face à la crise de la covid-19, le système d'information SI-VIC souffrait de fonctionnalités limitées ainsi que d'un défaut d'exhaustivité et de mise à jour du statut des patients.
*
290 L'identification de l'ensemble des cas
contacts s'avère toutefois difficile dès lors que le nombre
d'infections quotidiennes est élevé. D'après un rapport
publié par la Cour des comptes en décembre 2022, l'Assurance
maladie a joint plus de 32 millions de personnes testées positives
et près de 22,7 millions de personnes contact. Si cette
stratégie de « contact tracing » a probablement
permis de réduire le nombre de contaminations, la Cour souligne une
efficacité « incertaine ». Voir : Cour des
comptes, Tracer les contacts des personnes contaminées par la covid
19, Audit flash, 2022 (
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/tracer-les-contacts-des-personnes-contaminees-par-la-covid-19).
Face
à la difficulté de tracer manuellement l'ensemble des cas
contacts, une application de « contact tracing »
basée sur l'utilisation du bluetooth - StopCovid, ensuite
remplacée par TousAntiCovid - a été
développée. Faute d'une large adoption par la population, cette
fonctionnalité n'aurait eu qu'un rôle
« marginal » dans le dispositif de lutte contre la
covid-19, comme l'indiquent les rapports d'activité de cette application
et comme l'avait également souligné un rapport de la
délégation à la prospective du
Sénat.
Voir : a) Ministère des solidarités et
de la santé, Rapport d'activité : TousAntiCovid du
2 juin 2020 au 30 novembre 2021, 2022 (
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_tousanticovid_2021.pdf) ;
b) Rapport d'information n° 673 (2020-2021) fait au nom de
la délégation sénatoriale à la prospective sur
« les crises sanitaires et outils numériques :
répondre avec efficacité pour retrouver nos
libertés » par Mmes Véronique Guillotin,
Christine Lavarde, et M. René-Paul Savay, sénateurs (
https://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-673-notice.html) ;
c) Ministère des solidarités et de la santé,
Rapport d'activité : TousAntiCovid du
1er octobre 2021 au 25 janvier 2023, 2023 (
https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_tousanticovid_mars_2023.pdf).
* 291 Au cours de la première vague, seuls les patients hospitalisés avaient accès à ces tests.
* 292 Voir « Le dépistage en population asymptomatique » dans le Rapport fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur « les aspects scientifiques et techniques de la lutte contre la pandémie de la covid-19 » par MM. Jean-François Eliaou et Gérard Leseul, députés, et Mmes Sonia de La Provôté et Florence Lassarade, sénatrices ( https://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-741-notice.html).
* 293 D'après la HAS, les infections respiratoires aiguës représenteraient 70 % des prescriptions d'antibiotiques en ambulatoire alors qu'une part importante de celles-ci - entre 30 et 50 % - seraient d'origine virale. Voir : HAS, Intérêt des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) antigéniques COVID/grippe et COVID/grippe/VRS en ville, 2023 ( https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-06/rapport_trod_grippe_covid_vrs_vd.pdf).
* 294 HAS, Intérêt des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) antigéniques COVID/grippe et COVID/grippe/VRS en ville, 2023 ( https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2023-06/rapport_trod_grippe_covid_vrs_vd.pdf).
* 295 En raison de cette sensibilité moyenne, les TROD grippe ne sont aujourd'hui recommandés qu'au sein des collectivités à risque, en période épidémique, lorsque des cas groupés d'infections respiratoires aiguës laissent suspecter un foyer épidémique. Voir : Ministère des solidarités et de la santé, Instruction n° DGS/SP1/VSS/DGOS/PF2/DGCS/MSP/2019/185 du 7 août 2019 relative aux mesures de prévention et de contrôle de la grippe saisonnière, 2019 ( https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_grippe_070819.pdf).
* 296 La précocité du suivi dépend toutefois du délai entre l'infection et le début de l'excrétion virale, qui peut différer selon les virus, et de la fréquence et de la rapidité de traitement des analyses des eaux usées.
* 297 Le suivi des eaux usées dans les stations d'épuration ne donne des informations que pour un bassin relativement large de population. Toutefois, si les eaux usées sont prélevées et analysées plus en amont dans le réseau, il est possible de suivre la population plus finement, à l'échelle d'un quartier ou même d'un bâtiment.
* 298 H. Asghar et al., J. Infect. Dis. 2014, 210, S294 ( https://doi.org/10.1093/infdis/jiu384).
* 299 UK Health Security Agency, Poliovirus detected in sewage from North and East London, 2022 ( https://www.gov.uk/government/news/poliovirus-detected-in-sewage-from-north-and-east-london).
* 300 A. K. Debes et al., Am. J. Trop. Med. Hyg.2016, 94, 537 ( https://doi.org/10.4269/ajtmh.15-0496 ).
* 301 P. Callaghan et al., J. Hyg. 1968, 66, 489 ( https://doi.org/10.1017/S0022172400028230).
* 302 a) M. Bisseux et al., Euro. Surveill. 2018, 23, 17 ( https://doi.org/10.2807/1560-7917.es.2018.23.7.17-00237) ; b) C. McCall et al., Water Res. 2020, 184, 116160 ( https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.116160).
* 303 Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, Wastewater analysis and drugs -- a European multi-city study ( https://www.emcdda.europa.eu/publications/html/pods/waste-water-analysis_en).
* 304 C. D. Metcalfe et al., Environ. Toxicol. Chem. 2010, 29, 79 ( https://doi.org/10.1002/etc.27).
* 305 L'excrétion virale précède l'apparition des symptômes. Voir : V. Maréchal et al., Bull. Acad. Vét. France 2021, 174, 137 ( https://doi.org/10.3406/bavf.2021.70970).
* 306 G. Medema et al., Environ. Sci. Technol. Lett. 2020, 7, 511 ( https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00357).
* 307 S. Wurtzer et al., Euro. Surveill. 2020, 25, 2000776 ( https://doi.org/10.2807/1560-7917.es.2020.25.50.2000776).
* 308 N. Cluzel et al., Environ. Int. 2022, 158, 106998 ( https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106998).
* 309 C. C. Naughton et al., FEMS Microbes, 2023, 4, 1 ( https://doi.org/10.1093/femsmc/xtad003).
* 310 a) S. Harris-Lovett et al., J. Public Health Manag. Pract. 2023, 29, 317 ( https://doi.org/10.1097/PHH.0000000000001636) ; b) R. R. Spurbeck et al., Sci. Total Environ. 2021, 789, 147829 ( https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147829).
* 311 W.-y. Ng et al., Sci. Total Environ. 2023, 875, 162661 ( https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162661).
* 312 S. W. Olesen et al., Water Res. 2021, 202, 117433 ( https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117433).
* 313 R. Schill et al., Sci. Total Environ. 2023, 871, 162069 ( https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162069).
* 314 K. Bibby et al., Water Res. 2021, 202, 117438 ( https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117438).
*
315 A. Xiao et al., Water Res.
2022, 212, 118070 (
https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118070).
De
la même manière, dans le Nevada, alors qu'aucune avance n'avait
été constatée avec le variant Delta, celle-ci a
été significative au cours de la vague Omicron, probablement en
raison d'une surcharge des capacités de dépistage. Voir : L.
Li et al., Heliyon 2024, 10, e29462 (
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29462).
* 316 R. Schill et al., Sci. Total Environ. 2023, 871, 162069 ( https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162069).
* 317 Pour s'affranchir de cette contrainte, il est nécessaire de normaliser les résultats avec les débits des sites d'échantillonnage et des biomarqueurs humains permettant d'identifier l'échantillon de population concerné. Voir : D. Polo et al., Water Res. 2020, 186, 116404 ( https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.116404).
* 318 D. L. Wannigama et al., Lancet. Infect. Dis. 2024, sous presse ( https://doi.org/10.1016/S1473-3099(24)00155-5).
* 319 a) « Veolia, le CNRS et Université Côte d'Azur traquent les variants du SARS-CoV-2 dans les eaux usées », 2021 ( https://www.cote-azur.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/veolia-le-cnrs-et-universite-cote-dazur-traquent-les-variants-du-sars-cov-2-dans-les-eaux) b) G. Rios et al., Lancet Reg. Health Eur. 2021, 10, 100202. ( https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2021.100202).
Voir également : a) S. Wurtzer et al., Sci. Total. Environ. 2022, 810, 152213 ( https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152213) ; b) S. Wurtzer et al., Sci. Total. Environ. 2022, 848, 157740 ( https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.157740).
* 320 a) D. S. Smyth et al., Nat. Commun. 2022, 13, 635 ( https://doi.org/10.1038/s41467-022-28246-3) ; b) A. C. Reis et al., Sci. Total Environ. 2024, 921, 170961( https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.170961).
* 321 F. S. Brunner et al., Water Res. 2023, 247, 120804 ( https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.120804).
* 322 a) F. Amman et al., Nat. Biotechnol. 2022, 40, 1814 ( https://doi.org/10.1038/s41587-022-01387-y) ; b) M. Yousif et al.,. Nat. Commun. 2023, 14, 6325 ( https://doi.org/10.1038/s41467-023-41369-5).
* 323 V. Maréchal et al., Bull. Acad. Vét. France 2021, 174, 137 ( https://doi.org/10.3406/bavf.2021.70970).
* 324 La disponibilité des tests reste toutefois nécessaire à l'échelle individuelle dans une perspective de diagnostic.
* 325 On peut également souligner d'autres initiatives de moins grande ampleur comme l'unité Comete (Covid-19 Marseille Environment Testing & Expertise) mise en place par les marins-pompiers de Marseille et le CNRS.
* 326 Voir : https://www.reseau-obepine.fr/carte-des-tendances/.
Des rapports d'analyses fournissant une présentation plus détaillée des résultats par station étaient également publiés. Voir : https://www.reseau-obepine.fr/donnees-ouvertes/.
* 327 Direction générale de l'environnement de la Commission européenne, Recommandation (UE) 2021/472 de la Commission du 17 mars 2021 concernant une approche commune pour la mise en place d'une surveillance systématique de la présence du SARS-CoV-2 et de ses variants dans les eaux usées de l'Union européenne, 2021 ( https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/05b46cb0-8855-11eb-ac4c-01aa75ed71a1/language-fr).
* 328 Un suivi de 30 à 50 stations est resté toutefois en place pour répondre aux activités de recherche.
* 329 Des travaux menés par Obépine avaient déjà montré la possibilité de suivre précocement la circulation du virus Mpox à Paris à partir des eaux usées. Voir : S. Wurtzer et al., Environ. Sci. Technol. Lett. 2022, 9, 991 ( https://doi.org/10.1021/acs.estlett.2c00693).
* 330 V. Maréchal et al., Anaesth. Crit. Care Pain Med. 2023, 42, 101251
( https://doi.org/10.1016/j.accpm.2023.101251).
* 331 P. M. Choi et al., Trends Anal. Chem. 2018, 105, 453 ( https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.06.004).
* 332 Voir « Le suivi des variants du SARS-CoV-2 » dans le rapport fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur « les aspects scientifiques et techniques de la lutte contre la pandémie de la covid-19 » par MM. Jean-François Eliaou et Gérard Leseul, députés, et Mmes Sonia de La Provôté et Florence Lassarade, sénatrices ( http://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-741-notice.html) et « Quelles perspectives pour la pandémie de covid-19 ? Faut-il faire évoluer la stratégie de lutte contre le virus ? » dans le rapport fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur « la lutte contre la pandémie de la covid-19 : aspects scientifiques et techniques - conséquences indirectes » par MM. Jean-François Eliaou et Gérard Leseul, députés, et Mmes Sonia de La Provôté et Florence Lassarade, sénatrices ( https://www.senat.fr/rap/r21-531/r21-5311.pdf).
* 333 Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, et au Conseil : Un front uni pour vaincre la covid-19, 2021 ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2021%3A35%3AFIN).
* 334 H. Touzet et al., Le SARS-CoV-2 : une expérience inédite de surveillance génomique mondiale, 2023 ( https://inria.hal.science/hal-04155812/).
* 335 Activités de séquençage au sein du consortium Emergen ( https://emergen-db.france-bioinformatique.fr/fr/external/report/dashboard/).
* 336 Voir : https://gisaid.org/hcov-19-variants-dashboard/.
* 337 Voir : https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/projet-seq4epi.
* 338 a) Décret n° 2024-156 du 28 février 2024 portant diverses mesures relatives à la préparation et à la gestion des crises sanitaires ( https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049209996) ; b) Arrêté du 28 février 2024 modifiant l'arrêté du 6 avril 2016 portant organisation de la direction générale de la santé ( https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049210226).
* 339 Lettre circulaire DGS/DUS n° 2007-354 du 21 septembre 2007 relative au dispositif centralisé de réception et de gestion des alertes par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports : Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales (Corruss).
* 340 Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions présentant l'HERA, la nouvelle Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire, prochaine étape vers l'achèvement de l'Union européenne de la santé, 2021 ( https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cba81f5-16f8-11ec-b4fe-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF).
* 341 À l'échelle internationale, l'OMS a notamment créé : un Centre d'information sur les pandémies et les épidémies consacré à la collecte et l'analyse de renseignements sur les pandémies et les épidémies ; un système BioHub chargé de stocker et partager des agents pathogènes à des fins de recherche ; un Corps mondial pour l'action sanitaire d'urgence afin de coordonner et renforcer les capacités de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire ; un Fonds de lutte contre les pandémies pour aider les pays en développement à mieux se préparer et faire face à ces menaces. Un accord juridiquement contraignant sur la préparation et la riposte aux pandémies et des amendements au Règlement sanitaire international sont par ailleurs actuellement en cours de négociation.
* 342 Conseil européen, Multiannual financial framework 2021-2027, 2024 ( https://www.consilium.europa.eu/media/69866/20240201-special-euco-conclusions-mff-ukraine-en.pdf?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=European+Council+conclusions%2c+1+February+2024).
* 343 https://durableproject.org/
* 345 Commission européenne, Union de la santé : l'HERA présente la liste des trois principales menaces pour la santé auxquelles il faut se préparer, 2022 ( https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_22_4474).
* 346 Commission européenne, Health: HERA and CEPI agree on stronger cooperation in the development of medical countermeasures, 2022 ( https://health.ec.europa.eu/latest-updates/health-hera-and-cepi-agree-stronger-cooperation-development-medical-countermeasures-2022-10-24_en).
* 347 Covars, Avis du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) du 3 avril 2024 sur l'évaluation des risques de situations sanitaires exceptionnelles majeures pour la santé humaine en France au cours des années 2025-2030, 2024 ( https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2024-04/avis-du-covars-du-3-avril-2024---sse-32661.pdf).
* 348 S. L. Jin et al., Lancet Infect. Dis. 2024, sous presse ( https://doi.org/10.1016/S1473-3099(24)00105-1).
* 349 C. Apetrei et al., Trends Microbiol. 2022, 30, 948 ( https://doi.org/10.1016/j.tim.2022.07.004).
* 350 N. Chowdhury et al., J. Public Health 2023, 31, 553 ( https://doi.org/10.1007/s10389-021-01565-3).
* 351 Pour une présentation pédagogique de cette thématique, voir la note scientifique Face à l'explosion des données : prévenir la submersion de Ludovic Haye, sénateur, faite au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ( https://www.senat.fr/rap/r22-291/r22-2911.pdf).
* 352 Une distinction est faite entre la désinformation, qui désigne une information fausse qui aurait été produite ou partagée dans une volonté délibérée de tromper ou d'induire en erreur, et la mésinformation, qui relèverait de l'erreur honnête, de la déformation involontaire ou de la mésinterprétation.
* 353 World Economic Forum, The Global Risks Report 2024, 2024 ( https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2024.pdf).
* 354 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/coronavirus/.
* 355 J. Sarkis et al., La Presse Médicale Formation 2020, 1, 332 ( https://doi.org/10.1016%2Fj.lpmfor.2020.07.014).
* 356 Tedros Adhanom Ghebreyesus, Discours du Directeur général de l'OMS à la Conférence de Munich sur la sécurité, 2020 ( https://www.who.int/fr/director-general/speeches/detail/munich-security-conference).
* 357 Nations Unies, Assemblée générale : la covid-19 appelle à une lutte collective de la communauté internationale en tant que « nations, unies », 2020 ( https://press.un.org/fr/2020/org1706.doc.htm).
* 358 V. Tangcharoensathien et al., J. Med. Internet Res. 2020, 22, e19659 ( https://doi.org/10.2196/19659). Voir également : a) S. C. Briand et al., Cell 2021, 184, 6010 ( https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.10.031) ; b) F. M. Simon et al., New Media Soc. 2023, 25, 2219 ( https://doi.org/10.1177/14614448211031908).
* 359 OMS, Aplatissons la courbe de l'infodémie ( https://www.who.int/fr/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve).
* 360 R. Gallotti et al., Nat. Hum. Behav. 2020, 4, 1285 ( https://doi.org/10.1038/s41562-020-00994-6).
* 361 Plusieurs études ou rapports se sont récemment intéressés à cette question. Voir notamment : a) H. Bruns et al., Covid-19 misinformation: Preparing for future crises, 2022 ( https://doi.org/10.2760/41905) ; b) B. Petersen, Empowering Audiences - Against Misinformation Through « Prebunking », Background report commissioned by The Future of Free Speech 2023 ( https://futurefreespeech.org/background-report-empowering-audiences-against-misinformation-through-prebunking/) ; c) I. J. B. do Nascimento et al., Bull. World Health Organ. 2022, 100, 544 ( https://doi.org/10.2471/BLT.21.287654) ; d) V. J. Clemente-Suárez et al., Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 5321 ( https://doi.org/10.3390/ijerph19095321).
* 362 G. Bronner, Les Lumières à l'ère numérique, 2022
( https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/283201.pdf).
* 363 En ce qui concerne les liens pointant vers des sites Internet réputés fiables, seuls 30 % des liens sont partagés par le 1 % des contributeurs les plus actifs. Voir : M. Osmundsen et al., Am. Political Sci. Rev. 2021, 115, 999 ( https://doi.org/10.1017/S0003055421000290).
* 364 Center for Countering Digital Hate, The Disinformation Dozen, 2021 ( https://counterhate.com/research/the-disinformation-dozen/).
* 365 Institute for Strategic Dialogue, Deny, deceive, delay. Documenting and responding to climate disinformation at COP26 and beyond, 2022 ( https://www.isdglobal.org/isd-publications/deny-deceive-delay-documenting-and-responding-to-climate-disinformation-at-cop26-and-beyond-full/).
* 366 N. F. Johnson et al., Nature 2020, 582, 230 ( https://doi.org/10.1038/s41586-020-2281-1).
* 367 Y. Wang et al., Soc. Sci. Med. 2019, 240, 112552 ( https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112552).
*
368 D'après les révélations
des « Facebook Files », l'algorithme de Facebook
attribuerait 5 fois plus de poids à l'émoticône
« colère » qu'au simple
« j'aime ». Voir : J. B Merryl et al.,
Five points for anger, one for a `like' : How Facebook's formula
fostered rage and misinformation, 2021 (
https ://www.washingtonpost.com/technology/2021/10/26/facebook-angry-emoji-algorithm/).
Voir également : W. J. Brady et al., Proc. Natl.
Acad. Sci. USA 2017, 114, 7313 (
https://doi.org/10.1073/pnas.1618923114).
* 369 L. Edelson et al., IMC `21 2021, 444 ( https://doi.org/10.1145/3487552.3487859).
* 370 S. Altay et al., JQD:DM 2022, 2, 1 ( https://doi.org/10.51685/jqd.2022.020).
* 371 Center for Countering Digital Hate, Failure to Act. How Tech Giants Continue to Defy Calls to Rein in Vaccine Misinformation, 2020 ( https://www.counterhate.com/failure-to-act).
* 372 Une étude a par exemple montré que, face à des recherches sur la thématique climatique, YouTube proposait majoritairement des vidéos qui s'opposent au consensus établi. Voir : J. Allgaier, Front. Commun. 2019, 4, 36 ( https://doi.org/10.3389/fcomm.2019.00036). Voir également : Institute for Strategic Dialogue, Deny, deceive, delay (vol. 2). Exposing New Trends in Climate. Mis- and Disinformation at COP27, 2023 ( https://www.isdglobal.org/isd-publications/deny-deceive-delay-vol-2-exposing-new-trends-in-climate-mis-and-disinformation-at-cop27/).
*
373 a) M. Del Vicario et al.,
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2016, 113, 554 (
https://doi.org/10.1073/pnas.1517441113) ;
b) M. Del Vicario et al., Sci. Rep. 2016, 6, 37825 (
https://doi.org/10.1038/srep37825) ;
c) M. Cinelli et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2021,
118, e20233011 (
https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118).
Un
effet similaire a pu être observé avec les moteurs de recherche.
Voir : K. Aslett et al., Nature 2024, 625, 548 (
https://doi.org/10.1038/s41586-023-06883-y).
* 374 G. Bronner, Les Lumières à l'ère numérique, 2022
( https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/283201.pdf).
* 375 a) G. Pennycook et al., Nature 2021, 592, 590 ( https://doi.org/10.1038/s41586-021-03344-2) ; b) G. Pennycook et al., Trends Cogn. Sci. 2021, 25, 388 ( https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.02.007).
* 376 a) E. Mitchelstein et al., Soc. Media Soc. 2020, 6, 2056305120984452 ( https://doi.org/10.1177/2056305120984452) ; b) A. Jungherr et al., Soc. Media Soc. 2021, 7, 2056305121988928 ( https://doi.org/10.1177/2056305121988928) ; c) D. A. Scheufele et al., J. Appl. Res. Mem. Cogn. 2021, 10, 522 ( https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2021.10.009) ; d) S. Altay et al., Soc. Media Soc. 2023, 9, 2056305122115041 ( https://doi.org/10.1177/20563051221150412).
* 377 S. Vosoughi et al., Science 2018, 359, 1146 ( https://doi.org/10.1126/science.aap9559).
* 378 S. Altay et al., Soc. Media Soc. 2023, 9, 2056305122115041 ( https://doi.org/10.1177/20563051221150412).
* 379 M. Cinelli et al., Sci. Rep. 2020, 10, 1 ( https://doi.org/10.1038/s41598-020-73510-5).
* 380 C. M. Pulido et al., Int. Sociol. 2020, 35, 377 ( https://doi.org/10.1177/0268580920914755).
* 381 a) N. Johansen et al., HKS Misinformation Review 2022, 1 ( https://doi.org/10.37016/mr-2020-93) ; b) M. J. Metzger et al., Media Commun. 2021, 9, 3409 ( https://doi.org/10.17645/mac.v9i1.3409).
* 382 M. J. Lazer et al., Science 2018, 359, 1094 ( https://doi.org/10.1126/science.aao2998).
* 383 M. Osmundsen et al., Am. Political Sci. Rev. 2021, 115, 999 ( https://doi.org/10.1017/S0003055421000290).
*
384 E. Gabarron et al., Bull. World
Health Organ. 2021, 99, 455 (
https://doi.org/10.2471/BLT.20.276782).
Sur
d'autres sujets de santé, notamment sur les produits du tabac et les
drogues, la part de fausses informations pourrait être plus importante.
Voir : V. Suarez-Lledo et al., J. Med. Internet Res.
2021, 23, e17187 (
https://doi.org/10.2196/17187).
* 385 L. Cordonier et al., Comment les Français s'informent-ils sur Internet ? Analyse des comportements d'information et de désinformation en ligne, Étude de la Fondation Descartes, 2021 ( https://www.fondationdescartes.org/2021/03/comment-les-francais-sinforment-ils-sur-internet/).
*
386 R. Fletcher et al., Measuring
the reach of « fake news » and online disinformation in
Europe, Reuters Institute Factsheet 2018 (
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/measuring-reach-fake-news-and-online-disinformation-europe).
Sur
les sujets médicaux, les médecins représentent le canal
d'information le plus utilisé et celui qui bénéficie de la
plus grande confiance. Voir : L. Cordonier, Information et
santé. Analyse des croyances et comportements d'information des
Français liés à leur niveau de connaissances en
santé, au refus vaccinal et au renoncement médical,
Étude de la Fondation Descartes, 2023 (
https://www.fondationdescartes.org/2023/10/information-et-sante/).
*
387 L. Cordonier et al., Comment les
Français s'informent-ils sur Internet ? Analyse des comportements
d'information et de désinformation en ligne, Étude de la
Fondation Descartes, 2021 (
https://www.fondationdescartes.org/2021/03/comment-les-francais-sinforment-ils-sur-internet/).
Des
proportions similaires sont observées à l'étranger.
Voir : S. Altay et al., JQD:DM 2022, 2, 1 (
https://doi.org/10.51685/jqd.2022.020).
* 388 S. Altay et al., JQD:DM 2022, 2, 1 ( https://doi.org/10.51685/jqd.2022.020).
* 389 M. Faccin et al., PLoS ONE 2022, 17, e0271157 ( https://doi.org/10.1371/journal.pone.0271157).
* 390 A. Guess et al., HKS Misinformation Review 2020, 1 ( https://doi.org/10.37016/mr-2020-004).
*
391 S. Altay et al., Soc. Media
Soc. 2023, 9, 2056305122115041 (
https://doi.org/10.1177/20563051221150412).
Il
est toutefois nécessaire de souligner que l'adhésion à des
informations erronées sur la sécurité de la vaccination a
une incidence sur le recours à la vaccination. Voir : D. Romer
et al., Vaccine 2022, 40, 6463 (
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.09.046).
* 392 H. Mercier, Rev. Gen. Psychol. 2017, 21, 103 ( https://doi.org/10.1037/gpr0000111).
* 393 a) R. Fletcher et al., Inf. Commun. Soc. 2019, 22, 1751 ( https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1450887) ; b) A. Acerbi et al., HKS Misinformation Review 2022 ( https://doi.org/10.37016/mr-2020-87).
* 394 L. Cordonier, Information et santé. Analyse des croyances et comportements d'information des Français liés à leur niveau de connaissances en santé, au refus vaccinal et au renoncement médical, Étude de la Fondation Descartes, 2023 ( https://www.fondationdescartes.org/2023/10/information-et-sante/).
*
395 C. de Saint Laurent et al.,
Cogn. Res.: Princ. Implic. 2022, 7, 87 (
https://doi.org/10.1186/s41235-022-00437-y).
Une
étude menée au Royaume-Uni et aux Etats-Unis a toutefois
montré que l'exposition à des fausses informations était
susceptible de diminuer l'adhésion vaccinale contre la covid-19.
Voir : S. Loomba et al., Nat. Hum. Behav. 2021, 5, 337
(
https://doi.org/10.1038/s41562-021-01056-1).
Une étude menée avant la pandémie avait également
observé un effet similaire. Voir : D. Jolley et al.,
PLoS One 2014, 9, e89177 (
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0089177).
* 396 M. Faccin et al., PLoS One 2022, 17, e0271157 ( https://doi.org/10.1371/journal.pone.0271157).
* 397 a) A. Dechêne et al., Pers. Soc. Psychol. Rev. 2010, 14, 238 ( https://doi.org/10.1177/1088868309352251) ; b) G. Pennycook et al., J. Exp. Psychol. Gen. 2018, 147, 1865 ( https://doi.org/10.1037/xge0000465).
* 398 L. Pummerer et al., Soc. Psychol. Pers. Sci. 2021, 13, 49 ( https://doi.org/10.1177/19485506211000217).
* 399 H. Kim et al., Sci. Commun. 2020, 42, 586 ( https://doi.org/10.1177/1075547020959670).
* 400 Au cours de la crise sanitaire, on a notamment pu noter un nombre inquiétant de menaces envers des scientifiques s'exprimant sur la covid-19. Voir : « COVID scientists in the public eye need protection from threats », Nature 2021, 598, 236 ( https://doi.org/10.1038/d41586-021-02757-3).
* 401 L. Cordonier, Information et santé. Analyse des croyances et comportements d'information des Français liés à leur niveau de connaissances en santé, au refus vaccinal et au renoncement médical, Étude de la Fondation Descartes, 2023 ( https://www.fondationdescartes.org/2023/10/information-et-sante/).
* 402 a) M. S. Islam et al., Am. J. Trop. Med. Hyg. 2020, 103, 1621 ( https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-0812) ; b) S. A. Mahdavi et al., Alcohol Clin. Exp. Res. 2021, 45, 1853 ( https://doi.org/10.1111%2Facer.14680).
* 403 J. Allen et al., Sci. Adv. 2020, 6, eaay3539 ( https://doi.org/10.1126/sciadv.aay3539).
*
404 X. Nan et al., Soc. Sci.
Med. 2022, 314, 115398 (
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115398).
Pour
une revue de l'influence de ces différents facteurs sur la croyance et
le partage de fausses informations sur la covid-19, voir : H. Bruns
et al., Covid-19 misinformation: Preparing for future crises,
2022 (
https://doi.org/10.2760/41905).
* 405 ORS PACA, Enquête COVIREIVAC Vague 2 - SLAVACO Vague 4 : Rappels et vaccination des enfants en période de décrue de l'épidémie, 2022 ( http://www.orspaca.org/sites/default/files/note-covireivac-v2-slavaco-v4.pdf).
* 406 E. Humprecht et al., Int. J. Press/Politics 2020, 25, 493 ( https://doi.org/10.1177/1940161219900126).
* 407 G. Pennycook et al., Psychol. Sci. 2020, 31, 770 ( https://doi.org/10.1177/0956797620939054).
* 408 a) M. Duplaga, Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 7818 ( https://doi.org/10.3390/ijerph17217818) ; b) K. Pickles et al., J. Med. Internet Res. 2021, 23, e23805 ( https://doi.org/10.2196/23805).
* 409 D'après l'OCDE, la numératie se définit comme la capacité à utiliser, appliquer, interpréter et communiquer des informations et des idées mathématiques. Voir : J. Roozenbeek et al., R. Soc. Open Sci. 2020, 7, 201199 ( https://doi.org/10.1098/rsos.201199).
* 410 V. Èavojová et al., J. Health Psychol. 2022, 27, 534 ( https://doi.org/10.1177/1359105320962266).
* 411 D. Freeman et al., Psychol. Med. 2022, 52, 251 ( https://doi.org/10.1017/s0033291720001890).
* 412 J. K. Ward et al., Soc. Sci. Med. 2023, 328, 115952 ( https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.115952).
* 413 a) N. M. Brashier et al., Annu. Rev. Psychol. 2020, 71, 499 ( https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010419-050807) ; b) U. K. Ecker et al., Nat. Rev. Psychol. 2022, 1, 13 ( https://doi.org/10.1038/s44159-021-00006-y).
* 414 G. Pennycook et al., Trends Cogn. Sci. 2021, 25, 388 ( https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.02.007).
* 415 M. L. Stanley et al., Think. Reason. 2021, 27, 464 ( https://doi.org/10.1080/13546783.2020.1813806).
* 416 a) D. Graeupner et al., J. Exp. Soc. Psychol. 2017, 69, 218 ( https://doi.org/10.1016/j.jesp.2016.10.003) ; b) K.-T. Poon et al., Pers. Soc. Psychol. Bull. 2020, 46, 1234 ( https://doi.org/10.1177/0146167219898944).
* 417 M. B. Petersen et al., Am. Political Sci. Rev. 2023, 117, 1486 ( https://doi.org/10.1017/S0003055422001447).
* 418 a) S. M. Smith et al., Soc. Personal. Psychol. Compass 2008, 2, 464 ( https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2007.00060.x) ; b) W. Hart et al., Psychol. Bull. 2009, 135, 555 ( https://doi.org/10.1037%2Fa0015701).
* 419 M. Osmundsen et al., Am. Political Sci. Rev. 2021, 115, 999 ( https://doi.org/10.1017/S0003055421000290).
* 420 a) A. Acerbi, Palgrave Commun. 2019, 5, 15 ( https://doi.org/10.1057/s41599-019-0224-y) ; b) M. B. Tannenbaum et al., Psychol Bull. 2015, 141, 1178 ( https://doi.org/10.1037%2Fa0039729) ; c) W.-Y. S. Chou et al., Health Commun. 2020, 35, 1718 ( https://doi.org/10.1080/10410236.2020.1838096).
* 421 a) L. Cordonier et al., Comment les Français s'informent-ils sur Internet ? Analyse des comportements d'information et de désinformation en ligne, Étude de la Fondation Descartes, 2021 ( https://www.fondationdescartes.org/2021/03/comment-les-francais-sinforment-ils-sur-internet/) ; b) J. M. Miller et al., Am. J. Political Sci. 2016, 60, 824 ( https://doi.org/10.1111/ajps.12234).
* 422 Y. Algan et al., Confiance dans les scientifiques par temps de crise, Focus N° 068, 2021 ( https://www.cae-eco.fr/confiance-dans-les-scientifiques-par-temps-de-crise).
* 423 A. Adamecz et al., World Med. Health Policy 2023, 1 ( https://doi.org/10.1002/wmh3.568).
* 424 a) D. Zimand-Sheiner et al., Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 12894 ( https://doi.org/10.3390/ijerph182412894) ; b) W. Jennings et al., Vaccines 2021, 9, 593 ( https://doi.org/10.3390/vaccines9060593) ; c) C. J. McKinley et al., Vaccines 2023, 11, 1319 ( https://doi.org/10.3390/vaccines11081319).
* 425 J. K. Ward et al., La recherche sur les aspects humains et sociaux de la vaccination en France depuis le covid-19 - 1ère édition, 2024 ( https://shs-vaccination-france.com/la-recherche-sur-les-aspects-humains-et-sociaux-de-la-vaccination-en-france-depuis-le-covid-19-1ere-edition/).
* 426 Y. Tsfati, Ann. Int. Commun. Assoc. 2020, 44, 1 ( https://doi.org/10.1080/23808985.2020.1759443).
* 427 J. K. Ward et al., La recherche sur les aspects humains et sociaux de la vaccination en France depuis le covid-19 - 1ère édition, 2024 ( https://shs-vaccination-france.com/la-recherche-sur-les-aspects-humains-et-sociaux-de-la-vaccination-en-france-depuis-le-covid-19-1ere-edition/). Dans le cadre des vaccins contre la covid-19, plus de 50 % des Français estimaient à l'été 2022 que les experts ne semblaient pas d'accord sur cette thématique. Voir : J. E. Mueller et al., Bull. Epidémiol. Hebd. 2021, Cov_2, 2 ( http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/cov_2/2021_Cov_2_1.html).
* 428 Covars, Avis du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) du 9 février 2023 sur le futur des vaccins à ARNm dans l'anticipation et la gestion des crises sanitaires, 2023 ( https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2023-02/avis-du-covars-sur-le-futur-des-vaccins-arnm---13-f-vrier-2023-26444.pdf).
* 429 Think tank créé en 1983, les Ateliers de Giens visent à favoriser les échanges entre les milieux académique, institutionnel et industriel dans le domaine de la pharmacologie et de la recherche clinique. Voir : http://www.ateliersdegiens.org/
* 430 J. Micaleff et al., Therapies 2023, sous presse ( https://doi.org/10.1016/j.therap.2023.10.004). L'idée de cette plateforme est inspirée de la « foire aux questions » mise en place par la Société française de pharmacologie et de thérapeutique (SFPT) au cours de la crise sanitaire. Voir : L. Larrouquere et al., Fundam. Clin. Pharmacol. 2020, 34, 389 ( https://doi.org/10.1111/fcp.12564).
* 431 Pour ces individus, qui contribuent fortement à la production et la propagation de fausses informations, des interventions portant sur les causes de leur marginalisation doivent être menées.
* 432 a) N. Walter et al., Political Commun. 2020, 37, 35 ( https://doi.org/10.1080/10584609.2019.1668894) ; b) N. Walter et al., Health Commun. 2021, 36, 1776 ( https://doi.org/10.1080/10410236.2020.1794553).
* 433 R. Smith et al., Health Affairs 2023, 42, 1738 ( https://doi.org/10.1377/hlthaff.2023.00717).
* 434 À titre d'exemple, dans le cadre de l'épidémie de Zika au Brésil, la réfutation des fausses informations a eu pour conséquence d'augmenter les fausses croyances. Voir : J. M. Carey et al., Sci. Adv. 2020, 6, eaaw7449 ( https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw7449).
*
435 S. Lewandowsky et al., Eur. Rev.
Soc. Psychol. 2021, 32, 348 (
https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/10463283.2021.1876983).
Si
les interventions préventives ont montré être parfois plus
efficaces que les interventions correctives, cela n'est pas
systématique. Voir : a) D. Jolley et al., J.
Appl. Soc. Psychol. 2017, 47, 459 (
https://doi.org/10.1111/jasp.12453) ;
b) H. Bruns et al., OSF Preprints 2023 (
https://doi.org/10.31219/osf.io/vd5qt).
* 436 J. Roozenbeek et al., HKS Misinformation Review 2020, 3 ( https://doi.org/10.37016//mr-2020-008).
* 437 M. Basol et al., Big Data Soc. 2021, 8, 1, 205395172110138 ( https://doi.org/10.1177/20539517211013868).
* 438 Un tel outil d'écoute social a été mis en place par l'Organisation mondiale de la santé au cours de la crise sanitaire. Voir : T. D. Purnat et al., Stud. Health Technol. Inform. 2021, 281, 1009 ( https://doi.org/10.3233/shti210330).
* 439 Le nom Fides provient de la déesse de la confiance dans la mythologie romaine. Voir : https://www.who.int/teams/digital-health-and-innovation/digital-channels/fides
* 440 https://www.poynter.org/coronavirusfactsalliance/
* 441 M. Dutour et al., BMC Fam. Pract. 2021, 22, 36 ( https://doi.org/10.1186/s12875-021-01382-3).
* 442 À cet égard, on peut saluer l'élaboration par l'Organisation mondiale de la santé d'un manuel de communication à l'intention des autorités sanitaires et des praticiens afin d'améliorer la communication sur les vaccins covid-19. Voir : M. Juanchich et al., The COVID-19 Vaccine Communication Handbook. A practical guide for improving vaccine communication and fighting misinformation, 2021 ( https://sks.to/c19vax).
* 443 Dans cette perspective, les messages « DGS-Urgent » sont aujourd'hui relus par le Collège de médecine générale et les sociétés savantes concernées.
* 444 Y. Algan et al., « Confiance dans les scientifiques par temps de crise », Focus N° 068, 2021 ( https://www.cae-eco.fr/confiance-dans-les-scientifiques-par-temps-de-crise).
* 445 OECD, PISA 2022 Results (Volume I). The State of Learning and Equity in Education, 2023 ( https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2022-results-volume-i_53f23881-en).
* 446 Avis présenté par M. Philippe Berta au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur le projet de loi de finances pour 2023 (n° 374) - Recherche et enseignement supérieur : Recherche ( https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-cedu/l16b0374-tv_rapport-avis#).
* 447 a) A. M. Guess et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2020, 117, 15536 ( https://doi.org/10.1073/pnas.1920498117) ; b) P. C. Abrami et al., Rev. Educ. Res. 2015, 85, 275 ( https://doi.org/10.3102/0034654314551063).
* 448 Communication de M. Philippe Ballard et Mme Violette Spillebout, rapporteurs d'une mission « flash » sur l'éducation critique aux médias ( https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/organes/commissions-permanentes/affaires-culturelles/missions-de-la-commission/mi-education-medias).
* 449 A. Guess et al., Sci. Adv. 2019, 5, eaau4586 ( https://doi.org/10.1126/sciadv.aau4586).
* 450 E. Hoes et al., PsyArXiv 2023 ( https://doi.org/10.31234/osf.io/zmpdu).
*
451 a) G. Pennycook et al.,
Psychol. Sci. 2020, 31, 770 (
https://doi.org/10.1177/0956797620939054) ;
b) G. Pennycook et al., Nature 2021, 592, 590 (
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03344-2) ;
c) G Pennycook et al., Ann. Am. Acad. Pol. Soc.
Sci. 2022, 700, 152 (
https://doi.org/10.1177/00027162221092342) ;
d) A. A. Arechar et al., Nat. Hum. Behav. 2023, 7, 1502
(
https://doi.org/10.1038/s41562-023-01641-6).
Toutefois,
ces interventions n'étant pas spécifiques, elles sont
également susceptibles d'affecter les informations fiables.
* 452 a) A. M. Guess et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2020, 117, 15536 ( https://doi.org/10.1073/pnas.1920498117) ; b) Z. Epstein et al., HKS Misinformation Review 2021 ( https://doi.org/10.37016/mr-2020-71).
* 453 Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.277.01.0001.01.FRA&toc=OJ%3AL%3A2022%3A277%3ATOC).
* 454 En France, ce statut sera fourni par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).
* 455 A. Acerbi et al., HKS Misinformation Review 2022 ( https://doi.org/10.37016/mr-2020-87).
* 456 Évidemment, cela n'implique pas d'éclipser les potentiels dissensus scientifiques, qui doivent au contraire être explicités et expliqués.
* 457 ORS PACA, Enquête SLAVACO Vague 5 : Qui a (encore) peur de la covid-19 et jugements sur l'action des pouvoirs publics durant l'épidémie, 2022 ( http://www.orspaca.org/sites/default/files/note-slavaco-n5.pdf).
* 458 N. Calleja et al., JMIR Infodemiology 2021, 1, e30979 ( https://doi.org/10.2196/30979).