II. UNE RÉFORME ENGAGÉE MAIS QUI EST LOIN D'ÊTRE ACHEVÉE
Lorsque
votre rapporteur a commencé sa mission, le conseil d'administration de
l'Office, encouragé par le secrétariat d'Etat aux anciens
combattants, avait chargé son directeur général, de mettre
en oeuvre une réforme du service central et des établissements
afin de doter l'ONAC d'une gestion moderne et efficace.
Votre rapporteur a pu constater les progrès réalisés en
un an. Ainsi, des décisions courageuses ont été prises en
ce qui concerne les maisons de retraite tandis que la prise en charge par les
écoles de rééducation professionnelle de la
réinsertion des militaires de carrière justifie leur maintien
dans le champ de compétence de l'ONAC.
Toutefois, la réforme de l'Office est loin d'achevée.
A. LES ACTIONS DÉJÀ RÉALISÉES
A la fin
de l'année 1997, le conseil d'administration de l'ONAC a demandé
au directeur général d'engager une réforme de l'Office
afin de sortir de la crise financière dans laquelle il était
plongé depuis 1994 et d'améliorer la gestion de
l'établissement public.
Trois axes d'action ont alors été dégagés qui
visaient l'organisation générale, les maisons de retraite et les
écoles de rééducation professionnelle.
1. L'organisation générale
Plusieurs mesures ont d'abord été prises pour
rétablir l'équilibre budgétaire.
D'une part, des économies ont été recherchées en
matière de fonctionnement courant. Ainsi, en ce qui concerne les locaux
des services de proximité, un bilan a été dressé de
la situation de chaque service et des possibilités de relogement
à des conditions plus avantageuses.
D'autre part, l'Office national des anciens combattants a entrepris certaines
réformes visant à moderniser sa gestion.
Ainsi, un budget par " pôle de responsabilité " a
été mis en place en 1997, distinguant le service central, les
services départementaux et les établissements pour gérer
les engagements et les délégations de crédits et, en
conséquence, améliorer la transparence du budget de l'Office.
Par ailleurs, un poste de contrôleur de gestion a été
créé afin de procéder à une analyse des coûts
de chaque " pôle de responsabilité ", de définir
des indicateurs de gestion et de procéder au suivi des dépenses.
En outre, un effort de formation a été entrepris en direction des
directeurs des maisons de retraite et des écoles de
rééducation professionnelle.
Enfin, l'ONAC a lancé une politique de promotion de l'oeuvre nationale
du Bleuet de France. Cette institution regroupe les activités de
l'association du Bleuet de France et du Comité du souvenir et des
manifestations nationales. Le Bleuet trouve ses origines dans la guerre de
1914-1918. Il était fabriqué par les mutilés de guerre. Le
produit de sa vente permettait de financer des actions sociales en faveur des
anciens combattants.
Aujourd'hui, les recettes du Bleuet sont les produits des collectes et des
ventes organisées le 11 novembre et le 8 mai. Toutefois,
l'éloignement des conflits et l'urbanisation ont conduit à un
plafonnement des recettes autour de 6,5 millions de francs. Or, compte
tenu du contexte économique et social, les besoins en crédits
d'action sociale pour les anciens combattants croissent. C'est la raison pour
laquelle l'ONAC a pris des initiatives afin de renforcer la
notoriété de l'oeuvre nationale du Bleuet.
Ainsi, les plus hautes autorités de l'Etat ont été
sensibilisées et ont décidé de montrer l'exemple en
arborant le Bleuet à la boutonnière dans les
cérémonies officielles chaque 8 mai et 11 novembre.
Par ailleurs, cette oeuvre nationale a été autorisée par
décret à percevoir les produits de la vente de publications
consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs
civiques et morales attachées au Bleuet de France, ainsi que ceux
résultant de la commercialisation de produits portant la marque du
Bleuet de France.
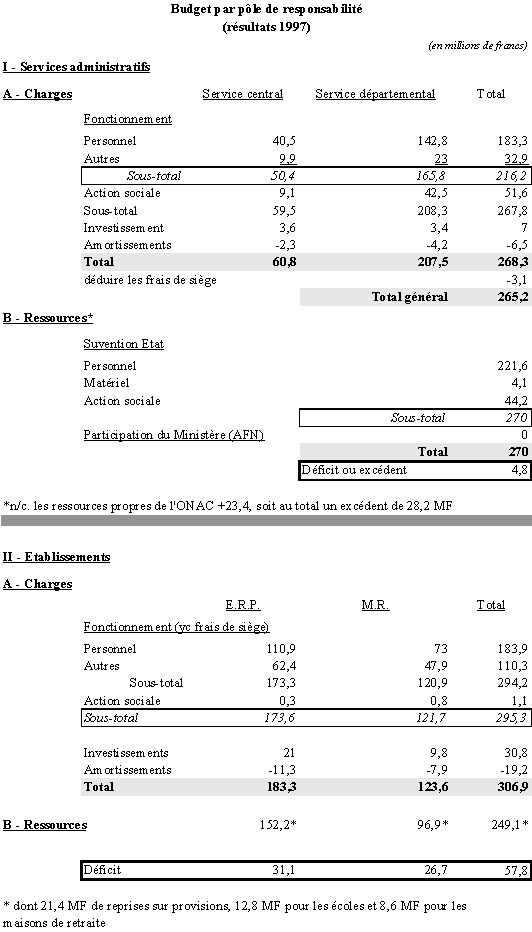
2. Les maisons de retraite
Les
causes du déficit structurel des maisons de retraite
gérées par l'Office national des anciens combattants sont
connues depuis longtemps. Le rapport du centre international de recherche et
d'études de la vie sociale de 1993, la note de la Cour des comptes de
1994, la note d'étude du contrôle général des
armées de 1997 portent tous sur la gestion des maisons de retraite et
les causes de leur déficit.
Deux obstacles empêchent une gestion équilibrée des maisons
de retraite :
- les prix de journée ne couvrent pas les coûts de
fonctionnement ;
- les retards accumulés en matière d'investissement sont tels
qu'ils ne peuvent plus être comblés aujourd'hui :
360 millions de francs seraient nécessaires pour rénover
entièrement le parc des maisons de retraite de l'ONAC.
Toute stratégie visant le retour à l'équilibre financier
doit donc intégrer ces contraintes.
En conséquence, l'ONAC doit non seulement parvenir à une
gestion équilibrée de ses maisons de retraite en
bénéficiant des dispositifs de droit commun (aide sociale
départementale, forfaits soins de l'assurance maladie), mais
également dresser un état des lieux de son parc et concentrer ses
efforts sur les établissements les mieux placés
.
Ce constat n'est pas récent. Ainsi, lorsque les crédits visant
à financer des travaux de rénovation dans les maisons de retraite
avaient fait l'objet d'un arbitrage, il avait été
décidé que 20 millions de francs seraient
débloqués pour le budget 1996. En contrepartie, l'ONAC devait
s'engager à restructurer son parc. Or, aucune mesure n'a
été prise dans ce sens jusqu'à l'adoption de la loi
instituant la prestation spécifique dépendance. L'ONAC se
contentait de rechercher des financements de droit commun sans qu'aucune
réflexion officielle ne soit lancée sur l'avenir du parc des
maisons de retraite.
Avec la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, les maisons de retraite de
l'Office sont contraintes de s'intégrer dans les dispositifs de droit
commun et de signer les conventions tripartites prévues si elles veulent
continuer à héberger des personnes âgées
dépendantes. En outre, grâce à ces conventions, elles
n'auront plus à prendre en charge le coût de la
médicalisation et de la dépendance ainsi que l'aide sociale pour
les plus démunis.
Toutefois, pour satisfaire aux obligations réglementaires et aux
conditions nécessaires pour passer convention avec les conseils
généraux et l'autorité assurant le financement de la
médicalisation, un énorme effort d'investissement est
indispensable, qui dépasse les moyens financiers de l'Office national
des anciens combattants.
Celui-ci a donc dû se résoudre
à dresser un état des lieux sur son patrimoine immobilier et
à envisager la fermeture de certains établissements trop
vétustes
.
Une première fermeture a eu lieu en 1998 et concernait la maison de
retraite de la Pomme à Marseille. Toutefois, la rencontre de votre
rapporteur avec la responsable des maisons de retraite à l'ONAC en
octobre 1998 avait laissé penser qu'il s'agissait d'une exception.
Aucune autre fermeture n'avait alors été évoquée.
Aussi a-t-il été étonné lorsque, prévoyant
de visiter la maison de retraite de Montpellier en mars 1999, il a appris que
cette dernière était fermée. Lors de sa dernière
visite à l'administration centrale de l'Office en septembre 1999, il lui
a été fait part de trois nouvelles fermetures : Villiers le
Sec, Ville Lebrun et Bouleville.
Ces décisions soudaines de fermeture sont la résultante de
plusieurs facteurs .
D'une part, certaines commissions départementales de
sécurité avaient notifié un avis défavorable
à la poursuite de l'exploitation.
D'autre part, un rapport avait
été remis au secrétaire d'Etat aux anciens combattants le
30 mars 1999 sur la situation des maisons de retraite. Pour chaque
établissement, un examen précis de son état était
présenté et une solution suggérée.
Votre rapporteur ne peut que se féliciter de cette prise de
conscience par l'Office de l'urgence d'entreprendre une réflexion
d'ensemble sur son parc de maisons de retraite.
En effet, comme le rappelle la Cour des comptes dans sa monographie sur le
budget des anciens combattants
10(
*
)
,
" la nature
immobilière de certains établissements ne permet pas le
développement de la médicalisation pour les personnes
âgées de plus en plus dépendantes ".
En
cédant ces bâtiments, l'Office pourrait affecter les ressources
ainsi dégagées à la réalisation d'investissements
dans les maisons de retraite viables.
3. Les écoles de rééducation professionnelle
Comme
votre rapporteur l'a montré précédemment, les
écoles de rééducation ne sont pas en déficit, mais
la réglementation comptable à laquelle est soumis l'Office en
tant qu'établissement public, la " M-9 ", qui impose
l'annualité budgétaire, ne permet pas d'appréhender leur
situation financière.
En conséquence, sauf à faire adopter aux écoles la
réglementation comptable à laquelle sont soumis les
établissements hospitaliers et médico-sociaux (la
" M-21 "), peu de réformes sont envisageables pour
éviter que la situation financière des écoles de
rééducation professionnelle doive être
étudiée sur trois ans.
L'Office national des anciens combattants a pris une mesure qui redonne toute
sa légitimité aux écoles de rééducation
professionnelle :
le 28 mars 1996, une convention cadre
était signée avec le ministère de la défense pour
une durée de cinq ans, permettant l'accueil des personnels de ce
ministère dans les écoles de rééducation
professionnelle
.
Ces derniers bénéficient d'une prise en charge financière
par le ministère de la défense, en matière de reconversion
professionnelle, dont la durée ne peut excéder un an.
Chaque école a dû adapter son offre de formation à ce
nouveau public. Ainsi, les équipes pédagogiques ont dû
s'engager à présenter les stagiaires à un examen de
l'Education nationale au bout d'un an au lieu de deux ans.
Sur la base des propositions faite par chaque école, une convention
entre l'ONAC et le ministère de la défense a été
signée le 14 janvier 1999.
L'objectif est d'accueillir 50 militaires
la première année.
Votre rapporteur salue cette entreprise qui devrait diminuer la
dépendance financière des écoles de
rééducation professionnelle vis-à-vis des DDASS et
renforcer leurs liens avec le monde combattant
. Il rappelle toutefois que
cette opération ne réussira que si les écoles arrivent
à développer des relations fortes avec les services du
ministère de la défense chargés de la reconversion des
militaires. Un travail important de promotion des écoles doit donc
être engagé alors même que le secteur de la
réinsertion professionnelle est soumis à une très forte
concurrence.
L'Office national des anciens combattants s'efforce également de
trouver des financements complémentaires pour l'école de
rééducation professionnelle de Béziers
.
L'école de Béziers ne bénéficie pas
d'agrément du ministère du travail et des affaires sociales pour
organiser la rééducation professionnelle des travailleurs
handicapés. C'est la raison pour laquelle cette école s'est
spécialisée dans la formation des enfants de Français
musulmans rapatriés d'une part et du personnel de l'Office d'autre part.
Elle a également diversifié son public en offrant des formations
ponctuelles au niveau local. Toutefois, la gestion de cet établissement
est devenue déficitaire (5,3 millions de francs de déficit
ont été constatés en 1998) car les sommes versées
par la délégation aux rapatriés, pour financer la
formation des enfants de Français musulmans, ne permet pas de couvrir
l'ensemble des charges de fonctionnement de l'école.
En outre, cette dépendance financière vis-à-vis de la
délégation aux rapatriés n'est pas sans
inconvénient. En effet, le nombre d'enfants de Français musulmans
rapatriés demandant une formation tend à diminuer. Ainsi, pour
l'année scolaire 1999/2000, alors qu'il existe 53 agréments,
l'école de Béziers n'a pu rassembler que 40 stagiaires.
Par ailleurs, si la convention entre l'ONAC et la délégation aux
rapatriés a été reconduite cette année pour une
formation de septembre 1999 à juin 2000 et pour une formation
qualifiante de septembre à décembre 2000, aucune convention n'est
prévue pour l'année 2001. Si d'autres sources de financement ne
sont pas trouvées, l'école sera menacée de fermeture.
L'établissement a demandé l'agrément pour accueillir 49
stagiaires handicapés dans des formations diplômantes ou
qualifiantes auprès du préfet de région. Les instances
chargées de l'instruction du dossier ont émis un avis favorable,
mais faute de crédits suffisants, la direction régionale des
affaires sanitaires et sociales refuse de donner son accord.
4. Des réformes qui s'intègrent dans la charte " un nouvel élan " pour l'ONAC
Comme
votre rapporteur l'a déjà rappelé, dès sa
nomination en tant que secrétaire d'Etat chargé des anciens
combattants, M. Jean-Pierre Masseret, a engagé, en collaboration
avec les plus grandes associations d'anciens combattants, une réflexion
sur l'avenir de son département ministériel et sa
nécessaire restructuration.
Parallèlement, l'Office national des anciens combattants s'est
engagé dans une analyse prospective sur le devenir de cet
établissement public dans un contexte en pleine évolution. Cette
réflexion a conduit à l'élaboration d'une charte
intitulée " un nouvel élan ", qui a pour ambition de
garantir le rôle central de l'Office au service du monde combattant.
Un nouvel élan pour l'ONAC
L'Office
national des anciens combattants et victimes de guerre est un
établissement public de l'Etat doté de la personnalité
civile et de l'autonomie financière.
Il est le résultat de la fusion de trois établissements
publics : l'Office national des pupilles de la nation, l'Office national
des mutilés et l'Office national du combattant.
L'Office national des anciens combattants est, depuis l'origine, le grand
service social du monde combattant. En associant, de manière paritaire,
l'administration et les organisations représentatives des anciens
combattants et victimes de guerre, il participe à la mise en oeuvre du
droit à réparation, il développe le devoir de
solidarité et le devoir de mémoire.
L'ONAC exprime la spécificité du monde combattant, son maintien
modernisé est une nécessité dans la France d'aujourd'hui
alors que les anciens combattants et victimes de guerre représentent
encore, avec l'arrivée de nouvelles catégories (opérations
en territoire étranger, victimes d'attentats terroristes) plusieurs
millions de ressortissants.
En cette fin de XXème siècle, l'ONAC inscrit son action dans un
contexte en pleine mutation.
La société, dont la majorité des classes d'âge est
née après la fin de la seconde guerre mondiale, paraît
moins sensible aux valeurs du monde combattant.
L'Etat et les collectivités publiques, qui font face à une forte
demande de solidarité, sont tentés par des solutions
globalisantes qui risquent de marginaliser l'imprescriptible droit à
réparation.
Pourtant, devant ces mutations, l'ONAC dispose d'une série d'atouts et
de moyens :
- un réseau de services de proximité adaptés au
terrain assuré par des fonctionnaires compétents ;
- un mode de gestion paritaire qui donne au monde combattant sa juste
place dans la gestion des dossiers qui le concerne ;
- une approche personnalisée du monde combattant s'accompagnant
d'un traitement particulier en faveur des ressortissants les plus
défavorisés ;
- une série d'établissements : maisons de retraite et
écoles de rééducation professionnelles qui doivent
être des outils dans une politique nouvelle ;
- un important réseau relationnel avec les préfectures, les
services de l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes
sociaux et les associations.
Ce sont ces atouts et ces moyens qui permettront à l'ONAC de faire face
aux mutations du temps présent.
L'ONAC développera trois ensembles essentiels d'activité.
Il sera, à l'échelon départemental, la structure
d'accueil, d'écoute, de conseil et de rencontre pour l'ensemble des
ressortissants du monde combattant.
Les services départementaux seront le lieu où chaque
ressortissant sera accueilli, consulté, orienté et aidé
dans ses demandes et démarches les plus diverses à
finalité sociale, administrative, économique et culturelle.
Ils instruiront les demandes relatives à la reconnaissance des droits
des anciens combattants et victimes de guerre. Les structures de gestion
paritaire de ces droits seront remodelées et renforcées.
Un paritarisme accru assurera l'ensemble des actions de solidarité
destinées aux ressortissants (prêts, secours...).
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sera
également l'instrument qui permettra d'apporter un soutien actif aux
ressortissants les plus âgés.
Les services départementaux oeuvreront, en liaison avec les services de
l'Etat et des collectivités territoriales, pour favoriser le maintien
à domicile des ressortissants concernés.
L'Etablissement public conservera la gestion d'un réseau de lits en
maisons de retraite pour ses ressortissants. Ces lits, dont le nombre devra
progressivement croître, seront répartis, soit dans des maisons
appartenant à l'ONAC, soit dans d'autres maisons dans lesquelles
l'Etablissement public aura par convention acquis la réservation
prioritaire d'une série de lits.
L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sera le socle
sur lequel se construiront et se diffuseront les activités de
mémoire des guerres et conflits contemporains dans les
départements.
Le service chargé, au niveau national, de la mémoire,
décidera de cette politique et les services départementaux seront
l'instrument de sa mise en oeuvre locale.
La gestion paritaire de la politique de mémoire qui s'exprime au sein
des commissions départementales pour l'information historique et pour la
paix sera renforcée dans un sens qui favorisera l'adhésion et la
participation, autour du monde combattant, des divers acteurs de la
mémoire (enseignants, animateurs de musées, responsables
d'associations culturelles...).
Les services départementaux interviendront, en étroite liaison
avec les services compétents du ministère de la défense,
pour affirmer et renforcer le lien entre l'armée et la nation.
Le lien entre l'armée et la nation est également à la base
d'une ouverture des écoles de rééducation professionnelle
aux militaires en voie de reclassement professionnel. Ces écoles
continueront à être gérées par l'ONAC.







