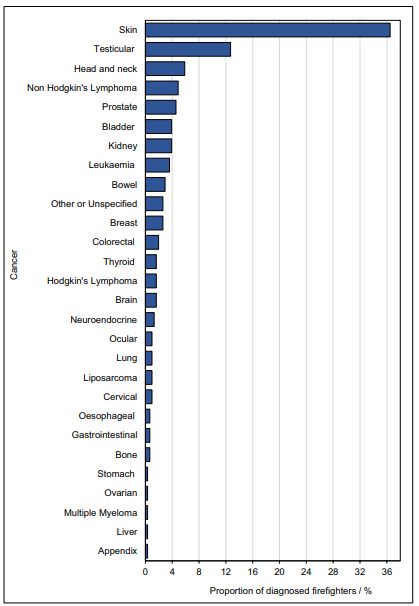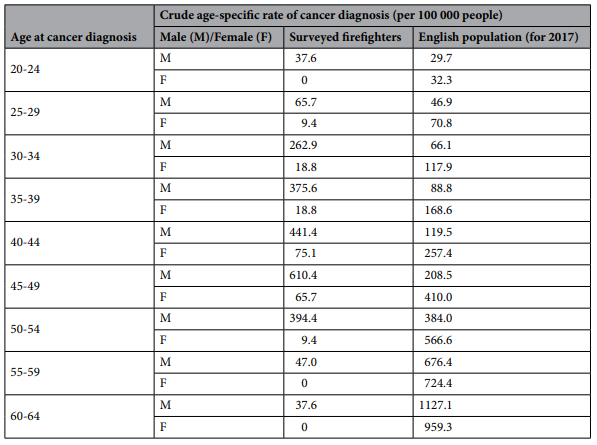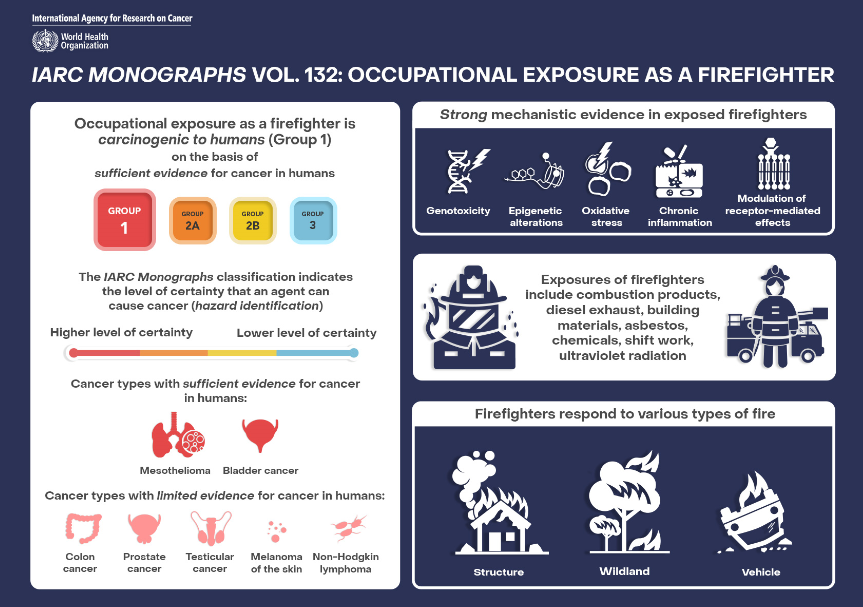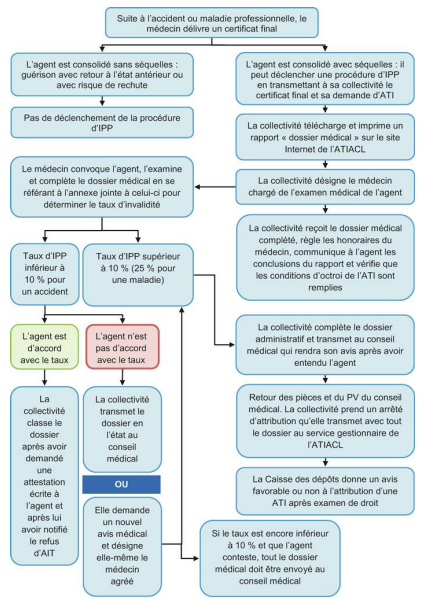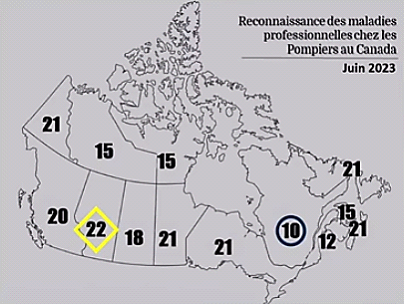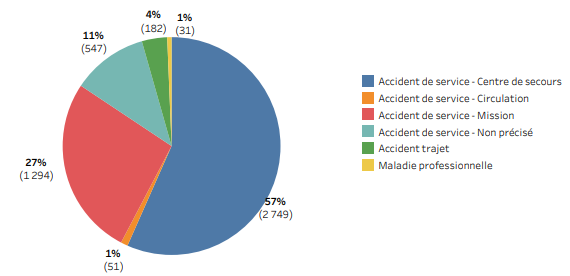- L'ESSENTIEL
- I. LES SAPEURS-POMPIERS ATTEINTS D'UN CANCER
IMPUTABLE AU SERVICE SONT ÉLIGIBLES À DES DISPOSITIFS DE
RÉPARATION
- II. PROTÉGER LES SOLDATS DU FEU : UNE
PRIORITÉ NATIONALE
- I. LES SAPEURS-POMPIERS ATTEINTS D'UN CANCER
IMPUTABLE AU SERVICE SONT ÉLIGIBLES À DES DISPOSITIFS DE
RÉPARATION
- LISTE DES PROPOSITIONS
- LISTE DES SIGLES
- I. LES SAPEURS-POMPIERS, DONT L'ACTIVITÉ EST
CANCÉROGÈNE, BÉNÉFICIENT DE DISPOSITIFS
LIMITÉS DE PRÉVENTION ET D'INDEMNISATION DES MALADIES IMPUTABLES
AU SERVICE
- A. EN DÉPIT DU MANQUE DE DONNÉES
OFFICIELLES, L'ACTIVITÉ DE SAPEUR-POMPIER EST DÉSORMAIS
RECONNUE COMME CANCÉROGÈNE POUR L'HOMME À L'ÉCHELLE
INTERNATIONALE
- B. DES EFFORTS ONT ÉTÉ ACCOMPLIS EN
MATIÈRE DE SIMPLIFICATION DE LA RECONNAISSANCE DES MALADIES
PROFESSIONNELLES ET DE PRÉVENTION DES RISQUES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
EN GÉNÉRAL
- 1. La reconnaissance de l'origine professionnelle
d'un cancer ouvre droit à plusieurs dispositifs de compensation et
d'indemnisation
- a) Le législateur a institué une
présomption d'imputabilité au service pour les maladies
déclarées par les fonctionnaires et figurant aux tableaux des
maladies professionnelles
- b) Des dispositifs spécifiques sont
prévus en cas d'incapacité temporaire et d'incapacité
permanente résultant d'une maladie imputable au service
- a) Le législateur a institué une
présomption d'imputabilité au service pour les maladies
déclarées par les fonctionnaires et figurant aux tableaux des
maladies professionnelles
- 2. La prévention des risques fait l'objet
d'une attention particulière, qui s'est renforcée au cours des
20 dernières années
- a) La médecine professionnelle, le
contrôle de l'aptitude et le suivi post-professionnel des
sapeurs-pompiers participe de l'effort de prévention du
développement de maladies professionnelles
- b) Les pouvoirs publics semblent avoir pleinement
pris en compte l'enjeu de prévention des risques chez les
sapeurs-pompiers
- a) La médecine professionnelle, le
contrôle de l'aptitude et le suivi post-professionnel des
sapeurs-pompiers participe de l'effort de prévention du
développement de maladies professionnelles
- 1. La reconnaissance de l'origine professionnelle
d'un cancer ouvre droit à plusieurs dispositifs de compensation et
d'indemnisation
- A. EN DÉPIT DU MANQUE DE DONNÉES
OFFICIELLES, L'ACTIVITÉ DE SAPEUR-POMPIER EST DÉSORMAIS
RECONNUE COMME CANCÉROGÈNE POUR L'HOMME À L'ÉCHELLE
INTERNATIONALE
- II. IL EST AUJOURD'HUI NÉCESSAIRE DE LEVER
LES FREINS À LA MISE EN oeUVRE D'UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE
PROTECTION DE LA SANTÉ DES SAPEURS-POMPIERS
- A. LE MANQUE DE VOLONTÉ POLITIQUE, LA
COMPLEXITÉ DES PROCÉDURES ET L'INSUFFISANCE DES MOYENS FONT
OBSTACLE À LA RÉALISATION DE PROGRÈS CONCRETS
- 1. Une réglementation limitative et des
pratiques inadaptées aux enjeux font obstacle à une juste
indemnisation des conséquences sanitaires de l'exercice des
fonctions de sapeur-pompier
- 2. Les moyens consacrés à la
protection de la santé des sapeurs-pompiers sont encore
insuffisants
- a) Des lacunes majeures fragilisent le suivi de
l'exposition des sapeurs-pompiers aux facteurs de risques
cancérogènes
- b) Le développement d'équipements de
protection individuelle adaptés aux risques se fait toujours
attendre
- c) La collecte et l'analyse de données
épidémiologiques pourrait retarder l'action gouvernementale en
faveur des sapeurs-pompiers
- a) Des lacunes majeures fragilisent le suivi de
l'exposition des sapeurs-pompiers aux facteurs de risques
cancérogènes
- 1. Une réglementation limitative et des
pratiques inadaptées aux enjeux font obstacle à une juste
indemnisation des conséquences sanitaires de l'exercice des
fonctions de sapeur-pompier
- B. MIEUX PROTÉGER CEUX QUI NOUS
PROTÈGENT : UN ENJEU DE SOLIDARITÉ NATIONALE ET DE
SANTÉ PUBLIQUE
- 1. La procédure de reconnaissance de
l'imputabilité au service des cancers des sapeurs-pompiers doit
être simplifiée et les expositions mieux
tracées
- a) L'élargissement de la présomption
d'imputabilité au service aux types de cancer dont le lien avec
l'activité de sapeur-pompier est établi
est particulièrement urgent
- b) Dans le même temps, le renforcement de la
traçabilité de l'exposition à des facteurs de risque
consoliderait les dossiers de demande de reconnaissance en maladie
professionnelle
- a) L'élargissement de la présomption
d'imputabilité au service aux types de cancer dont le lien avec
l'activité de sapeur-pompier est établi
est particulièrement urgent
- 2. En amont, l'effort de prévention des
risques doit mobiliser tous les moyens disponibles
- 1. La procédure de reconnaissance de
l'imputabilité au service des cancers des sapeurs-pompiers doit
être simplifiée et les expositions mieux
tracées
- A. LE MANQUE DE VOLONTÉ POLITIQUE, LA
COMPLEXITÉ DES PROCÉDURES ET L'INSUFFISANCE DES MOYENS FONT
OBSTACLE À LA RÉALISATION DE PROGRÈS CONCRETS
- I. LES SAPEURS-POMPIERS, DONT L'ACTIVITÉ EST
CANCÉROGÈNE, BÉNÉFICIENT DE DISPOSITIFS
LIMITÉS DE PRÉVENTION ET D'INDEMNISATION DES MALADIES IMPUTABLES
AU SERVICE
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- · TABLEAU DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
DES RECOMMANDATIONS
N° 641
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024
Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 mai 2024
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des affaires sociales (1) sur
les cancers imputables
à
l'activité de
sapeur-pompier,
Par Mmes Anne-Marie NÉDÉLEC et Émilienne POUMIROL,
Sénatrices
(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Xavier Iacovelli, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, M. Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, Monique Lubin, Brigitte Micouleau, M. Alain Milon, Mmes Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, M. François Patriat, Mmes Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris, MM. Dominique Théophile, Jean-Marie Vanlerenberghe.
L'ESSENTIEL
En 2022, l'activité de sapeur-pompier a été reconnue cancérogène pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer. Il appartient désormais aux pouvoirs publics de mobiliser les moyens nécessaires au renforcement de la prévention des risques liés à la lutte contre l'incendie et du traçage des expositions ainsi que de favoriser la reconnaissance des cancers en maladie professionnelle chez les soldats du feu.
I. LES SAPEURS-POMPIERS ATTEINTS D'UN CANCER IMPUTABLE AU SERVICE SONT ÉLIGIBLES À DES DISPOSITIFS DE RÉPARATION
A. LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES EXPOSE LES SAPEURS-POMPIERS À DES AGENTS CANCÉROGÈNES
1. Malgré le manque de données épidémiologique, le risque de développer un cancer paraît plus élevé chez les sapeurs-pompiers que dans la population générale
Au cours des dernières décennies, la question de la cancérogénicité de l'activité de sapeur-pompier a fait l'objet d'un nombre très limité d'études scientifiques en France.
Leurs résultats contrastés ne donnent pas une vision fiable de la dangerosité de cette activité, qui ne se limite pas au risque de développer un cancer. Elles concluent en effet à une mortalité globale inférieure chez les sapeurs-pompiers par rapport à la population générale, ce qui pourrait s'expliquer par la meilleure forme physique des soldats du feu.
Néanmoins, leur taux de mortalité par cancer y apparaît plus élevé pour plusieurs types de maladies, tandis qu'une étude britannique de 2023 a constaté une prévalence des cancers chez les pompiers âgés de 35 à 39 ans supérieure de 323 % à celle de la population générale.
2. La cancérogénicité de l'activité de sapeur-pompier a récemment été reconnue à l'échelle internationale
Les sapeurs-pompiers sont exposés à plusieurs types de produits de combustion reconnus cancérogènes par le Centre international de recherche sur le cancer (Circ). Par exemple, des retardateurs de flamme, composés chimiques visant à limiter l'inflammabilité des produits du quotidien, ont été retrouvés chez tous les sapeurs-pompiers ayant participé à des analyses biologiques organisées pour l'émission « Vert de Rage », parfois à des niveaux très élevés.
En 2022, sur la base de preuves suffisantes pour le mésothéliome et le cancer de la vessie (avec un niveau de risque supérieur, respectivement, de 58 % et de 16 % à celui de la population générale) et de preuves limitées pour les cancers du côlon, de la prostate et des testicules, le mélanome et le lymphome non hodgkinien, le Circ a classé l'activité de sapeur-pompier comme « cancérogène pour l'homme ».
B. LES CONSÉQUENCES SANITAIRES DE L'ACTIVITÉ DE SAPEUR-POMPIER FONT L'OBJET DE MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉPARATION
1. La prévention des risques liés à l'activité de sapeur-pompier s'est consolidée
En parallèle, un certain nombre de dispositifs sont mis en oeuvre en faveur de la prévention des risques. En matière de suivi médical, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient :
• de l'intervention des services de médecine préventive ;
• d'une visite d'aptitude annuelle ou bisannuelle auprès d'un médecin sapeur-pompier, incluant notamment un contrôle radiologique pulmonaire ;
• et, depuis 2015, lorsqu'ils ont été exposés, entre autres, à une substance cancérogène, d'un suivi médical post-professionnel.
La CNRACL, en particulier, est pleinement mobilisée, notamment au travers de son fonds national de prévention (FNP), qui met à la disposition des employeurs publics locaux le logiciel Prorisq, dédié au suivi de la sinistralité, ainsi que de la documentation sur les risques professionnels et participe au financement de projets et d'études épidémiologiques.
2. En cas d'imputabilité d'une pathologie au service, une indemnisation peut être accordée aux agents publics
Depuis 2017, les fonctionnaires bénéficient d'une présomption d'imputabilité au service pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions mentionnées dans ces tableaux. Si une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies ou si la maladie n'est pas désignée dans les tableaux, l'imputabilité au service peut également être reconnue sous conditions.
Conditions de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie
|
La maladie figure dans un tableau de maladies professionnelles |
La maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles |
|
|
Les conditions prévues par le tableau
de maladies professionnelles |
La maladie est présumée imputable au service |
La maladie peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire établit qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 % |
|
Les conditions prévues par le tableau
de maladies professionnelles |
La maladie peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire établit qu'elle est directement causée par l'exercice de ses fonctions |
Source : Article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, article 37-8
La reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie ouvre droit au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis), avec maintien du traitement, ainsi qu'au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés par cette maladie. Un agent justifiant d'une incapacité permanente partielle après avoir repris ses fonctions peut obtenir une allocation temporaire d'invalidité (ATI) cumulable avec son traitement.
II. PROTÉGER LES SOLDATS DU FEU : UNE PRIORITÉ NATIONALE
A. L'EFFORT DE PRÉVENTION ET DE RÉPARATION DES CANCERS IMPUTABLES À L'ACTIVITÉ DE SAPEUR-POMPIER EST ENCORE TROP LIMITÉ
1. La présomption d'imputabilité au service ne concernant que trop peu de cancers, ceux-ci font vraisemblablement l'objet d'une sous-déclaration
Seuls deux cancers sont aujourd'hui présumés imputables à l'activité de sapeur-pompier en France. Ce nombre est sensiblement supérieur dans d'autres pays développés, par exemple au Canada, où il varie de 9 au Québec à 19 en Ontario.
Types de cancer pouvant être reconnus
imputables au service
chez les sapeurs-pompiers
|
Désignation des maladies |
Délai de |
Liste des travaux susceptibles |
|
Carcinome du nasopharynx |
40 ans (sous réserve d'une exposition de 5 ans) |
Travaux d'extinction des incendies |
|
Carcinome hépato-cellulaire |
30 ans |
Services de secours et de sécurité : pompiers, secouristes, sauveteurs, ambulanciers, policiers, personnel pénitentiaire |
Source : Annexe II au code de la sécurité sociale : tableaux n° 30, 43 bis et 45
En 10 ans, la CNRACL n'a enregistré au total que 21 dossiers de demande d'ATI concernant des cancers professionnels, dont aucun n'émanait d'un sapeur-pompier, tandis que seules 31 maladies professionnelles ont été recensées chez des sapeurs-pompiers en 2022.
Ces chiffres extrêmement faibles prêtent à croire à une sous-déclaration d'ampleur, qui pourrait s'expliquer par la difficulté à obtenir des preuves de l'exposition de l'agent, l'absence de prise en compte de la polyexposition, des biais en défaveur des travailleurs au sein des conseils médicaux ou la complexité de la procédure de demande de l'ATI.
1. L'insuffisance des politiques publiques menées en matière de prévention est évidente
Les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) se gérant de façon autonome, l'effort de prévention des risques n'est pas coordonné à l'échelle nationale.
Ainsi, si certains départements tracent les expositions à des facteurs de risques, le remplissage de fiches d'exposition n'est ni systématique, ni généralisé.
Aucun modèle national de fiche d'exposition à des facteurs de risques n'est mis à la disposition des Sdis à ce jour
Le contrôle de l'aptitude pâtirait quant à lui de la désertification médicale et d'un manque de moyens, tandis que le suivi post-professionnel, qui ne concerne pas les volontaires, serait très limité.
Au surplus, bien qu'il soit démontré que l'efficacité de filtration de la cagoule utilisée lors des feux de forêts est nulle et qu'un nouveau modèle assurant un niveau de filtration de 70 % ait été élaboré, ce dernier est encore en cours de certification et devrait se révéler très onéreux.
Enfin, les rapporteures se réjouissent que le Gouvernement ait conclu un partenariat sur une thèse visant à documenter et évaluer les effets sur la santé de l'activité de sapeur-pompier et lancé l'élaboration d'une matrice tâches-exposition, mais craignent que ces initiatives ne retardent la mise en oeuvre d'actions concrètes en faveur de la santé des sapeurs-pompiers.
B. DIX MESURES D'URGENCE POUR PROTÉGER LES SAPEURS-POMPIERS
1. Favoriser la reconnaissance des cancers imputables à l'activité de sapeur-pompier
Dans l'optique de renforcer la lisibilité des tableaux de maladies professionnelles et de simplifier la procédure de reconnaissance, les rapporteures invitent le Gouvernement à consulter au plus vite les partenaires sociaux au sujet de la création d'un tableau dédié aux pathologies liées à la lutte contre l'incendie intégrant les 7 types de cancer dont le lien avec l'activité de sapeur-pompier a été établi par le Circ et à systématiser l'évaluation des droits à l'ATI des agents des collectivités locales (ATIACL) au terme d'un Citis.
Les 7 types de cancers dont le lien avec l'activité de sapeur-pompier a été reconnu devraient être présumés imputables au service
Pour ce qui concerne les autres types de cancer, il est nécessaire de permettre aux soldats du feu d'établir plus aisément la preuve de leur exposition à des agents cancérogènes en cas de cancer.
À cet effet, l'élaboration d'un modèle national de fiche d'exposition, dont le remplissage serait obligatoire, doit être envisagé. Dans ce cadre, la composition des fumées d'incendie devrait être systématiquement analysée et consignée.
2. Mieux prévenir le développement des cancers chez les sapeurs-pompiers est possible
Concernant les équipements de protection individuelle (EPI), il conviendrait que l'État soutienne financièrement les Sdis en vue de favoriser l'acquisition massive des futures cagoules filtrantes et d'équipements dont l'efficacité a été prouvée scientifiquement.
En parallèle d'un renforcement du dépistage des maladies, la collecte de données épidémiologiques doit se poursuivre sur le long terme afin de mieux envisager les risques exacts liés à ce type d'activité.
Une visite de contrôle devrait obligatoirement être proposée tous les 5 ans par les Sdis aux sapeurs-pompiers retraités
Des programmes nationaux de surveillance médicale spécifiques devraient donc être mis en oeuvre à intervalles réguliers, tandis que les Sdis seraient obligés de proposer aux sapeurs-pompiers retraités une visite de contrôle tous les 5 ans. Un Observatoire de la santé des sapeurs-pompiers pourrait être chargé d'analyser les données collectées dans ce cadre et de proposer des actions de prévention et de réparation.
Il paraît enfin nécessaire de mieux former les médecins et infirmiers de sapeurs-pompiers en médecine du travail afin de les sensibiliser à ces enjeux.
Liste des propositions
Proposition n° 1 : Créer un tableau de maladies professionnelles regroupant les pathologies liées aux travaux d'extinction des incendies.
Proposition n° 2 : Élargir la présomption d'imputabilité au service aux types de cancer dont le lien avec l'activité de sapeur-pompier est reconnu par le Centre international contre le cancer (Circ).
Proposition n° 3 : Procéder systématiquement à l'évaluation des droits à l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales au terme d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Proposition n° 4 : Élaborer un modèle national de fiche d'exposition à des facteurs de risques spécifique à l'activité de sapeur-pompier.
Proposition n° 5 : Rendre obligatoire le remplissage d'une fiche d'exposition après chaque intervention à risque sanitaire.
Proposition n° 6 : Accorder aux Sdis une dotation exceptionnelle destinée à l'acquisition du nouveau modèle de cagoules filtrantes et d'équipements de protection individuelle dont l'efficacité est prouvée scientifiquement.
Proposition n° 7 : Mener des programmes nationaux de surveillance médicale dédiés aux sapeurs-pompiers à des fins de dépistage des cancers et de collecte de données épidémiologiques.
Proposition n° 8 : Renforcer le suivi post-professionnel en obligeant les Sdis à proposer aux sapeurs-pompiers retraités une visite médicale de contrôle tous les cinq ans.
Proposition n° 9 : Installer un Observatoire de la santé des sapeurs-pompiers chargé d'analyser les données épidémiologiques disponibles et de proposer des mesures visant à renforcer la protection des agents.
Proposition n° 10 : Renforcer la formation des médecins et infirmiers de sapeurs-pompiers en médecine du travail.
Réunie le mercredi 29 mai 2024 sous la présidence de Philippe Mouiller, la commission des affaires sociales a adopté le rapport et les recommandations présentés par les rapporteures et en a autorisé la publication sous forme d'un rapport d'information.
LISTE DES PROPOSITIONS
|
Proposition n° 1 |
Créer un tableau de maladies professionnelles regroupant les pathologies liées aux travaux d'extinction des incendies |
|
Proposition n° 2 |
Élargir la présomption d'imputabilité au service aux types de cancer dont le lien avec l'activité de sapeur-pompier est reconnu par le centre international de recherche sur le cancer (Circ) |
|
Proposition n° 3 |
Procéder systématiquement à l'évaluation des droits à l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales au terme d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service |
|
Proposition n° 4 |
Élaborer un modèle national de fiche d'exposition à des facteurs de risques spécifique à l'activité de sapeur-pompier |
|
Proposition n° 5 |
Rendre obligatoire le remplissage d'une fiche d'exposition après chaque intervention à risque sanitaire |
|
Proposition n° 6 |
Accorder aux services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) une dotation exceptionnelle destinée à l'acquisition du nouveau modèle de cagoules filtrantes et d'équipements de protection individuelle (EPI) dont l'efficacité est prouvée scientifiquement |
|
Proposition n° 7 |
Mener des programmes nationaux de surveillance médicale dédiés aux sapeurs-pompiers à des fins de dépistage des cancers et de collecte de données épidémiologiques. |
|
Proposition n° 8 |
Renforcer le suivi post-professionnel en obligeant les Sdis à proposer aux sapeurs-pompiers retraités une visite médicale de contrôle tous les cinq ans |
|
Proposition n° 9 |
Installer un Observatoire de la santé des sapeurs-pompiers chargé d'analyser les données épidémiologiques disponibles et de proposer des mesures visant à renforcer la protection des agents |
|
Proposition n° 10 |
Renforcer la formation des médecins et infirmiers de sapeurs-pompiers en médecine du travail |
LISTE DES SIGLES
|
A |
|
|
ACGIH |
American conference of governmental industrial hygienists |
|
Anamnesis |
Association nationale des médecins des services d'incendie et de secours |
|
Anses |
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail |
|
APFO |
Composés chimiques perfluorés |
|
ARI |
Appareil respiratoire isolant |
|
ATI |
Allocation temporaire d'invalidité |
|
ATIACL |
ATI des agents des collectivités locales |
|
B |
|
|
BMPM |
Bataillon de marins pompiers de Marseille |
|
BND |
Banque nationale de données |
|
BPC |
biphényles polychlorés de type dioxine |
|
BSPP |
Brigade des sapeurs-pompiers de Paris |
|
C |
|
|
CDC |
Caisse des dépôts et consignations |
|
CHS |
Comités d'hygiène et de sécurité |
|
Ceren |
Centre d'essai et de recherche de l'Entente méditerranéenne |
|
Circ |
Centre international de recherche sur le Cancer |
|
Citis |
Congé pour invalidité temporaire imputable au service |
|
Coct |
Conseil d'orientation des conditions de travail |
|
Cnam |
Conservatoire national des arts et métiers |
|
CNRACL |
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales |
|
COV |
Composés organiques volatils |
|
C2P |
Compte professionnel de prévention |
|
C3P |
Compte personnel de prévention de la pénibilité |
|
D |
|
|
DGSCGC |
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises |
|
DUERP |
Document unique d'évaluation des risques professionnels |
|
E |
|
|
ECASC |
École d'application de sécurité civile |
|
EHESP |
École des hautes études en santé publique |
|
ENSOSP |
École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers |
|
EPI |
Équipements de protection individuelle |
|
F |
|
|
FNP |
Fonds national de prévention |
|
FNSPF |
Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France |
|
G |
|
|
GSNSPV |
Groupement syndical national des sapeurs-pompiers volontaires |
|
H |
|
|
HAP |
Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
|
I |
|
|
Inserm |
Institut national de la santé et de la recherche médicale |
|
P |
|
|
PCDD |
Polychlorobenzoparadioxine |
|
PCDF |
Polychlorodibenzofurances |
|
PFAS |
Substances perfluorées et polyfluorées |
|
PNSM |
Programme national de surveillance du mésothéliome |
|
S |
|
|
Sdis |
Services d'incendie et de secours |
I. LES SAPEURS-POMPIERS, DONT L'ACTIVITÉ EST CANCÉROGÈNE, BÉNÉFICIENT DE DISPOSITIFS LIMITÉS DE PRÉVENTION ET D'INDEMNISATION DES MALADIES IMPUTABLES AU SERVICE
A. EN DÉPIT DU MANQUE DE DONNÉES OFFICIELLES, L'ACTIVITÉ DE SAPEUR-POMPIER EST DÉSORMAIS RECONNUE COMME CANCÉROGÈNE POUR L'HOMME À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE
1. À défaut de données suffisantes, la prévalence des cancers chez les sapeurs-pompiers ne peut faire l'objet d'une évaluation fiable
a) Seules quelques études, dont les résultats ne sont pas probants, ont porté sur la prévalence des cancers chez les sapeurs-pompiers
À fin 2021, la France comptait 252 700 sapeurs-pompiers, dont 197 800 volontaires, 41 800 professionnels et 13 200 militaires.
Compte tenu de la nature particulière de leur activité, ceux-ci sont exposés à plusieurs types de risques, et en particulier à celui de développer des maladies professionnelles. Dans leur cas particulier, cette exposition peut être aggravée par ce que les sociologues Anne Marchand et Marion Gaboriau désignent comme des « mécanismes d'héroïsation » susceptibles de favoriser la prise de risques et leur minimisation.
Toutefois, bien que les témoignages abondent à l'appui de cette affirmation et que le lien direct entre l'activité de sapeur-pompier et le risque de cancer soit désormais incontestable (voir infra), la prévalence de ce type de pathologie au sein de la population des sapeurs-pompiers en France n'a toujours pas fait l'objet d'une étude approfondie.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) n'a en effet recensé que deux études ayant porté sur la santé des sapeurs-pompiers en France au cours des dernières décennies :
- une étude de mortalité de 830 sapeurs-pompiers ayant servi pendant 5 ans au moins au sein de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) au 1er janvier 1977 et publiée en 19951(*), jugée non extrapolable à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels par la seconde étude, dans la mesure où elle portait sur une population très spécifique (âge, encadrement, modes opératoires, etc.), mais qui a relevé :
? une mortalité inférieure à celle de la population masculine française, qui pourrait toutefois être liée au « phénomène du travailleur sain », dans la mesure où les sapeurs-pompiers sont généralement en meilleure forme physique que la population générale ;
? et une mortalité supérieure pour les cancers uro-génitaux, les cancers de l'appareil digestif, les cancers respiratoires et les maladies cérébro-vasculaires ;
- et une analyse de la mortalité de 10 829 sapeurs-pompiers professionnels actifs au 1er janvier 1979, composant la cohorte « C.PRIM », et publiée en 20122(*), qui n'a pas intégré les caractéristiques professionnelles individuelles telles qu'un nombre plus ou moins élevé d'interventions sur incendie que la moyenne des sapeurs-pompiers, mais dans le cadre de laquelle il a été constaté que :
? que 1 642 agents sont décédés entre 1979 et 2008, dont 45 % en raison de tumeurs ;
? une mortalité inférieure de près de 20 % à celle de la population masculine française, découlant en grande partie du « phénomène du travailleur sain », mais qui se rapproche progressivement de celle-ci avec le temps, une fois la sélection initiale passée, pour y devenir équivalente à l'âge de 70 ans ;
? et une mortalité par cancer non statistiquement différente de celle de la population générale, avec des excès modérés, sans être statistiquement significatifs, pour les cancers du rectum et de l'anus, du pancréas, des lèvres-cavité buccale-pharynx, de l'estomac, du foie et des voies biliaires et du larynx.
D'autres études ont été réalisées à l'étranger, sans toutefois pouvoir toujours être transposées à la France, compte tenu des spécificités de l'activité de sapeur-pompier dans chaque pays.
Au terme de l'une d'entre elles, publiée au Royaume-Uni en janvier 20233(*) et relayée en France par l'émission « Vert de Rage »4(*), il est apparu qu'un cancer avait été diagnostiqué chez 441 des 10 649 sapeurs-pompiers participants (24 % des sapeurs-pompiers britanniques), soit 4 % d'entre eux. En ne retenant que ceux qui avaient fourni davantage de détails sur leur diagnostic et qui avaient reçu ce dernier après le début de leur activité de sapeur-pompier, soit 307 personnes, les auteurs ont constaté qu'il s'agissait d'un cancer de la peau dans plus de 36 % des cas et d'un cancer des testicules dans plus de 12 % d'entre eux.
Classement des types de cancer déclarés par les sapeurs-pompiers ayant participé à l'étude britannique de 2023
Source : Wolffe, Robinson, Dickens, Turrell, Clinton, Maritan-Thomson, Joshi et Stec, Cancer incidence amongst UK firefighters, in Scientific Reports, 10 janvier 2023
D'après les résultats de l'enquête, le taux de cancer chez les sapeurs-pompiers britanniques serait supérieur à celui de la population générale pour les tranches d'âge inférieures à 55 ans, le dépassant même de 323 % chez les individus âgés de 35 à 39 ans.
Du reste, le risque de développer un cancer était 1,7 fois plus élevé chez les sapeurs-pompiers ayant servi durant 15 années ou plus que chez les autres.
Comparaison entre le taux de cancer par âge au diagnostic chez les sapeurs-pompiers ayant participé à l'étude britannique de 2023 et chez la population générale britannique en 2017 (pour 100 000 personnes)
Source : Wolffe, Robinson, Dickens, Turrell, Clinton, Maritan-Thomson, Joshi et Stec, Cancer incidence amongst UK firefighters, in Scientific Reports, 10 janvier 2023
Ces données, qui reposent sur une population extrêmement restreinte, doivent toutefois être considérées avec beaucoup de prudence. Dès lors, les rapporteures regrettent vivement le manque d'études épidémiologiques sérieuses, qui ne permet de formuler aucune conclusion définitive.
b) Les données aujourd'hui collectées sur les maladies professionnelles des sapeurs-pompiers ne sauraient constituer une base de travail satisfaisante
D'après Anne Marchand et Marion Gaboriau, qui constatent que les données existantes à l'échelle internationale ne sont pas toujours mobilisées en France, quatre éléments permettent d'expliquer le manque de données sur les maladies professionnelles des sapeurs-pompiers :
- le désengagement des pouvoirs publics du financement de la recherche épidémiologique, qui nécessite pourtant des investissements importants, comme l'illustre l'annonce par Santé publique France, en décembre 2023, de l'abandon du programme national de surveillance du mésothéliome (PNSM) ;
- la focalisation des études épidémiologiques sur des facteurs de risques dont les effets sont facilement mesurables sur une population large, au détriment des facteurs de risques plus importants, mais qui ne concernent qu'une population restreinte, comme c'est le cas des sapeurs-pompiers ;
- l'influence des entreprises productrices de substances potentiellement cancérigènes non seulement pour les sapeurs-pompiers, mais pour l'ensemble de la population, comme les retardateurs de feu (voir infra), susceptible de freiner la recherche à ce sujet ;
- et la faible production de statistiques sur les maladies professionnelles dans la fonction publique.
Sur ce dernier plan, le colonel Christian Pourny avait relevé dès 2003 que la France ne disposait « d'aucune donnée épidémiologique sur les accidents en service et maladies professionnelles » et proposait « de mettre sur pied une véritable veille sanitaire des sapeurs-pompiers s'appuyant sur une banque nationale de données (BND) fiable qui, seule, peut permettre des études épidémiologiques indispensables et préalables à toute politique de prévention », en précisant que « cette BND pourrait s'appuyer à la fois sur le logiciel informatique Prorisq que la Caisse des dépôts et consignations (CDC) accepte de fournir gratuitement aux services d'incendie et de secours (Sdis) et sur les informations émanant des comités d'hygiène et de sécurité (CHS) locaux, autorisant ainsi une gestion optimisée et en temps réel des accidents en service et maladies professionnelles »5(*).
Cette BND sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, créée depuis lors par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), semble toutefois ne présenter qu'un intérêt limité, dans la mesure où, comme le relève le professeur Laura Temime, qui dirige le laboratoire MESuRS du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et a conduit à ce titre des travaux de recherche visant à quantifier les risques de cancer professionnels chez les sapeurs-pompiers en collaboration avec la BSPP, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont fortement sous-déclarés en France.
La banque nationale de données de la CNRACL
Gérée par le fonds national de prévention (FNP) des accidents du travail et des maladies professionnelles de la CNRACL6(*), la BND recueille les déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles des fonctions publiques territoriale et hospitalière issues du logiciel Prorisq, qui permet aux employeurs territoriaux et hospitaliers de suivre et de piloter leur sinistralité.
Le FNP recourt à ces données pour produire des rapports statistiques annuels relatifs à la sinistralité dans le cadre de sa mission d'établissement, au plan national, des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées dans les collectivités territoriales et établissements hospitaliers en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets7(*).
Il convient de noter que la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles via Prorisq n'est pas obligatoire. En 2022, 90 % des sapeurs-pompiers professionnels étaient cependant couverts. La CNRACL estime que « l'impulsion de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) incitant fortement les Sdis à utiliser le logiciel Prorisq a constitué un tournant pour permettre aux Sdis de disposer de bases objectives et communes sur lesquelles travailler, se comparer, échanger et ainsi moduler et prioriser leurs actions de prévention ».
Dans un rapport de 20198(*), l'Anses préconisait d'assurer l'alimentation de la BND par tous les départements et de standardiser la collecte des données.
Toutefois, considérant qu'il ne s'agit que d'une base de données médico-administrative dédiée au recensement de la sinistralité et que les données relatives à la santé des sapeurs-pompiers collectées dans le cadre de leur surveillance médicale dont disposent chaque service départemental d'incendie et de secours (Sdis), la BSPP et le bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) ne sont ni centralisées ni exploitées, l'Anses recommandait également de « mettre en place une base de données permettant de centraliser les données de santé des sapeurs-pompiers professionnels (y compris militaires) et volontaires à des fins de surveillance épidémiologique ».
Interrogée sur cette proposition, la DGSCGC a indiqué aux rapporteures que « cette question doit faire l'objet d'une réflexion qui n'est pas aboutie à ce stade ».
2. Le lien de causalité entre l'exposition professionnelle des sapeurs-pompiers et le développement de cancers ne saurait plus être mis en doute
a) Les sapeurs-pompiers sont exposés à des facteurs de risques majeurs dans l'exercice de leur activité
L'activité de sapeur-pompier est une activité dangereuse, dont les risques ne se limitent pas à sa cancérogénicité.
Le Centre international de recherche sur le Cancer (Circ) note ainsi que « l'exposition professionnelle en tant que pompier est complexe et comprend une variété de dangers résultants d'incendies et d'évènements non liés à l'incendie. Les pompiers peuvent avoir divers rôles, responsabilités et emplois (par exemple, à temps plein, à temps partiel ou bénévoles) qui varient considérablement d'un pays à l'autre et changent au cours de leur carrière. Les pompiers répondent à divers types d'incendies (par exemple, incendies de structure, de végétation et de véhicules) et à d'autres évènements (par exemple, accidents de véhicules, incidents médicaux, rejets de matières dangereuses et effondrements de bâtiments). (...) Les pompiers peuvent être exposés aux produits de combustion des incendies (par exemple, les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les particules), aux matériaux de construction (par exemple, l'amiante), aux produits chimiques contenus dans les mousses anti-incendie (par exemple, les substances perfluorées et polyfluorées (PFAS), aux retardateurs de flamme, au diesel gaz d'échappement et autres dangers (par exemple, travail de nuit et rayonnement ultraviolet ou autre) »9(*).
Il précise en outre que « l'absorption d'effluents d'incendie ou d'autres produits chimiques peut se produire par inhalation et absorption cutanée et éventuellement par ingestion. Les pompiers comptent sur les équipements de protection individuelle (EPI) pour réduire leurs expositions. Un appareil respiratoire autonome est souvent porté pendant les activités de lutte contre les incendies impliquant des structures ou des véhicules, mais moins fréquemment pendant la lutte contre les incendies de forêt, où les pompiers peuvent être déployés sur des incendies de forêt plusieurs fois par an et rester près du feu pendant plusieurs semaines. L'absorption cutanée de produits chimiques peut se produire même chez les pompiers portant un EPI en raison des limites de sa conception, de son ajustement, de son entretien ou de sa décontamination. De plus, des expositions peuvent survenir lorsque les pompiers ne combattent pas activement les incendies et ne portent pas d'EPI ».
Les risques induits par l'exercice de l'activité de sapeur-pompier
Parmi les principaux risques auxquels sont exposés les sapeurs-pompiers dans l'exercice de leur activité, peuvent notamment être cités, sans prétention à l'exhaustivité :
- le risque traumatique (plaies, contusions, lésions ostéoarticulaires, brûlures) ;
- le risque toxique (inhalation de fumées, de poussières ou de suie, accidents de transport de matières dangereuses) ;
- le risque de stress thermique et de déshydratation (du fait du port des équipements de protection individuelle lourds et gênants pour la thermorégulation et de l'exposition à des températures élevées) ;
- le risque infectieux (contagion par proximité d'une personne malade, accidents d'exposition aux liquides biologiques) ;
- le risque de troubles musculosquelettiques ;
- le risque cardio-vasculaire ;
- le risque respiratoire (bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), asthme) ;
- le risque psychologique (stress, syndrome post-traumatique, anxiété, dépression) ;
- le risque radiologique ;
- ou encore le risque routier.
Il n'est certes pas possible, comme le souligne la DGSCGC, d'établir un lien systématique entre une exposition à un produit cancérogène et le développement d'un cancer, dans la mesure où ce dernier implique, au-delà de la seule exposition à un tel produit, l'atteinte d'un seuil d'action, qui associe un dosage, une durée et une fréquence d'exposition, et dont la mesure est particulièrement difficile.
Du reste, les effets de la polyexposition demeurent encore méconnus. Il est en effet vraisemblable que l'exposition simultanée à plusieurs agents ou substances cancérogènes soit plus nocive qu'une exposition consécutive aux mêmes produits.
Il n'en reste pas moins que, dans le cadre de la lutte contre l'incendie, les sapeurs-pompiers sont exposés à des produits de combustion cancérogènes présents dans les fumées, à l'instar des HAP, de certains composés organiques volatils (COV) tels que le benzène, des aldéhydes, et notamment du formaldéhyde, de l'amiante ou des particules fines, ainsi qu'aux PFAS contenues dans les émulseurs des produits d'extinction et dans les produits de dégradation de leurs tenues isolantes et hydrofuges.
Substances régulièrement
identifiées dans des prélèvements par frottis
sur la
peau, dans des échantillons d'air ou par surveillance biologique
lors d'incendies de bâtiments municipaux ou de
véhicules
|
Substances |
Classification de l'American conference of governmental industrial hygienists (ACGIH)10(*) |
Classification du Centre international de recherche sur le cancer (Circ)11(*) |
|
Buta-1,2-diène |
n.é. |
n.é. |
|
Buta-1,3-diène |
A2 |
1 |
|
1-4 dichlorobenzène |
n.é. |
2B |
|
1-butène/2-methylpropène |
n.é. |
n.é. |
|
1-méthylcyclopentène |
n.é. |
n.é. |
|
2-méthylbutane |
n.é. |
n.é. |
|
Acénaphtylène |
n.é. |
n.é. |
|
Acétone |
n.é. |
n.é. |
|
Acroléine |
A4 |
3 |
|
Arsenic |
A1 |
1 |
|
Composés de benzène substitués
|
Cancérogène en fonction des composants |
|
|
Benzène |
A1 |
1 |
|
Benzofluoranthène |
A2 |
2B |
|
Cadmium |
A2 |
1 |
|
Monoxyde de carbone |
n.é. |
n.é. |
|
Chrome |
A1 |
1 |
|
Cyclohexane |
n.é. |
n.é. |
|
Cyclopentène |
n.é. |
n.é. |
|
Ethylbenzène |
A3 |
2B |
|
Formaldéhyde |
A2 |
1 |
|
Glutaraldéhyde |
A4 |
n.é. |
|
Isopropylbenzène |
n.é. |
2B |
|
Méthoxyphénols |
n.é. |
n.é. |
|
Naphtalène |
A4 |
2B |
|
Composés chimiques perfluorés (APFO) |
n.é. |
2B |
|
HAP (brais de goudron de houille) |
A1 |
1 |
|
Polychlorobenzoparadioxine (PCDD), polychlorodibenzofurances (PCDF), biphényles polychlorés de type dioxine (BPC) |
Cancérogène en fonction des composants |
1 |
|
HAP |
Cancérogène en fonction des composants |
1 |
|
Propane |
n.é. |
n.é. |
|
Propène |
n.é. |
n.é. |
|
Styrène |
A4 |
2B |
|
Toluène |
A4 |
3 |
|
Particules ultrafines |
n.é. |
n.é. |
|
Mélange de xylènes |
A4 |
3 |
Source : Anses, Risques sanitaires liés aux expositions professionnelles des sapeurs-pompiers, juin 2019, d'après l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité au travail
Le cas des retardateurs de flamme, en particulier, a récemment attiré l'attention médiatique. Ces composés chimiques, incorporés dans des produits de consommation afin de les rendre moins inflammables et présents, par conséquent, dans les fumées d'incendie, sont pour certains cancérogènes.
En 2023, l'équipe de l'émission « Vert de Rage », en collaboration avec l'Oregon State University, a équipé des sapeurs-pompiers français de bracelets en silicone pendant une semaine puis les a analysés. Il est apparu au terme de ces travaux que tous les participants avaient été exposés aux retardateurs de flamme. Par la suite, le laboratoire tchèque Recetox a analysé des échantillons de sang prélevés chez une vingtaine d'entre eux et a constaté que tous contenaient au moins un retardateur de flamme. Du reste, un retardateur, le BDE-209, a été retrouvé dans ces échantillons à des niveaux très importants, ce qui suggère qu'un lien pourrait être établi avec l'exposition professionnelle des sapeurs-pompiers.
b) L'activité de sapeur-pompier a récemment été reconnue comme cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer
Dès décembre 2007, le Circ a classé l'activité de sapeur-pompier comme « probablement cancérogène pour l'homme » sur la base d'indications limitées de cancer chez l'homme, notamment pour le lymphome non hodgkinien, le cancer de la prostate et le cancer des testicules12(*).
Sur la base de nouvelles études de cohorte de grande envergure suivies à long terme et d'indications mécanistiques issues d'études épidémiologiques, le groupe consultatif chargé de recommander des priorités pour le programme des Monographies du Circ pour la période 2020-2024 a invité à réévaluer l'exposition professionnelle des sapeurs-pompiers.
L'évaluation de la cancérogénicité d'un agent par le programme des Monographies du Centre international de recherche sur le cancer
En collaboration avec des groupes consultatifs d'experts internationaux indépendants, le programme des Monographies du Circ identifie, à partir de données scientifiques, les agents soupçonnés de cancérogénicité sur lesquels il se propose de travailler prioritairement.
Leur évaluation est réalisée par un groupe de travail composé d'experts internationaux indépendants, qui collectent et examinent les données scientifiques disponibles, à savoir :
- les études épidémiologiques portant sur la cancérogénicité pour l'homme ;
- les études expérimentales portant sur la cancérogénicité pour l'animal ;
- et les études portant sur les mécanismes de cancérogénicité.
Après avoir évalué globalement la force des indications de la cancérogénicité de l'agent pour l'homme, le groupe de travail le classe dans l'une des quatre catégories existantes :
- le groupe 1 (cancérogène pour l'homme) ;
- le groupe 2A (probablement cancérogène pour l'homme) ;
- le groupe 2B (peut-être cancérogène pour l'homme) ;
- ou le groupe 3 (inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme).
Au terme de l'analyse de plus de 30 études de cohorte ne se chevauchant pas et menées en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et en Océanie, le Circ a trouvé des indications cohérentes d'un risque accru de développer certains types de cancer chez les sapeurs-pompiers. Dans le même temps, les nouvelles études mécanistiques disponibles ont mis en évidence « des indications constantes et cohérentes » de cinq des dix caractéristiques clés des agents cancérogènes13(*).
En juin 2022, le Circ a donc classé l'exposition professionnelle en tant que sapeur-pompier comme « cancérogène pour l'homme » sur la base de preuves suffisantes pour le mésothéliome et le cancer de la vessie et de preuves limitées pour les cancers du côlon, de la prostate et des testicules, le mélanome et le lymphome non hodgkinien14(*).
Le risque serait plus élevé de 58 % chez les sapeurs-pompiers par rapport à la population générale pour ce qui concerne le mésothéliome et de 16 % pour le cancer de la vessie. Les agents causaux les plus plausibles seraient l'amiante dans le premier cas et, dans le second, les HAP et la suie.
S'agissant des types de cancers au sujet desquels les preuves trouvées ont été qualifiées de « limitées », ne pouvaient être exclus comme éléments d'explication des associations positives crédibles observées par le groupe de travail « les biais résultant d'une surveillance médicale et d'une détection accrues chez les pompiers, ou la confusion due aux caractéristiques physiques et au mode de vie », tandis que, pour certains d'entre eux, un doute légitime sur le lien causal avec l'exposition en tant que sapeur-pompier découlait d' « une grande hétérogénéité dans les estimations de la méta-analyse, des résultats positifs incohérents provenant d'études informatives, ou [de] peu de preuves d'expositions à la lutte contre les incendies connues pour être associées à ces types de cancer ».
Enfin, pour les autres types de cancer, notamment pour ceux du poumon et de la thyroïde, le Circ a jugé les preuves apportées « inadéquates ». En effet, le taux d'incidence du cancer du poumon, plus faible que dans la population générale, pouvait s'expliquer par le phénomène du travailleur sein et par le tabagisme. À l'inverse, il est possible que le biais de surveillance soit à l'origine d'un taux d'incidence du cancer de la thyroïde plus élevé que dans la population générale.
B. DES EFFORTS ONT ÉTÉ ACCOMPLIS EN MATIÈRE DE SIMPLIFICATION DE LA RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES ET DE PRÉVENTION DES RISQUES DANS LA FONCTION PUBLIQUE EN GÉNÉRAL
1. La reconnaissance de l'origine professionnelle d'un cancer ouvre droit à plusieurs dispositifs de compensation et d'indemnisation
a) Le législateur a institué une présomption d'imputabilité au service pour les maladies déclarées par les fonctionnaires et figurant aux tableaux des maladies professionnelles
Jusqu'en 2017, il appartenait au fonctionnaire estimant être victime d'une maladie professionnelle d'établir son imputabilité au service. De fait, contrairement aux salariés du secteur privé15(*), les fonctionnaires ne bénéficiaient pas d'une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles16(*).
Depuis lors17(*), est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées dans ces tableaux18(*). Il appartient donc désormais à l'autorité territoriale de démontrer que la maladie n'est pas imputable au service si elle estime que le lien n'est pas établi.
Descriptif des tableaux de maladies professionnelles
|
Désignation des maladies |
Délai de prise en charge |
Liste des travaux susceptibles de provoquer l'affection en cause |
|
Sont listés ici les symptômes ou les affections dont le malade doit souffrir. Leur énumération est limitative. Par exemple, lorsqu'un travailleur est soumis à des travaux bruyants énumérés dans le tableau n° 42 du régime général, il ne sera pris en compte que les troubles liés à la surdité correspondant aux critères définis dans cette colonne. |
Il s'agit du délai maximal entre la constatation de l'affection et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque. Ce délai est variable non seulement suivant chaque maladie, mais parfois, pour une même cause, selon les manifestations ou symptômes cliniques présentés par le malade. Certains tableaux prévoient également une durée minimale d'exposition |
Cette liste peut être : - Limitative : seuls les travailleurs affectés aux travaux énumérés peuvent demander une rémunération au titre des maladies professionnelles. C'est le cas des maladies infectieuses et de la plupart des cancers ; - Indicative : tout travail où le risque existe peut être pris en considération même s'il ne figure pas dans la liste. C'est le cas notamment de certaines maladies provoquées par des substances toxiques. |
Source : Anses, Guide méthodologique pour l'élaboration de l'expertise en vue de la création ou de la modification de tableaux de maladies professionnelles, ou de recommandations aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, juillet 2020
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne sont pas remplies, une maladie désignée par les tableaux peut tout de même être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.
Enfin, peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 %, ce taux devant être déterminé par le conseil médical sur la base d'un barème réglementaire indicatif19(*).
À cet égard, la jurisprudence administrative requiert uniquement que le lien entre l'exercice des fonctions et la maladie soit direct, et non nécessairement exclusif ni certain20(*).
La composition du conseil médical
Institué auprès du préfet dans chaque département, le conseil médical est compétent à l'égard du fonctionnaire qui exerce dans ce département ou qui y a exercé en dernier lieu ses fonctions21(*).
En formation plénière, il est composé :
- de trois médecins titulaires et d'un ou plusieurs médecins suppléants figurant sur la liste des médecins agréés et désignés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable ;
- de deux représentants de la collectivité ou de l'établissement public (le Sdis, dans le cas des sapeurs-pompiers) ;
- de deux représentants du personnel22(*).
Chaque titulaire de ces deux dernières catégories dispose de deux suppléants.
La présidence du conseil médical est assurée par un médecin désigné par le préfet parmi les médecins titulaires.
Conditions de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie déclarée par un fonctionnaire
|
La maladie figure dans un tableau de maladies professionnelles |
La maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles |
|
|
Les conditions prévues par le tableau de maladies professionnelles sont remplies |
La maladie est présumée imputable au service |
La maladie peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire établit qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 % |
|
Les conditions prévues par le tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies |
La maladie peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire établit qu'elle est directement causée par l'exercice de ses fonctions |
Source : Article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, article 37-8
Les tableaux de maladies professionnelles sont établis par le pouvoir réglementaire après consultation des partenaires sociaux composant la commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles du Conseil d'orientation des conditions de travail (Coct)23(*).
b) Des dispositifs spécifiques sont prévus en cas d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente résultant d'une maladie imputable au service
Lorsque qu'une incapacité temporaire de travail résulte d'une maladie professionnelle, le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis)24(*). Il conserve dans ce cadre l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite25(*). Le maintien ou la suspension des primes et indemnités sont déterminés par l'autorité territoriale compétente, c'est-à-dire par chaque Sdis dans le cas des sapeurs-pompiers.
Du reste, le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie26(*).
Les modalités d'attribution d'un
congé pour invalidité temporaire
imputable au service en cas
de maladie professionnelle
Pour obtenir un Citis, le fonctionnaire ou son ayant droit doit adresser par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits27(*). La déclaration doit comporter un formulaire précisant les circonstances de la maladie et un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions en résultant ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant.
La déclaration doit être adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Sauf dans quelques cas prévus par la loi, la demande de l'agent est rejetée lorsque ce délai n'est pas respecté28(*).
L'autorité territoriale peut faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service et diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à l'apparition de la maladie29(*).
Elle dispose, pour se prononcer sur l'imputabilité au service de la maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle. Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute à ce premier délai en cas d'enquête administrative, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent30(*).
Le conseil médical doit être consulté par l'autorité territoriale lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service dans le cas où la maladie figure dans un tableau de maladies professionnelles mais où une ou plusieurs conditions prévues par ce tableau ne sont pas remplies et dans celui où la maladie ne figure pas dans les tableaux31(*).
Par ailleurs, le médecin du travail doit remettre un rapport au conseil médical, sauf s'il constate que la maladie figure dans un tableau de maladies professionnelles et que les conditions prévues par celui-ci sont remplies. Dans ce dernier cas, il doit en informer l'autorité territoriale32(*).
Au terme de l'instruction, l'autorité territoriale se prononce sur l'imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en Citis pour la durée de l'arrêt de travail33(*).
Au terme du Citis, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade34(*). S'il se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions, il peut être admis à la retraite pour invalidité, soit d'office, soit sur demande35(*).
Il convient de noter que le temps passé en Citis est pris en compte pour la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite36(*).
Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de stabilisation37(*).
En cas de rechute d'une maladie imputable au service survenu alors qu'il était en activité ou de survenance d'une telle maladie déclarée postérieurement à sa radiation des cadres, le fonctionnaire retraité peut demander à l'autorité territoriale ayant prononcé sa radiation à bénéficier du remboursement des honoraires et autres frais médicaux directement entraînés par ladite maladie38(*).
Dans le délai d'un an à compter du jour où il a repris ses fonctions après la consolidation de son état de santé39(*), le fonctionnaire qui a été atteint d'une incapacité permanente partielle résultant d'une maladie professionnelle peut demander l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) cumulable avec son traitement et dont le montant est égal à la fraction du traitement indiciaire brut afférent à l'indice majoré 245, soit 1 206 euros, correspondant au taux d'incapacité permanente40(*).
La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ses conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elle entraîne sont appréciés par le conseil médical, le bénéfice de l'ATI des agents des collectivités locales (ATIACL) étant in fine conditionné à l'émission par la CNRACL d'un avis conforme41(*). Elle est accordée pour une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle les droits font l'objet d'un nouvel examen et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit supprimée42(*).
Procédure d'attribution de l'ATIACL
Source : Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Orientales
Ces dispositifs sont ouverts aux sapeurs-pompiers professionnels, qui ont la qualité de fonctionnaires territoriaux43(*). Les sapeurs-pompiers volontaires, quant à eux, n'exercent pas leur activité à titre professionnel, mais dans des conditions propres à celle-ci44(*) et bénéficient par conséquent d'un régime de protection sociale spécifique.
Le cas des sapeurs-pompiers volontaires
Le sapeur-pompier volontaire atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit :
- sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cette maladie ;
- à une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;
- et à une allocation ou une rente en cas d'incapacité permanente45(*).
En vue de l'attribution de ces prestations et indemnisations, le conseil médical se prononce sur le rapport du directeur départemental des services d'incendie et de secours et après que le chef du centre de secours dont dépend le sapeur-pompier concerné a été invité à fournir ses observations écrites46(*). Il apprécie la réalité des infirmités, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent. Le pouvoir de décision appartient in fine au président du conseil d'administration du Sdis pour les prestations en nature et l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail et au directeur général de la CNRACL pour l'indemnisation de l'incapacité permanente et les autres prestations.
Dans ce cadre, le conseil médical comprend le médecin-chef départemental des services d'incendie et de secours et le directeur département des mêmes services, ainsi qu'un officier chef de centre de secours et un sapeur-pompier volontaire de même grade que celui dont le cas est examiné47(*).
2. La prévention des risques fait l'objet d'une attention particulière, qui s'est renforcée au cours des 20 dernières années
a) La médecine professionnelle, le contrôle de l'aptitude et le suivi post-professionnel des sapeurs-pompiers participe de l'effort de prévention du développement de maladies professionnelles
Au-delà de la seule indemnisation des maladies professionnelles, un certain nombre de dispositifs de prévention sont déployés en faveur des sapeurs-pompiers.
Ainsi, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de l'intervention des services de médecine préventive, chargés de conseiller les autorités territoriales, les agents et leurs représentants en ce qui concerne notamment l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, l'évaluation des risques professionnels ou la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle48(*).
La surveillance médicale des agents publics locaux
Les agents des collectivités locales bénéficient d'une visite d'information et de prévention au minimum tous les deux ans. Celle-ci a pour objet :
- d'interroger l'agent sur son état de santé ;
- de l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;
- de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre ;
- d'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
- et de l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail49(*).
Du reste, le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires au dépistage d'une maladie professionnelle susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent50(*).
En outre, le sapeur-pompier tant professionnel que volontaire doit remplir certaines conditions d'aptitude médicale pour participer aux missions et accomplir les fonctions qui lui sont dévolues, le contrôle de l'aptitude médicale devant constituer « une première démarche de médecine de prévention permettant de s'assurer de ses capacités à assumer les fatigues et les risques ou à prévenir une éventuelle aggravation d'une affection préexistante liée à l'accomplissement des fonctions ou des missions qui lui sont confiées »51(*).
L'aptitude médicale est prononcée par un médecin sapeur-pompier habilité au terme de visites annuelles ou, sur décision du médecin pour les sapeurs-pompiers âgés de 16 à 38 ans, bisannuelles52(*). Ces visites comprennent entre autres un contrôle radiologique pulmonaire dont la périodicité est laissée à l'initiative du médecin en fonction de l'emploi du sapeur-pompier, de l'examen clinique ou des antécédents et des examens biologiques, si les données de l'examen clinique les rendent nécessaires et à partir de 40 ans au moins tous les trois ans53(*).
Dans sa réponse à une question orale posée par la rapporteure Émilienne Poumirol le 7 décembre 2023, la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville, Sabrina Agresti-Roubache, a indiqué que la refonte du cadre réglementaire applicable au contrôle de l'aptitude des sapeurs-pompiers faisait l'objet d'une « réflexion ».
D'après la DGSCGC, il s'agirait de créer « un référentiel national « conditions de santé particulières des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires » », qui permettrait d'aboutir à « une certaine harmonisation des pratiques », d' « apporter des précisions selon des activités ou situations spécifiques », de « disposer d'un texte de recommandations médicales » et de « pouvoir l'adapter rapidement aux évolutions de la médecine ».
Enfin, depuis 2015, les agents de la fonction publique territoriale, dont les sapeurs-pompiers professionnels, ayant été, dans le cadre de leurs fonctions, exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans le cadre d'activités les ayant placés en contact avec de l'amiante ou figurant dans un tableau de maladies professionnelles ont droit, après avoir cessé définitivement leurs fonctions, à un suivi médical post-professionnel54(*). Il convient de préciser, comme l'a rappelé la FNSPF, que les sapeurs-pompiers volontaires, qui représentent près de 80 % des effectifs de sapeurs-pompiers, sont exclus du bénéfice de ce suivi.
Le suivi médical post-professionnel des fonctionnaires territoriaux
Les agents au bénéfice desquels un suivi médical post-professionnel est institué doivent être informés de leurs droits par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions55(*).
Le bénéfice de ce suivi est subordonné à la délivrance aux agents d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, établie après avis du médecin de prévention par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions, en lien direct avec la traçabilité de l'exposition à une ou des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la production révélées par le document unique d'évaluation des risques professionnels des agents concernés56(*).
Le suivi est assuré, au choix des agents, par le service de médecine de prévention, par tout médecin librement choisi par l'intéressé ou par les centres médicaux avec lesquels la collectivité ou l'établissement prenant en charge le suivi passe une convention57(*).
Les honoraires et frais médicaux résultant de ce suivi sont intégralement pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement au sein duquel l'agent a été exposé58(*). Cette prise en charge est assurée dans la limite des prestations de même nature prévues par le régime général de la sécurité sociale, les frais de transports occasionnés n'étant pas pris en charge.
b) Les pouvoirs publics semblent avoir pleinement pris en compte l'enjeu de prévention des risques chez les sapeurs-pompiers
Plusieurs mesures visant à renforcer la prévention des risques d'apparition de pathologies d'origine professionnelle chez les sapeurs-pompiers ont également été mises en oeuvre ces dernières années, tant par l'État et les Sdis que par la CNRACL.
À travers son fonds national de prévention (voir supra), cette dernière fournit aux Sdis un accompagnement en la matière. D'après elle, le rapport Pourny « a permis d'opérer une forme de révolution en faisant passer la prévention au premier plan, alors que la « gestion » des risques professionnels au sein des services d'incendie et de secours reposait principalement sur la réparation et une démarche exclusivement réactive voire empirique ».
Sur le plan méthodologique, le FNP de la CNRACL met à la disposition des employeurs publics locaux le logiciel Prorisq, dédié au suivi de la sinistralité, ainsi que de la documentation sur les risques professionnels et la prévention. Concernant plus particulièrement les sapeurs-pompiers, il publie chaque année un rapport statistique à partir d'éléments tirés de la banque nationale de données (voir supra) et élabore des documents spécifiques, à l'instar du guide national de prévention des accidents de service dans la pratique des activités physiques et sportives chez les sapeurs-pompiers, paru en 2013.
Au surplus, le FNP intervient également sur le plan financier. Il a ainsi apporté son soutien à 57 Sdis différents depuis 2005 dans le financement de projets en matière d'évaluation des risques professionnels, de structuration de réseaux autour de la prévention et de déploiement de démarches de prévention du risque routier, des risques psychosociaux et des troubles musculosquelettiques, pour un montant de plus de 5,6 millions d'euros. Le fonds a également participé à hauteur de 553 000 euros au financement de l'étude épidémiologique ayant porté sur la cohorte C.PRIM entre 2007 et 2011 (voir supra).
Par ailleurs, la CNRACL a participé à la constitution d'un groupe de travail conjoint avec la DGSCGC et plusieurs experts sur les risques liés aux fumées d'incendie ayant donné lieu, en 2017, à la publication d'un rapport comportant 43 recommandations59(*), lequel a été actualisé en 2020 à la suite de la constitution, en 2018, d'un nouveau groupe conjoint et a souligné l'importance capitale du nettoyage et de la décontamination des tenues après une exposition aux fumées. Il en a notamment résulté une adaptation progressive des bâtiments des centres de secours et des casernes dans le but de permettre la dépollution des tenues aussitôt après l'intervention. La DGSCGC a elle-même publié en 2018 un guide de doctrine opérationnel sur la prévention des risques liés à la toxicité des fumées.
La CNRACL a également confié au Centre d'essai et de recherche de l'Entente méditerranéenne (Ceren) la réalisation d'une étude sur l'efficacité de filtration des cagoules utilisées par les sapeurs-pompiers lors des feux de forêts60(*), qui a conduit à l'élaboration d'un prototype de cagoule de nouvelle génération dont le taux de filtration des particules fines est évalué à 70 % au moins, contre un taux nul aujourd'hui. Cette cagoule constitue, selon la DGSCGC, un compromis optimal entre un haut niveau de filtration et l'exigence de respirabilité.
Enfin, dans le cadre de son programme d'actions pour 2018-2023, prolongé jusqu'au 31 décembre 2024, le FNP et la DGSCGC ont apporté leur soutien à un projet, actuellement en cours, du Sdis de l'Hérault visant à permettre aux sapeurs-pompiers de simuler l'encerclement par un feu de forêt dans une cabine dédiée. Au total, 328 millions d'euros ont été consacrés aux Sdis dans le cadre de ce programme.
De façon générale, plusieurs des préconisations du rapport Pourny ont été mises en oeuvre ou satisfaites, à commencer par la création de la BND de la CNRACL et d'un pôle « santé » chargé, au sein de la DGSCGC, d'élaborer la politique nationale de recherche et de développement de la communication sur la prévention dans les domaines de la santé et de la sécurité des sapeurs-pompiers61(*).
Au surplus, les sapeurs-pompiers disposent d'un certain nombre d'outils et de procédures destinés à assurer leur protection, à commencer par le port d'un appareil respiratoire isolant (ARI), obligatoire pour tout engagement dans les milieux où l'air est vicié ou susceptible de l'être. De plus, un soutien sanitaire peut être assuré par la sous-direction santé du Sdis62(*) en fonction de l'analyse des risques de l'intervention ou à la demande du commandant des opérations de secours et consistant en l'envoi sur le terrain de professionnels de santé sapeurs-pompiers formés à la gestion de situations présentant un risque pour la santé et d'engins spécifiques offrant certaines ressources logistiques (eau potable, alimentation, abris visuels, atténuation des ambiances thermiques, lieu de repos, etc.).
Certaines initiatives locales en faveur de la prévention des risques peuvent également être mentionnées, comme l'engagement de moyens de décontamination, avec la mobilisation, par les Sdis de la Haute-Loire, de la Marne ou de l'Yonne par exemple, d'un véhicule chargé de décontaminer les personnels et de récupérer les équipements de protection individuelle (EPI) contaminés directement sur le site de l'intervention, ou encore le suivi spécifique assuré à l'initiative de certains Sdis en cas d'expositions particulièrement dangereuses, à l'instar du suivi toxicologique conduit par la sous-direction santé du Sdis de la Seine-Maritime avec l'appui du service de santé au travail du CHU de Rouen à la suite de l'incendie de Lubrizol ou du suivi des plombémies mené par la BSPP après l'incendie de Notre-Dame-de-Paris.
II. IL EST AUJOURD'HUI NÉCESSAIRE DE LEVER LES FREINS À LA MISE EN oeUVRE D'UNE VÉRITABLE POLITIQUE DE PROTECTION DE LA SANTÉ DES SAPEURS-POMPIERS
A. LE MANQUE DE VOLONTÉ POLITIQUE, LA COMPLEXITÉ DES PROCÉDURES ET L'INSUFFISANCE DES MOYENS FONT OBSTACLE À LA RÉALISATION DE PROGRÈS CONCRETS
1. Une réglementation limitative et des pratiques inadaptées aux enjeux font obstacle à une juste indemnisation des conséquences sanitaires de l'exercice des fonctions de sapeur-pompier
a) La liste des cancers pouvant être reconnus comme imputables à l'activité de sapeur-pompier est extrêmement limitée en France
S'agissant des cancers, pour ce qui concerne spécifiquement les sapeurs-pompiers, les tableaux de maladies professionnelles ne reconnaissent actuellement que deux types de cancer comme pouvant être présumés imputables au service, le carcinome du nasopharynx63(*) et le carcinome hépato-cellulaire64(*), une liste bien plus limitée que dans certains pays étrangers tels que le Canada ou les États-Unis.
Le mésothéliome et le cancer de la vessie, dont le lien avec l'exercice des fonctions de sapeur-pompier a été reconnu par le Circ, figurent dans ces tableaux65(*), mais la liste des travaux susceptibles de les provoquer n'inclut pas l'extinction des incendies.
Types de cancer pouvant être reconnus
imputables au service
chez les sapeurs-pompiers
|
Désignation des maladies |
Délai de prise en charge |
Liste des travaux susceptibles de provoquer l'affection en cause |
|
Carcinome du nasopharynx |
40 ans (sous réserve d'une exposition de 5 ans) |
(...) Travaux d'extinction des incendies |
|
Carcinome hépato-cellulaire |
30 ans |
(...) Services de secours et de sécurité : pompiers, secouristes, sauveteurs, ambulanciers, policiers, personnel pénitentiaire |
Source : Annexe II au code de la sécurité sociale : tableaux n° 30, 43 bis et 45
Le mode de construction des tableaux de maladies professionnelles pose lui-même question, dans la mesure où ils résultent de négociations entre les partenaires sociaux et ne suivent pas strictement l'évolution des connaissances scientifiques.
Les sociologues Anne Marchand et Marion Gaboriau, qui, reprenant l'expression de l'historien Paul-André Rosental, parlent de « maladies négociées », évoquent ainsi des « conflits d'intérêts qui opposent traditionnellement, d'un côté, les représentants du patronat - qui financent la prise en charge des maladies professionnelles et n'ont donc que peu d'intérêt à l'extension des tableaux - et, de l'autre, les syndicats de salariés qui luttent contre les phénomènes de sous-reconnaissance des maladies professionnelles » et soulignent qu' « au-delà de l'inscription des pathologies dans ces tableaux, la détermination des critères de reconnaissance des pathologies est, elle aussi, objet de luttes qui déterminent des modifications tantôt extensives en faveur des travailleuses et des travailleurs, tantôt restrictives, durcissant les conditions de reconnaissance des pathologies ».
Cette situation contraste avec celle de nombreux pays ou provinces étrangers, comme l'État du Nevada, aux États-Unis, où 28 types de cancer pourraient être reconnus comme maladies professionnelles au sein de cette population, ou le Canada.
Au Québec, l'article 29 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) prévoit qu'un travailleur est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il est atteint d'une maladie prévue par règlement et si, au jour où il reçoit le diagnostic de cette maladie, il rencontre les conditions particulières en lien avec cette maladie prévues par règlement.
Le règlement sur les maladies professionnelles (chapitre A-3.001, r. 8.1), pris pour son application, liste 9 types de cancer dont l'origine professionnelle est présumée si le sapeur-pompier satisfait aux conditions de type d'activité et de durée d'exposition prévues par ledit règlement.
Le fait d'avoir été fumeur pendant les 10 ans ayant précédé le diagnostic prive toutefois l'agent de la reconnaissance en maladie professionnelle pour ce qui concerne le cancer pulmonaire ou le mésothéliome pulmonaire et le cancer du larynx.
Types de cancer présumés imputables
au service chez les sapeurs-pompiers
au Québec
|
Maladies |
Conditions particulières |
|
Cancer pulmonaire ou mésothéliome pulmonaire |
Avoir exercé un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante |
|
Avoir exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d'incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l'enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l'emploi d'une ville ou d'une municipalité Le diagnostic doit avoir été posé après une durée d'emploi minimale de 15 ans Ne pas avoir été un fumeur pendant les 10 ans ayant précédé le diagnostic |
|
|
Mésothéliome non pulmonaire |
Avoir exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d'incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l'enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l'emploi d'une ville ou d'une municipalité |
|
Cancer du rein |
Avoir exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d'incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l'enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l'emploi d'une ville ou d'une municipalité Le diagnostic doit avoir été posé après une durée d'emploi minimale de 20 ans |
|
Cancer de la vessie |
Avoir exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d'incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l'enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l'emploi d'une ville ou d'une municipalité Le diagnostic doit avoir été posé après une durée d'emploi minimale de 20 ans |
|
Cancer du larynx |
Avoir exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d'incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l'enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l'emploi d'une ville ou d'une municipalité Le diagnostic doit avoir été posé après une durée d'emploi minimale de 15 ans Ne pas avoir été un fumeur pendant les 10 ans ayant précédé le diagnostic |
|
Myélome multiple |
Avoir exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d'incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l'enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l'emploi d'une ville ou d'une municipalité Le diagnostic doit avoir été posé après une durée d'emploi minimale de 15 ans |
|
Lymphome non hodgkinien |
Avoir exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d'incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l'enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l'emploi d'une ville ou d'une municipalité Le diagnostic doit avoir été posé après une durée d'emploi minimale de 20 ans |
|
Cancer de la peau (mélanome) |
Avoir exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d'incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l'enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l'emploi d'une ville ou d'une municipalité Le diagnostic doit avoir été posé après une durée d'emploi minimale de 15 ans |
|
Cancer de la prostate |
Avoir exercé un travail impliquant une exposition à des gaz et fumées d'incendie pendant des opérations visant à les maîtriser ou lors du déblaiement ou de l'enquête après leurs extinctions, et être ou avoir été un pompier combattant à temps plein ou à temps partiel, à l'emploi d'une ville ou d'une municipalité Le diagnostic doit avoir été posé après une durée d'emploi minimale de 15 ans |
Source : Règlement sur les maladies professionnelles (chapitre A-3.001, r. 8.1)
Au Canada, le nombre de types de cancer reconnus comme maladies professionnelles chez les sapeurs-pompiers varie selon les provinces et s'élève jusqu'à 19 dans l'Ontario.
Nombre global de maladies professionnelles spécifiques aux sapeurs-pompiers reconnues dans les différentes provinces du Canada
Source : Richard Amnotte, directeur adjoint et coordonnateur adjoint à la sécurité civile de la direction du service de sécurité incendie de la ville de Lévis (Québec)
b) Un grand nombre d'autres facteurs expliquerait l'absence de cas de cancer reconnu imputable au service chez les sapeurs-pompiers français
En tout état de cause, la CNRACL n'a enregistré depuis 2013 que 21 dossiers de demande d'ATIACL concernant des cancers professionnels (dont 18 ont reçu un avis d'octroi66(*) et 3 ont été rejetés), aucun d'entre eux n'émanant d'un sapeur-pompier professionnel. Il en va de même pour ce qui concerne les départs en retraite pour invalidité. La caisse n'a pas non plus identifié de dossier lié à un cancer chez les sapeurs-pompiers volontaires sur les dernières années.
À défaut de données épidémiologiques officielles, il est particulièrement difficile d'évaluer la prévalence de ces pathologies chez les sapeurs-pompiers et de déterminer si celles-ci sont sous-déclarées ou non.
De façon générale, le nombre de maladies professionnelles reconnues chaque année au sein de cette population paraît assez faible : pour 2022, le rapport statistique de la BND ne fait état que de 31 maladies professionnelles déclarées chez les sapeurs-pompiers professionnels67(*).
Répartition des évènements ayant affecté des sapeurs-pompiers professionnels en 2022
Source : Banque nationale de données, Rapport statistique - Services d'incendie et de secours, 2022
Les sociologues Anne Marchand et Marion Gaboriau avancent plusieurs éléments qui pourraient expliquer une éventuelle sous-déclaration :
- en matière de reconnaissance, en premier lieu :
? nombre de médecins refuseraient d'établir le certificat médical initial, du fait d' « un déficit de formation sur l'étiologie professionnelle et sur ce volet très pointu du droit de la sécurité sociale », de « l'ignorance du compromis social et du système de financement des maladies professionnelles », d' « un contexte d'intensification du travail qui ne favorise pas l'échange avec le patient sur ses conditions de travail », du « sentiment de s'éloigner de leur coeur de métier, le soin, pour entrer dans une zone de conflit » et du fait que certains d'entre eux « pensent qu'ils doivent certifier l'origine professionnelle alors qu'ils ne doivent certifier que le diagnostic » ;
? l'obtention des preuves de l'exposition de l'agent à des facteurs de risques est d'autant plus compliquée qu'elles sont anciennes et peu documentées, dans la mesure où « aucun dispositif de traçabilité institutionnel n'a été mis en place qui garantisse la fabrication et la conservation de manière pérenne de ces preuves du travail exposé », où « la rédaction (par les médecins de prévention) de rapports complets attestant précisément des expositions peut être négligée par manque de temps ou de connaissances pratiques des conditions de travail actuelles ou passées des travailleurs » et où « les changements de postes au cours d'une carrière professionnelle supposent pour les travailleurs d'obtenir ces attestations auprès d'employeurs multiples qui ne les délivrent pas systématiquement » (voir infra) ;
? la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie se fait substance par substance, tandis que la plupart des travailleurs sont polyexposés, soit simultanément, soit successivement, à des agents cancérogènes, sans que les effets de cette polyexposition soient suffisamment pris en compte ;
? les conseils médicaux sont « composés d'acteurs médicaux parfois éloignés des conditions de travail des potentielles victimes » et laissent « peu de place à l'expertise des travailleurs », leur attention étant concentrée sur l'existence de facteurs de risques extraprofessionnels, comme le tabac, qui peuvent justifier un refus de reconnaissance en maladie professionnelle68(*) ;
- en matière d'indemnisation, ensuite :
? en cas de maladie professionnelle reconnue hors tableau, le bénéfice de l'ATIACL est conditionné à la constatation d'une incapacité permanente d'au moins 25 %, seuil particulièrement élevé qui exclut du droit à indemnisation une partie des victimes potentielles ;
? le délai limite d'un an après la consolidation de l'état de santé prévu pour la demande d'attribution de l'ATIACL paraît trop restrictif, dans la mesure où les agents n'en ont pas toujours connaissance et « ne disposent pas toujours des ressources sociales et médicales nécessaires pour déposer des dossiers complets dans les délais impartis » ;
? enfin, certains employeurs publics décideraient « délibérément de ne pas informer les agents de l'évaluation médicale de leur taux d'incapacité afin de limiter les recours auprès des conseils médicaux départementaux ».
Au total, comme l'ont souligné à l'unanimité les organisations syndicales, la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle constitue aujourd'hui, pour les sapeurs-pompiers, un véritable parcours du combattant, que nombre d'entre eux renoncent vraisemblablement à traverser.
2. Les moyens consacrés à la protection de la santé des sapeurs-pompiers sont encore insuffisants
a) Des lacunes majeures fragilisent le suivi de l'exposition des sapeurs-pompiers aux facteurs de risques cancérogènes
Il ressort des auditions conduites par les rapporteures que, du fait de l'autonomie de gestion dont bénéficient les Sdis, il existe autant de politiques de prévention que d'établissements.
La problématique majeure, en la matière, réside dans la question de la documentation des expositions à des agents ou substances cancérogènes, qui devrait être assurée par le biais, notamment, de fiches d'exposition.
La documentation de l'exposition aux facteurs de
risques professionnels
dans la fonction publique
Jusqu'en 2015, l'employeur était tenu de consigner dans une fiche, pour chaque travailleur exposé à un certain nombre de risques professionnels, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur avait été exposé, la période au cours de laquelle cette exposition était survenue ainsi que les mesures de prévention mises en oeuvre pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période69(*). Cette fiche, dite « de pénibilité », devait être transmise au médecin du travail et compléter le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur.
La fiche de pénibilité ayant été supprimée lors de la création du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P)70(*), devenu depuis lors compte professionnel de prévention (C2P), les employeurs de travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du C2P (dont les fonctionnaires) et qui sont exposés aux facteurs de risques pris en compte dans le cadre du C2P (activités en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes et travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte) doivent désormais établir une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques auxquels sont exposés lesdits travailleurs au-delà des seuils réglementaires71(*).
L'employeur doit remettre la fiche individuelle de suivi au travailleur au terme de chaque année civile et la conserver par tout moyen pendant 5 ans après l'année à laquelle elle se rapporte.
Du reste, l'élaboration de fiches spécifiques est obligatoire dans certains cas, par exemple lorsqu'un travailleur est exposé à l'amiante. La fiche d'exposition à l'amiante doit ainsi indiquer :
- la nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
- les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;
- les procédés de travail utilisés ;
- et les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés72(*).
Au surplus, les employeurs sont tenus de répertorier dans un document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, de façon à assurer la traçabilité collective de ces expositions73(*).
Le DUERP et ses versions antérieures doivent être conservés par l'employeur et tenu à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs ainsi que de toute personne ou instance pouvant justifier d'un intérêt à y avoir accès pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration74(*).
Or, si, d'après la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), une fiche d'intervention comprenant des informations telles que la nature de l'intervention, l'heure et le lieu, les moyens engagés ou encore les actions réalisées serait effectivement renseignée pour chaque intervention de chaque sapeur-pompier dans l'ensemble des Sdis, une fiche d'exposition ne serait pas systématiquement remplie, de l'aveu même de la DGSCGC.
La CGT des Sdis de France, qui, comme l'ensemble des syndicats de sapeurs-pompiers, partage ce constat, indique pour sa part que même « les départements qui ont mis en place une forme de traçabilité sont loin d'une fiche systématique ».
De même, les médecins-colonels Michel Weber et Thierry Dulion, président et membre du conseil d'administration de l'Association nationale des médecins des services d'incendie et de secours (Anamnesis), constatent que « l'emploi d'une fiche d'exposition n'est pas généralisé dans l'ensemble des Sdis » et que « certains expérimentent des dispositifs, mais cela reste une initiative locale et dépendante des moyens octroyés et de la sensibilité des responsables ». Du reste, à la demande des rapporteures tendant à la transmission d'un modèle de fiche d'exposition, la DGSCGC a indiqué qu'un tel modèle n'existait pas.
Il en découlera nécessairement des difficultés pour les sapeurs-pompiers qui seront victimes d'une maladie professionnelle lorsqu'il s'agira d'apporter la preuve de leur exposition à des agents ou substances cancérogènes.
Par ailleurs, le contrôle de l'aptitude semble lui aussi inadapté aux enjeux de prévention. Il semble en effet qu'en raison de la désertification médicale, notamment, certains Sdis respectent difficilement la fréquence réglementaire des visites d'aptitude. L'Anamnesis regrette en outre le manque de moyens dédiés au suivi de la santé des sapeurs-pompiers. La CGT des Sdis de France, qui juge que « le contrôle de l'aptitude médicale se borne à constater la capacité des agents à exercer des fonctions opérationnelles », illustre cette situation par le cas dramatique d'un sapeur-pompier du Nord reconnu apte à l'exercice de son activité et chez qui un cancer métastatique a été diagnostiqué au cours de la même, entraînant son décès moins de 5 mois plus tard.
Enfin, il en irait de même du suivi post-professionnel, qui, d'après l'Anamnesis, serait « très variable » en raison de l'absence d'une coordination au niveau national et se bornerait en pratique à inviter le sapeur-pompier, au moment de la cessation de ses fonctions, à consulter régulièrement son médecin traitant. En tout état de cause, ainsi que le souligne la DGSCGC, comme pour ce qui concerne le contrôle de l'aptitude, la mise en oeuvre du suivi post-professionnel par les Sdis « peut s'avérer difficile lorsque ces derniers sont confrontés aux très fortes tensions nationales d'accès aux médecins du travail ».
b) Le développement d'équipements de protection individuelle adaptés aux risques se fait toujours attendre
D'après l'Anamnesis, l'obligation de port d'un ARI lorsque l'air est vicié serait « parfois non appliquée jusqu'à la phase ultime de l'exposition » du fait :
- d'une part, d'un ressenti du risque amoindri dans cette dernière phase, dans la mesure où les fumées résiduelles sont alors beaucoup moins intenses ;
- d'autre part, de l'absence de marqueur objectif et simple à recueillir pouvant servir de base à une autorité pour décider de l'arrêt du port de l'ARI ;
- et enfin, de la balance faite par les sapeurs-pompiers entre les bénéfices de la protection respiratoire et les contraintes liées au port de l'ARI (réduction sensorielle et communicationnelle, gestes et postures contraignantes, déplacements de charges lourdes, etc.).
En outre, alors qu'elle dépend du degré de connexion de celui-ci avec la peau de son porteur, l'étanchéité du masque est susceptible d'être limitée par le port de la barbe.
À défaut de porter un ARI, les sapeurs-pompiers recourent à une cagoule. Toutefois, comme l'a constaté le Ceren dès 2018 (voir supra), le modèle actuellement utilisé ne filtre ni les particules fines ni les composés chimiques contenus dans les fumées et ne se limite qu'à la protection thermique.
Bien qu'un nouveau modèle assurant un niveau de filtration de 70 % au moins - il n'est pas envisageable, en pratique, d'assurer une filtration intégrale pour des raisons liées à l'enjeu de respirabilité de l'équipement - ait été élaboré dans le cadre de travaux menés entre la DGSCGC, le Ceren et les organismes de certification, sa mise sur le marché ne s'opérera que progressivement, dans la mesure où seule la partie relative à la protection thermique a été certifiée. La certification de celle qui concerne la protection filtrante devrait normalement être délivrée en 2024.
Quoi qu'il en soit, une fois cette cagoule mise à leur disposition, les Sdis demeureront libres d'en faire l'acquisition ou non. Or, son coût devant atteindre 40 à 50 euros selon la DGSCGC, contre une quinzaine d'euros pour le modèle actuel, il est peu crédible que les sapeurs-pompiers en soient massivement équipés dans les années à venir compte tenu des contraintes pesant sur les finances des collectivités territoriales.
En outre, cette cagoule ne filtrera pas les substances autres que les particules fines auxquelles sont exposés les sapeurs-pompiers lors de l'extinction des incendies. Les rapporteures soulignent par ailleurs que l'incidence du port de cet équipement sur la respiration et la thermorégulation n'est pas certaine.
Dans le même temps, la DGSCGC a engagé des travaux pour concevoir une tenue répondant aux enjeux à la fois de protection thermique et de protection cutanée contre les fumées et les particules fines et dont les caractéristiques sont les mêmes que celles de la cagoule de protection filtrante. Pour autant, les premières certifications ne devant intervenir que courant 2024, sa mise sur le marché ne semble pas envisagée à court terme.
c) La collecte et l'analyse de données épidémiologiques pourrait retarder l'action gouvernementale en faveur des sapeurs-pompiers
En réponse à une question au Gouvernement posée par le député Yannick Monnet (Gauche démocrate et république - Nupes) le 25 octobre 2023 au sujet du manque de données épidémiologiques relatives aux sapeurs-pompiers, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin, a reconnu un « retard s'agissant de la récolte de données » et annoncé avoir « lancé une étude épidémiologique sur les sapeurs-pompiers conduite par le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) » avec le ministre de la santé « il y a plus de six mois », soit au printemps de 2023.
En précisant que « sa réalisation prendra un certain temps », le ministre s'est engagé à tirer « toutes les conclusions qui s'imposent en matière de suivi et d'accompagnement professionnel » et à « revenir vers (les parlementaires) lorsque les résultats de cette étude nous seront connus et à apporter à nos sapeurs-pompiers tout l'accompagnement qu'un grand pays comme la France se doit de leur fournir ».
D'après les informations communiquées par la DGSCGC, il semble en réalité que l'initiative prise par le Gouvernement consiste à la fois :
- en « un partenariat sur une thèse visant à documenter et à évaluer les effets sur la santé à moyen et long terme de l'activité des sapeurs-pompiers » ;
- en l'élaboration d' « une matrice emploi-tâche-exposition qui permettra d'identifier et coter les expositions des pompiers dans toutes leurs activités dans le but d'augmenter la connaissance par les sapeurs-pompiers de leur encadrement sur les risques inhérents à leurs activités, qui permettra au médecin d'envisager le suivi post-exposition et qui contribuera à faciliter la reconnaissance de maladies professionnelles » ;
- en l'établissement d' « une méthodologie visant à évaluer et à mesurer le niveau d'exposition aux toxiques des fumées, des suies et particules fines lors de feux de forêts », mission confiée aux centres de recherche de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) et de l'École d'application de sécurité civile (ECASC) ;
- et en l'installation d'un « observatoire des sapeurs-pompiers », chargé de « travailler collectivement à l'élaboration de consensus sociaux en amont des résultats objectivés scientifiquement qui demandent du temps ».
S'agissant des travaux universitaires en cours, la professeure Catherine Delgoulet, titulaire de la Chaire d'ergonomie du Cnam, a indiqué aux rapporteures qu'il s'agissait d'une thèse en ergonomie réalisée par Charlyne Poncato, doctorante, et financée dans le cadre du programme de formation doctorale Santé-Travail porté par l'École des hautes études en santé publique (EHESP)75(*).
Catherine Delgoulet, qui co-encadre ces travaux, estime néanmoins que ceux-ci ne sont pas suffisamment aboutis à ce jour pour lui permettre d'en rendre compte. Du reste, Laura Temime, directrice du laboratoire MESuRS du Cnam, précise qu' « en tant qu'établissement supérieur et de recherche, le Cnam ne peut être saisi par le Gouvernement pour traiter un sujet, comme pourrait l'être une agence ».
Pour ce qui concerne la matrice tâches-exposition, sa réalisation a été confiée par la DGSCGC au professeur de santé et médecine du travail et épidémiologiste spécialisé dans les risques professionnels Alexis Descatha le 2 mars 2023. La lettre de mission, consultée par les rapporteures, indique : « Vous avez volontiers accepté de contribuer à notre conseil scientifique en santé et nous vous en remercions. Dans ce cadre, nous sollicitons votre concours dans la perspective d'un travail de recherche visant à aboutir à établir plus finement les risques et leurs conséquences pour la santé subis par les sapeurs-pompiers. Ce travail pourrait prendre la forme d'une matrice tâches-exposition, tant pour le travail des sapeurs-pompiers professionnels que pour l'activité des sapeurs-pompiers volontaires ».
Aucune échéance n'ayant été fixée pour la présentation de ses travaux, le professeur Descatha a proposé de « développer un outil avec une approche participative, c'est-à-dire construite en lien avec les parties prenantes (sapeurs-pompiers notamment) » sur une période de deux ans, avec des points d'étapes réguliers.
Bien que leur lancement soit extrêmement encourageant, il est à craindre que ces démarches ne servent de prétexte au report sine die des mesures indispensables à la prévention des risques et à l'indemnisation de leurs conséquences sur la santé des sapeurs-pompiers, alors que le Circ, autorité incontestée, à clairement reconnu le caractère cancérogène de leur activité.
B. MIEUX PROTÉGER CEUX QUI NOUS PROTÈGENT : UN ENJEU DE SOLIDARITÉ NATIONALE ET DE SANTÉ PUBLIQUE
1. La procédure de reconnaissance de l'imputabilité au service des cancers des sapeurs-pompiers doit être simplifiée et les expositions mieux tracées
a) L'élargissement de la présomption d'imputabilité au service aux types de cancer dont le lien avec l'activité de sapeur-pompier est établi est particulièrement urgent
Compte tenu à la fois de l'exigence de préservation de la santé de ceux qui consacrent leur vie à la protection des Français, de la gravité des risques encourus par eux et de leurs conséquences potentielles, de la reconnaissance, à l'échelle internationale et de par le monde, de la cancérogénicité de l'activité de sapeur-pompier et du risque de sous-déclaration lié à la complexité des démarches à entreprendre en vue de la reconnaissance d'une pathologie en maladie professionnelle, il est aujourd'hui nécessaire de faire évoluer la réglementation dans le sens d'une automatisation plus large de cette reconnaissance chez les sapeurs-pompiers.
Les rapporteures invitent donc le Gouvernement à proposer sans délai aux partenaires sociaux la création d'un tableau de maladies professionnelles spécifique regroupant l'ensemble des pathologies liées aux travaux d'extinction des incendies.
Y seraient intégrés, outre les deux types de cancer pouvant d'ores et déjà faire l'objet d'une présomption d'imputabilité au service (carcinome du nasopharynx et carcinome hépato-cellulaire), le mésothéliome et le cancer de la vessie, dont le développement a été reconnu par le Circ comme directement imputable à l'activité de sapeur-pompier sur la base de preuves suffisantes, ainsi que les cancers du côlon, de la prostate et des testicules, le mélanome et le lymphome non hodgkinien, dont l'imputabilité à cette activité découle de preuves encore limitées, mais non moins significatives.
Dans ce cadre, pourraient être prévus un délai de prise en charge de 40 ans, identique au délai applicable, par exemple, au carcinome du nasopharynx, et une durée d'exposition de 15 à 20 ans, comme c'est le cas au Québec.
Il importe de noter que, si ces pathologies ne peuvent pas encore être présumées imputables au service chez les sapeurs-pompiers, elles peuvent d'ores et déjà faire l'objet d'une reconnaissance en maladie professionnelle, soit si plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie ne sont pas remplies, soit si celle-ci ne figure pas dans les tableaux, sur la base de preuves du lien entre son apparition et l'exercice des fonctions, qui doivent être apportées par le sapeur-pompier ou ses ayants droit.
Les rapporteures préconisent de prévoir une clause de revoyure afin d'adapter le tableau spécifique en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques.
Une évolution de cette nature de la réglementation applicable simplifiera considérablement les démarches des victimes potentielles, en leur épargnant la contrainte de devoir fournir des preuves souvent difficiles à obtenir (voir supra).
Les rapporteures insistent sur l'urgence que revêt la mise en oeuvre de cette mesure, qui ne saurait attendre une nouvelle analyse de données épidémiologiques certes utile pour affiner la compréhension des risques, mais dispensable dans cette perspective, compte tenu des conclusions du Circ.
Elle permettra, du reste, de placer la France à la pointe du progrès social en la matière, aux côtés de grandes nations telles que l'Australie, les États-Unis ou le Canada. Sur ce sujet plus que sur aucun autre, les disparités réglementaires internationales ne sauraient en effet se justifier. De fait, comme l'a très justement relevé Richard Amnotte, directeur adjoint et coordonnateur adjoint à la sécurité civile de la direction du service de sécurité incendie de la ville de Lévis, au Québec, « un cancer est un cancer et un pompier est un pompier. Où qu'il soit dans notre grand pays, les risques sont les mêmes, les combustibles présents dans les incendies sont les mêmes et l'être humain est constitué de la même matière, quel que soit son lieu de résidence ou de pratique du métier de pompier ».
Proposition n° 1 : Créer un tableau de maladies professionnelles regroupant les pathologies liées aux travaux d'extinction des incendies.
Proposition n° 2 : Élargir la présomption d'imputabilité au service aux types de cancer dont le lien avec l'activité de sapeur-pompier est reconnu par le Circ.
Dans la même logique de simplification, la mise en oeuvre systématique d'une évaluation des droits à l'ATIACL au terme d'un Citis devrait être envisagée afin de limiter le non-recours à cette prestation.
Proposition n° 3 : Procéder systématiquement à l'évaluation des droits à l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales au terme d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
b) Dans le même temps, le renforcement de la traçabilité de l'exposition à des facteurs de risque consoliderait les dossiers de demande de reconnaissance en maladie professionnelle
En parallèle, pour ce qui concerne les types de cancer qui ne feraient pas l'objet d'une présomption d'imputabilité au service, il est indispensable de renforcer la traçabilité des expositions subies par les sapeurs-pompiers afin de leur permettre d'apporter la preuve du lien entre une éventuelle pathologie et leur activité.
Les rapporteures préconisent donc l'édiction d'un modèle national de fiche d'exposition spécifique à l'activité de sapeur-pompier, dont la réglementation devrait prescrire le remplissage par les Sdis après chaque intervention ayant induit une exposition significative et, à défaut, sur une base annuelle. Cette fiche devrait permettre de distinguer les incendies sur la base d'une classification qui serait établie par la DGSCGC en fonction de leur localisation et des caractéristiques des produits de combustion. Il serait nécessaire qu'elle soit intégrée au dossier médical de chaque sapeur-pompier et tenue à sa disposition.
Proposition n° 4 : Élaborer un modèle national de fiche d'exposition à des facteurs de risques spécifique à l'activité de sapeur-pompier.
Proposition n° 5 : Rendre obligatoire le remplissage d'une fiche d'exposition après chaque intervention à risque sanitaire.
Ces mesures pourraient pleinement s'inscrire dans le cadre de la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030, qui a fixé l'objectif de « mieux reconnaître les expositions professionnelles pour mieux prévenir les cancers professionnels ». Celui-ci doit être atteint au travers de six actions, dont la poursuite de l'adaptation de la réglementation et des dispositifs de prévention à l'état des connaissances scientifiques et le contrôle de leur application, ainsi que la lutte contre la sous-déclaration des cancers professionnels.
2. En amont, l'effort de prévention des risques doit mobiliser tous les moyens disponibles
Aux yeux des rapporteures, la limitation de l'exposition à des facteurs de risques et la prévention des maladies professionnelles constituent une priorité absolue. En effet, nul ne saurait se satisfaire d'une meilleure reconnaissance de l'origine professionnelle de ces pathologies si celles-ci peuvent être en grande partie évitées par la mise en oeuvre de mesures de bon sens.
À cet égard, les pouvoirs publics ne disposent pas de moyens d'action que dans le cadre de la prévention tertiaire, c'est-à-dire en matière de reconnaissance de l'imputabilité des pathologies au service, mais aussi dans celui de la prévention primaire et secondaire.
a) La prévention primaire : limiter l'exposition aux facteurs de risques
La prochaine mise sur le marché du nouveau modèle de cagoule filtrante devrait creuser les disparités en matière de protection individuelle, dans la mesure où son acquisition relèvera de chaque Sdis. Une telle situation serait inacceptable, compte tenu des sacrifices consentis par les soldats du feu, qui sont exposés aux mêmes risques lorsqu'ils inhalent des fumées quel que soit leur département.
Les rapporteures invitent donc l'État à accorder aux Sdis une dotation exceptionnelle destinée à assurer leur équipement en cagoules de nouvelle génération, plus largement en EPI dont l'efficacité est prouvée scientifiquement. Cette aide pourrait s'inscrire dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement structurant des services d'incendie et de secours, attribuée par le ministre de l'intérieur pour une dépense d'investissement intervenant dans le champ de la sécurité civile et concourant à la mise en oeuvre de projets présentant un caractère structurant, innovant ou d'intérêt national76(*).
Proposition n° 6 : Accorder aux Sdis une dotation exceptionnelle destinée à l'acquisition du nouveau modèle de cagoules filtrantes et d'EPI dont l'efficacité est prouvée scientifiquement.
Il paraît également nécessaire d'inviter les fabricants d'ARI à investir dans l'innovation afin de produire des équipements plus adaptés à la morphologie de leurs porteurs, moins lourds et encombrants.
b) La prévention secondaire : dépister les pathologies le plus précocement possible
L'objet de la prévention secondaire réside dans le dépistage précoce des pathologies. La problématique de la désertification médicale constitue certes une difficulté majeure limitant l'accès de tous à la médecine préventive et doit être appréhendée dans un cadre plus large que celui de la présente mission d'information.
En tout état de cause, considérant les enjeux spécifiques à l'exercice d'une activité de sapeur-pompier en termes de risques professionnels, il paraîtrait judicieux de mettre en place, à intervalles réguliers, des programmes nationaux de surveillance médicale spécifiques comprenant des examens de dépistage précoce des cancers dont le lien avec ces fonctions est établi, comme le préconise le Groupement syndical national des sapeurs-pompiers volontaires (GSNSPV).
Au surplus, il paraîtrait judicieux de renforcer le suivi post-professionnel des sapeurs-pompiers en obligeant les Sdis à proposer tous les cinq ans à leurs retraités une visite de contrôle réalisée par un médecin de sapeurs-pompiers.
Les données collectées dans ce cadre pourraient ensuite alimenter un Observatoire de la santé des sapeurs-pompiers, qui serait chargé de les analyser sur le long-terme et de formuler des propositions tendant à limiter l'exposition aux facteurs de risques et à mieux réparer leurs conséquences.
Proposition n° 7 : Mener des programmes nationaux de surveillance médicale dédiés aux sapeurs-pompiers à des fins de dépistage des cancers et de collecte de données épidémiologiques.
Proposition n° 8 : Renforcer le suivi post-professionnel en obligeant les Sdis à proposer aux sapeurs-pompiers retraités une visite médicale de contrôle tous les cinq ans.
Proposition n° 9 : Installer un Observatoire de la santé des sapeurs-pompiers chargé d'analyser les données épidémiologiques disponibles et de proposer des mesures visant à renforcer la protection des agents.
De surcroît, l'amélioration du niveau de connaissance et la sensibilisation des médecins et infirmiers de sapeurs-pompiers en matière de reconnaissance des maladies professionnelles est indispensable. L'Anamnesis suggère dès lors d'assurer une meilleure formation77(*), qui, sans chercher à les spécialiser en médecine du travail, leur permettrait d'en acquérir les principes généraux, les bases réglementaires et les modes d'application dans le contexte spécifique de l'exercice des fonctions de sapeur-pompier.
Proposition n° 10 : Renforcer la formation des médecins et infirmiers de sapeurs-pompiers en médecine du travail.
De façon générale, les rapporteures souhaiteraient que les sapeurs-pompiers soient systématiquement informés des risques induits par cette activité dès leur première visite d'aptitude, et ce afin de leur permettre de prendre conscience qu'ils doivent être les premiers acteurs de la protection de leur santé.
EXAMEN EN COMMISSION
M. Philippe Mouiller, président. - Nous entendons à présent la communication d'Anne-Marie Nédélec et Émilienne Poumirol à l'issue des travaux de la mission d'information qu'elles ont conduite sur les cancers imputables à l'activité de sapeur-pompier.
Je vous rappelle que les travaux de nos collègues s'inscrivent dans le programme de contrôle de la commission pour la session 2023-2024.
Mme Anne-Marie Nédélec, rapporteure. - En tant qu'élus des territoires de la République, nous sommes tous ici particulièrement attentifs à ce qui concerne les sapeurs-pompiers, qui assurent chaque jour un service public particulièrement précieux auprès de nos concitoyens.
Nous comptons au total un peu moins de 253 000 sapeurs-pompiers en France, dont près de 80 % sont volontaires. Leur activité est évidemment dangereuse : risques traumatiques, toxiques, infectieux, cardio-vasculaires, routiers, psychologiques, de stress thermique, de déshydratation, de troubles musculosquelettiques, etc.
Il est en revanche un risque dont nous parlons trop peu, je veux parler de celui de développer une maladie professionnelle, notamment un cancer.
Il est important de préciser, pour commencer, que trop peu d'études ont porté sur ce sujet dans notre pays au cours des dernières décennies - deux, en l'occurrence. Publiées en 1995 et en 2012, elles concluent à une mortalité globale plus faible chez les sapeurs-pompiers par rapport à la population générale, ce qui pourrait s'expliquer par un biais appelé le « phénomène du travailleur sain » : les soldats du feu sont généralement en meilleure santé physique que le reste de la population. S'agissant de la mortalité par cancer en particulier, si la seconde étude ne notait qu'une surmortalité modérée, mais non statistiquement significative pour certains types de cancers, la première aboutissait au constat d'une mortalité supérieure pour les cancers uro-génitaux, respiratoires et digestifs.
En outre, l'an dernier, il est apparu au terme d'une étude britannique portant sur près de 11 000 sapeurs-pompiers qu'un cancer avait été diagnostiqué chez 4 % d'entre eux. Il s'agissait, dans plus d'un tiers des cas, d'un cancer de la peau et, dans 12 % des cas, d'un cancer des testicules. Les auteurs de cette étude, qui doit certes être regardée avec prudence en raison du champ statistique restreint, estimaient que le taux de cancer était supérieur de 323 % chez les sapeurs-pompiers âgés de 35 à 39 ans par rapport à la population générale.
Il est regrettable que nous ne disposions pas de données épidémiologiques pouvant servir de base de travail fiable, recueillies sur le long terme au sein d'un échantillon assez large. Nous ne sommes pas les premières à le déplorer : le colonel Christian Pourny, dans son fameux rapport de 2003, le notait déjà, en invitant à créer une banque nationale de données (BND). Cette BND a été créée depuis lors au sein de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), mais elle ne présente qu'un intérêt limité dans la mesure où tous les départements ne l'alimentent pas et où les maladies professionnelles sont, comme les accidents du travail, largement sous-déclarées en France.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux que les sapeurs-pompiers s'exposent, dans l'exercice de leurs fonctions, à nombre d'agents et de substances reconnues cancérogènes. Citons par exemple certains produits de combustion, comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des matériaux de construction, comme l'amiante, les substances perfluorées et polyfluorées (PFAS) contenues dans les émulseurs des produits d'extinction ou encore les retardateurs de flammes libérés dans l'air au cours de la combustion des objets du quotidien. Ces derniers ont d'ailleurs été retrouvés chez tous les sapeurs-pompiers ayant participé à des analyses biologiques organisées par l'équipe de l'émission de France Télévisions « Vert de rage » avec une université américaine et un laboratoire tchèque, y compris l'un d'entre eux, le BDE-209, à des niveaux très importants.
Il est donc logique que, en juin 2022, le Centre international de recherche sur le cancer (Circ), agence de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ait classé l'activité de sapeur-pompier comme cancérogène pour l'homme sur la base de preuves suffisantes pour le mésothéliome et le cancer de la vessie et de preuves limitées pour les cancers du côlon, de la prostate et des testicules, le mélanome et le lymphome non hodgkinien. Pour ce qui concerne le mésothéliome, le risque serait plus élevé de 58 % chez les pompiers qu'au sein de la population générale ; il serait supérieur de 16 % dans le cas du cancer de la vessie.
Dans ce contexte, quel est donc l'état du droit en France en ce qui concerne la reconnaissance d'un cancer en maladie professionnelle chez un sapeur-pompier ?
Depuis 2017, les fonctionnaires, y compris les sapeurs-pompiers professionnels, bénéficient d'une présomption d'imputabilité au service pour tout cancer désigné par un tableau de maladies professionnelles et contracté en service ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions mentionnées par ledit tableau. Si l'autorité territoriale compétente estime que la pathologie n'est pas imputable au service, il lui appartient désormais d'en apporter la preuve, dont la charge se trouve ainsi inversée.
En tout état de cause, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste des travaux susceptibles de provoquer l'affection ne sont pas remplies, l'imputabilité au service d'une maladie désignée par un tableau peut tout de même être reconnue, si l'agent prouve qu'elle a été directement causée par l'exercice de ses fonctions.
Une pathologie peut enfin être reconnue comme ayant une origine professionnelle, y compris si elle ne figure pas dans les tableaux, à la double condition que l'agent établisse qu'elle a été essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'au moins 25 %. Dans ces deux derniers cas, le conseil médical départemental, composé de médecins, de représentants du service départemental d'incendie et de secours (Sdis) et de représentants du personnel, est obligatoirement consulté pour avis avant que le Sdis ne prenne sa décision sur l'imputabilité de la maladie au service.
Si son origine professionnelle est reconnue et si une incapacité temporaire de travail en découle, le fonctionnaire peut prétendre à un congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) durant lequel il conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il reprenne ses fonctions ou soit mis à la retraite. Du reste, il a également droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie.
Le temps passé en congé est pris en compte pour la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade, ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite. Si, au terme du congé, il est apte à reprendre ses fonctions, le fonctionnaire doit être réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade. Le cas échéant, il peut demander le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) cumulable avec son traitement s'il est atteint d'une incapacité permanente partielle résultant de la maladie. S'il est en revanche dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions, il peut être admis à la retraite pour invalidité.
De même, un sapeur-pompier volontaire atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service pourra bénéficier de la prise en charge des frais médicaux directement liés à cette maladie, d'une indemnité journalière compensant la perte de revenus subie du fait de l'incapacité temporaire de travail et d'une allocation ou rente en cas d'incapacité permanente.
Au-delà de ces dispositifs de réparation, les pouvoirs publics ont accentué, depuis la publication du rapport Pourny, leurs efforts en matière de prévention des risques.
Sur le plan du suivi médical, d'abord. Les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient ainsi de l'intervention des services de médecine préventive, avec notamment une visite d'information et de prévention au minimum tous les deux ans. Ils sont également astreints à un contrôle régulier de l'aptitude médicale, laquelle est prononcée par un médecin de sapeurs-pompiers tous les ans, ou tous les deux ans pour les sapeurs-pompiers âgés de 16 à 38 ans. Dans ce cadre, le médecin peut notamment prescrire un contrôle radiologique pulmonaire au moins tous les trois ans à partir de 40 ans. Le Gouvernement envisage d'ailleurs de réformer le contrôle de l'aptitude afin d'harmoniser les pratiques et de les adapter aux évolutions de la médecine. Enfin, un suivi post-professionnel est ouvert depuis 2015 aux agents ayant notamment été exposés à une substance cancérogène. Celui-ci est assuré soit par le service de médecine préventive, soit par un médecin choisi par l'agent, les frais en découlant étant intégralement pris en charge par le Sdis.
La prévention s'inscrit également dans le cadre opérationnel. Au travers de son fonds national de prévention (FNP), la CNRACL contribue ainsi au financement de projets en la matière et d'études épidémiologiques. Elle met également à la disposition des Sdis de la documentation sur les risques professionnels, ainsi qu'un logiciel, dénommé Prorisq, qui leur permet de suivre leur sinistralité.
La Caisse s'est enfin trouvée à l'origine de plusieurs initiatives importantes ces dernières années, à commencer par la constitution d'un groupe de travail sur les risques liés aux fumées d'incendie ayant abouti à un rapport contenant quarante-trois recommandations et à la publication par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) d'un guide de doctrine opérationnel sur la prévention desdits risques.
Je citerai également le rapport du Centre d'essai et de recherche de l'Entente méditerranéenne (Ceren) sur l'efficacité de filtration des cagoules utilisées lors des feux de forêts, commandité par la CNRACL, qui a démontré que ces cagoules ne filtraient quasiment rien et conduit à l'élaboration d'un nouveau modèle de cagoules, dont le taux de filtration atteint au moins les 70 %. L'enjeu de la prévention des risques professionnels semble donc bel et bien assimilé par les pouvoirs publics.
Mme Émilienne Poumirol, rapporteure. - Néanmoins, des progrès majeurs nous semblent encore devoir être réalisés. En effet, pour ce qui concerne les sapeurs-pompiers, seuls deux types de cancer sont aujourd'hui présumés imputables au service, à savoir le carcinome du nasopharynx et le carcinome hépatocellulaire, dont le lien avec l'activité de sapeur-pompier ne semble pourtant établi par aucune publication. Les tableaux sont en effet édictés par le Gouvernement après consultation des partenaires sociaux, selon des logiques visiblement assez éloignées de l'état des connaissances scientifiques. Si le cancer de la vessie et le mésothéliome, dont le lien avec l'activité de sapeur-pompier a été confirmé par le Circ, figurent bien dans les tableaux de maladies professionnelles, la liste des travaux susceptibles de les provoquer n'inclut pas l'extinction des incendies. Les agents potentiellement concernés sont donc contraints d'apporter la preuve du lien direct entre ces pathologies et l'exercice de leurs fonctions, ce qui est souvent difficile à matérialiser.
Certains autres pays développés, comme les États-Unis ou le Canada, sont bien en avance sur la France à cet égard. Ainsi, 28 types de cancer pourraient être reconnus comme maladies professionnelles chez les sapeurs-pompiers dans l'État du Nevada. Au Canada, ce nombre varie selon les provinces et va jusqu'à 19 en Ontario. Au Québec, en particulier, 9 types de cancer sont présumés imputables au service : les cancers du rein, de la vessie, de la peau et de la prostate, le myélome multiple, le lymphome non hodgkinien, le mésothéliome non pulmonaire ou pulmonaire et le cancer du larynx, ces deux derniers ne pouvant l'être qu'à la condition que le malade n'ait pas été fumeur pendant les dix ans ayant précédé le diagnostic.
Pour revenir au cas français, la CNRACL nous a indiqué n'avoir enregistré, au cours des dix dernières années, que 21 demandes d'allocation temporaire d'invalidité concernant des cancers professionnels chez des fonctionnaires territoriaux, sans qu'aucun d'entre eux n'émane d'un sapeur-pompier. Du reste, seules 31 maladies professionnelles ont été déclarées chez les sapeurs-pompiers professionnels en 2022, ce qui laisse deviner une forte sous-déclaration. Plusieurs facteurs d'explication de ce phénomène peuvent être avancés : le refus du médecin d'établir le certificat initial à défaut de formation ou de compréhension de la procédure, une prise en compte insuffisante de la polyexposition, des biais au sein des conseils médicaux en défaveur des travailleurs, l'extrême complexité de la procédure de reconnaissance et d'indemnisation ou encore la difficulté à obtenir des preuves de l'exposition à des facteurs de risque, qu'aggrave le caractère très limitatif des tableaux de maladies professionnelles dans leur état actuel s'agissant du cas des pompiers.
En matière de prévention aussi, nous pouvons et devons faire mieux. Le principal obstacle à son développement réside dans l'autonomie de gestion des Sdis, qui empêche toute coordination à l'échelle nationale. Je veux insister, à titre d'illustration, sur le cas des fiches d'exposition. Il ressort de nos auditions que certains Sdis tâcheraient de tracer les expositions auxquelles sont soumis leurs agents, mais que ces pratiques ne seraient ni systématiques ni généralisées. Et pour cause, aucune prescription législative ou réglementaire n'existe, pas plus, d'ailleurs, qu'un modèle national de fiche d'exposition. À défaut, il est extrêmement difficile pour les sapeurs-pompiers victimes d'un cancer, sans pouvoir prétendre à la présomption d'imputabilité au service, de démontrer le lien entre leur activité et cette pathologie.
À cela s'ajoutent les insuffisances constatées en matière de suivi médical. Du fait de la désertification médicale, bien des Sdis rencontreraient en effet des difficultés à respecter la fréquence réglementaire des visites d'aptitude, dans le cadre desquelles, au surplus, les médecins se bornent à constater la capacité des agents à exercer des fonctions opérationnelles, sans réel examen de leur état de santé. Le suivi post-professionnel, quant à lui, se heurterait à la même problématique de démographie médicale et se résumerait en pratique à une invitation faite à l'agent, au moment de la cessation de ses fonctions, à consulter régulièrement son médecin traitant. Notons, par ailleurs, que ce suivi ne concerne que les sapeurs-pompiers professionnels, à l'exclusion des volontaires.
Nous avons également relevé de sérieuses lacunes s'agissant des équipements de protection individuelle (EPI) utilisés par les Sdis. Si les logiques d'héroïsation tendent à céder le pas à une responsabilisation accrue des sapeurs-pompiers, le port des appareils respiratoires isolants (ARI) ne serait pas systématique, en raison, notamment, des contraintes qu'ils représentent en opération - ils pèsent 14 kilos et posent des problèmes de thermorégulation. Or, il est démontré que la capacité de filtration de la cagoule qui leur est parfois substituée est nulle. Le prototype de cagoule filtrante n'est, quant à lui, toujours pas certifié et n'est donc pas encore accessible. En tout état de cause, quand il le sera, son coût devrait représenter le triple de celui des cagoules actuelles, ce qui limitera vraisemblablement les possibilités d'acquisition par les Sdis, dont les finances sont hélas particulièrement contraintes. Ce dispositif filtrera au moins 70 % des particules fines, mais pas les autres substances chimiques libérées au cours de la combustion, et ses conséquences sur la respiration et la thermorégulation ne sont pas certaines.
Sur le plan scientifique, enfin, le ministre de l'intérieur a annoncé, en fin d'année dernière, avoir lancé une étude épidémiologique conduite par le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Nous avons donc souhaité en savoir un peu plus sur cette initiative. Il apparaît en réalité que celle-ci correspond à la fois à un soutien apporté à une thèse en ergonomie en cours d'élaboration, qui vise à documenter et à évaluer les effets sur la santé de l'activité de sapeur-pompier, et à la conception d'une matrice tâches-expositions, qui doit permettre de mieux identifier les expositions des sapeurs-pompiers et de faciliter le suivi médical et la reconnaissance d'éventuelles maladies professionnelles. Bien qu'il ne s'agisse donc pas réellement d'une étude épidémiologique à proprement parler, contrairement à ce qu'a affirmé Gérald Darmanin devant l'Assemblée nationale, nous nous réjouissons de ces démarches, qui s'inscrivent dans le bon sens. Néanmoins, nous craignons qu'elles servent de prétexte au Gouvernement pour reporter aux calendes grecques la mise en oeuvre des mesures d'urgence qu'impose la reconnaissance à l'échelle internationale de la cancérogénicité de l'activité de sapeur-pompier.
Nous formulons par conséquent dix propositions visant à mieux protéger la santé des soldats du feu. D'abord et avant toute chose, il est impératif de simplifier et de favoriser la reconnaissance en maladie professionnelle des cancers imputables à la lutte contre l'incendie. Nous invitons donc le Gouvernement, qui y est habilité, à soumettre aux partenaires sociaux la création d'un tableau de maladies professionnelles spécifique regroupant les pathologies liées aux travaux d'extinction des incendies, aujourd'hui éparpillées entre plusieurs tableaux.
Devraient alors y être intégrés les sept types de cancer dont le lien avec l'activité de sapeur-pompier a été affirmé par le Circ, avec un délai de prise en charge de quarante ans et une durée d'exposition minimale de quinze à vingt ans. Il ne s'agit pas de permettre leur reconnaissance en maladie professionnelle, ce qui est déjà possible sous condition d'apporter la preuve de leur lien avec l'extinction des incendies, mais de leur appliquer la présomption d'imputabilité au service chaque fois que les conditions que je viens de mentionner seront remplies. Du reste, une clause de revoyure devrait permettre à l'avenir de mettre à jour ce tableau spécifique en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques. De plus, nous préconisons de procéder systématiquement à l'évaluation des droits à l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) des agents des collectivités locales au terme d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis), ce qui contribuerait à limiter le non-recours à cette allocation.
Pour tous les cancers qui resteraient en dehors du tableau spécifique dont nous proposons la création et dont le lien potentiel avec la lutte contre l'incendie n'est pas démontré en l'état des connaissances scientifiques, il importe de permettre aux sapeurs-pompiers de fournir plus aisément la preuve de leur exposition à des facteurs de risque afin de démontrer le lien entre ces affections et l'exercice de leurs fonctions. Nous proposons par conséquent d'élaborer un modèle national de fiche d'exposition à des facteurs de risque spécifiques à l'activité de sapeur-pompier et d'en rendre obligatoire le remplissage après chaque intervention à risque.
Mais, comme le dit l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir. En matière de prévention, nous avançons plusieurs pistes d'action. L'équipement en cagoules filtrantes de nouvelle génération devant constituer une priorité compte tenu des enjeux, il serait justifié que l'État accorde aux Sdis une dotation exceptionnelle afin de leur permettre d'en acquérir massivement, de même que tous types d'équipements dont l'efficacité en matière de protection individuelle est prouvée scientifiquement. Je pense en particulier aux combinaisons, qui n'empêchent pas la pénétration de substances cancérogènes.
Dans le même temps, la recherche scientifique et l'analyse de données doivent se poursuivre en parallèle d'un renforcement des efforts de dépistage précoce des cancers et autres pathologies liées à l'activité de sapeur-pompier. Nous invitons donc les pouvoirs publics à mener, à intervalles réguliers, des programmes nationaux de surveillance médicale destinés aux sapeurs-pompiers et comportant des examens de dépistage précoce de ces maladies. Il nous paraît tout aussi nécessaire de renforcer le suivi post-professionnel en obligeant les Sdis à proposer tous les cinq ans une visite de contrôle assurée par un médecin de sapeurs-pompiers à l'ensemble des pompiers professionnels retraités. Dans le cadre de cette surveillance, des données épidémiologiques seraient collectées et analysées par un observatoire de la santé des sapeurs-pompiers. Ce dernier serait chargé de proposer des mesures dans le champ de la prévention comme dans celui de la réparation.
Enfin, dans ce domaine comme dans tant d'autres, nous n'avancerons pas sans nous appuyer sur le personnel médical, qui joue un rôle crucial au plus près des agents. La formation des médecins et infirmiers de sapeurs-pompiers en médecine du travail gagnerait donc à être renforcée afin de leur en inculquer les principes et les modes d'application à la situation des sapeurs-pompiers. Nous souhaitons que cet effort d'information vise en premier lieu les sapeurs-pompiers eux-mêmes. Il est donc impératif que les risques auxquels cette activité les expose leur soient présentés dès la première visite médicale d'aptitude. Nous ne le dirons jamais assez : les sapeurs-pompiers doivent être les premiers acteurs de leur propre santé.
Je terminerai mon propos en redisant, en votre nom à tous, mes chers collègues, la reconnaissance de la Nation envers ces femmes et ces hommes qui mettent chaque jour leur vie en péril pour protéger celle des autres. À eux tous, nous disons du fond du coeur : « Merci. Nous sommes à vos côtés ».
Je remercie le président Mouiller de m'avoir confié ce rapport, et Mme Anne-Marie Nédélec pour le travail transpartisan que nous avons mené.
Mme Annie Le Houerou. - Je vous remercie pour ce travail. Vous avez cité de nombreuses difficultés : la sous-déclaration des maladies professionnelles, la difficulté du suivi médical, la formation des professionnels de santé - médecins et infirmiers -, ou encore la nécessité d'études particulières et de données centralisées sur ces pathologies.
Un article paru hier dans Le Monde précise que les pompiers sont « aux premières loges » dans la contamination aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). Des traces ont été retrouvées dans les cheveux de tous les sapeurs-pompiers testés par les organisations syndicales, à la demande notamment du mouvement Les Écologistes.
Les mousses anti-incendie et les tenues imperméabilisées en seraient pour partie responsables. Pensez-vous que la contamination à ces polluants particuliers pourrait être intégrée à la liste des maladies imputables au service ?
Par ailleurs, comment systématiser les analyses pour assurer un meilleur suivi des sapeurs-pompiers, afin d'éviter le développement de maladies ?
Mme Raymonde Poncet Monge. - Je salue la qualité de votre rapport.
De manière générale, il y a beaucoup à faire sur les maladies professionnelles de l'ensemble des corps de métiers. Néanmoins, il faut pour cela faire preuve de volonté. Vous avez dit qu'il fallait des subventions exceptionnelles pour que les Sdis, dont l'équilibre financier est souvent précaire, puissent investir dans des équipements réellement protecteurs.
Vous avez parlé de polyexposition. On entend souvent dire qu'il n'existerait pas de mousses anti-incendie aussi efficaces que celles qui contiennent des PFAS. Certes, mais des alternatives pourraient tout aussi bien être utilisées lors des exercices de simulation, qui représentent 90 % de l'activité des sapeurs-pompiers ! Tel sera l'objet de plusieurs amendements sur la proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux PFAS qui sera examinée lors de la niche du groupe GEST demain. C'est une mesure de bon sens, surtout quand on sait que ces polluants sont éternels et que nous ne pouvons pas revenir en arrière.
Mme Pascale Gruny. - Je remercie les rapporteures et le président d'avoir pris en compte ce sujet essentiel. En effet, si les pompiers jouent un rôle clé dans nos territoires, ils apparaissent, à première vue, en très bonne santé physique, et la thématique essentielle que vous avez abordée est peu visible.
Je regrette que nous ne nous intéressions trop souvent qu'aux mesures curatives, au lieu de chercher à faire de la prévention. Des équipements plus efficaces et moins polluants sont-ils utilisés à l'étranger ? Le coût de la mauvaise protection des sapeurs-pompiers finit en effet par être répercuté sur la sécurité sociale, sans même prendre en compte la sous-déclaration. Le cas des volontaires doit aussi susciter notre réflexion, beaucoup travaillant par ailleurs en entreprise.
Avez-vous travaillé sur les troubles musculo-squelettiques ? Les sapeurs-pompiers sont de plus en plus mobilisés en cas d'accident et dans le cadre du service ambulancier. Or, la formation dans ce domaine est généralement lacunaire. Par ailleurs, la prise en charge psychologique est souvent insuffisante.
Vous avez parlé du financement des Sdis. Nous connaissons bien ces enjeux. Mon département a investi 22 millions d'euros en leur faveur. Nous attendons désormais le rapport de la Cour des comptes.
Enfin, il faut noter que les volontaires sont plus souvent face au feu que les professionnels.
M. Khalifé Khalifé. - L'amiante, qui libère des fibres cancérogènes après un incendie, est en bonne partie responsable des cancers en lien avec l'activité de sapeur-pompier. Néanmoins, nombre de pompiers logent dans des bâtiments construits dans les années 1960. Avez-vous établi un lien entre la présence d'amiante dans les casernes et les cancers ?
Mme Émilienne Poumirol, rapporteure. - L'article du journal Le Monde révèle l'ampleur de la contamination aux PFAS. Tous les pompiers testés montrent des signes de contamination, y compris à une molécule pourtant interdite depuis 2009.
Nous avons essayé de faire le lien entre des facteurs d'exposition et le risque de maladie professionnelle. Nous manquons de données, puisqu'il n'existe que deux études, la première datant d'il y a trente ans, la deuxième, d'une dizaine d'années.
Mme Raymonde Poncet Monge. - C'est significatif !
Mme Émilienne Poumirol, rapporteure. - C'est en effet significatif de l'intérêt que portent les pouvoirs publics en général à la santé des sapeurs-pompiers, dont ils vantent si souvent l'héroïsme.
La question des retardateurs de flamme est particulièrement problématique, comme l'a montré l'enquête de « Vert de rage ». Ceux-ci, présents dans tous les objets du quotidien, y compris les jouets ou les pyjamas pour bébés, sont souvent extrêmement toxiques.
Je veux insister sur le risque lié à la polyexposition. Les fumées contiennent un très grand nombre de substances nocives. En outre, les pompiers avaient souvent l'habitude de retirer leur ARI une fois le feu éteint, alors que les dernières fumerolles sont les fumées les plus toxiques... Il faut donc systématiser les analyses.
Madame Poncet-Monge, il est sans doute nécessaire de limiter les exercices dans les caissons. Je me sens un peu coupable, car j'ai été à l'origine de l'acquisition de superbes caissons d'entraînement dans mon département ! Néanmoins, nous avons redoublé de précaution, notamment à l'égard des formateurs, qui y passent de nombreuses heures.
Madame Gruny, il ne nous a pas été indiqué qu'il existait du matériel de meilleure qualité dans d'autres pays. Cela me semble assez peu probable, compte tenu de l'ampleur des travaux conduits en France en vue de l'élaboration d'un prototype de cagoules filtrantes.
Monsieur Khalifé, nous n'avons pas étudié spécifiquement la question des casernes. Néanmoins, les bâtiments qui sont construits aujourd'hui ne sont pas concernés par les problèmes d'amiante. En revanche, il peut exister des problématiques liées à l'agencement des locaux, par exemple lorsque les gaz d'échappement sont orientés vers les vestiaires, malgré la présence de circuits de décontamination.
Mme Anne-Marie Nédélec, rapporteure. - Vos questions rejoignent plusieurs problématiques que nous avons soulevées.
Il y a d'abord le manque de données, qui nous a fortement handicapées. Je ne m'attendais pas à de telles lacunes, car je pensais que les fiches d'intervention étaient bien plus complètes.
Par ailleurs, nous avons constaté l'insuffisance du suivi médical, notamment d'analyses régulières.
Il faut aussi tenir compte de l'adaptation des équipements aux dangers. Nous n'avons pas reçu d'informations sur l'existence de nouveaux équipements à l'étranger. Concernant les cagoules, la France est relativement en avance, mais nous serons confrontés à la question de leur coût. En effet, le prix d'une cagoule passera de 15 euros à 40 ou 50 euros.
Par ailleurs, 80 % de nos pompiers sont des volontaires. Les activités sont variables selon les pompiers, les pays - le secours à la personne prend ainsi une place importante dans le travail des sapeurs-pompiers français - et même les régions. Ainsi, nous avons voulu savoir si des pathologies particulières affectaient les sapeurs-pompiers du sud de la France, plus régulièrement exposés aux feux de forêt que ceux du nord. Aucune étude n'existe sur le sujet.
Nous avons besoin de plus d'éléments chiffrés, et de fiches d'exposition contenant des données précises.
Davantage de cancers doivent en outre pouvoir être présumés imputables à l'activité de sapeur-pompier. À ce titre, les deux seuls cancers pouvant l'être à ce jour ne le sont nulle part ailleurs dans le monde. Le Circ ne les a pas même évoqués ! Nous n'avons pas voulu proposer leur retrait de la liste, mais nous recommandons d'en ajouter plusieurs autres, pour lesquels le lien a été confirmé par le Circ ou jugé très probable.
Nous ne devons pas oublier les sapeurs-pompiers volontaires, qui peuvent être soumis à des substances cancérogènes dans le cadre de leur activité professionnelle. C'est sur eux, en effet, que repose l'essentiel de nos services de secours.
Enfin, il faut insister sur la prévention afin d'éviter le développement de cancers. De grands progrès ont été accomplis en la matière. Néanmoins, les formateurs nous l'ont dit : le pire ennemi du pompier reste souvent le pompier lui-même.
Les recommandations sont adoptées.
La mission d'information adopte, à l'unanimité, le rapport d'information et en autorise la publication.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
· Émission « Vert de Rage » (France Télévisions)
Martin Boudot, journaliste
Mathilde Cusin, journaliste
· Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)
Alain Anastasi, retraité SPP et membre du conseil d'administration de la CNRACL
Ludovic Degraeve, actif SPP et membre du conseil d'administration de la CNRACL
David Filippi, responsable du service employeur compensation et risques professionnels et responsable de l'unité Fonds National de Prévention de la CNRACL
Jonathan Belcastro, adjoint au directeur de la gestion - Caisse des dépôts et consignation
Bernard Orbillot, responsable du service « actifs » - Caisse des dépôts et consignation
Florence Pontgahet, responsable de l'unité liquidation AT/MP - Caisse des dépôts et consignation
· Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC)
Tiphaine Pinault - directrice des sapeurs-pompiers
Jérôme Bancarel - Médecin chef des services
Rémi Capart - Adjoint au chef de bureau des sapeurs-pompiers volontaire et de l'engagement citoyen
Isabelle Merignant - Sous-directrice de la doctrine et des ressources humaines
· Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses)
Henri Bastos, directeur scientifique "Santé Travail" et adjoint au directeur de l'évaluation des risques Responsable santé et travail
Sarah Aubertie, chargée des relations institutionnelles
· Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF)
Médecin-Colonel Norbert Berginiat, vice-président de la FNSPF chargé des secours et soins d'urgence aux personnes et du service de santé et de secours médical
· Marion Gaboriau, sociologue
· Anne Marchand, sociologue
· Association nationale des médecins des services d'incendie et de secours (ANAMNESIS)
Médecin-colonel Thierry Dulion, membre du conseil d'administration et médecin du travail
Médecin-colonel Michel Weber, Médecin-chef du service de santé et de secours médical et président de l'ANAMNESIS
· Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP)
Guillaume Tinlot, chef de service des politiques sociales, salariales et des carrières - Direction générale de l'administration et de la fonction publique
· Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)
Pr Alexis Descatha, professeur des universités et praticien hospitalier en médecine et santé au travail (CHU d'Angers)
Anne-Sophie Etzol, responsable des relations institutionnelles
· Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
Laura Temime, professeure des universités, directrice du laboratoire MESuRS
· Centre international de recherche sur le cancer (CIRC)
Dr Mary Schubauer-Berigan, Branch Head Evidence Synthesis and Classification
· Richard Amnotte, directeur adjoint et coordonnateur adjoint à la sécurité civile de la direction du service de sécurité incendie de la ville de Lévis
· Syndicats
Sébastien Bouvier, secrétaire fédéral en charge des SDIS - Fédération CFDT INTERCO Sdis
Mickaël Biberon, secrétaire général - CFTC-Spasdis
Michaël Pacanowski, vice-président - CFTC-Spasdis
Anthony Chauveau, président - CFTC-Spasdis
Cyril Péhu, membre de la formation spécialisée en santé, sécurité et condition de travail - SUD SDIS
Arnaud Mougin, officier prévisionniste industrie au SDIS 44, référent départemental HSE pour la partie Incendie et référent/expert HSE - SUD SDIS
Peter Gurruchaga, membre du collectif - CGT des Sdis de France
Noël Auray, membre du collectif - CGT des Sdis de France
Angelo Carlucci, mandaté CGT FDSP - CGT des Sdis de France
Benjamin Calvario - mandaté CGT FDSP - CGT des Sdis de France
Cédric Taillade, cadre de santé de SPP au SDIS 77 - FO-SIS
Christophe Sansou, secrétaire général, SPP au SDIS 82 - FO SIS
Rémy Laurens, conseiller toxicité des fumées - UNSA-Sdis
Grégory Chaillou, secrétaire général adjoint - UNSA-Sdis
David Saquet, secrétaire général - UNSA-Sdis
Xavier Boy, président fédéral - FA/SPP-PATS
Frédéric Monchy, président - SNSPP-PATS
Mohamed Laradji, conseiller syndical national - SNSPP-PATS
Alain Laratta, secrétaire général - Avenir Secours CFE-CGC
Eddie Nicolas, vice-président en charge de la filière santé - Avenir Secours CFE-CGC
Sylvain Trouvain, secrétaire adjoint - GSNSPV
Helen Pierre, infirmière sapeur-pompier volontaire - GSNSPV
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
· Direction générale du Travail (DGT)
· Centre d'essai et de recherche de l'Entente méditerranéenne (CEREN)
· TABLEAU
DE MISE EN OEUVRE ET DE SUIVI
DES RECOMMANDATIONS
|
N° |
Recommandations |
Acteurs concernés |
Support |
|
1 |
Créer un tableau de maladies professionnelles regroupant les pathologies liées aux travaux d'extinction des incendies |
Gouvernement |
Texte réglementaire |
|
2 |
Élargir la présomption d'imputabilité au service aux types de cancer dont le lien avec l'activité de sapeur-pompier est reconnu par le Circ |
Gouvernement |
Texte réglementaire |
|
3 |
Procéder systématiquement à l'évaluation des droits à l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales au terme d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service |
Gouvernement |
Texte réglementaire |
|
4 |
Élaborer un modèle national de fiche d'exposition à des facteurs de risques spécifique à l'activité de sapeur-pompier |
Gouvernement |
Texte réglementaire |
|
5 |
Rendre obligatoire le remplissage d'une fiche d'exposition après chaque intervention à risque sanitaire |
Parlement |
Texte législatif |
|
6 |
Accorder aux Sdis une dotation exceptionnelle destinée à l'acquisition du nouveau modèle de cagoules filtrantes et d'équipements de protection individuelle dont l'efficacité est prouvée scientifiquement |
Gouvernement |
/ |
|
7 |
Mener des programmes nationaux de surveillance médicale dédiés aux sapeurs-pompiers à des fins de dépistage des cancers et de collecte de données épidémiologiques |
Gouvernement/Sdis |
/ |
|
8 |
Renforcer le suivi post-professionnel en obligeant les Sdis à proposer aux sapeurs-pompiers retraités une visite médicale de contrôle tous les cinq ans |
Gouvernement |
Texte réglementaire |
|
9 |
Installer un Observatoire de la santé des sapeurs-pompiers chargé d'analyser les données épidémiologiques disponibles et de proposer des mesures visant à renforcer la protection des agents |
Gouvernement |
/ |
|
10 |
Renforcer la formation des médecins et infirmiers de sapeurs-pompiers en médecine du travail |
Gouvernement |
Texte réglementaire |
* 1 Deschamps, Momas et Festy, Mortality among Paris fire-fighters, in European Journal of Epidemiology, décembre 1995.
* 2 Amadeo et Marchand, Analyse de la mortalité des sapeurs-pompiers professionnels actifs au 1er janvier 1979. Cohorte C.PRIM, 2012.
* 3 Wolffe, Robinson, Dickens, Turrell, Clinton, Maritan-Thomson, Joshi et Stec, Cancer incidence amongst UK firefighters, in Scientific Reports, 10 janvier 2023.
* 4 « Vert de Rage. La contamination à petit feu », France 5, 15 janvier 2024.
* 5 Colonel Christian Pourny, Rapport de la mission sécurité des sapeurs-pompiers, décembre 2003.
* 6 Article L. 814-1 du code général de la fonction publique.
* 7 Article L. 814-2 du code général de la fonction publique.
* 8 Anses, Risques sanitaires liés aux expositions professionnelles des sapeurs-pompiers, août 2019.
* 9 IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Hazards to Humans, Occupational Exposure as a Firefighter (vol. 132), juin 2022.
* 10 Classification de l'ACGIH : A1 - Agent cancérogène pour les humains ; A2 - Agent cancérogène présumé pour les humaines ; A3 - Agent cancérogène pour les animaux dont la portée est inconnue chez les humains ; A4 - Ne peut être classé comme cancérogène pour les humains.
* 11 Classification du Circ : Groupe 1 - Cancérogène pour les humains ; Groupe 2 - Peut-être cancérogène pour les humains ; Groupe 3 - Ne peut être classé quant à sa cancérogénicité pour les humains.
* 12 IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Painting, Firefighting, and Shiftwork (vol. 98), janvier 2007.
* 13 « Est génotoxique », « Induit des modifications épigénétiques », « Induit un stress oxydatif », « Induit une inflammation chronique » et « Module les effets médiés par des récepteurs ».
* 14 IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Hazards to Humans, Occupational Exposure as a Firefighter (vol. 132), juin 2022.
* 15 Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
* 16 Conseil d'État, 27 avril 2015, n° 374541, Commune de Roissy-en-Brie.
* 17 Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, article 10.
* 18 Article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; ancien article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
* 19 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, article 37-8.
* 20 Conseil d'État, 3ème-8ème chambres réunies, 8 mars 2023, n° 456390.
* 21 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, article 3.
* 22 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, article 4.
* 23 Articles R. 4641-11 à R. 4641-13 du code du travail.
* 24 Article L. 822-21 du code général de la fonction publique.
* 25 Article L. 822-22 du code général de la fonction publique.
* 26 Article L. 822-24 du code général de la fonction publique.
* 27 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, article 37-2.
* 28 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précité, article 37-3.
* 29 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précité, article 37-4.
* 30 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précité, article 37-5.
* 31 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précité, article 37-6.
* 32 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précité, article 37-7.
* 33 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précité, article 37-9.
* 34 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précité, article 37-11.
* 35 Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, article 30.
* 36 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, article 37-16.
* 37 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 précité, article 37-17.
* 38 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987précité, article 37-18.
* 39 Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, article 3.
* 40 Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 précité, article 4.
* 41 Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, article 6.
* 42 Décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, article 9.
* 43 Article L. 723-2 du code de la sécurité intérieure.
* 44 Article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure.
* 45 Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, article 1er.
* 46 Décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale, article 1er.
* 47 Décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 précité, article 2.
* 48 Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, article 14.
* 49 Décret n° 85-603 du 10 juin précité, article 20.
* 50 Décret n° 85-603 du 10 juin précité, article 22.
* 51 Arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours, article 1er.
* 52 Arrêté du 6 mai 2000 précité, article 5.
* 53 Arrêté du 6 mai 2000 précité, article 18.
* 54 Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, article 1er.
* 55 Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, article 2.
* 56 Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, article 3.
* 57 Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, article 6.
* 58 Décret n° 2015-1438 du 5 novembre 2015 relatif aux modalités du suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, article 7.
* 59 DGSCGC/CNRACL, Impacts et prévention des risques relatifs aux fumées d'incendie pour les sapeurs-pompiers, mars 2017.
* 60 Ceren, Évaluation de l'efficacité de filtration de la cagoule feux de forêts vis-à-vis des fumées et des particules fines, avril 2018.
* 61 Inspection de la défense et de la sécurité civile, Bilan et évaluation de la mise en oeuvre du rapport de mission sur la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention (« Rapport Pourny ») 2004-2014, décembre 2015.
* 62 Article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales.
* 63 Annexe II au code de la sécurité sociale : tableau n° 43 bis (affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique).
* 64 Annexe II au code de la sécurité sociale : tableau n° 45 (infections d'origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E).
* 65 Annexe II au code de la sécurité sociale : tableaux n° 15 ter (lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels), 16 bis (affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon) et 30 (affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante).
* 66 Un cas relevant du tableau de maladies professionnelles n° 25 (affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille), 6 relevant du tableau n° 30 (affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante), 6 relevant du tableau n° 30 bis (cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante) et 5 relevant du tableau n° 40 (maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques (Mycobacterium avium/intracellulaire, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium xenopi, Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum)).
* 67 Banque nationale de données, Rapport statistique - Services d'incendie et de secours, 2022.
* 68 D'après Sylvie Platel, Connaissance, expertise et reconnaissance des maladies professionnelles : système complémentaire et cancers en Seine-Saint-Denis, thèse de santé publique, Université Paris 13, 2014.
* 69 Ancien article L. 4121-3-1 du code du travail.
* 70 Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, article 28.
* 71 Article D. 4163-4 du code du travail.
* 72 Article R. 4412-120 du code du travail.
* 73 Article L. 4121-3-1 du code du travail.
* 74 Article R. 4121-4 du code du travail.
* 75 Voir Charlyne Poncato, Catherine Delgoulet, Willy Buchmann, Émilie Counil, Documenter les effets de moyen et long terme des conditions de travail des sapeurs-pompiers sur leur santé, Doctoriales ARPEGE 2023, juillet 2023, pp. 43-49.
* 76 Article L. 1424-36-2 du code général des collectivités territoriales.
* 77 Arrêté du 16 août 2004 relatif aux formations des médecins, pharmaciens et infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels.