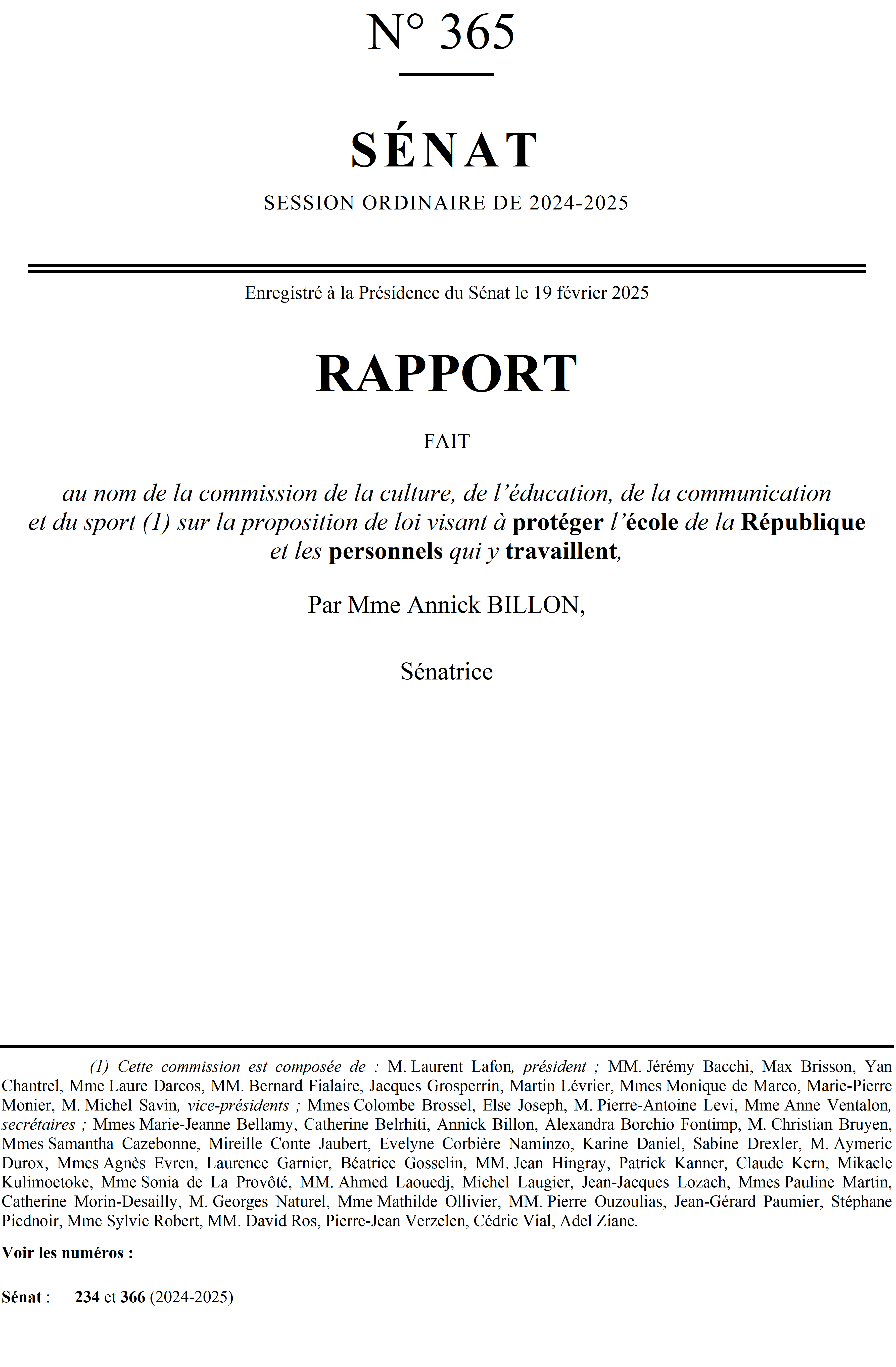- AVANT-PROPOS
- I. UNE IMPÉRIEUSE
NÉCESSITÉ : MIEUX PROTÉGER L'ÉCOLE ET LES
PERSONNELS QUI Y TRAVAILLENT
- II. LES MESURES DE LA PROPOSITION DE LOI
- A. RECENTRER LE CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT MORAL ET
CIVIQUE POUR FAVORISER L'ÉMERGENCE D'UNE CULTURE CITOYENNE
COMMUNE
- B. CLARIFIER LE PÉRIMÈTRE DE
L'INTERDICTION POUR LES ÉLÈVES DU PORT DE SIGNES OU TENUES
MANIFESTANT UNE APPARTENANCE RELIGIEUSE
- C. RESPONSABILISER DAVANTAGE LES
ÉLÈVES ET LEURS PARENTS EN CAS DE PERTURBATION
RÉPÉTÉE DU FONCTIONNEMENT D'UN ÉTABLISSEMENT
SCOLAIRE
- D. GARANTIR UNE MEILLEURE PROTECTION DES PERSONNELS
DE L'ÉDUCATION NATIONALE
- E. GARANTIR L'INFORMATION DES AUTORITÉS
ACADÉMIQUES ET DES CHEFS D'ÉTABLISSEMENT EN CAS DE MISE EN EXAMEN
OU DE CONDAMNATION D'UN ÉLÈVE POUR TERRORISME
- A. RECENTRER LE CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT MORAL ET
CIVIQUE POUR FAVORISER L'ÉMERGENCE D'UNE CULTURE CITOYENNE
COMMUNE
- III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA
COMMISSION
- I. UNE IMPÉRIEUSE
NÉCESSITÉ : MIEUX PROTÉGER L'ÉCOLE ET LES
PERSONNELS QUI Y TRAVAILLENT
- EXAMEN DES ARTICLES
- Article 1er
Contenu de l'enseignement moral et civique
- Article 2
Extension de l'interdiction pour les élèves du port de tenues ou signes manifestant une appartenance religieuse à l'ensemble des activités organisées par l'institution scolaire y compris en dehors du temps scolaire
- Article 3
Renforcement de l'accompagnement et de la responsabilisation des élèves et de leurs parents face à des actes répétés perturbant le fonctionnement des établissements scolaires
- Article 4
Protection fonctionnelle automatique pour les personnels
de l'éducation nationale
- Article 5
Possibilité pour l'administration de déposer plainte à la place
d'un personnel de l'éducation nationale avec son accord
- Article 6
Information de l'autorité académique et du chef d'établissement de la mise en examen ou de la condamnation pour terrorisme d'un élève scolarisé
ou ayant vocation à l'être
- Article 6 bis
(nouveau)
Possibilité pour les chefs d'établissement, leurs adjoints et les conseillers principaux d'éducation de procéder à une inspection visuelle des effets personnels des élèves
- Article 6 ter (nouveau)
Application outre-mer
- Article 7
Gage financier
- Article 1er
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU
RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
- LA LOI EN CONSTRUCTION
AVANT-PROPOS
La proposition de loi visant à protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent est issue des travaux de la mission conjointe de contrôle disposant des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête, chargée de dresser un état des lieux des menaces, violences et insultes dont sont victimes les enseignants1(*).
Ses travaux ont mis en exergue l'existence d'une violence endémique tant dans le secondaire que dans le primaire et fait le constat d'un quotidien pour les personnels de l'éducation nationale marqué par des propos ou des actes violents. La mission conjointe de contrôle a formulé 38 recommandations dont 6 de nature législative, traduites dans cette proposition de loi.
Ce texte législatif prévoit ainsi de recentrer le contenu de l'enseignement moral et civique (art. 1er), de clarifier le périmètre d'application de l'interdiction pour les élèves du port de signes ou tenues manifestant une appartenance religieuse (art. 2), de responsabiliser davantage les élèves perturbateurs et leurs parents (art. 3), de garantir une meilleure protection des personnels de l'éducation nationale (art. 4 et 5) et d'informer les services académiques et les chefs d'établissement en cas de mise en examen ou de condamnation d'un élève - ou d'un jeune non scolarisé mais ayant vocation à l'être - pour une infraction à caractère terroriste (art. 6).
À l'initiative de la rapporteure, la commission a adopté trois amendements visant à améliorer la protection des agents de l'éducation nationale et renforcer les prérogatives des chefs d'établissement pour garantir la sécurité des élèves.
I. UNE IMPÉRIEUSE NÉCESSITÉ : MIEUX PROTÉGER L'ÉCOLE ET LES PERSONNELS QUI Y TRAVAILLENT
A. UN CLIMAT SCOLAIRE FORTEMENT DÉGRADÉ
La violence à l'école connaît ces dernières années un développement croissant et généralisé. En 2021-2022, les deux-tiers des établissements du secondaire ont déclaré au moins un incident grave. Fait nouveau, la violence touche désormais le primaire, jusqu'alors épargné.
Les témoignages recueillis lors de la mission conjointe de contrôle ont mis en avant une très forte précarité du climat scolaire, un rien pouvant entraîner des incidents, y compris dans des établissements scolaires apaisés.
Face à des élèves perturbateurs, les équipes pédagogiques et administratives se retrouvent souvent démunies. Or, tout enseignant et tout élève a le droit d'évoluer dans un climat scolaire apaisé.
S'il existe, notamment dans le secondaire, une échelle de sanctions précise ainsi que des mesures de responsabilisation des élèves et des parents, celles-ci ne sont pas toujours adaptées et parfois difficilement mobilisables. Tel est le cas du protocole d'accompagnement et de responsabilisation (PAR), document signé entre les parents de l'élève, le chef d'établissement et les services académiques : le PAR ne peut être mis en oeuvre qu'après une deuxième expulsion définitive lors d'une même année.
Surtout, ces outils sont inefficaces face à des parents absents, qui ne se rendent pas aux réunions auxquelles ils sont convoqués par les enseignants ou le chef d'établissement.
B. DES ENSEIGNANTS VICTIMES D'INSULTES ET DE VIOLENCES
La traduction des pourcentages d'enseignants victimes d'atteintes aux personnes ou aux biens, sur lesquels communique le ministère, en chiffres absolus, témoigne de la banalisation de la violence en milieu scolaire. Les paroles ou les actes violents sont ainsi devenus une « normalité dans l'anormalité ».
Par ailleurs, les assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard ont profondément ébranlé la profession. Il existe désormais une peur dans l'exercice du métier, avec le sentiment qu'un passage à l'acte violent est désormais possible.
Comme tout agent de la fonction publique, les personnels de l'éducation nationale disposent de la protection fonctionnelle. Pendant longtemps méconnue, celle-ci fait l'objet ces dernières années d'une demande croissante de la part des agents et parallèlement d'une meilleure information de ces derniers par l'administration sur son existence On dénombre ainsi, en 2023, 5 264 demandes d'agents relevant des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et des sports, soit un nombre en augmentation de 28 % en un an - 4 085 demandes ayant été recensées en 2022.
Dans 68% des cas, les auteurs des faits à l'origine de ces demandes sont des élèves, des étudiants ou leurs représentants légaux. 91 % des dossiers portent sur des atteintes volontaires à l'intégrité de l'agent (atteinte physique, morale, actes de harcèlement notamment). 28 % des demandes font l'objet d'un refus, dans la moitié des cas de manière implicite par une absence de réponse dans un délai de deux mois2(*).
Ce nombre de demandes ne doit toutefois pas faire oublier les nombreux enseignants qui par méconnaissance ou parce qu'ils estiment ne pas être en mesure de bénéficier de la protection fonctionnelle, ne déposent pas de demande, alors même qu'ils pourraient y prétendre. Aussi, la mission conjointe de contrôle suggère de « renverser la charge de la preuve » : la protection fonctionnelle doit être automatiquement attribuée dès lors qu'un agent de l'éducation nationale, victime d'un acte de violences ou d'outrages du fait d'élèves, de parents d'élèves ou de tiers, en ferait la demande.
II. LES MESURES DE LA PROPOSITION DE LOI
A. RECENTRER LE CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE POUR FAVORISER L'ÉMERGENCE D'UNE CULTURE CITOYENNE COMMUNE
La rédaction actuelle de l'article L. 312-15 du code de l'éducation, particulièrement « bavarde », conduit les enseignants à devoir faire un choix dans les programmes de l'enseignement moral et civique (EMC). Il en résulte un « enseignement à la carte », à rebours de l'objectif de l'EMC de disposer d'une culture citoyenne commune.
L'article 1er de la proposition de loi permet de recentrer le contenu de l'enseignement moral et civique sur la connaissance des institutions françaises et européennes, des grands enjeux sociétaux, environnementaux et internationaux, ainsi que sur les principes de la République dont la laïcité.
B. CLARIFIER LE PÉRIMÈTRE DE L'INTERDICTION POUR LES ÉLÈVES DU PORT DE SIGNES OU TENUES MANIFESTANT UNE APPARTENANCE RELIGIEUSE
L'article L. 141-5-1 du code de l'éducation interdit aux élèves le port de tenues ou signes religieux manifestant une appartenance religieuse dans les établissements scolaires publics. Cette interdiction s'applique également aux sorties scolaires qui ont lieu pendant le temps scolaire.
Les travaux de la mission conjointe de contrôle ont toutefois montré l'existence de zones grises pour les activités organisées par les établissements scolaires en dehors du temps scolaire par exemple une pièce de théâtre le soir en lien avec l'oeuvre étudiée en cours, une remise de prix hors temps scolaire pour un concours organisé en classe ou encore la visite d'un salon d'orientation un mercredi ou un samedi après-midi encadrée par des enseignants et rendue possible grâce à un car affrété par l'établissement.
Afin de clarifier le périmètre d'application de cette interdiction, l'article 2 précise que celui-ci inclut toute activité organisée par les établissements scolaires, y compris celles qui ont lieu en dehors du temps scolaire.
C. RESPONSABILISER DAVANTAGE LES ÉLÈVES ET LEURS PARENTS EN CAS DE PERTURBATION RÉPÉTÉE DU FONCTIONNEMENT D'UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
L'article 3 rappelle que le respect de la vie collective et celui du bon fonctionnement de l'établissement font partie des obligations de l'élève et sécurise la mise en place par voie réglementaire de mesures d'accompagnement et de responsabilisation des parents des élèves concernés, pouvant aller jusqu'à une amende.
La commission rappelle qu'en cas de non-respect de l'assiduité scolaire, qui constitue la seconde obligation des élèves mentionnée dans le code de l'éducation, les textes réglementaires prévoient dans un premier temps un dispositif d'aide et d'accompagnement des parents qui inclut une contractualisation avec les services académiques et l'équipe pédagogique, puis dans un second temps des mesures éducatives et sociales prises par le conseil départemental. Si l'absentéisme de l'élève persiste, les parents peuvent s'exposer à une amende.
Pour la commission, le non-respect de la vie collective et celui du bon fonctionnement des établissements doivent faire l'objet d'un processus d'accompagnement, de responsabilisation et de sanction analogue à celui existant en cas de non-respect de l'assiduité scolaire.
D. GARANTIR UNE MEILLEURE PROTECTION DES PERSONNELS DE L'ÉDUCATION NATIONALE
Répondant à une demande de plusieurs syndicats de personnels, l'article 4 rend automatique l'octroi de la protection fonctionnelle pour les agents de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à leur demande, l'administration disposant d'un délai de 4 mois pour ensuite la retirer.
Par ailleurs, afin de rendre plus systématique le dépôt de plainte, l'article 5 impose à l'administration, avec l'accord de l'agent concerné ou de ses ayants droit s'il est décédé, de déposer plainte à sa place, lorsqu'il a été victime d'outrages, menaces ou violences du fait de ses fonctions.
E. GARANTIR L'INFORMATION DES AUTORITÉS ACADÉMIQUES ET DES CHEFS D'ÉTABLISSEMENT EN CAS DE MISE EN EXAMEN OU DE CONDAMNATION D'UN ÉLÈVE POUR TERRORISME
L'article 6 élargit aux infractions à caractère terroriste la liste des crimes et délits pour lesquels la mise en examen ou la condamnation d'un élève, ou d'un mineur ayant vocation à être scolarisé, implique d'informer les autorités académiques ainsi que les chefs d'établissement public comme privé. Il répond à une demande des chefs d'établissement, responsables de la sécurité des élèves et des personnels.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA COMMISSION
À l'initiative de la rapporteure, la commission a adopté trois amendements à la proposition de loi.
À l'article 4, elle a supprimé toute référence à une demande de protection fonctionnelle afin d'en faciliter l'octroi automatique. La notion de demande risque en effet d'entraîner une régression dans l'attribution de la protection fonctionnelle. Ces dernières années, le ministère rappelle aux services académiques que cette protection peut être attribuée même sans demande de la part de l'agent concerné.
Elle a adopté un nouvel article permettant pour des raisons de sécurité, et dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, à un chef d'établissement, à son adjoint ou à un conseiller pédagogique d'éducation, de procéder à l'inspection visuelle du sac ou du casier d'un élève et de fouiller ceux-ci avec son accord ou celui de ses représentants légaux.
Enfin, elle a adopté un amendement permettant l'application de ce texte à Wallis-et-Futuna ainsi qu'en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans les domaines relevant de la compétence de l'État.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
Contenu de l'enseignement moral et
civique
Cet article vise à recentrer le contenu de l'enseignement moral et civique sur la connaissance des institutions, ainsi que sur la compréhension des enjeux sociétaux et environnementaux. Il prévoit également une formation aux valeurs de la République et à la laïcité tout au long de la scolarité.
Les travaux de la mission d'information sur la culture citoyenne3(*) ont mis en exergue le caractère confus du programme d'enseignement moral et civique. En effet, le législateur n'a eu de cesse d'enrichir l'article L. 312-15 du code de l'éducation. Celui-ci a ainsi été modifié sept fois depuis 2017. Comme l'a souligné Souâd Ayada lors de son audition en janvier 2022 par la mission d'information précitée, alors présidente du Conseil supérieur des programmes, cet enseignement est constitué par l'accumulation de « nombreuses strates », ce qui ne facilite « ni son appréhension, ni son traitement ». Elle appelait à « simplifier la structuration du programme ».
La commission ne peut que souscrire à ces propos. En effet, la profusion des thèmes mentionnés à l'article L. 312-15 du code de l'éducation oblige l'enseignant à faire des choix, à rebours de la notion même de programme national. Par ailleurs, comme la commission l'a souligné à de nombreuses reprises, il n'appartient pas au législateur de définir le contenu des programmes scolaires. Le Sénat a ainsi voté en novembre 2023 un dispositif identique visant à réécrire cet article du code de l'éducation4(*).
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 2
Extension de l'interdiction pour les
élèves du port de tenues ou signes manifestant une appartenance
religieuse à l'ensemble des activités organisées par
l'institution scolaire y compris en dehors du temps scolaire
Cet article vise à étendre l'interdiction pour les élèves de porter des tenues ou signes manifestant une appartenance religieuse à l'ensemble des activités organisées par l'établissement scolaire, y compris lorsque celles-ci se déroulent à l'extérieur de celui-ci ou en dehors du temps scolaire.
L'article L. 141-5-1 du code de l'éducation interdit aux élèves le port de signes et tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.
La circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics précise que cette loi s'applique d'une part à l'ensemble des élèves inscrits dans un établissement scolaire public, y compris ceux suivant une formation postbac (classe préparatoire, BTS notamment) et d'autre part, aux activités placées sous la responsabilité des établissements et des enseignants, incluant celles se déroulant en dehors des établissements scolaires (sortie scolaire, cours d'éducation physique et sportive...).
Le vademecum de la laïcité à l'école, réalisé par le conseil des sages de la laïcité, indique dans ses fiches pratiques que l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation s'applique « pour toutes les activités placées sous la responsabilité des écoles ou établissements scolaires ou des enseignants » en citant l'exemple « d'un élève scolarisé dans un établissement d'enseignement scolaire public qui se voit remettre, à l'extérieur de l'établissement, le prix d'un concours auquel il a participé avec sa classe dans le cadre de l'enseignement dispensé par l'établissement ».
Toutefois, les travaux de la mission conjointe de contrôle relative au signalement et au traitement des pressions, menaces et agressions dont sont victimes les enseignants5(*) ont mis en évidence l'existence de zones grises et d'interrogations lorsque l'activité se déroule dans son intégralité en dehors du temps scolaire et de l'établissement.
Aussi l'article 2 vise à préciser que l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation s'applique à l'ensemble des activités organisées par les établissements scolaires, y compris celles qui ont lieu en dehors du temps scolaire. Il reprend la recommandation n° 6 de la mission conjointe de contrôle.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 3
Renforcement de l'accompagnement et de la responsabilisation
des élèves et de leurs parents face à des actes
répétés perturbant le fonctionnement des
établissements scolaires
Cet article vise à réaffirmer les obligations de l'élève dans le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective de l'établissement et à renforcer son accompagnement et sa responsabilisation ainsi que ceux de ses parents en cas de leur non-respect.
L'article L. 511-1 du code de l'éducation précise que les obligations des élèves comprennent « l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études », « l'assiduité » et « le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ».
L'article 3 de la proposition de loi invite le pouvoir réglementaire à définir les modalités d'accompagnement et de responsabilisation des élèves perturbateurs ainsi que de leurs parents.
Il vise à permettre la mise en oeuvre de dispositions analogues à celles existantes en cas de non-respect de l'assiduité scolaire - autre obligation des élèves prévue par le code de l'éducation - définies à l'article R. 131-7 de ce même code qui prévoit une action graduelle en plusieurs étapes incluant tout d'abord l'équipe pédagogique pour le premier degré ou la commission éducative pour le second degré, puis les services académiques, et enfin le président du conseil départemental.
Si les mesures prises, dont chaque étape fait l'objet d'un engagement contractualisé des parents, ne permettent pas un retour de l'enfant en classe, le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur délégation du recteur, peut saisir le procureur de la République. En application de l'article R. 624-7 du code pénal, les parents s'exposent alors à une amende prévue pour les contraventions de quatrième catégorie pouvant aller jusqu'à 750 euros.
La commission estime important d'inscrire dans le code de l'éducation ce principe d'accompagnement et de responsabilisation des élèves perturbateurs et de leurs parents, à la fois à l'article L. 111-3-1 du code de l'éducation relatif au respect dû aux personnels de l'éducation nationale et à l'institution scolaire par les élèves et leurs familles, et à l'article L. 511-1 du même code qui définit les devoirs des élèves. Par ailleurs, elle souligne la nécessité de revoir les instruments mobilisables face aux élèves perturbateurs ainsi que les moyens pour responsabiliser davantage les parents, ceux-ci devant pouvoir aller jusqu'à une sanction financière.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 4
Protection fonctionnelle automatique pour les
personnels
de l'éducation nationale
Cet article vise à rendre automatique l'octroi de la protection fonctionnelle pour les personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, l'administration disposant de la possibilité de la retirer postérieurement dans un délai de quatre mois.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement supprimant la notion de demande de l'agent pour bénéficier de la protection fonctionnelle.
Les articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique précisent les modalités de protection de l'agent public dans l'exercice de ses fonctions. L'article L. 134-5 prévoit notamment que « la collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
Quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, la circulaire interministérielle du 2 novembre 2020 visant à renforcer la protection des agents publics face aux attaques dont ils font l'objet dans le cadre de leurs fonctions a posé, dans l'urgence, le principe d'une protection immédiate en cas de danger d'atteinte grave à l'intégrité physique des agents publics. Elle précise notamment que la protection fonctionnelle doit être accordée sans délai « lorsque les circonstances et l'urgence le justifient [...] afin de ne pas laisser l'agent public sans défense dans une situation pouvant se traduire par une atteinte grave à son intégrité ».
Ces dispositions ont été complétées par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant les principes de la République, la commission des lois du Sénat ayant estimé que « l'assassinat de Samuel Paty a mis en lumière la nécessité d'un renforcement de la protection des agents publics face aux attaques qu'ils subissent dans l'exercice de leurs fonctions ».
L'article L. 134-6 du code général de la fonction publique dispose désormais que « lorsqu'elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l'existence d'un risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique de l'agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d'urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l'aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en oeuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque ».
Les travaux de la mission conjointe de contrôle précités ont toutefois souligné qu' « une part non négligeable des membres de la communauté éducative, tout en étant au courant de l'existence de ce droit et de la démarche à suivre, renoncent à demander la protection fonctionnelle, par découragement ou conviction que leur demande sera rejetée ».
L'article 4 de la proposition de loi rend obligatoire l'octroi de la protection fonctionnelle aux personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur victimes de violences, de menaces ou d'outrages du fait de leur fonction, dès qu'ils la demandent. L'administration conserve toutefois la possibilité de retirer le bénéfice de cette protection dans un délai de quatre mois.
La commission constate que cet article confère aux personnels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur un régime particulier pour l'octroi de la protection fonctionnelle. Elle estime toutefois important que le débat ait lieu pour renforcer la protection des personnels de l'éducation nationale et accélérer les délais d'octroi de cette protection : en effet, la mission conjointe de contrôle a constaté que les délais moyens d'octroi sont de 29 jours, alors que le besoin de protection et de soutien est souvent urgent. Le sentiment d'absence de soutien par la hiérarchie pèse lourdement sur le malaise croissant des enseignants et plus largement sur l'ensemble des personnels de l'éducation nationale.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un amendement ( COM-1) visant à supprimer la notion de demande. En effet, comme l'ont souligné les représentants du ministère de l'éducation nationale à l'occasion de leur audition, la protection fonctionnelle doit être mise en oeuvre par l'administration, même en l'absence de demande de l'agent, dès lors qu'il est insulté, menacé ou agressé du fait de sa fonction. La rédaction actuelle de l'article 3 crée une incertitude juridique sur la nécessité pour l'administration d'être destinataire d'une demande de l'agent pour lui octroyer cette protection, ce qui est à rebours des directives données depuis quelques années par le ministère aux services du rectorat.
La commission a adopté cet article ainsi modifié.
Article 5
Possibilité pour l'administration de déposer
plainte à la place
d'un personnel de l'éducation nationale
avec son accord
Cet article vise à permettre à l'administration de porter plainte en lieu et place d'un personnel de l'éducation nationale avec son accord, lorsque celui-ci est victime d'insultes, d'outrage ou d'agression.
L'article L. 433-3-1 du code pénal permet à l'administration de déposer plainte lorsqu'elle a connaissance de toute menace, violence ou acte d'intimidation à l'égard d'une personne « participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service ». Toutefois, ce dépôt de plainte ne se substitue pas à celui de l'agent ayant été victime d'intimidation, menacé ou agressé. En effet, comme l'a souligné la commission des lois dans le cadre du projet de loi confortant les principes de la République, qui a créé cet article L. 433-3-1 du code pénal, c'est le service public lui-même qui a été mis en cause par l'infraction ; le dépôt de plainte de l'administration vise à défendre les intérêts du service public.
L'article 5 prévoit l'obligation pour l'administration de déposer plainte, à la place d'un personnel de l'éducation nationale et avec son accord, ou celui de ses ayants droit s'il est décédé, lorsque celui-ci est victime d'un crime ou délit contre sa personne ou ses biens ou menacé de l'être, d'une entrave pour exercer son métier d'enseignant ou de diffamation. Cette obligation s'impose également lorsque le conjoint, les parents ou les enfants de ce personnel sont menacés en raison de l'exercice du métier de l'agent.
Tant les représentants des syndicats des personnels qu'Élisabeth Borne, ministre de l'éducation nationale, lors de son audition le 11 février dernier par la commission de la culture, ont indiqué être favorables à cet article. Il doit notamment permettre de rendre plus systématique le dépôt d'une plainte pour les personnels de l'éducation nationale victimes de menaces ou de violences.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 6
Information de l'autorité académique et du chef
d'établissement de la mise en examen ou de la condamnation pour
terrorisme d'un élève scolarisé
ou ayant vocation
à l'être
Cet article vise à permettre l'information de l'autorité académique et du chef d'établissement de la mise en examen ou de la condamnation pour terrorisme d'un élève scolarisé ou d'un jeune ayant vocation à l'être.
Les articles 138-2 et 712-22-1 du code de procédure pénale prévoient respectivement en cas de mise en examen et de condamnation d'une personne scolarisée ou ayant vocation à l'être, dans un établissement public ou privé, pour des crimes et délits dont la liste est strictement définie par la loi, l'information de l'autorité académique ainsi que du chef d'établissement. Il s'agit de tous les crimes ainsi que certains délits à caractère sexuel, notamment l'agression sexuelle, l'atteinte sexuelle sur mineur, le proxénétisme à l'égard d'un mineur et le recours à la prostitution d'un mineur.
L'article 6 prévoit d'inclure à cette liste les crimes ou infractions à caractère terroriste. Cette disposition a été adoptée par le Sénat le 30 janvier 2024 dans le cadre de l'examen de la proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste.
La rapporteure rappelle que l'instruction du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires impose aux « directeurs d'école et aux chefs d'établissement [de] veille[r] au quotidien à la sécurité des élèves et plus généralement des membres de la communauté éducative ». Par ailleurs, le partage d'informations sensibles sur le casier judiciaire des élèves est fortement encadré : la circulaire du Garde des Sceaux du 14 mai 2012, prise en application des deux articles du code de procédure pénale précités, précise que cette transmission est strictement limitée d'une part aux « personnels de direction, aux conseillers principaux », ainsi que, pour les internats, aux professionnels sociaux et de santé tenus au secret professionnel, et d'autre part pour les seuls infractions mentionnées aux articles 138-2 et 721-22-1 du code de procédure pénale.
La commission a adopté cet article sans modification.
Article 6 bis (nouveau)
Possibilité pour les chefs
d'établissement, leurs adjoints et les conseillers principaux
d'éducation de procéder à une inspection visuelle des
effets personnels des élèves
Cet article additionnel vise à permettre au chef d'établissement, à leurs adjoints et conseillers principaux d'éducation de procéder à l'inspection visuelle du sac et du casier d'un élève, et la fouille de ceux-ci avec son accord ou celui de ses représentants légaux.
En application des articles L. 421-3 et R. 421-10 du code de l'éducation, le chef d'établissement est responsable de la sécurité au sein de l'établissement. Ainsi, « en qualité de représentant de l'État au sein de l'établissement, le chef d'établissement prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens ».
L'instruction ministérielle du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires indique la nécessité du « respect des consignes Vigipirate » dans l'ensemble des établissements d'enseignement public et privé prévoyant notamment « les contrôles visuels des sacs ». Elle s'inscrit dans le contexte particulier des attentats de 2015 et 2016 et vise à lutter contre la menace terroriste.
Il existe un vide juridique sur la possibilité de procéder à une inspection des effets personnels des élèves pour une autre raison, comme par exemple en cas de suspicion de port d'arme blanche.
Sur proposition de la rapporteure, la commission a adopté un article additionnel ( COM-3) visant à donner une base législative à l'inspection visuelle des sacs et casiers des élèves par le chef d'établissement, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation, en cas de menaces pour l'ordre et la sécurité au sein de l'établissement. Par ailleurs, avec l'accord de l'élève, ou celui de ses représentants légaux s'il est mineur, la fouille de ses effets personnels peut être autorisée.
Afin de faciliter la mise en oeuvre de cette mesure, l'établissement peut procéder au recueil annuel de l'autorisation écrite de l'élève ou de ses représentants légaux. Au regard de la jurisprudence constitutionnelle relative à la fouille des effets personnels, l'article limite la portée de cette autorisation annuelle aux risques d'atteinte grave à l'ordre public.
En cas de refus de l'élève ou de son représentant légal, le chef d'administration, son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ne pourra pas procéder à la fouille - seul un officier de la police judiciaire est habilité à le faire. Toutefois, le chef d'établissement pourra, à titre conservatoire et jusqu'à la venue d'un officier de police judiciaire, conserver les effets personnels ou interdire l'accès à l'établissement scolaire à l'élève muni de ses effets personnels potentiellement dangereux6(*).
Dans un contexte marqué par une augmentation des actes violents avec arme blanche aux abords immédiats ou dans les établissements scolaires, la commission estime nécessaire de sécuriser la mise en oeuvre des pouvoirs de police administrative des chefs d'établissement.
La commission a adopté l'article 6 bis ainsi rédigé.
Article 6 ter (nouveau)
Application outre-mer
Cet article additionnel vise à étendre l'application de cette proposition de loi à l'ensemble du territoire français, y compris les territoires d'outre-mer.
La commission a adopté un amendement de la rapporteure ( COM-4) portant article additionnel visant à assurer l'application des dispositions de la proposition de loi relevant du champ de compétences de l'État en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à Wallis-et-Futuna.
La commission a adopté l'article 6 ter ainsi rédigé.
Article 7
Gage financier
Cet article permet d'assurer la recevabilité financière de la proposition de loi.
L'article 7 de la proposition de loi assure sa recevabilité financière au titre de l'article 40 de la Constitution.
La commission a adopté cet article sans modification.
*
* *
La commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.
EXAMEN EN COMMISSION
MERCREDI 19 FÉVRIER 2025
_________
M. Laurent Lafon, président, auteur de la proposition de loi. - Nous examinons à présent le rapport de notre collègue Annick Billon sur la proposition de loi visant à protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent, dont nous débattrons en séance le 6 mars prochain dans le cadre de l'espace réservé au groupe Union Centriste (UC).
Ce texte fait suite au travail mené conjointement avec la commission des lois sur l'état des pressions, menaces et agressions dont l'ensemble du personnel éducatif est victime. Face à ce malaise croissant dont nous sommes tous conscients, la mission avait formulé dans son rapport 38 recommandations. Notre ambition était d'intégrer celles qui avaient une dimension législative dans une proposition de loi et d'apporter ainsi une réponse au travers de dispositifs protecteurs.
Mme Annick Billon, rapporteure. - En janvier dernier, la mission conjointe de contrôle disposant des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête sur les menaces dont sont victimes les enseignants, présidée par Laurent Lafon et François-Noël Buffet, rendait ses conclusions. Celles-ci sont préoccupantes : la violence à l'école n'est certes pas un phénomène nouveau, mais elle s'est généralisée. Deux tiers des établissements du secondaire ont signalé au moins un incident grave. Fait nouveau, cette violence se diffuse au primaire.
Elle se manifeste également contre les personnels. Les chiffres absolus mis en avant par la mission conjointe de contrôle permettent de mettre en exergue une réalité masquée par le raisonnement en pourcentage : dans le second degré, elle estime ainsi à 58 500 le nombre d'enseignants menacés ; 17 200 ont été bousculés intentionnellement ou victimes de coups et blessures ; enfin, 900 ont été menacés avec une arme - et il s'agit de chiffres portant sur une seule année scolaire.
Nous assistons à une véritable banalisation de la violence envers les enseignants.
Certes, comme tout agent de la fonction publique, les enseignants et personnels administratifs de l'éducation nationale peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle. Longtemps méconnue, elle fait l'objet d'un nombre croissant de demandes, qui reste très faible au regard des chiffres que je viens de rappeler. Dans un périmètre un peu plus large que celui de la seule éducation nationale, englobant les personnels de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports, le ministère dénombre 5 200 demandes en 2023.
L'analyse de ces demandes montre que, dans plus de deux tiers des cas, les auteurs des faits reprochés sont des élèves, des étudiants ou leurs représentants légaux. Pour 9 demandes sur 10, il s'agit d'atteintes volontaires à l'intégrité de l'agent, à savoir des atteintes physiques, morales ou des actes de harcèlement. Les autres cas concernent par exemple les atteintes aux biens, la protection des ayants droit ou encore la protection du fait de poursuites pénales contre l'agent.
Pour répondre à cette situation, la mission conjointe de contrôle a formulé 38 recommandations. Parmi celles-ci, 32 ne relèvent pas du domaine de la loi, mais elles sont importantes et ne doivent pas être oubliées. Je pense par exemple à celles qui sont relatives à la formation du personnel éducatif pour lui permettre de mieux faire face aux contestations d'enseignement et à la gestion des conflits, ou encore aux mesures visant à assurer la sécurité des établissements scolaires. Les 6 recommandations restantes, de portée législative, trouvent leur débouché dans la présente proposition de loi de notre président Laurent Lafon.
L'article 1er vise à recentrer le contenu de l'enseignement moral et civique (EMC). À de nombreuses reprises, nous avons constaté et dénoncé son contenu pléthorique, qui oblige l'enseignant à faire des choix en fonction de ses appétences ou de ce qui va intéresser ses élèves. Il en résulte un enseignement à la carte, à rebours de l'objectif de l'EMC devant permettre à tous les élèves de disposer d'une culture citoyenne commune.
L'article 2 tend à clarifier le périmètre d'application de la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Je tiens à le dire clairement : cet article concerne non pas les accompagnants des sorties scolaires, mais les élèves des établissements publics.
Aujourd'hui, la loi interdit à ces élèves le port de signes ou tenues religieux en cours, y compris lorsque ce cours se situe à l'extérieur du bâtiment - que ce soit dans le gymnase municipal pour l'EPS ou lors d'une sortie scolaire. Il en est de même lorsque l'activité commence pendant le temps scolaire et se poursuit au-delà de celui-ci, par exemple lors d'un voyage scolaire.
Pour reprendre l'expression du ministère de l'éducation nationale, il n'y aurait pas « d'effet cendrillon » selon lequel, à l'heure habituelle de fin des cours, la loi de 2004 cesserait subitement de s'appliquer si les élèves sont en sortie scolaire. Il existe toutefois une zone d'incertitude sur l'application de cette loi : elle concerne les activités liées à l'enseignement, mais qui ont intégralement lieu en dehors du temps scolaire. Les exemples suivants ont été cités à la mission conjointe de contrôle : une pièce de théâtre le soir en lien avec l'oeuvre étudiée en cours, une remise de prix hors du temps scolaire pour un concours organisé en classe, ou encore la visite d'un salon d'orientation un mercredi ou samedi après-midi avec un bus affrété par l'établissement scolaire.
L'article 2 vise à préciser que la loi de 2004 s'applique dès lors que les activités sont organisées par l'établissement scolaire, peu importe le lieu, le jour ou l'heure.
L'article 3 part d'un constat : les équipes pédagogiques et les établissements scolaires ont du mal à trouver une réponse face à des élèves perturbateurs. Les outils existants sont mal calibrés et difficilement mobilisables. Or tout élève et tout enseignant a le droit d'apprendre et de travailler dans un climat scolaire apaisé.
L'article 3 tend à rappeler que le respect de la vie collective et du bon fonctionnement de l'établissement fait partie des obligations de l'élève. Il permet la mise en place d'un parcours d'aide et de responsabilisation de l'élève et de ses parents. Peut-être faudrait-il aller plus loin. J'envisage ainsi de déposer un amendement en séance pour préciser un parcours progressif allant de l'accompagnement à la sanction. Nous aurons certainement l'occasion d'en débattre.
L'article 3 inscrit ce parcours à deux endroits dans le code de l'éducation.
D'une part, à l'article L. 111-3-1 du code de l'éducation introduit par la loi pour une école de la confiance. Celui-ci pose le principe d'un lien de confiance entre l'ensemble de la communauté éducative qui implique notamment le respect des personnels de l'éducation nationale par les élèves et leurs familles.
D'autre part, à l'article L. 511-1 du code de l'éducation qui définit les obligations de l'élève.
Il me semble important de nous attarder quelques minutes sur cet article de la proposition de loi. Le code de l'éducation définit trois obligations pour l'élève : l'accomplissement des tâches inhérentes à ses études, l'assiduité, et enfin le respect de la vie collective et du bon fonctionnement de l'établissement scolaire.
En cas de non-respect de l'obligation d'assiduité scolaire, le code de l'éducation prévoit dans sa partie réglementaire un processus graduel d'accompagnement en plusieurs étapes pouvant aller jusqu'à la sanction : d'abord avec les équipes pédagogiques ou la commission éducative pour le second degré, puis avec les services académiques, et enfin avec le président du conseil départemental. À chacune de ces étapes, des mesures sont prises et font l'objet d'un contrat avec les parents. Si, malgré l'ensemble de ces mesures - qui incluent des actions éducatives et sociales -, l'enfant continue à être absent, le directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen), sur délégation du recteur, peut saisir le procureur de la République. Les parents s'exposent alors à une contravention de classe 4, soit 750 euros.
Par parallélisme, il me semble cohérent qu'un processus graduel analogue puisse être mis en place pour le non-respect des règles de vie collective et pour les atteintes au bon fonctionnement de l'établissement scolaire.
L'article 4 vise à rendre automatique en cas d'outrages, menaces ou violences, l'octroi de la protection fonctionnelle pour les personnels relevant du code de l'éducation - enseignants, personnels administratifs, accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) et assistants d'éducation notamment. Je vous proposerai tout à l'heure un amendement visant à préciser ce dispositif.
Par ailleurs, l'article 5 impose à l'administration, avec l'accord de l'agent victime ou de ses ayants droit s'il est décédé, de déposer plainte en son nom. La semaine dernière, Élisabeth Borne a déclaré être favorable à cette mesure. De même, les syndicats que j'ai rencontrés plaident pour un renforcement de la protection des personnels de l'éducation nationale.
Enfin, l'article 6 tend à renforcer l'information des autorités académiques et des chefs d'établissement en cas de mise en examen ou de condamnation à une infraction à caractère terroriste d'un de leurs élèves ou d'un jeune ayant vocation à être scolarisé.
Cet article répond à une demande des chefs d'établissement. En effet, ceux-ci sont responsables de la sécurité au sein de leur collège ou lycée. Je précise que le partage de ces informations sensibles est strictement encadré : seuls les personnels de direction, les conseillers principaux ainsi que, pour les internats, les professionnels sociaux et de santé tenus par le secret professionnel, peuvent en être informés. En sont exclus les enseignants, ainsi que les parents d'élèves.
Pour faciliter le rôle des chefs d'établissement en matière de sécurité, je vous proposerai un amendement visant à sécuriser le régime juridique de l'inspection et de la fouille des sacs et casiers des élèves.
Cet article s'inscrit dans le contexte d'agressions violentes avec des armes blanches dans les établissements scolaires ou à leurs abords. L'inspection visuelle des sacs est déjà possible dans le cadre du plan Vigipirate. Il s'agit de sécuriser la base juridique pour les autres menaces à la sécurité de l'établissement scolaire. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, la fouille des effets personnels de l'élève nécessitera son accord ou celui de ses représentants légaux. Enfin, il n'est évidemment pas question de palpation.
En conclusion, le présent texte constitue une étape pour renforcer la protection des personnels de l'éducation nationale et restaurer un climat scolaire apaisé au sein des établissements scolaires.
Concernant le périmètre pour l'application des irrecevabilités prévues par l'article 45 de la Constitution, je vous propose qu'il inclue les dispositions relatives à la défense et la promotion de la laïcité, au renforcement de l'autorité scolaire, à la sécurité des établissements scolaires et de leurs abords, à la protection des personnels travaillant pour l'institution scolaire.
En revanche, n'entreraient pas dans ce périmètre les dispositions relatives à la protection de l'ensemble des agents publics ou des élus.
Il en est ainsi décidé.
Mme Marie-Pierre Monier. - Nous examinons ce matin le rapport qui vient concrétiser, sur le plan législatif, la mission conjointe de contrôle sur le signalement et le traitement des pressions, menaces et agressions dont les enseignants sont victimes, initiée par notre commission en lien avec la commission des lois à la suite de l'attentat terroriste ayant conduit à la mort de Samuel Paty. L'assassinat de Dominique Bernard, survenu quelques mois après son lancement, nous a douloureusement rappelé à quel point elle était pertinente.
Les attentes étaient et demeurent immenses au regard des faits dramatiques dont il est question. Je sais que nous partageons, au sein de cette commission, un même impératif : celui de tout mettre en oeuvre pour garantir la sécurité des personnels qui font vivre chaque jour notre école de la République.
À cet égard, nous ne pouvons que saluer l'article 4, à notre sens le plus important de ce texte, qui tend à faciliter la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle, ainsi que la proposition de la rapporteure visant à ce que l'administration accorde, de plein droit et sans délai, cette protection lorsqu'un personnel de l'éducation nationale est victime de violences, menaces ou outrages. C'est une amélioration concrète, indispensable au regard des carences actuelles du dispositif pointées par la mission d'information.
L'article 5, qui permet à l'administration de déposer plainte en lieu et place d'un personnel de l'éducation nationale, conformément à une annonce du ministre de la fonction publique en septembre 2023 - jusqu'ici jamais concrétisée -, va également dans le bon sens.
L'article 1er est moins concrètement lié au sujet qui nous préoccupe, mais nous en rejoignons l'esprit, qui vise à recentrer le contenu de l'enseignement moral et civique sur la formation aux valeurs et aux principes de la République et le fonctionnement des institutions - même si nous regrettons que cet élagage conduise à la disparition de certaines notions qui nous paraissent essentielles.
L'article 2 permet de lever toute ambiguïté concernant le périmètre d'application de la loi de 2004 concernant l'interdiction du port de signes et tenues religieux ostentatoires. Les auditions menées dans le cadre de l'élaboration de ce rapport ont toutefois souligné que, dans les faits, cette interdiction s'appliquait déjà à l'ensemble des activités organisées par l'institution scolaire.
Pour conclure, j'évoquerai les deux articles qui suscitent davantage de réserves de la part du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER).
L'article 3 vise à renforcer la responsabilisation des parents en cas de non-respect répété des règles de fonctionnement et de la vie collective de l'établissement. Or le recours à la voie réglementaire nous ôte toute prise sur ce qu'impliquera concrètement cette responsabilisation - j'entends les réflexions de la rapporteure à ce sujet. Je l'avais indiqué lors de l'examen du rapport issu de la mission d'information, la prévention et l'accompagnement des familles en vue de renouer le dialogue entre parents et institution scolaire auront toujours notre préférence sur une réponse répressive et autoritaire.
En ce qui concerne l'article 6, qui prévoit l'information de l'autorité académique et du chef d'établissement en cas de mise en examen ou condamnation pour un crime ou une infraction à caractère terroriste d'un élève, nous nous interrogeons sur le poids de la nouvelle responsabilité qui pourrait peser sur le chef d'établissement.
Mon groupe sera donc très attentif aux évolutions que pourrait connaître ce texte en séance et nous réservons notre vote.
M. Max Brisson. - Cette proposition de loi honore le Sénat. Elle témoigne de la capacité de notre assemblée à réfléchir à froid après un drame absolu, l'assassinat atroce de Samuel Paty. L'idée de cette proposition de loi est née lors de la rencontre entre Gérard Larcher et Mickaëlle Paty, soeur de Samuel Paty. Elle s'inspire des conclusions de la mission conjointe de contrôle sur les menaces dont sont victimes les enseignants, présidée par Laurent Lafon et François-Noël Buffet. Nous avons tous vécu des moments de grande émotion lors des auditions. Celles-ci nous ont aussi permis de prendre la mesure du climat de violence au quotidien dans lequel travaillent beaucoup de professeurs.
Je tiens à remercier Laurent Lafon d'avoir déposé cette proposition de loi, ainsi que notre rapporteure pour le travail remarquable qu'elle a effectué : ils ont su analyser à froid le drame, en le replaçant dans un contexte plus général, en évitant toute surréaction liée à l'émotion. Ils nous proposent une réponse mature, qu'il convient de soutenir.
Il est crucial de rassurer et de protéger les professeurs, si l'on veut rétablir l'attractivité de ce métier. Il est indispensable en effet de répondre à leur mal-être. Celui-ci est lié, notamment, aux violences qu'ils peuvent subir dans leur travail. Ils exercent dans une ambiance d'insécurité, et doivent être sur le qui-vive en permanence, ce qui est épuisant. Cela contribue à la dégradation de l'image des professeurs, tandis que ceux-ci perdent confiance dans l'éducation nationale et dans la société.
La France est le pays de l'Union européenne où les actes de violence à l'école sont les plus nombreux. Parmi les pays de l'OCDE, seuls des pays très violents comme l'Argentine, le Brésil ou le Mexique, sont plus mal classés que nous.
Le recensement des actes de violence progresse, car le « pas de vagues ! » recule. Il ne recule toutefois pas assez pour que la violence du quotidien soit totalement identifiée.
Cette proposition de loi n'apporte qu'un début de réponse, car l'essentiel, en la matière, relève du pouvoir réglementaire. Ce texte n'aura donc de sens que si le Gouvernement prend des mesures en adéquation avec ce texte. Le rapport Lafon-Buffet comporte de nombreuses pistes concrètes, d'ordre réglementaire, qui mériteraient d'être mises en oeuvre sans tarder en matière de prévention, de sanction et de réparation, ces trois axes qui doivent constituer le trépied d'une politique visant à protéger les professeurs.
La protection des professeurs par l'État doit être spécifique, car leur exposition à la violence est particulière. Nous ne pouvons pas accepter que leur sécurité soit assurée par l'entremise de mesures prévues pour l'ensemble des fonctionnaires. Le ministère doit leur apporter une protection particulière. Les ministres de l'intérieur ont toujours le réflexe de protéger leurs agents. Le ministère de l'éducation nationale doit avoir les mêmes réflexes.
Le texte recentre les missions de l'éducation morale et civique. Je m'en réjouis car cet enseignement a été dilué et s'est éparpillé, au risque d'oublier l'essentiel. Cet enseignement est d'abord fait pour apprendre et comprendre les principes et les valeurs de notre République, et le fonctionnement des institutions.
Le texte clarifie le périmètre d'application de la loi de 2004 concernant l'interdiction du port de signes et tenues religieux ostentatoires. Nous avons toujours dit que l'école hors les murs était le prolongement de l'école.
Ce texte vise à renforcer la responsabilisation des parents. Nous regrettons que la jurisprudence ne permette pas d'envisager d'étendre ce qui existe dans l'école privée sous contrat, c'est-à-dire le contrat d'engagement, qui responsabilise davantage les parents. Il y a là une inégalité entre l'école privée sous contrat et l'école publique. Il faut que cette dernière soit dotée des mêmes moyens d'action à cet égard.
L'automaticité de l'octroi de la protection fonctionnelle pour les personnels relevant du code de l'éducation va dans le bon sens, mais j'envisage de déposer des amendements en séance afin d'accorder aux chefs d'établissement un statut particulier, qui pourrait s'apparenter à celui d'agent dépositaire de l'autorité publique, de manière à ce qu'il soit possible d'accroître les peines prononcées si un fait est commis à leur encontre, comme cela est le cas pour les policiers ou pour les magistrats.
Ce texte donne des droits nouveaux aux chefs d'établissement et je m'en réjouis, mais le pouvoir réglementaire doit prendre les mesures nécessaires pour le compléter. Il est urgent de rétablir les prérogatives d'autorité dont disposaient les chefs d'établissement, les conseils de classe et les conseils de discipline il y a encore quelques années. C'est ainsi que nous pourrions protéger l'école et ses professeurs.
Notre groupe salue les avancées de ce texte, mais nous attendrons beaucoup des réponses de la ministre en séance.
Mme Sonia de La Provôté. - Cette proposition de loi s'inscrit dans le prolongement de longs travaux, assez douloureux, puisque nous avons vécu des moments très intenses lors des auditions. Comme l'a souligné Max Brisson, le Sénat s'honore à traiter de cette manière ce sujet fondamental.
La proposition de loi aborde de nombreux sujets. Je pense ainsi à l'octroi de la protection fonctionnelle, une demande qui est revenue souvent lors des auditions. La rédaction proposée sur ce point est claire et ne donne lieu à aucune ambiguïté.
Je m'interroge sur notre capacité à observer les faits. Nous sommes confrontés à une banalisation de la violence. Les professeurs éprouvent un sentiment de désarroi et d'anxiété. Mais nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg. Même si les signalements de ces faits sont plus fréquents, il reste de nombreux « trous dans la raquette » et nous sommes dans l'incapacité de dresser un diagnostic précis et juste de l'ampleur du phénomène.
Il faudrait identifier les facteurs de risques, qu'ils soient territoriaux, de nature sociale, corrélés à la typologie des établissements scolaires, liés à l'environnement de l'auteur des troubles, etc. Il conviendrait d'analyser ces éléments avec l'objectivité d'un médecin qui évalue des symptômes, afin de pouvoir mettre en oeuvre des actions de prévention ou de formation adaptées. La qualité du diagnostic reste insuffisante. Pour l'améliorer, il importe d'y consacrer les moyens nécessaires.
Je constate aussi que les programmes de l'enseignement moral et civique sont muets sur l'école de la République en tant qu'institution, sur son histoire, sur la nécessité de la protéger. Les jeunes enfants doivent savoir que l'existence de l'école est une chance pour eux, et non un obstacle à leur épanouissement dans notre pays. Les programmes de l'EMC devraient comporter un volet sur l'école comme sur toutes les autres institutions fondatrices de la République.
Enfin, le texte prévoit un triptyque « sanction, protection, réparation ». Mais on est encore loin de pouvoir aborder avec sérénité ces problèmes. Si un nouvel événement dramatique intervenait demain, nous serions sans doute conduits à créer une nouvelle mission d'information sur le sujet...
Mme Monique de Marco. - Ce texte s'inscrit dans le prolongement de la mission présidée par Laurent Lafon et François-Noël Buffet, qui a été créée en 2023 et qui a rendu ses conclusions il y a déjà un an.
Nous vivons dans un climat de violence généralisée et notre école n'est pas épargnée. Nous payons les conséquences du délaissement de nos services publics.
Alors que l'école devrait être un sanctuaire, un lieu d'émancipation et de lutte contre les inégalités, elle manque de tout, d'enseignants, de médecins, de psychologues scolaires, d'éducateurs, etc. Les services de protection de l'enfance sont aussi en déshérence.
Au cours des quarante dernières années, huit enseignants ont été tués dans le cadre de leur fonction, dont trois récemment. Les professeurs sont confrontés au quotidien à de nombreuses agressions physiques, verbales et psychologiques de la part des élèves ou des parents d'élèves.
Cette progression de la violence en milieu scolaire en général, et envers les enseignants en particulier, touche tous les territoires, urbains ou ruraux, favorisés ou populaires. En Aquitaine on a recensé, depuis le début de l'année scolaire, 180 menaces verbales de la part de parents contre le personnel éducatif et 11 faits déclarés de violences physiques commises par des élèves envers la communauté éducative : ces chiffres sont élevés et sont en forte progression. La rectrice, pour faciliter les relations avec les parents, invite les parents, s'ils le souhaitent, à signer une charte des relations entre l'école et les familles.
Ce texte traduit une prise de conscience de la nécessité de renforcer le soutien aux enseignants, qui souffrent d'un manque d'écoute et ont l'impression d'être abandonnés. Nous soutenons les dispositions visant à octroyer automatiquement la protection fonctionnelle et à soutenir les enseignants dans les démarches judiciaires.
Cependant, à mon sens, ce texte fait l'impasse sur certains problèmes structurels de l'école, qui nourrissent les tensions et participent à la dégradation du climat scolaire. Je pense notamment au manque de personnel encadrant pour accompagner les élèves et prévenir les tensions, ce qui est souvent le rôle des conseillers principaux d'éducation (CPE), des psychologues scolaires ou des assistants d'éducation.
Le groupe écologiste sera donc vigilant et attentif aux évolutions de ce texte en séance.
Mme Laure Darcos. - Je tiens à mon tour à saluer le travail de notre rapporteure et à me réjouir du dépôt de ce texte, que nous sommes nombreux à avoir cosigné. J'ai aussi un souvenir très ému des auditions de certains professeurs, avant même la création de notre mission conjointe de contrôle, qui voulaient rester anonymes, tellement ils avaient peur d'être réprimandés s'ils parlaient à coeur ouvert, à l'époque du hashtag #PasdeVague.
Comme Max Brisson, je pense que nous pourrions aller beaucoup plus loin dans la réflexion sur le règlement intérieur, afin d'impliquer, comme dans le privé, les parents, les élèves, les professeurs et le chef d'établissement. Nous pourrions y faire figurer la mention qu'un enseignement du fait religieux sera dispensé. Il devrait être signé par toutes les parties prenantes. Ce serait une manière de sceller un vrai contrat de confiance entre les partenaires.
Vous n'avez pas du tout évoqué le problème des groupes WhatsApp. J'ai un exemple en tête : des élèves n'ont pas été exclus de leur établissement alors qu'ils avaient insulté leurs professeurs et certains de leurs camarades, menaçant même de les égorger, sur un groupe WhatsApp de l'ensemble de la classe. Comme cela se passait hors du temps scolaire, ils n'ont pas été pénalisés. Il conviendrait de trouver une manière de lutter contre le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Le sujet est difficile.
Il serait pertinent de donner plus d'autorité aux chefs d'établissement. Toutefois, c'est un sujet très compliqué. Dans de nombreux cas, les professeurs ne sont pas soutenus par le chef d'établissement ou par la direction académique. Certains enseignants ne savent plus à qui s'adresser. Il faut donc réfléchir à la situation de ces professeurs qui ne sont pas soutenus, et qui sont même parfois harcelés par leur hiérarchie au motif qu'il ne faut pas faire de vagues dans l'établissement.
Mme Evelyne Corbière Naminzo. - Ce texte est important, il est attendu. Il traduit notre volonté collective de protéger l'école de la République et les personnels.
L'article 2 clarifie les règles sur le port des signes et tenues manifestant une appartenance religieuse. Au lendemain des débats que nous avons eus ici au Sénat sur la proposition de loi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport, il est judicieux d'adopter un tel article qui précise de façon pratique les choses et qui évite de longues discussions.
L'article 3 concerne la responsabilité des parents. Je partage ce qui a été dit sur le rôle de l'école en matière de prévention et d'éducation. La préoccupation qui nous guide de vouloir protéger l'école et les valeurs qu'elle véhicule est importante. Il faut restaurer l'autorité des enseignants, mais il convient également d'accompagner les parents pour les aider à trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Il est important de renforcer la responsabilisation des parents, mais on ne peut pas se contenter d'exclure de l'école les élèves qui posent des soucis.
Nos travaux d'aujourd'hui appellent d'autres textes pour apporter de vraies solutions, car autrement, qu'allons-nous faire de tous ces enfants qu'on retire de nos écoles, mais qui existent malgré tout dans notre société ? Nous sommes donc favorables à des mesures progressives, allant de l'accompagnement à la sanction, de façon à impliquer tous les acteurs intervenant autour de la famille, et pas seulement au sein de l'école.
L'article 4 est fondamental. Il constitue une réponse pertinente à nos préoccupations de vouloir protéger et soutenir l'école de la République. Je m'interroge pourtant sur la décision de retrait éventuel de la protection fonctionnelle. Comment concrètement ce retrait peut-il être notifié ? Mes propos s'inscrivent dans la continuité de ceux de Laure Darcos sur le recours à la voie hiérarchique. Nous devons nous interroger sur tous les contextes concrets qui entourent des situations de violence. Comment accorder automatiquement une protection fonctionnelle, si celle-ci est susceptible d'être retirée quatre mois plus tard, après un véritable examen de la demande ? Cela ne semble pas faisable. Il faudrait clarifier ce point. Le professeur risque d'être discrédité.
L'article 5 comporte une bonne mesure, mais nous ne sommes pas naïfs. Il s'agit en fait d'un véritable changement de paradigme. L'injonction du « pas de vagues » a formaté des générations de professionnels dans l'éducation nationale. Il faut prévoir une formation et une information régulières des professionnels, afin que chacun des membres de la communauté éducative ait une bonne connaissance de la loi. Puisque celle-ci change régulièrement, il est nécessaire d'entretenir un dialogue constant entre l'institution de l'éducation nationale et tous ses agents sur ce point.
En conclusion, ce texte doit répondre aux problématiques auxquelles sont confrontées les équipes pédagogiques. L'enjeu est de résoudre le problème de la violence à l'école, dans un contexte social de perte de sens, de perte de perspectives et de pauvreté croissante. L'école doit être en mesure d'apporter des solutions, d'ouvrir des perspectives et de permettre à toute notre jeunesse, même à celle qui pose problème, de rêver et d'espérer en un avenir meilleur. Nous analyserons les modifications qui seront apportées à ce texte. Dans l'immédiat, nous réservons notre vote.
M. Jacques Grosperrin. - J'ai été très ému lors de l'audition de la soeur de Samuel Paty.
Notre rapporteure dit que la situation est préoccupante. En 2015, j'avais rédigé un rapport intitulé Faire revenir la République à l'École. Nous avions déjà formulé une série de préconisations, mais on se rend compte que les choses ne bougent pas vraiment. Les assassinats de Samuel Paty et de Dominique Bernard ont choqué la France entière, et nous ne pouvons pas rester passifs.
La laïcité, cela ne s'enseigne pas, cela se partage ! Cela signifie que nous devons soutenir l'article 1er, qui vise à recentrer le contenu de l'enseignement sur la laïcité. Je déplore que les projets qui participent à la construction du « vivre ensemble » dans les établissements scolaires souffrent de la suspension de la part collective du pass Culture.
Le débat que nous avons eu hier dans l'hémicycle sur la laïcité dans le sport m'interroge. Il a montré que nous n'étions pas unis autour de certains principes de la République ou certains principes de la laïcité. Voilà un message négatif que nous envoyons à l'ensemble des Français.
Il est fondamental que nous soyons unis sur cette proposition de loi, afin que les gens puissent se dire que les parlementaires sont d'accord entre eux. Ceux qui ont assisté au débat d'hier peuvent au contraire se dire qu'il existe différents types de laïcité, différentes approches. Nous ne cherchons pas à stigmatiser les uns ou les autres. Nous voulons simplement protéger nos enseignants et faire revenir la République à l'école. Il serait sans doute intéressant de faire en sorte que la laïcité soit non seulement enseignée, mais aussi partagée dès le plus jeune âge, dès 3 ans. C'est ainsi que l'on infusera concrètement le principe de laïcité dans les familles. Les parents pourront comprendre que les choses ne sont pas tout à fait ce qu'ils imaginent.
En ce qui concerne l'article 3 relatif à la responsabilité des parents, nous devons être intransigeants. Il faut les faire venir à l'école dès le premier acte répréhensible.
Lorsqu'il y a des difficultés, les enfants sont parfois déplacés. Il convient de réfléchir à la création de structures adaptées pour les accueillir et les accompagner.
Les articles 4 et 5 sont importants.
En conclusion, nous ne devons pas avoir la main qui tremble, car l'école est le premier lieu d'apprentissage et d'éducation des enfants. Beaucoup se joue à cet âge. Il faut donc être sévère ; c'est à travers la sévérité que l'on aide les enfants à grandir.
M. Pierre Ouzoulias. - Je suis encore extrêmement ému par ce que j'ai entendu lors de cette mission conjointe de contrôle.
En tant qu'archéologue, je me souviens du jour où j'ai appris la mort de mon collègue archéologue à Palmyre, tué par l'État islamique. J'ai été très ému. Je ne pensais pas que l'on pouvait être assassiné simplement parce que l'on est archéologue. J'ai réagi de la même façon à la mort de Samuel Paty, car j'ai enseigné l'histoire. Là aussi, j'ai pris conscience que l'on pouvait être assassiné simplement - si j'ose dire - parce que l'on est professeur d'histoire. Dans les deux cas, la même idéologie est à l'oeuvre : une idéologie islamiste qui combat la connaissance, la rationalité, la raison et finalement la culture.
J'ai eu de nombreuses discussions avec les enseignants. Aujourd'hui, ils sont tous unanimes. On assiste à une montée du sentiment religieux, dans toutes les religions. Il devient parfois difficile d'enseigner la littérature, la biologie, l'histoire. Les jeunes professeurs, qui ne savent pas encore comment maîtriser leur classe, préfèrent éviter des sujets qui risquent de susciter des débats parmi les enfants et surtout parmi les parents. Ils sont confrontés à une génération de parents, dans tous les quartiers, pas seulement les communes populaires, qui considèrent qu'ils connaissent mieux la pédagogie que les enseignants et donc corrigent les enseignements. Les professeurs éprouvent une immense perte de sens.
Je reviens à Ferdinand Buisson : le rôle de l'école de la République, c'est de former des républicains. Nous devons soutenir les enseignants, afin qu'ils aient le sentiment qu'ils forment des républicains.
En ce qui concerne la protection fonctionnelle, j'avais déposé une proposition de loi qui était plus large puisqu'elle visait à améliorer la protection fonctionnelle accordée à tous les agents publics. Mais il serait déjà bien de faire en sorte de faciliter l'octroi de cette protection aux enseignants.
En tant que père d'une interne en médecine, je peux témoigner que les violences à l'égard des personnels soignants dans les hôpitaux sont terrifiantes. Malheureusement, l'hôpital doit prendre en charge tous les cas psychiatriques dont les autres organismes ne veulent plus s'occuper.
Enfin, je souhaite dire avec beaucoup de bienveillance à certains de mes collègues que j'ai bien entendu leur discours sur la nécessité de libérer les jeunes filles de la contrainte du voile. Ils ont raison, mais il faut aller plus loin et étendre le champ de la loi de 2004 à l'école privée. Je déposerai des amendements en ce sens. Si nous devons défendre les petites filles contre l'emprise du voile, nous devons le faire dans le privé comme dans le public.
M. Bernard Fialaire. - L'émotion suscitée par les assassinats et les agressions de professeurs est très forte, mais je constate que nous en revenons toujours aux mêmes thèmes.
Le caractère pléthorique de l'enseignement moral et civique a été évoqué. Il y a deux ans, j'ai été rapporteur de la proposition de loi d'Henri Cabanel tendant à renforcer la culture citoyenne. Nous faisions le même constat et nos préconisations étaient déjà les mêmes que celles que vous formulez, mais rien n'a changé !
Les problèmes dont nous discuterons tout à l'heure en examinant la proposition de loi relative à la lutte contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur proviennent aussi du fait que la culture républicaine n'a pas été transmise durant la scolarité par les enseignements d'éducation morale et civique. J'y insiste : les programmes sont pléthoriques et les enseignants n'ont pas le temps de les traiter.
En ce qui concerne l'absentéisme, j'avais rédigé un rapport Prévenir la délinquance des mineurs - Éviter la récidive, avec Laurence Harribey, Muriel Jourda, et Céline Boulay-Espéronnier. Nous faisions là encore les mêmes constats que vous aujourd'hui sur l'ampleur du décrochage scolaire.
Peut-être pourrions-nous rassembler tous nos rapports et toutes nos propositions pour leur donner plus de force. Il serait temps qu'elles soient suivies d'effets ! Combien de temps encore allons-nous faire les mêmes constats et proposer les mêmes solutions ?
Mme Catherine Belrhiti. - Il faut mettre l'accent dans l'enseignement moral et civique sur les devoirs. On parle beaucoup de valeurs, mais on parle peu des devoirs. J'ai enseigné l'histoire pendant quarante ans. On consacre dix heures dans l'année à l'éducation civique. Ce n'est pas suffisant. Il est important d'enseigner ce qu'est être Français.
L'article 3 prévoit la possibilité, en cas de non-assiduité scolaire, d'infliger une amende aux parents. Cela me semble irréalisable. Mieux vaudrait toucher aux allocations, car c'est le seul moyen de pouvoir récupérer de l'argent ou de forcer les parents à envoyer leurs enfants à l'école.
Mme Annick Billon, rapporteure. - Cette proposition de loi ne constitue en aucun cas une réponse à tous les maux de l'école. Elle s'inscrit dans le prolongement de la mission menée par Laurent Lafon et François-Noël Buffet, à la suite des assassinats sordides de Samuel Paty et Dominique Bernard.
Marie-Pierre Monier a émis des réserves sur l'article 3 et sur l'article 6, mais sur les autres articles, nos points de vue convergent.
En ce qui concerne la responsabilisation des parents, je suis favorable à un parcours progressif d'accompagnement allant de la prévention à la sanction. Il ne s'agit pas de commencer par la sanction.
L'article 6 renforce l'information des chefs d'établissement en cas de mise en examen ou de condamnation pour une infraction à caractère terroriste d'un de leurs élèves. Je rappelle que ce partage d'informations a déjà lieu pour les crimes et délits, notamment ceux à caractère sexuel. Il me semble tout à fait opportun qu'il s'applique aussi en cas de terrorisme.
Je souscris aux propos de Max Brisson. Cette proposition de loi ne constitue en effet qu'une partie de la réponse. Le rapport de Laurent Lafon et François-Noël Buffet comportait trente-huit propositions, seules six d'entre elles sont reprises dans la proposition de loi, puisque toutes les autres n'ont pas un caractère législatif. Mais cette proposition de loi est une première réponse. À charge désormais au ministère de s'emparer des autres recommandations d'ordre réglementaire, qui sont aussi très importantes pour répondre aux maux de l'école.
Max Brisson a également mis l'accent sur la responsabilisation des parents. Il a évoqué la possibilité d'étendre le contrat d'engagement qui existe dans les écoles privées sous contrat à l'école publique. Cela pourrait être une piste de réflexion pour d'éventuels amendements. Toutefois, cela me semble difficile à mettre en oeuvre. Que fera-t-on si les parents refusent de signer ? Mais je suis ouvert à vos propositions.
Vous proposez également de rendre les chefs d'établissement dépositaires de l'autorité publique. Actuellement leurs prérogatives découlent du fait qu'ils exercent une mission de service public. Peut-être pourrions-nous renforcer leur rôle. Mais s'ils deviennent dépositaires de l'autorité publique, cela signifie qu'ils auront le pouvoir de sanction. Je ne sais pas s'ils le souhaitent.
Sonia de La Provôté a mis en évidence, avec raison, le manque de données chiffrées dont nous disposons, qui nous empêche d'apporter des réponses adéquates. Quel que soit le problème, nous avons toujours besoin de données précises et étayées pour pouvoir le résoudre. Elle a évoqué par ailleurs le triptyque « sanction, protection, réparation ». Nous préférons commencer par la prévention, puis par l'accompagnement, avant de prononcer, en dernier lieu, des sanctions.
Monique de Marco a souligné que l'école n'est pas épargnée par les violences. L'école, en effet, n'est plus un sanctuaire. Les solutions aux problèmes structurels de l'école qu'elle a évoqués ne relèvent pas nécessairement du domaine législatif, même si certains sujets peuvent être traités par cette voie. Par exemple, si l'on déplore le faible nombre de médecins scolaires, il nous appartient de faire voter, lors de l'examen du budget, des crédits pour augmenter les moyens de la médecine scolaire.
Les propos de Laure Darcos sur le règlement intérieur font écho à ceux de Max Brisson sur la signature d'un contrat entre les parents, les élèves, les enseignants et l'éducation nationale. Mais là encore que faire si les parents refusent de signer ? Dans la mesure où l'éducation est obligatoire et où l'enfant a droit à l'éducation, on ne pourra pas l'exclure de l'école.
En ce qui concerne les faits qui auraient lieu en dehors de l'école sur des groupes WhatsApp, la jurisprudence administrative autorise l'établissement à prendre des sanctions même si les faits ont lieu à l'extérieur de l'établissement dès lors qu'ils sont liés à la qualité d'élève ou à l'école.
En ce qui concerne la responsabilisation des parents en cas de non-respect de l'obligation d'assiduité scolaire, un processus graduel d'accompagnement en plusieurs étapes pouvant aller jusqu'à la sanction existe. Nous proposons d'appliquer le même mécanisme pour le non-respect des règles de vie collective et pour les atteintes au bon fonctionnement de l'établissement scolaire.
Par ailleurs, vous vous interrogiez sur la pertinence d'octroyer automatiquement la protection fonctionnelle si celle-ci est susceptible d'être retirée quelques mois plus tard. Mais le bénéfice de la protection fonctionnelle peut déjà être octroyé puis retiré. Le mécanisme que nous proposons existe en fait déjà.
Jacques Grosperrin évoquait le fait que la laïcité ne s'enseigne pas, elle se partage. Certes, mais encore faut-il que la volonté de la partager existe aussi !
Il est donc nécessaire de préciser le cadre juridique en vigueur, afin de pouvoir dispenser le même enseignement à tous les élèves, quel que soit l'établissement scolaire.
Pierre Ouzoulias a fait remarquer, à juste titre, que la protection fonctionnelle devrait pouvoir être octroyée à de nombreux fonctionnaires au-delà des enseignants et des personnes qui travaillent dans l'éducation nationale. Nous partageons ce constat, mais ce n'est pas l'objet de cette proposition de loi, qui vise à rendre au métier d'enseignant tout son lustre, afin qu'il redevienne attractif. Je vous indique néanmoins que le Gouvernement a la volonté de s'emparer de ce sujet.
Comme le souligne Bernard Fialaire, nous réalisons un travail considérable au Sénat, qui se traduit notamment par des missions d'information et le dépôt de propositions de loi. Tant mieux si celles-ci convergent. Cela leur donne plus de poids.
Enfin Catherine Belrhiti propose d'aller plus loin en ce qui concerne les sanctions. Telles ne sont pas les propositions formulées dans ce texte, mais il est tout à fait possible de déposer des amendements en ce sens.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1er
M. Max Brisson. - L'article 1er vise à recentrer le contenu de l'enseignement moral et civique. C'est très bien. Cela traduit l'existence d'une volonté politique. Mais cet article est d'ordre réglementaire. Si la ministre veut rénover les programmes de l'enseignement moral et civique, il lui suffit de saisir le Conseil supérieur des programmes.
L'article 1er est adopté sans modification.
Article 2
L'article 2 est adopté sans modification.
Article 3
L'article 3 est adopté sans modification.
Article 4
Mme Annick Billon, rapporteure. - L'amendement COM-1 vise à faciliter la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle : l'administration n'a pas à attendre une demande de la part de l'agent concerné pour l'attribuer.
La mise en oeuvre de la protection fonctionnelle est subordonnée à certaines conditions. Ces dernières années, le ministère de l'éducation nationale a donné des directives claires à ses services pour que la protection fonctionnelle soit attribuée, même en l'absence de demande de l'agent.
La rédaction actuelle de l'article 4 mentionne une demande de l'agent, ce qui pourrait donner l'impression qu'il existe une obligation pour l'administration de disposer d'une demande formelle de la part de l'agent pour octroyer cette protection fonctionnelle. Cette pratique serait à rebours de la politique actuelle menée par le ministère pour mieux protéger les personnels de l'éducation nationale.
L'amendement COM-1 est adopté.
L'article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 5
L'article 5 est adopté sans modification.
Article 6
L'article 6 est adopté sans modification.
Articles additionnels après l'article 6
Mme Annick Billon, rapporteure. - L'amendement COM-3 vise à sécuriser le régime d'inspection et de fouille des affaires personnelles de l'élève.
Les chefs d'établissement doivent veiller à la sécurité des élèves et, de manière générale, à celle de l'ensemble des personnes présentes dans l'établissement. Dans le cadre du plan Vigipirate, il peut être procédé à une inspection aléatoire visuelle des sacs. Cet article vise à donner un outil opérationnel supplémentaire aux chefs d'établissement, ainsi qu'à leurs adjoints et aux conseillers principaux d'éducation, dans un contexte de violence accrue. Il permet aussi, avec l'accord de l'élève ou de ses représentants légaux, de procéder à la fouille des affaires personnelles.
Mme Marie-Pierre Monier. - Cette dernière précision est importante : l'accord de l'élève et des parents est important. Les élèves peuvent être impressionnés par le chef d'établissement. Pour les élèves mineurs, il convient de prévoir l'accord des parents.
Mme Annick Billon, rapporteure. - Un élève mineur qui sort de l'établissement pour aller au supermarché avec son sac à dos devra ouvrir ce dernier à l'entrée du magasin. Je ne vois donc pas pourquoi le chef d'établissement ne pourrait pas fouiller le sac d'un élève.
L'amendement COM-3 est adopté et devient article additionnel.
Mme Annick Billon, rapporteure. - L'amendement COM-4 vise à permettre l'application de cette proposition de loi à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie dans les domaines relevant de la compétence de l'État. Tous les territoires ultramarins n'ont pas pris les mêmes compétences ; il s'agit donc d'une coordination ultramarine.
L'amendement COM-4 est adopté et devient article additionnel.
Article 7
L'article 7 est adopté sans modification.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :
|
Auteur |
N° |
Objet |
Sort de l'amendement |
|
Article 4 |
|||
|
Mme Annick BILLON, rapporteure |
1 |
Condition de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle |
Adopté |
|
Articles additionnels après l'article 6 |
|||
|
Mme Annick BILLON, rapporteure |
3 |
Sécurisation du régime d'inspection et de fouille des affaires personnelles de l'élève |
Adopté |
|
Mme Annick BILLON, rapporteure |
4 |
Amendement de coordination ultramarine |
Adopté |
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
ET DES CONTRIBUTIONS
ÉCRITES
Mardi 4 février 2025
Table ronde des représentants des syndicats des personnels de l'Éducation nationale : MM. Jean-Rémi GIRARD, président national du SNALC, et Vincent LOUSTAU, secrétaire fédéral de la CFDT Éducation Formation Recherche Publiques.
Mercredi 5 février 2025
- Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports - Direction générale de l'enseignement scolaire (Dgesco) : M. Jean HUBAC, chef du service de l'accompagnement des politiques éducatives.
- Direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale (DGRH) : MM. Boris MELMOUX-EUDE, directeur général des ressources humaines, et Guillaume ODINET, directeur des affaires juridiques.
CONTRIBUTION ÉCRITE
Ø Fédération syndicale unitaire (FSU)
Proposition de loi n° 234 (2024-2025) visant à protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent
RÈGLES RELATIVES À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 45 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 44 BIS DU RÈGLEMENT DU SÉNAT (« CAVALIERS »)
Si le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution, depuis la révision du 23 juillet 2008, dispose que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », le Conseil constitutionnel estime que cette mention a eu pour effet de consolider, dans la Constitution, sa jurisprudence antérieure, reposant en particulier sur « la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » 7(*).
De jurisprudence constante et en dépit de la mention du texte « transmis » dans la Constitution, le Conseil constitutionnel apprécie ainsi l'existence du lien par rapport au contenu précis des dispositions du texte initial, déposé sur le bureau de la première assemblée saisie8(*).
Pour les lois ordinaires, le seul critère d'analyse est le lien matériel entre le texte initial et l'amendement, la modification de l'intitulé au cours de la navette restant sans effet sur la présence de « cavaliers » dans le texte9(*). Pour les lois organiques, le Conseil constitutionnel ajoute un second critère : il considère comme un « cavalier » toute disposition organique prise sur un fondement constitutionnel différent de celui sur lequel a été pris le texte initial10(*).
En application des articles 17 bis et 44 bis du Règlement du Sénat, il revient à la commission saisie au fond de se prononcer sur les irrecevabilités résultant de l'article 45 de la Constitution, étant précisé que le Conseil constitutionnel les soulève d'office lorsqu'il est saisi d'un texte de loi avant sa promulgation.
En application du vademecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des Présidents, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a arrêté, lors de sa réunion du mercredi 19 février 2025, le périmètre indicatif de la proposition de loi visant à protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent.
Elle a considéré que ce périmètre incluait les dispositions relatives :
- à la défense et la promotion de la laïcité ;
- au renforcement de l'autorité scolaire ;
- à la sécurité des établissements scolaires et de leurs abords ;
- à la protection des personnels travaillant pour l'institution scolaire.
En revanche, n'entreraient pas dans ce périmètre les dispositions relatives à la protection de l'ensemble des agents publics ou des élus.
LA LOI EN CONSTRUCTION
Pour naviguer dans les rédactions successives du texte, visualiser les apports de chaque assemblée, comprendre les impacts sur le droit en vigueur, le tableau synoptique de la loi en construction est disponible sur le site du Sénat à l'adresse suivante :
https://www.senat.fr/leg/ppl24-234.html
* 1 L'école de la République attaquée : agir pour éviter de nouveaux drames, François-Noël Buffet et Laurent Lafon, rapport d'information n° 377, session 2023-2024.
* 2 Bilan de la protection fonctionnelle, année 2023, direction des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
* 3 Comment redynamiser la culture citoyenne, Stéphane Piednoir, Henri Cabanel, rapport n° 648, session 2021-2022.
* 4 Proposition de loi tendant à renforcer la culture citoyenne adoptée par le Sénat le 23 novembre 2023.
* 5 L'école de la République attaquée : agir pour éviter de nouveaux drames, Laurent Lafon, François-Noël Buffet, rapport d'information n° 377, 2023-2024.
* 6 Dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, le Conseil constitutionnel a jugé que le refus pour une personne de se soumettre aux palpations de sécurité et fouilles de bagages pour assister à une manifestation ne peut avoir pour autre conséquence que le refus d'accès aux lieux où se déroule la manifestation, et ne constitue ni une méconnaissance de la liberté d'aller et venir, ni celle du droit au respect de la vie privée.
* 7 Cf. commentaire de la décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites.
* 8 Cf. par exemple les décisions n° 2015-719 DC du 13 août 2015 - Loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne et n° 2016-738 DC du 10 novembre 2016 - Loi visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias.
* 9 Décision n° 2007-546 DC du 25 janvier 2007 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions et modifiant le code de la santé publique.
* 10 Décision n° 2020-802 DC du 30 juillet 2020 - Loi organique portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France.