Rapport d'information n° 65 (1995-1996) de M. Bernard BARBIER , fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification, déposé le 9 novembre 1995
Disponible au format Acrobat (1,3 Moctet)
-
PRÉSENTATION
-
I. UNE PROJECTION À MOYEN TERME
(1995-2002) DES FINANCES SOCIALES
-
II. L'IMPACT DES FLUCTUATIONS
MONÉTAIRES EN EUROPE
-
III. L'ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES
MÉNAGES COMMENT ÉVALUER L'INCERTITUDE ?
-
I. UNE PROJECTION À MOYEN TERME
(1995-2002) DES FINANCES SOCIALES
-
ANNEXE - Perspectives à moyen terme des
finances sociales de la France*
-
1. Les perspectives macro-économiques
générales.
-
2. Les dépenses de santé à
moyen terme : une hausse modérée de la CSG serait
nécessaire.
-
3. Us retraites : peu de problèmes de
financement à l'horizon 2002
-
4. Les dépenses pour la famille, le
chômage et le RMI ne menacent pas les grands équilibres
-
5. Quelles réformes ?
-
6. Conclusions
-
1. Les perspectives macro-économiques
générales.
N ° 6 5
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996
|
|
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation du Sénat pour la planification (1) sur les résultats de travaux de projection : finances sociales, environnement international,
Par M. Bernard BARBIER,
Sénateur.
(1) Cette délégation est composée de : MM. Bernard Barbier, président , Bernard Hugo, Marcel Lesbros, Georges Mouly, René Régnault, vice-présidents ; Jacques Braconnier, Louis Minetti, secrétaires ; Mme Janine Bardou, MM Michel Charzat, Roger Husson, Henri Le Breton, Daniel Percheron, Jean-Marie Poirier, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert.
Prévisions et projections économiques . - Chômage - Consommation - Cotisations sociales -Croissance - Dépenses de santé - Dévaluations - Emploi - Épargne - Finances sociales - Inflation - Plan - Retraite - Sécurité sociale - Rapports d'information.
PRÉSENTATION
Comme les années précédentes, la Délégation pour la Planification vous soumet quelques éléments de réflexion sur les perspectives économiques à moyen terme. Cet exercice permet de faire la synthèse de différents travaux de projection et de simulation suivis par la Division des Études macroéconomiques du Sénat, sous l'égide de la Délégation.
Ceux qui sont présentés dans la première partie et l'annexe à ce rapport ont été réalisés à l'aide du modèle MOSAÏQUE de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). Ils concernent les perspectives à l'horizon 2002 des finances sociales .
L'ambition de cette étude n'est pas de proposer des réponses aux difficultés actuelles de la Sécurité Sociale. Il s'agit plutôt d'illustrer, par un éclairage à moyen terme et sur la base d'un scénario macroéconomique donné, les grandes tendances des finances sociales. De par son caractère tendanciel, cet exercice se différencie de celui que votre Délégation vous avait présenté au printemps dernier 1 ( * ) , lequel reposait sur l'hypothèse d'une maîtrise rigoureuse de l'évolution des dépenses sociales. Votre Délégation souhaite ainsi contribuer en présentant cette étude, à nourrir le débat au Parlement sur la Sécurité sociale.
La deuxième et la troisième parties sont consacrées à la présentation de simulations réalisées à l'aide du modèle multinational MIMOSA 2 ( * ) . La deuxième partie propose une évaluation des conséquences macroéconomiques des dépréciations monétaires survenues en Europe depuis 1992.
Enfin, la troisième partie étudie les conséquences pour la croissance économique de la France et de ses principaux partenaires, du maintien des taux d'épargne à leur niveau actuel, c'est-à-dire d'un prolongement durable du comportement prudent des ménages en matière d'affectation de leur revenu.
I. UNE PROJECTION À MOYEN TERME (1995-2002) DES FINANCES SOCIALES
A. CONCEPTION GÉNÉRALE DE L'ÉTUDE
La projection des finances sociales à l'horizon 2002, dont les principaux résultats et conclusions sont décrits dans ce chapitre, a été réalisée à l'aide du modèle macroéconomique MOSAÏQUE de l'Observatoire français des conjonctures économiques. L'étude menée par le Département d'économétrie de l'OFCE est intégralement présentée en Annexe à ce rapport.
Votre rapporteur rappelle qu'un exercice de ce type n'est pas une prévision, en ce sens qu'il ne cherche pas à décrire ce que seront probablement, dans les prochaines années, l'évolution de l'économie française en général, et celle des finances sociales en particulier.
Il s'agit plutôt :
• d'illustrer par une projection à
l'horizon 2002 - et ainsi, de mieux mettre en lumière - ce que seront,
sur la base d'un scénario macroéconomique donné, les
grandes
tendances d'évolution
des prestations et des
recettes des organismes sociaux ;
• ce faisant, de mettre en évidence
l'
écart structurel
pouvant éventuellement
apparaître entre l'évolution des prestations sociales et celle des
recettes et, en conséquence, d'indiquer le montant des redressements
nécessaires pour parvenir à un équilibre des comptes
sociaux sur
l'ensemble de la période
. Dans cette
optique, l'ambition de l'étude n'est pas de donner un résultat
pour chaque régime, ou chaque type de risque, ou année par
année, mais de dessiner les conditions d'un équilibre
global
des régimes sociaux sur
le moyen
terme
. De même, l'exercice prend-il le parti de ne pas analyser
les moyens d'une résorption des déficits contractés avant
1995 ;
• enfin, de décrire les
incidences macroéconomiques
des modalités de
redressement des comptes sociaux.
B. CARACTÉRISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE
L'évolution des finances sociales dépend très largement des perspectives macroéconomiques générales. Celles-ci déterminent en effet l'évolution des recettes des régimes sociaux et celle des dépenses liées au chômage.
Le scénario macroéconomique de « référence » qui sert à la projection des finances sociales a été élaboré à l'aide du modèle MOSAÏQUE de l'OFCE. Il s'appuie sur les perspectives d'environnement international qui résultent de la projection de l'économie mondiale présentée récemment à la demande de votre délégation 3 ( * ) et réalisée à l'aide du modèle MIMOSA.
Les principales caractéristiques en sont décrites ci-après.
•
L'environnement international
de la projection décrit une reprise conjoncturelle chez nos principaux
partenaires - à l'exception des États-Unis et du Royaume-Uni, en
avance dans la phase du cycle. La croissance de l'ensemble des pays de l'OCDE
serait de 3,1 % en 1995, puis de 2,9 % en 1996. Cette reprise serait
essentiellement tirée par l'investissement productif.
Par la suite, celui-ci s'essouffle et, compte tenu d'une part de la contrainte exercée sur la croissance par la réduction des déficits publics - en particulier en Europe - et, d'autre part, de « l'atterrissage en douceur » de l'économie américaine, la croissance dans les pays de l'OCDE fléchirait nettement pour atteindre 2,5 % par an en moyenne de 1997 à 2002.
•
La politique
budgétaire
française serait également
orientée dans un sens restrictif en raison de l'objectif de
réduction des déficits.
• Le niveau très élevé
atteint par le chômage à la suite de la récession de 1993
pèse, en projection, sur l'évolution du
pouvoir d'achat
du salaire
par tête. Celui-ci progresserait entre 1995 et 2002
de 0,5 % par an en moyenne. Ainsi, malgré
la baisse du taux
d'épargne des ménages
(- 0,4 point par an), la
consommation des ménages
ne croîtrait que de
2,1 %
par an en moyenne.
•
L'investissement productif
,
très dynamique en début de période (+ 7,6 % par
an de 1995 à 1997), ralentirait par la suite (+ 3,9 % par an en
moyenne de 1998 à 2002), une fois ajustées les capacités
de production.
•
La balance des transactions
courantes
reste excédentaire tout au long de la période
(de 1 % du PIB environ en moyenne), ce qui traduit le maintien de la
compétitivité de l'économie française.
• Dans ces conditions,
la croissance
économique
suivrait l'évolution de l'investissement
productif -les économistes évoquent dans ce cas un
« cycle d'investissement »- : dynamique en
début de période, ralenti par la suite compte tenu de l'atonie de
la consommation des ménages et de la demande publique. Le PIB
croîtrait ainsi de 2,3 % par an en moyenne de 1995 à 2002.
Il faut remarquer que le déficit de croissance de la période 1991-1993 par rapport à un sentier de croissance tendancielle ne serait pas résorbé au terme de la période de projection.
Ceci n'est pas sans incidence sur l'analyse des finances sociales : on pourrait en effet en déduire que les déficits sociaux imputables au ralentissement conjoncturel de la période 1991-1993 - ou déficits « conjoncturels » - ne seraient pas spontanément résorbés à moyen terme, dans la mesure où le PIB resterait durablement inférieur à son niveau tendanciel 4 ( * ) .
• La projection retient l'hypothèse d'un
enrichissement du contenu en emplois de la croissance, en raison notamment de
la réduction de la durée du travail (du fait du
développement du temps partiel) et des mesures d'allégement du
coût du travail non qualifié.
En conséquence, la productivité du travail ne progresserait plus en moyenne que de 1,4 % par an, contre 2,2 % sur les vingt dernières années.
L'emploi total augmenterait ainsi de 0,8 % par an en moyenne (soit 185.000 emplois créés chaque année).
Compte tenu des perspectives d'évolution de la population active, le taux de chômage baisserait de 0,8 point à l'horizon 2002.
• L'augmentation des prix à la
consommation, enfin, resterait limitée à 2,2 %
par
an.
Au total, le diagnostic que l'on peut tirer de cette simulation à moyen terme ne diffère guère de ceux que présentait déjà votre Délégation au printemps et à l'automne dernier 5 ( * ) : celui d'une économie française compétitive et non-inflationniste, dynamisée à court terme par l'investissement des entreprises, mais freinée par l'évolution modérée des autres composantes de la demande intérieure.
L'évolution des grandeurs macroéconomiques décrite ci-dessus apparaît par ailleurs peu favorable a l'équilibre spontané des comptes de la Sécurité sociale. Non seulement l'économie croît moins que son rythme tendanciel, mais de surcroît la masse salariale , qui constitue l'assiette des cotisations sociales, progresse en volume moins vite que le PIB (+ 1,6 % par an en moyenne).
C. L'ÉQUILIBRE DE LA BRANCHE MALADIE DU RÉGIME GÉNÉRAL
1. La projection des dépenses de santé
La projection des dépenses de santé repose sur une hypothèse centrale et trois hypothèses techniques .
• L'hypothèse centrale est celle d'une
prolongation de la
tendance
de long terme d'évolution
des dépenses de santé.
Celle-ci se caractérise depuis 1960 par une augmentation constante de la part des dépenses de santé dans le PIB : celle-ci passe de 4,4 % en moyenne entre 1960 et 1970, à 5,9 % entre 1970 et 1980, 7,5 % entre 1980 et 1990 et 8,6 % entre 1990 et 1994.
Toutefois, la croissance des dépenses de santé en volume connaît sur longue période une décélération sensible. Elle passe de 8,8 % par an en moyenne entre 1960 et 1970, à 7,3 % par an entre 1970 et 1980, 5,3 % par an entre 1980 et 1990 et 3,3 % entre 1990 et 1994. La projection repose ainsi sur l'hypothèse d'une poursuite du ralentissement de la croissance tendancielle des dépenses de santé (illustrée par le graphique ci-dessous).
Écart entre la croissance des dépenses de santé et celle du PIB en %
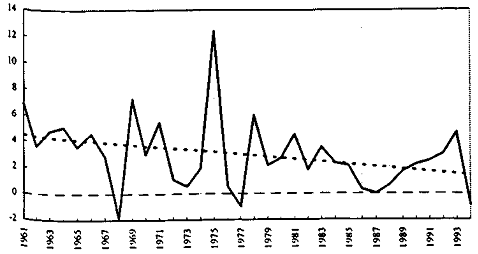
• Si la croissance du total des dépenses
de santé ralentit sur longue période, les
différentes composantes
de ces dépenses
connaissent des
évolutions contrastées
:
alors que les dépenses hospitalières ralentissent fortement, les
autres dépenses connaissent une augmentation rapide.
Toutefois, d'un point de vue macroéconomique, il est apparu plus prudent de projeter le volume total de la consommation médicale que d'agréger l'évolution des dépenses selon les divers secteurs . En effet, celles-ci ne semblent pas indépendantes. Il est probable, par exemple, que l'introduction du budget global à l'hôpital a contribué à transférer une partie des soins vers la médecine ambulatoire.
• La projection tient compte par ailleurs des
incidences sur l'évolution des dépenses de santé du
vieillissement démographique
, le montant des
dépenses de santé par tête progressant en effet fortement
après soixante ans
6
(
*
)
.
• Enfin, les différentes réformes
de la gestion du système de santé ont entraîné des
économies durables sur
le niveau
des dépenses,
mais n'ont pas
modifié
leur
rythme
tendanciel
d'augmentation.
La projection retient ainsi l'hypothèse qu'il en irait de même pour la réforme du système de santé intervenue en 1993.
Sous ces hypothèses, le volume de la consommation médicale progresserait de 3 % par an en moyenne d'ici 2002. Si la participation de la Sécurité sociale au financement des dépenses de santé était stabilisée à son niveau actuel (soit 71,6 % contre 74,3 % en 1980), les dépenses à la charge de la branche maladie du régime général augmenteraient en volume de 2,7 % par an en moyenne de 1994 à 2002.
Par ailleurs, la part des dépenses de santé dans le PIB augmenterait de 0,3 point environ d'ici 2002.
2. L'évolution des recettes
Les ressources de l'assurance-maladie sont constituées de cotisations assises sur les salaires. Or, en projection, les salaires évoluent moins rapidement que le PIB . Les cotisations à l'assurance-maladie progressent ainsi en volume de 1,6 % par an en moyenne de 1994 à 2002, contre 2,3 % pour le PIB en volume.
3. Le rééquilibrage de l'assurance-maladie
L'écart entre la croissance des dépenses de santé à la charge du régime général (2,7 % par an en moyenne) et celle des cotisations (1,6 % par an) se traduirait par un déficit « spontané » de 90 milliards de francs en 2002.
Pour financer ce déficit, les auteurs de l'étude rappellent que « l'on a (...) à rechercher un financement complémentaire dont la base augmente le plus rapidement possible. »
Aussi une augmentation de la Contribution sociale généralisée (CSG) de 1,5 point a-t-elle été simulée (cf. graphique ci-dessous). Une augmentation de 1 point au 1er janvier 1996 permettrait de dégager des excédents en 1996 et 1997 (respectivement 18 et 13 milliards de francs) qui apureraient pratiquement en totalité le déficit de 1995. Une nouvelle augmentation de la CSG de 0,5 point au 1er Janvier 1999 permettrait par la suite d'assurer l'équilibre de l'assurance-maladie.
Équilibre de la branche maladie
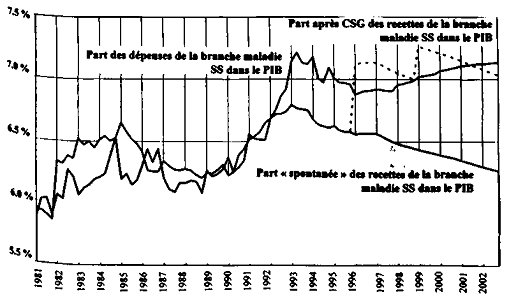
D. LES PERSPECTIVES DES RÉGIMES DE RETRAITE
L'ensemble des prestations-vieillesse croîtrait en moyenne de 1,9 % l'an en moyenne en francs constants d'ici 2002, soit une progression inférieure à celle du PIB (2,2 % par an).
Leur part dans le PIB baisserait ainsi de 9,6 % en 1994 à 9,4 % en 2002.
Cette inflexion par rapport aux tendances antérieures obéit à deux raisons :
- l'arrivée à la retraite des classes creuses de l'immédiat avant-guerre et de la guerre. Ainsi, entre 1994 et 2002, le taux de croissance annuel moyen de la population âgée de plus de 60 ans serait-il de 1,1 % par an (contre 1,5 % en 1985 et 1995) ;
- l'effet des mesures prises dans la loi du 22 juillet 1993 sur la sauvegarde de la protection sociale : allongement de la durée de cotisation, allongement à 25 ans de la période de référence pour le calcul de la retraite et indexation des pensions sur les prix et non sur les salaires.
Les prestations-vieillesse progresseraient néanmoins légèrement plus rapidement que les cotisations . En conséquence, et compte tenu d'une situation de départ déséquilibrée (14,7 milliards de déficit pour l'assurance-vieillesse du régime général selon le dernier rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale), une hausse de 0,04 point par an environ de la cotisation vieillesse des employés à partir de 1996 (soit 0,3 point en 7 ans ) permettrait de parvenir à l'équilibre en 2002. Si l'on voulait apurer ce passif de départ plus rapidement, il est évident qu'une hausse plus forte des cotisations en début de période serait nécessaire.
Par ailleurs, il faut rappeler qu'il s'agit là d'un résultat macroéconomique à moyen terme qui n'implique pas un équilibre régime par régime et année par année.
La situation de certains régimes spéciaux pourrait nécessiter de fortes hausses de cotisations. Mais au total, à un niveau agrégé, l'intérêt de la projection est de montrer que le financement global des régimes de retraite serait assuré sans trop de difficulté à moyen terme.
E. AUTRES DÉPENSES SOCIALES
•
Les prestations familiales
ont connu une forte progression en 1993, principalement en raison de
l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire. Plus
généralement, selon les auteurs de l'étude, les
déficits de la Caisse nationale d'allocations familiales semblent
imputables à la mauvaise conjoncture de la période 1991-1993.
D'ici 2002, leur croissance ralentirait très nettement - + 1 % par an en moyenne en francs constants -, compte tenu de la diminution des effectifs de moins de vingt ans. Dans ces conditions, la branche famille ne devrait pas rencontrer de difficulté de financement.
• Sous l'effet
de la baisse du
chômage et de la réforme en 1992
du régime de
l'indemnisation du chômage, l'UNEDIC connaîtrait
spontanément une évolution financière positive.
• Les dépenses pour le
Revenu
Minimum d'Insertion
ont connu une forte augmentation au cours des
années récentes, en raison de la combinaison de la progression du
chômage et de la réforme de l'indemnisation du chômage.
Cette évolution se ralentirait avec l'arrêt de la
dégradation du marché du travail.
F. CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET ÉQUILIBRE DES COMPTES SOCIAUX
1. Incidences du ralentissement de la croissance sur les comptes sociaux
Quelle serait aujourd'hui la situation des comptes de la Sécurité sociale si l'économie française n'avait pas connu le fort ralentissement conjoncturel du début des années 90, débouchant sur la récession de 1993 ?
L'étude tente de répondre à cette question en simulant rétrospectivement, à l'aide du modèle MOSAÏQUE, ce qui serait advenu si la croissance de 1990 à 1995 avait été supérieure à celle que l'économie française a effectivement connue (+ 1,5 % par an en moyenne).
Dans cette simulation, certaines mesures de soutien à la conjoncture (augmentation de l'allocation de rentrée scolaire ou augmentation du R.M.I.) ou de réduction des dépenses de santé (réformes de 1993) ont par ailleurs été annulées, dans la mesure où l'on peut considérer qu'une croissance plus soutenue les aurait rendues moins nécessaires. Inversement, l'augmentation de la Contribution Sociale Généralisée de 1993 a été maintenue.
Les résultats montrent que, sous ces conditions, une croissance de 2,3 % par an en moyenne sur la période 1990-1995 aurait permis d'assurer l'équilibre financier global des régimes de Sécurité sociale.
Aussi, dans la mesure où ce taux annuel de croissance de 2,3 % est inférieur au taux de croissance sur longue période de l'économie française (soit 2,5 % environ), on pourrait déduire de cet exercice que les déficits actuels de la Sécurité sociale semblent plus de nature conjoncturelle que structurelle.
2. Incidences macroéconomiques du rééquilibrage des comptes sociaux...
a) Par une augmentation des prélèvements sur les ménages...
Il a été indiqué plus haut que les prélèvements sur les ménages nécessaires pour résorber les déficits « spontanés » - résultant sur la période 1995-2002 de l'écart entre la croissance tendancielle des prestations sociales et celle des recettes - équivalaient à 1,5 point de Contribution Sociale Généralisée (1 point au 1 er janvier 1996 et 0,5 point au 1 er janvier 1999) et 0,3 point de cotisation-vieillesse des salariés (soit 0,04 point par an).
Ce prélèvement sur les ménages aurait un effet négatif sur la croissance en raison d'une moindre augmentation de la consommation des ménages : l e niveau du PIB serait en 2002 inférieur de 1 point à celui du scénario sans rééquilibrage des régimes sociaux.
L'emploi total serait ainsi inférieur de 114.000 en 2002.
b) Par une moindre augmentation des dépenses de santé
Un rééquilibrage à moyen terme de la branche maladie du régime général pourrait être obtenu par une limitation de la progression des dépenses de santé. Pour parvenir à ce résultat, il serait nécessaire que la consommation médicale soit stabilisée en volume (ce qui équivaut à une croissance en valeur identique à la hausse des prix) de 19 % à 1999.
Les conséquences macroéconomiques d'un contrôle des dépenses de cette ampleur seraient, selon le modèle MOSAÏQUE, pratiquement équivalentes à celles d'une augmentation en deux étapes de la C.S.G.
G. CONCLUSIONS
Votre rapporteur tirera quatre conclusions de l'exercice dont les principaux résultats viennent d'être présentés.
1°) Un premier élément de réflexion concerne les tendances d'évolution des prestations sociales à l'horizon 2002.
• Hormis pour quelques régimes
spéciaux qui pourraient connaître d'importants
déséquilibres, les problèmes de financement pour
l'ensemble des régimes de retraite semblent plus se poser sur le long
terme que sur le moyen terme, et notamment à partir de 2005 avec l'effet
de l'arrivée à l'âge de la retraite des classes nombreuses
de l'après-guerre
7
(
*
)
.
•
Les dépenses de
santé
ont connu au cours des dernières années une
évolution beaucoup plus rapide que celle du PIB. Ceci n'a rien
d'original : d'autres catégories de dépenses - logement,
loisirs, éducation... - ont connu des évolutions similaires. La
structure de la consommation des ménages se modifie avec le revenu et
peut être stimulée, comme c'est le cas pour la consommation
médicale, par le progrès technique. L'hypothèse que cette
évolution serait essentiellement imputable à son système
de financement, - la Sécurité sociale -, paraît par
ailleurs infirmée par l'exemple des États-Unis où un
financement privé important n'a pas empêché la très
forte progression des dépenses de santé. Celles-ci
représentaient en 1992 14 % du PIB contre 9,4 % en France.
Toutefois, il faut noter que si les dépenses de santé en France ont augmenté plus vite que le PIB, elles n'en ont pas moins connu, depuis les années soixante, une décélération sensible. De telle sorte que si l'on prolongeait tendanciellement cette décélération, même en la corrigeant des effets du vieillissement démographique, la progression des dépenses de santé d'ici 2002 ne serait pas réellement « explosive ». Elle tendrait même à se rapprocher de celle du PIB à l'horizon de la projection.
2°) Sur la période 1995-2002, des redressements seraient nécessaires pour assurer l'équilibre des comptes sociaux, notamment celui de la branche maladie du régime général. En effet, l'évolution des dépenses prises en charge par l'assurance-maladie reste supérieure à celle du PIB, même si elle tend à s'en rapprocher. De plus, l'assiette des cotisations, c'est-à-dire la masse salariale , évolue en projection plus lentement que le PIB - il s'agit là, d'ailleurs, d'un phénomène que l'économie française connaît en moyenne depuis le milieu des années 80 -. De telle sorte que l'on peut se demander si la difficulté structurelle de financement de l'assurance-maladie vient de l'évolution des prestations ou de celle de l' assiette des cotisations. Ainsi l'étude invite-t-elle à réfléchir à un mode de financement de la Sécurité Sociale dont la base progresserait comme la richesse nationale
3°) L'équilibre à moyen terme de l'assurance-maladie pourrait résulter d'une augmentation de la C.S.G., à hauteur de 1,5 point, et en deux étapes, ou d'une réforme du système de santé qui entraîne une stabilisation en volume des dépenses de santé de 1996 à 1999.
Les deux catégories de mesures seraient, selon le modèle utilisé, équivalentes sur le plan macroéconomique. Il faut par ailleurs observer que l'expérience des réformes passées du système de santé montre qu'une stabilisation en volume des dépenses est un objectif particulièrement difficile à atteindre. Si ces réformes ont en effet permis de réaliser des économies sur le niveau des dépenses, elles n'ont cependant pas modifié leur tendance d'évolution sur longue période.
Une autre difficulté du financement à moyen terme de l'assurance-maladie semble donc résider moins dans l'importance du prélèvement supplémentaire nécessaire pour assurer son équilibre, que du caractère « obligatoire » de ce prélèvement. Les taux de cotisations sont trop souvent considérés comme immuables : ceci empêche ainsi toute programmation de leur hausse, justifiée par ailleurs par une tendance lourde, telle que la progression des dépenses de santé, et par leur neutralité macroéconomique dans la mesure où il s'agit d'un prélèvement sur les ménages pour financer une prestation en faveur des ménages.
4°) Ces considérations ne s'opposent pas aux réflexions et aux propositions pour assurer une plus grande efficacité du système de soins. Celle-ci permettrait en effet d'assurer un « bien-être » équivalent pour une dépense moindre, ce qui est précisément une finalité de l'activité économique. L'étude montre ainsi que si la question des gains d'efficience est fondamentale, elle n'est toutefois pas d'ordre macroéconomique. En effet, une simulation, réalisée à l'aide du modèle, des effets d'une réduction structurelle des dépenses de santé, permettant une baisse équivalente des cotisations, montre qu'elle aurait des effets défavorables sur l'activité et l'emploi. Les dépenses de santé, même inutiles, sont génératrices d'emploi : or, le secteur de la santé est riche en emplois et abrité de la concurrence étrangère.
Ainsi, les conclusions que votre rapporteur vient de tirer de cette étude permettent-elles au moins de relativiser la problématique de la Sécurité sociale en la formulant en ces termes : la Sécurité sociale est-elle réellement une « charge » pour l'économie et le prix à payer pour son financement à moyen terme est-il « insupportable » eu égard à sa finalité sociale ?
II. L'IMPACT DES FLUCTUATIONS MONÉTAIRES EN EUROPE
A. LES FLUCTUATIONS MONÉTAIRES EN EUROPE : DESCRIPTION
L'Union européenne a connu à partir de l'été 1992 des fluctuations monétaires importantes, Entre 1992 et 1995, plusieurs monnaies - lire, livres anglaise et irlandaise, peseta, escudo, drachme, markka finlandais, couronnes suédoise et norvégienne - se sont fortement dépréciées par rapport au mark. Cette dépréciation a été particulièrement forte pour la lire (51 %), la drachme (59 %), la peseta (42 %) ou la couronne suédoise (39 %). Ces évolutions sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.
Dépréciation par rapport au mark (1992-1995)
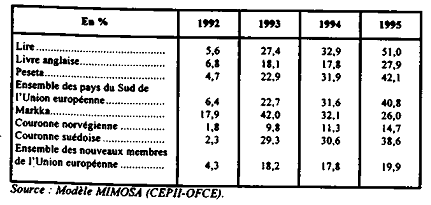

L'origine de ces dévaluations réside dans la situation économique propre de chacun de ces pays : dégradation de la compétitivité, déséquilibre de la balance courante, difficulté à poursuivre des politiques de convergence - notamment budgétaire --dans un contexte de chômage élevé.
La réunification allemande a toutefois constitué un élément décisif de ces évolutions. La nécessité pour l'Allemagne de soutenir la convergence tant économique que sociale des nouveaux Läinder, s'est traduite par une politique budgétaire expansionniste. Ainsi la politique monétaire allemande a-t-elle dû supporter exclusivement le poids du réglage de la conjoncture, et en particulier celui de la lutte contre l'inflation. L'excès de demande par rapport aux capacités de production de l'économie allemande (en raison de la hausse de l'investissement privé et des dépenses d'infrastructures à l'Est) a ainsi entraîné le resserrement de la politique monétaire menée par la Bundesbank et une hausse des taux d'intérêt allemands à court terme.
En changes flexibles, ceci aurait entraîné une réévaluation du mark, de telle sorte que le surcroît de demande aurait pu être satisfait par les producteurs étrangers en raison de l'amélioration de leur compétitivité.
Par le biais du SME, « système de changes fixes mais ajustables », la politique monétaire restrictive allemande a été « exportée » vers les autres pays d'Europe, alors que leur situation conjoncturelle n'était précisément pas celle de l'Allemagne, dont l'activité était dynamisée par la réunification. Dès lors, un certain nombre de pays ne pouvaient supporter les coûts que cette situation entraînait pour leur économie et ont soit laissé fluctuer leur monnaie - comme l'Italie et le Royaume-Uni -, soit procédé à des réalignements répétés - comme l'Espagne -.
Les conséquences théoriques d'une dévaluation peuvent, en première analyse, être décrites comme suit :
- pour les pays dont la monnaie s'est dépréciée, le surcroît de compétitivité qui en résulte entraîne une augmentation de l'activité et de la production ; pour les pays dont la monnaie s'est dépréciée, les conséquences sont inverses ;
- une dépréciation de la monnaie se traduit par un renchérissement des importations, donc un « choc inflationniste ». Mais l'ampleur de celui-ci dépend non seulement de l'importance de cette dépréciation - il faut avoir à l'esprit qu'une dépréciation de la lire par rapport au mark de 50 % se traduit, toutes choses égales par ailleurs, par un doublement du prix des importations en provenance d'Allemagne -, mais aussi du comportement des agents intérieurs et en particulier des modalités d'indexation des salaires à la hausse des prix. L'effet positif pour la compétitivité de la dévaluation sera plus ou moins fort, et plus ou moins durable, selon la rapidité et l'importance de l'indexation des salaires sur les prix ;
- une dévaluation a, à court terme, un effet négatif sur la balance courante : celle-ci est transitoirement dégradée en raison du renchérissement des importations. Par la suite, les gains de compétitivité permettent un redressement du solde courant. Cette séquence est généralement résumée par l'expression de « courbe en J » qui décrit l'évolution du solde extérieur d'un pays dont la monnaie s'est dévaluée ;
- enfin, le surcroît de production engendré par la dévaluation devrait normalement se traduire par une augmentation de l'emploi et une baisse du chômage.
L'analyse des expériences de dévaluations en Europe 8 ( * ) met toutefois en évidence des évolutions assez différentes de ces schémas théoriques et sensiblement divergentes entre elles , en particulier pour ce qui concerne les économies les plus importantes : Royaume-Uni, Italie et Espagne.
• La première surprise suscitée
par cette analyse concerne l'inflation. Celle-ci a ainsi baissé en 1993
et 1994 dans la plupart des pays qui ont connu une dévaluation, et
notamment au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne. Ce n'est qu'en 1995 que des
tensions sur les prix ont commencé à se manifester, mais
celles-ci demeurent limitées, surtout eu égard aux effets
généralement pronostiqués. Ainsi, la
dépréciation nominale du taux de change s'est-elle
accompagnée durablement d'une dépréciation réelle,
alors que les expériences des années 70 et 80 tendaient à
montrer, au contraire, qu'en raison des conséquences inflationnistes
d'une dévaluation, la dépréciation réelle du change
n'était pas durable.
• Les
déficits
extérieurs
des pays qui ont dévalué se sont
réduits. L'Italie connaît même un excédent
extérieur et on n'y retrouve pas la « courbe en J »
qui décrit l'évolution du solde extérieur
caractéristique d'une dévaluation : le redressement du solde
extérieur y est en effet immédiat.
• Le rétablissement du solde
extérieur dans les pays dont la monnaie s'est
dépréciée, a permis de soutenir la demande et
l'activité.
• Paradoxalement, malgré cet impact
positif sur la demande et l'activité, ces pays ont connu des
évolutions de l'emploi plus défavorables que les pays à
monnaie forte (Allemagne et France).
• Mais l'analyse des expériences de
dévaluations met également en évidence des divergences
très nettes.
En Italie et en Espagne, les taux d'intérêt ont augmenté, ce qui a ralenti l'investissement. Cette augmentation s'est traduite en Italie par une politique budgétaire restrictive, afin de compenser l'effet négatif sur la dette publique de la hausse des taux d'intérêt. Enfin, la consommation des ménages s'est fortement contractée en Italie. Au Royaume-Uni au contraire, les taux d'intérêt ont baissé, ce qui, combiné à une politique budgétaire expansionniste, a stimulé l'investissement.
De même, les évolutions de taux de change ont-elles été très différentes, autant dans leur ampleur que dans leur dynamique. Les entreprises britanniques ont profité de la dévaluation pour augmenter leurs marges à l'exportation, ce qui a eu des effets positifs sur leurs investissements. Au contraire, les entreprises italiennes et espagnoles ont profité des dévaluations pour gagner des parts de marché à l'exportation et limiter ainsi les effets négatifs de la contraction de la demande intérieure. Ceci peut expliquer le caractère plus « incontrôlé » de la baisse du taux de change en Italie et en Espagne, alors qu'au Royaume-Uni, celui-ci s'est au contraire stabilisé après la sortie du Système Monétaire Européen.
B. UNE ÉVALUATION À L'AIDE DU MODÈLE MIMOSA DES INCIDENCES DES CHANGEMENTS DE PARITÉ EN EUROPE.
Il s'agit ici d'évaluer rétrospectivement, sur la période 1992-1995, à l'aide du modèle multinational MIMOSA, l'incidence sur la période 1992-1995 des changements de parités en Europe.
L'intérêt d'un exercice de cette nature est aussi évident que sa complexité.
L'intérêt de cette variante est tout d'abord d'évaluer, d'un point de vue quantitatif, ce qui, dans les évolutions décrites ci-dessus, peut être imputable aux modifications des taux de change. Cet exercice illustre également, à l'aide d'un instrument dont la caractéristique est de décrire des évolutions cohérentes entre elles, le lien entre les évolutions constatées et les explications généralement suggérées. Il permet ainsi de décrire comment le contexte macroéconomique qui a entouré ces dévaluations peut expliquer les « surprises » des dévaluations de 1992-1994 et, en particulier, le fait que l'inflation a été plus faible que prévu.
La complexité de l'exercice réside dans la nécessité de construire un scénario « fictif »- afin de le comparer au scénario « réel » - dans lequel les parités seraient restées fixes en Europe entre 1992 et 1995. Or, ceci suppose d'apporter des réponses à de nombreuses questions : quelle aurait été l'évolution des taux d'intérêt, en l'absence de dévaluation ? Quelle aurait été la politique budgétaire des pays qui ont dévalué en l'absence de dévaluation ? Quel aurait été le comportement salarial dans ces pays ? Comment aurait évolué la politique monétaire allemande ?
Les réponses à ces questions déterminent les principales hypothèses de l'exercice présentées ci-dessous.
1. Principales hypothèses de la simulation
• Une première question concerne
l'évolution des t
aux d'intérêt
dans les
pays qui ont connu une dévaluation.
Ainsi le Royaume-Uni et la Finlande ont-ils connu à la suite de la dévaluation de leur monnaie une forte baisse de la prime de risque sur les taux à court terme par rapport à l'Allemagne (- 4 points pour le Royaume-Uni en 1993 et -4 points pour la Finlande en 1994). En Italie, au contraire, la prime de risque augmente sensiblement dès 1992 (+ 2 points), de manière moindre par la suite.
L'exercice retient l'hypothèse qu'en l'absence de dévaluation, les primes de risque vis-à-vis du mark seraient restées dans ces pays à leur niveau de 1991.
• Une deuxième hypothèse a trait
à l'orientation de la
politique monétaire
allemande
. Les dévaluations se sont traduites par moins
d'inflation et de croissance en Allemagne, en raison de la diminution du prix
des importations en provenance des pays qui ont dévalué. On peut
donc imaginer que les dévaluations ont entraîné un
assouplissement de la politique monétaire allemande. L'hypothèse
retenue ici est que dans un scénario « sans
dévaluations », les taux d'intérêt allemands
auraient été plus élevés. Pour simuler cette hausse
des taux d'intérêt, la variante applique les règles
habituelles des simulations réalisées à l'aide du
modèle MIMOSA : le taux court augmente de 1,5 point si l'inflation
est plus élevée de 1 point, et de 0,5 point si le niveau du PIB
est supérieur de 1 %.
Sous ces conditions, on estime qu'en l'absence de dévaluation, les taux courts allemands auraient été supérieurs de 0,7 point en moyenne de 1992 à 1995, et les taux longs de 1 point .
• Les
politiques
budgétaires
qui ont accompagné la dévaluation ont
nettement divergé en Italie et au Royaume-Uni.
L'Italie a pris, après la dévaluation, des mesures restrictives (Plan Amato). Le Royaume-Uni a, au contraire, à la suite du flottement de la livre, soutenu la reprise par une politique budgétaire expansionniste.
Les hypothèses retenues dans la variante en matière d'orientation des politiques budgétaires en l'absence de dévaluation sont les suivantes : le déficit budgétaire en Italie aurait été supérieur de 0,9 point de PIB chaque année, de 1992 à 1995 ; au contraire, au Royaume-Uni, le déficit budgétaire aurait été inférieur de 1 point de PIB en 1993 et de 0,5 point de PIB en 1994.
• L'évolution des
salaires
en Italie et au Royaume-Uni a été
beaucoup
moins vive
que ce que décrivent
spontanément les équations du modèle MIMOSA.
L'hypothèse retenue ici,
est que ce comportement salarial,
inexplicable par le modèle, est imputable à la
dévaluation
, et qu'en conséquence, en l'absence de
dévaluation, l'évolution des salaires aurait été
aussi rapide que ce que décrit le modèle.
• L'emploi a évolué en Italie et
en Europe du Sud de manière moins favorable que ce que décrit le
modèle. Il en va de même pour l'investissement au Royaume-Uni et
surtout en Italie (où il a chuté de 19 % en 1993).
La variante retient l'hypothèse que ces comportements anormaux en matière d'emploi et d'investissement peuvent s'expliquer par l'attentisme et l'instabilité consécutifs aux dévaluations.
2. Principaux résultats de la simulation
Les résultats de la simulation sont ainsi obtenus en comparant le scénario sans changements de parités réalisé à l'aide du modèle aux évolutions constatées. Les principaux résultats de cet exercice sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Évaluation des conséquences
macroéconomiques
des dépréciations monétaires
en Europe (1992-1995)
Principaux résultais
(Écarts en niveau
par rapport à un scénario sans dévaluation en
Europe)
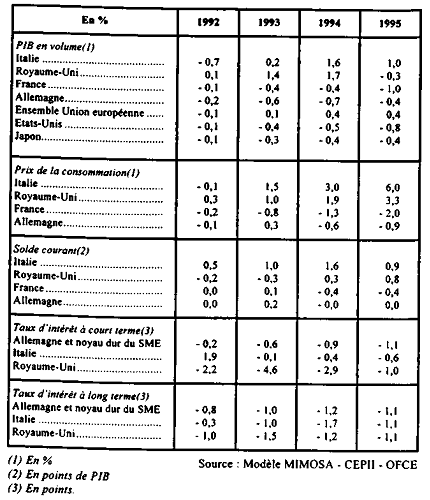

• Les dépréciations
monétaires auraient eu globalement un effet expansionniste sur
l'économie européenne (l'analyse de la Commission
européenne sur ce sujet, résumée dans l'encadré
ci-dessous, donne cependant des résultats opposés).
|
L'impact des fluctuations monétaires sur le marché intérieur (Résumé de la Communication de la Commission au Conseil Européen) La communication de la Commission au Conseil Européen sur l'impact des fluctuations monétaires en Europe depuis 1992 met en évidence plusieurs phénomènes : - un ralentissement de la croissance , de l'ordre d e 0,25 à 0,5 % du PIB , imputable à l'incertitude et à l'attentisme que les turbulences monétaires ont suscités chez les agents économiques ; - un effet variable sur la compétitivité-coût : parmi les pays dont la monnaie s'est dépréciée, certains ont connu une amélioration de leur compétitivité-coût (c'est le cas de l'Italie - l'amélioration est de l'ordre de 24 % par rapport à la moyenne européenne entre 1987 et 1995 -, de l'Irlande, de la Suède), d'autres une dégradation (l'Espagne), d'autres une stabilité (le Royaume-Uni). Parmi les pays dont la monnaie s'est appréciée, l'Allemagne connaît une dégradation sensible de sa compétitivité-coût - - 20 % par rapport à la moyenne européenne entre 1987 et 1995 - et la France une relativité stabilité ; - un effet secondaire sur les soldes commerciaux : la Commission considère que l'évolution des soldes commerciaux semble moins influencée par les fluctuations monétaires que par des facteurs structurels ou par la différence du rythme de croissance entre les pays membres ; - un effet important sur les comportements de marge : si les dévaluations ont eu des effets macroéconomiques limités, ceci est imputable selon la Commission aux comportements de marge des exportateurs : dans les pays dont la monnaie s'est dépréciée, ceux-ci ont mis à profit la dévaluation pour augmenter leurs marges bénéficiaires et donc, leur prix en monnaie nationale ; un phénomène inverse s'est produit dans les pays dont la monnaie s'est appréciée (contraction des marges) ; - un impact plus sensible aux niveaux sectoriel et régional : certains secteurs semblent néanmoins touchés par l'impact des fluctuations monétaires : dans l'automobile ou l'habillement, les pays à monnaie stable connaissent une érosion des marges et une diminution des exportations en volume. Certaines régions frontalières connaissent également des difficultés. Sur la base de ce constat, la commission invite les États-membres à s'attaquer aux causes des fluctuations monétaires plutôt qu'à leurs effets. Elle considère ainsi que les perturbations monétaires ont globalement un impact négatif sur l'économie européenne en raison de l'incertitude qu'elles génèrent sur les opérateurs économiques, laquelle freine les investissements et ralentit la croissance. Ainsi la réponse à ces difficultés se trouve-t-elle dans un renforcement de la convergence des économies européennes, préalable à la mise en oeuvre de la monnaie unique , « complément indispensable » du Marché unique. Dans ces conditions, vouloir corriger les effets des fluctuations monétaires pour les secteurs et les régions les plus touchés « risquerait d'aggraver les problèmes ». La Commission recommande donc de ne pas modifier les règles et les mécanismes communautaires en vigueur en matière d'interventions régionales. |
Les pays qui ont dévalué ont ainsi bénéficié d'un surcroît de compétitivité, donc d'un regain d'activité.
L'effet est sensible en Italie où la dépréciation de la lire a été considérable : le niveau du PIB en 1995 est supérieur de 3,2 % à ce qu'il aurait été en l'absence de dévaluation. L'effet de relance dû à l'amélioration de la compétitivité est toutefois modéré par la rigueur budgétaire et la diminution de l'investissement des entreprises.
L'effet de relance est plus faible au Royaume-Uni (il équivaut à 1 point de PIB en 1995). La dépréciation de la livre et, par conséquent, l'effet compétitivité y sont moindres, mais la politique budgétaire contribue à stimuler l'activité.
Les pays dont le taux de change s'apprécie (France et Allemagne en particulier) perdent certes en compétitivité, mais profitent de la baisse des taux d'intérêt allemands suscitée par les dépréciations monétaires. La perte d'activité pour la France est ainsi limitée à l'équivalent de 0,3 % du PIB en 1995.
L'ensemble de l'Union européenne bénéficie à la fois de la dépréciation moyenne de ses monnaies par rapport au dollar ou au yen, et de l'impact de la baisse moyenne des taux d'intérêt, en raison du rôle directeur joué par les taux allemands. Au total, le niveau du PIB en Europe est supérieur de 0,4 % en 1995 alors que pour les États-Unis, les pertes de compétitivité entraîneraient une contraction du PIB de l'ordre de 0,8 % en 1995
• L'inflation augmente dans les pays qui
dévaluent en raison de la hausse du prix des importations et du
surcroît d'activité. L'inflation est en moyenne annuelle accrue du
fait de la dévaluation de 1,5 point en Italie de 1992 à 1995, et
de 0,8 point au Royaume-Uni. L'augmentation des prix est cependant
limitée par la modération des comportements salariaux et, en
Italie, par la forte augmentation de la productivité.
Selon le modèle, l'accélération de l'inflation imputable à la dévaluation serait néanmoins sensible en 1995 : + 3 points en Italie, + 1,4 point au Royaume-Uni. Ces résultats semblent toutefois très exagérés si on les compare aux évolutions actuellement observées : entre 1994 et 1995, l'inflation devrait passer de 3,9 % à 5,5 % en Italie, et de 1,7 % à 2,6 % au Royaume-Uni.
Ainsi, malgré la prise en compte d'hypothèses de forte modération salariale et d'attentisme des entreprises en matière d'emploi, le modèle ne parvient-il pas à expliquer totalement pourquoi l'inflation est demeurée aussi faible en Italie et au Royaume-Uni.
• L'impact de la dévaluation sur le
solde des transactions
courantes est particulièrement
sensible en Italie 1 point de PIB d'amélioration en moyenne de 1992
à 1995. En outre, le redressement se produit rapidement : ainsi la
dégradation de début de période caractéristique de
la « courbe en J » ne se produit-elle pas en raison de la
très forte contraction de la demande intérieure, due à la
rigueur budgétaire et à la chute de l'emploi et de
l'investissement.
Au Royaume-Uni, le solde courant se dégrade en début de période, conformément à la « courbe en J ». Cet effet est cependant aggravé par la politique budgétaire expansionniste qui soutient l'achat de produits importés. Le redressement du solde courant intervient par la suite : celui-ci s'est amélioré de 0,8 point de PIB en 1995 grâce à la dévaluation.
Au total, deux enseignements peuvent être tirés de cet exercice de simulation :
- la modération de l'inflation dans les pays qui ont dévalué reste assez largement inexpliquée par le modèle, donc par les comportements habituels des agents économiques. Cette modification des comportements, pour l'instant encore assez « mystérieuse », explique qu'à l'inverse des expériences de dévaluation des années 70 et 80, la dépréciation nominale du taux de change s'est accompagnée jusqu'à présent d'une dépréciation réelle ;
- une appréciation du mark - correspondant aux dépréciations d'autres monnaies européennes - permet une détente de la politique monétaire allemande qui, en elle-même, a des effets positifs sur l'activité pour l'ensemble de l'Europe.
III. L'ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES MÉNAGES COMMENT ÉVALUER L'INCERTITUDE ?
A. L'INCERTITUDE SUR L'ARBITRAGE DES MÉNAGES ENTRE CONSOMMATION ET ÉPARGNE
Les prévisions de croissance de l'activité dépendent de manière cruciale de l'évolution de la consommation des ménages, qui représente environ 70 % du PIB. Ceci est encore plus évident pour la projection de l'économie mondiale à l'horizon 2002 réalisée à l'aide du modèle MIMOSA et présentée récemment 9 ( * ) . Celle-ci en effet décrit une reprise tirée en début de période par le redémarrage de l'investissement des entreprises. Mais au-delà de ce « cycle de l'investissement », et une fois que les entreprises auront reconstitué leurs capacités de production, la consommation pourra-t-elle constituer un moteur pour la croissance ?
La réponse dépend d'abord de l'évolution du revenu des ménages. Or, celui-ci est bridé dans la projection MIMOSA -comme dans la plupart des prévisions, tant à court terme qu'à moyen terme, actuellement disponibles- par la progression modeste de sa composante essentielle, les salaires. Dans la projection MIMOSA, le taux de croissance des salaires réels de 1994 à 2002 est ainsi limité à 0,8 % par an en France.
La projection repose toutefois sur l'hypothèse d'une forte baisse du taux d'épargne des ménages : de 11,7 % du revenu disponible en 1995 à 9 % en 2002 pour la France. Ainsi, la progression de la consommation des ménages serait-elle plus rapide (2 % par an en moyenne de 1994 à 2002) que celle de leur revenu disponible (1,5 % par an en moyenne).
L'hypothèse d'une baisse du taux d'épargne des ménages a, de plus, été retenue pour la plupart des pays industrialisés, en particulier pour le Japon - de 19,1 % en 1995 à 15,3 % en 2002, et pour le Royaume-Uni - de 9,6 % en 1995 à 7,6 % en 2002-.
C'est précisément parce qu'une hypothèse de cette nature soutient fortement l'activité dans la prévision qu'il convient d'en souligner l'incertitude .
Le taux d'épargne des ménages a connu en effet depuis le début des années 90 des évolutions atypiques et mal expliquées .
Le taux d'épargne a fortement progressé dans nombre de pays industrialisés - France, Royaume-Uni et Japon notamment - pendant la phase de ralentissement de 1990-1993 - ; il a augmenté de 2,3 points en France, contribuant à une évolution ralentie de la consommation (+ 1,3 % par an en moyenne) et de la croissance (+ 0,6 % par an en moyenne). Selon certaines estimations 1 ( * )0 , si le taux d'épargne était resté stable sur cette période, la progression du PIB aurait été le double de celle constatée.
Or l'arbitrage des ménages entre consommation et épargne s'est modifié de manière atypique dans cette période de ralentissement du revenu et de l'inflation : le taux d'épargne suit en effet généralement une évolution inverse de celle de l'activité et du revenu. En période de ralentissement, les ménages tendent à réduire leur épargne pour maintenir leur consommation. Inversement, en phase de reprise, l'accélération des revenus ne se répercute que lentement sur leur consommation, ce qui se traduit par une augmentation du taux d'épargne. L'évolution du taux d'épargne contribue ainsi à amortir les fluctuations de la conjoncture et joue un rôle « contra-cyclique ».
La rupture de comportement des ménages depuis 1990, par rapport aux années 70 et 80, n'est pas expliquée par les déterminants habituels du taux d'épargne que sont l'évolution du pouvoir d'achat du revenu et l'inflation. L'écart entre le niveau de la consommation observée et le niveau de la consommation simulée selon ces déterminants, est ainsi évalué à environ 5 % en 1994 par la Direction de la Prévision 1 ( * )1 .
Les économistes avancent ainsi plusieurs raisons à l'augmentation a priori surprenante du taux d'épargne des ménages depuis 1990 :
- les variations du taux de chômage pourraient être à l'origine du comportement d'épargne de précaution ;
- la forte augmentation de la part des revenus financiers dans le revenu des ménages depuis le milieu des années 80 expliquerait également l'augmentation du taux d'épargne ; la propension à consommer ce type de revenus serait en effet inférieure à celle des revenus non financiers 1 ( * )2 ;
- la déréglementation financière survenue au milieu des années 80 aurait accru la concurrence dans la distribution du crédit, entraînant ainsi une augmentation des crédits de trésorerie aux ménages. Ceci expliquerait dans un premier temps la baisse du taux d'épargne au cours des années 80. Par la suite, au contraire, cette évolution, conjuguée au développement des instruments de placement financier, aurait rendu les ménages plus sensibles au taux d'intérêt. Ainsi la hausse des taux d'intérêt en 1992-1993 aurait accru, d'une part la contrainte de désendettement des ménages et, d'autre part, l'attrait pour les placements financiers, les deux phénomènes concourant à une hausse du taux d'épargne.
La prise en compte de ces variables ne parvient toutefois à expliquer qu'en partie la modification du comportement des ménages et le niveau élevé du taux d'épargne. Le modèle MIMOSA intègre, dans l'équation qui détermine l'évolution de la consommation, des variables telles que la variation du chômage ou le niveau des taux d'intérêt. Pourtant, la consommation observée reste inférieure de 2,7 % en 1995 à la consommation qui résulterait du fonctionnement spontané du modèle. L'écart est de 4,3 % pour le Japon et de 4,8 % pour le Royaume-Uni.
La dernière projection à l'horizon 2002 réalisée à l'aide du modèle MIMOSA retient l'hypothèse que cet écart - ce « manque à consommer » - serait résorbé à moyen terme, de telle sorte que la consommation progresserait plus vite que ce qui résulterait du fonctionnement spontané du modèle.
Ceci suppose une baisse du taux d'épargne, qui reviendrait à un niveau « normal ».
L'incertitude qui entoure cette hypothèse est toutefois évidente : un retour du taux d'épargne vers son niveau normal paraît d'autant plus difficile à justifier que son niveau actuel n'est pas totalement expliqué.
C'est pourquoi il paraît nécessaire de présenter une variante dans laquelle les taux d'épargne seraient durablement plus élevés que dans la projection MIMOSA de référence.
Cette variante permet en quelque sorte d'évaluer l'incertitude sur l'évolution future de la consommation et de l'épargne des ménages.
B. UNE VARIANTE SUR LE TAUX D'ÉPARGNE DES MÉNAGES
1. Les hypothèses de la variante
• L'hypothèse d'une stabilité des
taux d'épargne revient, d'un point de vue technique, à
considérer que le « manque à consommer »
observé en 1995 par rapport aux simulations du modèle n'est pas
résorbé en cours de projection. Autrement dit, l'évolution
de la consommation de 1995 à 2002 résulte seulement, dans cette
variante, de celle de ses variables explicatives (revenu, inflation, taux
d'intérêt, variation du chômage).
L'hypothèse d'une stabilité des taux d'épargne se traduit donc, par rapport à la projection MIMOSA de référence, par une diminution ex ante 1 ( * )3 de la consommation (cf. tableau ci-dessous).
Hypothèse d'une stabilité des taux
d'épargne :
incidences
ex ante
sur la consommation des
ménages
Écarts en points du taux de croissance
annuel moyen 1996-2002
de la projection MIMOSA de
référence

• La variante repose par ailleurs sur deux
hypothèses de politique économique. En effet, une consommation
des ménages moindre aurait un impact récessif et
entraînerait une inflexion de la politique économique.
La politique monétaire de l'Allemagne serait infléchie en fonction de la règle propre aux simulations réalisées à l'aide du modèle MIMOSA : le taux d'intérêt à court terme baisse de 1,5 point quand le taux d'inflation baisse de 1 point, et de 0,5 point quand le niveau du PIB est réduit de 1 %. Les taux d'intérêt dans l'ensemble de l'Europe sont par ailleurs supposés suivre l'évolution des taux allemands.
La politique budgétaire serait également infléchie, en fonction de l'évolution des déficits publics : l'hypothèse retenue est celle d'une augmentation de 0,5 point du PIB des impôts directs sur les ménages lorsque le déficit public de l'année précédente a augmenté de 1 point de PIB.
2. Principaux résultats de la variante
Une stabilité à moyen terme des taux d'épargne aurait des effets nettement récessifs. Toutefois, le ralentissement de la croissance s'accompagne en variante d'une désinflation et donc d'une baisse des taux d'intérêt, de 1 point environ pour les taux à court terme dans les pays européens. Cette baisse des taux compense en partie les effets récessifs d'une moindre consommation des ménages.
L'impact de la variante sur la croissance du PIB par rapport à la projection MIMOSA de référence est présenté dans le tableau ci-dessous.
Impact sur la croissance du PIB d'une stabilité des taux d'épargne
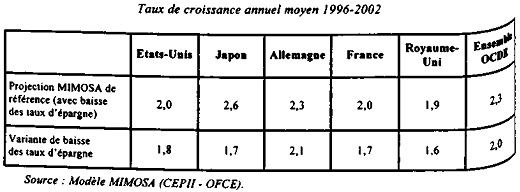
C'est au Japon, en France et au Royaume-Uni qu'une stabilité des taux d'épargne aurait les effets les plus récessifs par rapport à un scénario où les taux d'épargne retrouveraient un niveau conforme aux comportements traditionnels des ménages.
La variante permet d'évaluer l'ampleur de l'incertitude sur la consommation future des ménages à 0,3 point de croissance par an pour la France comme pour l'ensemble de l'OCDE.
Une diminution de cette ampleur de la croissance aurait des effets sensibles sur le taux de chômage : celui-ci serait en 2002 supérieur de 1,9 point au Japon, 1,3 point au Royaume-Uni et 1,1 point en France et aux États-Unis.
Pour la France, cela signifierait que le taux de chômage ne baisserait pratiquement pas d'ici 2002.
ANNEXE - Perspectives à moyen terme des finances sociales de la France* ( * )
Cinquante ans après sa fondation la survie de la Sécurité sociale suscite de nombreuses interrogations. Alors que son histoire a été marquée par des crises récurrentes de financement qui se sont toujours conclues par une hausse des prélèvements et une réduction des prestations (notamment des remboursements de la branche maladie), le déficit qui s'est creusé à partir de 1993 semble, plus que jamais, difficile à combler. Les choix nécessaires paraissent aussi de plus en plus douloureux. Faut-il maintenir le principe fondateur d'égalité des cotisants face au risques couverts ou faut-il y renoncer pour soumettre à des conditions de ressources une part plus grande des prestations ? Cette évolution conduirait en conséquence à privatiser une partie de la Sécurité sociale en contraignant une fraction de la population à recourir, plus qu'aujourd'hui, à des régimes complémentaires d'assurances. Cène évolution semble inéluctable à ceux qui pensent qu'il n'est plus possible d'augmenter les prélèvements et que la dérive des dépenses excède trop le rythme de croissance pour que cène hausse soit supportable par l'économie. Une telle évolution, en fait déjà à l'oeuvre depuis plusieurs années du fait de la réduction des prestations (taux de remboursement maladie, retraite de base des salariés), changerait profondément la nature du système de protection sociale qui d'universel, deviendrait dès lors un simple filet de protection pour les plus démunis. Le risque serait que, dans un tel système, la protection des plus faibles devienne de plus en plus minimale alors que les plus favorisés auraient de moins en moins de raisons de cotiser aux régimes publics. Le dualisme social s'en trouverait renforcé avec les risques que cela peut comporter pour la cohésion nationale.
Mais, la majorité des français est toujours attachée au principe de l'universalité de la protection sociale. Dans l'avenir, il est donc vraisemblable que les décisions de réformes dépendront principalement des difficultés financières des régimes de Sécurité sociale qui furent toujours à l'origine des remises en causes du système. La présente étude a pour objectif d'éclairer le débat en retraçant les perspectives macro-économiques à moyen terme des comptes de la sécurité sociale.
1. Les perspectives macro-économiques générales.
L'avenir des finances sociales dépend très largement des perspectives macro-économiques générales qui déterminent l'essentiel de l'évolution des recettes des systèmes de protection sociale et la partie de leurs charges liée au chômage. Le compte de référence que nous avons utilisé pour évaluer les perspectives financières de la protection sociale dérive de la prévision à moyen terme que nous avions présentée en janvier dernier 1 ( * ) . Il s'appuie en outre sur les prévisions internationales à moyen terme réalisées avec le modèle MIMOSA en septembre dernier 2 ( * ) . L'analyse qui sous tend cette prévision, comme celle de Mimosa, met l'accent sur le risque de « quasi déflation » engendré par le maintien de taux d'intérêt trop élevés et la tendance à la baisse durable de la part des salaires dans la valeur ajoutée.
Les conditions favorables de la seconde moitié des années quatre-vingt qui avaient permis une croissance de 3,5 % en moyenne (avec des pointes de 4,5 et 4,8 en 1988 et 1989) ne se reproduiraient donc pas. Très schématiquement, on peut dire que la croissance de l'économie française fut jusqu'au milieu des années quatre-vingt, limitée par la contrainte extérieure. Pour s'en affranchir la France a adopté une stratégie de désinflation compétitive qui freinait la demande interne. Ce freinage était cependant lui-même limité par la désinflation qui permettait une forte baisse du taux d'épargne des ménages. Au milieu des années quatre-vingt, le contre choc pétrolier qui stimula la croissance mondiale plaça l'économie française dans une situation particulièrement favorable : les efforts passés de baisse des coûts (les salaires réels évoluaient déjà moins vite que la productivité du travail) avaient amélioré la compétitivité, alors que la demande interne restait encore relativement dynamique, celle des administrations car le déficit public était modéré et celle des ménages car les hausses de salaires réels, sans être élevées, restaient significatives, et que la poursuite de la désinflation permettait encore des baisses de taux d'épargne. La récession liée à la montée des taux d'intérêt, au ralentissement de l'économie européenne, et au comportement procyclique des ménages qui élevèrent leur taux d'épargne, a entraîné une forte hausse du chômage (de l'ordre de 750 000 personnes) qui fut la cause d'un nouveau ralentissement des hausses de salaires. Ce ralentissement devrait être durable car le taux de chômage ne pourrait, au mieux, que reculer lentement. Ainsi, après la récession, le potentiel de croissance de la demande des ménages est encore en retrait, malgré les marges de baisse du taux d'épargne, alors que celui des administrations publiques est annulé par le fort déficit accumulé. Au delà du cycle d'investissement, les perspectives de croissance apparaissent dès lors très limitées.
Le tableau 1 permet de comparer les perspectives pour les années 1994-2002 aux évolutions observées au cours des cycles précédents.
Tableau 1 : Comparaison des équilibres macro-économiques au cours du cycle précédent avec les perspectives 1994-2002
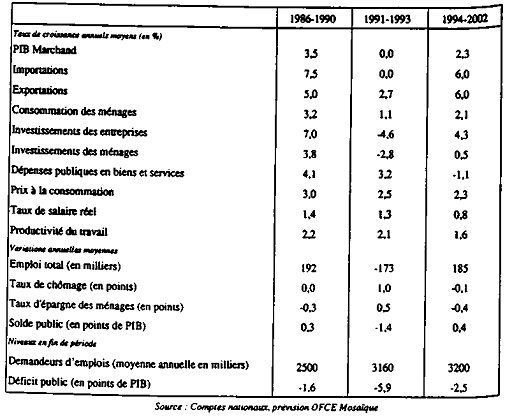

Si l'on compare les perspectives de l'économie française à l'horizon 2000 avec le dernier cycle d'augmentation de l'emploi (1986-1990), le ralentissement de la croissance tendancielle de la demande interne apparaît nettement. La consommation des ménages qui avait augmenté de 3,2 % par an ne croîtrait plus que de 2,1 % en moyenne. Pourtant la baisse du taux d'épargne se ferait à un rythme similaire (respectivement -0,3 et -0,4 point par an). Les investissements des entreprises, très dynamiques en début de période ralentiraient, une fois ajustées les capacités de production, si bien qu'ils tireraient un peu moins la croissance qu'au cours des années 1985-90. Les dépenses publiques seraient également très en retrait.
Ce compte de départ n'est pas équilibré du point de vue de la Sécurité sociale car les dépenses sont supposées évoluer à leur rythme tendanciel, alors que les aux de cotisations et de prélèvement sont maintenus fixes (tableau 2). Il s'agit d'un compte technique, les analyses qui suivent ayant pour objectifs de fixer l'ordre de grandeur des ajustements nécessaires de taux pour atteindre l'équilibre des comptes sociaux. L'impact de ces ajustements, dont on verra qu'ils devraient être finalement relativement limités, est analysé dans la conclusion de l'étude.
Tableau 2 : Détail du compte central technique non équilibré
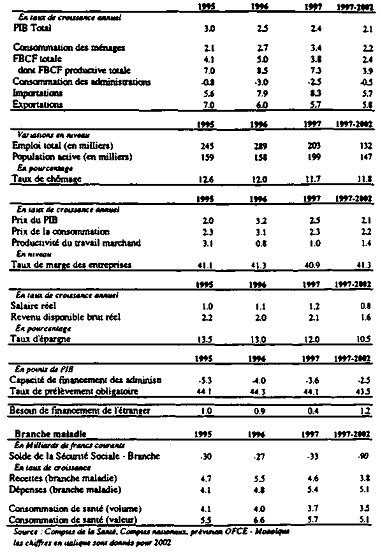
Il est à noter que la situation actuelle résulte en grande partie de la récession de 1991-1993. L'exercice qui consiste à simuler ce qui se serait passé si la croissance du PIB avait été en moyenne (1990/95) de 2,3 % au lieu de 1,5 % est présenté dans le tableau 3. Les hypothèses qui sont à la base de cette simulation sont principalement une demande étrangère accrue, rétablie à sa progression moyenne de 1985-1988 et des comportements des entreprises et des ménages non affectés par la récession. Différentes mesures de politique économique ont été annulées, dont principalement l'allocation de rentrée et la réduction des dépenses de santé en 1993-1994. Par contre, l'augmentation de la CSG en 1993 est maintenue.
Tableau 3 : Et si il n'y avait pas eu de récession ? Écart par rapport à l'historique
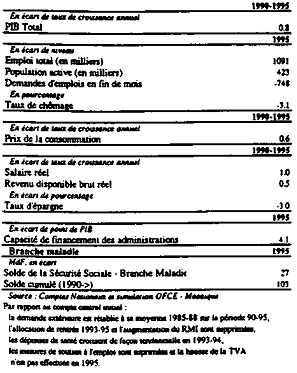
L'effet d'une croissance soutenue pendant cette période est particulièrement net en ce qui concerne les déficits publics. L'évaluation présentée, largement discutable quant aux hypothèses, montre que le déficit public en 1995 serait de 1,1 point de PIB au lieu de 5,3. Les différentes branches de la Sécurité sociale ne connaîtraient aucun déficit, cumulé ou courant. Les déficits que nous connaissons actuellement sont donc dus entièrement à la récession de 1991-1993. Les mesures qui doivent être envisagées actuellement ont plus pour objet de combler l'effet de cette récession que de reformer un système qui serait structurellement en déficit.
Tableau 4 : Impact de la récession sur les finances sociales
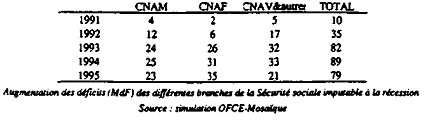
2. Les dépenses de santé à moyen terme : une hausse modérée de la CSG serait nécessaire.
Depuis que la Comptabilité Nationale permet de mesurer précisément les dépenses de santé, on a observé une croissance importante de la part de ces dernières dans le revenu national (graphique 1). Ce phénomène n'est pas propre à la santé. De nombreuses autres dépenses ont augmenté plus rapidement que la PIB sur longue période. Qu'il s'agisse de dépenses privées (loisirs, tourisme, transport,...) ou de dépenses collectives (éducation). Ce mouvement n'a rien d'anormal en soi : l'augmentation du revenu réel par tête et le progrès technique impliquent des changements de la structure de la répartition de la consommation. La part des biens destinés à satisfaire les besoins de base recule (alimentation, habillement,...) alors que d'autres consommations apparaissent ou se développent rapidement pour satisfaire des besoins supérieurs. La santé fait manifestement partie de la catégorie dont la consommation est stimulée par le progrès technique.
Graphique 1 : Part des dépenses de biens et de services médicaux dans le PIB
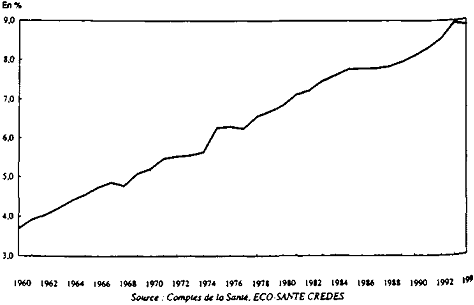
Comme pour les autres catégories de biens et de services dont la croissance de la consommation excède structurellement celle du PIB, la part du revenu affectée au financement de la dépense de santé a tendance à augmenter sur longue période. C'est ce qui explique fondamentalement les crises financières récurrentes de la branche maladie de la Sécurité sociale. Compte tenu de la nature du service rendu par la branche maladie, il était facile de prévoir que la dépense augmenterait plus rapidement que le revenu et que des hausses régulières de cotisations seraient nécessaires. Celles-ci auraient du être programmées, mais on a toujours considéré que les taux de cotisation devaient être fixés une fois pour toutes. La conséquence de ce comportement est de faire apparaître la nécessaire révision des taux de cotisations comme l'expression d'une crise profonde, alors qu'elle ne résulte que d'une évolution de longue période largement anticipable. Le sentiment de crise est d'autant plus fort que les difficultés financières apparaissent tout naturellement lors des creux conjoncturels, au moment où l'écart entre la croissance des dépenses et celle du PIB passe par un maximum.
Comparée aux principaux pays développés (tableau 5), la situation de la France n'est pas atypique. La part des dépenses de santé n'est pas la plus importante, même si l'on tient compte du niveau de PIB par tête. La part du public dans les dépenses de santé ne présente pas non plus un caractère original, puisque d'autres pays ont un taux de prise en charge bien supérieur.
Tableau 5 : Dépenses de santé dans les pays de l'OCDE (1992)
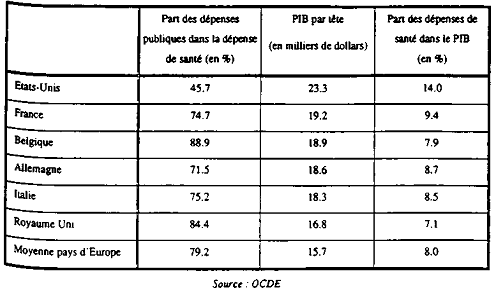
La situation que connaît aujourd'hui la Sécurité sociale n'est pas nouvelle. Dès 1967, alors que l'on n'était pas sorti des trente glorieuses, mais que l'on passait déjà par une phase de croissance ralentie, il avait fallu réformer la Sécurité sociale dans un contexte de crise financière. En 1993, le schéma traditionnel qui combine les effets de l'insuffisance de ressources à long terme pour la Sécurité sociale due à l'absence de programmation des hausses de cotisations, et ceux de la crise macro-économique conjoncturelle, s'est reproduit. Est-il possible de surmonter cette nouvelle crise par les voies traditionnelles ou faut-il une réforme plus profonde du système ?
La réponse à cette question dépend en particulier de l'écart futur entre le taux de croissance des dépenses de santé et celui de l'économie. Les perspectives de croissance économique ne sont pas particulièrement favorables et il paraît difficile d'imaginer que, d'ici 2002, la croissance du revenu national permette de financer l'augmentation spontanée des dépenses de santé sans une hausse des taux de prélèvement. Toutefois l'examen des tendances met en évidence un ralentissement très marqué de la croissance des dépenses de santé sur longue période qui permet d'envisager que cette hausse soit modérée.
Ainsi, la croissance de la consommation de biens et services de santé à prix constant qui était de 8,8 % par an en moyenne entre 1960 et 1970, n'est plus que de 3,3 % depuis 1990. Leur part dans le PIB a pratiquement doublée depuis les années soixante (passant de 4,4 en moyenne entre 1960 et 1970 à 8,6 depuis 1990) mais l'écart entre la croissance des dépenses en valeur et celle du PIB se réduit régulièrement depuis 1980, ce qui diminue la hausse nécessaire des taux de cotisation à moyen terme (graphique 2).
Tableau 6 : Croissance des dépenses de santé et du PIB
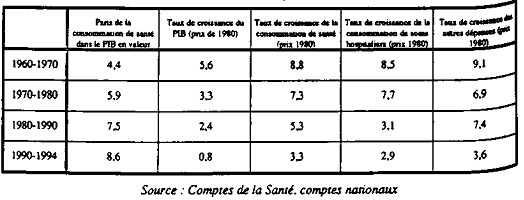
Graphique 2 : Écart entre la croissance des dépenses de santé et celle du PIB
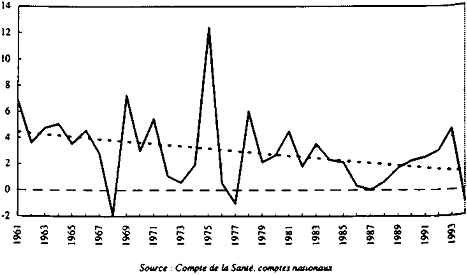
Le ralentissement de la croissance des dépenses de santé concerne aussi bien l'hôpital public que les autres dépenses (cliniques privées, médecine ambulatoire, consommation de médicaments, auxiliaires médicaux, etc.) Toutefois, depuis 1980, alors que la croissance des dépenses de l'hôpital public a ralenti, on observe toujours une augmentation des autres dépenses (graphique 3). Cette évolution des quinze dernières années compense le mouvement inverse qui s'était produit au cours des années soixante-dix. La croissance du total des dépenses apparaît plus stable sur longue période que celle de ses composantes. Ceci suggère que des transferts de dépenses entre secteurs peuvent se produire, soit en fonction du progrès des techniques médicales (dans un premier temps celles-ci ne peuvent être mises en oeuvre qu'à l'hôpital) voire des modalités de gestion du système de santé. L'introduction du budget global à l'hôpital, intervenu au début des années quatre-vingt, a pu contribuer à transférer une partie des soins de l'hôpital vers les autres secteurs de la médecine.
Graphique 3 : Évolution du partage de la consommation de services de santé entre l'hôpital et les autres dépenses
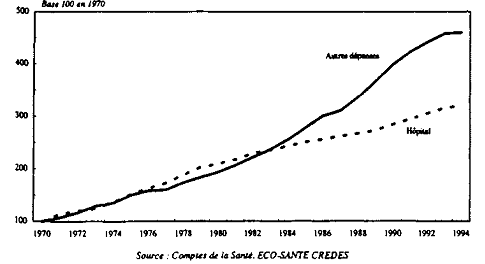
D'un point de vue macro-économique, il est donc plus prudent de projeter la tendance du volume total de la consommation de soins, plutôt que d'agréger des tendances sectorielles dont il n'est pas certain qu'elles soient indépendantes. C'est ce que nous avons réalisé en tenant compte de la déformation de la structure par âge de la population. En effet, le montant des dépenses de santé par individu est très différent selon l'âge. Élevée à la naissance, la consommation de soins diminue ensuite, puis se stabilise à l'âge adulte avant d'augmenter à nouveau après soixante ans (graphique 4).
Le vieillissement de la population est donc un facteur de hausse du coût de la santé. Il n'est pas certain que ce facteur joue aussi fortement qu'on ne l'imagine car l'élévation du montant des dépenses par tête avec l'âge, masque la concentration des soins au cours de la phase terminale de la vie. Il est donc possible que l'allongement de la durée de la vie résulte autant du progrès social général que de l'augmentation des dépenses de santé et que le vieillissement de la population s'effectue en conséquence sans surcoûts excessifs. Néanmoins, les incertitudes relatives à ces évolutions restent importantes et nous avons retenu une hypothèse plus prudent de maintien du différentiel de coût de la santé en fonction de l'âge.
Graphique 4 : Dépenses de santé selon l'âge de l'individu
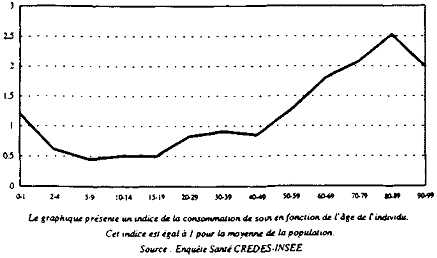
L'observation des séries passées de dépenses médicales montre par ailleurs que chacune des reformes du système de remboursement ou du mode de financement de l'hôpital (1967, 1977, 1983, 1986, 1993) ont eu un effet ponctuel sur l'évolution de la consommation de soins. Précisément, il apparaît que ces interventions ont contribué à l'apparition de « marches d'escalier » dans la progression des dépenses. Elles n'ont pas influencé la tendance de longue période, mais ont provoqué des économies durables. Il est trop tôt pour vérifier s'il en va de même pour la dernière réforme intervenue en 1993, mais les observations conjoncturelles de l'évolution des dépenses de santé (stagnation en 1994, puis redémarrage au rythme antérieur depuis le milieu de 1995) semblent conformes aux évolutions attendues. Nous avons donc admis que les économies suscitées par la réforme de 1993 auraient, comme précédemment, un impact durable sur le niveau.
La tendance des dépenses a été estimée sous ces hypothèses, sans tenir compte de l'incidence d'autres facteurs que le temps, le vieillissement de la population et les réformes du système de remboursement et de financement.
Il est par ailleurs possible de relier les dépenses de santé à l'augmentation du revenu réel. Ceci revient à considérer que, pour une part, les ménages se comportent pour ce qui concerne la consommation de soins comme ils le font à l'égard des autres biens et services. Cette hypothèse peut être validée économétriquement et l'élasticité estimée de la consommation médicale au revenu est de 0,4 sur la période 1970-1993 (en intégrant une tendance temporelle). La modération progressive de la croissance de la dépense médicale s'expliquerait alors en partie par celle des revenus. Un tel mécanisme est autorégulateur du taux de cotisation nécessaire à l'équilibrage des comptes de la Sécurité sociale, puisqu'il fait évoluer dans la même direction recettes et dépenses au cours du cycle macro-économique. Un nouveau ralentissement de la croissance entraînerait ainsi mécaniquement une réduction de la croissance des dépenses et limiterait l'augmentation du déficit. Par contre, en sens inverse, l'accélération de la croissance macro-économique serait moins efficace pour réduire le déficit. Nous n'avons pas retenu cette hypothèse car il nous semble que, pour une part importante, le lien entre la croissance macroéconomique et celle de la consommation médicale résulte plus de comportements collectifs délibérés que des comportements individuels. Le freinage des dépenses de l'hôpital public est ainsi largement discrétionnaire et dépend directement de décisions publiques (fermetures de lits, regroupement des hôpitaux, régulation du budget global). De même, la maîtrise des dépenses de soins ambulatoire dépend plus des comportements des médecins où des caisses d'assurance maladie et de l'État, que de celui malades. Certes, un certain nombre d'individus (notamment ceux dont les revenus sont les plus faibles) doivent limiter leur consommation de soins en fonction de leur revenu, mais les montants de dépenses en jeu ne constituent vraisemblablement pas l'essentiel des coûts de l'assurance maladie. Parce qu'elle est très largement « présente » la consommation médicale est très peu sous le contrôle direct des « consommateurs ». Il nous est apparu plus réaliste de considérer que l'évolution des dépenses santé était exogène à l'environnement macro-économique, ce qui nous permettait de simuler effets de décisions collectives destinées à modifier les tendances spontanées, notamment au cours des périodes de ralentissement de l'économie.
Compte tenu des tendances de longue période, le volume de consommation médicale devrait continuer à augmenter régulièrement d'ici l'an 2002. Toutefois le ralentissement de la tendance du taux de croissance est net puisqu'il ne serait plus que de 3 % par an environ en 2002 alors qu'il est encore supérieur à 4 % au début de la période (graphique 5). L'augmentation du volume de la consommation médicale n'est donc pas explosive. À l'horizon de 2002, sa croissance tend à se rapprocher spontanément de celle du PIB potentiel 3 ( * ) .
Graphique 5 : Taux de croissance annuel des dépenses de santé (francs 1980)
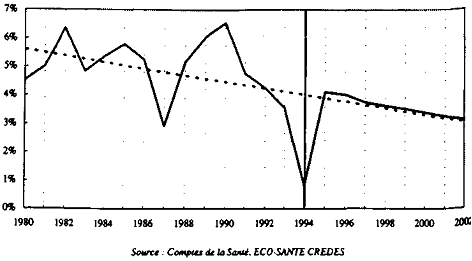
Le taux de prélèvement nécessaire à l'équilibrage des comptes de la branche maladie de 1a Sécurité sociale dépend, outre la croissance des dépenses en volume, de la tendance des prix relatifs de la consommation médicale. Or celle-ci fut orientée nettement à la baisse dans les années quatre vingt (graphique 6). Elle l'est encore depuis le début des années quatre vingt dix, sur un rythme plus ralenti. Pour le futur nous avons supposé une stabilisation progressive de cette tendance qui néanmoins, contribue encore à limiter la charge des dépenses de santé sur le revenu.
Les perspectives de dépenses de la branche maladie de la Sécurité sociale sont donc, à moyen terme , moins sombres que ne le traduit l'ampleur des déficits à court terme. Certes, une hausse des taux de prélèvement est encore nécessaire car la tendance est toujours à la hausse de la part de la consommation médicale dans la consommation des ménages. Mais, cette augmentation devrait être de plus en plus faible... si la croissance économique atteint au moins le niveau actuellement projeté. À plus long terme, on aperçoit le point à partir duquel la croissance des dépenses de santé n'excéderait plus celle du PIB, ce qui permettrait cette fois la stabilisation définitive des taux de prélèvement.
Graphique 6 : Prix relatif de la consommation médicale totale par rapport au prix de la consommation des ménages
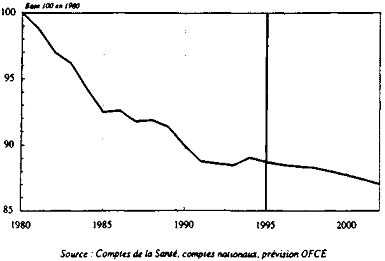
Depuis le début des années quatre vingt, les taux de remboursement ou de prise en charge des dépenses de santé par la Sécurité sociale diminuent. Entre 1980 et 1994 la participation de la Sécurité sociale au financement de la consommation de biens et services de santé a diminué de 2,7 points alors que celle des ménages et des assurances privées augmentait de 2,2 points (tableau 7). On a supposé pour établir notre prévision centrale, que ce recul continu de la Sécurité sociale, mais aussi de l'État et des collectivités locales, serait stoppé à partir de 1996 (graphique 7).
Tableau 7 : partage du financement de la consommation médicale (en % du total)
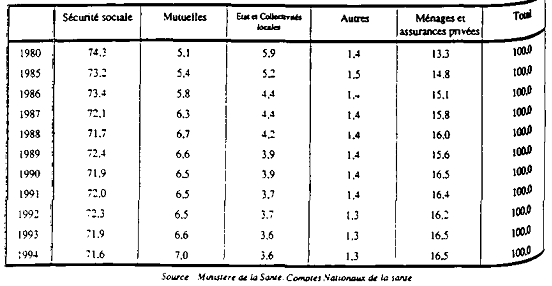
Graphique 7 : part du régime général dans le financement de dépense de soins
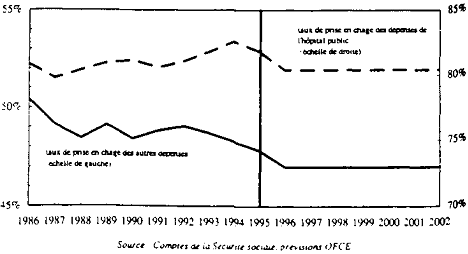
Les autres dépenses a !a charge de la branche maladie du régime général évoluent moins rapidement que les dépenses directes de soins notamment les indemnités journalières et les allocations de décès ou d'invalidité). Il en va de même pour les indemnités d'accidents du travail (tableau 8).
Tableau 8 : Taux de croissance annuel moyen des dépenses de santé en volume
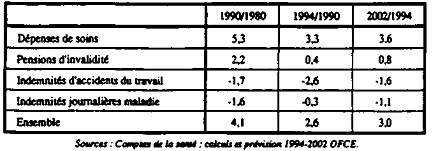
Au total, compte tenu également des dépenses de gestion et des transferts, les dépenses à la charge de la branche maladie du régime général de la Sécurité sociale devraient augmenter de 2,7 % par an, à prix constant, entre 1994 et 2002. La dérive des prix relatifs de la santé s'atténuant progressivement, l'écart entre le taux de croissance des dépenses de santé et celui du PIB serait d'environ 0,1 point par an. La part des dépenses dans le PIB n'augmenterait donc que très faiblement, de 0,3 point environ à l'horizon de 2002. Si les recettes de la Sécurité sociale augmentaient comme le PIB, il n'y aurait donc pratiquement pas de besoin de financement supplémentaire. Mais, les ressources actuelles de la Sécurité sociale sont constituées de cotisations assises sur les salaires qui augmentent moins rapidement que le PIB. L'écart entre la croissance des dépenses de santé à la charge du régime général et celle de ses ressources habituelles pourrait ainsi atteindre près de 1 point par an.
La ressource à trouver représenterait donc 0,07 point de PIB par an (la part des dépenses à la charge de la branche maladie du régime général représente environ 7 % du PIB en 1994) soit 0,5 point en 7 ans. Pour combler la dérive des dépenses de santé, on a donc intérêt à rechercher un financement complémentaire dont la base augmente le plus rapidement possible. Compte tenu du caractère général de la couverture des soins de maladie et de l'absence de lien direct entre les cotisations et le montant des prestations versées (à l'exception des indemnités journalières), il apparaît judicieux de retenir la CSG comme source future de financement. Celle-ci n'augmente pas le coût salarial. Elle permet de débattre clairement de la question du partage du revenu du travail entre consommation privée et consommation collective, sans interférer avec la question du partage entre salaires et profits. Par ailleurs la CSG peut être prélevée sur l'ensemble des revenus ce qui. dans les circonstances macro-économiques prévisibles, garanti un rendement supérieur aux cotisations salariales. Nous n'avons pas envisagé ici une extension de la fiscalité sur les revenus financiers des ménages, mais la sous taxation manifeste de cette catégorie de revenus pourrait aussi fournir la base d'une ressource à long terme pour la protection sociale 4 ( * ) .
Sans changement important de la structure de la fiscalité il est cependant possible de trouver assez facilement les ressources nécessaires à l'équilibre de la branche maladie. Compte tenu du déficit initial (aux alentours de 33 milliards de francs en 1995), une hausse de 1 point de la CSG au 1 er janvier 1996 permettrait à la fois de combler le déficit passé 5 ( * ) et de prendre un peu d'avance sur la dérive future des dépenses de santé. De fait, avec une telle augmentation le compte de la branche maladie est légèrement excédentaire jusqu'en 1998. À ce moment une nouvelle augmentation de la CSG deviendrait nécessaire, mais elle pourrait être limitée à 1/2 point. Au total, il faudrait donc augmenter de 1,5 point la CSG d'ici 2002. À cette époque, le rythme de croissance des dépenses devrait avoir ralenti suffisamment pour qu'il soit possible d'envisager une période de stabilisation du taux de prélèvement, sous réserve que le vieillissement de la population, qui sera de plus en plus marqué à partir du milieu des années 2000, ne s'accompagne pas d'une reprise forte de la dérive des dépense, ceci dans l'hypothèse du maintien d'un taux de croissance au moins égal à 2 % en moyenne (graphique 8 et tableau 9).
La question du financement des dépenses liées à la santé est donc moins préoccupante qu'on ne le dit souvent. La nécessité d'une réforme fondamentale due à l'excès de charges que ferait peser les dépenses de santé sur l'économie, n'apparaît pas clairement, si la décélération tendancielle des dépenses se poursuit.
L'augmentation du taux de prélèvement nécessaire reste en effet supportable à moyen terme. Il apparaît en fait que la question de la réforme du système de santé n'est pas de nature macroéconomique mais bien plutôt micro-économique : si des économies sur les dépenses sont possibles sans réduire ni la quantité des services de santé rendus aux individus, ni leur qualité, alors l'efficience du système sera augmentée et des retombées positives, en terme de bien être, peuvent être attendues. Si par contre ces économies entraînent un rationnement des soins pour une partie de la population ou une baisse de la qualité des services rendus, alors le résultat sera socialement négatif sans gains macro-économiques significatifs.
Tableau 9 : Perspectives à moyen terme avec augmentation de la CSG
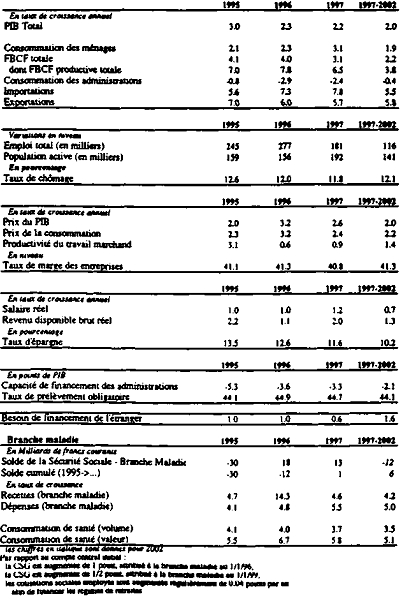
Graphique 8 : Augmentation de la CSG, équilibre de la branche maladie

Par ailleurs, il apparaît que dans ce second cas de figure, l'effort devrait être significatif car, pour combler entièrement le besoin de financement de la branche maladie à moyen terme, il faudrait stabiliser entièrement le montant des dépenses en volume d'ici 1999 (tableau 10).
Tableau 10 : Arrêt de la progression des dépenses de santé jusqu'en 1999 inclus
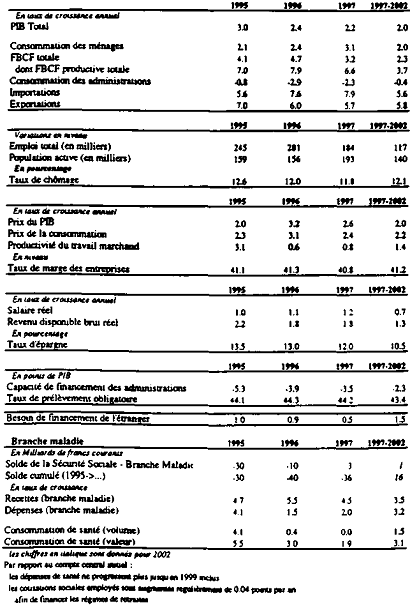
Si les conséquences macro-économiques d'un tel plan de contrôle des dépenses sont pratiquement équivalente à l'augmentation en deux étapes de la CSG, la réduction des déficits (de la branche maladie, ou plus généralement public) se fait plus lentement.
3. Us retraites : peu de problèmes de financement à l'horizon 2002
Avec plus de 750 milliards de prestations versées en 1994, les retraites constituent la principale dépense de protection sociale. L'évolution démographique caractérisée par la baisse de la natalité et l'allongement continu de la durée de vie entraîne à long terme, une hausse du rapport entre le nombre de retraités et celui des cotisants qui nécessite une augmentation parallèle des taux de cotisation. Les structures démographiques héritées du passé ont longtemps été favorables et les taux de cotisations ont pu être fixés à un bas niveau, tout en permettant une augmentation appréciable du pouvoir d'achat des retraités.
Cette période d'aubaine qui a caractérisé les années d'après guerre, va bientôt se terminer. À partir de 2003, les classes très nombreuses du baby-boom atteindront l'âge de la retraite et une hausse importante des taux de cotisations sera alors nécessaire pour maintenir l'équilibre des régimes. Jusqu'à cette date toutefois, la pression démographique sur le système de retraites restera faible. À l'inverse, les années de 1995 à 2005 seront même caractérisées par un ralentissement de la croissance de la population âgée de plus de 60 ans, puisque les générations qui atteindront l'âge de la retraite correspondent aux classes « creuses » de l'immédiat avant guerre et de la guerre (graphique 9). Les systèmes de retraite vont donc bénéficier d'un répit pendant toute la période étudiée ici.
Graphique 9 : population de 60 ans et plus

De 1994 à 2002, le taux de croissance annuel moyen de la population âgée de plus de 60 ans devrait ainsi être inférieur à 1 % par an alors qu'il avait atteint 1,3 % entre 1983 et 1995 et qu'il sera voisin de 2,5 % entre 2003 et 2011
En outre, les réformes décidées en 1993 et 1994 devraient conduire à un ralentissement de la croissance du pouvoir d'achat de la retraite moyenne.
En ce qui concerne le régime général, trois décisions importantes ont été prises : l'allongement des durées de cotisation à 40 ans pour une retraite à taux plein ; l'allongement de 10 à 25 ans de la période retenue pour le calcul du salaire de référence ; la révision du mode d'actualisation des pensions définitivement indexées sur les prix et non plus sur les salaires, comme c'était le cas avant. Cette réforme a pour conséquence une baisse du niveau relatif des retraites. L'allongement des durées de cotisation devrait inciter ceux dont l'entrée en activité fut tardive à repousser l'âge de leur départ à la retraite et donc, à espérance de vie donnée, raccourcir la période moyenne de versement des pensions. Ceci sera surtout sensible pour les cadres puisqu'une carrière de 40 ans suppose, pour un départ à 60 ans, une entrée en activité à 20 ans, soit un niveau de scolarité bac+2. L'allongement de la période de référence à 25 ans et l'indexation sur les prix devraient entraîner une baisse de la retraite moyenne en réduisant le salaire de référence servant au calcul des pensions. Toutefois, le résultat final dépendra beaucoup de l'évolution future des salaires réels. Si ceux-ci augmentent rapidement l'écart entre retraite et revenus d'activité se creusera ; s'ils stagnent le rapport retraite/salaire restera pratiquement constant. D'ici 2002, le maintien d'une faible croissance du salaire réel limitera le creusement de l'écart entre salaires et retraites. D'autant plus que l'application de la réforme est progressive et qu'elle touche peu les générations qui prennent actuellement leur retraite. En ce qui concerne les régimes complémentaires, les aménagements décidés ont des caractéristiques différentes. Il sont en effet essentiellement orientés vers l'amélioration de la situation financière des régimes à l'horizon de 10 ans. Ils comportent deux volets : la réduction progressive du rendement des régimes et l'augmentation des taux de cotisation. Cette dernière mesure apportera bien des recettes supplémentaires à court terme, mais elle entraînera une augmentation des droits et donc des charges à long terme. Ainsi le taux de remplacement du revenu d'un ouvrier par la retraite ARRCO. qui est de 21 % pour un salarié parti en 1994 serait de 22 % pour un salarié partant en 2014, alors que pour les cadres le taux de remplacement pourrait même augmenter légèrement malgré la baisse du rendement.
Au total, l'ensemble des réformes du régime général et des régimes complémentaires devraient toutefois contribuer significativement à limiter les dépenses de retraites à l'horizon 2002. Selon les évaluations réalisées à l'OFCE 6 ( * ) l'impact total des réformes s'élèverait à 3 points de cotisations en 2000. Si bien que l'ensemble du système des retraites serait quasi équilibré à l'horizon de 2002. D'après nos calculs, compte tenu d'une croissance en retrait par rapport aux hypothèses précédemment retenues, une hausse très légère des cotisations pourrait néanmoins être nécessaire, mais elle serait limitée à 0,3 point de cotisations en sept ans (soit 0,04 point par an environ). Il s'agit là d'un résultat macro-économique qui n'implique pas que tous les régimes soient équilibrés. La complexité du système et la variété des régimes professionnels est telle qu'il est possible que certaines caisses connaissent des déséquilibres marqués alors que d'autres enregistreraient des excédents.
Le financement des retraites devrait donc être assuré facilement au cours des sept ans qui viennent. Pour le plus long terme, la question se pose de savoir s'il ne faudrait pas compléter le système, qui à partir de 2005 devra subir l'effet du « contre choc démographique ». On ne reprendra pas ici les analyses qui montrent que l'introduction d'un régime supplémentaire de capitalisation n'apparaît pas opportun compte tenu des ses effets anti solidaires et des incertitudes qui pèsent sur la possibilité de construire un système fondé sur ce principe 7 ( * ) . On notera simplement que la situation macro-économique plaide peu en faveur d'un tel système. L'économie française, au cours des années qui viennent, risque plus de souffrir de l'atonie de la demande des ménages, dont les revenus réels augmenteraient lentement, que d'une insuffisance d'épargne, alors même que les entreprises continueraient à disposer de ressources d'autofînancement importantes.
Dans un tel contexte, la stimulation de l'épargne des ménages, qui aurait pour contrepartie mécanique une baisse de la consommation, risquerait à l'inverse de peser sur la croissance et finalement aussi sur les investissements.
4. Les dépenses pour la famille, le chômage et le RMI ne menacent pas les grands équilibres
Les dépenses pour la famille ont connu une forte augmentation au cours de la période récente du fait de la récession de 1993.
Pour une part cette croissance a été délibérée et elle résulte, pour les allocations familiales, de la décision d'augmenter de manière importante l'allocation de rentrée scolaire (graphique 10).
Pour les autres prestations elle découle directement de la crise qui a considérablement gonflé les dépenses d'assistance, notamment le RMI (graphique 11), mais aussi certaines allocations logement pour les plus démunis (graphique 12). En conséquence, les déficits qui sont apparus dans la branche famille du régime général de la Sécurité sociale sont largement imputables à la très mauvaise conjoncture de la période 1991-1993.
Graphique 10 : Prestations familiales à prix constants par jeune de moins de 20 ans
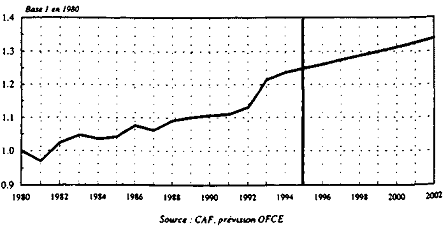
Graphique 11 : RMI à prix constants
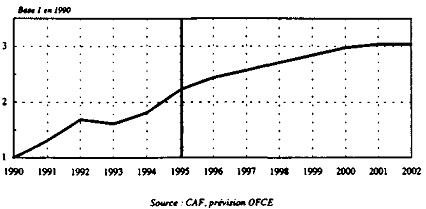
Graphique 12 : Allocations logement à prix constants
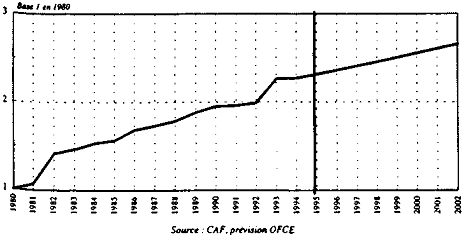
En ce qui concerne le RMI, la combinaison de la forte montée du chômage au cours de cette période et de la réforme de l'indemnisation du chômage est la cause principale de l'explosion des dépenses.
La reprise de la croissance, même sur un rythme modéré devrait suffire pour assurer l'équilibre entre la croissance des dépenses et des ressources financières. Ainsi, l'augmentation des prestations familiales devrait retrouver un rythme très modéré à prix constant du fait de la baisse progressive des effectifs des moins de vingt ans, de l'ordre de 1 à 1,3 % par an jusqu'en 2000, puis un peu inférieur à 1 % .
La croissance du PIB excéderait donc largement celle des prestations dont la pan diminuerait. Les allocations logement devraient quant à elles retrouver un rythme de croissance de l'ordre de 2 % par an à prix constants. Les éventuels problèmes financiers de la branche famille du régime général ne sont donc pas de nature macro-économique, mais découlent d'une mauvaise répartition des ressources et des charges entre les divers agents qui concourent au financement des prestations. Le transfert des cotisations d'allocations familiales sur un impôt d'État ou sur la CSG. permettrait de clarifier la situation alors que le système actuel qui fait reposer le financement sur des cotisations employeurs est néfaste du point de vue du coût du travail.
Globalement, s'il n'est donc pas nécessaire de prévoir un financement complémentaire pour les prestations familiales, dans l'hypothèse où de nouvelles prestations ne seraient pas créés et où celles qui existent seraient indexées sur l'inflation, une réforme de la structure de ce financement pourrait néanmoins être envisagée.
En ce qui concerne le RMI, la montée en charge des dépenses pourrait se ralentir avec l'arrêt de la dégradation du marché du travail. Il en irait de même pour l'indemnisation du chômage dont la pan dans le PIB continuerait à diminuer. Même s'il est très difficile de mesurer l'impact de la réforme des prestations de l'Unedic de 1992, celle-ci a conduit à une baisse de 1a couverture des chômeurs par la partie « assurance » du régime. Là encore un problème de partage des charges et des ressources entre les agents concernés (essentiellement l'État et l'Unedic) pourrait amener à réviser la logique de l'ensemble du système de protection contre le chômage et la pauvreté. Mais cette éventuelle refonte ne justifie pas un accroissement des prélèvements, sauf si l'on considère qu'il serait utile de revenir sur la réduction de l'indemnisation des chômeurs ou si l'on souhaite mettre en place des prestations nouvelles (pour les moins de vingt cinq ans par exemple).
5. Quelles réformes ?
La projection de l'équilibre des régimes de protection sociale à l'horizon 2002 ne fait pas apparaître de crise grave de l'ensemble du système. Ce résultat contraste avec les analyses souvent développées d'une crise structurelle qui ne pourrait être résolue que par un bouleversement des principes qui fondent la Sécurité sociale.
Certes, une certaine hausse des cotisations et des prélèvements est encore nécessaire, mais d'ici 2002 elle correspond uniquement, à la poursuite de la déformation de la structure de 1a consommation des ménages en faveur des dépenses de santé. Le rythme de plus en plus ralenti de cette évolution est toutefois significatif ; il laisse entrevoir une stabilisation à terme de la part du revenu qui devra être affecté à la satisfaction des besoins de santé.
Il n'y a donc pas d'explosion du système.
Après 2002, la retraite nécessitera, à son tour, une hausse des cotisations, mais il s'agira alors d'arbitrer entre le maintien d'un niveau de vie acceptable pour les retraités et la contribution des actifs. Aucun système ne permettrait d'éviter d'avoir à affronter ces choix. En particulier le repli de la couverture des régimes de protection sociale publics sur les catégories les moins favorisées de la population et le désengagement progressif à l'égard des catégories aisées, contraindrait ces dernières à recourir à une protection privée dont le coût serait pour elles, tout aussi élevé.
Par contre, une telle protection sociale à deux vitesses entraînerait inévitablement un relâchement de la solidarité entre catégories sociales puisque les transferts, qui fondent tous les systèmes d'assurance, seraient réalisés selon des canaux plus étanches qu'aujourd'hui (les bien portants riches paieraient pour les malades riches ; les salariés riches pour les retraités riches, etc.). Avec un tel système, il est vraisemblable qu'à terme les transferts riches/pauvres seraient de plus en plus difficiles. D'autant plus qu'ils devraient passer plus qu'aujourd'hui par l'État dont les prélèvements sont les plus facilement contestés. Le développement des inégalités serait donc de plus en difficile à éviter alors que le chômage contribue déjà largement à accentuer les fractures sociales.
Plus que d'une réforme d'ensemble, le système aurait donc avant tout besoin d'aménagements pour mieux satisfaire des besoins qui, à l'heure actuelle, restent mal couverts mais aussi pour alléger certaines prestations dont l'utilité apparaît moins clairement aujourd'hui qu'au moment de la fondation de la Sécurité sociale. Enfin, subsiste un problème micro-économique permanent, qui concerne la santé, et qui est de s'assurer de l'efficience technico-économique du système de production des services de soins.
5.1 Des dépenses nouvelles
Les débats sur l'avenir de la protection sociale ne sont pas uniquement orientés vers la recherche d'économies, comme le prouve le projet en discussion de création d'une allocation tendance pour les personnes âgées. En effet, il est apparu progressivement qu'avec le vieillissement de la population, le nombre de ceux qui ne peuvent plus subvenir sans aide aux contraintes de la vie courante était en forte augmentation. Des systèmes divers de protection sociale existaient bien qui ont permis de parer aux situations les plus graves, mais une partie importante de la charge de la dépendance a été reportée sur les familles des personnes concernées. La nécessité d'une intervention publique est donc apparue nettement en Franc* comme dans d'autres pays de même niveau de développement, notamment l'Allemagne.
Le gouvernement propose de créer une allocation spécifique qui permettrait aux personnes concernées de recourir aux services d'aides spécialisées. Au plan macro-économique, cette prestation nouvelle viendrait remplacer en partie des dépenses en place. Ainsi, sur les 20 milliards de dépenses correspondant à la prestation dépendance, 6 milliards seraient déjà pris en charge par les départements.
En première analyse, et sous réserve que la prestation nouvelle ne réduise pas par ailleurs d'autres dépenses de protection sociale existantes (allocations pour handicapés par exemple). la mesure correspondrait à un transfert de 14 milliards de francs entre les ménages. On peut penser en effet que le coût des prestations sera financé par une hausse de la CSG (0,3 point environ serait nécessaire). Un tel transfert est à priori neutre au plan macro-économique (les ménages versent 14 milliards d'impôts supplémentaires et ils reçoivent 14 milliards de prestations supplémentaires).
Il est cependant possible que la mesure puisse créer des emplois supplémentaires si le contenu de la dépense de prestations est plus riche en travail que celui de la consommation courante qui sera amputée par l'augmentation des prélèvements. Le gouvernement a annoncé que le nombre d'emplois susceptible d'être créés est de l'ordre de 50 à 100 000. Comme la réduction d'emplois provoqué par la CSG serait, selon une simulation réalisée avec le modèle Mosaïque, de 30.000, ceci implique une création « nette » d'emplois de 30 à 70.000.
Compte tenu du montant de la prestation et du nombre de personnes actuellement dépendantes (environ 600.000 dont la moitié en institutions) cet ordre de grandeur est sans doute réaliste et la nouvelle prestation n'aurait pas d'inconvénient au plan macro-économique, puisqu'elle serait neutre sur la croissance et qu'elle pourrait permettre une augmentation plus rapide de l'emploi.
Toutefois, on voit bien sur cet exemple que l'essentiel du débat sur la protection sociale n'est pas d'ordre macro-économique. Une prestation, nécessairement financée à long terme par un prélèvement, a peu d'effet sur les grands équilibres. Elle doit être jugée principalement en fonction de ses caractéristiques « micro-économiques » : est-elle nécessaire ? correspond-elle à un besoin social réel ? est-elle justement attribuée ?
D'autres besoins que ceux de la dépendance des personnes âgées sont actuellement peu ou mal satisfaits. Dans le domaine de la santé on sait que certaines catégories de soins sont mal couverts (optique, soins dentaires notamment) et que la situation sanitaire des plus défavorisés se dégrade. Cette situation résulte pour partie des baisses passées des taux de remboursement. Une révision à la hausse de certaines prestations pourrait donc être sérieusement envisagée, en particulier dans le secteur de la santé. Des insuffisances apparaissent également en ce qui concerne la protection des chômeurs, notamment depuis la réforme de l'assurance chômage. Le RMI joue certes son rôle de filet de protection, mais des catégories importantes comme les moins de vingt cinq ans au chômage, sont écartées de toute prestations. Les étudiants font également partie des populations qui pourraient bénéficier de l'amélioration de la protection sociale.
Des dépenses supplémentaires sont envisageables et probablement justifiées dans de nombreux cas. Il serait important pour une bonne appréciation des évolutions souhaitables de la protection sociale à moyen terme de pouvoir les recenser plus précisément et les évaluer. Sans doute n'est-il pas possible, ni opportun, de satisfaire toutes les demandes. Mais, le seul argument macro-économique d'un poids trop lourd de la protection sociale pour les refuser n'est pas convainquant dans un domaine où l'essentiel des effets consiste dans des transferts entre ménages.
5.2 des économies possibles
S'il existe des possibilités pour augmenter les dépenses de la protection sociale, il est également nécessaire d'examiner les sources d'économies possibles, En matière de retraite, les décisions déjà prises devraient entraîner une réduction sensible du pouvoir d'achat des futurs retraités. Par rapport au système antérieur, le dispositif en cours devrait entraîner une baisse relative des retraites de 10 à 15 % pour ceux qui quitteront la vie active en 2014, et de 25 à 30 % pour ceux qui la quitteront vingt ans plus tard, si l'on maintient la règle d'indexation des retraites servies sur les prix. Il paraît très difficile d'aller beaucoup plus loin sous peine de remettre en cause le statut des personnes âgées dans la société, En matière de couverture du chômage et de la pauvreté on a vu que ce sont plutôt des dépenses nouvelles que des économies qu'il faudrait envisager.
Dans le domaine du logement, les aides sont soumises à des conditions de ressources et il est très difficile de les réduire alors que le problème du logement social n'est pas résolu. Ceci n'implique pas que des transferts entre catégories de dépenses pour le logement ne soit pas nécessaires. L'application effective du surloyer pour les occupants de HLM qui dépassent les plafonds de ressources pourrait financer les aides supplémentaires rendues indispensables par la dégradation sociale de certains quartiers.
Globalement, et sous réserve de travaux micro-économiques approfondis, les sources d'économies paraissent limitées.
Le seul domaine où un redéploiement significatif est envisageable est celui des allocations familiales. En effet, sur un total de 178 milliards de francs versé par les caisses d'allocations familiales en 1993 (dont 53 milliards au titre du logement et 97 milliards au titre de la famille) 55 milliards le sont sous forme d'allocations familiales sans conditions de ressources. Or cette prestation a été conçue pour assurer un niveau de vie décent aux familles, à une époque où le pouvoir d'achat moyen était relativement faible. Après cinquante ans de croissance du revenu réel, peut être est-il possible d'envisager la remise en cause de cet avantage, si l'on considère que d'autres priorités sont plus urgentes ou si, plus simplement, on souhaite réduire les prélèvements. Si l'on soumettait ces allocations à des conditions de ressources et en retenant les plafonds actuellement utilisés pour les autres prestations, il serait possible de dégager une économie de 15 à 20 milliards de F. par an. Une telle modification irait évidement en sens inverse des politiques destinées à favoriser la natalité ou à instaurer le « libre choix » entre travail salarié ou domestique pour les femmes.
La seule source importante d'économie potentielle pour la protection sociale resterait l'amélioration de l'efficience du système de production des services de santé.
Ce secteur est en effet caractérisé par une domination structurelle de l'offre sur la demande Les médecins sont prescripteurs des biens et des services dont ils sont les producteurs et le « pouvoir de consommateur » des malades est insignifiant. Rien ne garantit l'efficience du système.
De nombreuses observations micro-économiques, qui malheureusement sont très difficiles à synthétiser, tendent à montrer qu'il serait possible de fournir à moindre coût une quantité égale de services de santé de qualité égale.
Si l'action micro-économique de gestion du système de santé pouvait parvenir à ce résultat il en découlerait naturellement un desserrement des contraintes qui pèsent sur la Sécurité sociale et une amélioration du « bien être national ». Pour autant, le « produit national brut » ne serait pas mécaniquement augmenté. C'est ce que montre la simulation des effets d'une réduction structurelle des dépenses de santé accompagnée d'une baisse à due proportion, des cotisations (tableau 11).
Les « gâchis » comme les productions utiles sont effet comptabilisés dans le PIB. Leur réduction n'améliore donc pas celui-ci. Par ailleurs, ils sont aussi générateurs d'emplois. En conséquence le redéploiement de la demande libérée par la baisse des cotisations due à la réduction des dépenses de santé « inutiles » , ne fait que compenser les réductions d'effectifs dans le secteur médical. Comme ce secteur est abrité de la concurrence étrangère et qu'il est riche en emplois, les économies sur la santé ont tendance à réduire le PIB, à diminuer l'emploi total et à augmenter le chômage. Ce résultat négatif est dû au fait que les fruits de l'amélioration de l'efficacité du système de santé, liée à la disparition des dépenses inutiles, est redistribuée aux actifs ayant un emploi.
Tableau 11 : Impact d'une plus grande efficacité du système de soin
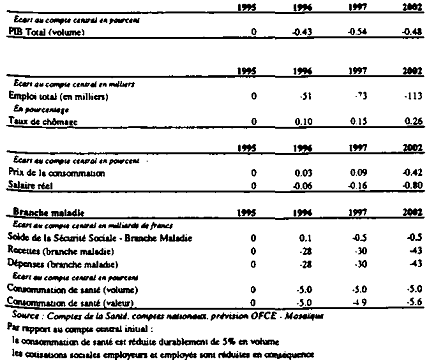
Il apparaît donc clairement que la question de l'efficacité du système de soins n'est pas de nature macro-économique. On ne peut pas attendre d'une réduction des dépenses une relance de l'activité ou des créations nettes d'emplois, ceux-ci ne pouvant provenir que d'une amélioration générale des conditions de la croissance (taux d'intérêt, partage salaires/profits adéquat, stabilité des marchés financiers, taux de change adaptés aux situations économiques relatives des différents pays. etc.). Ceci ne signifie pas qu'il faille se désintéresser du problème qui peut avoir une grande importance pour l'amélioration du bien être social, mais simplement qu'il s'agit d'une question micro-économique dont la solution ne permettrait pas de suppléer aux carences des politiques de régulation macro-économique.
6. Conclusions
Au terme de cette étude des perspectives macro-économiques de la protection social de France, les enjeux des débats en cours sur l'avenir de la Sécurité sociale mentent d'être précisés.
En premier lieu, la « crise de l'État providence » si souvent annoncée n'apparaît pas clairement. La logique qui conduit à l'augmentation des taux de prélèvement destinés à financer des consommations dont le besoin est croissant n'est pas l'expression d'une crise mais résulte d'un processus normal. Si la Sécurité sociale n'avait pas pris en charge le financement de la maladie, les français auraient quand même dû affecter une pan croissante de leur revenus aux dépenses de santé. Au cours des années qui viennent, une augmentation supplémentaire des taux sera nécessaire. Mais elle n'est pas démesurée, puisque, tous régimes confondus, elle devrait rester de l'ordre de 1,5 points de CSG en 7 ans. Par ailleurs, elle est anticipable et donc programmable. Le prix à payer pour le maintien du système de protection, social à moyen terme est loin d'être déraisonnable si l'on tient compte des avantages qu'il procure. Qu'il s'agisse des avantages directs pour les assurés qui bénéficient d'une sécurité indéniable, ou des avantages pour la société, qui malgré les difficultés créés par la mauvaise conjoncture macro-économique, a réussi jusqu'à présent à maintenir une certaine solidarité entre les catégories sociales.
En second lieu, les analyses de la charge que fait peser la protection sociale sur l'économie sont en général mal formulées. Les prestations qui correspondent à de purs transferts (indemnités chômage, prestations familiales, retraites. RMI) sont mécaniquement neutres au plan macro-économique à condition que le prélèvement soit opéré sur les ménages par un impôt du type de la CSG. Dans le passé, le système de partage des cotisations entre employeurs et salariés à pu perturber le fonctionnement macro-économique en élevant le coût relatif du travail. Une réforme du mode de financement des prestations est encore nécessaire de ce point de vue. Depuis plus de dix ans, toute l'augmentation des dépenses a pesé presqu'exclusivement sur les ménages et, dans l'avenir, la CSG devrait être le principal prélèvement augmenté. Si bien que l'on ne peut pas dire que l'augmentation de la charge sociale a pesé sur l'économie et ralenti la croissance ou réduit le nombre d'emplois.
La crise de la protection sociale est la conséquence de la situation macro-économique. Celle-ci est due aux dysfonctionnements de la politique économique (taux d'intérêt, absence de coordination efficace des politiques européennes, priorité excessive à la lutte contre l'inflation) ainsi qu'à un enchaînement récessif lié à l'incapacité de maîtriser l'évolution du partage entre revenus du travail et profits. La sortie de cette crise par une réduction des transferts sociaux ou une meilleure utilisation des ressources par le système de production de services santé est illusoire. Les mécanismes de redistribution des gains de productivité globale dans une économie dont la croissance est largement contrainte, n'entraînent pas mécaniquement une amélioration de la production et de l'emploi.
À l'inverse, on peut même craindre, si des mécanismes de redistribution volontaires ne sont pas mis en place, que les améliorations d'efficience produisent du chômage et des inégalités supplémentaires. Ceci ne signifie nullement que l'objectif d'amélioration de l'efficacité des systèmes productifs -qu'ils soient privés ou publics - doit être abandonné. Au contraire, comme il s'agit de la seule source d'amélioration du « bien être » à long terme, elle doit être constamment recherchée. Mais elle ne peut se substituer à la recherche des solutions aux problèmes proprement macro-économiques qui se posent à l'économie française et européenne. D'autre part, elle doit vraisemblablement s'accompagner d'une réorganisation du travail qui permette un meilleur partage de l'emploi.
* 1 Rapport d'information SÉNAT (1994-1995) n° 293 Une projection à moyen terme (1994-2000) : Tendances macroéconomiques et perspectives pour les finances publiques.
* 2 Ces simulations, réalisées par l'équipe responsable du modèle MIMOSA - commune au CEPII et à l'OFCE - sont diffusées en intégralité dans la série « Les documents de travail du Sénat », Série Études (n° E 2).
* 3 Voir le rapport d information n° 411 (SÉNAT. 1994-1995)
* 4 C'est-à-dire le niveau atteint si l'on prolongeait la tendance de la croissance sur longue période de l'économie française (soit 2,5 % par an environ).
* 5 Rapports d'information SÉNAT n° 293 (1994-1995) et n° 127 (1994-1995).
* 6 Les auteurs de l'étude soulignent cependant que l'incidence du vieillissement démographique sur les dépenses de santé pourrait être moins forte qu'on ne l'imagine, dans la mesure où l'augmentation des dépenses par tête avec l'âge, marque la concentration des soins au cours de la phase terminale de la vie.
* 7 La question des incidences macroéconomiques du vieillissement démographique, et en particulier celle du développement des régimes par capitalisation, a été évoquée par votre Délégation dans son rapport d'information n° 127 (SÉNAT. 1994-1995).
* 8 La revue du CEPII n° 63, 3 ème trimestre 1995) est consacrée à une analyse de ces dévaluations
* 9 Voir rapport d'information n° 411 (SÉNAT 1994-1995).
* 10 Voir Revue de l'OFCE n° 53 (Avril 1995) « Le mystère de la consommation perdue » .
* 11 Rapport sur les comptes de la Nation en 1994 (Tome 1, page 56).
* 12 Ce qui semble notamment évident pour les intérêts versés par les SICAV de capitalisation : dans ce cas, les revenus d'intérêts viennent directement abonder l'épargne des ménages et ne sont pas consommés.
* 13 C'est-à-dire avant de faire « tourner » le modèle : la simulation d'une diminution ex ante de la consommation se traduira par moins de croissance, moins d'investissement, moins de salaires, etc., de telle sorte que, par le jeu du multiplicateur, la diminution ex post de la consommation sera supérieure à sa diminution ex ante .
* * Ce rapport a été réalisé par Gérard Comilleau. Damien Echevin et Xavier Tïmbeau du département d'économétrie de l'OFCE. Les simulations ont été effectuées à l'aide du modèle de l'économie française Mosaïque.
* 1 voir « Perspectives moyen terme de l'économie française ». Revue de l'OFCE n° 52, janvier 1995.
* 2 Équipe MIMOSA CEPII-OFCE. « Quand les marches triomphent », Rapport pour U Délégation pour la planification du Sénat, septembre 1995.
* 3 Le concept de croissance potentielle ne fait pas l'unanimité chez les économistes. Certains retiennent comme critère essentiel le maximum de croissance soutenable sans accélération de l'inflation et donc sans déséquilibres susceptibles d'entraîner une réaction négative des marchés financiers. D'autres retiennent plutôt comme critère le maximum de croissance possible compte tenu des ressources physiques disponibles (travail et capital), de l'évolution de ces ressources (qui pour le capital peuvent elle-même dépendre de la répartition du revenu entre salaires et profits) et de celle de l'efficience des facteurs de production (productivité du travail et du capital). Selon que l'on privilégie une catégorie de critères ou une autre l'estimation de la croissance peut être très différente. Compte tenu des contraintes qui pèsent actuellement sur les politiques économiques européennes, le maintien des équilibres implique une croissance faible (du type de celle qui est décrite dans nos perspectives à moyen terme). Pour les tenant de la première école cette croissance est en fait proche de la croissance potentielle puisqu'on ne pourrait pas accélérer l'économie sans remettre en cause les grands équilibres. Pour ceux de la seconde école cette croissance effective est en fait très inférieure à la croissance potentielle. Si l'on s'en tient aux travaux de simulation à moyen terme réalisés avant la récession de 1993, l'économie française était dans une situation, du point de vue de l'évolution des facteurs de production. qui lui permettait de croître en moyenne de 3 % par an.
* 4 Sur le problème général de la fiscalité en France, voir Henri Sterdyniak. « Vers une reforme fiscale en France ». Revue de l'OFCE n° 53. avril 1995. On trouvera notamment dans cet article une analyse qui montre que la création d'un Impôt Social Généralisé au taux de 20 % (se substituant aux actuelles cotisations employeurs et salariés pour la maladie et les prestations familiales) permettrait d'accroître de 80 milliards l'imposition des revenus financiers.
* 5 Celui-ci est en partie imputable à la récession de 1993. On aurait pu considérer qu'il n'était pas nécessaire de combler la part du déficit observé correspondant au mouvement de la conjoncture. Mais, les perspectives de croissance futures montrent qu'au delà de l'accident purement conjoncturel, la récession de 1993 débouche sur un rythme de croissance tendanciel ralenti. Dans ces conditions, il n'est plus possible d'attendre un apurement automatique des déficits accumulés.
* 6 Voir, Girard Comilleau et Henri Sterdyniak. « Les retraites en France : des débats théoriques aux choix politiques », in Bernard Cochemé et Florence Legros, Les retraites : Genèse, acteurs, enjeux, Armand Colin, Paris, 1995.
* 7 Voir également Gérard Comilleau et Henri Sterdyniak. op. cit.







