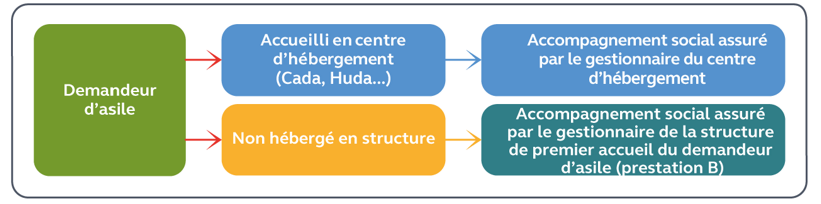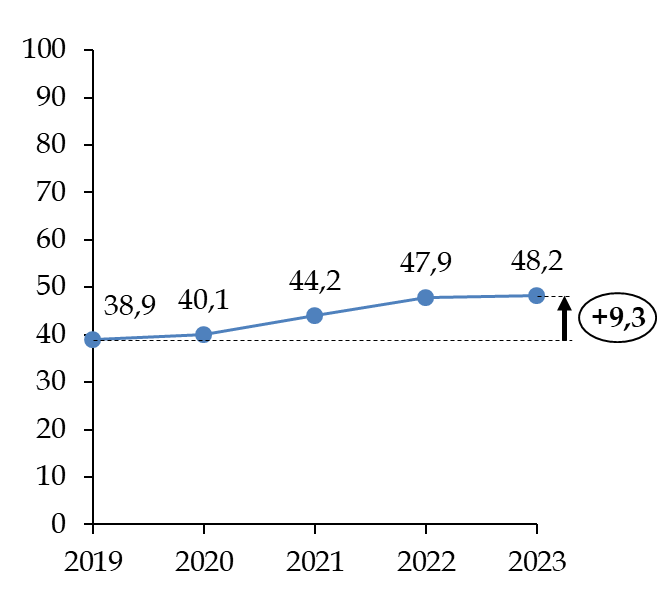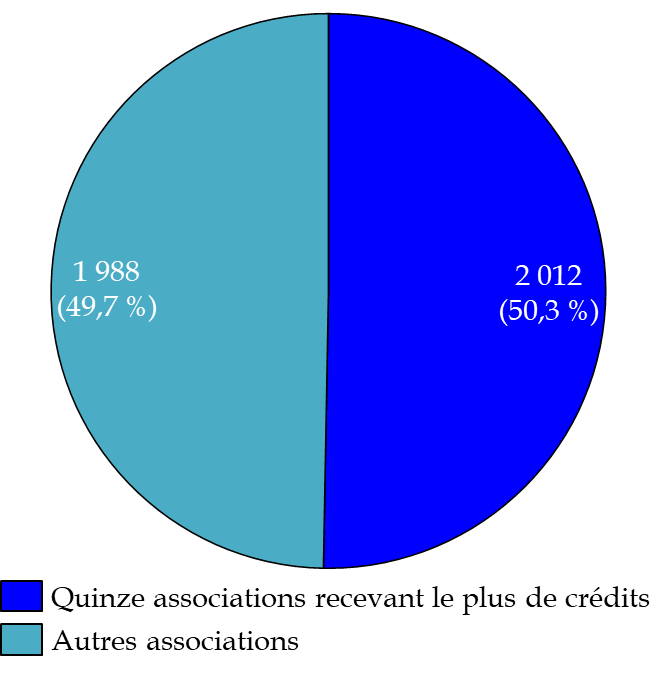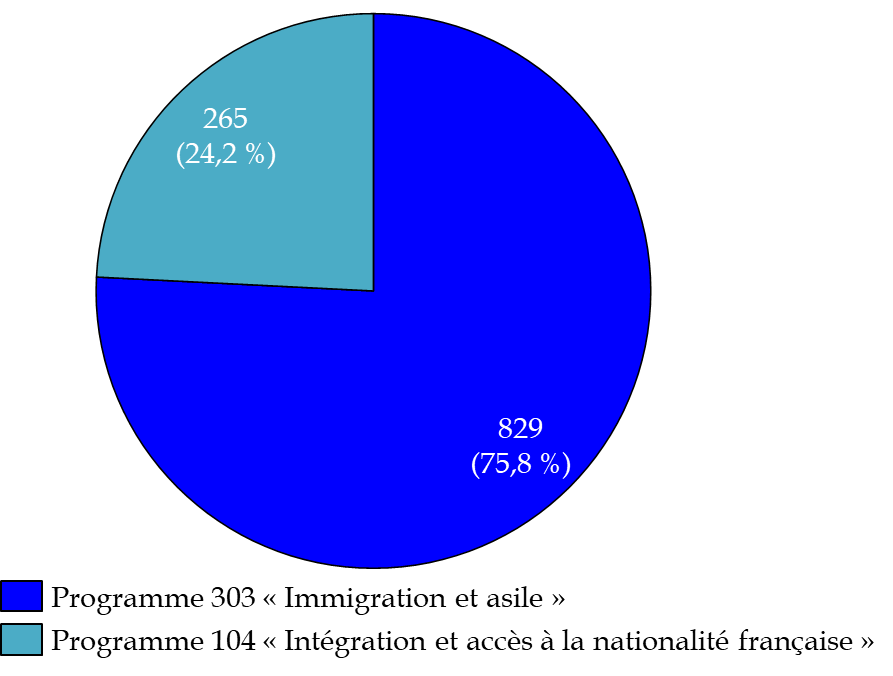- AVANT-PROPOS
- LES PRINCIPALES OBSERVATIONS
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL
- I. LA MISE EN oeUVRE DES POLITIQUES D'ASILE ET
D'INTÉGRATION S'APPUIE LARGEMENT SUR LES ASSOCIATIONS, POUR UN
COÛT SIGNIFICATIF ET EN FORTE HAUSSE
- A. LES ASSOCIATIONS SE VOIENT CONFIER UNE PART
SIGNIFICATIVE DE L'EXÉCUTION MATÉRIELLE DES POLITIQUES D'ASILE ET
D'INTÉGRATION...
- B. ...POUR UN COÛT DE PLUS
D'UN MILLIARD D'EUROS PAR AN, EN HAUSSE DE PLUS DE MOITIÉ
ENTRE 2019 ET 2023
- 1. Les crédits de la mission versés
aux associations, en nette augmentation, représentent aujourd'hui au
total plus d'un milliard d'euros par an
- 2. Des crédits versés à un
nombre élevé d'associations, tandis qu'une petite proportion
d'entre elles en représente la moitié
- 3. Si le poids de l'asile reste
prépondérant, la progression du montant des crédits
octroyés aux associations concerne la quasi-totalité des missions
qui leur sont confiées
- 1. Les crédits de la mission versés
aux associations, en nette augmentation, représentent aujourd'hui au
total plus d'un milliard d'euros par an
- C. UNE AUGMENTATION BUDGÉTAIRE
EXPLIQUÉE PAR UNE PROGRESSION DU NOMBRE DES PUBLICS
BÉNÉFICIAIRES MAIS ÉGALEMENT PAR DES HAUSSES DES
COÛTS UNITAIRES
- 1. Un nombre de publics bénéficiaires
en progression notable
- 2. Une nette augmentation des coûts unitaires
des prestations réalisées par les associations
- a) Une forte hausse des coûts unitaires des
formations du CIR liée à une augmentation de leur volume et de
leur intensité et à la mise en place de nouvelles
prestations
- b) Une augmentation notable des coûts
unitaires des prestations d'accompagnement des demandeurs d'asile et des
réfugiés hébergés
- c) Une hausse du coût de l'assistance
juridique des personnes retenues, en dépit d'une baisse de leur
nombre
- a) Une forte hausse des coûts unitaires des
formations du CIR liée à une augmentation de leur volume et de
leur intensité et à la mise en place de nouvelles
prestations
- 1. Un nombre de publics bénéficiaires
en progression notable
- A. LES ASSOCIATIONS SE VOIENT CONFIER UNE PART
SIGNIFICATIVE DE L'EXÉCUTION MATÉRIELLE DES POLITIQUES D'ASILE ET
D'INTÉGRATION...
- II. DES ENJEUX DE DÉFINITION, DE
COORDINATION ET DE CONTRÔLE DE PLUSIEURS MISSIONS CONFIÉES AUX
ASSOCIATIONS
- A. DES ÉCUEILS TENANT À LA
DÉFINITION ET À LA COORDINATION DE CERTAINES ACTIONS
EXÉCUTÉES PAR LES ASSOCIATIONS
- 1. En matière d'intégration, un
besoin d'une plus grande coordination dans l'attribution de missions aux
associations
- 2. En matière d'asile, la
nécessité d'une meilleure définition des missions
d'accompagnement des demandeurs
- a) L'hébergement et l'accompagnement des
demandeurs d'asile hébergés : pour une vision
stratégique de long terme et une plus grande prise en compte de
l'accompagnement
- b) L'accompagnement des demandeurs d'asile et des
réfugiés non hébergés : un pilotage peu
développé et des imprécisions concernant les
compétences requises
- a) L'hébergement et l'accompagnement des
demandeurs d'asile hébergés : pour une vision
stratégique de long terme et une plus grande prise en compte de
l'accompagnement
- 1. En matière d'intégration, un
besoin d'une plus grande coordination dans l'attribution de missions aux
associations
- B. UN NIVEAU DE CONTRÔLE INÉGAL,
À RENFORCER, EN PARTICULIER DANS LE DOMAINE DE L'ASILE
- A. DES ÉCUEILS TENANT À LA
DÉFINITION ET À LA COORDINATION DE CERTAINES ACTIONS
EXÉCUTÉES PAR LES ASSOCIATIONS
- III. DANS UN CONTEXTE DE FORTE PRESSION MIGRATOIRE
ET DE MOYENS BUDGÉTAIRES CONTRAINTS, LE POIDS DES CRÉDITS
VERSÉS AUX ASSOCIATIONS DOIT ÊTRE QUESTIONNÉ
- A. UN RECOURS AUX ASSOCIATIONS QUI INTERROGE AU
REGARD DE SON EFFICIENCE ET DE SA LÉGITIMITÉ DANS CERTAINS
DOMAINES
- B. FACE À LA HAUSSE DES FLUX MIGRATOIRES ET
DU MONTANT DES CRÉDITS VERSÉS AUX ASSOCIATIONS AINSI QU'AUX
ÉVOLUTIONS DU DROIT APPLICABLE, DES CHOIX DOIVENT ÊTRE
OPÉRÉS DANS LES MISSIONS CONFIÉES AUX ASSOCIATIONS
- A. UN RECOURS AUX ASSOCIATIONS QUI INTERROGE AU
REGARD DE SON EFFICIENCE ET DE SA LÉGITIMITÉ DANS CERTAINS
DOMAINES
- I. LA MISE EN oeUVRE DES POLITIQUES D'ASILE ET
D'INTÉGRATION S'APPUIE LARGEMENT SUR LES ASSOCIATIONS, POUR UN
COÛT SIGNIFICATIF ET EN FORTE HAUSSE
- TRAVAUX DE LA COMMISSION :
AUDITION POUR SUITE À DONNER
- ANNEXE :
COMMUNICATION DE LA COUR DES COMPTES
À LA COMMISSION DES FINANCES
N° 326
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 février 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des finances (1) pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes, transmise en application de l'article 58-2° de la LOLF, sur les missions, le financement et le contrôle par l'État des associations intervenant au titre de la politique d'immigration et d'intégration,
Par Mme Marie-Carole CIUNTU,
Sénatrice
(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
La commission des finances du Sénat a demandé à la Cour des comptes, par un courrier daté du 9 février 2024, la réalisation d'une enquête sur les missions, le financement et le contrôle par l'État des associations intervenant au titre de la politique d'immigration et d'intégration, en vertu du 2° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (Lolf).
Ce sujet fait l'objet depuis plusieurs années d'une vigilance du Sénat, et en particulier de la commission des finances, face au montant élevé des crédits qui leur sont octroyés, et de débats quant à leur rôle et à leur contrôle. Il importait donc de disposer de chiffres et données fiables. L'étude de la Cour des comptes s'inscrit dans ce cadre.
Les associations se voient confier, au sein de la mission « Immigration, asile et intégration » (mission « IAI »), un spectre large de missions relevant de ces politiques. Celles-ci tiennent notamment à l'hébergement et à l'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés vulnérables, à l'assistance juridique des personnes retenues dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière, et aux actions d'intégration des étrangers primo-arrivants, notamment en ce qui concerne les formations linguistiques et civiques.
Reflet de l'étendue de ces missions, le montant des crédits versés aux associations par l'intermédiaire de la mission « IAI » dépasse aujourd'hui 1 milliard d'euros par an. Cette dernière figure ainsi en cinquième position dans le classement de celles octroyant le plus de fonds aux associations, en valeur absolue. En outre, et surtout, elle leur consacre une part très significative - près de la moitié - de l'ensemble des crédits ouverts. Enfin, les montants concernés tendent à augmenter très fortement : ils ont crû de plus de moitié entre 2019 et 2023.
Or, la place centrale accordée aux associations n'est pas toujours associée à un niveau de contrôle et d'évaluation suffisants. Si, pour certaines missions, l'intensité et les modalités du contrôle apparaissent satisfaisantes, ce n'est pas le cas s'agissant notamment de l'hébergement1(*) et de l'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés vulnérables ou encore des crédits déconcentrés destinés à des actions d'intégration des publics étrangers. Aussi, les actions financées sont parfois trop peu coordonnées, pouvant générer des doublons, en particulier en matière de formation linguistique. Enfin, l'évaluation des résultats obtenus, qui a le mérite d'exister pour plusieurs séries de missions, est encore trop peu développée.
Plus largement, ces différents constats doivent être interprétés dans le double cadre du niveau très élevé de pression migratoire, ainsi que du contexte budgétaire fortement contraint. En effet, la hausse des crédits octroyés aux associations doit notamment être analysée à l'aune de l'augmentation des flux entrants de publics étrangers, ainsi que de la progression des coûts unitaires des prestations. Elle doit l'être également désormais, depuis 2024 - et donc postérieurement à la période sous revue de l'enquête, à savoir de 2019 à 2023 -, au regard de la nette baisse des crédits de la mission, qui implique de faire des choix. Certains ont d'ores et déjà été mis en oeuvre, tandis que d'autres devront encore être réalisés.
L'ensemble de ces éléments devront inviter à réfléchir à la pertinence des actions confiées aux associations par l'État et financées comme telles.
Pour donner suite à la remise de cette enquête, la commission des finances a organisé, le 11 février 2025, une audition réunissant Mme Sophie Thibault, présidente de la cinquième chambre de la Cour des comptes, et MM. Arnaud Oseredczuk, président de section au sein de la même chambre, Éric Jalon, directeur général des étrangers en France, Didier Leschi, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et Arnaud Richard, directeur général de l'association Coallia.
LES PRINCIPALES OBSERVATIONS
DU RAPPORTEUR
SPÉCIAL
I. LA MISE EN oeUVRE DES POLITIQUES D'ASILE ET D'INTÉGRATION S'APPUIE LARGEMENT SUR LES ASSOCIATIONS, POUR UN COÛT SIGNIFICATIF ET EN FORTE HAUSSE
A. LES ASSOCIATIONS SE VOIENT CONFIER UNE PART SIGNIFICATIVE DE L'EXÉCUTION MATÉRIELLE DES POLITIQUES D'ASILE ET D'INTÉGRATION...
Les politiques d'immigration, d'asile et d'intégration sont conduites par l'État et sont pilotées par la direction générale des étrangers en France (DGEF). La mise en oeuvre de ces politiques est toutefois largement confiée à des prestataires extérieurs, au premier rang desquels les associations. Les crédits versés à ces dernières atteignent ainsi aujourd'hui un montant total très élevé et en nette progression ces dernières années.
1. Les politiques d'immigration, d'asile et d'intégration sont pilotées par la DGEF, qui s'appuie sur ses opérateurs et les services déconcentrés...
La DGEF, rattachée au ministère de l'Intérieur, assure le pilotage des politiques d'immigration, d'asile et d'intégration, ainsi que des crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » (mission « IAI »), aux échelles nationale et déconcentrée.
Elle s'appuie, pour ce faire, sur ses services mais également sur l'implication des services déconcentrés de l'État, au sein des préfectures. Les préfets, et les services qui en dépendent, sont ainsi chargés d'une mission de coordination des actions déployées dans le département. En outre, ils disposent de crédits déconcentrés de la mission pour ce qui concerne certaines actions d'intégration des étrangers2(*).
En outre, la DGEF peut s'appuyer sur deux opérateurs qui lui sont rattachés :
- d'une part, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), placé sous la tutelle de la DGEF, qui est principalement en charge des missions d'accueil et d'intégration des étrangers dans le cadre de leur installation durable en France. À ce titre, il assure notamment, pour ce qui relève du présent rapport, le premier accueil et l'accompagnement des demandeurs d'asile, d'un côté, et l'intégration des étrangers primo-arrivants autorisés à séjourner durablement en France et signataires à ce titre d'un contrat d'intégration républicaine (CIR), de l'autre ;
Les formations civiques et linguistiques des étrangers primo-arrivants dans le cadre du CIR
Le contrat d'intégration républicaine (CIR) constitue la matérialisation du parcours personnalisé d'intégration républicaine de nombreux étrangers primo-arrivants et prévoit un dispositif de formation linguistique et civique.
Néanmoins, comme le rapporteur spécial l'a récemment développé dans un rapport de contrôle3(*) sur le sujet, jusqu'ici, les formations n'ont reposé sur aucune obligation de résultats. L'étranger signataire d'un CIR n'est ainsi soumis à aucune condition d'acquisition de la langue ou d'assimilation des notions dispensées dans le cadre de la formation civique. Seuls l'assiduité et le sérieux des signataires sont pris en compte pour l'octroi ultérieur d'un titre de séjour pluriannuel. En outre, le niveau élémentaire A14(*) visé ne permet pas une réelle intégration, tandis que la formation civique est excessivement théorique et condensée et par ailleurs mal articulée avec la formation linguistique.
En dépit de moyens budgétaires croissants, les résultats obtenus à l'issue de ces formations apparaissaient décevants. Seulement 68 % des personnes orientées en formation linguistique ont atteint ce niveau en 2023, soit une baisse de neuf points par rapport aux résultats obtenus en 2021.
La loi CIAI du 26 janvier 2024, qui entrera en vigueur sur ce point une fois un décret d'application publié et au plus tard au 1er janvier 2026, a opéré des changements visant principalement à adopter une logique d'obligation de résultats, d'une part, et à exiger un niveau linguistique plus élevé, d'autre part5(*).
Source : commission des finances.
- d'autre part, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), compétent pour instruire les demandes d'asile, mais dont les activités présentent néanmoins très peu de liens avec celles confiées aux associations.
2. ...mais sont principalement mises en oeuvre par des associations en matière d'asile et d'intégration
La politique d'immigration s'appuie de façon relativement marginale sur les associations, qu'il s'agisse de la politique de délivrance de visas et de titres de séjour, ou en matière de naturalisation et de lutte contre l'immigration irrégulière. Il convient néanmoins de noter, comme le rappelle la Cour, que l'assistance juridique dans les centres de rétention administrative (CRA) est confiée, en l'état du droit6(*), à des associations par un marché public. En outre, le rapporteur spécial rappelle que les associations sont également mobilisées dans le cadre du parc de places d'hébergement en dispositif de préparation au retour volontaire7(*).
À l'inverse, ainsi que le souligne l'enquête, les politiques d'intégration et a fortiori d'asile portées par la mission « IAI » voient leur mise en oeuvre matérielle être largement confiée à des prestataires extérieurs.
L'État conclut ainsi des marchés et des conventions, ou lance des appels à projets auprès de différents types d'acteurs, et en particulier des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises et des associations.
Les associations jouent, parmi ces prestataires, un rôle prépondérant. Il convient d'ailleurs de distinguer, au sein des actions des associations concernées, celles confiées par l'État et financées comme telles, et celles résultant de leur propre initiative - même si celles-ci peuvent également présenter un caractère d'intérêt général. L'objet de l'enquête de la Cour et du présent rapport porte sur les premières, dans le cadre desquelles l'État mobilise les associations comme des quasi-opérateurs, pour des missions pour lesquelles il ne dispose pas toujours de la compétence en interne, notamment en matière d'hébergement des demandeurs d'asile.
Selon la Cour, en 2023, les associations étaient ainsi notamment bénéficiaires de 57,8 % des crédits des marchés du CIR, tandis qu'elles représentaient 73 % des gestionnaires de structures d'hébergement et 100 % des opérateurs de structures de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA8(*)).
Concrètement, les missions confiées aux associations diffèrent selon la nature des publics étrangers. Il s'agit principalement de l'hébergement et de l'accompagnement des demandeurs d'asile, de l'intégration des étrangers primo-arrivants, y compris des réfugiés, et de l'assistance juridique aux personnes retenues dans les CRA.
a) L'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile
Les demandeurs d'asile disposent principalement, outre le bénéfice de l'ADA, d'une place en centre d'hébergement (dans la limite des places disponibles) et d'un accompagnement social et administratif.
L'accompagnement social des demandeurs d'asile
pendant l'instruction de leur demande
Source : présente enquête de la Cour des comptes
Cet accompagnement consiste en une aide au dépôt de leur demande par les associations gestionnaires de leur centre d'hébergement (aide à l'élaboration du dossier de demande, appui à la traduction du récit, aide dans les démarches auprès de la préfecture pour le renouvellement de l'attestation de la demande d'asile, etc.), ou, lorsqu'ils ne sont pas hébergés, par les SPADA ou enfin, pour ce qui concerne les seuls réfugiés, le programme Agir9(*). L'accompagnement peut également concerner l'accès à leurs droits, notamment en matière de santé ou de scolarisation de leurs enfants mineurs.
b) L'intégration des étrangers primo-arrivants, y compris des réfugiés
Les étrangers primo-arrivants qui souhaitent s'installer durablement sur le territoire - dont les réfugiés -, bénéficient d'actions d'intégration dans la société, en particulier des formations civiques et linguistiques dans le cadre du CIR géré par l'OFII. À ce jour, pour les personnes ne disposant pas du niveau A110(*) en langue française, le prestataire de formation met en oeuvre l'un des quatre parcours visant à l'acquisition de ce niveau, pour ce qui concerne le CIR (de 100 à 600 heures de formations).
Outre le CIR, sont également ouvertes aux étrangers primo-arrivants des actions d'intégration financées par les services déconcentrés de l'État. Ces derniers financent une grande variété d'actions, allant de l'accompagnement généraliste à l'insertion par le sport ou la culture. Quatre thématiques d'intervention dominent cependant : apprentissage de la langue, appropriation des valeurs de République, accompagnement vers l'emploi et accompagnement global.
Au sein des étrangers primo-arrivants, les réfugiés bénéficient quant à eux, en raison de leur vulnérabilité et de leur plus grande difficulté d'insertion, d'actions d'intégration renforcées, notamment pour l'accès au logement et à l'emploi11(*).
c) L'assistance juridique aux personnes retenues dans les centres de rétention administrative
Les personnes en situation irrégulière peuvent être retenues dans des centres de rétention administrative (CRA), préalablement à leur départ du territoire national.
Ces personnes peuvent alors avoir accès à une assistance juridique, uniquement réalisée par des associations. En effet, comme le rappelle l'enquête, conformément au droit applicable, l'étranger maintenu en rétention bénéficie d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de ses droits et préparer son départ12(*). Plus précisément, l'article R. 744-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. À cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. »
C'est sur cette base qu'un marché est conclu avec des associations. Ce marché précise que les actions réalisées par le titulaire incluent, à l'initiative du retenu, l'analyse juridique de la situation, le conseil et l'orientation vers les démarches adaptées, l'aide à la rédaction des demandes auprès des autorités administratives et judiciaires compétentes et la mise en relation avec un avocat.
Pour le marché couvrant la période 2021 à 2024, quatre candidats (soit un de moins que pour le marché précédent) avaient présenté une offre et avaient été retenus : la Cimade, le groupe SOS Solidarités, Forum réfugiés - Cosi et France Terre d'Asile.
B. ...POUR UN COÛT DE PLUS D'UN MILLIARD D'EUROS PAR AN, EN HAUSSE DE PLUS DE MOITIÉ ENTRE 2019 ET 2023
La forte implication des associations dans la mise en oeuvre des politiques se traduit mécaniquement dans le montant significatif des crédits qui leur sont versés à ce titre par la mission « IAI ». Ce montant, qui n'intègre pas d'éventuels financements publics d'autres natures (autres missions budgétaires, collectivités territoriales, etc.) tend en outre à augmenter fortement sur la période sous revue de l'enquête de la Cour.
1. Les crédits de la mission versés aux associations, en nette augmentation, représentent aujourd'hui au total plus d'un milliard d'euros par an
D'un point de vue budgétaire, la mission « IAI » est composée de deux programmes :
- le programme 303 « Immigration et asile », qui regroupe principalement, pour ce qui concerne le présent rapport, les dépenses liées à la garantie du droit d'asile (hébergement, accompagnement, allocation pour demandeur d'asile), y compris la subvention à l'OFPRA, et à la lutte contre l'immigration irrégulière ;
- le programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française », qui rassemble principalement les crédits en faveur de l'intégration des étrangers en situation régulière, notamment à travers le financement des actions du CIR opérées par l'OFII (action n° 11) et de celles des services déconcentrés (action n° 12).
En 2023, dernière année de la période sous revue de l'enquête, le budget exécuté de la mission était de 2,268 milliards d'euros en crédits de paiement (CP), dont 1,732 milliard d'euros au titre du programme 303 et 536 millions d'euros pour le programme 104. Il convient néanmoins de noter que les dépenses de l'État induites par l'immigration ne se limitent toutefois pas à cette mission budgétaire. En effet, le rapporteur spécial rappelle que le coût estimé de la politique française de l'immigration et de l'intégration était de 7,46 milliards d'euros en 2023 et serait de 7,74 milliards d'euros en 202513(*).
En 2023, selon les données de la Cour, 1,094 milliard d'euros ont été versés aux associations par le biais de la mission « IAI », en hausse de plus de moitié (+ 52,7 %) par rapport à 2019 (soit 716,3 millions d'euros cette année-là), alors que le montant total des crédits exécutés de la mission n'a progressé que dans une bien moins grande mesure sur la même période (+ 23,3 %). La hausse des crédits octroyés aux associations atteint ainsi près de 380 millions d'euros en termes absolus en quatre ans14(*).
Selon une extrapolation des données de l'enquête, les crédits versés aux associations représentent ainsi près de la moitié (48,2 %) de ceux consommés pour cette même mission en 2023. C'est près de 10 points de plus qu'en 2019 (38,9 %).
Évolution du rapport entre les crédits versés aux associations via la mission « IAI » et le total des crédits consommés pour cette mission entre 2019 et 2023
(en pourcentage)
Source : commission des finances d'après les données de l'enquête de la Cour
Hors subvention à l'OFII et à l'OFPRA et dépenses contraintes relatives à l'allocation aux demandeurs d'asile (ADA), plus de deux tiers des crédits consommés (66,9 %) ont même été versés aux associations en 2023. Pour le programme 104, hors subvention à l'OFII, les dépenses réalisées par des associations représentent 72,7 % des dépenses du programme. Pour le programme 303, sans la subvention à l'OFPRA et l'ADA, ce taux atteint 65,6 %.
En définitive, il apparaît ainsi que le poids des crédits octroyés aux associations dans l'exécution budgétaire de la mission « IAI » est doublement singulier. D'une part, il est très significatif en termes absolus, puisqu'en 2022, seules quatre missions consacraient plus de crédits aux associations15(*) : Cohésion des territoires (2,247 milliards d'euros), Enseignement scolaire (1,295 milliard d'euros), Travail et emploi (1,154 milliard d'euros) et Justice (1,027 milliard d'euros). D'autre part, et surtout, ces crédits représentent une part très importante en proportion des crédits totaux consommés.
2. Des crédits versés à un nombre élevé d'associations, tandis qu'une petite proportion d'entre elles en représente la moitié
Si l'enquête n'approfondit pas cet aspect, il convient de remarquer que le nombre d'associations bénéficiaires des crédits de la mission « IAI » est élevé. Certaines d'entre elles se voient d'ailleurs confier de très petits montants. Selon les informations recueillies par le rapporteur spécial16(*), 1 472 associations avaient ainsi bénéficié de crédits versés par la mission en 2022 : 383 associations avaient été financées au titre de l'asile et 1 252 à celui de l'intégration, certaines s'étant vu verser des crédits au titre des deux.
L'enquête souligne toutefois une relative concentration des crédits versés aux associations par la mission « IAI » sur un nombre assez réduit d'entre elles. Les quinze associations ayant bénéficié le plus des crédits de la mission « IAI » entre 2019 et 2023 représentent 46 % du total des crédits octroyés aux associations par le programme 104 (365,1 millions d'euros sur 793,6 millions d'euros sur la période) et 51,3 % du total pour le programme 303 (1 646,4 millions d'euros sur 3 206,2 millions d'euros). Au total, il est possible d'en déduire que sur la période 2019-2023, la moitié en moyenne (50,3 %) des crédits des deux programmes de la mission « IAI » dédiés aux associations ont été versés à quinze d'entre elles.
Répartition des crédits versés aux associations par la mission « IAI »
(en millions d'euros et en pourcentage)
Source : commission des finances d'après les données de l'enquête de la Cour
Selon une extrapolation des données de la Cour, sur la période, les cinq associations ayant bénéficié des sommes les plus importantes sont Coallia (115 millions d'euros par an en moyenne), France Terre d'Asile (57,5 millions d'euros par an en moyenne), la Croix-Rouge française (40 millions d'euros par an en moyenne), le groupe Sos Solidarités (31,5 millions d'euros par an en moyenne) et Forum réfugiés (26 millions d'euros par an en moyenne). Dans tous les cas, les financements proviennent très majoritairement du programme 303, et plus précisément des actions en lien avec l'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile.
3. Si le poids de l'asile reste prépondérant, la progression du montant des crédits octroyés aux associations concerne la quasi-totalité des missions qui leur sont confiées
D'un point de vue financier, ce sont l'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile (programme 303) qui impliquent le plus les associations, davantage que les actions d'intégration (programme 104) et a fortiori d'assistance juridique des personnes retenues en CRA (programme 303).
Ainsi, selon une extrapolation des données de l'enquête, les crédits versés aux associations le sont pour plus de trois quarts via le programme 303 (75,8 %, soit 829 millions d'euros), tandis que la part du programme 104 est plus réduite, bien que loin d'être négligeable (24,2 %, soit 265 millions d'euros).
Montant des crédits versés aux associations par la mission « IAI »,
ventilé par programmes
(en millions d'euros et en pourcentage)
Source : commission des finances d'après les données de l'enquête de la Cour
Mais si les dépenses en lien avec la politique d'asile restent prépondérantes, la quasi-totalité des missions confiées aux associations ont connu une nette hausse de leur coût entre 2019 et 2023.
a) L'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile
Selon l'enquête, en cumulé, toutes sources de financement confondues de la mission « IAI », les crédits versés aux associations au titre de l'hébergement et de l'accompagnement des demandeurs d'asile - et des réfugiés vulnérables - hébergés représentaient 850 millions d'euros en 2023. Au sein de cette somme, selon une estimation de la Cour, 264 millions d'euros environ sont consacrés aux prestations d'accompagnement, même si cette dépense n'est pas isolée au sein des financements pour l'hébergement des bénéficiaires17(*). Il peut en être déduit qu'environ 587 millions d'euros sont consacrés à l'hébergement en lui-même.
L'enquête, dont le périmètre n'incluait pas l'hébergement, souligne que le coût de l'accompagnement dans les structures d'hébergement gérées par des associations a augmenté de 45,5 % entre 2019 et 2023, passant de 181,2 millions d'euros à 263,8 millions d'euros.
Pour ce qui concerne l'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés non hébergés, le marché 2022-2024 géré par l'OFII des SPADA s'élevait, en prévision, à 104,2 millions d'euros, soit une progression de 26,3 % par rapport au montant exécuté dans le cadre du marché précédent, correspondant à 82,5 millions d'euros.
b) L'intégration des étrangers primo-arrivants, y compris des réfugiés
Si d'un point de vue budgétaire, les actions d'intégration impliquent moins fortement les associations que l'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile, elles les concernent néanmoins de façon substantielle.
C'est en particulier le cas pour les formations linguistiques18(*) et civiques dans le cadre du CIR géré par l'OFII (action n° 11 du programme 104). Les financements des associations afférents ont en effet plus que doublé entre 2019 et 2023, passant de 35,6 millions d'euros en 2019 à 76,3 millions d'euros en 2023 (+ 114 %).
S'agissant des crédits des services déconcentrés de l'État dédiés à l'intégration des étrangers primo-arrivants (action n° 12 du même programme), ils représentent une part non négligeable et croissante des dépenses consacrées à l'accueil et à l'intégration des réfugiés. La dynamique de ces crédits déconcentrés est en outre sensible : hors programme Agir, la progression est de 76,8 % sur la période de 2019 à 2023. Or, la très grande majorité de ces actions est portée par des associations (87 % en 2022). Néanmoins, les évolutions budgétaires récentes induisent désormais une forte baisse de ces crédits19(*).
c) L'assistance juridique aux personnes retenues dans les centres de rétention administrative
Les dépenses liées à l'assistance juridique des personnes retenues en CRA, qui est réalisée par des associations, correspondent au marché conclu à cet effet. Pour la période de 2021 à 2024, le coût est de 6,3 millions d'euros, soit un coût supérieur de 28,6 % à la période de 2017 à 2020.
C. UNE AUGMENTATION BUDGÉTAIRE EXPLIQUÉE PAR UNE PROGRESSION DU NOMBRE DES PUBLICS BÉNÉFICIAIRES MAIS ÉGALEMENT PAR DES HAUSSES DES COÛTS UNITAIRES
En cohérence avec la hausse de la pression migratoire, l'une des explications de la progression du montant des crédits versés aux associations tient dans l'élargissement des publics bénéficiaires des actions financées. Néanmoins, il apparaît à la lumière de l'enquête que la hausse des coûts unitaires joue également un rôle important, même en excluant les effets de l'inflation.
1. Un nombre de publics bénéficiaires en progression notable
Selon l'enquête, entre 2019 et 2023, le nombre de bénéficiaires des dispositifs déployés en lien avec l'asile et l'intégration a progressé.
Ainsi, le nombre de demandes d'asile déposées à l'Ofpra a crû de + 7,4 % (142 649 demandes présentées en 2023)20(*), tandis que, parallèlement, le nombre de bénéficiaires de la protection internationale (réfugiés et personnes ayant obtenu la protection subsidiaire) a augmenté de 30 % (60 892 nouveaux bénéficiaires en 2023). Dans le même temps, le nombre de signataires du CIR a augmenté de 18,9 % (127 876 signataires en 2023).
Cette tendance nette produit, à prestations constantes, un effet mécanique à la hausse sur le coût de ces dernières et donc sur les crédits de la mission qui les financent.
2. Une nette augmentation des coûts unitaires des prestations réalisées par les associations
Néanmoins, comme le montre l'enquête, l'intensité de la hausse des crédits versés aux associations ne s'explique pas par la seule progression des flux des publics bénéficiaires. S'y ajoutent en effet différents facteurs qui conduisent à une croissance des coûts unitaires, parmi lesquels : une évolution du profil des publics bénéficiaires, une hausse de l'intensité de l'accompagnement, la mise en place de nouvelles prestations ou encore un manque de concurrence entre prestataires sur certains territoires.
a) Une forte hausse des coûts unitaires des formations du CIR liée à une augmentation de leur volume et de leur intensité et à la mise en place de nouvelles prestations
S'agissant du CIR, la hausse des coûts unitaires résulterait ainsi, selon l'enquête, de plusieurs effets :
- un effet « volume » lié non seulement à l'augmentation du nombre de signataires du CIR mais également à l'évolution de leur profil. En effet, sur la période de 2019 à 2023, l'augmentation de la part des réfugiés dans les bénéficiaires et, parmi eux, de la part de personnes non scolarisées dans leur pays d'origine, a participé à la hausse du nombre de parcours linguistiques de longue durée, les plus coûteux ;
- un effet « intensité de la formation » lié à l'augmentation du nombre d'heures de formation. En effet, à partir de 2019, le nombre d'heures des formations linguistiques et des modules de formation civique a été doublé ;
- un effet « nouvelles prestations ». En effet, à partir de 2022, ont été mis en place de nouveaux marchés pour la réalisation des missions de positionnement linguistique, afin d'évaluer le niveau de langue des signataires.
Ainsi, selon l'enquête, les coûts par signataire ont augmenté de 68 % de 2019 à 2023. En revanche, la Cour constate une absence d'effet « prix », le coût par heure et par stagiaire étant globalement stable, en dépit de disparités géographiques qui résultent surtout des difficultés rencontrées par l'OFII pour susciter de la concurrence dans certaines régions.
b) Une augmentation notable des coûts unitaires des prestations d'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés hébergés
S'agissant de l'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés hébergés, la Cour constate qu'alors que les dépenses ont progressé de 45,5 % entre 2019 et 2023, l'augmentation du nombre de places d'hébergement dans tous les centres (qu'ils soient ou non sous statut associatif), a été limitée sur la même période à 14,7 %. La progression des dépenses d'accompagnement a donc été plus rapide que celle des créations de places21(*), témoignant d'une hausse des coûts unitaires.
Pour ce qui concerne l'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés non hébergés, la progression de 26,3 % des coûts du marché 2022-2024 des SPADA interviendrait alors que les flux de demandes d'asile en guichet unique des demandeurs d'asile ont progressé plus modestement, de 4,8 %, entre 2019 et 2023. Comme dans le cadre du CIR, l'OFII attribue cette situation au faible degré de concurrence sur ces marchés entre associations. S'y ajouteraient d'autres motifs, notamment la création de six nouvelles implantations, conduisant à une augmentation de l'offre sur le territoire.
c) Une hausse du coût de l'assistance juridique des personnes retenues, en dépit d'une baisse de leur nombre
La dynamique de hausse des coûts de près de 30 % de l'assistance juridique des personnes retenues en CRA pendant la période sous revue pourrait être due notamment à l'augmentation du nombre de lots du marché, consécutive à la progression du nombre de centres de rétention.
Néanmoins, elle s'opère à contre-courant de l'évolution du nombre de personnes effectivement retenues (de 50 486 à 40 056 retenus par an, entre 2019 et 2023).
II. DES ENJEUX DE DÉFINITION, DE COORDINATION ET DE CONTRÔLE DE PLUSIEURS MISSIONS CONFIÉES AUX ASSOCIATIONS
Dans son enquête, la Cour constate des difficultés tenant à la définition et à la coordination de certaines missions exécutées par les associations. En outre, elle révèle un niveau de contrôle inégal de leur exécution.
A. DES ÉCUEILS TENANT À LA DÉFINITION ET À LA COORDINATION DE CERTAINES ACTIONS EXÉCUTÉES PAR LES ASSOCIATIONS
1. En matière d'intégration, un besoin d'une plus grande coordination dans l'attribution de missions aux associations
Selon la Cour, en matière d'intégration, les prestations offertes dans le cadre du CIR géré par l'OFII (action n° 11 du programme 104) et celles financées par les crédits déconcentrés dans les préfectures (action n° 12 du même programme) « peuvent concerner en partie les mêmes publics, pour les mêmes finalités, faute d'une coordination suffisante entre les services déconcentrés et les directions territoriales de l'OFII ». La question de l'articulation se pose ainsi principalement pour les formations linguistiques, qui représentent une part prépondérante des crédits déconcentrés.
Selon l'enquête, la DGEF met certes en avant le fait que les formations du CIR ne couvrent pas l'ensemble des besoins et que de nombreux primo-arrivants n'en sont pas signataires (étudiants, travailleurs temporaires, passeports talents, étrangers malades, etc.). Elle précise que le niveau A122(*) visé n'est pas atteint par l'intégralité des personnes ayant suivi leur formation CIR (le taux de réussite étant de 68 %) et qu'il est donc utile de proposer de poursuivre une « immersion linguistique », même après la clôture du contrat. En outre, elle indique que près de la moitié des signataires du CIR sont positionnés avec un niveau de langue supérieur à A1 et ne bénéficient pas de l'offre linguistique de l'OFII. Enfin, elle ajoute que les compétences mobilisées et l'ingénierie pédagogique adoptée sont différentes : les formations linguistiques du CIR s'appuieraient sur des parcours précis et une mallette pédagogique détaillée, tandis que les appels à projets sur crédits déconcentrés financeraient majoritairement des « ateliers sociolinguistiques » permettant l'apprentissage de la langue par des mises en situation.
Néanmoins, la Cour estime au final que si certaines formations financées par les crédits déconcentrés peuvent être justifiées lorsqu'elles visent un public non soumis au CIR, le risque de doublon demeure élevé. Comme la Cour, le rapporteur spécial rappelle que la question de l'articulation entre ces actions financées par les préfectures, et celles prises en charge dans le cadre du CIR se posera de manière encore plus aiguë à l'avenir, la nouvelle obligation de résultat posée par le législateur devant conduire l'OFII à redéfinir son offre de formations au titre du CIR23(*).
Il apparaît donc nécessaire que soit conçue une stratégie globale et coordonnée s'agissant des formations linguistiques des étrangers primo-arrivants, qu'elles soient financées dans le cadre du CIR ou par les services déconcentrés de l'État.
2. En matière d'asile, la nécessité d'une meilleure définition des missions d'accompagnement des demandeurs
Dans le cadre de la politique de l'asile, les dispositifs d'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés sont définis au moyen de cahiers des charges et d'appels à projet des structures.
Selon l'enquête, l'État et l'OFII ne définissent pas avec suffisamment de précision la nature des missions d'accompagnement, les compétences requises pour les réaliser et, dans les structures d'hébergement, le taux d'encadrement associé.
a) L'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile hébergés : pour une vision stratégique de long terme et une plus grande prise en compte de l'accompagnement
L'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés vulnérables hébergés, notamment lorsqu'ils sont confiés au secteur associatif, souffre de différents écueils. Ils tiennent principalement aux limites imposées par le système subventionnel pour la définition des prestations attendues, à des différences - pas toujours justifiées - dans les exigences fixées pour des prestations censées être identiques et au caractère insuffisant de la prise en compte spécifique des actions d'accompagnement.
En premier lieu, si la présente enquête n'avait pas pour objet de traiter le sujet de l'hébergement - tout en traitant de celui de l'accompagnement des personnes hébergées -, il convient néanmoins de rappeler que dans son rapport sur Les relations entre l'État et les gestionnaires de structures d'hébergement24(*), notamment associatifs, la Cour a récemment analysé leurs cadres juridiques, et les conséquences sur leur fonctionnement et leur financement.
Le dispositif national d'accueil (DNA25(*)) comprend ainsi des structures d'hébergement avec deux statuts juridiques différents :
- les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), qui sont soumis à un système d'autorisation d'une durée de 15 ans. Au sein du DNA, seuls les centres d'accueil des demandeurs d'asile (CADA, pour les demandeurs d'asile) et les centres provisoires d'hébergement (CPH, pour les réfugiés vulnérables) relèvent de cette catégorie. Ils sont financés sous la forme d'une dotation globale de fonctionnement, et non d'une subvention ;
- toutes les autres structures (notamment les centres d'accueil et d'examen des situations, CAES, et les places d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, HUDA) ressortent de dispositifs dits « d'urgence », quelle que soit la pérennité effective des places ou la durée d'hébergement, et sont financées sous le régime de subventions annuelles.
La Cour a ainsi souligné que le recours à des structures d'hébergement d'urgence offre certes une grande souplesse pour satisfaire les besoins (ouverture rapide de places et engagement seulement annuel), mais « ne permet pas à l'État financeur, ni de définir précisément la nature et le niveau de service attendu, ni de contrôler de près sa mise en oeuvre et donc de s'assurer de sa qualité ». En effet, comme le rappelle la Cour, le régime de la subvention à l'issue d'un appel à projets suppose notamment que le financeur ne soit pas à l'origine du projet, ce qui limite sa capacité à en définir le contenu de manière très précise.
Il apparaît ainsi nécessaire que soit privilégié plus largement, en matière d'hébergement des demandeurs d'asile, le recours à des structures relevant de la catégorie des ESSMS.
Par ailleurs, la difficulté est la même pour ce qui concerne l'accompagnement des publics en centre d'hébergement financé par subvention : l'État n'a ainsi pas la possibilité de définir très précisément ni de suffisamment contrôler la mise en oeuvre des prestations.
En deuxième lieu, la Cour constate que si les prestations d'accompagnement attendues sont identiques dans les différents types d'hébergement, les taux d'encadrement prévus diffèrent, tandis que la qualification des professionnels n'est pas définie précisément dans la plupart des structures, ce qui laisse des marges de manoeuvre importantes aux associations.
En troisième lieu, l'accompagnement des personnes hébergées fait l'objet d'une attention secondaire par rapport aux enjeux d'hébergement eux-mêmes. Ainsi, alors que les orientations nationales sont centrées sur le nombre et la gestion des places d'hébergement (y compris leur disponibilité effective et le taux de présence indue), la question de l'accompagnement y apparaît subsidiaire. Les schémas nationaux, circulaires et comités de pilotage stratégiques se concentrent également en premier lieu sur l'hébergement et relèguent au second plan les thématiques d'accompagnement.
Cet état de fait se reflète du point de vue budgétaire : la dépense d'accompagnement n'est pas chiffrée en tant que telle et est confondue avec la prestation d'hébergement. Le rapporteur spécial estime qu'il s'agit là d'une lacune26(*).
La Cour estime au final qu'il manque « une réflexion explicite sur les tâches attendues, leur contenu et les compétences nécessaires pour les exercer ».
b) L'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés non hébergés : un pilotage peu développé et des imprécisions concernant les compétences requises
Selon l'enquête, encore davantage que pour l'accompagnement des personnes hébergées, le pilotage étatique de l'accompagnement par les SPADA des demandeurs non-hébergés apparaît peu développé. Le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés n'est pas applicable en la matière ; ainsi, seul le contrat d'objectif et de performance signé par l'OFII en traite.
En outre, la Cour constate des imprécisions concernant les compétences requises pour réaliser l'accompagnement social des demandeurs. Si les marchés conclus avec les SPADA décrivent avec précision les publics concernés et les prestations attendues des associations, ils n'évoquent pas les qualifications requises, en particulier pour exercer les missions d'accompagnement social, ni le taux d'encadrement. Les normes d'intervention entre les SPADA et les centres d'hébergement ne sont ainsi pas alignées, « alors même que les publics sont identiques, et que la passation d'un marché permet de définir précisément les attendus en la matière ». En outre, comme pour l'accompagnement en hébergement, il n'existe pas de référentiel des tâches d'accompagnement.
Il apparaît ainsi nécessaire de définir précisément les modalités de l'accompagnement des demandeurs d'asile, qu'ils soient hébergés ou non, et d'isoler le coût budgétaire associé pour ceux qui bénéficient d'un hébergement.
Par ailleurs, s'agissant du programme Agir qui concerne le public spécifique des réfugiés, alors qu'il est en principe exclusif du bénéfice d'autres accompagnements (en CPH ou en SPADA en particulier), il apparaît que, dans un certain nombre de situations, les bénéficiaires continuent à être accompagnés par d'autres dispositifs, ou, à l'inverse, sont en rupture de droits.
B. UN NIVEAU DE CONTRÔLE INÉGAL, À RENFORCER, EN PARTICULIER DANS LE DOMAINE DE L'ASILE
Dans son enquête, la Cour confirme que les contrôles exercés sur les associations dans le cadre des missions qui leur sont confiées par l'État sont diversement exercés, en fonction des types d'actions.
1. Un contrôle satisfaisant en ce qui concerne les prestataires de l'OFII, dans le cadre du CIR et des SPADA
a) Un contrôle satisfaisant des prestataires du CIR...
Pour le contrôle et les audits des prestataires de ses marchés publics dans le cadre du CIR, l'OFII déploie, selon l'enquête, une méthodologie rigoureuse. Elle contrôle ainsi régulièrement ses prestataires, notamment associatifs, soit en amont27(*), soit en aval. 291 contrôles sur place (dits « audits ») ont ainsi eu lieu en 2023.
Selon l'enquête, les contrôles peuvent conduire à relever une proportion significative de situations non conformes, qui donnent toutefois rarement lieu in fine à des sanctions28(*).
b) ...et de ceux des SPADA
De même, l'OFII a mis en oeuvre, selon l'enquête, une démarche rigoureuse d'audits pour ses marchés relatifs aux SPADA.
Il a notamment prévu des obligations en matière de suivi des activités et pour l'organisation d'audits sur place et sur pièces. En cas de manquement, le marché applicable prévoit le versement de pénalités. En 2023, 28 associations ont ainsi été visitées, sur 68 implantations. Les taux de conformité auraient nettement progressé récemment, dans tous les champs d'audit.
2. Un suivi lacunaire des crédits déconcentrés et une activité de contrôle des opérateurs d'hébergement limitée
a) Des crédits déconcentrés dont l'exécution via des associations connaît un suivi insuffisant
Les associations qui bénéficient des crédits d'intégration déconcentrés (action n° 12 du programme 104) ne sont contrôlées qu'occasionnellement.
S'il est rendu compte de l'utilisation de ces crédits dans le cadre d'un plan national d'évaluation et si la DGEF procède à des visites de porteurs de projets associatifs dans le cadre de déplacements en régions, il n'y a pas d'audits des structures, en raison d'autres priorités données aux moyens disponibles en administration centrale comme en service déconcentré, au demeurant parfois très limités dans certaines préfectures.
b) Une activité de contrôle des opérateurs d'hébergement limitée, y compris en matière d'accompagnement des personnes hébergées
L'enquête de la Cour constate que l'activité de contrôle, qui repose sur la vérification des documents administratifs et sur des inspections, apparait limitée s'agissant des opérateurs d'hébergement, notamment associatifs. En outre, il n'existe pas de stratégie nationale en la matière, ni de coordination avec les autres acteurs.
En premier lieu, la capacité à contrôler les structures sur la base des documents administratifs et financiers varie selon leur nature juridique et les conditions de financement de la prestation. En effet, la prestation est d'autant plus difficile à définir précisément qu'elle est financée par subvention29(*). Il est ainsi plus difficile d'assurer un contrôle efficace des CAES et HUDA (régime de la subvention) que des CADA et CPH (régime des ESSMS, et donc de la dotation globale de fonctionnement). Mais, même pour ces derniers, il apparaît que les contrôles ont porté « davantage sur les questions d'hébergement, en particulier sur les taux de présence, que sur le volet de l'accompagnement dans les centres ».
En second lieu, les inspections sur place des différents types d'hébergement souffriraient d'un champ très étendu et de la faiblesse de ses moyens humains, compte tenu du nombre d'établissements à couvrir. Hors évaluations externes30(*), elles sont donc en moyenne contrôlées une fois tous les 14 ans pour les Cada, tous les 75 ans pour les Huda et les CAES, et tous les 35 ans pour les CPH. Une absence de stratégie et de coordination pour le déploiement des dispositifs de contrôle est également relevée.
Il apparaît nécessaire de renforcer le nombre de contrôles sur les opérateurs d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés vulnérables, en y intégrant systématiquement un volet sur l'accompagnement.
3. Un contrôle qui mène de manière trop exceptionnelle à des sanctions
Si l'enquête n'approfondit pas ce point, le rapporteur spécial constate qu'il apparaît que le nombre de sanctions prononcées à l'encontre d'associations pour des manquements dans l'exercice des missions qui leur sont confiées par le biais de la mission est très réduit.
S'agissant des prestataires du CIR, notamment associatifs, l'enquête précise que si les contrôles rigoureux mis en oeuvre peuvent conduire à relever une proportion significative de situations non conformes et qu'il s'en suit une procédure corrective et contradictoire, « ils débouchent rarement sur des pénalités, l'OFII estimant le plus souvent que des mesures correctives ont été appliquées par la suite31(*). »
Concernant les SPADA, des pénalités n'auraient été appliquées aux prestataires associatifs que dans un seul cas, pour une réfaction cumulée d'environ 145 000 euros en raison d'une exécution très partielle des missions confiées par l'OFII.
Pour ce qui concerne l'assistance juridique en CRA, la DGEF n'a fait part, là encore, que d'une seule situation effective de non-paiement à une association, dans le cadre des marchés 2020-202432(*), à savoir une réfaction d'environ 100 000 euros.
Enfin, l'enquête ne mentionne pas de sanctions dans le domaine de l'accompagnement des personnes hébergées. Au demeurant, le rapport sur Les relations entre l'État et les gestionnaires de structures d'hébergement n'en faisait pas état non plus en matière d'hébergement des demandeurs d'asile, même s'il mentionnait le fait qu'il était prévu d'introduire plus largement la possibilité de prononcer des pénalités financières. Si le rapporteur spécial n'est pas en capacité d'établir si une sanction a été ou non prononcée récemment dans ce domaine, il apparaît en tout état de cause que cela relève a minima de cas isolés.
Le rapporteur spécial estime qu'un travail efficace et crédible de contrôle doit impliquer un taux de sanction plus élevé à l'égard des associations qui ne respectent pas le cadre ou les modalités des missions qui leur sont confiées par l'État.
III. DANS UN CONTEXTE DE FORTE PRESSION MIGRATOIRE ET DE MOYENS BUDGÉTAIRES CONTRAINTS, LE POIDS DES CRÉDITS VERSÉS AUX ASSOCIATIONS DOIT ÊTRE QUESTIONNÉ
A. UN RECOURS AUX ASSOCIATIONS QUI INTERROGE AU REGARD DE SON EFFICIENCE ET DE SA LÉGITIMITÉ DANS CERTAINS DOMAINES
1. La nécessité d'évaluer l'efficience des actions menées, y compris à l'aune des modèles étrangers
La Cour rappelle la nécessité pour l'administration de procéder à des évaluations régulières des différentes actions mises en oeuvre. Certes, le suivi des indicateurs de performance relève d'un processus évaluatif, notamment en matière de résultats des formations linguistiques ou encore de taux d'hébergement des demandeurs d'asile.
Néanmoins, il convient d'aller plus loin. D'une part, un suivi plus précis des résultats des actions menées peut être réalisé. À titre d'illustration, les formations civiques ne débouchent pas aujourd'hui sur une certification, ni sur une évaluation quantitative. D'autre part, de véritables évaluations doivent être menées. En effet, si certaines études de nature scientifique ont été produites, s'agissant notamment des effets pluriannuels du CIR sur les signataires, elles doivent être actualisées et leur spectre élargi.
Dans le cadre de l'enquête, la Cour des comptes n'a pas procédé à une évaluation des dispositifs déployés et de l'opportunité de recourir aussi largement aux associations pour leur mise en oeuvre.
Le rapporteur spécial constate que les délais de production de cette enquête rendaient en effet difficile la réalisation d'un tel travail d'évaluation, qui aurait vocation à couvrir l'essentiel des politiques portées par la mission. Toutefois, comme cela a été évoqué lors de l'audition pour suite à donner à la présente enquête33(*), il serait intéressant que la Cour des comptes, si elle le souhaite, complète son enquête par une analyse de l'efficience des missions confiées aux associations. En effet, si la présente enquête permet d'établir que les crédits versés aux associations augmentent nettement, il conviendrait désormais de savoir si les résultats obtenus sont à la hauteur de cette hausse, ce dont le rapporteur spécial n'est pas certain.
En outre, il serait utile de s'interroger sur des modèles alternatifs de mise en oeuvre des politiques de la mission « IAI » qui s'appuieraient moins sur les associations et davantage sur d'autres acteurs, que ce soit l'État lui-même, les collectivités territoriales, des établissements publics ou encore des entreprises. Une telle analyse intégrerait opportunément une dimension comparative internationale. En outre, elle pourrait tirer profit de l'analyse de l'encadrement et de l'action des associations dans le cadre d'autres politiques publiques qui les mobilisent fortement, notamment l'enseignement scolaire, la justice ou le logement.
2. L'exemple de l'assistance juridique des personnes retenues : un recours aux associations qui n'apparaît pas comme une solution indispensable
Parallèlement, il apparaît utile de questionner dès aujourd'hui la pertinence du recours aux associations pour certains types de missions.
C'est notamment le cas s'agissant de l'assistance juridique des personnes retenues en CRA, aujourd'hui déléguée à des associations sélectionnées par des marchés publics34(*).
Le rapporteur spécial considère bien évidemment, s'agissant du principe, que le placement en rétention administrative, qui constitue une mesure privative de liberté, implique nécessairement l'existence d'une assistance juridique. S'agissant ensuite des modalités de cette assistance, celle-ci peut prendre des formes diverses : intervention d'associations, d'avocats ou encore de services de l'OFII.
Le rapporteur spécial s'interroge toutefois sur le fait de déléguer cette mission à des associations. En effet, une partie de celles titulaires des marchés correspondants déploient parfois un discours difficilement compatible avec l'idée même du renvoi de personnes en situation irrégulière. En outre, il est permis de s'interroger sur le fait de savoir si au-delà de leur mission d'aider les personnes retenues à la présentation de recours contentieux, elles ne participent pas à un mouvement de massification des recours, de nature à entraver quelque peu la politique mise en oeuvre. Ainsi que le rappelle pudiquement la Cour, « il n'est pas douteux que les associations remplissent effectivement leurs missions d'assistance juridique, qui ont notamment pour conséquence le dépôt de recours devant les tribunaux, au vu du volume soutenu de ceux-ci. »
Le rapporteur spécial estime que l'assistance juridique devrait être délivrée aux personnes retenues selon d'autres modalités à l'avenir. Une telle évolution serait d'ailleurs l'occasion de prendre en compte le fait que, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a récemment énoncé35(*) que l'aide juridictionnelle36(*), qui couvre notamment les frais d'avocat, était ouverte y compris aux étrangers se trouvant en situation irrégulière en France. Dans ce cadre, le rapporteur spécial considère qu'il serait opportun de confier à l'OFII un rôle d'information sur l'accès au droit des personnes placées ou maintenues en rétention administrative, incluant la possibilité de demander la désignation d'un avocat et le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cette solution permettrait de garantir la protection des droits des personnes retenues, sans nécessiter l'intervention d'associations.
B. FACE À LA HAUSSE DES FLUX MIGRATOIRES ET DU MONTANT DES CRÉDITS VERSÉS AUX ASSOCIATIONS AINSI QU'AUX ÉVOLUTIONS DU DROIT APPLICABLE, DES CHOIX DOIVENT ÊTRE OPÉRÉS DANS LES MISSIONS CONFIÉES AUX ASSOCIATIONS
1. Une nette baisse du budget de la mission depuis 2024, alors que la pression migratoire reste à un niveau très élevé...
La France, tout comme l'Union européenne, connaît une progression continue de la pression migratoire sur les dernières années, s'agissant tant des demandes d'asile que du nombre de titres de séjours et de visas délivrés. En 2023, 142 649 demandes d'asile ont ainsi été introduites à l'OFPRA, soit un record historique. 326 954 titres de séjours avaient en outre été délivrés cette année-là, là encore un niveau très élevé37(*).
En 2024, soit postérieurement à la période sous revue de l'enquête, la pression migratoire est restée forte. Si le nombre de visas octroyés a crû de 16,8 %, surtout, le nombre de titres de séjour délivrés a continué d'augmenter, pour s'établir à 336 710, en hausse de 1,8 %38(*). Par ailleurs, il convient de noter que s'il est attendu une légère baisse du nombre de demandes d'asile présentées devant l'OFPRA en 2024, le Gouvernement prévoit une nouvelle hausse de 5 % en 2025. Le nombre de contrats d'intégration républicaine (CIR) signés en 2024 est quant à lui en baisse par rapport à 2023 (- 10,5 %), mais en raison en particulier de l'interruption des signatures de CIR au mois d'août, compte-tenu du contexte budgétaire ; le niveau de 2024 reste en outre nettement supérieur à celui des années précédentes.
Si l'année 2024 a donc connu des évolutions quelque peu contradictoires, il n'en demeure pas moins qu'elle est marquée par le maintien d'un niveau de pression migratoire très élevé, qui pourrait encore augmenter.
Or, dans le même temps, les crédits de la mission « IAI » (même s'ils ne sont pas les seuls à porter les politiques d'immigration et d'intégration39(*)) ont connu une nette réduction. Ainsi, s'agissant de l'exécution des crédits en 2024, le décret du 21 février 202440(*) a procédé, dans un contexte budgétaire difficile, à une annulation de 174,7 millions d'euros de crédits en autorisations d'engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) à l'échelle de la mission41(*). Surtout, la loi de finances pour 2025 prévoit, une fois les évolutions de périmètre neutralisées42(*), une baisse de plus de 250 millions d'euros des crédits initiaux de la mission par rapport au budget pour 2024, soit près de 12 % en un an.
2. ...qui a déjà impliqué des choix et en exigera d'autres
Cette évolution contradictoire des flux de personnes étrangères et du budget de la mission « IAI » est de nature à produire un effet ciseaux pour les dispositifs qu'elle déploie via des associations. Elle implique donc de faire des choix dans les missions qui leur sont confiées. Certains ont d'ores et déjà été mis en oeuvre, tandis que d'autres devront encore être réalisés.
a) Le recentrage du programme « Agir »
Le déploiement du programme Agir, sous forme de marchés conclus essentiellement avec des associations, s'est effectué lentement, les derniers dispositifs devant recevoir leurs publics début 2025.
Il fait en outre face à de fortes contraintes budgétaires, dans le cadre de l'action n° 12 du programme 104. Cette action finance plusieurs dispositifs d'intégration hors CIR, dont le programme Agir. Après avoir connu une annulation de crédits en 2024, l'action connaît, dans le cadre de la loi de finances pour 2025, une réduction de ses CP de plus de 45 % (- 79 millions d'euros, dont 58 millions d'euros pour le programme Agir destiné aux réfugiés et 21 millions d'euros pour les actions en faveur de l'ensemble des primo-arrivants).
Dans ce contexte, la DGEF a ainsi fait part de nouvelles conditions d'accès au programme à compter de 2024. Ce dernier est désormais recentré sur la prise en charge des réfugiés les plus vulnérables, tandis que les orientations vers le programme sont interrompues dans les départements où il a été déployé depuis 2022 et 2023 et qui ont atteint un certain niveau de bénéficiaires. L'objectif poursuivi est de viser une cible de 25 000 bénéficiaires en moyenne à l'échelle nationale (contre 31 446 bénéficiaires au 31 juillet 2024), sur environ 50 000 réfugiés éligibles sur une année.
Si le rapporteur spécial est attaché à l'intégration des publics étrangers destinés à demeurer sur le territoire national durablement, il constate qu'en cohérence avec une volonté globale de maîtriser le nombre de personnes accueillies à l'avenir et face à des moyens réduits, il est nécessaire de rationaliser les dispositifs et d'apporter un accompagnement de qualité à ceux qui en ont le plus besoin.
b) L'adaptation des formations linguistiques des primo-arrivants à un nouveau cadre juridique, dans un contexte budgétaire contraint
Dans un contexte budgétaire devenu très exigeant, doit être repensée une partie significative du dispositif d'accompagnement des primo-arrivants en matière linguistique, majoritairement assuré par des associations.
En effet, comme le souligne l'enquête, des réflexions sont en cours pour l'adapter au nouveau cadre institué par la loi « CIAI » du 26 janvier 202443(*), qui modifie la logique des conditions de séjour des étrangers en France s'agissant des attendus en matière de maîtrise de la langue. D'une part, elle conditionne désormais la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à l'échéance du parcours du CIR à la connaissance d'un niveau minimal de la langue française, établissant ainsi une obligation de résultats. D'autre part, elle relève le niveau exigé d'A1 à A244(*) pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle, de A2 à B1 pour une carte de résident et de B1 à B2 pour la naturalisation. Elle fait aussi le pari d'une plus forte implication de l'employeur dans la formation linguistique de ses salariés allophones. Par ailleurs, elle rehausse les attendus en matière de formations civiques s'agissant de l'histoire et de la culture françaises et instaure un test civique.
Comme le rappelle l'enquête et ainsi que l'a déjà indiqué le rapporteur spécial, compte tenu des résultats récents en matière de taux d'atteinte du niveau A1 (environ 68 %), les nouvelles exigences au niveau A2 semblent difficiles à atteindre pour une partie des étrangers dans le cadre actuel.
Interrogée par la Cour sur les évolutions possibles des parcours de formation dans le cadre des nouvelles exigences législatives, la DGEF a indiqué que « l'augmentation du nombre d'heures de formation ne fait pas partie des pistes privilégiées, pour deux raisons principales :
- d'un point de vue pédagogique, les forfaits de 600 heures sont très - voire trop longs - au vu de l'absentéisme constaté de la part de certains publics ;
- et eu égard au contexte budgétaire contraint ».
La DGEF et l'OFII étudient donc45(*), selon l'enquête, dans quelle mesure l'offre de formation linguistique, compte tenu du fait qu'elle n'est plus assortie d'une obligation d'assiduité, peut être adaptée aux besoins et aux parcours de différents bénéficiaires.
Le rapporteur spécial considère que l'absence de hausse des crédits de l'action n° 11 en 2025, qui finance notamment les formations civiques et linguistiques dans le cadre du CIR, supposera d'améliorer nettement l'efficience des formations et de s'appuyer davantage sur une contribution des élèves et des entreprises.
Dans ses réponses au questionnaire du rapporteur spécial dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2025, la DGEF indiquait que plusieurs solutions sont envisagées. Il pourrait notamment s'agir de responsabiliser l'apprenant en lui faisant choisir entre se former via les formations de l'OFII ou par d'autres moyens (à sa charge), ou encore de développer l'offre de formation en ligne.
Globalement, il apparaît ainsi nécessaire de redéfinir les modalités des formations linguistiques pour répondre aux nouvelles exigences posées par la loi CIAI pour l'obtention d'une carte de séjour pluriannuelle, en améliorant leur efficacité tout en en maîtrisant le coût pour les finances publiques.
c) D'autres évolutions des missions confiées aux associations seront nécessaires
Face à une pression migratoire très élevée et en progression et des moyens budgétaires en baisse, d'autres dispositifs mis en oeuvre par les associations devront en outre être rationalisés, voire remis en cause.
En matière d'hébergement, le budget pour 2025 porte à ce titre d'ailleurs déjà une volonté de rationalisation de la taille du parc d'hébergement du dispositif national d'accueil (DNA), qui bénéficie aux demandeurs d'asile et aux réfugiés vulnérables, et désormais également aux bénéficiaires de la protection temporaire. En effet 6 500 places seraient ainsi fermées en 2025, alors que 5 000 autres qui n'étaient pas disponibles jusqu'ici le sont désormais, limitant finalement la baisse du nombre de places effectivement disponibles à 1 500, soit environ 1,3 % du parc (113 258 places en 2025).
Le rapporteur spécial considère que ces évolutions doivent être approfondies et élargies à différentes missions confiées aux associations, dans le cadre d'une politique migratoire consistant à davantage maîtriser le nombre de personnes accueillies, à lutter fermement contre l'immigration irrégulière mais également à mieux intégrer - dans un cadre rationalisé - ceux qui ont vocation à rester durablement en France. Il conviendra ainsi d'interroger l'ensemble des dispositifs mis en oeuvre par les associations à l'aune de ces priorités.
TRAVAUX DE LA
COMMISSION :
AUDITION POUR SUITE À DONNER
Réunie le mardi 11 février 2025, sous la présidence de M. Claude Raynal, président, la commission des finances a procédé à l'audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes, réalisée en application de l'article 58-2° de la LOLF, sur les missions, le financement et le contrôle par l'État des associations intervenant au titre de la politique d'immigration et d'intégration.
M. Claude Raynal, président. - Nous procédons cet après-midi à l'audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes, réalisée à la demande de notre commission en application du 2° de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances (Lolf), sur les missions, le financement et le contrôle par l'État des associations intervenant au titre de la politique d'immigration et d'intégration.
Il s'agit d'un sujet que le Sénat a régulièrement eu l'occasion d'évoquer, notamment lors de l'examen des projets de loi de finances ou de textes et débats portant sur l'immigration.
Sur la proposition de Marie-Carole Ciuntu, rapporteur spécial des crédits de la mission « Immigration, asile et intégration », il a ainsi semblé utile à la commission des finances de faire un point global sur le sujet. Il importe en effet que, dans un domaine qui peut être politiquement sensible - cela n'aura échappé à personne -, la commission et le Sénat disposent des constats et de données factuelles de la Cour des comptes.
En outre, si ce n'est pas la seule politique publique qui s'appuie sur les associations pour sa mise en oeuvre concrète, elle est peut-être une de celles qui, en proportion des crédits disponibles, se reposent le plus sur elles. Il s'agit là d'une originalité manifeste de cette mission budgétaire.
Sans trop anticiper la présentation qui nous en sera faite, le rapport d'enquête de la Cour des comptes, après avoir constaté l'ampleur des missions confiées aux associations et la hausse de leur coût, pointe certaines limites du contrôle et de l'évaluation qui y sont associés. Il souligne également la nécessité de mieux définir et coordonner les missions confiées aux associations.
Pour aborder tous ces sujets, nous recevons Mme Sophie Thibault, présidente de la cinquième chambre de la Cour des comptes, et M. Arnaud Oseredczuk, président de section au sein de cette même chambre, lequel nous exposera les conclusions de cette enquête.
Le rapporteur spécial de la mission, Marie-Carole Ciuntu, prendra ensuite la parole pour indiquer les principaux enseignements qu'elle retient de ce travail et pour exposer sa réflexion.
Pour prolonger nos échanges, nous éclairer et répondre aux observations de la Cour et du rapporteur spécial, nous entendrons ensuite MM. Éric Jalon, directeur général des étrangers en France (DGEF), Didier Leschi, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) et Arnaud Richard, directeur général de l'association Coallia. Je précise que l'association Coallia a été conviée, car, sur la période sous revue de l'enquête, à savoir de 2019 à 2023, c'est elle qui a le plus bénéficié des crédits versés par la mission.
Évidemment, ceux de nos collègues qui le souhaitent pourront ensuite vous interroger.
À l'issue de notre réunion, je demanderai aux membres de la commission des finances leur accord pour publier l'enquête remise par la Cour des comptes.
Je vous indique enfin que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo et est retransmise sur le site internet du Sénat.
Mme Sophie Thibault, présidente de la cinquième chambre de la Cour des comptes. - J'ai pris mes fonctions de présidente de la cinquième chambre de la Cour des comptes en octobre 2024. Pour cette audition, je suis accompagnée de Arnaud Oseredczuk, président de section au sein de cette même chambre. Il vous présentera les conclusions détaillées du rapport intitulé Les missions, le financement et le contrôle par l'État des associations intervenant au titre de la politique d'immigration et d'intégration, et réalisé à votre demande en application du 2° de l'article 58 de la Lolf.
Avant que mon collègue ne vous fasse part des principaux constats et des cinq recommandations de la Cour, je vous donnerai quelques éléments de contexte concernant le déroulement de cette enquête.
En octobre 2024, la Cour a publié un rapport sur les relations entre l'État et les gestionnaires de structures d'hébergement, qui faisait suite à trois contrôles organiques sur des intervenants importants dans ce domaine, et à une enquête plus spécifique réalisée par la Cour sur le pilotage de la mission que l'État confie à ces associations.
Mme le rapporteur spécial Marie-Carole Ciuntu, avec laquelle j'ai travaillé antérieurement en ma qualité de préfète du Val-de-Marne, a évoqué début 2024 avec la Cour les attendus de la commande d'un rapport sur les associations actives dans le domaine de l'immigration et de l'intégration. Nous avons défini ensemble un périmètre plus circonscrit, excluant notamment les politiques d'hébergement, qui étaient largement abordées dans le travail alors en cours spécifiquement sur ce sujet. Nous sommes convenus que l'accompagnement des personnes concernées comprenait, outre l'hébergement, un volet social au sens large, qu'il s'agisse de démarches pour faire valoir ses droits, de cours de langues ou de formations dispensées, autant d'aspects qui méritaient que nous engagions des travaux. Ces prestations sont fournies, vous l'avez dit également, par des structures ou des associations que l'État rémunère notamment au titre de subventions.
Nous avons ensuite tenté de mieux comprendre ce que finance l'État, notamment à travers les crédits gérés par la DGEF, dont une partie est déléguée à l'Ofii, étant précisé que nous avons exclu les financements provenant des collectivités territoriales. L'objectif était de savoir comment les circuits financiers se mettent en place, quels sont les montants engagés, au profit de quels acteurs et de quelles activités, et d'expliquer les évolutions en la matière.
Dans l'idéal, nous aurions dû aller plus loin pour statuer sur l'efficience de ces politiques, mais le temps nous a manqué. Cela étant, nous allons poursuivre nos contrôles organiques habituels. Et même si cette enquête présente des limites, elle apporte un certain nombre d'éléments d'information et de constats intéressants, susceptibles de nourrir les réflexions du Parlement.
M. Arnaud Oseredczuk, conseiller maître, président de section au sein de la cinquième chambre de la Cour des comptes. - Sur un sujet aussi complexe, on ne peut omettre de rappeler le cadre et les acteurs impliqués.
Les actions d'accompagnement au bénéfice des étrangers se regroupent en quatre familles.
Premièrement, les primo-arrivants souhaitant s'installer durablement sur le territoire, pour des raisons très diverses : immigration pour les études - c'est le premier motif de demande -, le travail, le regroupement familial ou au titre du statut réfugié. En 2023, la France a accordé un peu plus de 300 000 premiers titres de séjour, qui permettent de bénéficier d'actions d'intégration dans la société telles que le contrat d'intégration républicaine (CIR) : formations civique, linguistique, etc. Près d'un tiers de ces primo-arrivants sont originaires du Maroc, d'Algérie et de Tunisie, et l'on a enregistré 127 000 signataires du CIR en 2023, compte tenu des exemptions existantes pour certains primo-arrivants. Une petite moitié des signataires invoque des motifs familiaux et un tiers sont des réfugiés.
Deuxièmement, les demandeurs d'asile. Nous les accompagnons dans leurs démarches pour obtenir la protection internationale, soit dans le cadre de leur centre d'accueil, soit au sein de structures spécifiques. Ils ont été un peu plus de 145 000 demandeurs en 2023, issus notamment d'Afghanistan, de Turquie et de plusieurs pays d'Afrique, à être accueillis dans des structures de premier accueil des demandeurs d'asile (Spada) et orientés vers des guichets uniques pour demandeurs d'asile (Guda). Les agents de la préfecture leur délivrent une attestation, ceux de l'Ofii évaluent leur situation, puis leur demande d'asile est déposée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Cette même année, 61 000 décisions favorables ont été rendues, pour les trois quarts par l'Ofpra et pour un quart, en appel, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
Troisièmement, les demandeurs d'asile qui obtiennent le statut de réfugié et deviennent alors des primo-arrivants. Ils ont accès aux formations du CIR et à un accompagnement spécifique en termes d'accès au logement et à l'emploi.
Quatrièmement, les retenus en centre de rétention administrative (CRA), qui ont aussi accès à une assistance juridique.
Sur le plan budgétaire, on distingue les deux catégories de demandeurs d'asile et de réfugiés, qui relèvent néanmoins toutes deux du fameux dispositif national d'asile (DNA) et du programme 303 « Immigration et asile », dont les crédits - assez dynamiques - sont passés de 1,453 milliard en 2019 à 1,732 milliard d'euros en 2023, en grande partie du fait de l'accueil des Ukrainiens. Ce budget inclut la subvention à l'Ofpra et le versement de l'aide aux demandeurs d'asile.
Les autres étrangers primo-arrivants, qui disposent d'un titre de séjour, font l'objet d'une action d'intégration définie dans le programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » : les crédits sont plus limités mais plus dynamiques, puisqu'ils passent de 386 millions à 536 millions d'euros, soit une hausse de 38 %.
L'Ofii finance les actions liées au CIR pour tous les primo-arrivants et l'accompagnement social des demandeurs d'asile et des réfugiés non hébergés, via les Spada. La direction centrale de l'Ofii est renforcée par 31 directions territoriales.
La DGEF finance les actions d'accompagnement des personnes hébergées grâce au DNA, les mesures appliquées dans les CRA ainsi que certains dispositifs d'intégration à destination de publics non soumis au CIR. Environ 80 % des crédits sont déconcentrés.
Mentionnons également la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés (Diair), qui avait l'ambition de décloisonner, de mieux faire connaître les dispositifs et d'expérimenter des solutions innovantes, et dont le rôle apparaît désormais moins clairement.
Le rapport commence par expliciter la place exacte des associations dans ce dispositif. Celles-ci représentent 73 % des gestionnaires de structures d'hébergement, 100 % des opérateurs des structures de premier accueil des demandeurs d'asile et environ 58 % des titulaires des marchés du CIR.
Je m'attarderai un peu plus sur les enseignements de la première partie, qui concernent les déterminants de la dépense et ses évolutions. Notre travail a consisté à cartographier le financement des associations et à expliquer les hausses de crédits, qui sont assez sensibles dans tous les domaines. Les annexes 3 et 4 de l'enquête montrent une relative concentration des dépenses envers les quelques associations qui représentent près de 30 % des crédits concernés : en font partie Coallia, France terre d'asile, SOS Solidarités et Forum réfugiés.
Les dépenses d'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés hébergés sont comprises dans le financement des places d'hébergement et s'élèvent à 263 millions d'euros en 2023 - sur un total de 850 millions d'euros -, avec une progression de 45 % depuis 2019. Cette hausse s'explique en partie par les flux concernés, mais aussi par la croissance du coût unitaire des prestations, qui passe de 2 500 euros à 3 000 euros par personne et par an.
L'accompagnement social des demandeurs d'asile non hébergés, principalement reçus en Spada, coûte 16 millions d'euros : de l'ordre de 150 euros par personne et par an.
Pour ce qui est du CIR, la dépense en faveur des associations a doublé en cinq ans, atteignant 76 millions d'euros en 2023, et ce pour trois raisons : une augmentation de 20 % des bénéficiaires, une hausse du nombre d'heures du contrat, et une plus grande proportion de personnes ne parlant pas le français ; le coût par personne est passé de 600 euros à 1 000 euros. De plus, le prix des prestations est très variable d'un endroit à un autre, en fonction des conditions de passation des marchés et des monopoles locaux.
L'enjeu budgétaire de l'accompagnement social dans les CRA est plus réduit, de l'ordre de 6 millions d'euros.
Pour conclure cette partie, je dirai que la forte hausse des crédits visés résulte de plusieurs phénomènes, dont des prestations parfois plus intensives, un flux plus important de bénéficiaires ou des changements concernant la composition de ces publics, et enfin, un manque de concurrence dans certains territoires.
Évoquons maintenant la définition des missions et des prestations par l'État et l'Ofii.
On remarque un risque de doublon concernant les crédits déconcentrés de la DGEF. Le vecteur principal de ses actions étant le CIR, on peut se demander à quoi correspondent ses crédits, qui étaient en forte augmentation et chiffrés à 75 millions d'euros en 2023. Selon la DGEF, les formations du CIR ne couvrent pas l'ensemble des besoins : de nombreux primo-arrivants n'en sont pas signataires et le niveau A1 n'est pas toujours atteint. Il peut donc être utile de continuer à proposer des actions d'intégration en dehors du CIR.
Au départ, nous préconisions une fusion de l'ensemble de ces crédits, qui auraient pu être pilotés par l'Ofii. Nous nous orientons désormais plutôt vers une amélioration de la coordination des actions entre les préfectures et les directions territoriales de l'Office. Les administrations concernées y travaillent.
Second point - et c'est le plus important -, ce qui est demandé à ces associations sur le plan de l'accompagnement n'est pas toujours défini avec suffisamment de précision, tant de la part de l'Ofii, qui procède par des marchés, que de celle de la DGEF, qui accorde plutôt des subventions et recourt par conséquent davantage aux appels à projets. Il n'existe pas véritablement de référentiel commun de ce à quoi correspondent l'accompagnement, ses tâches ou le temps moyen consacré par personne bénéficiaire.
Ce travail n'est pas irréalisable. La Cour des comptes vient ainsi de mener une assez longue enquête sur l'accompagnement social dans les départements et dans les caisses d'allocations familiales (CAF) qui montre qu'il est possible de fixer des objectifs et de normer l'activité d'accompagnement social.
Actuellement, l'État et l'Ofii définissent principalement leurs attentes par des taux d'encadrement et par des niveaux de compétence des travailleurs sociaux.
Selon les types de structure d'hébergement - centres d'accueil pour demandeurs d'asile (Cada), centres provisoires d'hébergement (CPH), hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile (Huda), etc. -, qui, il est vrai, n'ont pas tous un positionnement identique, les taux d'encadrement ne sont pas les mêmes, variant d'un pour dix à un pour vingt-cinq. Ce dernier taux correspond à des publics de « dublinés » qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire national ; le premier concerne plutôt des publics qui présentent des vulnérabilités particulières et à qui l'on propose un niveau de prise en charge plus important. Leur calcul demeure cependant relativement arbitraire, en l'absence d'identification des tâches d'accompagnement.
Des écarts analogues se retrouvent en matière de qualification. Certaines structures exigent ainsi 50 % de travailleurs sociaux, d'autres 100 %, d'autres encore, notamment les Spada, ne formulent pas d'exigence particulière.
Si nous soulignons, dans le rapport sur l'hébergement, que le recours fréquent de l'État à la subvention présente l'avantage de la souplesse d'une année sur l'autre, nous relevons néanmoins que ce mode de financement offre assez peu de prise sur le contenu détaillé de ce que l'on attend de la prestation et de la capacité à le contrôler. Le cadre de la subvention n'est en effet pas conçu pour cela. Être beaucoup plus prescriptif quant aux tâches à accomplir et aux contrôles à effectuer suppose de passer par un modèle du type de celui des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), en s'inscrivant dans la durée, ce qui est certes plus coûteux et peu évident compte tenu de flux de populations qui peuvent être difficiles à anticiper.
Pour les personnes non hébergées, les marchés d'animation des Spada décrivent bien les publics et les prestations concernés, mais non les qualifications requises ni le taux d'encadrement.
En définitive, que le bénéficiaire soit ou non hébergé, aucun référentiel des tâches ne permet d'objectiver ce qui est attendu. Un tel référentiel nous semblerait des plus utiles. Il serait le premier pas vers une tarification à la prestation, ce que nous n'allons toutefois pas jusqu'à recommander directement, car ce procédé nécessiterait une étude approfondie, en particulier sur ses possibles effets pervers, effets d'aubaine et de multiplication de l'offre. Nous avons en effet tous en tête la tarification à l'activité (T2A) instaurée à l'hôpital.
J'en viens au contrôle des prestations par l'État. La maturité et la qualité des dispositifs diffèrent. L'Ofii applique une méthodologie d'audit assez rigoureuse, avec l'organisation d'un nombre élevé de contrôles sur place, tant pour l'application des CIR qu'auprès des Spada. En ce qui concerne la DGEF et sa mission à l'endroit des opérateurs d'hébergement, nous retrouvons le même débat sur le contrôle effectif de leurs prestations d'accompagnement. Une mission régionale et interdépartementale de contrôle est censée se présenter dans les différentes structures d'hébergement. Ses effectifs sont cependant tels que le bilan se résume en 2023 au contrôle de 26 Cada sur 363, de 5 Huda sur 298 et de 4 CPH sur 140. À ce rythme, les Cada seraient contrôlés une fois tous les quatorze ans, les Huda tous les soixante-quinze ans et les CPH tous les trente-cinq ans, ce qui n'est évidemment pas satisfaisant.
Pour les années à venir, la DGEF annonce un projet de développement d'un système d'information afin de mieux piloter ce parc d'hébergement et, en principe, l'accompagnement associé. Il devrait faciliter tant le contrôle financier que le contrôle de la qualité.
Les éléments que nous avons rassemblés sur le programme d'accompagnement global et individualisé des réfugiés (Agir) restent préliminaires. Ils visent à changer la manière dont on appréhende le parcours des personnes et leur insertion dans la société après l'obtention du statut de réfugié.
Le rapport se termine par l'évocation du nouveau cadre instauré par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif au CIR, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026, avec un niveau d'exigence linguistique significativement relevé pour bénéficier du titre de séjour de dix ans. Il provoquera nécessairement un bouleversement de l'offre linguistique de l'Ofii, qui d'ores et déjà y travaille.
Au total, notre message est très nuancé. Le coût des dépenses en faveur des associations augmente de 52 % en cinq ans pour les deux programmes confondus, principalement sous l'effet des demandes de l'État et des flux de bénéficiaires, plutôt qu'en raison d'une hausse des tarifs. Les prestations sont définies de manière peu précise, par le seul moyen de taux d'encadrement et de niveaux de compétences. Les contrôles, fréquents dans le cas des titulaires des marchés des CIR, restent beaucoup plus limités dans celui des acteurs de l'hébergement.
Nous formulons cinq recommandations, largement ciblées sur la question d'une meilleure définition des prestations attendues et d'un meilleur suivi de celles-ci. Nous soulignons également la nécessité de bien coordonner l'action dans le domaine linguistique, en faisant jouer autant que possible la concurrence.
La première recommandation porte sur l'amélioration du sourcing des candidats par l'Ofii, afin d'obtenir une baisse des prix des marchés de formations. Les trois recommandations suivantes ont trait au référentiel des tâches inhérentes à l'accompagnement des étrangers, à la définition des compétences requises pour les accompagner et à l'amélioration du suivi de l'activité par les gestionnaires d'hébergement. Enfin, nous nous intéressons, au sein du programme 104, à la cohérence entre les formations linguistiques et civiques financées par l'action no 12 « Accueil des étrangers primo-arrivants » de la DGEF et celles que l'Ofii soutient.
M. Claude Raynal, président. - Votre présentation nous confirme toute la complexité du sujet.
Mme Marie-Carole Ciuntu, rapporteur spécial de la mission « Immigration, asile et intégration ». - Je tiens tout d'abord à remercier la Cour des comptes pour la qualité de l'enquête et la clarté de la présentation qui vient de nous en être faite. La commande de cette étude par la commission à la Cour fait suite à des interrogations manifestées régulièrement au cours des dernières années par le Sénat sur le cadre d'intervention des associations au sein de la mission « Immigration, asile et intégration ».
Je rappelle d'ailleurs que, si je suis ce dossier de près, mon prédécesseur avait lui-même déjà souhaité interroger la DGEF pour obtenir des informations sur ce sujet. Des données nous avaient ainsi été fournies à l'automne 2023.
Sur cette base, j'avais déjà constaté devant notre commission, à l'occasion de l'examen des projets de loi de finances (PLF), un niveau élevé et en hausse des crédits versés aux associations ainsi qu'un déséquilibre en faveur des dépenses liées à l'asile par rapport à celles qui étaient consacrées à l'intégration. J'avais en outre exprimé quelques doutes sur le caractère approfondi des contrôles sur les associations dans certains domaines, en dépit des efforts faits.
L'enquête de la Cour s'appuie sur des données plus fournies et des constats plus détaillés. Mais - et je parle ici sous le contrôle de Mme Thibault et de M. Oseredczuk -, elle confirme ces constats généraux.
J'en viens aux principaux enseignements que je retiens de l'enquête, étant rappelé qu'elle ne comportait pas dans son périmètre l'hébergement des demandeurs d'asile.
En premier lieu, l'enquête montre que si les politiques sont pilotées par la DGEF, qui se repose également sur l'Ofii et les services déconcentrés, leur mise en oeuvre concrète s'appuie largement sur des prestataires extérieurs, au premier rang desquels les associations.
Si l'implication des associations est relativement limitée en matière de politique d'immigration, à l'exception notamment de l'assistance juridique des personnes retenues en CRA, elle est très significative en matière d'actions d'intégration, et même prépondérante pour ce qui concerne l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des demandeurs d'asile.
En toute logique, cet état de fait se reflète, d'un point de vue budgétaire, par le niveau important des crédits de la mission qui sont versés aux associations. En 2023, plus d'un milliard d'euros leur ont été octroyés via les deux programmes de la mission, très majoritairement au titre de la politique d'asile.
Néanmoins, je rappelle que la spécificité des montants affectés aux associations dans le cadre de cette mission ne tient pas seulement à leur niveau cumulé. Quatre missions versent en effet encore davantage de crédits aux associations pour la mise en oeuvre des politiques qu'elles portent, notamment la mission « Cohésion des territoires », ou encore la mission « Justice ».
La particularité tient encore davantage à la forte proportion des crédits totaux de la mission qui sont effectivement octroyés aux associations. Selon l'enquête, hors subvention aux opérateurs de la mission et hors allocation pour demandeur d'asile (ADA), plus de deux tiers des crédits, soit 66,9 %, sont versés aux associations. Même lorsque l'on prend en compte l'ensemble des crédits consommés, ce taux atteint 48 % en 2023. Cette proportion est sans doute beaucoup plus élevée que pour l'essentiel des autres missions budgétaires.
Concrètement, les crédits sont versés à un nombre important d'associations, près de 1 500 en 2022 selon les informations que j'avais obtenues de la DGEF. Toutefois, une faible partie d'entre elles perçoit la majorité de ces crédits. Selon l'enquête, sur la période de 2019 à 2023, la moitié - 50,3 % - des crédits de la mission consacrés aux associations a été octroyée aux quinze associations recevant le plus de fonds. Coallia figure en tête, avec 115 millions d'euros par an en moyenne, devant France terre d'asile.
En deuxième lieu, l'enquête constate que le total des crédits versés aux associations par la mission est en nette hausse entre 2019 et 2023. Sur la période, ils ont augmenté de plus de moitié, et plus précisément de 52,7 %. Et si l'accueil des bénéficiaires ukrainiens de la protection temporaire à compter de 2022 peut sans doute en expliquer une part, il n'explique pas tout.
La progression des crédits octroyés concerne la quasi-totalité des types d'intervention. Pour l'accompagnement des demandeurs d'asile et des réfugiés hébergés, l'augmentation est de 45,5 % entre 2019 et 2023. De même, en matière de formations civiques et linguistiques dans le cadre du CIR, les crédits ont plus que doublé.
Cette tendance résulte de différents facteurs. Elle découle d'abord mécaniquement de la hausse du nombre de bénéficiaires des actions déployées, en lien avec l'augmentation de la pression migratoire. Si cela n'est pas une surprise, l'enquête nous le confirme. Surtout, cette dernière révèle en outre une hausse des coûts unitaires, notamment imputable, en fonction des prestations, à une évolution du profil des publics bénéficiaires, à une hausse de l'intensité de l'accompagnement, à la mise en place de nouvelles prestations, ou encore à un manque de concurrence entre prestataires sur certains territoires.
Pour ce qui concerne le CIR, le coût par signataire a ainsi progressé de 68 % entre 2019 et 2023. Pour l'assistance juridique en CRA, les crédits versés ont augmenté de 30 %, alors même que le nombre de personnes effectivement retenues a été réduit de plus de 10 000 entre 2019 et 2023.
En troisième lieu, le rapport d'enquête révèle des écueils dans la définition et la coordination d'une partie des missions confiées aux associations.
Ainsi, en matière d'intégration, les prestations offertes dans le cadre du CIR et celles qui sont financées par les crédits des services déconcentrés peuvent - comme l'indique la Cour - « concerner en partie les mêmes publics, pour les mêmes finalités, faute d'une coordination suffisante entre les services déconcentrés et les directions territoriales de l'Ofii »,.
Quant à l'accompagnement des demandeurs d'asile, l'État et l'Ofii ne définiraient pas avec suffisamment de précision la nature des missions d'accompagnement, les compétences requises et, dans les structures d'hébergement, le taux d'encadrement pour les réaliser.
En dernier lieu, l'enquête constate un niveau de contrôle inégal de l'activité des associations.
Si les contrôles exercés sur les associations intervenant au titre du CIR et sur celles qui gèrent les Spada paraissent satisfaisants, ce n'est pas le cas pour ce qui concerne l'hébergement des demandeurs d'asile et l'accompagnement associé, ou encore les crédits versés par les services déconcentrés dans le domaine de l'intégration. Je conviens toutefois que les moyens humains disponibles pour ces missions de contrôle sont loin d'être toujours pléthoriques.
Sur le fondement de ces différents constats, la Cour formule cinq recommandations, qui visent notamment à favoriser la maîtrise des coûts, à mieux définir, harmoniser et suivre les prestations attendues des associations et à mieux coordonner les actions les plus susceptibles de créer des doublons. En tant que rapporteur spécial, je rejoins l'analyse de la Cour, de même que ses recommandations.
Plus largement, bien que ce ne soit pas l'objet direct de l'enquête, il me paraît important de s'appuyer sur ces conclusions pour s'engager dans des considérations plus larges sur la place confiée aux associations en matière d'immigration, d'asile et d'intégration. J'en formulerai trois.
Premièrement, il me semble que nous ne pouvons pas nous dispenser d'une réflexion sur l'opportunité d'appuyer si fortement la mise en oeuvre de ces politiques sur les associations. L'importante progression des crédits octroyés à ces dernières dans les années récentes nous y invite, ne serait-ce que du point de vue budgétaire. Mais même au-delà, il me semble que la question méritera un débat : jusqu'où peut-on aller dans la délégation à des associations ? Un autre modèle est-il possible et opportun ?
Deuxièmement, en matière de contrôle exercé sur les associations auxquelles sont versés des crédits, je souhaite rappeler que, outre les vérifications quant à la réalité et à la qualité des prestations, il importe de s'assurer que les fonds versés ne financent pas une forme de militantisme des associations, sous une forme ou une autre.
Évidemment, c'est un sujet qui ne concerne pas toutes les associations, dont les activités et les philosophies sont très différentes : on ne peut pas mettre sur le même plan Coallia et la Cimade. Mais certains financements peuvent conduire à nous interroger. Par exemple, est-il vraiment judicieux que l'assistance juridique des personnes retenues dans les CRA soit confiée à des associations par des marchés publics ? Est-il ainsi pertinent de financer sur fonds étatiques des associations dont je crains qu'elles incitent surtout largement aux recours contre les décisions d'éloignement, y compris pour des personnes dangereuses pour la société ? Je veux être très claire : je pense qu'une assistance juridique des personnes retenues peut utilement être prévue, mais celle-ci pourrait par exemple être réalisée par un service spécialisé de l'Ofii, pourquoi pas dirigé par un magistrat ?
Enfin, il me semble que les missions et les financements des associations doivent aussi être interrogés à la lumière des évolutions budgétaires récentes.
En effet, dans le budget pour 2025 que le Parlement vient d'adopter, les crédits de la mission sont en baisse d'environ 15 %, une fois neutralisées les évolutions de périmètre, et il y a fort à parier que ces crédits restent sous tension pour les années à venir. Dans ce contexte, il me semble nécessaire de regarder, parmi ce que l'on confie aux associations, ce qui doit être maintenu et ce sur quoi il faut faire des économies.
M. Éric Jalon, directeur général des étrangers en France. - Je remercie la Cour des comptes de ce rapport et la commission des finances du Sénat qui l'a commandé, car on en retire beaucoup d'enseignements qui arrivent, pour plusieurs raisons, très opportunément.
Premièrement, le rapport complète celui que la Cour a produit sur l'hébergement - ce dernier représente une grande partie de nos dépenses adossées à des associations - et que nous avons commencé à mettre en oeuvre, notamment sur les modalités de travail avec les associations.
En substance, l'intégralité du parc de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile, celui des Huda, fonctionne aujourd'hui par un régime de subvention. Il est légitimement permis de s'interroger sur cette caractéristique, dès lors que l'État fixe ses objectifs, par exemple quant au nombre de places ou sur le cahier des charges. À la suite des échanges que nous avons eus l'an dernier avec la Cour, nous nous engageons dans le sens d'une évolution, probablement vers un régime d'agrément analogue à celui qui prévaut pour les ESSMS et qui est celui des Cada.
Deuxièmement, ce rapport, même s'il s'arrête dans son analyse à 2023, intervient après une année 2024 marquée par plusieurs inflexions, qui nous ont conduits à resserrer les dépenses : ainsi de la baisse de 25 % des crédits déconcentrés du programme 104 « Intégration et accès à la nationalité française » et de celle du nombre de CIR, avec une diminution de 10,5 % du nombre de signataires et de 13 % des formations linguistiques prescrites.
Troisièmement, le rapport intervient au moment où, pour assurer la mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2026 des prescriptions de la loi du 26 janvier 2024, nous reconfigurons l'organisation des formations civiques et linguistiques à l'occasion de nouveaux marchés que nous préparons avec l'Ofii. Les recommandations de la Cour en matière de pilotage trouveront à s'intégrer dans ce travail.
Enfin, il intervient à un moment où nous réfléchissons à la place des associations dans différents dispositifs, et notamment dans celui de l'assistance juridique dans les CRA.
Une précision au sujet des subventions aux associations, dont on parle, légitimement, beaucoup. Nous considérons ces associations comme des opératrices de nos politiques publiques et nous finançons par elles une action dont nous avons besoin. Tous les opérateurs n'ont du reste pas le statut d'association. Dans le champ de l'hébergement, une partie de notre parc est par exemple confiée à Adoma, une filiale de CDC Habitat qui ne relève pas de ce statut. Nous regardons en définitive moins le statut de l'opérateur que sa capacité à agir, mais il se trouve qu'un certain nombre de grandes associations professionnelles, dont Coallia, sont aujourd'hui les principales intervenantes dans ce secteur.
Le rapport fait état d'une forte augmentation des dépenses, ce qui est exact. Il souligne cependant qu'elle résulte de l'accroissement des publics éligibles bénéficiant du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile. Le taux d'hébergement des demandeurs d'asile éligibles est actuellement de l'ordre de 70 %, ce qui est très élevé compte tenu du contexte de très fort niveau de la demande d'asile. Ce taux est aussi la conséquence du choix de ces dernières années, en particulier en 2018-2019, d'intensifier l'action d'intégration et de notamment doubler le volume des formations linguistiques. Il est en enfin le fruit d'un effort spécifique pour l'intégration des bénéficiaires de la protection internationale des réfugiés au travers du déploiement du programme Agir. Une partie de la dépense est donc subie, une autre résolument choisie.
La dépense n'en est pas moins pilotable et pilotée, même si ce pilotage est perfectible. Nous nous servirons évidemment des recommandations de la Cour en ce sens.
Grâce aux efforts de pilotage et de vérification systématique de l'éligibilité des demandeurs à laquelle l'Ofii procède, la dépense de guichet liée à l'ADA, à nombre de primo-demandeurs d'asile équivalent, et hors bénéficiaires de la protection temporaire ukrainiens, a diminué de moitié entre 2019 et 2024, passant de 500 millions à un peu moins de 250 millions d'euros.
L'effort mené avec l'Ofii porte également sur la disponibilité du parc du DNA : en deux ans, ce sont quelque 5 000 places qui ont été rendues disponibles. Tous les mois, nous communiquons à chaque préfet le taux d'indisponibilité et le taux de présence indue dans les structures d'accueil des demandeurs d'asile de son département, afin qu'il puisse se rapprocher des opérateurs et travailler à l'amélioration de ces taux.
L'effort de pilotage se manifeste encore par la stabilisation du dispositif Agir, avec la fixation de cibles très précises département par département, pour un nombre total de personnes prises en charge de 25 000.
Par ailleurs, dans une relation de marchés publics où les associations agissent comme prestataires, nous procédons à des réfactions sur les factures qu'elles nous adressent quand nous considérons que la prestation n'est pas totalement remplie. Nous avons eu l'occasion de le faire en 2023 pour une association intervenant dans un CRA, ce qu'elle n'a, en l'occurrence, pas contesté au contentieux.
Je terminerai par les voies de progrès.
Elles consistent d'abord en une remise à plat de nos modes d'intervention dans le DNA, avec une évolution du système de subvention vers un système plus proche de celui des ESSMS.
Elles passent ensuite par la recherche d'une meilleure articulation et complémentarité entre les formations organisées par l'Ofii et les actions déconcentrées. Nous avons en ce sens proposé d'associer les directions territoriales de l'Ofii au choix des bénéficiaires des subventions accordées par les préfets au titre du programme 104.
Il nous faut en outre repenser notre offre de formation civique et linguistique. C'est ce à quoi, en tout état de cause, nous oblige la loi du 26 janvier 2024. Nous travaillons actuellement avec l'Ofii aux marchés qui devront être passés. Sans doute la formation linguistique en présentiel se concentra-t-elle sur les publics qui en ont le plus besoin, ceux des non-lecteurs et non-scripteurs ; la formation à distance, plus souple, sera développée à l'attention des autres publics, dont on voit qu'ils ont du mal à concilier le CIR avec d'autres formations professionnelles. Du reste, la loi du 26 janvier 2024 ouvre une nouvelle voie de formation, en disposant que celle des salariés allophones est prise en compte dans le temps de travail.
Enfin, nous partageons le constat de la nécessité de renforcer nos capacités de contrôle. Nous allons demander à l'inspection générale de l'administration (IGA) et à l'inspection générale des affaires sociales (Igas) de nous proposer une méthodologie de contrôle rigoureuse, pour que nous puissions procéder à des contrôles périodiques effectifs sur les grands opérateurs qui interviennent dans le champ de l'hébergement d'urgence. Nous observons en effet aujourd'hui une assez forte concentration de ces opérateurs, qui comporte en elle-même un risque systémique, et un taux de contrôle effectif dans les établissements relativement faible.
M. Didier Leschi, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii). - L'Ofii opère exclusivement via des marchés publics et la Cour des comptes, que je remercie de son travail, relève, parmi les points positifs, le fait qu'il organise des contrôles extrêmement rigoureux. Ils sont la marque de l'importance que nous accordons à la dépense publique dans une matière complexe.
L'Ofii a dispensé 13,5 millions d'heures de cours en 2023 et 13,1 millions en 2024. La baisse du nombre de CIR, passant de 127 000 à 114 000, explique en partie l'augmentation des coûts unitaires, puisque la dépense est passée, dans le même temps, de 95 millions à 102 millions d'euros. L'effort d'accompagnement a été accentué pour la prise en charge de publics qui présentent souvent la particularité d'être, quand ils arrivent sur notre territoire, non lecteurs et non scripteurs.
Sans doute faut-il encore améliorer cet accompagnement. C'est toute la question du profil des travailleurs sociaux. Dans les Spada notamment, nous sommes censés accompagner des personnes en attente d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; il s'agit donc non de les accompagner dans l'insertion, notamment par le travail, mais d'identifier leurs éventuelles vulnérabilités particulières et de les accompagner dans leur attente de la décision qu'elles sollicitent. C'est là une définition qui n'est pas simple de l'action sociale.
En ce qui concerne les réfugiés, d'autres programmes, comme Agir, ont été mis en oeuvre.
Nous sommes évidemment soucieux des prix des prestations. C'est pourquoi, à l'occasion des nouveaux marchés, nous passons de 20 à 12 lots, afin d'augmenter la possibilité d'obtenir de nouveaux opérateurs concurrentiels et une baisse des prix qui n'induise pas une dégradation de la qualité des prestations.
Nous ferons beaucoup mieux en matière de formations linguistiques, grâce aux cours de français à distance qui permettront d'accompagner, comme dans d'autres pays européens, des personnes déjà dans l'emploi ou en formation, ce que nous avions jusqu'à présent du mal à faire. Nous maintenons notre effort avec des cours en présentiel pour les non-lecteurs et non-scripteurs.
Pour répondre aux interrogations du rapporteur spécial, nous nous appuyons sur les associations quand il n'existe pas d'autres opérateurs. En matière de formation linguistique, nous pouvons, outre les associations, compter sur les groupements d'établissements publics locaux d'enseignements (Greta), souvent très performants dans ce domaine. Sur le contrôle, nous essayons de faire au mieux en fonction de la commande et je vous remercie ici de la confiance que vous nous accordez pour ce qui a trait à l'éventuelle assistance juridique dans les CRA : ce serait en réalité peut-être une simple information juridique compte tenu des évolutions de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'accès des étrangers à l'aide juridictionnelle.
Enfin, je précise que l'Ofii fait lui-même l'objet d'un contrôle régulier de la Cour des comptes, j'allais dire quasiment tous les ans.
M. Arnaud Richard, directeur général de l'association Coallia. - Notre association a une histoire assez atypique, avec un positionnement plutôt singulier à l'égard de l'État, à qui elle doit sa création en 1962. Elle ne compte pas de bénévoles, ne reçoit pas de dons et n'est pas confessionnelle. Son positionnement n'est donc pas exactement celui de l'ensemble du secteur associatif, avec lequel nous travaillons cependant très bien.
Nous sommes une association de professionnels du travail social et médico-social. Nos champs d'intervention, larges, sont non seulement l'asile et l'intégration, mais aussi le logement accompagné, le handicap, le grand âge ou la protection de l'enfance. Nous sommes présents dans 53 départements.
Un précédent rapport sur la période 2016-2021 nous avait, il faut le reconnaître, ébranlés. L'association a beaucoup appris de ce rapport, qui lui a été des plus utiles.
Nous sommes sans conteste légalistes et nous nous reconnaissons - ce que les associations généralement n'apprécient guère pour elles-mêmes - comme opérateurs de l'État, en ce que nous répondons à des cahiers des charges, à des appels à projets, à des mises en concurrence et à des marchés publics, avec des obligations aussi fortes que précises, au service de la commande publique.
Grâce au travail d'évaluation et de contrôle, travail que vous exercez aujourd'hui, les choses se sont nettement améliorées. L'amélioration concerne tant le pilotage de l'hébergement d'urgence - avoir confié l'ensemble du programme 177 « Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables » à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (Dihal) est une bonne chose - que celui de l'asile, objet du programme 303 « Immigration et asile ». La qualité des marchés qui concernent les Spada est également sans comparaison avec ce qu'elle était il y a cinq ou dix ans.
Je suis très attaché aux contrôles, qui nous ont permis de progresser au sein de l'association Coallia, et volontaire sur ce terrain. Nous en réalisons d'ailleurs nous-mêmes en interne et nos salariés tiennent beaucoup à la qualité du service rendu.
Un des piliers de notre travail repose sur la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, dont les principes ont été récemment réaffirmés par la Haute Autorité de santé (HAS). Ce texte régit ce que doit être la qualité de service d'un établissement social et médico-social. Ses dispositions valent pour un Cada, un institut médico-éducatif (IME), un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ou un Ehpad.
À cet égard, passer d'un système de subvention à un système d'agrément est un gage, pour la puissance publique, de qualité accrue du service rendu, avec un contrôle externe resserré, intervenant tous les cinq ans et appliquant une grille exigeante de 276 critères.
S'y ajoutent les contrôles inopinés, qui contribuent à vérifier l'emploi des crédits considérables que l'on nous confie en qualité d'opérateurs des politiques publiques. Nous ne sommes pas à proprement parler délégataires de missions de service public, mais nous nous en approchons.
Pour nos professionnels, qui doivent dérouler leur carrière de travailleurs sociaux, le régime de la subvention n'est pas satisfaisant. Chez Coallia, quelque 60 % de nos crédits proviennent en effet de subventions et l'on pourrait concevoir que, en bon gestionnaire, je compte une même proportion de CDD. Notre réalité n'est, fort heureusement, pas celle-là.
Par ailleurs, il est certain que les demandeurs d'asile sont contraints d'attendre longtemps quand ils sollicitent la protection de notre pays. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet il y a quelques jours au cours d'une audition à l'Assemblée nationale : leur avoir interdit de travailler avait peut-être à l'origine une raison, mais cela risque surtout aujourd'hui de leur laisser à penser qu'on leur donne de l'argent pour ne pas travailler, ce qui n'est pas sain du tout. Il n'est pas aisé de définir la nature du travail social pendant cette période d'attente du demandeur d'asile, au cours de laquelle il bénéficie de certains droits mais non de tous.
En revanche, pour les personnes qui obtiennent la protection internationale, on doit pouvoir trouver un référentiel de l'accompagnement, même s'il reste complexe de définir le temps précis à consacrer à tel ou tel type d'acte, et avec les risques que comporte une tarification à l'acte, ce que vous avez évoqué. Mais, sur le principe, il me paraît normal que la puissance publique sache exactement l'usage qui est fait des crédits extrêmement importants qu'elle accorde.
S'agissant des propositions de la Cour, celle qui a trait à l'accès à la formation linguistique nous concerne peu. Quant à l'établissement d'un référentiel de tâches, il me semblerait normal, si nous parvenons à une solution praticable qui ne soit pas une usine à gaz et qui respecte le travail des professionnels du travail social engagés à nos côtés. En matière d'harmonisation des compétences requises, notre difficulté majeure, avant même le déroulement des carrières de nos salariés, consiste à les recruter. Nous espérons que les partenaires sociaux pourront à brève échéance s'entendre sur une convention unique étendue. Dans le domaine de l'accompagnement, nous nous conformerons à ce que la commande publique nous demande ; ne mésestimons simplement pas le fait que, dans les secteurs de l'hébergement d'urgence et de l'asile, nous nous sommes souvent efforcés en vain d'obtenir des systèmes d'information globaux.
M. Olivier Bitz, rapporteur pour avis de la commission des lois. - Je me réjouis de ce travail de la Cour des comptes qui nous communique des éléments d'analyse objectifs et précisément chiffrés. Néanmoins, je reste un peu sur ma faim. Vous nous dites, madame la présidente, que vous ne nous êtes pas interrogée sur l'efficacité de l'action publique par manque de temps et de moyens. Mais au moment où nous cherchons des sources d'économies ou, du moins, de rationalisation des dépenses, l'optimisation de l'argent public investi dans les associations qui interviennent au titre de la politique d'immigration et d'intégration est au coeur de ma réflexion. Pensez-vous que le niveau de prestations et de services dans ce domaine corresponde à celui de l'investissement budgétaire consenti ?
D'autre part, le mode de gestion massivement externalisé qui est, ici, historiquement celui de l'État et qui s'est poursuivi vous paraît-il encore opportun ? Ne devons-nous pas nous interroger sur la possibilité d'internaliser une partie des missions concernées ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Merci aux intervenants. Avec la question de l'efficience de la politique d'immigration et d'intégration qui vient d'être posée nous touchons aux limites de l'exercice qui relève de la seule commission des finances. Les travaux d'autres commissions du Sénat doivent, à mon avis, le compléter.
Un PLF est toujours désagréable pour ceux qui obtiennent moins de crédits qu'ils n'en attendaient. Ceux-là pourraient considérer que l'on remet en cause la qualité de leur travail ou qu'on ne le reconnaît pas à sa juste valeur. Pourtant, il va falloir que nous changions de logiciel, c'est-à-dire notre manière de réfléchir à cet égard. Vu le niveau particulièrement élevé des dépenses publiques, des prélèvements et des taxes en France, nous devrions être le pays du bonheur absolu et des résultats excellents... Avec un peu plus de 3 300 milliards d'euros de dette, permettez-moi de le contester. La vérité des chiffres nous rappelle la situation globalement tendue dans laquelle nous nous trouvons.
J'entends dans vos propos que l'on relève une certaine amélioration, mais que vous reconnaissez aussi une augmentation des crédits dans une ampleur plus forte que la hausse des bénéficiaires. Il est parfois difficile de savoir s'il faudrait des politiques plus intégrées. Il existe peut-être un phénomène de déperdition des fonds mobilisés en raison d'une mauvaise articulation entre les acteurs de la chaîne.
Comme vous l'avez souligné, la situation s'est améliorée, mais la question de l'efficience de la prise en charge des différents publics - primo-arrivants, demandeurs d'asile, réfugiés - reste posée, dans le contexte démographique que nous connaissons. Quelles pistes d'amélioration pourriez-vous proposer afin de mieux accompagner les bénéficiaires, et ce au-delà des seuls enjeux budgétaires ?
M. Grégory Blanc. - Merci pour la qualité de ce travail. Je partage l'avis du rapporteur général quant à la nécessité de changer de logiciel face aux défis à venir, même si nous divergerons peut-être sur les solutions à apporter.
En janvier 2024, la Cour des comptes avait consacré un rapport à la politique de lutte contre l'immigration irrégulière indiquant que les alourdissements successifs de la législation aboutissaient à un enchevêtrement de dispositions peu lisible. Le même rapport constatait que les moyens consacrés à la lutte contre l'immigration irrégulière ont connu une hausse considérable au cours des dernières années, point qui mériterait d'être intégré à une réflexion plus globale sur l'immigration.
Enfin, la Cour insistait sur la nécessité de renforcer la coordination entre les différents services du ministère de l'Intérieur, en lien avec les préfectures. Faudrait-il, sur certains points, apporter des clarifications aux associations afin de gagner en efficience ?
Je note, par ailleurs, que le logement est peu abordé dans le rapport. J'ai toujours été frappé par le fait que les opérateurs privilégient les logements les moins chers et donc les bailleurs sociaux, ce qui entraîne une concentration des populations arrivantes dans les quartiers prioritaires, c'est-à-dire dans un environnement difficile. Avez-vous évalué l'impact de ces choix en termes d'accompagnement ? L'intégration est bien plus malaisée lorsque 80 % des enfants d'une même classe ne parlent pas français.
En conclusion, je tiens à souligner que le ministère de l'Intérieur n'hésite pas à consacrer davantage de ressources à la chasse aux étrangers qu'au budget de la sécurité civile, notamment pour financer un pacte « inondations ».
M. Thomas Dossus. - Cette enquête objective bien les faits après une série de déclarations fantasmatiques sur les sommes perçues par les associations. Sa lecture permet de constater que l'augmentation des coûts résulte avant tout de l'évolution des règles encadrant notre politique migratoire dans un sens plus strict, notamment en matière de politique linguistique, puisque l'on exige plus de qualifications de la part des étrangers, d'où un accompagnement plus intensif et un alourdissement des coûts.
De la même manière, les coûts d'accueil dans les centres de rétention progressent malgré la diminution du nombre de personnes qui y transitent, ce qui est logique puisque la durée de rétention s'est allongée et que les recours se sont multipliés.
J'en profite pour rebondir sur les propos du rapporteur spécial, qui a explicitement ciblé la Cimade, se faisant le porte-voix du ministre de l'Intérieur, lequel a également visé cette association dans une interview récente. Je rappelle que l'accès aux droits et la faculté de s'opposer à un acte administratif constituent des piliers de notre démocratie et de l'État de droit, et qu'il est bienvenu que des associations indépendantes se chargent de ces recours. Je tiens d'ailleurs à rappeler que la Cimade, fondée en 1940, est connue dans le département du Rhône pour avoir fait sortir 108 enfants juifs du camp de transit de Vénissieux : je juge donc les propos qui la ciblent assez abjects, car cette association oeuvre en solidarité avec les étrangers, quelle que soit leur situation administrative.
Pour ce qui est du coût de notre politique migratoire, la perspective d'une augmentation de la durée de rétention administrative aura-t-elle un impact financier ? Par ailleurs, est-ce qu'autoriser les demandeurs d'asile à travailler plus tôt permettrait de réaliser des économies ? Enfin, a-t-on évalué le coût du renforcement des obligations linguistiques, poussé à un point tel que des Français bien intégrés peineraient à satisfaire le niveau requis ?
M. Pascal Savoldelli. - Madame le rapporteur spécial, vous avez évoqué votre volonté d'examiner une restriction du rôle des structures associatives, ce qui a le mérite de clarifier le débat. Ma question est très simple : conservons-nous une doctrine d'intégration - en admettant que certaines spécificités culturelles puissent être maintenues - ou décidons-nous d'adopter une doctrine d'assimilation ?
Alors que nous cherchons à juste titre à améliorer l'efficience de l'action publique, je tiens à citer le rapport que la Cour des comptes a consacré à la politique de lutte contre l'immigration irrégulière l'année dernière : « La plupart des préfectures sont surchargées, commettent régulièrement des erreurs de droit face à un cadre juridique particulièrement complexe, et rencontrent des difficultés à respecter les délais légaux. En outre, elles n'assurent quasiment plus la défense contentieuse de leurs décisions devant les juridictions administratives. Celles-ci sont également saturées par ce contentieux de masse, qui a représenté 41 % des affaires des juridictions administratives en 2021. »
De manière tout à fait légitime, nous contrôlons aujourd'hui le rôle des associations, mais effectuons-nous la même démarche pour l'État ? Le coût de ces dysfonctionnements a-t-il été estimé ?
Mme Nathalie Goulet. - Je remercie le rapporteur spécial pour ce contrôle, que nous avions été nombreux à souhaiter. En ce qui concerne le CIR, la baisse constatée du nombre de signataires est-elle due aux cas de dispenses ou à des refus de signer ce contrat ? Il serait intéressant de connaître le nombre de personnes dispensées, par nationalité.
Par ailleurs, où en sommes-nous de l'harmonisation de l'administration numérique pour les étrangers en France (Anef) et de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), deux fichiers qui ont été à l'origine d'un certain nombre de dysfonctionnements ?
Enfin, disposons-nous d'une étude comparée de la manière dont les primo-arrivants sont traités dans les pays voisins, à la fois du point de vue des moyens et des procédures ?
M. Christian Bilhac. - Je tiens tout d'abord à exprimer mon désaccord avec le rapporteur général : il n'est pas question de changer de logiciel pour analyser la dépense publique, mais plutôt d'en avoir un !
De nouveau, l'État se défausse en transférant aux associations la gestion du droit d'asile, alors que cette compétence met en jeu l'identité de la France en tant que terre d'accueil. En l'absence de ligne directrice, on bricole, sans réellement savoir ce que l'on fait, ni comment.
Les appels d'offres permettent-ils de choisir le mieux-disant ou aboutissent-ils, en raison des contraintes de prix et de l'absence d'une véritable concurrence, à un partage du gâteau entre les différents acteurs ?
M. Éric Jalon. - Je n'ai aucune difficulté à « changer de logiciel » : qu'il s'agisse de la diminution de la moitié de l'ADA à nombre de primo-demandeurs d'asile équivalent, de la reconfiguration des formations linguistiques en lien avec l'Ofii à la suite de la loi du 26 janvier 2024 ou encore de la réflexion autour de la place des associations dans les CRA, nous montrons qu'il n'existe pas de question taboue, tout en maintenant un équilibre entre l'accès aux droits - qui doit être garanti - et la pertinence de notre organisation du point de vue des dépenses publiques.
En revanche, il nous est plus difficile de suivre les prestations d'hébergement et d'accompagnement, qui doivent être différentes selon qu'il est question d'une personne qui n'a pas vocation à séjourner sur le territoire - si elle fait l'objet d'une procédure « Dublin », par exemple - ou d'une personne qui a vocation à s'intégrer durablement - si elle bénéficie du statut de réfugié.
En effet, accompagner et héberger ces personnes est un métier que l'État ne maîtrise pas : il n'est donc pas question de se défausser, mais de s'appuyer sur des compétences développées par des opérateurs aux statuts variés. Adoma est ainsi une filiale du groupe CDC Habitat, tandis que d'autres structures portent la double casquette d'opérateur de l'État et de porteur de plaidoyer : dans la mesure où nous avons avec eux une relation de commanditaire à opérateur, nous souhaitons progressivement sortir du régime des subventions, car cela contribuera à clarifier la situation.
En ce qui concerne l'enchevêtrement des normes, je rappelle que la loi de janvier 2024 a apporté une série de simplifications, notamment en matière de contentieux, conformément au schéma préconisé par le Conseil d'État. Le contentieux a été ainsi radicalement simplifié dans le domaine du droit des étrangers, tandis qu'une série d'obstacles à la mise en oeuvre de la lutte contre l'immigration irrégulière a été levée par ladite loi, d'où une augmentation du nombre d'éloignements de 27 % entre 2023 et 2024 : la simplification des procédures et la levée des entraves peuvent donc se traduire par une efficacité accrue.
Pour ce qui est de la coordination, le conseil des ministres a adopté le 22 janvier un décret refondant le comité interministériel de contrôle de l'immigration. Ce dernier doit être l'instrument d'une meilleure coordination et devrait être installé prochainement, ce qui répond à l'une des recommandations de la Cour des comptes.
Monsieur Dossus, il n'est pas question de priver les étrangers placés en rétention de l'accès aux droits ou de la possibilité d'exercer un recours, mais il faut garder en tête une récente décision du Conseil constitutionnel rappelant que l'accès à l'aide juridictionnelle est inconditionnel, quel que soit le statut du demandeur. Un étranger en situation irrégulière dispose donc d'un droit inconditionnel à bénéficier de cette aide et il me semble légitime de nous demander si nous ne payons pas deux fois, d'une part pour la prestation d'accompagnement juridique d'une association, d'autre part pour l'aide juridictionnelle versée aux avocats.
Il convient donc de distinguer ce qui relève de l'information juridique - qui peut être apportée par l'Ofii, largement présent dans les centres de rétention - de l'appui au recours. S'orienter dans cette direction suppose que les personnes placées en rétention soient informées dès leur entrée dans le centre - et non pas uniquement au moment de leur rencontre avec le juge des libertés et de la détention (JLD) - de la possibilité de demander l'appui d'un avocat ou l'aide juridictionnelle.
Monsieur Savoldelli, le droit est assez clair : le terme « intégration » n'empêche pas de rehausser le niveau d'exigence linguistique et l'introduction d'un examen civique au moment de la délivrance des titres de séjour, en particulier lorsque ces derniers deviennent pluriannuels ; le terme « assimilation », quant à lui, est inscrit dans notre droit positif puisqu'il est utilisé dans le code civil au sujet de l'accès à la nationalité française, dans le cadre des procédures de naturalisation.
Quant à la surcharge des préfectures, réelle, elle explique justement la réorganisation du contentieux que j'évoquais. Je rappelle que les mesures d'éloignement, et en particulier les obligations de quitter le territoire français (OQTF), font l'objet d'un nombre de recours très élevé - à hauteur de 80 % ou 85 % - et que 82 % d'entre elles sont confirmées par les tribunaux administratifs. Là aussi, j'espère que la réforme du contentieux permettra des progrès, sans priver qui que ce soit du droit des recours, car, une fois encore, tel n'est pas le sujet.
J'en viens à l'Anef et à l'AGDREF : j'ai lu avec beaucoup d'attention le rapport de la Défenseure des droits publié fin 2024, qui pointe à raison une série de difficultés suscitées par ces systèmes d'information. Cependant, ce travail se penche logiquement sur les atteintes aux droits qui ont été signalées à un moment donné, et des corrections ont pu intervenir après la publication de ce document.
Plus précisément, 83 % des titres de séjour sont désormais délivrés via l'Anef - système le plus récent -, mais nous dépendons, pour une série de fonctionnalités, de l'AGDREF, qui a été développé dans les années 1990 avec le langage Cobol. Or les informaticiens qui le pratiquent encore aujourd'hui sont extrêmement rares et très sollicités par certains établissements bancaires qui utilisent encore ce langage informatique, ce qui nous pose des problèmes de recrutement. Notre objectif prioritaire consiste donc à rendre le premier outil indépendant du second, ce qui semble envisageable pour la fin de l'année 2025.
Cela étant, le nombre d'anomalies a reculé de 85 % entre la fin 2023 et le début de l'année 2025, car j'ai décidé de consacrer la moitié des ressources de développement à leur résorption. En outre, nous proposons un dispositif permettant aux usagers en butte à des difficultés techniques de contacter le centre de contact citoyens de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Si ce dernier ne parvient pas à résoudre le problème, nous reprenons la main : ces cas ne représentent que 0,4 % de l'ensemble des titres délivrés chaque année par les préfectures.
Je reste disposé à échanger sur le sujet, car ces erreurs sont synonymes de ruptures de droits pour les intéressés et représentent un motif d'insatisfaction légitime pour des étrangers qui peinent à obtenir le renouvellement de leurs titres de séjour.
Enfin, monsieur Bilhac, l'État ne se défausse pas en matière de droit d'asile compte tenu des financements qu'il y consacre, tandis que l'Ofpra et la CNDA statuent de manière autonome sur les demandes. En matière d'accompagnement, l'État s'appuie sur des opérateurs disposant des compétences qu'il ne possède pas en interne.
M. Didier Leschi. - Il est toujours possible de s'interroger sur le transfert des missions de l'État aux associations. Un sénateur célèbre, Jean-Pierre Chevènement, s'était opposé à ce mouvement.
En matière de logement et l'hébergement, je rappelle que nous pratiquons l'orientation directive pour les demandeurs d'asile. Notre mission consiste à nous assurer que ceux qui obtiennent une protection puissent poursuivre leur parcours d'insertion : dans ce cadre, une attention particulière est en effet accordée au logement social.
Depuis qu'une poussée migratoire importante est survenue, 20 % du parc d'hébergement est situé dans des départements de moins de 500 000 habitants, une volonté de déconcentrer l'accueil et de procéder à une meilleure répartition sur le territoire national s'étant exprimée. Pour autant, nous ne disposons pas de mécanisme directif pour imposer un lieu de résidence à ceux qui ont obtenu une protection ; d'autres pays, dont l'Allemagne, ont au contraire opté pour ce type de mécanisme, et cette question doit être tranchée par le législateur.
En ce qui concerne la dépense publique, je rappelle que le Sénat a décidé la gratuité des cours de français, à l'inverse de ce qui est pratiqué par la plupart des pays européens. Sans doute pourrions-nous réfléchir à l'engagement financier de ceux qui demandent un titre de séjour, non pas en leur demandant d'assumer l'intégralité du coût du service, mais en sollicitant une participation qui existe pour d'autres dispositifs.
Le contenu des niveaux linguistiques est quant à lui déterminé par l'éducation nationale, le ministère de l'Intérieur n'ayant pas de compétence en la matière.
Sur un autre point, toutes les personnes qui en relèvent signent le CIR. Il existe en revanche des dérogations quant à l'obligation d'en conclure un. L'exception la plus notable concerne les Algériens, qui ne sont pas soumis à l'obligation de signer ce contrat - ni à l'exigence du niveau de langue -, ce qui explique le décalage que mentionnait Mme Goulet.
J'en viens à la confiance en matière d'information juridique, en précisant que je ne nourris aucun grief à l'encontre des associations, quelles qu'elles soient. Cela étant, il est parfois déroutant, pour un agent de l'Ofii intervenant dans un CRA, d'être confronté à un personnel associatif dont on sent bien que l'action qu'il mène sur le terrain va à l'encontre de la philosophie générale du marché public pour lequel sa structure a été mandatée. S'il existe là un point à clarifier, les associations sont bien sûr indépendantes et certains de leurs membres sont en droit de considérer que la reconduite n'est pas une politique efficiente en matière de contrôle de l'immigration.
Enfin, le travail des demandeurs d'asile accueillis dans les Cada est autorisé en Belgique en contrepartie du fait qu'ils payent leur hébergement, ce qui ne serait sans doute guère audible en France. J'ajoute que nos voisins belges associent étroitement l'hébergement en Cada et l'action de la police aux frontières, ce qui n'est pas le cas dans l'Hexagone.
M. Arnaud Richard. - Je crois que le décloisonnement des politiques publiques est toujours le bienvenu en termes d'économies, les budgets des programmes 303 et 177 se cannibalisant l'un l'autre.
Pour compléter le propos du directeur général de l'Ofii, le marché public impose de trouver aux personnes réfugiées un emploi et un logement pérennes, dans le cadre d'une philosophie ambitieuse qui a le mérite de placer la politique liée aux réfugiés au coeur de l'ensemble des politiques publiques sur un territoire donné, en particulier en matière d'emploi. Coallia ne se chargeait pas de cette facette par le passé et nous avons dû recruter des conseillers en insertion professionnelle. De manière générale, passer par un marché est sain puisque cela implique un cahier des charges clair qu'il est possible de refuser.
Monsieur le rapporteur général, je n'ai pas nécessairement de réponse à vous apporter sur un changement de logiciel, mais force est de constater que peu d'acteurs se disent complètement satisfaits de la situation actuelle, malgré les montants importants qui sont mobilisés. Je crois pour ma part aux partenariats, notamment avec les collectivités locales, qui n'ont été que peu évoquées jusqu'à présent : si leur rôle est modeste en matière d'immigration et d'asile, Coallia considère notamment les maires comme des partenaires incontournables sur le terrain.
Je ne crois pas, enfin, que l'on puisse parler d'une défausse de l'État en matière d'asile. L'histoire de France aboutit à la situation actuelle, les associations s'étant montrées assez agiles à l'occasion de la création du DNA.
Enfin, j'estime, à titre personnel, que la distinction entre Spada et Guda a fait son temps et qu'il faudrait s'orienter vers un système à la fois plus efficient pour la dépense publique et plus lisible, tant pour les demandeurs d'asile que pour les fonctionnaires.
Mme Sophie Thibault. - Je tiens à revenir sur les raisons pour lesquelles nous n'avons pas procédé à une évaluation de politique publique passant au crible l'efficacité et l'efficience de la politique d'immigration et d'intégration. Une telle évaluation représente en effet un travail de grande envergure, nécessiterait d'associer plusieurs chambres de la Cour et d'organiser des contrôles organiques et des déplacements sur le terrain, ce que nous n'étions pas en mesure d'accomplir dans le délai qui nous était imparti.
Une évaluation de politique publique pourrait donc être envisagée et il serait effectivement pertinent, madame Goulet, de disposer dans ce cadre d'éléments de comparaison avec nos voisins européens.
Malgré tout, ce rapport pose la première brique d'une future évaluation. Afin d'apprécier le niveau d'atteinte des objectifs au regard des sommes engagées, l'État doit lui-même préciser ses attentes, d'où nos recommandations relatives à un référentiel unique des tâches, à l'harmonisation des compétences attendues et au suivi de l'accompagnement social. Sous réserve d'une meilleure définition de ces objectifs, nous pourrions répondre favorablement à une demande d'évaluation de politique publique.
Mme Marie-Carole Ciuntu, rapporteur spécial. - Ce rapport décrit et objective parfaitement la situation, même si le droit comparé nous aurait apporté des pistes de réflexion : soyons persévérants, puisque nous disposons désormais des fondations nécessaires à la poursuite de notre travail.
Je précise qu'il n'est pas question de cibler précisément une association sur l'ensemble de ses actions, même si je maintiens mes propos. Par ailleurs, loin de nous l'idée de supprimer l'assistance et l'information dans les CRA, mais il n'existe pas de tabou et je tiens à rappeler que ces sujets doivent être abordés sans passion.
À ce titre, monsieur Dossus, je rappelle qu'il est ici question d'asile et d'intégration et je conteste votre affirmation selon laquelle nous rendons la vie impossible aux étrangers en leur imposant des tests, ce qui entraînerait une hausse des coûts. Il s'agit au contraire de renforcer l'apprentissage de la langue - à un niveau qui reste faible - avec la volonté de faire en sorte que la France accueille dans de bonnes conditions : je tiens à dissiper toute confusion sur ce point. Je me réjouis, enfin, que la Cour des comptes se dise disposée à poursuivre ce travail.
M. Claude Raynal, président. - Merci pour vos apports respectifs sur un sujet d'une grande complexité.
La commission a autorisé la publication du rapport de la Cour des comptes, ainsi que du compte rendu de la présente réunion en annexe à un rapport d'information du rapporteur spécial.
ANNEXE :
COMMUNICATION DE LA COUR DES COMPTES
À LA COMMISSION DES FINANCES
Consultable uniquement au format PDF
* 1 L'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés vulnérables n'était toutefois pas intégré au périmètre de la présente enquête, la Cour des comptes ayant par ailleurs produit un rapport, publié le 1er octobre 2024, sur Les relations entre l'État et les gestionnaires de structures d'hébergement.
* 2 Voir infra.
* 3 Apprentissage du français et des valeurs civiques : davantage de moyens et toujours pas davantage de réussite, rapport d'information n° 772 (2023-2024), déposé le 24 septembre 2024, Mme Marie-Carole CIUNTU.
* 4 Niveau d'utilisateur élémentaire (niveau introductif ou de découverte)
* 5 Voir infra.
* 6 Idem.
* 7 Dispositif dit « Dpar », non traité par l'enquête.
* 8 Le premier accueil des demandeurs d'asile est assuré par les SPADA, qui matérialisent la porte d'entrée de la demande d'asile. Elles assurent également d'autres missions, notamment s'agissant de l'accompagnement des demandeurs d'asile qui n'ont pas encore été orientés vers un hébergement par l'OFII. Chacune des SPA est gérée par une seule association, responsable d'exécuter l'ensemble des prestations prévues au marché. En 2022, le maillage territorial a été renforcé avec six nouvelles implantations, pour un total de 68 structures.
* 9 Voir infra. Le programme d'accompagnement global et individualisé des réfugiés (Agir) a été lancé en 2022. Il s'appuie sur la constitution, dans chaque département (tous les départements devaient être couverts en 2025), d'un guichet unique de l'intégration des bénéficiaires de la protection internationale par l'accès à l'emploi et au logement. L'opérateur Agir a la charge, sous l'autorité du préfet, d'assurer la coordination entre tous les dispositifs et programmes existants dans le département. L'entrée effective dans le programme se réalise au moment du premier entretien de signature du CIR, qui s'articule autour de l'accès aux droits, au logement et à l'emploi.
* 10 Niveau d'utilisateur élémentaire (niveau introductif ou de découverte).
* 11 Ils peuvent bénéficier d'un accompagnement vers l'emploi et le logement durable par l'association gestionnaire de leur centre d'hébergement pour demandeur d'asile, dans lequel ils sont autorisés à se maintenir pendant six mois après l'obtention de la protection internationale. Les plus vulnérables d'entre eux peuvent être accueillis dans un centre provisoire d'hébergement (CPH), qui leur proposera un accompagnement ciblé pendant au moins neuf mois. Enfin, s'ils ne sont pas hébergés, ils peuvent être accompagnés par les SPADA ou les plateformes Agir.
* 12 Article L.744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
* 13 Document de politique transversale, Politique française de l'immigration et de l'intégration, annexé au projet de loi de finances pour 2025. En outre, ce coût, auquel contribuent 19 programmes répartis au sein de 12 missions budgétaires, prend en compte les dépenses directes et orientées à titre principal vers les étrangers. Le coût complet des forces de sécurité intérieure, de l'hébergement d'urgence et de l'enseignement scolaire n'est par exemple que partiellement intégré.
* 14 S'il convient de noter qu'à compter de 2022, ont été accueillis en France les bénéficiaires de la protection temporaire des Ukrainiens à la suite du déclenchement d'un conflit par la Russie, cet élément ne suffit pas à expliquer l'intensité de la hausse des coûts.
* 15 « Jaune » budgétaire relatif à l'effort financier de l'État en faveur des associations annexé au projet de loi de finances pour 2024. Selon ce document, 1,001 milliard d'euros avaient été transférés aux associations par la mission « IAI » en 2022.
* 16 Réponses de la DGEF au questionnaire du rapporteur spécial, octobre 2023.
* 17 Voir infra.
* 18 Et le test de positionnement linguistique et la certification de niveau.
* 19 Voir infra.
* 20 Le rapporteur spécial rappelle que la hausse est de près de 130 % entre 2014 et 2023.
* 21 Le coût annuel de l'accompagnement social par place d'hébergement aurait ainsi évolué de 2 553 € en 2019 à 3 043 € en 2023, soit une progression de 19 %, toutes structures confondues.
* 22 Niveau d'utilisateur élémentaire (niveau introductif ou de découverte).
* 23 Voir infra.
* 24 Publié le 1er octobre 2024.
* 25 Le DNA regroupe différents types de centres d'hébergement dédiés à héberger principalement les personnes en instance de demande d'asile. S'y ajoutent des places en faveur des réfugiés vulnérables.
* 26 La Cour indique que le prix de la journée par place occupée dans une structure d'hébergement sert de base au paiement des associations, et est généralement indiqué dans les appels à projet, et les notes d'information sur la création de places.
* 27 Notamment par la validation des curriculums vitae des formateurs par exemple et l'organisation de réunions de suivi.
* 28 Voir infra.
* 29 Voir supra.
* 30 Les ESSMS (CADA et CPH pour ce qui concerne le champ de l'enquête), sont soumis à un type de contrôle supplémentaire : l'évaluation externe (confiée à des organismes tiers), qui intervient tous les cinq ans. En 2023, 23 CAES ont été évalués dans ce cadre en 2023, et 11 CPH. Cependant, la DGEF ne disposerait pas des données agrégées relatives aux résultats d'évaluation des structures du dispositif national d'accueil, qui sont seulement accessibles par la Haute autorité de santé.
* 31 Dans le cadre des marchés de formations civiques, 30 516 euros de pénalité auraient ainsi été appliqués (pour un montant initial du marché de 2,7 millions d'euros) et dans le cadre des marchés de positionnement linguistique et de certification, une pénalité de 3 816 euros (pour un montant initial du marché de 541 685 euros).
* 32 Ainsi, en 2023, une salariée de la Cimade au centre du Mesnil-Amelot a été agressée par une personne en rétention administrative. L'association a décidé de retirer ses équipes pendant 44 jours, du 2 février au 18 avril 2023. La DGEF a procédé à une réfaction proportionnelle à l'absence de service fait.
* 33 Voir infra.
* 34 Voir supra.
* 35 Décision n° 2024-1091/1092/1093 QPC du 28 mai 2024.
* 36 La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle.
* 37 Selon, respectivement, les données de l'OFPRA et du ministère de l'Intérieur.
* 38 Données du ministère de l'Intérieur.
* 39 Voir supra.
* 40 Décret n° 2024-124 du 21 février 2024 portant annulation de crédits, qui avait annulé un peu plus de 10 milliards d'euros à l'échelle du budget de l'État.
* 41 Cette évolution a été seulement légèrement compensée par une ouverture de crédits dans le cadre de la loi n° 2024-1167 du 6 décembre 2024 de finances de fin de gestion pour 2024, à hauteur, en cumulé, de 5,6 M€ en AE et de 47,3 M€ en CP.
* 42 Le budget pour 2025 intègre pour la première fois dans les crédits initiaux les dépenses afférentes à l'accueil des personnes fuyant l'Ukraine et bénéficiaires de la protection temporaire (BPT).
* 43 Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
* 44 Niveau d'utilisateur élémentaire (niveau intermédiaire ou usuel).
* 45 L'OFII a, dans ce contexte, lancé deux marchés expérimentaux dont l'un en Bourgogne-Franche-Comté, via la mise en place d'un parcours obligatoire de 200 heures visant l'atteinte du niveau A2, soit à l'issue du parcours de formation linguistique « classique » permettant d'approcher le niveau A1, soit dès l'orientation par la plate-forme d'accueil pour les signataires évalués en A1 et à ce jour dispensés de formation linguistique. Cette expérimentation a débuté le 1er mars 2024.