II. CRISE DE LANGUEUR ÉCONOMIQUE
«
L'économie a souffert de la crise, le
secteur bancaire non.
»
Jézabel
Couppey-Soubeyran,
maître de conférences en sciences
économiques
à l'université Paris I.
Les gouvernements et les banques centrales n'ont ménagé ni les réunions mondiales, régionales et locales, ni les lois et les règlements, ni les milliers de milliards pour sortir le système financier de l'embolie à laquelle son autorégulation l'avait conduit.
S'il n'est pas plus stable aujourd'hui qu'avant la crise, voire par certains de ses côtés encore moins, si les raisons d'inquiétude sont toujours là, constatons qu'après une baisse spectaculaire durant la crise la valeur des actifs bancaires a été largement reconstituée.
Pour les banques françaises, elle est passée de 7 000 milliards d'euros en 2007 à 8 500 milliards d'euros en 2014 (dont 6 037 milliards d'euros pour les quatre banques systémiques, chiffre de 2015).
L'activité sur les produits dérivés est toujours florissante au niveau mondial. L'encours notionnel des produits dérivés s'élevait à 625 000 milliards de dollars en 2012. De même, le shadow banking qui, comme son nom ne l'indique pas, se situe dans l'orbite des banques, aurait dépassé, selon le Conseil de stabilité financière, institution parente du G20, 67 000 milliards de dollars d'activité, ce qui équivaut environ à la somme des PIB de tous les pays de la planète.
« Bénéfices impressionnants » des banques américaines en 2015 peut titrer Le Monde le 21 janvier 2016. Les six plus importants établissements ont réalisé 91 milliards de dollars de bénéfices.
Les banques européennes apparaissent comme la seule véritable ombre au tableau. Moins profitables que leurs homologues américaines, leur valorisation bancaire, après une courte remontée en 2011, est retombée au niveau de la période de crise.
Il faut dire que l'existence de mastodontes en grande difficulté pèse lourdement dans ces résultats.
Tout cela n'est rien cependant à côté de l'état de l'économie.
A. UNE SORTIE DE CRISE EN TÔLE ONDULÉE
Après une crise, la période qui suit peut prendre trois formes.
• Une reprise économique forte
Elle permet plus ou moins rapidement de retrouver le niveau de croissance passé ; c'est ce que prévoit la théorie et qui s'est, au cas japonais près, réalisé jusqu'à ces dernières années.
• Un nouvel effondrement économique
Il survient après une période plus ou moins longue de redressement trop fragile pour durer. Cela pourrait être le cas de la Russie, qui connaîtra trois crises sévères entre 1998 et 2014.
Trop dépendante de ses exportations de matières énergétiques, elle retrouvera des taux de croissance largement supérieurs à 5 % entre 2000 et 2008, avant de pâtir de la crise mondiale en 2009 et de l'effondrement des cours du pétrole à partir de 2014.
Il n'est pas impossible non plus que la Chine ait du mal à se relever de la crise mondiale, qui a provoqué un effondrement de son taux de croissance en 2009. Cela reste la grande inconnue.
• Une interminable convalescence, dite en « tôle ondulée »
Elle se caractérise par une reprise de l'activité mais à un niveau en moyenne inférieur à celui de l'avant-crise, régulièrement ponctuée de baisses et de hausses, pouvant laisser présager, tantôt un nouvel effondrement, tantôt la fin de la crise.
C'est ce que vit le Japon.
C'est ce à quoi ressemble la situation actuelle de l'Europe et, quoique à un niveau moyen de croissance supérieur, celle des États-Unis.
Aux États-Unis, entre 2010 et 2015, les taux de croissance annuelle oscillent entre 2,5 % et 1,5 %. Ceux de la zone euro et de l'Union européenne à vingt-huit, entre 1 % et - 0,4 %, l'Union européenne à vingt-huit étant plus souvent proche du maximum que la zone euro.
Croissance en berne, sous-utilisation des capacités productives, haut niveau de sous-emploi, telles sont les caractéristiques de la situation.
1. Une croissance en berne
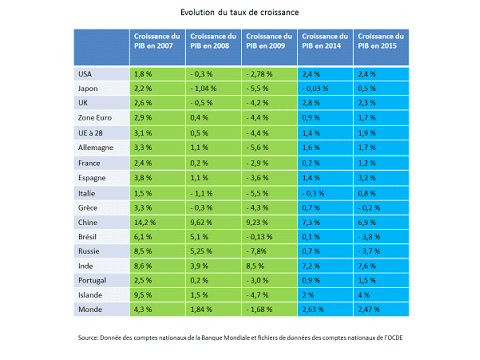
Globalement, dans tous les pays, la crise a entraîné une chute brutale du taux de croissance, dès 2008 et plus nettement encore à partir de 2009.
Celle-ci a été immédiatement suivie d'une reprise importante en 2010 - sauf cas particulier, comme la Grèce -, qui parfois se prolonge sur 2011 - France, Pays-Bas, Grande-Bretagne. On retrouve le modèle standard, la reprise suivant inéluctablement l'effondrement. On se souvient de cette déclaration au micro de RTL d'Éric Woerth alors ministre du Budget, le 26 septembre 2008 : « La crise est venue d'une manière extrêmement violente mais la reprise peut être extrêmement forte. »
En même temps l'inflation repart, la sortie de crise paraît acquise.
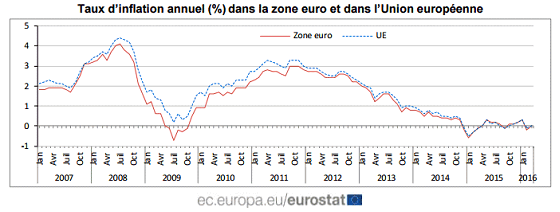
À partir de là, on entre dans une configuration nouvelle. Au lieu d'une confirmation de la reprise, contrairement aux prévisions, dès 2011, souvent et plus encore dans la zone euro en 2012, la croissance baisse de nouveau puis semble se stabiliser, et ce à un niveau inférieur à l'avant-crise pour l'ensemble des pays. Tous les pays industrialisés de l'OCDE sont concernés.
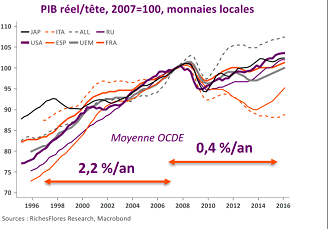
C'est probablement dans la zone euro que le phénomène est particulièrement net, zone euro qui a le plus de mal à se remettre de la crise. Cela dit, bien que restant à un niveau élevé - à la fiabilité des statistiques près -, le taux de croissance de la Chine a été divisé par deux, passant sous la barre des 7 %, considérée comme le plancher en deçà duquel le consensus politique de la modernisation lancée par Deng Xiaoping risquerait d'être remis en cause.
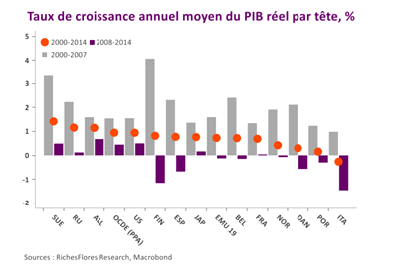
Le taux de croissance semble se caler sur celui du Japon, en déflation depuis 1990.
2. Une baisse de l'investissement et une sous-utilisation des capacités productives en Europe
Le graphique suivant, issu d'un rapport de la Banque européenne d'investissement publié en 2013 193 ( * ) , présente le taux d'utilisation des capacités de l'industrie européenne. Il s'agit de l'investissement total (y compris immobilier) et en machines et équipements productifs.
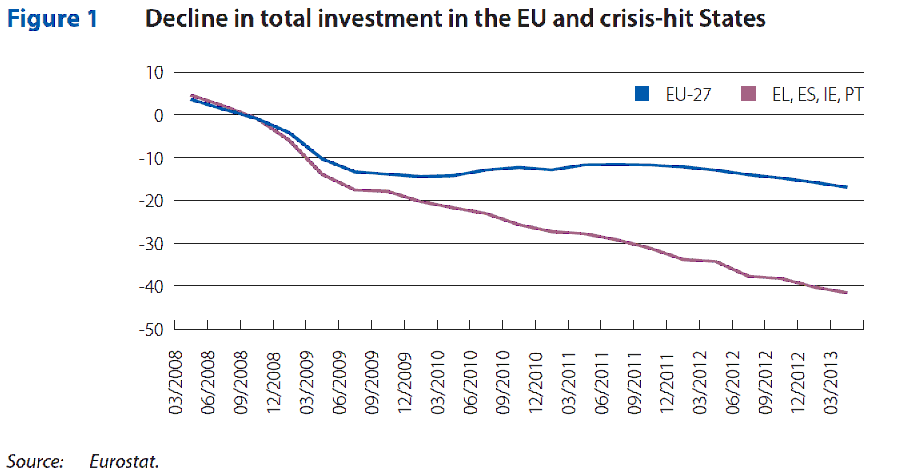
Le tableau ci-dessous, tiré d'une note de la Société Générale 194 ( * ) , illustre l'écart entre la production réelle et celle que permettrait le potentiel économique s'il était pleinement utilisé.
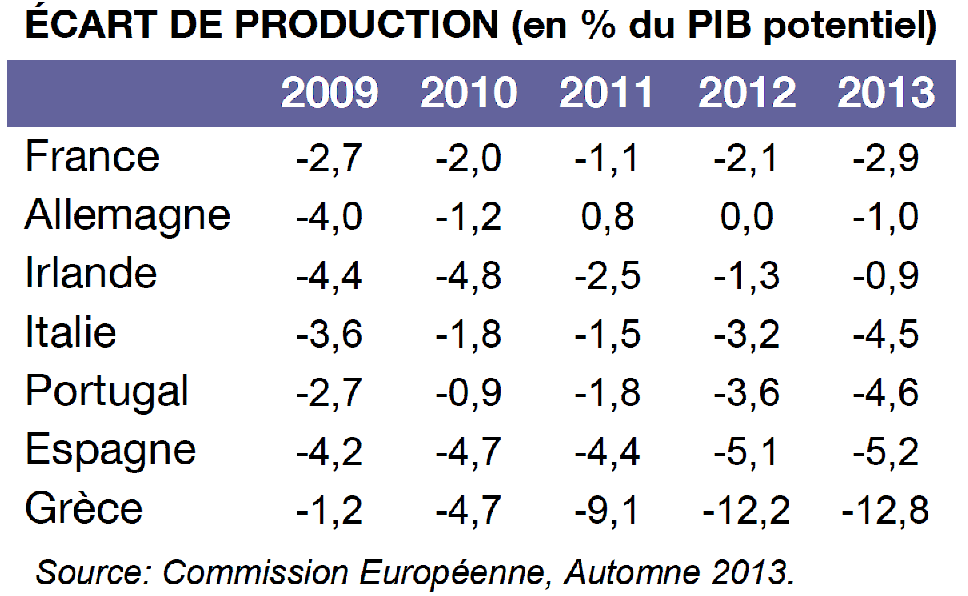
3. Des niveaux de chômage améliorés au prix du sous-emploi et d'une dégradation des conditions de travail
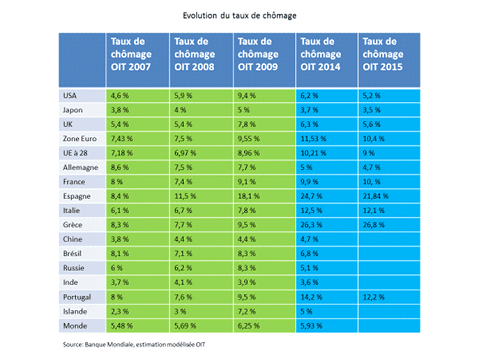
a) Quel niveau de chômage ?
Les taux de chômage officiels restent généralement plus élevés qu'avant la crise, quoique en réduction par rapport à leur point haut de 2007, avec des exceptions là aussi. Ils masquent des réalités non seulement moins brillantes mais encore plus contrastées.
Comme on s'en doute, en effet, les modes de calcul des taux de chômage, évidemment variables d'un pays à l'autre, présentent un certain nombre de biais, qui, s'ils ne faussent pas la perception des évolutions en tendance, minimisent fortement le nombre de personnes ne trouvant pas leur place sur le marché du travail et, donc, dans la société.
Si on recalcule le taux de chômage en intégrant les personnes qui ont été découragées de rechercher un emploi de plus en plus aléatoire et celles qui, faute de mieux, travaillent à temps partiel contraint et forcé, les résultats sont nettement différents.
|
Taux de chômage
recalculé
|
On constate d'ailleurs que l'écart entre taux officiels et taux recalculés est d'autant plus important que le marché de l'emploi est dégradé, ce qui est compréhensible dans la mesure où les demandeurs d'emplois sont d'autant plus dissuadés de chercher un emploi qu'ils ont peu de chance de réussir. Ainsi, à cette aune, les États-Unis sont loin du plein emploi malgré les bons chiffres officiels - taux légèrement supérieur à 5 %.
Si l'on réintègre dans la cohorte des chômeurs officiels les personnes qui, désireuses de travailler, n'ont pas effectué les démarches nécessaires, on obtient un taux de chômeurs proche de 8,5 %. Si l'on ajoute celles qui travaillent à temps partiel sans l'avoir voulu - on est considéré comme travaillant à temps partiel à partir d'une heure de travail par semaine -, on obtient un taux supérieur à 12 %.
Par ailleurs, le taux de participation des 25-54 ans - nombre d'actifs par rapport à la population concernée - baisse.
Il y a bien une amélioration de la situation par rapport à 2009-2010, mais on n'a pas encore retrouvé celle d'avant-crise. Surtout, le chômage reste à un niveau élevé.
Il y a bien aussi une baisse du nombre d'emplois à temps partiel par rapport à la période de crise où ils avaient été massivement utilisés, mais celui-ci reste élevé.
Surtout, sur la période 2008-2015, le salaire médian réel (hors inflation) aura baissé de plus de 4 %.
Les chiffres ci-dessus et les graphiques suivants sont largement empruntés à Prime View (octobre 2015 pour les États-Unis et avril 2016 pour l'Europe) ainsi qu'au blog de Philippe Waechter 195 ( * ) , directeur de la recherche économique chez Natixis Asset Mangement.
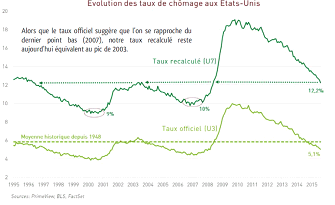
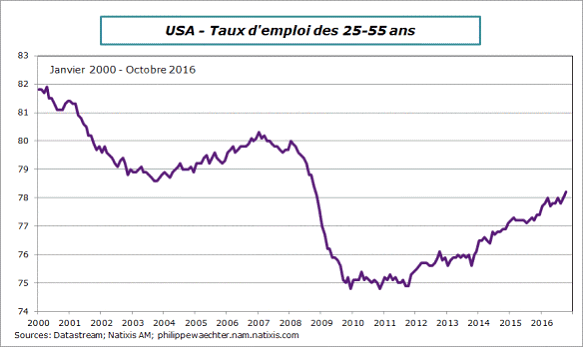
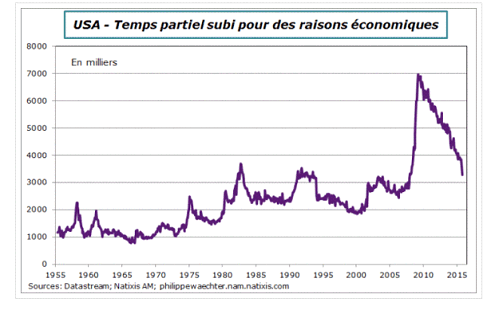
Les chiffres européens sont tout aussi impressionnants.
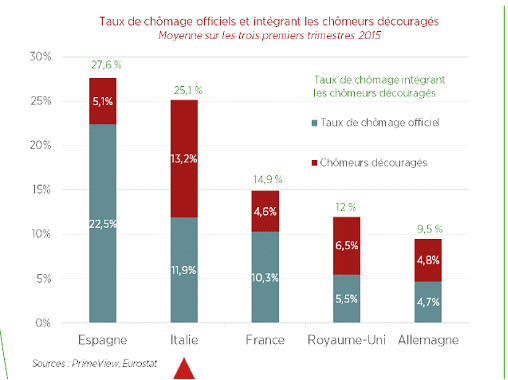
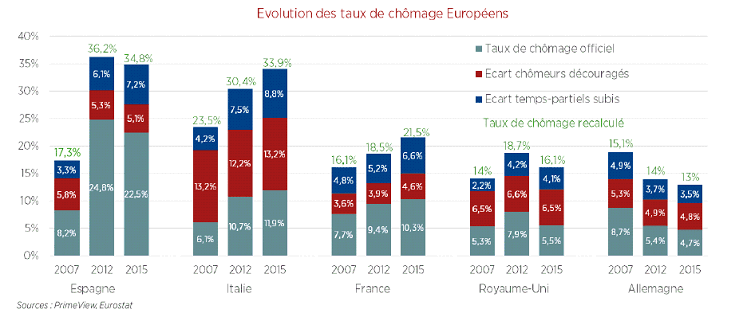
On remarque la situation particulière de l'Allemagne et du Royaume-Uni, ainsi que les taux faramineux atteint par l'Espagne et l'Italie.
S'agissant de la France, selon les chiffres officiels, la croissance continue du chômage, stabilisée depuis la fin de 2014, s'est inversée au second trimestre 2016, à 9,6 %, un niveau cependant supérieur à l'avant-crise. En revanche, le taux d'emploi des 15-64 ans a retrouvé son niveau d'avant-crise.
b) La dégradation des conditions de travail
Ces chiffres masquent des pondérations différentes des remèdes utilisés contre la crise : longueur moyenne du temps de travail annuel, importance du travail à temps partiel, rémunération du travail.
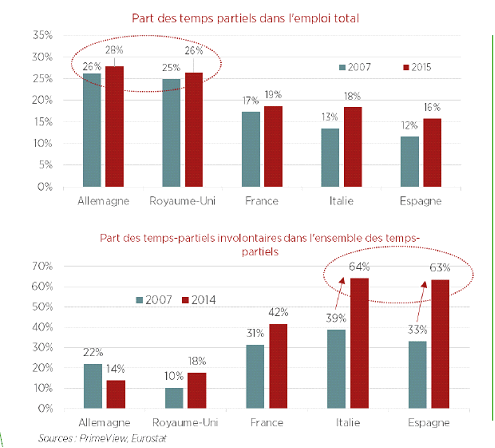
Il apparaît que les Britanniques ont privilégié la baisse des salaires, levier qu'avait déjà utilisé l'Allemagne avant la crise. Britanniques et Allemands ont également recouru au travail à temps partiel. Dans ces deux pays, ce type d'emploi représente structurellement plus du quart des emplois. Cela explique que, durant la crise, l'augmentation du temps partiel a été moins forte et surtout mieux ressentie qu'en Italie, Espagne ou France.
L'Allemagne a utilisé le chômage partiel durant le gros de la crise et l'augmentation des emplois à temps partiels ensuite. La réduction du temps de travail observée a pour origine l'augmentation des emplois à temps partiel et non un « partage » administré de ce temps de travail. Le coût du partage repose non pas sur l'entreprise, mais sur l'employé.
En revanche, le Royaume-Uni a surtout utilisé la « modération » salariale : le salaire réel moyen a baissé de plus de 6 % entre 2007 et 2014. Résultat : baisse des salaires assortie d'une augmentation du temps partiel et du nombre d'heures ouvrées !
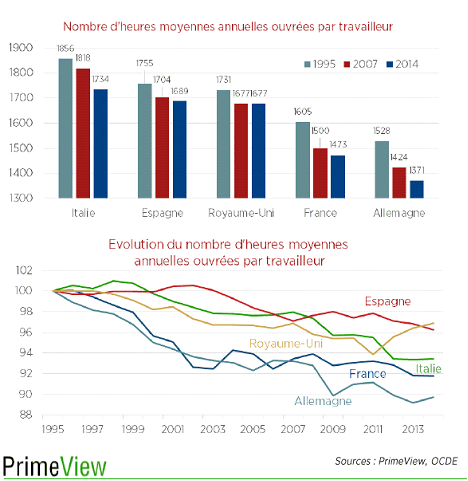
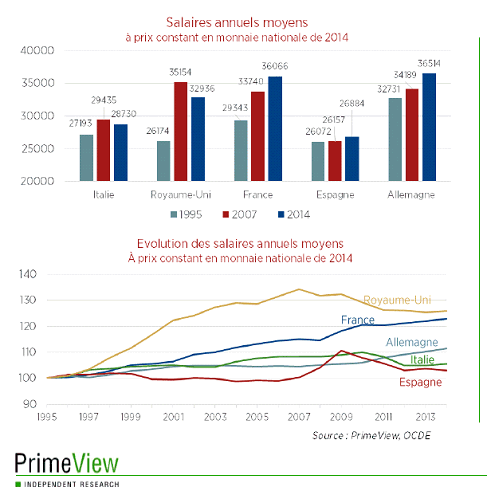
c) Partout, une insertion des jeunes toujours aussi difficile
La baisse du taux de participation des 15-24 ans renvoie, certes, à l'allongement des études mais aussi à la difficulté permanente de leur accès à un marché du travail très dégradé.
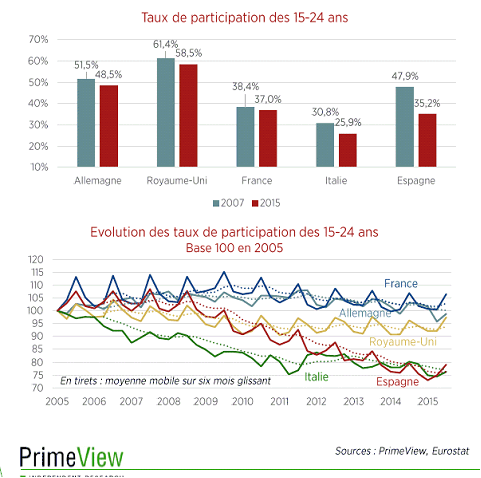
* 193 L'investissement et le financement d'investissements en Europe - Banque européenne d'investissement - 14 novembre 2013.
* 194 Marie-Hélène Duprat - EcoNote n° 22 - Département des études économiques de la Société Générale - Décembre 2013.
* 195 www.philippewaechter.nam.natixis.com







