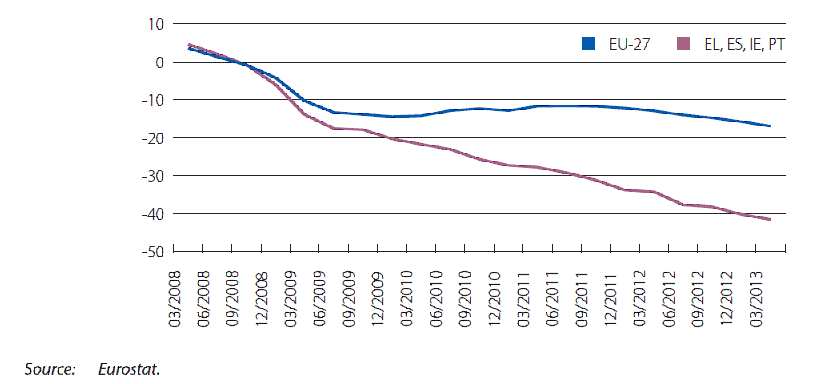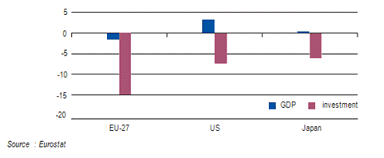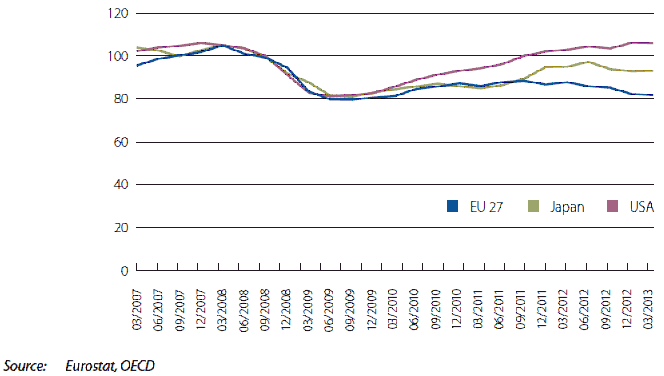B. LES ÉTATS-UNIS ET L'EUROPE FACE À LA CRISE
1. Des problèmes communs
Sur le fond, les États-Unis et l'Europe, confrontés aux mêmes problèmes, ont eu le même type de réponses et la même incapacité à sortir de leurs contradictions.
Ces contradictions résultent de l'application du modèle économique de l'après-Bretton Woods, dans un contexte tout à fait nouveau. D'où les problèmes insolubles auxquels se trouvent brutalement confrontés les responsables politiques.
a) Comment relancer la machine économique ?
La question doit être précisée : comment relancer une machine économique dont le dynamisme reposait jusque-là largement sur l'endettement, au moment même où le désendettement privé et public devient, selon l'orthodoxie libérale, d'une impérieuse nécessité, sans augmenter les revenus du travail, ce qui nuirait à la compétitivité, sans augmenter - voire en diminuant - le nombre d'agents publics ou les transferts sociaux, pour ne pas nuire à l'équilibre budgétaire ?
Les graphiques suivants sont issus d'une publication de l'économiste Véronique Riches-Flores, fondatrice et présidente de RichesFlores Research 196 ( * ) . Rappelons que depuis la crise l'endettement privé a baissé dans les pays développés 197 ( * ) et que les conditions du travail, y compris les salaires, se sont détériorées 198 ( * ) . En particulier depuis 2008, aux États-Unis, le salaire médian réel (hors inflation) a perdu plus de 4 % 199 ( * ) .
b) Comment relancer le moteur que constitue l'investissement public, sans augmenter l'endettement du même nom ?
Pour le FMI 200 ( * ) , relancer l'investissement public est en effet indispensable ; à condition de respecter certaines règles :
« L'augmentation de l'investissement public a un effet particulièrement fort sur la production si : 1. Cet investissement intervient en période de ralentissement économique et de politique monétaire accommodante, cette dernière limitant la hausse des taux d'intérêt face à l'accroissement de l'investissement. 2. L'efficience de l'investissement public est élevée, en ce sens que le surcroît de dépenses d'investissement n'est pas gaspillé, mais alloué à des projets ayant un rendement élevé. 3. L'investissement public est financé par l'emprunt, et non par une augmentation d'impôts ou la réduction d'autres dépenses, les deux options entraînant des baisses similaires du ratio dette publique/PIB. »
Mais force est de constater la baisse du niveau de l'investissement public durant la période.
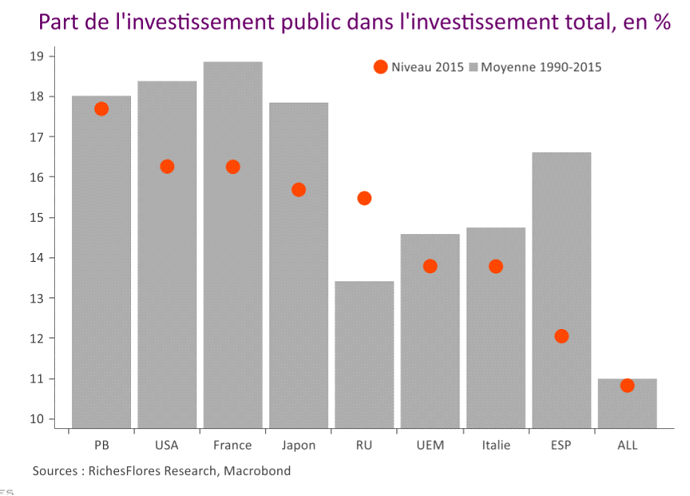
Le graphique ci-dessous est particulièrement instructif, dans la mesure où il montre que même l'endettement public massif de l'État fédéral étasunien s'est accompagné de restrictions budgétaires hors service de la dette : à partir de 2010, le solde primaire devient en effet positif.
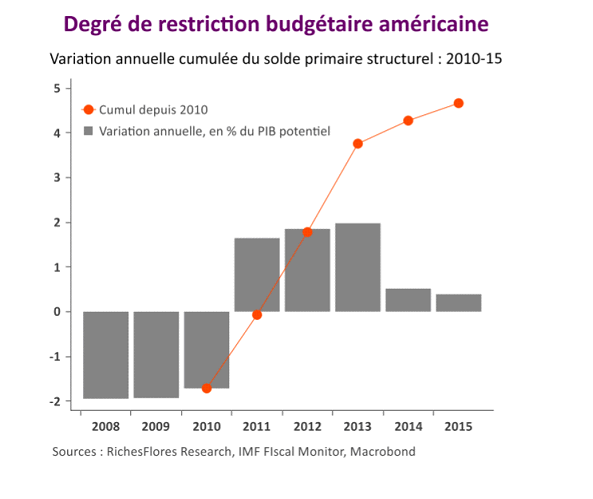
Comme on le verra un peu plus loin, l'effet contracyclique de son solde négatif, entre 2008 et 2010 - financement de l'ARRA notamment -, sera contrebalancé par la politique clairement procyclique des États fédérés, majoritairement gouvernés par des Républicains, qui rétabliront leurs finances en licenciant en masse, en réduisant l'investissement au minimum et en utilisant les ressources transférées par le fédéral pour se désendetter.
Résultat, si l'endettement fédéral s'est bien poursuivi, il n'a pas eu tous les effets escomptés sur l'investissement.
Même constat, évidemment, s'agissant de l'Europe, comme le montre le graphique ci-dessous, sauf que le déficit primaire des années 2008-2010 n'a même pas servi à financer un effort en matière d'investissement.
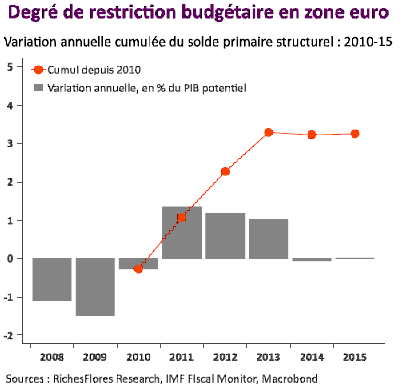
Comme le note l'économiste Véronique Riches-Flores : « La restriction budgétaire a absorbé une trop large partie des effets attendus des politiques monétaires. Le resserrement des politiques budgétaires est intervenu beaucoup trop tôt. Avec un multiplicateur budgétaire minimum de 0,5, il aurait respectivement confisqué 2,5 et 1,5 points de PIB aux États-Unis et en zone euro depuis 2010. La vérité est vraisemblablement supérieure de plus d'un point dans chacun des deux cas. » 201 ( * )
c) Comment relancer la consommation ?
En effet, comment relancer la consommation tout en diminuant le nombre d'agents publics et sans augmenter ni les transferts sociaux, ni les déficits ni les dettes publiques ?
Déficits et dettes sont puissamment dopés par la baisse des recettes consécutives au blocage de l'économie, puis à sa stagnation, pour les premiers, et par le sauvetage du système bancaire, pour les secondes.
Comme le montrent les graphiques 202 ( * ) , la tendance est aussi à la baisse des transferts sociaux.
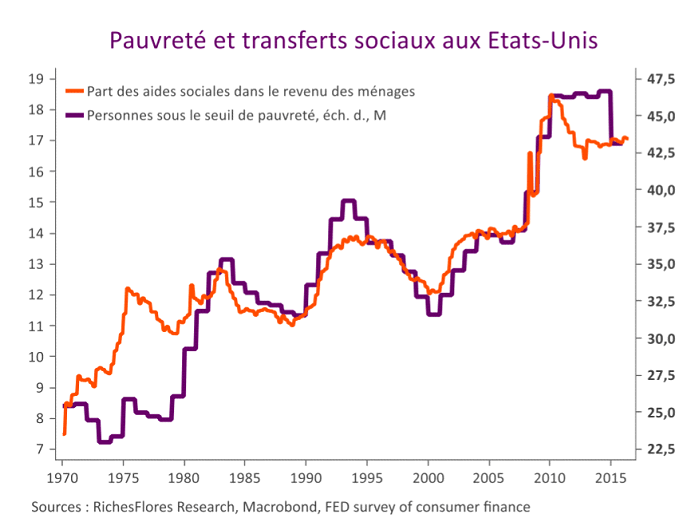
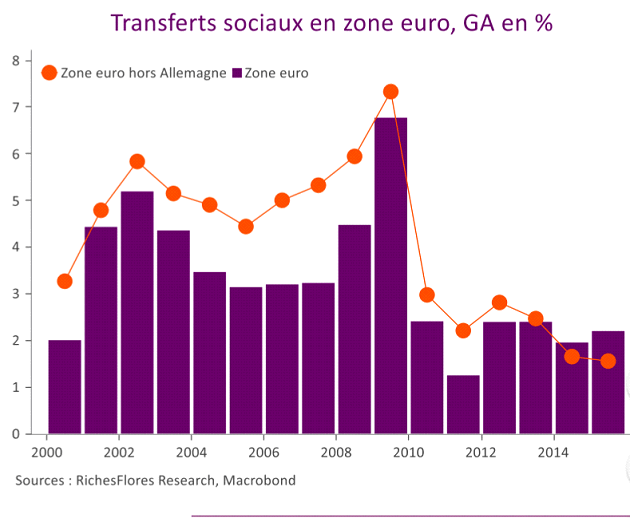
Conséquence : les inégalités ont continué à augmenter aux États-Unis et globalement en Europe, avec des exceptions, les résultats obtenus étant très dépendant des politiques locales et des écarts hérités du passé.
Une reprise par la consommation s'en trouve d'autant entravée.
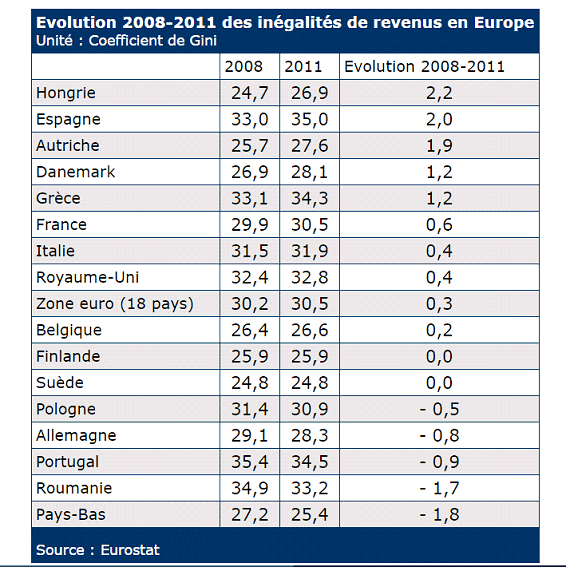
d) Comment faire face aux conséquences économiques du vieillissement de la population ?
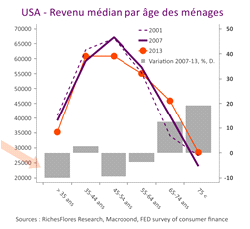
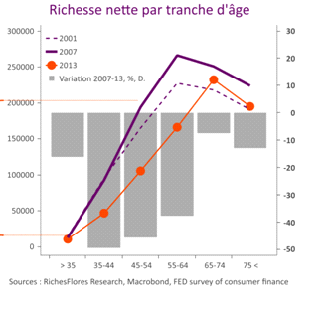
L'essentiel de la richesse se constitue entre 25 et 55 ans. C'est aussi la classe d'âge qui consomme le plus. Or c'est elle qui a été le plus affectée par la crise, notamment dans son volet immobilier. Le nombre des propriétaires, notamment aux États-Unis, chute fortement durant la crise, en même temps que les loyers augmentent.
De plus, le vieillissement de la population entraîne une baisse de la propension à consommer.
e) Comment réduire la spéculation ?
Comment réduire une spéculation qui a failli faire exploser le système financier mais qui, en même temps, est indispensable à son bon fonctionnement et à l'origine des bouffées de croissance économiques qui permettent à la machine de fonctionner ?
Comment mettre en place un système de financement de l'économie réelle qui ne soit pas le diverticule de caution d'utilité sociale d'un système financier parasitaire fonctionnant selon ses propres règles et à ses propres fins ?
Comme nous l'avons vu, le peu qui aura été fait sous l'effet de la panique initiale pour limiter la spéculation sera progressivement désactivé.
Quant au système financier à l'origine de la crise, personne n'envisage sérieusement de le réformer, encore moins de l'utiliser à d'autres tâches que l'enrichissement de ses pratiquants.
f) Comment enfin sortir de l'impasse ?
Comment enfin sortir de l'impasse créée par le remède employé pour stopper l'effondrement du système financier, l'injection massive de liquidités ? Remède du diable qui, certes, a permis de sauver le système financier et, dans un premier temps, de relancer la machine économique, mais qui se révélera non seulement dangereux pour la stabilité du système financier lui-même mais de moins en moins opérant en matière économique.
Reprenant l'expression de Keynes, de plus en plus d'économistes pensent que l'Europe serait tombée dans une « trappe à liquidité », à savoir une situation où :
- les investisseurs, devenus prudents, faute de perspectives économiques de redémarrage économique et de débouchés nouveaux, préfèrent conserver liquides leurs avoirs plutôt que de les investir ;
- les politiques monétaires conventionnelles (baisse des taux directeurs, injection de liquidités) n'ont plus aucun effet sur la croissance économique. Pas plus, d'ailleurs, que les politiques non conventionnelles.
En Europe, cette « trappe » ressemble fort à un gouffre, des taux directeurs proches de zéro et l'injection de liquidités de la BCE alimentant la spéculation plutôt que la croissance économique.
Le problème, c'est qu'arrêter cette politique risquerait d'avoir des conséquences immédiatement catastrophiques. On gagne donc du temps en la continuant.
Toutes choses inégales par ailleurs, la Fed, embarrassée par la bulle d'actif qu'elle a créée (voir supra ) est dans la même situation. Cesser trop brutalement cette politique risque de la crever avec les risques qui vont avec.
g) Au final, le bilan n'est pas brillant
Les déficits et la dette publique ont augmenté au détriment de l'investissement public et sans effet significatif sur les dépenses courantes. La variation des dépenses publiques dépendant essentiellement des taux de croissance et du taux de chômage, la réduction sur dix ans des dépenses courantes des pays de l'OCDE n'a été que de 0,3 %, rappelle Véronique Riches-Flores 203 ( * ) . La principale victime de la rigueur budgétaire a été l'investissement public, alors qu'il est essentiel à toute reprise.
Si l'endettement des ménages a diminué, surtout dans les pays qui en avaient le plus abusé, c'est au prix de leur solvabilité, donc d'une restriction de la demande (consommation et investissement) et d'une baisse des rentrées fiscales potentielles. Les catégories sociales les plus touchées sont celles qui sont les plus susceptibles de stimuler la demande.
En même temps, les salaires réels ont baissé, parfois fortement, et les inégalités ont augmenté.
Au regard de l'attentisme des acteurs économiques, les politiques monétaires accommodantes n'ont abouti qu'à faire tourner un peu plus vite l'économie casino.
Ce bilan vaut globalement pour les deux côtés de l'Atlantique.
Cela dit, force est de constater, s'agissant des pays anciennement développés, que c'est dans la zone euro que les résultats sont non seulement les plus mauvais, mais que les perspectives d'amélioration sont les moins visibles.
Tentons de savoir pourquoi.
2. Des stratégies bien différentes
Face à la crise financière, comme nous l'avons déjà indiqué 204 ( * ) , l'attitude des États-Unis et celle de la zone euro ont été très différentes.
a) Plus grande réactivité et moindre dogmatisme idéologique du côté étasunien
Les États-Unis ont réagi très vite et très puissamment, ne séparant pas sauvetage du système financier et relance économique, alliant : politique des taux directeurs, plan d'aide à la consommation dès 2008 et relance (ARRA) dès 2009, politique massive de quantitative easing . Alors que, jusqu'à l'arrivée de Mario Draghi, la BCE compte sur les banques pour faire repartir l'économie et que les plans européens de relance se limitent à des effets d'annonce.
Autant que libéraux, les États-Unis sont pragmatiques. La vulgate libérale n'y a pas pris la forme de pensée unique et les keynésiens n'y font pas figure de secte exotique. Au contraire, l'existence de figures de premier plan alimente un débat ouvert et public, ce qui n'est pas le cas en Europe, tout particulièrement en France.
On sait là-bas que la stabilité du système financier lui-même, que la sortie de crise effective dépendent du retour de l'économie à son niveau d'activité d'avant-crise, ce qui est impossible sans une politique de relance vigoureuse. Que d'autres forces ou intérêts s'y opposent ne signifie pas que ce type d'intervention soit tenu pour un non-sens, ce qui, jusqu'à une date très récente, était le cas sur le vieux continent.
Pour les orthodoxes européens, les pouvoirs publics n'ont aucune légitimité à intervenir dans le domaine économique. Le retour à bonne fortune de l'économie dépendant d'abord et quasi exclusivement de la restauration du niveau de profitabilité du système bancaire. Priorité au sauvetage du système financier donc, le redémarrage de l'économie viendra de surcroît.
À y regarder de près, les « politiques financières non conventionnelles » et les taux directeurs bas utilisés des deux côtés de l'Atlantique ont des significations différentes.
Pour la BCE , même si elle espère ainsi faire baisser l'euro et donc stimuler l'exportation, il s'agit d'abord de donner les moyens aux banques de prêter à l'économie dans l'espoir de la voir redémarrer. On sait que cet espoir ne fut pas vérifié, les entreprises n'empruntant que si elles ont l'espoir de débouchés et les banquiers préférant des spéculations plus rentables que l'aide aux entreprises 205 ( * ) . Rappelons que, en Europe, 80 % des crédits à l'économie sont d'origine bancaire, contre 20 % aux États-Unis où les entreprises font plus appel aux marchés financiers.
Pour la Fed , en revanche, le QE vise d'abord à maintenir des taux d'intérêts bas favorables à l'activité économique et à éviter un effondrement des obligations, à commencer par celles qui sont émises par les entreprises.
Pour la Fed, le premier des dangers, c'est la déflation. Ainsi Ben Bernanke, l'avant-dernier gouverneur de la Fed, promettait-il de larguer des valises de dollars du haut d'un hélicoptère si elle montrait le bout du nez. Pour la BCE, le premier des dangers, c'est l'inflation d'où, pendant longtemps, sa politique des taux directeurs. Le jour où la BCE, s'apercevant enfin que, sans inflation, il n'y aurait pas de désendettement indolore, l'injection de liquidités et la baisse des taux n'ont plus eu aucun effet.
Interrogé par le journal L'Opinion, Patrick Artus, directeur de la recherche et des études de Natixis, précise : « Personne ne critique les politiques de "quantitative easing" lancées aux États-Unis puis au Royaume-Uni fin 2008, début 2009. Ce qu'on peut blâmer en revanche, c'est la poursuite du QE dans ces deux pays jusqu'en 2014, alors que leurs économies sont reparties depuis longtemps. Et le déploiement de mesures similaires au Japon et en Europe trop tardivement. Qu'espère la BCE quand elle fait du quantitative easing en 2015 ? Les banques de la zone euro sont déjà inondées de liquidités, tout le monde a du cash plein les poches. Le seul effet notable, c'est la dépréciation de l'euro. C'est une politique non coopérative qui a un effet transitoire, car on ne fait pas baisser son taux de change de 15 % tous les ans. » 206 ( * )
b) Un exemple de politique de relance économique keynésienne : l'ARRA
Un exemple parlant de cette différence d'attitude : la politique de relance économique du Gouvernement fédéral étasunien en direction des pouvoirs locaux, États fédérés et autres collectivités durant la crise, alors même qu'administrés majoritairement par des Républicains hostiles, arc-boutés sur une politique de désendettement, ceux-ci faisaient tout pour la faire échouer, notamment en licenciant les fonctionnaires par milliers.
L'ARRA 207 ( * ) , le plan de relance économique des États-Unis, l'un des tout premiers actes de Barack Obama à son arrivée à la Maison-Blanche puisqu'il est engagé dès le mois de février 2009, est sur ce point significatif 208 ( * ) .
L'ARRA représente une politique contracyclique de relance de la croissance et de l'emploi. Un plan de 787 milliards de dollars, soit 5,6 % du PIB de 2009, une politique menée par l'État fédéral, le Trésor et la Fed. Objectif visé : préserver entre 1,2 et 3 millions d'emplois, soit entre 0,7 % et 1,8 % du taux de chômage.
Pour réussir, une telle politique devait s'appuyer sur les États fédérés (et les pouvoirs locaux qui en dépendent), en grande difficulté budgétaire (ces États, sauf le Vermont, doivent respecter la règle d'or de l'équilibre budgétaire en vertu de leur Constitution).
Le problème, c'est que l'aide fédérale, qui représentait environ un tiers du déficit budgétaire local à combler, n'a même pas été utilisée pour maintenir les effectifs de fonctionnaires locaux qui furent licenciés en grand nombre, encore moins pour investir mais essentiellement pour se désendetter. Sous direction très majoritairement républicaine, les États fédérés ont clairement mené une politique procyclique qui a réduit les effets de la politique fédérale. Washington a même eu beaucoup de difficultés à maintenir l'aide sociale à un niveau suffisant.
c) Des résultats en faveur des États-Unis
Qu'il s'agisse de l'emploi, de la croissance et de l'investissement, comme le montrent les graphiques et tableaux ci-après, les résultats sont en faveur des États-Unis.
• Emploi
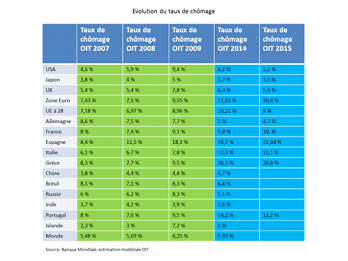
• Croissance
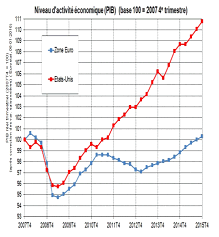

Source : Thomas Piketty (Blog)
• Investissement
Résultats aussi en faveur des États-Unis en matière d'investissement total ou d'investissements importants (Voir graphiques ci-dessous 209 ( * ) ).
|
Recul de l'investissement total
|
|
Recul de l'investissement brut dans l'Union
européenne
Variation de l'investissement et du PIB entre 2008 et
2012
|
|
Évolution de l'indice de formation brute de
capital fixe réelle
Données trimestrielles corrigées des effets de calendrier et des variations saisonnières, calculées en volumes chaînés exprimés en monnaie nationale (année de référence : 2005) et normalisées en fonction de la moyenne des quatre trimestres de 2008. |
Pendant que les États-Unis, au gros de la crise, mobilisaient les finances fédérales pour relancer leur économie, l'Europe surveillait l'équilibre des finances publiques, particulièrement la France, où les collectivités locales, qui pourtant assurent 70 % de l'investissement public civil, verront leurs ressources financières régulièrement amputées. Le redémarrage économique est censé découler mécaniquement et fatalement d'un retour aux équilibres gravé dans le marbre à Maastricht et d'une diminution des ressources de l'État, des collectivités locales et des organismes sociaux. Il n'y a pas à sortir de ça. D'ailleurs on y est resté.
Il faut bien un économiste étasunien de renommée mondiale comme Paul Krugman pour s'en étonner !
« La seule chose à mettre au crédit de l'Europe est paradoxalement celle que l'on critique depuis toujours, à savoir l'ampleur et la générosité de l'État providence, qui a contribué à réduire l'impact de la crise.
« Et elle n'est pas à sous-estimer. La sécurité sociale et l'ampleur des aides en termes d'assurance chômage et d'aide à l'insertion ont contribué à maintenir, du moins jusqu'à maintenant, un niveau de pauvreté sociale bien inférieur à celui que connaissent les États-Unis. De plus, ces programmes permettront de soutenir la consommation en pleine crise.
« Mais de tels "stabilisateurs automatiques" ne peuvent se soustraire à une réelle action.
« Pourquoi l'Europe sombre ? Le manque de gouvernance fait partie intégrante de son histoire. Les dirigeants bancaires européens, qui ont complètement sous-estimé l'ampleur de la crise, se comportent encore aujourd'hui de manière complaisante. Pour entendre aux États-Unis l'équivalent des diatribes d'ignorant proférées par le ministre des finances allemand, il faut se tourner vers, ... eh bien, les Républicains. » 210 ( * )
Paradoxe des paradoxes , donc, c'est par la remise en question de l'héritage de l'État providence qui a limité les dégâts de la crise financière en Europe que ses dirigeants entendent la faire sortir de la crise !
Ce qui incite fortement à penser que les fautes de gouvernance - ce qui, par parenthèse, supposerait qu'il y en eut une - sont loin d'expliquer les difficultés de l'Europe à surmonter la crise. Force est de constater qu'elles renvoient malheureusement à des causes structurelles plus profondes.
3. Les causes structurelles de la stagnation de la zone euro
Si aucune économie ne s'est encore remise, dix ans après le début de la crise des subprimes , si l'Europe et les États-Unis, confrontés à des problèmes communs, ont essentiellement mis en oeuvre des remèdes « libéraux-compatibles », parmi les pays avancés, la zone euro, comme on vient de le voir, est particulièrement à la peine. Si la différence de stratégie face à la crise n'y est certes pas pour rien, elle n'explique pas l'essentiel : un mode de construction de la monnaie unique et des principes de fonctionnement de la zone qui la rendent inapte à la prise des bonnes décisions en temps utile.
a) Une absence de gouvernance politique légitime
Dépourvue d'une gouvernance politique assise sur une légitimité démocratique la rendant capable de décider, l'Europe se trouve privée de capacité de réaction et de décision en temps réel face à une crise sérieuse. Comme l'écrit Paul Krugman dans la tribune précitée : « L'Europe se révèle structurellement faible par temps de crise. » C'est le moins qu'on puisse dire !
Elle le doit à son mode de construction conforme au rêve ordolibéral d'une gouvernance par les règles en lieu et place d'un gouvernement politique 211 ( * ) . Comme s'il suffisait de figer les parités des anciennes monnaie en les assortissant de contraintes budgétaires gravées dans le marbre des traités et de censeurs vigilants chargés de les faire respecter pour régler le problème.
Citons de nouveau Jacques Sapir 212 ( * ) : « Il ne peut y avoir une finance, des marchés de biens libéralisés et un système de change fixe, ce qui est le cas avec l'euro. L'euro n'est pas une monnaie, c'est un système de changes fixes, facteur de rigidités insupportables. Cela bloque la parité des changes entre les pays à un niveau donné. »
Faute d'un mécanisme de redistribution des excédents, cette absence de liberté d'ajustement des parités en fonction de l'évolution des compétitivités respectives est tout particulièrement pénalisante pour les pays du Sud, lesquels, on l'a vu, ont encaissé le gros du choc du chômage.
Même un problème aussi minuscule que celui posé par la Grèce, qui représentait à l'époque 3 % du PIB de la zone, n'est toujours pas réglé sur le fond. Quant aux moyens utilisés pour mater le berceau de notre civilisation, ils sont simplement indignes d'une Europe qui, forte de ses valeurs universelles, prétendait vouloir réunir les peuples.
Peut-on encore croire, comme se plaisent à le faire les gouvernements français, que les réformes dont dépend l'avenir de l'Europe passent par un « couple » franco-allemand qui n'existe que pour les Français ? André Sapir, chercheur associé au think-tank Bruegel 213 ( * ) , souligne ainsi : « L'Allemagne doit davantage consommer. Elle est allée trop loin dans sa quête de compétitivité, sans doute une conséquence de la réunification de 1990. Ce qui entraîne des déséquilibres non négligeables. Que ce soit l'Allemagne ou la France, ces deux pays doivent trouver des solutions politiques dans la zone euro. » Certes, mais cela a-t-il quelque chance d'aboutir quand le système est à ce point dépourvu d'institution susceptible de trancher des noeuds gordiens de plus en plus serrés ?
b) Un système institutionnel autobloquant
À y regarder de près, les contradictions dans lesquelles se sont enfermés les Européens font de la zone euro un système autobloquant. Il est tout de même paradoxal, en effet, que le chômage soit plus important dans la zone euro - dont les initiateurs annonçaient qu'elle serait le moteur économique de l'Europe - que dans l'Union à 28 !
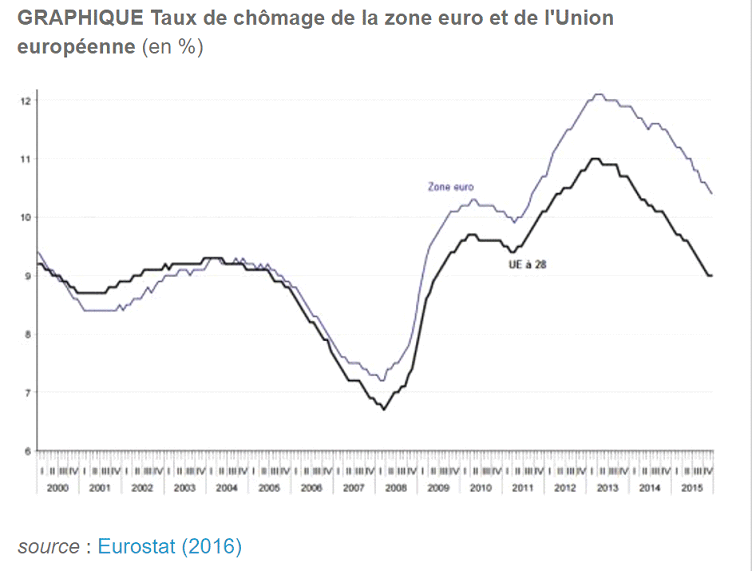
• Un système de parités fixes facteur de dépression en cas de crise
Le système des parités fixes au sein de la zone devient paralysant quand l'arrêt de liquidités en provenance des pays du Nord, au moment des crises, coïncide avec une obligation de désendettement et de réduction des dépenses des pays du Sud. La classique dévaluation externe n'étant pas possible, ces pays doivent recourir à une forme de « dévaluation interne » - réduction des dépenses publiques, baisse des salaires, des pensions et retraites - pour limiter leurs achats extérieurs et augmenter leur compétitivité, la solution de l'investissement technologique n'étant pas applicable, en tout cas à court ou moyen terme.
Voici ce qu'on peut lire dans une publication de la Société Générale : « Des coûts unitaires du travail toujours trop élevés dans les pays de la périphérie (par rapport aux pays du nord de la zone euro), conjugués à une forte contraction de la demande globale ont entraîné dans ces pays des chutes d'emplois et de production dignes des pires épisodes de dépression économique. Et parce que les processus de désendettement et de dévaluation interne ne sont pas encore achevés, la croissance effective en Europe devrait rester durablement inférieure à la croissance potentielle. » 214 ( * )
Comme le montre le graphique ci-dessous, extrait de la publication précitée, dans tous les pays de la zone, la crise s'est traduite par une baisse du coût unitaire du travail dans le but d'améliorer la compétitivité. Mais en Europe, c'est dans les pays du Sud, à l'exception de l'Italie, et en Irlande, particulièrement frappée par la crise, que cette baisse a été la plus forte.
Quand se conjuguent baisse des salaires et désendettement, il ne faut pas s'étonner de trouver la dépression au rendez-vous. Une dépression qui frappe, certes, d'abord les pays les plus faibles de la zone, mais qui se répercute inévitablement sur les autres.
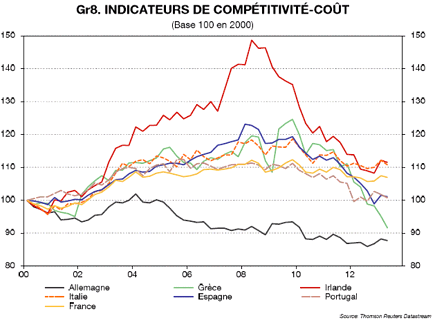
• Des échanges déséquilibrés sans système de recyclage des excédents
Comme le montre le graphique ci-dessous 215 ( * ) , en 2014, la zone euro présente un important excédent courant de 3,4 % du PIB qui, n'étant pas recyclé dans la zone, stérilise sa dynamique économique interne.
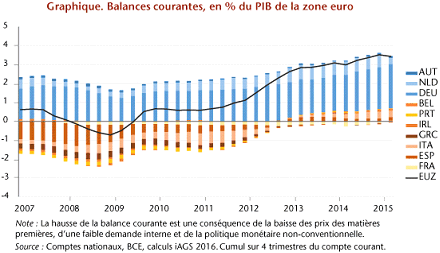
• Un carcan budgétaire et idéologique interdisant toute politique de la demande, au niveau des États membres comme de l'Union européenne
C'est pourtant d'un manque de demande - consommation des ménages et investissements des entreprises - que l'Europe souffre et l'heure reste à la politique de l'offre (salaires bas) et au manque d'investissement (échec des politiques de taux bas, des politiques monétaires conventionnelles et non conventionnelles, des politiques fiscales ou de financement des transferts sociaux favorables aux entreprises).
- La consommation, moteur économique
On a complètement oublié qu'en Europe, comme aux États-Unis et dans tous les grands pays développés, le moteur de l'économie, c'est la consommation. Il suffit de regarder les courbes pour s'en apercevoir : si l'Europe n'est pas en plus mauvais état, c'est que le niveau de consommation, notamment du fait des « amortisseurs sociaux », a bien résisté, bien plus que l'investissement et que les exportations sur lesquels on continue à miser, au moment même où la demande extérieure se contracte (voir plus bas).
Certes, il ne peut y avoir de reprise solide sans redémarrage de l'appareil de production. Néanmoins, sans augmentation de la demande, on ne voit pas pourquoi ceux qui sont aux commandes cesseraient d'utiliser leurs liquidités à autre chose qu'au rachat de leurs propres actions, ce qui augmente les dividendes et la valeur desdites actions, au rachat d'entreprises concurrentes ou, tout bonnement, à l'augmentation des dividendes distribués ?
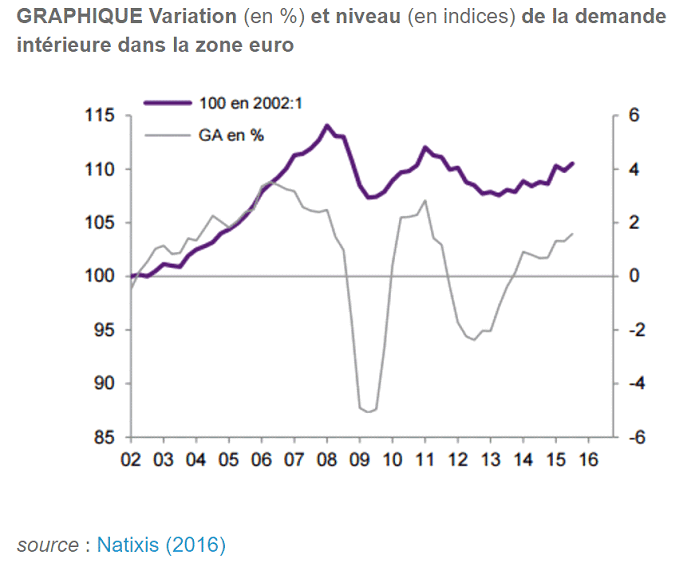
- L'investissement public
L'une des contradictions majeures, c'est d'un côté la nécessité de relancer l'investissement public, l'investissement privé se dérobant, et, de l'autre, l'impossibilité de le financer par le déficit budgétaire public, compte tenu du carcan des critères de convergence. Quant à l'idée que ce financement pourrait être directement ou indirectement assuré par la BCE, ce qui aurait l'avantage de n'engendrer aucun coût pour les budgets, on ne peut même pas en rêver.
Depuis qu'il a été popularisé par Keynes, l'investissement public a cet avantage d'entraîner, par ricochet, d'autres investissements et une consommation supplémentaire. C'est ce qui s'appelle « l'effet multiplicateur ».
Alors qu'il devrait augmenter, il a diminué en Europe, globalement de 17 % entre 2007 et 2013, et de beaucoup plus dans les pays particulièrement touchés par la crise immobilière.
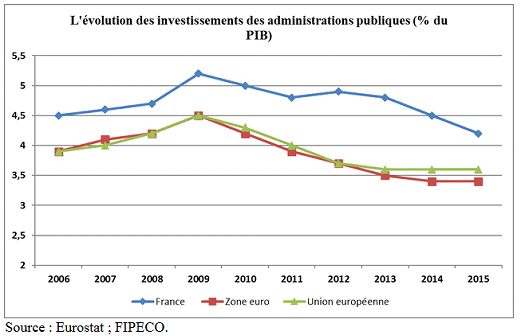
Le FMI n'est pas le seul à plaider pour une relance par l'investissement public 216 ( * ) , et donc pour un desserrement du carcan budgétaire. L'OCDE, le G20, la BCE depuis l'appel de Mario Draghi en août 2014, même la Commission européenne plus récemment, s'accordent pour dire qu'une politique monétaire sans politique budgétaire adaptée est vouée à l'échec. Pour l'instant, rien n'a bougé.
Les 315 milliards d'euros du plan Juncker mettent du temps à être consommés et en mettront encore plus à produire leurs effets. Quant aux 80 milliards d'euros qui seraient théoriquement nécessaires pour mobiliser à 100 % les capacités productives de la machine économique européenne, ils restent des sujets de discours et d'exégèse des messages subliminaux de Wolfgang Schäuble. Pourtant, il suffit de comparer ces chiffres aux 800 milliards de dollars de l'ARRA mobilisés en urgence pour réaliser que l'on est encore loin de ce qu'il faudrait faire si les responsables européens voulaient mettre en oeuvre une vraie politique de relance économique du vieux continent.
Christophe Nijdam, secrétaire général de Finance Watch au moment de son audition 217 ( * ) , et depuis membre des Stakeholders Groups de l'Autorité bancaire européenne (EBA) et de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), fait l'analyse suivante : « Il faudrait relancer l'investissement public, les infrastructures, les grands travaux, cela pourrait fonctionner. En revanche, on ne relancera pas la demande par le marché unique des capitaux. De même, on ne peut pas relancer la croissance en commettant la même erreur qui avait été commise pendant la crise, c'est-à-dire en endettant le consommateur. La crise de 2008 a été une crise de l'endettement global, sur longue durée, les gens se sont endettés pour maintenir leur niveau de vie ; ce qui a fortement touché l'économie. Pour vous donner une image, pendant la bulle internet de 1999 à 2001, les gens jouaient au casino avec leur argent, ils perdaient, cela s'arrêtait là. À l'inverse, dans une bulle de l'endettement, les gens vont jouer au casino avec l'argent des autres, ce qui entraîne un effet domino et une crise globale. » Il précise : « Ce n'est pas un problème d'octroi de crédits, c'est un problème de demande globale, de confiance consommateur. »
c) Un système bancaire oligopolistique qui ne joue pas le rôle qu'il est censé jouer
Retrouvant la question précédemment abordée 218 ( * ) , nous nous contenterons d'y renvoyer, nous limitant à rappeler que le fonctionnement parasitaire du système financier est une entrave majeure au dynamisme économique.
Gunther Capelle-Blancard nous l'a rappelé 219 ( * ) : « Même s'il est difficile de les quantifier , on a légitimement l'idée qu'on a affaire à des activités presque parasitaires, qui se développent, au sens biologique du terme. Il n'y a pas de déconnexion [entre finance et économie réelle] : le parasite se nourrit de la bête, le développement du parasitaire n'a pas d'utilité, il n'y a pas de déconnexion, il y a même une symbiose entre eux. Si on coupe ce lien, le parasite meurt. » Après avoir rappelé la liste des catastrophes qui ont suivi la formation des bulles spéculatives de ces trente dernières années, il ajoute : « Quand on fait le bilan : pendant les fameuses Trente Glorieuses et même dix ans après, il n'y a rien eu. Pendant quarante ans, les entreprises se finançaient. Depuis maintenant trente ans, les bulles se multiplient. »
On ne peut que constater une déconnexion complète de ce que peuvent faire les banques centrales et un hypothétique redémarrage de l'économie. Des mondes parallèles.
D'autres systèmes ont existé qui ont donné satisfaction, d'autres peuvent de nouveau exister. L'épargne est aujourd'hui abondante en Europe, rien que les Français ont de côté aujourd'hui un peu plus de 10 000 milliards d'euros, environ 16 % de leurs revenus. Ne serait-il pas temps de recréer des circuits financiers de financements directs de l'économie, notamment des PME-PMI, ou en tous cas de développer les institutions existantes ?
La séparation des banques de dépôts et d'affaires irait dans le même sens : les dépôts serviraient exclusivement à l'émission de prêts.
Parmi toutes les mauvaises raisons invoquées avec succès jusque-là pour éviter la fin du modèle de banque universelle, citons l'argument selon lequel séparer, en Europe, les banques de dépôts et d'investissement reviendrait à livrer la « gestion d'actifs » à la concurrence étasunienne. Sauf que le classement des gestionnaires d'actifs mondiaux montre qu'une telle séparation n'aurait pas cet effet, soit que la partie bancaire des établissements est faible (cas d'Axa Groupe, huitième gestionnaire d'actifs mondial), soit qu'après scission la partie gestion d'actifs des grandes banques européennes reste largement suffisante pour résister à la concurrence. C'est le cas de BNP Paribas, dixième gestionnaire d'actifs mondial, qui demeurerait avant Goldman Sachs, quinzième seulement au classement, avec 1 042 milliards de dollars d'actifs. À noter qu'au classement 2013 des cinq cents principaux gestionnaires d'actifs mondiaux du cabinet Towers Watson 220 ( * ) , l'Europe place neuf établissements parmi les trente premiers, dont quatre français parmi les vingt premiers.
Notons, enfin, que le système bancaire étasunien est plus concurrentiel que le système européen. Outre la garantie implicite des pouvoirs publics de ne pas faire faillite, ce qui lui permet de se financer à des tarifs privilégiés, il dispose d'une clientèle, sinon captive, du moins pour laquelle changer de banque est ressenti, à en croire les enquêtes d'opinion, comme difficile.
* 196 Hélicoptère Keynes - Véronique Riches-Flores (www.richesflores.com) - Septembre 2016.
* 197 Voir, supra, « Un endettement public en augmentation, un endettement privé en lente diminution dans la plupart des pays développés mais en forte croissance en Chine ».
* 198 Voir supra, « Des niveaux de chômage améliorés au prix du sous-emploi et d'une dégradation des conditions de travail ».
* 199 Selon Jean-Luc Buchalet, du Cercle des analystes indépendants.
* 200 Le moment est-il propice à une relance des investissements dans les infrastructures ? Les effets macroéconomiques de l'investissement public - Perspectives de l'économie mondiale - Octobre 2014.
* 201 Hélicoptère Keynes - Véronique Riches-Flores (www.richesflores.com) - Septembre 2016.
* 202 Ibid.
* 203 Hélicoptère Keynes - Véronique Riches-Flores (www.richesflores.com) - Septembre 2016.
* 204 Voir supra, au sein de la deuxième partie, le développement intitulé « La crise économique ».
* 205 Voir supra.
* 206 Patrick Artus - L'Opinion - 17 janvier 2016.
* 207 American Recovery and Reinvestment Act.
* 208 Les collectivités territoriales des États-Unis : les enseignements à tirer de modèles économiques univoques - Communication de Pierre-Yves Collombat dans le cadre d'un rapport préparatoire d'un projet de rapport sur le rôle économique des collectivités locales, faite devant la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales le 28 juin 2011.
* 209 Ces graphiques sont issus de la publication « L'investissement et le financement d'investissements en Europe » (disponible uniquement en anglais) - Banque européenne d'investissement - 14 novembre 2013.
* 210 Tribune « A continent adrift » (« Un continent à la dérive »), parue le 16 mars 2009 dans le New York Times.
* 211 Voir, supra, au sein de la troisième partie, le développement intitulé « Le rêve d'une institution politique sans politique ».
* 212 Audition du 14 janvier 2016.
* 213 Audition du 6 avril 2016 dans le cadre du déplacement à Bruxelles.
* 214 Marie-Hélène Duprat - EcoNote n° 22 - Département des études économiques de la Société Générale - Décembre 2013.
* 215 Sébastien Villemot et Bruno Ducoudré - Quelle stratégie pour le rééquilibrage interne de la zone euro ? - OFCE - 5 janvier 2016.
* 216 On l'a vu supra.
* 217 Audition du 6 avril 2016 dans le cadre du déplacement à Bruxelles.
* 218 Voir, au sein de la troisième partie, le développement intitulé « À quoi sert réellement le marché financier ? »
* 219 Professeur des Universités en sciences économiques - Audition du 28 janvier 2016.
* 220 Voir Le Monde Éco&Entreprise du 11 novembre 2014.