b) Les moyens spatiaux de renseignement
(1) Les moyens existants
Le commandement interarmées de l'espace est devenu une réalité en juillet 2010. Il travaille en synergie avec les autres directions chargées de l'espace militaire : la Direction Interarmées des Réseaux d'Infrastructure et des Systèmes d'Information (DIRISI) pour les télécommunications ; la Direction du Renseignement militaire (DRM) pour les moyens d'observation, et le Commandement de la Défense aérienne et des Opérations aériennes (CDAOA) pour la surveillance de l'espace.
Nos capacités en matière de communications sécurisées par satellites sont fondées sur deux satellites Syracuse lancés en 2005 (Syracuse 3A) et 2006 (Syracuse 3B), qui doivent être prochainement complétés par un satellite franco-italien (Sicral 2). Des capacités sont également prêtées dans le cadre de l'OTAN. Par ailleurs, l'armée a aussi recours à des satellites civils (Inmarsat, Iridium...) sur la base de contrats cadres d'acquisition de services de télécommunications pour la transmission d'informations non classifiées (Astel S et Astel L).
En matière d'observation, la France dispose des deux satellites militaires en orbite basse Helios 2A et Helios 2B, dans les domaines visible et infrarouge. Ces satellites ont succédé au programme Helios 1, lancé dans la deuxième moitié des années 1990.
Depuis fin 2011, la France dispose aussi du premier satellite Pléiades, à caractère dual, dont les images sont en couleur (contrairement à celles d'Helios) et qui se caractérise par son agilité (il permet d'obtenir des images en trois dimensions). Le lancement du deuxième satellite Pléiades est prévu fin 2012. Alors que Spot 5 permet d'observer des détails de 2,5 m au sol sur un champ de 60 à 120 km, Pléiades acquiert des images avec une résolution de 70 cm sur un champ de vue de 20 km.
Exemple d'image Pléiades 1A (Shanghai, 19 janvier 2012)
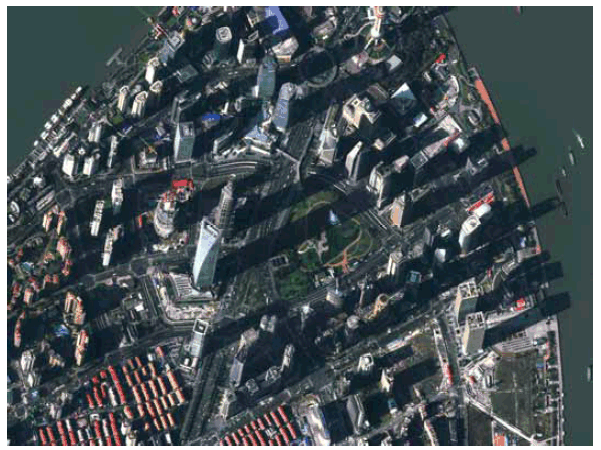
Source : CNES
Nos besoins en images radars sont couverts par des échanges avec l'Allemagne (SAR-Lupe) et l'Italie (Cosmo-SkyMed). Les satellites radars fournissent des renseignements moins exploitables que les satellites optiques mais ils permettent de s'affranchir des conditions météorologiques et d'éclairement solaire.
Les écoutes électromagnétiques, qui permettent de protéger nos forces et de positionner utilement les capteurs optiques, ont fait l'objet de programmes exploratoires (Cerise, Essaim), puis d'un programme de démonstration ELISA, constellation de quatre petits satellites lancés fin 2011.
(2) Les développements attendus
Les satellites ayant une durée de vie limitée (par exemple, 5 ans minimum pour Helios, 12 ans minimum pour Syracuse), les développements attendus ont d'abord pour objet d'assurer une continuité de service, donc au minimum de renouveler l'existant. Ils doivent aussi permettre la mise en place de systèmes plus complets et plus performants.
Dans le domaine des télécommunications, la coopération franco-italienne doit aboutir prochainement à la mise en orbite des satellites Athena-Fidus et Sicral 2, qui viendront compléter les capacités nationales existantes (Syracuse). Athena-Fidus offrira à la Défense une capacité de télécommunications haut débit (bande Ka) complémentaire aux systèmes militaires hautement sécurisés. Il doit être lancé en 2013.
Dans le domaine de l'observation, Musis 51 ( * ) est un programme européen lancé pendant la présidence française de l'UE en 2007, en coopération entre l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, la Grèce l'Italie, la Pologne et la Suède. Il a pour objectif la réalisation d'un système spatial d'imagerie à des fins de défense et de sécurité, pour succéder aux systèmes français Hélios 2, italien Cosmo-SkyMed et allemand SAR Lupe. Il était prévu que les quatre composantes spatiales de Musis, comprenant les satellites et leurs segments sol, fassent l'objet de programmes nationaux ou en coopération :
- un programme « défense » conduit par la France, éventuellement en coopération, pour la composante optique visible et infrarouge très haute résolution (CSO), dont la conception a été entreprise en 2008 ;
- un programme espagnol dual (civil et militaire) pour la composante optique champ large ;
- un programme de défense allemand pour une composante radar très haute résolution ;
- un programme italien dual (civil et militaire), ouvert à la coopération, pour une seconde composante radar haute et très haute résolution.
Une fédération de ces composantes doit assurer leur interopérabilité.
La lettre d'intention portant sur la réalisation de Musis a été signée le 10 novembre 2008. L'Agence européenne de défense (AED) est étroitement associée au projet, notamment pour assurer le lien avec l'Union européenne dans le cadre de la Politique européenne de sécurité et de défense. Toutefois, en l'absence d'accord de coopération finalisé et afin d'éviter tout risque de rupture capacitaire opérationnelle à la fin de vie d'Helios 2, la France a décidé en 2010 de lancer seule la réalisation de la composante spatiale optique, mais sur la base de 2 satellites, au lieu des trois prévus.
La coopération franco-italienne, qui est motrice pour l'Europe de la défense, a été mise à mal lors de l'opération libyenne, en raison d'une approche française des accords d'échange en vigueur jugée par les Italiens trop « comptable ». L'insatisfaction italienne a contribué au lancement d'un programme national de satellite optique (OPSIS) qui remet en cause l'esprit de l'accord de Turin fondé sur la spécialisation capacitaire des pays.
En cas de nécessité opérationnelle, comme lors de l'opération menée en Libye, une approche trop comptable des accords passés n'est pas souhaitable, car elle met en péril l'avenir de la coopération.
|
OBSERVATION DE LA TERRE : DES ACCORDS EUROPÉENS FRAGILISÉS La France a ratifié en 2001 un accord bilatéral franco-italien, dit accord de Turin, qui porte sur la constitution d'une capacité commune d'observation de la Terre comprenant une composante optique au travers du programme français Helios (2 satellites) et une composante radar au travers du programme italien Cosmo-SkyMed (4 satellites). Les premiers échanges opérationnels ont débuté le 7 juillet 2010. Avec l'Allemagne, la France a signé en 2002 les accords de Schwerin qui prévoient un échange d'images optiques Hélios et radar SAR-Lupe (5 satellites) au moyen de segments sol développés de façon coordonnée. Les satellites Helios sont possédés et ont été développés en copropriété par la France (85 %) avec la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la Grèce et depuis récemment, avec l'Allemagne. La disponibilité du système pour chacun des associés est fonction de sa part de financement. D'après les accords de Turin, l'Italie a obtenu une part supplémentaire d'images optiques en contrepartie d'images radars fournies à la France. Le ratio de ces échanges est de 75 images radars contre 7 images Helios. Lors de l'opération Harmattan (Libye), l'Italie, qui avait besoin d'images optiques, a demandé à la France plus d'images que ce qui était prévu dans les accords de Turin. La France, qui faisait alors usage de l'ensemble de ses droits de programmation, redistribuant les images à ses partenaires, s'en est néanmoins strictement tenue aux termes de l'accord entre les deux pays. A la suite de ce désaccord, l'Italie pourrait vouloir développer ses propres capacités optiques, ou se rapprocher de l'Allemagne. Plus généralement, la volonté de certains pays européens de développer leurs propres capacités risque de fragiliser une coopération européenne pourtant indispensable au déploiement d'une politique spatiale d'envergure. |
Dans le domaine de l'observation, comme dans celui des télécommunications, une multiplication d'initiatives nationales serait regrettable. Certes cette fragilité ne fait que refléter les limites actuelles de « l'Europe de la défense ». Mais la mutualisation des capacités est plus que jamais nécessaire en période de crise ; et, surtout, cette mutualisation est le ciment d'une ambition commune, seule à même de permettre à l'Europe de parler d'égal à égal avec les autres grandes puissances. C'est pourquoi il est nécessaire de relancer cette coopération, selon des règles plus souples, dans la perspective de partenariats durables.
Dans le domaine de l'observation, deux démonstrateurs sont en cours de définition (CXCI dans le domaine de l'optique haute résolution, GRANDIR dans le domaine de l'infrarouge).
Par ailleurs, l'observation en orbite géostationnaire semble une voie d'avenir à explorer, avec des applications nombreuses et duales (défense, sécurité civile...), ce qui permet d'envisager un financement partagé. D'après le projet GO-3S 52 ( * ) d'Astrium, un tel système permettrait d'observer une large zone (100 kmx100 km) en vidéo sur un tiers du globe, en pouvant faire varier la zone observée en quelques minutes. Des travaux exploratoires sont menés aux États-Unis. C'est le type même de technologie d'avenir sensible qu'il serait utile que la France maîtrise.
En ce qui concerne les satellites d'écoutes électromagnétiques, le programme de démonstration ELISA doit être suivi d'un programme pleinement opérationnel, CERES, dont le Livre blanc prévoyait la réalisation pour le milieu de la décennie. Sa mise en service a été reportée à 2020.
Le programme d'alerte avancée opérationnelle (visant à détecter et à caractériser par infrarouge le tir d'un missile balistique), reposant sur un satellite en orbite géostationnaire et un radar au sol, a lui aussi été reporté, malgré le succès des satellites de démonstration SPIRALE.
* 51 Multinational space based imaging system
* 52 Geostationary Observation Space Surveillance System







