(2) « Ariane 6 » : un lanceur plus modulable
Ariane 6 apporte une réponse un peu plus tardive, mais probablement plus durable, aux évolutions en cours.
(a) Pourquoi un lanceur de nouvelle génération ?
La décision prise par l'ESA en 2008 stipulait la nécessité d'un réexamen des besoins du marché à l'issue de la phase préparatoire de pré-développement d'Ariane 5ME.
Or, comme cela a été décrit plus haut, l'évolution des marchés semble s'accélérer. L'année 2012 s'est caractérisée, par exemple, par une percée spectaculaire du lanceur Falcon 9 de Space X ; il a vu aussi la vente par Boeing de satellites tout-électrique, qui pourrait marquer un tournant vers des satellites plus petits. L'arrivée des lanceurs des pays émergents est aussi source de préoccupation. Si ces évolutions n'ont pas encore d'impact immédiat pour Ariane 5, elles pourraient en avoir au cours des toutes prochaines années.
Arianespace anticipe aujourd'hui 5 à 7 lancements d'Ariane 5 par an, soit entre 10 et 14 satellites à lancer. Il est admis qu'en-deçà de 5 lancements par an, la cadence de production d'Ariane 5 devient insuffisante pour demeurer viable et garantir la fiabilité du lanceur (qui a connu 51 succès d'affilée à ce jour). Si Ariane 5 perdait au cours des prochaines années ne serait-ce que 2 à 4 satellites à lancer, au profit de ses concurrents, la situation deviendrait critique. Et il n'est pas certain que les pays européens trouveraient un accord pour soutenir un lanceur gravement déficitaire, cette question soulevant déjà de nombreuses réticences en Europe alors qu'Arianespace est pour le moment dans une situation relativement favorable.
Par ailleurs, Ariane 5ME ne résout pas le problème, devenu aigu pour Arianespace, de l'appairage des satellites en vue du lancement double. Les équations de l'appairage pourraient se compliquer encore, si de nouveaux acteurs captaient une partie du marché, diminuant les combinaisons possibles. Il s'agit là d'une vraie question de compétitivité : en effet, pour l'opérateur qui attend l'appariement de son satellite à un autre, les revenus sont différés d'autant. Étant donné l'accroissement de la taille des gros satellites, il n'est de plus pas certain qu'Ariane 5ME pourrait en lancer deux de ce type ; on risque de revenir rapidement à la nécessiter d'apparier un gros satellite avec un plus petit.
Passer au lancement simple, plutôt que double, donne en revanche plus de flexibilité et permet d'accroître par ailleurs la cadence de production du lanceur.
(b) Quel lanceur de nouvelle génération ?
« Ariane 6 » est à ce jour une série d'avant-projets concernant un lanceur modulable, de performance 2 à 8 t en orbite de transfert géostationnaire, dont plusieurs configurations sont à l'étude. Ce peut être un lanceur majoritairement à propergols solides : c'est la configuration dite PPH avec boosters à propergol solide en nombre variable, 2 étages à propergols solides et un troisième étage à propulsion liquide (hydrogène-oxygène) ; ce peut aussi être un lanceur majoritairement à ergols liquides : c'est la configuration dite HH avec boosters à propergols solides en nombre variable et deux étages à propulsion liquide.
Dans les deux cas, l'étage supérieur à propulsion liquide est doté du moteur rallumable Vinci, commun avec Ariane 5ME.
Ce lanceur serait donc modulable en fonction de la charge à lancer. Il pourrait procéder à des lancements « simples » (mono-satellites).
Dans sa version PPH, il est complémentaire de Vega puisqu'il réutiliserait l'étage P80 en augmentant sa puissance, ce qui permettrait la production en série d'un grand nombre de moteurs à poudre. Fondé sur une technologie en soi fiable et peu coûteuse (la poudre), ce lanceur permettrait, au surplus, de bénéficier d'effets de standardisation. Les moteurs à poudre pourraient être préparés et assemblés au Centre spatial guyanais, qui dispose déjà d'une compétence dans ce domaine. La version PPH paraît devoir être privilégiée pour son caractère « low cost », si toutefois elle a autant de souplesse que la version HH, la cryogénie étant reconnue comme une technologie permettant davantage de précision et de flexibilité.
D'après le CNES, le coût de production du lanceur Ariane 6 pourrait être très inférieur au coût d'un Ariane 5ME (70 M€ pour le premier - pour un lancement simple - contre 170 M€ pour le second - pour un lancement double).
D'après les auditions réalisées par vos rapporteurs, l'estimation des coûts et délais respectifs des deux lanceurs varie selon que l'on s'adresse aux partisans d'Ariane 5ME (Astrium, Safran) ou à ceux d'Ariane 6 (CNES, Arianespace).
Pour les premiers, Ariane 5ME entrerait en service assez rapidement (2017) et son coût de développement pourrait être limité à 1,2 Md€. En revanche, Ariane 6 ne pourrait être fiabilisée avant 2024 et son coût de développement serait de l'ordre de 5,5 Mds€.
Pour les seconds, Ariane 5ME arriverait en 2018 pour un coût d'environ 2 Mds€ ; et Ariane 6 en 2021 pour « seulement » le double (4 Mds€) mais apporterait une réponse durable aux questions posées par le marché, ce qui ne serait pas le cas du projet ME.
En septembre dernier, le CNES et les industriels (Astrium, Safran) ont élaboré une position commune, en vue de la réunion ministérielle de l'ESA de novembre. Cet accord suggère de poursuivre les programmes de développement des deux lanceurs en 2013 et 2014, d'ici à une prochaine réunion ministérielle de l'ESA, qui pourrait avoir lieu en 2014.
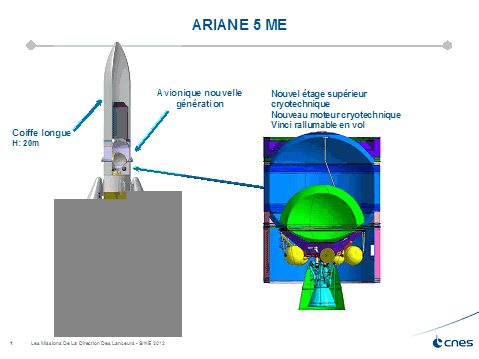
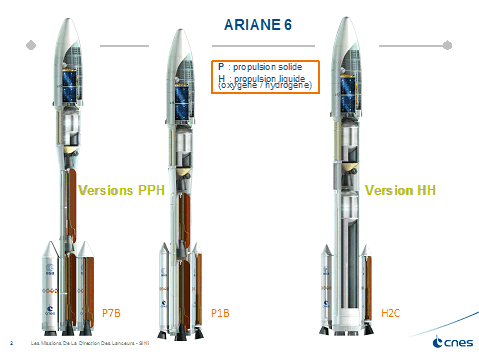
Vos rapporteurs se sont efforcés de faire objectivement état de l'ensemble des arguments qui leur ont été exposés au cours de leurs auditions, en faveur de chacun des deux projets.
A l'examen, il leur semble qu'Ariane 6 apporte une solution, certes plus tardive, donc peut-être plus risquée à court terme, mais plus durable et moins coûteuse à long terme.
Il n'est pas péjoratif d'ajouter que - particulièrement dans sa version PPH - Ariane 6 serait, en définitive, un lanceur « low cost », plus simple, plus modulable, complémentaire de Vega. Ariane 6 paraît plus en phase avec l'évolution générale du marché des lanceurs, qui court moins après l'augmentation de la performance qu'après la réduction des coûts. En conséquence, Ariane 6 semble davantage susceptible de préserver les finances publiques des États européens, qui souhaitent réduire voire annuler à terme le soutien public à l'exploitation de leurs lanceurs.
Afin de préserver durablement l'autonomie européenne d'accès à l'espace, un passage aussi rapide que possible à Ariane 6 est donc souhaitable.
Néanmoins, Ariane 6 n'est pour le moment qu'un avant-projet pour lequel une décision définitive ne peut pas être prise dès aujourd'hui et qui n'aura pas d'impact immédiat sur l'activité des industriels. C'est pourquoi le virage à prendre doit permettre de préserver les compétences acquises lors du développement d'Ariane 5ME, qui doivent servir à faire fonctionner Ariane 5 jusqu'à l'entrée en service de son successeur.
Ce virage progressif doit toutefois être sans ambiguïté : l'objectif principal est le développement, aussi rapide que possible, du lanceur de nouvelle génération.
Orientations
- Développer aussi rapidement que possible un lanceur de nouvelle génération modulable, à étage supérieur rallumable, en mettant la priorité sur la réduction des coûts afin de le rendre compétitif sur le marché
- Présenter, au plus tard en 2014, un projet de développement complet de ce lanceur de nouvelle génération (configuration, engagements industriels, délais, coûts)
- Prendre alors une décision définitive concernant Ariane 5 ME, afin de ne pas continuer plus longtemps à financer deux projets
- Faire évoluer Véga dans le sens d'une complémentarité avec le lanceur de nouvelle génération tout en européanisant l'ensemble de ses composants afin que ce lanceur participe pleinement à l'objectif d'autonomie d'accès de l'Europe à l'espace.







