Rapport d'information n° 699 (2010-2011) de M. Gilbert BARBIER , sénateur et Mme Françoise BRANGET, député, fait au nom de la Mission d'information sur les toxicomanies, déposé le 30 juin 2011
Disponible au format PDF (1 Moctet)
-
INTRODUCTION
-
I.- LES TOXICOMANIES, UN
PHÉNOMÈNE EN PROGRESSION ALARMANTE
-
A. DES PRODUITS QUI ÉVOLUENT
-
B. DES PRATIQUES QUI SE TRANSFORMENT
-
C. DES RISQUES QUI S'ACCROISSENT
-
A. DES PRODUITS QUI ÉVOLUENT
-
II.- TROIS POLITIQUES COMPLÉMENTAIRES
INDISPENSABLES : MIEUX PRÉVENIR, RENFORCER L'OFFRE DE SOINS ET
RÉDUIRE LES RISQUES
-
A. PRÉVENIR LE PASSAGE À L'ACTE,
UNE PRIORITÉ
-
B. REFUSER LE DÉFAITISME EN
RENFORÇANT L'OFFRE DE SOINS
-
C. POURSUIVRE UNE POLITIQUE DE
RÉDUCTION DES RISQUES ÉQUILIBRÉE ET RESPONSABLE
-
A. PRÉVENIR LE PASSAGE À L'ACTE,
UNE PRIORITÉ
-
III.- FACE AUX TOXICOMANIES, LA
NÉCESSITÉ D'UN DISCOURS CLAIR ET UNIVOQUE
-
A. LA DÉPÉNALISATION DE L'USAGE,
UNE IMPASSE ÉTHIQUE ET JURIDIQUE
-
1. Un objectif légitime : une
société sans drogues
-
2. L'impossible dépénalisation
de l'usage
-
3. Mieux assurer l'efficacité de
l'interdit en modulant l'échelle des peines
-
a) Une réponse pénale d'ores et
déjà modulée en fonction de l'efficacité
recherchée
-
b) Une modulation néanmoins
insuffisante au regard des réalités de la
répression
-
c) Conforter la réponse pénale
et corriger les incohérences en créant une incrimination d'usage
simple sanctionnée par une contravention
-
d) Instituer une contravention d'usage simple
de troisième classe
-
a) Une réponse pénale d'ores et
déjà modulée en fonction de l'efficacité
recherchée
-
1. Un objectif légitime : une
société sans drogues
-
B. LES CENTRES D'INJECTION SUPERVISÉS,
UNE OPTION HASARDEUSE
-
A. LA DÉPÉNALISATION DE L'USAGE,
UNE IMPASSE ÉTHIQUE ET JURIDIQUE
-
CONTRIBUTIONS
-
EXAMEN DU RAPPORT PAR LA MISSION
-
I.- LES TOXICOMANIES, UN
PHÉNOMÈNE EN PROGRESSION ALARMANTE
N° 3612 N° 699
____ ___
ASSEMBLÉE NATIONALE SÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2010 - 2011
____________________________________ ___________________________
Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale Enregistré à la présidence du Sénat
le 30 juin 2011 le 30 juin 2011
________________________
MISSION D'INFORMATION SUR LES TOXICOMANIES
________________________
RAPPORT D'INFORMATION
sur
les toxicomanies
Par Mme Françoise Branget, Députée, et
M. Gilbert Barbier, Sénateur
TOME I - RAPPORT
__________ __________
Déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale Déposé sur le Bureau du Sénat
par M. Serge BLISKO, par M. François PILLET,
Coprésident de la mission Coprésident de la mission
COMPOSITION DE LA MISSION D'INFORMATION
Coprésidents
|
M. Serge BLISKO, député |
M. François PILLET, sénateur |
Vice-présidents
|
M. Jean-Christophe LAGARDE, député M. Noël MAMÈRE, député (*) |
Mme Samia GHALI, sénatrice M. Yves POZZO DI BORGO, sénateur |
Rapporteurs
|
Mme Françoise BRANGET, députée |
M. Gilbert BARBIER, sénateur |
Membres
|
DÉPUTÉS |
SÉNATEURS |
|
M. Patrice CALMÉJANE |
M. Jean-Paul ALDUY |
|
Mme Michèle DELAUNAY |
Mme Nicole BONNEFOY |
|
M. Jean-Paul GARRAUD |
Mme Brigitte BOUT |
|
M. Philippe GOUJON |
Mme Christiane DEMONTÈS |
|
M. François GROSDIDIER |
M. Bruno GILLES |
|
M. Michel HEINRICH |
Mme Marie-Thérèse HERMANGE |
|
Mme Fabienne LABRETTE-MÉNAGER |
Mme Christiane HUMMEL |
|
M. Jean-Marie LE GUEN |
Mme Virginie KLÈS |
|
Mme Catherine LEMORTON |
M. Jacky LE MENN |
|
M. Georges MOTHRON |
M. Alain MILON |
|
M. Daniel VAILLANT |
Mme Isabelle PASQUET |
(*) membre jusqu'au 15 mars 2011
INTRODUCTION
Le présent rapport conclut les travaux de la mission d'information bicamérale sur les toxicomanies dont la création avait été conjointement souhaitée par M. Bernard Accoyer, Président de l'Assemblée nationale, et M. Gérard Larcher, Président du Sénat, le 5 octobre 2010. Cette initiative intervenait quarante ans après l'adoption du texte fondateur, la loi du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses. C'est pourquoi les présidents Bernard Accoyer et Gérard Larcher ont estimé qu'il convenait, en premier lieu, de dresser un bilan de la mise en oeuvre de cette loi. La mission d'information proposée devait, en second lieu, étudier les situations et solutions retenues dans différents pays en matière de toxicomanies et faire des propositions réalistes et efficaces pour lutter au mieux contre ce phénomène et apporter aux victimes des réponses appropriées. Les conférences des présidents de l'Assemblée nationale du 7 septembre 2010 et du Sénat du 6 octobre 2010 ont entériné cette proposition.
Il faut relever le caractère profondément novateur de cette initiative : nulle expérience similaire n'avait été tentée auparavant. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, créé par la loi du 8 juillet 1983, ne constitue pas un véritable précédent, puisque cette instance pérenne a pour mission d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin d'éclairer ses décisions et non de participer, comme c'est le rôle des missions d'information, au contrôle de la politique du Gouvernement. La composition de la mission d'information et de son bureau s'est alors inscrite dans une démarche d'absolue parité. Elle a ainsi comporté quinze membres issus de chaque assemblée ; les fonctions de coprésident ont été attribuées pour l'une, à M. Serge Blisko, député, et pour l'autre, à M. François Pillet, sénateur. La même approche a prévalu s'agissant des fonctions de corapporteur confiées à Mme Françoise Branget, députée, et à M. Gilbert Barbier, sénateur.
La mission d'information commune a procédé à cinquante-trois auditions entre le 12 janvier et le 15 juin 2011 tantôt à l'Assemblée nationale, tantôt au Sénat, et ainsi entendu cent sept personnes impliquées dans le champ des toxicomanies : associations, scientifiques, professionnels de santé, services ministériels (directions d'administration centrale) et interministériel (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies) engagés dans la lutte contre les stupéfiants et la prise en charge des toxicomanies, juristes, magistrats, représentants des cultes et naturellement Gouvernement. Toutes ces auditions ont fait l'objet de comptes rendus (1 ( * )) .
La mission d'information commune a également souhaité donner un éclairage pratique à ses travaux. Pour ce faire, elle a procédé à six déplacements pour visiter le service d'addictologie de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, une communauté thérapeutique en Gironde, l'espace d'accueil et de consommation Quai 9 à Genève, le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie Pierre Nicole, géré par la Croix Rouge française, à Paris, un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues à Villepinte, et enfin le centre thérapeutique San Patrignano à Rimini.
La mission d'information commune a souhaité, lors de sa première réunion qui s'est tenue le 15 décembre 2010, circonscrire clairement son champ d'investigation : « les toxicomanies ». Plusieurs possibilités s'offraient en effet à elle.
La première consistait à se fonder sur la définition législative du « toxicomane » figurant dans le code de la santé publique : « une personne usant d'une façon illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants », sans distinguer entre ces substances ou plantes selon leur supposé degré de toxicité. Le caractère illicite de la consommation de produits psychoactifs excluait alors du champ d'études l'alcoolisme et le tabagisme, que le code de la santé publique distingue de la toxicomanie.
Une deuxième solution aurait pu résider dans l'étude d'un champ élargi correspondant au domaine de compétences de diverses institutions, telles que la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie ou les observatoires français et européen des drogues et des toxicomanies. Ce champ aurait alors recouvert non seulement la consommation de drogues illicites, mais aussi celle de produits licites comme l'alcool et le tabac et même, concernant le champ couvert par la mission interministérielle, les addictions dites « sans produit » comme la dépendance au jeu.
Une troisième approche aurait enfin pu consister à différencier les toxicomanies selon la toxicité supposée des produits consommés, comme cela peut être le cas dans certains pays, en distinguant entre les drogues dites « dures » et les drogues dites « douces ».
Les membres de la mission d'information commune ont jugé qu'un champ d'investigation trop large nuirait à la qualité de leurs travaux. En tant que législateurs, il leur a également semblé opportun de concentrer leur réflexion sur la notion de toxicomanies en s'appuyant sur la définition du toxicomane figurant dans le code de la santé publique. Il a donc été décidé de circonscrire l'analyse à la consommation de produits illicites stupéfiants, sujet d'ailleurs très vaste : on ne peut guère en traiter sans aborder la question de l'offre, de la lutte contre les trafics, du régime juridique de la consommation ou encore de la prise en charge des toxicomanes.
Vos rapporteurs ont souhaité, dans cette optique, dresser un tableau objectif et aussi complet que possible du phénomène des toxicomanies. Afin de ne pas démultiplier les sujets abordés dans ce cadre, ils ont exclu de leur réflexion la question du financement de la politique publique de lutte contre les toxicomanies, discutée chaque année dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances, et celle de l'organisation administrative, moins cruciale du point de vue de la santé publique qui constitue le fil d'Ariane du présent rapport.
Ils ont tout d'abord constaté que les toxicomanies sont effectivement plurielles et connaissent une progression alarmante, tant pour ce qui concerne les produits consommés que les pratiques des usagers de drogues et les risques qu'ils encourent, qui semblent croissants ( I ).
Pour lutter contre ce phénomène inquiétant, trois politiques complémentaires doivent en réalité être confortées : la prévention dès le plus jeune âge, qui constitue une priorité ; une offre de soins abondante et adaptée, car le défaitisme ne peut être une option ; une réduction des risques encourus par les toxicomanes du fait de leur consommation de drogues, selon une démarche équilibrée et responsable ( II ).
Enfin, il est nécessaire que chacun, et en particulier les pouvoirs publics, tienne un discours clair et univoque réaffirmant la dangerosité des drogues et le caractère illicite de leur consommation. Il ne peut donc être envisagé de dépénalisation de leur usage, car celle-ci constituerait une impasse éthique et juridique ; il convient au contraire de garantir une réponse pénale plus immédiate et donc plus efficace. L'expérimentation de centres d'injection supervisés semble, pour sa part, être une option plus qu'hasardeuse ( III ).
Vos rapporteurs sont conscients que le dispositif actuel de lutte contre les drogues et de prise en charge des toxicomanies souffre d'imperfections. Ils ont souhaité que leur rapport soit empreint d'équilibre. Pour ce faire, ils ont toujours gardé à l'esprit la diversité des témoignages recueillis, la responsabilité première du législateur en matière de politique de santé publique et l'attention due à toutes les victimes des toxicomanies.
I.- LES TOXICOMANIES, UN PHÉNOMÈNE EN PROGRESSION ALARMANTE
En 2003, le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites évoquait « l'explosion des drogues » et faisait part d'un « constat très préoccupant » (2 ( * )) .
Huit ans plus tard, force est de constater que la situation est tout aussi inquiétante pour notre pays, et ce tant du fait de l'évolution des produits psychotropes et des trafics associés que de la transformation des comportements toxicomanes et de l'augmentation des risques de toute nature qui en découlent.
A. DES PRODUITS QUI ÉVOLUENT
La modification des produits stupéfiants tient tout autant à l'évolution de leur composition qu'au rapprochement progressif des lieux de production et de consommation.
1. La diversification des produits
Parallèlement à l'augmentation des volumes diffusés, les produits stupéfiants sont marqués par leur rapide évolution. « Outre la forte diffusion, on assiste à une très grande diversification des drogues et de leurs usages. En 1970 ou 1980, on n'avait jamais entendu parler d'ecstasy, de kétamine, de « binge drinking» , ou de «binge cocaïne » , de dopage dans le milieu professionnel, etc. » (3 ( * )) a ainsi fait observer M. Alain Morel, directeur général d'Oppelia.
Ces changements constants, rendant difficile toute politique suivie de lutte contre le trafic de stupéfiants, affectent aussi bien les drogues dites « classiques » - héroïne, cocaïne et cannabis - que le détournement de produits licites - souvent des médicaments à destination des populations toxicomanes - ou que la mise au point de drogues synthétiques.
a) L'évolution des drogues traditionnelles
L'évolution la plus marquante concernant les drogues « classiques » a trait à l' élévation du taux de principe actif du cannabis . Comme l'a expliqué à la mission M. François Thierry, commissaire divisionnaire, chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS), « le cannabis européen est produit de manière hydroponique ; il est transgénique, les semences ayant été manipulées pour être plus productives. Le principe actif du cannabis, le tétrahydrocannabinol, est présent entre 3 % et 6 % dans la plante à l'état naturel, comme au Maroc. Le plant peut aller jusqu'à 25 %, 30 % ou 35 % de concentration. On en trouve à 37 % ou 38 % quand le plant a été génétiquement modifié pour que son rendement en THC soit supérieur. La particularité de ces plants est d'avoir une croissance plus rapide et d'être plus forts, ce qui conduit aussi le cannabis à être plus dangereux qu'avant et susceptible de davantage d'utilisations en raison de sa très forte teneur en principe actif » (4 ( * )) .
Cette évolution est d'autant plus marquante que la part de cannabis diffusée sous forme d'herbe, qui permet une telle augmentation des taux de principe actif, est en fort accroissement. Comme l'a fait remarquer le colonel Marc de Tarlé, chef du bureau des affaires criminelles à la direction générale de la gendarmerie nationale, « la part de la résine est tombée de 90 % à 60 %, tandis que celle de l'herbe est passée de 10 % à 40 %. Or, cette herbe a une teneur très importante en THC (delta-9-tétrahydrocannabinol), jusqu'à sept fois plus que la résine » (5 ( * )) .
Le cannabis n'est pas la seule drogue dont les principes actifs se trouvent accrus : si l' héroïne est autour, normalement, de 5 à 10 %, on en trouve désormais à des taux bien supérieurs. L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) a notamment observé, dans une étude exploitant les données de l'enquête nationale Sintes-héroïne réalisée entre mars 2007 et juin 2008, un grand écart de concentration en héroïne pure entre les différentes poudres en circulation. Les pourcentages peuvent varier de zéro à plus de 60 % sans qu'aucune caractéristique physique, comme la couleur par exemple, ne permette d'avoir connaissance de ces différences de composition. Selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), la part des échantillons d'héroïne dosés à plus de 30 % est également en augmentation, ce qui entraînerait une hausse des surdoses mortelles.
Parallèlement à l'augmentation du taux de principe actif, la tendance est à la régression de la pureté des stupéfiants . C'est tout d'abord le cas pour la cocaïne : les stocks disponibles étant moins importants et les prix restant constants, les trafiquants recourent à des produits dans lesquels sont incorporés des composants de toute nature. « Il y a en effet dans la cocaïne au minimum seize produits chimiques différents, voire plus, sans compter les coupages », a expliqué M. François Thierry ; « les feuilles de cocaïne trempent d'abord dans un bain de kérosène afin de les transformer en pâte que l'on fait réagir avec de l'acide sulfurique, puis chlorhydrique. C'est cette substance que l'on s'introduit dans le nez » (1) .
La même évolution a été signalée par M. Fabrice Besacier, chef de la section « stupéfiants » du laboratoire de police scientifique de Lyon : « contrairement à ce qui se passait il y a dix ou quinze ans, elle arrive en France déjà coupée, que ce soit dans les cargos ou à l'aéroport, notamment à Roissy. Ensuite, à peine arrivée sur le territoire national, un coupage beaucoup plus important est opéré, essentiellement à partir de produits pharmaceutiques détournés, et la pureté de cette cocaïne peut descendre jusqu'à 10 % ou 20 % au niveau de la rue » (6 ( * )) .
Le constat est identique pour ce qui est de l' héroïne : les stocks arrivent « bruts » en Europe, où ils sont ensuite fréquemment coupés avec du plâtre, de la farine, de la colle, du sucre, du talc, de la brique, ou encore de nombreux anesthésiants vétérinaires renforçant son effet. M. Gilbert Pépin, biologiste, expert près la Cour d'appel de Paris, agréé par la Cour de cassation, expert près le tribunal administratif de Paris, a fait état d'analyses menées ces deux dernières années sur des lots d'héroïne et de cocaïne saisis, qui ont révélé non seulement la présence d'excipients banaux, comme la caféine ou la lidocaïne, succédané de la cocaïne, mais aussi de médicaments comme le lévamisole ou la phénacétine, antalgique retiré du marché français en raison des maladies qu'il causait, la présence d'alprazolam constituant le cas le plus grave (7 ( * )) .
La raison pour laquelle les fabricants mélangent ces composants à l'héroïne ou à la cocaïne est mal connue. Eu égard à leur concentration maximale, ils ne sont normalement pas à l'origine d'une toxicité aiguë. En revanche, associé à l'héroïne, l'alprazolam, qui est une benzodiazépine, provoque une perte de conscience très rapide du consommateur et peut avoir des effets catastrophiques si celui-ci est au volant.
b) Les produits médicamenteux
Certains médicaments, s'ils ne constituent pas des drogues en eux-mêmes, peuvent en devenir par destination, selon la façon dont ils sont accommodés et utilisés.
Ainsi en est-il par exemple des benzodiazépines , médicaments psychotropes utilisés dans le traitement de l'anxiété et des troubles phobiques, et constituant une alternative aux barbituriques. Le détournement de l'usage des benzodiazépines à des fins toxicomaniaques peut prendre la forme classique d'une toxicomanie isolée, mais a lieu le plus souvent en association avec d'autres substances psychoactives (héroïne ou alcool, le plus souvent).
Ce risque, que l'on rencontre davantage chez des publics féminins, est d'autant plus élevé que notre pays détient des records de prescriptions d'anxiolytiques, parmi lesquels les benzodiazépines sont les produits les plus prescrits. Or, leur prise provoque des effets de dépendance psychologique et physique induisant un besoin irrésistible de consommation, avec souvent la nécessité d'augmenter régulièrement les doses pour que soit maintenu l'effet recherché.
Mais le principal médicament faisant l'objet d'abus est un produit justement destiné au traitement des toxicomanes. Le mésusage de traitements de substitution est bien documenté par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). Selon celle-ci, en 2004, 5 % de leurs utilisateurs étaient concernés, et l'on pouvait aller jusqu'à 20 % avec des « intermittents de la substitution », usagers de drogues prêts à recourir à un traitement de substitution ou objets de rechute.
Utilisé comme substitut des opiacés chez les consommateurs d'héroïne, le Subutex - médicament dont le principe actif est la buprénorphine - fait aujourd'hui couramment l'objet de détournements à des fins toxicomanes. « Un tiers du marché de la buprénorphine servirait actuellement, dans notre pays, à contaminer de jeunes individus qui n'étaient pas encore passés aux agents morphiniques et entreront par ce sas dans l'héroïnomanie, dont on voit d'ailleurs le nombre de victimes croître à la mesure de l'augmentation de ce détournement. Il est insupportable qu'un produit qui coûte si cher à la collectivité nationale puisse être à ce point détourné » a ainsi témoigné M. Jean Costentin, président du Centre national de prévention, d'études et de recherches en toxicomanie (8 ( * )) . Les mésusages du Subutex sont connus et variés : injection intraveineuse, « sniff », utilisation comme première et unique drogue, et enfin, cumul avec des benzodiazépines.
Également utilisée comme substitut des opiacés chez les consommateurs d'héroïne, la méthadone fait en revanche l'objet de beaucoup moins de dérives. À la différence du Subutex, prescrit par un médecin de ville, elle voit sa distribution beaucoup plus encadrée, puisqu'elle ne peut être assurée que par des médecins exerçant en établissements de santé.
D' autres produits , moins connus, font aussi l'objet de mésusages, comme l'a indiqué M. Thierry Huguet, chef de la brigade des stupéfiants de la direction régionale de la police judiciaire : « nous constatons des détournements réguliers de produits pharmaceutiques utilisés de manière courante. Nous avons tous à l'esprit le détournement des produits de substitution aux opiacés, qui touche en effet beaucoup plus le Subutex que la méthadone. Mais la kétamine est aussi assez régulièrement détournée, notamment dans les milieux asiatiques. Cet anesthésique, du reste aujourd'hui essentiellement prescrit dans le domaine vétérinaire, est utilisé par certains toxicomanes à la recherche de sensations fortes - on parle de sensation de mort imminente ».
Le détournement de ces produits pharmaceutiques, outre les risques qu'il induit, n'est pas sans coût pour la collectivité. Le professeur Jean Costentin, membre de la commission sur les addictions de l'Académie nationale de médecine, a ainsi stigmatisé l'usage de « produits de substitution, Subutex et méthadone, qui font l'objet d'un trafic scandaleux. C'est particulièrement vrai pour le Subutex, dont un tiers des cachets, remboursés une fortune par la Sécurité sociale, sont absorbés par des jeunes gens qui n'étaient pas jusque-là usagers d'opiacés mais qui, quand ils ne se satisferont plus du Subutex, passeront à l'héroïne » (9 ( * )) .
En vue de mieux réguler le marché des médicaments ayant des effets psychotropes, et de prévenir en ce domaine les abus et mésusages, la mission d'information propose, comme cela sera précisé plus loin, de développer le recours à des ordonnances sécurisées pour ces produits.
c) La multiplication des drogues de synthèse
Le développement des drogues de synthèse - produits psychotropes synthétisées artificiellement, par opposition aux drogues d'origine végétale - a été particulièrement intense au cours des dernières années. Le type le plus connu en est l' ecstasy , un stimulant de type amphétaminique.
M. Jérôme Fournel, directeur général des douanes et des droits indirects, a insisté sur le « phénomène marquant en 2009 et 2010 » qu'a constitué la saisie croissante, par son administration, de drogues de synthèse, « ecstasy et LSD, mais aussi de nouvelles molécules récemment interdites comme la méphédrone, les méthamphétamines, etc . » (10 ( * )) . M. Bernard Petit, sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière à la direction générale de la police nationale, a ainsi fait état de « quarante nouvelles molécules susceptibles d'être utilisées par des consommateurs [qui] ont été détectées et identifiées » en 2010 (2) .
Les drogues de synthèse sont marquées par l'apparition et le développement rapide des « legal highs », présentées aux consommateurs comme des alternatives licites aux drogues illicites. Conçus par des « drug designers », ces produits contournent l'interdiction de commercialisation de molécules classées parmi les stupéfiants en choisissant les plus proches, naturelles ou synthétiques, avant que celles-ci ne soient à leur tour interdites.
La méphédrone , molécule de synthèse dérivée de la cathinone, l'alcaloïde du khat, et constituant un substitut médicamenteux à l'ecstasy ou à la cocaïne, donne un bon exemple de ce procédé. Les effets du produit ainsi que son faible coût et le vide juridique dans lequel il se trouvait ont créé un véritable engouement au Royaume-Uni. En effet, un léger déplacement d'une des branches chimiques de la molécule initiale avait permis de ne rien changer aux effets psychotropes du médicament et d'en maintenir la revente sous forme de produit stupéfiant sans encourir d'interdiction. En s'appuyant sur un plan de promotion très ciblé, ce produit y est devenu, en un an seulement, la quatrième drogue la plus consommée, avant finalement d'être classé comme stupéfiant et d'être interdit à l'échelle européenne à la fin de l'année 2010.
Un autre exemple réside dans le remplacement du cannabis par un mélange d'herbes exotiques auquel sont ajoutés des composants synthétiques. « Le cannabis étant interdit, il suffit de synthétiser des cannabinoïdes dits de synthèse vendus comme engrais, sels de bain, encens et déconseillés à la consommation humaine pour ne pas être inquiété par la police ou par les douanes ! » a ainsi expliqué le docteur William Lowenstein (11 ( * )) . Ces produits, dont les effets sont proches du cannabis, sont fabriqués essentiellement en Asie, a-t-il expliqué. Leurs molécules sont connues parce que développées, pour la plupart, par des universitaires dans le cadre d'études sur le comportement lié à la prise de cannabis, avant d'avoir été détournées pour être vendues et consommées.
M. Frédéric Dupuch, directeur de l'Institut national de police scientifique, a bien analysé l' exploitation par les trafiquants des vides juridiques provisoires ménagés par une réglementation qui a toujours une « longueur de retard » par rapport à l'évolution des produits : « ne peut être poursuivi pour trafic de drogue que quelqu'un qui vend de la drogue, concept qui obéit à une définition juridique. Les drogues médicamenteuses sont listées dans un texte réglementaire, mis à jour par le ministère de la santé. Si un produit s'en rapproche, mais qu'il ne correspond pas à la définition, il n'est pas considéré comme une drogue illicite et ne peut donc, en tant que tel, donner lieu à des poursuites, alors même qu'il est toujours possible d'incriminer les trafiquants pour des infractions de nature fiscale ou douanière » (12 ( * )) . Aussi, afin d'y faire face, des pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni ont choisi d'établir une classification, non par molécule, mais par famille de molécules structurellement proches d'un point de vue chimique.
C'est ainsi qu'une nouvelle drogue apparaît sur le marché tous les deux mois environ, et que les législations anti-drogue sont régulièrement contournées par des chimistes peu scrupuleux qui ont toujours « un tour d'avance » sur l'état du droit. De nombreuses personnes auditionnées ont ainsi fait état de la « course contre la montre » engagée entre des chimistes inventant de nouvelles molécules ayant des effets toxicologiques, mais ne sont pas immédiatement classées comme produits stupéfiants, et les services de lutte contre la drogue, qui cherchent à les faire classer comme telles aussi rapidement que possible. « Chaque semaine, une nouvelle molécule de synthèse est créée avant d'être interdite. Dans un jeu sans fin du chat et de la souris informatique, des centaines de millions de comprimés ou de grammes de poudre sont vendus » a relevé le docteur Lowenstein (1) .
M. Franck Zobel, rédacteur scientifique et analyste des politiques en matière de drogue à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), a ainsi fait état de la recrudescence de nouvelles substances : dix ont été identifiées chaque année de 2005 à 2007, trente en 2008, quarante en 2009, 50 en 2010 et sans doute un chiffre supérieur en 2011 (13 ( * )) . Ce changement incessant de nom et de type des produits rend en outre très difficile la mesure de l'ampleur de la production et de la consommation.
En vue d'un traitement plus efficace, et surtout plus réactif, du problème posé par la multiplication des drogues de synthèse, et notamment des « legal highs », la mission d'information propose que soient classées dans le tableau des stupéfiants non pas des molécules, mais des familles de molécules structurellement proches, en procédant par analogie.
2. Des sources d'approvisionnement qui se rapprochent des lieux de consommation
Le marché de la drogue est un marché international où les zones de production, souvent éloignées des marchés de consommation, tendent toutefois à s'en rapprocher. La transformation de la matière brute en produits plus ou moins élaborés s'effectue dans des laboratoires clandestins, situés au départ ou, de plus en plus, vers la fin de la filière, sur notre propre territoire national. Le transport de la drogue, sous ses diverses formes, est l'opération qui présente le plus de risques pour les trafiquants, expliquant leur souci de multiplier les itinéraires.
a) Le maintien des filières « traditionnelles »
? Le cannabis
Le cannabis se rencontre sous forme de résine (ou « haschich » ou « shit ») forme la plus souvent consommée en France -, d'herbe (ou « marijuana ») et, accessoirement, d'huile.
La résine de cannabis saisie en France provient essentiellement du Maroc - dont elle constitue la deuxième source de revenu -, le plus souvent via l'Espagne, d'où elle est acheminée par des réseaux criminels plus ou moins organisés. Aujourd'hui, ce marché semble moins dynamique du fait de la concurrence grandissante provoquée par l'accroissement de l'autoculture, les politiques d'éradication menées dans les pays traditionnellement producteurs ou encore la tendance des réseaux importateurs à lui préférer d'autres produits plus rentables.
En effet, s'il reste l'une des principales régions de production de cannabis à destination de l'Europe (14 ( * )) , et le principal fournisseur de la France, le Maroc a tenté de juguler ce phénomène. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, un effort significatif a été accompli dans ce pays, la surface de culture du cannabis ayant été réduite de 130 000 hectares à 64 000 hectares, et les quantités saisies ayant considérablement augmenté. Cependant, il semble que cette réduction quantitative soit compensée par une augmentation du nombre de récoltes et du taux de THC. Selon M. Gilbert Pépin, biologiste, le taux moyen de tétrahydrocannabinol (THC) y est passé, en trois ans, de 13,4 % à 14,7 % (15 ( * )) .
L' Espagne reste la « plaque tournante » du trafic du Sud de l'Europe et le principal point d'alimentation de notre pays, avec d'importants volumes stockés dans des villes comme Madrid, Malaga, Barcelone et Alicante. La résine de cannabis part souvent du Maroc, transite par l'Espagne et parvient dans notre pays, où une partie y est revendue tandis que l'autre s'exporte à travers toute l'Europe. Entre 200 et 300 tonnes de résine seraient ainsi acheminées chaque année pour satisfaire la consommation française.
Quant à l' herbe de cannabis saisie en France, elle provient essentiellement des Pays-Bas et de Belgique, comme c'est le cas dans les autres pays consommateurs européens, mais aussi des États producteurs de l'aire caribéenne, pour ce qui est de la consommation dans les départements d'outre-mer. La production locale, sur notre propre territoire national, tend toutefois à prendre une place grandissante comme source d'approvisionnement (16 ( * )) .
? L'héroïne
Dans son rapport 2010, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) constate une tendance à la hausse de la disponibilité de l'héroïne sur le marché français, qu'elle attribue au nouveau dynamisme de l'offre enregistré depuis dix ans en Afghanistan , pays d'où provient 90 % de l'héroïne consommée en France. L'augmentation de la production d'opium et d'héroïne dans ce pays a ainsi favorisé le développement d'organisations criminelles, turques et albanaises en particulier, qui importent l'héroïne, via la route des Balkans, sur le territoire français et la vendent en demi-gros ou en gros à des réseaux de détaillants, impliqués en général dans le trafic de résine de cannabis importée d'Espagne ou du Maroc, implantés dans les cités périphériques des grandes agglomérations urbaines françaises.
En outre, rapporte l'organisation, à côté de ces réseaux qui relèvent du crime organisé, existent des réseaux qualifiés de « secondaires » par la police, à savoir des microstructures composées pour la plupart d'usagers-revendeurs qui s'approvisionnent en héroïne dans les pays proches de la France comme la Belgique et les Pays-Bas , lieux traditionnels de stockage de l'héroïne arrivant via la route des Balkans. Tous ces facteurs contribuent au caractère de plus en plus diffus de la présence du produit sur le territoire français, conclut l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), et facilite son « retour en grâce » parmi certaines couches de consommateurs.
Pour l'héroïne comme pour les autres types de stupéfiants, la France tend de plus en plus à devenir un pays de transit . Ainsi que l'a indiqué M. Bernard Petit, « cette dernière provient d'Afghanistan, remonte par la route des Balkans, «tape» en Allemagne, puis «rebondit» aux Pays-Bas où se trouvent les structures commerciales permettant une diffusion dans le reste de l'Europe : le marché britannique en tête, puis la France, l'Espagne, l'Italie, etc . » 80 % environ de l'héroïne consommée dans nos cités et dans le Sud du pays viennent des Pays-Bas et du Nord de la Belgique (17 ( * )) .
M. François Thierry, commissaire divisionnaire, chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a fait part à la mission de son inquiétude quant à une résurgence significative de ce produit : « on assiste lentement mais sûrement à une reprise de son usage [...] . Ce produit a une apparence plus «attirante» qu'autrefois, s'injecte moins, se sniffe et se fume plus qu'avant mais a toujours les mêmes effets dévastateurs sur la santé et sur les capacités d'insertion de nos concitoyens dans la vie sociale. L'héroïne revient progressivement par l'Est de l'Europe. Les chiffres des saisies, plus d'une tonne cette année, sont en augmentation régulière. Je pense qu'il faudra être extrêmement vigilant et surveiller la diffusion de l'héroïne par le biais du milieu festif ou des « raves parties » » (18 ( * )) .
? La cocaïne
Produite uniquement par les pays andins - Colombie, Pérou, Bolivie et peut-être une zone en Équateur -, la cocaïne est transportée par voie maritime ou aérienne. Elle transite ensuite soit par le couloir de l'Amérique centrale et du Mexique pour entrer aux États-Unis, soit par l'Afrique occidentale pour entrer en Europe par la péninsule ibérique ou les Pays-Bas.
Toujours selon les tendances mises à jour par l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), l'offre de cocaïne est en progression régulière et bénéficie depuis dix ans d'une restructuration qui favorise la diffusion du produit sur l'ensemble du territoire. Les réseaux importateurs de résine de cannabis produite au Maroc tendent en effet à y substituer la vente de cocaïne, bien plus rentable que celle de résine : la première est revendue 30 euros par gramme contre environ 2 euros pour le gramme de résine de cannabis.
Cette tendance est favorisée en outre par la modification des routes du grand trafic international de la cocaïne, qui se calquent de plus en plus sur celles du cannabis précédemment évoquées. 20 % à 30 % de la cocaïne saisie en Europe passerait ainsi par l'Afrique de l'ouest en remontant par les pays du Maghreb, qui sont des lieux traditionnels d'approvisionnement en résine de cannabis. Et la prolifération de réseaux « multi trafics », très anciennement implantés, dans les banlieues périphériques des grandes villes françaises contribue au développement d'une offre importante de cocaïne.
Par ailleurs, et de la même façon que ce que l'on constate pour l'héroïne, se développent rapidement des réseaux fondés sur des usagers-revendeurs alimentant une petite clientèle d'usagers s'approvisionnant dans les pays voisins de la France, tels que l'Espagne, la Belgique et les Pays-Bas. Ces micro-réseaux, au nombre de plusieurs centaines, favorisent une diffusion de l'offre de cocaïne dans les territoires tant urbains que ruraux.
? Les drogues de synthèse
L'approvisionnement en drogues de synthèse se fait en provenance de pays du Nord de l'Europe (Pays-Bas, Belgique, Allemagne), et plus rarement auprès de filières relevant du crime organisé originaires d' Europe de l'Est .
La majeure partie des produits, acheminés de ces pays essentiellement par la voie routière, et saisie sur le territoire français, est destinée au marché britannique. Viennent ensuite les marchés français, espagnol, italien et portugais. On note qu'une large part du trafic de ces produits a pour origine des actes d'achat effectués sur internet.
b) La culture domestique
Autrefois marginale et expérimentale, la culture personnelle tend à s'accroître et à prendre des proportions excédant le simple cadre domestique.
Ainsi que l'explique l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) dans son rapport 2010, l'herbe de cannabis est la seule substance illicite à faire l'objet d'une production sur le territoire national par autoculture réalisée le plus souvent dans un cadre domestique ou plutôt artisanal. L'organisation lie ce phénomène à un esprit du temps qui voit le développement d'une mode privilégiant l'usage de produits dits « biologiques » supposés être de meilleure qualité, et au souci grandissant des usagers de se protéger des risques d'interpellation en évitant la fréquentation des marchés parallèles et des revendeurs.
En augmentation depuis une dizaine d'années, au regard des dernières données datant de l'année 2005, le phénomène concernerait de 100 à 200 000 « cannabiculteurs » pour une production annuelle d'une trentaine de tonnes. En outre, les services en charge de la répression du trafic illicite de stupéfiants notent le développement du commerce transfrontalier d'herbe en provenance de Belgique et des Pays-Bas, pays où la culture a pris une ampleur extrêmement importante du fait de l'implication du crime organisé dans une production à grande échelle.
M. Gilbert Pépin, biologiste, a rendu compte de cette évolution marquante : « l'herbe, quant à elle, est souvent cultivée chez soi. Les acheteurs de graines, peu connaisseurs, se retrouvent souvent à faire pousser du sisal, utilisé pour confectionner des paniers ou des cordes, et donc dépourvu de THC ! En se fournissant sur internet ou à Amsterdam, les plus malins peuvent arriver à récolter de l'herbe au taux de 14,7 %. Mais ils sont loin d'être les plus nombreux » (19 ( * )) .
Faisant part de son expérience dans la région jurassienne, M. Bernard Amiens a rapporté l'ingéniosité avec laquelle sont utilisées par les producteurs les conditions naturelles locales pour optimiser leur offre. Une grande quantité de caves serait utilisée pour la germination des plans de cannabis avant qu'ils ne soient replantés à la belle saison en pleine nature dans les bois, les champs de maïs, les jardins. La gendarmerie d'Arbois a saisi 1 000 pieds de cannabis en 2009, ce qui représente environ 20 % de la production locale. La rentabilité de ce type de culture, bien supérieure à celle de pieds de vigne, explique qu'il soit de plus en plus recherché (20 ( * )) .
Il est à noter que la commercialisation de kits de production sur internet , en toute impunité, contribue directement à l'accroissement de la production domestique dans un pays comme la France. En 2003, le rapport d'information sénatorial sur les drogues avertissait déjà qu'« internet peut également être utilisé pour obtenir des renseignements sur les méthodes de mise au point de certaines drogues, qu'elles soient naturelles ou chimiques ». Et de citer M. Jacques Franquet, alors premier vice-président de l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), qui avait reconnu que l'on pouvait trouver sur le réseau « tous les modes de culture du cannabis, toutes les recettes possibles pour fabriquer de l'ecstasy ». Cette disponibilité contribue par ailleurs directement à l'élévation des taux de principe actif précédemment mentionnée, puisqu'est vendu sur internet le matériel nécessaire pour une culture en chambre, hydroponique, sous éclairage artificiel, conçue pour l'obtention de plants aux taux de THC décuplés.
c) Les laboratoires clandestins
Si notre pays s'approvisionne encore massivement à l'étranger, la crainte est désormais avérée qu'il devienne à son tour - comme d'ailleurs tous les autres États européens - un pôle d'offre à plus ou moins grande échelle, comme a pu en témoigner devant la mission M. François Thierry (21 ( * )) .
La Belgique ou les Pays-Bas - où l'on estime que 45 000 plantations de cannabis sont disséminées - accueillent depuis longtemps déjà des laboratoires de production ou de transformation de stupéfiants, cannabis comme drogues de synthèse. Or, « il n'y a aucune raison pour que nous ne courrions pas le risque de voir la production s'implanter dans notre pays », a reconnu M. Thierry, pour qui « nous avons aussi des surfaces agricoles à même d'accueillir ces fermes et des exploitations en faillite pouvant être rachetées ».
Cette évolution est particulièrement préoccupante du fait du rapprochement du lieu de production et de consommation qu'elle induit, lequel permet un approvisionnement moins risqué, de meilleure qualité, plus rapide et à moindre coût. L'échelle dont il est ici question n'est plus celle de la production domestique, où les quantités restent marginales, mais relève d'une véritable industrie qui se professionnalise.
« Nous avons tous en tête l'image de l'étudiant cultivant du cannabis chez lui après avoir ramené des graines d'un voyage aux Pays-Bas. À cette production a succédé progressivement, depuis deux ou trois ans, celle effectuée dans des appartements dédiés à cette culture, voire dans des lieux plus importants exploités par des gens dont les préoccupations sont avant tout commerciales » a témoigné à cet égard M. Thierry.
Ce cannabis se prévaut par ailleurs d'une image « bio » avancée comme un élément de marketing différenciant auprès de consommateurs européens plus exigeants qualitativement. « Les trafiquants marocains, libanais ou afghans ont de plus en plus mauvaise réputation : les produits ont été tellement coupés que les consommateurs se sont tournés vers un produit vendu comme plus naturel et de manière plus directe. Ce produit risque donc d'avoir la faveur des consommateurs dans les deux à trois ans qui viennent, et de nous poser problème » a ainsi souligné M. Thierry.
M. Fabrice Besacier, chef de la section Stupéfiants du Laboratoire de police scientifique de Lyon, a également pointé les dangers que font peser sur les utilisateurs ces produits fabriqués dans des laboratoires et parés de vertus tirées de leur prétendue naturalité. « Les consommateurs pensent que l'herbe de cannabis est un produit plus fiable parce que c'est un produit naturel, une herbe qui est fumée telle quelle. Or, dans tous les pays d'Europe, notamment en 2008 jusqu'au début 2009, des micro-billes de verre, de l'ordre de 50 micromètres, ont été insérées dans la plante, dans ses sommités fleuries. L'intérêt pour le trafiquant était qu'elles faisaient briller le produit, qui semblait davantage dosé en THC, et qu'elles pouvaient en augmenter la masse jusqu'à 30 %. Mais quand les gens le fumaient, les micro-billes pouvaient se casser et provoquer une atteinte pulmonaire » (22 ( * )) .
Cette évolution, loin de se limiter au continent européen, touche l'ensemble de la planète. Ainsi que l'a relevé M. Étienne Apaire, président du Groupe Pompidou du Conseil de l'Europe, « les distinctions subtiles entre pays producteurs et pays consommateurs s'amenuisent considérablement. En effet, si les drogues chimiques sont plutôt l'apanage de pays développés, leur consommation se développe dans les pays asiatiques. En outre, les pays producteurs deviennent des pays consommateurs. [...] On compte un million d'héroïnomanes en Afghanistan, entre trois et quatre millions au Pakistan. Ces pays sont désormais tout autant victimes que nous de leur production. Au Sénégal, en Guinée et Guinée-Bissau, et maintenant au Maroc et en Algérie, la route de la cocaïne déverse aussi des drogues parmi les populations » (23 ( * )) .
B. DES PRATIQUES QUI SE TRANSFORMENT
Parallèlement à l'évolution des produits stupéfiants, on assiste à une modification de la demande touchant aussi bien les volumes de consommation de chaque type de produits que les modes de consommation, le tout engendrant une adaptation des trafics en vue de « coller » le plus possible aux nouveaux marchés de la drogue.
1. L'évolution contrastée des consommations
De façon générale, et comme l'illustrent les deux graphiques ci-dessous, on observe une hausse assez nette de l'expérimentation de cannabis depuis 1992. Si l'usage d'autres produits illicites reste relativement marginal en France, certaines substances ont néanmoins connu une diffusion croissante au cours des années 1990 et depuis le début des années 2000, comme la cocaïne et les hallucinogènes (LSD et champignons hallucinogènes). Il en va de même de substances synthétiques telles que l'ecstasy ou les amphétamines, dont l'expérimentation a fait plus que tripler entre 1995 et 2005. Les niveaux d'expérimentation d'héroïne sont pour leur part restés relativement stables sur l'ensemble de la période, concernant environ 1 % des 18-44 ans.
Évolution de l'usage de cannabis au cours de
la vie
parmi les 18-44 ans depuis 1992
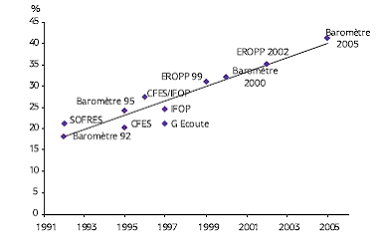
Source : Sondage
1992, SOFRES ; Baromètres 1992, 1995, 1996, 2000, CFES ;
sondage 1997 IFOP ; sondage 1997, Publimétrie Grande
Écoute ; EROPP 1999, 2002, OFDT ; Baromètre
santé 2005 INPES.
Usage au cours de la vie de substances psychoactives (hors alcool, tabac et cannabis) parmi les 18-44 ans depuis 1992

Source : Baromètres Santé 1992-1995-2000-2005, INPES Exploitation OFDT ; EROPP 2002 OFDT
a) Le cannabis, un produit de grande consommation
Selon les chiffres de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), la France compterait aujourd'hui :
- 12,4 millions d'expérimentateurs de cannabis , c'est-à-dire de personnes ayant déclaré avoir consommé au moins une fois au cours de leur vie ;
- dont 3,9 millions actuels, c'est-à-dire consommateurs dans l'année ;
- et 1,2 millions réguliers, c'est-à-dire reconnaissant au moins 10 consommations de cannabis dans le mois.
Le cannabis est aujourd'hui la première substance illicite consommée en France , cet usage étant surtout le fait de populations jeunes . Avec 31 % des jeunes de seize ans scolarisés déclarant avoir déjà expérimenté le cannabis et 15 % qui déclarent une consommation au cours du mois, la France se situe parmi les tout premiers pays européens en la matière (respectivement à la cinquième et troisième place pour les deux indicateurs).
Cependant, ainsi que l'a commenté M. Jean-Michel Costes, directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), l'usage de cannabis, « après deux décennies d'augmentation régulière, a connu un changement de tendance qui s'est traduit, en 2002-2003, par une stabilisation à un niveau assez haut et, depuis quelques années, par une diminution de la consommation chez les jeunes », qui va d'ailleurs de pair, a-t-il également souligné, avec une diminution du tabagisme chez ces populations (24 ( * )) .
Le docteur William Lowenstein a scindé les consommateurs de cannabis, très schématiquement, en deux populations, « soit des adolescents avec une consommation extraordinairement intense que l'on n'aurait pu imaginer dans les années 1970-1980 et très souvent une psychopathologie associée, soit des adultes de trente-cinq à cinquante-cinq ans qui n'en peuvent mais de leur dépendance, c'est-à-dire de leur consommation modeste mais quotidienne et régulière depuis vingt à quarante ans » (25 ( * )) .
b) Le retour inquiétant de l'héroïne
Le niveau d'expérimentation de l'héroïne dans la population générale, en France, reste faible : il ne dépasse pas les 1 %, que ce soit chez les 15-34 ans (0,9 %) ou les 35-64 ans (0,7 %). Le nombre d'expérimentateurs d'héroïne en France parmi les 12-75 ans est ainsi estimé à 360 000 personnes, ce chiffre apparaissant stable depuis le début des années 1990. En revanche, parmi les jeunes âgés de dix-sept ans, l'expérimentation de l'héroïne est en hausse depuis 2005, s'élevant à 0,8 % chez les filles et à 1,4 % chez les garçons. À la différence des années 1980, les usagers fument ou « sniffent » l'héroïne beaucoup plus qu'ils ne se l'injectent.
En France, la partie la plus visible de la population consommatrice d'héroïne, constituée majoritairement d'hommes de plus de trente ans, est composée de personnes fragiles qui fréquentent les structures dites de première ligne consacrées à la réduction des risques (boutiques, programmes d'échange de seringues) et les centres de soins spécialisés pour les toxicomanes. Un rajeunissement des populations affectées serait néanmoins observé, le docteur William Lowenstein ayant évoqué « de nouveaux usages chez des jeunes de dix-sept à vingt-cinq ans, souvent extraordinairement précarisés » (1) .
Depuis quelques années en effet, on assiste à l'émergence de nouvelles populations d'usagers . L'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) les classe en trois groupes distincts :
- des usagers en situation précaire, évoluant entre le milieu festif « techno » et les zones urbaines. Il s'agit d'une population jeune, le plus souvent en situation d'errance, volontaire ou non ;
- des usagers plus intégrés socialement, qui fréquentent ce même milieu festif, essentiellement consommateurs de produits stimulants, qui prennent de l'héroïne en complément afin de moduler les effets de ceux-ci ;
- des usagers ayant une pratique occasionnelle du produit, que ce soit dans un contexte festif (clubs, discothèques) ou privé.
M. Franck Zobel, rédacteur scientifique et analyste des politiques en matière de drogue à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), a clairement rendu compte de cette évolution : « les problèmes liés à l'héroïne ont très sévèrement augmenté en Europe durant les années 1980 et 1990, avant de se stabiliser puis de diminuer vers la fin des années 1990. En revanche, depuis 2003 et 2004, on observe, de façon presque choquante, une inversion de tendance, la consommation cessant de diminuer avant de repartir à la hausse » (26 ( * )) .
c) La banalisation de la cocaïne
S'agissant de la cocaïne, la France est marquée, selon les propres termes de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), par « un usage de moins en moins rare en population générale ». L'organisation relève ainsi que si le niveau d'expérimentation est encore relativement faible, cette substance est une des drogues illicites les plus consommées après le cannabis : son expérimentation touche 2,6 % des 15-64 ans, plus souvent des hommes (3,9 %) que des femmes (1,6 %). Tout en ne concernant qu'une petite frange de la population, ce produit a néanmoins connu une expansion croissante au cours des années 1990, passant de 1,2 % en 1992 à 3,8 % en 2005 parmi les 18-44 ans. Le nombre d'expérimentateurs de cocaïne en France parmi les 12-75 ans est aujourd'hui estimé à environ 1 million de personnes, et le nombre d'usagers au cours de l'année à environ 200 000 personnes.
La diffusion de la cocaïne sous forme de poudre (chlorhydrate) ne cesse de s'élargir en France, dans l'espace festif comme dans l'espace urbain. « Les milieux sociaux concernés par cette consommation sont devenus tellement larges et hétérogènes qu'il est difficile aujourd'hui de dresser un portrait type du consommateur », note l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT).
Son directeur, M. Jean-Michel Costes, a fait clairement état des préoccupations quant à l'évolution à venir de l'usage de ce type de produit, observant « une amorce significative de la consommation de stimulants comme la cocaïne, qui est passée de 1 % en 2000, chez les jeunes de dix-sept ans, à 3,3 % en 2008, les indicateurs montrant une tendance à l'augmentation dans la population générale. Les jeunes Français se situent à 15 % par rapport à la consommation européenne, suivant en cela le modèle de certains pays dans la décennie précédente, comme l'Italie, l'Espagne ou le Royaume-Uni. La consommation de cocaïne est encore à un niveau relativement faible, ce qui fait dire qu'il s'agira d'un enjeu important au cours des cinq ou dix prochaines années » (27 ( * )) .
De son côté, M. François Thierry, commissaire divisionnaire, chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, a fait le lien entre les problèmes de consommation et de trafic de cette substance : « la France reste un pays de consommation de cocaïne, produit très préoccupant. Le plafond n'est probablement pas encore atteint, le nombre d'usagers continuant à augmenter, tout comme celui des trafiquants interpellés. On pense que le développement de cette activité n'est pas encore arrivé à son point d'équilibre ; c'est pourquoi nous sommes extrêmement motivés pour poursuivre la lutte contre les trafiquants de cocaïne qui ont la particularité d'être particulièrement corrupteurs pour les États dans lesquels ils oeuvrent. On l'a vu de manière spectaculaire dans des États comme le Mexique ou le Venezuela et, plus près de nous, plus récemment, dans les États africains concernés » (28 ( * )) .
d) La consommation encore marginale des drogues de synthèse
L' ecstasy reste un produit globalement peu expérimenté , avec 2 % des personnes âgées de quinze à soixante-quatre ans en France. Cependant, le niveau d'expérimentation apparaît nettement plus élevé chez les jeunes adulte s (3,7 % à 15-34 ans) que chez les plus âgés (0,6 % à 35-64 ans). De plus, ce niveau apparaît en hausse depuis le milieu des années 1990. Le nombre de personnes âgées de douze à soixante-quatre ans ayant consommé de l'ecstasy au moins une fois au cours de leur vie est aujourd'hui estimé à 800 000 personnes et celui des usagers au cours de l'année à 200 000.
La fréquence de l'expérimentation d' amphétamines en population générale est relativement faible , avec 1,4 % des personnes de quinze à soixante-quinze ans. Chez les jeunes de dix-sept ans, l'expérimentation est de 1,9 % chez les filles et de 3,5 % chez les garçons, soit des chiffres en hausse par rapport à ceux de 2005, qui eux-mêmes avaient progressé après 2000. Cependant, la France reste moins touchée que des pays comme l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Italie et le Danemark, très fortement affectés à cet égard.
En règle générale, les usagers de l'ecstasy viennent de milieux festifs technos, qu'ils soient « commerciaux » (clubs, discothèques) ou « alternatifs » ( teknivals , free-parties ). Les comprimés et les gélules sont les formes plus répandues dans les premiers, et la poudre étant plus fréquente dans les seconds. S'agissant des amphétamines, si les milieux festifs sont très largement des lieux de consommation, celle-ci ne s'y limite pas et touche assez fréquemment des « jeunes errants » des espaces urbains.
M. François Thierry, (OCRTIS), a fait état de l'aspect encore peu développé de l'usage des drogues de synthèse en France, indiquant que nous étions « marginalement un pays consommateur d'ecstasy et d'amphétamines. On annonce une augmentation des saisies d'ecstasy de 500 % mais nous partons de chiffres extrêmement modestes : environ 700 000 cachets ont été saisis cette année, ce qui reste très en deçà des 2 à 3 millions saisis couramment par an il y a dix ans. Ce produit n'a donc pas fonctionné commercialement.
« L'ecstasy n'a pas la faveur du consommateur français, contrairement à ce que l'on constate aux Pays-Bas, en Belgique ou en Grande-Bretagne, mais cela ne signifie pas qu'elle ne resurgira pas sous une autre forme. Il faut noter qu'il existe d'autres produits assez proches qui peuvent devenir à la mode en quelques mois. L'ecstasy, en tout état de cause, ne représente pas un problème pour la France pour le moment, dans la mesure où, peu diffusée, elle est restée confinée dans des milieux particuliers pour ce qui est de l'usage mais aussi de la distribution. Ce n'est pas un produit aux mains du banditisme organisé » (29 ( * )) .
2. De nouvelles pratiques de consommation qui induisent de nouveaux consommateurs
Autrefois le seul fait de quelques initiés ou marginaux, l'usage de la drogue s'est très largement développé. « On a assisté à une très importante diffusion des pratiques de consommation dans toutes les couches de la société. On peut le regretter et le dénoncer, mais c'est une réalité partagée par tous les pays développés » a ainsi fait observer M. Alain Morel, directeur général d'Oppelia (30 ( * )) .
Au-delà de ce constat général, une analyse plus affinée montre que les pratiques majoritaires sont aujourd'hui à la consommation de plusieurs produits et au détournement d'usage de produits non illicites.
a) La polytoxicomanie, un phénomène désormais largement répandu
« L'évolution majeure de ces dix dernières années, comparées aux années 1970, est le passage d'une toxicomanie plutôt centrée sur un produit à une polytoxicomanie », a déclaré à la mission M. Gilles Leclair, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense Sud. « Sans parler du tabac, une soirée type de certains jeunes commence avec de l'alcool ; ensuite vient la prise d'un «joint», pour être en forme en boîte de nuit, puis d'ecstasy et de cocaïne, pour améliorer ses performances, en boîte puis au lit, enfin, le cas échéant, d'un peu d'héroïne pour se remonter d'un coup de blues . Pendant une soirée, une personne peut ainsi prendre six produits addictifs », a-t-il indiqué pour illustrer son propos (31 ( * )) .
Ces propos rendent bien compte d'une nouvelle caractéristique des pratiques de consommation, celle d'un usage « à la carte » , en fonction des envies ou des possibilités. « On n'est plus aujourd'hui face à des mono-consommateurs mais des poly-consommateurs ; les usagers adoptent différents menus de consommation, peuvent s'arrêter cinq jours et reprendre à la faveur d'un moment festif, d'une souffrance, d'une angoisse » a souligné le docteur Yves Edel (32 ( * )) .
M. Jean-Michel Costes, directeur de l'OFDT, a établi un lien entre polyconsommation et « usage problématique » des drogues, c'est-à-dire un usage débouchant sur des dommages sanitaires et sociaux : « on estime qu'il existe environ, en France, 230 000 usagers problématiques de drogues opiacées et de stimulants ou d'hallucinogènes. Ce sont pour la plupart des poly-consommateurs : la figure de l'héroïnomane ne se rencontre plus parmi les populations d'usagers problématiques de drogues ! » (33 ( * )) .
La figure de l'accro à la seule cocaïne ne se rencontre pas davantage, si l'on écoute le docteur Marc Valleur : « il n'existe pas [...] de cocaïnomane pur. Les gens qui consomment de la cocaïne prennent aussi de l'alcool, du tabac, des opiacés et des médicaments psychotropes en même temps. La poly-consommation est donc actuellement plus la règle que l'exception. Cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une conduite irrationnelle mais que la rationalité des consommations est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine » (34 ( * )) .
M. Franck Zobel, rédacteur scientifique et analyste des politiques en matière de drogue à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), a mis l'accent sur la connexion des problèmes affectant consommateurs d'héroïne et de cocaïne , la première étant souvent associée à la seconde pour assurer la « descente » (35 ( * )) . Soulignant l'accroissement considérable de la diffusion de la cocaïne en Europe ces dernières années, il a indiqué que les usagers la consommaient désormais en sus de l'héroïne, de l'alcool et de médicaments comme les benzodiazépines, et ceci alors que les mélanges d'alcool et de cocaïne, ou encore d'héroïne et de cocaïne sont extrêmement dangereux.
b) Les usages festifs et les consommations séquentielles
L'usage de psychotropes dans les milieux festifs (clubs, teknivals, free-parties , rave-parties , pubs, soirées privées ...) est croissant depuis quelques années (36 ( * )) .
À cet égard, la cocaïne est sans doute l'un des stupéfiants les plus prisés parmi les publics qui se veulent « branchés ». « C'est un produit encore à la mode qui a été fort bien lancé commercialement par ceux qui en vendent », a indiqué M. François Thierry, (OCRTIS). « Il jouit encore d'une certaine faveur dans la «jet-set» ou dans une certaine classe sociale et ce ne sont pas les confessions publiques d'animateurs de la télévision qui y changeront quelque chose » (37 ( * )) .
Mais toutes les drogues se prêtent en réalité aujourd'hui aux usages dits « festifs » ou « récréatifs », y compris celles réservées autrefois à des publics marginalisés, comme l'héroïne. Le témoignage de Mme Anne Guichard, chargée de mission au département « Évaluation et expérimentation » de la direction des affaires scientifiques de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), est à cet égard éclairant, notamment sur les problèmes d'identification des usagers que cela entraîne : « un nouveau profil d'usagers injecteurs d'héroïne apparaît : il s'agit de jeunes, bien intégrés, qui consomment dans un cadre festif. D'un point de vue épidémiologique, ces injections occasionnelles sont tout aussi catastrophiques que les autres, mais il nous est difficile de cerner ces usagers, noyés dans la masse de la population » (38 ( * )) .
En fait, les consommations festives sont de plus en plus des polyconsommations . « Les données dont nous disposons, souvent en retard sur l'évolution réelle des pratiques, montrent que les modes de consommation évoluent. Les injections très occasionnelles, en augmentation, sont le fait de jeunes, bien intégrés, étudiants, qui consomment en milieu festif du Subutex, des amphétamines, de la cocaïne et même de l'héroïne, sans pour autant tomber immédiatement dans la compulsion » note ainsi Mme Anne Guichard, qui insiste sur le peu de visibilité des publics concernés : « ce sont précisément ces nouveaux modes de consommation qui nous inquiètent : la population est plus difficile à atteindre, elle est moins demandeuse de soins. Pourtant, ses comportements sont tout aussi dangereux ».
Différent de la polyconsommation de caractère festif est l'usage de « drogues séquentielles ». Ce concept renvoie à de nouvelles substances chimiques, à mi-chemin entre le médicament, le dopant et le stupéfiant, ayant pour particularité d'entraîner des effets psychoactifs différant dans le temps selon le moment auquel ils interviennent. À la différence de la polyconsommation, les produits sont consommés successivement et l'effet recherché est l'enchaînement d'effets psychoactifs différents.
L'ingestion d'un produit de ce type permet ainsi, par exemple, d'accroître son efficacité professionnelle durant la matinée, d'augmenter ses performances sportives pendant l'après-midi, de stimuler sa sensibilité le soir et de provoquer un état de relaxation ou d'extase pour la nuit.
« Des secteurs de plus en plus larges de la population comme les jeunes adultes sont en quête de méthodes destinées à maîtriser leurs états mentaux : recherche d'euphorie, modification de l'humeur, changement hédonique de leur état mental mais aussi automédication », a commenté le docteur Michel Le Moal, psychiatre. « Toutes les substances toxicophiliques ou addictogènes ont une valeur d'automédication et peuvent être utilisées pour compenser un léger état affectif négatif . [...] Cette automédication permet aussi de réguler des états de stress, d'améliorer des performances, de chercher de façon presque épidémique à améliorer les performances ou accroître les interactions sociales. Il peut également s'agir d'améliorer le comportement sexuel, de maîtriser les apparences physiques. [...] Toutes ces molécules ont également la faculté de changer les capacités sensorielles. Ces différentes facultés sont pratiquement partagées par l'ensemble des substances addictogènes » (39 ( * )) .
c) Les détournements de produits licites
Le détournement de produits licites - essentiellement médicamenteux - vers des usages stupéfiants est en passe de devenir un phénomène d'importance majeure dans nos sociétés. Le rapport annuel de l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) pour 2007 relevait déjà que dans certaines régions du monde, l'abus de médicaments délivrés sur ordonnance a dépassé celui de drogues illicites traditionnelles. « La plupart des pays n'ont pas conscience de l'ampleur du détournement et de l'abus de médicaments légalement prescrits, malgré la multiplication des décès qui y sont liés », soulignait alors le président de l'organisation mandaté par l'ONU, M. Philip Emafo (40 ( * )) .
L'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) estime ainsi qu'en France, un quart des prescriptions de buprénorphine (Subutex) est détourné vers le marché illicite et parfois réexporté. M. Bernard Amiens, administrateur de l'ARAFDES, institut de formation des cadres de l'action sociale, dresse un constat inquiétant de ce point de vue : « 99 000 personnes sont concernées en France par le Subutex et 25 000 par la méthadone. 125 000 personnes sont en situation de traitement, ce qui représente un nombre considérable de personnes qui ne se traitent pas. Or, nous constatons que le vendredi soir la «défonce» s'organise avec du Subutex sur prescription médicale. Ces produits de substitution sont attendus comme le « shoot » ! » (41 ( * )) .
Parallèlement au détournement de médicaments prescrits légalement, la production, le détournement du circuit commercial licite de produits chimiques de base - ou « précurseurs » - généralement contenus dans les médicaments et utilisés pour transformer et affiner des drogues illicites constitue une menace croissante.
Ces composants sont en effet indispensables pour la fabrication illicite d'amphétamines et d'autres drogues de synthèse, ainsi que pour la transformation illicite de drogues telles que la cocaïne et l'héroïne. Par exemple, la métamphétamine est produite illégalement à partir de l'éphédrine - ingrédient de nombreux médicaments antitussifs - ou de la pseudo-éphédrine - qui entre dans la composition de décongestifs des fosses nasales délivrés sans ordonnance. Le permanganate de potassium, qui sert à purifier la cocaïne, est par ailleurs un désinfectant et sert à purifier l'eau.
Ces précurseurs chimiques sont soumis à un contrôle international draconien mais n'en font pas moins l'objet d'un trafic très important. En France, c'est à la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques qu'il revient de suivre l'achat de l'un des 23 produits précurseurs dont l'usage peut être potentiellement illicite. Elle dispose à cet effet de larges attributions en matière de contrôle des précurseurs de stupéfiants, tant sur le plan national (relations avec les industriels, surveillance des échanges extérieurs, coordination des services administratifs compétents) qu'international (contacts avec les administrations étrangères, représentation de la France dans les institutions européennes et internationales).
3. L'adaptation constante des trafics
Malgré les importantes saisies opérées par les services répressifs et les démantèlements de réseaux qu'elles permettent, le trafic de drogues illicites continue de perdurer, et ce grâce à une constante évolution de ses composantes.
M. François Thierry, commissaire divisionnaire, chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a insisté devant la mission sur cette formidable capacité d'adaptation des organisations criminelles : « il faut toujours ramener le trafic de stupéfiants à celui d'un commerce. Certes, ce n'est pas un commerce comme un autre mais il génère pour les trafiquants des problématiques commerciales classiques de production, d'acheminement, de stockage, de marché, de marges, de risques sur la route. Il faut rapprocher les lieux de stockage des lieux de demande. Si vous mettez trop de temps à répondre à une demande, vous allez être concurrencé sur votre marché et vous ne serez plus compétitif, de même que si vous êtes trop cher ou si votre marchandise est de mauvaise qualité. Si vous effrayez le consommateur, ce qui est fréquent dans le domaine des stupéfiants, vous ne serez plus compétitif non plus ! Toutes ces problématiques sont au coeur du métier de trafiquant de stupéfiants et nécessitent des adaptations incessantes » (42 ( * )) .
a) Des filières traditionnelles qui se transforment
Tout d'abord, l'internationalisation des trafics est patente, ainsi que l'a souligné M. Bernard Petit, sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière à la direction générale de la police nationale. « Ils ont changé d'échelle : autrefois, de petites équipes achetaient leur produit en France ou en Espagne où se trouvaient leurs contacts et distribuaient 100 kilogrammes de résine dans une cité ; aujourd'hui, les équipes descendent en Espagne, ont des contacts avec des Français de souche marocaine ou algérienne, voire avec des Colombiens, ce qui leur permet d'accéder à différents produits de qualité satisfaisante et à des prix compétitifs » (43 ( * )) .
La tendance générale, d'un point de vue géographique, semble être au remplacement progressif des filières venant du Nord de l'Europe par d'autres provenant du Sud, ainsi que de l'Afrique - notamment avec de nouveaux pays situés au-delà du Maghreb, comme la Guinée et la Guinée-Bissau, où les trafics prospèrent du fait de la situation économique et sociale dramatique - et des Balkans. M. Danilo Ballota, officier principal de police scientifique chargé de la coordination institutionnelle à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), reprenant les termes d'Europol, a ainsi parlé d'une véritable « autoroute » des drogues en Méditerranée où « les trafiquants ne se donnent même pas la peine de dissimuler les paquets de cocaïne sur les navires : les hélicoptères peuvent les apercevoir stockés sur le pont et les photographier » (44 ( * )) .
Au niveau national, de nouvelles approches basées sur une analyse quasi commerciale du marché émergent. « Dans la deuxième partie des années 1970, les trafiquants étaient spécialisés : haschich, cocaïne, héroïne. Aujourd'hui, petits ou puissants, ils se sont adaptés au marché : ils vont où est l'argent », a indiqué M. Gilles Leclair, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense Sud (45 ( * )) . Le professeur Michel Reynaud a rapporté quant à lui « l'implantation massive des circuits de distribution du cannabis dans les collèges et lycées, où ils servent de plateformes à de petits trafiquants multicartes ». Un constat qui l'a amené à se demander si cette intrusion « ne permettra pas à des jeunes consommateurs de cannabis d'avoir accès à d'autres produits », et d'ainsi favoriser l'escalade (46 ( * )) .
M. Étienne Apaire, président de la MILDT, a quant à lui insisté sur la capacité des trafiquants de taille intermédiaire à adapter l'offre par rapport à l'évolution des politiques antidrogues : « chaque département français abrite deux ou trois grossistes en cannabis - il n'a pas été réalisé d'étude pour les autres drogues -, dont le chiffre d'affaires est compris entre 250 000 et 500 000 euros par an. [...] Or, ces grossistes ne sont pas spécialisés. Tous les produits les intéressent. Lorsqu'ils constatent une baisse de consommation d'un produit, ils essaient d'en lancer un autre. [...] En admettant - hypothèse hautement improbable - que le Gouvernement légalise la production de cannabis, du jour au lendemain les organisations criminelles essaieraient aussitôt de diffuser un autre produit. Autrement dit, la diminution de la consommation d'un produit peut être contrebalancée par l'augmentation du trafic d'un autre, et donc ne pas être incompatible avec un maintien à haut niveau du chiffre d'affaires des trafiquants » (1) .
M. François Thierry a pour sa part fait observer les modifications des filières et des méthodes d'approvisionnement des trafiquants, « obligés de changer leurs routes et d'adopter des stratégies plus onéreuses. C'est ainsi que la cocaïne voyage de moins en moins sous sa forme finie. Traditionnellement, la cocaïne peut voyager en pain d'un kilo ; aujourd'hui, elle est déstructurée et mélangée à d'autres supports dans un laboratoire du pays de départ. Il s'agit de lui donner une forme différente pour la rendre moins détectable et plus facilement dissimulable et stockable à l'arrivée. Ceci nécessite, outre le laboratoire du pays de départ, d'en avoir un dans le pays d'arrivée pour retransformer la cocaïne et la rendre à nouveau compatible avec une commercialisation directe ».
Il a par ailleurs insisté sur l' approche marketing qu'ont désormais les trafiquants, par exemple pour l'héroïne : « ce sont des «commerçants» : ils ont compris les inconvénients de leur produit et ont énormément travaillé le packaging, l'image, la publicité, les effets secondaires et le mode de prise. Il fallait que ce soit plus à la mode qu'un « shoot » qui a aujourd'hui mauvaise presse. Ils ont réussi à offrir un produit relativement compétitif et disposent d'environ deux ans de stocks, en raison de l'importante production afghane et maintenant iranienne. Ils peuvent ainsi se permettre d'offrir des prix bas pour favoriser la reprise de la consommation » (47 ( * )) .
M. Jérôme Fournel, directeur général des douanes et des droits indirects, a fait état d'une « diversification des modes d'acheminement . Alors que les opérations de contrôle portaient traditionnellement sur les poids lourds, les vecteurs sont aujourd'hui bien plus variés », il a ajouté : « début 2011, près de 800 kilogrammes de cocaïne ont été découverts dans un conteneur arrivant par voie maritime, véhicules légers, fret express, fret postal, etc. Les formes de cache et d'organisation sont sophistiquées et mobiles » . M. Fournel a évoqué l'utilisation de plus en plus fréquente de produits industriels, comme des « pièces pour les piles de pont, qui sont montées en usine avec de la drogue à l'intérieur, ce qui requiert de grandes capacités d'anticipation et d'investissement » (48 ( * )) .
L'ingéniosité des trafiquants pour acheminer leur marchandise sur le territoire national semble sans limite. M. Fabrice Besacier, chef de la section « stupéfiants » du laboratoire de police scientifique de Lyon, a par exemple signalé que « la cocaïne peut être facilement dissoute - jusqu'à un demi-kilogramme dans une bouteille d'un litre de soda - ou incorporée dans le plastique thermoformé d'une valise. Une fois en France, quelques laboratoires clandestins utilisent des produits chimiques du commerce pour récupérer cette cocaïne et la revendre » (49 ( * )) .
« Les trafiquants s'organisent ! », a souligné M. Gilles Leclair, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense Sud. « Ainsi, les voitures de luxe ne sont plus achetées par les trafiquants mais louées ou prêtées afin d'éviter que la police ne retrouve le trafiquant qui les utilise. [...] Ils sont aussi très mouvants et capables de se réfugier dans d'autres grandes villes ou à l'étranger lorsqu'ils se sentent cernés » (50 ( * )) .
Il semble en effet que la réactivité des trafiquants soit de plus en plus grande , et la réponse judiciaire d'autant plus difficile à apporter de façon systématique. « Le trafic génère énormément d'argent et les groupes criminels se structurent très rapidement », a ainsi expliqué M. Bernard Petit, sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière à la direction générale de la police nationale. « En seulement deux ans, un groupe criminel né du trafic de résine de cannabis atteint une maturité et un développement problématiques qui nécessitent l'intervention, non d'un commissariat ou d'une unité de gendarmerie territoriale, mais d'unités spécialisées » (51 ( * )) .
Afin de lutter plus efficacement contre l'ensemble de ces trafics en croissance continue, la mission d'information propose de créer une base de référence d'échantillons de drogues permettant d'établir plus facilement leur origine et de reconstituer ainsi les réseaux criminels en vue de leur appréhension.
b) Le recours croissant aux services de messagerie
La livraison à distance, rapide et anonyme que permettent les transporteurs de colis, nationaux comme internationaux, via les services de messagerie est une véritable aubaine pour des revendeurs de drogues toujours à la recherche de procédés de commercialisation aussi discrets que possible.
M. François Thierry, commissaire divisionnaire, chef de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a fait état de ce point de vue des difficultés que pose aux services répressifs nationaux la maîtrise des flux de colis et paquets susceptibles de véhiculer des produits stupéfiants : « la France reste [...] un pays de transit pour toute la messagerie expresse [...] . Le hub de Roissy est devenu le second d'Europe pour Federal Express, DHL et Colissimo. Plusieurs millions de paquets par semaine transitent par ces hubs . Certes, les quantités sont mesurées mais il existe un trafic de fourmi et ces opérateurs nous posent un important problème de logistique, les paquets ne restant en transit sur notre territoire qu'un temps très court. Il est extrêmement difficile pour les services douaniers de détecter les trafics en une heure à peine » (52 ( * )) .
L' administration des douanes semble en tout cas avoir saisi l'ampleur du problème et tenter d'y faire face. « Nous sommes aussi de plus en plus présents dans les centres de tri du fret postal et du fret express, où il est assez facile de poser une « nasse » », a déclaré M. Jérôme Fournel, directeur général des douanes et des droits indirects. « Ainsi, l'an dernier, 2 tonnes de stupéfiants et 36 tonnes de tabac y ont été saisies par la douane. Nous travaillons en étroite coopération avec La Poste comme avec les transporteurs express pour recueillir l'information et cibler les colis qui présentent un risque parmi les millions d'envois quotidiens : bien que les trafiquants se montrent de plus en plus subtils dans les acheminements, nous savons que les molécules de synthèse proviennent souvent d'Asie ou du Moyen-Orient » (53 ( * )) .
c) Le défi de l'offre de produits sur internet
Le développement sans précédent du réseau internet au cours des dernières années a rapidement constitué un support très prisé pour des trafiquants ne connaissant pas les frontières, mais également pour des consommateurs désireux de s'approvisionner en toute discrétion.
« Il est vrai qu'en matière de criminalité, internet va être un des gros enjeux des années à venir » a ainsi reconnu M. François Thierry, commissaire divisionnaire, chef de Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS). « Pour ce qui concerne les stupéfiants, internet propose non seulement des graines à la vente mais aussi la méthode pour planter et récolter, ainsi que le matériel. Plus de 400 sites sont accessibles en France. Internet propose également de la vente de produits nouveaux comme le « spice », cannabis de synthèse fabriqué sous forme de spray dont on peut imbiber n'importe quel support à fumer. Ce produit est interdit mais la molécule, Delta 09, est extrêmement puissante. On manque de recul pour évaluer ses incidences sur la santé publique mais un produit plus fort que le cannabis ne devrait pas être bon pour la santé. De tels produits méphédrone, kétamine, spice sont disponibles sur internet... » (54 ( * )) .
M. Franck Zobel, rédacteur scientifique et analyste des politiques en matière de drogue à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), a fait état d'un « nouveau marché, très dynamique », des drogues de synthèse qui « s'est développé essentiellement sur internet », où son organisation a recensé pas moins de 170 commerces en ligne cette année (55 ( * )) . Le docteur William Lowenstein a évoqué quant à lui « le nombre grandissant de patients qui commandent sur des sites de tous pays de nouvelles drogues de synthèse - les « party pills » - totalement légales et livrables en 48 heures tant qu'elles ne sont pas repérées et interdites ». « On peut acheter sur internet tout le matériel et toutes les graines que l'on veut et, avec un investissement de 15 000 euros, certains produisent une tonne de cannabis en intérieur en une année », a reconnu à cet égard M. Gilles Leclair, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense Sud (56 ( * )) .
Observant que « les drogues profitent aussi de la mondialisation », M. Philippe Batel, psychiatre, a rapporté pour sa part qu'« aujourd'hui, les cathinones, dérivées des amphétamines et dont fait partie la méphédrone, s'achètent sur internet ». Il s'est alarmé qu'« une quinzaine de ces drogues donnent lieu à des situations de dépendance un peu inquiétantes, les sujets sous leur emprise développant des troubles du comportement et se livrant à des prises de risques majeurs » et a fait remarquer que du fait de l'anonymat du réseau, « on ignore le nombre de consommateurs » (57 ( * )) .
Or, les services répressifs sont pour l'instant démunis face à ce phénomène grandissant, a reconnu M. François Thierry : « je n'ai pas de solution en matière de contrôle d'internet : nous sommes pourtant nombreux à être concernés. Nous agissons avec internet comme pour tous les autres moyens de transport du produit. Nous faisons de la veille et nous allons en faire davantage. Nous visitons ces sites, faisons de l'infiltration, comme pour les autres affaires. [...] On ne fera pas de miracles avec internet dans le domaine des stupéfiants » (58 ( * )) .
M. Jérôme Fournel, directeur général des douanes et des droits indirects, a toutefois assuré avoir « beaucoup investi ces deux dernières années en faveur de la surveillance du commerce électronique », avec la création d'une division spécialisée, Cyberdouane , qui assure en permanence, à partir de moteurs de recherche, la veille sur ce qui se passe sur internet, pour les stupéfiants mais aussi pour les tabacs et les contrefaçons. Il a indiqué que la coopération avec nos partenaires européens est de qualité, « y compris en ce qui concerne les nouvelles drogues et la vente des stupéfiants sur internet », et a évoqué avoir réalisé, à l'automne dernier, « un important travail pour renforcer la lutte contre la cybercriminalité, y compris la vente de médicaments contrefaits » (59 ( * )) .
Les capacités à agir des différents États ne sont pas identiques, a-t-il toutefois reconnu. Ainsi, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne sont les seuls à disposer d'une cellule du type Cyberdouane. Or, selon M. Jérôme Fournel, « si l'on veut gagner en efficacité, il faudrait qu'il en existe dans tous les pays et qu'elles fonctionnent en réseau, comme c'est le cas, en France, avec l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ».
C. DES RISQUES QUI S'ACCROISSENT
Si les chiffres de mortalité liés à l'usage de drogues illicites peuvent accréditer l'idée que les risques encourus ne sont « pas si graves » au regard des drogues illicites - quelques centaines d'overdoses fatales par an pour les premières, contre 30 000 décès dus à l'alcool et 60 000 au tabac -, une analyse plus pointue montre très vite que les dommages liés aux toxicomanies sont excessivement élevés, pour les usagers eux-mêmes comme pour leur entourage proche et pour la société dans son ensemble.
1. De graves risques pour la santé
Les risques que fait peser la consommation de drogues concernent aussi bien les usagers pris individuellement - ils sont alors aussi bien d'ordre physique que psychique - que dans les relations qu'ils entretiennent entre eux.
a) Des risques individuels : les effets des drogues sur l'organisme
Toute drogue présente, à des degrés divers, un potentiel intoxicant somatique, c'est-à-dire capable de léser physiquement certains organes, et un potentiel intoxicant psychique.
S'agissant tout d'abord du potentiel intoxicant somatique , la conséquence sanitaire la plus brutale - et fort heureusement la plus rare - liée à l'usage de drogues est bien sûr le décès par overdose. Et en la matière, ainsi que l'a fait observer M. Jean-Michel Costes, directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), « le risque majeur - cela ne fait pas débat dans la littérature scientifique - est l'utilisation de la voie intraveineuse ». C'est pourquoi, ainsi que le rapport mondial sur les drogues de 1996, rapportant des études réalisées en Angleterre dans les années 60, l'accréditait, les héroïnomanes ont un taux de mortalité très supérieur à la moyenne.
Selon les dernières données de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) en la matière, le nombre de décès par overdose s'élève actuellement à environ 300 par an. M. Jean-Michel Costes, directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), a toutefois tenu à apporter un correctif à cet indicateur : « on sait en effet, pour avoir mené d'autres études, que l'on sous-estime de 25 % à 30 % le nombre des décès. Il est même probable que les décès liés à l'usage problématique de drogues soient plus proches du millier que de 300. Cela reste à relativiser par rapport à la position de la France, dont le taux de mortalité est inférieur à la moyenne européenne » (60 ( * )) .
Même nuance de la part de M. François Thierry, (OCRTIS), selon lequel « on sait qu'il existe un chiffre noir des décès par overdose de cocaïne et que certaines personnes développent des troubles mentaux sévères mais aussi bien d'autres pathologies. Nous sommes persuadés qu'un certain nombre d'infarctus, de ruptures d'anévrisme, etc., sont dus à la consommation de ce produit sans que ce soit détecté. Il reste donc de gros progrès à faire dans ce domaine » (61 ( * )) .
Les facteurs augmentant les risques d'overdose sont relativement variés. Cela peut tenir à la qualité des produits, et notamment à l'augmentation significative (62 ( * )) de la teneur en composants actifs, qui favorise les surdoses, comme à la quantité utilisée. Cela provient également des modes de consommation : comme l'a fait remarquer M. Jean-Michel Costes, « les overdoses se produisent essentiellement à la suite d'une rechute ou à la fin d'une incarcération, l'usager de drogues ayant oublié que la méthodologie a changé ».
En dehors des cas de mort directement liés à leur consommation, les drogues ont des effets néfastes avérés sur la physiologie des utilisateurs :
- l' héroïne a des conséquences sur le système nerveux, entraînant une rigidité musculaire, des vomissements et des problèmes respiratoires ; sur le système cardiovasculaire, engendrant une modification de la fréquence cardiaque ; sur le système gastro-intestinal, notamment sur la vésicule biliaire ; et enfin sur la peau et la dentition. Une consommation prolongée peut même entraîner une baisse du désir sexuel jusqu'à l'impuissance chez l'homme, une perturbation du cycle menstruel chez la femme, ainsi que léthargie et anorexie ;
- la cocaïne et le crack , favorisant la coagulation du sang, peuvent entraîner des oedèmes cérébraux, des atrophies cérébrales, des infarctus du myocarde et des crises d'épilepsie ;
- le cannabis provoque des effets quasi immédiats (pupilles dilatées avec une irritation des conjonctives, hypotension, sensation de soif, hypoglycémie, parfois nausées et vomissements), temporaires, réversibles et d'intensité en règle générale modérée. Ils peuvent parfois être à l'origine de malaises, d'une chute de la tension artérielle et de tachycardie favorisant les thromboses et les embolies. En cas de prise répétée et massive, les effets sont de même nature que ceux observés chez les grands fumeurs (troubles du sommeil, amaigrissement, constipation et des problèmes dentaires, laryngites et bronchites, problèmes cardiovasculaires et troubles asthmatiques, probabilité accrue de complications foetales et néonatales, voire cancers) ;
- les drogues de synthèse engendrent, elles aussi, des effets à court terme (tension musculaire, nausée, vision brouillée, faiblesse générale, frissons ou transpiration) qui peuvent être suivis d'effets brutaux (coagulation intravasculaire, insuffisance rénale aiguë, anémie aplasique, endommagement de certains organes comme le foie, le cerveau et le coeur, dégénérescence des cellules nerveuses, accident vasculaire cérébral).
Les effets néfastes des drogues sur l'organisme sont d'autant plus importants que la première expérimentation se fait jeune et qu'elle laisse place à une consommation régulière et soutenue. Tel est le constat dressé par le professeur Michel Reynaud à propos du cannabis, pour qui « le danger réside dans sa consommation massive par des jeunes qui présentent une vulnérabilité cérébrale à ce produit. Plus on commence tôt, plus on a de chances de devenir dépendant et plus on altère ses circuits cérébraux » (63 ( * )) . Le professeur a donc logiquement préconisé, comme « premier moyen de réduire les dommages », le fait d'éviter, « dans toute la mesure du possible, toute consommation de la part des moins de dix-huit ou vingt ans », tout en reconnaissant que ce sont « précisément ceux qui cherchent à consommer ». Le professeur Jean Costentin a pareillement fait observer que « la rencontre avec le cannabis a lieu à l'adolescence, période de grande vulnérabilité où le système nerveux central n'est pas encore fini. En interférant dans les processus de «prolifération» et d'«élagage» en cours, le cannabis perturbe gravement son achèvement » (64 ( * )) .
Outre les effets physiologiques à proprement parler, les effets sur le psychisme des consommateurs de stupéfiants peuvent être considérables : modification de l'humeur, anxiété, dépression, crise d'angoisse et de panique, perte de contrôle de soi, trouble du comportement, délire, épisode psychotique, trouble de la personnalité, paranoïa... S'ils sont répétés, ces troubles deviennent durables et peuvent conduire à des affections psychiatriques graves : dépression, psychose, paranoïa ou schizophrénie chroniques.
À cet égard, des interactions entre usage de cannabis et schizophrénie semblent aujourd'hui bien établies. « C'est un fait que 95 % des schizophrènes ont fumé du cannabis », a ainsi souligné M. Jean Canneva, président de l'Union nationale des amis et familles de malades psychiques (1) . Si le sens de la relation de causalité entre les deux est encore incertain, « on ne peut pas soutenir qu'il n'existe pas de lien entre les deux » a-t-il fait valoir, rapportant que des jeunes dépourvus de problèmes psychiques « disjonctaient » brutalement après avoir fumé du cannabis. « Cette consommation n'est peut-être pas la seule cause de leur problème comportemental mais pour des personnalités fragiles, elle est sans doute un facteur déclenchant », a estimé M. Jean Canneva.
Même constat de la part du professeur Jean Costentin, pour qui « plus personne ne nie sérieusement la relation entre cannabis et schizophrénie ; plus le cannabis est consommé tôt et à des doses élevées, plus les conséquences sur le développement psychique, la mémoire, les processus éducatifs, l'anxiété et la dépression sont graves. Le discours sur le cannabis ne peut plus être celui qui nous était servi il y a trente ans » (1) . Pour le docteur Henri Joyeux également, la drogue « abîme le cerveau et de multiples études montrent chez les jeunes une augmentation de la schizophrénie liée à l'utilisation de la drogue » (65 ( * )) .
L'ensemble de ces effets psychiatriques est susceptible de déboucher sur les conséquences les plus graves, et notamment l'automutilation ou la mort par suicide . Les interactions entre consommation de drogue et suicide ont été démontrées dans la littérature scientifique (66 ( * )) : on a en effet constaté une nette augmentation des comportements suicidaires chez les adolescents qui consomment des drogues. Ainsi, le troisième facteur de risque des comportements suicidaires, selon le degré d'importance, est la consommation de drogue, les deux premiers étant les tentatives précédentes et la dépression. « À l'adolescence », constate ainsi le professeur Philippe Jeammet, « nous voyons s'installer sous nos yeux des conduites destructrices qui ne sont pas choisies, mais qui donnent le sentiment d'exister. Ces conduites peuvent aller jusqu'au suicide : je n'ai pas choisi de naître, mais je peux choisir de mourir - ce qui me permet aussi d'envoyer ce geste à la face des autres » (67 ( * )) .
Outre l'incitation au suicide qu'engendrent les effets psycho-sociaux des drogues, leurs effets neuronaux immédiats peuvent également entraîner des comportements suicidaires involontaires , en altérant l'état de conscience des usagers. À cet égard, le cannabis très fortement titré, comme il s'en vend de plus en plus, est naturellement beaucoup plus dangereux que le cannabis de base. Le rapport de la mission sénatoriale sur les drogues illicites de 2003 a ainsi évoqué le cas, fort médiatisé, d'un jeune homme s'étant défenestré après avoir fumé un « joint » préparé avec du cannabis provenant de Hollande et titré à 14,4 %.
b) Des risques collectifs : la transmission de maladies contagieuses
À côté des risques individuels liés à la consommation de drogues, pesant sur le corps ou le psychisme des usagers concernés, existent des risques de nature collective et tenant à la transmission de maladies contagieuses - VIH, VHB et VHC - par la voie des instruments ou produits utilisés par les toxicomanes.
D'une façon générale, les données de la littérature épidémiologique indiquent que les contaminations surviennent tôt dans les trajectoires des usagers de drogues par voie intraveineuse, probablement dès les premières injections. De nombreuses études attestent de taux de séroconversion VIH et VHC plus élevés parmi les jeunes et les nouveaux consommateurs que parmi les usagers de drogues anciens et expérimentés. L'enquête Coquelicot, menée par l'Institut de veille sanitaire, confirme cette tendance en montrant que 30 % des usagers de moins de trente ans sont infectés.
S'agissant tout d'abord de la contamination au VIH , la tendance est plutôt encourageante, la tendance apparaissant à la baisse et la France rejoignant, à cet égard, la grande majorité des pays européens. La prévalence du SIDA chez les usagers de drogues par voie intraveineuse, qui était de l'ordre de 40 % dans les années 1990 et qui a fait une dizaine de milliers de morts durant cette décennie, est aujourd'hui de l'ordre de 10 % à 12 %. 6 000 personnes environ seraient contaminées aujourd'hui par cette maladie parmi les toxicomanes. La politique de réduction des risques, et notamment le programme d'échange des seringues, a en effet permis d'améliorer les conditions d'hygiène dans lesquelles les toxicomanes s'administrent leurs produits.
Pourtant, et même si les usagers de drogues représentent un pourcentage infime des personnes infectées par le VIH, il demeure des motifs d'inquiétude. Tout d'abord, les toxicomanes restent dix-huit fois plus exposés que la population générale à la contamination, tandis que 90 % des personnes atteintes par le VIH sont également porteuses du VHC. De plus, un inquiétant relâchement est visible chez ces populations exposées, ainsi que l'a pointé le docteur François Bourdillon : si « pratiquement tous ceux qui ont utilisé les seringues dans les années 1980 ont été contaminés, aujourd'hui, les jeunes y sont beaucoup moins attentifs et peut-être plus concernés par le VHC et le VHB que par le VIH ! ». Enfin, le VIH reste un vrai problème dans les prisons, 1 % de la population carcérale étant contaminée - 3 % par le VHB et 7 % par le VHC - « ce qui est considérable », a estimé le docteur Bourdillon. « La drogue circulant en prison, en l'absence d'accès aux programmes d'échange de seringues, les prisonniers ont recours à des moyens artisanaux utilisés dans des conditions d'hygiène difficiles », ce qui explique cette surcontamination (68 ( * )) .
Les hépatites sont des inflammations du foie causées, soit - et c'est la majorité des cas - par des virus, soit par des substances toxiques, au premier rang desquelles les drogues. Désignées par les lettres A, B, C, D (ou delta) et E, elles diffèrent par leur mode de transmission, celle-ci étant parentérale - c'est-à-dire qui n'emprunte pas la voie digestive - pour les virus B et C.
Affectant très largement les toxicomanes s'administrant leurs produits par voie intraveineuse, ces maladies sont aujourd'hui un enjeu de santé public plus important pour ces populations que le VIH. Comme l'a en effet souligné M. Pascal Melin, président de SOS Hépatites, « pour l'hépatite C, comme pour l'hépatite B, on compte environ quatre mille nouvelles contaminations chaque année en France. Or, alors que les moyens importants consacrés au VIH ont réduit le nombre de morts à quelques centaines, les hépatites virales continuent à tuer autant que la route, avec cinq mille morts par an, ce qui est d'autant plus inacceptable que nous avons les moyens de réduire ce nombre en adaptant nos politiques sanitaires » (69 ( * )) .
S'agissant de l' hépatite C , les nouvelles contaminations sont essentiellement liées à l'usage de drogues, tandis que les niveaux de prévalence sont très élevés, de l'ordre de 60 % des usagers de drogues par voie intraveineuse. Cependant, comme l'a fait observer M. Jean-Michel Costes, « il faut [...] prendre conscience du fait que, pour des raisons de coûts, les sources utilisent pour l'essentiel la prévalence déclarée, qui entraîne une sous estimation de l'ordre de 15 à 20 %. Il est donc probable que la prévalence du VHC soit plus proche de 60 % que de 40 %. Même si on voit s'amorcer une diminution qui reste à surveiller, cette prévalence demeure élevée et constitue un problème général en Europe » (70 ( * )) .
Le taux de contamination des toxicomanes à l' hépatite B est moins élevé : ainsi, environ 5 % des usagers de drogue par voie intraveineuse sont porteurs chroniques du VHB. Ce taux reste toutefois supérieur à la prévalence de la maladie dans la population générale, où il est inférieur à 1 %. Et une étude réalisée par l'Institut de veille sanitaire en 2006 a placé l'usage de drogues par voie intraveineuse au premier rang des facteurs à risque dans la contraction de cette maladie.
Quelles que soient les maladies considérées, la contamination par des maladies contagieuses du fait des usages toxicomanes est particulièrement prégnante en prison . Actuellement, 3 300 détenus sont atteints d'hépatite C, 1 700 de l'hépatite B et 800 du VIH, sachant qu'entre soixante et cent détenus sont contaminés chaque année en prison, selon l'estimation des professionnels de terrain. Comme l'a rappelé le docteur André-Jean Rémy, l'Institut de veille sanitaire, dans son enquête sur la prévalence des hépatites en France, a démontré que la prison multiplie par dix le facteur de risques relatifs à l'hépatite C et par 4 celui de l'hépatite B (71 ( * )) .
Il existe en effet des pratiques à risques en prison du fait de l'absence d'activités et de la relative disponibilité de produits illicites ou de médicaments détournés de leur usage thérapeutique. Ces pratiques sont multiples : injections, « sniffs », tatouages artisanaux, piercings , scarifications ou relations sexuelles non protégées... D'après le docteur André-Jean Rémy, « ces pratiques à risques en milieu carcéral sont connues des équipes soignantes ».
Selon l'enquête « Coquelicot » réalisée par l'Institut de veille sanitaire (72 ( * )) , sur 61 % d'usagers de drogues ayant souvent fréquenté la prison, on dénombre 12 % d'injecteurs dont 30 % avec échange de matériel non stérile. Et selon les résultats d'une enquête de pratiques 2010 citée par le docteur André-Jean Rémy, les données françaises de terrain montrent que deux tiers des unités de consultations et de soins ambulatoires ont eu connaissance de pratiques de « sniff », la moitié de partage de paille, un tiers d'injection et de partage de seringues entre détenus, et un quart de partage de coton ou de cuillères.
Face à ces risques de contamination, les vaccinations - qui sont un moyen efficace de prévenir la contamination aux différents types d'hépatites - restent en retrait par rapport aux enjeux de santé publique. Le taux de couverture vaccinale des populations toxicomanes contre l'hépatite C, par exemple, est de 30 %. Or, comme l'a souligné le docteur André-Jean Rémy, les expériences internationales menées dans les centres de prise en charge montrent que l'on peut vacciner les patients de façon efficace contre une hépatite C quel que soit leur environnement.
2. Des risques sociaux
Moins perceptibles peut-être que les risques sanitaires, car plus indirects, les risques sociaux liés à l'usage de drogues illicites sont cependant substantiels. Leur coût qui a ainsi pu être chiffré en 2003 à 2,8 milliards d'euros, sans compter les coûts découlant de l'infection aux VIH, VHB et VHC.
a) Les risques issus de la consommation
Le risque social majeur pour les usagers de drogues réside dans une marginalisation progressive , dans une mise au ban de la société, une autoexclusion tenant à la différence de temporalité ressentie par rapport aux autres. Comme l'a très bien analysé devant la commission le docteur Xavier Emmanuelli, « dans l'exclusion, on est hors du temps. Il s'agit d'une sorte de présent répétitif. On ne peut faire de projets puisqu'il ne se passera rien et qu'il ne s'est rien passé auparavant. Les gens sont «achroniques» : ils n'arrivent pas à se projeter mais n'ont pas de passé non plus. Ils sont en permanence dans un instantané reproductif » (73 ( * )) .
Cette désocialisation des toxicomanes peut résulter de symptômes proprement psychiques. Ainsi en est-il en cas de schizophrénie , que la consommation de cannabis peut engendrer. « Une fois la maladie déclarée, le risque est grand qu'elle n'accentue l'isolement social des malades et, surtout, ne les conduise à la rue », a observé M. Jean Canneva, président de l'Union nationale des amis et familles de malades psychiques (74 ( * )) , faisant remarquer leur tendance -malades comme familles - à se cacher. Il a également pointé le fait que la consommation de substances addictives, y compris l'alcool, aggravait considérablement les symptômes et pouvait notamment rendre violentes des personnes qui ne l'avaient jamais été.
À l'opposé de ce risque d'exclusion du corps social qu'induit la consommation, existent des risques de confrontation avec ce dernier, s'accompagnant parfois de violences . C'est en effet le propre des produits psychotropes que de supprimer les inhibitions et de donner aux usagers un sentiment de toute-puissance les conduisant à surestimer leurs capacités et leur appréciation du danger, et à se livrer à des actes de violence (agressions, violences conjugales et familiales...) ou à provoquer des accidents (de la route, professionnels ou domestiques).
Le docteur Michel Le Moal a bien expliqué le phénomène résultant de l'usage de drogues à l'origine de cette perte de repères : « une partie spécifique du cerveau est atteinte, le cortex préfrontal, dernier élément de l'évolution, très développé chez les primates et chez l'homme. C'est un cortex qui est venu tardivement dans la phylogenèse, un cortex d'inhibition et de contrôle, en position pontificale pour réguler les autres fonctions du cerveau. L'atteinte des fonctions de ce cortex entraîne la désinhibition et la perte de contrôle. [...] Tout ce qu'il y a de plus phylogénétiquement fondamental dans les conduites de préservation de l'individu et de perpétuation de l'espèce, qui sont programmées depuis des millions d'années, disparaît » (75 ( * )) .
Les conséquences de l'usage de drogues sur la conduite automobile constituent un autre risque social majeur. Les effets hallucinogènes qu'engendre le cannabis, notamment, « sont évidemment peu compatibles avec la conduite », a expliqué M. Gilbert Pépin, biologiste : « ils provoquent une diminution de la vigilance et altèrent la perception de la vitesse et des distances. Un délai s'installe entre la perception et la réaction. La vision devient floue, en association avec une mydriase. Alors que l'alcool s'élimine vite, l'action du cannabis sur la conduite, une fois qu'il est présent dans le cerveau, peut durer très longtemps » (76 ( * )) .
Une étude sur les molécules impliquées dans les accidents mortels de la circulation citée par Gilbert Pépin, qui porte sur trois années et 482 cas, fait état de 31 % de cas positifs aux drogues, dont 27,8 % au cannabis, le taux montant à 42 % chez les conducteurs de moins de vingt-sept ans. La part des opiacés n'est que de 4,8 %, avec cette réserve que, dans la plupart des cas, il s'agit de morphine, administrée à des agonisants. La part de la cocaïne est quant à elle de 4,7 %. Les amphétamines sont quasiment absentes.
La dangerosité du cannabis au volant s'établit au moyen d'un coefficient multiplicateur de risques, qui est en France de 2,5, et peut dépasser 14 en cas de combinaison avec l'alcool. Celui de l'alcool est de 3,8, celui des médicaments de 1,7 et celui de la combinaison de cannabis et d'alcool peut dépasser 14 : autrement dit, certaines personnes peuvent présenter un risque d'accident supérieur de 14 fois à celui d'un conducteur normal !
La cocaïne rend également la conduite dangereuse : l'usager devient excité et se croit doué de qualités qu'il n'a pas. Cependant, le nombre d'accidents mortels impliquant des conducteurs sous l'emprise de la cocaïne est faible : pour les utilisateurs chroniques, qui deviennent irritables parce que se croyant persécutés, la conduite est si difficile qu'ils préfèrent ne pas prendre le volant.
Alors que l'amphétamine est un stimulant, elle n'est pas détectée dans les accidents mortels, mais ceci pour des raisons purement techniques, a nuancé M. Gilbert Pépin. Les jeunes qui l'utilisent dans les « rave parties », outrepassant leurs capacités naturelles, épuisent leur organisme : si, à l'issue de la soirée, ils parviennent néanmoins à conduire et se tuent au volant, les amphétamines ont déjà disparu de l'organisme.
Quant aux opiacés, ils provoquent une si forte somnolence que, dans la plupart des cas, le sujet est incapable de conduire.
Les problèmes posés par l' usage de drogues au travail , ou ayant des répercussions sur l'activité professionnelle, revêtent par ailleurs une importance croissante. « On constate [...] l'augmentation des accidents du travail dus à la consommation de substances psychotropes », a indiqué M. le professeur Paul Lafargue, président de la commission Substances vénéneuses et dopantes de l'Académie nationale de pharmacie (77 ( * )) . Cette dernière a d'ailleurs annoncé l'organisation, le 19 octobre 2011, d'une séance thématique sur le thème « drogues illicites, médicaments psychotropes et monde du travail ».
Selon M. Gilbert Pépin, les tests auxquels les entreprises soumettent leurs salariés « permettent de conclure que 20 % des accidents du travail seraient causés par des addictions aux drogues ». Quelques accidents d'importance auraient été causés par la prise de cannabis, a indiqué M. Gilbert Pépin, qui a cité l'échouage de l'Exxon Valdès, des incidents anciens dans des centrales nucléaires en France ou encore des accidents de chantier, comme des chutes mortelles de grutiers.
La consommation de cannabis, aujourd'hui très répandue, pose notamment problème dans les activités professionnelles du fait des « relargages » qu'elle peut engendrer un laps de temps important après qu'elle a eu lieu. Le professeur Paul Lafargue a ainsi rapporté avoir « décelé des dérivés cannabinoïdes dans les urines soixante et onze jours après la dernière prise de l'individu considéré ». Or, a-t-il poursuivi, le stress que peut occasionner le travail, « en augmentant le taux de catécholamines dans le sang, induit la résurgence tardive du cannabis «stocké», si bien que le cerveau d'un sujet ayant cessé toute consommation depuis huit ou neuf jours peut se trouver subitement en état d'ivresse cannabique ».
Ce phénomène explique que depuis 1989, les dispositions réglementaires applicables, par exemple, en matière d'aéronautique militaire imposent la recherche systématique des conduites addictives et que, plus généralement, des entreprises en nombre croissant aient inscrit dans leur règlement intérieur l'obligation de cesser toute absorption de substances psychotropes pendant l'activité professionnelle. La médecine du travail revêt ici un rôle majeur, dans la mesure où il appartient à ses membres de diagnostiquer les conduites toxicophiles et d'en tirer les conséquences, par exemple en déclarant inapte au travail un chauffeur consommateur, sans forcément donner le motif de son inaptitude.
b) La délinquance induite
Si les relations entre usage de substances psychotropes et délinquance sont sujettes à débat - la cause étant difficile à distinguer de l'effet, et les enquêtes au niveau national étant rares et circonscrites -, il n'en reste pas moins que des interactions fortes ont été mises en évidence.
Comme le soulignait la commission d'enquête sénatoriale sur les drogues illicites de 2003, « si les usagers de drogues dites dures ne constituent donc pas l'essentiel des délinquants, leur prévalence dans la délinquance est néanmoins nettement supérieure ». La mission faisait ainsi état de nombreuses études démontrant, par exemple, que la proportion de consommateurs de drogues chez les jeunes prisonniers américains était le double de celle des adolescents du même âge dans la population générale, ou encore qu'un quart des délinquants étudiés dans un arrondissement de Paris étaient mis en cause pour usage de drogues.
Selon la « théorie de la porte d'entrée » , le fait de rechercher un produit interdit pousserait à fréquenter des milieux marginaux (délinquance, criminalité, banditisme), constituant ainsi une « porte d'entrée » dans ces milieux. À cet égard, la consommation de cannabis favoriserait statistiquement le passage à des comportements délictueux. Pour le professeur Michel Reynaud, « le risque (résultant de l'usage de ce produit) est davantage un risque social, lié à l'illégalité des circuits parallèles et à la délinquance qu'entretient la consommation du produit, qu'un risque de santé publique » (78 ( * )) .
Certes, il n'a pas été démontré que l'usage de drogues était en lui-même de nature à provoquer une infraction, ni que la délinquance conduisait nécessairement à l'usage de drogues. En revanche, plusieurs hypothèses ont été avancées sur ces interactions dans ce rapport :
- le besoin impulsif pour le consommateur de se procurer des drogues dont il est dépendant peut le conduire à des activités criminelles en vue d'en financer l'acquisition. Commettre des vols, se livrer à du recel, vendre des drogues ou se prostituer constituent dans ce cas des moyens de trouver rapidement les fonds nécessaires. Les consommateurs réguliers de drogues dites « dures », telles que l'héroïne ou la cocaïne, sont sans doute plus concernés, mais de jeunes consommateurs réguliers de cannabis ou d'ecstasy pourraient l'être tout autant ;
- les propriétés psychopharmacologiques des drogues sur le cerveau et le système nerveux, sources de désinhibition, peuvent conduire à des comportements violents sans que le sujet en soit pleinement conscient, l'écart entre l'idée même d'un acte délictueux et sa réalisation étant annihilé par une altération des facultés de jugement critique. « L'augmentation de la concentration n'est pas sans conséquences », a souligné à ce titre M. Gilbert Pépin, biologiste : « le principe actif du THC est un agent hallucinogène au même titre que le diéthylamide de l'acide lysergique (LSD). Il y a alors levée des inhibitions, facteur très important dans les actes criminels » (1) ;
- le trafic de stupéfiants, notamment s'il est exacerbé par une dépénalisation des drogues, est susceptible de déboucher sur une « guerre des gangs » pour la prise de possession des marchés et un repli des bandes exclues vers d'autres actions délictueuses sources de revenus. C'est ainsi que la dépénalisation des drogues en Espagne en 1982 a été suivie d'une recrudescence des vols à main armée. Et actuellement, a indiqué M. Gilles Leclair, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense Sud, « soixante cités sont touchées par ce qui ne peut pas être considéré autrement que de la grande criminalité : des bandes s'entretuent pour le marché, les preneurs de «contrats» étant assez souvent sous l'emprise de la cocaïne ou d'autres produits. Les conditions des règlements de compte relèvent vraiment de la barbarie » (79 ( * )) ;
- enfin, une corrélation , certes non expliquée, a été mise en évidence entre consommation de drogues illicites et criminalité . Comme le soulignait la mission d'information sénatoriale précitée, « certains jeunes sont aux prises avec une sorte de syndrome général de déviance. Les consommations de cannabis, d'autres drogues, d'alcool, la délinquance et la violence sont bien souvent corrélées entre elles. La consommation se révèle assurément être un facteur aggravant mais ces phénomènes sont avant tout liés à une socialisation et à un mode de vie déviants, et à l'intégration du jeune à des groupes de pairs antisociaux ».
Ce schéma a été, grosso modo , repris par le docteur Marc Valleur, psychiatre, médecin chef du centre Marmottan. Faisant remarquer combien « le lien entre dangerosité sociale, passage à l'acte et usage de drogue est extrêmement complexe », il a énuméré :
- une « délinquance d'acquisition » , observée « dans les années 1970, [avec] des toxicomanes devenus agressifs parce qu'ils étaient en manque. [...] C'est l'époque des casses de pharmacie et des arrachages de sacs à main perpétrés par des gens qui avaient besoin d'argent pour s'acheter leur drogue et qui tombaient dans la délinquance. [...] Il s'agit d'une délinquance acquisitive, liée à l'état de manque et au besoin de continuer [...] ».
- des « délinquances de type psychopharmacologique » , où le « passage à l'acte est déclenché par l'effet même de la substance : c'est le cas avec certains délires amphétaminiques ou cocaïniques, le produit le plus en cause restant toutefois l'alcool, produit le plus documenté en matière de passage à l'acte suicidaire ou délinquant [...] ». M. Gilbert Pépin a rapporté, à cet égard, avoir découvert « avec stupeur », lors des centaines de procès d'assises auxquels il a assisté, « que même lorsqu'elle n'est pas la cause de la mort, la drogue est à l'origine d'un grand nombre de cas de criminalité. Les meurtriers, mais aussi les victimes, sous l'emprise de la drogue, ne savent pas ce qu'ils font. L'agent le plus horrible est le cannabis. Détendus, les sujets n'ont plus conscience du danger. Un porteur de canif va agresser en riant un porteur de revolver qui va le tuer en riant tout autant » ;
- un « lien systémique » : les « mêmes personnes, pour des raisons sociologiques, psychologiques et culturelles vont être amenées à être à la fois délinquants et usagers de drogues. Traumatisés dans leur enfance et n'ayant pas foi en l'avenir, ils sont malheureux et ne voient leur salut que dans la révolte et la délinquance. Demandant en quelque sorte réparation à un monde qu'ils considèrent injuste, ils vont s'adonner à la drogue pour essayer d'atténuer des souffrances préexistantes » (80 ( * )) .
Un autre cas pourrait être rajouté à cette liste, celui de l'utilisation de stupéfiants pour faciliter la commission d'un délit. C'est la « soumission chimique » qui est ici visée, soit l'administration à une personne, à son insu, d'une substance psycho-active à des fins criminelles. Cette substance jouera sur sa volonté, sur son libre arbitre, sur son indépendance ou sur sa mémoire, la victime confondant rêve et réalité et consentant à ce qui lui sera demandé.
Les produits concernés sont d'abord l'alcool, puis le cannabis, les amphétamines, le LSD et aussi le GHB - gamma-hydroxybutyrate - dénommé également la « drogue du viol ».
La soumission chimique, a expliqué M. Gilbert Pépin, biologiste, est utilisée à des fins de viol, d'agression pédophile et de vols. Viennent ensuite les extorsions de fonds - et les captations d'héritages -, les homicides et les actions pour la garde d'enfant. En effet, a-t-il précisé, dans certaines séparations difficiles, il arrive que de la drogue soit donnée à son insu à l'un des parents, dont il sera dit ensuite qu'il en est consommateur, ce qui sera confirmé par l'analyse toxicologique.
Sont dissociés l'administration à l'insu de la personne et l'abus d'état de faiblesse. Dans ce dernier type d'abus, où des stupéfiants sont retrouvés dans 17,4 % des cas, la personne prend consciemment le produit, mais le dosage de celui-ci aboutit à altérer, voire à annihiler sa volonté et son discernement. M. Gilbert Pépin a rapporté avoir constaté « des viols sous association de cannabis et d'alcool, de cannabis seul - mais où les «joints» étaient élaborés à partir d'huile de cannabis, dont le principe actif est très fort - et encore d'amphétamines, plus précisément d'ecstasy » (81 ( * )) .
Le risque de délinquance induite par la consommation de stupéfiants est d'autant plus important que le consommateur est jeune . « La déscolarisation est, dans 95 % des cas, due à la consommation de cannabis, qui conduit rapidement à un besoin, lequel va entraîner un début de délinquance car il faut de l'argent pour se procurer le produit » a indiqué le professeur Jean Costentin. « De ce fait », a-t-il ajouté, « le jeune consommateur déscolarisé se trouve progressivement désocialisé. Le problème n'est pas moral mais social » (82 ( * )) .
3. Des usages qui invalident la distinction entre drogues « dures » et « douces »
Après avoir longtemps été structurante dans l'approche des stupéfiants, la distinction entre drogues « dures » et drogues « douces » tend à s'effacer au profit de la notion d'échelle des risques, rendant mieux compte de l'idée du danger potentiel existant dès la première expérimentation et de la gradation des risques résultant d'une consommation plus régulière, susceptible de mener à la dépendance et à l'addiction, surtout chez des populations connaissant des fragilités structurelles.
a) L'échelle des risques : de l'usage simple ou récréatif à l'addiction
? Les controverses autour de la notion d'escalade
Afin de rendre compte du fait que tous les usagers de drogues n'encourent pas les mêmes dangers, et que ceux-ci dépendent de nombreux facteurs - tenant aussi bien au produit qu'à la personne et son environnement, si l'on en s'en rapporte au docteur Claude Olievenstein, selon lequel « la toxicomanie, c'est la rencontre entre un individu, un contexte social et un produit » -, a été forgée la notion d'« échelle des risques » , dont les degrés sont échelonnés entre une consommation occasionnelle, maîtrisée, récréative, bref, qui ne pose pas de problèmes en tant que telle, et une consommation fréquente, addictive, relevant de la dépendance, et qui nécessite une prise en charge médicale.
Cette distinction, qui certes n'est pas à l'abri de critique en tant qu'elle accrédite l'idée qu'une certaine forme de consommation peut être individuellement et socialement acceptable, permet cependant d' affiner la notion de « toxicomanie » qui englobe dans une même catégorie le fumeur ponctuel de haschich et l'héroïnomane hyper-dépendant. C'est ce dont a rendu compte M. Fabrice Olivet, directeur général d'Auto-support des usagers de drogues, lorsqu'il a critiqué « le mot «toxicomanie», incompréhensible dans les conférences internationales, où l'on utilise les termes anglo-saxons de « drug use » et « drug abuse » et évoqué « l'échec historique de ce concept-roi des années marquées par l'héroïne, l'injection et l'épidémie de SIDA », estimant qu'il devrait être « banni et remplacé celui d'«usage de drogues» ou d'«addictions» » (83 ( * )) .
Cette « échelle des risques » rend compte de la dangerosité croissante des usages et du lien existant entre eux. Le problème vient du fait qu'aucun usage récréatif n'est assuré de ne pas déboucher sur une réelle addiction. La « théorie de l'escalade » avance ainsi que la consommation d'un produit psychotrope à moindre risque entraînerait l'usage de produits de plus en plus nocifs selon le schéma : alcool > tabac > cannabis > cocaïne > héroïne. C'est le tabac qui constituerait donc la première étape, celle « mettant le pied à l'étrier » et menant à l'addiction du fait du mélange tabac/cannabis fumé par la grande majorité des usagers de haschich.
Le professeur Jean Costentin, membre de la commission sur les addictions de l'Académie nationale de médecine, a rappelé qu'on avait « longtemps contesté l'escalade dans l'usage de drogues alors qu'elle est évidente [...] dans l'échelle qui mène de la consommation de méthylxanthines - présentes dans le café - à l'héroïne, en passant par le tabac, l'alcool et le cannabis » (84 ( * )) .
Certaines personnes auditionnées ont cependant remis en cause cette théorie . Le docteur William Lowenstein a évoqué « un certain nombre de travaux [qui] ont démontré le contraire » et le fait que « d'autres facteurs interviennent », tout en reconnaissant que le cannabis peut parfois jouer un rôle de « déclencheur » (85 ( * )) . Pour le professeur Michel Reynaud, « le cannabis par lui-même n'induit pas un risque de passage à l'héroïne. Les héroïnomanes sont tous des fumeurs, mais les fumeurs de cannabis cessent généralement de consommer vers trente ans, lorsque leur organisation de vie a changé » (86 ( * )) .
M. Alain Rigaud, président de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, lui a préféré pour sa part la « théorie de la porte ouverte » , selon laquelle « le franchissement d'une première étape peut conduire à une deuxième étape, etc. » (1) . Une théorie rendant toutefois bien compte de l'idée selon laquelle la première expérimentation peut être le « marchepied » vers l'usage d'autres types de drogues, même si la proportion d'expérimentateurs devenant dépendant reste - fort heureusement - faible : comme l'a rappelé le docteur Marc Valleur, « l'immense majorité des expérimentateurs d'héroïne ou de cocaïne ne deviendront jamais dépendants de ces produits. On estime le pourcentage de personnes qui ont basculé dans la dépendance aux drogues les plus dures entre 10 % et 20 % du nombre total d'usagers » (87 ( * )) .
? Les caractéristiques de la dépendance
Le docteur Michel Le Moal a longuement expliqué les différents éléments constitutifs de l'addiction sur le plan clinique :
« Le premier symptôme central est la perte des capacités d'autorégulation , la perte du contrôle.
« Le second symptôme est la compulsion . Au cours de l'usage ou du mésusage, on sent une conduite impulsive en général consciente à l'égard de l'objet. Mais il y a encore contrôle dans une certaine mesure. Si on le lui fait remarquer, la personne le reconnaît et l'objet peut être laissé de côté. À partir d'un certain moment, le processus neurobiologique s'enclenche, avance, les dégâts au sein du cerveau progressent et on passe à l'état de compulsion. Le sujet est non seulement impulsif mais répète cette impulsivité sans aucun contrôle ni autolimitation. Les régions motrices du cerveau sont atteintes.
« Le troisième symptôme est lié à ce que j'appelle l' homéostasie hédonique . Nous savons tous faire la part entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, contrôler le passage de l'un a l'autre dans la recherche du plaisir, moteur essentiel de notre existence. Or, le sujet en état d'addiction ne recherche pas le plaisir, contrairement à ce que beaucoup disent. Le grand système neurologique à la base du cerveau, appelé système de récompense ou de plaisir, est atteint.
« Enfin, il existe deux symptômes complémentaires ; il y a chez le sujet un état de compulsion permanente : son répertoire comportemental se rétrécit au fur et mesure des semaines et des mois pour ne plus être axé que sur une seule chose : l'obtention de la drogue ou de l'objet » (88 ( * )) .
Variable selon les drogues, en puissance et rapidité d'installation, mais toujours présent, le potentiel addictif est très rapide pour le tabac, le crack , la méthamphétamine et les opiacés, et plus ou moins rapide pour les autres drogues (cocaïne, benzodiazépines, cannabis) en fonction du mode de consommation et de l'état psychique de l'usager.
Un « indice addictogène » , qui représente le nombre de personnes devenues dépendantes par rapport à celles qui sont en contact avec la substance psychoactive, a pu être mis au point pour estimer ce potentiel addictif. Le docteur William Lowenstein, qui en a fait état, a distingué de ce point de vue le cannabis, dont l'indice addictogène est de 10 % à 15 % ; la cocaïne, dont il n'est « que » de 17 %, et l'héroïne, pour lequel il « grimpe » à près de 60 % : « un adolescent qui découvre les opiacés et l'héroïne a 60 % de probabilités de devenir dépendant » a-t-il souligné à cet égard, tout en précisant que « l'indice addictogène n'est pas le seul facteur » et qu'il existe des consommations de drogues illicites sans dépendance, dans un cadre récréatif et maitrisé, ce qui « pose d'ailleurs d'énormes problèmes de prévention » (89 ( * )) . Le professeur Michel Reynaud a, de son côté, avancé des chiffres divergents, évoquant un indice « de 70 % à 90 % pour l'héroïne, de 50 % à 60 % pour la cocaïne, [...] et de 2 % ou 3 % pour le cannabis » (90 ( * )) .
? La notion d'usage problématique
S'il est difficile, dans un discours de prévention, de reconnaître que tout usage de drogues, indépendamment de leur licéité d'ailleurs, n'engendre pas systématiquement une dépendance et les dommages qui lui sont associés, il n'en demeure pas moins que seule une part des consommateurs se livre à un usage réellement problématique de ces produits. Ainsi, selon M. Jean-Michel Costes, directeur de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), « sur 230 000 usagers problématiques de drogues en France, on estimait, en 2006, que 74 000 faisaient un usage actif d'héroïne, 145 000 un usage actif de la voie intraveineuse au cours de toute leur vie et 81 000 un usage actif par voie intraveineuse au moins une fois par mois » (91 ( * )) . La prévalence d'usagers problématiques de drogues situe la France à un niveau moyen en Europe, inférieur à celui de l'Angleterre ou de l'Italie mais supérieur à celui de l'Allemagne.
En moyenne âgée de trente-cinq ans, cette population apparaît vieillissante et majoritairement masculine, même si des tendances récentes montrent qu'il y a de nouvelles générations d'usagers problématiques de drogues - jeunes migrants, mineurs en rupture sociale et familiale - et que la part des femmes est plus importante. Elle se caractérise par trois faits majeurs, selon M. Jean-Michel Costes : elle est composée de poly-consommateurs de produits licites et illicites, tous fumeurs et qui détournent certains médicaments (Subutex, méthadone, psychotropes) de leur usage. Enfin, cette population est marquée par une grande précarité et se diffuse sur les territoires ruraux et en zone périurbaine (1) .
b) L'invalidité de la distinction entre drogues « dures » et « douces »
Les termes de « drogues dures » et « drogues douces » sont apparus lors de la mise en place des réglementations internationales concernant les drogues, en vue d'en différencier le traitement pénal selon le risque qu'elles font encourir aux usagers et à la société. Ils ne sont toutefois pris en compte, au niveau national, que dans la pénalisation du trafic, et non de la consommation, qui fait l'objet d'un même dispositif répressif quelle que soit la nature du produit saisi.
La notion de « drogue dure » recouvre des substances à même de provoquer une dépendance psychique et physique forte. Elle désigne généralement les dérivés de cocaïne et d'héroïne. La notion de « drogue douce » désigne quant à elle presque exclusivement le cannabis, du fait que celui-ci induise une faible dépendance mentale et un risque de décès par surdose théoriquement nul.
Si elle a eu des vertus simplificatrices et clarificatrices dans les débats réglementaires sur le dispositif répressif à adopter contre les drogues, cette distinction n'en paraît pas moins aujourd'hui dépassée sur le plan purement scientifique . Ainsi que l'a fait remarquer M. Alain Rigaud, président de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, « selon beaucoup d'addictologues, il peut y avoir des «usages doux» de «drogues dures» et des «usages durs» de «drogues douces» » (92 ( * )) . En fait, ainsi que l'a souligné le professeur Daniel Bailly, « le problème ne vient pas de la consommation mais de l'abus et de la dépendance » (93 ( * )) .
M. Serge Lebigot, président de Parents contre la drogue, a pour sa part vu dans les notions de « drogues dures » et « drogues douces » « des termes à bannir car ils correspondent à des techniques de marketing utilisées par ceux qui veulent banaliser les drogues ». La « vraie distinction », a-t-il estimé, « doit porter sur les drogues à effet rapide et les drogues à effet lent, l'héroïne jouant le rôle de la crise cardiaque et le cannabis celui d'un cancer qui ne se révèle que lorsque les dommages deviennent visibles » (94 ( * )) .
La distinction est basée sur la notion de dangerosité du produit, laquelle découle en grande partie de celle de dépendance par rapport au produit. Remettant en cause la différenciation entre drogues licites et drogues illicites, le rapport du professeur Bernard Roques sur la dangerosité des drogues, publié en juin 1998, classait les produits stupéfiants en trois catégories selon leurs effets neuropharmacologiques :
- héroïne, cocaïne et alcool, substances les plus dangereuses à tous les niveaux ;
- les psychostimulants, hallucinogènes, tabac, benzodiazépines, substances intermédiaires ;
- le cannabis, situé en retrait comme produit le moins dangereux.
La relégation du cannabis en bas de l'échelle de la dangerosité a pu être critiquée. En effet, toutes les drogues illicites entraînent une dépendance des usagers aux produits consommés. Et ce, y compris pour ce qui est du cannabis, considéré comme une drogue douce car la dépendance qu'il induit est moins brutale et donc moins visible que pour d'autres types de drogues. Ainsi que l'a expliqué le professeur Jean Costentin, « pour caractériser la toxicomanie, on s'attache toujours aux manifestations de l'abstinence. Or la période de stockage du THC dans le cerveau est si longue qu'un fumeur peut attendre plusieurs jours avant d'avoir besoin d'un autre «joint» ; il peut donc ignorer être dépendant. Lorsque l'usager régulier est contraint de cesser sa consommation, [...] les manifestations physiques de l'abstinence ne se perçoivent que quinze ou vingt jours plus tard. [...] En raison de cette longue rémanence, à aucun moment le consommateur ne ressent l'abstinence de façon abrupte. Toutefois, la dépendance physique a été avérée par l'administration d'un antagoniste des récepteurs CB1, le rimonabant : en se substituant brutalement au THC, il déclenche des syndromes d'abstinence semblables à ceux observés chez les héroïnomanes. La pharmacodépendance au cannabis est donc très forte, mais elle est masquée par la lente disparition du THC dans l'organisme » (95 ( * )) .
c) Des populations particulièrement fragiles
D'une façon générale, les populations les plus affectées par l'usage des drogues présentent des fragilités structurelles : personnes en situation de comorbidité, atteintes de troubles psychiatriques, en situation administrative irrégulière, notamment sans-papiers, habitant des quartiers défavorisés, en situation d'échec scolaire ou professionnel, délinquantes, incarcérées...
La drogue est en effet la réponse matérielle à un mal-être , un manque, une frustration qui relèvent le plus souvent du psychique et de l'affectif. « L'environnement économique et social mondial pousse malheureusement de plus en plus de personnes à se tourner vers des consommations destinées à réparer une souffrance », a noté M. Olivier Maguet, membre du conseil d'administration de Médecins du Monde (96 ( * )) , rejoint par M. Xavier Emmanuelli en ces termes : la toxicomanie, « c'est un rapport à la réalité et à l'affect, à l'adulte, à l'image. Je dis toujours qu'on n'existe que par le regard des autres. Si les autres ne vous regardent pas, votre image corporelle disparaît, vous êtes sans intérêt, sans sens, sans amour » (97 ( * )) . « On sait bien que la drogue est une histoire de malheur », pour M. Hubert Pfister, ancien président de la Fédération de l'Entraide protestante, « c'est bien parce qu'on est dans le malheur que l'on se drogue et non l'inverse ! Les toxicomanes nous ont appris qu'ils sont mal dans leur peau et que la drogue leur permet de ne plus ressentir ce malaise » (98 ( * )) .
Les prédispositions biologiques et psychologiques joueraient un rôle majeur dans le basculement vers l'addiction. Le docteur Michel Le Moal a ainsi émis l'hypothèse, « sans en être totalement sûr, que la personne dépendante possède, depuis la petite enfance ou non, un état psychopathologique préalable [...] ne serait-ce que par la recherche de l'automédication » (99 ( * )) . Pour le professeur Daniel Bailly, « des facteurs génétiques interviennent également pour 30 % à 60 % dans le déterminisme de la dépendance, vraisemblablement suivant des voies différentes. Certains facteurs génétiques interviennent dans le métabolisme dès la première prise. Nous ne sommes pas tous égaux devant les produits » (100 ( * )) .
Le professeur Michel Reynaud a également exposé cette hypothèse d'un double facteur, physiologique et contextuel, aggravant les risques de dépendance : « des éléments de plus en plus nombreux donnent à penser que les consommateurs qui deviennent dépendants présentent une vulnérabilité génétique, mais cette vulnérabilité est complexe, mettant en jeu plusieurs gènes, la réaction des circuits cérébraux et le métabolisme cellulaire. Elle est en outre aggravée par l'effet de situations personnelles ». Bref, « ce sont, au bout du compte, des interactions entre les gènes et l'environnement qui font la vulnérabilité », ces interactions s'exprimant « en fonction des événements de vie et des circonstances sociales ». C'est dire qu'« il n'y a pas plus de déterminisme génétique que de déterminisme psychologique ou social. Nous subissons des déterminismes multiples, aucun n'étant absolu » (101 ( * )) .
Les partisans de cette théorie, a fait observer le docteur Marc Valleur, « supposent que l'addiction répond à un phénomène biologique sous jacent que l'on pourrait isoler, un facteur «x» dont la présence ou l'absence permettrait de signer l'existence d'une vraie addiction ». Or, a-t-il ajouté, « il faut [...] rappeler que ce facteur est hypothétique. On a cru le trouver dans les endorphines, dans la dopamine ; on pense aujourd'hui le situer dans les découplages des circuits sérotoninergiques et noradrénergiques ; d'autres pensent le trouver dans la perte de la plasticité cérébrale... On peut prévoir que dans dix ans, dans quinze ans, dans vingt ans, d'autres modèles auront cours » (102 ( * )) .
S'agissant du facteur endogène , celui tenant au consommateur en lui-même, « on considère généralement qu'il existe deux types de personnalités vulnérables à la dépendance », a estimé le professeur Michel Reynaud : « il y a, d'une part, ceux qui recherchent des sensations, qui ont besoin de vivre des situations fortes et de connaître une excitation permanente, qui sont plutôt des hommes, et, d'autre part, ceux qui ont à apaiser une souffrance ou un malaise et qui sont plus habituellement des femmes .[...] Si l'environnement joue un rôle dans l'incitation et la consommation, il existe donc, vraisemblablement, des vulnérabilités individuelles cumulant des vulnérabilités génétiques, sur lesquelles nous devons poursuivre les recherches, et des vulnérabilités liées à l'histoire personnelle, au malaise, au stress et aux violences subies » (103 ( * )) .
Si l'on s'intéresse à présent aux lieux de particulière vulnérabilité , les villes restent plus touchées que les campagnes par les trafics et la consommation. « C'est dans le milieu urbain que l'on en recense le plus, du fait de l'anonymat qu'offrent les villes », a ainsi déclaré M. Henri Joyeux, président de l'association Familles de France (104 ( * )) . « À Paris, Lyon, Marseille ou Montpellier, certains quartiers sont bien connus pour être des lieux où la drogue circule facilement ». Dans ces zones urbaines, les personnes dépourvues de domicile restent plus vulnérables que les autres. Ainsi que l'a rapporté M. Jean-François Corty, directeur des missions France de Médecins du monde, « entre 30 % et 40 % des sans-domiciles fixes connaissent des troubles mentaux ou des problèmes d'addiction » (105 ( * )) . M. Xavier Emmanuelli, a pour sa part indiqué que 95 % des personnes auprès desquelles ses équipes interviennent dans les rues de Paris ont un problème toxicologique (3) .
Cependant, la drogue commence à se diffuser dans les zones rurales , mais également littorales , vers des populations que l'on aurait pensé protégées. Selon le colonel Pierre Tabel, adjoint du sous-directeur de la police judiciaire à la direction générale de la gendarmerie nationale, « il y a une assez grande disponibilité des produits stupéfiants au plan national et [...] la tendance à la baisse des prix favorise leur diffusion, même au-delà des grands centres urbains, à tel point que de plus en plus d'affaires concernent les agriculteurs. De même, dans la pêche, métier très dur, la consommation de cocaïne est assez importante. Ainsi, cette forme de criminalité, très urbaine au départ, s'étend. Cette tendance concerne aussi les zones de stockage » (106 ( * )) . M. Bernard Amiens, administrateur de l'ARAFDES, s'est dit « également inquiet de la prégnance de ce phénomène en campagne ! Je puis même assurer que la proportion de jeunes en grande difficulté est pour le moins comparable à celle des grandes villes. L'offre de produits, qui est la même qu'en secteur urbain, connaît parfois des facteurs aggravants » (107 ( * )) . M. Michel Gaudin, préfet de police de Paris , a également indiqué que « depuis dix ou quinze ans, la drogue est aussi présente dans les communes rurales les plus reculées » (108 ( * )) .
Les jeunes , bien évidemment, constituent un public particulièrement vulnérable. L'affirmation de sa personnalité passe en effet, chez les populations les plus jeunes, par la transgression d'interdits. « Quand on est adolescent, on se structure en s'opposant, d'où l'utilisation de produits illicites », a fait valoir le docteur Xavier Emmanuelli. Or, normalement, « au fur et à mesure que la personnalité se structure, les jeunes qui ont peu consommé abandonnent du fait des impératifs sociaux », mais certains, pour différents types de raisons, persistent et tombent dans l'addiction (109 ( * )) .
C'est même durant l' enfance que les comportements déviants « cristallisent » une fragilité que l'enfant porte en lui, comme l'a souligné le professeur Daniel Bailly : « on sait que la consommation précoce est le facteur le plus prédictif de la survenue d'une dépendance à la fin de l'adolescence. 75 % des adolescents consommateurs abusifs ou dépendants ont au moins un trouble mental associé ; dans les deux tiers des cas, ce trouble a débuté avant l'abus ou la dépendance, qui apparaissent donc comme les complications d'un trouble ayant existé bien avant et évoluant depuis l'enfance » (110 ( * )) .
M. Thierry Vidor, directeur général de l'association Familles de France, a livré un portrait particulièrement inquiétant de la circulation du cannabis dans les établissements scolaires accueillant des adolescents : « dans les lycées et les lycées professionnels, 90 % des jeunes ont du « shit » sur eux. S'ils n'en ont pas, ils sont déconsidérés. La famille ne peut même plus agir. Il y a là un problème de société. C'est aussi vrai dans les populations défavorisées que dans les populations favorisées. Dans les lycées où les parents sont vigilants, 50 à 60 % de jeunes ont une barrette de « shit » dans leur poche ! » (4) . « On sait que des trafics s'y déroulent, essentiellement autour du cannabis, mais aussi d'autres substances », a confirmé M. Michel Gaudin, préfet de Paris : « les problèmes des établissements scolaires sont réels » (3) .
Même constat de la part de M. Richard Maillet, président de la Fédération nationale des associations de prévention de la toxicomanie, qui a mis en sus l'accent sur le rajeunissement progressif des jeunes usagers : « En 1996, les chefs d'établissement nous demandaient d'intervenir en seconde et en troisième ; en 1999, en quatrième et en cinquième, et en 2002, en CM2 ! Non seulement la consommation a explosé mais l'âge des premières consommations s'est abaissé à neuf ou dix ans » (111 ( * )) .
Comment expliquer cette grande fragilité de la jeunesse à l'égard des drogues ? L'immaturité, la peur de ne « pas oser » et d'avoir l'air ridicule, le désir d'imitation, le goût pour la transgression, la fascination face à l'inconnu... sont bien des motifs très présents, mais d'autres de nature plus sociologique peuvent également être avancés. « Une autre raison pour laquelle les jeunes prennent de la drogue est que c'est «branché» » , a ainsi avancé M. Richard Maillet, qui a évoqué « l'influence néfaste des médias. Combien de fois n'ai-je entendu le soir, rentrant de réunions de prévention avec des parents et des professeurs, des vedettes du spectacle, du monde musical ou des présentateurs de télévision tenir des propos banalisant, voire valorisant l'usage des drogues ? Où est la cohérence ? » (1) . Le constat dressé par M. Thierry Vidor, est identique : « quel message la société et les médias nous font-ils passer ? «Cela n'a pas de conséquence : il vaut mieux fumer un pétard que prendre un verre de vin ou tomber dans la dépression» ! Pour les jeunes, c'est pratiquement un médicament ! On a complètement banalisé le produit » (112 ( * )) .
L' absence de structuration de la vie quotidienne et de perspectives peuvent également être incriminés : « le problème de l'addiction est soit l'oisiveté, soit la solitude » a souligné M. Thierry Vidor. « On trouve beaucoup de jeunes qui se retrouvent seuls dans leur chambre le soir et d'autres qui, ne se retrouvant pas en famille, sortent et se retrouvent dans des groupes. Cette oisiveté ou cette solitude est mère de toute addiction, par un effet d'entraînement ».
Les difficultés relationnelles avec les parents durant la petite enfance constituent également un motif de fragilisation, ainsi que l'a rapporté Mme Martine Lacoste, secrétaire générale du Centre d'information régional sur les drogues et les dépendances de Midi-Pyrénées : « trente années de travail sur ce sujet m'invitent à plaider pour un repérage précoce des enfants et des adolescents en situation de maltraitance. En effet, 90 % à 95 % des jeunes femmes reçues dans le centre que je dirige ont vécu des situations «incestuelles» ou incestueuses - et ce cas n'est pas rare non plus pour les jeunes gens » (113 ( * )) .
M. Richard Maillet a également pointé l' absence de réponse répressive systématique entretenant l'idée d'une certaine impunité : « les jeunes se droguent aussi parce qu'aucune sanction n'est jamais prononcée à l'encontre ni des simples usagers ni des petits « dealers » » (114 ( * )) .
Or, c'est durant la jeunesse que se fait généralement la découverte de drogues considérées comme plus dures que le cannabis, comme en témoigne, s'agissant de l'héroïne, Mme Anne Guichard, chargée de mission au département « Évaluation et expérimentation » de la direction des affaires scientifiques de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) : « la première injection est souvent un acte non programmé, opportuniste, avec le prêt par un tiers, potentiellement contaminé, de son matériel d'injection. L'initié n'est alors pas conscient des risques : il vit une «lune de miel» avec le produit, qui n'apporte à ses yeux que des bénéfices ; âgé en moyenne de dix-sept ans, il éprouve un sentiment d'invulnérabilité. Les jeunes consommateurs constituent un public difficile à atteindre, dans la mesure où ils ne se trouvent pas encore en contact avec les structures existantes et que les stratégies de prévention et de réduction des risques n'en ont pas toujours fait une priorité » (1) .
II.- TROIS POLITIQUES COMPLÉMENTAIRES INDISPENSABLES : MIEUX PRÉVENIR, RENFORCER L'OFFRE DE SOINS ET RÉDUIRE LES RISQUES
A. PRÉVENIR LE PASSAGE À L'ACTE, UNE PRIORITÉ
La prévention commence par la limitation de l'offre de stupéfiants, c'est-à-dire par l'interdiction de l'usage des drogues illégales, la répression de leur détention et celle de leur production et de leur commerce. Le maintien de la pénalisation de l'usage est donc un volet essentiel de la politique de prévention comme on le montrera dans la dernière partie du présent rapport. Cela ne suffit naturellement pas, puisqu'on a aussi évoqué les signaux alarmants donnés par les statistiques de consommation. Il faut alors inlassablement informer et éduquer, dépister les facteurs de risque, proposer le cas échéant une aide sociale, médicale ou psychologique. C'est dire que la prévention doit être à la fois collective et individuelle, couvrir une très large gamme d'actions, depuis le message diffusé par les médias jusqu'à l'entretien avec un professionnel éventuellement suivi d'une consultation spécialisée.
Les conditions de l'efficacité des politiques de prévention sont de mieux en mieux connues, en particulier grâce à des études effectuées à l'étranger, la culture de l'évaluation étant encore insuffisamment développée en France, ainsi qu'il a été souvent indiqué à la mission d'information.
Certains enseignements tirés de l'ensemble des réflexions menées à ce sujet sont présentés ci-dessous ; il a semblé particulièrement important à vos rapporteurs de proposer d'améliorer l'efficacité des campagnes de prévention lancées en France en s'inspirant des enseignements tirés des études et d'évaluations disponibles, de préconiser le renforcement de la prévention dès le plus jeune âge, d'améliorer la formation des personnels chargés de la prévention.
1. Améliorer les méthodes de la prévention
L'identification des publics prioritairement destinataires de la prévention, l'adoption d'une démarche centrée sur la promotion de la santé et la clarification des messages diffusés sont les principaux axes de l'effort à mener afin d'améliorer les méthodes de la prévention.
a) Mieux cibler les publics visés
La nécessité d'élaborer la politique de prévention en fonction des types de consommation et des publics visés a souvent été soulignée devant la mission d'information. M. Pierre Arwidson, directeur des affaires scientifiques de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, a ainsi précisé que l'institut « travaille sur deux axes complémentaires : d'une part, prévenir ou réduire la consommation de substances psychoactives ; d'autre part, prévenir ou réduire les conséquences liées aux addictions chez les consommateurs. » (115 ( * ))
Cette distinction n'est pas éloignée des trois catégories de prévention identifiées par le professeur Daniel Bailly, pédopsychiatre et auteur d' Alcool, drogues chez les jeunes : agissons :
- la prévention universelle , qui s'adresse à l'ensemble de la population potentiellement consommatrice ;
- la prévention sélective , qui s'adresse, au sein de cette population, aux personnes présentant des facteurs de risques pour le trouble concerné ;
- la prévention indiquée , qui s'adresse plus spécifiquement aux personnes à très haut risque, présentant des marqueurs cliniques ou biologiques de vulnérabilité ou manifestant les symptômes du trouble.
Les cibles visées appellent en effet des démarches différentes : « Ce n'est pas parce que l'on diminue la consommation moyenne de la population adolescente que l'on va réduire l'incidence de l'abus et de la dépendance. Autant les programmes de prévention généralisée centrés sur l'amélioration des compétences psychosociales et de l'estime de soi sont efficaces en termes de consommation, autant agir sur l'abus et la dépendance nécessite de repérer très tôt les enfants à risque pour les aider à faire face à ce risque. Les deux types de prévention peuvent fort bien être mis en place en milieu scolaire mais ils ne poursuivent pas les mêmes objectifs, ne recourent pas aux mêmes méthodes de travail et ne concernent pas les mêmes populations », a commenté à cet égard le professeur Daniel Bailly lors de son audition (116 ( * )) .
M. Alain Morel, directeur général de l'association Oppelia, a estimé de son côté : « Il existe deux stratégies importantes. La première consiste en une intervention précoce afin d'apporter, dans le dialogue, des outils de changement pour ceux qui en ont besoin. La seconde repose sur l'éducation préventive et le travail sur les comportements d'usage. » (2)
b) Adopter une démarche centrée sur la promotion de la santé
Il est admis par ailleurs que la prévention ne doit pas seulement viser à limiter la consommation de drogues mais aussi promouvoir, notamment auprès du public des enfants et des adolescents, l'acquisition de comportements faisant obstacle aux risques de troubles qu'il s'agit de prévenir. La prévention ne vise donc pas uniquement tel ou tel produit ou telle ou telle catégorie de produits mais tend à renforcer la capacité des personnes à se protéger et s'assumer pleinement.
Encore faut-il que l'information soit accessible. Certes, il existe le site internet « Drogues info services », dépendant de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) qui permet au public de s'informer et de s'orienter grâce notamment à des services téléphoniques d'urgence. Mais il conviendrait de mieux faire connaître l'existence de ce service au grand public, sans doute par le moyen de campagnes médiatiques.
c) Clarifier les messages
? Clarifier
La prévention universelle est parfois mise en oeuvre de façon maladroite, la conception des messages peut ne pas être pertinente. Un message télévisé réalisé par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) a été mentionné comme ce qu'il ne faut pas faire : selon M. Pierre Arwidson, directeur des affaires scientifiques, « Le « post-test » réalisé sur « Drogues : ne fermons pas les yeux » a montré que les jeunes, en effet, n'avaient pas bien compris le message. Ce sont les parents qui, en fin de compte, ont apprécié le plus la campagne. » (117 ( * )) Tel n'était pas l'objectif essentiel... De même, Mme Isabelle Adenot, présidente du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, a noté : « L'été dernier, la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie a édité des affiches sur le thème « J'en ai besoin pour faire la fête ? » ou « La dépendance, ça commence quand ? » : les pharmaciens les ont trouvées «tristounettes» et, pour ma part, il a fallu qu'on m'explique certaines subtilités graphiques... Elles ont par conséquent peu été mises en valeur, ce que la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie nous a reproché à juste raison. » (118 ( * ))
Au-delà des erreurs ponctuelles de conception, la prévention universelle, dans ses modalités les plus « grand public », est sans doute difficile à concevoir, si ce n'est inutile, comme le suggérait le docteur William Lowenstein, directeur général de la clinique Montevideo à Boulogne-Billancourt : « C'est pourquoi on essaye de cibler les messages. Il ne peut évidemment pas y avoir de prévention globale ou de politique globale. « Dire non à la drogue », « La drogue, c'est de la merde ! » ou « Ne fermons pas les yeux » fait certainement le bonheur de quelques agences publicitaires mais n'a vraisemblablement aucun impact, tant la situation, en termes de santé publique, est hétérogène. » (119 ( * )) Dans une optique assez proche, M. Alain Grimfeld, président du Comité consultatif national d'éthique a indiqué à la mission d'information : « Plus que les campagnes télévisuelles, l'information de proximité pourrait faire bouger les lignes. Une jeune fille atteinte de mucoviscidose, qui a subi une transplantation coeur-poumons qui n'a malheureusement été fonctionnelle qu'un an, m'avait dit qu'au lieu de culpabiliser les gens à travers le petit écran pour les amener à donner, il vaudrait mieux faire des campagnes d'impact local. Je sais que les élus locaux seraient ravis d'y participer. » (3)
Inversement, comme l'a fait remarquer M. Serge Lebigot, président de l'association Parents contre la drogue, « les dispositions de l'article L. 3421-4 du code de la santé publique, qui réprime toute incitation directe ou indirecte à la prise de drogues, doivent être appliquées et renforcées. Certaines stations de radios ou chaînes de télévision ne se privent pas de diffuser des messages banalisant l'usage de drogue. Promouvoir la drogue, ce n'est pas être « cool » : c'est être irresponsable ! » (120 ( * )) . Dans une optique convergente, M. Richard Maillet, président de la Fédération nationale des associations de prévention de la toxicomanie, a remarqué : « Certaines stations de radio - vous savez comme moi lesquelles - n'hésitent pas à diffuser des messages banalisant l'usage des drogues. Certains groupes français de rap ou de reggae leur emboîtent le pas, incitant dans leurs chansons à la consommation . » (121 ( * ))
? Responsabiliser
Clarifier ne va pas sans responsabiliser. À cet égard, l'attention de vos rapporteurs a été attirée sur le comportement de certains encadrants d'associations de jeunes qui n'hésiteraient pas à inciter les adolescents à consommer du cannabis.
C'est pourquoi, vos rapporteurs se sont réjouis de l'annonce faite par Mme Jeannette Bougrab, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative (122 ( * )) , de la publication d'un décret modifiant le contenu de la formation au BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur) en introduisant dans le cursus un module spécifique de formation sur les conduites addictives. Chaque année, 50 000 jeunes passent le BAFA et 4 millions de jeunes sont encadrés dans ces centres de loisir, il est donc très positif que les moniteurs soient formés à la prise de conscience de leurs responsabilités.
Cette démarche orientée vers des jeunes responsables d'autres jeunes est d'autant plus intéressante que « la prévention par les pairs - les jeunes qui parlent aux jeunes - constitue le canal de prévention le plus efficace » , comme l'a indiqué par ailleurs Mme Jeannette Bougrab, citant l'exemple de jeunes en mission de service civique qui contribuent à la politique de prévention grâce à leurs interventions dans les écoles.
Mme Jeannette Bougrab a aussi mentionné les associations de sport amateur comme vecteurs essentiels de lien social et de prévention de comportements à risque chez les jeunes : « la vie de quartier et la culture des clubs permettent de rompre avec l'isolement des jeunes, et de leur apporter des référents. »
Il conviendrait d'élargir aux encadrant de ces structures ainsi qu'à l'ensemble des travailleurs sociaux actifs auprès des jeunes la formation mentionnée plus haut.
2. Prévenir dès le plus jeune âge
S'il était une seule leçon à retenir des auditions de la mission d'information, ce serait en effet le caractère prioritaire de la prévention destinée aux plus jeunes. Dès lors, sans méconnaître les efforts menés dans l'ensemble de l'Éducation nationale et ailleurs, vos rapporteurs ont choisi de mettre en exergue le rôle central des services de santé scolaire dans le travail de prévention à mener, tout en insistant par ailleurs sur la nécessaire association des familles, trop souvent tenues à l'écart, en fonction, sans doute, de choix méthodologiques dépassés.
a) Le consensus scientifique sur l'efficacité des programmes s'adressant aux plus jeunes
? Intervenir dès la petite enfance
Les témoignages recueillis par la mission d'information établissent de façon convaincante que, plus l'expérience de la drogue est précoce, plus le risque de voir un abus ou une dépendance se manifester par la suite est sensible. La consommation avant l'âge de douze ans apparaît, en particulier, comme un facteur prédictif de la possibilité d'une dépendance à la fin de l'adolescence. Il convient manifestement d'intervenir bien avant : dès l'école primaire. M. Serge Lebigot, président de l'association Parents contre la drogue a confirmé du point de vue des parents l'importance de cette démarche précoce : « Nous n'avons de cesse de réclamer une politique de prévention et de sortie de la toxicomanie. Je parle ici d'une prévention sérieuse, dès le plus jeune âge. Il ne s'agit ni de banaliser, ni de dramatiser mais d'expliquer les problèmes liés à la drogue, en relation avec les problèmes de l'adolescence. » (123 ( * ))
Il y a donc nécessité urgente à mener des actions de prévention dès le plus jeune âge à l'école primaire, voire à la maternelle.
Notons cependant que l'école, lieu manifestement privilégié de la prévention orientée vers les jeunes, ne doit pas être considérée comme le seul lieu approprié : certains interlocuteurs de la mission d'information ont d'ailleurs mis en doute l'efficacité des actions qui y sont mises en oeuvre ; ainsi, selon Mme Béatrice Magdelaine, chargée de mission santé de la Fédération nationale familles rurales : « L'Éducation nationale n'est pas le lieu où l'on sensibilise le plus d'enfants ; les choses se font souvent en dehors des murs. Nous avons remarqué que tout ce qui se faisait en dehors de l'établissement fonctionnait nettement mieux, comme dans le cadre des forums intercommunaux. Les jeunes de trois ou quatre collèges que l'on accueille en un même lieu autour d'actions relatives au champ de la santé sont bien plus attentifs à ce qui se passe et aux messages qui leur sont adressés. Il ne faut pas réduire la prévention à la seule Éducation nationale. Il existe d'autres actions sur le terrain, même si l'on est souvent confronté à une certaine méconnaissance des acteurs, à une mauvaise coordination et à une absence de moyens financiers. La position de Familles rurales, en ce qui concerne la toxicomanie, est claire : nous n'intervenons pas à la place des associations spécialisées. Nous ne sommes pas compétents. Nous sommes là pour entendre les familles, les jeunes et les renvoyer vers les réseaux existants. » (124 ( * ))
Pour autant, M. Didier Jourdan, coordonnateur du réseau des instituts universitaires de formation des maîtres pour la formation en éducation à la santé et prévention des conduites addictives, a estimé devant la mission (125 ( * )) : « En matière de prévention des conduites addictives, la première intervention du système éducatif est centrée sur la question de la liberté [...] . L'école doit ainsi s'efforcer, d'abord, de donner à chacun des élèves la capacité de conserver sa liberté vis-à-vis des produits, donc d'être en situation de choix. La seconde intervention de l'école, qui s'approche davantage de l'objet de votre mission, est de donner dans chaque établissement aux enfants la possibilité de trouver des conditions éducatives qui leur conviennent, notamment un environnement exempt de stress, de pression sociale et de produits toxiques. Pour le reste, la diminution de tel ou tel risque de morbidité ou de mortalité me semble relever d'une dynamique de santé publique dont l'école n'a pas pour mission première d'être un vecteur. Ainsi, elle n'est pas un instrument de prévention des pratiques addictives, mais elle en est un acteur, sous les deux angles que je viens de rappeler. Le premier axe de travail est le développement des compétences autour de ce que l'on sait de l'addiction, qui lie individu, environnement et comportement. Il convient donc, à l'école, de donner à chaque élève la capacité de connaître les produits, de se connaître lui-même et de connaître la loi - car il n'y a pas d'éducation sans loi. Le deuxième axe a trait à l'individu : il s'agit de développer chez l'élève les compétences qui lui permettront de résister à la pression et d'être capable de gérer les conflits sans recourir à la violence ou aux psychotropes. Le troisième axe est celui de l'environnement, autour du développement de l'esprit critique et de la mise à distance de la pression des pairs et des médias : dans 96 % des cas, c'est votre meilleur ami qui vous a donné votre première cigarette, dans plus de 90 % des cas, c'est en famille que vous avez consommé de l'alcool pour la première fois. On est là au coeur de la mission de l'école et du socle commun, et c'est donc par là qu'il faut commencer pour prévenir les conduites addictives. » En conséquence : « Éducation, prévention et protection, tels sont donc les rôles de l'école en tant que telle et non en tant qu'instrument. »
Les modalités des actions de prévention diffèrent selon qu'il s'agit de prévention sélective ou indiquées d'une part, de prévention universelle de l'autre.
? Prévention sélective et prévention indiquée
M. Alain Morel, directeur général de l'association Oppelia a estimé : « L'intervention précoce a été inventée pour lutter notamment contre les psychoses infantiles, en rapprochant les premiers symptômes des services de soins et des aides nécessaires. Cela amène des résultats considérables et permet de redonner à un enfant ou à un adulte les capacités de modifier son comportement grâce à une aide et à un certain nombre d'outils simples, qui ne sont pas ceux de spécialistes mais qui nécessitent des formations. Parmi les patients que nous recevons, plus de la moitié connaissent des problèmes d'addictions en même temps qu'un psycho-traumatisme lié aux maltraitances, abus sexuels, accidents graves. La prise de produit - légal ou illégal - constitue une recherche de solution. Croyez-vous qu'en leur disant que la consommation est interdite et en leur expliquant les dangers qu'ils courent, on va arriver à répondre à ces problèmes ? Bien sûr que non ! Si on ne se rapproche pas de ces personnes pour évaluer avec elles la situation et apporter des réponses dans la communauté, à travers la famille, les services sociaux, l'école, il n'y a aucun espoir que ce comportement change - ou tardivement, une fois que les choses sont graves . »
Le facteur de risque le plus fréquent en matière d'abus et de dépendance est le trouble des conduites observé dès le plus jeune âge. Il est donc nécessaire, voire urgent, de déceler la violence et les conduites agressives à l'école pour prévenir l'abus et la dépendance qui risquent de s'ensuivre : ce sont les conduites antisociales à l'école qui précèdent ou accompagnent le début de l'abus et de la dépendance, et non l'inverse.
Il existe d'autres troubles - troubles anxieux, hyperactivité - facteurs de risque. Des facteurs génétiques interviennent également pour 30 à 60 % dans le déterminisme de la dépendance, suivant des voies différentes. Ce déterminisme se manifestant dès l'enfance, les programmes de prévention qui se sont avérés efficaces dans ce domaine démarrent au plus tard à l'école primaire.
De nombreux programmes de prévention mis en place à l'étranger ont fait l'objet d'évaluations positives.
Parmi les programmes mentionnés à cet égard par M. Roger Vrand (126 ( * )) , sous-directeur à la direction générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale, il est possible de retenir :
- Montréal Prevention Experiment visant à réduire les comportements agressifs chez les enfants âgés de sept à neuf ans ;
- Life Skills training , programme américain de type universel visant à développer les facteurs psycho-sociaux de protection à l'école primaire et au collège ;
- Mieux vivre ensemble dès l'école maternelle , programme anglo-saxon adapté en France.
Les programmes qui se sont montrés efficaces mettent en oeuvre un travail sur l'estime de soi et les compétences psychosociales : comment gérer les relations interpersonnelles, résoudre les problèmes, gérer son stress, améliorer la confiance en ses capacités. Il s'agit de compétences de vie. Ce n'est qu'ensuite que l'on met en scène des thèmes en fonction de la maturation du sujet.
Ces thèmes varient. Un programme mené aux États-Unis mentionné par le professeur Bailly va du primaire jusqu'à la fin du collège. Au cours du primaire le travail porte essentiellement sur les compétences de vie, l'on commence à aborder des thèmes spécifiques à partir du collège, en lien avec ce que l'on a travaillé à l'école primaire. Ce programme s'étale sur dix ans et comprend deux parties, un programme de prévention généralisée s'adressant à tous les enfants et un programme de prévention sélective ciblé sur les enfants à risque issus des quartiers défavorisés ou qui présentent un niveau élevé d'agressivité repéré à l'école primaire.
Les objectifs visés sont la diminution de la consommation moyenne de la population adolescente et la baisse des accidents liés à la consommation. Notons que les accidents mortels de circulation liés à un excès d'alcool chez les adolescents ne sont pas dus aux consommateurs abusifs mais occasionnels. Chacun de ces deux groupes de consommateurs nécessite donc une approche différente.
Dans le programme général, on commence par améliorer les compétences psychosociales puis, lors de la transition entre le primaire et le collège, on aborde les produits, la sexualité, le monde du travail, etc., en fonction de la maturation de l'individu. Ce programme a été mis en place il y a trois ans. Il a été possible d'enregistrer d'ores et déjà, au sein de la population en bénéficiant, une diminution très nette de la consommation d'alcool et de drogues, des comportements violents à l'école, de l'absentéisme scolaire et du recours à l'orientation vers des classes spéciales.
Il s'agit de repérer l'enfant « à risque » de manière pragmatique, sans le stigmatiser . Les programmes de prévention pour tous dédramatisent ainsi le contexte, en montrant que tout le monde est concerné mais qu'il existe des différences dans les risques.
En fonction de ces constatations, il apparaît opportun :
- de mettre en place des programmes spécifiques et pérennes, au plus tard à l'école primaire et jusqu'au lycée, afin de détecter les facteurs de risque chez les enfants (comportements agressifs et anti-sociaux, troubles anxieux, hyperactivité...) ;
- d'appeler l'attention des médecins et infirmiers scolaires sur la nécessité d'un dépistage des problèmes psychiques des adolescents pour repérer précocement leur consommation de stupéfiants.
Une fois l'enfant repéré, un programme structuré doit être mis en oeuvre. Il doit comporter des séances individuelles, un suivi tutorisé avec l'élève, des visites effectuées à domicile par un enseignant référent chargé d'accompagner les parents dans le soutien scolaire, des séances avec les parents pour les aider à améliorer ce que l'on appelle leur « habileté parentale » et des séances regroupant les parents et les enfants pour vérifier les acquis.
? Prévention universelle
L'éducation préventive destinée à contenir l'expérimentation et la consommation simple de drogues constitue le deuxième volet de toute politique de prévention.
Une partie importante de cet aspect de la politique de prévention est gérée par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES). M. Pierre Arwidson, directeur des affaires scientifiques, a indiqué à cet égard à la mission d'information : « Nous avons conduit deux des trois campagnes médiatiques de ce plan : une campagne d'alerte lancée en 2009, intitulée « Drogues : ne fermons pas les yeux », qui confrontait l'image positive de la drogue à ses conséquences négatives, et une campagne sur la responsabilité des parents et des proches, menée en 2010, « Contre les drogues, chacun peut agir ». Nous éditons des documents d'information pour le grand public, comme Drogues et dépendance . Nous projetons d'éditer une série d'ouvrages consacrés à l'aide à la parentalité et aux compétences psycho-sociales. Nous éditons également des documents destinés aux usagers de drogues ainsi qu'aux professionnels qui les entourent. » (127 ( * ))
Les critiques mentionnées plus haut contre la campagne « Drogues : ne fermons pas les yeux » donne à penser que la politique de communication de l'INPES devrait mieux associer l'ensemble des parties prenantes à la lutte contre les toxicomanies dès l'enfance, les familles et les infirmiers scolaires en particulier.
De fait, une grande partie de la prévention générale a lieu en milieu scolaire. Les interventions extérieures (témoignages devant les classes d'associations, de parents concernés par l'addiction de leurs enfants...) y sont souvent jugées inutiles, voire contre-productives. Selon le professeur Daniel Bailly, elles exciteraient plutôt la curiosité des jeunes et auraient fréquemment l'effet inverse de celui recherché. M. Henri Bergeron, chercheur, auteur de Sociologie de la drogue, a estimé de son côté : « Je ne suis pas spécialiste de l'évaluation des campagnes de prévention mais je sais néanmoins, pour m'être plongé dans cette littérature en tant que coordonnateur scientifique de l'OEDT, que les programmes d'intervention qui, à l'école, mettent en avant les forces de l'ordre ne sont pas des plus efficaces. Les policiers ne sont pas considérés comme crédibles. Or, on sait que, dans les campagnes de prévention, la qualité de la source et sa crédibilité sont au moins aussi importantes que l'information transmise. » (128 ( * ))
Cela met en cause, entre autres, le rôle des services de police et de gendarmerie, qui fournissent des efforts remarquables en faveur de la prévention dans les établissements scolaires. Le colonel Marc de Tarlé, chef du bureau des affaires criminelles à la direction générale de la gendarmerie nationale, a indiqué à cet égard à la mission d'information : « La lutte contre le trafic de stupéfiants doit être totale, c'est pourquoi nous ne négligeons pas la prévention. Ainsi, depuis leur création en 1990, six cent soixante-dix formateurs relais antidrogue ont été formés et ils ont touché environ 7 millions de personnes, notamment des jeunes, dans divers milieux. Le dispositif SAGES - «Sanctuarisation globale de l'espace scolaire» - permet en outre d'aller au coeur des établissements classés les plus sensibles en zone relevant de la gendarmerie », tout en précisant que « les retours des enseignants sur le dispositif des formateurs relais antidrogue sont globalement positifs. Je suis bien incapable de vous dire quel est l'impact réel de ces formations sur les préadolescents et les jeunes adolescents que nous rencontrons. Dans la mesure où 42 % des jeunes de dix-sept à vingt ans sont usagers de cannabis, ces formations ne sont certainement pas assez efficaces, mais si elles n'existaient pas, ce serait une lacune dans le dispositif et ce taux serait probablement plus élevé... Il fut un temps où nous n'étions pas bien accueillis dans les collèges ; ce n'est plus le cas car le problème est réel. Mais il serait intéressant que nous puissions faire des sondages auprès des enseignants. Bref, si le dispositif est perfectible, il est nécessaire. » (129 ( * )) De son côté, M. Patrick Hefner, contrôleur général, chef du pôle judiciaire Prévention et partenariat à la direction générale de la police nationale, a noté : « S'agissant enfin des structures de formation et d'information à destination du public, je ne parlerai que des policiers formateurs anti-drogue : deux cent soixante-sept de ces cinq cent douze fonctionnaires sont dédiés à l'information des parents d'élèves, des élèves et des enseignants dans les collèges et les lycées. En 2010, notre auditoire a été de 112 542 personnes. L'information dispensée est très prisée des parents qui découvrent le monde des stupéfiants. Le savoir unanimement reconnu de ces fonctionnaires est également très apprécié à l'étranger. » (2)
M. Michel Gaudin, préfet de police de Paris, a indiqué de son côté : « la partie répressive de notre métier s'accompagne d'un volet de prévention que nous ne négligeons en aucune façon. Le phénomène est trop préoccupant sur le plan sanitaire comme en termes d'organisation de l'économie souterraine. Il nous faut donc sensibiliser nos concitoyens, notamment les jeunes, à cette problématique. À Paris, notre action de prévention est conduite dans le cadre du contrat de prévention et de sécurité que nous avons signé avec le maire de Paris, qui est parfaitement conscient des difficultés. Mes trois collègues de la petite couronne travaillent également dans le cadre de tels contrats. Nous disposons, intra muros, de vingt-six policiers formateurs antidrogue. Chaque année, nos interventions touchent 14 000 écoliers et collégiens et 11 000 lycéens. » (130 ( * ))
Faut-il revoir ces interventions ? M. Michel Gaudin a encore déclaré devant la mission d'information : « l'éducation sanitaire de nos jeunes concitoyens n'est pas forcément de la compétence de la préfecture de police. C'est la première fois que j'entends un élu dire que les policiers ne sont pas ceux qui assureraient le mieux cette formation - c'est aussi mon avis. Que le «croquemitaine» réussisse dans cette tâche mérite réflexion... Je suis un défenseur acharné de la police de proximité, mais je suis d'accord : apprendre aux jeunes à jouer au football ne fait pas partie du métier de policier. Il reste que les policiers formateurs antidrogue effectuent un travail que personne d'autre ne fait . »
On voit que le débat est ouvert, sans doute serait-il utile de mener une évaluation de ces actions en concertation avec les services de police et de gendarmerie.
On notera simplement ici que le premier chercheur à avoir identifié les possibles effets pervers de l'intervention de personnes extérieures dans les classes, a indiqué le professeur Daniel Bailly, fut un enseignant français travaillant en Bretagne sur la prévention et l'alcool dans les écoles. Il a montré que venir parler du produit dans une classe augmentait la curiosité et poussait à l'expérimentation.
Face à une classe, a expliqué le professeur Daniel Bailly, il y a trois groupes d'élèves : « Le premier est constitué de ceux qui sont a priori contre. Le second est composé de ceux qui ont déjà expérimenté et qui ont leur propre idée sur les produits ; le danger est de raconter des choses qui soient à mille lieues de ce qu'ils ont vécu. Dire que le cannabis rend fou va les faire rire. Enfin, il y a ceux qui sont entre les deux. Ce sont les plus dangereux. Ce n'est pas notre parole qui va compter mais la manière dont ceux qui expérimentent vont interpréter nos propos. Le grand risque est d'être disqualifié, en particulier quand on stigmatise le produit, qui est quand même un facteur d'intégration au groupe des pairs. Faire intervenir un ancien toxicomane est plus dangereux. Intervenir juste après un incident dans l'école lié au produit l'est encore plus » . Il faut mettre un terme à ces pratiques, a estimé le professeur Daniel Bailly.
b) Un enjeu majeur pour les services de santé scolaire
Les services de santé scolaire ont un rôle majeur à jouer en matière de prévention, particulièrement en matière de prévention indiquée, qui implique une démarche individuelle de repérage. Mme Béatrice Tajan, secrétaire nationale adjointe du Syndicat national des infirmiers éducateurs de santé-UNSA a indiqué à cet égard : « L'enfant tenté par des conduites déviantes n'est pas facile à identifier. Quand des indicateurs se mettent au «rouge», en termes de réussite scolaire, de comportement dans le groupe ou de consommation de soins infirmiers, il faut réunir les informations, réfléchir aux moyens de travailler ensemble et définir un projet. » (131 ( * ))
Le rôle des infirmières scolaires, très demandeuses d'une formation et d'une spécialisation, est central de ce point de vue. Mme Béatrice Tajan a ainsi déclaré devant la mission d'information : « Je l'ai dit, les infirmières de l'Éducation nationale sont un des premiers acteurs de santé de proximité. Par leurs missions et leur place au sein des établissements, elles interviennent aussi bien de façon individuelle que collective dans la prévention, l'information et la mise en place d'une prise en charge auprès des intervenants, internes ou externes. Elles doivent développer l'estime de soi, prévenir le mal-être des élèves et organiser des actions de prévention. Elles doivent aussi recevoir le personnel, dispenser une information régulière sur les produits et les nouveaux modes de consommation pour mieux répondre à cette problématique, et mieux repérer les prises de risque. » Notons que le Conseil national de l'ordre des infirmiers travaille actuellement, en collaboration avec plusieurs universités, à un dispositif de formation qui permettrait d'offrir un diplôme aux infirmières déjà en place et de proposer à celles qui aspirent à le devenir une licence professionnelle centrée sur le milieu scolaire. C'est ainsi qu'on leur permettra d'assumer l'essentiel des responsabilités liées à la place de l'aspect médical au sein des établissements. « Nous avons besoin à la fois d'une médecine scolaire liée à une médecine communautaire et, au sein des établissements, d'infirmières à qui l'on donne des compétences étendues, donc des missions importantes de coordination, mais aussi d'écoute, d'accompagnement individuel et de «mise en lien» avec le système de soins », a expliqué Mme Dominique Le Boeuf, Présidente (132 ( * )) .
Par ailleurs, et conformément aux prescriptions du Plan de lutte contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011, le Conseil national de l'ordre des infirmiers travaille actuellement, avec la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, sur la notion de repérage des toxicomanes, le plan prévoyant la mise en place de formations des infirmiers scolaires dans ce domaine. Mme Dominique Le Boeuf a rappelé que l'Éducation nationale avait lancé un grand nombre d'expérimentations s'agissant du repérage et du suivi des élèves toxicomanes. Le rôle des infirmières scolaires est surtout de faire de la prévention, mais on leur demande de plus en plus d'être capables de détecter et d'orienter ces jeunes toxicomanes. Elles sont de plus en plus formées à percevoir les alertes, à y répondre et à assurer le suivi d'adolescents qui doivent absolument pouvoir trouver un interlocuteur au sein des établissements scolaires. C'est tout l'intérêt des expérimentations que l'Éducation nationale est en train de mettre en place, a indiqué Mme Dominique Le Boeuf : « Je pense notamment à ce que fait l'académie de Versailles : les infirmières scolaires y sont formées à repérer et orienter les jeunes à risque. Mais cela suppose que les structures auxquelles on peut adresser ces jeunes soient clairement identifiées. »
Vos rapporteurs tiennent à relever par ailleurs l'opportunité de tirer parti du travail des infirmières scolaires en exploitant de façon plus complète qu'à présent le cahier de l'infirmière scolaire afin de constituer une base de données, au niveau national, sur les consommations de produits psychoactifs par les élèves. Rappelons que, mis en place par une circulaire du ministère de l'Éducation nationale du 12 octobre 1995, le cahier de l'infirmière est composé de deux volets : le premier relève les mouvements et actes infirmiers ; le second répertorie l'ensemble des activités et actions collectives.
Il est intéressant de relever à cet égard une remarque de Mme Béatrice Gaultier, secrétaire générale du Syndicat national des infirmier(e)s conseiller(e)s de santé-FSU : « Notre syndicat regrette que le ministère de l'éducation nationale ait renoncé à analyser les statistiques du «cahier de l'infirmier», qui signale, outre le passage des élèves à l'infirmerie, l'accueil ou le soin qu'ils reçoivent et l'action éducative ou l'orientation qui leur est proposée. Mise en place par une circulaire de 2003, cette source de renseignements serait très utile pour comprendre l'état de santé et le comportement des élèves. » (133 ( * ))
c) La nécessaire association des familles
Les actions de prévention doivent, au-delà du public cible, impliquer tous les acteurs intéressés : parents, enseignants, professionnels de la santé, professionnels du champ socio-éducatif.
On a mentionné plus haut l'intérêt des programmes comportant des séances avec les parents pour les aider à améliorer leur « autorité parentale » et des séances regroupant les parents et les enfants pour vérifier les acquis. De façon beaucoup plus large, il est indispensable d'associer les familles à l'ensemble de la politique de prévention destinées aux enfants et adolescents.
Il est en effet incontestable que le climat familial joue un rôle dans les dérives vers l'addiction, tout comme la qualité des interactions entre parents et enfants. La position des parents vis-à-vis des produits intervient également : le comportement inconscient et irresponsable de certains parents fumant du haschich devant leurs enfants a été souligné à plusieurs reprises devant la mission d'information.
Les parents doivent donc être informés, et même associés à la mise en place des projets de prévention. Ils doivent bénéficier d'une information, non seulement sur l'action elle-même, mais aussi sur les éléments qui conduisent la réflexion : réalité des consommations, évolution psychologique des adolescents, principes de prévention, etc.
Par ailleurs, quand un élève ayant un problème de consommation est repéré dans un établissement scolaire, il importe que les parents soient alertés et que toutes informations utiles leur soient fournies sur les ressources possibles à l'extérieur de l'établissement, notamment sur les centres de consultation jeunes consommateurs.
Ainsi, le programme de prévention mis en place aux États-Unis évoqué plus haut intègre les parents.
3. Améliorer la formation des personnels chargés de la prévention et des enseignants
On a mentionné le besoin de formation des infirmières scolaires et les efforts d'ores et déjà engagés dans ce sens. Le même besoin concerne l'ensemble des intervenants de la lutte contre les toxicomanies. M. Henri Joyeux, président de l'association Familles de France, a estimé devant la mission d'information : « Si les parents craignent que leur enfant ne les aime plus s'ils lui disent «non», il faut leur dispenser une formation à la parentalité. Nous demandons que soit créé un statut parental qui comprendrait ce type de formation. » (134 ( * )) Quoi qu'il en soit de cette idée originale, la formation des professionnels de santé et celle des enseignants appellent des initiatives fortes.
a) Renforcer la formation des professionnels de la santé
M. Patrick Romestaing, président de la section Santé publique du Conseil national de l'ordre des médecins, a relevé à cet égard : « Hormis en matière de vaccination, la prévention est très insuffisante dans notre pays. On pourrait dire que nos confrères ne cessent d'en faire, mais qu'en même temps ils en font très peu, faute de temps. Ils souhaiteraient que ce pan essentiel d'activité soit spécifiquement rémunéré, par exemple au forfait. Le sujet est d'ailleurs à l'ordre du jour de la négociation conventionnelle. Une mixité de la rémunération permettrait sans doute aux médecins de consacrer plus de temps à la prévention. Cela dit, ils déplorent aussi d'y être mal formés, celle-ci étant le parent pauvre de la formation médicale. » (135 ( * )) M. Patrick Romestaing a aussi précisé : « Il est urgent de remettre sur les rails une véritable formation continue. C'est une priorité que de former les jeunes médecins à toutes les facettes du métier. Aujourd'hui, formés à l'hôpital, ils ignorent tout ou presque des réalités de l'exercice libéral. »
De même, selon Mme Isabelle Adenot, présidente du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, « Il faut donc une formation non seulement pour mieux connaître les produits et pour apprendre à sensibiliser la population ou à répondre aux sollicitations des jeunes et des parents, mais aussi pour communiquer avec les toxicomanes. Il faut savoir où sont les bornes à ne pas franchir, sous peine de se laisser entraîner aux dérives qui amènent certains de nos confrères en chambre de discipline. » (2)
b) Impliquer et former les enseignants
Comme l'a indiqué M. Didier Jourdan, coordonnateur du réseau des instituts universitaires de formation des maîtres pour la formation en éducation à la santé et prévention des conduites addictives (136 ( * )) : « La troisième piste est celle de la formation des enseignants. Désormais «mastérisée», elle est passée sous la responsabilité des universités, ce qui signifie qu'il faut permettre à chacune d'entre elles de former à la prévention des conduites addictives. Dans un certain nombre de cas, on dispose de personnes qui y sont aptes et nous mettons à leur disposition l'outil de formation que nous avons construit avec l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Quant aux universités qui ne disposent pas des moyens nécessaires, nous leur proposons le dispositif de formation à distance que nous avons créé avec le réseau. »
Le ministère de l'Éducation nationale et la MILDT ont créé des outils spécifiques.
Le guide d'intervention pour les établissements du second degré , intitulé « Prévention des conduites addictives », mis en ligne en mars 2011 sur le site http://eduscol.education.fr et sur le site de la MILDT, est censé permettre de mettre en oeuvre une démarche de prévention dans les collèges et les lycées. Il propose :
- des connaissances d'ordre général permettant de mieux comprendre le phénomène des conduites addictives des adolescents. Il met l'accent sur le rôle des parents, sur les lois et les règlements ainsi que sur les conduites à tenir dans un établissement scolaire en cas de consommation ou de trafic des stupéfiants ;
- des pistes pour mettre en oeuvre la politique de prévention dans les établissements scolaires, des repères pour l'action ainsi que des techniques pour l'acquisition des compétences psychosociales en articulation avec les compétences du socle commun et les programmes ;
- des informations complémentaires présentées sous formes de fiches concernant les nouveaux contextes d'usage, y compris les addictions sans substance ainsi que les ressources et les points d'appui pour les élèves.
Ce guide complète un dossier documentaire sur les nouveaux éléments de connaissance et d'information relatifs aux produits et à leurs effets, les données géopolitiques et épidémiologiques ainsi que les programmes de collège en lien avec les conduites addictives.
Enfin, un guide d'intervention à destination des enseignants de l'école primaire dans le champ de l'éducation à la santé et la citoyenneté intègre un volet prévention des conduites addictives. Cette brochure, en cours de finalisation, devrait être diffusée et mise en ligne prochainement.
4. Intensifier la prévention dans l'entreprise
L'ensemble des lieux de vie où la consommation de drogues peut faire l'objet d'une action ciblée et concertée est concerné par les politiques de prévention. L'entreprise, en particulier, est trop rarement évoquée. C'est pourquoi il serait, entre autres priorités, indispensable de faire de la prévention au travail.
D'après un avis du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé rendu en mai 2011 sur l'usage de l'alcool, des drogues et toxicomanie en milieu de travail et sur les enjeux éthiques liés à leurs risques et à leur détection : « Dans le contexte professionnel, environ 10 % des salariés consommeraient régulièrement ou occasionnellement des produits illicites ; en premier lieu et très majoritairement, le cannabis (de l'ordre de 8 %), puis la cocaïne, les amphétamines et - très peu - l'héroïne. Parmi les personnes au travail (actifs occupés), la consommation est très variable selon les catégories socioprofessionnelles : très faible chez les agriculteurs (2,7 %), elle atteint des pics chez les professionnels des arts et du spectacle (17 %), et à un moindre degré dans l'hôtellerie-restauration. Elle est de l'ordre de 9 % chez les artisans, commerçants et chefs d'entreprise, de 7 % chez les cadres et dans les professions intermédiaires. Ce sont les chômeurs, les demandeurs d'emploi et les jeunes apprentis qui sont les consommateurs les plus réguliers de cannabis (15 % et 19 % respectivement) contre 5,7 % chez les étudiants. »
Cette situation et particulièrement les estimations concernant les apprentis, appellent des initiatives en matière de prévention. On peut imaginer de renforcer à cet égard le rôle des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Rappelons que ces comités doivent procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs (article L. 4612-2 du code du travail) et à la prévention de ces risques (article L. 4612-3 du code du travail). Ils disposent à cet effet de moyens d'information et d'investigation, et peuvent notamment recourir à un expert (article L. 4614-12 du code du travail).
On rappellera, par ailleurs, que certaines grandes entreprises telles que la SNCF, EDF et Air France ont mis en oeuvre des chartes de prévention des risques liés à l'alcool. Ces chartes ont été signées par les directions, les syndicats de salariés, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elles prévoient l'interdiction d'introduire ou de consommer de l'alcool sur les lieux de travail et excluent toute présence d'alcool lors des événements festifs accompagnant la vie de l'entreprise. Mutatis mutandis , ces chartes pourraient inspirer des initiatives dans le domaine des drogues illicites.
B. REFUSER LE DÉFAITISME EN RENFORÇANT L'OFFRE DE SOINS
De nombreux intervenants l'ont rappelé à la mission d'information : la toxicomanie est, comme l'avait souligné le professeur Claude Olievenstein, la rencontre entre un produit et une personnalité, dans un contexte social et culturel donné. Autant dire que cette simple définition permet d'appréhender l'ampleur de la tâche qui consiste à accompagner les toxicomanes dans leur sortie de l'addiction - d'autant que, selon le docteur Xavier Laqueille, psychiatre, chef du service d'addictologie de l'hôpital Sainte-Anne à Paris que la mission d'information a pu visiter, il faut moins parler de « guérison » que de « rémission » de plus ou moins longue durée.
L'offre de traitement a tenté de répondre à la diversité des profils et des problèmes des toxicomanes. Élaborée dans les années 1970, reposant sur un principe d'anonymat du patient et de gratuité des soins, elle a assez longtemps été marquée par le relatif désintérêt des personnels soignants, médecins et psychiatres, pour lesquels les toxicomanes constituaient des patients « à part », difficiles à prendre en charge. L'offre de traitement a donc été d'abord le fait d'associations ainsi que de quelques personnalités très engagées, comme le professeur Claude Olievenstein qui a créé le centre de Marmottan. Il en a résulté une grande diversité des structures susceptibles de prendre en charge les usagers de drogues souhaitant traiter leur addiction, et une palette de réponses thérapeutiques diversifiées dans laquelle on peine parfois à se retrouver. Traitement médico-social ou hospitalier des addictions, structures résidentielles ou prise en charge ambulatoire, centres spécialisés ou médecine généraliste de ville sont autant de possibilités ouvertes aux dépendants en recherche de traitement.
Cette abondance n'est cependant qu'apparente : l'offre de soins souffre en réalité de certaines insuffisances et de déséquilibres auxquels il faut aujourd'hui remédier, car le défaitisme ne peut être une option.
1. Multiplier les structures d'accueil résidentiel
L'offre de soins à destination des toxicomanes peut paraître abondante, mais elle est aussi en cours de structuration et de rationalisation. La multiplicité des structures dans le souci d'une offre diversifiée ne répond qu'imparfaitement aux besoins des toxicomanes et de leurs familles. Certains dispositifs mériteraient ainsi d'être confortés. Cela concerne au premier chef les structures de traitement résidentielles médico-sociales qui permettent de prendre en charge des patients pour lesquels une prise ambulatoire est inadaptée et dont l'accompagnement est le plus difficile.
Les structures de soins résidentiels peuvent prendre diverses formes mais le nombre de places disponibles - environ 1 100 - reste plus que limité au regard des près de 230 000 usagers problématiques de drogues. On mesure les efforts à consentir en la matière !
Ce point est d'ailleurs souligné dans le Livre blanc de l'addictologie française établi par la Fédération française d'addictologie et communiqué à la mission d'information par M. le professeur Michel Reynaud, psychiatre, secrétaire général du collège universitaire des enseignants d'addictologie et chef du service de psychiatrie et d'addictologie du groupement hospitalier universitaire Paul Brousse (137 ( * )) .
Ce livre blanc, dans sa proposition n° 39, juge en effet nécessaire d'« augmenter les capacités d'accueil des services de soins résidentiels sur la base d'une programmation nationale et régionale, garantissant l'égalité d'accès aux différents profils et parcours d'usagers et aux offres correspondantes » et, dans sa proposition n° 40, de « doubler les capacités d'accueil des services de soins résidentiels et mettre notamment en place une programmation pour [disposer], en moyenne par région, [de] trente places en centres thérapeutiques résidentiels, trente places en communautés thérapeutiques et dix places en réseau de famille d'accueil » (138 ( * )) .
a) Conforter le message d'espoir des communautés thérapeutiques
La mission d'information a visité deux communautés thérapeutiques : la Communauté du fleuve, située à Barsac en Gironde, et le centre San Patrignano en Italie, à proximité de Rimini. Ces deux déplacements ont permis de montrer toute l'utilité de telles structures pour accompagner les toxicomanes dans leur sortie de la dépendance. Indispensables pour les accompagnements au long cours, elles sont malheureusement trop peu nombreuses et méritent d'être confortées.
? Les communautés thérapeutiques, des structures un temps contestées en France mais en cours de réhabilitation
Il convient de rappeler ce que sont les communautés thérapeutiques. Elles s'inscrivent, à l'origine, dans une logique de « démédicalisation » et de « dépsychiatrisation » du traitement des usagers de drogues. Leur démarche repose sur l'éloignement des toxicomanes de leur environnement habituel pour rompre avec le milieu de la drogue. Ces structures d'hébergement s'adressent donc à des usagers de drogues dépendants dont l'objectif est l'abstinence. La vie en communauté doit les conduire à abandonner leur comportement toxicomaniaque et retrouver leur autonomie avec l'aide de leurs pairs et d'un personnel d'encadrement. La participation à des travaux collectifs et à des groupes de parole doit les aider à se stabiliser sur le plan comportemental et psychologique en vue de leur réinsertion future. Comme l'a indiqué à la mission d'information M. Andrea Muccioli, qui dirige le centre San Patrignano, la communauté a vocation à remplir le vide laissé par la drogue et à aider les personnes accueillies à retrouver leur estime de soi.
Apparues dans les années 1970 en France, les communautés thérapeutiques ont longtemps constitué le standard dominant du traitement des toxicomanies qui visait le sevrage et l'abstinence. Puis, l'apparition de la politique de réduction des risques dans les années 1990 a contribué à « remédicaliser » le traitement des toxicomanies, notamment grâce à la diffusion des traitements de substitution aux opiacés. La montée en puissance de centres spécialisés de soins aux toxicomanes a également conduit à se détourner des communautés thérapeutiques. Parallèlement, l'image de ces dernières s'est dégradée en France, en raison d'une nébuleuse d'entités se présentant comme telles - bien que non reconnues par les pouvoirs publics ou les réseaux internationaux de communautés thérapeutiques -, regroupées au sein de l'association Le Patriarche dont les dérives sectaires ont été établies par la commission d'enquête sur les sectes constituée par l'Assemblée nationale en 1995 (139 ( * )) . Les communautés thérapeutiques ont alors suscité la défiance ; leur objectif d'abstinence a même pu être dénigré au motif qu'il serait irréaliste et porteur de valeurs morales jugées dépassées.
Pourtant, lorsque les séjours de brève durée dans les centres de post-cure ont échoué, quand le recours aux structures ambulatoires a atteint ses limites et la réponse médicamenteuse est inadaptée, l'approche psychosociale et la rupture avec un environnement incitant à la consommation de produits psychoactifs prennent tout leur sens. Comme l'a déclaré à la mission d'information le docteur Xavier Emmanuelli, président et fondateur du Samu-social, « on sait traiter les crises aiguës mais on n'a pas fourni de solution de rechange. Les psychiatres aiment bien se servir des produits et n'ont pas les moyens de les suivre à long terme. Or, le problème de société qui est posé ici est celui de l'accompagnement, de l'hébergement, de l'intérêt, de l'affection pour les malades et ne sera pas résolu uniquement par des moyens matériels » (140 ( * )) .
C'est exactement ce que la mission d'information a pu constater lors de sa visite de la communauté de San Patrignano. Toutes les personnes qu'elle a pu y rencontrer ont loué le caractère familial de la structure, alors même qu'elle compte plus de mille six cents membres. La rupture avec l'environnement qui a conduit à la consommation de produits y est totale : lors de la première année de résidence, aucun contact n'a lieu avec l'extérieur, si ce n'est par voie épistolaire. Ce n'est qu'après que peuvent être organisées les visites de proches, et les sorties à l'extérieur de la communauté n'interviennent qu'après deux ans de séjour ou un peu plus longtemps. L'encadrement permanent par les pairs, reposant sur un système de parrainage par les résidents les plus anciens, ainsi qu'une vie en communauté continue - les résidents dorment ainsi en dortoirs collectifs pendant tout leur séjour, qui dure près de quatre ans - permettent d'apporter un soutien tout au long du parcours. Pour autant, l'autonomie est aussi progressivement acquise, par de nouvelles responsabilités données au fil du séjour et des sorties à l'extérieur de plus en plus fréquentes.
Fort heureusement, une telle approche du soin des dépendants semble désormais en cours de réhabilitation en France ; car quoi qu'en disent certains, la plupart des toxicomanes souhaitent, même s'ils n'y parviennent pas facilement, « sortir » de leur addiction lorsque les conséquences de celle-ci deviennent ingérables. Pour les plus fragiles, cette sortie est longue, parsemée d'embûches, jamais définitivement acquise. Un encadrement permanent, un soutien psychologique et l'entraide des pairs sont alors essentiels pour le maintien dans l'abstinence, objectif qui n'est souvent qu'imparfaitement poursuivi lorsqu'une démarche strictement médicale est privilégiée. Les structures ambulatoires ne peuvent apporter une telle réponse ; ne pas l'offrir serait pourtant irresponsable.
? Des structures aux résultats très positifs
Les communautés thérapeutiques ont fait la preuve de leur efficacité. Les données internationales montrent qu'elles obtiennent des résultats remarquables pour les personnes qui parviennent au bout du programme.
Une des critiques à l'égard de ces structures consiste à leur reprocher de procéder à un « tri » de leurs résidents, en exigeant qu'ils soient déjà sevrés à leur entrée. Mais c'est bien là que réside l'enjeu : le but est de consolider l'abstinence de toxicomanes sevrés. L'offre de sevrage est relativement abondante, notamment en milieu hospitalier. Une fois cette étape franchie, la difficulté pour les dépendants consiste à éviter la rechute et à être suffisamment motivés pour envisager de se maintenir dans l'abstinence ; si tel n'est pas le cas, il est évident que la démarche est vouée à l'échec. Ainsi, pour entrer au centre San Patrignano, les demandeurs doivent-ils attester de leur sevrage ; leur degré de motivation est également évalué par le personnel d'encadrement. Les demandeurs se soumettent en outre à un bilan psychiatrique complet, qui permet de déterminer si leurs éventuels troubles psychiatriques étaient préexistants à la consommation de drogues. Si tel est le cas, ils ne sont pas admis car la vie en communauté, assortie de règles strictes, ne serait pas adaptée.
Les bons résultats obtenus par les communautés thérapeutiques pour ceux de leurs résidents qui parviennent au bout de leur parcours sont également souvent relativisés, dans la mesure où seulement 15 % à 25 % des personnes accueillies parviennent, effectivement, à achever ce parcours. La plupart des départs surviennent en effet fréquemment lors des trois premiers mois du séjour.
Mais cette observation ne vaut pas pour toutes les communautés, dont certaines obtiennent des « taux de réussite » excellents. C'est le cas du centre San Patrignano qui a donné lieu à des études indépendantes réalisées par les universités d'Urbino, de Bologne et de Pavie (141 ( * )) . Cette communauté a le meilleur taux mondial de « rétention » de ses résidents puisque selon les années, il varie entre 61 % et 71 % après un an de séjour, ce qui est extrêmement élevé si on le compare aux 25 % cités plus haut. Après deux ans - soit la durée maximale prévue pour les séjours en communauté thérapeutique en France -, ce taux est de 52 % à 55 %. Il est de 45 % après trois ans. Les mêmes études ont en outre analysé les parcours d'anciens résidents de la communauté trois ans au moins après la conclusion de leur parcours éducatif et ont conclu que plus de 70 % d'entre eux étaient totalement réinsérés et ne consommaient plus aucune drogue.
La durée du séjour a un impact non négligeable sur les résultats obtenus. Comme le soulignent le Dr Jean-Michel Delile et M. Jean-Pierre Couteron (142 ( * )) , d'après les études de suivi, une durée minimale de séjour de trois mois est nécessaire pour obtenir de premiers résultats positifs et la durée optimale est bien supérieure, puisqu'elle est estimée entre six et vingt-quatre mois. Les communautés thérapeutiques ont alors « des taux de rechute plus faibles et, globalement, obtiennent de meilleurs résultats que les programmes ambulatoires ». Cela est en particulier le cas au centre San Patrignano, où la durée totale du « parcours » est d'environ quatre ans.
? Un encadrement strict des modalités de fonctionnement
Vos rapporteurs ont constaté que les critiques auparavant adressées aux communautés thérapeutiques, à savoir leurs dérives sectaires, leurs conditions restrictives d'accès, l'absence de personnel soignant ou leur fermeture à toute influence extérieure ne peuvent plus être encourues par les établissements aujourd'hui expérimentés en France.
Les communautés thérapeutiques d'aujourd'hui ne peuvent être comparées à la nébuleuse d'associations aux pratiques douteuses qui ont pu exister il y a un temps. Elles ont désormais un statut juridique bien défini : il s'agit d'établissements médico-sociaux à caractère expérimental régis par le 12° du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Leurs modalités de fonctionnement sont bien encadrées par un cahier des charges défini par voie de circulaire (143 ( * )) et qui précise explicitement qu'il a pour objet de « préciser le modèle des communautés thérapeutiques, en garantir la qualité, et prévenir les dérives autoritaires, le prosélytisme religieux ou sectaire et l'exploitation économique ». La circulaire précisant le régime des communautés prévoit qu'elles font l'objet d'une procédure d'autorisation temporaire, comme les autres établissements médico-sociaux. Celle-ci est délivrée par le représentant de l'État dans le département, pour une durée de trois ans ; l'autorisation est renouvelable une fois pour une durée d'un an, au vu des résultats positifs d'une évaluation. Toute crainte de dérives semble donc devoir être écartée compte tenu des garanties qu'offre le statut juridique de ces établissements.
S'agissant des conditions d'accès aux communautés thérapeutiques, il est vrai qu'elles peuvent être restrictives car ces structures ne peuvent accueillir certaines catégories de toxicomanes. Les personnes souffrant de troubles psychiatriques sévères, en particulier, ne peuvent résider dans des communautés dont elles perturberaient par trop le fonctionnement. Pour autant, le cahier des charges des communautés thérapeutiques françaises n'exclut pas qu'y résident des personnes souffrant de troubles mineurs, puisqu'il prévoit que les patients présentant des troubles psychiatriques compatibles avec la vie en collectivité et les activités proposées sont acceptés. Leur traitement est alors poursuivi ou adapté, en liaison avec les services médicaux locaux ou départementaux. Vos rapporteurs ont ainsi pu constater, à la communauté thérapeutique de Barsac, qu'au cours de l'année 2010, les cinquante-sept résidents avaient bénéficié de 510 actes délivrés par un psychiatre.
De même, la critique à l'encontre d'une « démédicalisation » exagérée des communautés thérapeutiques ne semble plus fondée. Ces structures doivent certes placer le groupe au coeur du projet thérapeutique et d'insertion sociale, mais en application de leur cahier des charges, elles sont également tenues de s'inscrire dans un réseau de prise en charge sanitaire et sociale - en particulier, elles peuvent accueillir des patients sous traitement de substitution aux opiacés au moment de leur entrée, dès lors que l'objectif du résident est de parvenir à l'abstinence. Elles doivent également assurer un suivi médical de leurs résidents.
La mission d'information a ainsi pu constater que la communauté thérapeutique de Barsac accueille des personnes atteintes de maladies infectieuses et accepte les personnes sous traitement médicamenteux - notamment des psychotropes - ou sous traitement de substitution aux opiacés, mais désirant l'arrêter. Ainsi, sur un total de cinquante-sept patients hébergés en 2010, seize d'entre eux bénéficiaient d'une prescription de méthadone et vingt-quatre autres d'une prescription de buprénorphine haut dosage. Il est par ailleurs expressément prévu que le personnel d'encadrement des communautés soit constitué de personnel médico-social, tout en pouvant comprendre d'anciens résidents. Ainsi, à la Communauté du fleuve, un psychiatre et un psychologue exercent à mi-temps et la communauté dispose de 1,5 équivalent temps plein pour le poste d'infirmier.
Le reproche de la trop grande fermeture à l'extérieur des communautés thérapeutiques ne peut pas, non plus, leur être adressé. Le temps des communautés repliées sur elles-mêmes et à dérives sectaires est, fort heureusement, révolu. Comme a pu le constater la mission d'information lors de sa visite de la Communauté du fleuve, un travail de fond est en réalité mené avec les proches et les familles, lorsque cela est possible, pour créer un lien thérapeutique entre ceux-ci, le résident et l'institution communautaire, le but étant de parvenir à une réinsertion non seulement professionnelle mais aussi affective et sociale.
? Des structures à conforter impérativement en s'inspirant des expériences les plus positives
Les communautés thérapeutiques ont su faire la preuve de leur efficacité à l'étranger. On n'en compte aujourd'hui en France que sept ; une communauté supplémentaire est en cours de création. Cela est totalement insuffisant pour répondre aux besoins - il n'est qu'à voir les listes d'attente que les communautés existantes ont à gérer. Il faut, de toute évidence, conforter et multiplier ces structures qui portent un véritable message d'espoir à tous les dépendants en quête d'un séjour de rupture.
Pourrait-on envisager d'accroître les capacités de communautés existantes ? Leur cahier des charges prévoit qu'elles doivent offrir trente à trente-cinq places d'hébergement. Mais la mission d'information a pu constater, lors de sa visite du centre San Patrignano, que des communautés de très grande taille pouvaient aussi obtenir des résultats saisissants.
San Patrignano, qui est un véritable village, s'étend sur 260 hectares de collines dont 14 000 mètres carrés sont dédiés aux structures communautaires (dortoirs collectifs, réfectoire accueillant l'ensemble de la communauté, ou encore immense salle polyvalente). Sa très grande taille a permis d'accueillir, depuis 1978, près de vingt mille personnes ; en 2007, la communauté en a pris en charge 1 635 ! Elle accueille en moyenne six cents nouvelles personnes par an. Comprenant soixante maisons pour les familles des éducateurs qui y travaillent et les personnes qui reconstruisent leur propre cellule familiale, elle héberge de nombreux enfants de bénévoles et de personnes qui suivent le parcours de réhabilitation. Elle comporte également un centre éducatif fermé où elle accueille des mineurs toxicomanes sous main de justice.
La communauté est dotée d'un centre médical de cinquante lits, spécialisé dans les maladies liées à la toxicomanie et qui accueille notamment des malades en phase terminale atteints du syndrome d'immunodéficience acquise ; son laboratoire dispose d'ailleurs de la base de données la plus importante dans ce domaine. La communauté comporte également un centre d'orthodontie car tous les résidents bénéficient, à leur arrivée, d'un bilan médical complet et se voient offrir des soins dentaires gratuits. La communauté comporte également un centre éducatif pour les enfants, de nombreuses structures récréatives, scolaires et sportives. Elle compte enfin plus de cinquante ateliers de formation professionnelle qui touchent à de nombreux domaines : artisanat haut de gamme, élevage, viticulture, restauration, édition, graphisme ou encore services internet, et permet à ses résidents de suivre des cours pour obtenir des diplômes qualifiants d'enseignement supérieur ou intermédiaire. Il n'est dès lors pas étonnant de noter que la quasi-totalité des résidents de San Patrignano trouvent, à leur sortie du centre, un emploi.
Il est vrai que les ateliers que la mission d'information a pu visiter sont tout à fait remarquables. Il s'agit de réelles entreprises, dotées d'un matériel de très haute qualité, extrêmement bien entretenu, qu'il s'agisse de l'atelier de décoration, de la cave, des bâtiments destinés à l'élevage, de la fromagerie ou encore du laboratoire produisant les détergents utilisés par la communauté. Partout l'excellence domine, car la volonté est de produire des biens de haute qualité. Ainsi, l'atelier de décoration produit-il des papiers peints exportés aux États-Unis et des peluches en fourrure destinées à l'industrie du luxe française, ainsi que du mobilier haut de gamme ; les vins produits ont été plusieurs fois primés ; les fromages sont vendus, eux aussi, à l'extérieur et très appréciés. La communauté dispose d'ailleurs d'un magasin extrêmement bien tenu proposant ses produits au public et que rien ne distingue d'une boutique haut de gamme.
Le centre a su s'entourer de compétences reconnues pour développer ses divers ateliers d'activités. Il a ainsi bénéficié de la collaboration bénévole d'un chef cuisinier étoilé ; un oenologue mondialement réputé aide, lui aussi, à faire fonctionner l'activité viticole. De nombreux autres bénévoles, très compétents, oeuvrent dans les autres ateliers ; dans certains cas, le centre rémunère des salariés professionnels d'un secteur pour maintenir la qualité et le savoir-faire des équipes.
Les moyens mis en oeuvre sont évidemment conséquents : San Patrignano compte ainsi environ cent quarante éducateurs bénévoles et trois cent cinquante personnes ayant un statut d'employé, de collaborateur ou de consultant, dont certains sont des anciens toxicomanes. Toutes les prestations fournies aux résidents (hébergement, nourriture, vêtements, formation professionnelle) sont gratuites. Le centre n'acceptant ni subvention de l'État, ni participation des familles des personnes accueillies, il assure son financement par récolte de fonds (14,7 millions d'euros en 2009 provenaient de dons et contributions philanthropiques de personnes privées, d'entreprises et de fondations) et par les recettes tirées de la vente des produits fabriqués par les membres de la communauté (pour un montant de 12,4 millions d'euros en 2009).
Le choix de l'excellence est délibéré. Il s'agit en effet de permettre à des personnes qui ont très souvent perdu toute estime d'elles-mêmes d'être fières de ce qu'elles ont accompli. La mission d'information a d'ailleurs pu constater que cette stratégie portait ses fruits : tous ceux qu'elle a pu rencontrer respiraient la joie de vivre et montraient un réel enthousiasme pour leur activité, alors même qu'ils y avaient été affectés, dès le premier jour de leur entrée dans le centre, au vu de leur dossier, sans avoir de choix entre les divers ateliers.
Sans prétendre créer une structure équivalente au centre de San Patrignano - cette expérience remarquable est probablement unique au monde, comme l'a d'ailleurs noté M. Andrea Muccioli qui dirige la communauté -, on peut penser que des marges de progression existent en France et qu'on pourrait utilement s'inspirer de sa démarche. En particulier, les activités offertes et les parcours de réinsertion semblent perfectibles. Cela nécessite évidemment des moyens ; la stratégie économique de San Patrignano, qui repose en grande partie sur les recettes tirées des ventes de ses produits, mérite à cet égard d'être examinée avec attention.
Il est peut-être aussi nécessaire d'engager une réflexion sur la durée de séjour dans les communautés thérapeutiques. Leur cahier des charges prévoit actuellement que cette durée ne peut excéder deux ans. Mais les expériences étrangères font état de durées de séjour parfois sensiblement plus élevées : ainsi, au centre San Patrignano, le parcours des résidents dure-t-il entre trois et quatre ans ; la durée de séjour dans la communauté des Rives du Rhône dans le canton du Valais est de deux à trois ans.
On devrait sans doute s'inspirer des exemples étrangers les plus couronnés de succès pour parvenir à une offre suffisante permettant de couvrir les besoins des toxicomanes en recherche d'un traitement résidentiel visant le sevrage et l'abstinence.
Vos rapporteurs proposent donc de multiplier les communautés thérapeutiques et de conforter les communautés existantes, en fixant pour objectif que chaque région soit dotée d'au moins une telle structure, en s'inspirant des exemples étrangers qui ont montré leur efficacité .
b) Renforcer les capacités d'hébergement des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie
Au-delà des communautés thérapeutiques qui sont des structures de soins de long séjour, vos rapporteurs jugent également pressant d'accroître la capacité d'accueil résidentiel des autres établissements médico-sociaux que sont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.
Ceux-ci relèvent du 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et, comme les communautés thérapeutiques, sont soumis à une procédure d'autorisation. Ainsi qu'il est précisé par voie de circulaire (144 ( * )) , ils peuvent fonctionner soit en ambulatoire, soit avec hébergement, mais ils peuvent également assurer ces deux types de prestation. Les centres avec hébergement proposent des prestations résidentielles collectives (centres thérapeutiques résidentiels, structures d'hébergement d'urgence ou de transition). Le cas échéant, ils peuvent mettre en place des modalités d'hébergement individuel (appartements thérapeutiques relais, par exemple). Les missions obligatoires de ces centres que sont l'accueil, l'information et surtout la prise en charge médicale, psychologique et sociale par un personnel très compétent constituent des gages importants du sérieux de leur travail.
La mission d'information a pu visiter le centre Pierre Nicole géré par la Croix Rouge française, qui offre des prestations d'hébergement ; vos rapporteurs ont pu constater que les actions qui y sont menées sont tout à fait remarquables. La prise en charge médicale de ses usagers est bien encadrée par des protocoles stricts, notamment pour la délivrance supervisée de traitements de substitution aux opiacés, afin d'éviter tout mésusage. Les autres pathologies liées à l'usage de la drogue (maladies virales, abcès, lésions) font également l'objet de soins. Les actions sociales visant à la formation et la réinsertion ainsi que l'aide apportée dans l'accomplissement des démarches administratives constituent, à l'évidence, un soutien précieux pour les toxicomanes en cours de traitement. Le centre offre en outre, en 2011, vingt-sept places d'hébergement en centre thérapeutique résidentiel, dont dix sont réservées à des usagers sous main de justice.
Le succès de telles initiatives, comme l'a justement noté le professeur Jean-François Mattei, président de la Croix Rouge française, est évidemment facilité lorsque la structure d'accueil offre, en plus de ces prestations, une capacité d'hébergement qui permet d'offrir un encadrement continu, comme dans les communautés thérapeutiques. L'hébergement est l'occasion, pour les patients, de « se poser » afin d'améliorer et stabiliser leur état sanitaire et psychologique, et s'orienter, par la suite, vers des structures de soins ambulatoires moins exigeantes. Cela est particulièrement nécessaire pour les catégories d'usagers de drogues rencontrant des difficultés sociales et particulièrement démunis, comme les personnes sortant de détention qui ont besoin d'un lieu où elles pourraient éviter de « replonger ».
Or, comme l'a souligné auprès de la mission d'information M. François Hervé, représentant de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale, « le secteur de l'hébergement est de plus en plus amené à pallier les carences de la politique de santé ou de la politique pénale. [...] Il existe [...] une limite aux politiques publiques de santé et aux sorties d'hôpital car il n'y a pas toujours de possibilités d'hébergement. Ceci a amené la création d'un dispositif, mais il reste insuffisant » (145 ( * )) .
La situation actuelle est donc critique, d'autant plus que d'après le Livre blanc de la Fédération française d'addictologie, « alors que les demandes d'admission dans ces dispositifs sont en nombre très élevé, les capacités d'accueil se sont modifiées : la baisse de l'accueil en [centres thérapeutiques résidentiels] et familles d'accueil (entre 1999 et 2009, le nombre de [centres thérapeutiques d'accueil] est passé de soixante à trente-cinq, les capacités d'accueil en famille ont été divisées par trois, le nombre d'appartements thérapeutiques a stagné) n'est que partiellement compensée par l'ouverture de [communautés thérapeutiques] » (146 ( * )) .
Ce constat a également été partagé par M. Jean-Marc Borello, délégué général et président du directoire de SOS Drogue international-Groupe SOS, qui a déploré un renforcement des demandes d'admission pour tous les types de structures. Il a estimé que « sur le plan quantitatif, le dispositif [avait] vraisemblablement diminué au cours des dernières années, avec la disparition d'un certain nombre d'associations et de lieux de soins de petite taille. Les structures encore existantes continuent de recevoir des demandes d'admission, à raison de cinq ou dix pour une place disponible » (147 ( * )) .
Ainsi, d'après les données fournies par la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, l'ensemble constitué par les centres thérapeutiques résidentiels et communautaires offre seulement cinq cent soixante-dix places. Les demandes pour de tels séjours de « rupture » de moyenne durée, avec un encadrement professionnel continu et un soutien psychologique, social et médical, sont très nombreuses. Bien souvent, malheureusement, y accéder relève du parcours du combattant.
Alors que les demandes surgissent souvent dans l'urgence, lorsque le toxicomane qui a décidé de « sortir » de la drogue est encore très vulnérable, il se heurte à des listes d'attente qui ne font qu'aggraver son risque de rechute. Vos rapporteurs jugent qu'un effort doit donc être consenti pour soutenir ces centres qui répondent à de réels besoins, aujourd'hui insatisfaits.
Parmi les autres structures de soins résidentiels figurent également les appartements thérapeutiques relais. Ces unités de soins qui poursuivent une visée d'autonomie sociale sont mises à la disposition d'anciens usagers de drogues engagés dans une démarche de soins et ayant suivi une cure de sevrage. Ils nécessitent un encadrement en personnels soignants mais leur intégration au sein d'un groupe dans un centre d'hébergement collectif n'est pas requise. Ces appartements répondent donc à un souci de socialisation et de restauration de la capacité des toxicomanes à maîtriser leur situation d'abstinence et à agir de manière autonome. Le centre Pierre Nicole propose ainsi une vingtaine de studios et petits appartements dans Paris, loués par la Croix Rouge française qui les sous-loue aux résidents, dans des conditions très encadrées. Les sorties de ces appartements s'effectuent par un relogement ; ils constituent donc un élément tout à fait précieux pour aboutir à une réinsertion durable des anciens toxicomanes.
Là encore, vos rapporteurs jugent nécessaire de renforcer l'offre d'hébergement dans de telles structures. Le nombre de places disponibles dans ces appartements n'est que de quatre cent quatre-vingt-huit. Ils sont pourtant essentiels pour permettre aux anciens usagers de drogues de progresser en autonomie, leur apprendre à gérer leur budget et leur emploi du temps, et à accomplir diverses formalités qui les aideront pour leur réinsertion sociale et professionnelle.
Enfin, le même effort doit être consenti pour inciter à la multiplication des réseaux de familles d'accueil, qui n'offrent aujourd'hui que quarante-sept places. Ces réseaux, rattachés à des centres de soins ambulatoires, constituent une expérience riche et originale : les familles, en ouvrant leur maison et en partageant leur mode de vie, s'engagent dans une réelle démarche de rencontre humaine qui permet aux toxicomanes de retrouver une stabilité et de retisser du lien social.
2. Renforcer l'offre de soins spécialisés
La multiplication des structures résidentielles médico-sociales de moyen et long séjour constitue un impératif. Mais il convient aussi de renforcer et poursuivre la structuration de l'offre de soins spécialisés de proximité, qu'il s'agisse des services hospitaliers d'addictologie de proximité ou des structures d'accueil ambulatoire médico-sociales.
a) Conforter les services hospitaliers d'addictologie
Comme l'a indiqué le professeur Michel Reynaud, chef du service de psychiatrie et d'addictologue du groupement hospitalier universitaire Paul Brousse (148 ( * )) , l'offre hospitalière en addictologie est relativement récente - elle ne date que de 2005 - et s'organise en trois niveaux : des équipes de liaison et de soins en addictologie, pour une réponse de proximité, dans tous les hôpitaux possédant un service d'urgences ; des services de référence, avec des lits d'hospitalisation spécialisés, pour la prise en charge d'addictions en situation complexe ; des services universitaires, enfin.
Le plan de prise en charge et de prévention des addictions pour la période 2007-2011, partant du constat qu'environ 20 % des personnes hospitalisées avaient des difficultés dans la gestion quotidienne de leur consommation de substances psychoactives, avait fixé comme objectif une réorganisation de l'hôpital pour permettre à l'addictologie d'être reconnue et de se développer. Il avait ainsi défini une politique ambitieuse de renforcement de l'offre hospitalière en addictologie : doter tous les hôpitaux d'une équipe de liaison et de soins en addictologie ; créer cent vingt services d'addictologie de recours proposant des sevrages simples ou complexes pour que tout territoire de santé comprenant plus de 500 000 habitants soit couvert ; doter chaque centre hospitalier universitaire - soit vingt-six établissements - d'un pôle d'addictologie.
Vos rapporteurs constatent qu'un réel effort a été consenti pour améliorer la couverture du territoire par une offre hospitalière en addictologie ; la situation n'est, en effet, en rien comparable à ce qu'elle pouvait être au début des années 2000, comme l'a d'ailleurs souligné Mme Annie Podeur, directrice générale de l'offre de soins (149 ( * )) . Pour autant, les objectifs qui avaient été fixés par le plan gouvernemental n'ont été que partiellement atteints. Il convient de poursuivre les efforts en menant une politique volontariste.
S'agissant des équipes de liaison et de soins en addictologie qui jouent un rôle essentiel auprès des personnels soignants hospitaliers - il leur revient de les conseiller sur les questions de dépistage, de diagnostic, de prise en charge des problèmes d'intoxication aiguë, de sevrage, de traitement de substitution, de prise en charge psychologique ou encore d'orientation -, elles se sont bien développées au cours des cinq dernières années. En 2009, on en comptait, selon les données communiquées par la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, deux cent quatre-vingt onze. Toutefois, selon la Fédération française d'addictologie, on compte encore une trentaine d'établissements pourvus d'un service d'accueil des urgences qui ne disposent ni de telles équipes, ni de services d'addictologie, ce qui pose évidemment un problème en termes de repérage des dépendances des patients hospitalisés pour des raisons somatiques.
L'offre hospitalière comporte par ailleurs, selon les données communiquées par la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, 476 consultations d'addictologie, 261 unités pour sevrages simples - soit environ 1 300 lits -, 51 unités de soins complexes - représentant environ 1 100 lits -, 55 hôpitaux de jour - soit près de 300 places - et 60 soins de suite et de réadaptation - correspondant à environ 1 900 lits.
Cette offre est encore insuffisante au regard des objectifs qui avaient été fixés par le plan de prise en charge et de prévention des addictions pour la période 2007-2011. Il est vrai, ainsi que l'a souligné Mme Annie Podeur, directrice générale de l'offre de soins, que la mise en place des agences régionales de santé a pu ralentir la mise en oeuvre de ce plan. Vos rapporteurs appellent à poursuivre les efforts pour aboutir à une offre de soins complète. Cela suppose évidemment la création de nouvelles structures mais aussi une meilleure diffusion de la culture en addictologie dans les services hospitaliers - par exemple, comme l'a suggéré la Fédération française d'addictologie, en facilitant la réalisation de sevrages simples dans des services non spécialisés en addictologie.
b) Renforcer le maillage territorial en services médico-sociaux de suivi ambulatoire
Le secteur médico-social en addictologie permet d'assurer une offre de prise en charge ambulatoire de proximité et pluridisciplinaire (médicale, psychosociale, éducative) qui permet de répondre à la diversité des besoins de la population des toxicomanes.
? Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie
Le plan de prise en charge et de prévention des addictions pour la période 2007-2011 a permis d'engager une restructuration de l'offre de services médico-sociaux ambulatoires aux toxicomanes, avec la transformation des centres de soins spécialisés aux toxicomanes et des centres de cure ambulatoire en alcoologie en centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, pour regrouper l'ensemble des structures sous un statut juridique commun. Celui-ci a été adopté en 2008 (150 ( * )) . La restructuration était attendue et constitue, indubitablement, une avancée pour la prise en charge d'usagers de drogues dont on a vu plus haut qu'ils étaient de plus en plus des polytoxicomanes, leur consommation de produits illicites s'accompagnant fréquemment de consommation d'alcool. Créer des structures dédiées au traitement de toutes les addictions est donc une démarche de rationalisation qui va dans le bon sens.
Le « paysage » de l'offre de prise en charge médico-sociale est, du fait de cette restructuration, diversifié et évolutif et l'obtention de données consolidées est parfois difficile. D'après les données communiquées par la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, on comptait, en 2009, près de 500 centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie - par addition des 270 centres de soins spécialisés aux toxicomanes et des 230 centres de cure ambulatoire en alcoologie. Comme l'indique la mission interministérielle, certaines de ces structures ayant fusionné, leur nombre réel pourrait être inférieur à 500. S'agissant des files actives, celle de l'ensemble des centres de soins spécialisés aux toxicomanes était évaluée, en 2008, à environ 112 000 patients, tandis que celle des centres de cure ambulatoire en alcoologie était estimée à 121 426. Ainsi, au total, le nombre de consultants de ces structures était d'environ 233 000 en 2008.
Malgré le nombre relativement important de centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, la plupart d'entre eux sont débordés de demandes et certains territoires, en particulier ruraux, en sont peu pourvus. Pourtant, la consommation de drogues et la demande d'accompagnement y sont bien présentes, comme il ressort des propos tenus par les représentants de l'association Familles rurales de France (151 ( * )) . M. Bernard Amiens, administrateur de l'ARAFDES, Institut de formation des cadres de l'action sociale, et maire d'Arbois dans le département du Jura, a quant à lui expliqué que le centre de soins habilité à prescrire de la méthadone le plus proche de sa commune en était distant de 35 kilomètres (152 ( * )) .
Certains départements ne disposent ainsi d'aucun centre de soins en addictologie médico-social ; c'est le cas du Cantal, où les toxicomanes ne peuvent se tourner que vers un service hospitalier psychiatrique ; il en est de même des départements de la Charente ou du Territoire de Belfort qui ne disposent, pour leur part, que d'une équipe hospitalière de liaison en addictologie.
Comme l'indique le Livre blanc de la Fédération française d'addictologie, dans de nombreux départements et territoires, des consultations d'addictologie hospitalières sont en effet considérées comme palliant l'absence de centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Ces derniers « sont intégrés à l'hôpital et ne sont parfois qu'une porte d'entrée et de suivi pour un service hospitalier, ne répondant pas à l'ensemble des missions du dispositif médico-social » (153 ( * )) . Car l'approche médicale ne peut suffire : tous les intervenants rencontrés par la mission d'information ont insisté sur la nécessité de proposer une prise en charge diversifiée et adaptée aux différents profils des usagers de drogues.
La situation actuelle ne peut donc être considérée comme satisfaisante : le toxicomane qui souhaite être pris en charge a besoin, en premier lieu, d'une offre de soins de proximité et d'un premier contact qui lui permettent de faire le point sur sa consommation et d'élaborer un projet de sortie de son addiction. Plus cette offre sera éloignée, moins la démarche, déjà difficile, de sortie de la dépendance sera envisageable et envisagée.
Il semble aujourd'hui nécessaire de renforcer la couverture du territoire par ces structures afin de parvenir à une couverture homogène des besoins et garantir ainsi une égalité d'accès aux soins. Vos rapporteurs sont conscients du fait qu'un effort financier important est déjà consenti en la matière ; en 2009, 243,6 millions d'euros y ont été consacrés. Mais cet effort doit être poursuivi et même renforcé ; l'immobilisme ne peut être une option face à l'enjeu de santé publique que constitue une prise en charge appropriée et accessible à tous.
? Les consultations pour jeunes consommateurs
Vos rapporteurs sont particulièrement préoccupés par la prévalence de la consommation de drogues, notamment de cannabis, parmi les jeunes - il n'est qu'à voir la sortie de certains collèges et lycées pour appréhender l'ampleur du phénomène. Ils considèrent que la prise en charge des jeunes devenus dépendants ou sur le point de le devenir doit être considérée comme un objectif prioritaire.
Des structures ont été mises en place à cet effet, en 2005, en application du plan gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l'alcool pour la période 2004-2008, selon un cadre régi par voie de circulaire (154 ( * )) . Ces « consultations pour jeunes consommateurs » ont pour mission d'offrir une prise en charge brève aux jeunes ayant un usage nocif de produits psychoactifs, de les accompagner ou leur proposer une orientation lorsque la situation le justifie, et d'offrir un accueil aux parents en difficulté du fait de la consommation de leurs enfants. Elles sont généralement assurées par les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou des services hospitaliers.
On compte aujourd'hui, selon M. Étienne Apaire, président de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (155 ( * )) , 300 structures de consultation destinées aux jeunes consommateurs. Leurs actions méritent d'être réexaminées pour ensuite être réorientées et renforcées car leurs résultats semblent, pour l'instant, plutôt décevants au vu des évaluations disponibles.
Selon une étude réalisée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies portant sur l'activité de ces « consultations pour jeunes consommateurs » sur la période courant entre 2004 et 2007 (156 ( * )) , on constate ainsi un léger tassement du nombre total de consultations par structure. Il semble que celui-ci soit dû en réalité à un recentrage du dispositif sur sa « clientèle-cible », à savoir les usagers de cannabis, qui formaient ainsi 80 % du public reçu en 2007. Les consultants peuvent aussi être des consommateurs de cocaïne (à 13 %), d'ecstasy (à 11 %) ou encore d'héroïne (pour 8 % d'entre eux). Ce point plutôt positif mérite toutefois d'être nuancé car la part des nouveaux consultants semble avoir considérablement baissé, ce qui traduit certes une bonne capacité à « fidéliser » les jeunes ayant fait le premier pas vers une consultation, mais aussi la faible attractivité du dispositif à l'égard des autres.
L'étude établit ainsi que la moitié des consultations reçoivent moins de dix consommateurs par mois. En outre, la moitié des consommateurs qui viennent en consultation sont adressés par la voie judiciaire, généralement à la suite d'une mesure alternative aux poursuites ; les recours spontanés ne concernent que 22 % d'entre eux. Les autres sont adressés par leur famille, un médecin, un professionnel de santé ou l'Éducation nationale.
On observe par ailleurs que les jeunes fréquentant ces consultations sont plus âgés que le public visé, puisque moins d'un sur cinq est mineur ; l'âge moyen des consommateurs est ainsi de 23,2 ans. Si le plus jeune a douze ans, le plus âgé en a soixante-deux, ce qui est loin d'en faire un « jeune consommateur » !
Malgré ces insuffisances, un abandon de ce dispositif ne paraît pas souhaitable. En effet, il obtient des résultats plutôt positifs. Parmi les consultants qui reviennent après une première consultation, la moitié d'entre eux déclarent avoir réduit leur consommation de cannabis dès le deuxième entretien, tandis que les autres l'ont stabilisée ; seuls 3 % pensent l'avoir augmentée. Le taux de réduction de la consommation est le plus élevé parmi les consultants qui viennent pour la troisième ou la quatrième fois : il est de 60 %, pour légèrement diminuer ensuite.
Ce dispositif obtient donc des résultats, certes parfois insuffisants mais qui sont néanmoins encourageants car ils montrent qu'il est possible de détourner la jeunesse des drogues tant qu'il est encore temps. Il convient de le consolider. Pour cela, il est sans doute nécessaire d'aménager les consultations pour jeunes consommateurs afin de les rendre plus attractives, et de mieux les faire connaître, par des campagnes de communication adaptées, tant auprès des jeunes que de leurs parents, pour accroître les recours spontanés et les demandes des familles .
3. Développer les passerelles entre les dispositifs de prise en charge
La diversité de l'offre de soins aux toxicomanes, en cours de recomposition, constitue certes un atout du dispositif français. Elle souffre néanmoins de certains déséquilibres. L'éparpillement des structures peut rendre difficile la mise en oeuvre d'une prise en charge continue qui permettra aux usagers de drogues de s'acheminer vers une rémission de long terme. De toute évidence, il est nécessaire de renforcer la collaboration entre les intervenants afin de garantir un parcours de soins continu aux toxicomanes.
a) Renforcer la collaboration entre les intervenants
? Impliquer encore davantage la médecine de ville et les pharmaciens d'officine en développant les réseaux ville-hôpital
Le premier point d'entrée dans le dispositif de soins est, tout naturellement, le médecin généraliste vers lequel peuvent se tourner non seulement les usagers de drogues en quête d'un traitement mais aussi les parents d'enfants dont la consommation de drogues devient préoccupante.
Or, l'implication des acteurs de la médecine générale dans le traitement des toxicomanies est inégale. Comme l'indique la Fédération française d'addictologie, certains, très engagés, deviennent des « spécialistes implicites » en addictologie - rappelons que les médecins généralistes peuvent prescrire, en première intention, de la buprénorphine haut dosage et prolonger la prescription de méthadone après initiation du traitement dans un centre de soins spécialisé.
Mais les patients toxicomanes constituent une patientèle particulière à l'égard de laquelle certains médecins se trouvent démunis et dont la prise en charge est délicate. Ainsi que l'a souligné M. Patrick Romestaing, président de la Section publique du Conseil national de l'ordre des médecins, « un médecin doit recevoir tout patient qui s'adresse à lui et ne peut opérer aucune discrimination. [...] Force est néanmoins de constater que ce sont presque toujours les mêmes praticiens qui, en empathie avec les toxicomanes, les prennent en charge. Certains confrères, en revanche, changent parfois de lieu d'exercice pour être moins confrontés à cette population particulièrement difficile à gérer » (157 ( * )) .
Cette situation est dommageable car aucun réseau en addictologie ne peut prétendre à un maillage du territoire aussi dense que celui de la médecine de ville. La prise en charge par des associations ou par des structures spécialisées, dont la qualité était soulignée par M. Patrick Romestaing, est évidemment indispensable ; encore faut-il que les toxicomanes soient orientés vers celles-ci à partir d'un premier diagnostic ou d'un repérage précoce des consommations à risques.
Le réseau de la médecine de premier recours constitue, à cet égard, un élément précieux pour assurer un suivi dans la durée et la proximité, ce qui est essentiel pour des populations qui ont besoin d'un accompagnement constant jusqu'à leur sortie de l'addiction. Il convient donc de valoriser l'activité des médecins généralistes dans le domaine de l'addictologie, au même titre que dans celui de la prévention, ce qui pourrait utilement être abordé dans le cadre des négociations conventionnelles en cours.
De la même manière, le rôle des pharmaciens d'officine est essentiel pour garantir un accompagnement continu des toxicomanes en cours de traitement et lutter contre les mésusages. Comme l'a indiqué Mme Isabelle Adenot, présidente du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, « les pharmaciens sont disponibles : on les trouve au coin de la rue, ce sont les seuls professionnels de santé qu'on peut solliciter sans prendre rendez-vous » (158 ( * )) . Leur contribution à la prise en charge des toxicomanies est donc tout à fait essentielle. On ne peut d'ailleurs que saluer la détermination dont fait preuve l'Ordre national des pharmaciens dans ce domaine.
On dispose ainsi de réseaux denses de professionnels de santé de premier recours, complétés par une offre de soins spécialisés diversifiée, bien qu'encore insuffisamment abondante. Ces atouts sont aujourd'hui trop peu exploités : comme l'a souligné la Fédération française d'addictologie, l'offre de soins en direction des toxicomanes est excessivement compartimentée entre hôpital, médecine de ville et secteur médico-social pour garantir leur prise en charge continue. Même si l'offre hospitalière en addictologie est en cours de progression, cela n'exonère pas d'un effort pour mieux l'articuler avec la médecine de ville.
En outre, ainsi que l'a observé Mme Annie Podeur, directrice générale de l'offre de soins (159 ( * )) , sur un total de 742 réseaux ville-hôpital, seulement 45 concernent les addictions. Ils sont en outre très inégalement répartis sur le territoire.
C'est pourquoi il semble nécessaire de développer encore plus la mise en réseau des professionnels en promouvant la démarche des réseaux ville-hôpital qui reposent sur la pluridisciplinarité .
? Renforcer la collaboration entre addictologie et psychiatrie
Les intervenants auprès de la mission d'information ont, pour la plupart, insisté sur le fait que les approches de traitement des dépendances variaient grandement selon les toxicomanes suivis. Ce point a notamment été soulevé par M. Alain Rigaud, président de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, qui a observé : « les toxicomanies - car il s'agit d'un phénomène pluriel - n'appellent pas une réponse univoque : s'il existait un traitement efficace à tous les coups, on le saurait depuis longtemps. Il y a des réponses de plusieurs ordres et ce qui est important, c'est de pouvoir conjuguer une large palette de méthodes selon les usages, les formes cliniques, les parcours des usagers, les produits, etc. » (160 ( * )) .
La multiplicité des réponses se traduit par un foisonnement des méthodes et des intervenants, comme l'a indiqué M. Michel Le Moal, psychiatre et professeur de neurosciences, qui a ainsi jugé que « tout ce qui touche à la drogue est un champ bourré de controverses, de camps, de clans, souvent d'ailleurs en raison de l'origine des acteurs. [ ... ] C'est un champ est extrêmement conflictuel » (161 ( * )) .
De toute évidence, addictologie et psychiatrie sont toutes deux sollicitées dans le traitement des toxicomanies, d'autant que certains toxicomanes peuvent présenter des comorbidités psychiatriques sévères, comme l'a indiqué à la mission d'information le docteur Xavier Laqueille, psychiatre et chef du service d'addictologie de Sainte-Anne. Ainsi, des traitements de substitution aux opiacés très encadrés peuvent être satisfaisants pour traiter des dépendants à l'héroïne et à ses dérivés, tandis que les dépendances à la cocaïne ou d'autres excitants sont plus difficilement traitées par la prescription de médicaments, généralement utilisés en dehors de leur autorisation de mise sur le marché, comme des régulateurs d'humeur ou certains anti-épileptiques. Dans ce cas, la prise en charge est souvent psychiatrique.
Or, d'après le Livre blanc de l'addictologie française, « la psychiatrie et l'addictologie ont des difficultés à travailler ensemble alors que ces deux disciplines sont concernées car une majorité de patients présente des troubles comorbides et nécessitent une double prise en charge, psychiatrique et addictologique » (162 ( * )) . Ces difficultés ont également été observées par Mme Annie Podeur, directrice générale de l'offre de soins (163 ( * )) , qui a relevé qu'existait effectivement un débat universitaire sur la question du traitement des toxicomanies.
Comme le propose la Fédération française d'addictologie, il convient de définir les missions et les modalités de collaboration de ces deux disciplines, en créant des équipes de liaison en addictologie dans chaque établissement psychiatrique et des capacités d'accueil ciblées pour les dépendants présentant des comorbidités psychiatriques importantes. L'hôpital Sainte-Anne a ainsi pour projet de créer une équipe mobile d'addictologie pour aider le personnel soignant à repérer les addictions et les traiter, et de mettre en place huit lits en addictologie pour les patients nécessitant les soins les plus lourds. Il convient de soutenir de telles initiatives car on compte, pour l'heure, bien plus de capacités d'accueil en addictologie somatique (traitements et sevrages) qu'en addictologie « psychiatrique ».
Vos rapporteurs estiment que cette démarche doit également concerner le milieu pénitentiaire, particulièrement touché par la problématique des usagers de drogues présentant des troubles psychiatriques.
? Mieux associer les familles et les instances de soutien au parcours de soins des toxicomanes
Les toxicomanies ont des conséquences lourdes non seulement pour les usagers de drogues mais aussi pour leur entourage. De nombreux représentants d'associations familiales auditionnés par la mission d'information ont pu témoigner de la profonde détresse qui touche les parents découvrant, souvent trop tardivement, que leur enfant est toxicomane. Alors qu'ils sont supposés être un point de stabilité et d'ancrage pour leur progéniture à la dérive, ils se sentent fréquemment démunis et isolés, culpabilisent et ne savent vers qui se tourner. Les associations de soutien jouent là un rôle essentiel en les aidant à surmonter cette épreuve.
Car ainsi que l'a indiqué Mme Marie-Françoise Camus, présidente de l'association Le Phare-Familles face à la drogue, « c'est grâce à la fermeté aimante de leurs parents que beaucoup s'en sortent. [ ... ] Nous ne pouvons pas décider à la place du jeune mais nous pouvons changer notre relation avec lui ; souvent, quand les jeunes constatent le bien que l'association fait à leurs parents, ils ont envie de nous connaître eux aussi » (164 ( * )) .
Les associations de soutien aux proches et aux familles mènent un travail tout à fait remarquable qui doit être reconnu à sa juste valeur et encouragé ; car au-delà de la réponse médicamenteuse ou psychiatrique, le toxicomane a également besoin de soutien, d'écoute et d'amour pour retrouver sa place et une stabilité affective. Vos rapporteurs soutiennent donc évidemment les propositions de la Fédération française de l'addiction qui appelle à encourager le développement des associations de parents et inscrire l'accueil des familles dans les missions des soignants et des centres de soins . Il est également nécessaire, comme le suggère la fédération, de reconnaître le rôle de ces associations en leur donnant une plus grande place dans les instances sanitaires, médico-sociales et administratives.
Cette démarche doit aussi concerner les associations de toxicomanes en traitement, telle l'Association française des dépendants en rétablissement, auditionnée par la mission d'information (165 ( * )) et qui milite fortement en la matière. Car comme ses représentants l'ont noté, la parole des usagers de drogues en rétablissement est primordiale pour élaborer la politique de lutte contre les toxicomanies. La prise en compte de leur expérience ne pourra que contribuer à améliorer l'offre de soins aux toxicomanes.
b) Garantir un parcours de soins continu à tous les toxicomanes et un suivi à la sortie
L'enjeu, en matière de traitement des toxicomanies, est non seulement d'appliquer un modèle thérapeutique adapté - on a vu que les approches étaient multiples - mais aussi de parvenir à un suivi continu du toxicomane en voie de rétablissement. Cela suppose une démarche de long terme, avec un véritable parcours de soins allant de l'entrée dans le traitement à la sortie effective de l'addiction. Or, le nombre insuffisant et l'éparpillement des structures de soins ainsi que l'absence d'un réel suivi en fin de traitement accroissent les risques de rechute.
Une réflexion doit être engagée pour se doter de structures intermédiaires permettant un accompagnement continu car l'addiction est, de l'avis de tous, une maladie dont on ne sort qu'après de longues années. Il s'agit là, à l'évidence, d'un « chaînon manquant » qui a été évoqué tant par le docteur Xavier Emmanuelli, président et fondateur du Samu-social, que par le père de Parcevaux, chargé de mission par l'archevêché de Paris sur la problématique des toxicomanies (166 ( * )) .
? Accompagner les toxicomanes les plus vulnérables
Le dispositif de soins actuel, bien que très diversifié, se révèle insuffisant pour traiter les plus fragiles. Vos rapporteurs sont particulièrement préoccupés concernant les jeunes dépendants. Certes, les « consultations pour jeunes consommateurs » leur permettent de faire le point sur leur consommation et les orientent vers des structures de soins. Mais l'offre de soins proprement dite est très largement insuffisante. Ainsi que le soulignait Mme Martine Lacoste, secrétaire générale du centre d'information régional sur les drogues et les dépendances de Midi-Pyrénées (167 ( * )) , on déplore un manque cruel de services consacrés aux jeunes mineurs en situation d'addiction puisqu'on n'en compte que deux en France.
Il faut absolument consentir un effort soutenu pour se doter de dispositifs adaptés car on ne peut, en matière de toxicomanie des jeunes, tolérer le défaitisme. Il convient ainsi de soutenir des expériences telle celle conduite par le père de Parcevaux qui a créé une structure permettant à de jeunes consommateurs de drogues, souhaitant « se poser » dans un lieu neutre, de se retirer du milieu familial et médical et passer un court séjour dans un lieu de vie sans médicament, ni psychiatre ni psychologue.
Se pose également la question du suivi de leur traitement par les personnes sortant de prison. Il est extrêmement préoccupant de constater que des détenus qui ont réussi à « décrocher » de la toxicomanie lors de leur détention ne font que trop rarement l'objet, à leur sortie du milieu carcéral, d'un accompagnement pour les soutenir dans leur démarche, faute de « point de chute ». Certes, des places existent dans des structures de soins résidentiels, comme par exemple le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie Pierre Nicole que la mission d'information a visité ; mais, comme on l'a vu plus haut, nous manquons encore de telles structures d'hébergement. Cela étant, ce problème s'inscrit dans la problématique, plus vaste, des carences de la préparation de la sortie des détenus qu'il n'appartenait pas à la mission d'information d'analyser.
Une autre catégorie de toxicomanes particulièrement fragiles est celle des femmes isolées, dépourvues de ressources et de logement stables et vivant dans des conditions extrêmement précaires. Il leur est difficile de trouver des places dans des structures de soins accueillant également leurs jeunes enfants ; comme pour les jeunes toxicomanes, il convient de renforcer les efforts pour créer des lieux d'accueil adaptés qui leur permettent de suivre un traitement tout en préservant la cellule familiale.
Vos rapporteurs sont également sensibles aux propos de M. François Hervé, responsable de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (168 ( * )) , qui a insisté sur la nécessité de tenir compte des usagers de drogues vieillissants pour qui « il est extrêmement difficile de [...] trouver des dispositifs d'accueil. Ils n'ont pas accès aux maisons de retraite, ni à un certain nombre de dispositifs classiques. Ils sont parfois extrêmement fatigués du fait de leur vie passée, et très marqués. Leur vieillissement est souvent prématuré. Il est nécessaire de réfléchir à des dispositifs d'accueil de ces personnes ».
Ce constat problématique rejoint celui dressé par une récente étude de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (169 ( * )) qui note une nette tendance au vieillissement des usagers de drogues accueillis dans les centres spécialisés, où la part de toxicomanes âgés de plus de quarante ans est passée de moins de 4 % à plus de 21 % entre 1993 et 2008. Ce vieillissement constitue un défi : de toute évidence, une réflexion doit être engagée pour définir quelles seraient les structures les mieux adaptées à ce public très particulier, souvent désinséré et dont l'entrée dans le troisième âge, avec l'ensemble des problèmes qui y sont associés, va appeler de nouvelles solutions.
Enfin, vos rapporteurs s'alarment de la situation des toxicomanes sans domicile fixe dont l'étude dénommée « Samenta », menée par le Samu-social de Paris, montre qu'ils sont davantage touchés par les addictions et les troubles psychiatriques que la population générale. Or, comme l'a déploré le docteur Xavier Emmanuelli, président et fondateur du Samu-social, « il n'y a pas de filière, pas d'aval [...] Chaque quartier ou chaque petite ville devrait pouvoir disposer de quinze à vingt lits. Ce serait un immense effort, pas si cher que cela » (170 ( * )) . Vos rapporteurs rejoignent cette analyse : le traitement des plus vulnérables nécessite, en premier lieu, de se doter de capacités d'hébergement adéquates pour pouvoir envisager un réel accompagnement et un traitement.
? Assurer un suivi à la sortie du traitement
Si l'entrée des toxicomanes dans le système de soins constitue un premier défi, leur suivi en fin de traitement est tout aussi primordial. Les divers intervenants auprès de la mission d'information ont tous fait état du risque de rechute, la sortie de l'addiction n'étant qu'une rémission de plus ou moins longue durée. L'accompagnement après le sevrage et le maintien dans l'abstinence sont tout aussi difficiles que la prise de décision d'arrêter de consommer des produits stupéfiants. Or, vos rapporteurs ont pu constater qu'une fois le traitement achevé ou interrompu, trop souvent, les anciens toxicomanes ne sont pas suivis sur le long terme. On observe ainsi que peu d'établissements de soins pour toxicomanes disposent de statistiques leur permettant de connaître le devenir des personnes qu'ils ont accueillies et leur réel « taux de réussite ».
Des structures visent pourtant à accompagner les anciens usagers de drogues une fois leur traitement ou leur sevrage achevé ; il convient de multiplier les initiatives en la matière pour leur apporter un soutien dans le maintien de l'abstinence.
Diverses démarches sont possibles. Vos rapporteurs ont pu assister à une réunion de l'association Narcotiques Anonymes qui repose sur l'écoute et le soutien des pairs en appliquant le modèle thérapeutique dit « Minnesota », jalonné de douze étapes visant à parvenir à une abstinence prolongée. Les « partages de parole » décrivent ainsi la prise de conscience de l'état de dépendance, la rechute, la difficulté du maintien dans l'abstinence ou la fierté de la réussite. De telles approches ne sont probablement pas adaptées à tous les anciens usagers de drogues ; elles semblent néanmoins constituer une aide précieuse pour les anciens toxicomanes qui se définissent toujours, même après de très nombreuses années d'abstinence, comme des dépendants.
D'autres initiatives originales méritent d'être soutenues, telle celle décrite par le docteur Xavier Laqueille, chef du service d'addictologie de l'hôpital Sainte-Anne, qui a fait état de l'expérience conduite par l'association Ligne de vie, fondée par M. Michel Platini et désormais hébergée par l'hôpital. Cette association propose une centaine d'emplois aidés à d'anciens toxicomanes, sur la base d'une convention conclue avec la mairie de Paris, pour une durée de deux à cinq ans. Elle a proposé, depuis cinq ans, trois cent soixante emplois. Les anciens usagers de drogues bénéficient ainsi non seulement d'une réinsertion sociale et professionnelle, mais aussi d'un véritable suivi puisqu'en cas de comportement problématique, le service d'addictologie de l'hôpital Sainte-Anne est contacté pour reprendre les soins dans le cadre d'un arrêt de travail. Cette expérience, très positive, mériterait sans nul doute d'être diffusée et reproduite à plus grande échelle.
4. Mieux connaître pour mieux soigner
Les addictions ne sont pas un phénomène nouveau. Pourtant, le corps médical semble parfois démuni pour les prendre en charge et même, dans certains cas, pour les repérer.
a) Renforcer la formation en addictologie des professionnels de santé
Ainsi que l'a souligné le professeur Michel Le Moal (171 ( * )) , l'addictologie est, en France, apparue relativement récemment, avec quinze ans de retard sur les États-Unis. Cette discipline étant récente, elle est relativement ignorée des personnels de santé qui se trouvent, de ce fait, moins bien armés pour prendre en charge les dépendants.
Ce point a été souligné par de nombreux intervenants auprès de la mission d'information. Ainsi en a-t-il été du docteur Jean-Pierre Daulouède, psychiatre addictologue, responsable de mission Réduction des risques à Médecins du Monde, que la mission d'information a pu rencontrer lors d'un déplacement à Bordeaux. Le docteur Patrick Romestaing a lui aussi jugé que « la formation initiale des médecins déjà en activité, en matière de toxicomanies comme de santé publique en général, [était] indigente. Quant à la formation continue sur le sujet, elle concerne surtout les praticiens qui, de par leur lieu d'exercice ou leurs relations professionnelles, ont été amenés à prendre en charge des patients toxicomanes et s'intéressent à cette patientèle particulière » (172 ( * )) . Mme Annie Podeur, directrice générale de l'offre de soins, a pour sa part insisté sur la nécessité d'offrir des formations pluridisciplinaires dans le champ du développement professionnel continu pour parvenir à une diffusion des bonnes pratiques allant du dépistage précoce au suivi postérieur au sevrage, en passant par l'accompagnement et le traitement lui-même (173 ( * )) .
Le constat du besoin en une formation adéquate pour prendre en charge les usagers de drogues a également été mis en évidence par Mme Isabelle Adenot, présidente du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui a estimé que « pour commencer, il faudrait une sensibilisation plus poussée au cours des études et un effort supplémentaire de formation. Mais en matière de toxicomanie, les choses évoluent terriblement vite. Une formation presque récente peut ne plus être valable. Il faut donc des formations très organisées pour les confrères qui le souhaitent ou qui sont confrontés aux toxicomanies, en liaison avec tous les réseaux, associations, instituts de formation et partenariats » (2) .
Certes, des efforts ont été accomplis, notamment dans le cadre du plan de prise en charge et de prévention des addictions pour la période 2007-2011 qui prévoyait la création d'une filière d'addictologie grâce à la constitution de pôles d'addictologie dans les centres hospitalo-universitaires. La discipline d'addictologie a par ailleurs été créée, par arrêté, sous forme d'option inscrite dans sept sous-sections de la filière de formation médicale universitaire (174 ( * )) . Le plan prévoyait également l'acquisition de compétences en addictologie dans le cadre de la formation médicale continue, en particulier pour les médecins généralistes, les médecins scolaires et les médecins du travail.
Mais les objectifs fixés n'ont été que partiellement atteints. Seule une quinzaine de centres hospitaliers universitaires a une activité d'enseignement et de recherche en addictologie. Cette situation n'est pas dépourvue de conséquences car, comme l'a observé le professeur Michel Reynaud (175 ( * )) , faute de formations cohérentes, la prise en charge peut ne pas reposer sur les meilleures stratégies validées. Il semble donc aujourd'hui nécessaire de mener une action volontariste pour améliorer la formation initiale et continue des médecins en addictologie , et ainsi le repérage précoce et le traitement des addictions, en poursuivant la structuration de la filière universitaire dans cette discipline.
b) Développer la recherche en matière de traitement des toxicomanies
Vos rapporteurs ont eu le sentiment, au fil des auditions, que le corps médical était parfois démuni pour traiter certaines dépendances en raison d'un manque de connaissances sur les mécanismes qui sont à l'oeuvre. De toute évidence, la réponse médicamenteuse a des limites : elle existe pour traiter la dépendance au tabac ou aux opiacés, grâce aux traitements de substitution, mais elle peine à traiter les dépendants à d'autres substances. C'est notamment le cas de l'addiction à la cocaïne dont la consommation, une fois arrêtée, donne lieu au « craving », état de manque psychologique qui conduit l'usager à chercher compulsivement à renouveler la prise de produit. Des médicaments peuvent être prescrits pour calmer cet état, mais leur efficacité reste partielle.
Il convient donc de poursuivre la recherche en matière de traitement des toxicomanies . Certains sont, sur ce point, extrêmement pessimistes, tel le professeur Michel Le Moal, qui s'est écrié devant la mission d'information : « je récuse totalement cette forme de béatitude médiocre de l'ensemble des neurosciences qui prétendent que l'on pourra régler l'ensemble des problèmes de la psychiatrie à partir des connaissances sur le cerveau [ ... ] À chaque décennie, on a pensé avoir trouvé la solution, qu'il s'agisse des neurotransmetteurs, des récepteurs ou de la transition cellulaire... En l'état actuel, il n'existe pas de médicament » (176 ( * )) .
Cette analyse, particulièrement sombre, semble partiellement fondée, dans le sens où les traitements de substitution aux opiacés constituent, aujourd'hui, le seul traitement médicamenteux disponible, ce qui laisse de côté bon nombre d'autres addictions. Mais ne peut-on espérer que des découvertes changent la donne ? Vos rapporteurs ont ainsi eu l'impression, au fil des auditions menées, que la recherche en épigénétique pouvait ouvrir des voies prometteuses pour expliquer le mécanisme des addictions. Ils ne prétendent pas définir ce que devraient être les programmes de recherche en addictologie, mais ont le sentiment que le champ reste largement ouvert et que des avancées sont encore possibles.
*
* *
L'offre de soins aux toxicomanes, certes en cours de recomposition, est donc diversifiée mais souffre de déséquilibres et d'insuffisances. Vos rapporteurs ne peuvent qu'appeler à renforcer les efforts dans ce domaine et espèrent que le futur plan gouvernemental de prévention et de lutte contre les addictions saura y accorder les moyens financiers nécessaires - qui devront être conséquents.
Pour autant, si la sortie des usagers de drogues de leur dépendance doit constituer une priorité, on ne peut ignorer tous ceux qui ont sombré dans l'addiction et n'envisagent pas encore une entrée dans le traitement. C'est ici qu'intervient la politique de réduction des risques, dont vos rapporteurs souhaitent qu'elle soit poursuivie selon une approche équilibrée et responsable.
C. POURSUIVRE UNE POLITIQUE DE RÉDUCTION DES RISQUES ÉQUILIBRÉE ET RESPONSABLE
La politique de réduction des risques vise à minimiser les risques encourus par les usagers de drogues et en particulier celui d'infections liées aux injections de produits. Résultant d'initiatives de terrain pour faire face aux problèmes liés à la consommation de drogues à la fin des années 1980, elle est désormais consacrée par la loi.
1. L'implication de multiples acteurs
a) Une démarche pragmatique progressivement reconnue
Comme l'indique l'expertise collective menée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) (177 ( * )) , jusque dans les années 1980, la politique de la France en matière de lutte contre les toxicomanies s'est fondée sur l'abstinence, considérée comme un pilier de la stratégie sanitaire. Les conceptions ont changé face à l'ampleur alarmante de la diffusion de maladies infectieuses parmi les usagers de drogues, en particulier du syndrome d'immunodéficience acquise qui a causé d'énormes dégâts dans la communauté des usagers de drogues.
Il est alors apparu urgent de traiter ce problème de santé publique. Cela a nécessité un véritable bouleversement culturel puisqu'on a dû, pour sauver des vies humaines, se résoudre à « faire avec » l'usage de produits illicites et accepter que la population concernée ne soit pas, en premier lieu, orientée vers un traitement visant le sevrage et l'abstinence.
Plusieurs étapes ont conduit à l'actuelle politique de réduction des risques. La première d'entre elles a été la publication, en 1987, du décret pris sur le rapport de Mme Michèle Barzach, ministre de la santé, autorisant temporairement la vente libre de seringues en pharmacie (178 ( * )) . Cette initiative fondatrice a été suivie d'autres qui ont permis, progressivement, de structurer le domaine de la réduction des risques : expérimentation des programmes d'échanges de seringues en 1990 ; prescription de traitements de substitution aux opiacés - méthadone en 1995 et buprénorphine haut dosage en 1996 -, reconnaissance du concept de réduction des risques par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 puis par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, ou encore mise en place de structures spécifiques de réduction des risques pour usagers de drogues (179 ( * )) .
Suite à ces diverses initiatives, la politique de réduction des risques est désormais définie, en application de l'article L. 3121-4 du code de la santé publique, comme visant à « prévenir la transmission des infections, la mortalité par surdose par injection de drogue intraveineuse et les dommages sociaux et psychologiques liés à la toxicomanie par des substances classées comme stupéfiants ». Elle est caractérisée par une multiplicité d'intervenants de terrain, tous très engagés et actifs dans le domaine des toxicomanies.
b) De multiples intervenants aux actions diverses mais encadrées
Les actions de réduction des risques en direction des usagers de drogues ont le plus souvent été initiées par le secteur associatif. Sont évidemment impliquées de grandes associations de lutte contre les maladies infectieuses, telles Aides, SOS-Hépatites, Sidaction ou Act-Up, mais aussi des organisations comme Médecins du Monde ou SOS-Drogue International, des associations résultant d'initiatives locales, dans lesquelles sont impliqués des personnels soignants, comme Gaïa Paris ou Espoir Goutte d'Or, ou encore des associations dites « d'auto-support » des usagers de drogues, comme Asud, qui toutes ont été entendues par la mission d'information.
Le paysage de la réduction des risques est aujourd'hui très hétérogène et varié. Les intervenants sont aujourd'hui multiples : ils vont de l'officine de pharmacie et du médecin de ville à l'établissement médico-social, en passant par des associations dites « de première ligne » qui n'ont pas toutes souhaité rejoindre le dispositif médico-social, considéré par certaines comme trop contraignant ou inadapté aux actions qu'elles mènent, en milieu festif par exemple.
La multiplicité des intervenants ne doit cependant pas laisser penser que le secteur de la réduction des risques serait celui d'une expérimentation permanente. Il recouvre des actions en réalité structurées et désormais encadrées, notamment en raison de la mise en place des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, établissements médico-sociaux qui peuvent être gérés par des associations ou des établissements de santé. On en comptait, en avril 2010, 133, qui doivent en outre répondre aux conditions fixées par le référentiel national des actions de réduction des risques datant de 2005 (180 ( * )) .
Les modalités d'intervention de ces centres, si elles ont résulté d'initiatives souvent associatives et informelles, sont aujourd'hui relativement homogènes. Les diverses actions qu'ils peuvent mener sont en effet limitativement énumérées par l'article R. 3121-33-1 du code de la santé publique.
En pratique, ainsi que l'a indiqué l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (181 ( * )) , plus de neuf de ces structures sur dix proposent un espace d'accueil et de repos, une mise à disposition de boisson et nourriture et un accès téléphonique ou à internet ; plus d'un centre sur deux propose également un espace laverie et sanitaire. Mais un très grand nombre d'entre eux - près d'un centre sur deux - développe aussi des interventions mobiles « hors les murs », en espace festif notamment, ce qui leur permet d'entrer en contact avec des personnes ne fréquentant pas les structures spécialisées. D'après l'observatoire, on pouvait également noter, en 2008, le développement de programmes d'intervention en milieu pénitentiaire, assurés par trente-deux centres.
Les actes réalisés par les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues sont d'abord l'écoute, qui revêt des formes très variées - accueil dans la structure fixe, visite, échange dans la rue ou autour d'un stand de promotion des risques en milieu festif, par exemple -, et représentait 575 000 contacts en 2008. Au-delà du soutien et du réconfort qu'ils procurent aux usagers de drogues, ces contacts sont aussi l'occasion de mener des actions d'information sur les comportements les moins risqués et d'éducation à la santé.
Les centres jouent également un rôle important en matière de mise à disposition et de récupération de matériel de prévention. Selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, ils ont distribué plus de 3,8 millions de seringues en 2008, soit par le biais d'automates, soit en délivrant directement des trousses ou des seringues à l'unité. Mais sont également diffusés des tampons alcoolisés, des flacons d'eau, des filtres ou des cupules stériles ou, dans une moindre mesure, du matériel pour fumer ou inhaler des produits comme la cocaïne, l'héroïne ou le crack .
Suivent les soins médicaux et infirmiers, au nombre d'environ 101 000 actes la même année, et qui recouvrent non seulement des soins de première nécessité mais aussi des actes de dépistage, de vaccination et de traitement contre les maladies infectieuses. Enfin, dans une très moindre proportion, les centres mènent des actions en matière d'accès aux droits, de logement et d'hébergement des usagers de drogues ainsi que de réinsertion professionnelle.
La politique de réduction des risques repose également sur un autre pilier, celui des traitements de substitution aux opiacés, c'est-à-dire la méthadone et la buprénorphine haut dosage, dérivés d'opiacés pouvant être prescrits par un médecin et délivrés par les officines de pharmacie. Ces traitements permettent d'éviter, chez les personnes dépendantes, le symptôme de manque, en présentant de moindres risques sanitaires que l'héroïne (les risques de surdoses sont amoindris). Ils n'ont pas, non plus, les mêmes effets psychoactifs que celle-ci. Leur prescription et leur délivrance par les intervenants du système de soins permettent en outre aux dépendants aux opiacés de ne plus centrer toute leur vie autour de la recherche et de la prise du produit, ce qui doit leur permettre d'atteindre, à terme, une stabilisation psychosociale et faciliter leur retour à une vie « normale ».
Le secteur de la réduction des risques se caractérise donc par des initiatives multiples, progressivement structurées dans le champ médico-social. Cette diversité ne doit pas cacher l'unité de la démarche poursuivie qui consiste, prioritairement, à améliorer l'état de santé des usagers de drogues, considéré comme un enjeu de santé publique. Sur ce point, le constat est celui d'avancées encourageantes.
2. Une avancée pour la santé publique
Les diverses actions de réduction des risques ont, indéniablement, eu un impact positif en matière de santé publique. Comme l'a indiqué M. Serge Longère, président de l'Association française pour la réduction des risques, « la création des [centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues] a permis à plusieurs associations de poursuivre leurs actions de façon pérenne auprès des usagers de drogues. Grâce à ce cadre institutionnel, les usagers de drogues en rupture avec le droit commun ont eu accès à une prise en charge plus globale - échange de seringues dans le cadre de pratiques à moindres risques, meilleures conditions d'hygiène ou prise en charge sociale » (182 ( * )) .
En effet, non seulement les actions de réduction des risques ont amélioré la situation sanitaire des usagers de drogues, mais elles ont aussi offert aux plus précaires une porte d'entrée dans le système de soins.
a) L'amélioration de la situation sanitaire des usagers de drogues
? Des résultats encourageants en matière de transmission de certaines maladies contagieuses
La politique de réduction des risques a eu des résultats remarquables s'agissant de la diffusion du virus de l'immunodéficience humaine parmi les usagers de drogues. Le taux de prévalence de ce virus chez les toxicomanes fréquentant les services médico-sociaux spécialisés est ainsi passé de près de 25 % en 1994 à moins de 10 % aujourd'hui. On mesure les progrès réalisés : alors qu'en 1993 on estimait à 1 495 nouveaux cas le nombre de personnes infectées par le virus en raison de l'injection de drogues, celui-ci est descendu à 51 nouveaux cas en 2008. Les nouvelles contaminations sont donc de plus en plus rares.
L'épidémie de virus de l'hépatite C, pour sa part, reste stable à un haut niveau chez les usagers de drogues, avec un taux de prévalence voisin de 50 %. Ce taux avait connu une hausse sensible à plus de 60 % à la fin de l'année 2000 ; il a ensuite un peu fléchi. Si l'on se restreint aux seuls usagers de drogues injecteurs, le taux de prévalence du virus serait chez eux de l'ordre de 60 % ; il semble néanmoins légèrement régresser depuis le début des années 2000. Cette évolution favorable pourrait s'expliquer par l'impact des mesures de santé publique prises et des évolutions des pratiques des usagers de drogues (183 ( * )) .
La situation n'en demeure pas moins très préoccupante : comme on l'a vu plus haut, le caractère très infectieux du virus de l'hépatite C rend son endiguement difficile. Les pratiques de distribution de matériel d'injection stérile constituent une avancée, mais elles ne semblent pas suffire pour lutter efficacement contre le virus. Il est donc positif de constater une accessibilité croissante du traitement antiviral, puisqu'en 2008, selon l'expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, 70,5 % des usagers des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues se déclarant séropositifs au virus de l'hépatite C avaient consulté pour cette pathologie, et 28 %, soit 5,5 % de plus qu'en 2006, étaient sous traitement (2) .
? Une diminution du nombre de surdoses mortelles
La politique de réduction des risques a permis d'enregistrer une diminution notable du nombre de surdoses mortelles parmi les usagers de drogues, en raison notamment de la grande diffusion des traitements de substitution aux opiacés. Après le pic atteint au milieu des années 1990, où l'on comptait plus de 500 décès par surdose, ce nombre a ainsi rapidement chuté jusqu'en 1998 pour s'établir à environ 200.
Toutefois, la tendance actuelle semble être à une remontée du nombre de surdoses mortelles depuis la deuxième moitié des années 2000. Celle-ci pourrait, selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (184 ( * )) , être imputable à divers facteurs. Le premier serait l'apparition de nouveaux usagers, jeunes et peu connus des centres de soins dont le peu d'expérience et la méconnaissance des substances et de leurs modes de consommation se traduiraient par des conduites plus risquées. L'usage croissant de la cocaïne et autres stimulants depuis le début des années 2000 et la disponibilité accrue de l'héroïne pourraient être une autre explication. Les avancées enregistrées grâce à la politique de réduction des risques ne doivent donc pas être tenues pour acquises, d'autant, comme on le verra plus loin (185 ( * )) , qu'on enregistre un nombre alarmant de décès liés à la prise de méthadone, qui constitue un élément important de cette politique.
b) Une porte d'accès aux soins pour les plus précaires
Le nombre de toxicomanes accueillis par les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues varie entre 48 000 en 2007 selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et près de 56 000 en 2008 selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. D'après ce dernier, la même année, plus de 575 000 contacts avaient été réalisés par les équipes des centres.
Comme le montre une récente étude de l'activité des centres d'accueil (186 ( * )) , ceux-ci sont fréquentés par des populations qui présentent une vulnérabilité sociale importante. En 2008, près de la moitié de leurs usagers n'avaient pas de logement stable et étaient sans domicile fixe, vivaient en « squat » ou ne disposaient que d'un logement provisoire. Plus de la moitié (51,7 %) percevaient un revenu social - revenu minimum d'insertion ou allocation aux adultes handicapés. Un quart des usagers ne disposaient d'aucun revenu licite et vivaient de la mendicité, de ressources illégales ou de la prostitution. Seuls 1,1 % étaient aidés par la famille ou des tiers. Enfin, 17,4 % des personnes accueillies dans les centres avaient connu un épisode d'incarcération dans l'année. Le public aidé par ces centres vit donc, majoritairement, dans des conditions matérielles très précaires.
Les liens noués par les structures de réduction des risques avec le système de soins sont donc un grand avantage et permettent à celles-ci de jouer le rôle de porte d'entrée dans le système de soins.
Par exemple, le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues « First » de Villepinte, visité par la mission d'information, a conclu une convention avec l'hôpital Robert Ballanger, qu'il jouxte, ainsi qu'avec trois centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Il a également conclu un protocole de dépistage des maladies infectieuses avec le laboratoire d'analyse médicale de l'hôpital et travaille en liaison avec son service de psychiatrie, ce qui permet aux usagers le fréquentant d'avoir un accès facilité aux traitements de substitution aux opiacés, à des consultations en addictologie ou à des soins en médecine ambulatoire.
De telles initiatives sont tout à fait positives et méritent d'être largement promues et diffusées. Des partenariats entre centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et structures de soins spécialisées, comme des services hospitaliers d'addictologie ou de psychiatrie ou des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, sont une démarche qu'il convient de généraliser.
Les structures de réduction des risques ont donc contribué à améliorer la santé des usagers de drogues et, partant, la santé publique. Pour autant, la situation sanitaire des toxicomanes reste très largement dégradée. Ce constat milite en faveur du renforcement de certaines actions, dans une démarche équilibrée et responsable.
2. Des défis à relever
a) Poursuivre une diffusion responsable des outils de réduction des risques
? S'adapter aux profils des toxicomanes et à leurs pratiques
Un des aspects majeurs de la politique de réduction des risques chez les usagers de drogues consiste en la distribution et l'échange de matériel destiné à la consommation de drogues pour lutter contre la contamination par les maladies virales. Il s'agit pour l'essentiel de seringues, dont 13,8 millions ont été diffusées en 2008, d'après l'Observatoire français de drogues et des toxicomanies : ont été vendues ou distribuées en pharmacies 4,3 millions de seringues à l'unité et 5,2 millions sous forme de Stéribox, 2,3 millions à l'unité et un million en Stéribox dans les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues et enfin un million par des automates. La France se situe ainsi au troisième rang européen en termes d'accès au matériel d'injection, après la Norvège et le Luxembourg, en distribuant environ 170 seringues par an et par usager de drogues par voie intraveineuse, selon l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.
Ce constat est évidemment tout à fait positif, mais ne doit pas faire oublier que des contaminations surviennent aussi chez des usagers de drogues déclarant n'avoir jamais eu recours à l'injection. Comme cela est souligné par l'expertise collective de l'INSERM, de nombreuses études montrent des taux de prévalence du virus de l'hépatite C chez les consommateurs de drogues non injectables très supérieurs à ceux de la population générale. Cela est notamment lié au partage du matériel de consommation, comme les pailles utilisées pour consommer par voie nasale les produits se présentant sous forme de poudre.
La distribution de matériel devrait donc concerner, aussi, les usagers de drogues non injecteurs dont la vulnérabilité ne doit pas être sous-estimée . Ce point a d'ailleurs été souligné par le personnel du centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques « First » de Villepinte. Une diversification des matériels distribués constitue donc un axe d'amélioration de la réduction des risques.
? Améliorer la situation en milieu carcéral en promouvant des programmes d'échange de seringues
La prison est, comme l'a souligné le Dr André-Jean Rémy (187 ( * )) , membre du groupe d'experts de l'INSERM ayant étudié la réduction des risques chez les usagers de drogues, un lieu de contamination virale. On a déjà indiqué que le risque d'y être contaminé par le virus de l'hépatite C était dix fois supérieur à celui encouru en milieu libre, et le risque de transmission du virus de l'hépatite B y est multiplié par quatre.
Cette situation sanitaire très préoccupante est largement liée à la diffusion, en milieu carcéral, d'un grand nombre de pratiques à risques qui sont souvent passées sous silence, la consommation de drogues en milieu pénitentiaire constituant un sujet que l'on s'efforce, en règle générale, d'éviter - la consommation de drogues étant illicite, elle ne pourrait exister en prison.
Les constats du docteur André-Jean Rémy rappelés plus haut tranchent évidemment avec les propos tenus à la mission d'information par M. Paul Louchouarn, directeur de l'établissement pénitentiaire de Fleury-Mérogis (188 ( * )) , qui a déclaré ne pas avoir connaissance de présence de seringues dans son établissement - hormis celles réservées aux détenus diabétiques suivant un traitement à l'insuline - et a considéré que le risque de contamination par le partage de seringues n'était pas réellement un sujet. Vos rapporteurs ne doutent pas de la bonne foi de ce témoignage ; mais le décalage existant entre ce dernier et les données transmises par les unités de consultations et de soins ambulatoires les laisse à penser que la réalité de la toxicomanie en prison est peut-être imparfaitement perçue par l'administration pénitentiaire.
Même si les injections et autres pratiques peuvent être moins fréquentes en prison qu'à l'extérieur, elles présentent davantage de risques. Les partages de matériel conduisent, hélas, à de trop nombreuses contaminations. Face à cette situation, peu a été fait. Le docteur André-Jean Rémy a même jugé que « la réduction des risques s' [était] arrêtée aux portes des prisons ».
Les initiatives en la matière sont en effet peu nombreuses. Il est possible d'initier une primo-prescription de méthadone ou de buprénorphine haut dosage en milieu pénitentiaire, mais des réticences existent. Elles peuvent être liées à la contradiction perçue entre la mission de l'institution pénitentiaire et la prescription de traitements psychoactifs susceptibles de faire l'objet de trafics ou de mésusages. Il est vrai aussi que certains séjours brefs en milieu carcéral se prêtent mal à l'initiation d'un traitement au long cours.
D'autres actions de réduction des risques ont également été menées en direction des usagers de drogues incarcérés, comme la distribution d'eau de javel titrée à 12 degrés, supposée désinfecter le matériel d'injection. Mais son efficacité en la matière est plus que douteuse, surtout concernant le virus de l'hépatite C. En outre, cette eau de javel est parfois insuffisamment titrée.
Les mesures actuelles ne suffisent pas, à l'évidence, pour infléchir les pratiques à risques des détenus usagers de drogues et avoir un impact positif sur leur état de santé. Il est sans doute temps de se doter d'outils de réduction des risques plus efficaces, comme des programmes visant à échanger du matériel d'injection, dont la littérature scientifique démontre amplement l'utilité sur un plan de santé publique.
On comprend qu'il soit difficile à l'institution pénitentiaire d'admettre que se déroulent en ses murs des pratiques illégales et qu'il lui faudrait mener des actions visant non pas à les éradiquer mais à en réduire les conséquences néfastes. Mais passer sous silence la consommation de drogues en milieu carcéral n'est pas une bonne solution : ce n'est pas parce qu'on détourne le regard que le phénomène disparaît. La lutte contre les trafics doit bien sûr être poursuivie, mais elle a ses limites. Comme l'a souligné M. Paul Louchouarn, directeur de l'établissement pénitentiaire de Fleury-Mérogis, la sévérité des sanctions encourues peut conduire les détenus les plus vulnérables à être réticents à s'engager dans des trafics, ce qui peut donner lieu à des comportements d'ultra-violence à leur égard de la part des « chefs » des réseaux.
Vos rapporteurs comprennent la difficile situation dans laquelle sont placés non seulement l'institution pénitentiaire mais aussi ses personnels. Pour autant, après mûre réflexion, ils estiment que la situation sanitaire des détenus impose d'agir. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur des pratiques illicites ou de les approuver implicitement, mais bien de prendre en compte un impératif de santé publique. Il s'agit aussi d'assurer un égal accès des détenus et des personnes libres aux dispositifs de santé publique, dont font partie les programmes d'échange de seringues.
Comme l'a fort justement souligné le Conseil national du SIDA dans son avis du 10 septembre 2009 (189 ( * )) , « le dispositif de [réduction des risques] devrait bénéficier à l'ensemble de la population, y compris aux personnes détenues [...] Les impératifs légitimes de sécurité au sein des établissements pénitentiaires et la pénalisation de l'usage des stupéfiants ne doivent pas constituer des obstacles à l'expérimentation des outils les plus efficaces de la [réduction des risques] . La peine d'emprisonnement demeure une peine de privation de liberté, non pas de privation de soins et de prévention ».
Vos rapporteurs partagent cette position et appellent donc à ce que soient mis en oeuvre des programmes d'échange de seringues en milieu carcéral, en insistant sur le fait qu'il s'agit bien d'échange et non de distribution : le but est aussi de pouvoir contrôler la délivrance et le stockage du matériel d'injection. Il serait souhaitable que ces programmes soient gérés par les unités de consultations et de soins ambulatoires, dans un souci de confidentialité et de respect du secret médical.
La distribution responsable de matériel d'injection constitue, pour vos rapporteurs, un élément important pour améliorer l'efficacité de la politique de réduction des risques. Il est nécessaire d'engager la réduction des risques et notamment une réflexion sur les traitements de substitution aux opiacés, qui constituent certes un autre pilier de cette politique, mais dont l'usage se révèle, en pratique, parfois problématique.
b) Mieux contrôler les traitements de substitution aux opiacés
Vos rapporteurs ont, à l'égard des traitements de substitution aux opiacés, trois préoccupations majeures : le maintien des patients dans ces traitements pour une durée de plus en plus longue ; les détournements et mésusages dont fait l'objet l'un d'entre eux, le Subutex ; le nombre élevé de surdoses liées à la prise de méthadone.
? Les traitements de substitution aux opiacés, des traitements à vie ?
Les traitements de substitution aux opiacés se divisent en deux catégories de produits : d'une part, la méthadone ; d'autre part, la buprénorphine haut dosage, d'abord commercialisée sous le nom de Subutex et qui a donné lieu à l'autorisation de mise sur le marché de génériques. Tous deux sont des substances opioïdes ayant une longue durée d'action ; ils agissent sur les aspects pharmacologiques de la dépendance en permettant de réduire les manifestations aiguës du sevrage, en particulier l'effet de manque, sans avoir d'effets psychoactifs similaires à ceux de l'héroïne.
Comme l'a indiqué le docteur Xavier Laqueille, chef du service d'addictologie de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, le statut de ces traitements est ambigu car leur diffusion a poursuivi, concurremment, deux objectifs : traiter les dépendants aux opiacés en vue de leur rémission et réduire les risques encourus.
La méthadone est généralement prescrite dans le cadre d'une prise en charge médicale du patient très encadrée, avec un contrôle urinaire systématique et une posologie élevée - l'objectif est alors de réduire progressivement les doses jusqu'à l'abstinence. Mais sa prescription peut également poursuivre un objectif de réduction des risques, comme cela est par exemple le cas avec les « bus méthadone » qui prescrivent des posologies plus faibles qu'en milieu hospitalier et les accompagnent de distribution de matériel d'injection à usage unique. Il s'agit alors d'éviter à la fois les partages de seringues et les risques de surdoses. Dans tous les cas, le docteur Xavier Laqueille a observé que la durée des traitements à la méthadone était de plus en plus longue, au point qu'il a parlé d'une pathologie « au long cours ».
La délivrance de buprénorphine haut dosage par la médecine de ville semble, elle aussi, répondre à une préoccupation de réduction des risques - tel est d'ailleurs le cas dans l'expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale sur la réduction des risques infectieux des usagers de drogues.
Pourtant, ce produit est bien supposé être, au départ, un traitement de la dépendance. On pourrait donc s'attendre à ce qu'il puisse y être mis un terme, comme l'a souligné le professeur Jean Costentin, membre de la commission sur les addictions de l'Académie nationale de médecine, qui a jugé que « le bénéfice du Subutex est avéré lorsque le produit est prescrit et délivré par des professionnels bien formés. S'il est pris dans une perspective de réduction progressive des doses menant à l'abstinence, il est irremplaçable et a toute sa place dans l'arsenal de lutte contre la toxicomanie » (190 ( * )) .
Les traitements de substitution ont-ils vocation à avoir un terme, ou bien sont-ils des traitements « à vie » ? Les professionnels de santé eux-mêmes semblent s'interroger sur ce point, comme M. Alain Martin, président du conseil régional de Lorraine de l'ordre des infirmiers, qui a observé : « les traitements de substitution aux opiacés entraînent une dépendance majeure et il s'avère extrêmement difficile de se débarrasser de la «béquille». Il serait peut-être temps de dresser le bilan de ces traitements » (191 ( * )) . Tout le problème est en effet que ces traitements ne mettent pas fin à la dépendance mais la remplacent par une autre.
Doit-on, comme le préconisait le docteur William Lowenstein, directeur général de la clinique Montevideo à Boulogne-Billancourt (192 ( * )) , considérer les addictions - et donc la dépendance aux opiacés - comme une affection de longue durée ? C'est un argument qu'on pourrait entendre s'il était avéré qu'il est impossible de mettre fin aux traitements de substitution aux opiacés ou d'atteindre un état que le docteur Xavier Laqueille qualifiait de « rémission de longue durée ». Mais tel n'est pas le cas, puisque certains parviennent, finalement, à se sevrer et se maintenir dans l'abstinence.
Il semble aujourd'hui nécessaire de mener des études sérieuses pour faire le bilan des traitements de substitution aux opiacés et conduire des recherches sur les voies de sortie de ces traitements. Les toxicomanes doivent pouvoir s'engager dans un parcours de soins individualisé, ayant pour but ultime, aussi souvent que possible, le sevrage et la suppression de ces « béquilles chimiques ». Ces traitements présentent certes un réel intérêt, mais ils ne sont qu'une étape du parcours et ne peuvent constituer une fin en soi.
Vos rapporteurs ne prétendent évidemment pas déterminer leur durée optimale a priori , qui dépend étroitement des personnes traitées et de leur cadre de vie. Ils sont en revanche persuadés qu'il convient, avant tout, que les médecins aient, pour chacun de leurs patients toxicomanes, un projet thérapeutique précis ; tel ne semble malheureusement pas toujours être le cas.
? La nécessité de lutter contre les détournements et mésusages de buprénorphine haut dosage
Bien qu'ils ne soient pas classés comme stupéfiants, au contraire de la méthadone, les médicaments à base de buprénorphine haut dosage (en pratique, le Subutex et ses génériques) sont soumis à des règles de prescription similaires à celles applicables aux médicaments stupéfiants définies aux articles R. 5132-29 à R. 5132-35 du code de la santé publique :
- leur prescription doit indiquer sur une ordonnance sécurisée, en toutes lettres, le nombre d'unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage ;
- la durée de traitement prescrit ne peut excéder vingt-huit jours ;
- la délivrance doit être fractionnée et les fractions doivent correspondre à des durées maximales de sept jours, sauf si le prescripteur a porté la mention « délivrance en une seule fois » sur l'ordonnance ;
- le chevauchement des prescriptions n'est pas possible, sauf mention expresse du praticien ;
- une copie de l'ordonnance doit être conservée pendant trois ans par le pharmacien.
Ces précautions n'ont pas permis d'empêcher l'apparition de mésusages et détournements inquiétants de ce produit qui est très majoritairement utilisé - au premier semestre 2010, on comptait 103 000 bénéficiaires de remboursement par l'assurance maladie. Comme l'a indiqué le professeur Dominique Maraninchi, directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé (193 ( * )) , l'agence a identifié, dès 2003, cinq types d'utilisation problématique de la buprénorphine haut dosage. Il s'agissait de l'autosubstitution, dans un usage thérapeutique mais hors protocole médical ; l'usage toxicomaniaque avec des risques de primo-dépendance, le Subutex étant parfois considéré comme une « héroïne du pauvre » car utilisé par des populations très précaires ; le recours à une autre voie que la voie sublinguale (injection, prise par voie nasale ou voie fumée), ce qui entraîne des atteintes hépatiques, des candidoses, des problèmes d'atteintes vasculaires et des risques de dépression respiratoire ; le nomadisme médical ; enfin, le trafic.
L'agence a alors adressé un courrier aux professionnels de santé pour leur rappeler les règles de bon usage et la nécessité d'un suivi régulier des patients. Cela a été l'occasion pour elle de recommander que soit établi un lien étroit entre le médecin et le pharmacien. Ses recommandations ont été prises en compte, ce qui a conduit à établir des modalités de contrôle assez strictes.
Ainsi, depuis un arrêté du ministre chargé de la santé du 1 er avril 2008 (194 ( * )) , la buprénorphine haut dosage fait partie des produits considérés comme susceptibles de mésusage ou d'un usage détourné ou abusif au sens de l'article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale. Sa prise en charge par l'assurance maladie est donc subordonnée à l'obligation, pour le patient, d'indiquer au prescripteur, à chaque prescription, le nom du pharmacien qui sera chargé de la délivrance, et à l'obligation, pour le médecin, de mentionner ce nom sur la prescription. Un protocole de soins doit être établi en cas de constatation, par les services du contrôle médical de l'assurance maladie, d'un usage détourné ou abusif.
De plus, par arrêté du 5 février 2008 du ministre chargé de la santé (195 ( * )) , il est explicitement interdit au pharmacien de dispenser, à l'expiration de la validité de l'ordonnance et à titre exceptionnel, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement.
Par ailleurs, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés a engagé, en 2004, un programme de lutte contre la fraude en matière de traitements de substitution aux opiacés. Il a tout d'abord concerné les consommateurs et, en 2006, il est élargi aux prescripteurs.
Selon les données communiquées par M. Pierre Fender, directeur du contrôle-contentieux et de la répression des fraudes de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (196 ( * )) , les actions engagées entre 2004 et 2010 ont ainsi permis d'engager à peu près quatre cents procédures pénales à l'encontre des assurés ; 4 359 prises en charge de traitements de substitution aux opiacés ont été suspendues par la caisse ; 9 922 protocoles de soins ont été conclus. Vingt-quatre procédures pénales ont concerné dix-huit médecins et six pharmaciens ; près de cinquante procédures ordinales ont également été engagées.
La mise en oeuvre du programme de lutte contre les fraudes a ainsi permis de réduire sensiblement le nombre de « méga-consommateurs » de buprénorphine haut dosage, définis comme bénéficiant du remboursement de plus de 32 milligrammes de cette substance par jour - sachant que la dose maximale indiquée est de 16 milligrammes. On en comptait en effet 1 530 au premier semestre de l'année 2010, contre 1 948 au second semestre de l'année 2004. Le montant des fraudes détectées par l'assurance maladie est ainsi très sensiblement en baisse : il était de 3,8 millions d'euros en 2008 contre 9,7 millions d'euros en 2007 et 7,1 millions d'euros en 2006. Il est vrai que l'arrestation, en avril 2007, d'une bande organisée spécialisée dans le trafic de Subutex, a permis de porter un coup important au trafic de ce produit.
Malgré ces efforts, le détournement de Subutex - car ce phénomène ne concerne que peu ses génériques - perdure. Comme l'a observé M. Pierre Fender, une proportion anormalement élevée de « méga-consommateurs » existe dans certaines régions, en particulier l'Île-de-France et les régions frontalières. Des médecins doivent faire face à des pressions de la part de fraudeurs parfois très violents ; des vols ou des falsifications d'ordonnances peuvent se produire ; enfin, la possibilité d'une prescription du produit par le médecin généraliste de ville permet à certains toxicomanes de pratiquer un nomadisme médical et d'accumuler les prescriptions soit pour un usage personnel, soit pour alimenter un trafic. Ainsi, l'Organe international de contrôle des stupéfiants a-t-il noté l'introduction clandestine de buprénorphine en Finlande « en grandes quantités, principalement de la France via l'Estonie » (197 ( * )) . Il a également observé qu'en France, existait un abus de préparations pharmaceutiques, « notamment celles qui contiennent [...] de la buprénorphine » (198 ( * )) .
En outre, comme l'indique le bilan, établi en 2010, du plan de gestion des risques mis en place pour la buprénorphine et ses génériques, les problèmes de mésusage, notamment d'injection et de prise par voie nasale, subsistent. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a donc demandé à l'ensemble des laboratoires concernés la réalisation d'une étude commune sur l'utilisation de Subutex et de ses génériques en situation réelle pour évaluer leur mésusage ; cette étude devrait être conduite d'ici à la fin de l'année 2011. On peut malheureusement craindre que ses résultats ne soient guère encourageants.
Vos rapporteurs jugent nécessaire d'agir pour lutter contre les mésusages, qui peuvent pour certains devenir une porte d'entrée dans l'addiction de primo-consommateurs. Deux voies sont possibles. La première consisterait à restreindre les modalités de prescription de buprénorphine haut dosage en les alignant sur celles de la méthadone, notamment en réservant sa primo-prescription aux centres de soins spécialisés et aux établissements de santé. Cela permettrait de lutter contre les trafics efficacement - la méthadone est en effet beaucoup moins détournée que la buprénorphine haut dosage. Mais la faible couverture du territoire par les centres de soins spécialisés conduirait sans doute à réduire drastiquement la possibilité, pour les toxicomanes, d'accéder au produit de substitution aux opiacés le moins toxique et qui n'entraîne pas de risque de surdose mortelle. L'impact en termes de santé publique risquerait fort d'être négatif.
La seconde voie, qui semble plus praticable, consisterait à prévoir une ouverture systématique du dossier pharmaceutique en cas de délivrance de buprénorphine haut dosage - ce qui pourrait d'ailleurs être étendu aux délivrances de méthadone. Selon Mme Isabelle Adenot, présidente du Conseil national de l'ordre des pharmaciens (199 ( * )) , une telle mesure serait sans doute très efficace, puisqu'elle a jugé qu'« il suffit d'obliger toute personne sous Subutex à ouvrir un dossier pharmaceutique pour stopper immédiatement le mésusage ». Certes, elle a expliqué qu'elle n'ouvrait jamais un dossier pharmaceutique à une personne se faisant délivrer ce produit car celle-ci aurait le sentiment qu'on cherche à la contrôler. Mais tel est bien le but, puisqu'il s'agit de lutter contre les mésusages et détournements.
Vos rapporteurs jugent donc souhaitable de s'engager dans la voie d'une systématisation de l'ouverture du dossier pharmaceutique en cas de délivrance de buprénorphine haut dosage, mesure qui pourrait être étendue à la délivrance de méthadone.
Ils se rallient par ailleurs aux propositions émises par Mme Isabelle Adenot concernant un développement de l'ordonnance électronique ou « e-prescription », qui consiste en une prescription de médicaments via un logiciel et sa transmission électronique au pharmacien, ce qui réduirait probablement les risques d'ordonnances falsifiées et donc de détournement du Subutex. Il pourrait sans doute aussi être envisagé de rendre obligatoire la mention, sur l'ordonnance, de l'officine chargée de délivrer ce produit, qui n'est actuellement exigée que pour le remboursement par la sécurité sociale.
? La nécessité d'encadrer plus encore la prescription et la délivrance de méthadone
La méthadone est classée, par arrêté du ministre chargé de la santé, comme stupéfiant (200 ( * )) , contrairement à la buprénorphine haut dosage. Ce classement emporte des conséquences importantes en termes de prescription et de délivrance. Comme pour la buprénorphine haut dosage, le médecin doit mentionner, sur la prescription, le nom du pharmacien chargé de la délivrance, désigné par le patient. La prise en charge de la méthadone sous forme de gélules est, en outre, subordonnée dès l'initiation du traitement à l'élaboration d'un protocole de soins pour éviter tout mésusage. En application d'un arrêté du ministre chargé de la santé (201 ( * )) , la prescription de la méthadone est limitée à une durée de quatorze jours et la délivrance du produit doit être fractionnée, les fractions devant correspondre à des durées de traitement de sept jours.
Depuis une circulaire de 2002 (202 ( * )) , la prescription initiale est désormais réservée non seulement aux médecins exerçant en établissements de santé (en hospitalisation, consultation externe ou milieu pénitentiaire) mais aussi à ceux exerçant en centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, le médecin généraliste pouvant intervenir en relais. En cas de prescription par un centre de soins, la délivrance du produit doit être quotidienne sous contrôle médical ou infirmier puis, selon stabilisation, un traitement pour sept jours peut être délivré. Enfin, lors de la mise en place du traitement, des contrôles urinaires doivent être effectués pendant trois mois, une à deux fois par semaine, puis deux fois par mois.
Ces conditions strictes semblaient avoir permis d'éviter un trafic de méthadone similaire à celui existant avec la buprénorphine haut dosage, mais cette appréciation mérite d'être nuancée. M. Pierre Fender, directeur du contrôle-contentieux et de la répression des fraudes de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés s'est en effet déclaré préoccupé par la très forte progression des remboursements de méthadone sous forme de gélules, dont l'évolution semestrielle moyenne depuis le premier semestre 2008 est supérieure à 50 % ; à la fin du premier semestre 2010, on comptait près de 11 600 bénéficiaires de tels remboursements, contre environ 29 000 pour la méthadone sous forme de sirop. M. Pierre Fender a d'ailleurs déclaré que la caisse procèderait à diverses vérifications afin de s'assurer de l'absence de trafics ou fraudes.
Au-delà de la problématique des détournements de méthadone, les conditions strictes de sa prescription et de sa délivrance ne semblent pas suffisantes pour empêcher que ne surviennent des surdoses mortelles liées à sa consommation, dans des proportions tout à fait alarmantes. En effet, ce produit présente une toxicité supérieure à celle du Subutex et la marge thérapeutique est étroite.
D'après les données communiquées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à la mission d'information (203 ( * )) , la méthadone (sous sa forme de sirop et de gélules) a ainsi été « impliquée dans un tiers des décès par overdose en 2008 ». Le fichier de l'agence sur les « décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances » dénombre, pour l'année 2009, soixante-huit décès liés directement à la prise de méthadone, dont vingt en association avec d'autres substances psychoactives. À titre de comparaison, c'est plus que le nombre de décès liés à la prise de cocaïne - qui était de cinquante-trois la même année. La comparaison est encore plus frappante s'agissant du nombre de décès liés à des surdoses où seule une substance est en cause : on en comptait en 2009 quarante-huit pour la méthadone, contre soixante-quinze pour l'héroïne et quinze pour la cocaïne. L'enquête menée par l'agence en 2009 (204 ( * )) établit en outre que sur deux cent soixante décès par surdose liés à la consommation d'une substance psychoactive, 52,7 % d'entre eux sont liés à la prise de stupéfiants illicites, dont 44,6 % à celle d'héroïne ; les « médicaments de substitution de la dépendance aux opiacés représentent 34,2 % des décès » (2) .
Vos rapporteurs sont extrêmement préoccupés par ce constat. Certes, la méthadone répond à des conditions de prescription et de délivrance strictes mais celles-ci sont manifestement insuffisantes ; on ne peut tolérer qu'un produit présenté comme un traitement donne lieu à tant de morts. L'intérêt général commande de contrôler plus encore les modalités de prescription de ce produit qui est particulièrement dangereux.
Vos rapporteurs proposent de maintenir le dispositif existant en matière de primo-prescription ; ils sont donc opposés à ce que soit ouverte la possibilité, pour les médecins de ville, de procéder à cette primo-prescription sous certaines conditions de formation ou d'habilitation. En revanche, ils estiment indispensable de mieux encadrer le relais de la prescription au médecin de ville, dans le respect du principe de liberté de prescription.
Vos rapporteurs proposent que le relais à la médecine de ville ne puisse s'effectuer qu'auprès des médecins inscrits dans un réseau de santé ville-hôpital spécialisé dans la prise en charge des toxicomanies . Cette inscription serait le gage d'une bonne formation aux problématiques d'usage de la méthadone. Ils proposent en outre que soit rendu obligatoire un bilan médical complet et régulier , par exemple tous les six mois, des patients des médecins de ville suivant un traitement à la méthadone pour s'assurer de la sécurité de la posologie et éventuellement l'ajuster. Ils estiment enfin nécessaire , comme l'a suggéré M. Jean-Yves Grall, directeur général de la santé (205 ( * )) , que soit donc menée une étude épidémiologique approfondie afin d'étudier avec attention les décès dans lesquels est impliquée la méthadone et qu'en soient tirées toutes les conséquences .
c) Lutter contre l'escalade des pratiques
Comme l'a indiqué à la mission d'information Mme Anne Guichard, chargée de mission au département Évaluation et expérimentation de la direction des affaires scientifiques de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'entrée dans l'injection constitue une étape particulièrement risquée de la trajectoire des usagers de drogues. Le constat est désormais que « les outils de réduction des risques, efficaces contre le virus de l'immunodéficience humaine, ne permettent pas de lutter contre celui de l'hépatite C qui est beaucoup plus contagieux et implique d'autres temps de la préparation du produit injecté » (206 ( * )) . Les programmes d'échange de seringues et la distribution de matériel stérile ne permettent pas de lutter efficacement contre la diffusion du virus.
Une voie d'action consiste donc à tenter de prévenir le passage à l'injection et de ce fait, « l'escalade » des pratiques. Cela constitue un vrai défi car, ainsi que l'a observé Mme Anne Guichard, « la première injection est souvent un acte non programmé, opportuniste, avec le prêt par un tiers, potentiellement contaminé, de son matériel d'injection. L'initié n'est alors pas conscient des risques : il vit une «lune de miel» avec le produit, qui n'apporte à ses yeux que des bénéfices ; âgé en moyenne de dix-sept ans, il éprouve un sentiment d'invulnérabilité ».
Peut-être pourrait-on s'inspirer du programme britannique Break the cycle qui, par un travail de terrain, en face-à-face ou par petits groupes de pairs, consiste à faire réfléchir les usagers déjà injecteurs sur leurs propres pratiques, à modifier leur comportement potentiellement incitatif et à leur apprendre à répondre par la négative à un jeune qui demande expressément à être initié. Il semble avoir produit des effets positifs pour éviter aux plus jeunes de franchir le pas de l'injection. Il est toutefois difficile de prédire si un tel programme serait adapté à la situation française.
En tout état de cause, on peut penser que les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues pourraient jouer un rôle important pour lutter contre l'escalade des pratiques. Ces « structures de première ligne » sont en effet les mieux placées pour aller au contact des usagers injecteurs et les sensibiliser aux risques que leurs pratiques font courir à eux-mêmes et aux jeunes qu'ils initient. Ils pourraient aussi permettre d'atteindre les toxicomanes non injecteurs pour les convaincre de ne pas passer à un mode d'administration plus risqué.
d) Multiplier les contacts sur le terrain avec les usagers de drogues
? Renforcer la couverture du territoire par les structures « de première ligne » pour multiplier les contacts avec les usagers de drogues
La visite de l'espace d'accueil et de consommation Quai 9 à Genève par la mission d'information, ainsi que les auditions auxquelles elle a procédé, ont mis en évidence l'enjeu que constitue la prise en charge des usagers de drogues les plus précaires et vulnérables. Y répondre suppose, en premier lieu, de multiplier les structures susceptibles de nouer avec eux un premier contact pour, par la suite, les informer sur les pratiques à moindres risques et, si possible, les orienter vers le système de soins. Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues semblent être les plus à même de remplir cette mission.
Il apparaît donc nécessaire de parvenir à une couverture du territoire satisfaisante par ces structures, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. En effet, on compte 133 centres, mais, selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (207 ( * )) , trois régions en sont dépourvues : la Corse, le Limousin et le Martinique ; 25 % des départements ne disposent pas d'un tel centre.
? Renforcer les actions de rue et de médiation
Il a été suggéré à la mission d'information, lors de la visite qu'elle a effectuée au centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues « First » de Villepinte, d'élargir les missions sociales de tels centres à l'hébergement et la possibilité de mener des actions dans le domaine de l'économie solidaire, comme cela est le cas pour certains organismes assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficulté.
Vos rapporteurs ne partagent pas cette position. Ils considèrent que l'hébergement médico-social des toxicomanes doit s'accompagner d'une démarche de soins et de soutien pour aller vers l'abstinence. Cette mission relève bien davantage des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou des communautés thérapeutiques.
En revanche, il semble nécessaire de multiplier les contacts avec les usagers de drogues très précaires et désinsérés pour les orienter vers des structures de soins . Vos rapporteurs souscrivent donc pleinement à l'analyse de M. Michel Gaudin, préfet de police de Paris (208 ( * )) , qui a jugé nécessaire de « développer les maraudes de contact pour aller au-devant de ces personnes. Les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ne disposent pas des moyens suffisants pour cela. »
Ainsi, à Paris, la principale « scène de consommation de drogues » ne fait-elle pas l'objet d'une présence médico-sociale suffisante. Selon M. Renaud Vedel, directeur-adjoint de cabinet du préfet de police de Paris, « les temps de maraude à Stalingrad [sont] de deux fois deux heures pour l'association la plus importante, Coordination toxicomanies 18, deux autres associations intervenant également. La couverture de la principale scène de consommation parisienne est donc très faible, alors que les policiers y mènent tous les jours des opérations de surveillance ou des interventions » (209 ( * )) .
Un constat similaire a été partagé par M. Jean-Louis Bara, directeur du centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues « First » de Villepinte, qui a jugé que les interventions de rue constituaient le « maillon faible » de l'action menée par ce centre.
Cette présence insuffisante ne peut, en aucun cas, être imputée à un éventuel désintérêt des personnels impliqués ; le manque de moyens et des considérations sécuritaires jouent un rôle important dans cette situation. On ne doit en effet pas sous-estimer les obstacles à des actions de rue. Comme M. Jean-Louis Bara l'avait souligné, il est souvent délicat d'intervenir dans des quartiers difficiles où le trafic d'héroïne et de cocaïne est important ; or, les usagers de drogues les plus désinsérés se trouvent souvent sur les lieux de trafic.
Des actions de médiation peuvent aussi être menées avec les bailleurs sociaux pour intervenir dans les parties communes des immeubles, mais là encore, cette tâche est malaisée dans les quartiers les plus sensibles où les petits trafiquants utilisent des méthodes très poussées de contrôle et d'intimidation pour empêcher toute présence « indésirable » sur les lieux de trafic. L'audition de M. Gilles Leclair, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense Sud, a, sur ce point particulier, été très éclairante (1) , puisqu'il a parlé de contrôles de personnes non connues à l'entrée des cités et de l'interdiction de monter dans les cages d'escaliers si les trafics sont en train de s'y dérouler.
Cela démontre que l'action de rue, indispensable, doit aller de pair avec une collaboration équilibrée avec les forces de l'ordre. Il ne s'agit pas d'intervenir dans une logique de répression mais de santé publique ; pour cela, encore faut-il que les structures allant au contact des usagers de drogues puissent le faire dans des conditions de sécurité satisfaisantes. De telles collaborations existent : M. Michel Gaudin, préfet de police de Paris, a ainsi demandé aux policiers de faire preuve de beaucoup de discernement dans l'application de la politique répressive aux alentours des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues. La préfecture de police de Paris a en outre accepté, en accord avec la Ville de Paris et en concertation avec les mairies d'arrondissement, de retirer les caméras là où l'on pouvait la suspecter d'utiliser des images de toxicomanes venant se faire soigner. Il convient de promouvoir de telles démarches, dans le souci d'une approche équilibrée du phénomène des toxicomanies.
*
* *
La politique de réduction des risques a permis des avancées encourageantes en termes de santé publique, notamment en permettant d'endiguer l'épidémie de virus de l'immunodéficience humaine. Mais elle doit aujourd'hui s'adapter pour faire face à de nouveaux défis : la diffusion du virus de l'hépatite C, contre lequel elle semble démunie, les interrogations sur la gestion, dans le temps, des traitements de substitution aux opiacés et la grande précarité de certains usagers de drogues.
Cela nécessite de procéder à des ajustements, dans une démarche alliant esprit de responsabilité et discernement. La politique de réduction des risques doit permettre d'améliorer, par elle-même, la santé des toxicomanes, mais elle ne peut être une fin en soi et doit mobiliser les énergies pour permettre d'orienter, à terme, les usagers de drogues vers l'offre de soins spécialisés.
III.- FACE AUX TOXICOMANIES, LA NÉCESSITÉ D'UN DISCOURS CLAIR ET UNIVOQUE
Dépénaliser l'usage des drogues illégales et mettre en place des centres d'injection supervisés, la mission d'information a examiné sans parti pris ces deux propositions, objet récurrent d'un « bruit de fond » favorable. Elle les a jugées non crédibles au vu de l'inconsistance de leurs avantages allégués, et inopportunes au vu de la nécessité de maintenir la lisibilité et la cohérence de la politique de lutte contre les toxicomanies.
Elle s'emploie à le démontrer dans les développements qui suivent, mais il est au préalable indispensable d'éclaircir les approximations sémantiques à partir desquelles les partisans de la dépénalisation construisent leur argumentation. Il serait question, en effet, moins de « dépénaliser » que de « légaliser ». Notons à cet égard que « dépénaliser » signifie supprimer les sanctions pénales actuellement attachées à l'usage des drogues illicites, ce qui revient à lever l'interdit pesant sur cette consommation. Un adage bien connu de notre tradition juridique libérale énonce que ce qui n'est pas interdit est permis ; ajoutons que ce qui est permis est légal ; par voie de conséquence, pour le débat qui nous occupe, la « dépénalisation » est l'exact équivalent de la « légalisation ». Il n'en serait autrement que s'il était proposé de remplacer les sanctions pénales - c'est-à-dire criminelles, délictuelles (l'usage de drogues illicites est actuellement sanctionné par des peines délictuelles) ou contraventionnelles - par d'autres sanctions, administratives en l'occurrence, ce que personne, apparemment, ne propose en France. Dans le débat en cours, « dépénalisation » équivaut donc à « légalisation » . Précisons encore à ce sujet que toute dépénalisation-légalisation est nécessairement opérée dans le cadre d'un régime juridique organisant, c'est-à-dire limitant, l'exercice de la liberté nouvellement instituée : à titre d'exemple, la dépénalisation-légalisation de l'avortement a eu lieu dans un cadre contraignant toujours en vigueur. La construction d'un régime juridique ad hoc serait tout aussi indispensable en cas de dépénalisation-légalisation de certaines drogues illicites. Il faudrait en particulier élaborer une définition juridique des drogues concernées, préciser les conditions de consommation admises (par exemple, on n'imagine pas que la consommation soit autorisée dans les établissements d'enseignement), définir les lieux de ventes autorisés, inventer des modes d'approvisionnement de ces lieux : autant de conditions à la marge desquelles les trafics que l'on prétend asphyxier se reconstruiraient immanquablement comme il est démontré plus bas.
A. LA DÉPÉNALISATION DE L'USAGE, UNE IMPASSE ÉTHIQUE ET JURIDIQUE
On examinera successivement la pertinence intacte de l'objectif traditionnel de construire une société sans drogues, l'impossible dépénalisation de l'usage et l'opportunité d'assurer pragmatiquement un meilleur respect de l'interdit pesant sur la consommation.
1. Un objectif légitime : une société sans drogues
La construction d'une société sans drogues est un objectif mobilisateur partagé par l'ensemble des pays du continent européen. Elle implique la mise en oeuvre de l'ensemble des outils identifiés de la politique de lutte contre les toxicomanies. Elle justifie ainsi la prohibition de l'usage des drogues illicites, mais n'est pas exclusive des autres dimensions de cette politique : la prévention et la réduction des risques en particulier.
a) De quoi s'agit-il ?
L'objectif d'une société sans drogues est l'horizon intellectuel et politique du régime de répression pénale des usages de drogues illicites. Il est souvent critiqué comme irréaliste, fantasmatique, infantilisant et producteur de désastres sanitaires par les tenants d'une politique de réduction des risques dynamique et efficace. L'étude déjà citée de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) sur la réduction des risques infectieux chez les usagers de drogues résume les arguments de ceux qui opposent ainsi la réduction des risques à l'idéal de la société sans drogues : « Du point de vue philosophique, la réduction des risques opère un changement de paradigme fondamental qui rompt avec l'idéal d'éradication des drogues et propose plutôt d'apprendre à «vivre avec les drogues» tout en promouvant la notion de mesure à la place de l'abstinence. [...] Ce postulat signifie une représentation spécifique de l'usager de drogues et du rapport aux drogues à partir des notions de responsabilité individuelle, d'autonomie, de rationalité des comportements et de participation citoyenne aux politiques publiques. »
Pourtant, la politique de lutte contre les toxicomanies menée en France et à l'étranger illustre pleinement le fait qu'il n'est pas besoin de renier l'objectif légitime d'une société sans drogues et d'abandonner les dispositifs répressifs qui constituent l'une de ses manifestations pour mettre en oeuvre une politique ambitieuse de réduction des risques. Il est dépassé, en effet, le temps où des arguments invoquant les effets pervers de la distribution de seringues sur l'éradication souhaitée de la consommation d'héroïne étaient opposés à cette mesure de bon sens dont les effets sur l'épidémie de VIH parmi les toxicomanes ont été spectaculaires. La réduction des risques fait aujourd'hui irrévocablement partie de la politique de lutte contre les toxicomanies et le choix de ses instruments n'est soumis à aucun filtrage « idéologique », on le verra ci-après à propos des salles de consommation supervisée, mais à la seule appréciation des avantages attendus.
On comprend ainsi que la société sans drogues n'est pas un principe exclusif dont se déduiraient mécaniquement des conséquences aveugles à ce qui lui est étranger, mais un objectif ouvert légitimé par l'examen des faits sociaux et sanitaires, mobilisateur pour l'État et la société, conservant toute leur place aux autres dimensions du combat à mener .
b) La nocivité sociale démontrée de l'ensemble des drogues illicites
On a montré dans la première partie de ce rapport le caractère dépassé de la distinction des drogues dures et des drogues douces. Toutes les drogues, licites ou illicites, sont nocives et socialement dangereuses. Il appartient, dès lors, à la collectivité de s'opposer à leur consommation et de rechercher leur éradication pour ce qui est des drogues illicites, d'imposer leur usage modéré et responsable pour ce qui est des licites. Rappelons à cet égard qu'en vertu de l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, intégrée à la Constitution, « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. [...] » L'objectif de la société sans drogues mérite assurément, de ce point de vue, l'adhésion du législateur, auquel il est peu approprié d'opposer l'autonomie de l'usager se droguant chez soi sans causer de tort à quiconque. Sans doute de nombreux usagers décident-ils librement de consommer tel ou tel produit dans un cadre privé où le dommage social est moins visible que dans d'autres lieux. Sans doute nombre d'usagers parviennent-ils - de nombreux médecins auditionnés en ont témoigné - à gérer leur consommation sans tomber dans l'addiction. Mais pour combien d'autres l'approche de la drogue est-elle le facteur déclencheur d'un processus conduisant à la perte de toute autonomie et de toute liberté ? Le dommage social se profile incontestablement dès le moment où il y a consommation.
Du reste, aucun interlocuteur de la mission, comme aucun membre de celle-ci, n'a plaidé l'innocuité de quelque drogue que ce soit : comme le résumait M. Jean-Marc Borello, délégué général et président du directoire de SOS Drogue international-Groupe SOS : « Croit-on que si nous n'étions pas tous persuadés qu'il vaut mieux vivre sans drogue, nous aurions consacré vingt-cinq ans de notre vie à aider les gens à sortir de la toxicomanie ? » (210 ( * )) . Ajoutons que le caractère socialement nuisible des drogues a été affirmé dans un arrêt récent de la Cour de justice de l'Union européenne : « [...] la nécessité de lutter contre la drogue a été reconnue par différentes conventions internationales auxquelles les États membres, voire l'Union, ont coopéré ou adhéré. Dans les préambules de ces instruments, sont rappelés le danger que constituent notamment la demande et le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes pour la santé et pour le bien-être des individus, ainsi que les effets néfastes que ces phénomènes ont sur les fondements économiques, culturels et politiques de la société. » (211 ( * ))
c) Le cannabis n'est pas un cas à part
Cependant, objectera-t-on, le cannabis est un cas particulier parmi les drogues illicites, plus comparable à l'alcool qu'à la cocaïne et à l'héroïne. Ne faut-il pas, dès lors, chercher à en garantir un usage « responsable » plutôt qu'affirmer, en vain, une interdiction de plus en plus violée ? Tel fut le point de vue adopté en 1995 par le rapport de la commission de réflexion sur la drogue et la toxicomanie, présidée par le professeur Roger Henrion : « Il est difficile d'admettre l'amalgame fait, au moins dans les textes législatifs, entre l'adolescent fumeur occasionnel de haschich et l'héroïnomane qui se pique plusieurs fois par jour. Le sens de l'acte n'est pas le même. Dans le premier cas, il s'agit d'une pratique sociale répandue, inspirée par la quête d'un sentiment d'euphorie passager, souvent convivial, de curiosité, d'une transgression «initiatique» de jeunes qui ne sont pas toxicomanes et ne le deviendront jamais. Dans le second cas, il s'agit d'un comportement toxicomaniaque au sens pathologique du terme. » Ceci tendrait à justifier le rapprochement du régime juridique de la consommation du cannabis de celui de la consommation d'alcool. Le législateur n'a jamais retenu cette approche. Les faits lui ont donné raison puisque, comme on l'a noté dans la première partie du présent rapport, d'une part, les travaux scientifiques ont fait, entretemps, raison du discours sur la faible nocivité du cannabis, d'autre part, le phénomène croissant des polytoxicomanies démultiplie les dangers liés à la consommation d'une seule drogue, licite ou illicite .
d) Des comparaisons législatives inopérantes
Comment, dira-t-on encore, l'objectif d'une société sans drogues peut-il être crédible alors que l'alcool et le tabac, dont la morbidité dépasse de beaucoup celle du cannabis, sont en vente partout et que personne ne prône leur interdiction ? La mission d'information ne juge pas nécessaire de se livrer à l'étude des méfaits comparés des drogues licites et illicites. Les unes sont inscrites dans notre culture, les autres non, on reviendra ensuite sur ce point. Ceci justifie les différences de politiques publiques. Les données scientifiques communiquées à la mission d'information sur le taux d'addiction des différentes drogues ou sur la mortalité découlant des divers usages ne peuvent donc pas être retenues à l'appui d'une éventuelle proposition d'étendre à l'alcool et au tabac le régime répressif que la loi du 31 décembre 1970 applique aux stupéfiants. Inversement, elles ne peuvent pas d'avantage justifier de baisser la garde sur des produits illégaux dont la nocivité ne fait pas de doute.
On notera par ailleurs que la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne a été mentionnée plusieurs fois comme un exemple de démarche législative pertinente rompant avec le paradigme de l'interdiction. Le docteur Marc Valleur, psychiatre, médecin chef du Centre Marmottan de Paris, remarquait à cet égard devant la mission : « La loi sur le jeu constitue un exemple d'une démarche qui pourrait gagner à être mise en perspective avec ce qui a été fait pour les drogues. Cette loi est une loi de légalisation mais il s'agit d'une légalisation partielle, certains jeux ayant été légalisés et pas d'autres. On a donc là un peu de prohibition dans un modèle d'allure libérale » (212 ( * )) . Cependant, l'adoption de la loi du 12 mai 2010 a résulté des obligations européennes de la France dans le champ de la concurrence, et non de la « découverte » par le législateur de l'intérêt social éventuel d'une libéralisation de l'accès aux jeux d'argent qui n'avait, du reste, jamais été interdit mais seulement étroitement contrôlé par l'État pour des raisons plus financières que sanitaires et sociales. La comparaison de la loi du 12 mai 2010 avec le régime juridique des drogues illicites n'est donc pas probante. Au demeurant, s'il fallait comparer, on noterait que ce qu'il y a de pragmatique ou de « libéral » dans ce texte attentif aux dérives addictives que suscitent les jeux d'argent est représenté, mutatis mutandis , dans le domaine de la lutte contre les toxicomanies, par l'équilibre réalisé au fil du temps entre les dimensions répressives, préventives et curatives de la politique en vigueur. De la même façon, comme le notait encore le docteur Marc Valleur : « Cette loi ne marchera que si les opérateurs sentent au-dessus de leur tête une épée de Damoclès constituée par une possible prohibition. Autrement dit, le modèle prohibitionniste ne fonctionne que si des actions de prévention, de soins, d'accompagnement sont mises en oeuvre ; le modèle libéral ne fonctionnera que s'il intègre la possibilité - au moins virtuelle - d'une prohibition, d'un retour en arrière. »
e) Derrière la diversité des approches nationales, la prégnance du rejet social des drogues illicites
Aucun pays européen n'a renoncé à l'objectif de construire une société sans drogues.
En ce qui concerne les questions liées à l'usage illicite, cela se traduit par une politique répressive conduite selon des modalités diverses. Selon une contribution transmise à la mission d'information par M. Bernard Leroy, avocat général près la Cour d'Appel de Versailles, responsable de 1990 à 2010 du programme d'assistance juridique de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), sept pays de l'Union européenne - Chypre, la France, la Finlande, la Grèce, le Luxembourg (sauf pour le cannabis), la Suède et la Norvège - considèrent l'usage de stupéfiants comme une infraction pénale. L'usage simple est une infraction administrative en Estonie, en Espagne, en Lettonie, et au Portugal. Les autres États membres n'interdisent pas directement l'usage de stupéfiants en tant que tel, mais par le biais de l'interdiction des actes qui le préparent, en particulier la détention.
Quoi qu'il en soit de la diversité des approches nationales, ceci montre que le rejet des drogues illicites demeure prégnant en Europe. Il est intéressant de l'illustrer en comparant trois modèles nationaux.
? Le système suédois
On commencera cette comparaison intra-européenne en évoquant l'exemple de la politique suédoise de lutte contre les toxicomanies, explicitement fondée sur le paradigme de la société sans drogues. La politique suédoise telle que décrite dans le plan national antidrogues 2006-2010 affiche clairement l'objectif d'une société sans drogues. Toutes les mesures proposées par ce plan sont orientées vers cet objectif. L'accent est notamment mis sur la nécessité de réduire l'offre de drogue en intensifiant la lutte contre les trafics et en prévenant les entrées en consommation. Comme le précisait à la mission d'information M. Per Holmström, ministre plénipotentiaire à l'ambassade de Suède en France : « En ce qui concerne la législation sur les drogues illicites, la France et la Suède ont depuis longtemps des politiques assez fermes au sein de l'Union européenne. Depuis 1988, avoir de la drogue sur soi, en transporter ou aider quelqu'un à en vendre constitue une infraction pénale ; les pouvoirs publics affichent une tolérance zéro en la matière. C'est un point essentiel à retenir. » (213 ( * )) Selon le document intitulé The Swedish action plan on narcotic drugs 2006-2010 , publié en février 2008 par le ministère suédois de la santé et des affaires sociales, l'objectif de la société sans drogues comprend trois sous-objectifs : réduire le passage à l'abus de drogue, inciter les personnes faisant face à des problèmes d'abus de substances à renoncer à l'abus, réduire l'offre de drogues.
La rigueur assumée de cette démarche qui considère la politique de lutte contre les drogues comme une part de la politique de santé publique n'est nullement exclusive d'une politique de réduction des risques. Il est vrai, pour autant, selon M. Per Holmström, que « le débat à propos de la question sanitaire est également assez vif en Suède. Pour l'instant, l'échange de seringues, malgré le fait que cela peut réduire les risques de transmission de certaines maladies comme le VIH, n'est pas considéré comme une réponse au problème. C'est une question d'idéologie et il n'est pas question de l'aborder pour l'instant. Cela n'empêche toutefois pas le débat. La Suède a étudié ce qui se passait en Suisse et le Gouvernement en a tiré ses conclusions. » Comme le remarquait devant la mission d'information M. Franck Zobel, rédacteur scientifique et analyste des politiques en matière de drogue à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) : « La Suède mène une politique stable et très claire : elle souhaite une société sans drogue. Les Suédois ne comprendraient pas l'approche hollandaise, ou celle du Portugal où la décriminalisation et les locaux de consommation ont été envisagés. » (214 ( * ))
? Le système portugais
Le cas du Portugal a été assez souvent présenté au cours des auditions de la mission d'information comme le paradigme d'une politique libérale et axée sur les soins sans être pour autant permissive. M. Henri Bergeron, sociologue, chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a ainsi indiqué : « Pendant longtemps, on a considéré que le fait de sortir l'infraction d'usage simple du droit pénal et de la décriminaliser, comme a pu le faire le Portugal en 2001, traduisait une politique laxiste. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. » Dans le même sens, le docteur William Lowenstein, directeur général de la clinique Montevideo à Paris, a estimé de son côté : « Il ne faut pas tout permettre mais, comme au Portugal, constituer sous la responsabilité du ministère de la santé des commissions dites de probation qui n'abandonnent pas le toxicomane. S'il n'y a plus de sanction pénale, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de sanctions administratives, ni d'interdits symboliques. Personne ne peut conseiller à qui que ce soit de fumer du cannabis ou de boire de l'alcool - surtout aux jeunes - mais la culture de notre pays doit évoluer. » (215 ( * ))
Qu'en est-il ? Depuis une loi de 2000 portée par l'idée « qu'il vaut mieux soigner que punir », la possession d'une petite quantité de produits stupéfiants, ou sa consommation, n'est plus un délit au Portugal, tout en restant une infraction.
Selon les informations communiquées par la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT), en cas d'interpellation, les agents des divers services répressifs effectuent une première appréciation des circonstances de fait en déterminant si la drogue est, ou non, destinée à la consommation personnelle (quantité estimée pour dix jours de consommation) ou au trafic.
Le contrevenant est ensuite présenté à une commission chargée de déterminer s'il est toxicodépendant ou usager occasionnel. Dans le premier cas, le contrevenant est dirigé vers une institution afin de suivre un traitement thérapeutique. Cette prise en charge thérapeutique semble faire l'objet d'une forte adhésion du toxicodépendant. Il est rare que celui-ci refuse l'aide médicale qui lui est proposée. Le consommateur occasionnel est de son côté sanctionné par des mesures administratives telles que l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de fréquenter des établissements ouverts la nuit ou la suspension de certains revenus sociaux, ainsi que par des travaux d'intérêt général et des amendes.
Une amende peut être prononcée à l'encontre de consommateurs occasionnels pour usage ou possession de stupéfiants. Cette sanction est cependant rarement appliquée.
Dix ans après la mise en place de cette approche axée sur la réponse thérapeutique à l'usage de stupéfiants, on ne constate pas d'explosion de la consommation ou du trafic au Portugal.
Pour autant, l'argument souvent invoqué mettant en avant la disparition des trafics organisés d'importation de produits stupéfiants qui seraient privés de ressources, n'est pas recevable au regard de la réalité des saisies effectuées par les services répressifs portugais : le bilan 2009 des infractions liées au trafic et à l'usage de stupéfiants révèle une augmentation des quantités d'héroïne saisies, contrairement aux saisies de résine de cannabis, de cocaïne et d'ecstasy, qui connaissent une forte baisse par rapport à 2008. Au contraire, pour les six premiers mois de 2010, il y aurait une augmentation des saisies de cannabis et une très forte augmentation des saisies de cocaïne et d'ecstasy par rapport à 2009. Parallèlement, les saisies d'héroïne semblent avoir fortement diminué.
En fin de compte, le Portugal offre l'exemple d'une société qui, sans légaliser le moins du monde l'usage des drogues illicites, a choisi une voie moyenne alliant une répression modulée avec une forte insistance sur le traitement des toxicomanes.
? Le dispositif hollandais
La loi néerlandaise sur les stupéfiants de 1976 interdit la possession, le commerce, la culture, le transport, la fabrication, l'importation et l'exportation de stupéfiants. Les infractions sont passibles de sanctions pénales, y compris s'agissant du cannabis et de ses dérivés, sauf en cas d'utilisation à des fins médicales, scientifiques ou éducatives, sous réserve d'autorisation préalable.
Sur cet arrière-plan législatif prohibitionniste, les Pays-Bas ont mis en oeuvre une politique de tolérance à l'égard de la vente et de la consommation de « drogues douces » à la suite d'un long processus d'élaboration marqué en 1972 par le rapport gouvernemental de la commission dite Baan et, en 1995, par un rapport intitulé « Politique en matière de drogue aux Pays-Bas : continuité et changement ».
Dans la mesure où les risques liés à la consommation de « drogues douces », qui comprennent le cannabis et ses dérivés, sont jugés « acceptables », la possession de ce type de drogues pour usage personnel a été décriminalisée et leur vente a été tolérée, pour des quantités strictement limitées et dans des circonstances contrôlées.
Cette politique de tolérance a notamment été mise en oeuvre dans le cadre des directives édictées par le collège des procureurs généraux. Ces directives fixent les priorités du ministère public néerlandais en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites pénales engagées à la suite d'une infraction à la loi sur les stupéfiants. Les autorités judiciaires se sont ainsi fondées sur le principe de l'opportunité des poursuites pour mener une politique répressive sélective, n'engageant pas systématiquement de poursuites pénales à l'encontre des petits commerces de stupéfiants et réservant une priorité à la répression du trafic de stupéfiants et à celle de la grande criminalité.
Les autorités néerlandaises ont ainsi toléré la vente de petites quantités de produits à base de chanvre dans les maisons des jeunes par des revendeurs attitrés. Elles ont, ensuite, étendu cette politique aux coffee shops vendant à titre commercial aux adultes. Les coffee shops sont des établissements accessibles au public, relevant de la catégorie des établissements de restauration rapide où des aliments peuvent être consommés, mais dans lesquels la vente de boissons alcoolisées est interdite. Les autorités locales, à savoir le maire, le procureur et le chef de la police, peuvent autoriser l'établissement de ces coffee shops sous réserve de conditions précises.
Le régime juridique de tolérance ciblée et encadrée appliqué au Pays-Bas est ainsi passablement différent des autres modèles européens. Il n'est pas sans poser problème à l'intérieur et à l'extérieur du territoire néerlandais : troubles récurrents à la tranquillité publique dans l'environnement des boutiques, trafics divers à leurs abords, narco-tourisme, facilités d'approvisionnement apportées aux non-nationaux, climat de permissivité. Lors de son audition par la mission d'information, M. François Thierry, commissaire divisionnaire, chef de l'office central pour la répression du trafic des stupéfiants a estimé : « Aux Pays-Bas, 75 % à 80 % des gens qui viennent se fournir dans les coffee shops ne sont pas hollandais. Cela a généré des trafics énormes. L'État en récolte certes les fruits, les gens dépensant de l'argent par ailleurs, mais on ne sait plus comment se défaire de ces trafics. Les coffee shops sont fermés les uns après les autres et l'on assiste à des troubles associés colossaux, avec des plaintes du voisinage incessantes. » (216 ( * )) De son côté, M. Michel Gaudin, préfet de police de Paris, a exprimé en termes vifs le jugement très sévère qu'il porte au modèle hollandais : « Dans mes anciennes fonctions, j'étais assez peu apprécié des représentants de la police néerlandaise, d'autant que je reprenais souvent une expression du Président de la République Jacques Chirac : je persiste à penser que les Pays-Bas sont un «narco-État», un loup dans la bergerie européenne. Aujourd'hui, il circule plus de drogue dans les capitales des pays où la consommation a été libéralisée que chez nous. » (217 ( * ))
Ce système a en effet été très largement, immanquablement dira-t-on, mis à profit par les trafiquants et détourné de son objectif initial d'« éviter la stigmatisation et la marginalisation des consommateurs de «drogues douces» et [...] séparer le marché des «drogues dures» de celui des «drogues douces» de façon à créer une barrière sociale entravant le passage des unes aux autres » (218 ( * )) . Il est critiqué à l'extérieur ; il est aussi remis en cause au Pays-Bas : de nombreuses municipalités ont entrepris de limiter l'activité des coffee shops . À l'origine de l'affaire C-13709, celle de Maastricht avait fermé l'une d'elles au motif qu'elle contrevenait à une réglementation locale interdisant la vente à des non-résidents.
Le système néerlandais est donc manifestement pernicieux. Néanmoins, il n'affirme pas non plus la légitimité de la consommation de drogues : tolérance n'est pas approbation, seulement acceptation d'un moindre mal. Il traduit un aveu d'impuissance, enregistre une démission latente des pouvoirs publics, s'inscrit dans le sillage de la culture libertaire qui a parcouru l'Europe des années 1970, mais ne représente pas véritablement, à ce jour au moins, l'affirmation d'une renonciation expresse et délibérée à l'objectif d'éradication de la drogue, partagé par l'ensemble des pays européens.
2. L'impossible dépénalisation de l'usage
Aucune argumentation solide ne justifierait une dépénalisation de l'usage des drogues illicites que les obligations internationales contractées par la France interdisent, au demeurant, de prévoir.
a) Le bien-fondé de l'interdit législatif
Dès lors que le législateur entend affirmer l'objectif d'une société sans drogues, il lui appartient d'instituer les interdits correspondants et de prévoir les sanctions nécessaires. Ces deux étapes ne vont pas nécessairement de soi aux yeux de tous ou, tout au moins, ne sont admissibles pour certains que selon des conditions de mise en oeuvre plus ou moins restrictives.
C'est ainsi que le rapport de 1994 sur les toxicomanies (219 ( * )) adopté par le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé affirmait : « Le simple usage d'un produit dangereux ne devrait être réprimé que lorsqu'il est public, ou lorsque la preuve est apportée (en toute régularité de procédure) qu'il a une influence néfaste sur l'entourage, notamment familial. »
Il faut donc affirmer le bien-fondé de l'interdit et de la sanction qui accompagne sa violation.
Qu'en est-il, tout d'abord, du droit du législateur de poser des interdits en cette matière comme en d'autres ? D'un point de vue juridique, la position du Comité consultatif national d'éthique se réfère implicitement à la notion de liberté individuelle, en l'occurrence celle de disposer de son corps, comprise comme permettant à chacun de faire chez soi ce qui ne nuit pas à autrui. Cependant, on a montré ci-dessus les graves nuisances qui résultent pour l'être humain, en tant que personne et en tant que citoyen, ainsi que pour la société dans son ensemble, des toxicomanies. L'article 5 de la Déclaration de 1789 permet à la loi d'interdire les « actions nuisibles à la société » : la consommation de drogues est assurément l'une de ces actions.
C'est pourquoi de nombreux interlocuteurs de la mission d'information ont tenu à évoquer la légitimité et la nécessité de l'interdit. Le docteur Xavier Emmanuelli, Président-fondateur du SAMU social, a justement noté : « Toutes les sociétés ont le droit de fixer des interdits. On se rappelle la prohibition, qui a connu plus ou moins de bonheur. Vous pouvez légaliser le cannabis mais je ne vous souhaite pas de vous trouver sur le chemin de quelqu'un qui conduit à vive allure sous l'emprise de celui-ci ! » (220 ( * )) . Mme Marie-Françoise Camus, présidente de l'association Le Phare-Familles face à la drogue, a lancé de son côté cet appel au législateur : « La famille doit désormais être au coeur du dispositif de prévention. Pour ce faire, il s'agira de réaffirmer l'interdit et de renforcer ainsi les parents dans leur légitimité à l'imposer à leurs enfants » (221 ( * )) . M. Patrick Romestaing, président de la section Santé publique du Conseil national de l'ordre des médecins, a indiqué à propos des salles d'injection supervisée : « L'ordre croit en la force des interdits [...] , il est contre l'ouverture de tels centres pour que perdure un interdit fort sur ces substances illicites ». Dans une optique différente, tout en estimant que « l'approche politique des usages de drogues ne peut plus être centrée sur la définition d'un acte de délinquance, ce qui est le cas actuellement », M. Alain Morel, directeur général de l'association Oppelia, n'en a pas moins déclaré : « La prévention, en France, a toujours consisté à expliquer les dangers et à fixer des interdits [...] Par exemple, les interdits d'usage envers les mineurs ou sur la voie publique sont évidemment nécessaires mais ne sont utiles que s'ils servent à la fois de protection et de prévention des nuisances, et surtout s'ils créent des opportunités systématiques de rencontres, de consultations, voire de suivis thérapeutiques, à l'image de ce que fait depuis dix ans le Portugal. » (1) De même, à l'occasion d'une évocation critique de la politique en vigueur, M. Hubert Pfister, ancien président de la Fédération de l'entraide protestante, a affirmé : « Le fait que je ne sois pas adepte de la prohibition ne signifie pas que je sois favorable à la banalisation, ni même à la dépénalisation, qui est une très mauvaise idée. La dépénalisation des drogues est selon moi le type même de la fausse bonne idée, car il est indispensable que les interdits sociaux restent formulés . Pour cela, il faut qu'ils soient intelligibles pour les personnes auxquelles ils s'adressent. » (222 ( * ))
Vos rapporteurs estiment de leur côté que la consommation de drogues est une des « actions nuisibles à la société » que l'article 5 de la Déclaration de 1789 permet à la loi d'interdire .
L'efficacité de la sanction associée est l'objet des contestations les plus vives. Ce biais est traditionnel : prenant acte de la croissance rapide de la consommation de cannabis, le rapport Henrion relevait en son temps : « Aucun rempart douanier ou policier ne semble pouvoir réellement faire échec à cette banalisation du cannabis. Dans ces conditions, conserver une sanction pénale qui n'est pratiquement plus appliquée devient dérisoire et déconsidère la justice aux yeux des adolescents . Certains n'ont d'ailleurs plus conscience de violer un interdit tant le phénomène leur parait banal. »
C'est pourquoi, selon le rapport Henrion, « une réglementation, effectivement appliquée, serait préférable à la situation actuelle où l'usage du cannabis est, au moins dans de nombreux endroits, banalisé et où l'interdit se révèle le plus souvent formel ».
Lors de son audition, le docteur William Lowenstein a déclaré à la mission d'information : « Après quarante ans de pénalisation, il est temps d'en débattre. Quelle est la méthode de décriminalisation la plus adaptée à notre pays ? La dépendance est une maladie et non un crime, paradoxe toujours délicat à faire partager. La plupart des experts reconnaissent, statistiques et expériences internationales à l'appui, que le phénomène des addictions est bien plus socioculturel, médical et individuel que pénal. En d'autres termes, le phénomène des addictions est pratiquement aveugle face à la loi ! Les comportements addictifs sont très peu sensibles aux lois ; cependant, les conséquences sanitaires et sociales des addictions sont d'autant plus violentes et graves que la loi est répressive. »
Ainsi, de l'adolescent expérimentateur au toxicomane confirmé, l'efficacité de la sanction est-elle contestée à chaque extrémité de l'échelle des mésusages.
Vos rapporteurs relèvent derrière ces critiques le risque d'une démission de l'État et du corps social devant les dangers avérés de la drogue .
Du reste, les arguments invoquant le prétendu enracinement culturel de la consommation des drogues illicites apparaissent bien fragiles. Le cannabis n'est pas nécessairement un élément constitutif de notre mode de vie : les non-consommateurs restent très largement majoritaires en France, puisque le nombre des personnes ayant fait un usage du cannabis au moins une fois au cours de la vie s'élève selon l'Observatoire français des drogues et toxicomanies à 12,4 millions contre 34,8 millions pour le tabac et 42,5 millions pour l'alcool).
C'est pourquoi vos rapporteurs estiment que le cannabis n'est pas, en France, un phénomène culturel d'ampleur telle, qu'il soit devenu impossible de s'y opposer. Il reste une transgression, il faut qu'il le demeure afin que les jeunes à qui il arrive de s'y adonner continuent d'y renoncer dans leur grande majorité quand, à la sortie de l'adolescence, le moment vient pour chacun de poser les fondements d'une vie stable. Dépénaliser inciterait ces jeunes à poursuivre. Les chiffres de la consommation de cannabis auraient alors vraisemblablement tendance à s'aligner sur ceux de l'alcool et du tabac. Il faut aussi penser à ce que les conducteurs irresponsables retiendraient de la dépénalisation de la consommation du cannabis en dépit des sanctions attachées aux conduites dangereuses. Là encore, l'assimilation à l'alcool tendrait à banaliser une consommation d'ores et déjà très préoccupante. Rappelons à ce sujet que M. Gilbert Pépin, biologiste, expert près la cour d'appel de Paris, agréé par la Cour de cassation, expert près le tribunal administratif de Paris, a indiqué lors de son audition : « Nous avons effectué une étude, qui porte sur trois années et quatre cent quatre-vingt deux cas, sur les molécules impliquées dans les accidents mortels de la circulation. Nous avons trouvé 31 % de cas positifs aux drogues, dont 27,8 % au cannabis. La totalité des drogues était présente chez 34,3 % des conducteurs sous l'emprise de stupéfiants au moment de l'accident. » M. Gilbert Pépin a aussi cité, rappelons-le, une étude sur les molécules impliquées dans les accidents mortels de la circulation. Cette étude, qui porte sur trois années et 482 cas, fait état de 31 % de cas positifs aux drogues, dont 27,8 % au cannabis, le taux montant à 42 % chez les conducteurs de moins de vingt-sept ans. M. Pépin a aussi indiqué que la dangerosité du cannabis au volant s'établit au moyen d'un coefficient multiplicateur de risques, qui est en France de 2,5, et peut dépasser 14 en cas de combinaison avec l'alcool (223 ( * )) .
Par ailleurs, s'il n'est pas de bonne méthode de légiférer au regard des sondages, il convient pourtant de noter que l'opinion publique n'est pas favorable au renversement de la politique en vigueur. M. Étienne Apaire, président de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie a indiqué à cet égard devant la mission d'information que « si l'on se réfère à une enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes, dite «EROPP», régulièrement renouvelée, cette politique recueille l'accord de la majorité des Français. » (224 ( * ))
b) La dépénalisation de l'usage serait-elle cependant souhaitable en raison des effets pervers allégués de la répression ?
Est-il possible de contourner la légitimité de l'interdit et la nécessité de la sanction qui le garantit en invoquant des effets pervers de la répression ?
Le rapport Henrion présente ainsi la position des partisans d'une dépénalisation de l'usage des drogues illicites : « Il leur apparaît au contraire que la logique de la position répressive est de sacrifier une part du travail de prévention et de réduction des risques à la poursuite d'un objectif de réduction de la consommation de drogues que la répression n'a pas permis d'atteindre jusqu'à présent. Il semble que la montée des risques sanitaires et l'état de très grande détresse sociale de certains toxicomanes qui en est inséparable, rendait cette position irréaliste et la condamnait. Ils ont, en outre, fait valoir que l'idée selon laquelle la pénalisation traduisait un sentiment responsabilité collective à l'égard de la drogue était critiquable, et qu'il pouvait également être affirmé qu'elle entretenait une diabolisation du phénomène qui pouvait conduire la population à décharger sur la police sa prise en charge, comme c'est le cas aujourd'hui. La dépénalisation peut, selon eux, mettre l'accent sur la nécessité de maintenir auprès des jeunes, et dans les quartiers les plus exposés aux violences de tous ordres, des médiateurs capables de leur donner des repères, la toxicomanie n'étant qu'un des risques parmi d'autres auxquels ces jeunes exposés. Beaucoup de personnes entendues par la commission ont insisté sur ce point. Enfin, ceux des membres de la commission qui avaient une expérience professionnelle associative du travail de prévention auprès des personnes en grande difficulté sociale ont mis en doute l'idée selon laquelle la pénalisation peut constituer une possibilité concrète d'aider ceux chez lesquels une lourde toxicomanie est associée à des difficultés de vie anciennes et multiples. Deux positions tranchées se sont donc affrontées. Les uns estiment que la répression de l'usage est dissuasive pour le citoyen, utile pour les services de police, qu'elle permet de prendre en charge des toxicomanes et concourt à la résorption du phénomène. Les autres estiment que l'objectif de résorption est fictif s'il est poursuivi de cette manière, et qu'il devient danger dès lors que l'interpellation des usagers contribue à faire obstacle à ce qu'ils soient prévenus des risques très graves pour la santé publique. »
Un autre argument de la dépénalisation conçue comme antidote aux effets pervers de la prohibition tient aux conséquences du caractère clandestin de l'usage, du commerce et de la production des substances illicites. D'une part, le contrôle de la qualité des produits est impossible en régime de prohibition, d'autre part, la prohibition favoriserait la consommation des drogues les plus dangereuses .
Un argument supplémentaire des tenants de la dépénalisation invoque l'étouffement des trafics par la suppression de la prohibition qui les a suscités . Le rapport Henrion note à cet égard que « le prix des produits sur le marché clandestin impose au toxicomane dépendant de mobiliser d'importantes ressources pour se procurer le produit. Les usagers dépendants se trouvent ainsi contraints, dans une large mesure, de recourir à des moyens illégaux pour financer une consommation qui excède assez vite leurs moyens financiers. Comme le confirment des enquêtes menées dans certains milieux de toxicomanes défavorisés, le vol, la prostitution et la revente de drogues sont les trois possibilités qui s'offrent à ces usagers pour financer leur consommation. Cette situation suffit, par elle-même, à renforcer le lien entre drogue et criminalité. Le caractère addictif des substances fait du toxicomane dépendant un client captif. La prohibition et les conditions particulières du marché clandestin en font un vendeur modèle. » Par ailleurs, « l'importance des profits potentiels dont cette explosion des prix de vente est porteuse est exploitée par des organisations criminelles structurées, qui tirent parti, partout dans le monde, des failles du système prohibitionniste pour exploiter la rente qu'il engendre. En assurant à la fois le maintien d'un prix élevé et d'un haut niveau de risque, la prohibition facilite la prise de contrôle du marché de la drogue par les criminels les plus dangereux et les mieux organisés. »
Vos rapporteurs estiment de leur côté, tout d'abord, que l' on ne peut raisonnablement affirmer que la pénalisation de la consommation fait obstacle à l'efficacité de la réduction des risques . Ce pouvait être le cas en 1995, date d'adoption du rapport Henrion, alors que cette politique était balbutiante. On n'en est plus là : le présent rapport rappelle l'avancée progressive, les succès et l'ancrage définitif de cette politique devenue l'un des volets les plus dynamiques de la politique de lutte contre les toxicomanies.
Par ailleurs, les auditions de la mission d'information ne permettent nullement d'accréditer l'idée d'une morbidité significative due à l'absence de contrôle de la qualité des produits illicites : ce sont les produits eux-mêmes qui sont nocifs, les substances servant au coupage étant, à ce qu'il semble, généralement plutôt inoffensives, comme il est indiqué dans la première partie du présent rapport. C'est bien pour cela que les salles d'injection supervisées peuvent s'abstenir d'effectuer un contrôle de la qualité des produits injectés ou inhalés dans leur enceinte, comme une délégation de la mission d'information l'a constaté lors de sa visite de Quai 9 à Genève.
Du reste, les auditions ont mis en lumière l'extrême capacité d'adaptation des trafiquants. Ceux-ci agissent généralement simultanément sur les marchés de plusieurs drogues qu'ils gèrent avec une remarquable habileté commerciale en manipulant la demande, en faisant par exemple varier les prix pour relancer tel ou tel marché, en renouvelant et en diversifiant l'offre. Il serait naïf d'imaginer que ces trafiquants ne sauraient pas créer une demande de produits non dépénalisés, non contrôlés, d'autant plus dangereux que leur raison d'être serait leur puissance, afin de faire perdurer leur commerce . Dès lors, l'argument de la qualité des produits n'est en aucun cas recevable . On le vérifie avec l'exemple connexe du trafic des pièces détachées : des produits légaux, des trafiquants sans scrupules, un marché parallèle, des contrefaçons bon marché, un risque accru pour les consommateurs...
Enfin, le lien de cause à effet entre la prohibition, d'une part, la petite et la grande criminalité, de l'autre, est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il ne suffirait pas de supprimer la cause, la prohibition, pour supprimer la conséquence, la criminalité liée aux trafics . Les organisations criminelles s'adaptent en effet aux évolutions de leur environnement : que l'on sache, la fin de la prohibition de l'alcool aux États-Unis n'a pas fait disparaître les mafias dont cette même prohibition avait favorisé l'essor : au trafic de l'alcool s'est substitué celui de la drogue... Il en irait de même, mutatis mutandis , si la prohibition de la consommation du cannabis était décidée. Comme le remarquait devant la mission d'information M. François Thierry, commissaire divisionnaire, chef de l'Office central pour la répression du trafic des stupéfiants, « le cannabis n'est pas un produit stable, on l'a vu : si vous autorisez la production d'un cannabis le moins dangereux pour la santé, à 10 % de THC, les organisations criminelles vendront du 30, du 35 ou du 38 %. Ils en vendront aux mineurs si vous en avez interdit la vente aux mineurs ; ils en vendront la nuit si vous avez interdit la vente de nuit ! C'est ce qui se passe aux Pays-Bas, où toutes sortes de commerces sont apparues à côté du commerce légal, ce qui ne résout rien. [...] Autoriser un produit de plus ne diminuera pas l'activisme très violent de ces organisations criminelles, ni leur activité. Les Pays-Bas, qui s'étaient engagés dans cette voie, sont en train d'en revenir. Ils subissent des conflits entre bandes rivales qui se battent pour fournir les coffee shops . Les coffee shops sont autorisés à vendre 100 kg d'une provenance fléchée mais en vendent en fait 2 tonnes : 100 kg de la provenance fléchée et, sous le manteau, 1,9 tonne de provenances diverses ! » (225 ( * )) Comme le relevait aussi M. Jérôme Fournel, directeur général des douanes et des droits indirects : « On avance souvent, en faveur de la dépénalisation, l'idée que l'on supprimerait de la sorte une bonne partie de l'économie souterraine. Mais on voit bien qu'il n'en est rien pour un produit pourtant légal comme le tabac. Les caches, la structure, la complexité et l'organisation des filières de la contrebande de tabac ne sont pas très différentes de ce qui se fait en matière de stupéfiants. [...] La polyvalence des organisations criminelles est en outre très forte : les réseaux criminels n'hésitent pas à acheter de la cocaïne à un endroit et à vendre du cannabis à un autre, en fonction des demandes des différents marchés. On n'a pas encore observé une telle porosité entre les stupéfiants et le tabac, mais on sait que les organisations mafieuses comme la Camorra font du trafic de cigarettes, y compris pour se procurer des ressources qu'elles investissent ensuite sur le marché des stupéfiants. Il apparaît par ailleurs extrêmement difficile d'établir une frontière entre les échanges autorisés et non autorisés, ce que confirment d'ailleurs nos collègues des pays où certains stupéfiants sont dépénalisés. » (226 ( * ))
Comment croire, en effet, que les trafiquants impliqués dans de multiples trafics de drogues, de cigarettes, de pièces détachées, de tous produits susceptibles de rapporter des gains immenses pour peu que l'on franchisse, où qu'elle se trouve, la frontière - qui existe nécessairement - entre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, comment croire que ces trafiquants « fermeront boutique » quand on leur aura signifié que l'État prend désormais l'affaire en charge et qu'il n'y a plus lieu de méfaire !
c) Les engagements internationaux de la France
Plusieurs conventions internationales multilatérales ratifiées par la France régissent actuellement le domaine des stupéfiants :
- la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972 ;
- la convention de 1971 sur les substances psychotropes ;
- la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.
Leur objectif est d'assurer un usage sans risque des substances psychoactives potentiellement dangereuses et de prévenir la consommation de médicaments sans utilité médicale.
Dans cette perspective, les conventions de 1961 et de 1971 n'autorisent ni la détention ni l'usage illicites de substances placées sous contrôle qui n'ont pas été médicalement prescrites. Elles prévoient l'attribution de la qualification d'infractions pénales aux comportements contraires. C'est ainsi que l'article 36 de la convention de 1961 telle que modifiée par le protocole de 1972 stipule :
« 1. a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, la mise en vente, la distribution, l'achat, la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition en transit, le transport, l'importation et l'exportation de stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte qui, de l'avis de ladite Partie, serait contraire aux dispositions de la présente Convention, constituent des infractions punissables lorsqu'elles sont commises intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d'un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d'autres peines privatives de liberté.
« b) Nonobstant les dispositions énoncées à l'alinéa précédent, lorsque des personnes utilisant de façon abusive des stupéfiants auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la condamnation ou de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d'éducation, de postcure, de réadaptation et de réintégration sociale conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 38 [...] »
Par ailleurs, le 2 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de psychotropes du 19 décembre 1988 stipule : « Sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique, chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, à la détention et à l'achat de stupéfiants et de substances psychotropes et à la culture de stupéfiants destinés à la consommation personnelle [...] ».
Les États parties aux conventions internationales relatives au contrôle des drogues, dont la France, sont donc tenus d'attribuer une qualification d'infraction pénale à l'usage de drogues illicites.
Questionné sur cette obligation lors de son audition par la mission d'information, M. Marc Moinard, magistrat et membre de l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), qui est l'organe de contrôle établi en 1968 par la convention unique sur les stupéfiants de 1961 afin de surveiller l'application des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues, a confirmé : « S'agissant de la question de la légalisation pour consommation personnelle, les traités ne le permettent pas. » (227 ( * ))
L'ensemble des considérations qui précèdent conduit la mission d'information à réaffirmer clairement l'objectif d'une société sans drogues et de son corrélat, la pénalisation de l'usage des stupéfiants . Cet objectif fixe un cap, prévient la tentation de la démission et, par contrecoup, rend possible une action publique pragmatique, attentive aux réalités complexes du terrain. La politique française de lutte contre les toxicomanies est guidée par ce double souci de clarté et de pragmatisme.
3. Mieux assurer l'efficacité de l'interdit en modulant l'échelle des peines
L'objectif d'une société sans drogues justifié, la nécessité de l'interdit validée, la sanction est-elle efficacement assurée par le dispositif en vigueur ? L'un des maîtres mots, en ce qui concerne l'efficacité de la sanction, est sans doute, en la matière, modulation . Il faut moduler la sanction de l'usage afin qu'elle frappe avec discernement et atteigne son but, qui est de dissuader les débutants et, s'agissant des usagers problématiques, de favoriser les conditions d'une sortie de la toxicomanie. La modulation est déjà très largement en vigueur. Elle reste insuffisante .
a) Une réponse pénale d'ores et déjà modulée en fonction de l'efficacité recherchée
? Le clair rejet de principe de toute consommation
La loi du 31 décembre 1970 a introduit dans le code de la santé publique des dispositions pénales sanctionnant toute consommation de drogue illicite.
L'article L. 3421-1 du code de la santé publique dispose en ses deux premiers alinéas : « L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. » Ainsi la loi ne fait-elle pas de distinction entre les stupéfiants selon leur dangerosité. Ce parti pris a souvent été critiqué comme irréaliste et de nature à décrédibiliser la loi. A posteriori , les progrès de la connaissance des effets des stupéfiants, jamais anodins, jamais « doux », rappelés dans la première partie du présent rapport, donnent pourtant raison au législateur. On notera par ailleurs que la détention de petites quantités de produits stupéfiants est souvent assimilée par l'autorité judiciaire à l'usage, de même que la culture de cannabis lorsqu'elle est destinée à une consommation personnelle.
L'usage est ainsi un délit quel que soit le produit . Ajoutons que toute modalité d'usage est un délit , ce qui suscite aussi des critiques, dénuées de pertinence au regard de l'objectif d'une société sans drogues.
? Une large modulation de la réponse pénale en fonction de la diversité des usages et des usagers
* La nécessité d'adapter la réponse pénale au comportement des usagers de drogues
La nécessité de tenir compte, en matière répressive, de la diversité des usages et des usagers ne semble guère contestée. Le professeur Daniel Bailly, pédopsychiatre, professeur de psychiatrie à l'université d'Aix-Marseille, a ainsi indiqué : « On reste centré sur le produit mais il n'a aucune espèce d'importance. On sait très bien que les sujets qui ont une addiction à internet ont aussi une addiction au tabac, à l'alcool, à la cocaïne, etc. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi un individu, quand il a rencontré un comportement ou un produit, en est venu à utiliser ce produit de telle façon qu'il ne peut plus s'en passer ! Cela touche moins de 20 % des consommateurs, même chez les adolescents. Autant la consommation est largement répandue et touche tous les adolescents, autant l'abus et la dépendance sont des phénomènes assez limités. » (228 ( * ))
De fait, un usager n'est pas l'équivalent d'un autre, il n'y a pas fongibilité des usages . Ceci rejoint le constat ci-dessus rappelé du rapport Henrion sur la difficulté d'assimiler l'adolescent fumeur occasionnel de haschich à l'héroïnomane se piquant plusieurs fois par jour. M. Alain Rigaud, président de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, à de son côté relevé que « depuis 1998, la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie et ses présidents successifs ont fait évoluer les approches, l'approche par produit ayant cédé la place à une approche par comportement. Or les comportements sont eux aussi pluriels, avec des risques divers induisant des états plus ou moins pathologiques, selon un continuum clinique de gravité. Les politiques publiques, tant au niveau de la prévention qu'à celui de la réponse, doivent donc couvrir un spectre très large et répondre à des besoins de plus en plus différenciés que les usagers eux-mêmes, « engloutis » dans les toxicomanies, sont souvent de moins en moins en mesure d'exprimer et qu'il incombe de plus en plus aux professionnels d'identifier. » (229 ( * ))
La mission d'information ne peut que rejoindre ces opinions de bon sens. La modulation de la réponse publique à l'usage de drogues illicites est justifiée ; elle doit être effectuée en fonction de la particularité et des dangers sanitaires et sociaux que représente chaque type d'usage. Du reste, cette modulation est d'ores et déjà largement inscrite dans les pratiques et dans les textes .
* Les circulaires ministérielles de politique pénale relatives au traitement de l'usage des drogues illicites prennent en compte de la nécessité d'observer la diversité des usages
Les circulaires d'application de la loi du 31 décembre 1970 ont constamment préconisé une mise en oeuvre modulée de la réponse pénale en fonction de distinctions variées entre les usages et entre les usagers. La circulaire Chalandon du 12 mai 1987 a ainsi effectué une distinction entre les « usagers occasionnels » et les « usagers d'habitude ». La circulaire Guigou du 17 juin 1999 a recommandé de systématiser les mesures alternatives aux poursuites en cas de « simple usage ». Cette circulaire précisait par ailleurs que « sont à proscrire les interpellations du seul chef d'usage de stupéfiants à proximité immédiate des structures à bas seuil ou des lieux d'échanges de seringues », ce qui avait pour effet de soustraire à la répression de droit commun, dans un but de réduction des risques sanitaires confirmé depuis par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, certains usagers en fonction de leur localisation.
La circulaire Perben du 8 avril 2005, tout en confirmant le refus du gouvernement de banaliser la consommation de produits stupéfiants, a préconisé une réponse pénale graduée elle aussi en fonction du type de consommation et de la nature des usagers. En ce qui concerne les majeurs :
- le classement sans suite est considéré comme à éviter absolument ;
- le classement accompagné d'un rappel à la loi est présenté comme approprié aux usagers sans antécédents judiciaires d'infractions à la législation sur les stupéfiants pouvant détenir de très faibles quantités ;
- le classement sous condition et le classement avec orientation sanitaire s'adresse aux usagers occasionnels ou réguliers ;
- l'injonction thérapeutique est estimée convenir aux usagers de drogues dures et polytoxicomanes ;
- la composition pénale convient pour les usagers récidivants ;
- les poursuites pénales sont préconisées pour les usagers réitérants, tout en privilégiant les soins.
Les circulaires d'application en vigueur empruntent, nous le verrons, la même approche.
* La loi elle-même, au-delà de l'apparente uniformité de l'interdiction de l'usage, observe la gravité de l'infraction sanctionnée
La loi, tout en conservant à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique le principe de la pénalisation indistincte de l'ensemble des usages, a développé la gamme des mesures et des sanctions disponibles afin de donner aux autorités judiciaires la possibilité de choisir cas par cas la réponse la mieux adaptée à la réalité changeante des comportements. Lors de son audition par la mission d'information, Mme Françoise Baïssus, chef du bureau de la santé publique, du droit social et de l'environnement du ministère de la justice, a confirmé : « La volonté publique dans ce domaine n'a cessé de se préciser, de s'affiner ; elle a, depuis 1970, en particulier avec la loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007, multiplié, diversifié, individualisé la réponse pénale. Je ne parle pas de poursuites mais, volontairement, de réponse pénale, pour rendre compte du large éventail des outils disponibles. » (230 ( * ))
Emblématique de cette démarche, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a créé le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants (article L. 131-35-1 du code pénal). Obligatoire et payant, le stage a pour objet, selon le décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007, de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits. Il peut être prononcé par le procureur de la République à différentes étapes de la procédure pénale, comme alternative aux poursuites, dans le cadre de la composition pénale, ainsi que dans le cadre d'une ordonnance pénale, ou encore à titre de peine complémentaire. Il peut être prononcé à l'égard des mineurs âgés d'au moins treize ans selon les modalités prévues par les articles 7-1 et 7-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Rappelons que les mesures alternatives aux poursuites, la composition pénale et l'ordonnance pénale, ne sont pas spécifiques à la répression de l'usage des stupéfiants.
Dans le cadre de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites, le procureur de la République peut mettre en oeuvre des mesures alternatives aux poursuites. En fonction de la gravité et de la nature des infractions commises, « s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits », il peut notamment procéder à un rappel à la loi et orienter l'auteur de l'infraction vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle (article 41-1 du code de procédure pénale).
La composition pénale est un type particulier de procédure alternative aux poursuites. Elle a été créée par la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale afin d'apporter une réponse systématique aux actes de petite et moyenne délinquance faisant souvent l'objet de classement sans suites. Elle permet au procureur de la République de proposer une ou plusieurs mesures (amende, travail non rémunéré au profit de la collectivité pour une durée maximale de 72 heures dans un délai n'excédant pas six mois, etc.) à une personne reconnaissant avoir commis un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans ou d'avoir été auteur de contraventions. Elle peut être appliquée aux mineurs de plus de 13 ans lorsqu'elle paraît adaptée à la personnalité de l'intéressé et sous certaines conditions précises. Prononcée en contrepartie de l'abandon des poursuites, elle est pourtant mentionnée sur le casier judiciaire (article 41-2 du code de procédure pénale) car, décidée par le parquet, elle est validée par le président du tribunal.
L'ordonnance pénale s'inscrit de son côté dans le cadre de poursuites judiciaires. Il s'agit d'une procédure de jugement simplifiée et rapide. Cette procédure a été créée par la loi du 3 janvier 1972 pour les contraventions à la règlementation de la circulation routière. La loi du 9 septembre 2002 sur l'orientation et la programmation de la justice en a étendu le champ d'application aux délits. Elle est rendue par une juridiction pénale sans débat contradictoire préalable. Le tribunal peut décider de condamner l'auteur de l'infraction, sans qu'il comparaisse, à une amende ou à certaines peines comme la suspension du permis de conduire. En cas de condamnation, l'intéressé dispose de trente jours pour s'acquitter du montant de l'amende ou faire opposition.
La répression aggravée des usages dangereux pour autrui est une autre forme de modulation de la loi.
La loi institue en effet des circonstances aggravantes augmentant les peines encourues. C'est ainsi que :
- les articles L. 235-1 à L. 235-4 du code de la route disposent : « Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende. » De nombreuses peines complémentaires sont prévues. En outre, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite et l'infraction donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
- l'article L. 3421-1 du code de la santé publique institue des peines plus sévères (cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende) lorsque l'usage de stupéfiants est commis par des personnes exerçant une profession susceptible de mettre directement en danger la vie d'autrui, telles que les transporteurs, ainsi que par des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public lorsqu'ils ont fait usage de stupéfiants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ;
- l'article L. 3421-4 du même code aggrave les peines encourues lorsque l'infraction d'usage est commise dans l'enceinte des établissements d'enseignement, d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi qu'à leurs abords à l'occasion de l'entrée et la sortie des élèves ou du public ;
- les articles 222-12-14, 222-13- 14, 222-24-12, 222-28-8, 222-30-7 et 227-26-5 du code pénal prévoient une circonstance aggravante en cas de violences commises sous l'emprise manifeste de stupéfiants, ainsi que pour les faits de viol, d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles commis dans les mêmes circonstances.
? Un autre type de modulation : l'accompagnement sanitaire et social associé à la répression
L'accompagnement sanitaire et social associé à la répression est un autre moyen de moduler la réponse pénale. La loi du 31 décembre 1970 permet en effet de considérer l'usage de stupéfiants comme une conduite à risque pouvant nécessiter l'intervention de professionnels du réseau sanitaire et social.
Selon la circulaire relative à la lutte contre la toxicomanie et les dépendances du 19 mai 2008, le stage de sensibilisation , initié par la loi du 5 mars 2007 « est une mesure dont la portée pédagogique est indéniable. Il doit faire prendre conscience au consommateur des dommages induits par la consommation de produits stupéfiants, ainsi que des incidences sociales d'un tel comportement. [...] Le procureur de la République peut proposer le stage de sensibilisation à l'auteur des faits dans le cadre des alternatives aux poursuites (art. 41-1 CPP) et dans celui de la composition pénale (art. 41-2 CPP). Il peut le proposer à tout auteur majeur ainsi qu'aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par les articles 7-1 et 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Ce stage peut aussi être ordonné dans le cadre de l'ordonnance pénale et à titre de peine complémentaire au même titre que celles traditionnellement encourues. Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants peut aussi être ordonné à titre de peine complémentaire pour réprimer la conduite d'un véhicule sous l'influence de produits stupéfiants (art. L. 235-1 du code de la route), les atteintes à la vie, les infractions entraînant une mise en danger de la personne, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne, les extorsions et les dégradations. [...] Par principe, les frais du stage de sensibilisation seront à la charge de l'usager. À titre exceptionnel, il pourra être décidé de le dispenser du paiement de tout ou partie du coût du stage dans les cas ci-après indiqués où la loi le permet. Cette décision sera évidemment guidée par l'examen de la situation familiale et sociale de l'usager. La dispense de paiement devra être réservée au bénéfice des usagers pour lesquels un stage de sensibilisation apparaît hautement souhaitable et qui sont réellement dans l'impossibilité d'en assumer la charge financière [...] »
Sans doute conviendrait-il de permettre l'association des parents à l'exécution de cette mesure lorsqu'elle concerne les mineurs , dans une logique identique à celle d'une meilleure association des familles aux actions de prévention recommandée par ailleurs dans le présent rapport.
L'injonction thérapeutique a été introduite dans le code de la santé publique par la loi du 31 décembre 1970. Il s'agit, selon l'article L. 3413-1 du code de la santé publique, d'une mesure de soin ou d'un suivi médical : « Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe le directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin habilité en qualité de médecin relais [...] ». L'article L. 3413-2 du même code précise : « Si l'examen médical prévu à l'article L. 3413-1 confirme l'état de dépendance physique ou psychologique de l'intéressé, le médecin relais invite ce dernier à se présenter auprès d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office, pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une surveillance médicale adaptés. »
L'utilisation de cette mesure a été freinée, selon le rapport de politique pénale 2006 cité par la circulaire relative à la lutte contre la toxicomanie et les dépendances du 19 mai 2008, le plus souvent par manque de moyens sanitaires et sociaux. La loi du 5 mars 2007 a fait du médecin relais institué par elle le pivot du fonctionnement de l'injonction thérapeutique. La même loi a par ailleurs élargi les possibilités de recours à cette mesure. Celle-ci peut désormais être mise en oeuvre dans le cadre des alternatives aux poursuites et de la composition pénale, à l'égard de l'usager majeur comme du mineur de treize ans au moins, comme modalité d'exécution d'une peine, notamment dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, y compris en matière d'infractions liées à l'abus d'alcool. Elle peut être également ordonnée par le juge d'instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que par la juridiction de jugement.
Il s'agit donc de remédier à « l'état de dépendance physique ou psychologique » du toxicomane. La circulaire relative à la lutte contre la toxicomanie et les dépendances du 19 mai 2008 ne mentionne pas explicitement les communautés thérapeutiques parmi les modalités possibles de mise en oeuvre de la mesure. Pourtant ces dispositifs, certes encore très insuffisamment implantés sur le territoire français, obtiennent de beaux succès, comme le montre la deuxième partie du présent rapport. Aussi conviendrait-il de promouvoir leur utilisation par les autorités judiciaires .
b) Une modulation néanmoins insuffisante au regard des réalités de la répression
? Des interpellations pour usage nombreuses mais focalisées
Selon Mme Françoise Baïssus, chef du bureau de la santé publique, du droit social et de l'environnement du ministère de la justice, « Sur 65 millions de Français, 12 millions ont consommé des produits illicites, 1 à 2 millions ayant une consommation régulière de produits stupéfiants. 800 à 900 000 sont des consommateurs réguliers de résine de cannabis, surtout dans la tranche d'âges 15-25 ans. » (231 ( * )) L'usage est donc une délinquance de masse et, comme tel, appelle des sanctions fréquentes, acceptables, crédibles et équitables. À défaut, la répression fonctionne peu et mal. De fait, les lacunes du dispositif de répression sont flagrantes.
Ainsi, il y a eu, en 2009, 137 594 interpellations pour
usage simple
- distingué de l'usage-revente - de
stupéfiants. Ces interpellations ont à 90 % concerné
l'usage de cannabis. Mme Françoise Baïssus a déclaré
à ce propos : « O
n considère aujourd'hui que
les interpellations ont été multipliées par deux depuis la
fin des années 1990
». L'évolution du taux de
croissance et en valeur absolue est impressionnante mais reste faible au regard
du chiffre des consommateurs réguliers ou occasionnels.
En outre, les interpellations épargnent des catégories entières de consommateurs .
Selon certaines études, la population la plus susceptible d'être interpellée est constituée d'une « clientèle policière » ne comprenant pas les usagers responsables de la majorité des actes délictueux. La population dont le dernier usage est intervenu au lycée et celle des plus gros consommateurs, dont le dernier usage a eu lieu au domicile passent ainsi au travers du filet de la répression (232 ( * )) . M. Henri Bergeron, chercheur, auteur de Sociologie de la drogue a indiqué dans le même sens à la mission d'information : « les études montrent que les populations contrôlées par exemple pour la consommation de cannabis sont situées dans des zones géographiques défavorisées, alors que les études de l'OFDT, sur Paris, prouvent que les quartiers riches consomment plus de cannabis que les quartiers pauvres ! » (233 ( * ))
Dès l'étape de l'interpellation, le système répressif souffre manifestement d'un dysfonctionnement d'autant plus regrettable que figurent parmi les catégories bénéficiant d'une sorte d'immunité de fait la population des jeunes collégiens, lycéens, apprentis et étudiants, pour lesquels il serait essentiel de faire jouer l'effet dissuasif de la sanction pénale.
? Une réponse judiciaire en progrès mais durablement lacunaire
Entre 2001 et 2008, le volume d'affaires d'usage de stupéfiants traitées par les parquets est passé de 10 261 à 17 553. La part des classements sans suite et des affaires jugées non poursuivables a diminué de 29,3 % à 8,5 %.
La statistique semble témoigner du souci de la justice de maximiser la réponse pénale à l'usage de drogues illicites. Mme Françoise Baïssus, chef du bureau de la santé publique, du droit social et de l'environnement du ministère de la justice, a indiqué à ce propos à la mission d'information : « La circulaire du 9 mai 2008 a déterminé ses orientations en vue afin d'éviter de banaliser la consommation de drogues. C'est un point important, que l'on a largement défini et décliné à l'intention des procureurs généraux et des procureurs de la République. [...] Ceci mérite d'être relevé : qui dit politique pénale dit prise de conscience du fait qu'il faut apporter au moins une réponse pénale. La circulaire du 9 mai 2008 est très claire sur ce point : les réponses doivent être individualisées, appropriées, en fonction du profil de l'usager, mais systématiques, notamment lorsqu'il s'agit d'usagers mineurs » (234 ( * )) .
Néanmoins, les alternatives aux poursuites ont représenté 70,4 % des affaires traitées par les parquets en 2008 contre 54,7 % en 2001. Au sein de cette catégorie de mesures, les rappels à la loi, pourtant peu dissuasifs pour les consommateurs, conservent une place très largement prépondérante, même si leur part est passée de 81,3 % en 2001 à 73,4 % en 2008 . L'Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT), dans un document intitulé Cannabis, données essentielles, 2007 , relevait déjà ces caractéristiques : « ces affaires d'usage [de cannabis] sont rarement classées sans suite, en particulier quand il s'agit de mineurs. Elles sont majoritairement (et de plus en plus fréquemment) traitées par une mesure alternative aux poursuites (80 % des procédures en 2005, contre 56 % en 2002). Concrètement, il s'agit le plus souvent d'un rappel à la loi (71 % en 2005), d'une injonction thérapeutique (14 %) ou d'un classement avec orientation sanitaire (8 %). »
La réponse pénale, lacunaire et pusillanime parce qu'inadaptée aux réalités quotidiennes de la consommation de drogues illicites, apparaît dès lors très modérément efficace à l'égard de ce que la circulaire relative à la lutte contre la toxicomanie et les dépendances du 19 mai 2008 appelle l'usager simple , c'est-à-dire le « délinquant usager occasionnel de produits stupéfiants ou consommateur régulier qui ne pose toutefois pas de problèmes de santé ou d'insertion majeure, et qui détient une très petite quantité de substances ». Comme l'indiquait devant la mission d'information M. Gilles Leclair, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense Sud : « Peu à peu, les magistrats ont renoncé à se faire présenter les personnes au-dessous d'un certain seuil de détention de produit et ont même renoncé à toute procédure à l'encontre des usagers de cannabis : au mieux, on les enregistre dans le fichier national des auteurs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, mais il n'y a plus de réponse pénale et médicale. » (235 ( * ))
Au regard de ce constat, un instrument fait manifestement défaut dans la gamme des réponses judiciaires .
Sa création aurait en outre l'avantage d'introduire plus de cohérence et plus de réalisme dans la panoplie pénale en vigueur.
c) Conforter la réponse pénale et corriger les incohérences en créant une incrimination d'usage simple sanctionnée par une contravention
? Remédier aux incohérences du dispositif en vigueur
Certaines remarques ou prises de position exprimées devant la mission amènent les rapporteurs à s'interroger sur la cohérence de plusieurs éléments du régime juridique de l'usage de drogues. Est-il, en particulier, durablement envisageable de faire encourir à de jeunes consommateurs de cannabis nullement voués à l'addiction une peine de prison d'un an tout en renonçant par avance, sans trop le dire, à appliquer la sanction ? Qu'en est-il alors de la valeur de l'interdit, du respect dû à la loi ? Est-il raisonnable de remettre à la discrétion des procureurs de la République le choix de ne pas engager les poursuites pénales contre des « délinquants » que le jeune âge incite à débusquer l'incohérence et à dénoncer l'arbitraire des adultes ? L'hétérogénéité territoriale de la politique pénale pratiquée à l'encontre de telle ou telle catégorie de jeunes primo-usagers est-elle soutenable ? Mme Françoise Baïssus, chef du bureau de la santé publique, du droit social et de l'environnement du ministère de la justice, a déclaré à ce propos : « Même si la mise en oeuvre n'est pas forcément uniforme dans tous les tribunaux de France métropolitaine et d'outre-mer, il n'existe pas un tribunal qui n'ait pas de politique pénale en matière d'usage de stupéfiants. Ceci mérite d'être relevé : qui dit politique pénale dit prise de conscience du fait qu'il faut apporter au moins une réponse pénale. » (236 ( * )) On a vu que cette réponse pénale n'est actuellement en rien garantie, du fait même de l'absence de réalisme de son architecture ; quand elle intervient, on souhaiterait du moins qu'elle soit uniforme d'une cour d'appel l'autre pour chaque catégorie significative d'usagers. Ce n'est pas le cas : un fumeur de haschich court en principe le risque de s'entendre condamner à un an de prison à tel endroit mais ne subit que les rigueurs tempérées du rappel à la loi à tel autre. Telles sont les conséquences normales de l'indépendance des parquets. Les circulaires ministérielles d'application de la loi du 31 décembre 1970 tentent, apparemment sans grands résultats on l'a vu, d'harmoniser et de rationaliser la politique pénale des parquets. Le législateur peut sans doute contribuer au résultat attendu en créant une peine contraventionnelle de primo-usage.
? Répondre à la réalité du primo-usage
Il s'agit de dissuader l'usager débutant - surtout le jeune - tout en continuant d'orienter l'usager problématique vers la prise en charge thérapeutique et sociale décrite dans la deuxième partie du présent rapport. Dans l'intervalle de ces deux extrêmes, les solutions mentionnées plus haut, à commencer par le stage de sensibilisation, doivent bien entendu rester appliquées.
La création d'une amende contraventionnelle sanctionnant la première consommation procède ainsi du constat que le primo-usager constitue une catégorie spécifique et appelle une réponse telle. Le monde de la drogue est bien une juxtaposition de situations très diverses qui rendent indispensable, en matière répressive comme en matière de traitement, la création d'outils diversifiés.
? Diversifier le public soumis à la réponse pénale
Cet effet attendu de la contraventionnalisation des premiers usages résulte des observations présentées plus haut sur la probable étroitesse du public faisant actuellement l'objet d'une réponse pénale à l'usage de drogues illicites. La possibilité d'infliger une contravention forfaitaire aux abords des collèges et lycées, par exemple, devrait favoriser la prise de conscience de l'interdit par toute une nouvelle population d'expérimentateurs.
? Désengorger les tribunaux
On notera pour mémoire, car cette préoccupation n'est pas au coeur des sujets d'intérêt de la mission d'information, l'opportunité de concourir au désengorgement des tribunaux. En dépit de ses lacunes notoires, l'exercice des poursuites contre les usagers de drogues illicites joue en effet un rôle dans la charge de travail des parquets et des juridictions pénales.
? Responsabiliser les parents
Même fixée à un taux modeste, on peut penser que la contravention alertera les parents des mineurs sur les pratiques de leurs enfants et la nécessité de s'impliquer dans la prévention.
? L'argument contraire de la perte de la possibilité de remonter les filières
L'enquête policière et la garde à vue offrent l'opportunité de remonter les filières à partir des informations livrées par l'usager interpellé, y compris le primo-usager. C'est pourquoi les magistrats et policiers auditionnés par la mission se sont prononcés contre la contraventionnalisation. Ainsi, M. François Thierry, commissaire divisionnaire, chef de l'office central pour la répression du trafic des stupéfiants, a estimé : « Il est important de conserver des infractions qui permettent de toucher les organisations criminelles ; si vous les supprimez, vous privez les services d'enquête d'un moyen d'accès à ces organisations. Il s'agit d'infractions occultes, difficiles à mettre en lumière. La situation peut être très calme dans un quartier alors que celui-ci est aux mains d'une organisation de trafiquants ! Un intérêt de l'incrimination est de contraindre l'usager à nous parler, avant de l'envoyer chez le médecin ou l'assistante sociale. » (237 ( * )) De même, pour Mme Françoise Baïssus, chef du bureau de la santé publique, du droit social et de l'environnement du ministère de la justice : « On a largement évoqué cette possibilité en 2004. Il est très intéressant de conserver l'infraction délictuelle avec une peine d'emprisonnement à la clé et la possibilité de garde à vue : c'est une façon irremplaçable de remonter les trafics. Lors de la préparation de la loi sur le dopage, nous avons cherché à pénaliser l'usage de produits dopants : faute d'y être arrivés, on ne parvient pas à remonter les filières. C'est évidemment sur le consommateur qu'il faut se concentrer si l'on veut remonter le trafic. C'est toujours ainsi que les choses se passent, il s'agit d'un cadre procédural qui simplifie la remontée des filières et améliore la possibilité de lutter contre le trafic. » (1) Néanmoins, la réforme de la garde à vue limite la possibilité de faire pression au cours de la garde à vue sur les personnes interpellées. Surtout, selon M. Bernard Petit, sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière à la direction générale de la police nationale, « la disparition de l'incrimination délictuelle ferait perdre à nos collègues des brigades territoriales ou des commissariats, qui sont en contact avec l'usager, la possibilité de remonter au moins un échelon dans la filière, et d'atteindre le petit trafiquant implanté dans une rue ou une barre d'immeubles, où il cause déjà des dégâts. En revanche, elle serait sans effet sur ceux qui enquêtent sur le trafic national ou international et mènent des actions d'entrave aux arrivages massifs. » (238 ( * )) Au regard de l'intérêt social d'une réponse pénale plus efficace et effective car mieux calée sur la réalité des faits, la perte, par la police, de la possibilité de remonter du primo-consommateur verbalisé sur le trottoir du lycée à son fournisseur immédiat apparaît largement indifférente .
? À cet argument central, un document communiqué à la mission par le ministre de la justice (239 ( * )) avance que la contraventionnalisation représenterait un abaissement du niveau de la répression aux yeux de l'opinion publique. Il fait également état de certaines craintes : une banalisation de la consommation des stupéfiants, traitée comme le sont de simples infractions au code de la route ; des problèmes de recouvrement des amendes ; l'impossibilité de recourir à l'injonction thérapeutique dans les cas complexes ; l'exclusion des règles de la récidive ; l'inégalité devant la loi des contrevenants selon les ressources financières dont ils disposent ; le problème de la saisie des produits ; l'insuffisance d'une durée de rétention de quatre heures en lieu et place de la garde à vue, désormais impossible ; la disparition du levier que constitue « l'échange » entre le policier et le consommateur ; enfin, la disparition, pour l'autorité judicaire, de la possibilité d'évaluer la situation socioéducative du mineur consommateur de stupéfiants.
Vos rapporteurs soulignent pour leur part que :
- leur proposition de contraventionnaliser la première consommation de drogue illicite tend plutôt à renforcer la réponse pénale en passant d'une carence manifeste à une répression effective. L'opinion ne peut s'y tromper ;
- l'argumentation présentée par le ministère paraît valable à l'encontre d'une contraventionnalisation de toute consommation, y compris la consommation récurrente et la consommation problématique. Elle est en revanche moins convaincante en ce qui concerne la première consommation, seul objet en vérité de la proposition de vos rapporteurs ;
- l'exclusion des règles de la récidive pour la première consommation ne gênera guère la police, qui ne s'adresse que peu, actuellement, à la catégorie de consommateurs visée par la proposition de vos rapporteurs. Il serait en tout état de cause loisible au législateur, s'il le jugeait utile, de soumettre la nouvelle infraction contraventionnelle aux règles de la récidive ;
- l'éventuelle rétention de quatre heures d'un primo-usager jamais enregistré auparavant dans les fichiers de la police pour une infraction d'usage de drogue illicite semble un plafond plus que raisonnable. Si un primo-usager ne reconnaît pas l'infraction pour laquelle il est verbalisé, cette possibilité de rétention est de nature à faciliter les opérations de saisie et d'analyse nécessaires ;
- la perte de « l'échange entre le consommateur et le policier » à l'occasion de la garde à vue peut parfaitement s'admettre dans l'intérêt d'une réponse pénale plus systématique et plus efficace qu'elle ne l'est actuellement ;
- la perte de la possibilité d'ordonner l'injonction thérapeutique ne pose pas d'insurmontables problèmes dans le cas de primo-usagers appelés à rentrer dans le régime de la répression délictuelle, avec son cortège de réponses thérapeutiques, quand le rappel à l'ordre de la contravention n'a pas eu l'effet dissuasif espéré ;
- enfin, les objections tenant aux ressources des contrevenants inciteraient, si on les suivait, à supprimer toutes les infractions sanctionnées par des contraventions.
d) Instituer une contravention d'usage simple de troisième classe
Pour répondre aux besoins mis en évidence par les développements qui précèdent, il faut créer une sanction simple, aussi systématique et par conséquent effective que possible, immédiate, homogène et non stigmatisante pour les personnes, quel que soit leur âge, prises en compte par les statistiques comme consommant une fois au moins dans l'année du cannabis (3,9 millions), de la cocaïne (250 000), de l'ecstasy (200 000) ou toute autre drogue illicite.
La commission d'enquête sénatoriale de 2003 avait proposé la création d'une contravention de la cinquième classe en cas de première infraction et de maintenir la qualification délictuelle (avec peine d'emprisonnement d'un an) en cas de récidive. « Punir d'un an d'emprisonnement un usager de drogue occasionnel n'ayant commis aucun autre délit paraît disproportionné » était-il précisé dans le rapport. La qualification d'usager occasionnel disparaissait à la première infraction sanctionnée.
Un inconvénient de ce dispositif d'inspiration novatrice réside dans le passage nécessaire de l'auteur de l'infraction devant le tribunal de police (ou la juridiction pour enfants), ce qui tend à priver la sanction de sa simplicité, de son automaticité et de son immédiateté. Il est vrai que la saisine de la juridiction par convocation par un officier ou agent de police peut sembler de nature à compenser cet inconvénient, mais cette procédure n'est possible que sur instructions du procureur de la République, ce qui implique, par construction, l'hétérogénéité territoriale de sa mise en oeuvre.
C'est pourquoi, en raison de la possibilité de sanctionner l'infraction, en l'occurrence la première consommation par une amende forfaitaire empêchant le déclenchement des poursuites, les contraventions des quatre premières classes semblent le mieux correspondre à l'objectif de créer une sanction répondant aux objectifs recherchés . La fixation des taux des amendes forfaitaires à un niveau raisonnablement dissuasif renforcerait l'efficacité de cette mesure.
Dans ces conditions, pourrait être créée une peine d'amende de la troisième classe dont le taux maximum encouru , en deçà duquel le juge resterait libre de prononcer la sanction qui lui paraît la plus appropriée, est aujourd'hui de 450 euros (article 131-13 du code pénal). Selon le régime applicable à l'ensemble des contraventions des quatre premières classes, les faits punissables relèveraient de la juridiction de proximité (sauf attribution expresse de compétence au tribunal de police). Ces contraventions ne nécessitent pas d'instruction préalable au jugement, sauf à la requête du procureur de la République. Elles permettent la saisine de la juridiction par citation directe (l'accusation peut attraire directement l'auteur de l'infraction devant la juridiction de jugement) ; la juridiction peut aussi être saisie par convocation par un officier ou agent de police ; l'ordonnance pénale est possible.
L'intérêt de la mesure réside naturellement dans la notion d'amende forfaitaire (article 529 du code de procédure pénale) dont la création nécessiterait un ajout à la liste énumérée à l'article R. 48-1 du code de procédure pénale. Cette amende, payée dans un délai de 45 jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, serait de 68 euros (article R. 49 du code de procédure pénale). Un taux majoré de 180 euros s'appliquerait aux amendes non réglées dans les 45 jours et pour lesquelles aucune réclamation n'a été présentée (article R. 49-7 du code pénal). Cette amende majorée serait assortie d'un avertissement et devrait être payée dans les 45 jours. L'amende judiciaire maximale est, on le rappelle, de 450 euros.
L'impossibilité de mentionner les condamnations sur le casier judiciaire (sauf si une mesure d'interdiction, de déchéance, ou d'incapacité est prise à titre principal, ce qui ne sera pas le cas dans l'hypothèse de l'application d'amendes forfaitaires) serait un autre élément positif de cette sanction du primo-usage, dans la mesure où elle éviterait la stigmatisation des intéressés.
Pour permettre le repérage des contrevenants entrant, à la suite de leur premier usage sanctionné, dans le champ d'application de la répression délictuelle, la tenue d'un fichier est nécessaire. Il existe actuellement un fichier national des auteurs d'infraction à la législation sur les stupéfiants , pas nécessairement renseigné de façon systématique si l'on se réfère aux propos du préfet Gilles Leclair mentionnés plus haut. Renforcé et adapté en tant que de besoin, il pourrait servir à la mise en oeuvre de la politique contraventionnelle préconisée par la mission d'information.
B. LES CENTRES D'INJECTION SUPERVISÉS, UNE OPTION HASARDEUSE
Les centres d'injection supervisés sont, comme l'a indiqué l'expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, des « structures où les usagers de drogues par injection [...] peuvent venir s'injecter des drogues - qu'ils apportent - de façon plus sûre et plus hygiénique, sous la supervision de personnel qualifié » (240 ( * )) .
Ces centres étaient, jusqu'à l'été 2010, des structures peu connues du grand public en France. La publication de l'expertise collective menée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale sur la réduction des risques infectieux chez les usagers de drogues a conduit à leur médiatisation intense, au point qu'ils ont fait l'objet d'une certaine controverse. Alors que de nombreux autres sujets étaient étudiés par l'expertise collective, les centres d'injection supervisés ont rapidement concentré toute l'attention.
Force est de constater que le débat a, dès le départ, pris un mauvais chemin. Les appréciations sur ces structures ont été plus que tranchées. Certains ont jugé que l'expertise collective consacrait la nécessité évidente d'instaurer, toutes affaires cessantes, des « salles de consommation à moindres risques » en France ; d'autres ont contesté vigoureusement le principe même de ce qu'ils ont appelé des « salles de shoot ».
Il paraît aujourd'hui nécessaire d'aborder le sujet de manière objective et responsable et de dépasser les outrances de la polémique. Même s'il ne doit pas occulter les autres problématiques à aborder, vos rapporteurs ne souhaitent évidemment pas l'évacuer. La question est suffisamment complexe pour être examinée avec retenue et rigueur. Cela suppose de rendre compte, aussi honnêtement que possible, des résultats des expériences étrangères et de s'interroger sur leur adéquation à la situation française.
1. Les interrogations face aux expériences étrangères
Il convient, avant toute chose, d'exposer ce qu'ont été les expériences étrangères en matière de centres d'injection supervisés et les raisons qui ont poussé à la création de telles structures. La mission d'information s'est, pour sa part, déplacée à Genève pour y visiter l'« espace d'accueil et de consommation » dénommé Quai 9 et a, à cette occasion, rencontré de nombreux responsables du canton de Genève qui l'ont éclairée sur ses objectifs et ses modalités de fonctionnement.
a) Des structures issues d'initiatives souvent locales et répondant à une logique de réduction des risques et des nuisances
La plupart des centres d'injection supervisés sont situés dans des pays européens. Ils étaient, en 2009, au nombre de quarante-cinq dans trente villes aux Pays-Bas, vingt-cinq dans seize villes en Allemagne, douze dans huit villes en Suisse, six dans trois villes en Espagne, un au Luxembourg et un en Norvège. On en trouve aussi, dans une moindre proportion, dans des pays anglo-saxons - en Australie et au Canada.
? Des structures mises en place dans un contexte très particulier
Pour traiter du sujet de manière aussi objective que possible, vos rapporteurs souhaitent rappeler les conditions dans lesquelles sont apparus les centres d'injection supervisés, leurs objectifs et leurs missions. Ces centres, dont le premier a été créé à Berne en 1986, s'adressent à des usagers de drogues très marginalisés, en situation de grande précarité et présentant un fort risque de contamination ou de transmission de maladies infectieuses, essentiellement le virus de l'immunodéficience humaine et le virus de l'hépatite C. Les personnes potentiellement concernées sont donc des usagers de drogues injecteurs et ceux risquant de consommer dans l'espace public dans des conditions sanitaires déplorables.
À leur création, ces structures poursuivaient souvent un double objectif : d'une part, un objectif sanitaire pour permettre aux usagers de drogues de pratiquer une injection dans de bonnes conditions d'hygiène, réduire les risques liés (surdoses, abcès, ou encore infections virales en cas de partage de seringues) et leur offrir une porte d'entrée vers le système de soins ; d'autre part, un objectif de réduction des nuisances liées à la consommation de drogues dans l'espace public.
Comme l'a souligné Mme Jeanne Étiemble, directrice du centre d'expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les centres d'injection supervisés ont généralement été mis en place « à la suite d'une succession d'événements dont les trois principaux sont le développement d'une épidémie de consommation de drogues par injection - héroïne et plus récemment cocaïne -, l'arrivée de l'épidémie de [virus de l'immunodéficience humaine] et la présence constante de consommateurs de drogues en situation d'extrême précarité, souvent sans domicile fixe, se piquant dans l'espace public » (241 ( * )) .
Cela correspond exactement à la situation qui a été décrite à la mission d'information lors de son déplacement à Genève. L'ensemble des responsables qu'elle a entendus ont souligné que la création de salles de consommation en Suisse avait été précédée par une période, dans les années 1980, de « laisser faire » qui avait permis des rassemblements importants d'injecteurs de drogues dans l'espace public. Les personnels soignants étaient amenés à y intervenir, de manière informelle, pour donner des soins de base aux toxicomanes et, avec l'apparition de l'épidémie de syndrome d'immunodéficience acquise, leur distribuer du matériel d'injection stérile, tandis que les autorités de police, en cas de besoin, pouvaient intervenir ponctuellement.
Le phénomène a cependant pris une telle ampleur, en rendant visibles les conditions de vie très précaires des toxicomanes, qu'il a été jugé nécessaire d'y répondre de manière pragmatique. C'est ainsi que la « fermeture » de certaines scènes ouvertes, comme celle du Platzsplitz de Zurich, s'est accompagnée de l'ouverture de salles avec local d'injection, mais aussi de la mise en place de programmes de traitement et de réduction des risques allant jusqu'à la prescription d'héroïne dite « médicalisée » pour les consommateurs d'opiacés.
? Des régimes juridiques divers
Au vu des éléments détaillés fournis par la division de législation comparée du Sénat, les salles de consommation de drogues résultent, selon les pays, d'initiatives diverses essentiellement locales et ont des statuts variés.
En Espagne, le premier « dispositif d'assistance à l'injection » a été ouvert en 2000 dans le bidonville de Las Barranquillas près de Madrid. Il n'y existe pas de législation spécifique à de telles structures ; elles résultent, pour la plupart, d'initiatives locales. Ainsi, la salle de Madrid a été créée à l'initiative de l'agence antidrogue de la communauté autonome de la capitale. La première salle de Barcelone a été créée dans le cadre d'un programme social concernant un quartier défavorisé. Une seconde, gérée par la municipalité et une organisation non gouvernementale, a été ouverte en 2003. Un centre hospitalier comporte également une salle d'injection.
En Allemagne, après des expériences menées à Hambourg et Francfort au début des années 1990, la loi sur les stupéfiants a été modifiée pour donner un caractère juridique incontestable aux salles de consommation de drogues. L'article 10 a de la loi du 28 juillet 1981 sur les stupéfiants ( Betäubungsmittelgesetz ) a prévu que l'exploitation d'une salle d'injection devait être soumise à l'autorisation d'une autorité supérieure du Land sous réserve que le gouvernement régional ait adopté une ordonnance relative aux conditions de délivrance de cette autorisation. Six des seize Länder ont édicté une telle ordonnance .
Aux Pays-Bas, la première des salles « de consommation » ( gebruiksruimten ) a été ouverte à Maastricht en 1994. La création de telles salles résulte d'un accord entre communes et partenaires locaux.
En Suisse, l'ouverture de salles d'injection qui a débuté, dès la fin des années 1980, sans que la législation et la réglementation alors en vigueur ne soient modifiées, n'est prévue par aucun texte. Selon la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, les cantons sont chargés de la mise en oeuvre de la politique en matière de drogue dont ils décident avec une grande autonomie. Les salles d'injection ont été créées essentiellement dans les cantons alémaniques, l'espace Quai 9 de Genève constituant à cet égard une exception.
? Des modalités de fonctionnement souvent proches
Les modalités de fonctionnement des salles de consommation de drogues sont souvent proches d'un pays à l'autre. Certaines structures sont, à proprement parler, des centres d'injection supervisés. D'autres accueillent aussi des usagers de drogues qui consomment leurs produits par d'autres voies, comme l'espace Quai 9 de Genève qui comportait à l'origine exclusivement des places d'injection, puis a créé des places pour la consommation par voie nasale (ou « sniff ») et enfin un local hermétique destiné à l'inhalation de drogues. Dans la plupart des cas, ces structures comportent un espace d'accueil et d'attente où l'on peut parfois boire un café ou se restaurer, un local séparé réservé à la consommation de drogues et une pièce pour dispenser des soins de base.
Le matériel d'injection stérile et à usage unique est distribué par les structures soit gratuitement, soit sous forme d'échange, comme dans l'espace Quai 9 qui a fait état d'un taux de retour du matériel usagé de près de 95 %. En cas de non-retour de matériel usagé, le matériel stérile destiné à l'injection y est facturé 50 centimes de francs suisses (41 centimes d'euro).
Les salles de consommation, bien qu'à « bas seuil d'exigence » à l'égard des usagers de drogues qu'elles accueillent, sont dotées d'un règlement intérieur fixant quelques règles de base : n'y sont en principe admises que les personnes déjà très fortement dépendantes et majeures ; toutefois, des exceptions peuvent être admises, notamment en ce qui concerne les premières injections qui y sont découragées mais peuvent parfois être tolérées, comme à l'espace Quai 9. Sont généralement prohibés dans l'enceinte de la salle de consommation le commerce, la distribution et le partage de drogues, la violence contre les personnes et les biens, le partage du matériel d'injection ou encore la consommation de drogues en dehors du local réservé à cet usage. Dans certains centres, l'accès est refusé aux personnes sous traitement de substitution, mais cela n'est pas systématique ; ainsi, à l'espace Quai 9, 70 % des personnes fréquentant la salle dans les premiers jours de son ouverture suivaient un traitement de substitution aux opiacés. L'entrée en salle d'injection peut aussi parfois être refusée lorsque les usagers viennent manifestement de pratiquer de très nombreuses injections et de consommer une quantité importante de drogue. Peuvent également être interdits des modes d'injection particulièrement risqués (par exemple, dans la jugulaire). Des règles d'hygiène de base, comme le lavage des mains, peuvent être édictées. Le non-respect du règlement intérieur peut donner lieu à des mesures d'exclusion temporaire.
Le personnel de ces structures, chargé de superviser les injections mais pas d'y participer, est composé en général de travailleurs sociaux, d'infirmiers et, parfois, de médecins qui assurent des consultations dans les locaux. La supervision consiste à s'assurer que l'injection est pratiquée dans de bonnes conditions d'hygiène, alerter l'usager de drogues sur ses pratiques à risques et prodiguer les premiers soins en cas de surdose. Des dispositions peuvent être prises pour éviter la mise en cause de la responsabilité de ce personnel en cas d'incident médical lié à la prise de drogues dans les locaux. C'est le cas pour l'espace Quai 9 de Genève où seule la responsabilité de la personne qui a préparé le produit consommé - ce qui exclut le personnel de la structure qui n'intervient pas à ce stade - peut être engagée en cas d'incident.
Les centres d'injection supervisés obéissent donc à certaines règles communes et visent les mêmes objectifs de réduction des risques et des nuisances. Ils ont donné lieu à une littérature scientifique abondante pour en évaluer les modalités de fonctionnement ainsi que l'efficacité. Celle-ci a été analysée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale dans le cadre d'une expertise collective qui a, comme on l'a rappelé, suscité bien des controverses. Une lecture objective de cette expertise permet de considérer que ses conclusions à l'égard des centres d'injection supervisés sont sans doute plus nuancées que ce qui en a parfois été présenté.
b) Des appréciations contrastées
? Une expertise collective des centres d'injection supervisés plus discutable qu'on a pu le laisser penser
L'expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a pu être considérée par certains comme confirmant la nécessité qu'il y aurait de créer en France des centres d'injection supervisés. Non seulement les centres ont pu faire l'objet d'expertises plus nuancées qu'on ne l'a dit mais certaines appréciations divergentes ont été fâcheusement occultées. En fait, M. Gérard Bréart, membre du groupe d'experts, a précisé à la mission d'information : « je ne crois pas que l'on affirme [dans notre rapport] que les centres d'injection supervisés ont prouvé leur efficacité. Ce n'est pas ce que l'on dit : nous disons que ce dispositif peut être intéressant » (242 ( * )) . Le groupe d'experts n'a donc pas appelé à l'ouverture de telles structures. Il a recommandé « de mener une étude des besoins pour l'ouverture d'un [centre d'injection supervisé] afin de définir les objectifs spécifiques de ce dispositif » (243 ( * )) .
S'agissant des objectifs sanitaires poursuivis par les centres d'injection supervisés, que conclut l'expertise collective ?
Ces centres semblent avoir permis d'atteindre les groupes visés, à savoir des usagers de drogues à hauts risques, marginalisés, parfois sans domicile fixe, n'ayant pas ou peu accès aux services de santé. Pour autant, il existe divers modes de fréquentation et celle-ci peut n'être qu'épisodique, par exemple à Genève ou Sydney, ce qui laisse à penser que la population visée ne recourt pas forcément à ces structures.
L'objectif d'amélioration de l'état de santé des usagers de drogues par réduction des surdoses semble être atteint, mais celles-ci ne disparaissent pas du seul fait de la fréquentation d'un centre d'injection supervisé. Certes, aucune surdose mortelle n'a été constatée dans un centre ; les surdoses fatales évitées ont été estimées à dix par an en Allemagne et à quatre par an à Sydney. Pour autant, l'injection dans un centre n'est pas un gage d'absolue sécurité : les surdoses et autres urgences seraient en effet de l'ordre de 0,5 à 7 pour 1 000 injections, ce qui n'est pas anodin.
L'appréciation est mesurée s'agissant de l'impact des centres d'injection supervisés en matière de réduction des risques infectieux. Selon l'expertise collective, « la question de l'hygiène et de la technique d'injection est une des raisons principales de l'utilisation des [centres d'injection supervisés]. Les conseils à ce sujet représentent une part importante de l'activité des [centres] » (244 ( * )) . Pour autant, analyse la même expertise, « aucune étude n'a permis de mettre en évidence un impact direct des [centres] sur la réduction de l'incidence des maladies infectieuses, qui n'est d'ailleurs pas un des objectifs premiers » (245 ( * )) de ces derniers.
Selon l'expertise collective, il est en effet délicat de quantifier, de manière fiable, les résultats des centres en matière de réduction des risques de transmission de maladies infectieuses. La plupart des usagers des centres ont également accès à d'autres dispositifs de réduction des risques, comme des programmes d'échange de seringues qui couvrent plus largement la population ciblée. Il est dès lors très malaisé d'isoler l'impact des centres d'injection supervisés.
Les tentatives de quantification de cet impact aboutissent en outre à des résultats plutôt décevants : d'après l'expertise collective, une étude menée à Vancouver a estimé à seulement deux par année le nombre de décès liés au virus de l'immunodéficience humaine évités en raison de la fréquentation du centre d'injection supervisé, cette estimation ayant en outre été estimée un peu trop élevée. La synthèse de l'expertise collective est encore plus sévère concernant l'impact des centres d'injection supervisés sur la diffusion du virus de l'hépatite C, considérant qu'ils ne sont pas « coût-efficaces », en raison notamment du caractère très infectieux de ce virus.
Le dernier objectif sanitaire des salles est celui d'une entrée dans le système de soins des usagers de drogues les fréquentant. L'expertise collective conclut que les centres « contribuent à l'amélioration de l'accès aux soins des usagers de drogues injectées, par leur offre de soins de base et par leur activité de relais vers des structures plus spécialisées » (246 ( * )) . Mais ce relais reste faible : à Genève, une visite sur cinquante, soit 2 %, aboutit à un soin dans le centre. Parmi ces 2 %, 20 % des interventions sont suivies d'un relais médical (247 ( * )) . Ce ne seraient donc que 0,4 % des visites au centre qui donneraient lieu à un tel relais - sachant qu'une même personne peut effectuer plusieurs visites par jour, dans le cas d'un injecteur compulsif. Si les centres permettent d'avoir un premier contact avec des personnes souffrant d'une grande exclusion et très éloignées du système de santé, voire de leur octroyer des soins médicaux de base s'ils sont équipés à cet effet, l'orientation de ces usagers vers des structures adaptées n'est donc suivie d'effets que dans une faible part.
Enfin, l'expertise collective établit l'absence de conséquences sanitaires négatives, telle l'augmentation du nombre d'injecteurs (même si des cas de première injection ont pu être signalés, ce qui n'est guère rassurant) ou la diminution des entrées en traitement. Il est toutefois préoccupant de constater que la même expertise estime qu'une partie « non négligeable » (248 ( * )) des usagers des centres ont déjà été ou sont en traitement pour leur dépendance, tout en continuant à s'injecter des drogues. L'expertise collective est sur ce point prudente : elle conclut que dans une telle situation, la fréquentation d'un centre « peut être une occasion de renouer avec un traitement abandonné ou mal suivi » (1) , sans établir que tel est effectivement le cas.
L'expertise collective a par ailleurs analysé les résultats des centres d'injection supervisés en matière de réduction des nuisances à l'ordre public .
Comme cela a été précisé plus haut, les considérations d'ordre public ont très souvent joué un rôle important dans la décision de créer des centres d'injection supervisés. Ainsi, aux Pays-Bas, la plupart de ces structures ont eu pour origine des initiatives conjointes de riverains de « scènes ouvertes » et des forces de police, soutenues par les autorités locales, pour réduire les nuisances ; des considérations similaires ont conduit à la création de salles d'injection en Suisse et en Espagne, où des objectifs sanitaires étaient concurremment poursuivis. Les nuisances à l'ordre public que l'on souhaitait ainsi éviter étaient de plusieurs ordres : injections et abandon du matériel dans l'espace public, rassemblements d'usagers de drogues, trafics et délits associés.
L'expertise collective constate que l'ouverture de centres d'injection supervisés s'est traduite par une diminution de l'injection dans l'espace public. Pour autant, celle-ci ne disparaît pas totalement - elle dépend en effet aussi des horaires d'ouverture des centres et de la nature des drogues consommées. Il n'aurait pas été constaté d'augmentation de délits associés à la consommation de drogues. L'abandon de matériel d'injection sur la voie publique serait généralement lui aussi en diminution, sans être éradiqué, ce qui a pu nécessiter d'organiser des équipes de nettoyage, à Genève par exemple. Des rassemblements d'usagers autour des centres ont pu être observés dans certains cas.
Les conclusions de l'expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ne sont donc pas aussi univoques qu'ont pu le penser certains partisans des centres d'injection supervisés. C'est d'ailleurs le propre de la démarche scientifique que de faire état de toutes les données du problème. Au-delà, les expériences étrangères ont pu susciter des réactions très diverses de la part des intervenants français dans le domaine des toxicomanies, qui montrent que ce sujet doit être appréhendé avec un certain recul.
? Les appréciations divergentes des intervenants de terrain
La mission d'information a auditionné et rencontré de très nombreux acteurs impliqués dans l'accompagnement et la prise en charge des usagers de drogues en France. Elle a pu constater que leurs avis concernant les centres d'injection supervisés étaient loin d'être homogènes.
Certains se sont très nettement prononcés en faveur de l'expérimentation de salles de consommation de drogues.
Ainsi en a-t-il été, par exemple, de divers représentants d'associations impliquées dans la lutte contre les maladies infectieuses comme SOS Hépatites, Aides (249 ( * )) ou Sidaction (250 ( * )) . Pour ces derniers, les centres d'injection supervisés constitueraient un prolongement de la politique de réduction des risques et une solution pragmatique pour proposer le plus tôt possible un contact, un lien ou un accompagnement à des personnes extrêmement fragiles. Selon M. Pierre Chappard, président d'Act-up Paris et fondateur du « Collectif du 19 mai », ensemble d'associations ayant fortement milité pour l'expérimentation de salles de consommation de drogues, la création de telles structures, si elle n'est pas une panacée, constituerait une « urgence » et un « outil de santé publique et d'ordre public réservé à un public très restreint et très précaire » (251 ( * )) .
Le docteur William Lowenstein, directeur général de la clinique Montevideo à Boulogne-Billancourt, s'est également montré très favorable aux centres d'injection supervisés (252 ( * )) , de même que M. Alain Rigaud, psychiatre addictologue et président de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (1) .
Certains intervenants n'ont pas écarté l'intérêt que pourraient présenter des centres d'injection supervisés mais se sont montrés plus nuancés. Cela a par exemple été le cas du professeur Jean-François Mattei, président de la Croix-Rouge française, que la mission d'information a rencontré au cours de son déplacement au centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie Pierre Nicole, géré par son association. Récusant le terme de salle de « consommation » de drogues dont il a estimé qu'il faussait d'emblée le débat, il a jugé utile l'expérimentation de deux ou trois structures, dans des centres similaires au centre Pierre Nicole, pour permettre à des grands dépendants aux produits morphiniques de pratiquer des injections dans des conditions hygiéniques et contrôlées.
Le docteur Marc Valleur, psychiatre, médecin chef du Centre Marmottan, a adopté pour sa part une position certes favorable en jugeant que des centres d'injection supervisés pourraient être justifiés, en termes de santé publique, s'il existait des « scènes ouvertes » de consommation de drogues, mais s'est interrogé : « En a-t-on les moyens ? Combien cela coûte-t-il ? Le budget existe-t-il ? » (253 ( * )) .
D'autres personnalités ont fait part d'appréciations encore plus réservées, tel le docteur Xavier Laqueille, psychiatre, chef du service d'addictologie de l'hôpital Sainte-Anne à Paris que la mission d'information a pu rencontrer sur son lieu d'exercice. Ce dernier a estimé que des centres d'injection supervisés avaient pu montrer un intérêt quand existaient des scènes d'injection dans l'espace public, mais s'est interrogé sur l'intérêt de telles structures en France. Faisant valoir que seulement 2 % à 3 % des nouvelles contaminations par le virus de l'immunodéficience humaine étaient liées à l'usage de drogues et que la contamination des usagers de drogues par le virus de l'hépatite C intervenait en général très tôt dans leur parcours de consommation, il a reconnu préférer que soient mises en place des structures d'hospitalisation en addictologie étoffées, dotées de financements pérennes.
Enfin, la mission d'information a pu constater qu'existaient aussi des opinions très nettement défavorables à l'égard des centres d'injection supervisés. Le docteur Patrick Romestaing, président de la section Santé publique du Conseil national de l'ordre des médecins (254 ( * )) , a ainsi indiqué que le conseil national n'avait pas pris officiellement position sur la question mais qu'un débat nourri avait été tenu sur la question au sein de sa section et avait conduit à un avis globalement négatif à l'égard de telles structures.
Le docteur Xavier Emmanuelli, président et fondateur du Samu-social, qu'on ne peut certes pas soupçonner d'être indifférent aux questions de santé publique et de lutte contre les maladies infectieuses, s'est prononcé encore plus fermement contre les salles de consommation de drogues. Ses propos ont en effet été sans équivoque et même sévères lorsqu'il a déclaré à la mission : « je pense que les salles d'injection constituent une perversité et ne peuvent fonctionner, faute de moyens. Je suis d'autre part extrêmement choqué que l'on abandonne les gens à leur définition de toxicomanes. [...] C'est non seulement inesthétique mais antiéthique et antihumaniste » (255 ( * )) .
Une éventuelle adaptation, en France, des expériences étrangères en matière de centres d'injection supervisés est donc loin de susciter un réel consensus, y compris parmi ceux qui sont le plus impliqués dans l'accompagnement, au quotidien, des usagers de drogues les plus fragiles.
? Des interrogations qui subsistent
Au vu des auditions et des déplacements réalisés, vos rapporteurs estiment que des interrogations subsistent quant à l'évaluation de l'impact global des centres d'injection supervisés.
Tout d'abord, comme l'a souligné M. Cédric Grouchka, membre du collège de la Haute Autorité de santé (256 ( * )) , l'expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale n'est qu'un élément parmi d'autres pour guider la réflexion et ne constitue pas la seule source d'information et de recommandation. Il ne s'agit pas de mettre en cause la qualité du travail fourni, mais de simplement noter que celui-ci n'est pas forcément exhaustif, qu'il n'a pas, comme l'a souligné M. Cédric Grouchka, donné lieu à une procédure de gestion des conflits d'intérêts et qu'il souffre de l'absence d'évaluation médico-économique des centres d'injection supervisés.
Il est vrai qu'on ne dispose que de très peu d'éléments quant au coût de fonctionnement de ces structures qui semble, selon les cas, osciller entre un et trois millions d'euros. Les responsables de l'espace Quai 9 de Genève ont indiqué à la mission d'information que le budget de l'association gestionnaire était d'environ 2,8 millions de francs suisses, soit environ 2,2 millions d'euros, dont près de 80 % étaient consacrés aux rémunérations du personnel. Il est évidemment toujours délicat, en matière de santé publique, de faire valoir des arguments de nature financière. La contrainte budgétaire est pourtant une réalité qui s'impose à tous et qui impose des arbitrages. Il ne semble pas illégitime de souhaiter une évaluation médico-économique approfondie de structures oeuvrant dans le champ des toxicomanies, comme cela est le cas pour d'autres entités intervenant dans le domaine médico-social ou sanitaire.
La multiplicité des sources qui font état de résultats parfois contradictoires ne peut en outre qu'appeler à la prudence pour éviter tout jugement hâtif. Ainsi, l'expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale indique-t-elle que « certaines études montrent une augmentation du nombre d'usagers entrant en traitement pour leur dépendance » (257 ( * )) . Mais une note récente de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies faisant, elle aussi, la synthèse de la littérature internationale sur la question des salles de consommation de drogues, souligne qu'un « petit nombre d'études mettent en évidence un retard dans l'entrée en traitement » (258 ( * )) . Quelle conclusion tirer d'appréciations manifestement aussi opposées ? De telles divergences ne sont, malheureusement, pas rares sur la question de l'accompagnement des toxicomanes et des dépendances. Elles rendent difficile de se forger une opinion définitive. Elles invitent également à la circonspection à l'égard de certaines affirmations catégoriques.
En outre, une lecture attentive de l'expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale peut, elle aussi, susciter des interrogations : on peut y lire successivement, à la même page, qu'« aucune étude n'a permis de mettre en évidence un impact direct des [centres d'injection supervisés] sur la réduction de l'incidence des maladies infectieuses », notamment en raison de problèmes méthodologiques, puis qu'« on peut dire qu'il existe une preuve convaincante que les [centres...] ont un effet sur les risques liés à la transmission des maladies virales » (259 ( * )) . On reconnaîtra qu'à une telle lecture, il est malaisé d'établir son opinion sur la question.
Cela est d'autant plus difficile que les centres d'injection supervisés remplissent deux missions : l'une, propre à toutes les structures dites « à bas seuil d'exigence », qui consiste à distribuer ou échanger du matériel d'injection stérile et procéder à des soins de base ; l'autre, spécifique, qui est d'offrir un local où sont pratiquées les injections.
On constate qu'il est en réalité malaisé d'individualiser les impacts sanitaires respectifs de chacune de ces activités. Cela a été particulièrement mis en évidence par une étude de l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne qui a souligné que « la comparaison entre les villes disposant d'une [structure à bas seuil] sans local de consommation et villes disposant d'une [structure à bas seuil] avec local de consommation ne fait pas apparaître de grandes différences en matière de pratiques à risque et de taux d'infection par le [virus de l'immunodéficience humaine] , le [virus de l'hépatite C] et le [virus de l'hépatite B] chez les consommateurs de drogue utilisant ces structures » (260 ( * )) .
Vos rapporteurs ont également jugé, lors de leur visite de l'espace Quai 9 à Genève, que des interrogations subsistaient quant à l'impact sanitaire de cette structure. Certes, l'ensemble des personnes rencontrées a jugé que l'état physique des toxicomanes s'était sensiblement amélioré depuis la création de ce centre. Toutefois, la sûreté des injections n'y est pas totalement garantie : l'échange de matériel d'injection, stérile et à usage unique, constitue évidemment une avancée sanitaire, mais le produit consommé ne fait jamais l'objet d'un contrôle préalable et des surdoses peuvent survenir. On compte ainsi de trente à quarante appels aux services d'urgence médicale chaque année. Ces appels ont probablement évité des drames et peut-être même sauvé des vies. Mais force est de constater que l'espace Quai 9 n'est pas un lieu d'injection « sans risque ».
Par ailleurs, les conséquences de telles structures en termes d'ordre public méritent d'être examinées avec plus d'attention. Vos rapporteurs ont retiré une impression mitigée de leur visite de l'espace Quai 9. La plupart des responsables rencontrés par la mission d'information ont fait valoir que la création de celui-ci répondait à une demande des riverains, lassés des nuisances occasionnées par l'abandon de seringues et la consommation de drogues dans l'espace public. Cela étant, ils ont aussi souligné que la salle n'était pas exclusivement fréquentée par des résidents genevois et qu'elle attirait bien au-delà des frontières du canton, en raison notamment de l'universalité de ses prestations. Outre des personnes de nationalité géorgienne fréquentant Quai 9, qui semblent assez nombreuses, on compte ainsi près de 25 % de Français parmi les utilisateurs du local d'injection.
Certains y verraient la nécessité de mettre en oeuvre, en France, des structures similaires. D'autres souligneront que l'offre de produits stupéfiants à Genève est particulièrement abondante et bon marché, ce qui pourrait expliquer l'importante proportion de non-résidents parmi les utilisateurs du centre. Vos rapporteurs se demandent, pour leur part, si cette fréquentation ne traduit pas la réelle attractivité d'un lieu qui offre des garanties similaires à celles des coffee shops néerlandais pour qui souhaite consommer des stupéfiants.
Le risque n'est-il alors pas d'accroître la fréquentation, par des usagers de drogues et des trafiquants, de quartiers dont les riverains sont déjà confrontés, au quotidien, à la toxicomanie ? Cela poserait un véritable problème d'acceptabilité sociale des centres d'injection supervisés. Tel semble d'ailleurs être le cas puisque la question de l'ouverture d'un deuxième centre avec local d'injection à Genève a été évoquée pour « relâcher la pression » sur le quartier où est installé l'espace Quai 9 ; il semble que le choix d'un second site se heurte à des réticences assez fortes.
Vos rapporteurs ont en outre pu constater que les résultats des centres d'injection supervisés, présentés comme un remède aux nuisances à l'ordre public, sont moins exceptionnels que certains le laissent penser. Même s'il ne paraît pas envisagé de revenir sur l'universalité de l'accès à l'espace Quai 9, nos voisins genevois ont, à de multiples reprises, souligné sa fréquentation par des non-résidents qui ne semble pas faciliter la tâche des forces de l'ordre. M. Philippe Bertschy, chef de la police judiciaire genevoise par intérim, a certes fait part de son appréciation globalement positive de l'espace d'accueil et de consommation Quai 9, mais il a aussi souligné que sa fréquentation par des toxicomanes originaires de France ou du canton de Vaud avait posé des problèmes en termes de sécurité publique et de lutte contre le trafic de stupéfiants.
La création du centre a par ailleurs dû s'accompagner de moyens supplémentaires pour maintenir l'ordre public, avec des îlotiers qui ont pu constater que les comportements de certains non-résidents à l'égard des forces de police étaient parfois agressifs et violents. La vigilance à l'égard du trafic de stupéfiants à proximité du centre a également dû être renforcée ; la police procède ainsi à une centaine d'arrestations par an à titre de mesure de « régulation ». La présence de « rabatteurs » qui orientent les usagers de drogues vers de petits trafiquants situés à une distance plus éloignée du centre a également été constatée. Quant au succès du programme d'échange de seringues, celui-ci a été mis en perspective par M. Philippe Bertschy qui a souligné qu'on trouvait toujours une certaine quantité de seringues usagées dans l'espace public en raison des injections pratiquées en dehors des heures d'ouverture de Quai 9.
Vos rapporteurs estiment, au vu de ces éléments, qu'on ne peut conclure, comme certains l'ont hâtivement fait, que l'expérience des centres d'injection supervisés à l'étranger appelle une appréciation catégorique et univoque. Il est légitime de s'interroger plus avant sur le bilan global de ces structures et de tenir compte de toutes les positions, notamment celles d'instances officielles intervenant dans le champ des toxicomanies.
c) La condamnation de telles structures par des instances officielles
Les centres d'injection supervisés font, comme on l'a constaté, l'objet d'appréciations contrastées quant à leur efficacité et leur nécessité. Pour tenir compte de toutes les données du débat, il convient de rappeler qu'ils ont aussi été condamnés par des instances officielles, sur divers plans.
? Le refus ferme de l'Académie nationale de médecine
La question des centres d'injection supervisés a été examinée par l'Académie nationale de médecine qui a fait part de sa position sur le sujet en adoptant un communiqué pour le moins explicite et adopté à une très large majorité (soixante-dix-neuf votants : soixante et un pour, douze contre et six abstentions).
Rappelons-en les termes : jugeant « qu'une démarche médicale ne peut consister à favoriser l'administration de la drogue qui a généré l'addiction », l'académie a estimé qu'on ne pouvait « demander à des médecins de superviser ou même de se livrer à de telles «intoxications médicalement assistées», ce d'autant plus que les «drogues de la rue» peuvent correspondre à des mélanges de toxicité potentiellement mortels ». Elle a en outre souligné « les moyens matériels inévitablement importants que mobiliserait cette initiative », dont elle a jugé qu'ils « seraient bien mieux utilisés pour renforcer les actions de prévention et d'aide au sevrage ». Sa conclusion a été claire : « dans ces conditions et dans l'état actuel des connaissances, l'Académie nationale de médecine ne peut que marquer son opposition à un tel projet » (261 ( * )) .
Ainsi que l'a rapporté à la mission d'information le professeur Claude Joly, Président de l'Académie (262 ( * )) , le débat a été très long dans cette instance d'expertise indépendante. Il a en particulier porté sur le fait de savoir si des centres d'injection supervisés permettraient d'approcher une population très précaire et de l'orienter ainsi ultérieurement vers le système de soins. La réponse a été, comme l'a souligné le professeur Claude Joly, « sans équivoque ». Lorsqu'on sait la qualité des membres de l'Académie nationale de médecine, on ne peut balayer cette prise de position d'un revers de la main. Elle paraît tout aussi légitime et digne d'intérêt que les résultats auxquels est parvenue l'expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Car après tout, des médecins pourraient avoir à superviser les injections qui seraient pratiquées dans des salles de consommation de drogues ; leur parole sur ce sujet ne peut donc pas être ignorée.
? Les critiques de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
M. Étienne Apaire, président, a pour sa part relevé des éléments que vos rapporteurs doivent prendre en compte. L'expertise collective menée par l'INSERM a, comme il l'a souligné, consisté en une expertise « littéraire » (263 ( * )) . Il s'agit d'une synthèse de la littérature scientifique sur la question de la réduction des risques, selon une méthodologie qu'il ne s'agit pas de contester ici. Mais on doit rendre compte du questionnement de M. Étienne Apaire qui se demandait si les articles recensés l'avaient été « par des experts proches des structures en question ou par des personnes ayant bénéficié d'un certain recul leur conférant peut-être un peu plus d'objectivité ». Vos rapporteurs ne peuvent évidemment trancher sur ce point. Le simple fait que l'interrogation existe ne peut cependant être ignoré et doit être rapproché des remarques émises par M. Cédric Grouchka, membre du collège de la Haute Autorité de santé.
? La condamnation par l'Organe international de contrôle des stupéfiants
Au-delà du débat national que nous connaissons sur les centres d'injection supervisés, ceux-ci ont fait l'objet d'une prise de position sévère, au plan international, par l'Organe international de contrôle des stupéfiants dans son rapport pour l'année 2009.
Rappelons que l'Organe international de contrôle des stupéfiants est une instance indépendante, chargée de surveiller l'application des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues. Il doit en particulier veiller à ce que soient disponibles en quantités suffisantes les stupéfiants requis à des fins médicales et scientifiques et empêcher leur détournement vers des circuits illicites. Pour ce faire, il identifie les lacunes susceptibles d'exister dans les systèmes de contrôle national et international et peut émettre des recommandations à l'égard des États parties aux traités internationaux sur les stupéfiants.
Son rapport pour l'année 2009 a été particulièrement explicite à l'égard des États sur le territoire desquels existaient des salles de consommation de drogues. Ainsi, s'agissant de l'Australie, il a demandé au Gouvernement « de fermer la «salle d'injection de drogues» de Sydney » (264 ( * )) . Concernant le Luxembourg, il a rappelé avoir adressé une lettre au Gouvernement pour lui recommander de faire « immédiatement le nécessaire pour fermer » la salle de consommation de drogues qu'il avait visitée en 2006.
D'une manière plus générale, l'organe international a jugé que la création et le fonctionnement de salles d'injection de drogues étaient « contraire [s] aux traités internationaux relatifs au contrôle des drogues ». En effet, en application de l'article 4 de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le protocole de 1972, les États parties doivent prendre « les mesures législatives et réglementaires qui pourront être nécessaires [...] pour limiter exclusivement aux fins médicales et scientifiques la production, la fabrication, l'exportation, l'importation, la distribution, le commerce, l'emploi et la détention des stupéfiants ».
L'organe international en a tiré les conséquences dans sa recommandation n° 32, qui constitue une condamnation très explicite des centres d'injections supervisés : « L'Organe note avec préoccupation que, dans un petit nombre de pays, des «salles de consommation de drogues» et des «salles d'injection» où l'on peut consommer impunément des drogues acquises sur le marché illicite fonctionnent encore. L'Organe engage les gouvernements à faire fermer ces salles et autres lieux similaires et à faire en sorte que les toxicomanes puissent accéder à des services sanitaires et sociaux, y compris aux services de traitement de la toxicomanie, conformément aux dispositions des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues » (265 ( * )) .
Certains pourraient certes être tentés d'engager un débat sur le caractère contraignant ou pas des recommandations de l'Organe international de contrôle des stupéfiants. Cela ne relèverait que de la posture : la doctrine internationale actuelle ne considère à l'évidence pas les centres d'injection supervisés comme poursuivant des fins médicales et scientifiques. La bonne foi qui doit guider la France dans l'exécution de ses obligations internationales commande de s'en tenir à cette interprétation.
2. Le véritable enjeu : déterminer l'opportunité d'un tel choix pour la France
L'expertise collective de l'INSERM a tiré de son travail de compilation de la littérature scientifique une conclusion importante qui mérite d'être soulignée : « pour que les [centres d'injection supervisés] soient efficaces, il est nécessaire qu'ils répondent à des besoins identifiés qui peuvent varier selon le contexte : importance de l'injection en public, nombre d'usagers injecteurs sans contact ou en rupture avec des structures de soin, nombre d'overdoses mortelles, existence de problèmes de santé liés à l'injection » (266 ( * )) .
M. Étienne Apaire a prolongé cette réflexion en posant des questions qui sont, pour vos rapporteurs, essentielles : les centres d'injection supervisés sont-ils adaptés aux enjeux nationaux ? Sont-ils politiquement et économiquement viables ? Pourraient-ils être acceptés par la population ? L'expertise collective n'a pas répondu à ces questions, pourtant déterminantes. L'enjeu consiste, pour vos rapporteurs, à déterminer si de telles structures seraient adaptées à la situation française.
a) Des doutes sérieux sur l'adéquation des centres d'injection supervisés à la situation française
Vos rapporteurs ont tenté, dans un souci d'objectivité, d'établir si la situation française était comparable à celle des pays où ont été mis en place des centres d'injection supervisés : quelle est la situation sanitaire des usagers de drogues ? Quelles sont les caractéristiques des « scènes de consommation de drogues » en France ? Des dispositifs de réduction des risques existent-ils aujourd'hui qui permettent de viser les usagers de drogues les plus précaires ?
? Un nombre de surdoses mortelles plus faible en France qu'à l'étranger
Notre pays est celui où la proportion de décès liés à la consommation de drogues est la plus faible. Alors qu'au milieu des années 1990, on déplorait entre 500 et 600 surdoses mortelles, ce nombre a ensuite très nettement chuté. Les statistiques diffèrent certes selon les sources : ainsi, en 2007, on comptait, selon le centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, 333 décès par surdose, alors que ce nombre était de 217 selon l'enquête sur les décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances menée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Toujours est-il que le nombre de morts causées par l'usage de drogues est sans commune mesure avec celui qu'il fut il y a vingt ans.
Surtout, ainsi que le note la revue Tendances publiée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, « rapportées à des pays voisins, les données officielles placent la France dans une situation privilégiée. Le nombre de surdoses en France [...] est quatre à cinq fois moindre qu'en Allemagne, et six à sept fois inférieur au Royaume-Uni. [...] Le nombre de surdoses mortelles en France apparaît faible comparé à la situation d'autres pays européens » (267 ( * )) . À titre d'exemple, ce nombre était, en 2007, de 475 en Espagne.
Reconnaissant que le nombre de surdoses est sans doute sous-estimé d'environ 30 %, la même publication souligne que « même pris en compte, le niveau corrigé demeure en deçà des estimations relevées en Allemagne ou au Royaume Uni ». Ce résultat est intéressant à deux titres : d'une part, il montre que la France dispose de meilleurs résultats que l'Allemagne qui est pourtant dotée de vingt-cinq salles de consommation de drogues ; d'autre part, il est mis sur le compte de la politique française en matière de réduction des risques.
Ce constat rejoint les propos tenus à la mission d'information par M. Gilbert Pépin, biologiste et expert judiciaire (268 ( * )) , qui a noté que la France enregistrait beaucoup moins de morts du fait des opiacés que les autres pays européens et a jugé que cette situation était à mettre au crédit de sa politique de substitution aux opiacés. On peut penser que cela est aussi lié à la régression de l'administration de drogues par voie intraveineuse, qui est la plus risquée et a sensiblement diminué depuis les années 1990 grâce à la politique de réduction des risques, sans qu'il ait été besoin, pour atteindre de tels résultats, de créer des centres d'injection supervisés.
? Des « scènes de consommation de drogues » diffuses et mobiles
Vos rapporteurs ont pu constater que la mise en oeuvre de centres d'injection supervisés avait répondu non seulement à des préoccupations d'ordre sanitaire, mais également à des considérations d'ordre public en raison de l'existence de « scènes ouvertes » de consommation de drogues.
En France, même si certains quartiers subissent des nuisances indiscutables liées tant au petit trafic qu'à la consommation de produits stupéfiants dans l'espace public, nulle ville n'accueille des scènes d'une ampleur comparable à celle qu'ont pu connaître certaines villes allemandes ou suisses. Rappelons que le quartier du Letten à Zurich accueillait à une époque le regroupement de 3 000 à 4 000 toxicomanes, vivant dans des conditions sanitaires absolument effroyables.
Le phénomène est, dans les grandes agglomérations françaises, plus diffus et surtout beaucoup plus mobile, ainsi que l'a souligné M. Michel Gaudin, préfet de police de Paris (269 ( * )) . La consommation de crack à Paris s'est ainsi, pendant un temps, concentrée dans le quartier de la place Stalingrad, puis, grâce à l'action des services de police, s'est déportée vers la porte d'Aubervilliers et la gare de Saint-Denis. Elle revient désormais dans la ville de Paris, notamment dans ses dix-huitième et dix-neuvième arrondissements. Les consommateurs « suivent » ainsi les petits trafiquants qui se déplacent au fil des opérations de démantèlement des réseaux.
Il est indiscutable que les quartiers concernés subissent une situation très difficile, ne serait-ce qu'en raison de l'extrême détresse sanitaire des toxicomanes qui les fréquentent et à laquelle sont confrontés, au quotidien, les riverains. Cela a d'ailleurs donné lieu à des initiatives locales positives de médiation sociale et d'accompagnement des usagers de drogues, comme Coordination toxicomanies dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Mais comme l'a indiqué M. le préfet de police Michel Gaudin, il est douteux que la mise en place de structures fixes permettrait de répondre aux besoins, sauf à admettre une implantation durable des trafics à leurs abords ; on voit bien la situation intenable dans laquelle cela mettrait les forces de l'ordre et les nuisances à l'ordre public qui en résulteraient.
Vos rapporteurs sont en outre sensibles à l'argument selon lequel une salle de consommation de drogues ne présenterait de réel intérêt que si elle fonctionnait en continu, en particulier la nuit, pour répondre aux besoins des usagers de crack ; or ils ont pu constater qu'à Genève par exemple, l'espace Quai 9 est fermé de 19 heures à 11 heures du matin. Un tel mode de fonctionnement serait, à l'évidence, inadapté pour la scène parisienne de consommation de crack .
Cela étant, l'inaction n'est pas une option ; il est évidemment indispensable d'intervenir auprès des toxicomanes les plus vulnérables et précaires. Vos rapporteurs proposent donc de recourir davantage à des « maraudes » de contact , comme l'a suggéré M. le préfet de police Michel Gaudin. Une telle démarche offrirait l'avantage de la souplesse et de la réactivité pour s'adapter à la mobilité des lieux de consommation en permettant d'aller au-devant d'une population très désinsérée. Elle offrirait en outre l'avantage de correspondre aux modes d'intervention déjà mis en place par des structures très impliquées dans le domaine de la réduction des risques.
? Une politique active de réduction des risques qui a permis d'améliorer l'état de santé des usagers de drogues
On constate au niveau européen des différences importantes en matière d'accès à des dispositifs de réduction des risques qui, comme l'a observé l'expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, jouent un rôle important en matière de réduction des risques infectieux.
Selon les données de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, la France distribue ainsi quinze millions de seringues stériles, contre trois millions et demi en Espagne (on ne dispose pas de données concernant l'Allemagne et les Pays-Bas). Or, les programmes d'échange de seringues ont un impact sanitaire indéniable ; il n'est qu'à voir les résultats obtenus en matière de transmission du virus de l'immunodéficience humaine sans que la France ne dispose de centres d'injection supervisés : entre 1993 et 2008, le nombre de nouveaux cas de syndrome d'immunodéficience acquise attribués à l'usage de drogue injectable est passé de 1 495 à 51 et le nombre de décès que celui-ci a causés chez les usagers de drogues par voie intraveineuse a très nettement chuté en passant de près de 1 000 dans les années 1990 à 43 en 2007.
La France a également fait le choix d'une large diffusion des traitements de substitution aux opiacés : ceux-ci sont délivrés à 130 000 usagers de drogues, soit 51 % des usagers dits « problématiques » au sens de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (personnes qui font un usage répété de cocaïne, d'amphétamine ou d'héroïne, ou pratiquent l'injection de drogues).
À titre de comparaison, selon le même observatoire, en 2008, l'Allemagne comptait 72 200 usagers de drogues sous traitement de substitution (dont près de 58 000 sous méthadone) ; en Espagne, près de 82 000 personnes suivaient un tel traitement. La France se caractérise en outre par le choix original d'une prescription large de buprénorphine haut dosage qui présente des risques de surdose moins graves que ceux encourus en cas de prise de méthadone.
La situation est évidemment critique, et même franchement inquiétante, concernant la prévalence du virus de l'hépatite C parmi les usagers de drogues puisqu'elle est estimée à 60 % chez les usagers injecteurs. La question est de savoir si des centres d'injection supervisés permettraient d'améliorer, sur ce point, l'état de santé des usagers de drogues.
Il est à craindre que la réponse soit négative : comme on l'a vu plus haut, les études déjà menées ne permettent pas d'apprécier un éventuel impact de ces structures sur la transmission du virus de l'hépatite C, très contagieux. En outre, les usagers de drogues qui seraient susceptibles d'être concernés par ces centres ont déjà un long « parcours » de toxicomane derrière eux et sont, pour une grande partie, déjà infectés. La fréquentation d'un centre d'injection supervisé ne changerait malheureusement pas leur situation et le risque de transmission ne serait, d'après les études, pas amoindri par l'existence de telles structures.
Rappelons enfin que la France dispose d'un réseau dense de structures d'accueil ayant un bas seuil d'exigence à l'égard des personnes les fréquentant. Les interlocuteurs rencontrés par la mission d'information à Genève lors de sa visite de Quai 9 ont tous insisté sur le fait que ce centre constituait, avant toute chose, un espace d'accueil où se créait du lien social. Cela correspond en tout point à la mission des 130 centres français d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues. Ces derniers permettent en effet d'avoir un premier contact avec les mêmes populations que celles qui sont ciblées par les centres d'injection supervisés, à savoir des usagers de drogues ayant un long parcours de consommation et vivant dans des conditions souvent précaires. Ils procèdent, eux aussi, à des échanges de matériel d'injection et peuvent orienter les usagers de drogues vers 500 structures de traitement spécialisées ou, si cela est nécessaire, le système de soins de premier recours.
Les modalités de fonctionnement de ces structures sont peut-être à améliorer ; probablement pourrait-on envisager un aménagement de leurs missions et les encourager à multiplier les interventions mobiles. Toujours est-il que la France dispose d'espaces destinés à avoir un premier contact avec les usagers de drogues les plus fragiles et les plus marginalisés ; c'est un atout précieux que le débat sur les centres d'injection supervisés ne doit pas occulter.
? L'acceptation plus qu'incertaine de centres d'injection supervisés par la population
Il est évident que la mise en oeuvre de structures d'accueil de toxicomanes où ceux-ci pourraient procéder à des injections de substances illicites serait impossible sans l'acceptation de la population. Un tel choix nécessite un consensus, faute de quoi il est voué à l'échec.
Élus, vos rapporteurs doutent que ce consensus puisse être atteint. Au-delà des appréciations divergentes qui ont été mises en évidence plus haut et qui émanent de personnalités directement impliquées dans le champ des toxicomanies, il est fort probable que la seule expérimentation de centres d'injection supervisés susciterait non pas des réticences de la part de la population, mais sa franche opposition.
Les résultats de la dernière enquête sur les représentations, opinions et perceptions sur les psychotropes (publiée en juin 2010 à partir de données de 2008) sont d'ailleurs sans appel. Celle-ci note certes qu'une large majorité (72 %) des personnes interrogées adhère au principe de base qui fonde la politique de réduction des risques, bien que ce soutien se soit effrité depuis 2002 (81 % partageaient alors cette opinion). Mais, souligne l'enquête, « cette majorité favorable à la réduction des risques s'inverse lorsque l'on envisage les formes les plus «discutées». Ainsi, seuls 27 % des Français seraient favorables à l'idée de : «pour prévenir les risques pour la santé, mettre à disposition des consommateurs d'héroïne des locaux et du matériel spécial pour qu'ils puissent s'injecter leur propre drogue» » (270 ( * )) .
Or, comme l'a souligné fort justement l'expertise collective de l'INSERM, « pour garantir un fonctionnement adéquat [des centres d'injection supervisés], leur implantation doit reposer sur un consensus entre tous les acteurs locaux : santé, police, autorités politiques et administratives, population en général et voisinage immédiat, usagers eux-mêmes » (271 ( * )) .
Vos rapporteurs constatent que si des accords locaux entre associations et municipalités ont pu, dans certains cas, survenir, on est loin d'avoir abouti au consensus réclamé par l'expertise collective. De toute évidence, le choix d'implanter des centres d'injection supervisés serait incompris par une grande partie de la population et, ne serait-ce que pour cette raison, semble plus qu'hasardeux. Vos rapporteurs estiment qu'il porterait en outre un mauvais coup à la politique de prévention des toxicomanies en brouillant le message délivré par les autorités publiques à l'adresse des populations les plus vulnérables face aux toxicomanies, en particulier les jeunes.
b) L'ambiguïté du message délivré
Toutes les personnes entendues par vos rapporteurs ont, sans exception, jugé nécessaire de prévenir les toxicomanies. Vos rapporteurs se félicitent de cette intention unanime, mais constatent qu'elle recouvre des approches, en pratique, fort diverses, selon qu'on parle de prévention primaire, secondaire ou même tertiaire. Ils sont pour leur part persuadés qu'une politique de prévention du passage à l'acte suppose un message clair et univoque : consommer de la drogue constitue un danger que l'on fait courir à soi-même et un risque pour la société dans son ensemble.
La création de centres d'injection supervisés constituerait, de ce point de vue, une incohérence qu'il serait difficile de justifier. Comment, en effet, alerter les jeunes sur les dangers de la drogue et présenter sa consommation comme un risque inacceptable pour leur santé, leur insertion sociale et leur entourage qui justifie qu'elle soit pénalement réprimée et, dans le même temps, créer des zones de non-droit où l'usage de substances illicites et nocives serait toléré ? M. Patrick Romestaing, président de la section Santé publique du Conseil national de l'ordre des médecins, a parfaitement cerné le problème : « sur le fond, nous en sommes d'accord, il faut tout faire pour assurer une prise en charge correcte des toxicomanes. Mais prévenir les toxicomanies, c'est aussi ne pas exposer, aux yeux des jeunes en particulier, des lieux de consommation légale » (272 ( * )) .
La confusion du message de santé publique qui résulterait de la création de centres d'injection supervisés a également été soulignée par l'Académie nationale de médecine, qui a jugé, dans son communiqué du 11 janvier 2011, que « la mise à disposition de [...] salles d'injection aurait pour effet de sortir, de facto, les drogues les plus détériorantes du statut illicite où elles sont actuellement et de remettre ainsi en question l'image répulsive qu'il convient de leur conserver pour éviter toute confusion dans la population dans son ensemble et, en particulier, chez les jeunes ».
Il est en effet déjà suffisamment difficile de batailler contre la banalisation de la consommation de produits psychoactifs parmi les jeunes. Vos rapporteurs ne pensent pas opportun de compliquer cette tâche en donnant l'impression que l'usage de drogues pourrait être admissible et que dans certaines situations particulières, la puissance publique pourrait accompagner les toxicomanes dans leur addiction.
Comme l'ont souligné de multiples personnes auditionnées par la mission d'information, tel M. Serge Lebigot, président de l'association Parents contre la drogue (273 ( * )) , les familles seraient particulièrement démunies pour alerter leurs enfants contre les dangers de la drogue si, parallèlement, se mettait en place une « politique de la capitulation ». L'accompagnement des personnes dépendantes doit certes être organisé, par une offre de soins et d'insertion adéquate. Il ne peut prendre la forme d'une supervision bienveillante qui laisserait penser, à tort, que la pratique de la consommation de drogues serait dépourvue de risques ou, dans certains cas bien contrôlés, acceptable.
Vos rapporteurs jugent en outre que le message de santé publique serait brouillé non seulement à l'égard des non-consommateurs mais aussi en direction de toutes les personnes dépendantes qui envisagent de rompre avec leur addiction, et sont en recherche d'un centre de traitement ou sur liste d'attente pour accéder à une structure d'hébergement thérapeutique. Comment justifier à leur égard que des moyens financiers publics soient dégagés pour superviser des pratiques dont ils essaient, parfois désespérément, de sortir mais sans y parvenir faute d'une offre de soins suffisante ? Vos rapporteurs en sont convaincus : si l'on souhaite une politique de prévention efficace et des entrées de personnes dépendantes en traitement, le discours sur les drogues doit être clair. Toute ambiguïté ne pourrait qu'en amoindrir l'efficacité.
3. De délicats problèmes juridiques
Des interrogations existent quant à l'efficacité des centres d'injection supervisés et leur adéquation à la situation française. On doit également noter que leur éventuelle mise en oeuvre poserait des difficultés juridiques qu'il serait délicat de résoudre.
a) La responsabilité des personnels travaillant dans les centres
Vos rapporteurs estiment qu'en l'état de notre législation, la supervision, par un personnel soignant, de l'injection d'une substance illicite et toxique pourrait donner lieu à débat. Ainsi, l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose-t-il que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé [...] ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ». La supervision d'une injection de drogue constituerait-elle, à cet égard, une faute en cas d'incident, comme par exemple une surdose ? Cette supervision pourrait-elle d'ailleurs être regardée comme un « acte de prévention, de diagnostic ou de soins » ? Rien n'est moins sûr.
De toute évidence, le risque serait grand que les professionnels intervenant dans les centres d'injection supervisés ne voient leur responsabilité engagée, sur plusieurs fondements. Rappelons ainsi que la facilitation « par quelque moyen que ce soit » de l'usage illicite de stupéfiants est punie de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende (article 222-37 du code pénal) ; la provocation directe d'un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende (article 227-18 du même code) ; la provocation à l'usage et sa présentation favorable sont, pour leur part, punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (article L. 3421-4 du code de la santé publique). Enfin, la possibilité d'un engagement de la responsabilité pénale des personnels des centres d'injection supervisés pour mise en danger de la vie d'autrui, sur le fondement de l'article 121-3 du code pénal, doit aussi être envisagée.
Les médecins sont en outre soumis à un code de déontologie, figurant dans la partie réglementaire du code de la santé publique, et dont on peut penser que certaines de ses dispositions pourraient être invoquées à l'encontre d'une supervision médicale de l'acte d'injection d'un produit stupéfiant illicite. L'article R. 4127-2 prévoit ainsi que « le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». L'article R. 4127-3 dispose pour sa part que « le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine ». Plusieurs appréciations semblent possibles, selon qu'on considère qu'il est respectueux de la vie humaine et moral d'aider un toxicomane à pratiquer une injection dans un environnement sûr et hygiénique ou que l'on juge attentatoire à la personne et immoral de superviser l'injection d'un produit dont on sait qu'il est, par définition, toxique ou dont on ignore la composition exacte.
Il convient aussi de noter que les personnels de centres d'injection supervisés peuvent être confrontés à des situations particulièrement délicates, d'ailleurs mises en évidence dans une évaluation de l'espace Quai 9 de Genève menée par l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne (274 ( * )) . Jusqu'où aller dans l'accompagnement dans les étapes d'injection, lorsque l'usager ne sait pas préparer son produit ou ne sait pas l'injecter ? Que faire lorsque des usagers ont un état de santé très dégradé mais refusent de se soigner ? Quelle attitude tenir face aux nouveaux ou aux jeunes injecteurs ? Que faire face à une femme enceinte souhaitant pratiquer une injection ? Comment gérer un acharnement à l'injection ou des pratiques d'automutilation ?
Ce débat déontologique peut difficilement être tranché par vos rapporteurs. Il revient en réalité au corps médical de décider si la supervision d'une injection de drogue illicite peut être admise au regard des principes qui guident l'exercice de sa profession.
Comme on l'a vu plus haut, le Conseil national de l'ordre des médecins, compétent en matière de code de déontologie, ne s'est pas prononcé sur la question des centres d'injection supervisés. Seule sa section Santé publique a évoqué ce sujet, pour conclure que de telles structures n'étaient pas souhaitables. Mais vos rapporteurs sont sensibles à la position de l'Académie nationale de médecine qui a jugé, dans son communiqué précité, qu'« en cautionnant, même indirectement, l'injection d'une solution non stérile d'une substance non identifiée, le médecin superviseur engagerait sa responsabilité, qu'elle soit personnelle ou administrative ». Cette position, si elle ne préjuge en rien de ce que pourrait décider le Conseil national de l'ordre des médecins sur la question, conduit vos rapporteurs à penser que des centres d'injection supervisés soulèveraient des difficultés juridiques et déontologiques délicates.
b) Le régime juridique de la consommation et de la détention de stupéfiants dans et à proximité des centres
Certains partisans des centres d'injection supervisés soutiennent que l'expérimentation de telles structures pourrait être menée dans le cadre juridique actuel, comme ont pu être adoptées les précédentes mesures en matière de réduction des risques.
Ils estiment que deux éléments militent en faveur de cette interprétation. D'une part, la réduction des risques est désormais reconnue sur le plan législatif - l'article L. 3121-4 du code de la santé publique dispose qu'elle « vise à prévenir la transmission des infections, la mortalité par surdose par injection de drogue intraveineuse et les dommages sociaux et psychologiques liés à la toxicomanie par des substances classées comme stupéfiants ». D'autre part, l'expérimentation de structures avec local d'injection s'inscrirait dans le référentiel national des actions de réduction des risques en direction des usagers de drogue, approuvé par décret (275 ( * )) , qui prévoit que « les actions de réduction des risques auprès des personnes qui consomment des stupéfiants ont pour objectifs [...] de prévenir les infections sévères, aiguës ou chroniques, en particulier celles liées à l'utilisation commune du matériel d'injection, [...] de prévenir les intoxications aiguës, notamment les surdoses mortelles résultant de la consommation de stupéfiants [... et] d'améliorer leur état de santé physique et psychique et leur insertion sociale ».
Vos rapporteurs ne partagent pas cette analyse. Ils jugent qu'il y a en effet une différence de taille entre la mise à disposition de matériel d'injection stérile et la supervision d'une injection de substance illicite dont l'usage est pénalement réprimé. Une lecture attentive du référentiel de réduction des risques permet en outre de constater que celui-ci dresse une liste limitative des interventions qui peuvent être admises : hébergement d'urgence, soins infirmiers, orientation vers le système de soins, éducation à la santé ou encore distribution et promotion du matériel d'hygiène et de prévention. Cela ne semble pas laisser de place à la création de lieux où l'injection serait tolérée. On peut par ailleurs noter que ce référentiel exclut expressément les interventions consistant en une analyse des produits « sur site ».
Surtout, la mise en oeuvre de centres d'injection supervisés semble inconciliable avec le caractère d'infraction pénale que revêtent la détention et la consommation de stupéfiants. Vos rapporteurs estiment impraticable une expérimentation des centres d'injection supervisés en France en l'état du droit existant. De toute évidence, une modification législative serait nécessaire pour préciser que l'usage de stupéfiants dans une telle structure n'est pas illicite et ils considèrent comme abusif de prétendre le contraire.
Se pose en outre la question du régime de la consommation et de la détention de drogues illicites à proximité des centres d'injection supervisés, comme l'a fort justement souligné Mme Françoise Baïssus, chef du bureau de la santé publique, du droit social et de l'environnement au ministère de la justice : « qui dit centre d'injection spécialisé dit évidemment présence d'usagers, de toxicomanes autour de ces centres. Si je me place dans un cadre prospectif, il faudrait donc éviter des interpellations tout autour des centres et ne pas considérer comme complices les personnes fournissant les produits stupéfiants » (276 ( * )) .
Voilà qui paraît délicat sur un plan juridique. Dans la pratique, la détention de petites quantités de produits illicites peut être assimilée à l'usage de stupéfiants. Celui-ci revêt aujourd'hui un caractère délictuel, ce qui paraît difficilement conciliable avec l'existence d'un espace de « libre consommation ». En l'état du droit, admettre des centres d'injection supervisés reviendrait donc à tolérer, sur certaines portions du territoire national, la non-application de la loi de la République.
Cela serait choquant, et même indéfendable, sur le principe. Vos rapporteurs jugent qu'il n'est pas envisageable qu'un usager de drogues consommant dans l'espace public, voire même à son domicile, soit susceptible de sanction tandis que celui qui a la possibilité de fréquenter un centre d'injection supervisé ne ferait l'objet d'aucune poursuite, alors même qu'ils consomment, tous deux, un produit illicite. On pourrait même aboutir à une situation totalement paradoxale : un usager de drogues pourrait licitement consommer son produit dans un centre d'injection supervisé mais, en dehors de ses horaires d'ouverture, le même usager pourrait se voir sanctionné pour pratiquer une injection du même produit, acheté au même fournisseur, au pied du même local...
Il est en outre particulièrement délicat de prévoir un régime particulier pour l'intervention des forces de l'ordre à proximité des centres d'injection supervisés, comme l'a d'ailleurs souligné M. Michel Gaudin, préfet de police de Paris (277 ( * )) . Cela supposerait, en pratique, de déterminer à partir de quelle distance de la structure les détenteurs de drogues pourraient être considérés comme étant en infraction - mais sur quel fondement juridique ? - et éventuellement de ne pas procéder à l'interpellation de petits trafiquants dans le périmètre le plus proche du centre. Les forces de l'ordre seraient en outre placées dans une situation fort délicate en cas d'interpellation d'un détenteur de drogues leur soutenant qu'il se rend au centre d'injection supervisé...
Ces problèmes ont été résolus, à Genève, par l'application d'un principe d'opportunité qui s'applique dès le stade de l'interpellation. Cela n'a, semble-t-il, pas été sans quelques problèmes, toute la difficulté consistant en effet à savoir où « placer le curseur », comme l'a souligné auprès de la mission d'information M. Philippe Bertschy, chef de la police judiciaire genevoise par intérim. Il convient aussi de tenir compte du régime juridique de l'usage de stupéfiants en Suisse : l'article 19 a de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes prévoit que « dans les cas bénins », une simple réprimande peut être prononcée, tandis que l'article 19 b dispose que celui qui se borne à préparer pour lui-même la consommation de stupéfiants ou à permettre à des tiers d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est « pas punissable s'il s'agit de quantités minimes ».
En réalité, on le voit bien, les difficultés soulevées par vos rapporteurs ne pourraient être dépassées qu'en décidant d'une dépénalisation, éventuellement partielle, de la consommation de stupéfiants ; ce point a d'ailleurs été amplement souligné par M. le préfet de police de Paris. Pour les raisons évoquées plus haut (278 ( * )) , vos rapporteurs ne peuvent se ranger à une telle option qu'ils jugent irresponsable.
Ils s'interrogent en outre sur le traitement des infractions susceptibles d'être commises sous l'emprise de stupéfiants qui auraient été consommés dans l'enceinte d'un centre d'injection supervisé. Il serait pour le moins paradoxal de faire preuve d'indulgence à leur égard alors que notre pays a progressivement aggravé les peines encourues, que ce soit en cas d'usage de stupéfiants par un dépositaire de l'autorité publique ou par le personnel d'une entreprise de transports, ou encore en cas de conduite d'un véhicule motorisé après avoir consommé un produit psychoactif, comportement qui, hélas, peut avoir des conséquences dramatiques. Le témoignage de l'association Marilou (279 ( * )) a été, sur ce point, particulièrement poignant. C'est d'ailleurs grâce à son engagement que la conduite sous stupéfiants est désormais sévèrement réprimée.
L'expérimentation de centres d'injection supervisés ne semble pas compatible avec la démarche aujourd'hui poursuivie. De deux choses l'une : soit il faudrait réserver un sort particulier aux auteurs d'infractions ayant consommé un produit psychoactif dans un centre d'injection supervisé où cette pratique serait licite, soit il faudrait s'assurer que les personnes ayant consommé dans le centre ne s'apprêtent pas, par la suite, à adopter un comportement illicite et dangereux. On voit bien qu'aucune de ces solutions n'est satisfaisante ou matériellement praticable. On pourrait aussi, évidemment, opter pour la solution de facilité et refuser d'envisager ce qui est susceptible de se produire après que l'usager de drogues a consommé son produit. Cela relèverait, au mieux, de l'indifférence coupable.
*
* *
Au vu des éléments qui précèdent, vos rapporteurs estiment que la transposition, en France, de l'expérience des centres d'injection supervisés serait extrêmement hasardeuse et n'est en conséquence pas souhaitable . L'absence de données médico-économiques, les divergences d'appréciation sur l'efficacité de ces structures, leur condamnation par certaines instances officielles ainsi que les difficultés juridiques qu'une telle expérimentation comporterait conduisent à cette position. Mais surtout, l'ambiguïté du discours sur les drogues qui résulterait d'une telle expérimentation est, pour vos rapporteurs, inacceptable . Persuadés que la prévention du passage à l'acte constitue le premier pilier de la politique de lutte contre les toxicomanies, ils refusent de prendre le risque d'affaiblir la portée du message de santé publique sur le caractère illicite et nocif de la consommation de drogues .
CONTRIBUTIONS
CONTRIBUTION DE M. MICHEL HEINRICH, DÉPUTÉ
(Groupe de l'Union pour un Mouvement Populaire)
Le rapport d'information sur les toxicomanies voulu par les Présidents des deux assemblées traite de l'ensemble du sujet tel que cela avait été souhaité lors de la création de la mission d'information commune.
Je souhaite remercier les Présidents et les Rapporteurs pour le travail effectué.
Cette mission d'information a été créée suite au débat qu'a suscité la possibilité de création à titre expérimental de salles d'injection supervisées après publication du rapport de l'INSERM.
Nos rapporteurs finissent par affirmer que pour eux, la création même à titre expérimental serait inopportune.
Je voudrais revenir sur un certain nombre d'affirmations.
À propos de ces salles, le rapport parle d'espaces de libre consommation, de zones de non-droit, de politique de capitulation, ce qui laisse penser que seule la vision « salle de shoot » et non salle de consommation à moindre risques ait été perçue. Les salles de consommation sont extrêmement réglementées, supervisées par des professionnels. Elles ne peuvent exister que s'il y a une coopération étroite notamment avec la police, et que si elles sont soutenues par les collectivités locales et par l'État. Nous sommes donc très éloignés de la zone de non-droit et de l'espace de libre consommation. On ne peut pas parler de capitulation : les salles de consommation représentent une nouvelle main tendue à des usagers en grande précarité. Elles permettent à ces usagers de rentrer en contact avec des professionnels et d'entamer un parcours vers le soin. Par exemple, quand la salle de Vancouver s'est ouverte, il y a eu une augmentation de 30 % de demande de sevrage dans la ville, ce qui montre bien que c'est une porte d'accès vers le soin.
Ce rapport fait référence au rapport de l'INSERM mais ignore le rapport de l'Institut national du Québec, les 30 études de la salle de Vancouver, le rapport de l'association « Élus, Santé Publique et Territoires » (qui n'a d'ailleurs pas été auditionnée, mais qui, composée d'élus locaux de gauche et de droite, avait pris position pour l'expérimentation, en citant un certain nombre de conditions restrictives).
Au niveau des coûts des salles de consommation, qui seraient trop élevés, le rapport ne parle que des 2,8 millions d'euros que coûte la salle Quai 9 à Genève. Il a été oublié de mentionner que les intervenants de ces salles sont deux à trois fois plus payés qu'en France, et que ces 2,8 millions prennent en charge un bus d'échange de seringues. À titre de comparaison, la salle de consommation de Bilbao coûte 500 000 euros par an.
Le rapport coût-efficacité sur ces salles n'existerait pas. Or, les salles de Vancouver et de Sydney ont fait des études sur ce rapport cout-efficacité et les études menées à Vancouver montrent que un dollar mis dans une salle de consommation rapporte 5 dollars à l'État.
Concernant l'acceptation par la population, il est fait référence au sondage paru dans le rapport EROPP de 2008 où seuls 27 % des Français seraient pour l'ouverture de salles de consommation. Or, le sondage réalisé après le débat sur les salles de consommation, le 19 août 2010, confirme que 53 % des Français seraient favorables à ce dispositif.
Il est dit que les scènes ouvertes en France sont diffuses et mobiles. Or, dans le Nord Est parisien, dans le 10 ème entre les gares du Nord et de l'Est, à Saint Denis, à Stalingrad, des scènes de consommation existent depuis plus de 15 ans. Certes, elles se déplacent de 100 mètres, quand il y a une grosse opération de police. Mais la police ne pouvant pas toujours être là, elles finissent toujours par revenir.
Au niveau des overdoses, je relève un certain nombre d'incohérences : dans le chapitre sur « les risques pour la santé », il est affirmé que bien que les overdoses soient faibles en France, on les sous-estime d'au moins 30 % et que le nombre de décès est certainement plus proche du millier, et qu'on ne recense pas les décès par overdose de cocaïne en France. Alors que dans le chapitre « salles de consommation », il est dit, paradoxalement, que la France à un taux d'overdose plus faible qu'à l'étranger. Il faut cependant savoir que chaque pays a une manière propre de comptabiliser ses overdoses et qu'il ne peut y avoir de comparaison. Mais, même si le nombre d'overdoses était moins élevé en France, ce qui n'est certainement pas le cas, serait-ce une raison pour ne rien faire ?
Il est dit dans ce rapport qu'il existe 500 structures de traitement spécialisées mais il n'est pas précisé que pour beaucoup, ce sont des structures d'accueil pour l'alcool et non pour les usagers de drogues.
Comme le fait la MILDT, ce rapport assure que les salles de consommation banaliseraient l'usage de drogue et que ce serait une dépénalisation de fait. Il est important de noter que ce sont des arguments utilisés par les opposants aux programmes d'échange de seringues en pharmacies dans les années 80, ou les opposants aux programmes de méthadone dans les années 90. Or aujourd'hui, plus personne n'oserait affirmer cela. À chaque nouvel outil de réduction des risques, les opposants parlent de banalisation des drogues et de dépénalisation, ce qui témoigne d'une méconnaissance de ce qu'est la réduction des risques et de ses outils. Les études ont d'ailleurs montré que l'implantation des salles de consommation ne crée pas de nouveaux consommateurs dans la communauté, et que la consommation des usagers n'augmentait pas, ce qui contredit la banalisation. De plus, certains partisans des salles de consommation sont aussi pour une forte pénalisation de l'usage, ce qui montre bien que les sujets n'ont rien à voir.
La seule proposition faite pour remplacer les salles de consommation, c'est la proposition de la MILDT qui consiste à créer des maraudes, c'est-à-dire des actions où des professionnels parcourent les rues à la recherche des usagers. C'est tout à fait hors de propos. Par exemple, à Paris, ville qui a fait le voeu de pouvoir ouvrir au moins une salle de consommation, il existe déjà énormément de maraudes. Les associations Gaïa, Charonne, Ego en réalisent, mais ce sont ces mêmes associations qui demandent l'ouverture des salles de consommation parce qu'elles n'arrivent pas à atteindre et à travailler avec les usagers très précarisés. D'autre part, contrairement aux salles de consommation, les maraudes ne vont pas empêcher les usagers de consommer dans les caves, dans les parkings, les cages d'escaliers ou les toilettes publiques, ce qui est le reflet de notre indignité, et ce qui marginalise et exclut ces personnes. Les salles de consommation sont aussi un outil de citoyenneté : en donnant un endroit aux usagers pour consommer dignement et proprement, on les réintègre physiquement autant que symboliquement dans la cité. Enfin, avec les maraudes, on est sur le terrain des usagers, de la rue, alors qu'avec les salles de consommation, on est sur le terrain des professionnels. On ne peut pas faire le même travail, notamment par rapport à la création de lien social, mais aussi par rapport aux conseils de réduction des risques, ou de soins.
Je regrette donc que ce rapport ne soit pas plus prolixe sur la réduction des risques.
CONTRIBUTION DES DÉPUTÉS DU GROUPE SRC ET DE SÉNATEURS DU GROUPE SOCIALISTE
(M. Serge Blisko, coprésident, Mme Catherine
Lemorton, M. Jean-Marie Le Guen, M. Daniel Vaillant,
Mme Michèle Delaunay, députés, et
Mme Virginie Klès, Mme Nicole Bonnefoy,
sénatrices)
Les députés du groupe SRC et des sénatrices du groupe socialiste ayant participé à cette mission ont souhaité apporter une contribution au rapport afin de préciser leur position.
Un champ d'investigation trop restrictif
La mission d'information qui s'est constituée en décembre 2010 a circonscrit son champ d'analyse à la consommation de produits illicites stupéfiants, en précisant que ce champ impliquait de traiter les questions de l'offre, de la lutte contre les trafics, du régime juridique de la consommation, de la prise en charge des toxicomanes.
On peut regretter ce choix restrictif dans la mesure où, comme l'atteste le rapport dans la partie consacrée aux pratiques, on assiste à une augmentation de la polytoxicomanie, et en particulier dans les soirées de jeunes avec une consommation importante d'alcool en association avec d'autres produits, licites ou illicites.
La distinction entre produits licites et illicites en matière de toxicomanie revient donc sur le devant de la scène avec ce rapport, alors que bien des études ont montré que cette distinction ne permettait pas de construire une véritable politique de lutte contre toutes les addictions.
Serait-ce parce que l'objectif politique de la majorité au travers de cette mission était de clore le débat qui est à l'origine de sa création, à savoir les salles de consommation à moindres risques ?
Si une partie des constats (positifs et négatifs) issus des travaux de la mission concernant les produits, les pratiques et les politiques menées dans ce champ peuvent être partagés, cependant les conclusions qui en sont tirées pour les politiques à venir sont plus contestables et parfois même inacceptables.
La réduction des risques doit être un des objectifs prioritaires et non l'éradication utopique de la consommation de drogues.
La politique de réduction des risques est le résultat d'une véritable prise de conscience de la nécessité de traiter la consommation de drogue comme un problème de santé publique ; cela a représenté un bouleversement culturel. Ce changement est venu de la volonté des pouvoirs publics de prendre des mesures devant l'ampleur des problèmes de santé entraînés par la consommation de drogues, en termes de diffusion de maladies infectieuses et surtout devant les ravages causés par le SIDA dans la population toxicomane.
Les faits marquants de ces changements étaient le décret de 1987 pris par Michèle Barzach, autorisant la vente libre de seringues dans les pharmacies, suivi des programmes d'échange de seringues en 1990, puis les traitements de substitution aux opiacés, avec la méthadone et le Subutex en 1995.
Cette politique de réduction des risques est désormais inscrite depuis 2004 dans le code de la santé publique et définie par l'article L. 3121-4.
Considérer que tout traitement doit être uniquement orienté vers un objectif de sevrage ou d'abstinence s'est avéré être une erreur, que la réduction des risques est venue en quelque sorte corriger, sans remettre en cause bien sûr la lutte contre le trafic, ni la nécessité de prévenir l'usage de drogues.
Le rapport en fait part dans ses constats, mais il minimise à quel point la politique de réduction des risques a été un bouleversement majeur. Ainsi à la fin de la partie qui est consacrée à ce sujet, il ne parle que « d'avancées encourageantes »... qu'il convient « d'ajuster ».
Ces propos ne sont pas étonnants puisque l'objectif affiché est de parvenir à une société sans drogues, utopie pourtant dangereuse, qui exclut de fait une partie de la population toxicomane dont on sait qu'elle ne parviendra jamais à l'abstinence.
Près de 150 000 personnes prennent actuellement en France des traitements de substitution. Ces traitements ont permis de « resocialiser » une partie de cette population, en lui permettant de sortir de la rue, de reprendre une vie sociale, de construire une famille, de ne plus être exposée aux maladies infectieuses.
Sortir de l'addiction restera malheureusement un but inatteignable pour certains ; il faut donc définir des objectifs divers et définir ce que l'on peut considérer comme une réussite ou du moins une amélioration dans ce domaine.
La population toxicomane a une espérance de vie de 40-45 ans. Une partie ne sortira pas de la dépendance ; le devoir de l'État doit être de leur porter secours, car certains vivront avec toute leur vie. L'objectif en ce qui les concerne doit donc être de leur permettre de réintégrer le droit commun.
Il est nécessaire aujourd'hui de consolider une véritable politique de santé publique dotée de réels moyens avec une prévention digne de ce nom. Il faut donc sortir du débat stérile entre ce qui, de la répression ou de la prévention, doit l'emporter, et ne plus considérer la santé publique comme accessoire en matière de lutte contre les toxicomanies.
Concernant le public des jeunes, les messages des campagnes de communication de l'INPES ne sont pas efficaces. Il faut donc remettre à plat les outils de prévention et mettre les moyens sur ceux qui apparaissent les mieux adaptés.
Dans le rapport figure une partie intitulée « prévenir dès le plus jeune âge ». Elle rappelle le constat, largement admis depuis longtemps, selon lequel il faut intervenir le plus tôt possible auprès des enfants et qu'il ne s'agit pas de banaliser ni de dramatiser les problèmes liés à la drogue mais de prévenir par l'information.
La prévention doit porter aussi sur la place et la perception du médicament dans notre société et lutter contre sa banalisation comme un objet de « consommation courante ».
Or dans ce même chapitre, apparaît une proposition inacceptable selon laquelle il faudrait « mettre en place des programmes spécifiques et pérennes au plus tard à l'école primaire et jusqu'au lycée pour détecter les facteurs de risque chez l'enfant ». Nous ne pouvons tolérer de tels propos selon lesquels des comportements d'enfants en bas âge pourraient être des signes de délinquance à venir et justifier un fichage de ces enfants.
Une offre de soins organisée mais fragile
La mission a pu constater que si l'offre de soins est assez bien organisée dans notre pays, elle est totalement inégale suivant les territoires.
La spécialité d'addictologie reste à conforter, aux côtés d'une ouverture plus grande de la psychiatrie publique.
En revanche, le rapport montre bien que la prévention apparait désuète, inadaptée, trop tardive, et n'est pas bien traitée dans les établissements scolaires.
La prévention en matière de toxicomanie doit être menée par des acteurs de santé publique, des professionnels formés et adaptés aux enfants.
Il faut intégrer ce volet aux actions d'éducation à la santé menées dans les établissements scolaires. L'école ne peut pas tout, mais elle se révèle le lieu adapté pour mener une prévention efficace ; il faut simplement lui en donner les acteurs et les moyens.
Il ne peut pas y avoir de politique sanitaire sans prise en compte du volet social. De ce point de vue, les communautés thérapeutiques, comme le centre Pierre Nicole à Paris ou comme celles qui existent en Italie, pourraient être plus développées. Les groupes de parole des Narcotiques anonymes doivent être encouragés.
S'agissant des publics incarcérés, les informations confuses issues des auditions de la mission sur les pratiques en matière de drogues dans ce milieu sont révélatrices des difficultés pour les pouvoirs publics à appréhender le problème. Il convient de mener dans ce milieu plus d'actions de réduction des risques.
La nécessité de mieux prévenir mais aussi de mettre en place des expérimentations de salles de consommation à moindres risques
L'objectif d'une société sans drogues est irréaliste et dangereux car il revient à faire de la répression l'alfa et l'oméga de toute politique publique. Cela a pour conséquence d'éloigner les usagers de drogues du système de santé et de les condamner à la marginalisation, qui est pourtant une source d'insécurité pour eux-mêmes et pour les autres. Nous ne pouvons accepter cet objectif qui est une régression.
Nous pensons qu'il est nécessaire de multiplier les possibilités diverses de soins et d'accompagnement des personnes pour mener une réelle politique de santé publique.
Ainsi, contrairement au rapport qui présente les salles de consommation à moindres risques comme une option hasardeuse, nous souhaitons que les villes comme Paris, Toulouse et Marseille puissent mener à bien des expérimentations de salles d'injection contrôlées médicalement avec des professionnels de santé et des travailleurs sociaux.
Il en existe une cinquantaine à l'étranger ; les membres de la mission sont allés en visiter. En particulier, lors de la visite à Genève, on a pu constater que des Français venaient dans ce lieu.
Nous ne pouvons que souscrire à ces structures qui s'inscrivent dans la droite ligne de la politique de réduction des risques et ouvrent la perspective, pour ce public très précarisé et marginalisé, d'une porte d'entrée adaptée au système de soins.
La partie du rapport concernant la dépénalisation fait largement l'impasse sur la question essentielle de la crédibilité d'une loi répressive, car lorsque celle-ci est inégalement appliquée, la justice en ressort décrédibilisée. Le rapport Henrion abordait déjà ce problème concernant la loi de 1970.
Sur le sujet, ce rapport, loin de clore le débat, ne fait que le traiter partiellement, comme pour la question des salles de consommation à moindres risques.
Il n'est pas ici question de refaire le travail de la mission, mais il nous a paru essentiel de préciser ces remarques et de regretter que ce long travail n'ait pas permis de déboucher sur des propositions adaptées à la nécessité de traiter ce problème essentiel de lutte contre les addictions avec des moyens et une politique de santé publique digne d'une société moderne du 21 e siècle.
EXAMEN DU RAPPORT PAR LA MISSION
La mission d'information sur les toxicomanies se réunit le mercredi 29 juin à quatorze heures, sous la présidence de MM. Serge Blisko, coprésident pour l'Assemblée nationale, et François Pillet, coprésident pour le Sénat, pour examiner le rapport d'information de Mme Françoise Branget, corapporteure pour l'Assemblée nationale, et M. Gilbert Barbier, corapporteur pour le Sénat.
M. Serge Blisko, coprésident pour l'Assemblée nationale. Mes chers collègues, nous voici arrivés au terme de six mois d'un travail aussi intense que riche en auditions de grande qualité - leurs comptes rendus figureront dans les annexes du rapport - même si le nombre de nos déplacements a été limité tant pour des raisons budgétaires que d'emploi du temps.
Je tiens à remercier M. François Pillet, qui a présidé à mes côtés la mission d'information, les deux corapporteurs, pour leur sagacité, ainsi que tous les membres de la mission pour leur assiduité.
Si je ne partage pas toutes les conclusions du rapport, celui-ci n'en reflète pas moins la réalité du travail que nous avons effectué. Nous y ajouterons, avec les sénateurs socialistes, une contribution des députés du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, membres de la mission, qui porte sur quelques points sensibles du rapport.
M. François Pillet, coprésident pour le Sénat. Je tiens moi aussi à remercier chacun du travail fourni dans le cadre de cette mission qui s'est déroulée dans les meilleures conditions en vue de collecter les renseignements que nous souhaitions obtenir. Des auditions aussi nombreuses qu'approfondies nous ont permis d'entendre un large éventail d'experts.
En dépit de divergences inévitables, ce rapport sur les consommations de drogues, substances dont personne ne conteste l'extrême nocivité, me paraît être le mieux documenté sur le sujet depuis de nombreuses années.
Je m'associe aux félicitations qu'a adressées M. Serge Blisko, dont chacun a pu apprécier l'ouverture d'esprit.
Mme Françoise Branget, corapporteure pour l'Assemblée nationale. J'ai eu moi aussi beaucoup de plaisir à travailler au sein de cette mission d'information, notamment avec le corapporteur pour le Sénat, M. Gilbert Barbier. J'aurais aimé pouvoir approfondir davantage certains points ou élargir les sujets, mais le temps nous a manqué. Je m'associe aux remerciements formulés par MM. les coprésidents.
Mes chers collègues, vous avez pu prendre connaissance de notre rapport. Nous n'allons donc pas en exposer les nombreux éléments mais simplement donner des « coups de projecteur » sur certains points qui nous paraissent particulièrement importants.
Tous, nous partageons le constat suivant : les toxicomanies d'aujourd'hui ne peuvent être comparées à celles d'il y a trente ou quarante ans. La toxicité des drogues s'est fortement accrue ; la polytoxicomanie s'est répandue ; les réseaux de trafic se sont « professionnalisés ».
Nous estimons que la première des réponses doit être la prévention dès le plus jeune âge. La démarche actuelle nous paraît insuffisante : recourir à des gendarmes dans les écoles ne paraît pas le mieux adapté. Il faut donc, dès l'école primaire, conduire des actions centrées sur la promotion de la santé et l'estime de soi, pour apprendre aux élèves à dire « non » et à résister à la pression.
Il faut également mettre l'accent sur la détection précoce des jeunes à problèmes pour leur éviter de franchir le pas, en s'appuyant sur l'expérience des médecins et des infirmiers scolaires. Parallèlement, il convient de responsabiliser les adultes encadrant les jeunes en les formant à la prévention et de mieux associer les familles aux campagnes de sensibilisation. Enfin, il semble nécessaire d'intensifier la prévention dans l'entreprise.
Au-delà de la prévention, il faut également disposer d'une offre de soins variée et renforcée. Plusieurs voies doivent être exploitées, car il n'existe pas de réponse unique. La première consiste à développer, avec volontarisme, les communautés thérapeutiques. Celles-ci en sont au stade expérimental en France : on n'en compte que sept. C'est tout à fait insuffisant quand on constate les succès qu'elles remportent à l'étranger : non seulement elles orientent des toxicomanes vers l'abstinence, mais elles les aident à se réinsérer, sans pour autant les soumettre à un parcours médicalisé parfois sans fin. Nous fixons un objectif raisonnable : disposer d'une communauté thérapeutique par région.
Il faut également renforcer les capacités d'accueil et d'hébergement des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, poursuivre la structuration de l'offre hospitalière, améliorer le maillage territorial en établissements médico-sociaux et faire mieux connaître les consultations destinées aux jeunes consommateurs. Il convient en outre de développer les passerelles entre les dispositifs de prise en charge car l'éparpillement des structures nuit à la continuité du parcours de soins des toxicomanes.
Enfin, le renforcement de l'offre de soins suppose d'améliorer la formation en addictologie des professionnels de santé et la recherche dans ce domaine pour dépasser les querelles de chapelle.
Le troisième pilier de la prise en charge des toxicomanes est la réduction des risques. Cette politique, qui a permis des progrès en matière de santé publique, doit être aménagée dans un esprit de responsabilité. À cet égard, nous nous interrogeons sur les traitements de substitution aux opiacés, qui posent trois problèmes.
Le premier est celui de leur durée : ils semblent devenir des traitements « à vie ». Quelle est la voie de sortie ? Il faut mener des recherches et faire le véritable bilan de ces traitements. Le deuxième problème est celui du trafic de Subutex. Nous proposons l'ouverture systématique d'un dossier pharmaceutique pour les personnes souhaitant s'en faire délivrer, non pour les stigmatiser mais pour mieux contrôler la délivrance de ce produit qui peut conduire à l'addiction. Le troisième problème est celui des décès, beaucoup trop nombreux, liés à la prise de méthadone. Nous proposons que la prescription soit encore plus encadrée lors de la reconduction du traitement en médecine de ville, en s'appuyant sur les réseaux ville-hôpital, et qu'un bilan médical régulier soit mené pour éviter les surdoses.
Dans le cadre de la réduction des risques, certains ont proposé l'expérimentation de centres d'injection supervisés. Nous y sommes défavorables, comme le sont plusieurs instances officielles reconnues, dont l'Académie nationale de médecine. Nous constatons que l'expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, qui a lancé le débat de l'été dernier, est en réalité plus nuancée qu'on l'a laissé croire et que le consensus n'existe pas sur la question.
Notre visite de l'espace Quai 9 à Genève ne nous a pas non plus convaincus. L'efficacité de ces centres pour lutter contre la diffusion des virus de l'immunodéficience humaine et de l'hépatite C n'a pas été démontrée. De plus, ces centres ont été créés dans des pays qui connaissent des situations très particulières de « scènes ouvertes » de la drogue, phénomène dont l'ampleur est moindre en France.
Nous estimons donc que ces centres ne seraient pas adaptés à la situation française : les surdoses mortelles sont chez nous moins nombreuses, les scènes de consommation de drogues sont mobiles et diffuses et la réduction des risques a permis d'améliorer la santé des toxicomanes.
L'expérimentation de ces centres poserait en outre des difficultés juridiques puisqu'il faudrait accepter que, dans certains lieux, la consommation de drogues soit légale, ce qui serait contraire aux conventions internationales qui lient la France. Cela poserait également des questions difficiles à régler : quelle serait la responsabilité des professionnels de santé travaillant dans ces centres en cas de surdose ? Comment devraient agir les forces de l'ordre à proximité des centres ?
Enfin, nous jugeons que de tels centres donneraient un message extrêmement ambigu sur l'attitude des pouvoirs publics à l'égard de la drogue, ce qui ne pourrait qu'affaiblir la portée des actions de prévention. Nous ne pouvons l'accepter.
En réalité, ce qui compte, c'est moins d'offrir un espace d'injection que de nouer un contact avec des populations très fragiles. Nous proposons donc de multiplier les maraudes pour établir un premier contact avec ces populations et les orienter vers le système de soins.
Le corapporteur, M. Gilbert Barbier, va maintenant vous exposer notre point de vue sur d'autres questions, en particulier le régime juridique de l'usage des drogues.
M. Gilbert Barbier, corapporteur pour le Sénat. Je tiens à remercier nos deux coprésidents, ainsi que la corapporteure, Mme Françoise Branget. Si nous présentons chacun une partie des conclusions, elles n'en sont pas moins communes. Je remercie également l'ensemble des membres de la mission, notamment ceux du Sénat, dont certains sont en fin de mandat, ce qui entraîne pour eux un surcroît d'activité ; ainsi, Mme Marie-Thérèse Hermange a présenté hier un important rapport sur le Mediator.
Après la présentation par Mme Françoise Branget des questions touchant notamment à la prévention et aux centres d'injection supervisés, j'aborderai une autre question qui me paraît centrale : le caractère effectif de la dissuasion par la sanction. Toutefois, je souhaite auparavant compléter les propos de Mme Françoise Branget sur un point important de la réduction des risques : la question de la disponibilité de seringues dans les prisons.
Le risque d'être contaminé en prison par le virus de l'hépatite C est dix fois supérieur à celui encouru en milieu libre, et le risque de transmission des virus de l'hépatite B ou de l'immunodéficience humaine est multiplié par quatre. Les partages de matériel sont en effet systématiques en milieu carcéral. Face à cette situation, le Conseil national du SIDA, dont je suis membre, a estimé dans un avis de septembre 2009 que le dispositif de réduction des risques devait bénéficier aux personnes détenues. La peine d'emprisonnement, a remarqué le conseil, est privative de liberté, non pas de soins ni de prévention. Nous partageons cette conviction et proposons en conséquence que soient mis en oeuvre des programmes d'échange de seringues en milieu carcéral.
La question des sanctions de l'usage des drogues illicites comporte deux branches. Faut-il sanctionner ? Si oui, comment faire pour que la sanction soit plus efficace ?
Le débat sur la sanction est ancien ; il a été assez peu abordé par nos interlocuteurs mais relancé récemment par notre collègue député, M. Daniel Vaillant, qui propose de supprimer les sanctions de l'usage du cannabis et d'instituer un régime juridique de la fourniture de cannabis aux usagers. Je suis fondamentalement hostile à cette proposition car, à mes yeux, les drogues illicites, y compris le cannabis, sont des poisons - les auditions l'ont confirmé - dont il faut absolument combattre l'usage, et plus particulièrement par la jeunesse.
Vous avez lu le rapport. Je rappelle simplement qu'il n'y a pas de drogue « douce » : tous nos interlocuteurs en sont convenus peu ou prou. Le cannabis est dangereux, à l'instar des autres drogues. Je n'y reviens pas.
Cela dit, la plupart des arguments favorables à la dépénalisation de l'usage du cannabis mettent en avant non pas une supposée moindre dangerosité du cannabis mais des effets connexes de la prohibition de son usage, notamment la morbidité causée par l'absence de contrôle de la qualité des produits et le lien de causalité entre prohibition et criminalité.
Ces arguments ne convainquent pas.
S'agissant de la qualité des produits, je rappelle que ce qui est nocif, c'est la drogue et non pas tant ce qui peut lui être ajouté, qui est peu appétissant mais rarement dangereux - c'est du moins ce qui ressort des auditions. En tout état de cause, les marchés clandestins des produits restés interdits, qui se reconstitueraient nécessairement à la marge du secteur dépénalisé, seraient vraisemblablement approvisionnés par des produits plus dangereux, notamment en principe actif, que ceux qui sont actuellement proposés aux consommateurs : ces produits seraient plus concentrés et plus violents pour être plus alléchants. L'argument de la qualité des produits disponibles en régime de dépénalisation me paraît donc un leurre.
Je tiens également à remarquer qu'on a entendu parler de dépénalisation et de légalisation : ce sont, à nos yeux, deux termes synonymes.
En ce qui concerne les trafics, ne soyons pas non plus naïfs : le lien de cause à effet entre la prohibition, d'une part, la petite et la grande criminalité, d'autre part, est complexe. Il ne suffirait pas de supprimer la cause - la prohibition - pour supprimer la conséquence - la criminalité liée aux trafics : rappelons-nous la suppression de la prohibition de l'alcool aux États-Unis, qui a sans doute été largement à l'origine de la montée en puissance du trafic des stupéfiants et de la consolidation de la mafia. De la même manière, la suppression de la prohibition du cannabis susciterait l'apparition de nouveaux marchés clandestins contrôlés par les mêmes organisations criminelles ou mafieuses. J'ajoute, s'il en est besoin, que les engagements internationaux souscrits par la France ne permettent pas la légalisation de la consommation personnelle de quelque stupéfiant que ce soit.
Toutefois, ce n'est pas tout que de réaffirmer l'interdit, encore faut-il conforter son efficacité ; or notre législation laisse manifestement à désirer en la matière.
En principe, l'usage illicite des stupéfiants est sanctionné au maximum par une peine d'un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 euros. Je pense que trop de sanction tue la sanction : est-il raisonnable de promettre à des jeunes s'essayant à un premier usage une peine de prison d'un an alors qu'ils ont du mal à se considérer comme de dangereux délinquants ? Du reste, on ne les traîne pas en prison lors de leur première interpellation en « situation » ou en possession d'une dose destinée à leur usage personnel, et c'est heureux. Ce qui l'est moins, et qui est même très regrettable, c'est que l'interpellation et la sanction épargnent ainsi des catégories entières de jeunes consommateurs - collégiens, lycéens, apprentis, étudiants, jeunes dans la vie active -, c'est-à-dire toute une population qu'il faudrait dissuader de se lancer en toute impunité dans l'expérience de la drogue. Les sanctions doivent être vraisemblables, c'est-à-dire proportionnées, et effectives, c'est-à-dire appliquées. Or, quand il y a, rarement, interpellation suivie d'une sanction, celle-ci se borne la plupart du temps à un maigre rappel à la loi, oublié aussitôt qu'infligé. Qu'en est-il dès lors de la valeur de l'interdit et du respect dû à la loi ?
C'est pourquoi je propose une stratégie de dissuasion orientée vers l'usager expérimentateur, en sanctionnant la première consommation constatée de toute drogue illicite par une amende contraventionnelle. Cette sanction remplacerait l'inapplicable peine délictuelle actuellement en vigueur dès le premier usage. En cas de deuxième interpellation, le contrevenant retomberait dans le régime délictuel actuel.
Il s'agirait d'une amende de troisième classe, dont le taux maximum est de 450 euros. Conformément au régime juridique des contraventions, il serait possible au contrevenant, et c'est tout l'intérêt de la mesure, d'empêcher le déclenchement des poursuites en réglant une amende forfaitaire de 68 euros dans un délai de quarante-cinq jours. Une sanction simple, immédiate et donc effective et crédible pourrait ainsi être appliquée par les forces de l'ordre. Cette sanction serait en outre homogène, c'est-à-dire équitable, son montant ne dépendant pas de l'appréciation d'un magistrat ou de la politique d'un parquet. Elle serait également non stigmatisante pour le primo-consommateur sanctionné, les contraventions de troisième classe n'étant pas mentionnées au casier judiciaire. En un mot, il s'agit de créer une véritable dissuasion pour un segment de population particulier, mais essentiel et qui nous intéresse en priorité, la jeunesse, population pour laquelle la réponse pénale à la violation de l'interdit est actuellement lacunaire parce qu'inadaptée aux réalités quotidiennes de la consommation de drogues illicites.
Mme Françoise Branget, corapporteure pour l'Assemblée nationale. J'ajoute que nous proposons d'intituler le rapport : « Toxicomanies : rejeter la fatalité, renouveler les stratégies ».
M. Michel Heinrich, député. Je tiens moi aussi à saluer le travail effectué.
J'ai déjà eu l'occasion, en 2007, dans le cadre d'un rapport pour avis sur les crédits de la mission « Santé » du projet de loi de finances, d'aborder la question de l'efficacité des politiques menées en matière de lutte contre la toxicomanie. J'avais, à l'époque, préconisé les communautés thérapeutiques et les salles d'injection supervisées. Je me félicite que le rapport insiste sur la nécessité de développer les premières.
S'agissant des traitements de substitution aux opiacés, le mésusage du Subutex est un énorme problème - j'ai pu le constater en tant que pharmacien. Le dossier pharmaceutique apportera une solution efficace. Il faudra donc l'imposer afin de pouvoir suivre, dans le pays entier, tout patient prenant du Subutex, seul moyen d'éviter les prescriptions abusives.
À propos des salles d'injection supervisées, le rapport, à mon grand étonnement, évoque « des zones de non-droit » et « une politique de capitulation », ce qui laisse à penser que seule la vision « salle de shoot » et non « salle de consommation à moindres risques » a été retenue. Je tiens à rappeler que les salles de consommation sont réglementées, et supervisées par des professionnels. C'est une nouvelle main tendue à des usagers en grande précarité, à qui l'on permet d'entrer en contact avec des professionnels et d'entamer un parcours de soin.
Quant à dire du coût de ces salles qu'il serait trop élevé, c'est biaiser le débat puisque dans la salle Quai 9 de Genève, les intervenants sont deux à trois fois plus payés qu'en France et que de plus, le coût de cette salle - 2,8 millions d'euros - comprend également la prise en charge d'un bus d'échange de seringues. À titre de comparaison, la salle de consommation de Bilbao coûte 500 000 euros par an.
En ce qui concerne les surdoses, l'argument selon lequel elles sont moins nombreuses en France que dans les autres pays n'en est pas un : il en reste encore beaucoup trop !
Enfin, à la suite de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, ce rapport assure que les salles de consommation banaliseraient l'usage de drogues, entraînant une dépénalisation de fait. Je rappelle que ces mêmes arguments ont été utilisés par les opposants aux programmes d'échange de seringues en pharmacies lorsqu'elles ont été mises en vente libre en 1987, et par les opposants aux programmes de méthadone dans les années 1990.
La proposition, reprise de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, de remplacer les salles de consommation par des maraudes n'est pas satisfaisante. Du reste, ce sont les associations qui réalisent des maraudes - Gaïa, Charonne ou Ego -, qui demandent l'ouverture des salles de consommation parce qu'elles n'arrivent pas à atteindre les usagers les plus vulnérables, d'autant que les maraudes n'empêchent pas les conditions d'injection déplorables dans les caves ou d'autres lieux. L'absence de « scènes ouvertes » n'est pas non plus un très bon argument : entre les gares du Nord et de l'Est, à Paris, les scènes ouvertes de consommation de drogue existent depuis quinze ans. Simplement, elle se déplacent d'une centaine de mètres en fonction des opérations de police.
Je regrette enfin que le rapport ne soit pas plus prolixe sur la réduction des risques, notamment en milieu festif ou à la campagne, où des problèmes relativement nouveaux se posent de manière importante.
M. Patrice Calméjane, député. Je tiens à remercier les deux coprésidents et les deux corapporteurs du travail fourni par la mission d'information.
Je n'appartiens pas au milieu médical : je suis simplement élu dans un département qui est très concerné par la consommation de drogues et ses conséquences pour l'ensemble de la population. Samedi soir encore, un trentenaire s'est tué en se jetant d'un sixième étage après avoir consommé de la drogue - j'ignore s'il entrera dans les statistiques des suicides ou des morts par consommation de stupéfiants.
L'expérience nous enseigne que nos prédécesseurs ont eu raison de prendre des mesures permettant de freiner le développement des virus de l'immunodéficience humaine ou de l'hépatite C grâce, notamment, à la mise à disposition de seringues. Je suis d'accord avec M. Gilbert Barbier s'agissant des efforts à fournir en matière de lutte contre la transmission de ces maladies dans les prisons, dont la population est, par définition, sous contrôle. Mme Françoise Branget a également eu raison d'insister sur le fait qu'il faut poursuivre, en matière de prévention, les efforts de sensibilisation à l'adresse de la jeunesse. Les auditions ont ainsi mis en évidence qu'il fallait accentuer l'implication de l'Éducation nationale en la matière : dans certains pays du nord de l'Europe, c'est dès la maternelle que les enfants sont sensibilisés aux dangers des stupéfiants.
Je regrette enfin que le débat sur la dépénalisation de l'usage de la drogue se soit immiscé dans les travaux de la mission d'information car il n'y avait pas sa place. Il est rappelé, dans la troisième partie du rapport, que « la dépénalisation de l'usage » est « une impasse éthique et juridique ». Une analyse raisonnée le montre : il faut poursuivre le travail entamé. Les effets des politiques anciennes conjugués à ceux des politiques nouvelles qui seront engagées à la suite de ce rapport permettront de conserver en France un taux plus faible de consommation de drogues que dans les autres pays et donc d'en limiter les dégâts. Il faut maintenir notre niveau d'hygiène et de soins, sans faiblir en matière de répression. Je suis également favorable à la proposition de M. Gilbert Barbier d'instaurer, pour la première interpellation, une amende de troisième classe avant de recourir au régime délictuel à la deuxième interpellation. Il faut en effet sensibiliser, dès la première fois, les jeunes aux conséquences de la consommation de drogues : nous sommes plusieurs élus à constater que dans nos départements la consommation de drogues ne fait plus l'objet de sanction. Le volet pénal n'étant jamais appliqué, la loi a perdu tout son sens.
Je souhaite que ce rapport permette d'en revenir aux fondamentaux en matière de lutte contre la drogue. Les parlementaires ne s'étaient pas saisis du sujet depuis de nombreuses années : il conviendra que, dans cinq ou six ans, ils fassent le bilan des actions qui, à la suite de ce rapport, seront adoptées par le Parlement et mises en application par le Gouvernement, notamment en matière de santé et de sécurité publiques.
Mme Catherine Lemorton, députée. Cette mission nous a permis d'auditionner la majeure partie des experts sur le sujet.
Je n'ajouterai rien aux propos de M. Michel Heinrich sur les « salles de consommation » qu'on ne saurait précisément réduire à de simples lieux de consommation de drogue. Elles permettent de créer du lien social. Pour avoir effectué des maraudes avec Médecins du monde, je puis dire qu'elles ne suffisent pas à détecter les plus désociabilisés des toxicomanes et à recréer du lien social avec eux.
Je regrette qu'on ne laisse pas les villes qui se sont portées volontaires - Paris, Marseille, Toulouse - expérimenter l'ouverture de telles salles. Je l'ai déjà dit : on ne peut pas distribuer des seringues stériles dans les pharmacies et accepter que, cinquante mètres plus loin, la personne se pique au vu et au su de tous sur des places publiques ou dans des parkings souterrains.
Je propose par ailleurs des corrections d'ordre technique, de peur que des spécialistes n'accusent le rapport d'avoir été mal écrit. Ainsi, page 109, le rapport évoque des substances « morphiniques » : en pharmacologie, on préfère parler d'opioïdes. Il est écrit à la même page que les traitements de substitution agissent sur les aspects « biologiques », alors qu'ils agissent en réalité sur les aspects « pharmacologiques ».
Par ailleurs, je m'étonne de lire page 116 que M. Jean-Yves Grall, directeur général de la santé, demande que soit menée « une étude épidémiologique approfondie afin d'étudier avec attention les décès liés à des surdoses de méthadone ». Comme je l'ai rappelé lors de la précédente réunion de la mission d'information, la méthadone est un agoniste total, qui sature tous les récepteurs des opioïdes ; si, donc, la personne prend aussi une autre substance opiacée, elle sera victime d'un surdosage. Le Subutex, quant à lui, s'adresse à des personnes moins stabilisées parce qu'il a, si l'on peut dire, l'avantage d'être un agoniste partiel : le consommateur qui prendra des substances non prévues par le traitement ne risquera donc pas de surdose puisque tous les récepteurs des opioïdes ne sont pas saturés. Un chef de service de l'hôpital de Toulouse, spécialiste de pharmacologie, me l'a confirmé hier au téléphone, devant M. Serge Blisko.
Par ailleurs, qu'est-ce que sortir une personne de l'addiction ? Il n'y a pas de règle générale et les corapporteurs ont raison de vouloir ouvrir toutes les possibilités de prise en charge des personnes. Est-il toutefois possible de sortir totalement de l'addiction une certaine frange de la population? Ma réponse est claire : c'est non. De même qu'on ne pourra jamais réintégrer dans le monde du travail la petite frange complètement désociabilisée de la population, de même, on ne réussira pas à sortir de l'addiction certains toxicomanes, ceux qui sont à trois grammes d'héroïne par jour depuis l'âge de quatorze ans et dont l'espérance de vie ne dépasse pas quarante ans. Tous les psychologues vous diront qu'ils ont déjà un pied dans la tombe. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est la réalité du terrain, que j'ai connue durant quinze ans, comme M. Michel Heinrich, du reste.
S'agissant de la légalisation contrôlée, je répète ce qu'a dit M. Serge Blisko la semaine dernière : la position de M. Daniel Vaillant n'a rien à voir avec ce rapport parlementaire. Je regrette toutefois, en mon nom et au nom des signataires de la contribution des députés du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche, que le débat sur cette question ne soit pas ouvert alors même que chacun d'entre nous reconnaît que si la loi était aussi efficace qu'on le prétend, le nombre de consommateurs ne serait pas aussi élevé, ce qu'ont souligné aussi bien M. Robert Henrion dans son rapport que M. William Lowenstein. Loin de préjuger de la conclusion du débat, je me contente de faire le constat suivant : quand une loi n'est pas appliquée de la même manière selon l'origine sociale ou territoriale des personnes en infraction, la justice des adultes perd toute crédibilité aux yeux des adolescents et des jeunes.
De plus, dépénalisation n'est pas légalisation - ce n'est pas M. Jean-Paul Garraud qui me contredira. Il convient de le préciser, parce que beaucoup de Français, et même des politiques, confondent les deux notions.
S'agissant du dossier pharmaceutique, le rendre obligatoire pour les toxicomanes serait instaurer une mesure d'exception contraire à l'égalité républicaine. Nous avons rendu compte ce matin de l'expérimentation faite à Toulouse sur les toxicomanes « mégaconsommateurs » : nous avons réussi à en faire baisser le taux sans rendre le dossier pharmaceutique obligatoire. Nous étions à la limite de la loi, j'en conviens : c'est pourquoi nous attendons une adaptation de la réglementation.
Je m'élève violemment, en mon nom et au nom de mon groupe, contre la volonté, manifestée pages 66 et 68 du rapport, de cibler dès leur plus jeune âge les enfants dont les comportements sont agressifs ou déviants. Attention ! Un enfant peut avoir un comportement agressif, par exemple en raison du divorce difficile de ses parents, il ne deviendra pas pour autant un consommateur de substances illicites. Je rappel que l'Unesco a demandé des comptes à la France à propos de la base de données constituée sur les élèves. Le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche sera intransigeant sur la question.
Je regrette enfin que la mission ait écarté la question de l'alcool. Il fallait certes définir un champ précis d'investigation ; toutefois, l'alcool se retrouve dans tous les cas de polyaddiction.
M. Serge Blisko, coprésident pour l'Assemblée nationale. Madame Catherine Lemorton, nous convenons tous évidemment des liens existant entre polyaddiction et alcool.
M. Jean-Paul Garraud, député. Je partage, globalement, les conclusions d'un rapport qui fait, de nouveau, la lumière sur la complexité de la polytoxicomanie. Le toxicomane est un malade qui, dans le même temps, se trouve en infraction à la loi. Ses comportements sont souvent illégaux.
S'agissant des centres d'injection supervisés, le rapport en fait une analyse détaillée et objective, que je partage. C'était une fausse bonne idée, en dépit de la vision sanitaire de certains de nos collègues : en matière de toxicomanies, on ne peut pas séparer complètement le sanitaire du policier et du judiciaire, qui sont étroitement liés. Il faut également faire attention au message que la société envoie aux citoyens. De plus, cette mesure poserait, vis-à-vis des personnels de ces centres, des questions d'ordre juridique : qui imagine que l'État puisse organiser une consommation de stupéfiants, même sous contrôle médical ? Elle est d'autant plus inopportune que ces centres ne sont pas une réussite sur le plan médical et qu'à l'étranger, les communes qui en ont ouverts n'ont obtenu aucune diminution du nombre des surdoses ni aucune réduction du trafic des stupéfiants.
Il en est de même du débat lancé par M. Daniel Vaillant, plus que par le parti socialiste, encore que certains membres du parti l'aient repris. Peut-être le programme socialiste nous permettra-t-il de connaître la position officielle du parti sur la dépénalisation de certaines drogues. Une chose est certaine : les pays qui ont eu recours à la dépénalisation en sont revenus. Du reste, si les notions sont effectivement différentes d'un point de vue juridique, pour le citoyen, dépénalisation égale légalisation, puisque la dépénalisation équivaut à une véritable autorisation. Comment tolérer qu'un État distribue un produit dont la consommation est mauvaise pour la santé ? On compare souvent la nocivité du cannabis à celle de l'alcool ou du tabac : c'est oublier que la composition du cannabis n'a cessé d'évoluer vers une plus grande dangerosité.
Comment être efficace dans la répression ? Il est vrai, comme M. le corapporteur Gilbert Barbier l'a souligné, que trop de sanction peut tuer la sanction. Du reste, à l'heure actuelle, le simple usage n'est pas traité comme un délit et il ne mobilise pas le tribunal correctionnel. Toutefois, on ne saurait se pencher sur la question uniquement sous l'angle du toxicomane. Il ne faut pas oublier l'intérêt de la société qui est de lutter contre les réseaux mafieux de trafic de stupéfiants, d'autant que 70 % à 80 % des infractions sont liées, directement ou indirectement, aux stupéfiants. Remonter les filières est donc particulièrement important, et les placements en garde à vue de simples usagers, tout comme la perquisition de leurs domiciles, peuvent aider les enquêteurs. Or, si l'usager est soumis à une simple contravention, il ne pourra plus être placé en garde à vue. La contravention à la première interpellation empêcherait donc la police de remonter les réseaux. Pour avoir été directeur d'enquête dans de nombreuses affaires de stupéfiants, je sais que l'élucidation d'une grosse affaire de stupéfiants s'appuie presque toujours sur des indices recueillis lors de l'interpellation d'un simple usager. Rendre plus efficace la sanction à l'encontre de l'usager ne doit pas nuire à l'efficacité de la lutte contre les réseaux mafieux.
Mme Samia Ghali, sénatrice. Je me demande si la mission a su toujours se concentrer sur son objet principal, mais il est vrai que la toxicomanie est une question complexe, presque inépuisable, qui met en jeu un grand nombre de problématiques.
Comme Mme Catherine Lemorton, je refuse la stigmatisation de certains enfants : ceux qui connaissent des problèmes ne deviendront pas tous des trafiquants, des drogués ou des voleurs ! Cette vision est simpliste.
Je n'appartiens ni au monde médical ni à la magistrature. Je ne suis donc pas spécialiste de la toxicomanie sous un angle professionnel. Toutefois, c'est la drogue qui a provoqué mon engagement politique car j'ai vécu cette question de près, dans les années 1980, lorsqu'elle est arrivée dans ma cité : trois quarts de mes amis ont commencé à fumer du cannabis. Alors qu'ils réussissaient assez bien à l'école, au fur et à mesure qu'ils en devenaient dépendants, ils se sont coupés des autres ; trop souvent les politiques favorables à la dépénalisation du cannabis oublient l'effet de bande. Une chose est de fumer lorsqu'on est un adulte installé dans la société, une autre quand on est un jeune appartenant à une bande dans une cité, car les petits trafiquants ne sont jamais loin : 50 % de mes amis qui ont touché à la drogue en sont morts, et seuls 30 % de ceux qui sont encore en vie ont réussi à s'en sortir complètement. Tous, sans exception, sont passés par les drogues « dures ».
Il est vrai que la dépénalisation de l'usage du cannabis n'entrait pas dans le cadre du rapport. Elle n'en est pas moins devenue le sujet d'actualité, comme le montre la une du journal La Provence aujourd'hui. La mission d'information est donc rattrapée par cette question. Or j'affirme que la dépénalisation ne mettrait pas fin au trafic de drogues dans les quartiers. À La Castellane, à Marseille, une cité de 8 000 habitants, le chiffre d'affaires de la vente de drogue est de 150 000 euros par jour, soit 4,5 millions par mois et 50 millions par an ! C'est une industrie. Les trafiquants sont devenus des chefs d'entreprise qui, pour faire face aux conséquences d'une éventuelle dépénalisation du cannabis, s'activent déjà pour organiser le trafic d'un cannabis plus nocif ou préparer leurs clients à consommer des drogues dites « dures ». Faudra-t-il alors passer à la dépénalisation de la cocaïne ou de l'héroïne ?
Bien des problèmes demeurent irrésolus. Ainsi, la question de l'éducation doit être posée : lorsque des professeurs absents ne sont pas remplacés durant plusieurs mois, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Or les trafiquants, qui sont devenus les premiers employeurs des cités depuis que la police n'y pénètre plus, connaissent parfaitement la loi : s'ils n'hésitent pas à employer des enfants de dix ans, c'est qu'ils savent que ces derniers ne seront pas inquiétés. Et pendant ce temps, les centres sociaux des cités sont laissés sans moyens.
Ce serait donc faire preuve d'angélisme que de croire que la dépénalisation suffirait à régler le problème. Il convient de lancer une mission d'information généraliste, car il faut donner des réponses globales, en termes d'éducation, de sécurité et d'accompagnement social mais aussi de rénovation urbaine - par le biais de l'Agence nationale de la rénovation urbaine - à des questions de société qui, à l'heure actuelle, nous dépassent.
Mme Virginie Klès, sénatrice. Au sein du parti socialiste, chacun peut, démocratiquement, exprimer son point de vue, qui peut ne pas être celui de tous, monsieur Jean-Paul Garraud. Je m'associe aux remerciements adressés aux coprésidents et aux corapporteurs. J'ai relevé quelques « coquilles » aux pages 29, 42 et 43 du rapport ; je les signalerai précisément aux services et j'espère qu'elles pourront être corrigées avant la publication du rapport. J'approuve le propos de Mme Catherine Lemorton : comme elle, je considère l'alcool beaucoup plus toxique que le cannabis. Enfin, les sénatrices et les sénateurs socialistes et apparentés s'associent à la contribution des députés du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche membres de la mission. Mais, parce que prévention de l'usage des drogues et consommation médicamenteuse sont liés, ils souhaitent que le chapitre consacré à la prévention des risques soit complété, in fine , par une phrase ainsi rédigée : « La prévention doit porter aussi sur la place et la perception du médicament dans notre société et lutter contre sa banalisation comme un objet de «consommation courante» ».
M. Serge Blisko, coprésident pour l'Assemblée nationale. Nous verrons si la chose est encore possible à ce stade.
Mme Isabelle Pasquet, sénatrice. Je sais que, la fin de la session approchant, il aurait été très compliqué de trouver une autre date pour cette réunion, mais je déplore de n'avoir eu le rapport en main qu'il y a relativement peu de temps. Je n'ai, de ce fait, pu le lire en détail ; mon attention aurait été appelée, comme l'a été celle de Mme Catherine Lemorton, sur la préconisation tendant au « repérage » des enfants dits « à risque » dès le plus jeune âge.
Mme Samia Ghali nous a dit ce qu'elle a connu dans la cité où elle vivait adolescente s'agissant de l'usage de drogues. Dans celle où j'habitais, la consommation d'alcool, conséquence d'un mal-être - elle était le fait de gens en grande détresse, qui se sont trouvés au chômage après la fermeture des chantiers navals de La Ciotat -, a eu des conséquences qui n'étaient pas moins dramatiques : tentatives de suicide, séjours en hôpital psychiatrique, cures de désintoxication répétées et toujours infructueuses... Et pourtant, la consommation d'alcool est licite, et on continue, le plus légalement du monde, d'en faire la publicité !
Mme Catherine Lemorton, députée. C'est qu'il y a la pression des viticulteurs...
Mme Isabelle Pasquet, sénatrice. Cela m'amène à dire qu'en France, la tolérance est à géométrie variable : on y accepte ce qui est culturellement acceptable. Sachant que dans d'autres pays, la drogue est tolérée et l'alcool interdit, on voit bien que la question de la dépénalisation de l'usage du cannabis ne peut être posée en termes binaires - « oui, il faut » ou « non, il ne faut pas » : le champ du débat est bien plus vaste. Alors que les toxicomanes sont aussi des usagers et des victimes qui ont besoin de soins et d'accompagnement, ils sont considérés uniquement comme des délinquants et des voleurs potentiels. Cette approche univoque est inadmissible. Je ne pense pas que la France soit prête à dépénaliser demain l'usage du cannabis, mais il faut à tout le moins ouvrir le débat, ce que le rapport ne fait pas, se limitant à proclamer que la dépénalisation serait une mauvaise chose.
M. Serge Blisko, coprésident pour l'Assemblée nationale. L'objet de la mission n'était pas celui-là.
Mme Isabelle Pasquet, sénatrice. Je ne le nie pas, mais je déplore que le débat n'ait pas au moins été ouvert. Sans doute une nouvelle mission d'information devrait-elle être créée à cet effet.
Je partage sans réserve l'opinion exprimée par Mme Catherine Lemorton à propos des salles d'injection. Le terme est d'ailleurs mal choisi, en ce qu'il donne une idée fausse de ce que doivent être ces lieux : des endroits où accueillir des personnes que la communauté nationale doit aider à se replacer dans un parcours de soin et à se resocialiser.
M. Serge Blisko, coprésident pour l'Assemblée nationale. Certains des membres de la mission ayant des obligations impérieuses auxquelles ils ne peuvent se soustraire, je vous invite à vous prononcer maintenant sur la publication du rapport. La discussion se poursuivra ensuite.
Mme Samia Ghali, sénatrice. N'est-il donc plus temps d'amender le texte, notamment pour ce qui concerne la préconisation relative aux enfants ?
M. Serge Blisko, coprésident pour l'Assemblée nationale. Les corrections syntaxiques seront faites. Pour les questions de fond, il vous appartient de vous prononcer sur le texte en l'état.
La mission d'information autorise le dépôt du rapport d'information en vue de sa publication.
Mme Françoise Branget, corapporteure pour l'Assemblée nationale. M. Heinrich ne pense pas que le nombre de surdoses mortelles en France soit inférieur à ce qu'il est dans les pays voisins. Nous avons cité à ce sujet, en page 167 du rapport, une étude publiée dans la revue Tendances de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies que nous n'avions aucune raison de remettre en cause.
M. Michel Heinrich, député. Je n'en ai pas davantage. Mon propos était que, à supposer même que le nombre de surdoses mortelles soit inférieur en France à ce qu'il est dans d'autres pays, ce n'est pas une raison pour ne rien faire.
Mme Françoise Branget, corapporteure pour l'Assemblée nationale. Mme Catherine Lemorton, pour sa part, s'est dite en désaccord avec notre évaluation de la toxicité de la méthadone. Pour faire état des décès attribués dus à l'absorption de cette substance, nous nous sommes référés aux données de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; mais pour tenir compte de cet avis, nous pourrions rectifier la rédaction adoptée page 116, en précisant que l'on parle de décès « dans lesquels est impliquée la méthadone ».
M. Serge Blisko, coprésident pour l'Assemblée nationale. Sans doute avons-nous été elliptiques, mais il est difficile de résumer en une phrase des thèses volumineuses. Je vous propose donc d'en rester là.
Mme Marie-Thérèse Hermange, sénatrice . Il aurait été préférable, par souci de rigueur, de citer page 116, en italiques, les termes exacts utilisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ainsi que les références précises de l'étude. De plus, en fermant la phrase par un point d'exclamation, on sort de l'énoncé de données scientifiques pour porter un jugement de valeur.
M. Gilbert Barbier, corapporteur pour le Sénat. C'est exact.
Mme Marie-Thérèse Hermange, sénatrice . D'autre part, parler du « fichier des décès » de l'agence paraît un peu abrupt.
Mme Françoise Branget, corapporteure pour l'Assemblée nationale. Il était difficile de donner un autre nom à ce qui est effectivement un fichier sur les décès en relation avec l'abus de médicaments et de substances.
Mme Marie-Thérèse Hermange, sénatrice . Par ailleurs, il aurait été judicieux de préciser, dans une note de bas de page, les conditions actuelles de prescription et de délivrance de la méthadone. Dans un autre domaine, si, suivant l'avis du directeur général de la santé, on conduit une étude épidémiologique, il faut l'assortir d'une étude clinique.
Il aurait été possible de donner suite aux remarques de Mme Virginie Klès en exposant, en page 8, que la mission d'information se concentrant sur les substances illicites, la question du médicament en tant que telle n'est pas abordée.
Enfin, au dernier paragraphe de la page 9, il aurait été bon, me semble-t-il, de compléter la phrase : « Ils ont souhaité que leur rapport soit empreint d'équilibre » par les mots : « sans stigmatisation, car nous sommes conscients, quel que soit le point de vue d'où l'on se place, qu'il en va de la vie d'hommes, de femmes, voire d'adolescents ».
Mme Françoise Branget, corapporteure pour l'Assemblée nationale. Pour répondre aux remarques de M. Michel Heinrich relatives aux centres d'injection supervisés, je rappelle que M. Cédric Grouchka, membre du collège de la Haute Autorité de santé, a appelé notre attention sur l'absence d'évaluation médico-économique de ces centres. Par ailleurs, l'expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a clairement indiqué que ces dispositifs ne sont pas « coût-efficaces » dans la lutte contre la diffusion du virus de l'hépatite C.
M. Gilbert Barbier, corapporteur pour le Sénat. S'agissant des salles d'injection supervisées, c'est la comparaison avec les pays étrangers qui pose problème. Sans rouvrir le débat de fond, je rappelle qu'un dispositif existe en France, fondé sur les maraudes ; il répond partiellement aux besoins et doit être amélioré.
Je pense, comme Mme Catherine Lemorton, que mieux vaudrait parler d'« opioïdes », page 109.
Je souhaite revenir sur l'hypothèse de la dépénalisation de l'usage du cannabis. J'ai entendu M. Julien Dray dire, il y a quelques jours, qu'il était contre la dépénalisation mais favorable à la légalisation. On sait ce que signifie « dépénaliser » : c'est supprimer les sanctions pénales, à laquelle peuvent être substituées des sanctions administratives. Mais que faut-il entendre par « légaliser » ? Si j'ai bien compris M. Julien Dray, cela voudrait dire que l'État entrerait sur le marché du cannabis. Mais qui le produirait ? Qui le commercialiserait, sous quelle forme et dans quel dosage ? Serait-il vendu dans les bureaux de tabac ? Serait-il interdit aux mineurs de dix-huit ans ? De quoi parle-t-on exactement en préconisant la « légalisation » de l'usage du cannabis ? Je suis d'accord avec l'idée que l'on puisse ouvrir le débat, mais la création d'une nouvelle mission d'information parlementaire ne peut se concevoir avant l'automne. Dans l'intervalle, il aurait été intéressant d'entendre aujourd'hui M. Daniel Vaillant défendre sa position devant nous ; je regrette qu'il ne soit pas là pour le faire.
Si la drogue est illicite, madame Isabelle Pasquet, c'est qu'elle est nocive pour la santé des individus. Il s'agit d'un problème de santé publique, notamment pour les plus jeunes. Il faut bien sûr soigner les toxicomanes cinquantenaires qui sont de grands malades, mais ce sont les jeunes gens qui me préoccupent d'abord, ceux qui ne sont pas encore des toxicomanes mais des consommateurs. Pour moi, la priorité doit aller à la lutte contre cette consommation d'une substance qui, depuis une dizaine d'années, est devenue nocive dès les premiers grammes.
M. Jean-Paul Garraud a dit son ambivalence à l'idée de la création d'une incrimination d'usage simple sanctionnée par une contravention de troisième classe, expliquant que la suppression des gardes à vue nuirait à l'efficacité des enquêtes visant à remonter les filières. Nous avons entendu cette objection dans la bouche de magistrats et de policiers. Cependant, M. Jean-Paul Garraud reconnaît lui-même qu'actuellement la moitié au moins des premières interpellations de consommateurs de cannabis ne donne pas lieu à poursuite. Ces affaires sont classées sans suite ; il n'y a donc déjà, pour celles-là, ni gardes à vue ni possibilité de remonter une filière.
M. Serge Blisko, coprésident pour l'Assemblée nationale. Chères collègues, chers collègues, je vous remercie.
* (1) Voir tome 2.
* (2) Rapport de la commission d'enquête sur la politique nationale de lutte contre les drogues illicites, n° 321 (2002-2003).
* (3) Audition du 23 mars 2011.
* (4) Audition du 26 janvier 2011.
* (5) Audition du 30 mars 2011.
* (6) Audition du 13 avril 2011.
* (7) Audition du 11 mai 2011.
* (8) Audition du 2 février 2011.
* (9) Audition du 2 février 2011.
* (10) Audition du 30 mars 2011.
* (11) Audition du 6 avril 2011.
* (12) Audition du 13 avril 2011.
* (13) Audition du 19 janvier 2011.
* (14) Le premier producteur mondial en demeure l'Amérique du Nord, mais l'essentiel de cette production est réservé au marché local.
* (15) Audition du 11 mai 2011.
* (16) Voir infra .
* (17) Audition du 30 mars 2011.
* (18) Audition du 26 janvier 2011.
* (19) Audition du 11 mai 2011.
* (20) Audition du 4 mai 2011.
* (21) Audition du 26 janvier 2011.
* (22) Audition du 13 avril 2011.
* (23) Audition du 19 janvier 2011.
* (24) Audition du 12 janvier 2011.
* (25) Audition du 6 avril 2011.
* (26) Audition du 19 janvier 2011.
* (27) Audition du 12 janvier 2011.
* (28) Audition du 26 janvier 2011.
* (29) Audition du 26 janvier 2011.
* (30) Audition du 23 mars 2011.
* (31) Audition du 25 mai 2011.
* (32) Audition du 12 janvier 2011.
* (33) Audition du 12 janvier 2011.
* (34) Audition du 2 mars 2011.
* (35) Phase d'épuisement et de dépression suivant celle - « montée » - durant laquelle les effets psychotropes sont pleinement ressentis.
* (36) Notons en ce qui concerne le domaine connexe de l'abus d'alcool chez les jeunes le plan mis en place en juillet 2008 par la ministre en charge de la santé, Mme Roselyne Bachelot, constitué de trois mesures principales : l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs, l'interdiction de la vente au forfait et de l'offre à volonté de boissons alcooliques, et l'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique à proximité des établissements scolaires.
* (37) Audition du 26 janvier 2011.
* (38) Audition du 16 février 2011.
* (39) Audition du 2 mars 2011.
* (40) Voir Le Figaro du 15 octobre 2007.
* (41) Audition du 4 mai 2011.
* (42) Audition du 26 janvier 2011.
* (43) Audition du 30 mars 2011.
* (44) Audition du 19 janvier 2011.
* (45) Audition du 25 mai 2011.
* (46) Audition du 11 mai 2011.
* (47) Audition du 26 janvier 2011.
* (48) Audition du 30 mars 2011.
* (49) Audition du 13 avril 2011.
* (50) Audition du 25 mai 2011.
* (51) Audition du 30 mars 2011.
* (52) Audition du 26 janvier 2011.
* (53) Audition du 30 mars 2011.
* (54) Audition du 26 janvier 2011.
* (55) Audition du 19 janvier 2011.
* (56) Audition du 25 mai 2011.
* (57) Audition du 11 mai 2011.
* (58) Audition du 26 janvier 2011.
* (59) Audition du 30 mars 2011.
* (60) Audition du 12 janvier 2011.
* (61) Audition du 26 janvier 2011.
* (62) Voir supra .
* (63) Audition du 11 mai 2011.
* (64) Audition du 2 février 2011.
* (65) Audition du 9 février 2011.
* (66) Forman, Susan G. et Kalafat, John, Substance abuse and suicide: promoting resilience against self-destructive behavior in youth , School psychology review, vol. 27, n°.3, pp. 398-406, 1998.
* (67) Audition du 11 mai 2011.
* (68) Audition du 6 avril 2011.
* (69) Audition du 16 février 2011.
* (70) Audition du 12 janvier 2011.
* (71) Audition du 12 janvier 2011.
* (72) Enquête Coquelicot 2004-2007, Résultats d'une enquête sur l'hépatite C, le VIH et les pratiques à risques chez les consommateurs de drogues , Institut de veille sanitaire.
* (73) Audition du 9 février 2011.
* (74) Audition du 2 février 2011.
* (75) Audition du 2 mars 2011.
* (76) Audition du 11 mai 2011.
* (77) Audition du 2 février 2011.
* (78) Audition du 11 mai 2011.
* (79) Audition du 25 mai 2011.
* (80) Audition du 2 mars 2011.
* (81) Audition du 11 mai 2011.
* (82) Audition du 2 février 2011.
* (83) Audition du 2 février 2011.
* (84) Audition du 16 février 2011.
* (85) Audition du 6 avril 2011.
* (86) Audition du 11 mai 2011.
* (87) Audition du 2 mars 2011.
* (88) Audition du 2 mars 2011.
* (89) Audition du 6 avril 2011.
* (90) Audition du 11 mai 2011.
* (91) Audition du 12 janvier 2011.
* (92) Audition du 16 février 2011.
* (93) Audition du 23 mars 2011.
* (94) Audition du 23 mars 2011.
* (95) Audition du 2 février 2011.
* (96) Audition du 2 février 2011.
* (97) Audition du 9 février 2011.
* (98) Audition du 4 mai 2011.
* (99) Audition du 2 mars 2011.
* (100) Audition du 23 mars 2011.
* (101) Audition du 11 mai 2011.
* (102) Audition du 2 mars 2011.
* (103) Audition du 11 mai 2011.
* (104) Audition du 9 février 2011.
* (105) Audition du 2 février 2011.
* (106) Audition du 30 mars 2011.
* (107) Audition du 4 mai 2011.
* (108) Audition du 25 mai 2011.
* (109) Audition du 9 février 2011.
* (110) Audition du 23 mars 2011.
* (111) Audition du 2 février 2011.
* (112) Audition du 9 février 2011.
* (113) Audition du 16 février 2011.
* (114) Audition du 2 février 2011.
* (115) Audition du 16 février 2011.
* (116) Audition du 23 mars 2011.
* (117) Audition du 16 février 2011.
* (118) Audition du 9 mars 2011.
* (119) Audition du 6 avril 2011.
* (120) Audition du 23 mars 2011.
* (121) Audition du 2 février 2011.
* (122) Audition du 15 juin 2011.
* (123) Audition du 23 mars 2011.
* (124) Audition du 9 février 2011.
* (125) Audition du 25 mai 2011.
* (126) Audition du 1 er juin 2011.
* (127) Audition du 16 février 2011.
* (128) Audition du 9 février 2011.
* (129) Audition du 30 mars 2011.
* (130) Audition du 25 mai 2011.
* (131) Audition du 13 avril 2011.
* (132) Audition du 9 mars 2011.
* (133) Audition du 13 avril 2011.
* (134) Audition du 9 avril 2011.
* (135) Audition du 9 mars 2011.
* (136) Audition du 25 mai 2011.
* (137) Audition du 11 mai 2011.
* (138) Fédération française d'addictologie, Livre blanc de l'addictologie française - 100 propositions pour réduire les dommages des addictions en France, juin 2011.
* (139) Rapport n° 2468 de M. Jacques Guyard au nom de la commission d'enquête sur les sectes, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 décembre 1995.
* (140) Audition du 9 février 2011.
* (141) Giorgio Manfré, Giuliano Piazzi et Aldo Polettini, Multidisciplinary study of retention in treatment and follow-up on former residents of San Patrignano, FrancoAngeli, 2005 .
* (142) Dr Jean-Michel Delile, M. Jean-Pierre Couteron, « Réflexions sur le traitement résidentiel des addictions », Alcoologie et addictologie, 2009, tome 31 (1), pp. 27-35.
* (143) Circulaire DGS/MILDT/SD6B n ° 2006/462 du 24 octobre 2006 relative à la mise en place des communautés thérapeutiques.
* (144) Circulaire n° DGS/MC2/2008/79 du 28 février 2008 relative à la mise en place des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et à la mise en place des schémas régionaux médico-sociaux d'addictologie.
* (145) Audition du 23 mars 2011.
* (146) Fédération française d'addictologie, Livre blanc de l'addictologie française - 100 propositions pour réduire les dommages des addictions en France, juin 2011.
* (147) Audition du 16 février 2011.
* (148) Audition du 11 mai 2011.
* (149) Audition du 8 juin 2011.
* (150) Décret n° 2008-87 du 24 janvier 2008 relatif au fonctionnement et au financement des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie.
* (151) Audition du 9 février 2011.
* (152) Audition du 4 mai 2011.
* (153) Fédération française d'addictologie, Livre blanc de l'addictologie française - 100 propositions pour réduire les dommages des addictions en France, juin 2011.
* (154) Circulaire DGS/DHOS/DGAS n° 2004-464 du 23 septembre 2004 relative à la mise en place de consultations destinées aux jeunes consommateurs de cannabis et autres substances psychoactives et leur famille.
* (155) Audition du 19 janvier 2011.
* (156) Ivana Obradovic, Évaluation du dispositif des « consultations jeunes consommateurs » (2004-2007) - Publics, filières de recrutement, modalités de prise en charge, Observatoire français des drogues et des toxicomanies, janvier 2009.
* (157) Audition du 9 mars 2011.
* (158) Audition du 9 mars 2011.
* (159) Audition du 8 juin 2011.
* (160) Audition du 16 février 2011.
* (161) Audition du 2 mars 2011.
* (162) Fédération française d'addictologie, Livre blanc de l'addictologie française - 100 propositions pour réduire les dommages des addictions en France, juin 2011.
* (163) Audition du 8 juin 2011.
* (164) Audition du 23 mars 2011.
* (165) Audition du 16 février 2011.
* (166) Audition du 9 février 2011.
* (167) Audition du 16 février 2011.
* (168) Audition du 23 mars 2011.
* (169) Observatoire français des drogues et des toxicomanies, Les usagers de drogues âgés de 40 ans et plus pris en charge dans les structures de soins pour leurs problèmes d'addiction, note n° 2010-12, 9 août 2010.
* (170) Audition du 9 février 2011.
* (171) Audition du 2 mars 2011.
* (172) Audition du 9 mars 2011.
* (173) Audition du 8 juin 2011.
* (174) Arrêté du 25 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 29 juin 1992 fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques.
* (175) Audition du 11 mai 2011.
* (176) Audition du 2 mars 2011.
* (177) Institut national de la santé et de la recherche médicale, expertise collective, Réduction des risques infectieux chez les usagers de drogues, Les éditions INSERM, juillet 2010.
* (178) Décret n° 87-328 du 13 mai 1987 portant suspension des dispositions du décret n° 72-200 du 13 mars 1972 réglementant le commerce et l'importation des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales en vue de lutter contre l'extension de la toxicomanie.
* (179) Circulaire n° DGS/S6B/DSS/1A/DGAS/5C/2006/01 du 2 janvier 2006 relative à la structuration du dispositif de réduction des risques, à la mise en place des centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) et à leur financement par l'assurance maladie.
* (180) Décret n° 2005-347 du 14 avril 2005 approuvant le référentiel national des actions de réduction des risques en direction des usagers de drogue et complétant le code de la santé publique.
* (181) Matthieu Chalumeau, Les CAARUD en 2008, analyse nationale des rapports d'activité ASA-CAARUD, Observatoire français des drogues et des toxicomanies, Focus juillet 2010.
* (182) Audition du 23 mars 2011.
* (183) Institut national de la santé et de la recherche médicale, expertise collective, Réduction des risques infectieux chez les usagers de drogues, Les éditions INSERM, juillet 2010, p. 69.
* (184) Éric Janssen, Christophe Palle, « Les surdoses mortelles par usage de substances psychoactives en France » , Tendances n° 70, mai 2010.
* (185) Voir la sous-partie b de la partie 2 du présent C.
* (186) Matthieu Chalumeau, Les CAARUD en 2008, analyse nationale des rapports d'activité ASA-CAARUD, Observatoire français des drogues et des toxicomanies, Focus, juillet 2010.
* (187) Audition du 12 janvier 2011.
* (188) Audition du 1 er juin 2011.
* (189) Conseil national du SIDA, Note valant avis sur l'expérimentation des programmes d'échange de seringues dans les établissements pénitentiaires, 10 septembre 2009.
* (190) Audition du 2 février 2011.
* (191) Audition du 9 mars 2011.
* (192) Audition du 6 avril 2011.
* (193) Audition du 18 mai 2011.
* (194) Arrêté du 1 er avril 2008 relatif à la liste de soins ou traitements susceptibles de faire l'objet de mésusage, d'un usage détourné ou abusif, pris en application de l'article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale.
* (195) Arrêté du 5 février 2008 pris pour l'application de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique.
* (196) Audition du 8 juin 2011.
* (197) Organe international de contrôle des stupéfiants, Rapport 2009, p. 39.
* (198) Ibid., p. 47.
* (199) Audition du 9 mars 2011.
* (200) Arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants.
* (201) Arrêté du 8 février 2000 relatif au fractionnement de la délivrance des médicaments à base de méthadone.
* (202) Circulaire DGS/DHOS n° 2002/57 du 30 janvier 2002 relative à la prescription de la méthadone par les médecins exerçant en établissement de santé, dans le cadre de l'initialisation d'un traitement de substitution pour les toxicomanes dépendants majeurs aux opiacés.
* (203) Document distribué aux membres de la mission d'information par le professeur Dominique Maraninchi, directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, lors de son audition du 18 mai 2011 au Sénat.
* (204) Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé - Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance, DRAMES - Décès en relation avec l'abuse de médicaments et de substances - Résultats de l'enquête 2009, avril 2011.
* (205) Audition du 15 juin 2011.
* (206) Audition du 16 février 2010.
* (207) Matthieu Chalumeau, Les CAARUD en 2008, analyse nationale des rapports d'activité ASA-CAARUD, Observatoire français des drogues et des toxicomanies, Focus, juillet 2010.
* (208) Audition du 25 mai 2011.
* (209) Audition du 25 mai 2011.
* (210) Audition du 16 février 2011.
* (211) Affaire C-137/09, 16 décembre 2010, point 67.
* (212) Audition du 2 mars 2011.
* (213) Audition du 2 mars 2011.
* (214) Audition du 19 janvier 2011.
* (215) Audition du 6 avril 2011.
* (216) Audition du 26 janvier 2011.
* (217) Audition du 25 mai 2011.
* (218) Cf. conclusions de l'avocat général Yves Bot devant la Cour de justice de l'Union européenne sur l'affaire C-137/09, point 48.
* (219) Rapport n° 43, du 23 novembre 1994 sur les toxicomanies.
* (220) Audition du 9 février 2011.
* (221) Audition du 23 mars 2011.
* (222) Audition du 4 mai 2011.
* (223) Audition du 11 mai 2011.
* (224) Audition du 19 janvier 2011.
* (225) Audition du 26 janvier 2011.
* (226) Audition du 30 mars 2011.
* (227) Audition du 18 mai 2011.
* (228) Audition du 23 mars 2011.
* (229) Audition du 16 février 2011.
* (230) Audition du 26 janvier 2011.
* (231) Audition du 26 janvier 2011.
* (232) Cf. Danièle Barré, La répression de l'usage des produits illicites : état des lieux , CESDIP, 2008.
* (233) Audition du 9 février 2011.
* (234) Audition du 26 janvier 2011.
* (235) Audition du 25 mai 2011.
* (236) Audition du 26 janvier 2011.
* (237) Audition du 26 janvier 2011.
* (238) Audition du 30 mars 2011.
* (239) Courrier de M. Michel Mercier, Garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés, du 22 juin 2011.
* (240) Institut national de la santé et de la recherche médicale, expertise collective, Réduction des risques infectieux chez les usagers de drogues, Les éditions INSERM, juillet 2010, p. 209.
* (241) Audition du 12 janvier 2011.
* (242) Audition du 12 janvier 2011.
* (243) Institut national de la santé et de la recherche médicale, expertise collective, Réduction des risques infectieux chez les usagers de drogues, Les éditions INSERM, juillet 2010, p. 388.
* (244) Institut national de la santé et de la recherche médicale, expertise collective, Réduction des risques infectieux chez les usagers de drogues, Les éditions INSERM, juillet 2010, p. 217.
* (245) Ibid., p. 218.
* (246) Ibid., p. 219.
* (247) Ces données diffèrent légèrement de celles communiquées à la mission d'information par le personnel de Quai 9 qui a indiqué que 30 % des consultations de premier recours dans le centre, au nombre de 1 100 par an, donnaient lieu à des relais médicaux (hospitalisations ou centres de soins spécialisés).
* (248) Institut national de la santé et de la recherche médicale, expertise collective, Réduction des risques infectieux chez les usagers de drogues, Les éditions INSERM, juillet 2010, p. 220.
* (249) Audition du 16 février 2011.
* (250) Audition du 23 mars 2011.
* (251) Audition du 2 février 2011.
* (252) Audition du 6 avril 2011.
* (253) Audition du 2 mars 2011.
* (254) Audition du 9 mars 2011.
* (255) Audition du 9 février 2011.
* (256) Audition du 18 mai 2011.
* (257) Institut national de la santé et de la recherche médicale, expertise collective, Réduction des risques chez les usagers de drogues - Synthèse et recommandations, p. 34, Les éditions INSERM, 2010.
* (258) Christina Diaz Gomez, Les salles de consommation en Europe - Synthèse de la revue de littérature internationale, Note n° 09-4, Observatoire français des drogues et des toxicomanies, 20 mai 2009.
* (259) Institut national de la santé et de la recherche médicale, expertise collective, Réduction des risques infectieux chez les usagers de drogues, Les éditions INSERM, juillet 2010, p. 218.
* (260) Franck Zobel, Françoise Dubois-Arber, Brève expertise sur le rôle et l'utilité des structures avec local de consommation (SLC) dans la réduction des problèmes liés à la drogue en Suisse, Expertise réalisée à la demande de l'Office fédéral de la santé publique, p. 16, Lausanne, 2004.
* (261) Communiqué du 11 janvier 2011 de l'Académie nationale de médecine à propos d'un projet de création en France de « salles d'injection pour toxicomanes ».
* (262) Audition du 2 février 2011.
* (263) Audition du 19 janvier 2011.
* (264) Organe international de contrôle des stupéfiants, Rapport 2009, p. 39.
* (265) Ibid. , p. 140.
* (266) Institut national de la santé et de la recherche médicale, expertise collective, Réduction des risques chez les usagers de drogues - Synthèse et recommandations, p. 35, Les éditions INSERM, 2010.
* (267) Éric Janssen, Christophe Palle, « Les surdoses mortelles par usage de substances psychoactives en France » , Tendances n° 70, mai 2010.
* (268) Audition du 11 mai 2011.
* (269) Audition du 25 mai 2011.
* (270) Jean-Michel Costes, Cécile Laffiteau, Olivier Le Nézet, Stanislas Spilka, « Premiers résultats concernant l'évolution de l'opinion et la perception des Français sur les drogues 1999-2008 » , Observatoire français des drogues et des toxicomanies, 21 juin 2010.
* (271) Institut national de la santé et de la recherche médicale, expertise collective, Réduction des risques infectieux chez les usagers de drogues, Les éditions INSERM, juillet 2010, p. 388.
* (272) Audition du 9 mars 2011.
* (273) Audition du 23 mars 2011.
* (274) Sandra Solai, Fabienne Benninghoff, Giovanna Meystre-Agustoni, André Jeannin, Françoise Dubois-Arber, Évaluation de l'espace d'accueil et d'injection « Quai 9 » à Genève - Deuxième phase 2003, Hospices / CHUV Département universitaire de médecine et de santé communautaires, Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne, 2004.
* (275) Décret n° 2005-347 du 14 avril 2005 approuvant le référentiel national des actions de réduction des risques en direction des usagers de drogue et complétant le code de la santé publique.
* (276) Audition du 26 janvier 2011.
* (277) Audition du 25 mai 2011.
* (278) Voir le A de la partie III du présent rapport.
* (279) Audition du 2 février 2011.







