B. DE NOMBREUX ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX DIFFICILES À TENIR DANS UN CONTEXTE BUDGÉTAIRE TENDU
Cette volonté se traduit également par de nombreux engagements et promesses financières. En droite ligne avec les valeurs issues de son histoire et l'idée qu'elle se fait de son rôle dans le monde, la France se veut une nation généreuse.
Le bilan de ces engagements a parfois suscité des critiques. On a dit que les gouvernements successifs avaient privilégié, en matière de coopération, les effets d'annonce, sans se soucier ni de leur cohérence, ni de leur suivi. Et il est vrai que, parfois, on peinerait à mesurer, après quelques mois, la traduction concrète de ces engagements qui ne font pas toujours l'objet d'une affectation financière véritablement nouvelle et clairement identifiée, comme c'est désormais recommandé par l'OCDE. Certaines nouvelles « annonces » internationales s'appuient sur le recyclage d'une aide limitée ou une simple réallocation des subventions, non extensible, et déjà promise plusieurs fois.
Sur ce point, votre commission relève que le G8 a engagé un travail inédit de suivi de ses engagements en faveur du développement lors du sommet de l'Aquila en 2009, qui s'est concrétisé par un premier rapport lors du sommet de Muskoka en 2010. Cette nouvelle dynamique, qui implique la France, se caractérise par une transparence rigoureuse et un suivi méthodique des engagements, notamment en direction des pays en développement partenaires et de leurs populations. En 2011, les travaux porteront sur le suivi des engagements en matière de santé et de sécurité alimentaire, ce qui peut expliquer l'attention portée, dans le nouveau contrat d'objectifs et de moyens de l'AFD, à ces deux secteurs.
Plus largement, ces engagements internationaux ont un impact considérable sur la politique de coopération française et sur la conduite de l'Agence Française de Développement qui se trouve souvent en première ligne pour appliquer des promesses à la décision desquelles elle n'a pas toujours été associée, qui viennent parfois contredire sa programmation et pour lesquelles elle ne reçoit pas toujours de moyens supplémentaires.
Ces nombreux engagements financiers sont et seront, dans le contexte actuel de nos finances publiques, de plus en plus difficiles à tenir.
La France s'est, notamment, engagée de manière répétée et solennelle à porter son APD à 0,7 % du revenu national brut en 2015.
La France a également pris de nombreux autres engagements en faveur des pays les moins avancés, en faveur de l'Afrique subsaharienne, en matière de santé en général, -et de santé maternelle et infantile, en particulier-, et dans le domaine de l'agriculture ou de l'environnement.
S'agissant de l'engagement de consacrer, d'ici 2015, 0,7 % de son revenu national brut à l'aide publique au développement, la France devrait se situer à 0,50 % du RNB en 2010, puis à 0,47 % du RNB en 2011. Elle devrait, d'après les estimations en cours, rester stable en 2012 et se situerait en 2013 entre 0,41 % et 0,49 % selon les hypothèses retenues pour les annulations de dettes.
L'engagement français de tenir le 0,7% pour 2015 correspondrait à une projection de l'APD atteignant plus de 17 milliards d'euros. L'APD déclarée en 2011 étant estimée, dans le cadre de la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques, à 9,2 milliards d'euros, l'atteinte de cet objectif suppose une croissance annuelle de l'APD de 17 % sur la période 2012-2015, ce qui paraît peu vraisemblable au regard de la situation des finances publiques .
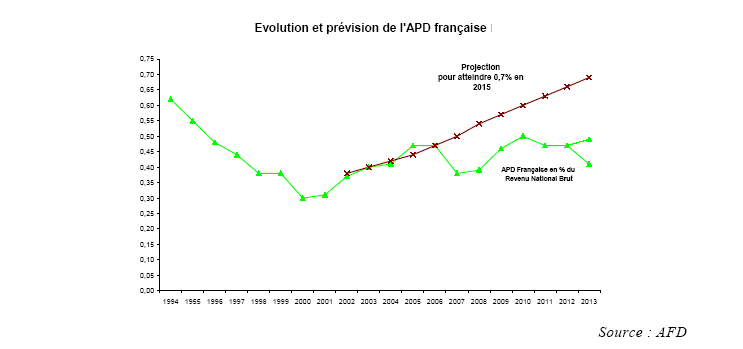
La France s'est également engagée en faveur des pays les moins avancés (PMA) à leur consacrer 0,15 % du RNB lors de l'adoption du Programme d'action 2001-2010 des Nations unies sur les PMA en 2001. Le CICID du 18 mai 2005 avait acté l'atteinte de cet objectif d'ici 2012. L'aide publique en direction des PMA s'élèverait à 0,11 % du RNB. Un bilan de cet engagement sera établi lors de la quatrième conférence sur les PMA, événement décennal, qui s'est tenu à Istanbul en mai 2011.
La France a pris également de nombreux autres engagements vis-à-vis de l'Afrique.
Lors de l'adoption du Consensus européen sur le développement, en 2005, la France a promis qu'un accroissement de 50 % de l'aide de l'Union européenne d'ici 2010 devrait aller à l'Afrique.
Lors du discours du Cap, en février 2008 , le Chef de l'Etat a également indiqué que le total des engagements financiers français bilatéraux pour l'Afrique subsaharienne s'élèvera à 10 milliards d'euros sur les cinq prochaines années. Cet engagement dépasse le seul cadre de l'APD, pour inclure les 2,5 milliards d'euros annoncés dans le cadre du soutien à l'initiative privée, dont des garanties et participations. Le montant moyen de 2 milliards d'euros par an est à comparer avec la totalité de notre aide bilatérale programmable pour le monde, qui s'élevait, en 2008, à 2,2 milliards d'euros.
L'AFD est concernée au premier chef par cet engagement. Elle dispose d'une large expertise dans le domaine du soutien à l'initiative privée, notamment avec sa filiale PROPARCO, et d'une large palette d'instruments d'intervention intégrant différentes modalités de prêts, garanties et subventions. C'est pourquoi le nouveau contrat d'objectifs et de moyens de l'AFD fait explicitement mention de l'engagement du Cap dans ses objectifs.
D'autres engagements concernent des secteurs particuliers.
Ainsi, à l'occasion du sommet d'Heiligendamm (2007), puis du sommet de Tokyo (2008), les pays du G8 se sont engagés à consacrer 60 milliards de dollars, au cours des 5 prochaines années, à la santé en Afrique. La France s'est engagée à hauteur d'un milliard de dollars par an. En 2009, la France a consacré plus de 12 % de son aide publique au développement à la santé dans les pays en développement, ce qui représente 973 millions d'euros, donc un peu plus d'un milliard de dollars dont 72 % sont affectés à un canal multilatéral.
Dans le domaine de l'éducation , à l'occasion du sommet France-Royaume-Uni, en mars 2008, ces deux pays ont annoncé le lancement d'un partenariat en faveur de l'éducation en Afrique. Chacun de ces deux pays s'est engagé à scolariser 8 millions d'enfants en Afrique subsaharienne d'ici 2010.
Dans le secteur de l'agriculture , la France s'est engagée en 2008 à investir 1 milliard d'euros dans l'agriculture africaine dans les cinq prochaines années.
Lors du G8 de l'Aquila, les Etats se sont engagés à hauteur de 20 milliards de dollars sur 3 ans en faveur de la sécurité alimentaire , toutes géographies confondues. Les engagements français à Aquila portent sur 1,5 milliard d'euros sur 2009-2011.
Récemment, la politique française de coopération s'est illustrée par trois nouveaux engagements :
- en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique dans le cadre des accords de Copenhague ( 420 millions d'euros par an sur la période 2010-2012) ;
- en faveur de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile dans le cadre du G8 de Muskoka (500 millions d'euros sur la période 2011-2015 soit 100 millions d'euros supplémentaires par an ) ;
- en faveur de la lutte contre le sida dans le cadre du Sommet des Nations unies en septembre dernier (60 millions d'euros par an).
Ces promesses engagent la France et par conséquent l'AFD.
Ainsi le contrat d'objectifs et de moyens fait explicitement référence aux engagements de Muskoka en faveur de la santé. Sur ces 100 millions d'engagement, l'AFD devrait couvrir 48 millions d'euros, le restant relevant du FSP (25 millions d'euros) et d'une quote-part de la contribution au fonds mondial sur le Sida (25 millions d'euros).







