II. UN FOSSÉ CROISSANT ENTRE LES AMBITIONS ET LES MOYENS
L'élaboration de ce nouveau contrat d'objectifs et de moyens de l'AFD intervient dans un contexte où les attentes à l'égard de la politique de coopération sont croissantes alors même que les moyens budgétaires sont de plus en plus modestes.
Aussi bien au niveau multilatéral, comme en témoigne l'introduction des problématiques du développement dans l'agenda du G20, qu'au niveau bilatéral, où chaque crise dans des pays traditionnellement partenaires de la France, comme la Côte d'Ivoire ou la Tunisie se traduit par un renforcement des projets de coopération, la France souhaite, à travers sa politique de coopération maintenir, voire accroître son influence et contribuer à un environnement international plus sûr pour ses concitoyens comme pour ceux des pays du Sud.
Les attentes des pouvoirs publics, du Gouvernement comme du Parlement, à l'égard de l'opérateur pivot de la coopération française qu'est devenue l'AFD doivent être interprétées au regard de ce contexte.
A. UNE AIDE PUBLIQUE FRANÇAISE QUI DEMEURE OFFICIELLEMENT UNE DES COOPÉRATIONS LES PLUS IMPORTANTES AU MONDE GRÂCE À UN THERMOMÈTRE LARGEMENT FAUSSÉ
Les rapporteurs de la commission des affaires étrangères, à l'occasion des missions sur le terrain, notamment au Mali et lors de leurs auditions, ont été frappés par le contraste entre la place de la France dans les statistiques officielles de l'OCDE en matière d'aide au développement et la réalité des moyens sur le terrain. Ils ont pris conscience au fur et à mesure de leurs travaux que ce contraste n'était pas tant lié à la façon dont l'Etat français déclare son aide au Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'OCDE qu'à la façon dont le CAD définit cette aide qui apparaît de plus en plus déconnectée de la réalité des crédits effectivement disponibles sur le terrain pour financer des projets de coopération.
La France déclare un volume d'APD supérieur à la moyenne des pays donateurs. L'APD totale nette française n'a cessé de croître en valeur entre 2007 et 2009, passant de 7,2 milliards d'euros à 9 milliards d'euros, soit une progression de 25 %.
Cette augmentation est due, par ordre d'importance, à l'augmentation des concours multilatéraux, à l'effet net des prêts consentis par l'AFD et des concours communautaires.
Le ratio APD/RNB qui mesure l'effort relatif de chaque pays en matière d'APD s'élève, en 2009, à 0,46 % du RNB et devrait s'établir à 0,50 % en 2010.
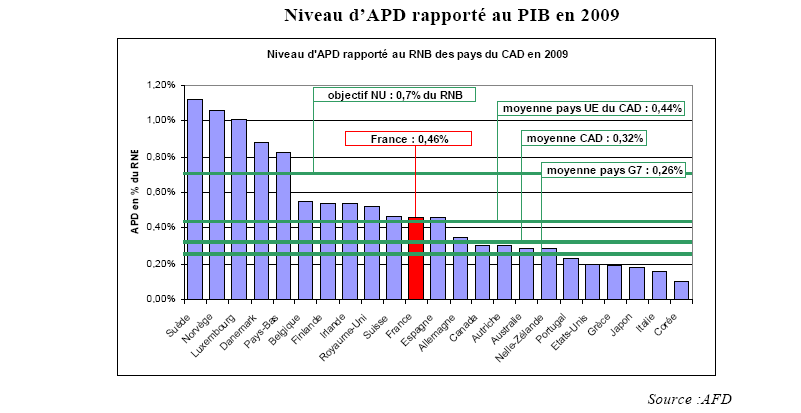
Figurent cependant au sein des dépenses déclarées au titre de l'APD française, en vertu d'une interprétation autorisée mais large des critères de l'OCDE, des crédits qui ont un rapport lointain avec une aide de terrain effective, telle que, par exemple, la prise en charge du coût des étudiants et des réfugiés étrangers en France ou des dépenses pour Mayotte.
D'après les travaux effectués par vos rapporteurs lors de l'examen de la loi de finances, on peut estimer ces dépenses à environ 18 % de l'APD déclarée par la France.
Dans le même temps, l'APD au sens de l'OCDE ne prend pas en compte nombre d'efforts qui contribuent clairement au développement des pays partenaires, comme les garanties apportées par l'Agence française de développement, les prises de participation de Proparco, le montant des déductions fiscales bénéficiant aux dotations privées des organisations non gouvernementales (ONG).
Les variations du volume total de l'APD française depuis 2002 sont également marquées par le rôle essentiel de la comptabilisation des annulations de dettes qui représentent entre 10 et 30 % de l'APD française selon les années. Ce rôle devrait cependant diminuer dans les prochaines années avec la fin annoncée d'un cycle d'annulation de dettes.
En outre, une partie croissante de l'aide au développement française s'effectue aujourd'hui sous forme de prêts, qui représentent ainsi 87 % des engagements de l'AFD.
En 2009, l'APD hors écolage, TOM, dépenses liées aux réfugiés, prêts et annulations de dette, ne représentait plus qu'environ 57 % de l'APD déclarée.
Le développement des prêts de l'AFD a permis d'accroître le montant déclaré de notre aide à effort budgétaire constant (grâce au fameux « effet de levier ») et de financer un nombre croissant de projets. .Les prêts en direction des pays en développement sont déclarés en APD au moment de leur décaissement mais viendront en déduction au moment des remboursements. Le développement des prêts dans la période récente a permis, à un coût limité et différé pour le contribuable, d'assurer la présence de la France au-delà des zones traditionnelles de notre coopération et d'accroître le montant de l'APD déclarée.
Ayant pour objectif de minimiser le coût Etat par projet, les prêts consentis conduisent cependant à rechercher des emprunteurs solvables, que l'AFD -en tant que banque- trouve naturellement plutôt parmi les moins pauvres des pays en développement. En revanche, ces prêts permettent moins aisément d'intervenir dans les pays les plus pauvres qui sortent pour certains à peine d'un processus de désendettement, dans les situations de crises ou dans les secteurs sociaux.
Comme le souligne la revue à mi-parcours de l'aide au développement française par le Comité d'Aide au Développement de l'OCDE, on observe une contradiction entre les objectifs de la coopération française et l'évolution des moyens budgétaires destinés à l'action bilatérale, tout particulièrement des dons.
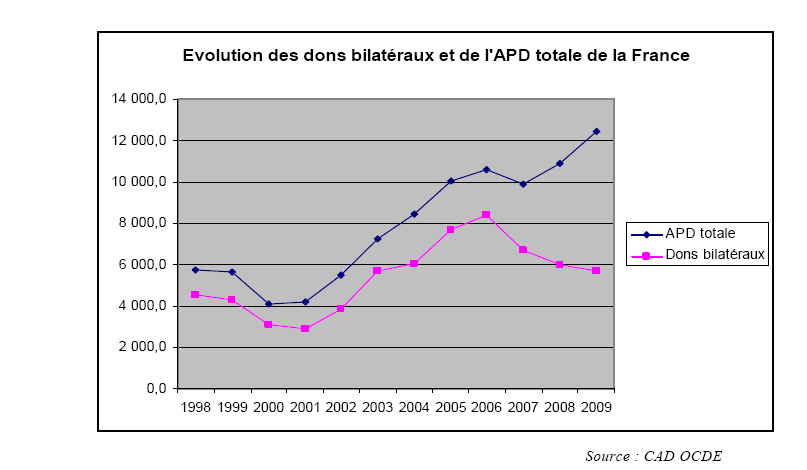
Au-delà des aspects quantitatifs, la politique de coopération française est aujourd'hui un élément important de la politique étrangère de la France et en particulier de sa diplomatie multilatérale. La France cherche dans le nouvel agenda international, marqué par les défis globaux, à maximiser son influence à travers une forte présence sur les thèmes liés à l'aide au développement.
Cette volonté se traduit, dans les enceintes internationales, par une forte capacité de proposition et d'innovation, comme en témoigne la contribution de la France à la création du Fonds Sida ou son leadership sur les questions de financements innovants.







