Rapport d'information n° 189 (2006-2007) de M. Joël BOURDIN , fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification, déposé le 30 janvier 2007
Synthèse du rapport (258 Koctets)
Disponible au format Acrobat (754 Koctets)
-
INTRODUCTION
-
CHAPITRE I : LA PRODUCTIVITÉ AU CoeUR
DE LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
-
I. QU'EST-CE QUE LA
PRODUCTIVITÉ ?
-
II. LA PRODUCTIVITÉ DANS LES PAYS
INDUSTRIALISÉS DEPUIS 1870
-
III. LA PRODUCTIVITÉ CONTRE
L'EMPLOI ?
-
IV. PRODUCTIVITÉ ET
COMPÉTITIVITÉ
-
I. QU'EST-CE QUE LA
PRODUCTIVITÉ ?
-
CHAPITRE II : LES ÉCARTS DE NIVEAU DE
VIE ENTRE LES PRINCIPAUX PAYS DÉVELOPPÉS : DESCRIPTION ET
EXPLICATIONS
-
I. LES DÉTERMINANTS COMPTABLES DU PIB PAR
HABITANT
-
II. UNE ANALYSE DES ÉCARTS DE NIVEAU DE VIE
ENTRE PAYS DÉVELOPPÉS ET DE LEUR ÉVOLUTION
-
III. QUELS ENSEIGNEMENTS ?
-
I. LES DÉTERMINANTS COMPTABLES DU PIB PAR
HABITANT
-
CHAPITRE III : ÉVOLUTIONS
RÉCENTES DE LA PRODUCTIVITÉ : L'EUROPE ET LA FRANCE
DÉCROCHENT-ELLES ?
-
I. LA DOUBLE INFLEXION DES RYTHMES DE
PRODUCTIVITÉ DEPUIS LES ANNÉES 1990 : RAPPEL DES
FAITS
-
II. QUEL EST LE RÔLE DES TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) DANS LES ÉVOLUTIONS
RÉCENTES DE LA PRODUCTIVITÉ ?
-
III. ÉVOLUTIONS SECTORIELLES DE LA
PRODUCTIVITÉ AUX ÉTATS-UNIS ET EN EUROPE : QUELLES
DIVERGENCES ?
-
IV. LE RALENTISSEMENT DE LA PRODUCTIVITÉ
PAR EMPLOYÉ EN FRANCE DEPUIS 1995 : UNE ILLUSTRATION DU PARADIGME
EUROPÉEN
-
V. QUEL DIAGNOSTIC ?
-
I. LA DOUBLE INFLEXION DES RYTHMES DE
PRODUCTIVITÉ DEPUIS LES ANNÉES 1990 : RAPPEL DES
FAITS
-
CHAPITRE IV : VIEILLISSEMENT
DÉMOGRAPHIQUE, NIVEAU DE VIE ET PRODUCTIVITÉ : QUELLES
PERSPECTIVES ?
-
I. QUEL IMPACT DU VIEILLISSEMENT
DÉMOGRAPHIQUE SUR LE NIVEAU DE VIE ?
-
II. AGIR SUR LA PRODUCTIVITÉ POUR
PRÉSERVER L'AUGMENTATION DU NIVEAU DE VIE ?
-
I. QUEL IMPACT DU VIEILLISSEMENT
DÉMOGRAPHIQUE SUR LE NIVEAU DE VIE ?
-
EXAMEN EN DÉLÉGATION
-
ANNEXE
-
NIVEAUX DE VIE ET PRODUCTIVITÉ : LA
FRANCE ET LES PRINCIPAUX PAYS DÉVELOPPÉS
N° 189
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
|
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 janvier 2007 |
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation du Sénat pour la planification (1) sur la productivité et le niveau de vie ,
Par M. Joël BOURDIN,
Sénateur.
(1) Cette délégation est composée de : M. Joël Bourdin, président ; M. Pierre André, Mme Évelyne Didier, MM. Joseph Kergueris, Jean-Pierre Plancade, vice-présidents ; MM. Yvon Collin, Claude Saunier, secrétaires ; MM. Bernard Angels, Gérard Bailly, Yves Fréville, Yves Krattinger, Philippe Leroy, Jean-Luc Miraux, Daniel Soulage .
|
Économie . |
INTRODUCTION
Pourquoi le mouvement de rattrapage par l'Europe du niveau de vie moyen des États-Unis, engagé après la Seconde guerre mondiale, s'est-il interrompu ?
Trois facteurs sont généralement évoqués :
- une première rupture est intervenue au milieu des années 70 , en lien avec le ralentissement de la croissance en Europe, ce qui a entraîné une hausse du chômage et un ralentissement de la croissance du facteur travail ;
- une deuxième rupture est intervenue au début des années 80 , avec la mise en oeuvre de politiques anti-inflationnistes en Europe, avec quelques années de retard sur les États-Unis et un impact négatif sur la croissance, à la fois plus durable et plus marqué ;
- une troisième rupture s'est produite au milieu des années 90 : à partir de 1995, la croissance de la productivité du travail aux États-Unis est passée d'un rythme tendanciel de 1,1 % par an à un rythme de 2,5 % par an ; en Europe, au contraire, le rythme a diminué, revenant de 2,3 % à 1,4 % par an. Ainsi, alors que l'Europe avait, en moyenne, pratiquement rattrapé les États-Unis en termes de productivité du travail, l'écart s'est à nouveau creusé à partir de 1995 .
Or, la capacité à mobiliser le facteur travail, d'une part, et la productivité du travail, d'autre part, déterminent le niveau de développement d'un pays. Ceci résulte de l'identité comptable très simple qui suit : le PIB est égal à l'emploi multiplié par la production par personne employée (c'est-à-dire la productivité du travail).
La triple inflexion évoquée ci-dessus est illustrée par le graphique n° 1 ci-dessous. On y voit notamment :
Graphique n° 1
PIB, PIB PAR HABITANT ET PIB PAR HEURE
TRAVAILLÉE
1960-2004
UE-15 EN % DES
ÉTATS-UNIS
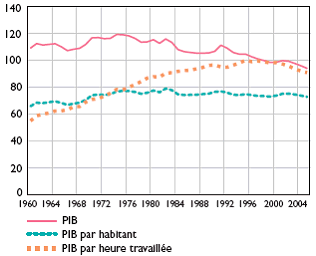
Note : le terme « UE-15 »
désigne les 15 pays membres de l'Union européenne, avant le
1
er
mai 2004.
Source : Groningen Growth and Development
Centre (GGDC)
- à partir de 1975 , l'interruption du rattrapage des États-Unis par l'Europe en termes de PIB par habitant - courbe en pointillés bleus -, en lien avec le ralentissement de la croissance et la hausse du chômage ;
- à partir de 1995 , la productivité horaire - courbe en pointillés espacés orange - connaît également une baisse relativement aux États-Unis, entraînant un nouveau creusement de l'écart de niveau de vie entre l'Europe et les États-Unis.
Ainsi, alors que le PIB par habitant dans l'Union européenne 1 ( * ) était inférieur de 22 % à celui des États-Unis en 1980, cet écart s'est par la suite creusé pour atteindre 26 % en 2004.
Si l'on se réfère aux éléments statistiques et comptables brièvement rappelés ci-dessus, l'Europe perdrait donc sur les deux tableaux : celui de l'utilisation de sa ressource en main d'oeuvre et celui de la productivité par tête, nourrissant ainsi le diagnostic d'un décrochage économique de l'Europe .
L'image d'une Europe prenant de plus en plus de retard par rapport aux États-Unis s'est en outre renforcée depuis le début des années 2000. En effet, suite au ralentissement de l'économie mondiale consécutive à l'éclatement de la « bulle Internet » en 2001, les États-Unis ont retrouvé un rythme de croissance proche de 3 %, effaçant ainsi rapidement la croissance perdue 2 ( * ) par rapport au potentiel de croissance. Le niveau du PIB des États-Unis est aujourd'hui supérieur à ce qu'il aurait été sans cette crise.
Dans le même temps, l'Europe qui avait mis fin, au tournant du XXe siècle, à huit années de « croissance molle », dépassant même les États-Unis en 2000 (+3,9 % de croissance contre +3,7 % pour les États-Unis) n'a pas encore surmonté la crise de 2001. Elle reste engluée dans une croissance (+1,3 % par an dans la zone euro sur 2002/2005) inférieure à son potentiel , souffrant ainsi, aujourd'hui, d'un « retard de croissance » de l'ordre de 1,5 % du PIB 3 ( * ) .
Alors qu'au cours des années 1990, la faiblesse de la croissance en Europe pouvait être imputée à l' orientation de la politique économique et, notamment, en lien avec la gestion de la réunification allemande, à des politiques ou stratégies monétaires (hausse des taux d'intérêt, dévaluations compétitives) extrêmement pénalisantes, rien de tel, en première analyse, au début des années 2000 : les soldes budgétaires se sont dégradés, semblant indiquer que la politique budgétaire a joué un rôle de stabilisation de la conjoncture, et la politique monétaire a été plus accommodante (les taux d'intérêt ont baissé de 4,4 % à 2,3 % entre 2000 et 2003).
Dans ce double contexte - le retard de la croissance de l'Europe et des politiques de régulation macroéconomique a priori accommodantes -, les travaux des économistes se sont plus particulièrement penchés sur les causes structurelles de ce décalage de dynamisme économique, et plus particulièrement sur les divergences d'évolution de la productivité .
*
La productivité est, en effet, le déterminant essentiel de la richesse des nations, pour paraphraser Jean Fourastié. Elle constitue la mesure de l'efficacité économique d'un pays .
La productivité est le rapport entre une production et les facteurs qui ont permis de la réaliser .
Il y a trois approches de la productivité, selon le facteur de production que l'on prend en compte : la productivité du travail, la productivité du capital, ou la productivité globale des facteurs c'est-à-dire la productivité de l'ensemble des facteurs utilisés (voir chapitre I pour une définition de ces concepts et la manière de les mesurer).
Ce rapport d'information est centré sur la productivité du travail , et chaque fois que le terme de « productivité » y sera employé, il sera fait référence à la productivité du travail.
La productivité du travail est, en effet, l'indicateur le plus important, car « il n'y a ni richesse ni force que d'hommes » , selon le mot de Jean BODIN au XVIe siècle 4 ( * ) , s'opposant ainsi à MALTHUS.
Cette expression traduit le fait que le nombre des hommes en capacité de travailler est le facteur qui, sur une longue période, limite la production. Accroître la productivité du travail est donc la seule manière d'augmenter le niveau de vie (de « faire plus avec moins » en quelque sorte).
Il faudrait ajouter que si les travaux sur la productivité concernent généralement la productivité du travail, cela résulte aussi de ce que le capital est très difficile à mesurer : on ne peut pas se contenter de compter le nombre de machines, il faut savoir aussi mesurer leur potentiel, et les comparaisons sont parfois impossibles.
Il est donc plus simple pour les économistes de privilégier la productivité du travail, en tenant compte de la qualité et de la quantité du facteur capital comme source d'augmentation de la productivité du travail.
*
Aborder la question de la productivité conduit inévitablement à affronter une difficulté fondamentale : si l'on sait décomposer ex post l'évolution de la productivité à partir des données comptables disponibles, et, ainsi, progresser dans les explications de cette évolution, la science économique reste encore relativement démunie pour en expliquer les déterminants fondamentaux, et notamment ce qui est au coeur de la productivité, le progrès technique .
L'augmentation de la productivité du travail résulte, en bonne partie, d'un « cadeau du ciel » 5 ( * ) . Longtemps qualifiée de « résidu inexpliqué » 6 ( * ) , elle souligne en quelque sorte les limites de la connaissance des sources de la croissance.
Avec la notion de productivité, on touche ainsi au coeur de tous des débats sur les déterminants de la croissance .
Cependant, les analyses menées pour comprendre la « double inflexion » de la productivité au cours des années 1990, c'est-à-dire son accélération aux États-Unis et son ralentissement en Europe, ont permis une nette avancée de la compréhension de ce phénomène.
Elles ont également permis à la science économique de progresser sur les deux questions suivantes :
- quel est l'impact de politiques sectorielles - recherche et développement, éducation et formation, développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, libéralisation des marchés de biens et services,... - sur la productivité ?
- quel est le rôle de la puissance publique pour créer un environnement favorable - notamment macroéconomique - à la diffusion de l'innovation et à l'augmentation de la productivité ?
*
En présentant ce rapport d'information sur « la productivité et le niveau de vie » , l'ambition de votre Délégation paraît donc élevée : parce que le sujet peut sembler relever de la recherche académique et parce qu'il est au coeur de tous les débats de politique économique.
Malgré cette double difficulté, il a paru nécessaire à votre Délégation de « faire un point » :
- tout d'abord sur un plan statistique et comptable, il lui semblait nécessaire de présenter un constat et une synthèse abordables permettant de mesurer les écarts de niveau de vie entre les principaux pays développés et d'en comprendre les déterminants.
Votre Délégation a ainsi demandé à l' INSEE (Direction des Etudes et Synthèses économiques) de réaliser une étude qui réponde à cette double exigence 7 ( * ) .
- ensuite, le moment semble venu d'une « mise
à plat » des travaux d'experts qui se sont récemment
multipliés sur la question des évolutions de productivité
des deux côtés de l'Atlantique, en lien avec la « double
inflexion » des rythmes de productivité depuis le milieu des
années 1990, afin de mettre en évidence les
éléments de diagnostic
les plus solides et d'en
déduire les
préconisations
les plus
pertinentes
8
(
*
)
.
Pour répondre à ce double objectif, votre rapporteur a pris le parti de traiter quatre problématiques :
La première est liée à la double nature du concept de productivité, qui détermine à la fois à la croissance à long terme d'un pays et le contenu en emplois de la croissance .
A un horizon où la croissance effective d'un pays n'est
pas contrainte par une insuffisance de la demande, celle-ci rejoint son
rythme potentiel
.
Or, le potentiel de la croissance d'un
pays dépend de la croissance de l'emploi et de la productivité
par tête
9
(
*
)
.
La productivité est ainsi au coeur du processus de croissance d'un pays et de sa richesse.
Mais, à un horizon où la croissance peut être contrainte par une insuffisance de la demande , la productivité détermine le contenu en emplois de la croissance .
Cette double nature du concept de productivité peut placer la politique économique face au conflit d'objectifs : dans un contexte de faible croissance, il peut être rationnel de mettre en oeuvre des politiques d' enrichissement du contenu en emplois de la croissance - donc de ralentir les gains de productivité - afin de lutter contre le chômage, mais elles contribuent à terme à abaisser le potentiel de croissance et à affaiblir structurellement l'économie.
Cette contradiction apparente peut-elle être dépassée, ce qui revient finalement à poser cette question triviale : la productivité joue-t-elle contre l'emploi ?
Cette problématique sera abordée dans un premier chapitre introductif.
La deuxième problématique est liée au creusement des écarts de niveau de vie entre l'Europe et les États-Unis : quels sont les facteurs comptables de ces écarts ? Résultent-ils en particulier d'une « préférence européenne pour le loisir » 10 ( * ) ?
Ces questions seront abordées dans le deuxième chapitre , sur la base de l'étude réalisée par l'INSEE et annexée à ce rapport d'information.
La troisième problématique résulte de ce qui apparaît en première analyse comme un décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis en matière d'évolution des rythmes de productivité depuis les années 1990 : quelle est la réalité de ce décrochage ? Quelles en sont les causes ? Que faut-il penser de la thèse souvent avancée, selon laquelle l'économie européenne aurait rattrapé, dans le courant des années 80, le niveau de la productivité américaine grâce à une stratégie d'imitation , mais qu'ayant atteint la « frontière technologique » 11 ( * ) , il lui faudrait désormais entrer dans une stratégie d'innovation permanente , que ses rigidités et ses faiblesses structurelles supposées (effort de recherche et de formation insuffisants, réglementation excessive...) freineraient ? ( troisième chapitre ).
La quatrième problématique est de nature prospective : dans un contexte de vieillissement démographique , qui va entraîner une augmentation du ratio de dépendance (rapport du nombre d'actifs au nombre d'inactifs), le ralentissement de la progression du niveau de vie est-il inéluctable ? Cela remet-il en cause la capacité des actifs à financer l'augmentation des dépenses liées au vieillissement démographique (retraites et santé) ? ( quatrième chapitre ).
*
* *
CHAPITRE I : LA PRODUCTIVITÉ AU CoeUR DE LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
Ce chapitre propose quelques rappels pour définir le concept de productivité et mettre en évidence le caractère déterminant de la productivité dans le processus de création de richesse et dans les enchaînements macroéconomiques.
A ce titre, une attention particulière est accordée aux liens entre productivité et emploi ( troisième partie ) et entre productivité et compétitivité ( quatrième partie ).
I. QU'EST-CE QUE LA PRODUCTIVITÉ ?
A. DÉFINITIONS
La productivité s'obtient en rapportant la production d'une entreprise, d'une branche ou d'un pays, aux facteurs nécessaires à sa réalisation (travail et capital) .
Cette définition de la productivité se rapporte à son niveau. Or, les évolutions de la productivité - ou « gains de productivité » - sont déterminantes dans le processus de croissance 12 ( * ) . L'évolution de la productivité se définit ainsi comme l'augmentation de la production divisée par celle d'un (ou des deux) facteur(s) de production : cet indicateur traduit l'augmentation de l'efficacité du (ou des) facteur(s) de production.
Si l'on prend en compte le seul facteur travail , on dispose de deux indicateurs de la productivité du travail :
- la productivité par tête , qui rapporte la production aux effectifs ;
- la productivité horaire , qui rapporte la production au nombre d'heures travaillées. Statistiquement, la productivité horaire s'obtient en corrigeant la productivité par tête de la variation moyenne annuelle de la durée du travail.
Même si cet aspect est développé par la note de l'INSEE (cf. annexe, page 146), votre rapporteur tient à souligner d'emblée, combien les comparaisons internationales de productivité horaire sont fragilisées par la médiocre fiabilité des statistiques sur la durée du travail.
C'est pourquoi, il faut être prudent à l'égard de faibles variations relatives et ne prendre en considération que les inflexions de tendance les plus marquées.
Sous cette condition, la productivité horaire est l' indicateur le plus couramment utilisé .
Si l'on prend en compte le capital, la productivité du capital rapporte la valeur ajoutée (PIB) au stock de capital mis en oeuvre.
La productivité de l'ensemble des facteurs de production, appelée productivité globale des facteurs (PGF) , est calculée en rapportant la production au volume de travail et de capital.
Une augmentation de la PGF traduit (et mesure) l'augmentation de la production qui n'est pas imputable aux deux facteurs de production, ou, pour le dire autrement, qui est supérieure à celle résultant de la seule augmentation des deux facteurs de production.
La PGF est ainsi considérée comme la meilleure mesure de l' efficacité globale de la combinaison productive , du processus productif.
Elle est présentée le plus souvent comme une mesure du « progrès technique » (cf. ci-après, page 20).
Ce rapport d'information, comme la plupart des travaux sur la productivité, privilégie la productivité du travail, c'est-à-dire un indicateur de productivité « partielle » (par opposition à la productivité « globale » des facteurs), dans la mesure où il ne prend en compte qu'un seul des deux facteurs de production.
B. COMMENT MESURER LA PRODUCTIVITÉ ?
1. Difficultés de mesure
La productivité du travail mesure le rapport entre la production et le volume de travail utilisé.
Des difficultés pèsent sur la mesure du numérateur comme sur celle du dénominateur. Avant de les détailler plus longuement 13 ( * ) , votre rapporteur évoquera ici des difficultés « conceptuelles » - plutôt que proprement statistiques - concernant la mesure de la production :
- la première difficulté est que l'unité de mesure de la production est la monnaie. Or celle-ci change de valeur au cours du temps à cause de la hausse des prix. Pour raisonner à « monnaie constante », il faut déflater la production de l'évolution des prix. Or celle-ci, si elle est correctement mesurée par l'indice des prix, ne donne pas l'évolution de la qualité des biens dont elle mesure les prix. L'augmentation du prix d'une voiture résulte-t-elle d'un phénomène d'inflation ou d'une augmentation de la qualité et de la performance, donc de sa « valeur réelle » ?
Les comptables nationaux affinent continûment les méthodes destinées à prendre en compte cette augmentation de la qualité (méthodes de « prix hédoniques ») mais ces améliorations sont insuffisantes, notamment lorsque les changements dans la qualité et la nature des produits s'accélèrent sous l'effet d'une innovation technologique : la « révolution technologique » des technologies de l'information et de la communication (TIC) aggrave ainsi les problèmes de mesure du « partage volume-prix », donc de la valeur ajoutée réelle , d'un nombre croissant de biens dont les performances augmentent très rapidement.
- une autre difficulté peut résulter de la sous-traitance ou de la délocalisation de certaines opérations. Comme la productivité de ces opérations délocalisées peut différer de la productivité moyenne (la productivité y est généralement inférieure), les comparaisons internationales sont faussées : la productivité des pays qui, comme les États-Unis, délocalisent relativement plus, donc délocalisent des activités moins productives que la moyenne, est dopée relativement à celles des pays qui délocalisent moins.
- la principale difficulté concerne la mesure de la productivité dans les services . Dans un souci de simplification, on peut distinguer trois types de difficulté (qui en réalité peuvent être liées entre elles) :
• Comment mesurer la productivité d'un orchestre, d'un médecin ou même d'un cabinet comptable ? Pour dépasser la difficulté à mesurer « véritablement » ce qui est produit par les prestataires de services cités ici en exemple, les comptables nationaux ont développé des méthodes d'évaluation qui, globalement, sous-estiment les gains de productivité du travail dans les services : c'est la conclusion des travaux conduits par les services de la Banque Fédérale américaine ou par le Bureau of Labor Statistics , l'agence statistique du Ministère du travail américain.
• Une partie des gains de productivité dans les
services est en réalité
« confisquée » par le secteur
manufacturier
. Si l'on prend l'exemple de la production
aéronautique qui externalise les activités de nettoyage,
l'économie réalisera des gains de productivité si les
entreprises d'entretien réalisent un travail de même
qualité, mais moins onéreux.
Mais le gain de
productivité qui en résulte est attribué au secteur
aéronautique : le nombre de salariés du secteur a
diminué alors que le nombre d'avions produits est inchangé.
La
production de services d'entretien aux entreprises étant
généralement mesurée à partir du coût du
travail, la productivité y est stable.
Une partie des gains de
productivité du travail est ainsi attribuée à tort au
secteur manufacturier. Toutefois, ceci n'a
pas d'impact sur la
productivité de l'ensemble
de l'économie.
• La dernière difficulté concerne la mesure de la production des services non marchands , tels que l'éducation ou la santé. La production de ces services est généralement évaluée au « coût des facteurs » de production utilisés, c'est-à-dire le salaire des personnels employés dans ces services non marchands. Par construction, l'augmentation de la production - numérateur - se retrouve au dénominateur de sorte qu'aucun gain de productivité ne peut apparaître dans les services non marchands.
Des efforts importants sont conduits pour mettre au point des indicateurs de productivité dans certains services non marchands, par exemple dans les hôpitaux, mais il serait illusoire d'en attendre une mesure des services non marchands comparable à celle du secteur manufacturier ou même des services marchands.
Ces questions de méthode n'ont pas qu'un intérêt académique : elles relativisent les analyses sur le rôle joué par les services dans le ralentissement de la productivité après le premier choc pétrolier ou dans son accélération aux États-Unis au début des années 90 (cf. chapitre III).
2. L'analyse comptable de la productivité du travail
En ne prenant en considération que l'évolution de la productivité du travail, on se prive d'un élément d'analyse important : l'augmentation de la productivité du travail peut résulter à la fois du nombre de machines à la disposition du facteur travail (augmentation de l'« intensité capitalistique ») et de l'augmentation de l'efficacité globale du processus de production c'est-à-dire la productivité globale des facteurs (PGF), ou encore le « progrès technique » 14 ( * ) .
Or ces deux contributions à l'augmentation de la productivité du travail - intensité capitalistique et PGF - sont de nature très différente :
- l'augmentation de l'intensité capitalistique correspond à l'accélération du processus de substitution de capital au travail . Celui-ci est surtout motivé par des considérations de coût de production , et est donc susceptible de se « retourner » contre l'emploi .
Ces gains de production sont caractéristiques d'une « économie d'imitation », ou de rattrapage : ils traduisent l'assimilation par les entreprises existantes, de technologies nouvelles ou de nouvelles formes d'organisation du travail.
Les effets d'augmentation de l'intensité capitalistique correspondraient ainsi à ceux qui dominaient en Europe depuis le premier choc pétrolier et surtout, comparativement aux États-Unis, depuis le milieu des années 90 : en Europe, la « révolution technologique » liée aux Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) aurait plutôt entraîné une substitution de capital TIC au travail qu'une diffusion des gains d'efficacité globale permise par les TIC à l'ensemble de l'économie ;
- la productivité globale des facteurs (PGF) constitue ce qui reste (notion de « résidu ») lorsqu'on a retiré de l'augmentation de la productivité du travail ce qui s'explique par l'augmentation de l'intensité capitalistique.
La PGF est ainsi le produit d'une utilisation plus efficace de la combinaison capital-travail, permise par une réorganisation du travail ou l'introduction d'innovations.
L'augmentation de la PGF résulte notamment de l'arrivée d' entreprises nouvelles , plus innovantes que les entreprises existantes.
Ces gains améliorant la compétitivité globale de l'économie et les conditions de la croissance, peuvent être favorables à l'emploi. Ils sont caractéristiques d'une économie où domine le processus d' innovation et non celui d'imitation, c'est-à-dire une économie qui évolue à la « frontière technologique », c'est-à-dire au stade le plus avancé - par rapport aux autres pays - du développement technologique.
Le « Rapport SAPIR », rédigé pour le Président de la Commission européenne 15 ( * ) , qui a largement inspiré la « Stratégie de Lisbonne », mettait l'accent sur l'importance de privilégier les gains de PGF en Europe.
Cette distinction entre deux types de gains de
productivité du travail
- l'intensité capitalistique et
la PGF
16
(
*
)
-
résulte des approches de « comptabilité de la
croissance ».
Il y sera très souvent fait référence dans ce rapport d'information, compte tenu de la dimension explicative de cette approche.
*
On peut résumer ce qui précède sur le passage de la productivité par tête au progrès technique à l'aide d'un schéma très simple :
Productivité par tête
(valeur
ajoutée/effectifs occupés)
Durée
du travail
Productivité
horaire
Productivité
horaire
Intensité capitalistique
Productivité globale des facteurs
(« progrès technique »)
= x x
= x
C. PRODUCTIVITÉ ET CROISSANCE
La place centrale de la productivité dans la croissance a été présentée en introduction à ce rapport par l'identité comptable : PIB = Productivité x emploi.
Mais, il ne s'agit-là précisément que d'une relation comptable, d'une décomposition ex post de la croissance qui ne décrit pas réellement la place de la productivité dans le circuit économique.
Le lien de causalité entre productivité et croissance peut être envisagé dans les deux sens.
Dans le premier, les gains de productivité entraînent une accélération de la croissance à la fois par le pouvoir d'achat qu'ils permettent de distribuer et par l'investissement qu'ils ont permis de financer. Cet enchaînement peut être illustré à partir du schéma ci-dessous :
LA PRODUCTIVITÉ FAIT LA CROISSANCE
Gains de productivité
Hausse des salaires réels
Hausse des profits
Hausse de l'investissement
Baisse des coûts
Augmentation
de la consommation
Augmentation
des exportations
Croissance
de la production
Mais un second lien de causalité peut être envisagé, dans lequel l' accélération de la croissance entraînerait celle de la productivité :
- à court terme , l'accélération de l'activité entraîne une hausse de l'utilisation des capacités de production ;
- à moyen terme , une hausse de la croissance et donc des débouchés entraîne celle de l'investissement et augmente ainsi l'intensité capitalistique ;
- à long terme , la croissance exerce une pression sur l'innovation et le progrès technique : les entreprises sont incitées à prendre des risques, ou plus précisément, le coût du risque est moindre du fait de l'augmentation des débouchés ; par ailleurs, l'augmentation des salaires réels incite les entreprises à mettre en oeuvre les combinaisons les plus capitalistiques.
Dans cette vision plus keynésienne, théorisée notamment par l'économiste Nicholas KALDOR, le progrès technique est considéré comme dépendant de la croissance (endogène) alors qu'il est considéré comme exogène dans la vision « schumpétérienne ».
La thèse du progrès technique, selon J. Schumpeter, considère, en effet, les innovations comme un processus discontinu : celles-ci reviennent par « grappes » et procèdent par « sauts » ; elles créent de nouveaux produits et de nouveaux processus de production. En périmant les produits et les techniques, le processus de « destruction créatrice » libère la voie aux produits et aux marchés nouveaux, nourrissant ainsi la croissance.
En sens inverse, le ralentissement de la productivité après le premier choc pétrolier a fait l'objet de nombreux travaux 17 ( * ) qui avancent trois séries d'explications :
- un effet de type schumpétérien, avec la fin de la diffusion de la grappe d'innovations due notamment au développement de l'automobile et de l'équipement des ménages, dans les années 60 ;
- la fin du processus de rattrapage par les pays européens du pays technologiquement le plus avancé (les États-Unis) ;
- le manque de dynamisme de la demande lié au ralentissement de la croissance après le premier choc pétrolier.
II. LA PRODUCTIVITÉ DANS LES PAYS INDUSTRIALISÉS DEPUIS 1870
Votre rapporteur propose ci-après un rappel sur l'évolution de la productivité sur longue période 18 ( * ) .
Ce regard historique repose sur les évolutions de la productivité horaire. Cet indicateur est fragile car il constitue aussi un « résidu statistique » : il faut partir du PIB, divisé par l'emploi, puis par l'évolution de la durée du travail pour arriver à la productivité horaire. Or, la mesure de la durée du travail et les comparaisons internationales en la matière sont extrêmement fragiles. Néanmoins, sur une période aussi longue, cette fragilité affecte peu l'analyse historique brièvement présentée ci-dessous.
A. LES GRANDES PHASES D'ÉVOLUTION DE LA PRODUCTIVITÉ DANS LES PAYS INDUSTRIALISÉS DEPUIS 1870
Le tableau n° 1 ci-dessous décrit les principales phases de l'évolution de la productivité dans les pays industrialisés.
Tableau n° 1
TAUX DE CROISSANCE ANNUEL
MOYEN DE PRODUCTIVITÉ HORAIRE DU TRAVAIL
DANS LES PRINCIPAUX PAYS
INDUSTRIALISÉS
(Ensemble de l'économie
en %)
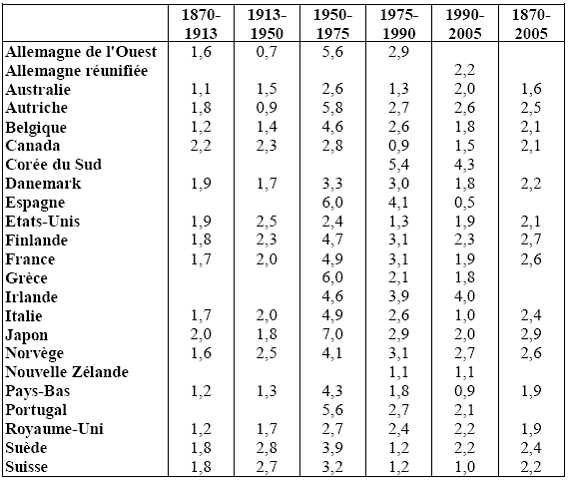
On peut formuler à partir de ce tableau les observations suivantes :
- sur l'ensemble de la période 1870-2005, les gains annuels de productivité dans les pays industrialisés ont varié autour d'une moyenne de 2,5 % : 2,6 % pour la France, 2,1 % pour les États-Unis, par exemple.
Cela a permis de multiplier d'un facteur d'environ 32 le PIB par heure travaillée en France ; 16,5 aux États-Unis (aux extrêmes : 50 au Japon, qui partait d'un niveau plus bas ou 8,5 en Australie qui partait d'un niveau plus élevé) et cela a constitué la source principale de la forte amélioration des niveaux de vie ;
- la période atypique en termes d'évolution de la productivité se situe pendant la période des « Trente Glorieuses » pour les pays industrialisés où l'évolution de la productivité horaire a été exceptionnellement rapide, à l'exception toutefois des États-Unis où l'accélération de la productivité y a été plus précoce (après la Première Guerre mondiale), plus longue (1913-1950) et moins marquée qu'en Europe.
Cette période qui va de la Première Guerre mondiale au premier choc pétrolier est décrite comme celle de la « grande vague » 19 ( * ) .
L'accélération plus tardive en Europe qu'aux États-Unis de la productivité s'explique par divers facteurs : protectionnisme qui a freiné la diffusion de l'innovation, diffusion plus tardive de l' énergie électrique , moindre niveau d' éducation ,...
- suite aux ralentissements après le premier choc pétrolier, puis dans les années 1990 en Europe, les gains de productivité sont souvent considérés comme « historiquement faibles » ; or, replacés dans une perspective longue, ils traduisent en fait un retour vers une tendance séculaire , après l'anomalie de la « grande vague » ;
- sur l'ensemble de la période 1870-2005, les progrès de la productivité horaire ont permis de réduire de 50 % en moyenne environ la durée du travail . La productivité par tête - et toutes choses égales par ailleurs, le niveau de vie - a donc augmenté deux fois moins que la productivité horaire .
B. LES INFLEXIONS DE TENDANCE ET LEURS CAUSES
1. Les facteurs d'accélération
L'économie américaine a connu quatre épisodes d'accélération de la productivité : 1873-1890 ; 1917-1927 ; 1948-1973 et depuis 1995 qui s'expliquent par :
- des innovations technologiques : machines à vapeur, à charbon et transport ferroviaire, pour le premier épisode ; diffusion de l'énergie électrique, du téléphone et du moteur à explosion pour le deuxième épisode ; développement des transports, de l'industrie chimique, de l'industrie électronique pour le troisième épisode ; production et diffusion des TIC pour le quatrième épisode ;
- des changements institutionnels : drainage de l'épargne par les banques à la fin du 19 e siècle, développement des marchés financiers après la Première Guerre mondiale, mondialisation des mouvements de capitaux dans les 3 ème et 4 ème épisodes, progression continue du niveau d'éducation.
2. Le rôle de la productivité globale des facteurs
Des économistes 20 ( * ) ont mis en évidence le rôle de la productivité globale des facteurs (PGF) dans les évolutions de la productivité sur longue période :
- de 1913 à 1950, la PGF explique l'essentiel de l'accélération de la productivité aux États-Unis ;
- de 1950 à 1973, la PGF explique presque intégralement l'accélération de la productivité en France. Le rattrapage rapide des niveaux de productivité des États-Unis s'opère donc davantage par la PGF que par la diffusion des techniques de production qui substituent du capital au travail ;
- le ralentissement consécutif au premier choc pétrolier s'explique aux États-Unis comme en France par celui de la PGF ; en France on observe même une accélération de l'intensité capitalistique - accélération de la substitution du capital au travail -, liée vraisemblablement à l'augmentation du coût du travail.
- sur la période 1980-2004, le ralentissement de la productivité en Europe s'explique à la fois par celui de l'intensité capitalistique et de la PGF, alors que ces deux grandeurs accélèrent aux États-Unis.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, la France demeure le pays qui connaît, comparativement aux États-Unis et au Royaume-Uni, les plus forts gains de PGF (l'augmentation de la PGF pouvant traduire la capacité à développer l'innovation).
III. LA PRODUCTIVITÉ CONTRE L'EMPLOI ?
La perception du concept de productivité est généralement ambiguë : associée à la richesse et au progrès du niveau de vie, elle est aussi perçue comme un facteur de diminution de l'emploi.
Ceci se comprend à partir de l'identité comptable rappelée en introduction à ce rapport : le PIB est égal au produit de la productivité par l'emploi. La productivité détermine donc - avec la main d'oeuvre disponible -le potentiel de croissance d'une économie.
Mais l'identité comptable ci-dessus peut également s'inscrire :
Emploi = PIB/Productivité
Pour une croissance donnée , la productivité détermine l'emploi (en niveau comme en variation), ou encore le contenu en emploi de la croissance .
Cette ambiguïté est certainement à l'origine du manque de cohérence du débat public en Europe et plus particulièrement en France. La France et l'Europe ont ainsi été stigmatisées - jusque dans les années 90 - pour la faiblesse des créations d'emploi et le faible contenu en emploi de la croissance. Mais depuis que l'objectif d'enrichissement du contenu en emploi de la croissance est atteint (ralentissement de la productivité), la faiblesse des gains de productivité fait craindre un décrochage économique de l'Europe.
A. ASPECTS THÉORIQUES ET EMPIRIQUES
Les enseignements de la théorie économique largement validés par les analyses empiriques permettent d'apporter des éléments de clarification.
Ils conduisent ainsi à distinguer trois horizons , avec pour chacun des relations différentes entre productivité, PIB et emploi.
1) A long terme tout d'abord, une accélération de la productivité se traduit par une accélération de la croissance du PIB , mais est neutre pour l'emploi .
Très concrètement, si l'on passe durablement d'un rythme de productivité de 1 à 2 % par an, la croissance du PIB est supérieure d'1 point et celle de l'emploi identique à la situation antérieure.
Ceci s'explique par la relation entre productivité et salaires . A long terme, il faut considérer, en effet, que les salaires évoluent comme la productivité. Ceci « permet » une stabilisation du partage de la valeur ajoutée entre salaires et profits 21 ( * ) .
Dans ce cas - salaires évoluant comme la productivité -, le coût salarial unitaire (qui rapporte le coût salarial à la productivité) est inchangé . La théorie économique postule qu'à long terme l'évolution du chômage n'est déterminée que par celle du coût du travail : lorsque le coût du travail augmente, le chômage « structurel » augmente 22 ( * ) .
Les travaux empiriques semblent valider cette analyse. Ainsi observe-t-on que le fort ralentissement de la productivité après le premier choc pétrolier s'est traduit dans pratiquement tous les pays par un ralentissement équivalent à la croissance du PIB, sans incidence sur l'évolution de l'emploi.
En France, par exemple (mais on observe les mêmes
relations dans la plupart de pays), le rythme d'évolution de la
productivité a ralenti de
-2,6 points par an sur la
période 1975-2005 par rapport à la période 1950-1975, et
la croissance du PIB a ralenti également de -2,6 points par
an ; par contre, l'évolution de la croissance de l'emploi entre les
deux périodes a été sensiblement identique.
Sur longue période, il semble donc clair que les évolutions de la productivité se reportent intégralement sur la croissance du PIB et pas sur l'emploi (la productivité « ne joue pas contre l'emploi »).
2) A moyen terme , la relation productivité-PIB-emploi est différente et dépend de la situation du marché du travail.
Si l'économie connaît un fort chômage, lié notamment à une croissance bridée par l'insuffisance de la demande (ou qui évolue en dessous de son potentiel), une accélération de la productivité n'aura pas d'effet sur la croissance du PIB - car celui-ci est contraint par l'insuffisance de la demande ; mais elle entraînera une diminution de l'emploi (dans l'identité emploi = PIB/Productivité, le dénominateur augmente et le numérateur ne change pas).
Inversement, une diminution de la productivité entraînera une augmentation de l'emploi (car le PIB est inchangé).
Les politiques d'enrichissement du contenu en emploi de la croissance, telles que la baisse de la durée légale du travail ou le développement du temps partiel, visent ainsi à freiner l'évolution de la productivité par tête, et ainsi à diminuer la composante keynésienne du chômage (c'est-à-dire la composante du chômage lié à l'insuffisance de la demande, par opposition au chômage « structurel » qui s'explique notamment par le coût du travail).
Cette approche théorique semble également
validée par l'analyse empirique
: ainsi, sur la
période 1995-2005, on observe que dans les pays de l'OCDE, plus le
ralentissement de la productivité a été important, moins
celui de l'emploi l'a été. Par exemple, en France si l'on compare
la période 1995-2005 à celle de 1985-1995, le ralentissement de
la productivité a été de
-0,6 point par an
(après 1995) et l'évolution de l'emploi supérieure de
0,6 point par an.
3) A court terme , les évolutions de la productivité sont connues sous l'expression de « cycle de productivité » : dans une phase d'accélération de l'activité, les entreprises tardent à ajuster l'emploi, ce qui entraîne une augmentation de la productivité (et une moindre progression de l'emploi relativement à celle du PIB). Dans une phase de ralentissement, un phénomène inverse se produit (ralentissement de la productivité).
B. LE DILEMME EUROPÉEN
Sur la période 1970-1990, le rythme de la croissance annuelle moyenne du PIB de l'Union européenne à15 est peu éloigné de celui des États-Unis : 2,7 % contre 3,2 %.
Par contre, la progression annuelle moyenne de l'emploi est beaucoup plus faible dans l'UE-15 : 0,5 % contre 1,9 % aux États-Unis.
Ces évolutions se retrouvent - en sens inverse - dans celles de la productivité (cf. tableau ci-après) : le ralentissement de la productivité aux États-Unis, des années 70 jusqu'au milieu des années 90, est beaucoup plus marqué qu'en Europe et dessine un modèle atypique (notamment par rapport à l'Europe et au Japon) de croissance riche en emploi et d'utilisation extensive du travail 23 ( * ) .
Tableau n° 2
PIB, PRODUCTIVITÉ ET EMPLOI - TAUX DE CROISSANCE
ANNUELS MOYENS
COMPARAISON ÉTATS-UNIS / UNION
EUROPÉENNE
1970-1990
|
En % |
PIB |
Productivité |
Emploi |
|||
|
UE-15 |
États-Unis |
UE-15 |
États-Unis |
UE-15 |
États-Unis |
|
|
1971 - 1980 |
3,0 |
3,2 |
2,6 |
1,2 |
0,3 |
2,1 |
|
1980 - 1990 |
2,4 |
3,2 |
1,8 |
1,3 |
0,7 |
1,7 |
Une abondante littérature a été consacrée à l'analyse des spécificités américaines au cours de cette période :
- le recul de l'influence des syndicats et des conventions collectives a pesé sur l'évolution des rémunérations, et la flexibilité du droit du travail américain facilite les ajustements du nombre de salariés par les entreprises en cas de retournement conjoncturel ; ces deux caractéristiques ont conduit les entreprises à ralentir la substitution capital/travail et à ne pas privilégier les combinaisons productives les plus capitalistiques ou économes en travail.
- la tertiarisation de l'économie y a été plus précoce et plus importante qu'en Europe ; le commerce, l'hôtellerie-restauration ou les activités financières ont créé massivement des emplois.
L'histoire européenne sur la période 1970-1990 a été très différente :
- selon l'OCDE, qui a développé cette thèse dans de nombreux rapports, le rythme rapide de l'évolution du coût du travail n'a pas connu en Europe d'inflexion après le premier choc pétrolier, en dépit du fort ralentissement des gains de productivité. Il en est résulté une dégradation de la part des profits de la valeur ajoutée et une hausse des coûts salariaux unitaires qui ont contraint les entreprises à privilégier des combinaisons productives capitalistiques et à « économiser » le travail. Les travailleurs les moins qualifiés ont ainsi été exclus massivement du marché du travail, d'où l'augmentation du chômage. Mais, compte tenu des enchaînements décrits, l'augmentation du chômage est ici de nature essentiellement structurelle .
L'exemple de la France est ainsi considéré comme illustrant le mieux cette évolution jusqu'en 1983 (« tournant de la rigueur-salariale »).
- dans les années 80 toutefois, les politiques macroéconomiques induites par le Système monétaire européen, ou des politiques monétaires anti-inflationnistes dont le calibrage a peut-être été inadapté, ont conduit les économies européennes à évoluer sur un sentier de croissance inférieur à leur potentiel, conduisant à l'augmentation d'un chômage de nature keynésienne .
Tous les pays européens ont cherché à mettre en oeuvre une stratégie d'enrichissement du contenu en emploi de la croissance à partir des années 90, et à emprunter au modèle américain, mais la France est certainement le pays où les dispositifs les plus complets ont été appliqués 24 ( * ) .
Deux types de dispositifs peuvent être distingués selon leur logique macroéconomique :
- les politiques de réduction du temps de travail (temps partiel et réduction de la durée légale hebdomadaire), qui se traduisent mécaniquement par une baisse de la productivité par tête mais un maintien (voire une hausse), de la productivité horaire, sont mises en oeuvre de telle sorte qu'en théorie, le coût salarial unitaire demeure inchangé . A ce titre, elles sont censées ne pas modifier le chômage structurel - déterminé par le coût du travail - et visent donc à réduire sa composante keynésienne (grâce au « partage » du travail) ;
- les politiques d'allègement des charges pesant sur le travail, ont pour but de diminuer le coût salarial unitaire et donc de freiner la substitution capital/travail. Ceci se traduit par un ralentissement des gains de productivité horaire , qui permet d'abaisser la composante structurelle du chômage.
Mise en oeuvre depuis le milieu des années 90, cette stratégie à double composante a permis un ralentissement de la productivité (elle en explique, en réalité, la moitié, cf. page 91), une forte accélération de l'emploi sur la période de croissance soutenue 1998-2000 et un moindre ralentissement de son évolution sur la période de ralentissement qu'a connue l'Europe, suite à la crise mondiale liée à l'éclatement de la « bulle Internet » en 2001.
Mais cette stratégie délibérée a ses revers : effets négatifs sur la qualité des emplois créés, substitution de travail non qualifié à du travail qualifié, déficit d'innovation dans les processus de production et faible adaptation de la spécialisation internationale aux évolutions de la demande mondiale, forte sensibilité aux fluctuations de la compétitivité-coûts et du taux de change,...
Le rebond de la productivité aux États-Unis
à partir de 1995 (cf.
chapitre III
), le
creusement des écarts de croissance potentielle et des niveaux de vie
qui en résulte, ont mis l'accent sur les aspects négatifs de la
stratégie européenne d'enrichissement du contenu en emploi de la
croissance : l'Europe prendrait du retard à cause de la production
et de la diffusion insuffisantes des technologies de l'information et de la
communication
- TIC - (cf. chapitre III) et de la stagnation de
l'effort de recherche et développement.
Dans le même temps, le ralentissement mondial de 2001 a plongé la zone euro dans une atonie durable, au contraire des États-Unis et de la plupart des pays de l'OCDE hors zone euro, contribuant à la persistance du chômage.
La zone euro se trouve ainsi prise dans une double contrainte : accélérer les gains de productivité globaux de l'économie afin de suivre le rythme des États-Unis, mais aussi, incitation à poursuivre des stratégies d'enrichissement du contenu de la croissance en emploi de travailleurs non qualifiés (les plus touchés par le chômage).
Ces deux stratégies, par nature, s'opposent. Cette difficulté pour l'Europe à définir une stratégie cohérente se retrouve dans les débats publics, notamment en France, entre incitations à enrichir le contenu en emploi de la croissance par des dispositifs d'allègement du coût du travail sur les non qualifiés (élargissement de l'assiette des cotisations sociales à la valeur ajoutée) ou sur l'ensemble des salariés (« TVA sociale »), et volonté de développer l'innovation et la spécialisation en faveur des secteurs de haute technologie par les dépenses de recherche-développement ou en faveur de l'enseignement supérieur.
La « Stratégie de Lisbonne » offre une illustration spécifique de ce dilemme européen :
- dans le prolongement du « Rapport SAPIR » 25 ( * ) , elle met l'accent sur l'innovation, la recherche et l'enseignement supérieur, et sur la relation positive : innovation-productivité-croissance potentielle-niveau de vie ;
- mais, elle met aussi l'accent sur la compétitivité donc sur la maîtrise des coûts salariaux (qui évolueraient donc moins vite que la productivité) qui permettrait à la fois de protéger l'emploi non qualifié et d'améliorer les positions européennes sur les marchés mondiaux.
Cette question sera plus longuement développée par votre rapporteur au quatrième chapitre .
IV. PRODUCTIVITÉ ET COMPÉTITIVITÉ
Il existe une relation inverse entre la productivité et l'indicateur de compétitivité constitué par le coût salarial unitaire (c'est-à-dire le coût salarial par unité produite) : celui-ci s'obtient en divisant le coût salarial par le volume de la production.
A coût de la main d'oeuvre inchangée, une augmentation de la productivité du travail conduit à diminuer l'horaire nécessaire pour produire une unité de bien, diminuant dans les mêmes proportions le coût salarial unitaire. Pour évaluer la compétitivité, il faut donc associer la productivité et le coût du travail afin de constituer une mesure unique du coût salarial unitaire.
L'objet de cette partie est de replacer la problématique du lien entre productivité et compétitivité dans le contexte de la concurrence des pays émergents sur les marchés mondiaux de produits manufacturés :
- quelle est la position compétitive des économies avancées par rapport aux économies émergentes , compte tenu des différentiels de productivité ?
- comment expliquer le paradoxe de l'économie américaine qui malgré l'accélération relative de sa productivité, voit sa performance à l'exportation se dégrader continûment depuis la fin des années 90 ?
A. PRODUCTIVITÉ
ET COMPÉTITIVITÉ :
ÉLÉMENTS DE
COMPARAISONS INTERNATIONALES
1. Les écarts de coûts salariaux unitaires entre économies avancées et économies émergentes
Le tableau n° 3 ci-après compare les niveaux relatifs de la productivité dans le secteur manufacturier pour trois économies avancées (États-Unis, Union européenne à 15 - UE-15 - et Japon) et trois économies émergentes (Chine, Inde, les 10 nouveaux Etats membres de l'Union européenne) et les niveaux de compétitivité mesurée par le coût salarial unitaire (coût du travail par unité produite).
Tableau n° 3
PRODUCTIVITÉ HORAIRE EN PARITÉ DU POUVOIR
D'ACHAT
ET COÛT SALARIAL UNITAIRE
DANS L'INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE
(niveaux, États-Unis =
100)
|
PRODUCTIVITÉ
|
COÛT SALARIAL UNITAIRE
|
|
|
Économies avancées |
||
|
UE à 15 |
78,8 |
90,5 |
|
Japon |
66,1 |
119,5 |
|
États-Unis |
100 |
100 |
|
Économies émergentes |
||
|
10 nouveaux membres de l'UE (a) |
20,5 |
72,4 |
|
Chine (b) |
5,3 |
- |
|
Inde (b) |
2,3 |
49,5 |
(a) Moyenne pour la République tchèque, la
Hongrie, la Pologne et la Slovaquie
(b) Productivité par personne
employée
Sources : TCB/GGDC et base de données STAN de
l'OCDE
On peut, certes, voir que les niveaux de productivité (colonne de gauche) sont beaucoup plus faibles dans les économies émergentes que dans les économies avancées :
- la productivité du secteur manufacturier en Inde ne représente que 2 % du niveau américain, 5 % en Chine ;
- celle des nouveaux Etats membres de l'UE représente 20 % du niveau américain (26 % du niveau européen).
Cependant, les écarts de coûts salariaux sont tels que la compétitivité-coût du secteur manufacturier des économies avancées est inférieure à celle des économies émergentes (colonne de droite dans le tableau ci-dessus) :
- les coûts salariaux unitaires en Inde s'établissent à 49,5 % du niveau américain ;
- à 72,4 % dans les nouveaux Etats membres de l'UE.
2. Les dynamiques de la productivité dans les secteurs manufacturiers
Le tableau n° 4 ci-dessous présente les performances de productivité du secteur manufacturier dans trois économies émergentes (Chine, Inde, les dix nouveaux Etats membres de l'Union européenne) et trois économies avancées (États-Unis, UE à 15 et Japon).
Tableau n° 4
PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE
(taux de croissance annuels
moyens)
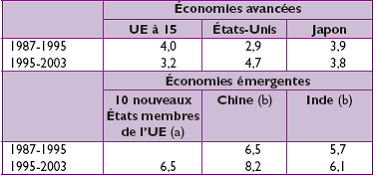
(a) Moyenne pour la République tchèque, la
Hongrie, la Pologne et la Slovaquie.
(b) Par personne employée,
1987-1994 et 1994-2002.
Sources : TCB/GGDC et base de données STAN de l'OCDE)
Le tableau ci-dessus met en évidence deux évolutions :
- la relative convergence des gains de productivité du secteur manufacturier dans les économies avancées ;
- une croissance rapide de la productivité dans les économies émergentes (comprise entre 6 et 8 %), supérieure à celle des économies avancées .
Au total, les économies avancées doivent non seulement faire face à des écarts salariaux très élevés mais aussi à une dynamique de la productivité dans les secteurs des biens échangeables qui leur est défavorable .
Dans ces conditions, lutter contre la concurrence des pays émergents à partir du seul facteur « coûts » ne parait pas constituer une stratégie adaptée .
B. LE PARADOXE DES ÉTATS-UNIS : FORTE PRODUCTIVITÉ, FAIBLE PERFORMANCE À L'EXPORTATION
L'évolution de la compétitivité américaine et de la performance à l'exportation est décrite dans le graphique ci-dessous.
Graphique n° 2
INDICATEURS DE COMPÉTITIVITÉ
(Base 100 en 1990)
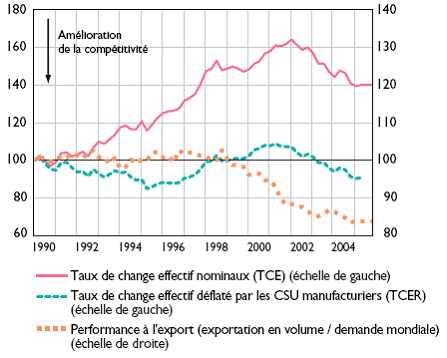
_______ Taux de change effectif nominaux (échelle de gauche)
---------- Évolution de la compétitivité
mesurée par les coûts salariaux
unitaires dans le secteur
manufacturier (échelle de gauche)
= = = = Performance à l'export (exportation en
volume/demande mondiale)
(échelle de gauche)
Source : OCDE
Celui-ci peut s'interpréter comme suit :
Le dollar s'est fortement apprécié au cours des années 90 (+60 points) puis déprécié à partir de 2001 (-20 points) - courbe en rose -.
La compétitivité du secteur manufacturier américain - mesurée par les coûts salariaux unitaires corrigés par le taux de change - a pourtant été relativement stable pendant la période d'appréciation du dollar. Puis, elle s'est sensiblement améliorée à partir de 2001 avec la baisse du dollar (courbe en tirets bleus).
La performance américaine à l'exportation - rapport des exportations en volume et de la demande mondiale adressée aux États-Unis (courbe en pointillés orange) - s'est dégradée continûment à partir de la fin des années 90.
Comment ce paradoxe peut-il s'expliquer ?
- l'amélioration de la productivité américaine pourrait concerner essentiellement le secteur des services (biens non échangeables ) ;
- par ailleurs, en matière de commerce international, les parts de marché perdues se reprennent difficilement (phénomènes « d'hystérèse ») ;
- cependant, des explications plus structurelles doivent être évoquées 26 ( * ) .
Parmi celles-ci, l'émergence de nouveaux concurrents sur le marché mondial aurait eu un impact plus important depuis 1990 que lors des précédentes vagues d'entrées de concurrents, notamment dans les années quatre-vingt.
Entre 1990 et 2004, les pays du G7 ont connu un recul très important de leurs parts de marché (près de 10 points), le gain de l'Asie émergente sur la période étant pratiquement équivalent.
La libéralisation des flux de capitaux et la baisse des coûts de transports et de communication auraient, en effet, permis de délocaliser des étapes du processus de production et non plus des secteurs d'activité entiers .
Ceci permet aux pays émergents de prendre position et d'augmenter leurs parts de marché, y compris sur des secteurs de haute technologie .
Dans les secteurs des TIC , les pays émergents développent des activités de production et d'assemblage de produits périphériques, les activités de conception des puces restant dans les pays avancés. Ceci explique la forte progression des parts de marché des pays émergents sur les produits TIC (cf. graphique ci-dessous).
Graphique n° 3
POSITIONS DE MARCHÉ SUR LES PRODUITS
TIC
(Solde TIC sur le marché mondial TIC,
en %)
1
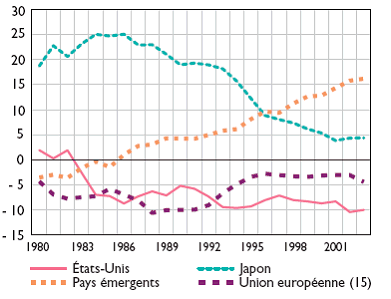
Source : CEPII CHELEM
CHAPITRE II : LES ÉCARTS DE NIVEAU DE VIE ENTRE LES PRINCIPAUX PAYS DÉVELOPPÉS : DESCRIPTION ET EXPLICATIONS
Comment s'expliquent les écarts de niveau de vie entre les principaux pays développés, et notamment entre les États-Unis, l'Europe et la France ?
La réponse réside-t-elle essentiellement dans une moindre mobilisation du facteur travail en Europe, laquelle résulterait d'une « préférence des Européens pour le loisir » ? Faut-il en déduire que la résorption des écarts de niveau de vie pourrait résulter d'une intensification du travail (« travailler plus ») et sous quelles conditions celle-ci pourrait-elle intervenir ?
Afin de répondre à ces questions, votre rapporteur rappelle ci-après quels sont les déterminants comptables de l'évolution du PIB par habitant, présente ensuite quelques « faits stylisés » permettant d' expliquer comptablement les écarts de niveau de vie entre pays développés et leur évolution depuis 1970, et propose un diagnostic s'efforçant de dépasser la simple approche comptable .
Un encadré de méthode est également présenté (page 45) qui rappelle la médiocre pertinence du PIB par habitant comme indicateur du « niveau de vie » et évoque les problèmes statistiques qui entachent d'incertitude la mesure de ces écarts.
Sur ce point, votre rapporteur - se basant sur les travaux de l'INSEE - rappelle que ces problèmes sont tels, que les écarts de niveau de vie inférieurs à 5 % en valeur absolue apparaissent trop fragiles pour pouvoir être considérés comme significatifs. C'est pourquoi ce rapport d'information n'entre pas dans le détail des performances relatives des pays européens, les polémiques que pourraient susciter ce type de travaux ayant peu de fondement économique.
Ce chapitre s'appuie notamment sur la note réalisée par la Direction des Etudes et Synthèses économiques de l'INSEE , présentée en annexe à ce rapport.
I. LES DÉTERMINANTS COMPTABLES DU PIB PAR HABITANT
Par un jeu d'identités comptables successives, on peut distinguer les quatre facteurs qui déterminent comptablement l'évolution du PIB/habitant.
Il faut partir de l'identité comptable de base rappelée en introduction à ce rapport : le PIB est égal au nombre d'emplois (l' emploi ) multiplié par la production par personne employée (c'est-à-dire la productivité ).
Cette identité s'écrit comme suit :
|
(1) PIB = emploi x productivité par tête |
La productivité par tête se décompose elle-même en productivité horaire et durée du travail.
On obtient ainsi :
|
(2) PIB = emploi x durée du travail x productivité horaire |
Si l'on veut passer au PIB par habitant , on obtient :
|
(3) PIB/habitant =
|
Le ratio emploi/nombre d'habitants peut lui-même se décomposer en :
emploi/population en âge de travailler
x population
en âge de travailler/population totale
Le ratio emploi/population en âge de travailler (c'est-à-dire la population âgée de 15 à 64 ans 27 ( * ) ) correspond au taux d'emploi .
Le ratio population en âge de travailler/population totale correspond à un ratio démographique .
Avec ces décompositions comptables successives, on aboutit à l'identité suivante :
|
(4) PIB/habitant = population en âge de
travailler/population totale x
|
Cette identité est valable en niveau comme en variation.
*
On peut donc analyser les écarts de niveau de vie et leur variation à partir de quatre facteurs :
- le facteur démographique , c'est-à-dire le rapport du nombre de personnes en âge de travailler à la population totale, c'est-à-dire le ratio de dépendance élargie qui permet une première approche sur les conditions dans lesquelles les actifs financent les dépenses de l'ensemble de la population inactive (jeunes de moins de 16 ans et personnes de plus de 65 ans).
Une dégradation de ce ratio démographique ou ratio de « dépendance élargie » pèse sur le PIB par habitant ;
- le taux d'emploi (rapport de la population ayant un emploi à la population en âge de travailler) qui prend en compte à la fois les évolutions du taux d'activité et celles du chômage (en particulier des jeunes de 16 à 25 ans ou des travailleurs de plus de 50 ans, dont la participation au marché du travail varie fortement selon les pays) ;
- la durée du travail sur l'année, qui tient compte du développement du travail à temps partiel et de la baisse de la durée du travail pour les salariés à temps complet ;
- la productivité par heure de travail , qui est en quelque sorte le résidu de cette décomposition du PIB par habitant.
Il est toutefois nécessaire de rappeler que cette approche est de nature comptable, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une décomposition ex post à partir des données statistiques disponibles.
Sa valeur explicative peut être altérée des corrélations et interactions possibles entre les divers facteurs.
La fragilité des comparaisons internationales de durée du travail rend incertain le partage des écarts de PIB par habitant en fonction de la durée du travail et de la productivité horaire.
Raisonner en productivité par actif occupé (qui regroupe ces deux composantes) permettrait de contourner cette difficulté mais conduirait à se priver d'un facteur explicatif - la durée du travail - dont on sait qu'il peut être déterminant et sur lequel on dispose malgré tout de données.
Au total, malgré les limites d'une approche strictement comptable, d'une part, et de réels problèmes de mesure, d'autre part, les faits stylisés sont suffisamment caractérisés pour être décrits ci-après.
II. UNE ANALYSE DES ÉCARTS DE NIVEAU DE VIE ENTRE PAYS DÉVELOPPÉS ET DE LEUR ÉVOLUTION
|
LE PIB PAR HABITANT, MÉDIOCRE INDICATEUR DU
NIVEAU DE VIE
Le PIB par habitant est l'indicateur utilisé pour les comparaisons internationales de niveau de vie. Il s'agit pourtant d'un indicateur médiocre qui souffre de deux faiblesses : - il ignore les composantes non monétaires du niveau de vie qui concourent pourtant au bien-être ; - il souffre de nombreux éléments de fragilité statistique. Les composantes du niveau de vie Deux individus de deux pays différents disposant d'un PIB par habitant identique (en parité du pouvoir d'achat) peuvent avoir des « niveaux de vie » très dissemblables si l'un travaille moins que l'autre, si son espérance de vie est supérieure ou s'il vit dans un environnement moins dégradé. Des efforts ont été faits depuis plusieurs années pour la prise en compte de ces autres dimensions de conditions de vie, notamment par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) avec son indicateur de développement humain (IDH). La méthode du PNUD a cependant été critiquée, notamment du fait de la pondération arbitraire des différentes composantes de l'indice. Des chercheurs ont proposé une méthodologie plus convaincante qui propose de traduire en « revenu équivalent » divers éléments du niveau de vie et de corriger en conséquence le PIB par tête 28 ( * ) . Ces éléments sont le temps de travail, l'espérance de vie en bonne santé, les inégalités, la composition des ménages 29 ( * ) (en partant de l'hypothèse qu'un ménage plus nombreux peut utiliser son revenu de façon plus efficace, car un même équipement collectif bénéficie à chacun de ses membres) ou encore la destruction des ressources naturelles (soutenabilité de la croissance). Les corrections ainsi apportées au PIB par tête en intégrant ces aspects de bien-être individuel et social conduisent à modifier les classements : le Japon et la France, par exemple, gagnent des places, tandis que les États-Unis reculent. |
|
La fragilité statistique des comparaisons par habitant La note de l'INSEE annexée à ce rapport d'information décrit les problèmes méthodologiques liés à la mesure des PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat (PPA) et à la fragilité des comparaisons des PIB par habitant qui en résulte (cf. Annexe, page 135). Certains problèmes statistiques, sources d'écarts entre les pays ont été atténués avec le récent changement de base comptable (passage en « base 2000 »), tel le traitement des dépenses de logiciels : une source de sous-estimation du PIB français et de divergence avec les États-Unis était le fait que ces dépenses y étaient traitées en consommations intermédiaires (venant en déduction de la valeur ajoutée) plutôt qu'en investissement. Néanmoins, deux difficultés principales subsistent : - la conversion du PIB en unité monétaire pour permettre les comparaisons internationales (« Parités de pouvoir d'achat ») repose sur de multiples conventions qui peuvent influencer les classements en fonction du PIB par habitant. Il faut rappeler à ce titre que les comparaisons de PIB par la méthode des Parités de Pouvoir d'Achat, publiées par EUROSTAT en 2002, s'appuyaient sur des mesures de PPA qui intégraient des hausses peu vraisemblables des prix de la construction en France, correspondant à une rupture des séries statistiques, diminuant d'autant la hausse du PIB en volume et conduisant ainsi à un fort recul du rang relatif de la France ; - par ailleurs, des divergences importantes entre les conventions comptables européennes et américaines conduisent à augmenter le niveau relatif et même de la croissance du PIB des États-Unis. On peut à ce titre citer l'exemple des dépenses en équipement militaire dont certaines sont comptabilisées comme des investissements aux États-Unis, augmentant d'autant le PIB, alors qu'elles sont considérées comme des consommations intermédiaires des administrations publiques en Europe, minorant d'autant le PIB. Ainsi « des écarts de niveau inférieurs à 5 % en valeur absolue apparaissent (...) trop fragiles pour permettre un interclassement fiable des pays » (cf. Annexe, page 135). |
A. LES ÉCARTS DE PIB PAR HABITANT EN 2004
• Le
graphique n° 4
ci-dessous décrit
les écarts de PIB par habitant par
rapport aux États-Unis en 2004
:
- le PIB/habitant français est inférieur de 22,7 % au PIB/habitant des États-Unis ;
- celui de l'Union européenne à 15 (UE-15) est inférieur de 26,2 % et celui du Japon de 25,1 % ;
- le PIB/habitant de la France est supérieur à celui de l'Allemagne ou de l'Italie, inférieur à celui du Royaume-Uni, dans des proportions toutefois trop faibles pour être significatives, compte tenu des incertitudes statistiques ;
- le PIB/habitant de l'Irlande se rapproche de celui des États-Unis, l'écart négatif étant de 6,8 % en 2004. Ce résultat doit toutefois beaucoup au poids de l'investissement étranger : en raisonnant en revenu national brut, qui ne prend en compte que la production des entreprises nationales, le RNB/habitant irlandais serait proche de la moyenne européenne ;
- le PIB/habitant de la Chine, malgré la dynamique de rattrapage engagée reste très inférieur à celui des pays développés : de l'ordre de 1/7 e de celui des États-Unis et de 1/5 e de celui de la France.
Graphique n° 4
PIB PAR HABITANT - ANNÉE 2004
ÉCART
RELATIF EN NIVEAU PAR RAPPORT AUX ÉTATS-UNIS

• Le tableau n° 5 ci-dessous décrit
les contributions comptables des quatre facteurs explicatifs
mis en évidence ci-dessus (le ratio de la population en âge de
travailler sur la population totale, le taux d'emploi, la durée du
travail et la productivité horaire) aux
écarts de niveau
de vie
.
|
Tableau n° 5
LES DÉTERMINANTS COMPTABLES
|
||||||
|
Écarts en niveau |
||||||
|
PIB/tête |
15-64 ans / population totale |
Taux d'emploi |
Durée du travail |
Productivité horaire |
||
|
France |
-22,7 |
-2,8 |
-10,7 |
-20,9 |
+12,5 |
|
|
Allemagne |
-27,5 |
-0,8 |
-7,4 |
-20,7 |
-0,5 |
|
|
Irlande |
-6,8 |
+1,6 |
-4,4 |
-9,4 |
+5,9 |
|
|
Italie |
-29,7 |
2,6 (2000) |
-19,5 (2000) |
-11,9 |
-10,3 |
|
|
Espagne |
-31,2 |
+2,5 |
-8,7 |
-1,2 |
-25,6 |
|
|
Royaume-Uni |
-20,6 |
-1,4 (2000) |
-3,9 (2000) |
-10,9 |
-10,2 |
|
|
UE-15 |
-26,2 |
+0,9 (2000) |
-12,0 (2000) |
-14,0 |
-7,9 |
|
|
Japon |
-25,1 |
-0,5 |
+5,4 |
-3,9 |
-25,7 |
|
- la contribution du facteur démographique (ratio de la population en âge de travailler à la population totale) aux écarts de niveau de vie est faible tant pour l'Union européenne que pour la France.
Le rôle des trois autres facteurs comptables est nettement plus marqué :
- le taux d'emploi « explique » près de la moitié de l'écart négatif de niveau de vie des pays européens par rapport aux États-Unis : le niveau du taux d'emploi dans l'Union européenne à 15 est inférieur de 12 %, pour un écart total de PIB/habitant de 26,2 % ; et de 10,7 % pour la France pour un écart de PIB/habitant de 22,7 %. Au Royaume-Uni et en Irlande toutefois, l'impact négatif de ce facteur est faible.
Au Japon enfin, le taux d'emploi est supérieur à celui des États-Unis.
Les niveaux de taux d'emploi relativement aux États-Unis sont décrits dans le graphique n° 5 ci-dessous.
Graphique n° 5
TAUX D'EMPLOI - ANNÉE 2004
ÉCART
RELATIF EN NIVEAU PAR RAPPORT AUX ÉTATS-UNIS
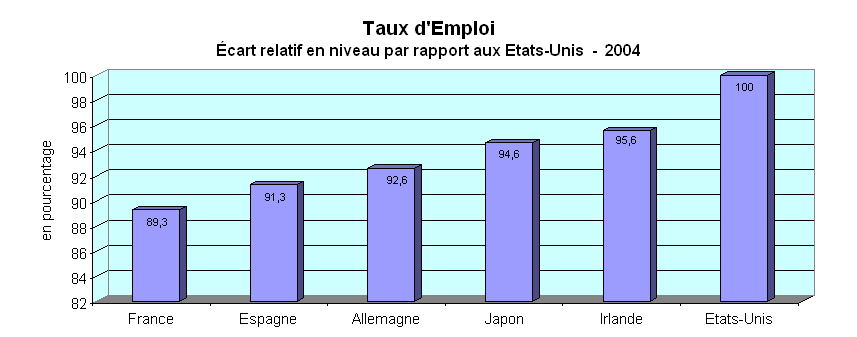
• L'impact négatif de la
durée
du travail
sur le niveau de vie comparée entre l'Union
européenne à 15 et les États-Unis est net :
- la durée du travail dans l'UE-15 est inférieure de 14 % à celle des États-Unis (pour un écart de PIB/habitant de 26,2 %) ;
- la France et l'Allemagne se situent dans une position extrême au sein de l'UE-15 avec une durée du travail inférieure respectivement de 20,9 % et 20,7 % à celle des États-Unis, presque équivalente à l'écart de PIB/habitant.
- pour l'Espagne au contraire, et le Royaume-Uni dans une moindre mesure, la durée du travail est plus proche de celle des États-Unis (respectivement -1,2 % et -10,9 %).
Les niveaux de durée du travail dans les principaux pays développés relativement aux États-Unis, sont décrits dans le graphique ci-après.
Graphique n° 6
DURÉE DE TRAVAIL - ANNÉE
2004
ÉCART RELATIF EN NIVEAU PAR RAPPORT AUX
ÉTATS-UNIS

• Le dernier déterminant comptable du niveau
de vie est le
résidu laissé inexpliqué
par les trois facteurs précédents : il s'agit de la
productivité horaire apparente du travail
.
Le graphique n° 7 ci-après décrit les niveaux de productivité de quelques pays développés relativement aux États-Unis.
Le constat est le suivant :
- le niveau moyen de la productivité horaire dans l'UE-15 était en 2004 inférieur de 7,9 % à celui des États-Unis.
- ce résultat global masque cependant des situations très contrastées : le niveau de la productivité horaire en France et en Irlande est supérieur à celui des États-Unis (respectivement +12,5 % et +5,9 %).
- le Royaume-Uni, l'Italie et surtout l'Espagne, ont une productivité horaire plus faible que celle des États-Unis (respectivement -10,2 %, -10,3 % et -25,6 %).
- La productivité horaire au Japon est également très inférieure à celle des États-Unis (-25,7 %).
Graphique n° 7
PRODUCTIVITÉ HORAIRE APPARENTE DU TRAVAIL -
ANNÉE 2004
ÉCART RELATIF EN NIVEAU PAR RAPPORT AUX
ÉTATS-UNIS
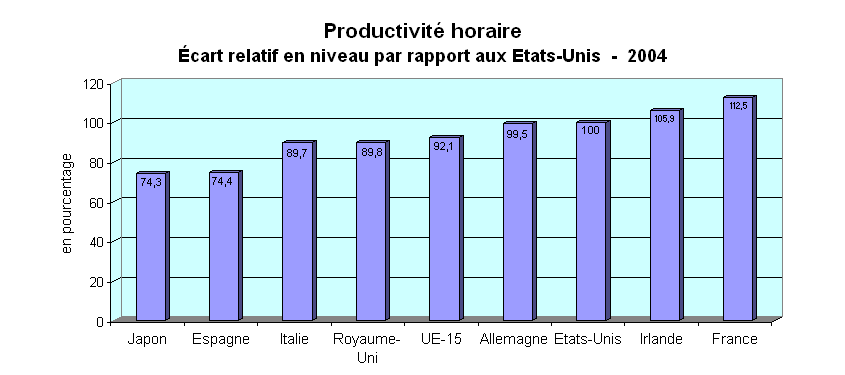
B. L'ÉVOLUTION DES ÉCARTS DE NIVEAU DE VIE (1970-2004)
Après une « photographie » des écarts de niveau de vie en 2004, votre rapporteur présente ci-après quelques données relatives à leur dynamique sur la période 1970-2004 .
1. L'évolution du PIB par habitant
Sur la période 1970-2004, la croissance annuelle moyenne du PIB par tête a été identique en Europe (UE-15) et aux États-Unis : + 2 % (+ 1,9 % pour la France).
Il en résulte que l'écart de niveau de vie entre les États-Unis et l'Europe est en 2004 sensiblement identique à celui de 1970 .
Le graphique n° 8 ci-dessous montre cependant que cette stabilisation de l'écart de niveau de vie sur l'ensemble de période résulte de plusieurs inflexions notables :
- au milieu des années 70 , le mouvement continu de rattrapage par l'Europe du niveau de vie américain, engagé après la Seconde Guerre mondiale, s'interrompt ;
- après une reprise du processus de rattrapage au tournant des années 80, une nette rupture se produit après 1983 ; il s'agit là de l'inflexion la plus marquée sur le graphique ci-dessous ;
- un nouveau décrochage se produit au début des années 90 , accentué au milieu de la décennie ;
- en fin de période ( 2001-2004 ), l'écart de niveau de vie Europe/États-Unis se creuse à nouveau .
Ces inflexions reflètent les décalages conjoncturels entre l'Europe et les États-Unis, mais le phénomène nouveau est que le PIB par tête suit dans les deux économies une trend identique alors que sur la période 1945-1970 la croissance européenne moyenne du PIB par tête était supérieure à celle des États-Unis.
On voit également que l'évolution du niveau de vie du Japon connaît les mêmes inflexions que celui de l'Europe, excepté sur la période 1980-1990 caractérisée par une forte croissance qui conduit le PIB par tête japonais au-dessus du niveau européen. Mais le décrochage des années 90 est tout aussi brutal, et le PIB par tête japonais repasse en fin de période sous le niveau européen.
Graphique n° 8
ÉVOLUTION DES PIB PAR TÊTE PAR RAPPORT AUX
ÉTATS-UNIS
FRANCE, UNION EUROPÉENNE À 15 ET
JAPON
1970-2004
(ÉTATS-UNIS = 0,00)
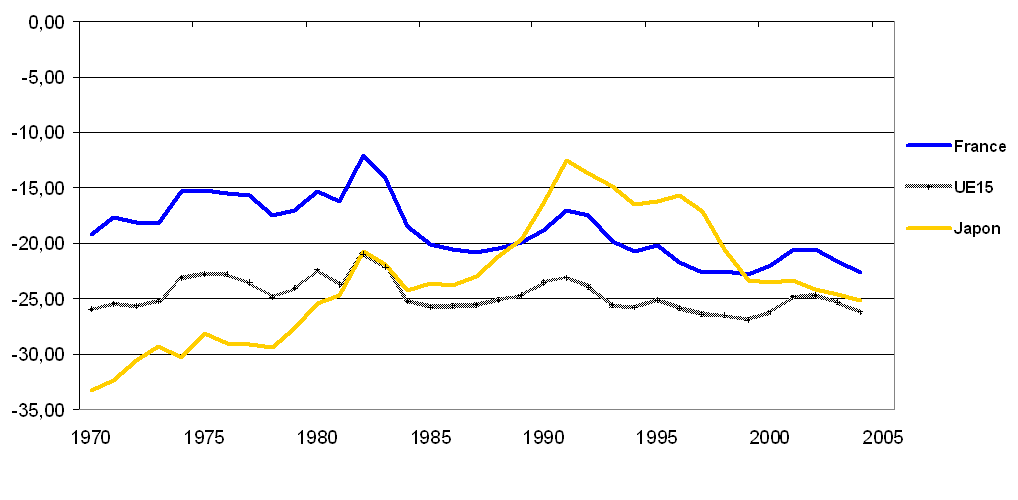
L'examen du graphique n° 9 ci-dessous qui décrit les évolutions de PIB par tête au sein de l'Union européenne appelle les observations suivantes :
Graphique n° 9
ÉVOLUTION DES PIB PAR HABITANT - PAYS
EUROPÉENS
1970-2004
(ÉTATS-UNIS = 0,00)

- le PIB/tête français se situe continûment au-dessus de celui de l'UE à 15, avec cependant un resserrement progressif de l'écart à partir des années 80 ;
- les inflexions successives dans la dynamique de rattrapage du niveau de vie américain, et plus particulièrement la rupture intervenue au début des années 80, affectent tous les pays européens représentés dans le graphique ;
- au-delà de ces inflexions communes à l'ensemble des pays européens, les circonstances propres à chacun d'entre eux influencent également l'évolution de leur niveau de vie : du fait de la réunification allemande, le niveau du PIB/tête allemand passe en dessous de celui de la France au début des années 90 ; pendant la première moitié des années 90, le PIB par tête du Royaume-Uni - pays qui n'a pas participé au processus de convergence vers la monnaie unique - rejoint le PIB par tête français et le dépasse même en fin de période ; enfin, l'évolution des PIB par tête irlandais et espagnol correspond à un processus de rattrapage, bien que d'un caractère particulier pour l'Irlande 30 ( * ) .
2. Les contributions aux évolutions des écarts de PIB par tête par rapport aux États-Unis
a) Le facteur démographique
L'impact du facteur démographique (évolution du ratio population en âge de travailler/population totale ) est au total assez secondaire. S'il « pénalise » l'Europe relativement aux États-Unis en fin de période en raison de la faible fécondité d'après le baby-boom, qui freine, à partir des années 90, la croissance des effectifs des plus de 15 ans.
Enfin, la structure démographique propre à la France ne joue qu'assez peu sur son écart de PIB par habitant par rapport aux États-Unis, d'autre part.
b) Le taux d'emploi
L'évolution du ratio emploi/population en âge de travailler (taux d'emploi) à l'écart de niveau de vie par rapport aux États-Unis obéit à une dynamique commune à tous les pays européens et au Japon :
- la montée du chômage et le raccourcissement de la vie active par ses deux extrémités expliquent la dégradation continue entre 1970 et 1995 de la contribution comptable du taux d'emploi à l'écart de niveau de vie par rapport aux États-Unis ;
- à partir de la fin des années 90, grâce à la baisse du chômage, la contribution du taux d'emploi à l'écart de niveau de vie redevient positive, sans toutefois effacer la dégradation antérieure ;
- la France est l'un des pays où l'évolution du taux d'emploi pèse le plus négativement : il génère un creusement comptable de l'écart de niveau de vie par rapport aux États-Unis de l'ordre de 17 points entre 1970 et 2004.
c) La durée du travail
Comme on le voit sur le graphique n° 10 ci-dessous, la durée du travail par personne en emploi était en Europe pratiquement équivalente à celle des États-Unis en 1970 ; en 2004, elle était inférieure de 14 %.
Pour la France, le mouvement est encore plus marqué : légèrement inférieure à celle des États-Unis en 1970 (- 4,3 %), la durée du travail est désormais inférieure de 21 %.
Même si la durée du travail a baissé au Japon relativement aux États-Unis (supérieure de 4 % en 1970 et inférieure de 4 % en 2004), cette diminution relative n'est néanmoins pas comparable dans son ampleur à celle que l'Europe a connue.
Graphique n° 10
CONTRIBUTIONS COMPTABLES À L'ÉCART DE
PIB/TÊTE PAR RAPPORT AUX ÉTATS-UNIS :
DURÉE
ANNUELLE DU TRAVAIL PAR PERSONNE EN EMPLOI
FRANCE, UNION EUROPÉENNE
À 15 ET JAPON
(ÉTATS-UNIS = 0,00)
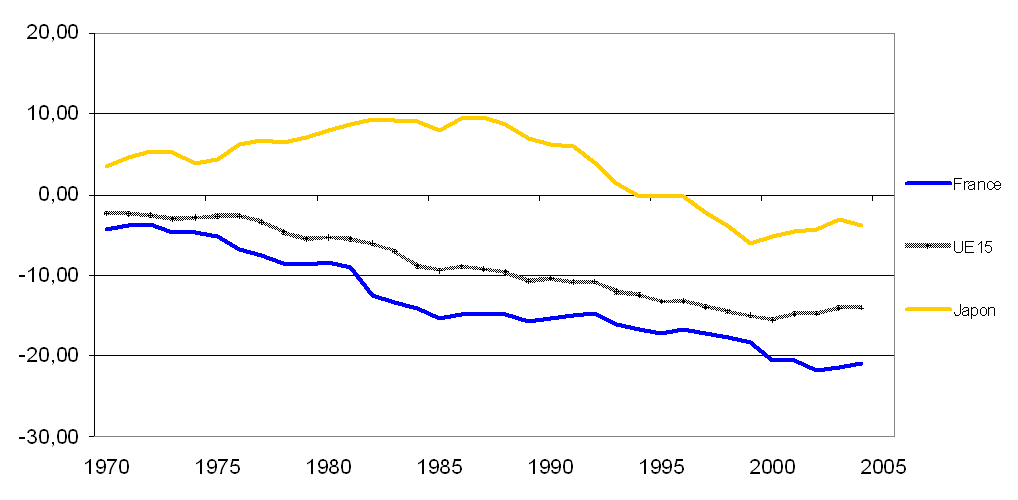
Source : GGDC et OCDE
Il est également important de noter (cf. graphique n° 11 ci-après) que tous les pays européens ont connu un mouvement de baisse de la durée du travail relativement aux États-Unis, même si elle est moins marquée pour l'Espagne ou le Royaume-Uni.
Cette baisse généralisée résulte à la fois de la montée du temps partiel et de la baisse de la durée du travail des salariés à temps complet.
La France et l'Allemagne se retrouvent aujourd'hui sur ce plan dans des positions identiques : l'effet durée du travail explique dans les deux pays près de 21 points d'écart de PIB/tête par rapport aux États-Unis.
On voit sur le graphique ci-dessous la cassure induite en France par les « 35 heures » au début des années 2000, mais qui, relativement à l'Allemagne, compense la relative stabilité de la durée du travail sur la période 1985-1995, alors que dans le même temps elle diminuait régulièrement en Allemagne.
Graphique n° 11
CONTRIBUTIONS COMPTABLES À L'ÉCART DE
PIB/TÊTE PAR RAPPORT AUX ÉTATS-UNIS :
DURÉE
ANNUELLE DU TRAVAIL PAR PERSONNE EN EMPLOI
TOUS PAYS
EUROPÉENS
(ÉTATS-UNIS = 0,00)
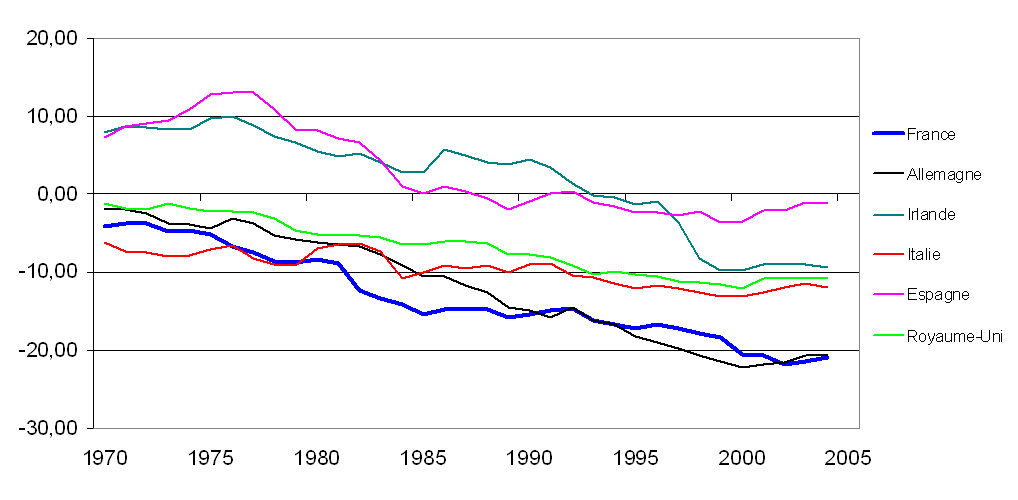
Source : GGDC et OCDE
d) La productivité horaire apparente du travail
Le quatrième déterminant, la productivité horaire, constitue le résidu inexpliqué par les trois facteurs précédents (cf. graphiques n° 12 et 13 ci-après) :
- d'un retard de l'ordre de 30 % en 1970, le niveau de productivité horaire de l'Europe relativement aux États-Unis croît régulièrement pour rejoindre le niveau américain en 1995, puis décliner depuis. Au total, sur la période 1970-2004, l'amélioration de la productivité horaire relativement aux États-Unis est de 21 % ;
- pour la France, l'évolution est encore plus accusée : le retard de productivité horaire par rapport aux États-Unis (- 21,5 % en 1970) est rattrapé au tournant des années 80 ; en 2004, la productivité horaire française est supérieure de 12,5 % à celle des États-Unis , et elle est la plus élevée de tous les pays européens représentés dans les graphiques ci-après 31 ( * ) ;
- enfin, au Japon, même si elle se redresse sur la
période 1970-2004, la productivité reste en fin de période
très inférieure au niveau
américain
(- 25,7 %).
Graphique n° 12
CONTRIBUTIONS COMPTABLES À L'ÉCART DE
PIB/TÊTE PAR RAPPORT AUX ÉTATS-UNIS :
PRODUCTIVITÉ
HORAIRE DU TRAVAIL PAR PERSONNE
FRANCE, UNION EUROPÉENNE À 15
ET JAPON
(ÉTATS-UNIS = 0,00)
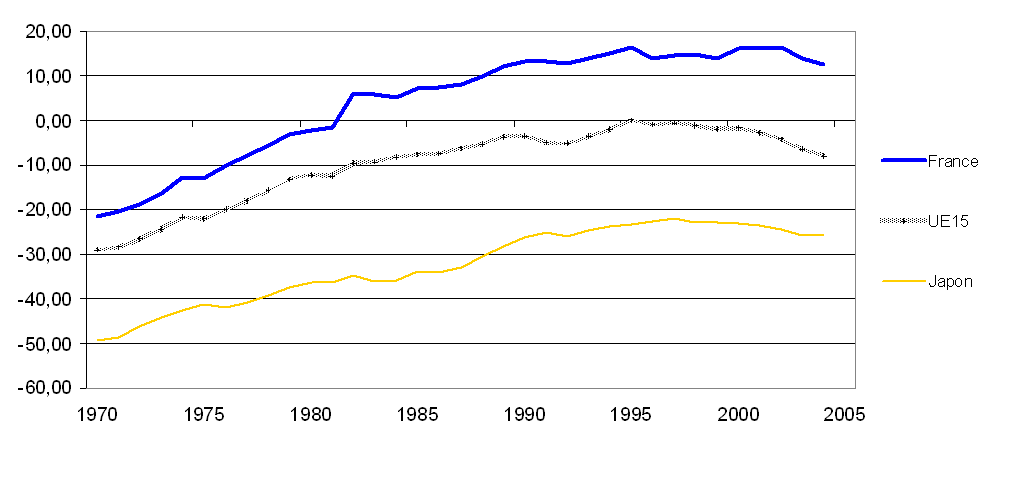
Graphique n° 13
CONTRIBUTIONS COMPTABLES À L'ÉCART DE
PIB/TÊTE PAR RAPPORT AUX ÉTATS-UNIS :
PRODUCTIVITÉ
HORAIRE DU TRAVAIL PAR PERSONNE
TOUS PAYS
EUROPÉENS
(ÉTATS-UNIS = 0,00)
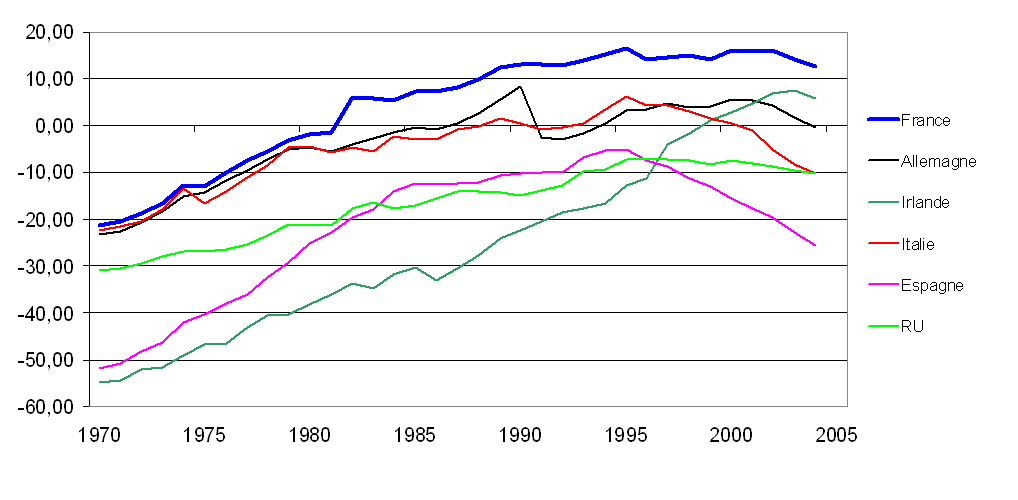
L'hypothèse d'un « modèle européen » qui combine forte croissance de la productivité horaire et baisse de la durée du travail , dont la France propose la version plus marquée, se dessine ainsi nettement.
III. QUELS ENSEIGNEMENTS ?
A. LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE L'ANALYSE COMPTABLE
Malgré les incertitudes méthodologiques et statistiques décrites ci-dessous (cf. encadré), quelques enseignements de l'analyse des déterminants comptables de l'écart de niveau de vie entre l'Europe et les États-Unis, telle qu'elle a été développée ci-dessus, peuvent être privilégiés :
1 - Entre 1970 et 2004 : l'écart de niveau de vie entre l'Europe et les États-Unis s'est peu modifié (de l'ordre de 26 %) 32 ( * ) .
2 - Les contributions comptables à cet écart de niveau de vie ont cependant nettement évolué entre ces deux dates . En 1970, le différentiel de productivité horaire expliquait l'essentiel de l'écart de PIB/habitant. En 2004, le niveau de la productivité horaire européenne a presque rattrapé celui des États-Unis (93 %), mais la durée du travail, et dans une moindre mesure le taux d'emploi, ont baissé relativement aux États-Unis.
3 - La France offre une version particulièrement marquée du « modèle européen » .
La productivité horaire y a dépassé le niveau américain (supérieure de 12,5 % en 2004), mais le taux d'emploi et surtout la durée du travail y sont nettement inférieurs (respectivement de -10,7 % et -20,9 %).
4 - Les pays européens, particulièrement ceux où la productivité est la plus élevée (Belgique, France, Allemagne...) se situeraient donc désormais à la « frontière technologique ».
5 - Cette position est toutefois fragile si l'on se réfère aux évolutions de la productivité au cours de la période 1995-2004.
L'Europe a, en effet, cessé de bénéficier d'une évolution de la productivité structurellement plus rapide que celle des États-Unis ; peut-être assisterait-on même à une inversion des tendances relatives de la productivité entre les deux économies.
6 - D'un point de vue statistique et comptable, la notion de « modèle européen » pour ce qui concerne l'évolution du niveau de vie relativement aux États-Unis est réelle mais ambiguë :
- certes, les ruptures dans le mouvement de rattrapage du niveau de vie coïncident chronologiquement dans tous les pays européens (cf. graphique n°9 page 53) ;
- néanmoins, on constate des divergences importantes entre pays quant aux contributions des différents déterminants comptables du niveau de vie.
B. AU-DELÀ DE L'ANALYSE COMPTABLE, UN AUTRE DIAGNOSTIC ?
Le diagnostic qui se dégage de l'analyse comptable semble clair : l'Europe a quasiment rattrapé le niveau technologique - mesuré par la productivité horaire - des États-Unis, mais l'écart de niveau de vie persiste en raison du faible nombre total d'heures travaillées en Europe 33 ( * ) (qui résulte à la fois d'un plus faible taux d'emploi et d'une durée du travail par personne employée plus faible).
Autrement dit, si le nombre d'heures travaillées par personne en Europe était resté le même 1 , le niveau de vie y serait aujourd'hui identique à celui des États-Unis.
L'analyse des déterminants comptables du niveau de vie dessine aussi un « modèle européen » qui relèverait d' un choix : celui de la distribution à l'ensemble de la population de la forte productivité horaire d'une population au travail restreinte, avec pour conséquence un moindre niveau de PIB par habitant comparé aux États-Unis.
Ce diagnostic souffre toutefois d'une faiblesse : il ne prend pas en considération les corrélations possibles entre les évolutions des facteurs comptables telles qu'elles ont été décrites ci-dessus. Par exemple, une forte productivité horaire peut résulter d'une faible durée du travail ou d'un faible taux d'emploi ; inversement, la faiblesse du taux d'emploi peut résulter d'une forte productivité ; ou encore, les évolutions de la productivité, de l'emploi ou de la durée du travail peuvent être le produit d'une adaptation à une faible croissance du PIB...
Ainsi, l'analyse à partir des facteurs comptables dessine des tendances suffisamment caractérisées pour devoir être prises en compte ; mais, elle doit être affinée et votre rapporteur insistera plus particulièrement sur les trois points suivants :
- l'Europe se situe-t-elle réellement à la frontière technologique ?
- le niveau de vie européen résulte-t-il d'une « préférence pour le loisir » ?
- suffirait-il aux Européens de « travailler plus » pour rejoindre le niveau de vie américain ?
1. L'Europe à la frontière technologique ?
a) Durée du travail, taux d'emploi et productivité horaire
L'analyse comptable présentée ci-dessus aboutit à la conclusion que l'Europe se situerait avec les États-Unis à la frontière technologique, c'est-à-dire au niveau technologique le plus avancé du processus productif.
Cette conclusion est toutefois contestée par divers travaux, notamment ceux menés à la Banque de France 34 ( * ) , qui soulignent que le haut niveau de la productivité horaire en Europe peut être partiellement déterminé par la faiblesse de la durée du travail et du taux d'emploi :
- concernant la durée du travail , ses rendements seraient globalement décroissants en raison d'effets de fatigue . Des travaux économétriques concordants montrent une élasticité négative de la productivité horaire à la durée du travail de l'ordre de 0,4 % 35 ( * ) .
- concernant le taux d'emploi , il apparaît que les écarts entre l'Europe continentale et les États-Unis se concentrent sur les jeunes (l'écart de taux d'emploi avec les États-Unis est de 15 et 30 points pour l'Union européenne et pour la France) et les travailleurs âgés (l'écart est d'environ 20 points). Or, la productivité des jeunes et des travailleurs âgés qui ne sont pas en emploi peut être considérée comme inférieure à celle des adultes en emploi : pour les jeunes, ceci s'explique par le déficit d'expérience ; pour les individus âgés qui ne sont pas en emploi par une obsolescence des compétences .
Les travaux de la Banque de France estiment à -0,4/0,5 l'élasticité de la productivité au taux d'emploi 36 ( * ) .
Ces travaux montrent aussi que le bon niveau européen, par rapport aux États-Unis, en termes de productivité horaire ne s'expliquerait pas uniquement par sa performance technologique mais aussi par une durée du travail plus courte et des taux d'emploi plus faibles, les moins productifs étant exclus de l'emploi.
Sur cette base, les services de la Banque de France ont calculé une productivité « structurelle » des pays européens relativement à celle des États-Unis, c'est-à-dire si la durée du travail d'une part, et les taux d'emploi d'autre part, étaient identiques à ceux des États-Unis.
Ces travaux conduisent à minorer le niveau de la productivité horaire des pays européens « à structure - de la durée du travail et de l'emploi - identique à celle des États-Unis », de respectivement 10 et 15 points 37 ( * ) environ pour l'Union européenne et la France, le niveau - relativement aux États-Unis - de la productivité structurelle par rapport à la productivité observée.
Selon cette approche, l'écart négatif de niveau de vie entre la France et les États-Unis, de l'ordre de 25 points en 2002 38 ( * ) s'expliquerait pour 7 points par une productivité « structurelle » plus faible (alors que la productivité observée est plus élevée en France), pour 10 points par une durée du travail plus faible et pour 8 points par un taux d'emploi plus faible (cf. tableau ci-dessous).
Tableau n° 6
DE LA PRODUCTIVITÉ HORAIRE AU PIB PAR HABITANT EN FRANCE, EN 2002
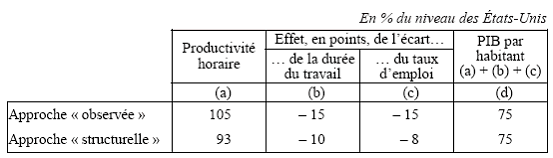
Note : l'approche « observée » suppose des rendements unitaires de la durée du travail et du taux d'emploi. L'approche « structurelle » prend en compte les rendements décroissants de la durée du travail et du taux d'emploi.
Source : Conseil d'Analyse Economique, Rapport « Productivité et croissance » (Gilbert Cette).
Ceci conduit les auteurs de ces travaux à conclure que « les niveaux plus élevés aux États-Unis qu'ailleurs de la productivité horaire structurelle indiquent que ce pays définit bien, en termes d'efficience productive, la frontière technologique dont les autres pays sont plus ou moins éloignés » 1 .
Cette conclusion est reprise dans le rapport du Conseil d'analyse économique « Productivité et croissance » (2004), les deux auteurs - Gilbert Cette et Patrick Artus - y développant ainsi l'idée que le retard de niveau de vie européen est aussi le fait d'un retard technologique structurel .
b) Substitution capital/travail et productivité
Une autre interprétation de la bonne performance apparente de l'Europe en matière de productivité du travail résiderait dans le fait que le coût du travail relativement élevé pour les travailleurs non qualifiés 39 ( * ) aurait contribué à y substituer plus rapidement qu'aux États-Unis des machines à la main-d'oeuvre.
Du coup, la productivité par tête en Europe aurait augmenté mécaniquement (moins de travailleurs pour une même production) mais celle du capital aurait diminué (plus de machines pour une même production) : la productivité globale des facteurs , qui traduit la véritable efficacité du processus de production 40 ( * ) , n'en aurait pas pour autant augmenté en Europe.
Le professeur d'économie au Massachusets Institute of Technology, Olivier BLANCHARD, estime ainsi que la productivité globale des facteurs est, en France, 10 % inférieure à celle des États-Unis 41 ( * ) .
Pourtant, cet économiste parvient au diagnostic selon lequel « les deux ajustements (en fonction du taux d'emploi et la productivité globale des facteurs) conduisent à une évaluation moindre de la productivité européenne relativement à celle des États-Unis. Mais l'Europe en général, et la France en particulier, restent dans des échelles de niveaux de productivité proches de celui des États-Unis » .
*
Ce propos vient pour le moins nuancer celui des économistes français cités ci-dessus... Quelle conclusion en tirer ?
Peut-être, selon votre rapporteur, que la thèse d'un retard technologique structurel important de l'Europe et de la France est excessive ; mais qu'après l'interruption du processus de rattrapage technologique des États-Unis au cours des années 80, les années 90 ont fragilisé la position européenne , du fait d'un déficit d'innovation dont les raisons seront analysées dans le troisième chapitre de ce rapport.
Et, aussi, qu'il est secondaire de trancher définitivement sur la position de l'Europe par rapport à la frontière technologique mais qu'il est essentiel, pour les politiques publiques, de considérer qu'une position ou un avantage technologiques ne sont jamais acquis et que les politiques publiques qui permettent de maintenir ou d'améliorer cette position doivent sans cesse être mobilisées ; ce que les pays européens ont certainement négligé depuis le début des années 90, comme votre rapporteur s'efforcera de le montrer dans le quatrième chapitre.
2. Une préférence européenne pour le loisir ?
Beaucoup de travaux universitaires ont cherché à expliquer la différence de niveau de PIB par habitant entre les États-Unis et l'Europe.
Robert J. GORDON, professeur d'économie à Northwestern University, considère ainsi qu'une part importante de l'avantage américain est consacré au maintien de conditions de vie acceptables et comparables à celles des européens, dans un environnement naturel beaucoup plus hostile (nécessitant une consommation et une production plus importantes d'énergie pour le chauffage et la climatisation), aux services de transport liés aux distances et au gigantisme des zones urbaines américaines et aux services de sécurité dans un environnement plus criminogène 42 ( * ) .
D'autres auteurs 43 ( * ) considèrent que les systèmes fiscaux rendent le travail plus coûteux que le loisir en Europe, et expliquent ainsi les différences en termes d'offre de travail entre l'Europe et les États-Unis.
Ou encore que les accords de partage du travail « défensifs » dans les secteurs en déclin n'ont pas créé d'emploi, mais ont rendu plus rentable l'allongement des vacances et des loisirs grâce à un effet multiplicateur social.
Toutes ces explications contiennent certainement leur part de vérité, mais celle qui a recueilli le plus d'écho en Europe et suscité le plus de commentaires est celle d'Olivier BLANCHARD 44 ( * ) , par ailleurs économiste américain, réputé connaître le fonctionnement des économies européennes : le niveau plus faible du PIB/habitant en Europe résulterait d'une « préférence pour le loisir ».
La forte augmentation de la productivité horaire y aurait permis une baisse de la durée du travail, ce qui se traduit par une moindre progression de la productivité par tête et donc du revenu (qui évolue globalement en ligne avec la productivité par tête. Les salariés européens auraient ainsi préféré bénéficier de plus de loisir au détriment de leur revenu.
Si comptablement les évolutions de la durée du travail, de la productivité horaire et du revenu ainsi décrites sont compatibles avec les statistiques présentées ci-dessus, la notion de « choix » ou de « préférence » prête cependant à discussion, ne serait-ce que parce qu'elle dessine une réalité prédéterminée pour l'Europe dans les décennies à venir, qui rendrait vain l'espoir d'un rattrapage du niveau de vie américain.
Certes, selon Olivier BLANCHARD, le choix de plus de loisirs pour moins de revenu est économiquement rationnel : le travail est une ressource rare et le loisir a donc une valeur économique ; si l'on mesurait la valeur implicite de l'heure de loisir à partir du salaire horaire, le PIB par habitant de l'Europe serait équivalent à celui des États-Unis.
Toutefois, ni la volonté ni la capacité des salariés européens d'imposer leur préférence pour le loisir ne sont claires :
- la diminution du nombre d'heures travaillées par habitant par rapport aux États-Unis ne résulte-t-elle pas avant tout de la hausse du chômage à partir du milieu des années 70, de la baisse des taux d'emploi liée aux mesures d'exclusion de la population active de certains publics (dispositifs de préretraites, par exemple), ou du développement du temps partiel subi ?
Olivier BLANCHARD montre néanmoins dans sa contribution que la diminution, relativement aux États-Unis du nombre d'heures travaillées par habitant résulte presque exclusivement de la réduction de la durée du travail par salarié à temps plein .
- la baisse du nombre d'heures travaillées par habitant en Europe n'est-elle pas la conséquence du système fiscalo-social qui pèse sur l'offre du travail ?
Olivier BLANCHARD conteste également cet argument en prenant l'exemple de l'Irlande où la taxation du travail a peu évolué entre 1970 et 2000, où elle ne peut être considérée comme pénalisante comparativement aux États-Unis et où la durée du travail par travailleur a pourtant diminué comme la moyenne de l'Union européenne (- 25 % sur la période 1970-2000).
Il en déduit que le rôle de la fiscalité est secondaire dans la baisse du nombre d'heures travaillées par tête entre 1970 et 2000 45 ( * ) .
Cependant, comme toute explication monocausale, la thèse d'une « préférence européenne pour le loisir » a le défaut de masquer une réalité européenne moins uniforme et plus complexe :
- la notion d'un modèle européen unique qui proposerait un arbitrage caractéristique, et différent du modèle américain, entre productivité du travail et intensité du travail, est trompeuse . S'il y a bien une moyenne européenne influencée notamment par les modes d'arbitrage entre productivité et durée du travail de la France et de l'Allemagne, on observe des fortes variations autour de cette moyenne : différences importantes des taux d'activité (faibles taux en Belgique ou en France, taux élevés aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves), de durée du travail (durée du travail proche du niveau américain dans les pays du sud de l'Europe, faible durée du travail en France, Allemagne ou aux Pays-Bas 46 ( * ) ) ;
- la thèse de la préférence pour le loisir peine à expliquer les évolutions intervenues en Europe à partir des années 90, caractérisées par un fort ralentissement de la productivité et une hausse des taux d'emploi (évolutions qui seront détaillées dans le chapitre III ) ;
- elle ne décrit pas comment s'exprime la préférence des salariés pour le loisir, en fonction de leur pouvoir de négociation, très différent selon les pays européens. Ainsi, en France, entre les réductions par voie législative, la durée du travail est stable ;
- enfin, elle ne permet pas de comprendre pourquoi les pays européens, avec des marchés du travail, une durée du travail et un niveau de productivité pourtant très différents, ont connu exactement au même moment 47 ( * ) les mêmes ruptures dans le processus de rattrapage, notamment au début des années 1980 et 1990 (cf. graphique n°10 page 55).
Ceci suggèrerait que les facteurs macroéconomiques ont été déterminants et en particulier les politiques mises en oeuvre en Europe pour contrer les poussées inflationnistes survenues à ces deux périodes. Contrairement aux États-Unis, la lutte contre l'inflation en Europe a été marquée par une longue phase d'adaptation en raison de la construction de l'union monétaire et de la poursuite d'une crédibilité anti-inflationniste.
L'hypothèse qu'un calibrage inadapté de la politique de lutte contre l'inflation ait pesé sur la croissance en Europe, freinant la croissance et induisant une hausse du chômage, et ai contraint chaque pays européen à ses propres arbitrages entre productivité, durée du travail, emploi et revenus 48 ( * ) , semble ainsi, selon votre rapporteur, sous-estimée.
3. Travailler plus ?
A partir notamment de l'analyse comptable des évolutions de niveau de vie en Europe comparativement aux États-Unis, l'idée s'est imposée qu'une mobilisation plus forte du facteur travail - grâce à une augmentation à la fois de la durée du travail et du taux d'emploi - permettrait à la fois d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés et le PIB par habitant.
Cet enchaînement, évidemment souhaitable, suppose néanmoins deux conditions :
- à court terme , une augmentation de la durée du travail se traduit instantanément par une accélération de la productivité par tête et donc une croissance moins riche en emplois. Une évolution de cette nature est donc difficilement compatible avec la situation de sous-emploi qui caractérise aujourd'hui quelques grands pays de la zone euro (Allemagne, Italie, France...) ;
- néanmoins, à moyen terme , si le taux de chômage diminue suffisamment, comme le laissent envisager les projections analysées dans un rapport d'information récemment présenté par votre Délégation 49 ( * ) , une augmentation de la durée du travail permet d'augmenter la productivité par tête, la croissance potentielle et le PIB par habitant .
Il faut d'ailleurs souligner que c'est dans une situation proche du plein-emploi, en fonction de l'arbitrage que les salariés opèreront entre plus de travail et de revenu ou plus de loisirs (et moins de productivité par tête) que pourra véritablement s'apprécier la « préférence pour le loisir ».
De même, une augmentation du taux d'emploi, et donc de la croissance potentielle et du PIB/habitant, n'est possible que si l'économie européenne évolue au voisinage de sa trajectoire de moyen-long terme ou de son potentiel. Or, actuellement, le déficit de production de l'Union européenne - par rapport à son potentiel - est évalué à 1,5 % de PIB 50 ( * ) .
Autrement dit, les politiques consistant à intensifier le recours au facteur travail ont un impact à moyen terme sur la croissance potentielle et le PIB par habitant. Mais à court terme, si les politiques macroéconomiques de régulation conjoncturelle ne permettent pas un retour de l'économie européenne à son potentiel, ces politiques de mobilisation du facteur travail ont un coût transitoire en termes de chômage.
Par ailleurs, la productivité horaire diminue avec le nombre d'heures travaillées en raison d'effets de fatigue, et avec le taux d'emploi - les entreprises ayant mobilisé en priorité les travailleurs les plus productifs -. Cela signifie que travailler plus longtemps ou (re)mettre des gens au travail entraîne, au moins de manière transitoire, une baisse de niveau de production horaire moyen.
Avoir plus d'emplois ou plus d'heures travaillées contribue certes à une augmentation du PIB par habitant mais ne suffit pas : il faut que l'Europe tire pleinement parti de technologies plus productives et d'une organisation du travail qui permette leur mise en oeuvre.
Ce propos est résumé par un éminent spécialiste des questions de productivité, Bart van Ark, Professeur à l'Université de Groningue : « A plus longue échéance, toutefois, les différentiels de productivité entre pays ne s'expliquent pas, au premier titre, par une carence d'effort de travail, mais par une sous-performance du capital et de la technologie ».
Ce qui pourrait trivialement se résumer en disant que l'Europe - et la France - a besoin non pas seulement de plus de travail, mais de plus de travail productif .
Votre rapporteur abordera dans le quatrième chapitre les voies par lesquelles cette condition pourrait être remplie.
CHAPITRE III : ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE LA PRODUCTIVITÉ : L'EUROPE ET LA FRANCE DÉCROCHENT-ELLES ?
Depuis 1970 jusqu'au milieu des années 90, l'Union européenne à 15 (UE à 15) a quasiment rattrapé le niveau de productivité horaire (PIB par heure travaillée) des États-Unis. Certains pays européens (France, Pays-Bas, Belgique,...) l'ont même dépassé.
Ce résultat est cependant trompeur : il ne signifie pas forcément que l'Europe a rejoint le niveau technologique des États-Unis. La productivité du travail y est en effet dopée par une moindre durée du travail et par une moindre mobilisation des travailleurs les moins qualifiés, particulièrement chez les jeunes et les personnes de plus de 55 ans.
Néanmoins, il ne fait aucun doute que l'Europe a connu depuis 1945 un processus de rattrapage technologique qui l'a nettement rapprochée de l'efficacité productive américaine.
Mais il ne fait non plus aucun doute que ce processus s'est ralenti dans les années 80, et surtout qu'il s'est interrompu, et peut être inversé à partir du milieu des années 90.
Quelques données chiffrées peuvent illustrer ce propos : sur la période 1987-1995, le rythme de progression annuelle de la productivité horaire en Europe était de 2,3 %, il est passé à 1,4 % sur la période 1995-2004. Pour les États-Unis, sur les deux mêmes périodes, il est passé de 1,1 % à 2,5 %. Cela signifie que le rapport relatif des croissances de productivité a été multiplié par quatre, en faveur des États-Unis .
Faut-il en déduire que le potentiel de progression des niveaux de vie respectifs de l'Europe et des États-Unis s'en trouve durablement - structurellement - modifié ? Après le rattrapage des États-Unis par l'Europe sur la période 1945-1975, puis la stabilisation de l'écart sur la période 1970-2000, une nouvelle période de creusement des écarts de niveau de vie vient-elle de s'ouvrir ?
La réponse à ces questions dépend de l'explication de la double inflexion des rythmes de productivité - ralentissement en Europe, accélération aux États-Unis - que l'on retient.
Les travaux d'analyse sur cette question se sont multipliés au cours des dernières années. Ils ont considérablement fait progresser la compréhension des déterminants de la productivité dans les économies avancées, mais ils sont complexes et parfois contradictoires .
Dans l'interprétation qui en est proposée ci-après, votre rapporteur s'efforcera de rester fidèle à l'objectif de clarification et de compréhension des phénomènes macroéconomiques qui est celui de votre Délégation, au risque de simplifications parfois excessives.
La première partie du chapitre sera consacrée à une présentation des évolutions intervenues depuis 1995, afin de rappeler la problématique.
La deuxième partie sera consacrée à une tentative d'explication globale , à partir du rôle des Technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les processus en cours.
La troisième partie en sera consacrée à une analyse des évolutions sectorielles de la productivité , afin de montrer le rôle généralement attribué à certaines activités de services dans les ruptures observées depuis 10 ans.
La quatrième partie sera consacrée aux évolutions observées en France , afin d'apprécier l'impact des politiques d'enrichissement du contenu en emplois de la croissance sur le ralentissement de la productivité.
La cinquième partie proposera un diagnostic global , à partir de l' analyse des évolutions les plus récentes (depuis 2000), afin d'apprécier la réalité et l' ampleur des ruptures de tendance de la productivité aux États-Unis et en Europe et d'en déduire les questions de politique économique qu'elles soulèvent.
*
I. LA DOUBLE INFLEXION DES RYTHMES DE PRODUCTIVITÉ DEPUIS LES ANNÉES 1990 : RAPPEL DES FAITS
A. LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE LA PRODUCTIVITÉ DANS LE MONDE
Comme on peut le lire sur le tableau n° 7 ci-dessous, la productivité horaire du travail au cours des années 90 connaît des inflexions marquées et différenciées selon les pays :
Tableau n° 7
TAUX DE CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ HORAIRE DU
TRAVAIL
1987 - 2004
|
PIB par heure travaillée |
|||
|
1987-1995 |
1995-2004 |
dont 2000-2004 |
|
|
UE-15 (a) |
2,3 |
1,4 |
1,1 |
|
Allemagne |
3,1 |
1,9 |
1,3 |
|
Autriche |
2,3 |
2,4 |
1,3 |
|
Belgique |
2,3 |
1,6 |
1,3 |
|
Danemark |
2,1 |
1,7 |
1,9 |
|
Espagne |
2,1 |
0,0 |
0,2 |
|
Finlande |
2,8 |
2,5 |
2,2 |
|
France |
1,9 |
1,8 |
1,9 |
|
Grèce |
0,8 |
2,7 |
2,8 |
|
Irlande |
4,0 |
4,7 |
3,5 |
|
Italie |
2,0 |
0,4 |
-0,2 |
|
Luxembourg |
2,6 |
2,0 |
1,2 |
|
Pays-Bas |
1,6 |
0,4 |
0,4 |
|
Portugal |
2,8 |
1,4 |
0,3 |
|
Royaume-Uni |
2,1 |
2,0 |
2,0 |
|
Suède |
1,4 |
2,4 |
2,4 |
|
UE-25, élargie (b) |
- |
1,8 |
1,6 |
|
États-Unis |
1,1 |
2,5 |
2,9 |
|
Japon |
2,8 |
2,1 |
1,9 |
|
Inde (c) |
3,7 |
3,9 |
3,1 |
|
Chine (c) |
4,7 |
6,1 |
6,8 |
(a) Se rapporte aux États membres de l'Union
européenne jusqu'au 30 avril 2004.
(b) Se rapporte à
l'ensemble des membres de l'Union européenne depuis mai 2004
(c)
Productivité exprimée en termes de PIB par personne
employée.
Sources : TCB/GGDC Total Economy Database, à partir des statistiques de l'OCDE sur les comptes nationaux et la main d'oeuvre.
- aux États-Unis, la productivité horaire accélère à partir de 1995, puis connaît une seconde accélération à partir de 2000.
Votre rapporteur reviendra ci-après sur cette double accélération, qui a été présentée par de nombreux économistes comme la confirmation du caractère « structurel » du regain de productivité américaine, mais qui doit pourtant être regardée avec précaution ;
- dans un grand nombre de pays à l'inverse, la productivité horaire ralentit une nouvelle fois au cours des années 90 - après le ralentissement des années 80 -. Ce ralentissement s'observe dès le début des années 90 pour certains pays (France et Japon en particulier 51 ( * ) ) mais la plupart du temps à partir de 1995. Il est très marqué pour l'ensemble de l'UE à 15 ;
- certains pays ne connaissent pas d'inflexion marquée au cours des années 1990. En Europe, on retrouve notamment dans cette situation : le Royaume-Uni, l'Irlande, la Suède ou la Grèce. Ailleurs, le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande ; c'est-à-dire d'un côté des pays qui poursuivent leur rattrapage (Irlande, Grèce) ou d'un autre côté des pays qui, comme l'ont souligné nombre de travaux, ont conduit des réformes importantes sur les marchés des biens et du travail (Suède, Canada, Royaume-Uni en particulier) ;
- enfin, certains pays émergents (la Chine, en particulier) connaissent une accélération continue , même si le niveau de la productivité y est encore très éloigné de celui des États-Unis (14 % du niveau américain pour la Chine et pour ce qui concerne la productivité par personne employée).
Il en résulte que les États-Unis, qui définissaient déjà la frontière technologique avant les années 1990, sont parmi les pays de l'OCDE celui où la productivité horaire progresse le plus vite 52 ( * ) , creusant ainsi leur avantage par rapport à l'Union européenne.
B. COMMENT APPRÉCIER LA PERFORMANCE FRANÇAISE ?
La performance française en matière de productivité horaire se distingue de celle de la moyenne de l'Union européenne :
- comme on le voit sur le tableau n° 7 ci-dessus, il n'y a pas de rupture dans le rythme d'évolution de la productivité horaire sur les trois périodes 1987-1995 (+1,9 %), 1995-2004 (+1,8 %), 2000-2004 (+1,9 %) ;
- à partir de 1995, le rythme de la productivité horaire française est nettement supérieur à celle de la moyenne de l'UE à 15 ;
- enfin, si l'on veut à la fois tenir compte du fait que le ralentissement en France s'est produit au début des années 1990 et que l'accélération américaine est récente, et donc raisonner sur une perspective plus longue, c'est-à-dire sur la période 1990-2004, on constate que la productivité horaire en France augmente au même rythme qu'aux États-Unis (+1,9 %).
Au regard de ces éléments, la situation française par rapport aux États-Unis ne semble donc pas défavorable .
Elle est cependant fragile :
- comme on le voit sur le graphique n° 14 ci-dessous, pour la période 1991-2005, on observe à partir de 2003 un freinage de la productivité horaire française par rapport aux États-Unis.
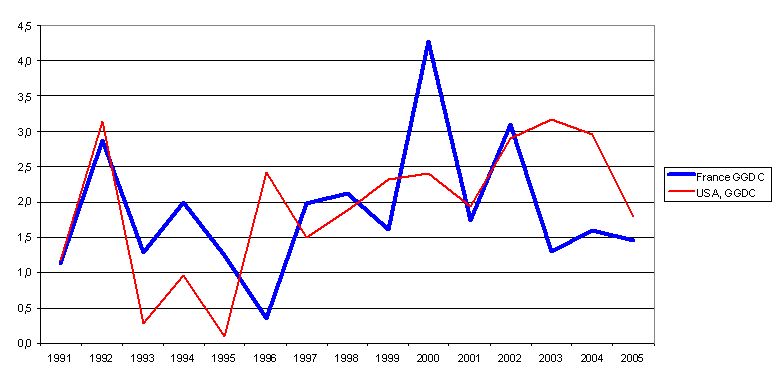
Graphique n° 14
CROISSANCE ANNUELLE DE LA PRODUCTIVITÉ PAR HEURE
TRAVAILLÉE,
FRANCE ET ÉTATS-UNIS
Source : GGDC
- en outre, sur la fin des années 1990, la bonne tenue de la productivité horaire française qui apparaît sur le graphique ci-dessus est, pour partie, un effet induit de la baisse de la durée du travail , puisqu'il est admis que la réduction de la durée du travail - en particulier lors du passage aux 35 heures - s'accompagne de son intensification.
Hors réduction de la durée du travail, les performances françaises en matière de productivité horaire se rapprocheraient donc de la moyenne européenne.
C. LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES DANS UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE : UNE PÉRIODE ATYPIQUE ?
Dans une perspective historique longue, l'accélération américaine ou le ralentissement européen - votre rapporteur s'appuiera plus précisément sur l'exemple de la France ci-après - doivent être relativisés :
- aux États-Unis, malgré son accélération à partir de 1995, la progression de la productivité par employé (2,02 % par an) est nettement plus faible que celle de 1922-1967 (2,54 %). Dans le secteur marchand non agricole, l'évolution de la productivité horaire de 1995 à 2002 (2,16 % par an) est peu supérieure à celle d'avant le premier choc pétrolier (2,09 %) ;
- en France, la croissance de la productivité par tête sur la période 1990-2002 (1,1 % par an) reste encore deux fois plus forte que celle observée sur le demi-siècle qui a précédé la Seconde Guerre mondiale et puis les Trente Glorieuses.
Cette mise en perspective montre que :
- la période récente ne se caractérise ni par des gains de productivité historiquement forts aux États-Unis ni particulièrement faibles en France (et en Europe) ;
- et si la « révolution technologique » liée aux TIC a bien engendré une accélération de la productivité aux États-Unis, elle n'a rien d'atypique. Seule la période de l'entre-deux-guerres aux États-Unis (la « grande vague ») ou celle de l'après-Seconde Guerre mondiale jusqu'au choc pétrolier en Europe (1945-1975, les « Trente Glorieuses ») restent atypiques du point de vue des évolutions de la productivité et du progrès technique.
II. QUEL EST LE RÔLE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) DANS LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE LA PRODUCTIVITÉ ?
A. L'EFFET DES TIC SUR LA PRODUCTIVITÉ
L'acronyme TIC regroupe les matériels informatiques, les logiciels et les matériels de communication, c'est-à-dire à la fois des technologies déjà anciennes comme les ordinateurs et des technologies plus modernes, comme la téléphonie mobile ou tout ce qui est lié à l'Internet.
L'appréciation de l'importance de la « révolution technologique » portée par les TIC, comparativement aux précédentes révolutions technologiques, telles que la machine à vapeur (sur la période 1830-1860) ou l'électricité (de 1899 à 1929), a fait débat.
Un spécialiste de l'histoire de la croissance, R. GORDON, a ainsi minimisé l'ampleur des effets des TIC. Cependant, des travaux plus récents qui semblent désormais faire autorité 53 ( * ) , ont montré que la contribution des TIC à la croissance et la productivité serait depuis 1995 supérieure à celle de la machine à vapeur ou de la diffusion de l'électricité.
Les TIC permettent d'accélérer les gains de productivité au travers de trois mécanismes :
une
substitution entre facteurs de
production
- des matériels TIC se substituant à des
travailleurs - permet d'élever la productivité du travail. Il
s'agit-là d'un mécanisme d'intensification capitalistique
« classique »
-
capital deepening
-,
renforcé par
la baisse des prix relatifs des matériels
TIC
;
les secteurs producteurs de TIC connaissent des gains rapides de production globale des facteurs (PGF) , ou « progrès technique » ; ces gains de PGF dans les secteurs producteurs de TIC s'expliquent par le fait que les gains de performance des matériels TIC étant très rapides, la mesure de leurs prix liée à cette amélioration de la qualité n'évolue pas aussi rapidement, de sorte que le partage volume-prix de la production est plus favorable au volume que pour d'autres biens de services ;
des gains de PGF dans les secteurs non producteurs de TIC sont liés aux « effets de réseau » : la diffusion des TIC élève les performances des TIC déjà diffusées auprès des ménages et des entreprises.
Il est nécessaire de souligner que, jusqu'à présent, ce troisième effet fait plus l'objet d'une présomption que de mesures significatives.
Enfin, même si cet effet est voisin ou englobe celui qui précède, il est généralement admis que l'investissement en TIC renforce certes la productivité du travail au travers de l'intensité capitalistique, mais qu'il stimule aussi le progrès technique dans les secteurs non producteurs de TIC , dans la mesure où il constitue un soutien puissant de l'innovation (en particulier de l'innovation non technologique, c'est-à-dire organisationnelle). Cet aspect sera analysé plus loin à propos des gains importants de productivité observés dans certains services marchands aux États-Unis.
B. UNE ANALYSE DE L'IMPACT DES TIC SUR LA PRODUCTIVITÉ AU COURS DE LA PÉRIODE RÉCENTE
L'analyse présentée ci-après décompose les évolutions de la productivité selon la méthode de la comptabilité de la croissance .
Pour la rappeler de manière très simplificatrice, l'augmentation de la productivité du travail y est séparée entre l' augmentation du rapport capital/travail (ou intensité capitalistique qui traduit l'amélioration de l'efficacité de chaque travailleur du fait de l'augmentation de la quantité de machines à sa disposition) et l' augmentation de la productivité (PGF) , (résidu qui traduit l'efficacité de la combinaison productive).
Les deux termes sont ensuite séparés entre intensité capitalistique en TIC et hors TIC, et PGF dans les secteurs producteurs de TIC et PGF dans les autres secteurs.
Ces décompositions sont statistiquement fragiles et leur solidité dépend de multiples conventions. Cette approche offre néanmoins une méthodologie simple qui peut servir de point de départ pour déterminer les contributions des diverses sources de la croissance. Enfin, les différents travaux qui utilisent ce type de méthode parviennent à des conclusions convergentes .
1. Une comparaison Europe/États-Unis
Le tableau ci-après montre les résultats de calculs effectués sur la base de la méthode présentée ci-dessus.
Tableau n° 8
SOURCES DE LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DU
TRAVAIL
DANS L'UE-15 ET AUX ÉTATS-UNIS
1987-2004
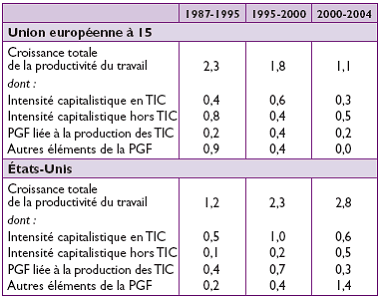
Source : van Ark et Inklaar (2005)
Trois conclusions principales s'en dégagent :
- l'intensité en capital TIC ainsi que la PGF dans les secteurs producteurs de TIC ont augmenté à la fois aux États-Unis et en Europe ;
- cette double augmentation a été toutefois nettement plus forte aux États-Unis qu'en Europe. L'Europe a notamment affiché un retard par rapport aux États-Unis en matière de renforcement de l'intensité capitalistique en TIC sur toutes les périodes ;
- l'accélération de la PGF dans les secteurs non producteurs de TIC a été continue aux États-Unis, surtout après 2000 (+1,4 % sur 2000-2004) ; inversement, en Europe, le ralentissement s'est accentué, la croissance de la PGF hors TIC étant même nulle après 2000.
A priori , la principale source de l'écart Europe/États-Unis - la PGF hors secteurs producteurs de TIC - ne concerne pas les TIC. Toutefois, même s'il faut être extrêmement prudent sur ce point, qu'aucune mesure statistique ne vient corroborer définitivement, une partie de la croissance plus rapide et de l'accélération de la PGF hors production des TIC aux États-Unis pourrait être due à de plus forts effets de diffusion liés à l'utilisation des TIC (qu'en Europe).
2. Une comparaison France/États-Unis
Le tableau ci-dessous présente une comparaison France/États-Unis des évolutions de productivité et de l'impact des TIC, dans la période récente.
Tableau n° 9
CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE ANNUELLE
MOYENNE
DE LA PRODUCTIVITÉ HORAIRE DU TRAVAIL
ENSEMBLE DE
L'ÉCONOMIE - EN % ET EN POINTS
|
FRANCE |
ÉTATS-UNIS |
|||
|
1980-1995 |
1995-2004 |
1980-1995 |
1995-2004 |
|
|
PIB |
2,56 |
2,25 |
2,99 |
3,30 |
|
Productivité horaire |
2,48 |
1,87 |
1,33 |
2,36 |
|
Intensité capitalistique, dont : |
1,08 |
0,71 |
0,67 |
1,11 |
|
Total TIC |
0,23 |
0,39 |
0,50 |
0,70 |
|
Autres capital |
0,84 |
0,33 |
0,17 |
0,42 |
|
Productivité globale des facteurs |
1,40 |
1,16 |
0,65 |
1,25 |
Source : Cette, Mairesse et Kocoglu (2006)
Les conclusions que l'on peut en tirer sur les différences entre la France et les États-Unis sont globalement identiques à celles résultant de la comparaison entre l'Union européenne et les États-Unis.
La France présente cependant deux spécificités par rapport à la moyenne européenne :
- le ralentissement de l'intensité capitalistique hors TIC (c'est-à-dire de la substitution du capital non TIC au travail), à partir de 1995, y est beaucoup plus marqué que dans l'ensemble de l'Europe , sans doute en bonne partie du fait de la mise en oeuvre de politiques d'enrichissement du contenu en emplois de la croissance ;
- le ralentissement de la PGF et l'écart avec les États-Unis sur la période 1997-2004 y sont moins marqués que pour la moyenne de l'Union européenne. Toutefois, cette meilleure performance résulte pour partie de la réduction de la durée du travail, de sorte que « structurellement » - c'est-à-dire à évolution de la durée de travail équivalente à celle de la moyenne de l'Union -, l'évolution de la PGF française s'éloignerait peu de celle de l'UE à 15.
*
Cette analyse de l'impact des TIC sur la productivité et l'écart de performance global entre l'Europe et les États-Unis depuis 1995, conduit votre rapporteur à proposer deux conclusions :
- la production et la diffusion des TIC sont favorables aux gains de productivité et à la croissance. Cet impact favorable est d'autant plus fort que le poids des activités productrices de TIC et la diffusion des TIC sont importants ;
- le retard européen et français sur ces deux volets ( production et diffusion ) est pénalisant par rapport aux États-Unis et explique la meilleure performance globale de ce pays en matière de productivité depuis 1995.
Les facteurs explicatifs de ce retard seront évoqués dans la partie V de ce chapitre (« quel diagnostic? »).
III. ÉVOLUTIONS SECTORIELLES DE LA PRODUCTIVITÉ AUX ÉTATS-UNIS ET EN EUROPE : QUELLES DIVERGENCES ?
La partie précédente a permis de mettre en évidence l'impact des TIC dans les divergences d'évolution de la productivité aux États-Unis et en Europe.
Toutefois, elle n'apporte pas de conclusion définitive sur les raisons de l'évolution plus rapide, aux États-Unis, de la productivité globale des facteurs (ou « progrès technique ») dans les secteurs non producteurs de TIC. Certes, une présomption se dégage : celle d'une moindre diffusion des TIC en Europe, à l'origine d'une moins bonne performance en termes de productivité globale des facteurs.
Une analyse sectorielle permet d'explorer cette hypothèse : la capacité d'absorption en TIC est variable selon les secteurs et a des incidences diverses en termes de production et de productivité. Il en résulte que les opportunités d' innovation induites par les TIC peuvent être exploitées de manière très différente selon les secteurs.
Par ailleurs, une approche sectorielle est utile car elle peut permettre d'identifier les secteurs moins performants en Europe et, ainsi, de mieux approcher les causes de cette sous-performance 54 ( * ) .
A. LE RÔLE DES SERVICES DANS L'AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ AUX ÉTATS-UNIS
Le tableau ci-dessous permet d'identifier les sources sectorielles d'écarts de performance de productivité entre l'Union européenne et les États-Unis :
Tableau n° 10
CONTRIBUTIONS SECTORIELLES À LA CROISSANCE
DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL DANS LE SECTEUR MARCHAND - DE 1987
À 2003
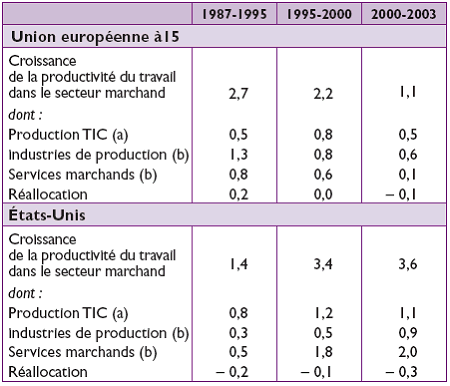
(a) Comprend la production de TIC, les services de
télécommunication et ceux liés aux logiciels.
(b)
Industrie manufacturière hors industries productrices de TIC
Source : van Ark et Inklaar (2005)
- le secteur producteur de TIC contribue plus fortement aux États-Unis qu'en Europe à la hausse de la productivité ; ceci s'explique plus par la part plus importante des secteurs producteurs de TIC dans la valeur ajoutée américaine (12,6 %) que dans la valeur ajoutée européenne (5,3 %) - « effet intersectoriel ») -, que par un différentiel de productivité dans les secteurs des TIC entre les États-Unis et l'Europe - « effet intrasectoriel » - ;
- le secteur manufacturier - hors production de TIC - joue un rôle mineur dans le différentiel de progression de la productivité du travail entre l'Europe et les États-Unis ;
- l'essentiel du différentiel Europe/États-Unis ainsi que de l'accélération de la productivité aux États-Unis s'explique par la contribution des services marchands . Cet écart va en outre en s'aggravant : à partir de 2000, la contribution des services marchands à la croissance de la productivité dans l'ensemble de l'économie est pratiquement nulle en Europe, alors qu'elle progresse aux États-Unis.
B. LE RÔLE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES DANS L'ÉCART DE PRODUCTIVITÉ EUROPE/ÉTATS-UNIS
Selon la base de données élaborée par l'université de Groningue avec l'aide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui permet de comparer les différentiels de productivité par branches de l'économie (cf. tableau n° 11 ci-après), il apparaît que l'essentiel de l'écart États-Unis/Europe est concentré dans trois des 56 branches. Comme l'expliquent les auteurs de cette étude, « trois branches, à elles seules, expliquent toute la différence dans les grains de productivité : le commerce de gros, le commerce de détail et les services financiers » 55 ( * ) .
R. GORDON ajoute même : « Les différences (entre les États-Unis et l'Europe) de taux de croissance de la productivité dans les 53 branches restantes sont soit légèrement positives, soit légèrement négatives, leur somme étant nulle » 56 ( * ) .
Tableau n° 11
LA PRODUCTIVITÉ
HORAIRE SELON LES BRANCHES
TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DE LA
PRODUCTIVITÉ HORAIRE ENTRE 1995 ET 2002
(PIB PPA EN DOLLARS
2002)
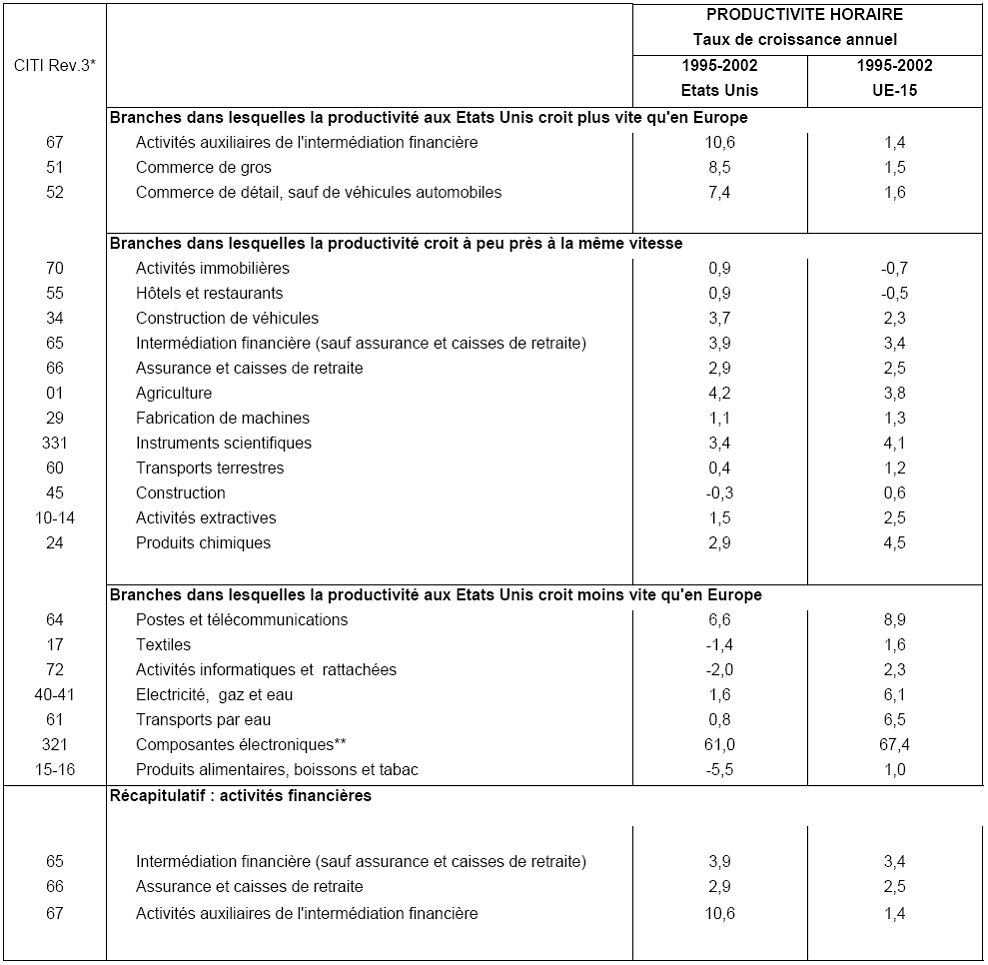
Source : Gröninguen Database (2005)
Depuis 1995, la source de l'écart d'évolution de la productivité entre l'Europe et les États-Unis réside moins dans le renforcement de l'intensité capitalistique en TIC que dans l'augmentation de la productivité globale des facteurs (PGF) 57 ( * ) .
Les causes d'une moindre augmentation du « résidu » que constitue la PGF sont par nature très difficiles à établir. Mais l'hypothèse selon laquelle cette moindre augmentation de la productivité serait la conséquence d'un déficit d'innovation est souvent évoquée 58 ( * ) .
Concernant les trois branches qui connaissent une forte augmentation de la productivité aux États-Unis, et plus particulièrement les commerces de gros et de détail, ce déficit d'innovation résulterait ainsi de mécanismes complexes qui interagissent les uns avec les autres.
Dans un souci de simplification, ces mécanismes peuvent être schématisés comme suit :
- l'utilisation productive des TIC permet de stimuler la PGF : le commerce de détail a ainsi bénéficié de l'introduction des codes-barres, qui facilitent l'encaissement mais aussi l'organisation de la chaîne d'approvisionnement ;
- la diffusion des TIC stimule les innovations en termes d'organisation, d'amélioration des connaissances (innovations dites non technologiques) : cet effet pourrait être présent, par exemple, dans le secteur bancaire américain ;
- la diffusion des TIC permet aussi une diffusion de l'innovation entre les fournisseurs de production (de machines, d'ordinateurs...), les entreprises de services et leurs clients.
Les estimations pour les États-Unis montrent une accélération de la croissance de la productivité dans les services qui dépendent le plus de l'innovation apportée par les fournisseurs dans les services marchands.
Autrement dit, les meilleures performances de productivité aux États-Unis résulteraient d'une sorte de « chaîne de l'innovation » : celle-ci répond à la demande des clients (ou la stimule), est mise en oeuvre par les entreprises des secteurs concernés et est proposée par les fournisseurs de capital TIC ou de main d'oeuvre capable d'utiliser ce capital TIC.
Pour d'autres économistes cependant, l'absence de preuve de l'existence de tels mécanismes les conduit à rejeter l'explication par un « déficit d'innovation », spécifique à l'Europe 59 ( * ) :
- les difficultés de mesure de la productivité dans les services rendent les comparaisons internationales particulièrement fragiles (cf. ci-après) ;
- la meilleure performance des États-Unis dans les secteurs du commerce ne serait en réalité qu'un rattrapage du retard pris avant 1995.
Dans le commerce de détail, la productivité augmentait ainsi au rythme de 2,1 % par an en Europe entre 1985 et 1995, contre 1,4 % par an aux États-Unis.
L'accélération de la productivité dans ce secteur intervenue aux États-Unis à partir de 1995 (+ 7,4 % par an de 1995 à 2001) résulterait de l'arrivée de nouveaux magasins géants et, de la disparition de près de 25 % du nombre de points de vente entre 1995 et 2001, alors que la productivité des magasins ayant « survécu » a stagné.
Ceci conduit les mêmes auteurs à se demander si un phénomène de concentration du secteur commercial comparable à celui des États-Unis constituerait un véritable progrès pour l'Europe, en termes de bien-être collectif.
C. LES LIMITES DES COMPARAISONS SECTORIELLES DE PRODUCTIVITÉ
Certains des travaux les plus avancés sur la productivité, comme ceux conduits par la Banque de France, ne se basent que sur les comparaisons de productivité agrégées pour l' ensemble de l'économie , considérant que les comparaisons sectorielles internationales reposent sur des statistiques dont la qualité n'est pas suffisante.
En effet, les comptables nationaux européens ne disposent pas des moyens, au contraire des États-Unis, pour produire des statistiques sectorielles fiables.
En outre, compte tenu de l'externalisation croissante des tâches par le secteur manufacturier, les partages sectoriels aussi bien de l'emploi que de la production sont sujets à caution : les services d'intérim, qui emploient 700.000 personnes dont la moitié dans l'industrie, constituent sur ce point l'exemple le plus connu.
Mais le doute le plus important sur l'ampleur et la nature de l'écart récent de productivité entre l'Europe et les États-Unis repose sur les difficultés de mesure de la productivité dans les services , liées notamment à l' utilisation accrue des TIC .
Tout d'abord, le partage de la valeur de la production entre leur prix et leur quantité (ou volume) est difficilement applicable à des activités de services où l'élément « quantité » n'apparaît pas clairement (comment mesurer la productivité d'un médecin, d'un orchestre ou d'un cabinet comptable ?).
Par ailleurs, la diffusion des TIC a accéléré l'évolution de la qualité de nombreux services , alors que la production en valeur correspondante est souvent mesurée par les salaires des employés qui ont produit ce service.
Or, si l'amélioration de la qualité de ces services était correctement mesurée, cela conduirait à diminuer leur prix et à augmenter leur volume , donc à augmenter la productivité.
Des améliorations ont été apportées notamment aux États-Unis, pour estimer le « changement de qualité » d'un produit par les méthodes hédoniques : elles utilisent une fonction mathématique dont les variables sont les « caractéristiques » que ce produit possède. Le cas le plus souvent mentionné est celui des ordinateurs et les caractéristiques retenues sont notamment : la vitesse de processus, la capacité de la mémoire vive ou celle du disque dur... Dans l'industrie automobile, également, différentes caractéristiques sont prises en compte pour estimer la qualité et donc l'évolution du prix des voitures.
Mais si ces techniques présentent une certaine solidité pour la production de biens manufacturés, elles sont moins adaptées à la production de services. Les dimensions d'une activité de service sont en effet complexes, du concept au type d'interface avec la clientèle ou au système de distribution.
Pour conclure sur ces questions qui font l'objet d'une abondante littérature, votre rapporteur se contentera de quatre observations :
- d'une manière générale, les TIC ont rendu obsolètes les méthodes d'estimation de la productivité dans les services. On peut considérer qu'elles ont abouti, globalement, à une sous-estimation de la production et de la productivité des services dans l'ensemble des pays développés ;
- de nouvelles méthodes ont toutefois été mises en place, notamment aux États-Unis, pour apprécier la qualité des services. Il faut ainsi remarquer que parmi les changements comptables intervenus aux États-Unis, certains concernent le secteur de l'intermédiation financière, secteur où précisément on observe une forte croissance de la productivité aux États-Unis (relativement à l'Europe).
Cependant, en dépit de cet exemple souvent cité par ceux qui contestent l'ampleur de l'écart de productivité entre les États-Unis et l'Europe, il semble qu'il n'existerait cependant « aucun signe indiquant clairement que ce biais (de mesures qui conduisent à sous-estimer la productivité dans les services) soit plus important en Europe qu'aux États-Unis 60 ( * ) ».
Compte tenu des difficultés méthodologiques décrites ci-dessus, il apparaît plus « sûr », ainsi que le fait la Banque de France, de ne raisonner que sur des comparaisons de productivité pour l'ensemble de l'économie . (Cette idée sera plus longuement développée dans la Ve partie de ce chapitre ).
IV. LE RALENTISSEMENT DE LA PRODUCTIVITÉ PAR EMPLOYÉ EN FRANCE DEPUIS 1995 : UNE ILLUSTRATION DU PARADIGME EUROPÉEN
Parmi les pays européens, la France est certainement celui où les politiques « d'enrichissement du contenu en emploi de la croissance », qui macroéconomiquement reviennent à freiner l'évolution de la productivité par employé, ont fait l'objet du consensus théorique et politique le plus marqué, et où elles ont donné lieu à la mise en oeuvre du dispositif le plus complet et le plus volontariste.
Certes, à partir du début des années 1990, tous les pays européens ont cherché à lutter contre la persistance du chômage au moyen de ce type de mesures.
Mais la France se caractérisait aussi par un contenu en emploi de la croissance plus faible que ses partenaires européens : pour un taux de croissance donné, elle créait moins d'emplois, non pas dans l'industrie mais surtout dans les services.
Les premières mesures d'allègement des charges sociales et d'abaissement du coût du travail se sont ainsi appuyées sur les rapports préparatoires du XIe Plan 61 ( * ) (lois du 27 juillet puis du 20 décembre 1993, instaurant une exonération totale ou partielle des cotisations familiales jusqu'à 1,3 SMIC).
Depuis, de nombreux dispositifs ont été mis en place :
- le premier type de dispositifs est celui des allègements de charges liés à la réduction du temps de travail. Leur coût pour les finances publiques est évalué à l'équivalent de 0,5 point de PIB environ et leur impact estimé à 300.000 emplois supplémentaires (fin 2002) par la Direction de la Prévision et de l'Analyse économique du Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie (MINEFI). Ces mesures ont été réellement efficaces puisqu'elles ont permis de stabiliser la part de l'emploi non qualifié dans l'emploi total, alors que celui-ci avait baissé entre 1982 et 1992 (de 28 % de l'emploi total à 23,5 %).
Elles auraient entraîné au niveau macroéconomique une diminution de 1,23 % de la productivité par employé .
- le deuxième type de dispositifs concerne la réduction du temps de travail (RTT) . L'impact de ce dispositif fait l'objet de multiples controverses. Si l'on retient l'évaluation qui en est donnée par la Direction de la Prévision et de l'Analyse économique, soit 300.000 emplois créés (pour un coût de finances publiques équivalent à 0,8 point de PIB), il faut considérer qu'au niveau macroéconomique, la RTT a abaissé la productivité par employé de 1,25 % ;
- un troisième type de dispositif concerne les emplois aidés dans le secteur non marchand (contrats emploi solidarité - CES -, « emplois jeunes », ...). Du fait que ces emplois sont soit à temps partiel, soit rémunérés au niveau du SMIC (soit moins de la moitié du coût salarial moyen des autres emplois du secteur non marchand), ces dispositifs contribuent à abaisser comptablement la productivité par tête 62 ( * ) , d'environ 0,5 % ;
- enfin, les dispositifs de déduction fiscale pour les ménages employant des personnes à domicile ont contribué à « blanchir » des emplois auparavant non déclarés.
Les comptables nationaux prennent en compte, autant que possible, les activités non déclarées dans l'évaluation du PIB, mais peu ou pas les emplois correspondants. Le « blanchiment » d'emplois non déclarés dans le secteur des services à domicile se serait ainsi traduit, au niveau macroéconomique, par un abaissement d'environ 1 % de la productivité par employé .
Ainsi, au total, sur la période 1992-2002, le niveau de la productivité par employé aurait été abaissé de 4 % par la mise en place de ces dispositifs, soit 0,4 % par an en moyenne .
L'augmentation de la productivité par employé observée sur la période a été de 1,1 % par an. Sans les dispositifs d'enrichissement du contenu en emplois de la croissance rappelés ci-dessus, la productivité par employé aurait été, toutes choses égales par ailleurs, de : 1,1 % + 0,4 % = 1,5 %.
Ce rythme aurait toutefois traduit une inflexion par rapport à la période 1980-1992 63 ( * ) . Les dispositifs d'enrichissement du contenu en emplois de la croissance n'expliqueraient que la moitié environ du ralentissement des gains de productivité observés en France sur la décennie 1992-2002 par rapport à la période 1980-1992.
L'autre moitié du ralentissement observé de la productivité s'expliquerait par d'autres facteurs. Dans le rapport du Conseil d'analyse économique « Productivité et croissance » (2004), Gilbert CETTE conclut l'analyse de l'évolution récente de la productivité en France en émettant une hypothèse que votre rapporteur analysera ci-après (cf. Ve partie) : « Une piste qui ne peut être écartée est celle d'une contradiction croissante entre certaines rigidités structurelles, par exemple réglementaires, et le besoin plus important de flexibilité et d'adaptabilité d'une croissance profondément transformée par des mutations profondes, par exemple technologiques comme la diffusion toujours plus importante des TIC ».
V. QUEL DIAGNOSTIC ?
Les évolutions de la productivité du travail depuis le milieu des années 90 décrivent-elles un décrochage de l'Europe et de la France - par rapport aux États-Unis - qui pourrait se traduire à terme par une diminution du potentiel de croissance de l'Europe, une baisse de sa performance économique relative, une dégradation de sa compétitivité et un nouveau creusement de l'écart de niveau de niveau de vie par rapport aux États-Unis ?
1) Il est tout d'abord nécessaire de rappeler que le ralentissement de la productivité observé en Europe au cours des années 90 s'inscrit dans un processus continu , depuis la fin des « Trente Glorieuses » (cf. graphique ci-dessous) et le premier choc pétrolier.
Graphique n° 15
PRODUCTIVITÉ HORAIRE
« OBSERVÉE » ET « STRUCTURELLE »
DANS LA ZONE EURO
(TAUX DE CROISSANCE ANNUELS MOYENS)
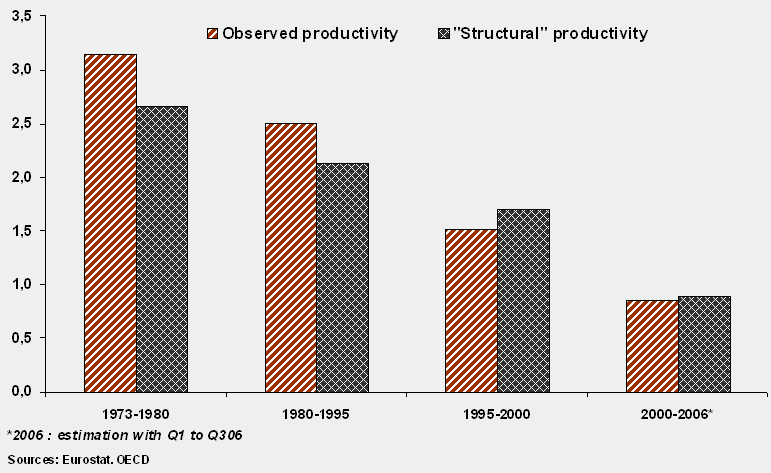
Note : La productivité « structurelle » corrige la productivité observée des effets de l'évolution de la durée du travail et du taux d'emploi (une hausse du taux d'emploi de 1 % entraîne une baisse de 0,4 % de la productivité horaire et une baisse de 1 % de la durée du travail entraîne une hausse de 0,4 % de la productivité horaire).
Source : EUROSTAT, OCDE
Ce graphique dément l'idée d'une brusque inadaptation des structures de production européennes, par exemple, à la mondialisation ou à l'évolution des conditions de la production.
Il confirme cependant l'idée de la difficulté de l'Europe à passer d'un modèle d'imitation , caractéristique d'une économie en phase de rattrapage, à un modèle d'innovation continue , qui lui permettrait de se maintenir au voisinage de la « frontière technologique » 64 ( * ) .
2) Nombre d'éléments et de données
présentés dans le débat public
- et qui ont
été analysés dans ce chapitre - donnent néanmoins
à penser qu'on assisterait à une
inversion des tendances
relatives
de la productivité entre l'Europe et les
États-Unis, plutôt qu'à la convergence qui aurait dû
normalement entraîner la fin du processus de rattrapage
européen.
Mais, comme le conclut la note de l'INSEE annexée à ce rapport d'information (....), « il est encore un peu tôt pour valider totalement cette (...) thèse. Le suivi régulier des performances des deux ensembles géographiques n'en apparaît que plus nécessaire ».
Votre rapporteur a ainsi pu bénéficier des travaux menés par les services de la Banque de France sur les évolutions les plus récentes de la productivité dans la zone Euro et aux États-Unis.
Ceux-ci donnent une idée des tendances à l'oeuvre dans la mesure où la productivité observée y est corrigée à la fois des effets de la variation de la durée du travail et du taux d'emploi (concept de productivité « structurelle ») et des effets du cycle économique 65 ( * ) (cf. tableau n° 12 ci-après).
Ces travaux relativisent tout d'abord le diagnostic d' une double accélération de la productivité aux États-Unis à partir de 2000 (après celle de 1995) 66 ( * ) .
On observerait plutôt un ralentissement structurel de la productivité aux États-Unis sur la période 2000-2004, bien que masqué - statistiquement - par une baisse à la fois de la durée du travail et du taux d'emploi, qui stimulent la productivité observée.
Comme on peut le voir sur le tableau n° 12, l' écart structurel d'évolution annuelle de la productivité entre l'Europe et les États-Unis serait en 2006 de 0,5 point (1,7 % aux États-Unis contre 1,2 % dans la zone euro) 67 ( * ) .
|
Tableau n° 12 CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ HORAIRE EN 2005-2006 |
||||
|
États-Unis |
Zone euro |
|||
|
2005 |
2006 |
2005 |
2006 |
|
|
Productivité observée |
1,5 |
1,5 |
0,7 |
1,3 |
|
Productivité observée corrigée
|
1,9 |
1,7 |
0,9 |
0,9 |
|
Productivité « structurelle » 1 |
1,7 |
1,7 |
0,8 |
1,7 |
|
Productivité structurelle corrigée des effets du cycle |
1,8 |
1,7 |
1,1 |
1,2 |
1 C'est-à-dire la productivité corrigée des effets de la durée du travail et du taux d'emploi.
Sources : OCDE, BOURLÈS et CETTE (2006)
Cet écart est donc nettement moins important qu'au cours de la deuxième moitié des années 90 et inférieur à celui que la majorité des économistes prenaient en compte dans leurs analyses.
Ce résultat résout aussi en grande partie les divergences sur la réalité et l'ampleur du différentiel de croissance de la productivité horaire, entre par exemple la Commission européenne qui met l'accent sur la dégradation supposée, relativement aux États-Unis, de la performance européenne en matière de productivité 68 ( * ) et le Fonds Monétaire International (FMI) , selon lequel « la zone euro n'aurait pas de problème de productivité » 69 ( * ) .
Toutefois, la persistance d'un écart d'évolution de la productivité structurelle entre les États-Unis et l'Europe - fût-il moindre que ce que la productivité observée dans les deux économies pouvait laisser supposer -, laisse subsister une question essentielle : traduit-il simplement le délai de mise en oeuvre d'adaptations qui conduiront prochainement la zone euro à rattraper le rythme américain d'évolution de la productivité, ou résulte-t-il d'une difficulté propre à la zone euro à mettre en oeuvre ce processus d'adaptation, du fait notamment d'institutions et de réglementations inadaptées ?
3) Répondre à cette question suppose tout d'abord de reprendre les conclusions les plus solides sur l'analyse des écarts de productivité entre les États-Unis et l'Europe qui a été développée dans ce chapitre :
- le ralentissement de la productivité en Europe est lié aux politiques volontaristes d'enrichissement du contenu en emploi de la croissance, mais en partie seulement ;
- l'accélération de la productivité aux États-Unis, en valeur absolue comme relativement à l'Union européenne, s'explique en grande partie par le rôle joué par les TIC :
• L'investissement en matériels TIC (« intensité capitalistique en TIC ») a constitué une source d'accélération de la productivité en Europe comme aux États-Unis (par un processus classique de substitution de capital TIC au travail), mais cet effet a été plus fort aux États-Unis qu'en Europe (il expliquerait 0,3 à 0,4 point d'écart de gain de productivité entre les États-Unis et l'Europe sur la période 1995-2004).
• Une part importante du ralentissement de la
productivité en Europe relativement aux États-Unis s'explique par
le ralentissement, absolu et relatif, de la productivité globale des
facteurs (PGF), « résidu », qui traduit
l'efficacité de la combinaison productive et mesure le progrès
technique, et se trouve ainsi
au coeur de la performance
économique
.
Le différentiel d'évolution
de la PGF entre l'Europe et les États-Unis peut s'interpréter
comme un
déficit d'innovation en Europe
. Ce
déficit d'innovation pourrait lui-même résulter - au moins
pour partie - d'une
moindre diffusion des TIC
, en particulier
dans les secteurs du commerce.
Même si cette explication reste
à étayer solidement, divers travaux ont avancé
l'hypothèse que des rigidités plus importantes sur les
marchés des biens et du travail pourraient expliquer la moindre
diffusion des TIC dans l'économie européenne et constituer ainsi
une source d'écart du dynamisme de la productivité entre les
États-Unis et l'Europe - et la France
70
(
*
)
.
4) Une autre hypothèse permettant d'expliquer l'écart de productivité Europe/États-Unis est de nature moins structurelle et n'est pas toujours très développée par les spécialistes des questions de productivité.
Les grands pays de la zone euro sont confrontés depuis les années 80 à la persistance du chômage . Cette situation pourrait avoir pesé sur les comportements des entreprises. Deux mécanismes peuvent ainsi être identifiés :
- le premier suppose que les politiques publiques d'enrichissement du contenu en emploi de la croissance aux États-Unis ont non seulement un effet direct - négatif - sur la productivité grâce à l'abaissement du coût du travail non qualifié (ralentissement de la substitution capital/travail), mais aussi un effet indirect résultant de la contrainte implicite exercée par les pouvoirs publics sur les entreprises pour qu'elles maintiennent l'emploi 71 ( * ) : les entreprises seraient peu motivées pour mettre en oeuvre des innovations dont la contrepartie pourrait être des réductions d'effectifs.
- un lien positif est assez clairement établi 72 ( * ) entre des taux élevés d'entrées et de sorties d'entreprises, pour un secteur d'activité, et l' accélération de la productivité . Un ralentissement de l'activité imputable à la faiblesse de la demande, surtout s'il est durable 73 ( * ) , freine les mouvements d'entrées et de sorties des entreprises du marché, et plus globalement l'esprit d'entreprise .
*
L'accélération de la productivité aux États-Unis à la fin des années 90 a reposé sur un développement de l'innovation, basée plus sur une refonte des processus de production permise par les fonctionnalités nouvelles offertes par les avancées technologiques que par une automatisation de ces processus. Les facteurs décisifs de la croissance de la productivité résideraient ainsi dans la souplesse et l'adaptabilité des entreprises et de la main d'oeuvre .
La manière dont l'amélioration du capital humain (éducation), la levée d'obstacles réglementaires ou un environnement macroéconomique plus favorable pourraient y contribuer est analysée dans le quatrième chapitre .
CHAPITRE IV : VIEILLISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE, NIVEAU DE VIE ET PRODUCTIVITÉ : QUELLES PERSPECTIVES ?
Le chapitre précédent a permis d'ouvrir la réflexion sur les sources de l'écart de productivité entre les États-Unis et l'Europe (notamment la diffusion des TIC et leur impact sur les innovations de toute nature) ainsi que sur les politiques publiques susceptibles de résorber cet écart et de soutenir l'innovation et la productivité (éducation, recherche et développement, déréglementation des marchés des biens et du travail,...).
Ces aspects sont explorés ci-après à partir de la problématique du vieillissement démographique et de son impact négatif sur la progression du PIB/tête, et en se basant plus spécifiquement sur le cas de la France.
I. QUEL IMPACT DU VIEILLISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE SUR LE NIVEAU DE VIE ?
A long terme, l'évolution du PIB par tête est déterminée par quatre facteurs :
- le facteur démographique constitué par le ratio population en âge de travailler (15 à 64 ans) sur population totale ;
- le taux d'emploi ;
- la durée du travail ;
- la productivité horaire.
A. L'IMPACT DE L'ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE SUR LA CROISSANCE DU PIB PAR TÊTE
Sur la période 1980-2004, la croissance du PIB par habitant en France s'est établie à 1,6 % par an en moyenne (1,75 % pour la moyenne de l'UE à 15).
La contribution du ratio démographique (rapport 15-64 ans/population totale) sur cette période a été nulle , ce qui revient à dire que la croissance de la population totale et celle de la population d'âge actif ont été identiques.
Le graphique ci-dessous , présente la contribution en points de croissance de l'évolution du ratio population 15-64 ans/population totale, à l'évolution du PIB par tête depuis 1970, et à l'horizon 2050 sur la base des dernières révisions des projections de population présentées par l'INSEE (qui se basent notamment sur une augmentation plus forte de la fécondité par femme - 1,9 enfant - et du solde migratoire 74 ( * ) ).
Graphique n° 16
CONTRIBUTIONS EN POINTS DE CROISSANCE
DE
L'ÉVOLUTION DU PIB PAR TÊTE POUR LA FRANCE
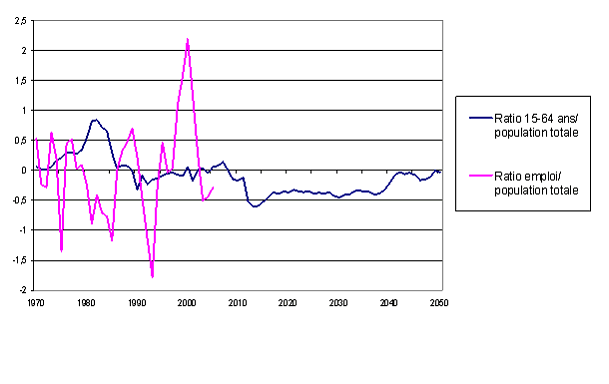
On peut voir dans le graphique ci-dessus que la contribution du ratio démographique à la croissance du PIB par tête sur les trente prochaines années serait négative à hauteur de 0,4 point de croissance par an en moyenne.
En effet, à partir de 2010-2011, le passage à 65 ans des premiers « baby-boomers » entraîne une accélération du nombre des 65 ans (dénominateur du ratio) et un freinage de la croissance des 15-64 ans (numérateur du ratio).
Toutefois, l'impact du ratio démographique (population 15-64 ans/population totale sur la croissance du PIB par tête) pourrait à l'avenir être de nouveau modifié par des révisions démographiques, comme celles qui sont intervenues en juillet 2006.
L'impact du ratio démographique qui était de -0,5 point de croissance potentielle annuelle du PIB par tête selon les anciennes projections, a été ramené à -0,4 point à partir de des nouvelles projections démographiques 75 ( * ) .
Les dernières évaluations démographiques de l'INSEE, notamment sur la hausse du taux de fécondité à 2 enfants par femme, renforcent la probabilité de révisions de cette nature 76 ( * ) .
B. LES VARIATIONS DU TAUX D'EMPLOI
Le taux d'emploi constitue un déterminant de l'évolution du niveau de vie.
Votre rapporteur présente ci-après les conditions dans lesquelles une hausse du taux d'emploi pourrait diminuer ou inverser l'impact négatif sur l'évolution du niveau de vie de la dégradation du ratio démographique (population 15-64 ans/population totale).
a) Les liens entre croissance et taux d'emploi
Le graphique n° 16 (page précédente) montre une forte variation des taux d'emploi (courbe en rose) depuis 1970.
Il apparaît ainsi que ces variations sont nettement corrélées avec celles de la croissance : les périodes de croissance soutenue (fin des années 80 et fin des années 90) entraînent de fortes hausses du taux d'emploi, les périodes de ralentissement (notamment le début des années 90) de fortes baisses.
Ceci tend à montrer qu'une part du « sous-emploi » (entendu ici au sens large, c'est-à-dire comme la combinaison d'un fort chômage et d'un faible taux d'emploi) français sur cette période est déterminée par une croissance effective inférieure à son potentiel .
b) Évolution démographique et taux d'emploi
Le ralentissement de l'augmentation de la population active, liée au vieillissement démographique, pèse sur l'évolution du PIB par habitant.
Cependant, ce ralentissement crée aussi des conditions plus favorables pour une baisse du chômage (donc une hausse du taux d'emploi) : à moyen terme, si la croissance française rejoint son potentiel (2,2 %), les créations d'emploi (175.000 par an en moyenne 77 ( * ) ) seraient supérieures au nombre de nouveaux actifs : 100.000 par an en moyenne contre 180.000 actifs sur 1995-2005 78 ( * ) .
c) Hausse du taux d'emploi et productivité
Des estimations économétriques montrent la relation inverse entre taux d'emploi et productivité : une hausse du taux d'emploi de 1 % entraînerait une baisse de la productivité horaire de 0,4 à 0,5 % 79 ( * ) .
Cependant, cet effet est transitoire et diverses études empiriques montrent qu'il disparaîtrait en moins de cinq ans : l'augmentation du taux d'emploi doit donc être un objectif constant de politique publique.
La réforme des retraites de 2003 traduit ainsi la prise en compte de cette double priorité et diminue fortement la désincitation à l'activité des travailleurs âgés : assouplissement des règles de cumul emploi-retraite, durcissement des conditions d'accès aux préretraites, incitation par une surcote à la prolongation de l'activité au-delà de la durée requise pour liquider sa pension à taux plein.
Cependant, des dispositifs désincitatifs subsistent , comme la dispense de recherche d'emploi pour les travailleurs âgés au chômage ou, pour les femmes, les nouvelles modalités de l'Allocation Parentale d'Education qui auraient induit le retrait d'activité de 100.000 à 150.000 femmes 80 ( * ) , pour un coût brut pour les finances publiques équivalent à 0,2 % du PIB.
L'objectif pour les politiques publiques dans un contexte où l'économie française pourrait se rapprocher du plein-emploi, sera donc de favoriser les conditions d'un libre choix individuel en matière de comportement d'activité, qui aujourd'hui ne sont pas toujours réunies, ce qui a un effet défavorable en termes de croissance potentielle et pèse sur les finances publiques.
C. LE VIEILLISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE A-T-IL UN IMPACT SUR LA PRODUCTIVITÉ ?
L'impact du vieillissement démographique sur la productivité moyenne est généralement perçu comme négatif. Pourtant la réalité semble plus complexe.
Pour comprendre le lien entre vieillissement démographique et productivité, il est nécessaire de distinguer trois problématiques :
- la productivité décroît-elle avec l'âge ?
- le vieillissement démographique entraîne-t-il un vieillissement de la population au travail ?
- quel est l'impact du vieillissement de la population active sur le salaire moyen ?
1. La productivité décroît-elle avec l'âge ?
Généralement, l'évolution de la productivité d'un travailleur en fonction de son âge est présentée comme épousant une forme en cloche :
- la productivité croîtrait avec l'âge du fait de l'accumulation des connaissances et du fait d'une meilleure connaissance de ses aptitudes par l'employeur ;
- mais par la suite, l'obsolescence des qualifications d'un travailleur âgé et sa moindre aptitude à suivre les innovations technologiques conduiraient à une diminution de sa productivité.
En fait, il existe peu d'estimations économétriques de ce type de relations entre âge et productivité individuelle, du fait notamment de la rareté des données disponibles.
Une étude a cherché à appréhender le lien entre âge et productivité en évaluant la productivité non pas au niveau individuel mais au niveau de catégories de salariés 81 ( * ) .
Sur cette base, les auteurs de l'étude estiment que la productivité des salariés croîtrait jusqu'à l'âge de 40 ans, avant de se stabiliser .
Ce résultat est cependant fragile, comme le soulignent les auteurs, compte tenu de la médiocre qualité des données et d'autres problèmes méthodologiques.
2. Le vieillissement démographique entraîne-t-il un vieillissement de la population au travail ?
Une idée courante est que le vieillissement d'ensemble de la population s'accompagnerait d'un vieillissement de la population active.
Une étude de 2002 82 ( * ) montrait que la réalité était plus complexe :
- ce n'est qu'après 2006 que l'avancée en âge des baby-boomers amorce une longue phase d'augmentation de la part des plus de 60 ans dans la population totale ; en revanche, la progression en âge des baby-boomers tend à augmenter l'âge moyen des actifs depuis plusieurs années déjà. Toutefois, ce processus ralentira sensiblement avec le départ à la retraite des générations de baby-boomers .
De ce point de vue, la réforme des retraites de 2003 aurait, selon votre rapporteur, des effets ambigus : l'allongement de la durée d'activité pourrait entraîner, jusqu'en 2010-2011, un vieillissement de la population active ; inversement, les dispositions sur le départ anticipé des travailleurs ayant des carrières longues jouerait dans le sens d'un rajeunissement de la population au travail.
- quels que soient les scénarios démographiques, leur impact sur l'âge moyen de la population active semblerait de second ordre : le scénario le plus défavorable se traduirait par une élévation de l'âge moyen de la population active de deux ans environ par rapport à la situation que connaît l'économie française depuis les années 80.
C'est pourquoi, même en retenant l'hypothèse extrême que la productivité individuelle décline avec l'âge, l'impact du vieillissement de la population active sur la productivité serait très limité .
3. Quel est l'impact du vieillissement de la population active sur le salaire moyen ?
Une autre question de politique économique posée par le vieillissement de la population active est celle de son impact sur le niveau moyen des salaires, et plus précisément sur le rapport entre salaire moyen et productivité moyenne.
Si l'on considère que la productivité diminue à partir d'un certain âge (hypothèse qui n'a cependant pas été validée empiriquement), d'une part, et que le salaire augmente avec l'âge (phénomène particulièrement marqué en France), d'autre part, le vieillissement de la population active pourrait entraîner un décalage entre l'évolution du salaire moyen et celle de la productivité. Ce décalage entraînerait une augmentation du coût salarial unitaire (le numérateur, le coût salarial augmente plus vite que le dénominateur, la productivité), et donc du chômage structurel (du fait d'une accélération de la substitution du capital au travail en réponse à l'augmentation du coût salarial unitaire).
L'étude citée précédemment 83 ( * ) montre toutefois que l'incidence de ce type d'hypothèse sur l'alourdissement du coût salarial unitaire est faible.
Cependant, comme votre rapporteur l'a souligné plus haut, le vieillissement global et son incidence négative sur l'évolution du PIB par tête justifieraient une augmentation de l'emploi des plus âgés. Or, la relation âge-salaire prévalant actuellement s'y opposerait, la remise en cause de cette relation paraissant difficile et étant susceptible de générer d'autres difficultés. Un moyen de sortir de cette contradiction, sans remettre en cause le lien positif entre âge et salaire, serait d'intensifier l'effort de formation au cours de la deuxième moitié de la vie active .
Mais cet effort de formation est lui aussi coûteux et se pose ainsi le problème du partage de ce coût.
*
S'il semble donc difficile de mettre en évidence un impact du vieillissement sur l'évolution de la productivité, la relation prévalant actuellement entre âge et salaire pourrait constituer un obstacle à l'augmentation de taux d'emploi des travailleurs âgés.
II. AGIR SUR LA PRODUCTIVITÉ POUR PRÉSERVER L'AUGMENTATION DU NIVEAU DE VIE ?
A. QUELLE TENDANCE D'ÉVOLUTION DE LA PRODUCTIVITÉ ?
Une hausse du taux d'emploi permettrait de compenser partiellement l'impact négatif sur le PIB par habitant de l'évolution démographique (baisse du ratio population 15-64 ans/population totale). Mais l'allègement de cette contrainte pourrait, surtout, résulter d'une reprise des gains de productivité par tête (combinaison de la productivité horaire et de la durée du travail ).
1. La productivité horaire à moyen-long terme
La méthode la plus simple dans un exercice prospectif consiste à prolonger les tendances en cours.
S'agissant de la productivité horaire, cette démarche est toutefois perturbée par les évolutions récentes de la productivité, marquées par son ralentissement récent (à partir des années 1990). Il n'est pas aisé de déterminer si ce ralentissement est de nature structurelle 84 ( * ) (donc extrapolable) ou s'il est le résultat des politiques d'enrichissement du contenu en emploi de la croissance.
Dans cette seconde hypothèse, il serait logique de considérer que ces politiques ne seront pas amplifiées, soit en raison de leur coût budgétaire, soit parce que dans un contexte de vieillissement démographique, il est plus opportun de privilégier une utilisation intensive du travail. La stabilisation - à leur « niveau » actuel - des politiques d'enrichissement du contenu en emploi de la croissance permettrait ainsi à la productivité horaire de retrouver sa tendance de long terme .
Ce propos liminaire permet ainsi d'évoquer trois hypothèses concernant l'évolution de la productivité à l'horizon 2020 :
- si l'on considère que la période 1995-2005 est atypique sur le plan de l'évolution de la productivité, dans la mesure où elle a été perturbée à la fois par les politiques publiques et par les contraintes exercées par la construction de la zone euro sur les politiques macroéconomiques conjoncturelles, une autre méthode consiste à « neutraliser » cette période et à retenir la tendance qui prévalait antérieurement à 1993 (qui marque le début de la politique d'allègement des charges ainsi que l'acmé du choc négatif de la réunification allemande).
Toutefois, depuis cette date, la part des services dans la production a continué à progresser (de 52,2 % en 1980 à 68,8 % en 2004) et la productivité dans les services est inférieure à celle du secteur manufacturier. La tendance antérieure à 1993 doit donc être corrigée de cet effet de « déformation sectorielle ».
Ce calcul, réalisé par le Centre d'Observation Economique de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris 85 ( * ) permet d'obtenir une tendance d'évolution de la productivité de 1,9 % par an ;
- cette estimation doit être considérée comme une référence moyenne : si l'on considère que la moitié du récent ralentissement (1995-2005) de la productivité ne s'explique pas par les politiques de l'emploi (allègements de charges, réduction de la durée tu travail,...) et obéit à des causes structurelles , il est prudent de retenir une hypothèse d'évolution de la productivité horaire de 1,5 % par an 86 ( * ) .
- une vision plus optimiste, tirée de l'expérience américaine est également possible. Elle repose sur l'idée qu'une part de l'accélération récente de la productivité aux États-Unis s'explique par l'utilisation plus intensive des Technologies de l'information et de la communication dans l'ensemble des secteurs, mais plus particulièrement dans les secteurs du commerce. Si les TIC venaient à être utilisés en Europe aussi intensivement qu'aux États-Unis, la productivité pourrait être accrue 87 ( * ) .
A partir des trois éléments rappelés ci-dessus, il est possible de retenir une « fourchette » allant de 1,5 à 2,5 % concernant l'évolution future de la productivité horaire.
2. La durée du travail
L'autre déterminant de l'évolution de la productivité par tête - et du PIB par tête - est la durée du travail.
Considérée sur longue période (1970-2004), la durée du travail a baissé dans toutes les économies avancées, mais cette baisse a été plus marquée en Europe (-0,6 % par an) qu'aux États-Unis (-0,3 %), ce qui a pesé sur l'évolution du PIB par habitant, en valeur absolue comme relativement aux États-Unis.
Parmi les pays européens, la baisse de la durée du travail a été la plus marquée en France et en Allemagne (respectivement -0,8 % et -0,9 % par an 88 ( * ) ).
Concernant l'évolution à long terme de la durée du travail, votre rapporteur formulera les deux observations suivantes :
- le maintien de la progression du PIB par habitant sur sa tendance antérieure - qui traduirait la possibilité de financer les dépenses liées au vieillissement démographique sans tensions accrues sur le partage du PIB entre actifs et inactifs -, paraît peu compatible avec la poursuite du mouvement de baisse de la durée moyenne du travail des personnes en emploi ;
- de nombreux travaux existent sur les facteurs qui ont encouragé la baisse de la durée du travail en Europe : préférence collective pour le loisir (thèse développée par l'économiste Olivier BLANCHARD), institutions et réglementations (taxation du travail, dispositifs incitant au retrait ou à la diminution d'activité de certains « publics » - femmes élevant de jeunes enfants, par exemple - qui peuvent avoir un « effet multiplicateur social » 89 ( * ) ), ralentissement durable de la croissance qui a conduit à considérer la réduction de la durée du travail comme un moyen de réduire le chômage...
Néanmoins, cette littérature n'est pas conclusive.
Par ailleurs, le vieillissement démographique constituant, par ses conséquences macroéconomiques, un phénomène inédit , elle ne permet pas d'apporter d'éclairage sur la manière dont les actifs réagiront à la tension sur le partage du revenu national, générée par l'augmentation de la part des inactifs.
Dans ce contexte, la responsabilité des politiques publiques est de préserver, ou de restaurer, la neutralité fiscale et réglementaire qui permettra des choix collectifs optimaux en matière de durée du travail.
3. Conclusion sur la tendance d'évolution future du PIB par habitant
A partir des analyses ci-dessus des quatre déterminants comptables de l'évolution de PIB par habitant (ratio démographique, taux d'emploi, durée du travail et productivité horaire), il est possible de dessiner une tendance sur son évolution à l'horizon 2020.
Celle-ci est décrite dans le tableau ci-dessous qui compare l'évolution du PIB habitant sur la période 1980-2004 à son évolution potentielle à l'horizon 2020.
Celle-ci s'appuie sur les quatre hypothèses suivantes :
- le ratio démographique population 15-64 ans /population totale pèserait négativement sur la croissance annuelle du PIB par tête (-0,4 % par an) ;
- la contribution du taux d'emploi serait positive à hauteur de 0,2 % par an, soit la prolongation des évolutions observées depuis 1990, qui semble cohérente à la fois avec l'évolution des politiques publiques et un contexte de « raréfaction » du facteur travail ;
- la durée moyenne du travail serait stabilisée et sa contribution à l'évolution du PIB par tête serait nulle ;
- l'évolution de la productivité horaire serait comprise dans une fourchette allant de 1,5 % à 2,5 % par an.
|
Tableau n° 13 QUELLE ÉVOLUTION À LONG TERME DU PIB/HABITANT ?
|
||||||||||||||||||||||
S'appuyant sur ce jeu d'hypothèses, la croissance annuelle du PIB par habitant à l'horizon 2020 serait comprise entre 1,3 et 2,3 % par an (contre 1,6 % entre 1980 et 2004). Le facteur essentiel d'incertitude concerne donc l'évolution de la productivité horaire : votre rapporteur conclura ainsi ce rapport d'information en évoquant la priorité fondamentale que les politiques publiques en Europe doivent accorder à l'innovation , déterminante pour l'évolution à long terme de la productivité et du niveau de vie.
Préalablement, deux remarques doivent être apportées concernant l'estimation à long terme de l'évolution du PIB par tête qui vient d'être proposée :
- comme tout exercice de projection, fut-il aussi fruste que celui-là, il ne s'agit que d'une illustration de la prolongation des tendances en cours ;
- l'estimation proposée par votre rapporteur peut s'écarter d'autres travaux, tels que ceux proposés par Patrick ARTUS, dont les études 90 ( * ) sont toujours largement commentées par les médias.
Celui-ci estime à 0,6 % par an la croissance potentielle du PIB à long terme en France (0,7 % pour l'Allemagne).
En termes de PIB par habitant, cette « faiblesse impressionnante » serait encore amplifiée par la dégradation du ratio population 15-64 ans/ population totale, de telle sorte que la croissance du PIB par habitant serait inférieure à 0,5 % par an.
Ceci induirait certainement de fortes tensions dans le partage du revenu national entre actifs et inactifs.
Votre rapporteur partage le souci de mettre l'accent sur l'urgence de mettre en oeuvre des politiques permettant de stimuler l'innovation et la productivité. Néanmoins, il ne partage pas complètement la méthode qui conduit à ce diagnostic :
- celui-ci ne semble pas prendre en compte les dernières révisions des projections de population active réalisées par l'INSEE 91 ( * ) ;
- elle s'appuie surtout sur les évolutions les plus récentes de la productivité globale des facteurs , qui connaît un ralentissement depuis quelques années. Or, il n'est pas habituel de calculer une croissance potentielle de long terme en se basant sur les données les plus récentes ; surtout, votre rapporteur a souligné la fragilité des méthodes consistant à isoler dans l'évolution de la productivité horaire, la contribution du résidu agrégé que constitue la productivité globale des facteurs.
B. QUELLES POLITIQUES EN FAVEUR DE L'INNOVATION ET DE LA PRODUCTIVITÉ ?
Ce rapport d'information suggère que le ralentissement de la productivité en Europe aurait résulté à la fois de politiques volontaristes de lutte contre le chômage et d'une adaptation plus lente qu'aux États-Unis à la nouvelle organisation du tissu économique et aux fonctionnalités permises par les Technologies d'information et de communication (TIC).
La compréhension de la lenteur du processus d'ajustement européen aux nouvelles technologies au cours des dernières années a considérablement progressé 92 ( * ) . Ces avancées ont ainsi permis une meilleure définition des politiques susceptibles de stimuler la productivité ainsi que des conditions de leur mise en oeuvre.
Deux considérations générales s'imposent cependant avant de détailler le contenu de ces politiques :
Les dispositifs susceptibles de stimuler la productivité sont très différents dans une économie en phase de rattrapage , c'est-à-dire dont le niveau de productivité est éloigné de celui des pays les plus avancés et dans une économie qui se situe au contraire au stade le plus avancé du développement technologique, « à la frontière technologique », dont le niveau de productivité est le plus élevé, et qui se caractérise également par les coûts de production les plus élevés.
Dans un processus de rattrapage, le moteur de la productivité réside dans l'imitation des processus et des stratégies sectorielles les plus productifs. Des institutions économiques adaptées à cet objectif ont ainsi fourni le cadre dans lequel se sont déroulées les « Trente Glorieuses » : grandes entreprises financées par le secteur bancaire et des soutiens publics, grands programmes et commandes publiques dans des secteurs à fort potentiel de croissance et sélectionnés par imitation des pays les plus avancés, limitation de la compétition dans ces secteurs afin de permettre l'accumulation de rentes, système éducatif qui privilégie l'enseignement initial, adapté à la mise en oeuvre de technologies existantes, marchés du travail qui privilégient l'accumulation de connaissances à l'intérieur d'une même entreprise (par rapport à la mobilité).
Le rattrapage par l'Europe du niveau de productivité américain, jusque dans les années 80, s'est appuyé sur cet environnement économique et réglementaire.
Au contraire, dans une économie qui se situe « à la frontière technologique », la capacité à innover en permanence est la condition de l'augmentation de la productivité et de la performance économique.
Ceci peut s'illustrer par l'exemple de l'investissement en Recherche et Développement (R et D). L'exigence d'investir dans la R et D est également présente dans une économie en rattrapage, mais cet investissement peut se limiter aux secteurs les plus technologiques, que les pouvoirs publics veulent soutenir. Dans une économie à coûts de production et productivité élevés, l'exigence d'investir dans la R et D s'applique à tous les secteurs : dans le secteur pharmaceutique par exemple, où l'intensité de la R et D est « naturellement » élevée mais aussi dans le secteur textile où la survie des entreprises dépend de leur capacité à innover.
Dans une économie au stade le plus avancé du développement technologique, l'investissement dans la R et D doit ainsi augmenter dans l'ensemble de l'économie et pas seulement dans quelques secteurs à fort potentiel de développement.
Une partie du retard pris par l'Europe sur les États-Unis résulterait d'un déficit d'innovation . Mais le processus d'innovation s'appuie sur des facteurs multiples :
- le développement de vecteurs de l'innovation (intensification de la Recherche-Développement, enseignement supérieur,...) ;
- des institutions économiques qui favorisent la diffusion de l'innovation (ouverture des marchés à la concurrence, développement du marché du crédit qui permet un meilleur financement de l'innovation, marché du travail qui permet aux entreprises d'évoluer continûment et de privilégier les produits ou processus les plus innovants...) ;
- un environnement macroéconomique dans lequel les politiques économiques amortissent autant que possible les fluctuations conjoncturelles et privilégient le maintien de la croissance sur sa trajectoire potentielle, de telle sorte que l' incitation à innover ne soit pas contrainte par l'insuffisance des débouchés et par l'augmentation du risque lié à l'investissement et l'innovation .
De la même manière que le ralentissement de la productivité en Europe ne se réduit pas à une seule explication, les politiques de soutien à l'innovation constituent ainsi un puzzle dans lequel chaque élément est complémentaire des autres.
Cette exigence de complémentarité et de cohérence des politiques publiques constitue sans aucun doute un apport important des travaux récents sur les déterminants de la productivité : une politique publique, telle que l'investissement en Recherche et Développement, ne suffit pas à elle seule à stimuler la productivité, si elle ne bénéficie pas d'un cadre propice à sa mise en oeuvre et favorable à la diffusion de l'innovation.
1. Les vecteurs de l'innovation
a) La Recherche-Développement
Le principal vecteur d'innovation et d'augmentation de la productivité est l'intensification de l'effort de recherche et développement (R et D). En outre, les bénéfices à attendre en termes de productivité, d'un investissement dans la recherche, sont d'autant plus élevés qu'une économie se trouve à un stade de développement technologique avancé.
Votre délégation a déjà présenté un ensemble de simulations réalisées à l'aide d'un modèle macroéconomique 93 ( * ) sur l'impact d'une augmentation des dépenses de recherche qui mettaient en évidence un effet multiplicateur très élevé des dépenses de R et D : 1 euro investi dans la recherche se traduirait, selon ces simulations, par un supplément de production de 7 euros à un horizon de long terme (une quinzaine d'années).
Toutefois, un financement public de la recherche se traduit à court-moyen terme par une aggravation du déficit budgétaire. Ceci conduit à s'interroger sur la capacité actuelle des gouvernements européens à investir dans la recherche. Mais, surtout, si un soutien public à la recherche peut s'avérer efficient dans une économie en phase de rattrapage et dont le développement repose sur une stratégie d'imitation, dans une économie qui se situe à la frontière technologique, un soutien direct à des technologies ou des secteurs en particulier suscite des interrogations quant à la capacité des autorités publiques à faire les bons choix .
C'est pourquoi l'enjeu essentiel pour la France concerne la capacité de ses entreprises à redresser leur investissement dans la Recherche, aujourd'hui à la fois déclinant et en retard sur nos concurrents (cf. tableau ci-dessous).
|
Tableau n° 14
DÉPENSES INTÉRIEURES BRUTES DE R&D EN
ENTREPRISES
|
Source : OCDE
Toutefois, un redressement de l'investissement des entreprises dans la R et D, déterminant fondamental d'une augmentation de la productivité, suppose un environnement favorable , autant sur le plan macroéconomique que sur un plan microéconomique.
b) L'enseignement supérieur
Les théories de l'innovation justifient doublement la nécessité d'augmenter l'investissement dans l'enseignement supérieur pour une économie comme celle de la France :
- l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) et la mise en oeuvre des opportunités qu'elles ouvrent, reposent sur une main d'oeuvre en moyenne plus qualifiée ;
- les travaux empiriques montrent que plus une économie se situe à un stade avancé de développement technologique, plus l'impact en termes de productivité et de croissance de l'investissement dans l'éducation supérieure est élevé.
Ainsi, pour la France, le surcroît de productivité procuré par une année d'études supplémentaire s'élèverait à environ 8 % (selon le Rapport du Conseil d'analyse économique, « Éducation et croissance », de Philippe AGHION et Élie COHEN, 2004).
Les différentes étapes du système éducatif ne joueraient pas le même rôle : dans une économie en rattrapage, le processus d'imitation nécessite des individus disposant d'une bonne compétence technique et professionnelle, que procurent l'enseignement secondaire ou l'enseignement supérieur spécialisé ; dans une économie avancée, le processus d'innovation repose sur des chercheurs et donc sur un enseignement long, plus généralisé.
L'enseignement supérieur en France, mais aussi dans beaucoup de pays européens, n'est pas adapté à une économie dont le développement repose sur l'innovation.
Le tableau ci-dessous montre ainsi le retard français relativement aux États-Unis concernant la proportion de diplômés de l'enseignement supérieur : celle-ci n'est ainsi que de 27 % en France contre 33 % aux États-Unis.
|
Tableau n° 15
POPULATION AYANT UNE FORMATION UNIVERSITAIRE
|
Le retard éducatif de la France peut également s'apprécier à partir du graphique ci-dessous sur le nombre moyen d'années d'éducation pour la population active : le nombre moyen d'années d'études (11,5 ans) y est nettement inférieur à celui observé aux États-Unis (13,3 ans) et même dans la moyenne de l'Union européenne (11,8 ans).
Graphique n° 17
NOMBRE MOYEN D'ANNÉES D'ÉDUCATION POUR LA
POPULATION ÂGÉE DE 25 À 65 ANS
EN 2004

Source : OCDE, Regards sur l'éducation
Le rapport du Conseil d'analyse économique précité montre que l'inadaptation du système d'enseignement supérieur français résulte non seulement d'une insuffisance de moyens (les dépenses d'enseignement supérieur ne représentent que 1,1 % du PIB en France contre 2,3 % aux États-Unis), mais aussi d'une efficience médiocre des premières années du système d'éducation supérieure (étudiants sortant sans diplôme, formations sans débouchés...). Celle-ci exigerait ainsi des réformes de structure dont l'analyse dépasserait le cadre de ce rapport.
Une unanimité certaine se dégage désormais en France sur la priorité financière à accorder à l'enseignement supérieur (à défaut d'unanimité sur la manière d'en améliorer l'efficience, en raison notamment du déficit d'évaluation d'ensemble du système).
Votre rapporteur ne conteste pas cette priorité : celle-ci s'impose à la fois comme un objectif en soi pour quiconque peut observer l'état de nos universités, mais aussi dans la perspective qui est celle de ce rapport d'information, c'est-à-dire le lien entre politique publique et productivité.
Néanmoins, dans cette même perspective, une même priorité ne doit-elle pas être accordée aux formations initiales (primaire et secondaire) ? Actuellement, 150.000 personnes - pratiquement 20 % d'une classe d'âge -, quittent le système scolaire sans formation . Ces jeunes sont les premiers exposés au risque de chômage. Mais il faut faire aussi ce constat trivial que les mêmes personnes, une trentaine d'années plus tard, c'est-à-dire en fin de vie active, sont soit au chômage, soit dans l'inactivité. Ce noyau de travailleurs sans qualification vient donc peser durablement sur les politiques de l'emploi dont ils constituent une cible prioritaire, mais aussi sur le marché du travail dont ils freinent les adaptations à l'exigence de souplesse.
Si l'innovation est la clé de la performance économique, si elle suppose la capacité des entreprises à saisir continûment les opportunités nouvelles, à s'adapter au nouveau tissu économique, si elle repose sur une main d'oeuvre mobile et adaptable, la persistance d'un volant d'actifs, dont l'employabilité est réduite par l'absence de formation, constitue un frein à l'innovation.
Enfin, le rapport du Conseil d'analyse stratégique sur « Les métiers en 2015 » met en évidence les perspectives d'augmentation de métiers « peu qualifiés », notamment dans les secteurs des services à la personne , mais qui exigent néanmoins de fortes capacités professionnelles.
La professionnalisation de ces services à la personne, source de gains de productivité, repose ainsi sur l'employabilité et l'adaptabilité de cette main d'oeuvre « peu qualifiée ». Ceci est peu compatible avec l'échec scolaire qui prévaut aujourd'hui.
Les travaux sur l'innovation mettent l'accent sur l'investissement à réaliser en matière d'enseignement supérieur. Votre rapporteur considère cependant qu'une priorité égale doit être accordée à la lutte contre l'échec scolaire, dans une perspective d' élévation générale de la productivité de l'économie française.
2. Un environnement propice à l'innovation et à sa diffusion
a) L'environnement macroéconomique
Les résultats des simulations d'un effort accru de recherche et développement présentées par votre Délégation conduisaient à distinguer deux périodes successives : le temps pour semer et le temps pour récolter . Au cours de la première période (4 à 5 ans), l'investissement en R et D des entreprises pèse sur leurs comptes sans contrepartie immédiate en termes d'amélioration de l'offre. Au cours de la période suivante, l'investissement en R et D donne des résultats importants en termes de gains de productivité et de croissance, grâce à des innovations de processus (qui permettent de baisser les prix) et des innovations de produits (qui permettent d'améliorer leur qualité). Pour obtenir les bénéfices de la deuxième période, il faut maîtriser les déséquilibres et les tensions inhérents à la première période.
Ceci suppose que la politique de régulation conjoncturelle ( policy mix ou combinaison des politiques budgétaires ou monétaires) réduise autant que possible pour les entreprises le risque associé à un investissement dans la R et D et créent ainsi un environnement macroéconomique favorable à l'innovation.
Or, comme l'illustrent divers travaux 94 ( * ) , les variations de la politique budgétaire discrétionnaire comme des taux d'intérêt, sont nettement moindres dans la zone euro qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni ou les autres pays de l'Union européenne hors zone euro.
Le coût direct en croissance de cette absence de réactivité de la politique de régulation conjoncturelle 95 ( * ) est en outre amplifié par des capacités d'emprunt nettement plus réduites pour les entreprises de la zone euro que pour les entreprises américaines.
Les crédits au secteur privé représentent ainsi 0,76 % du PIB dans la zone euro contre 1,32 % aux États-Unis. L'écart est également important lorsqu'on considère des indices de capital risque ou de capitalisation boursière. Ceci suggère que les marchés du crédit aux entreprises dans les pays de la zone euro, outre qu'ils sont peu harmonisés, sont aussi nettement moins « profonds » qu'aux États-Unis.
Ainsi, les capacités d'emprunt des entreprises européennes se réduisent nettement, et plus fortement qu'aux États-Unis, dans les périodes de récession , alors même que celles-ci sont plus accusées et plus longues en Europe du fait d'une réactivité insuffisante des politiques conjoncturelles.
Un environnement macroéconomique propice au développement de l'innovation dans la zone euro suppose donc à la fois le développement et l'harmonisation des marchés financiers de détail (crédits aux entreprises et aux ménages) et la mise en oeuvre d'un policy mix beaucoup plus nettement contracyclique .
Une partie de l'échec de la stratégie de Lisbonne, à l'échelle européenne, et notamment de l'objectif d'augmentation des dépenses de recherche jusqu'à 3 % du PIB, peut ainsi s'expliquer par l'incapacité des autorités européennes - politique et monétaire - à créer l' environnement macroéconomique favorable qui permettra de surmonter les tensions transitoires provoquées par une stratégie d'investissement dans la recherche.
b) L'environnement microéconomique
Jusqu'à une période récente, il semblait raisonnable de considérer que les régulations importantes des marchés des biens et du travail dans de nombreux pays industrialisés avaient des effets complexes sur la productivité et la croissance, et certainement pas univoques .
S'agissant ainsi des effets de l'environnement concurrentiel sur l'innovation et la productivité, une absence de protection (par exemple, en matière de propriété intellectuelle), décourage l'innovation mais, à l'inverse, une protection permanente réduit la compétition et affaiblit l'innovation des entreprises qui bénéficient des rentes procurées par des innovations antérieures. De même, l'accroissement de la pression concurrentielle peut stimuler l'effort d'innovation des entreprises - et des économies - les plus proches de la frontière technologique. A l'inverse, elle décourage celui des entreprises - ou des économies - éloignées de la frontière technologique, pour lesquelles les rentes associées à l'innovation diminuent avec la pression concurrentielle, et deviennent ainsi insuffisantes pour justifier l'effort d'innovation .
Cependant, au fur et à mesure que les pays européens se sont rapprochés du stade le plus avancé du développement technologique, les régulations importantes des marchés des biens et du travail auraient désormais un effet défavorable important sur la croissance et la productivité. Certaines « rigidités » qui pouvaient ne pas brider la croissance pendant les « Trente Glorieuses », et même la stimuler, deviennent pénalisantes dans un contexte de mutations technologiques de grande ampleur, qui exigent la recherche continue des meilleures opportunités et, à ce titre, reposent sur la souplesse et l'adaptabilité des entreprises et de la main d'oeuvre.
Les barrières à l'entrée de nouvelles firmes sur un marché constituent l'exemple le plus fort des facteurs réglementaires qui brident et diminuent l'effort d'innovation, et donc les gains de productivité. Dans ses nombreux travaux, Philippe AGHION met ainsi en évidence le lien positif entre créations et destructions d'entreprises , d'une part, et productivité et innovation, d'autre part. Il cite ainsi l'exemple du secteur pharmaceutique aux États-Unis où 50 % des nouveaux produits sont mis sur le marché par des entreprises âgées de moins de 10 ans, alors que ces jeunes entreprises ne sont à l'origine de la mise sur le marché que de 10 % des nouveaux produits en Europe.
De même, à la fin des années 1990, 12 % des plus grandes entreprises américaines avaient moins de 20 ans contre 4 % en Europe, et la faiblesse européenne en matière de destruction-création d'entreprises (turnover) est encore plus faible en Europe relativement aux États-Unis si l'on prend en compte les 500 plus grandes entreprises.
Le remplacement d'entreprises dont l'efficacité décline par des nouvelles entreprises plus innovantes jouerait ainsi un rôle très important dans les gains de productivité globaux de l'économie américaine, alors que la plus grande partie des gains de productivité en Europe s'observe dans les entreprises plus anciennes 96 ( * ) .
Même si les indicateurs de rigidité mobilisés par l'OCDE montrent une amélioration substantielle dans les pays de la zone euro, et en particulier en France et en Allemagne, ces deux pays se caractérisent cependant, au vu de ces indices, par un niveau de rigidités supérieur à la moyenne de l'OCDE. Certains économistes (Olivier BLANCHARD, par exemple) privilégient une vision optimiste : les pays de la zone euro percevraient prochainement les bénéfices en termes de productivité et d'innovation des réformes passées et en cours des différents marchés.
La thèse dominante, cependant, affirme la nécessité de poursuivre ces réformes visant à réduire les rigidités diverses sur les marchés des biens et du travail, afin que les entreprises puissent saisir l'ensemble des opportunités offertes par les nouvelles technologies.
*
Une croissance basée sur l'innovation requiert des politiques complémentaires et interdépendantes .
Il y aura immanquablement des perdants et des gagnants à la mise en oeuvre de certaines d'entre-elles : par exemple, l'abaissement des barrières réglementaires à l'entrée sur certains marchés, si elle stimule l'innovation pour des entreprises « à la frontière technologique », pénalise celles qui en sont éloignées et qui s'appuyaient jusque-là sur les rentes permises par la protection du marché.
De plus, les coûts associés à ces réformes, concentrés sur un nombre réduit de perdants, sont plus « visibles » que les gains, dilués parmi un plus grand nombre de gagnants.
Ceci constitue un obstacle à leur mise en oeuvre et rend d'autant plus nécessaire des politiques d'accompagnement. Parmi celles-ci, une politique macroéconomique expansive permettrait d'indemniser plus facilement les perdants, faciliterait les reclassements des secteurs en déclin vers les secteurs en expansion (et les plus innovants) et, au total, leur acceptabilité politique.
Il serait ainsi tout à fait opportun que la politique monétaire prenne en compte les réformes déjà intervenues dans la zone euro, que la Banque centrale européenne (BCE) a elle-même vivement recommandées, tant en termes de réduction du déficit budgétaire structurel, de modération salariale (dans un contexte de hausse des prix de l'énergie), ou de libéralisation des marchés, réformes qui ont permis de créer un contexte clairement désinflationniste. Autrement dit, que la politique monétaire accompagne la poursuite des réformes structurelles 97 ( * ) .
La réflexion sur la politique de change doit s'inscrire dans la même logique. Certes, des obstacles « structurels » brident, au sein de la zone euro, une croissance fondée sur l'innovation : l'appréciation de l'euro n'en est pas « responsable ». Mais une politique de change qui limite les risques d'investissement dans la recherche et l'innovation, en préservant les débouchés et la demande adressée aux entreprises, ne constitue-t-elle pas une condition déterminante pour la résorption de ces handicaps structurels ? L'analyse, théorique ou empirique, a toujours apporté des éléments de réponse très clairs à cette question, les États-Unis semblent les connaître et votre rapporteur ne connaît pas de raisons pour qu'ils aient changé.
EXAMEN EN DÉLÉGATION
Au cours de sa réunion du mardi 30 janvier 2007 , tenue sous la présidence de M. Joël Bourdin, président , la délégation pour la planification a procédé à l' examen du rapport d'information sur la productivité et le niveau de vie, de M. Joël Bourdin, rapporteur .
M. Joël Bourdin, président , a tout d'abord fait observer une minute de silence à la mémoire de Marcel Lesbros, dont il a rappelé qu'il avait été membre de la délégation pour la planification depuis sa création en 1984.
M. Joël Bourdin, rapporteur , a ensuite présenté le rapport d'information sur la productivité et le niveau de vie.
M. Joël Bourdin, rapporteur , a indiqué que la problématique fondamentale de ce rapport d'information se résumait à la question suivante : l'Europe prend-elle du retard sur les États-Unis en termes de productivité comme de niveau de vie ?
En effet, le PIB par habitant de l'Europe a rattrapé celui des États-Unis jusqu'au milieu des années 70, puis s'est stabilisé relativement aux États-Unis, avant d'entamer un déclin à partir du milieu des années 1990.
Aujourd'hui, le PIB par habitant en Europe est donc, comme en 1970, inférieur de 25 % environ à celui des États-Unis. La France se situe, pour sa part, 22 % en dessous du niveau de vie américain.
Le PIB par habitant est un indicateur très imparfait du niveau de vie, puisqu'il souffre d'imprécisions statistiques qui perturbent les comparaisons internationales et qu'il ne prend pas en compte de nombreux éléments du bien-être, comme l'espérance de vie en bonne santé, la préservation des ressources naturelles, le temps de travail, etc.
M. Joël Bourdin, rapporteur , a néanmoins estimé que ces comparaisons de PIB/habitant dessinaient des tendances claires sur les performances des ensembles économiques.
Après avoir défini le concept de productivité, souligné que le rapport d'information privilégiait la productivité du travail, et notamment la productivité horaire et rappelé que la productivité du travail était au coeur du processus de croissance et de la compétitivité, M. Joël Bourdin, rapporteur , s'est, tout d'abord, intéressé aux relations entre productivité, emploi et PIB.
En effet, la productivité est souvent associée à la destruction de l'emploi, alors que la relation est plus complexe. A long terme, les travaux théoriques et empiriques montrent que les variations de la productivité se reportent intégralement sur la croissance du PIB, et non sur l'emploi. A moyen terme, la relation peut être différente si l'économie souffre d'un chômage élevé, lié à une croissance du PIB qui évolue en dessous de son potentiel. Dans cette hypothèse, la croissance de la productivité n'a pas d'effet sur le PIB, contraint par l'insuffisance des débouchés, et les évolutions de la productivité se reportent négativement sur l'emploi.
Cet arbitrage entre productivité et emploi est très clair en Europe sur la période 1995-2005 : le ralentissement de la productivité y a profité à l'emploi.
M. Joël Bourdin, rapporteur , a ainsi estimé que la productivité était au coeur du dilemme de politique économique de l'Europe.
En effet, l'Europe et la France ont cherché à copier le modèle américain, qui, dans les années 80, créait beaucoup d'emplois pour une croissance donnée, au contraire de l'Europe. Une stratégie volontariste d'enrichissement du contenu en emplois de la croissance a été mise en oeuvre : allègement de charges, réduction de la durée du travail, encouragement au travail à temps partiel.
Cependant, M. Joël Bourdin, rapporteur , a observé qu'au moment où cette politique portait ses fruits, la productivité a accéléré fortement aux États-Unis et la stratégie européenne de ralentissement de la productivité est apparue peu soutenable : effets négatifs sur la qualité des emplois créés, déficit d'innovation, retard par rapport aux États-Unis... Ces évolutions ont nourri le discours sur le déclin économique de l'Europe et sur la nécessité de privilégier l'innovation et la productivité.
M. Joël Bourdin, rapporteur , a ensuite analysé l'écart de niveau de vie entre l'Europe et les États-Unis. Il a, tout d'abord, rappelé que l'évolution du PIB par tête est déterminée par quatre facteurs comptables : le ratio population 15-64 ans/population totale (c'est-à-dire un ratio démographique), le taux d'emploi (c'est-à-dire la part de la population en âge de travailler qui a un emploi), la durée du travail et la productivité horaire.
Sur la période 1970-2004, la productivité horaire a progressé continûment en Europe jusqu'à rejoindre, ou même dépasser pour la France, le niveau américain.
Mais, inversement, la durée du travail et le taux d'emploi ont baissé en Europe relativement aux États-Unis.
Les écarts de PIB par tête par rapport aux États-Unis pour l'Europe s'expliquent comptablement par une durée du travail et un taux d'emploi plus faibles qu'aux États-Unis.
Pour la France, ceci est encore plus marqué : l'écart de durée du travail explique pratiquement la totalité de l'écart de niveau de vie avec les États-Unis.
M. Joël Bourdin, rapporteur , a ainsi considéré que l'Europe avait besoin de plus de travail, mais surtout, de plus de travail productif, ce qui renvoie à sa capacité à innover, à mobiliser toutes les technologies.
Il est ensuite revenu sur la double inflexion des rythmes de productivité au cours des années 90, c'est-à-dire sa forte accélération et son ralentissement en Europe et a proposé un diagnostic en cinq points :
Le ralentissement de la productivité en Europe s'inscrit dans un processus continu, depuis les Trente Glorieuses. Ceci dément l'idée d'un décrochage brutal de l'Europe, d'une inadaptation qui se révèlerait soudainement.
On constate une inversion des tendances relatives de la productivité entre l'Europe et les États-Unis, mais l'ampleur de cet écart est discutée. Les toute dernières évolutions de la productivité (2005-2006), corrigées des effets conjoncturels, telles qu'elles sont estimées par les services de la Banque de France, montrent que l'écart structurel de croissance de la productivité est aujourd'hui de 0,5 point, c'est-à-dire beaucoup moins que ce que les économistes avaient généralement à l'esprit.
La persistance de cet écart de 0,5 point, qui se traduit par un écart de croissance potentielle équivalent, conduit à poser la question de son origine. M. Joël Bourdin, rapporteur , a avancé deux hypothèses :
- cet écart traduirait le délai de mise en oeuvre d'adaptations à la révolution des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), ce qui signifie que prochainement la zone euro va connaître un sursaut de sa productivité,
- ou, cet écart traduirait la difficulté propre de l'Europe à mettre en oeuvre ce processus d'adaptation, du fait de ce que l'on nomme communément ses rigidités.
L'accélération de la productivité aux États-Unis s'explique en grande partie par le rôle joué par les TIC et par leur diffusion beaucoup plus importante aux États-Unis. Ceci explique que l'innovation y a été beaucoup plus forte : innovation technologique, mais aussi innovation non technologique, comme la réorganisation du processus de production, de la relation au client.
Si la diffusion des TIC a été moindre en Europe, cela peut s'expliquer par une réglementation plus rigide des marchés des biens, qui freinent les mouvements d'entrées et sorties d'entreprises, l'innovation augmentant avec les entrées d'entreprises nouvelles sur les marchés.
M. Joël Bourdin, rapporteur , a estimé qu'une autre explication méritait d'être examinée : la persistance du chômage en Europe, due à l'atonie de l'activité, a eu un double effet : un effet de contrainte sur les entreprises pour qu'elles maintiennent l'emploi, ce qui offre un contexte très peu propice à l'innovation, d'une part ; une diminution de la capacité à prendre le risque d'innover dans ce contexte de réduction des débouchés, d'autre part.
M. Joël Bourdin, rapporteur , a ainsi identifié deux facteurs décisifs de l'innovation, la productivité et la croissance : la souplesse et l'adaptabilité des entreprises et de la main d'oeuvre, et la capacité des institutions à créer un environnement macroéconomique favorable à l'innovation, grâce notamment aux politiques conjoncturelles.
M. Joël Bourdin, rapporteur , a conclu en évoquant les perspectives d'évolution du niveau de vie dans un contexte de vieillissement démographique.
Il a indiqué que le vieillissement démographique se traduisait par une dégradation du ratio population en âge de travailler/population totale, ce qui pèserait sur l'évolution du PIB/habitant et estimé qu'à partir des dernières projections démographiques de l'INSEE, l'évolution démographique diminuerait la croissance du PIB par habitant de 0,4 point par an.
Si la croissance du PIB par habitant sur 1980-2005 était de 1,6 % par an, toutes choses égales par ailleurs, elle serait donc de 1,2 % par an à l'horizon 2020.
Cependant, le taux d'emploi, second déterminant comptable du niveau de vie, peut fluctuer très fortement, et se redresser très nettement dans les périodes de croissance soutenue. Ceci montre d'ailleurs que la faiblesse du taux d'emploi en France, et dans la zone euro, résulte surtout d'une croissance inférieure à son potentiel, qui conduit à exclure du marché du travail les plus jeunes et les plus âgés.
M. Joël Bourdin, rapporteur , a estimé qu'il fallait revenir sur cet arbitrage, les dispositifs qui découragent l'activité des femmes et des travailleurs âgés étant clairement identifiés, et la France commençant à les corriger progressivement.
M. Joël Bourdin, rapporteur , a considéré que l'autre priorité devait porter sur la mise en oeuvre des politiques susceptibles de stimuler l'innovation et la productivité. Celles-ci devraient, tout d'abord, privilégier les vecteurs de l'innovation, c'est-à-dire la recherche et le développement et l'enseignement supérieur, mais créer aussi un environnement macroéconomique et microéconomique favorable à la diffusion de l'innovation.
Concernant la Recherche-Développement, M. Joël Bourdin, rapporteur , a estimé que le recul en matière de recherche des entreprises françaises était préoccupant. Or, l'exigence d'investir dans la recherche augmente dans tous les secteurs, au fur et à mesure qu'un pays se développe et que son coût du travail augmente.
Ainsi, pour la France, la recherche devrait bien sûr augmenter tout autant, dans le secteur pharmaceutique, par exemple, que dans celui du textile, si les entreprises de ce secteur voulaient survivre.
Néanmoins, en matière de recherche, tous les travaux montrent qu'il y a une période de maturation, c'est-à-dire un temps pour semer et un temps pour récolter. Les entreprises peuvent d'autant plus facilement assumer cette période de transition, où la recherche est coûteuse et ne rapporte rien, que l'environnement macroéconomique est favorable.
En matière d'enseignement supérieur, M. Joël Bourdin, rapporteur , a rappelé qu'on établissait la relation suivante : une année supplémentaire d'études pour la moyenne de la population se traduirait par une augmentation de la productivité de 8 %.
Or, la population active française est moins éduquée que la moyenne de l'OCDE, et les dépenses que la France consacre à l'enseignement supérieur sont nettement inférieures à celles des États-Unis, pour une efficacité globale médiocre, au regard de critères économiques.
Enfin, lorsqu'un pays se rapproche du stade le plus avancé du développement technologique, ce qui est le cas de la France, les possibilités d'imitation deviennent plus limitées et il est alors plus rentable d'investir dans l'enseignement supérieur.
Innover est en effet le fait de chercheurs et met en jeu l'enseignement supérieur et les arguments théoriques et empiriques ne manquent pas pour faire de l'enseignement supérieur une priorité.
Cependant, M. Joël Bourdin, rapporteur , s'est demandé si une même priorité ne devait pas être accordée à la formation initiale, car si l'on considère que l'adaptabilité et la souplesse de la main d'oeuvre sont les clés de la productivité, la persistance d'un noyau de 150.000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans formation ni qualification constitue un véritable facteur de blocage, qui contribue à la cristallisation du marché du travail.
M. Joël Bourdin, rapporteur , a évoqué les conditions permettant une véritable diffusion de l'innovation. Sur un plan microéconomique, il a considéré que la première de ces conditions résidait dans un abaissement des obstacles réglementaires à l'entrée sur les marchés de biens.
Les travaux empiriques sont, en effet, nombreux, qui montrent que les obstacles réglementaires freinent la productivité et l'innovation dans les économies que l'on qualifie de proches de la frontière technologique, c'est-à-dire au stade le plus avancé du développement technologique.
Dans une économie en rattrapage, dont l'imitation constitue le moteur de la productivité, une protection peut être favorable, car elle est crée une incitation à copier les technologies les plus efficaces.
Mais dans les économies les plus avancées, le moteur de la productivité n'est pas l'imitation, mais l'innovation. Il faut donc encourager la compétition et l'accès aux marchés de nouvelles entreprises par nature plus innovantes.
Beaucoup de travaux montrent cependant que l'Europe et la France ont mis en oeuvre des réformes qui ont permis d'abaisser ces obstacles réglementaires et qu'elles pourraient en percevoir bientôt les bénéfices.
La seconde condition pour la réussite des politiques de productivité réside dans un environnement macroéconomique favorable à l'innovation.
Le policy mix est, au sein de la zone euro, insuffisamment mobilisé pour éviter que la croissance effective ne s'écarte trop de son secteur potentiel.
Cette réactivité insuffisante de la politique de régulation conjoncturelle est démontrée par de multiples travaux empiriques. Le fait que la zone euro connaisse des périodes de ralentissement de l'activité plus longues nuit à la crédibilité de la croissance et diminue l'incitation à l'innovation. Surtout, elle en accroît le risque, alors même que la contrainte de crédit est beaucoup plus forte en Europe qu'aux États-Unis, compte tenu de marchés du crédit à la fois peu harmonisés et moins complets.
La délégation a alors donné un avis favorable unanime à la publication du rapport d'information sur la productivité et le niveau de vie, de M. Joël Bourdin, rapporteur.
ANNEXE
ÉTUDE RÉALISÉE PAR LA DIRECTION
DES ÉTUDES ET SYNTHÈSES ÉCONOMIQUES DE L'INSEE

Institut national de la statistique et des études économiques
Niveaux de vie et productivité :
la
France et les principaux pays développés
Octobre 2006
NIVEAUX DE VIE ET PRODUCTIVITÉ : LA FRANCE ET LES PRINCIPAUX PAYS DÉVELOPPÉS
Le positionnement de la France dans la hiérarchie internationale des niveaux de vie et de la productivité est devenu un sujet d'interrogation récurrent, surtout depuis que la France s'est installée dans un régime de croissance affaiblie, à la fois distancée par les pays développés les plus performants, notamment les Etats-Unis, et concurrencée de manière croissante par un certain nombre de pays émergents, la Chine étant celui qui attire le plus d'intérêt, en raison de la vigueur exceptionnelle de sa croissance et son poids démographique.
Cette note récapitule les principaux éléments de constat sur ce positionnement relatif de la France, tant en termes de productivité que de niveau de vie, en niveau et en croissance. On s'intéressera principalement à la comparaison avec 6 pays (l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et les Etats-Unis), ainsi qu'avec l'ensemble constitué de l'Union Européenne à 15, avec quelques éléments additionnels relatifs à la Chine. On évoquera les problèmes de mesure qui peuvent affecter ces comparaisons internationales. Ces problèmes de mesure ne faussent pas les comparaisons d'ensemble, mais ils invitent à relativiser les écarts qui sont de trop faible ampleur.
On examinera ensuite la façon dont les différentiels de croissance sont comptablement déterminés par les différentiels de productivité horaire, de durée du travail, de taux d'emploi et de ratio démographique entre population d'âge actif et population totale. Le facteur démographique intervient de manière complexe et, dans le cas de la France, il contribue assez peu à expliquer le positionnement de la France par rapport aux Etats-Unis. La baisse de la durée travaillée joue un rôle tendanciel plus net, partagé par une bonne partie des pays Européens. Il en va de même pour les taux d'emploi. Le différentiel de productivité horaire joue plutôt à l'avantage de la France en termes de niveau, mais cet avantage a commencé à s'éroder en fin de période. On conclut en évoquant succinctement les quelques facteurs qui pourraient avoir contribué à ce décrochement.
I. COMPARAISONS DE PIB/TÊTE EN NIVEAU ET EN VARIATION
On ne reviendra pas en détail sur les limites du concept de produit intérieur brut pour la mesure ou la comparaison du bien-être entre pays et entre périodes : absence de prise en compte de la destruction de capital physique ou naturel, faible couverture des activités informelles, etc. Quelques uns de ces points sont développés succinctement dans l'encadré 1.
En revanche, même si l'on assume ces limites du concept, il reste un problème incontournable qui est celui du passage du PIB nominal (agrégat des valeurs ajoutées des entreprises en monnaie locale courante) au PIB réel. Il existe deux grandes façons de procéder :
|
Encadré 1
Problèmes méthodologiques de la mesure
des PIB nominaux et des SPA :
Comparabilité des PIB nominaux La littérature est assez abondante sur les sources d'imprécision du calcul du PIB, mais plus discrète sur leur chiffrage. Chaque « changement de base » est d'ailleurs l'occasion de constater que les montants précédemment admis ont été corrigés, parfois de manière importante. La rédaction des SCN (manuel de comptabilité nationale des Nations Unies) et des SEC (manuel de comptabilité nationale de l'Union Européenne) successifs est néanmoins de plus en plus précise, et le travail d'harmonisation d'Eurostat dans le cadre du contrôle de la quatrième ressource (comité RNB) oblige à une description plus complète des méthodes nationales, parfois assorties de « réserves » posées par Eurostat et devant donner lieu à des explications ou des évaluations pour correction du PIB au titre de la quatrième ressource. L'année 2005 a vu le changement de base de la plupart des pays européens. Certains aspects ont été harmonisés, notamment les Services d'Intermédiation Financière Indirectement Mesurés (SIFIM), le croît naturel forestier, l'évaluation des services informatiques autoproduits et le traitement des dépenses de logiciels. Une source de sous estimation du PIB/divergence entre la France et les Etats-Unis était le fait que ces dépenses y étaient traitées en consommations intermédiaires plutôt qu'en investissement (Lequiller, 2000). Il reste de nombreuses autres sources d'imprécision dans les comparaisons internationales, notamment : - la prise en compte des activités souterraines ou illégales ; - l'évaluation des services de logement, notamment des propriétaires-occupants ; - l'évaluation de la production des ménages ou des institutions sans but lucratif au service des ménages ; - le prochain sujet d'harmonisation concernera les actifs que constituent les originaux de biens et services culturels. Difficultés de mesure des Parités de Pouvoir d'Achat La comparaison spatiale de niveaux de prix est très difficile. Pour la consommation des ménages, elle nécessite de comparer les prix d'un panier de biens et services comparables et représentatifs entre pays d'environ 3000 produits. Or comparabilité et représentativité sont souvent des objectifs antagonistes. Comme ce sont les équipes nationales qui procèdent aux relevés de prix, on ne peut être assuré qu'elles ont effectué les mêmes choix subjectifs dans les 25 pays européens, car la définition n'est jamais assez précise, ou elle l'est trop. On peut estimer l'imprécision de l'exercice sur le consommation des ménages en comparant le résultat d'une enquête à celui de l'enquête précédente extrapolé par trois années d'indices de prix à la consommation. La comparaison des autres agrégats du PIB ou de la consommation finale des ménages en services de logement est encore plus problématique. Elle donne lieu, notamment en ce moment, à des task forces pour réviser les méthodes et les chiffrages, si possible sur le passé. Erreurs passées : révision en 2003 des séries de 1995 à 2002 La version de décembre 2001 des statistiques de PIB par habitant de l'année 1999 en termes de PPA, des différents pays européens publiée par Eurostat, avait fait grand bruit. En effet, selon ces données, la France s'inscrivait depuis 1997 à la douzième place du palmarès européen, alors qu'elle figurait au troisième rang ex-aequo en 1992. En réalité, même si les chiffres de la comptabilité nationale corroboraient bien pour la France sur la période 1992-1997 une moindre croissance du PIB par habitant par rapport à la moyenne européenne (+0,5% de population et -2% de PIB en écart relatif à la moyenne européenne sur la période, ce qui, d'après les chiffres européens aujourd'hui disponibles, se traduit par un recul la France de 6 ème place européenne en 1992 à la 9 ème en 1997 en terme de PIB nominal par habitant), le recul relatif de la France mesuré à l'aune les PIB par habitant en PPA était artificiellement accentué, car il était entaché d'une erreur dans le calcul des prix de certains produits (notamment de la construction). A la demande de la France, Eurostat a entrepris une révision des PPA sur les années passées (1995-2001), car cet exercice de comparaison spatiale faisait apparaître un manque de cohérence intertemporel pour chaque pays, lié au fait que les consignes internationales pour évaluer précisément certains prix restaient floues. Les prix des loyers, des services non marchands, de la FBCF en construction et en biens d'équipement ainsi que les taux de TVA ont ainsi été revus sur toute la période et tous les pays. Cette révision globale a été publiée en décembre 2003, en même temps que les résultats provisoires 2002. La cohérence intertemporelle pour chaque pays est maintenant établie, même si la cohérence spatiale demeure perfectible. Révisions à venir en 2006 Cet exercice de révision, à l'origine exceptionnel, est entré dans les moeurs. Ainsi, à l'occasion du changement de base des comptes nationaux de la plupart des pays européens en 2005, une nouvelle révision des parités de pouvoir d'achat est programmée à échéance fin 2006 (jusqu'en 1995 seulement). On attend en particulier des progrès méthodologiques sur les loyers (les prix britanniques apparaissent trop bas - ce qui toutes choses égales par ailleurs remonte indûment le niveau du PIB du Royaume Uni en PPA - ; le groupe de travail qui a eu lieu en 2005 a conclu sur une nouvelle méthode bien meilleure car articulée entre valeurs et prix, mais chaque pays doit maintenant procéder aux calculs) et sur les services non marchands (le manuel d'Eurostat laissait trop de place à l'arbitraire ; les prix français sont probablement trop bas, les prix allemands trop hauts ; un groupe de travail se réunira sur ce sujet en 2006 et 2007). |
• Si la question est uniquement de comparer le PIB pour un même pays à deux dates, la démarche consiste à diviser ce PIB par un déflateur mesurant l'évolution des prix de ce pays. On peut pour cela bénéficier d'indices assez fins et temporellement homogènes neutralisant les effets de qualité des produits, c'est-à-dire mesurant l'évolution moyenne au cours du temps d'un panier de produits inchangés et identifiés avec précision.
• Si la question est plutôt de comparer les PIB ou les PIB/tête entre deux pays le recours aux indices de prix nationaux est insuffisant : ces indices permettent seulement de contrôler les évolutions de prix, pas leurs niveaux. Ils disent si le prix du panier de consommation moyen évolue plus ou moins vite en France ou en Allemagne, mais ils ne disent rien de la comparaison des prix de ce même panier dans les deux pays. Pour ce faire, on a recours à la méthode des standards ou des parités de pouvoir d'achat (PPA) qui consiste à réaliser dans l'espace ce que les indices de prix usuels font dans le temps, i.e. comparer les montants nominaux requis pour acheter le même panier de biens dans les deux pays.
Dans l'idéal, cette méthodologie des PPA devrait être apte à couvrir à la fois la question des comparaisons dans le temps et dans l'espace. Mais tel n'est pas le cas. Il y a en particulier le fait que les comparaisons dans l'espace s'appuient sur des paniers dont la comparabilité temporelle est beaucoup moins garantie que ce n'est le cas pour les indices de prix nationaux. A titre d'exemple, on rappelle que des comparaisons de PIB par la méthode des PPA publiées par Eurostat en 2002, qui avaient fait apparaître un fort recul du rang relatif de la France, s'appuyaient sur des mesures des PPA qui intégraient des hausses peu vraisemblables des prix de la construction sur la période 1996-1997 (+40%), et qui correspondaient en fait à une rupture de série (Magnien, Tavernier et Thesmar, 2002).
Dans la pratique on est donc amené à combiner les deux approches. On utilise les indices de prix nationaux pour redresser chaque série nationale en fonction du temps, et les PPA d'une année de référence servent à positionner les différentes courbes nationales les unes par rapport aux autres.
Pour illustrer à la fois cet impact de la correction par les PPA et la marge d'erreur qui entoure cette correction, la figure 1 donne la comparaison des niveaux de PIB par habitant selon diverses sources et/ou méthodes de redressement, pour l'année 2004 qui est la dernière année commune à l'ensemble de ces sources. Les données sont fournies en niveaux relatifs par rapport à la moyenne de l'UE15. On fournit trois données issues des bases de l'OCDE (niveaux de vie ajustés compte tenu des taux de changes courants, des PPA courantes, des PPA de 2000), une donnée issue de la base du Groningen Growth and Development Centre (mise à jour de Timmer, Ypma et Van Ark, 2003, avec des données ajustées sur la base des PPA de 2002) et les données Eurostat (basées sur des PPA courantes).
Figure 1 : Comparaison de six mesures des PIB/habitant pour l'année 2004 (UE15=100).
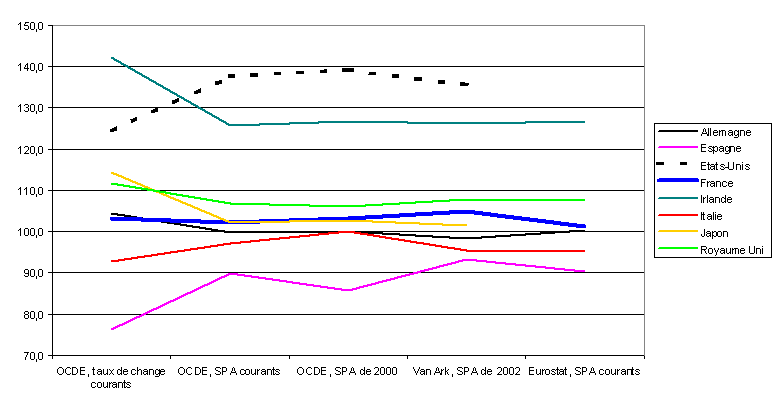
Chaque ligne de cette figure permet de suivre comment varie le positionnement relatif d'un pays par rapport à la moyenne de l'UE15 en fonction de la mesure retenue. La comparaison des deux premiers points de chaque courbe permet de voir l'ampleur de la correction qui résulte du passage des taux de change aux PPA. Les résultats principaux sont le relèvement de la situation relative des Etats-Unis (notamment en correction du faible niveau actuel du dollar), et un rapprochement partiel vers la moyenne de l'UE15 pour l'Irlande et le Japon (pays dont les prix intérieurs sont donc plutôt élevés) ainsi que pour l'Espagne (pays dont les prix intérieurs sont plutôt bas).
Modifier la source ou le système de PPA se traduit par des modifications qui sont évidemment de beaucoup plus faible ampleur que le basculement taux de change/PPA, mais les variations peuvent rester assez significatives. Si elles ne remettent pas en cause le placement relatif des cas extrêmes, les écarts de niveau de vie inférieurs à 5% en valeur absolue apparaissent effectivement trop fragiles pour permettre un interclassement fiable des pays. De fait, c'est bien la pratique des instituts de statistique de se refuser d'afficher tout classement sur la base d'écarts inférieurs à ce seuil. Dans le cas des pays de l'ancienne Union Européenne à 15, Eurostat n'utilise les PPA que pour différencier trois groupes : deux pays à haut niveau de vie (Luxembourg et Irlande), trois pays à bas niveau de vie (Espagne, Chypre et Grèce), et l'ensemble des 10 autres pays en situation médiane dont les PIB/tête s'étagent dans une bande de largeur relative à peu près égale à 10%.
Pour ne pas multiplier les résultats, et à l'instar d'Artus et Cette (2004) on se basera ici sur les données de la base du Groningen Growth and Development Centre , exprimées en Dollars de l'année 1995 et ajustées sur des PPA de 2002. Elles ont l'avantage d'avoir la couverture la plus large, temporelle et spatiale. On a vu sur la figure 1 que cette base avantage quelque peu la France par rapport à la moyenne de l'UE15 mais, encore une fois, il ne faut pas considérer un tel écart comme significatif. Dans la suite, on s'appesantira surtout sur les écarts les plus importants.
Les figures 2a et 2b utilisent cette base pour donner des évolutions de PIB/tête pour l'ensemble des pays sous revue. Le premier graphique montre le positionnement de la France par rapport à l'UE15 et aux trois pays hors UE. Malgré sa croissance récente, le revenu par habitant chinois reste très inférieur à celui des pays et développés, de l'ordre du cinquième du PIB par habitant de la France. A l'autre extrême, les Etats-Unis sont constamment au dessus, avec un écart par rapport à la France de l'ordre de 15% jusqu'à la première moitié des années 1990 et de l'ordre de 25% depuis, en légère croissance sur l'ensemble de la période.
Le positionnement relatif de la France par rapport au Japon et au reste de l'UE est ambigu. Vis-à-vis du Japon, les courbes se croisent à deux reprises : le Japon rattrape la France à compter de 1989, puis se fait à son tour rattraper dix ans plus tard. Sa croissance redevenue plus rapide sur les deux dernières années donne à penser qu'un troisième croisement pourrait être possible. Mais, à nouveau, nous sommes sur des ordres de grandeur des écarts qu'il ne faut pas considérer significatifs. Il en va de même vis-à-vis de l'ensemble de l'UE15. Avec cette source de données, la France reste au dessus de la moyenne de l'UE sur l'ensemble de la période, mais avec un écart qui se réduit progressivement. Comme on l'a vu sur la figure 1, d'autres sources indiqueraient que ce rattrapage par la moyenne de l'UE est déjà achevé.
La figure 2b permet de mieux voir ce que recouvre ce positionnement par rapport à la moyenne de l'UE. Il y a un clair phénomène de rattrapage par l'Espagne. Dans le cas de l'Irlande, le rattrapage se termine en dépassement : le niveau de vie irlandais est environ 20% supérieur au niveau de vie français en 2005, alors qu'il n'en représentait qu'à peine plus de la moitié en 1970. Mais, ce rattrapage spectaculaire doit beaucoup au poids de l'investissement direct étranger dans ce pays : raisonner en termes de revenu national brut (RNB) plutôt que de PIB réduirait d'à peu près 25 point la croissance irlandaise globale depuis le début des années 1970. Sa situation de fin de période s'en trouverait sensiblement rapprochée de la moyenne européenne.
Figure 2.a. Niveaux de PIB par tête en dollars 2005 (Source GGDC)
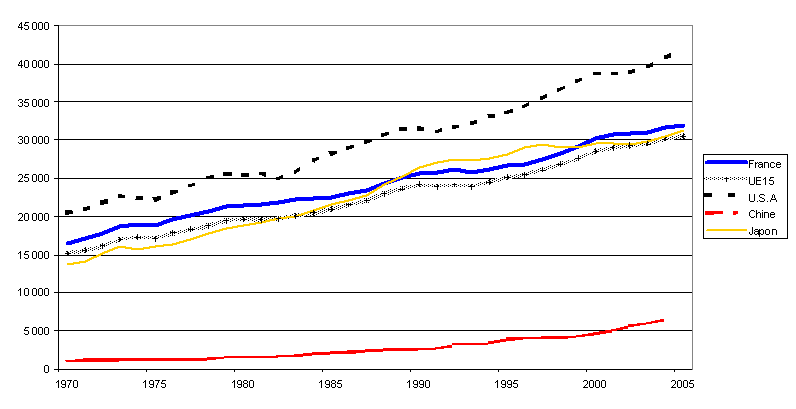
Figure 2.a. Niveaux de PIB par tête en dollars 2005 (Source GGDC)
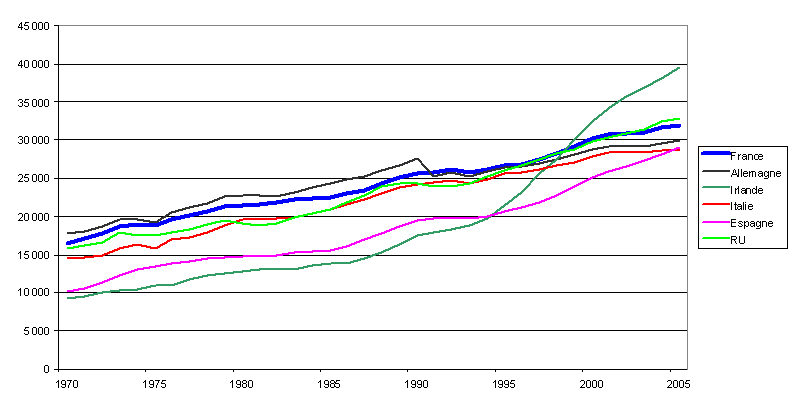
Outre l'Irlande, un phénomène de dépassement de la France intervient également pour le Royaume-Uni mais d'ampleur beaucoup plus limitée.
Vis-à-vis de l'Allemagne, la période est marquée par l'effet de la réunification. La série présentée enchaîne données de l'Allemagne Fédérale jusqu'en 1990 et données de l'Allemagne réunifiée depuis. La réunification fait chuter le niveau de vie allemand moyen légèrement en dessous de la moyenne française, et ce décrochement s'accentue en fin de période. Aucune tendance nette ne se dégage enfin vis-à-vis de l'Italie.
II. ANALYSE COMPTABLE DES ÉCARTS ENTRE PAYS
Ces différentiels de production par habitant résultent de nombreux facteurs. Il est courant de mettre l'accent sur quatre d'entre eux :
• le ratio de la population d'âge actif à la population totale
• le taux d'emploi au sein de la population d'âge actif
• le volume de travail (en heures) par personne employée
• et enfin la productivité horaire apparente du travail.
Ces quatre facteurs fournissent une décomposition comptable complète des écarts de PIB/tête. Si on note E l'emploi, P 15-64 la population d'âge actif, P tot la population totale, H le nombre total d'heures travaillées, le PIB par tête s'écrit en effet :
y=PIB/P tot =(PIB/H).(H/E).(E/P 15-64 ).(P 15-64 /P tot )
Le premier terme de cette équation est la productivité horaire qu'on notera , le second terme est la durée travaillée par personne en emploi qu'on notera h, le troisième terme est le taux d'emploi T e =E/P adu , le quatrième étant le ratio démographique R dem =P 15-64 /P tot . En variations relatives, l'équation se réécrit donc :
(1+y/y)=(1+/).(1+h/h).(1+T e /T e ).(1+R dem /R dem )
ce qui correspond à la décomposition comptable selon les quatre facteurs indiqués plus haut.
Dans la pratique, les différents termes de cette décomposition comptable posent eux aussi des problèmes de mesure (encadré 2). Si les données purement démographiques posent en principe peu de problèmes, la mesure de l'emploi est déjà plus délicate. Dans le cas des Etats-Unis, on sait notamment que les constats de la période récente diffèrent selon que l'emploi est mesuré sur données d'entreprises ou d'enquêtes auprès des ménages (Ménard, 2004). La mesure de la durée du travail est celle qui reste la plus imparfaite, d'où la fragilité du partage des écarts de PIB/tête entre ce qui résulte de durées du travail différentes ou de productivités horaires différentes.
Cette difficulté fait parfois préférer un regroupement de ces deux composantes, consistant à raisonner en productivité par actif occupé. Mais on se prive ce faisant de l'analyse du rôle d'un facteur explicatif sur lequel on dispose quand même de données, si imparfaites soient-elles. On a donc conservé le principe d'une décomposition en quatre facteurs, pour l'ensemble des pays ou zones déjà traités, en excluant néanmoins le cas de la Chine, pour laquelle les durées de travail ne sont de toute manière pas disponibles. En fait, pour ce pays, il est évident que l'essentiel des écarts de production par habitant proviennent de l'écart de productivité du travail, qu'elle soit par tête ou horaire. Chercher à saisir le rôle du facteur durée du travail et les rôles supplémentaires du taux d'emploi et du ratio démographique n'offre donc qu'un intérêt secondaire.
|
Encadré 2
La mesure du taux d'emploi « Le taux d'emploi est obtenu en divisant le nombre de personnes occupées âgées de 15 à 64 ans par la population totale de la même tranche d'âge. Au niveau européen, cet indicateur est dérivé de l'enquête communautaire sur les forces de travail (EFT), qui couvre l'ensemble de la population vivant dans des ménages privés. Elle exclut les personnes vivant dans des ménages collectifs (pensions, cités universitaires, établissements hospitaliers). La population occupée comprend les personnes qui, durant la semaine de référence et pendant une heure au moins, ont accompli un travail pour une rémunération ou un profit ou qui, n'ayant pas travaillé, avaient néanmoins un emploi dont elles étaient temporairement absentes ». Les heures travaillées par actif occupé Ce niveau d'heures travaillées peut-être estimé par enquête, mais la méthode peut s'avérer fragile : imprécision des réponses, difficulté du passage d'une durée mesurée sur une période référence particulière à une durée annuelle. C'est pourquoi la France, suit une méthodologie multi-sources dite de « comptabilité nationale ». Elle s'appuie majoritairement sur des données administratives exhaustives d'entreprise 98 ( * ) complétées de diverses données d'enquêtes visant à tenir compte le mieux possible de ce qui induit une différence entre le total théorique et le total « réel » : congés, maladies, chômage technique, grèves, heures supplémentaires, prise en compte du travail noir et de la fraude. En dépit de ce calcul complexe qui s'efforce d'être exhaustif, l'estimation des heures travaillées demeure entachée d'imprécision. On a pu estimer à deux heures par semaine, soit de l'ordre de 5% l'écart entre le nombre d'heures déclaré par l`employeur et celui déclaré par l'employé, sur un champ où l'on dispose de ces deux données. On suppose alors que l'écart est du même ordre dans le champ seulement couvert par enquête auprès des ménages, ce qui n'est pas absolument sûr. La base 2000 a amélioré les décomptes d'heures faites au titre des heures supplémentaires et de la multi-activité. Cependant, seules les heures payées et déclarées sont vraiment prises en compte. En particulier, on ne dispose pas d'information suffisante pour estimer correctement les heures faites mais non payées. Au total, on relève au minimum trois causes d'imprécisions pour les comparaisons internationales : - les sources sur l'emploi en personnes physiques : recensements, registres de la population, enquêtes sur les forces de travail ; - la multi-activité intervient dans le passage des données d'emploi en personnes physiques aux données en équivalent temps plein ; - la durée annuelle de travail des équivalent temps plein, qui est sujette à la source utilisée (ménages : enquête sur les forces de travail, ou entreprises : heures légales déclarées et payées) et donc à la prise en compte ou non des heures supplémentaires déclarées / non déclarées, payées / non payées. Les deux dernières causes peuvent représenter respectivement 10% et 5% d'imprécision. S'agissant de la base GGDC utilisée dans cette note, on relèvera notamment l'absence apparente de correction de la multiactivité et du différentiel de durée travaillée entre salariés et non salariés, contrairement à ce que font les comptes nationaux français. On a néanmoins utilisé telles quelles les données de cette base, une correction qui aurait été limitée à la France risquant de dégrader plutôt que d'améliorer la comparabilité des chiffres. |
Figure 3 : Ecarts de PIB/tête par rapport aux Etats-Unis (Source GGDC)
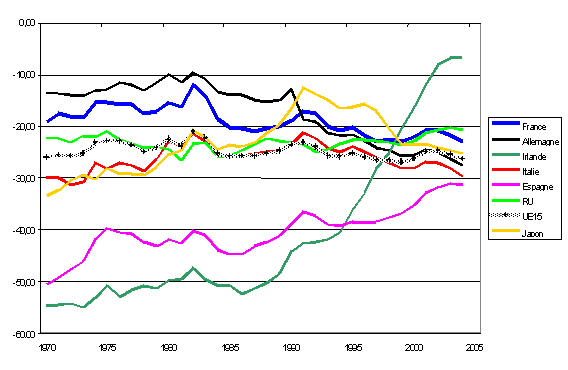
Pour tous les autres pays et à chaque date, on a appliqué l'analyse comptable à la décomposition de leurs écarts vis-à-vis de la situation des Etats-Unis à la même date. La démarche est donc une démarche d'analyse des écarts vis-à-vis des Etats-Unis en niveau, mais, étant répétée à chaque date, les graphiques qui en résultent donnent aussi une mesure de la façon dont les différents facteurs ont joué sur le différentiel de croissance vis-à-vis des Etats-Unis, soit dans le sens du resserrement des écarts de niveau de vie, soit dans le sens du creusement de ces écarts.
Plus précisément, la figure 3 donne les évolutions de l'écart de PIB/tête par rapport aux Etats-Unis pour chaque pays et pour l'UE15, et les figures 4 à 7 donnent les évolutions des contributions comptables des quatre facteurs explicatifs à cet écart. La figure 3 n'est qu'une autre façon de présenter l'information des figures 2a et 2b. On y retrouve le fait que les niveaux de vie de l'ensemble des pays se trouvent significativement en dessous du niveau américain, à l'exception du niveau de vie irlandais qui tend à s'en rapprocher en fin de période, au moins au sens du PIB/tête. Pour ce qui concerne le cas de la France, en trait épais, l'écart au niveau de vie américain est de -20% environ, en légère augmentation depuis les années 1980 mais avec quelques effets de cycle.
Figure 4 : Contributions comptables à l'écart de PIB/tête par rapport aux USA : ratio population en âge de travailler/population totale (Source GGDC et OCDE)
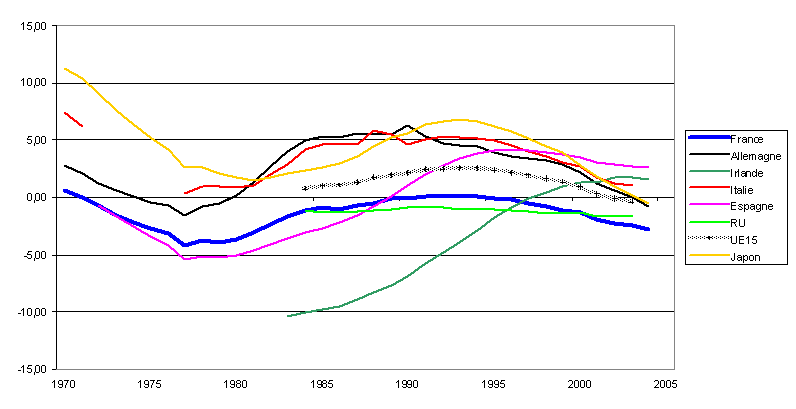
Figure 5 : Contributions comptables à l'écart de PIB/tête par rapport aux USA : ratio emploi/population en âge de travailler (Source GGDC et OCDE)
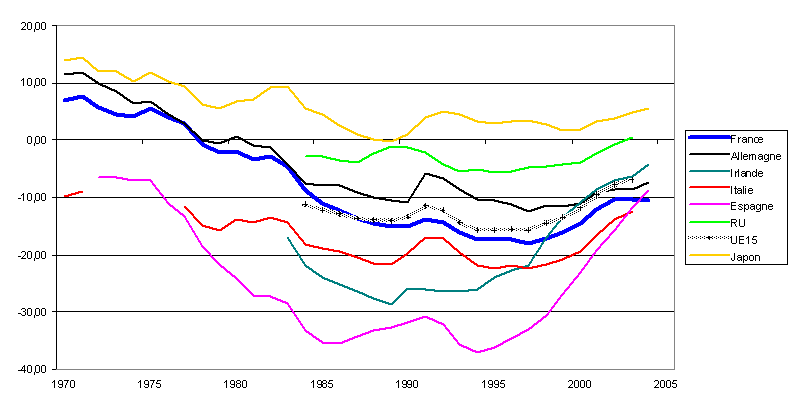
Quelle part de ces écarts est due au seul facteur démographique, c'est-à-dire la part de la population en âge de travailler dans la population totale ? La figure 4 indique le rôle joué par ce facteur, qui superpose de nombreux effets, assez complexes à démêler. Au début des années 1970, les Etats-Unis sortent d'une période où ils ont été « pénalisés » par le poids de leurs baby-boomers dans la tranche d'âge des moins de 15 ans. On sait que la baby-boom y a été beaucoup plus marqué qu'en Europe, mais s'y est également interrompu plus tôt : autour de 1960, l'indice de fécondité (enfants par femme) y est supérieur de près de 1,5 points à ce qu'il est dans les principaux pays Européens, écart qui disparaît presque complètement en dix ans. En 1970, l'écart des ratios de dépendance résultant de la différence d'ampleur des baby-booms est donc en train de se résorber et cède la place à un désavantage européen transitoire. La situation se rétablit ensuite de nouveau à l'avantage de ces pays européen, à la fois en raison du passage à la retraite des classes creuses de la première guerre mondiale, et en raison d'une fécondité d'après baby-boom tombée plus bas qu'aux Etats-Unis, ce qui allège temporairement la charge des plus jeunes. Ces deux effets s'atténuent ensuite à leur tour : les générations creuses nées durant la première guerre mondiale décèdent progressivement, et la faible fécondité d'après baby-boom finit par jouer également à la baisse sur l'effectif des plus de 15 ans des pays européens.
A ces vagues de fond se rajoutent des éléments propres à certains pays. Le fort « avantage » initial du Japon tient également aux pertes de la seconde guerre et à une mortalité initiale forte qui y limitaient le poids des plus âgés, avantage qui a disparu avec le vieillissement accéléré qu'a ensuite connu ce pays. Le profil également très différent de l'Irlande s'explique par le très haut niveau qu'y a longtemps connu la fécondité. C'est ce qui explique qu'elle était le seul pays avec un ratio de dépendance plus défavorable que les Etats-Unis en 1970, avant que cette fécondité de l'Irlande ne chute à son tour et rapproche sa structure démographique de la moyenne.
Dans ce paysage assez enchevêtré, la France occupe une position qui, au final, la différencie peu des Etats-Unis. C'est l'un des pays Européens où la fécondité initiale était la plus élevée, hormis l'Espagne et l'Irlande, et c'est l'un de ceux où elle a le moins baissé. Globalement, la structure démographique propre à la France ne joue qu'assez peu sur son écart de PIB/tête par rapport aux Etats-Unis : cet effet joue dans une bande comprise entre +2 et -4 points d'écart de PIB/tête.
L'analyse des contributions des trois autres facteurs comptables est plus directe car elle ne fait intervenir que des caractéristiques instantanées des économies, à savoir leurs taux d'emploi, et leurs durées du travail courantes.
En matière de taux d'emploi, il y a un mouvement général en « U » qui est commun à l'ensemble des pays (figure 5). La différence principale réside dans l'amplitude de ce mouvement. Initialement, le taux d'emploi des 15-64 ans contribue légèrement à favoriser le PIB/tête en France, en Allemagne et au Japon, et défavorise l'Espagne, l'Italie et l'Irlande. Au cours des 20 années qui suivent, il y a dégradation générale. Elle reste très limitée au Japon, particulièrement importante en Espagne et en Irlande, mais aussi très forte en France et en Allemagne : la montée du chômage et le raccourcissement de la vie active par ses deux extrémités, même compensées par la montée de l'activité féminine expliquent cette évolution. Ce phénomène se résorbe en partie en fin de période, surtout sous l'effet de la baisse du chômage autour de l'an 2000, mais cette amélioration laisse quand même l'ensemble des pays dans une situation de désavantage par rapport aux USA, à l'exception du Japon et du Royaume-Uni. En fin de période, la France est l'un des pays où ce facteur joue le plus négativement : il génère un décrochement comptable d'environ 15 points par rapport au PIB par tête des Etats-Unis.
|
Encadré 3 La contribution du facteur démographique à la croissance française : passé et projection Dans le cas de la France, la figure ci-dessous précise la contribution de la variation du ratio 15-64 ans/population totale à la croissance du produit par habitant, exprimée en points de croissance. Cette contribution est particulièrement positive autour de 1980 (faibles sorties d'âge actif dues au passage à 65 ans des générations creuses nées entre 1915 et 1919). Depuis cette date, la structure démographique est à peu près neutre pour le ratio entre population d'âge actif et la population totale, ce qui veut dire que la croissance de la population totale et celle de la population d'âge actif sont actuellement à peu près parallèles. Figure E1 : Contributions comptables à la croissance du PIB/tête (France, contributions exprimées en points de croissance) |
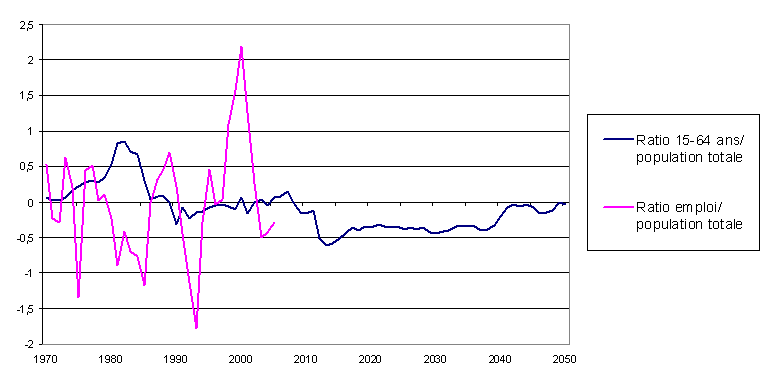
|
En projection, le graphique utilise le scénario tendanciel des dernières projections INSEE, tablant notamment sur une fécondité de 1,9 enfant par femme et un solde migratoire de 100000 personnes par an (Robert-Bobée, 2006). Sous ce scénario, la contribution devient négative à partir de 2010-2011, qui est la date de passage à 65 ans des premiers baby-boomers. Ce basculement a un double effet : une accélération de la croissance du nombre des plus de 65 ans et un freinage ou une inversion de la croissance du nombre des 15-64 ans. L'effet sur la croissance potentielle de cette rupture est un déficit d'environ 0,4 point de croissance annuelle, sur environ une trentaine d'années. L'examen de la contribution comptable du ratio emploi/population totale à la même croissance de 1970 à nos jours rappelle toutefois que cet effet démographique détermine au plus une tendance de fond autour de laquelle les variations du taux d'emploi introduisent une forte variabilité. La baisse tendancielle de l'âge de cessation d'activité jusque vers 1985 a totalement annulé l'effet démographique positif auquel on aura pu s'attendre à cette date. A l'inverse, la dynamique de l'emploi a été très favorable à la fin des années 1980 et à la fin des années 1990. |
Figure 6 : Contributions comptables à l'écart de PIB/tête par rapport aux USA : durée annuelle du travail par personne en emploi (Source CGDC).
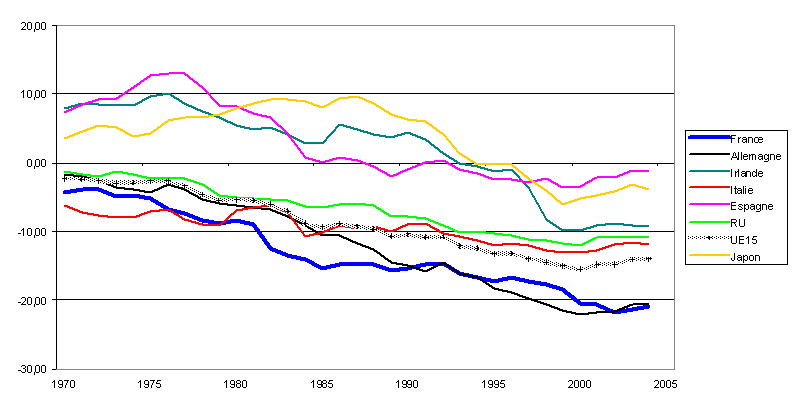
Figure 7 : Contributions comptables à l'écart de PIB/tête par rapport aux USA : productivité horaire (Source : GGDC)
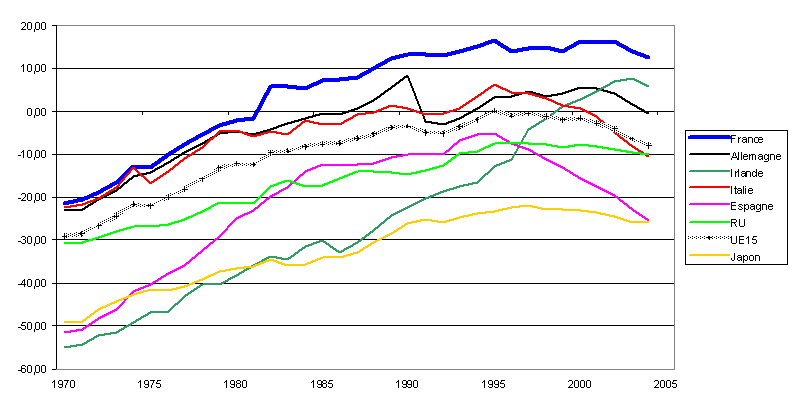
Un assez fort parallélisme s'observe en matière de durée du travail (figure 6). Pour l'UE15, l'effet durée du travail est à peu près neutre en début de période, positif pour l'Espagne et l'Irlande, comme il l'est hors d'Europe pour le Japon, légèrement négatif pour les autres pays. En fin de période, il y a eu un mouvement de baisse généralisée qui conserve à peu près la hiérarchie initiale. L'effet durée du travail en 2004 explique environ 20 points d'écart de PIB/tête par rapport aux Etats-Unis pour la France et l'Allemagne, 14% pour la moyenne de l'UE15. Il est à peu près neutre pour le Japon et l'Espagne. La baisse résulte à la fois de la montée du temps partiel et de la baisse de la durée de travail à temps complet, avec des différences de dosage entre pays. Dans le cas de la France, l'effet de la période du passage aux 35 heures ressort bien, mais de façon toute de même relativement amortie. Il compense une relative stabilité de la durée entre 1985 et 1995, ce qui explique que France et Allemagne se retrouvent in fine à des niveaux comparables.
Ce que présente finalement la figure 7 est le
résidu laissé inexpliqué par l'ensemble des facteurs
précédents. C'est ce résidu qui est qualifié de
productivité horaire apparente du travail. Sa mesure souffre
évidemment des imprécisions qui affectent les autres grandeurs,
notamment les heures travaillées. Mais ces erreurs ne peuvent remettre
en cause le constat global d'une amélioration de la position relative de
tous les pays par rapport aux Etats-Unis : l'écart de
productivité horaire contribuait en 1970 à
l'infériorité des PIB/tête par rapport aux Etats-Unis pour
des montants allant de -20 à
-55 points. Déjà
à cette époque, c'est la France qui s'avérait la mieux
placée parmi l'ensemble des pays autres que les Etats-Unis. Elle garde
cet avantage au terme de la période, et cet avantage s'est même
transformé en avantage par rapport aux Etats-Unis eux-mêmes
puisque, selon ces données, l'indice de productivité horaire
placerait la France plus de 10% au dessus des Etats-Unis. Mais, selon ce
graphique, cet avantage ne s'améliore plus depuis un peu plus d'une
dizaine d'années. Il aurait même laissé place à un
léger recul sur 2003 et 2004. En fait, parmi l'ensemble des pays
considérés, il n'y a que l'Irlande qui reste sur une tendance
nettement croissante. Globalement, sur l'ensemble de l'UE15 c'est à une
baisse de productivité horaire relative qu'on assiste depuis le pic
observé en 1995, où la productivité horaire moyenne avait
exactement rejoint le niveau US. On note que le retournement est
particulièrement marqué en Espagne. Dans ce cas d'espèce,
l'ampleur du retournement est concomitant à une brutale remontée
du taux d'emploi ce qui suggère une explication par le blanchiment
d'activités antérieurement non déclarées et peu
productives.
III. QUELQUES ÉLÉMENTS D'ANALYSE EXPLICATIVE
De l'analyse qui précède on retient que l'essentiel de l'écart de produit par tête entre l'Europe et les Etats-Unis semble s'expliquer par des différences de quantité de travail par habitant, résultant surtout des écarts de taux d'emploi et de durée annuelle du travail pour les personnes en emploi. Les causes de ces écarts du volume de travail ont fait l'objet d'une littérature abondante : plus grande difficultés des pays européens à revenir vers le plein emploi, politiques visant explicitement ou conduisant de facto à la réduction du volume de travail (préretraites, réduction de la durée de travail, systèmes de transferts moins incitatifs à l'activité) ou encore, in fine , traduction de préférences différentes en matière de mode de vie, valorisant plus fortement le loisir que ce ne serait le cas outre-atlantique (voir le débat suscité par la contribution de Prescott, 2004).
Cette note ne cherchera pas à revenir sur ces différents éléments. En revanche, quelques remarques peuvent être faites concernant les écarts de productivité horaire. Dans le cas de la France, en niveau, on a vu que ce facteur joue dans un sens qui est encore favorable mais menacé. En taux de croissance, il a joué positivement durant toute la période où la France et les autres pays ont été en situation de rattrapage de l'économie américaine. Sur les dix dernières années, on peut considérer qu'il a globalement neutre. La France aurait à peu près maintenu son écart favorable de productivité horaire par rapport aux Etats-Unis. La situation apparaîtrait donc plutôt positive. Mais cet acquis est fragile. Un zoom sur les données des deux pays pour la période 1991-2005 confirme ce que montrait déjà la figure 6, à savoir un freinage de la productivité horaire par rapport aux Etats-Unis depuis 2003 (figure 8a) et non plus seulement de la productivité par tête (figure 8b).
Une telle information contribue à relativiser la performance française en matière de productivité horaire. Il se peut en fait que la productivité horaire française soit ou ait été artificiellement favorisée par deux phénomènes. D'une part, mais ceci concerne plutôt le niveau, la productivité française reste favorisée par le fait que l'exclusion du marché du travail se fait majoritairement au détriment des segments les moins qualifiés et les moins productifs de la population active (Bourlès et Cette, 2005).
D'autre part, sur la fin des années 1990, la bonne tenue apparente de la productivité horaire a pu n'être qu'un effet induit de la baisse de la durée du travail puisqu'on admet en général que la réduction de la durée du travail s'accompagne de son intensification. Si tel est le cas, la trajectoire de la productivité horaire en période de baisse de sa durée n'est pas représentative de sa tendance véritable. C'est la stabilisation de la durée du travail qui permettrait de révèler cette tendance véritable, moins favorable, et cette tendance s'accentuerait encore dans l'hypothèse d'un retour à l'emploi les populations qui en sont actuellement exclues, qu'il s'agisse des chômeurs ou des seniors.
Ceci n'est évidemment pas une raison suffisante de s'opposer à ces politiques de retour à l'emploi : en toute hypothèse, leurs effets positifs directs sur le produit par tête doivent l'emporter sur leurs effets négatifs indirects sur la productivité moyenne. Mais, au moins du point de vue du PIB/tête, l'idéal serait d'arriver à concilier dynamisme du volume de l'emploi et dynamisme de sa productivité. On est donc bien conduit à s'interroger sur ce qui freinerait désormais la productivité européenne par rapport à celle des Etats-Unis.
Figures 8a : Croissances annuelles de la productivité par heure travaillée, France et Etats-Unis (source GGDC)
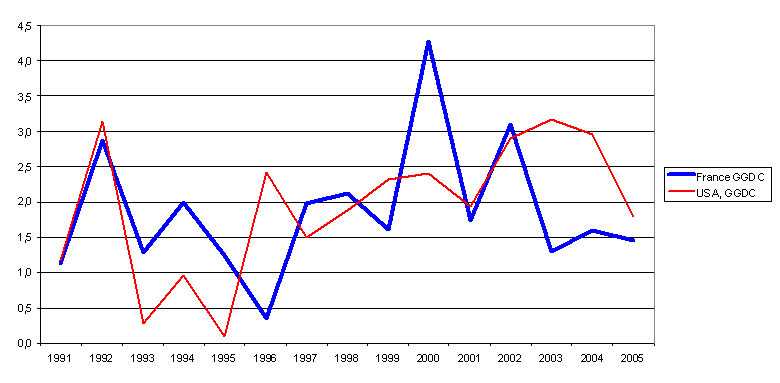
Figures 8b : Croissance annuelle de la productivité par personne en emploi,
France et Etats-Unis (source GGDC)
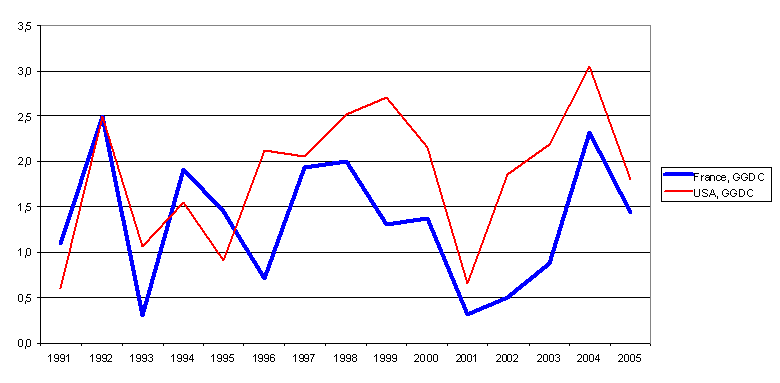
Diverses explications de ce recul peuvent être avancées (Artus et Cette, 2004) : moindre renouvellement du tissu productif, faiblesse de l'investissement TIC, faiblesse de l'effort de R & D, facteurs qui ne sont évidemment pas indépendants les uns des autres. Une illustration de l'effet TIC est donnée par le tableau 2, toujours issu des travaux de l'équipe du Groningen Growth and Development Centre (Timmer, Ypma et Van Ark, 2003). La période couverte est la période 1995-2001. Sur cette période, on retombe sur ce même résultat d'une performance française peu différente de la performance américaine en termes de productivité horaire. Mais le poids relatif de la croissance imputable et non imputable aux TIC diffère sensiblement entre les deux pays. Les TIC contribuent à 1,16 points de croissance annuelle aux Etats-Unis contre 0,64 points en France, cet écart correspondant à la fois à une moindre contribution des progrès de productivité du secteur producteur de TIC (0,44 contre 0,31 points) et à une moindre intensification en capital TIC dans les secteurs utilisateurs de ces TIC (0,72 contre 0,33 points), qui reflète le retard d'investissement que connaît la France dans ce domaine.
Cette moindre contribution des TIC à la croissance est certes contrebalancée, sur cette période, par un plus grand dynamisme de la croissance hors TIC (1,08 contre 0,69 point) mais, si l'on tient compte de ce fait que cette croissance de la productivité horaire hors TIC a pu être transitoirement stimulée par la baisse de la durée du travail, on retrouve l'idée d'un désavantage tendanciel de la France et de l'Europe en général dû à leur moins bon positionnement et à leur plus faible taux d'utilisation de ces technologies plus porteuses. C'est ce que révèlerait le décrochement relatif de la France en toute fin de période.
Plus globalement, le constat serait celui d'une certaine difficulté à passer d'un régime de rattrapage de la productivité américaine, qui aurait duré jusqu'à la fin des années 1980, à une phase de croissance « à la frontière », où le maintien de la position relative suppose une innovation continue (Aghion et Cohen, 2004 ; Lelarge, 2006).
Tableau 1 : Contribution comptable des TIC à la croissance, période 1995-2001
|
Croissance liée aux TIC |
Croissance hors TIC |
||||||
|
PIB/heure travaillée |
Total |
Ratio du capital TIC/ heures travaillées |
PGF du secteur producteur de TIC |
Total |
Ratio capital non-TIC/ heures travaillées |
PGF non TIC |
|
|
France |
1,72 |
0,64 |
0,33 |
0,31 |
1,08 |
0,53 |
0,55 |
|
Allemagne |
1,73 |
0,60 |
0,37 |
0,24 |
1,13 |
0,50 |
0,64 |
|
Irlande |
5,48 |
4,27 |
0,66 |
3,62 |
1,21 |
1,22 |
-0,01 |
|
Italie |
1,12 |
0,60 |
0,37 |
0,24 |
1,13 |
0,50 |
0,64 |
|
Espagne |
-0,36 |
0,32 |
0,17 |
0,15 |
-0,68 |
0,09 |
-0,77 |
|
Royaume-Uni |
1,66 |
0,99 |
0,61 |
0,38 |
0,68 |
0,59 |
0,09 |
|
UE15 |
1,37 |
0,69 |
0,42 |
0,27 |
0,67 |
0,48 |
0,19 |
|
Etats-Unis |
1,85 |
1,16 |
0,72 |
0,44 |
0,69 |
0,32 |
0,36 |
Source : Timmer, Ypma et Van Ark (2003).
Evidemment, cette inversion des tendances relatives de la productivité horaire est récente et reste donc à confirmer. On a d'une part mentionné les incertitudes sur la mesure de la durée travaillée, qui peuvent jouer aussi bien en évolution qu'en niveau. D'autre part, même si les chiffres sont exacts, il faut être certain de bien démêler le structurel du conjoncturel. Par exemple, la jobless recovery observée aux Etats-Unis après l'éclatement de la bulle Internet a pu également être expliquée par la croissance des coûts du travail, résultant de la croissance des dépenses de maladie et de retraite qui sont à la charge des entreprises (Borgy, Carnot et Quéma, 2004). Cette hausse du coût du travail aurait poussé les employeurs sur la voie de l'intensification du travail. Comme leurs homologues européens, ils feraient donc face, jusqu'à un certain point, au même problème d'arbitrage entre volume et efficacité de ce travail.
*
En synthèse, il y a peu de doutes que l'Europe a cessé de bénéficier d'une croissance de la productivité structurellement plus rapide que les Etats-Unis. Et certains facteurs donnent à penser qu'on pourrait même assister à une inversion des tendances relatives de la productivité entre les deux zones géographiques, plutôt qu'à la convergence qui aurait dû normalement résulter de la fin du processus de rattrapage européen. Mais il est encore un peu tôt pour valider totalement cette deuxième thèse. Le suivi régulier des performances des deux ensembles géographiques n'en apparaît que plus nécessaire.
Références
Aghion, P. et Cohen, E. (2004) Education et Croissance , rapport CAE n° 46.
Artus, P. et Cette, G. (2004) Productivité et croissance , rapport CAE n° 48.
Beffy, P.O., Lelarge, C., Ouvrard, J.F. et Piel, P.E. (2004) « Le ralentissement de la productivité dans les années 1990 : effet transitoire des politiques d'emploi ou rupture plus profonde », L'Economie Française, édition 2004-2005 , INSEE-Références.
Borgy, V., Carnot, N. et Quéma, E. (2004) « Retour sur les gains de productivité aux Etats-Unis », DP-Analyse Economiques , n° 51, Octobre
Bourlès, R. et Cette, G. (2005) « A comparison of structural productivity levels in the major industrialised countries », Notes d'études et de recherche de la Banque de France , n° 33.
Lelarge, C. (2006) « Innovation et niveau technologique des entreprises industrielles françaises », in L'Economie Française, édition 2006-2007 , INSEE-Références.
Lequiller, (2000) « La nouvelle économie et la mesure de la croissance », Economie et Statistique, n° 339-340.
Magnien, F., Tavernier, J.L. et Thesmar, D. (2002) « Les statistiques internationales de PIB par habitant en standard de pouvoir d'achat : une analyse des résultats », Document de travail INSEE/DESE , G2002/01.
Ménard, L. (2004) « Ecarts de croissance et de productivité Etats-Unis/one Euro : un usage prudent de ces écarts s'impose », DP-Analyse Economiques , n° 37, Avril
Prescott, E.C. (2004) «Why do Americans work so much more than Europeans ?», Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review , vo. 28, n° 1, pp 2-13.
Robert-Bobée, I. (2006) Projections de population 2005-2050, pour la France métropolitaine, INSEE Résultats, Série Société, n° 57.
Timmer, M., Ypma, G. et Van Ark, B. (2003), « IT in the European Union: Driving Productivity Divergence ? », GGDC Research Memorandum GD-67, University of Groningen, Appendix Tables, mise à jour de Juin 2005 (accessible à l'adresse http://www.ggdc.net/dseries/growth-accounting.shtml).
Annexe 1 : Les déterminants comptables
Tableaux A.1 : Ecarts relatifs de PIB/habitant en niveau par rapport aux Etats-Unis (en %)
|
Ecarts en niveau |
||||||
|
PIB/tête |
15-64 ans/ population totale |
Taux d'emploi |
Durée
|
Productivité horaire |
||
|
France |
1970 |
-19,2 |
0,6 |
6,9 |
-4,3 |
-21,5 |
|
1980 |
-15,4 |
-3,8 |
-1,9 |
-8,4 |
-2,1 |
|
|
1990 |
-18,8 |
-0,1 |
-15,2 |
-15,3 |
13,1 |
|
|
2000 |
-22,0 |
-1,3 |
-14,5 |
-20,5 |
16,2 |
|
|
2004 |
-22,7 |
-2,8 |
-10,7 |
-20,9 |
12,5 |
|
|
Allemagne |
1970 |
-13,5 |
2,8 |
11,4 |
-1,7 |
-23,1 |
|
1980 |
-9,9 |
0,2 |
0,6 |
-6,1 |
-4,8 |
|
|
1990 |
-12,7 |
6,2 |
-10,9 |
-14,9 |
8,4 |
|
|
2000 |
-25,3 |
2,1 |
-11,0 |
-22,1 |
5,5 |
|
|
2004 |
-27,5 |
-0,8 |
-7,4 |
-20,7 |
-0,5 |
|
|
Irlande |
1970 |
-54,8 |
7,9 |
-54,8 |
||
|
1980 |
-49,6 |
5,5 |
-38,1 |
|||
|
1990 |
-44,2 |
-6,9 |
-26,0 |
4,4 |
-22,4 |
|
|
2000 |
-16,1 |
1,3 |
-10,8 |
-9,8 |
2,8 |
|
|
2004 |
-6,8 |
1,6 |
-4,4 |
-9,4 |
5,9 |
|
|
Italie |
1970 |
-29,6 |
7,4 |
-9,9 |
-6,2 |
-22,4 |
|
1980 |
-22,9 |
0,8 |
-13,9 |
-7,0 |
-4,5 |
|
|
1990 |
-23,4 |
4,6 |
-19,8 |
-9,0 |
0,4 |
|
|
2000 |
-28,0 |
2,6 |
-19,5 |
-13,2 |
0,4 |
|
|
2004 |
-29,7 |
-11,9 |
-10,3 |
|||
|
Espagne |
1970 |
-50,5 |
1,0 |
-5,4 |
7,3 |
-51,7 |
|
1980 |
-41,6 |
-5,0 |
-24,2 |
8,1 |
-25,1 |
|
|
1990 |
-38,8 |
1,0 |
-31,9 |
-0,9 |
-10,3 |
|
|
2000 |
-35,2 |
3,5 |
-23,2 |
-3,4 |
-15,6 |
|
|
2004 |
-31,2 |
2,5 |
-8,7 |
-1,2 |
-25,6 |
|
|
Royaume- |
1970 |
-22,2 |
-1,2 |
-30,8 |
||
|
Uni |
1980 |
-24,4 |
-5,1 |
-21,4 |
||
|
1990 |
-23,1 |
-0,9 |
-1,3 |
-7,7 |
-14,7 |
|
|
2000 |
-22,9 |
-1,4 |
-3,9 |
-12,0 |
-7,5 |
|
|
2004 |
-20,6 |
-10,9 |
-10,2 |
|||
|
UE-15 |
1970 |
-26,0 |
-2,3 |
-29,1 |
||
|
1980 |
-22,4 |
-5,3 |
-12,2 |
|||
|
1990 |
-23,5 |
2,1 |
-13,5 |
-10,4 |
-3,4 |
|
|
2000 |
-26,2 |
0,9 |
-12,0 |
-15,5 |
-1,7 |
|
|
2004 |
-26,2 |
-14,0 |
-7,9 |
|||
|
Japon |
1970 |
-33,3 |
11,2 |
14,0 |
3,5 |
-49,2 |
|
1980 |
-25,4 |
1,7 |
6,8 |
7,9 |
-36,4 |
|
|
1990 |
-16,4 |
5,5 |
0,9 |
6,3 |
-26,1 |
|
|
2000 |
-23,5 |
2,8 |
2,0 |
-5,2 |
-23,1 |
|
|
2004 |
-25,1 |
-0,5 |
5,4 |
-3,9 |
-25,7 |
|
Tableau A2 : Décomposition de la croissance absolue par sous-période
(taux et contributions en points de pourcentage)
|
Croissance annuelle du PIB/tête |
Contributions |
|||||
|
15-64 ans/ population totale |
Taux d'emploi |
Durée
|
Productivité horaire |
|||
|
France |
1970-1980 |
2,6 |
0,2 |
-0,2 |
-1,2 |
3,8 |
|
1980-1990 |
1,8 |
0,3 |
-0,5 |
-0,9 |
2,9 |
|
|
1990-2000 |
1,6 |
-0,1 |
0,2 |
-0,4 |
1,9 |
|
|
2000-2004 |
1,1 |
0,0 |
0,2 |
-0,9 |
1,9 |
|
|
1970-2004 |
1,9 |
0,1 |
-0,1 |
-0,8 |
2,7 |
|
|
Allemagne |
1970-1980 |
2,5 |
0,4 |
-0,4 |
-1,2 |
3,7 |
|
1980-1990 |
1,9 |
0,5 |
-0,3 |
-1,0 |
2,7 |
|
|
1990-2000 |
0,5 |
-0,4 |
0,2 |
-0,7 |
1,3 |
|
|
2000-2004 |
0,6 |
-0,4 |
0,1 |
-0,4 |
1,3 |
|
|
1970-2004 |
1,5 |
0,1 |
-0,2 |
-0,9 |
2,4 |
|
|
Irlande |
1970-1980 |
3,2 |
-1,0 |
4,7 |
||
|
1980-1990 |
3,2 |
-0,2 |
3,7 |
|||
|
1990-2000 |
6,1 |
0,9 |
2,0 |
-1,3 |
4,4 |
|
|
2000-2004 |
4,0 |
0,4 |
0,8 |
-0,7 |
3,5 |
|
|
1970-2004 |
4,2 |
-0,8 |
4,2 |
|||
|
Italie |
1970-1980 |
3,0 |
0,0 |
0,2 |
-0,8 |
3,6 |
|
1980-1990 |
2,2 |
0,3 |
0,2 |
-0,3 |
1,9 |
|
|
1990-2000 |
1,4 |
-0,2 |
0,2 |
-0,3 |
1,6 |
|
|
2000-2004 |
0,8 |
-0,4 |
-0,1 |
|||
|
1970-2004 |
2,0 |
-0,5 |
2,1 |
|||
|
Espagne |
1970-1980 |
3,8 |
0,0 |
-1,6 |
-0,6 |
6,0 |
|
1980-1990 |
2,7 |
0,6 |
-0,2 |
-0,9 |
3,2 |
|
|
1990-2000 |
2,6 |
0,3 |
1,4 |
-0,1 |
1,0 |
|
|
2000-2004 |
2,9 |
0,1 |
3,4 |
-0,2 |
-0,4 |
|
|
1970-2004 |
3,0 |
0,3 |
0,3 |
-0,5 |
2,9 |
|
|
Royaume- |
1970-1980 |
1,8 |
-1,1 |
2,8 |
||
|
Uni |
1980-1990 |
2,4 |
-0,3 |
2,3 |
||
|
1990-2000 |
2,0 |
0,0 |
-0,1 |
-0,3 |
2,4 |
|
|
2000-2004 |
2,1 |
-0,5 |
2,0 |
|||
|
1970-2004 |
2,1 |
-0,6 |
2,4 |
|||
|
UE-15 |
1970-1980 |
2,6 |
-1,0 |
3,7 |
||
|
1980-1990 |
2,1 |
-0,6 |
2,4 |
|||
|
1990-2000 |
1,7 |
-0,1 |
0,3 |
-0,4 |
1,8 |
|
|
2000-2004 |
1,4 |
-0,4 |
1,1 |
|||
|
1970-2004 |
2,0 |
-0,6 |
2,4 |
|||
|
Japon |
1970-1980 |
3,2 |
-0,2 |
0,0 |
-0,3 |
3,8 |
|
1980-1990 |
3,4 |
0,3 |
0,3 |
-0,2 |
2,9 |
|
|
1990-2000 |
1,1 |
-0,2 |
0,3 |
-0,9 |
2,0 |
|
|
2000-2004 |
0,8 |
-0,5 |
-0,1 |
-0,4 |
1,9 |
|
|
1970-2004 |
2,4 |
-0,1 |
0,2 |
-0,5 |
2,8 |
|
|
USA |
1970-1980 |
2,1 |
0,7 |
0,6 |
-0,7 |
1,6 |
|
1980-1990 |
2,2 |
-0,1 |
0,9 |
-0,1 |
1,4 |
|
|
1990-2000 |
2,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
1,6 |
|
|
2000-2004 |
1,4 |
0,3 |
-0,9 |
-0,8 |
2,7 |
|
|
1970-2004 |
2,0 |
0,2 |
0,4 |
-0,3 |
1,7 |
|
|
Ecart de croissance du PIB/tête (par rapport aux EU) |
Contributions |
|||||
|
15-64 ans/ population totale |
Taux d'emploi |
Durée
|
Productivité horaire |
|||
|
France |
1970-1980 |
0,5 |
-0,4 |
-0,9 |
-0,4 |
2,2 |
|
1980-1990 |
-0,4 |
0,4 |
-1,5 |
-0,8 |
1,4 |
|
|
1990-2000 |
-0,4 |
-0,1 |
0,1 |
-0,6 |
0,3 |
|
|
2000-2004 |
-0,2 |
-0,4 |
1,1 |
-0,1 |
-0,8 |
|
|
1970-2004 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,5 |
-0,6 |
1,1 |
|
|
Allemagne |
1970-1980 |
0,4 |
-0,3 |
-1,0 |
-0,5 |
2,1 |
|
1980-1990 |
-0,3 |
0,6 |
-1,2 |
-1,0 |
1,3 |
|
|
1990-2000 |
-1,6 |
-0,4 |
0,0 |
-0,9 |
-0,3 |
|
|
2000-2004 |
-0,7 |
-0,7 |
1,0 |
0,4 |
-1,4 |
|
|
1970-2004 |
-0,5 |
-0,1 |
-0,5 |
-0,6 |
0,8 |
|
|
Irlande |
1970-1980 |
1,1 |
-0,2 |
3,1 |
||
|
1980-1990 |
1,0 |
-0,1 |
2,3 |
|||
|
1990-2000 |
4,1 |
0,8 |
1,9 |
-1,5 |
2,8 |
|
|
2000-2004 |
2,6 |
0,1 |
1,7 |
0,1 |
0,7 |
|
|
1970-2004 |
2,1 |
-0,5 |
2,5 |
|||
|
Italie |
1970-1980 |
0,9 |
-0,6 |
-0,5 |
-0,1 |
2,1 |
|
1980-1990 |
-0,1 |
0,4 |
-0,7 |
-0,2 |
0,5 |
|
|
1990-2000 |
-0,6 |
-0,2 |
0,0 |
-0,5 |
0,0 |
|
|
2000-2004 |
-0,6 |
0,4 |
-2,8 |
|||
|
1970-2004 |
0,0 |
-0,2 |
0,4 |
|||
|
Espagne |
1970-1980 |
1,6 |
-0,6 |
-2,2 |
0,1 |
4,4 |
|
1980-1990 |
0,5 |
0,6 |
-1,1 |
-0,9 |
1,8 |
|
|
1990-2000 |
0,6 |
0,2 |
1,2 |
-0,3 |
-0,6 |
|
|
2000-2004 |
1,5 |
-0,2 |
4,3 |
0,6 |
-3,2 |
|
|
1970-2004 |
1,0 |
0,0 |
-0,1 |
-0,2 |
1,3 |
|
|
Royaume- |
1970-1980 |
-0,3 |
-0,4 |
1,3 |
||
|
Uni |
1980-1990 |
0,2 |
-0,3 |
0,8 |
||
|
1990-2000 |
0,0 |
0,0 |
-0,3 |
-0,5 |
0,8 |
|
|
2000-2004 |
0,7 |
0,3 |
-0,7 |
|||
|
1970-2004 |
0,1 |
-0,3 |
0,8 |
|||
|
UE-15 |
1970-1980 |
0,5 |
-0,3 |
2,1 |
||
|
1980-1990 |
-0,1 |
-0,6 |
0,9 |
|||
|
1990-2000 |
-0,4 |
-0,1 |
0,2 |
-0,6 |
0,2 |
|
|
2000-2004 |
0,0 |
0,4 |
-1,6 |
|||
|
1970-2004 |
0,0 |
-0,4 |
0,8 |
|||
|
Japon |
1970-1980 |
1,1 |
-0,9 |
-0,7 |
0,4 |
2,2 |
|
1980-1990 |
1,1 |
0,4 |
-0,6 |
-0,2 |
1,5 |
|
|
1990-2000 |
-0,9 |
-0,3 |
0,1 |
-1,1 |
0,4 |
|
|
2000-2004 |
-0,5 |
-0,8 |
0,8 |
0,4 |
-0,9 |
|
|
1970-2004 |
0,3 |
-0,3 |
-0,2 |
-0,2 |
1,1 |
|
Tableau A3 : Décomposition de la croissance relative par rapport aux Etats-Unis
* 1 Les termes « Union européenne » utilisés dans ce rapport se réfèrent, sauf précision contraire, à la moyenne des 15 pays membres de l'Union en 2004.
* 2 A cause de la « crise Internet ».
* 3 C'est-à-dire que le niveau du PIB est inférieur de 1,5 % à son niveau potentiel ou tendanciel (estimation OFCE).
* 4 Expression citée par Arnaud Parienty, dans la revue « Alternatives économiques » (n° 240).
* 5 « A manna from heaven » selon l'image de l'économiste C. HALTEN.
* 6 Dans le modèle de croissance de l'économiste Robert SOLOW.
* 7 Cette étude est annexée à ce rapport d'information.
* 8 Ce rapport s'est notamment appuyé sur les travaux de Gilbert CETTE, Directeur des études macroéconomiques à la Banque de France. Cet économiste, coauteur avec Patrick ARTUS du rapport du travail d'Analyse Économique « Productivité et croissance » (2004), a proposé nombreuses contributions qui ont permis d'améliorer la compréhension des évolutions et des déterminants de la productivité.
* 9 Votre rapporteur rappelle que ceci se déduit de la simple décomposition comptable présentée ci-dessus (page 43) selon laquelle le PIB est égal au produit de la production par personne employée (c'est-à-dire la productivité) par le nombre de personnes employées. Cette décomposition ou cette identité est la même lorsqu'on raisonne en variation.
* 10 Pour reprendre l'expression d'Olivier BLANCHARD, Professeur au MIT dans « The Economic future of Europe » NBER Working Papers, février 2004.
* 11 C'est-à-dire le stade le plus avancé en matière de productivité et de technologie.
* 12 L'identité comptable rappelée en introduction : PIB = productivité x emploi, est valable en niveau comme en variation (l'augmentation du PIB = l'augmentation de la productivité x l'augmentation de l'emploi).
* 13 Des développements spécifiques sur les difficultés particulières de mesure de la productivité dans les services sont décrits dans le chapitre III consacré aux divergences d'évolution depuis 1995 de la productivité entre l'Europe et les États-Unis (page 88).
*
14
Une
littérature abondante est consacrée à
l'appréhension du concept de productivité globale des facteurs
(PGF) :
- la première interprétation, la plus
courante, considère la PGF comme une mesure du progrès
technique ;
- la deuxième interprétation
considère la PGF comme l'expression des gains de productivité
induits par l'activité économique, par exemple des effets
d'échelle, et non appréhendés par les facteurs de
production. La PGF représenterait ainsi un « don du
ciel » (A Manna from Heaven), c'est-à-dire des augmentations
de la production sans coûts. Dans cette interprétation, si les
facteurs de production étaient parfaitement mesurés et la
fonction de production correctement posée, la PGF serait nulle ;
- la troisième interprétation considère la PGF
comme une « mesure de notre ignorance » ; les
problèmes de mesure de la production et des facteurs de production sont
tels qu'il serait impossible de définir ce qui mesure la PGF :
progrès technologiques mais aussi innovations organisationnelles,
économies d'échelle, etc.
* 15 Rapport SAPIR : « An agenda for a growing Europe ». Commission européenne. 2003.
* 16 Cette méthode repose sur un certain nombre d'hypothèses et de conventions comptables complexes dont la présentation dépasserait le cadre de ce rapport d'information. Une présentation en est donnée dans les Cahiers français n° 323 « Croissance et innovation » par CETTE G., KOCOGLU Y. et MAIRESSE J.
* 17 La contribution la plus complète et la plus connue est celle de Paul DUBOIS « Rupture de croissance et progrès technique ». Economie et statistique, octobre 1985.
* 18 En s'appuyant notamment sur les travaux de Gilbert CETTE : Rapport du CAE « Productivité et croissance » ; « Diagnostic macroéconomique et lecture historique » (2004).
* 19 Expression de R. GORDON, professeur d'économie à la Northwestern University et spécialiste des questions de croissance et de productivité.
* 20 CETTE G., MAIRESSE J., KOCOGLU Y. (2006) : « A comparison of Labor Productivity Growth in France, the UK and the US over the Past Century ».
* 21 En effet, lorsque le salaire par tête évolue comme la productivité, la masse salariale (c'est-à-dire le salaire par tête x emploi) évolue comme la valeur ajoutée (productivité x emploi), ce qui correspond à une stabilité du partage de la valeur ajoutée.
* 22 L'augmentation du coût du travail conduit, en effet, les entreprises à « économiser le travail » et à privilégier les combinaisons les plus capitalistiques.
* 23 C'est-à-dire que la production est produite par un grand nombre de travailleurs dont l'intensité productive est faible - ce modèle s'oppose au modèle européen « intensif » qui concentre la production sur un plus faible nombre de travailleurs plus productifs -.
* 24 Cf. page 89. Par ailleurs, le rapport du CAE « Productivité et croissance » décrit également les dispositifs mis en place dans les autres pays européens.
*
25
André SAPIR : « An agenda for a growing
Europe », Commission européenne, juillet 2003
(il n'existe
pas de version française).
* 26 Ce point de vue a été développé par Marc-Olivier STRAUSS-KAHN, directeur général des Etudes et des Relations internationales à la Banque de France, lors du colloque consacré à la productivité. Banque de France. Novembre 2005 (pages 56 et 57).
* 27 Dans les données de l'OCDE, la population en âge de travailler correspond à la population âgée de 15 à 64 ans.
* 28 « Les champions du PIB par tête et ceux du niveau de vie », Marc FLEURBAEY et Guillaume GAULIER, Lettre du CEPII, octobre 2006.
* 29 Les niveaux de vie moyens qui rapportent le revenu à la population, comme si chacun vivait seul, doivent être réévalués pour tenir compte de la taille moyenne des ménages dans les différents pays.
* 30 Dont la forte croissance du PIB par tête doit beaucoup à l'investissement direct dans ce pays. En excluant la production des entreprises étrangères installées en Irlande (RNB par habitant), le niveau de vie serait proche de la moyenne de l'UE à 15.
* 31 En réalité, le Luxembourg est le seul pays européen où le niveau de la productivité est supérieur à celui de la France.
* 32 Autrement dit, la croissance du PIB par tête a été identique dans les deux économies sur la période.
* 33 Relativement aux États-Unis.
* 34 Voir notamment R. BOURLÈS et G. CETTE : « Une comparaison des niveaux de productivité structurels des grands pays industrialisés « Note d'étude et de recherche de la Banque de France n° 133 » (2005).
* 35 C'est-à-dire qu'une augmentation de la durée du travail de 10 % entraîne une baisse de la productivité horaire de 4 %. Ou, en raisonnant en productivité par tête (qui résulte du produit de la durée du travail et de la productivité horaire), une augmentation de la durée du travail de 10 % entraîne une augmentation de la productivité par tête de 6 %. Cette estimation semble confirmée par les évaluations pour la France du passage aux 35 heures.
* 36 Une hausse de 10 % du taux d'emploi entraînerait une baisse de 4 à 5 % de la productivité. Cette estimation signifie que la productivité des personnes d'âge actif, actuellement hors emploi, serait dans l'hypothèse où elles retrouveraient un emploi, environ deux fois plus faible que celle des personnes en emploi.
* 37 Gilbert CETTE : « Productivité : les États-Unis distancent l'Europe », Futuribles n° 299, juillet-août 2004.
* 38 En prenant l'OCDE comme source.
* 39 Compte tenu de salaires minimums élevés en pourcentage du salaire moyen et d'un coin fiscalo-social important.
* 40 Il faut rappeler, en effet, que la productivité du travail peut se décomposer comptablement en « intensité capitalistique » (qui traduit l'augmentation de la productivité du travail due à l'augmentation du capital) et « productivité globale des facteurs » (qui traduit l'efficacité de la combinaison productive et mesure le « progrès technique »).
* 41 « The economic future of Europe », National Bureau for Economic Research, Working paper 10310 (2004).
* 42 R.J. Gordon « Two centuries of economic growth : Europe chasing the american frontier », CEPR n° 4415 (2004).
* 43 Notamment E.C. Prescott « Why do Americans work so much than Europeans ? », Federal reserve Bank of Minneapolis Preview, volume 28 n°1 (juillet 2004).
* 44 « The Economic future of Europe », op. cit.
* 45 La fiscalité expliquerait ainsi un tiers seulement de cette baisse, les deux tiers restants résultant d'un choix volontaire des travailleurs.
* 46 L'économiste André Sapir distingue ainsi quatre modèles sociaux différents en Europe : un modèle nordique, un modèle anglo-saxon, un modèle méditerranéen, et un modèle d'Europe continentale.
* 47 Hormis des phénomènes de rattrapage très spécifiques comme pour l'Irlande.
* 48 Arbitrages qui ont, par ailleurs, varié avec le virage pris au cours des années 90 en faveur d'un enrichissement du contenu en emplois de la croissance.
* 49 Voir Rapport d'information du Sénat n° 89, 2006-2007, page 111 et suivantes.
* 50 Selon l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).
* 51 Mais on notera aussi que ces pays étaient ceux qui avaient les rythmes de productivité les plus élevés sur la période 1970-1990. Peut-être cela explique-t-il qu'ils « rentrent dans le rang » un peu plus précocement et un peu plus brutalement.
* 52 Hormis la Corée du Sud et la Grèce, en raison de leur situation de rattrapage.
* 53 N. CRAFTS : « The Solow Productivity Paradox in Historical Perspective », CEPR, Discussion paper n° 3142, janvier 2002.
* 54 Toutefois, l'approche sectorielle est très discutée, jugée faiblement crédible par nombre d'économistes, au motif que les statistiques sectorielles seraient, au moins en Europe, de faible qualité et, surtout, que la mesure de la productivité y est, par nature, très difficile.
* 55 B. von Ark, L. Inklaar et R. McGuchin « ICT and productivity in Europe and United States » CES info Economic studies, vol. 49, March 2003.
*
56
«Why
was Europe left at the station when America's productivity locomotive
departed»,
CEPR, Mars 2004.
* 57 Votre rapporteur rappelle qu'une analyse de « comptabilité de la puissance » distingue deux facteurs d'augmentation de la productivité du travail : le renforcement du capital (intensité capitalistique) et la productivité globale des facteurs, qui traduit l'amélioration de la combinaison productive (et mesure « le progrès technique »).
* 58 Bert von Ark, Professeur à l'université de Groningue, propose ainsi une explication de ce déficit d'innovation : « L'Europe va-t-elle rattraper son retard de productivité ? ». Banque de France, novembre 2005.
* 59 Pour une discussion de la réalité du sursaut de la productivité américaine, voir par exemple « Le sursaut de la productivité américaine : réalité ou illusion statistique ? », Francisco VERGARA, « L'économie politique », N° 29, 1 er trimestre 2006.
* 60 Selon Bart van Ark « L'Europe va-t-elle rattraper son retard de productivité ? », Banque de France, novembre 2005.
* 61 « Choisir l'emploi », Rapport du groupe de travail présidé par Bernard Brunhes. 1993.
* 62 Dans les secteurs non marchands, la production étant évaluée aux « coûts des facteurs » (c'est-à-dire la rémunération des salariés), les créations d'emplois aidés entraînent une faible augmentation du PIB non marchand par emploi ainsi créé.
* 63 Source INSEE et GGDC.
* 64 Cette idée est développée dans le rapport du Conseil d'analyse économique « Éducation et croissance » de P. Aghion et E. Cohen.
* 65 Une accélération cyclique de l'activité peut avoir un effet transitoire sur la productivité : les entreprises tendent à adapter les effectifs à la hausse de l'activité, ce qui entraîne une hausse cyclique de la productivité. Un phénomène inverse se produit dans une période de ralentissement.
* 66 Diagnostic qui est généralement posé aux États-Unis, en particulier sur la base des travaux de la Banque Fédérale de Réserve de New York.
* 67 Ces résultats viennent d'être confirmés par les dernières publications du Conference Board sur les évolutions de la productivité.
* 68 cf. « L'économie européenne », 2004, Commission européenne.
* 69 Idem, page 187.
* 70 Cf .notamment rapport du CAE : « Productivité et croissance », p. 72.
* 71 Cette hypothèse est évoquée par Olivier Blanchard, « The economic future of Europe », op. cit., p. 23. Cet auteur reconnaît toutefois que la faiblesse de cette hypothèse réside dans la difficulté à identifier les canaux par lesquels se transmettrait cette « pression gouvernementale ».
* 72 Par l'OCDE, par exemple « Les sources de la croissance dans les pays de l'OCDE » (2003).
*
73
Sur les
trente dernières années, les périodes de ralentissement
cyclique sont plus longues en
Europe qu'aux États-Unis.
* 74 Pour plus de précisions, voir rapport d'information du Sénat n° 89, 2006-2007, sur « les perspectives économiques 2007-2011 », présenté par Joël BOURDIN au nom de la Délégation pour la Planification.
* 75 Il faut rappeler - cf. rapport d'information Sénat n° 89, 2006-2007, de la Délégation pour la Planification - que ces révisions conduisent à réviser à la hausse l'évolution à long terme de la population active (+0,3 point par an) ainsi que celle de la population totale (+0,2 point par an). L'impact de la révision sur le PIB par tête est donc de 0,1 point (0,3 - 0,2).
* 76 L'impact de la hausse de la fécondité sur la croissance du PIB par tête ne serait toutefois perceptible que dans une quinzaine d'années.
* 77 Voir rapport Sénat, n° 89, 2006-2007, de la Délégation pour la planification.
* 78 Pour une analyse des liens croissance potentielle, population active, chômage : voir rapport Sénat, n° 89, 2006-2007, de la Délégation pour la planification (page 112).
* 79 Votre rapporteur rappelle que ceci s'explique par le retour ou l'entrée dans l'emploi de travailleurs moins qualifiés ou dont les qualifications sont devenues obsolètes du fait de leur inactivité.
* 80 Selon Thomas Piketty, Economie et Prévision, mai 1998.
* 81 AUBERT P., CRÉPON B. : « La productivité des salariés âgés : une tentative d'estimation ». Economie et statistique n° 368, Avril 2004.
* 82 Didier BLANCHET : « Le vieillissement de la population active : ampleur et incidence ». Economie et statistique, n° 355-356, 2002.
* 83 Didier BLANCHET : « Le vieillissement de la population active : ampleur et incidence ». Economie et statistique, n° 355-356, 2002.
* 84 Cf. page 89, pour l'analyse de ralentissement de la productivité horaire en France.
* 85 Alain HENRIOT, Carole DENEUVE : « Vers quelle évolution de la productivité en France », 2005.
* 86 Cf. page 91.
* 87 Une étude menée sous l'égide de l'Université de Groningue (B. van ARK, R. INKLAAR, R. MACGUCKIN, 2003) évalue à 0,8 point par an le supplément de productivité que l'Europe pourrait gagner à une utilisation intensive des TIC.
* 88 Source GGDC-INSEE, cf. Annexe, tableau A2 (page 159).
* 89 Cette expression traduit le fait que des conditions pouvant inciter un membre du couple à travailler moins, l'autre membre du couple pourra faire le même choix sans les mêmes incitations financières.
* 90 Voir l'ouvrage écrit avec Marie-Noëlle VIRARD : « Comment nous avons ruiné nos enfants » Economica (2005), ou Flash IXIS, juillet 2006.
* 91 Sur l'impact de ces révisions sur la croissance potentielle, voir rapport d'information Sénat, n° 89, 2006-2007, présenté par Joël BOURDIN au nom de la délégation pour la planification.
* 92 L'économiste Philippe AGHION, Professeur à Harvard propose une synthèse très convaincante de ces travaux. Voir notamment les deux rapports du Conseil d'analyse économique (CAE) : « Education et croissance » cosigné avec Elie COHEN (2004) ou « Politique économique et croissance en Europe », cosigné avec Jean PISANI-FERRY et Elie COHEN (2006).
* 93 Rapport Sénat, n° 391, 2003-2004, « Objectif 3 % de R et D : plus de recherche pour plus de croissance ? », présenté par Joël Bourdin au nom de la Délégation pour la planification.
* 94 Voir Philippe AGHION « A primer on innovation and growth », Bruegel Policy Brief (2006).
* 95 Selon Philippe AGHION, si le degré de réactivité de la politique budgétaire en Europe était identique à celui observé aux États-Unis, la croissance de long terme dans la zone euro serait supérieure d'un demi-point par an .
* 96 Ceci a été démontré par les travaux de G. NICOLETTI et S. SCARPETTA (2003).
* 97 Sur cette question, voir le Rapport du Conseil d'analyse économique (CAE) : « Politique économique et croissance en Europe », par Philippe AGHION, Élie COHEN et Jean PISANI-FERRY ainsi que le rapport d'information du Sénat n° 89, 2006-2007, sur « les perspectives économiques 2007-2011 », présenté par Joël BOURDIN au nom de la Délégation pour la Planification (pages 61 et 62).
* 98 Il est intéressant de constater que la Finlande fournit deux chiffres, l'un suivant une méthodologie « comptabilité nationale » et l'autre suivant une méthodologie « EFT », avec une différence de l'ordre de 3%.







