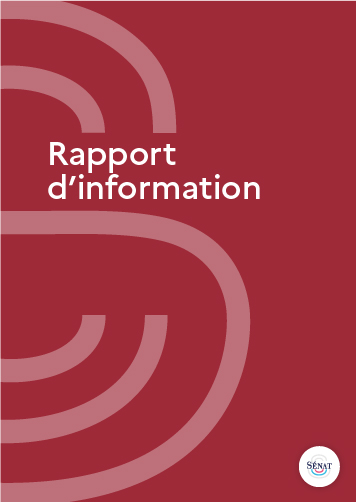Le résumé
Quels que soient les débats institutionnels et le degré d'autonomie des territoires ultramarins, l'État conserve un coeur de compétences qualifié de pouvoir régalien, portant essentiellement sur la sécurité, la défense et la justice. La délégation sénatoriale aux outre-mer, présidée par Micheline Jacques (LR Saint-Barthélemy) a décidé en 2024 d'étudier ce « noyau dur » non transférable qui fonde en grande partie la légitimité de l'État ainsi que la confiance des citoyens à son égard.
En effet, la multiplication et l'intensification des crises dans les outre mer, dont les évènements récents à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et en Martinique témoignent, interrogent la capacité de l'État à assurer pleinement ses missions premières et à construire des politiques publiques répondant efficacement aux réalités des territoires et aux besoins de leurs habitants.
À l'issue de plus d'une centaine d'auditions et après s'être rendus dans sept territoires, les rapporteurs Philippe Bas (LR Manche) et Victorin Lurel (SER Guadeloupe) dressent le constat d'une insécurité alarmante et multiforme dans la quasi-totalité des départements et régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte). Les collectivités d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna) ne sont pas épargnées.
Pour y remédier, ils appellent à un véritable choc régalien et formulent 38 recommandations pour y remédier. L'action de l'État outre-mer doit privilégier cinq orientations majeures : restaurer la sécurité au quotidien, durcir et spécialiser la lutte contre la criminalité organisée, en particulier les narcotrafics, endiguer l'immigration clandestine, en assumant une politique de fermeté, agir en État souverain face aux menaces exogènes, et restaurer la centralité de l'État autour du préfet.