3. L'évolution de flux d'aide à l'emploi en France depuis 1973
3.1. Les modes de financement
Le mode de financement prédominant repose sur le budget général de l'État, et, dans une moindre mesure, les budgets des collectivités locales. En 1993, 48,1 % du total des dépenses actives étaient financées par le budget du Ministère du Travail, 6 % par d'autres Ministères, et 4 % par les collectivités locales. De manière minoritaire, l'UNEDIC et les administrations de Sécurité Sociale contribuent également à ces dépenses (5,6 %) 14 ( * ) . Ceci correspond au financement direct par l'UNEDIC des conventions de conversion, allocations formation-reclassement et conventions de coopération. Ce mode de financement par cotisations sociales se traduit par l'application de critères d'éligibilité relevant du système d'assurance-chômage. Par exemple, les conventions de coopération sont ciblées sur les chômeurs sans emploi depuis au moins huit mois, et bénéficiant encore de droits à indemnisation. La subvention versée à l'entreprise 15 ( * ) en cas d'embauche est également calculée en fonction des droits ouverts dans le cadre du système d'assurance (six mois d'allocations).
L'originalité principale du système français réside dans l'existence d une contribution obligatoire et spécifique des employeurs à la formation professionnelle. De ce fait, la contribution des employeurs à la dépense pour l'emploi s'élevait à 36 % en 1993. Ce prélèvement a été créé en 1971, sur la base d'un accord interprofessionnel, repris sous forme législative. Son montant, calculé en pourcentage de la masse salariale, varie en fonction de la taille de l'entreprise 16 ( * ) . Il s'agit d'un prélèvement libératoire, c'est-à-dire que les entreprises peuvent être dispensées du paiement à l'État si elles réalisent elles-mêmes des dépenses de formation, soit en interne, soit sous forme de versements à des organismes de gestion du fonds de la formation professionnelle. Ce type de prélèvement constitue une forme traditionnelle de financement de la formation professionnelle au sein du système français de relations professionnelles : la taxe d'apprentissage, créée en 1925 (0,5 % de la masse salariale), fonctionne selon le même principe. Ce système a pour avantage de fournir des ressources stables pour la formation professionnelle.
Cependant, ce mode de financement paraît biaisé. En effet, le prélèvement destiné à la formation professionnelle bénéficie de manière quasi-exclusive aux salaries, les dépenses de solidarité (c'est-à-dire les mesures en faveur des chômeurs) étant principalement financées par l'État. De plus, au sein même des salariés, on note une forte sélectivité d'accès à la formation continue selon le type d'emploi occupé ou le type (l'entreprise : ainsi, d'après des données de l'enquête Formation et Qualification Professionnelle, entre 1989 et 1993, la moitié des personnes occupant un emploi de cadre ont reçu une formation. contre moins de 10 % des personnes occupant un emploi d'ouvrier non qualifié De plus, la probabilité d'être formé apparaît deux fois plus faible dans une entreprise de moins de 50 salariés par rapport à une entreprise de plus de 500 salaries (Goux et Maurin. 1997). Ce type de biais dans l'affectation des ressources est encore plus apparent dans le cas de la taxe d'apprentissage, qui finance très largement des formations initiales, sans aucun lien avec le dispositif d'apprentissage lui-même.
Toutefois, en dépit de ces dysfonctionnements et d'un " bilan mitigé " 17 ( * ) du point de vue de l'impact sur la sélectivité du marché du travail, il est indéniable que les flux financiers correspondants à cette spécificité française servent dans l'ensemble un objectif général de formation sur le marché du travail, et relèvent donc de la politique active de l'emploi.
On retiendra deux aspects, du point de vue de la relation entre structure du financement et politiques mises en oeuvre :
- le type de ressources (contributif ou non-contributif, i.e. impôts vs cotisations sociales) n'est pas neutre à l'égard des conditions d'accès aux mesures : le principe assurantiel de droits ouverts s'oppose au principe discrétionnaire lié aux mesures financées par le budget de l'État 18 ( * ) . Cette caractéristique doit être soulignée dans le cadre du débat sur 1'"activation des dépenses passives". Dans le cadre d'un système où les dépenses passives sont principalement financées par cotisation, elle implique en effet l'absence d'équivalence entre dépenses "activées" et dépenses actives ;
- dans la même perspective de l'incidence des types de financement, les systèmes de prélèvement libératoires constituent un outil incitatif intéressant (l'apport essentiel de l'accord de 1971 est sans doute l'intégration de la formation professionnelle à la gestion des ressources humaines), mais également une source de biais de sélectivité dans l'allocation des flux financiers. Ils peuvent donc être contradictoires avec la fonction redistributive de la politique de l'emploi.
3.2. Flux pour l'emploi et cycle économique
L'analyse longitudinale disponible des fluctuations des flux financiers prend comme indicateurs la dépense pour l'emploi et leur taux d'activité, indicateurs dont le caractère restrictif a été relevé
3.2.1. Les fluctuations de la Dépense Pour l'Emploi
L'analyse révèle cependant que la dépense pour l'emploi se caractérise par une croissance lente et régulière (jusqu'à un niveau supérieur à 4 % du PIB en 1996). Cette tendance peut être décomposée en trois phases :
- la première période, de 1973 à 1983, fait apparaître une forte hausse de la dépense pour l'emploi (jusqu'à 3,51 % du PIB en 1983), avec une accélération au cours des trois dernières années ;
- cette période est suivie d'une phase de stabilisation (1984-1987), et par deux années de baisse relative de la dépense (-2,7 % entre 1987 et 1988, -6,4 % entre 1988 et 1989), correspondant au retournement à la hausse de la conjoncture à la fin des années quatre-vingts ;
- l'accroissement du niveau de la dépense reprend pendant la première moitié des années quatre-vingt-dix, ce qui peut être mis en relation avec le ralentissement de la croissance et l'accroissement du chômage.
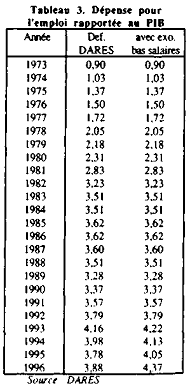
D'après ces données, il ne semble pas que la dépense de politique de l'emploi française ait réagi aux cycles économiques avant le milieu des années quatre-vingts : en effet, la courbe de l'évolution des flux d'aide a l'emploi (graphique 1) ne montre aucune variation cyclique pendant les années 1973-1988. On a ainsi un effort de la collectivité par chômeur globalement stable.
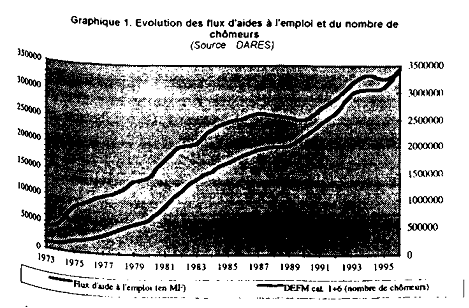
Nous analyserons ultérieurement les composantes de cette phase de croissance régulière. À partir de 1988, l'évolution de la dépense semble suivre approximativement le cycle, en particulier à la hausse de 1991 à 1993. Si l'on reprend la définition de la dépense pour l'emploi au sens de la DARES, il y a une diminution à partir de 1993 (de 4,16 % à 3,88 % du PIB en 1996). Comme on peut le constater sur le graphique 1 ci-dessus, cette baisse est compensée par la montée en charge des différents dispositifs d'exonération de cotisations sociales. Cette évolution coïncide néanmoins avec une tendance au ralentissement de la hausse du chômage 19 ( * ) .
3.2.2. Le taux d'activité de la politique de l'emploi
Deux périodes peuvent être clairement distinguées :
- entre 1973 et 1985, a part relative des mesures passives dans la DPE s'est accrue (de 34.1 % à 67,3 %, i.e. de 0,3 % à 2,43 % du PIB). Cette augmentation était le résultat d'une part de la hausse du chômage, en particulier du chômage de longue durée, d'autre part du développement des mesures de préretraites ;
- à partir de 1985, la part des dépenses actives commence à s'accroître. Cette évolution apparaît dans un premier temps comme l'effet indirect de la réduction des montants consacrés aux préretraites (le taux d'activité augmente, malgré une variation très faible des dépenses actives en pourcentage du PIB), puis comme la conséquence propre du développement des dépenses actives (à partir de 1990) 20 ( * ) .
Les spécificités françaises sur la période 1973-1997 sont donc d'une part l'impact des mesures de préretraites sur la structure de la dépense dans les années 1980, d'autre part la priorité accordée à l'activation des dépenses de politique de l'emploi depuis 1989 / 1990. Il s'agit à chaque fois du résultat d'une volonté politique, dont l'impact final est très probablement accentué par le système de financement. Ce type d'analyse s'applique en particulier au cas des préretraites dans les années 1980.
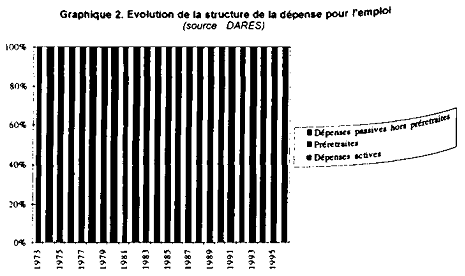
Le graphique 2 fait apparaître le profil très marqué de l'évolution des dépenses consacrées à ces programmes (hausse puis réduction très forte, le pic étant atteint en 1982-1984). Dans le même temps, le trend fortement croissant des dépenses actives à la fin des années soixante dix est renversé à partir de 1979, et stabilisé pendant la première moitié des années quatre-vingts.
La baisse des dépenses de préretraite coïncide ensuite avec la reprise de la croissance de dépenses actives. Dans la perspective de Schmid et al (1992), cette concomitance conduit l'hypothèse d'un effet d'éviction financière 21 ( * ) des dépenses actives par les préretraites, au sein du budget de l'État. Cette hypothèse semble cohérente avec une analyse institutionnelle du mode de financement des mesures mises en place au début des années quatre-vingts : création et le développement du régime des allocations spéciales du FNE (AS-FNE) 22 ( * ) relèvent en effet du budget de l'État. Parallèlement, l'abaissement de l'âge de la retraite en 1983 reporte sur la collectivité une partie des charges du régime "garantie de ressources" 23 ( * ) . On peut interpréter l'accroissement du poids de l'État 24 ( * ) dans le financement des mesures de préretraite, renforcé par l'impact indirect de mesures législatives sur 1e système de financement, comme un facteur explicatif du faible niveau et de l'inertie de dépenses actives dans les années quatre-vingts.
La décomposition entre dépenses actives et dépenses passives que nous exposons le reprend les données de la DARES et n'inclut donc pas plusieurs flux financiers de collectivités publiques. D'une part, les exonérations généralisées sur les bas salaires et les interventions économiques des collectivités locales devraient logiquement être intégrée : dans les dépenses active, comme les flux financiers en faveur de la réduction du temps de travail. À l'opposé, les flux financiers consacrés au RMI devraient prendre place dans les dépenses passives, puisque comme le montre une étude récente, ce dispositif joue désormais le rôle d'un troisième mode d'indemnisation du chômage, en plus des ASSEDIC et de l'ASS (Audier, Dang et Outin, 1998). Compte tenu des sommes en jeu, la tendance à la prédominance des dépenses dites actives n'est pas remise en cause par l'inclusion de ces divers flux financiers. Au contraire, comme nous l'avons déjà évoqué plus haut, elles tendraient à augmenter la part des dépenses actives.
La seule décomposition des flux entre les dépenses passives et actives est, nous l'avons souligné , insatisfaisante parce qu'elle ne dit rien sur la nature des mesures mises en oeuvre.
C'est pourquoi il est nécessaire de désagréger les flux financiers compte tenu des objectifs affichés pour chacune des mesures qu'ils supportent.
3.3. Structure des flux financiers en matière d'emploi
3.3.1. Évolution de la structure des flux financiers en matière d'emploi par catégorie de mesure
L'objectif est ici de préciser la structure des flux d'aide à l'emploi en France. Dans le cadre de cet "état des lieux", les informations disponibles sont fournies par les comptes pour l'emploi qui recensent l'ensemble de la dépense publique pour l'emploi. Nous lui ajouterons les mesures d'ordre général portant sur la réduction du coût du travail. Les séries représentées sur le graphique 3 reproduisent la catégorisation des mesures issue des Comptes pour l'Emploi en France.
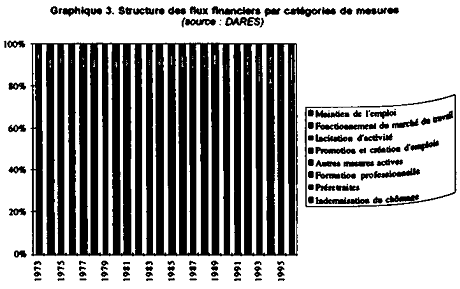
Ces classifications sont synthétisées dans l'encadré ci-dessous. Nous ne détaillerons pas dans ce qui suit le contenu des mesures, l'objectif étant avant tout d'identifier les structures, types d'intervention et leur dynamique.
En termes d'importance relative des différentes catégories, la France se caractérise par la place prédominante de la formation : d'après les travaux de la DARES (1996), on peut estimer que ce résultat ne serait pas modifié par une mesure des dépenses de formation restreinte aux chômeurs et aux jeunes. Cette hiérarchie des niveaux de dépense diffère du cas suédois jusqu'en 1986 (prédominance des mesures de création d'emplois) ; depuis, si l'on excepte les mesures en faveur des handicapés, l'ordre est le même en France et en Suède.
|
Les catégories de la Dépense pour l'Emploi Les Comptes de l'Emploi distinguent cinq catégories de dépenses actives, comprenant : (1) Maintien de l'emploi : l'indemnisation du chômage partiel, du chômage tempor a ire (chômage-intempéries), les ateliers de travail protégé des handicapés. (2) Promotion de l'emploi et créations d'emplois : les exonérations et primes à l'embauche, les programmes de créations d'emplois dans le secteur public et non-marchand, l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises, les primes régionales et d'aménagement du territoire, les primes et subventions à l'emploi des handicapés ; (3) Incitation à /' activité : les primes de mobilité, les aides a l'installation (agriculture), la garantie de ressources et les prêt à l'installation des travailleurs handicapés ; (4) Formation professionnelle : la formation destinée aux de m a n deu r s d'emploi et aux jeunes (AFPA, stages de formation du FNE, alternance...), la formation continue destinée aux actifs occupés financée par les entreprises ; ( 5) Perfectionnement du fonctionnement du marché au travail : le budget de fonctionnement et d'équipement de l'ANPE, les aides à la recherche d'emploi. |
Enfin, un dernier élément de différenciation des évolutions générales concerne le profil des évolutions. En France, l'ensemble des catégories de dépenses suit un trend croissant, avec des phases limitées d'accélération ou de réduction. Ceci contraste avec l'ampleur des variations observables pour la Suède, et le profil contra-cyclique des dépenses de création d'emplois jusqu'à la fin des années 1980.
De manière plus précise, trois catégories de dépenses peuvent être distinguées dans les comptes pour l'emploi.
* Tout d'abord, la catégorie " fonctionnement du marché du travail " correspond principalement à la subvention de l'État à l'ANPE, donc au financement des activités de placement. Elle suit une tendance régulière à la hausse sur toute la période (de 0,02 % du PIB en 1973 à 0,07 % du PIB en 1996). On peut remarquer qu'il s'agit d'un rythme de croissance inférieur à celui du nombre de demandeurs d'emploi inscrits : la dépense consacrée à l'ANPE a été multipliée par cinq, et le nombre de DEFM par huit. La comparaison avec les autres pays rend la faiblesse de ces montants particulièrement évidente. Au-delà des flux de dépenses, ce constat est renforcé par la faible part de marché de l'ANPE (elle est estimée à environ un quart de l'ensemble des vacances d'emplois).
* La place prédominante de la formation au sein des dépenses actives constitue une caractéristique importante du cas français 25 ( * ) . Le montant de la dépense correspondante, en pourcentage du PIB, a augmenté régulièrement sur toute la période (sauf depuis 1994). Les calculs de la DARES (1996, 1997) permettent de décomposer cet accroissement en une double dynamique : d'une part les dépenses de formation des actifs (en emploi) ont augmenté de manière régulière, d'autre part les dépenses en faveur des jeunes et des chômeurs ont suivi une tendance plus irrégulière, mais fortement orientée à la hausse. En conséquence, la structure de la répartition financière entre ces deux types de bénéficiaires s'est modifiée. En 1973. la formation des actifs s'élevait à 16 milliards de francs, et celle des jeunes et des chômeurs à 6 milliards ; en 1993, les montants des dépenses consacrées| aux deux catégories sont égaux (40 milliards de francs), en 1994 et 1995, la formation professionnelle des actifs devient à nouveau légèrement plus importante 26 ( * ) .
* L'évolution la plus importante concerne, enfin, la catégorie des dépenses de "création et de promotion de l'emploi ", qui passe de 0.04 % du PIB en 1973 à 0,58 % en 1996 27 ( * ) . Cette catégorie se caractérise par sa diversité, puisqu'elle regroupe des mesures hétérogènes, principalement des subventions à l'embauche et des mesures de création \ directe d'emplois, et sa variabilité temporelle. En effet, elle comprend une succession de mesures dont la plupart n'ont qu'une durée de vie limitée, suivant un cycle politique très net. Trois principales phases de développement peuvent être distinguées :
- la période 1977-1981, avec la création des Pactes pour l'Emploi des Jeunes, qui initient un mode d'intervention fondé sur des exonérations de charges ;
- entre 1985 et 1987, les Gouvernements de gauche et de droite relancent les dispositifs d'aide à l'emploi, par une mesure de création d'emplois dans le secteur non-marchand (Travaux d'Utilité Collective), des stages en entreprises (SIVP), et par une série de mesures à nouveau concentrées sur les jeunes dans le cadre du Plan d'Urgence (exonérations de charges à l'embauche, principalement) ;
- enfin, les années 1990 marquent une phase de développement quantitatif de ce type de mesures, sur la base d'un grand nombre de nouveaux dispositifs 28 ( * ) , qui exploitent l'ensemble des modalités d'aide à l'emploi, selon deux logiques prédominantes : la création d'emplois dans le secteur non-marchand, et l'abaissement du coût du travail pour les catégories en difficulté sur le marché du travail (jeunes, chômeurs de longue durée) dans le secteur marchand.
3.3.2. La période récente : des dispositifs ciblés aux mesures d'ordre général
Si les flux financiers en matière d'emploi ont pris une importance grandissante depuis 1973, leur objectif n'a pas toujours été clairement énoncé. Rétrospectivement, on peut dire que leur objet a oscillé et continue d'osciller entre deux objectifs.
Un premier objectif vise, à volume d'emploi donné, une redistribution des chances d'accès à l'emploi. Il s'agit d'atténuer la sélectivité du marché du travail, dans l'attente d'une reprise conjoncturelle susceptible d'accroître le volume de l'emploi. Cet objectif s'est progressivement affirmé comme le coeur de la politique de l'emploi au cours des décennies 1980 et 1990. Il consiste à mettre en oeuvre le principe d'une discrimination positive pour améliorer l'employabilité, c'est-à-dire la probabilité d'accéder i un emploi, pour les catégories vulnérables face au chômage et les plus exposées à la sélectivité du marché du travail - jeunes, non-qualifiés, chômeurs de longue durée... - (Comité interministériel de l'évaluation des politiques publiques, 1997). On attend alors des mesures publiques qu'elles puissent infléchir les pratiques de recrutement des entreprises en direction de ces catégories en modifiant l'ordre de la file d'attente des chômeurs.
Dès lors, l'administration s'attache à définir la catégorie défavorisée, celle qui va servir de cible aux dispositifs des politiques d'emploi : le public.
L'identification de la cible renvoie soit à l'analyse des mécanismes économiques et des phénomènes qui structurent le marché du travail, mais aussi aux déficits supposés des différentes populations, notamment au travers de certaines théories.
Un deuxième objectif est un objectif de stimulation de la demande de travail, afin d'enrichir contenu en emploi de la croissance. Il consiste à favoriser la création d'emplois supplémentaires et le développement d'activités nouvelles utiles socialement Les instruments utilisés à cet effet sont essentiellement des mesures d'ordre général. Celles-ci se sont progressivement centrées au cours des années 1990 vers l'abaissement du coût de travail. Depuis 1995, l'incitation à la réduction de la durée collective du travail comme instrument de création d'emploi a été exploré par la loi Robien puis la loi Aubry.
|
Les difficultés de mise en oeuvre des
dispositifs ciblés :
Le premier problème consiste dans la définition administrative de la catégorie cible. D'où pour les jeunes l'émergence de la catégorie des 16-25 ans. qui existe déjà statistiquement. La borne inférieure provient tout naturellement de l'âge légal de fin de scolarité obligatoire et donc de début d'entrée dans la vie active. L'allongement progressif de la borne supérieure (21 ans dans le rapport Schwartz, 25 ans dans les années 1980. 26 voire 30 ans avec les CEC et les emplois-jeunes) correspond à la perceptif du phénomène de prolongation des études et d'augmentation de lige médian de sortie du système éducatif (de 18 a 21 ans au cours des deux dernières décennie s ). La situation des jeunes est caractérisée dans la plupart des pays par l'existence d'un effet d'âge : le taux de chômage des jeunes est deux à trois fois supérieur à celui des adultes. Cependant, tous ne réagissent pas de la même manière, car l'indicateur politiquement sensible demeure le aux de chômage des jeunes Il n'est pas surprenant que les pays anglo-saxons interviennent peu. puisque comme on l'a vu précédemment, l'essentiel de la politique de l'emploi est constitué de mesures passives. Quand le taux de chômage des jeunes est important, certains pouvoirs publics tentent une action spécifique pour cette cible (Fiance. Italie. Finlande). Mais celle attitude n'est pas la seule suivie, puisque, par exemple l'Espagne n'en fait pas une priorité. Les difficultés des jeunes dans leur insertion professionnelle proviennent selon les modèles théoriques néoclassiques d'une productivité trop faible en comparaison des autres actifs (Gautié, 1995). Les jeunes parce qu'Us sont moins qualifiés, parce qu'ils débutent, ont en général une productivité inférieure au coût du travail aux conditions de droit commun. Il s'agit là de la représentation néoclassique du marché du travail. Rejetant l'idée d'une rémunération légale plus faible pour les jeunes (hormis pour les moins de 18 ans), les dispositifs vont donc s'orienter vers des mesures de subvention de l'emploi des jeunes, avec comme objectif de diminuer le coût du travail des débutants. Par ailleurs, l'analyse des trajectoires des jeunes sur le marché du travail montre très vite que le diplôme est un élément protecteur contre le chômage, notamment pour les plus formés. Les politiques publiques vont donc également tenter d'améliorer la formation des jeunes peu ou pas diplômés. Les difficultés d'accès à l'emploi étant liées à une faiblesse de qualification ou de compétence, la politique de l'emploi tente de combler ces faiblesse par la formation et par l'expérience professionnelle C'est pourquoi, les mesures de formation en alternance apparaissent capables de répondre aux besoins. des jeunes les plus défavorisés (d'autant qua l'issue du contrat le bénéficiaire peut acquérir un diplôme ou se voir certifier une qualification). Ces deux handicaps sont parfois intégrés dans le même dispositif, comme c'est le cas avec de nombreux contrats aidés du secteur marchand, cumulant un soutien à l'acquisition de qualification par la formation en alternance (formation subventionnée) et un a baissement du coût du travail des jeunes (salaire inférieur au SMIC, exonération de cotisation s sociales...). Néanmoins, l'analyse attentive du marché du travail montre que les problèmes d'accès à l'emploi concernent surtout les débutants. Or, la politique de remploi cible les "jeunes", ce qui n'est pas la même chose. Certains individus du même âge ayant déjà 4 ou 5 ans d'ancienneté sur le marché du travail, tandis que d'autres viennent de quitter le système éducatif. La population jeune est, de ce point de vue, assez hétérogène (Meron et Minm. 1995 ; Vincens 1996 et 1997). Si le phénomène d'"allongement de la jeunesse" se traduit par le fait que de plus en plus de jeunes sortent tardivement de l'école. l'allongement simultané des catégories cibles (26 et même 30 ans dans le plan emploi-jeunes) maintient l'hétérogénéité du groupe cible. Par ailleurs, les variables individuelles (origine sociale, sexe, lieu d'habitation) ont aussi une influence sur l'insertion professionnelle des jeunes (Minni et Vergnies, 1994 : Ponthieux, 1997). Ceci vient également perturber la vision traditionnelle globalisante de la catégorie "jeune" 29 ( * ) |
Les mesures d'ordre général sont cependant contraintes par l'environnement macro-économique lui-même. Les entreprises ne sont pas incitées à accroître leur volume d'emploi si la conjoncture ne les y incite pas. Il revient alors à la politique macro-économique, par l'action monétaire et/ou budgétaire d'envisager l'amélioration de cet environnement. En deuxième lieu, nombre de mesures d'ordre général sont elles-mêmes dépendantes des possibilités de financement qu'une nation peut dégager.
Compte tenu du coût que représentent désormais les flux en matière d'emploi, l'évaluation de leur efficacité au vu des objectifs définis a sensiblement réorienté le coeur de la politique de l'emploi. Malgré l'apparente hétérogénéité, voire le peu de cohérence des mesures successives mises en oeuvre dans le cadre de la politique de l'emploi en France (Gautié et al., 1994), il est néanmoins possible de décrire comme suit la tendance récente du point de vue des grands objectifs affichés. Organisée à l'origine autour de mesures ciblées sur certains demandeurs d'emploi, l'orientation des flux financiers en matière d'emploi est passée au cours de la dernière décennie à une approche plus généraliste, où l'objectif de contre-sélectivité tend progressivement à être placé derrière celui du soutien à la création d'emploi. Les dispositifs ciblés se sont ainsi développés jusqu'à 1993 où la part des flux financiers bascule progressivement en direction des mesures non-ciblées (Daniel, 1998). Par exemple, selon les définition de la DARES les aides ciblées représentaient 76,4 % des mesures d'allégement du coût du travail en 1993, et seulement 40.2 % en 1996. Dans l'ensemble des aides à l'emploi salarié (secteur marchand et secteur non marchand), les mesures générales représentent dorénavant plus de 50 % des flux financiers (cf. tableau 4).
Plusieurs limites à l'extension des politiques ciblées ont en effet pu être recensées.
* Premièrement, on constate que la politique de l'emploi a de telles difficultés face à la sélectivité du marché du travail parce que les mécanismes de substitution jouent prioritairement entre jeunes plutôt que vis-à-vis des adultes. Le problème vient du fait que plus la mesure est généraliste (la cible est large), plus la sélectivité est forte au détriment de ceux jugés les moins employables.
À l'inverse, plus elle met en avant des mesures ciblées, plus la politique de l'emploi tente de lutter contre la sélectivité du marché du travail, et de pallier les manques des bénéficiaires des mesures : il s'agit de modifier les "signaux" que ces derniers émettent en direction des entreprises, ou, au moins, de les accompagner de stimuli positivement reçus par les employeurs (Dayan, 1994).
* Pour autant, une deuxième limite des politiques ciblées peut être relevée : toute mesure très ciblée, notamment sur les plus défavorisés (en formation, en productivité estimée...), fait peser sur ses bénéficiaires des risques évidents de stigmatisation (Daniel. 1998).
* Mais surtout, et il s'agit d'une troisième limite, de nombreux travaux ont mis en évidence que ces politiques pouvaient manquer leur cible. Ainsi, au sein même des dispositifs ciblés on assiste à un élargissement des bénéficiaires au delà des catégories-cibles, notamment dans la catégorie jeune.
Dès le premier pacte pour l'emploi (Juillet 1977), les publics initialement visés (les jeunes les moins qualifiés), ne sont pas les plus concernés. En effet, les jeunes de niveaux V bis et VI non diplômés ne représentent que 24 % des contrats emploi formation et 20 % des stages pratiques en entreprises (Santelmann, 1993)
En outre, si l'on observe ce qui s'est passé depuis dix ans pour les mesures en faveur des jeunes, on s'aperçoit que les dispositifs voient le niveau de formation de leurs bénéficiaires s'élever. Ainsi parmi les jeunes qui ont signé un contrat de qualification, ceux dotés d'un diplôme de niveau III, II ou I, supérieur ou égal à Bac+2 étaient 12,3 % en 1990 mais 19,3 % en 1996, alors qu'à l'inverse, les jeunes de niveaux V bis et VI non-diplômés sont passés de 15,5 % à 8,7 % sur la même période. C'est pourtant un contrat qui s'adresse aux jeunes dépourvus de qualification ou dont la qualification est inadaptée.
Cette évolution, pour laquelle certains parlent de dérive (Vespa, 1995), de dévoiement à l'égard des objectifs de départ, se retrouve pour le contrat d'adaptation et même pour les CES. Ce phénomène est propre aux jeunes puisque pour l'ensemble des bénéficiaires des contrats aidés, il n'y a pas d'augmentation du niveau de formation (DARES, 1996).
La dérive du contrat de qualification est un bon indicateur de ces phénomènes en cours sur le marché du travail et du rôle de la politique de l'emploi. Elle relève d'une part d'une progression de l'emploi tertiaire (qui recrute principalement des individus de niveau IV Bac), du poids des grandes entreprises (qui recrutement des salariés plutôt plus formés que la moyenne) mais aussi de l'action des organismes privés de formation, qui se servent du CQ pour diminuer les coûts de scolarité (Gautié et Lefresne. 1997).
Notons que le critère d'absence de formation est également assoupli : avec l'APEJ (aide au premier emploi des jeunes, supprimée en 1996 pour des raisons budgétaires), qui succède au défunt CIP, l'État accorde une subvention aux entreprises pour tout embauche d'un jeune de moins de 26 ans, sans référence au niveau de formation.
Dans un marché du travail en situation de pénurie et fonctionnant en file d'attente, ces éléments conduisent donc à lever l'avantage relatif dont pouvaient disposer les moins qualifiés du fait de la politique de l'emploi.
* Enfin, une quatrième limite est représentée par ce que nous appelons un effet de segmentation du marché du travail. Postuler qu'en raison de l'acceptation d'une hypothèse de productivité inférieure (qui reste à démontrer empiriquement), les jeunes ne peuvent accéder à l'emploi qu'à partir du sas de contrats particuliers aidés débouche sur la conclusion qu'il ne saurait à l'avenir y avoir de première embauche sur des emplois typiques (non-aidés et à durée indéterminée). Autrement dit, la norme d'emploi pour l'insertion des jeunes tend à se déplacer vers une nouvelle forme d'emploi aux caractéristiques plus précaires. Ce phénomène ajoute à la segmentation du marché du travail car il interdit de fait toute mobilité ascendante vers une situation salariée stabilisée avant 25 ans.
C'est donc en partie parce qu'elles ont conscience de ces dérives que les politiques publiques ont cherché périodiquement à redéfinir les publics cibles, à recentrer les dispositifs (Gautié et Lefresne, 1997).
Dans la période de reprise conjoncturelle 1997-98, l'arbitrage entre mesures ciblées et généralistes n'est pas de prime abord tranché. En forçant le trait, les arguments en présence au moment des arbitrages peuvent être présentés comme suit :
Un argument en faveur des mesures ciblées considère que les dispositifs spécifiques demeurent nécessaires pour résorber la sélectivité du marché du travail et permettre l'insertion ou la réinsertion des publics défavorisés par des mesures ciblées. Ainsi, malgré les limites inhérentes aux mesures ciblées que nous venons de relever, l'effet anti-sélectif du CIE s'est traduit par le fait que 50 % des embauches n'auraient pas concerné le même type de public sans ce dispositif (Gelot, 1997). Selon cette ligne d'argumentation, les mesures générales de type exonérations non-ciblées de cotisations sociales ne sont pas réputées nécessaires en période de reprise pour stimuler l'emploi compte tenu de l'accroissement des carnets de commande qu'exerce ta reprise sur l'activité des entreprises. Cette assertion est d'autant plus valable dans un contexte de prédominance d'un chômage keynésien dû à une insuffisance de débouchés.
À l'opposé, un argument en faveur des mesures généralistes estime que les dépenses pour l'emploi doivent suivre une logique contra-cyclique ; celle-ci consiste à déstocker les flux en direction des publics cibles pour mieux restocker ces flux en période de récession. Les exonérations généralisées sont alors réputées nécessaires pour modifier la combinaison productive de toutes les entreprises pour rendre les choix techniques à terme plus riches en travail.
Le tableau 4 ci-dessous récapitule la structure des principales aides à l'emploi salarié où, pour la première fois en 1997, la part des mesures générales dépasse les mesures ciblée. À elles seules les "exonérations de cotisations sur les bas salaires" représenteraient 44,8 milliards selon les données disponibles pour 1997. Le total des exonérations d'ordre général, comprenant les abattements pour le temps partiel, la loi Robien et les diverses exonérations territoriales et sectorielles représentent 54,5 milliards de francs.

3.4. La politique de l'emploi et ses bénéficiaires : sept périodes depuis 1973
Jusqu'ici, nous avons surtout mis l'accent sur l'évolution des flux financiers d'aide à l'emploi. Si l'on s'intéresse à l'évolution des bénéficiaires des différentes mesures, on observe sept périodes depuis 1973.
En effet, après la tentative de retour à la "normale" au cours des années 1974-1975 consécutive au choc pétrolier de 1973 et à la montée du chômage, la politique connaît un essor à partir de 1976. Jusqu'au début des années 1980. il s'agit d'accompagner les restructurations dans l'industrie ; de réduire la population active au travers de mesures d'aides au retour des travailleurs étrangers et de retrait progressif des travailleurs âgés (avec l'accroissement des préretraites) ; enfin, un accent important est mis sur la lutte contre le chômage des jeunes (créations des premiers contrats aidés du secteur marchand).
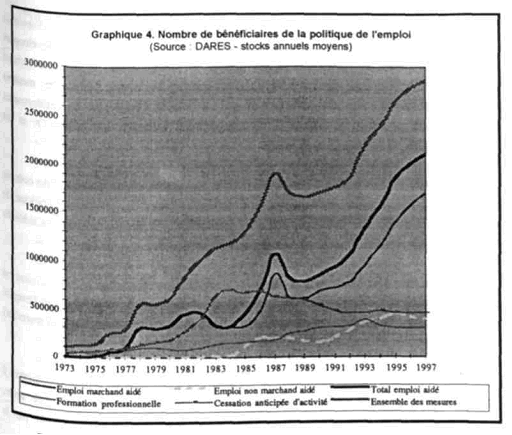
De 1981 à 1983, la politique de l'emploi connaît une pause, mises à part les cessations anticipées d'activité qui atteignent leur point culminant à cette période. Les pouvoirs publics se sont concentres sur des mesures générales comme l'augmentation de l'emploi public ou la réduction du temps de travail. En ce qui concerne les jeunes, suite au rapport Schwartz, l'action publique connaît également un fléchissement et une réorientation en direction des populations les plus défavorisées, avec la mise en place d'une gestion localisée et individualisée des dispositifs (création des PAIO et missions locales).
En 1983, la politique de l'emploi renoue avec une perspective d'action spécifique, à la fois en direction des jeunes (développement des formations en alternance), des chômeurs de longue durée (y compris en s'appuyant sur l'aide à la création d'entreprise). C'est aussi le début des actions en faveur de l'emploi non marchand.
De 1986 à 1988, les pouvoirs publics accentuent l'ampleur des actions, notamment en vue d'abaisser le coût du travail des jeunes, tout en favorisant la gestion de la main-d'oeuvre Les mesures dans le secteur non marchand progressent également avec la création des associations intermédiaires.
Au début des années 1990, l'action publique chercher à unifier certains dispositifs notamment pour les aides à l'emploi non marchand (création du CES), tout en développant des aides ciblées sur l'embauche de chômeurs de longue durée dans le secteur marchand (création du contrat de retour à l'emploi). Dans le même temps sont lancées des mesures d'exonération de cotisations, pures subventions à la création d'emploi par les entrepreneurs individuels ("exo. 1er salarié"), à l'emploi des jeunes ("exo-jeunes") et au développement du travail à temps partiel.
À partir de 1993, on assiste à l'extension des mesures d'abaissement généralisé du coût de travail par le biais des exonérations de cotisations sociales. La politique spécifique de l'emploi poursuit son développement, avec un accroissement marqué des contrats aidés du secteur marchand (CIE) et un tassement des contrats du secteur non marchand.
De même que pour l'évolution des dépenses, la progression du nombre de bénéficiaires est très forte, puisque les personnes qui étaient dans un dispositif de la politique de l'emploi représentaient 0,47 % de la population potentiellement active (population en âge de travailler) en 1973 et 10.86 % en 1997, selon les définitions de la DARES.
Il est évident que dans une approche plus exhaustive de la politique de l'emploi, conforme à celle que nous avons adopté pour les flux financiers, cette évolution est encore plus nette notamment pour la dernière période, puisque s'ajoutent les salariés concernés par la généralisation des mesures d'exonération des cotisations sociales (cf. Tableau 6).
Néanmoins, on ne peut en rester à une approche trop univoque des différents dispositifs, car ils renvoient i des logiques économiques diverses. C'est pour cela que nous avons choisi de construire une typologie des mesures, correspondant aux types de bénéficiaires et aux différents objectifs des dispositifs.
* 14 Source DARES
* 15 Ou au bénéficiaire lui-même s'il crée sa propre entreprise .
* 16 Jusqu'en 1992 les entreprises de moins de 10 salariés en étaient exemptées. Depuis 1992, la construction s'élève à 0,15 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 10 salariés, et à 1,5 % pour celles de plus de 10 salaries.
* 17 Goux et Maurin (1997), p 54.
* 18 Ceci est en conformité avec les principes généraux des politiques sociales (assurance vs solidarité).
* 19 Le taux de croissance des DEFM (catégorie 1) passe de 8,9 % en 1993 à 5,0 % en 1994.
* 20 Cette hausse fait plus que compenser les conséquences sur le taux d'activité de la croissance des dépenses d'indemnisation du chômage.
* 21 Schmid analyse cet effet d'éviction (overcrowding effect) dans une perspective plus générale : un financement
intégré des politiques actives et passives conduit : selon l'auteur à un risque plus important d'éviction des dépenses actives par les dépenses passives, en cas de montée du chômage C'est ce principe que nous appliquons ici au cas des
préretraites.
* 22 C'est la mesure qui connaît le développement le plus important à cette période. Elle fut créée en 1981, les entrées dans cette mesure étant stoppées en 1983.
* 23 Ce transfert de charges a lieu au travers de la création d'une structure spécifique (l'Association pour la Structure Financière - ASF), financée par une cotisation sur les salaires et par une subvention de l'État.
* 24 La part de l'État dans les dépenses de préretraite passe de 2,6 % en 1978 à 36,4 % en 1983.
* 25 En 1973. elle représentait 56 % du total de la DPE. Cette put relative s'est réduite (29 % en 1995) du fait de l'accroissement des autres catégories de dépenses.
* 26 Elle correspond alors à 16 % du total de U DPE. contre 14 et 13 % pour la formation des jeunes et chômeurs en 1994 et 1995, respectivement.
* 27 Soit 40 milliards en incluant les " exonérations non compensées"
* 28 La liste des mesures créées depuis 1990 dus cette catégorie est la suivante (entre parenthèses les dates de mise en place, et, le cas échéant, de suppression des mesures) :
Emploi non-marchand aidé :
Contrat Emploi Solidarité (90-). Contrat Emploi Consolidé (92-) ; Contrat Emploi de Ville (96-) ;
Emploi non-marchand aidé :
Contrat de Retour à l'Emploi (89-95). Contrat Initiative Emploi (95-). Entreprises d'Insertion (90-). Emploi Familiaux (92-). Allégement des charges sur les bas salaires (93-). exo-jeunes (91-93), exo-premier salarié (89-). abattement temps partiel (92-). [Source : DARES (1997. p 43)]
* 29 Ce qui a été en partie intégré par les pouvoirs publics qui ont développé récemment de nouvelles cibles "jeunes" : "jeunes issus de quartiers à l'habitat dégradé" des contrats-ville, du programme TRACES du plan de lutte contre l'exclusion.







