Rapport d'information n° 329 (1998-1999) de M. Gérard BAPT, député, fait au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques, déposé le 29 avril 1999
Disponible au format Acrobat (12 Moctets)
-
ETUDE ÉVALUANT LE RÔLE DES FLUX
FINANCIERS ENTRE LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES ET LES ENTREPRISES EN
MATIÈRE D'EMPLOI
-
INTRODUCTION
-
PREMIERE PARTIE - L'ÉFFICACITÉ DES
FLUX FINANCIERS EN MATIERE D'EMPLOI : L'ÉTAT DES LIEUX
-
DEUXIÈME PARTIE - LES NOUVELLES PISTES DE LA
POLITIQUE DE L'EMPLOI : PREMIÈRES ÉVALUATIONS
-
CONCLUSION GÉNÉRALE
-
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
-
ANNEXES
|
N°1547 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE |
N° 329 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999 |
|
Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale
|
Annexe au procès-verbal de la
séance
|
OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION
DES
POLITIQUES PUBLIQUES
RAPPORT
sur
LE RÔLE DES FLUX FINANCIERS
ENTRE LES
COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
ET LES ENTREPRISES EN MATIÈRE
D'EMPLOI
Par
M. GÉRARD BAPT,
Député
TOME II
ANNEXE
La composition de l'Office figure au verso de la présente page.
L'Office d'évaluation des politiques publiques est composé de MM. Alain Lambert, Président ; Augustin Bonrepaux, premier vice-président ; Laurent Dominati, Didier Migaud, Guy Poirieux, vice-présidents ; Gérard Bapt, Pierre Fauchon, Michel Grégoire, Serge Vinçon, secrétaires ; Mmes Marie-Hélène Aubert, Maryse Bergé-LaVigne, MM. Alain Barrau, Jacques Bimbenet, Michel Bouvard, Gilles Carrez, Michel Charasse, Michel Charzat, Mme Martine David, MM. Marcel Debarge, Patrick Delnatte, Charles Descours, André Ferrand, Bernard Fournier, Yves Fréville, Edmond Hervé, Didier Quentin, Paul Loridant, Philippe Marini, Pierre Méhaignerie, Arthur Paecht, Jean Vila, Jacques Oudin.
Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne
METIS (CNRS - URA n° 919) 1 ( * )
106-112 Bd de l'Hôpital, 75013 Paris
Tél. : 01-55-43-41-70
ETUDE ÉVALUANT LE RÔLE DES FLUX FINANCIERS ENTRE LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES ET LES ENTREPRISES EN MATIÈRE D'EMPLOI
Commandée par l'Office Parlementaire d'Évaluation des Politiques Publiques
Coordonnée par
HOANG NGOC Liêm
(Université de Paris I - METIS)
Christine ERHEL (Université de Paris I -
METIS)
Martine GADILLE (CNRS - LEST)
Rémy HERRERA (CNRS -
EUREQUA)
Tristan KLEIN (Université de Paris I - METIS)
LE VAN
Cuong (CNRS - CERMSEM)
Katia MIROCHNITCHENKO (CNRS - LEST)
Rapport final
mars 1999
INTRODUCTION
Les politiques publiques pour l'emploi n'ont cessé de se développer depuis le milieu de la décennie soixante-dix pour faire face à la montée et à la persistance du chômage de masse. Les flux financiers correspondant aux catégories recensées par la Dépense Publique pour l'Emploi (DPE) de la DARES s'élevaient en 1997 à plus de 300 milliards de francs, soit 4 % du PIB.
Les dispositifs de politique publique que soutiennent ces flux visent à indemniser les victimes du chômage et à compléter la politique macro-économique dont l'objectif principal est de soutenir la croissance ou de la stabiliser. Quatre types d'objectifs justifiant le développement de ces flux peuvent être relevés.
Le premier objectif est celui du traitement social du chômage et de la prise en charge des retraits anticipés d'activité.
Le deuxième objectif vise à rendre la croissance plus riche en emplois. Cet objectif s'est affirmé avec le ralentissement durable de la croissance depuis deux décennies.
Le troisième objectif est d'assister les entreprises dans leur processus d'innovation en les aidant à améliorer la qualification des emplois et des hommes par des aides à la formation continue.
Le quatrième objectif est de lutter contre la "sélectivité" du marché du travail afin de modifier l'ordre d'une file d'attente persistante de chômeurs en centrant certaines mesures sur des publics cibles réputés moins employables.
Les nombreux dispositifs mis en place successivement au cours de ces deux dernières décennies ont oscillé autour de ces différents objectifs.
Les dépenses d'indemnisation chômage n'entrent pas dans le champ de cette étude dans la mesure où elles dépendent de la gestion paritaire de l'UNEDIC.
Parmi les dispositifs relevant du financement des collectivités publiques, nous distinguerons les mesures d'ordre général, dont l'objectif est d'enrichir le contenu en emploi de la croissance et/ou d'améliorer la qualité globale de l'emploi, des mesures ciblées ou spécifiques, visant à mettre en oeuvre le principe d'une "discrimination positive".
Parmi les mesures d'ordre général, seront intégrées les aides sans contreparties exigées en termes d'engagement des entreprises pour l'emploi. Elles ne figurent pas dans les catégories de la Dépense Publique pour l'Emploi (DPE). Dans la période récente, le principal instrument général sans contreparties est la réduction du coût du travail non-qualifié. La fusion du dispositif d'exonération des cotisations familiales sur les bas salaires et la ristourne dégressive jusqu'à 1,3 fois le SM1C en constitue la principale mesure. Les flux consacrés à ce type de mesure absorbent une part croissante des flux d'aide à l'emploi.
Parmi les mesures d'ordre général et ciblées, les dispositifs qui reposent sur une convention entre l'État et l'entreprise feront l'objet d'une attention particulière. L'entreprise s'engage dans ce cas à réaliser un cahier des charges en échange de l'aide financière. Cette contrepartie porte par exemple sur le maintien ou la création d'emploi, l'amélioration des compétences ou de la qualification, en principe, envisagée en cohérence avec des innovations organisationnelles et technologiques. Entrent notamment dans cette catégorie les lois Robien et Aubry sur la réduction du temps de travail, ainsi que certaines mesures nationales, territoriales ou sectorielles d'aide à l'industrie, à la formation, à la reconversion.
Parmi les mesures ciblées, les instruments utilisés relèvent essentiellement d'une réduction du coût du travail sous forme de contrats aidés dans le secteur marchand et le secteur non-marchand. Ils consistent également en la mise en oeuvre d'aide à la formation pour les publics-cibles ou d'encouragement au rajeunissement de la pyramide des âges dans l'entreprise par des mesures de préretraite.
L'importance croissante des fonds publics consacrés à l'emploi requiert une évaluation comparée de ces différents types de mesures à l'aune des effectifs qui leur sont assignés.
De nombreux rapports ont été commandés dans la période récente aux organismes publics d'évaluation à propos de dispositifs ou d'ensemble de mesure précis. Parmi ces derniers, la réduction du temps de travail a été traitée par te Conseil d'Analyse Économique (Taddéi, 1998) et le CSERC (1998). Elle fait l'objet d'un suivi attentif de la DARES. L'allégement des charges sur tes bas salaires a fait l'objet d'un rapport du CSERC (1996) et de travaux antérieurs dans le cadre du CGP (Minc, 1994 ; Maarek, 1994). La totalité de Dépense Publique pour l'Emploi (excluant tes mesures d'ordre général) a fait l'objet d'un bilan détaillé de la DARES (1996) portant sur quarante ans de politique de l'emploi. Enfin, le Premier ministre a commandé deux rapports sur la réforme du mode de financement de la protection sociale, l'un à Jean-François Chadelat en juin 1997, l'autre à Edmond Malinvaud en septembre 1998.
Peu de travaux mettent en balance l'ensemble des dispositifs du point de vue de leur efficacité comparée. L'objet du présent rapport est donc l'étude comparative de l'efficacité de l'ensemble des flux consacrés à l'emploi, qu'il s'agisse des mesures d'ordre général ou des dispositifs ciblés, sectoriels et locaux.
Cette évaluation a pour objectif d'aider à la décision en ce qui concerne l'orientation immédiate de la politique publique de l'emploi. Depuis une décennie, le mécanisme privilégié par les dispositifs ciblés ou d'ordre général de la politique de l'emploi est essentiellement la réduction du coût relatif du travail et principalement du travail non-qualifié. Le bilan mitigé de ces politiques, que nous discuterons dans ce rapport, amène à explorer de nouvelles pistes en précisant le diagnostic sur les causes de la persistance du chômage.
Parmi ces pistes, le gouvernement a décidé d'engager une réflexion autour de deux axes complémentaires : la réduction du temps de travail et la réforme du financement de la protection sociale. Cette dernière se veut incitative dans le cadre du passage aux 35 heures afin de stimuler les entreprises où les acteurs s'engagent dans une négociation sur l'organisation de la production et l'emploi. Le contenu de la réforme du financement de la protection sociale doit alors être rapidement précisé, afin de la mener conjointement à la mise en place de la deuxième loi sur les 35 heures qui doit fixer les conditions définitives du passage aux 35 heures.
Les contenus possibles d'une telle réforme du financement de la protection sociale sont cependant loin de faire l'unanimité parmi les protagonistes de la politique de l'emploi. C'est pourquoi nous nous efforcerons de dresser la topologie des propositions en présence, en mettant l'accent à la fois sur le choix de société qu'elles sous-tendent et sur l'efficacité économique en termes d'emplois dont chacune d'elles est porteuse. Au coeur du débat de société, se trouve tout d'abord posée la question des catégories de revenus qui doivent participer au financement de la protection sociale. Se trouve ensuite posée la question du lien qui doit ou non exister entre le caractère universel de la protection sociale, voulu par le gouvernement, et les modes de financement, plus ou moins fiscalisés, sur lesquels doit reposer le système. Faut-il conserver une assiette salaire au nom de la généralisation de la société salariale ? Faut-il l'étendre à d'autres catégories de revenus tels les profits des entreprises et les revenus du capital ? Faut-il changer radicalement d'assiette en substituant une assiette valeur ajoutée à l'assiette salaire ? Tels sont les termes concrets des choix politiques auxquels les pouvoirs publics ont à faire face.
Le second débat est un débat économique portant sur l'efficacité (en termes de créations d'emplois) de chaque type de prélèvement. À la demande du Premier ministre, deux rapports - le rapport sur la réforme des cotisations patronales, rédigé par Jean-François Chadelat (1997) et le rapport intitulé les cotisations sociales à la charge des employeurs une analyse économique, rédigé par Edmond Malinvaud (1998) -, ont tenté de définir les termes d'un tel débat Le rapport Chadelat recommande une extension de l'assiette voire un changement d'assiette afin d'intégrer la valeur ajoutée, ou bien une modulation des cotisations patronales (dans ce cas toujours assises sur les salaires) en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Le rapport Malinvaud, pour sa part, propose une mesure d'ordre générale d'allégement du coût du travail non-qualifié : cette proposition se situe dans la lignée de la politique de l'emploi menée en France durant la décennie qui s'achève. Ces deux rapports n'établissent cependant pas une évaluation systématique des différents scénarios. Le rapport Malinvaud propose néanmoins une simulation de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires.
Le présent rapport repart des hypothèses utilisées par le rapport Malinvaud lui-même. Il complète la modélisation de l'économie, inachevée à notre sens, dans le modèle ayant servi de support au rapport Malinvaud. Il simule l'ensemble des scénarii de réformes possibles, notamment ceux qui sont esquissés, mais non-éprouvés, dans le rapport Chadelat.
Les premières évaluations des négociations effectuées dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation sont maintenant disponibles. On dispose en effet maintenant d'un panel suffisamment important d'accords d'entreprise et de branche pour en évaluer la portée. Une typologie de ces accords (tenant compte d'une double dimension), sera proposée, selon que ces accords soient offensifs ou défensifs (qu'ils aient créés ou maintenu l'emploi), et selon leur caractère "organique" ou "mécanique", autrement dit selon qu'ils engagent ou non une réflexion de long terme de l'entreprise en matière d'emploi, d'innovation stratégique et d'organisation du travail.
À la lumière de ces premières expériences, quelques suggestions peuvent être formulées afin de dessiner les contours de la seconde loi. Elles portent notamment sur les règles d'aménagement du temps de travail à fixer, les heures supplémentaire, les modalités de fixation du salaire minimum, la durée du travail des cadres.
La première partie dresse un état des lieux de l'évolution des flux financiers en matière d'emploi en France. Elle établit ensuite le bilan des évaluations disponibles de l'efficacité des mesures financées par les flux étudiés. Le premier chapitre commence par comparer le volume et la structure de la politique de l'emploi française avec les caractéristiques des politiques menées par d'autres pays réputés représenter différents "modèles" de politique de l'emploi tels que la Suède et les pays anglo-saxon. Il précise l'évolution de la structure des flux financiers. Le deuxième chapitre dresse une typologie des mesures mises en oeuvre en ayant le souci de les classer en fonction du caractère plus ou moins général de la mesure, et en fonction du type de mécanisme économique recherché. Le troisième chapitre expose successivement les méthodologies utilisées dans les évaluations macro-économiques, micro-économiques et monographiques. Le quatrième chapitre établira la synthèse des résultats par catégorie de mesure.
La deuxième partie présente les premières évaluations des pistes récentes en matière de politique publique de l'emploi. Celles-ci s'articulent autour des projets de réforme du mode de financement de la protection sociale et de la mise en place de la réduction du temps de travail.
Le cinquième chapitre établit la topographie des arguments présents dans le débat de société et dans le débat économique concernant les différents modes de financement des dépenses sociales. Une telle réforme possède en effet la particularité de devoir concilier deux objectifs : le financement de dépenses dont certaines revêtent désormais un caractère universel et la recherche du mode de financement le plus favorable à l'emploi. À l'aide de simulations inédites qui reprennent et complètent le modèle utilisé dans le rapport Malinvaud, est ensuite évaluée l'efficacité en termes d'emplois de quatre réformes : la baisse des cotisations patronales, le transfert du financement vers une assiette assise sur la Valeur Ajoutée, le transfert vers une assiette Excédent Brut d'Exploitation, la modulation des cotisations patronales (assises sur les salaires) en fonction de la part d'un critère économique mesurant la part des salaires dans la valeur ajoutée.
Le sixième chapitre propose un bilan détaillé des négociations de branche et d'entreprises qui se sont déroulées durant la phase d'application de la loi d'orientation et d'incitation pour la réduction du temps de travail. Il débouche sur un ensemble de recommandations susceptibles de contribuer à préciser le contenu de la deuxième loi qui doit encadrer le passage définitif aux 35 heures.
PREMIERE PARTIE - L'ÉFFICACITÉ DES FLUX FINANCIERS EN MATIERE D'EMPLOI : L'ÉTAT DES LIEUX
CHAPITRE I - HISTORIQUE, VOLUME ET STRUCTURE DES FLUX FINANCIERS EN MATIERE D'EMPLOI
L'objet de ce chapitre est de donner une définition la plus complète possible des flux financiers en matière d'emploi. Les catégories habituellement utilisées pour circonscrire le champ de la politique publique en matière d'emploi sont en effet souvent peu appropriées pour décrire les mécanismes économiques enclenchés par les dispositifs mis en place.
La distinction entre les dépenses actives et les dépenses passives est certes commode, mais elle ne dit rien sur la nature des mesures retenues. Les sous-catégories de la DPE, définies par la DARES en fonctions, surmontent partiellement ce problème, mais la DPE exclut elle-même les mesures d'ordre général qui représentent désormais un domaine de plus en plus important de la réflexion des pouvoirs publics en matière d'emploi.
La première section exposera notre propre définition des flux financiers en matière d'emploi provenant des collectivités publiques. La deuxième section fournira un aperçu comparatif des modèles nationaux d'intervention publique sur le marché du travail en tentant de situer le cas français. La troisième section analysera l'évolution quantitative et la structure des flux financiers en matière d'emploi en France.
1. Les flux financiers en matière d'emploi : définitions
La Dépense Publique pour l'Emploi constitue la catégorie définissant les dépenses de la collectivité consacrées à la politique de l'emploi. La DPE correspond à un compte public spécifique (Compte de l'Emploi et de la Formation Professionnelle) établi annuellement par la DARES.
La DPE comprend les mesures "actives" et "passives" de politique de l'emploi. Les dépenses "actives" concernent les mesures de formation et les aides à l'emploi mais excluent les mesures généralisée d'exonération des charges sociales portant sur les bas salaires. Les dépenses passives définissent l'indemnisation des chômeurs et les dispositifs de retrait de l'activité.
|
Définition de la dépense pour l'emploi en France "La dépense pour l'emploi recense les efforts de la collectivité dans la lutte pour l'emploi et contre le chômage" (Marioni. Roguet, 1997, p. 29). Dans une perspective opérationnelle, il s'agit de l'agrégat issu des Comptes de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, qui constitue un outil global d'évaluation financière et administrative de la politique de l'emploi, créé en 1973. Cette définition très générale peut être précisée , en référence aux agents financeurs correspondants. La dépense pour l'emploi regroupe alors trois principaux types de dépenses : - les dépenses des pouvoirs publics (État, établissements publics, collectivités locales). En ce qui concerne l'État, il s'agit principalement des crédits du Ministère du Travail, de l'Emploi, et de la Formation Professionnelle, mais également d'autres Ministères (Agriculture, Industrie, Économie--Finances, Éducation...) ; - les dépenses de l'UNEDIC. c'est-à-dire des employeurs et salariés, ainsi que l'Association pour la Structure Financière (ASP) 2 ( * ) : - les dépenses des employeur au titre de la participation obligatoire à la formation professionnelle. Les données correspondent à des dépenses effectives (crédits consommés) ou, très rarement, à des manque-a-gagner (exonérations non compensées) 3 ( * ) , ou encore à des dépenses fiscales (crédits d'impôt-formation et crédit d'impôt-apprentissage). Sources : DARES (1996) ; Marioni, Roguet (1997). |
Cette distinction est conventionnelle. Dans la réalité, de nombreuses mesures telles que les mesures de formation professionnelle, peuvent être inclues dans les deux catégories. La DARES (1996) propose pour sa part de distinguer au sein de la dépense pour l'emploi les mesures non-spécifiques et les mesures spécifiques ou ciblées. Ces dernières (incluant des mesures actives et passives) comprennent 76 mesures classées en quatre catégories : les emplois marchands aidés, les emplois marchands non-aidés, les mesures concernant la cessation anticipée d'activité, la formation professionnelle. En sont exclues l'indemnisation du chômage, la formation continue des actifs occupés, les dispositifs en faveur des handicapés, les dispositifs destinés aux entreprises, les dispositifs sectoriels.
La dépense pour l'emploi correspond tout d'abord à une dépense publique pour l'emploi. Cette caractéristique doit être appréciée de manière extensive, en référence soit à l'origine publique des fonds (budget de l'État, des collectivités locales), soit au caractère d'obligation légale de la dépense si celle-ci émane d'une institution privée (par exemple la formation professionnelle) 4 ( * ) . Cette notion de dépense publique s'oppose à celle de dépense nationale pour l'emploi, qui devrait alors inclure les dépenses de l'ensemble des agents économiques. Elle constitue donc une première restriction du champ de la dépense pour l'emploi, qui se confond avec l'ensemble des politiques publiques de l'emploi. La définition repose de plus sur l'exclusion des composantes législatives générales et macro-économiques de l'intervention publique en faveur de l'emploi (droit du travail, salaire minimum, réglementation de la durée du travail en particulier), et sur une différenciation par rapport aux mesures de politique industrielle (tes aides sectorielles ou régionales ne reposant pas sur un critère explicite de création ou maintien d'emploi sont également exclues du champ). Cette définition inclut également les flux consacré à l'indemnisation chômage, ces flux ne proviennent pas des collectivités publiques mais de l'UNEDIC.
En isolant ces dépenses d'indemnisation chômage qui n'entrent pas dans le champ de l'étude commandée, nous utiliserons une définition plus large que celle couramment utilisée pour désigner les dépenses publiques pour l'emploi. Notre rapport définira les flux financiers en matière d'emploi comme l'ensemble des dépenses des collectivités publiques dont l'objectif affiché est d'infléchir le niveau ou la structure de l'emploi à l'échelle macro-économique comme à l'échelle micro-économique.
Cette définition inclut, en plus des mesures comprises dans la DPE (à l'exception de l'indemnisation du chômage), les mesures d'ordre général d'exonération de cotisations sociales sur les bas salaires. Elle intègre également les interventions des collectivités locales pour la défense ou la promotion de l'emploi, ainsi que les aides sectorielles et autres primes à l'aménagement du territoire.
Dans le cadre de ce rapport intermédiaire portant sur "l'état des lieux" nous ne pourrons bien souvent que nous cantonner, notamment dans la comparaison internationale, aux données disponibles recensées dans la catégorie de la dépense pour l'emploi, telle qu'elle est définie par l'OCDE, cette définition étant elle-même plus restrictive que celle de la DARES dont le caractère restrictif vient d'être souligné. L'OCDE prend en compte les Politiques mises en oeuvre par les administrations centrales ou régionales et par les organismes parapublics comme les régimes d'assurance-chômage alimentés par les cotisations obligatoires des employeurs et salariés. Le champ retenu par l'OCDE couvre environ 80 % des comptes pour l'emploi de la DARES. La différence majeure entre la définition reprise dans les comptes pour l'emploi de la DARES et la définition OCDE tient à l'inclusion dans la DPE française des dépenses engagées par les entreprises dans le cadre de la formation professionnelle continue (non comptabilisées par l'OCDE).
2. La politique de l'emploi en France dans la comparaison internationale
2.1. Existe-t-il des modèles nationaux de politique de l'emploi ?
La diversité des pratiques nationales en matière de politiques de l'emploi constitue un résultat "classique" des outils comparatifs mis en place par l'OCDE, et en particulier de la présentation de données financières standardisées. Sur cette base, on peut globalement opposer les États-Unis et le Japon à l'Europe, les deux premiers pays étant caractérisés par des niveaux très faibles de dépense pour l'emploi (respectivement 0,4 et 0.5 % du PIB, contre un minimum européen de 1.5 % pour la Grande-Bretagne 5 ( * ) ). Au sein même de la Communauté Européenne, les écarts demeurent importants, tant en termes de niveau de dépense, que du point de vue de sa structure. D'après la nomenclature de l'OCDE, celle-ci se caractérise par sept catégories regroupées selon des critères fonctionnels ou selon le public visé, et par une dissociation plus synthétique entre les dépenses "actives", et les dépenses "passives" 6 ( * ) .
Le taux d'activité de la dépense varie ainsi de 22 % en Espagne à 55 % en Italie, et au sein de celles-ci, les mesures d'aide à l'embauche représentent une part négligeable 7 ( * ) des dépenses pour l'emploi au Royaume-Uni, contre 31,1 % en Italie. On ne multipliera pas les exemples de cette variabilité structurelle, apparente dans le tableau 2 page suivante, qui renvoie selon Gautié (1997) à trois " modèles " d'intervention publique sur le marché du travail.
Tableau 1 - Dépenses pour l'emploi et taux de chômage dans différents pays de l'OCDE en 1996-1997
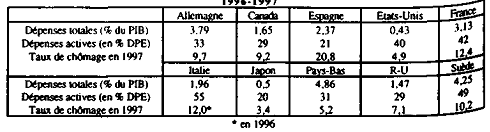
Source : OCDE, Perspectives de l'Emploi. 1998 8 ( * )
Premièrement, le modèle anglo-saxon, représenté en Europe par le Royaume-Uni, se caractérise par un effort global relativement faible, une part très importante des dépenses d'indemnisation du chômage (taux d'activité de 29 %), et des dépenses actives concentrées sur l'aide à la recherche d'emploi et la formation.
Deuxièmement, la France et l'Italie peuvent être regroupées sur la base de l'importance des mesures de retraites anticipées et de certaines mesures d'intervention directe en faveur de la création d'emplois.
Enfin, un troisième "modèle" correspondrait aux cas de l'Allemagne et de la Suède, caractérisés par l'importance de l'effort global consacré à la politique de l'emploi, et en particulier aux mesures de formation professionnelle et d'aide à l'embauche (les deux pays ayant une tradition de recours aux emplois publics aidés).
Cette classification ne recoupe que partiellement une appréciation de l'"effort" relatif des différents pays, l'effort étant mesuré par le ratio dépense moyenne par chômeur I PIB par habitant. La moyenne européenne obtenue selon cet indicateur est de 60 %. et on obtient une opposition entre les pays du Sud plus le Royaume-Uni, dans lesquels l'effort de politique de l'emploi est égal ou inférieur à 40 %, et les pays du Nord, où il dépasse 80 % voire 100 % (Pays-Bas, Finlande, Danemark). La France et la Suède se situent à un niveau moyen (60 % pour la Suède, 55 % pour la France) 9 ( * ) . Cette première approche de la politique de l'emploi dans une perspective comparative souligne la difficulté d'établir une hiérarchie stable entre les pays celle-ci varie selon l'indicateur retenu.
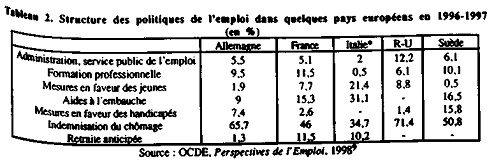 10
(
*
)
10
(
*
)
L'approche fonctionnelle et structurelle par les objectifs et les modalités d'intervention apparaît plus enrichissante : elle permet de préciser les composantes de l'hétérogénéité des politiques de l'emploi en Europe. Une seconde approche de cette diversité, moins courante dans les synthèses existantes, peut ainsi être fondée sur une analyse d'ordre organisationnel et institutionnel.
En premier lieu, on peut remarquer que les modes de financement de la dépense pour l'emploi (types de ressources) opposent deux cas polaires, l'Allemagne d'une part, où les dépenses sont quasi intégralement financées par les cotisations sociales, et la Grande-Bretagne d'autre part, où les ressources proviennent de l'impôt (Schmid et al, 1992). On retrouve te contraste classique de l'analyse des politiques sociales entre la logique beveridgienne et bismarckienne de protection sociale, étendue à l'ensemble des dépenses de politique de l'emploi, au-delà de l'indemnisation du chômage.
La France et la Suède constituent i cet égard des systèmes mixtes, où les politiques actives relèvent principalement de l'impôt. Sur le plan institutionnel, les structures de mise en oeuvre de la politique active de l'emploi apparaissent également diversifiées 11 ( * ) . Dans un certain nombre de pays, la politique active de l'emploi relève au niveau central d'une organisation autonome, sous le contrôle du gouvernement : le Conseil National de la Politique de l'Emploi (AMS) en Suède. l'Institut Fédéral du Travail (BAA) en Allemagne par exemple sont des institutions publiques indépendantes dotées à la fois d'un pouvoir décision et compétents à l'égard de la mise en oeuvre des mesures. A contrario , en France et aux Pays-Bas, l'organisation et la coordination de la politique de l'emploi relèvent directement de la responsabilité du Ministère du Travail ; en France, cette responsabilité est doublée d'un pouvoir de décision du Ministère à l'égard des orientations de la politique active de l'emploi.
L'autonomie des structures institutionnelles de la politique de l'emploi à l'égard du Gouvernement semble liée au degré de participation des partenaires sociaux à la politique de l'emploi, de même qu'au niveau de centralisation des relations professionnelles : en effet, les syndicats et organisations patronales participent à l'orientation et à la décision en matière de politique de l'emploi au niveau central en Allemagne et en Suède, l'AMS et le BAA étant des structures tripartites. Cette participation existe également aux Pays-Bas (Comité Central tripartite de la politique de l'emploi, CBA), tandis qu'elle n'apparaît pas dans le cas français 12 ( * ) . Le degré de décentralisation de la mise en oeuvre, y compris l'autonomie des échelons locaux, apparaît également très variable : les pays à haut degré d'autonomie des échelons locaux seraient la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. tandis que la France ou l'Allemagne se caractérisent par le maintien de relations hiérarchiques (entre le Ministère et les Directions Départementales du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, entre le BAA et les Bureaux locaux du Travail -AA). La Suède se situe de ce point de vue dans une position intermédiaire, le système institutionnel de mise en oeuvre de la politique de l'emploi étant intégré, mais avec des marges d'autonomie importantes sur la base de principes de management par objectifs. Ainsi les disparités de niveaux de dépenses et d'instruments de la politique de l'emploi sont-elles doublées, en Europe, de spécificités institutionnelles nationales fortes.
2.2. L'évolution récente des "modèles nationaux" de politiques de l'emploi.
La fin des années quatre-vingts et les années quatre-vingt-dix apparaissent comme une phase de transformation de ces politiques. Plusieurs orientations de réforme sont à l'oeuvre, en particulier sur le plan institutionnel abordé au paragraphe précédent. Une première tendance consiste en un renforcement de la coopération locale autour de la mise en oeuvre des politiques actives de l'emploi.
En Suède, des projets pilotes destinés à accroître l'implication des acteurs locaux dans la mise en oeuvre et le financement des mesures ont été mis en place en juillet 1996 se traduisant .institutionnellement par la création d'un conseil du service de l'emploi au niveau municipal (Niklasson, 1997).
En France, on constate le développement du "partenariat", c'est-à-dire de la coopération entre différentes catégories d'acteurs (Service Public de l'Emploi, collectivités locales, employeurs), autour de la politique active de l'emploi, en particulier sur la base de mesures reposant sur l'initiative locale, comme le Plan Local d'Insertion par l'Économique (Barbier. 1997).
Une seconde voie de réforme des institutions de la politique de l'emploi consiste en une privatisation de certains services d'aide aux chômeurs. Cette orientation a été développée au Royaume Uni et aux Pays-Bas. Dans ces deux pays, des institutions privées interviennent dans les activités de placement et de formation. Au Royaume-Uni, les Conseils Formation Entreprise (TEC) ont été institués en décembre 1988 sous la forme de sociétés locales dirigées par les employeurs : ils .sont responsables de la mise en oeuvre de la formation et des aides à la création d'entreprises (MISEP, 1996d).
Aux Pays-Bas, le service de l'emploi s'appuie partiellement sur des institutions semi-publiques de placement, comme l'agence d'intérim START, qui a pour objectif prioritaire l'insertion des chômeurs difficiles à placer en tant que salariés intérimaires (MISEP, 1996c). Sous un angle plus général, un des thèmes dominants apparaît également comme celui de l' "activation des dépenses passives", qui induit des modifications importantes dans les relation entre le système d'indemnisation du chômage et les institutions de la politique active de l'emploi (Gazier. 1996).
Enfin, au-delà de ces orientations de réforme, un thème dominant serait celui de la fin des modèles en Europe, suite à l'affaiblissement du modèle suédois dans les années quatre-vingt-dix, et aux tensions créées au sein du système allemand par la réunification. Cette thématique générale de la crise des modèles nationaux (DARES 1996), ou de " l'émergence de nouvelles régulations [...] de l'emploi " (Lallement. 1996) 13 ( * ) , signale la particularité du contexte des années quatre-vingt-dix, et l'enjeu d'une actualisation constante de l'analyse des politiques actives de l'emploi.
3. L'évolution de flux d'aide à l'emploi en France depuis 1973
3.1. Les modes de financement
Le mode de financement prédominant repose sur le budget général de l'État, et, dans une moindre mesure, les budgets des collectivités locales. En 1993, 48,1 % du total des dépenses actives étaient financées par le budget du Ministère du Travail, 6 % par d'autres Ministères, et 4 % par les collectivités locales. De manière minoritaire, l'UNEDIC et les administrations de Sécurité Sociale contribuent également à ces dépenses (5,6 %) 14 ( * ) . Ceci correspond au financement direct par l'UNEDIC des conventions de conversion, allocations formation-reclassement et conventions de coopération. Ce mode de financement par cotisations sociales se traduit par l'application de critères d'éligibilité relevant du système d'assurance-chômage. Par exemple, les conventions de coopération sont ciblées sur les chômeurs sans emploi depuis au moins huit mois, et bénéficiant encore de droits à indemnisation. La subvention versée à l'entreprise 15 ( * ) en cas d'embauche est également calculée en fonction des droits ouverts dans le cadre du système d'assurance (six mois d'allocations).
L'originalité principale du système français réside dans l'existence d une contribution obligatoire et spécifique des employeurs à la formation professionnelle. De ce fait, la contribution des employeurs à la dépense pour l'emploi s'élevait à 36 % en 1993. Ce prélèvement a été créé en 1971, sur la base d'un accord interprofessionnel, repris sous forme législative. Son montant, calculé en pourcentage de la masse salariale, varie en fonction de la taille de l'entreprise 16 ( * ) . Il s'agit d'un prélèvement libératoire, c'est-à-dire que les entreprises peuvent être dispensées du paiement à l'État si elles réalisent elles-mêmes des dépenses de formation, soit en interne, soit sous forme de versements à des organismes de gestion du fonds de la formation professionnelle. Ce type de prélèvement constitue une forme traditionnelle de financement de la formation professionnelle au sein du système français de relations professionnelles : la taxe d'apprentissage, créée en 1925 (0,5 % de la masse salariale), fonctionne selon le même principe. Ce système a pour avantage de fournir des ressources stables pour la formation professionnelle.
Cependant, ce mode de financement paraît biaisé. En effet, le prélèvement destiné à la formation professionnelle bénéficie de manière quasi-exclusive aux salaries, les dépenses de solidarité (c'est-à-dire les mesures en faveur des chômeurs) étant principalement financées par l'État. De plus, au sein même des salariés, on note une forte sélectivité d'accès à la formation continue selon le type d'emploi occupé ou le type (l'entreprise : ainsi, d'après des données de l'enquête Formation et Qualification Professionnelle, entre 1989 et 1993, la moitié des personnes occupant un emploi de cadre ont reçu une formation. contre moins de 10 % des personnes occupant un emploi d'ouvrier non qualifié De plus, la probabilité d'être formé apparaît deux fois plus faible dans une entreprise de moins de 50 salariés par rapport à une entreprise de plus de 500 salaries (Goux et Maurin. 1997). Ce type de biais dans l'affectation des ressources est encore plus apparent dans le cas de la taxe d'apprentissage, qui finance très largement des formations initiales, sans aucun lien avec le dispositif d'apprentissage lui-même.
Toutefois, en dépit de ces dysfonctionnements et d'un " bilan mitigé " 17 ( * ) du point de vue de l'impact sur la sélectivité du marché du travail, il est indéniable que les flux financiers correspondants à cette spécificité française servent dans l'ensemble un objectif général de formation sur le marché du travail, et relèvent donc de la politique active de l'emploi.
On retiendra deux aspects, du point de vue de la relation entre structure du financement et politiques mises en oeuvre :
- le type de ressources (contributif ou non-contributif, i.e. impôts vs cotisations sociales) n'est pas neutre à l'égard des conditions d'accès aux mesures : le principe assurantiel de droits ouverts s'oppose au principe discrétionnaire lié aux mesures financées par le budget de l'État 18 ( * ) . Cette caractéristique doit être soulignée dans le cadre du débat sur 1'"activation des dépenses passives". Dans le cadre d'un système où les dépenses passives sont principalement financées par cotisation, elle implique en effet l'absence d'équivalence entre dépenses "activées" et dépenses actives ;
- dans la même perspective de l'incidence des types de financement, les systèmes de prélèvement libératoires constituent un outil incitatif intéressant (l'apport essentiel de l'accord de 1971 est sans doute l'intégration de la formation professionnelle à la gestion des ressources humaines), mais également une source de biais de sélectivité dans l'allocation des flux financiers. Ils peuvent donc être contradictoires avec la fonction redistributive de la politique de l'emploi.
3.2. Flux pour l'emploi et cycle économique
L'analyse longitudinale disponible des fluctuations des flux financiers prend comme indicateurs la dépense pour l'emploi et leur taux d'activité, indicateurs dont le caractère restrictif a été relevé
3.2.1. Les fluctuations de la Dépense Pour l'Emploi
L'analyse révèle cependant que la dépense pour l'emploi se caractérise par une croissance lente et régulière (jusqu'à un niveau supérieur à 4 % du PIB en 1996). Cette tendance peut être décomposée en trois phases :
- la première période, de 1973 à 1983, fait apparaître une forte hausse de la dépense pour l'emploi (jusqu'à 3,51 % du PIB en 1983), avec une accélération au cours des trois dernières années ;
- cette période est suivie d'une phase de stabilisation (1984-1987), et par deux années de baisse relative de la dépense (-2,7 % entre 1987 et 1988, -6,4 % entre 1988 et 1989), correspondant au retournement à la hausse de la conjoncture à la fin des années quatre-vingts ;
- l'accroissement du niveau de la dépense reprend pendant la première moitié des années quatre-vingt-dix, ce qui peut être mis en relation avec le ralentissement de la croissance et l'accroissement du chômage.
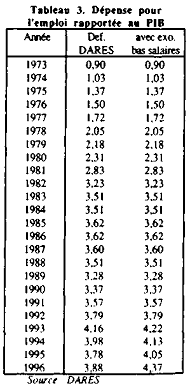
D'après ces données, il ne semble pas que la dépense de politique de l'emploi française ait réagi aux cycles économiques avant le milieu des années quatre-vingts : en effet, la courbe de l'évolution des flux d'aide a l'emploi (graphique 1) ne montre aucune variation cyclique pendant les années 1973-1988. On a ainsi un effort de la collectivité par chômeur globalement stable.
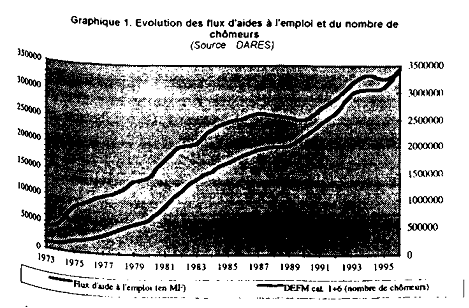
Nous analyserons ultérieurement les composantes de cette phase de croissance régulière. À partir de 1988, l'évolution de la dépense semble suivre approximativement le cycle, en particulier à la hausse de 1991 à 1993. Si l'on reprend la définition de la dépense pour l'emploi au sens de la DARES, il y a une diminution à partir de 1993 (de 4,16 % à 3,88 % du PIB en 1996). Comme on peut le constater sur le graphique 1 ci-dessus, cette baisse est compensée par la montée en charge des différents dispositifs d'exonération de cotisations sociales. Cette évolution coïncide néanmoins avec une tendance au ralentissement de la hausse du chômage 19 ( * ) .
3.2.2. Le taux d'activité de la politique de l'emploi
Deux périodes peuvent être clairement distinguées :
- entre 1973 et 1985, a part relative des mesures passives dans la DPE s'est accrue (de 34.1 % à 67,3 %, i.e. de 0,3 % à 2,43 % du PIB). Cette augmentation était le résultat d'une part de la hausse du chômage, en particulier du chômage de longue durée, d'autre part du développement des mesures de préretraites ;
- à partir de 1985, la part des dépenses actives commence à s'accroître. Cette évolution apparaît dans un premier temps comme l'effet indirect de la réduction des montants consacrés aux préretraites (le taux d'activité augmente, malgré une variation très faible des dépenses actives en pourcentage du PIB), puis comme la conséquence propre du développement des dépenses actives (à partir de 1990) 20 ( * ) .
Les spécificités françaises sur la période 1973-1997 sont donc d'une part l'impact des mesures de préretraites sur la structure de la dépense dans les années 1980, d'autre part la priorité accordée à l'activation des dépenses de politique de l'emploi depuis 1989 / 1990. Il s'agit à chaque fois du résultat d'une volonté politique, dont l'impact final est très probablement accentué par le système de financement. Ce type d'analyse s'applique en particulier au cas des préretraites dans les années 1980.
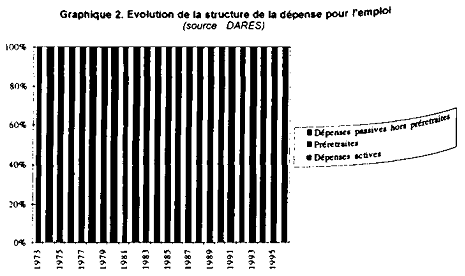
Le graphique 2 fait apparaître le profil très marqué de l'évolution des dépenses consacrées à ces programmes (hausse puis réduction très forte, le pic étant atteint en 1982-1984). Dans le même temps, le trend fortement croissant des dépenses actives à la fin des années soixante dix est renversé à partir de 1979, et stabilisé pendant la première moitié des années quatre-vingts.
La baisse des dépenses de préretraite coïncide ensuite avec la reprise de la croissance de dépenses actives. Dans la perspective de Schmid et al (1992), cette concomitance conduit l'hypothèse d'un effet d'éviction financière 21 ( * ) des dépenses actives par les préretraites, au sein du budget de l'État. Cette hypothèse semble cohérente avec une analyse institutionnelle du mode de financement des mesures mises en place au début des années quatre-vingts : création et le développement du régime des allocations spéciales du FNE (AS-FNE) 22 ( * ) relèvent en effet du budget de l'État. Parallèlement, l'abaissement de l'âge de la retraite en 1983 reporte sur la collectivité une partie des charges du régime "garantie de ressources" 23 ( * ) . On peut interpréter l'accroissement du poids de l'État 24 ( * ) dans le financement des mesures de préretraite, renforcé par l'impact indirect de mesures législatives sur 1e système de financement, comme un facteur explicatif du faible niveau et de l'inertie de dépenses actives dans les années quatre-vingts.
La décomposition entre dépenses actives et dépenses passives que nous exposons le reprend les données de la DARES et n'inclut donc pas plusieurs flux financiers de collectivités publiques. D'une part, les exonérations généralisées sur les bas salaires et les interventions économiques des collectivités locales devraient logiquement être intégrée : dans les dépenses active, comme les flux financiers en faveur de la réduction du temps de travail. À l'opposé, les flux financiers consacrés au RMI devraient prendre place dans les dépenses passives, puisque comme le montre une étude récente, ce dispositif joue désormais le rôle d'un troisième mode d'indemnisation du chômage, en plus des ASSEDIC et de l'ASS (Audier, Dang et Outin, 1998). Compte tenu des sommes en jeu, la tendance à la prédominance des dépenses dites actives n'est pas remise en cause par l'inclusion de ces divers flux financiers. Au contraire, comme nous l'avons déjà évoqué plus haut, elles tendraient à augmenter la part des dépenses actives.
La seule décomposition des flux entre les dépenses passives et actives est, nous l'avons souligné , insatisfaisante parce qu'elle ne dit rien sur la nature des mesures mises en oeuvre.
C'est pourquoi il est nécessaire de désagréger les flux financiers compte tenu des objectifs affichés pour chacune des mesures qu'ils supportent.
3.3. Structure des flux financiers en matière d'emploi
3.3.1. Évolution de la structure des flux financiers en matière d'emploi par catégorie de mesure
L'objectif est ici de préciser la structure des flux d'aide à l'emploi en France. Dans le cadre de cet "état des lieux", les informations disponibles sont fournies par les comptes pour l'emploi qui recensent l'ensemble de la dépense publique pour l'emploi. Nous lui ajouterons les mesures d'ordre général portant sur la réduction du coût du travail. Les séries représentées sur le graphique 3 reproduisent la catégorisation des mesures issue des Comptes pour l'Emploi en France.
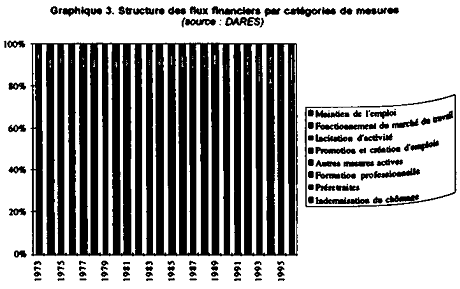
Ces classifications sont synthétisées dans l'encadré ci-dessous. Nous ne détaillerons pas dans ce qui suit le contenu des mesures, l'objectif étant avant tout d'identifier les structures, types d'intervention et leur dynamique.
En termes d'importance relative des différentes catégories, la France se caractérise par la place prédominante de la formation : d'après les travaux de la DARES (1996), on peut estimer que ce résultat ne serait pas modifié par une mesure des dépenses de formation restreinte aux chômeurs et aux jeunes. Cette hiérarchie des niveaux de dépense diffère du cas suédois jusqu'en 1986 (prédominance des mesures de création d'emplois) ; depuis, si l'on excepte les mesures en faveur des handicapés, l'ordre est le même en France et en Suède.
|
Les catégories de la Dépense pour l'Emploi Les Comptes de l'Emploi distinguent cinq catégories de dépenses actives, comprenant : (1) Maintien de l'emploi : l'indemnisation du chômage partiel, du chômage tempor a ire (chômage-intempéries), les ateliers de travail protégé des handicapés. (2) Promotion de l'emploi et créations d'emplois : les exonérations et primes à l'embauche, les programmes de créations d'emplois dans le secteur public et non-marchand, l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprises, les primes régionales et d'aménagement du territoire, les primes et subventions à l'emploi des handicapés ; (3) Incitation à /' activité : les primes de mobilité, les aides a l'installation (agriculture), la garantie de ressources et les prêt à l'installation des travailleurs handicapés ; (4) Formation professionnelle : la formation destinée aux de m a n deu r s d'emploi et aux jeunes (AFPA, stages de formation du FNE, alternance...), la formation continue destinée aux actifs occupés financée par les entreprises ; ( 5) Perfectionnement du fonctionnement du marché au travail : le budget de fonctionnement et d'équipement de l'ANPE, les aides à la recherche d'emploi. |
Enfin, un dernier élément de différenciation des évolutions générales concerne le profil des évolutions. En France, l'ensemble des catégories de dépenses suit un trend croissant, avec des phases limitées d'accélération ou de réduction. Ceci contraste avec l'ampleur des variations observables pour la Suède, et le profil contra-cyclique des dépenses de création d'emplois jusqu'à la fin des années 1980.
De manière plus précise, trois catégories de dépenses peuvent être distinguées dans les comptes pour l'emploi.
* Tout d'abord, la catégorie " fonctionnement du marché du travail " correspond principalement à la subvention de l'État à l'ANPE, donc au financement des activités de placement. Elle suit une tendance régulière à la hausse sur toute la période (de 0,02 % du PIB en 1973 à 0,07 % du PIB en 1996). On peut remarquer qu'il s'agit d'un rythme de croissance inférieur à celui du nombre de demandeurs d'emploi inscrits : la dépense consacrée à l'ANPE a été multipliée par cinq, et le nombre de DEFM par huit. La comparaison avec les autres pays rend la faiblesse de ces montants particulièrement évidente. Au-delà des flux de dépenses, ce constat est renforcé par la faible part de marché de l'ANPE (elle est estimée à environ un quart de l'ensemble des vacances d'emplois).
* La place prédominante de la formation au sein des dépenses actives constitue une caractéristique importante du cas français 25 ( * ) . Le montant de la dépense correspondante, en pourcentage du PIB, a augmenté régulièrement sur toute la période (sauf depuis 1994). Les calculs de la DARES (1996, 1997) permettent de décomposer cet accroissement en une double dynamique : d'une part les dépenses de formation des actifs (en emploi) ont augmenté de manière régulière, d'autre part les dépenses en faveur des jeunes et des chômeurs ont suivi une tendance plus irrégulière, mais fortement orientée à la hausse. En conséquence, la structure de la répartition financière entre ces deux types de bénéficiaires s'est modifiée. En 1973. la formation des actifs s'élevait à 16 milliards de francs, et celle des jeunes et des chômeurs à 6 milliards ; en 1993, les montants des dépenses consacrées| aux deux catégories sont égaux (40 milliards de francs), en 1994 et 1995, la formation professionnelle des actifs devient à nouveau légèrement plus importante 26 ( * ) .
* L'évolution la plus importante concerne, enfin, la catégorie des dépenses de "création et de promotion de l'emploi ", qui passe de 0.04 % du PIB en 1973 à 0,58 % en 1996 27 ( * ) . Cette catégorie se caractérise par sa diversité, puisqu'elle regroupe des mesures hétérogènes, principalement des subventions à l'embauche et des mesures de création \ directe d'emplois, et sa variabilité temporelle. En effet, elle comprend une succession de mesures dont la plupart n'ont qu'une durée de vie limitée, suivant un cycle politique très net. Trois principales phases de développement peuvent être distinguées :
- la période 1977-1981, avec la création des Pactes pour l'Emploi des Jeunes, qui initient un mode d'intervention fondé sur des exonérations de charges ;
- entre 1985 et 1987, les Gouvernements de gauche et de droite relancent les dispositifs d'aide à l'emploi, par une mesure de création d'emplois dans le secteur non-marchand (Travaux d'Utilité Collective), des stages en entreprises (SIVP), et par une série de mesures à nouveau concentrées sur les jeunes dans le cadre du Plan d'Urgence (exonérations de charges à l'embauche, principalement) ;
- enfin, les années 1990 marquent une phase de développement quantitatif de ce type de mesures, sur la base d'un grand nombre de nouveaux dispositifs 28 ( * ) , qui exploitent l'ensemble des modalités d'aide à l'emploi, selon deux logiques prédominantes : la création d'emplois dans le secteur non-marchand, et l'abaissement du coût du travail pour les catégories en difficulté sur le marché du travail (jeunes, chômeurs de longue durée) dans le secteur marchand.
3.3.2. La période récente : des dispositifs ciblés aux mesures d'ordre général
Si les flux financiers en matière d'emploi ont pris une importance grandissante depuis 1973, leur objectif n'a pas toujours été clairement énoncé. Rétrospectivement, on peut dire que leur objet a oscillé et continue d'osciller entre deux objectifs.
Un premier objectif vise, à volume d'emploi donné, une redistribution des chances d'accès à l'emploi. Il s'agit d'atténuer la sélectivité du marché du travail, dans l'attente d'une reprise conjoncturelle susceptible d'accroître le volume de l'emploi. Cet objectif s'est progressivement affirmé comme le coeur de la politique de l'emploi au cours des décennies 1980 et 1990. Il consiste à mettre en oeuvre le principe d'une discrimination positive pour améliorer l'employabilité, c'est-à-dire la probabilité d'accéder i un emploi, pour les catégories vulnérables face au chômage et les plus exposées à la sélectivité du marché du travail - jeunes, non-qualifiés, chômeurs de longue durée... - (Comité interministériel de l'évaluation des politiques publiques, 1997). On attend alors des mesures publiques qu'elles puissent infléchir les pratiques de recrutement des entreprises en direction de ces catégories en modifiant l'ordre de la file d'attente des chômeurs.
Dès lors, l'administration s'attache à définir la catégorie défavorisée, celle qui va servir de cible aux dispositifs des politiques d'emploi : le public.
L'identification de la cible renvoie soit à l'analyse des mécanismes économiques et des phénomènes qui structurent le marché du travail, mais aussi aux déficits supposés des différentes populations, notamment au travers de certaines théories.
Un deuxième objectif est un objectif de stimulation de la demande de travail, afin d'enrichir contenu en emploi de la croissance. Il consiste à favoriser la création d'emplois supplémentaires et le développement d'activités nouvelles utiles socialement Les instruments utilisés à cet effet sont essentiellement des mesures d'ordre général. Celles-ci se sont progressivement centrées au cours des années 1990 vers l'abaissement du coût de travail. Depuis 1995, l'incitation à la réduction de la durée collective du travail comme instrument de création d'emploi a été exploré par la loi Robien puis la loi Aubry.
|
Les difficultés de mise en oeuvre des
dispositifs ciblés :
Le premier problème consiste dans la définition administrative de la catégorie cible. D'où pour les jeunes l'émergence de la catégorie des 16-25 ans. qui existe déjà statistiquement. La borne inférieure provient tout naturellement de l'âge légal de fin de scolarité obligatoire et donc de début d'entrée dans la vie active. L'allongement progressif de la borne supérieure (21 ans dans le rapport Schwartz, 25 ans dans les années 1980. 26 voire 30 ans avec les CEC et les emplois-jeunes) correspond à la perceptif du phénomène de prolongation des études et d'augmentation de lige médian de sortie du système éducatif (de 18 a 21 ans au cours des deux dernières décennie s ). La situation des jeunes est caractérisée dans la plupart des pays par l'existence d'un effet d'âge : le taux de chômage des jeunes est deux à trois fois supérieur à celui des adultes. Cependant, tous ne réagissent pas de la même manière, car l'indicateur politiquement sensible demeure le aux de chômage des jeunes Il n'est pas surprenant que les pays anglo-saxons interviennent peu. puisque comme on l'a vu précédemment, l'essentiel de la politique de l'emploi est constitué de mesures passives. Quand le taux de chômage des jeunes est important, certains pouvoirs publics tentent une action spécifique pour cette cible (Fiance. Italie. Finlande). Mais celle attitude n'est pas la seule suivie, puisque, par exemple l'Espagne n'en fait pas une priorité. Les difficultés des jeunes dans leur insertion professionnelle proviennent selon les modèles théoriques néoclassiques d'une productivité trop faible en comparaison des autres actifs (Gautié, 1995). Les jeunes parce qu'Us sont moins qualifiés, parce qu'ils débutent, ont en général une productivité inférieure au coût du travail aux conditions de droit commun. Il s'agit là de la représentation néoclassique du marché du travail. Rejetant l'idée d'une rémunération légale plus faible pour les jeunes (hormis pour les moins de 18 ans), les dispositifs vont donc s'orienter vers des mesures de subvention de l'emploi des jeunes, avec comme objectif de diminuer le coût du travail des débutants. Par ailleurs, l'analyse des trajectoires des jeunes sur le marché du travail montre très vite que le diplôme est un élément protecteur contre le chômage, notamment pour les plus formés. Les politiques publiques vont donc également tenter d'améliorer la formation des jeunes peu ou pas diplômés. Les difficultés d'accès à l'emploi étant liées à une faiblesse de qualification ou de compétence, la politique de l'emploi tente de combler ces faiblesse par la formation et par l'expérience professionnelle C'est pourquoi, les mesures de formation en alternance apparaissent capables de répondre aux besoins. des jeunes les plus défavorisés (d'autant qua l'issue du contrat le bénéficiaire peut acquérir un diplôme ou se voir certifier une qualification). Ces deux handicaps sont parfois intégrés dans le même dispositif, comme c'est le cas avec de nombreux contrats aidés du secteur marchand, cumulant un soutien à l'acquisition de qualification par la formation en alternance (formation subventionnée) et un a baissement du coût du travail des jeunes (salaire inférieur au SMIC, exonération de cotisation s sociales...). Néanmoins, l'analyse attentive du marché du travail montre que les problèmes d'accès à l'emploi concernent surtout les débutants. Or, la politique de remploi cible les "jeunes", ce qui n'est pas la même chose. Certains individus du même âge ayant déjà 4 ou 5 ans d'ancienneté sur le marché du travail, tandis que d'autres viennent de quitter le système éducatif. La population jeune est, de ce point de vue, assez hétérogène (Meron et Minm. 1995 ; Vincens 1996 et 1997). Si le phénomène d'"allongement de la jeunesse" se traduit par le fait que de plus en plus de jeunes sortent tardivement de l'école. l'allongement simultané des catégories cibles (26 et même 30 ans dans le plan emploi-jeunes) maintient l'hétérogénéité du groupe cible. Par ailleurs, les variables individuelles (origine sociale, sexe, lieu d'habitation) ont aussi une influence sur l'insertion professionnelle des jeunes (Minni et Vergnies, 1994 : Ponthieux, 1997). Ceci vient également perturber la vision traditionnelle globalisante de la catégorie "jeune" 29 ( * ) |
Les mesures d'ordre général sont cependant contraintes par l'environnement macro-économique lui-même. Les entreprises ne sont pas incitées à accroître leur volume d'emploi si la conjoncture ne les y incite pas. Il revient alors à la politique macro-économique, par l'action monétaire et/ou budgétaire d'envisager l'amélioration de cet environnement. En deuxième lieu, nombre de mesures d'ordre général sont elles-mêmes dépendantes des possibilités de financement qu'une nation peut dégager.
Compte tenu du coût que représentent désormais les flux en matière d'emploi, l'évaluation de leur efficacité au vu des objectifs définis a sensiblement réorienté le coeur de la politique de l'emploi. Malgré l'apparente hétérogénéité, voire le peu de cohérence des mesures successives mises en oeuvre dans le cadre de la politique de l'emploi en France (Gautié et al., 1994), il est néanmoins possible de décrire comme suit la tendance récente du point de vue des grands objectifs affichés. Organisée à l'origine autour de mesures ciblées sur certains demandeurs d'emploi, l'orientation des flux financiers en matière d'emploi est passée au cours de la dernière décennie à une approche plus généraliste, où l'objectif de contre-sélectivité tend progressivement à être placé derrière celui du soutien à la création d'emploi. Les dispositifs ciblés se sont ainsi développés jusqu'à 1993 où la part des flux financiers bascule progressivement en direction des mesures non-ciblées (Daniel, 1998). Par exemple, selon les définition de la DARES les aides ciblées représentaient 76,4 % des mesures d'allégement du coût du travail en 1993, et seulement 40.2 % en 1996. Dans l'ensemble des aides à l'emploi salarié (secteur marchand et secteur non marchand), les mesures générales représentent dorénavant plus de 50 % des flux financiers (cf. tableau 4).
Plusieurs limites à l'extension des politiques ciblées ont en effet pu être recensées.
* Premièrement, on constate que la politique de l'emploi a de telles difficultés face à la sélectivité du marché du travail parce que les mécanismes de substitution jouent prioritairement entre jeunes plutôt que vis-à-vis des adultes. Le problème vient du fait que plus la mesure est généraliste (la cible est large), plus la sélectivité est forte au détriment de ceux jugés les moins employables.
À l'inverse, plus elle met en avant des mesures ciblées, plus la politique de l'emploi tente de lutter contre la sélectivité du marché du travail, et de pallier les manques des bénéficiaires des mesures : il s'agit de modifier les "signaux" que ces derniers émettent en direction des entreprises, ou, au moins, de les accompagner de stimuli positivement reçus par les employeurs (Dayan, 1994).
* Pour autant, une deuxième limite des politiques ciblées peut être relevée : toute mesure très ciblée, notamment sur les plus défavorisés (en formation, en productivité estimée...), fait peser sur ses bénéficiaires des risques évidents de stigmatisation (Daniel. 1998).
* Mais surtout, et il s'agit d'une troisième limite, de nombreux travaux ont mis en évidence que ces politiques pouvaient manquer leur cible. Ainsi, au sein même des dispositifs ciblés on assiste à un élargissement des bénéficiaires au delà des catégories-cibles, notamment dans la catégorie jeune.
Dès le premier pacte pour l'emploi (Juillet 1977), les publics initialement visés (les jeunes les moins qualifiés), ne sont pas les plus concernés. En effet, les jeunes de niveaux V bis et VI non diplômés ne représentent que 24 % des contrats emploi formation et 20 % des stages pratiques en entreprises (Santelmann, 1993)
En outre, si l'on observe ce qui s'est passé depuis dix ans pour les mesures en faveur des jeunes, on s'aperçoit que les dispositifs voient le niveau de formation de leurs bénéficiaires s'élever. Ainsi parmi les jeunes qui ont signé un contrat de qualification, ceux dotés d'un diplôme de niveau III, II ou I, supérieur ou égal à Bac+2 étaient 12,3 % en 1990 mais 19,3 % en 1996, alors qu'à l'inverse, les jeunes de niveaux V bis et VI non-diplômés sont passés de 15,5 % à 8,7 % sur la même période. C'est pourtant un contrat qui s'adresse aux jeunes dépourvus de qualification ou dont la qualification est inadaptée.
Cette évolution, pour laquelle certains parlent de dérive (Vespa, 1995), de dévoiement à l'égard des objectifs de départ, se retrouve pour le contrat d'adaptation et même pour les CES. Ce phénomène est propre aux jeunes puisque pour l'ensemble des bénéficiaires des contrats aidés, il n'y a pas d'augmentation du niveau de formation (DARES, 1996).
La dérive du contrat de qualification est un bon indicateur de ces phénomènes en cours sur le marché du travail et du rôle de la politique de l'emploi. Elle relève d'une part d'une progression de l'emploi tertiaire (qui recrute principalement des individus de niveau IV Bac), du poids des grandes entreprises (qui recrutement des salariés plutôt plus formés que la moyenne) mais aussi de l'action des organismes privés de formation, qui se servent du CQ pour diminuer les coûts de scolarité (Gautié et Lefresne. 1997).
Notons que le critère d'absence de formation est également assoupli : avec l'APEJ (aide au premier emploi des jeunes, supprimée en 1996 pour des raisons budgétaires), qui succède au défunt CIP, l'État accorde une subvention aux entreprises pour tout embauche d'un jeune de moins de 26 ans, sans référence au niveau de formation.
Dans un marché du travail en situation de pénurie et fonctionnant en file d'attente, ces éléments conduisent donc à lever l'avantage relatif dont pouvaient disposer les moins qualifiés du fait de la politique de l'emploi.
* Enfin, une quatrième limite est représentée par ce que nous appelons un effet de segmentation du marché du travail. Postuler qu'en raison de l'acceptation d'une hypothèse de productivité inférieure (qui reste à démontrer empiriquement), les jeunes ne peuvent accéder à l'emploi qu'à partir du sas de contrats particuliers aidés débouche sur la conclusion qu'il ne saurait à l'avenir y avoir de première embauche sur des emplois typiques (non-aidés et à durée indéterminée). Autrement dit, la norme d'emploi pour l'insertion des jeunes tend à se déplacer vers une nouvelle forme d'emploi aux caractéristiques plus précaires. Ce phénomène ajoute à la segmentation du marché du travail car il interdit de fait toute mobilité ascendante vers une situation salariée stabilisée avant 25 ans.
C'est donc en partie parce qu'elles ont conscience de ces dérives que les politiques publiques ont cherché périodiquement à redéfinir les publics cibles, à recentrer les dispositifs (Gautié et Lefresne, 1997).
Dans la période de reprise conjoncturelle 1997-98, l'arbitrage entre mesures ciblées et généralistes n'est pas de prime abord tranché. En forçant le trait, les arguments en présence au moment des arbitrages peuvent être présentés comme suit :
Un argument en faveur des mesures ciblées considère que les dispositifs spécifiques demeurent nécessaires pour résorber la sélectivité du marché du travail et permettre l'insertion ou la réinsertion des publics défavorisés par des mesures ciblées. Ainsi, malgré les limites inhérentes aux mesures ciblées que nous venons de relever, l'effet anti-sélectif du CIE s'est traduit par le fait que 50 % des embauches n'auraient pas concerné le même type de public sans ce dispositif (Gelot, 1997). Selon cette ligne d'argumentation, les mesures générales de type exonérations non-ciblées de cotisations sociales ne sont pas réputées nécessaires en période de reprise pour stimuler l'emploi compte tenu de l'accroissement des carnets de commande qu'exerce ta reprise sur l'activité des entreprises. Cette assertion est d'autant plus valable dans un contexte de prédominance d'un chômage keynésien dû à une insuffisance de débouchés.
À l'opposé, un argument en faveur des mesures généralistes estime que les dépenses pour l'emploi doivent suivre une logique contra-cyclique ; celle-ci consiste à déstocker les flux en direction des publics cibles pour mieux restocker ces flux en période de récession. Les exonérations généralisées sont alors réputées nécessaires pour modifier la combinaison productive de toutes les entreprises pour rendre les choix techniques à terme plus riches en travail.
Le tableau 4 ci-dessous récapitule la structure des principales aides à l'emploi salarié où, pour la première fois en 1997, la part des mesures générales dépasse les mesures ciblée. À elles seules les "exonérations de cotisations sur les bas salaires" représenteraient 44,8 milliards selon les données disponibles pour 1997. Le total des exonérations d'ordre général, comprenant les abattements pour le temps partiel, la loi Robien et les diverses exonérations territoriales et sectorielles représentent 54,5 milliards de francs.

3.4. La politique de l'emploi et ses bénéficiaires : sept périodes depuis 1973
Jusqu'ici, nous avons surtout mis l'accent sur l'évolution des flux financiers d'aide à l'emploi. Si l'on s'intéresse à l'évolution des bénéficiaires des différentes mesures, on observe sept périodes depuis 1973.
En effet, après la tentative de retour à la "normale" au cours des années 1974-1975 consécutive au choc pétrolier de 1973 et à la montée du chômage, la politique connaît un essor à partir de 1976. Jusqu'au début des années 1980. il s'agit d'accompagner les restructurations dans l'industrie ; de réduire la population active au travers de mesures d'aides au retour des travailleurs étrangers et de retrait progressif des travailleurs âgés (avec l'accroissement des préretraites) ; enfin, un accent important est mis sur la lutte contre le chômage des jeunes (créations des premiers contrats aidés du secteur marchand).
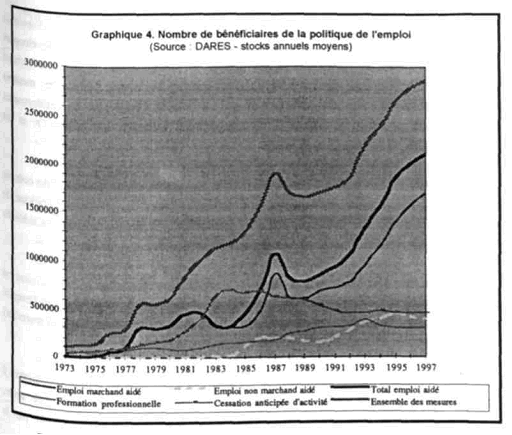
De 1981 à 1983, la politique de l'emploi connaît une pause, mises à part les cessations anticipées d'activité qui atteignent leur point culminant à cette période. Les pouvoirs publics se sont concentres sur des mesures générales comme l'augmentation de l'emploi public ou la réduction du temps de travail. En ce qui concerne les jeunes, suite au rapport Schwartz, l'action publique connaît également un fléchissement et une réorientation en direction des populations les plus défavorisées, avec la mise en place d'une gestion localisée et individualisée des dispositifs (création des PAIO et missions locales).
En 1983, la politique de l'emploi renoue avec une perspective d'action spécifique, à la fois en direction des jeunes (développement des formations en alternance), des chômeurs de longue durée (y compris en s'appuyant sur l'aide à la création d'entreprise). C'est aussi le début des actions en faveur de l'emploi non marchand.
De 1986 à 1988, les pouvoirs publics accentuent l'ampleur des actions, notamment en vue d'abaisser le coût du travail des jeunes, tout en favorisant la gestion de la main-d'oeuvre Les mesures dans le secteur non marchand progressent également avec la création des associations intermédiaires.
Au début des années 1990, l'action publique chercher à unifier certains dispositifs notamment pour les aides à l'emploi non marchand (création du CES), tout en développant des aides ciblées sur l'embauche de chômeurs de longue durée dans le secteur marchand (création du contrat de retour à l'emploi). Dans le même temps sont lancées des mesures d'exonération de cotisations, pures subventions à la création d'emploi par les entrepreneurs individuels ("exo. 1er salarié"), à l'emploi des jeunes ("exo-jeunes") et au développement du travail à temps partiel.
À partir de 1993, on assiste à l'extension des mesures d'abaissement généralisé du coût de travail par le biais des exonérations de cotisations sociales. La politique spécifique de l'emploi poursuit son développement, avec un accroissement marqué des contrats aidés du secteur marchand (CIE) et un tassement des contrats du secteur non marchand.
De même que pour l'évolution des dépenses, la progression du nombre de bénéficiaires est très forte, puisque les personnes qui étaient dans un dispositif de la politique de l'emploi représentaient 0,47 % de la population potentiellement active (population en âge de travailler) en 1973 et 10.86 % en 1997, selon les définitions de la DARES.
Il est évident que dans une approche plus exhaustive de la politique de l'emploi, conforme à celle que nous avons adopté pour les flux financiers, cette évolution est encore plus nette notamment pour la dernière période, puisque s'ajoutent les salariés concernés par la généralisation des mesures d'exonération des cotisations sociales (cf. Tableau 6).
Néanmoins, on ne peut en rester à une approche trop univoque des différents dispositifs, car ils renvoient i des logiques économiques diverses. C'est pour cela que nous avons choisi de construire une typologie des mesures, correspondant aux types de bénéficiaires et aux différents objectifs des dispositifs.
CHAPITRE 2 - TYPOLOGIE DES DISPOSITIFS D'AIDE À L'EMPLOI ET DE LEUR IMPACT ESCOMPTE
Le découpage usuel des catégories de la politique de l'emploi distinguant des dépenses dites "passives" et des dépenses dites "actives" est, cela a été souligné, certes nécessaire, mais réducteur. Parce que les aides à l'emploi ont implicitement deux principaux objectifs, favoriser la création d'emplois et améliorer la position relative de certaines populations sur le marché du travail 30 ( * ) , nous avons choisi de classer les flux financiers correspondant en distinguant les mesures généralistes (dont certaines et non des moindres sont exclues de la DPE par la DARES), qui répondent plutôt au premier objectif, et les aides ciblées, qui visent davantage à atteindre le second objectif. Au sein de chaque catégorie, seront précisés les mécanismes économiques susceptibles d'être enclenchés par les différents dispositifs.
Malgré leur caractère a priori complémentaire, les deux objectifs mentionnés sont parfois opposés. Ainsi, parmi les aides généralistes, les aides sans contrepartie bénéficient à toutes les entreprises sans contrainte sur le type de recrutement effectué ou sur le poste de travail ainsi subventionné. De fait, les employeurs utilisent alors ces flux financiers dans le cadre du marché du travail typique, au bénéfice des individus les mieux perçus par le marché du travail. On espère simplement que l'augmentation du volume d'emploi viendra fluidifier la file d'attente à l'entrée sur le marché du travail et permettra ainsi aux personnes jugées les moins employables d'être embauchées. Néanmoins, parmi les mesures généralistes, les mesures entrant dans le cadre de la contractualisation entre les pouvoirs publics et les entreprises engagent une contrepartie de la part de ces dernières en matière de création d'emplois ou d'amélioration de la qualification des emplois.
Au travers des mesures ciblées, à l'inverse, on tente de contraindre les pratiques des employeurs, de modifier leurs comportements d'embauches, plus que d'augmenter le volume global d'emplois. Ce n'est pas tant le chômage que l'on combat alors que les difficultés des jeunes, des moins qualifiés et des chômeurs de longue durée. Au sein de cette première typologie, les subventions seront distinguées des contrats aidés ou des conventions.
Les subventions "pures" renvoient directement à un contrat de travail de droit commun sans autre objectif que la baisse du coût du travail. Les contrats aidés se placent dans un champ différent puisque, outre des subventions non négligeables (exonérations de cotisations sociales et parfois primes à l'embauche, primes à la formation), ils introduisent aussi des dispositions nouvelles dans les règles du droit social, jusqu'à construire des statuts hybrides spécifiques, tant du point de vue des rémunérations offertes, que des durées proposées. Les dispositifs sont plus complexes et leur multiplicité semble souvent irrationnelle. On retrouve enfin dans ces mesures des dispositifs de maintien de l'emploi instrumentés par des conventions (préretraites progressive, conventions de conversion)
Enfin, si la réduction du coût du travail est l'axe essentiel des mesures ciblées et non ciblées, il convient de distinguer les mécanismes à l'oeuvre dans le cas d'un dispositif visant l'abaissement du coût relatif du travail et le cas d'une mesure de réduction du temps de travail, volet qui s'est développé dans le cadre des mesures d'ordre général. Dans le premier cas, l'objectif est surtout de modifier la combinaison productive des entreprises en agissant sur la structure des coûts relatifs des facteurs de production mais sans toucher à la norme répartition des revenus. Dans le deuxième cas, le débat qui s'amorce porte sur le partage des gains de productivité entre profit, salaire, emploi et temps de travail. Qu'il débouche sur une évolution de la durée collective du travail à temps plein ou de la norme de temps partiel, ce débat engage la diffusion d'une norme donnée de durée du travail et de réparation revenus.
La première section sera consacrée aux instruments s'inscrivant dans le cadre des mesures d'ordre général. Seront notamment classées parmi les mesures généralistes :
- Les exonérations de cotisations patronales entrant dans la réduction du coût du travail (cotisations familiales, 1er salarié, ristourne dégressive...)
- Les exonérations de cotisations patronales pour l'embauche de salariés à temps partiel
- Les incitations à la Réduction du temps de travail
- Les incitations à la formation continue
- Les aides financières des collectivités locales
- Les exonérations textiles
- Les exonérations territorialisées (zones franches, zones de redynamisation urbaines et rurales, Corse, etc...)
La deuxième section traitera des instruments mis en oeuvre dans le cadre des politiques' ciblées. Seront ainsi considérées comme mesures ciblées :
- Les emplois aidés marchands (CIE...)
- Les emplois aidés non-marchands (CES. CEC)
- APEJ, ARPE
- Les contrats en alternance
- les conventions de conversion et les préretraites progressives.
1. Les mesures d'ordre général
Les mesures d'ordre général sont ici définies comme celles qui consistent à exonérer les entreprises de cotisations sociales ou à les subventionner indifféremment, sans référence à un public cible clairement identifié par les financements. Ces mesures correspondent aux catégories définies par la DARES 31 ( * ) auxquelles s'ajoutent les mesures d'ordre général d'abaissement du coût du travail non-qualifié. Ces mesures d'ordre général d'abaissement du coût du travail entrent dans la rubrique que nous avons appelé les mesures d'ordre général sans contrepartie exigée en termes d'emploi ou de formation. Les mesures d'incitation à la réduction du temps de travail et de financement de la formation continue entrent dans la rubrique contractualisation avec contrepartie en termes d'action quantitative ou qualitative sur l'emploi dans l'entreprise.
1.1. Les mesures d'ordre général visant à l'abaissement du coût du travail
1.1.1. Les arguments théoriques
Les effets positifs possibles d'une réduction du coût du travail
Les mesures d'ordre général visant à la réduction du coût du travail consistent à exonérer les entreprises de cotisations sociales ou à les subventionner indifféremment, sans référence à leur appartenance sectorielle, à leur situation financière sans contrepartie en matière de créations d'emploi. Ces mesures visent à mettre en jeu l'un ou plusieurs des quatre effets suivants :
- L'effet profit est l'effet par lequel la modération salariale accroît la part des profits des la valeur ajoutée. L'augmentation de la rentabilité des entreprises leur permet de disposer de ressources financières pour l'investissement. Cet effet est couramment connu sous le nom du théorème Helmut Schmidt (du nom de l'ancien chancelier allemand) : les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain".
L'effet sur l'emploi dépend du type d'investissement. Il est faible en cas d'investissements de productivité. L'emploi s'accroît si les investissements sont des investissements de capacité.
- L'effet compétitivité-prix se produit lorsqu'une baisse du coût salarial permet aux entreprises de réduire leur prix sans entamer leurs marges afin d'améliorer leur position dans la concurrence internationale.
- L'effet de substitution entre les facteurs se produit lorsque la baisse du coût relatif d'un des facteurs de la combinaison productive des entreprises rend l'utilisation de ce facteur plus attractive. L'entreprise substitue partiellement aux autres facteurs le facteur dont le coût relatif a diminué. Ainsi, si le coût relatif du travail diminue par rapport au coût du capital, les entreprises ont intérêt à demander plus de travail pour rendre leur combinaison productive moins capitalistique. De la même façon, si le coût relatif du travail non-qualité diminue par rapport au coût du travail qualifié et/ou au coût du capital, les entreprises demanderont relativement plus de travailleurs non-qualifiés. Cet effet est représenté par la théorie néoclassique de la demande de travail.
- L'effet prix relatif se produit enfin lorsque rabaissement du coût salarial permet aux entreprises de baisser leur prix relatif, ce qui a pour effet d'accroître la demande qui leur est adressée. Cet effet suppose que ces entreprises ne soient pas en position non-concurrentielle de "price maker" leur permettant de maintenir des prix élevés.
Ces effets sont toutefois susceptibles d'être atténués, voire annihilés par quatre types de facteurs (Le Bihan, 1998) :
- La faible substituabilité des facteurs, avérée pour le cas français par de nombreuses études empiriques, rend inopérant l'effet de substitution travail/capital résultant d'une baisse du coût relatif du travail. L'effet d'une baisse du coût du travail sur l'emploi transite alors par d'autres canaux que certains modèles tentent de représenter (infra), en incorporant l'hypothèse de facteurs complémentaires (et non substituables).
- En admettant l'hypothèse d'une substitution travail-capital réussie, l'investissement peut alors décliner en raison d'une insuffisante accumulation de capital.
- Le financement de la mesure est susceptible d'engendrer un prélèvement sur certaines catégories de revenus et de détériorer la demande globale, ce qui contrecarre les effets bénéfiques de la baisse du coût salarial.
- Dans l'hypothèse de la recherche d'une amélioration de la compétitivité prix, cet effet peut être annihilé si tous les pays pratiquent une baisse du coût salarial de même ampleur.
Coût relatif du travail et chômage structurel
Plus que le dernier effet (l'effet de substitution), privilégié progressivement par les politiques de l'emploi, ce sont les deux autres effets (l'effet profit et l'effet compétitivité-prix) qui étaient à l'oeuvre dans le cadre de la politique dite de "désinflation compétitive". Au début des années quatre vingt, la chute de la rentabilité était en effet perçue comme la cause essentielle de la crise de l'investissement et de l'insuffisante modernisation de appareil productif. Dans ce contexte, les entreprises ont dû augmenter leurs prix pour maintenir leurs marges, ce qui contribuait à dégrader la compétitivité-prix et à aggraver le déficit commercial. La "désinflation compétitive", après 1983, s'attacha alors à déplacer la répartition des revenus en faveur des profits dans le but de stimuler "l'offre" tout en permettant aux entreprises de réduire leurs prix à l'exportation sans avoir à réduire leurs marges. La désindexation des salaires sur les prix dans le secteur public, obtenue à laide de l'instauration d'un nouveau mode de raisonnement pour fixer le taux d'augmentation des rémunérations, en fut un instrument. Elle servit de référence pour les employeurs du secteur privé.
Malgré le rétablissement des taux de marge (cf. Annexe 4) et des taux d'autofinancement des entreprises, malgré le rééquilibrage du commerce extérieur, le chômage demeurait cependant persistant au début de la décennie 1991. Ce n'est qu'alors, dans un deuxième temps, que les rapports officiels (Minc, 1994 ; Maarek. 1994) mirent presque exclusivement l'accent sur le mécanisme purement néo-classique de substitution des facteurs compte tenu de leur coût relatif pour justifier la nécessité des politiques d'abaissement du coût du travail, et en particulier du coût relatif du travail non-qualifié.
|
La théorie néo-classique de l'emploi et du chômage Dans la représentation néo-classique, l'économie est une somme de marchés interdépendants où s'effectuent les calculs d'agents économiques parfaitement rationnels. Sur le marché du travail, les entrepreneurs maximisent leur profit, c'est-à-dire l'écart entre les recettes et les coûts de production. Ils demandent du travail jusqu'à ce que le salaire qu'ils versent soit égal à la contribution productive du dernier travailleur embauché (ce que les économistes appellent sa productivité marginale). Clé de voûte de "l'hypothèse de l'excès du coût du travail", la demande de travail de l'entreprise est décroissante en fonction du salaire, non pas à cause du simple bon sens mais en raison d'une hypothèse technique inhérente à la combinaison productive de l'entreprise, celle-ci associant des unités de capital et de travail données à partir d'une fonction de production à facteurs substituables : pour un niveau de production donné il est possible de retenir plusieurs combinaisons capital travail possible, compte tenu du coût relatif de ces facteurs de production. Cette fonction de production à facteurs substituables a pour caractéristique la décroissance de la productivité marginale des facteurs : tout nouveau travailleur embauché, que l'on substitue à une unité de capital produire une contribution physique inférieure pour un même niveau de production. C'est pourquoi, dans la mesure où la règle de maximisation du profit est d'égaliser le salaire à la productivité marginale du travail, toute baisse du coût du travail par rapport au coût du capital rendra avantageuse pour l'entreprise l'utilisation d'un travailleur supplémentaire dont la productivité est inférieure. Dans ce sens, le problème du chômage des non-qualifiés à faible productivité marginale pourrait être résolu si le coût du travail non-qualifié était réduit relativement au coût du travail qualifié et au coût du capital. C'est tout du moins la philosophie des mesures d'abaissement du coût du travail non-qualifié (qu'elles passent par une mise en cause du salaire minimum, des exonérations de "charges sociales" ou des aides à l'emploi). Sous l'hypothèse de décroissance de la productivité marginale, tout travailleur qui accepte une baisse de son salaire trouve donc inévitablement un emploi. Le chômage ne peut être que volontaire. Il est dû au refus, voulu ou forcé, des travailleurs d'accepter une baisse de leur salaire. Ce refus est lié à l'existence d'allocations chômage décourageant la nécessité d'accepter un emploi à salaire faible. La désincitation au travail est d'autant plus forte que l'écart entre les allocations chômage et le salaire minimum est faible. Ce sont alors les "rigidités" du marché du travail qui expliquent l'existence du chômage : indemnisation des chômeurs, salaire minimum, cotisations sociales alourdissant le coût du travail, syndical s'opposant dans la négociation collective à la réduction du coût du travail. Certaines propositions de réforme des systèmes d'indemnisation chômage s'appuient sur cette représentation théorique pour réclamer la réduction du montant de l'indemnisation des chômeurs et prôner leur plus forte dégressivité dans le temps afin d'encourager les comportements de recherche d'emploi, c'est-à-dire de couper les subsides qui n'incitent pas les chômeurs à accepter des emplois à des salaires. |
Selon cette hypothèse, le chômage est avant tout de nature structurelle. Même si la demande augmentait, le niveau de l'emploi ne pourrait s'accroître plus compte tenu de la structure des coûts relatif des facteurs de production qui n'incite pas les entreprises à utiliser une combinaison productive plus riche en travail.
Dans ce contexte, comme le noyau dur du chômage concerne les travailleurs non-qualifiés (assimilés à des travailleurs à faible productivité), une baisse du coût relatif du travail non-qualifié est réputée favorable à l'embauche de ces chômeurs. Or, compte tenu de l'existence d'un salaire minimum, le coût du travail non-qualifié est trop élevé pour rendre solvable de telles créations d'emplois qui représentent pourtant des "gisements d'emplois" pour de nombreuses activités de service riches en main d'oeuvre.
Nombreux sont les rapports qui mettent l'accent sur les raisons sociales, mais aussi les causes économiques qui rendent impossible une suppression du salaire minimum (OFCE, 1994). Devant l'impossibilité de remettre en cause le salaire minimum, ils préconisent pour réduire le coût du travail de procéder à l'aide d'exonérations de "charges sociales" généralisées ou ciblées en direction des travailleurs non-qualifiés (c'est-à-dire des bas salaires), éventuellement assorties de subventions à l'embauche (Malinvaud, 1998). Au plan micro-économique, ces mesures sont justifiées par les hypothèses théoriques de la nouvelle micro-économie du marché du travail (Perrot, 1992). Celles-ci cherchent à expliquer la présence de rigidités salariales endogènes qu'il est impossible de supprimer et qu'il faut donc contourner par des politiques publiques incitatives permettant une réduction du coût du travail.
|
La « nouvelle micro-économie du marché du travail La nouvelle micro-économie du marché du travail se démarque du modèle néoclassique de référence à propos de l'hypothèse portant sur l'information dont disposent les agents. L'information est désormais supposée imparfaite. Ainsi, sur le marché du travail, l'information est dite asymétrique : les entrepreneurs ne connaissent pas la productivité du travailleur qu'ils vont embaucher. Dans les théories du "salaire d'efficience", certaines entreprises - notamment celles utilisant du travail qualifié, ne peuvent maximiser leur profit si elles connaissent mal la productivité des travailleurs au moments de l'embauche : le salaire qu'elles versent risque d'être supérieur à la productivité de ces travailleurs. Ces entreprises doivent par conséquent rechercher des mécanismes d'incitation pour que les travailleurs recrutés soient enclins à maximiser leur effort. Les entreprises peuvent donc avoir intérêt à verser des salaires élevés (appelés salaires d'efficience) pour des considérations d'efficacité productive et pour garder leurs meilleurs éléments. Elles n'ont pas intérêt à baisser les salaires et, ce faisant, le salaire en vigueur est trop élevé pour absorber l'ensemble de la population active dans l'emploi. Même les travailleurs dont les prétentions salariales sont inférieures demeurent dans une situation de chômage, dans ce cas involontaire. C'est pourquoi les aides à l'emploi sont ici recommandées pour compenser le déficit de productivité auquel les entreprises ont à faire face si elle : embauchaient de nouveaux arrivants. Autre exemple, dans les modèles "insider-misider", les salariés embauchés, les " insiders", savent que les entreprises auront du mal à se procurer une main d'oeuvre de qualité au moindre coût sur le marché. Ils sont alors en position de négocier des salaires supérieurs à ceux compatibles avec le plein-emploi. Ces arguments expliqueraient "économiquement" l'attachement des agents à l'existence de "rigidités, salariales" telles que le salaire minimum à cet attachement est "fondé" d'un point de vue économique. La conséquence "inintentionnelle" est de provoquer du chômage : le coût salarial des "insiders" est excessif à celui qui serait compatible avec le plein-emploi de la population active. |
À la différence du modèle néo-classique de base, la nouvelle micro-économie du marché du travail considère que le marché ne peut qu'être imparfait et défaillant. Le marché du travail est inéluctablement habité par ces rigidités dites "endogènes" parce qu'il est impossible de les éliminer : les agents économiques rationnels n'ont pas intérêt à la flexibilité du salaire si l'information est asymétrique. Le remède ne peut être une "déréglementation" des marchés et l'État doit intervenir pour stimuler la demande de travail des entreprises. Mais si l'interventionnisme de l'État est ici ressuscité, c'est non pas pour relancer la demande effective, mais pour alléger le coût du travail via des subventions à l'emploi (telles que le Contrat Initiative Emploi) et des exonérations de cotisations sociales dont le financement "équitable" doit par conséquent être recherché ailleurs que dans un système d'assurance sociale pesant sur les salaires.
Coût du travail et "gisements d'emplois" dans les services
Les deux tiers des activités et des créations d'emploi se situent désormais dans le secteur tertiaire, celui de la production de biens immatériels. De nombreux gisements d'emplois resteraient à exploiter. Ces emplois donnent lieu à de faibles gains de productivité. C'est pourquoi beaucoup estiment que, dans le secteur marchand, une baisse du coût relatif du travail est nécessaire pour rendre solvable ces emplois.
La délimitation du secteur tertiaire est néanmoins délicate. Tout d'abord, sa frontière avec l'industrie est floue. Ainsi certaines activités appartenant au secondaire sont des activités tertiaires dès lors qu'une entreprise industrielle décide de les externaliser en ayant recours par exemple à la sous-traitance. En deuxième lieu, ce secteur est complètement hétérogène du point de vue de sa structure technique. Si l'on considère les gains de productivité des activités tertiaires, il est généralement admis que ces gains de productivité sont plus faible à mesure que l'emploi s'y développe (Kuznets, 1966) 32 ( * ) .
Foucauld (1995) résume ainsi les problèmes posés par l'apparition des nouvelles demandes sociales : "Sans doute une partie des emplois nouveaux se redéploient dans les services à haute valeur ajoutée. Mais la plus grande part se crée dans des services à faible évolution de la productivité du travail pour lesquels la demande est très sensible aux prix. Ceci change complètement les données du jeu, par rapport au type de croissance que nous avons connu dans l'après-guerre, où le déversement se faisait majoritairement de l'agriculture vers l'industrie. Ce n'est donc pas un motif idéologique qui fait que, aujourd'hui l'emploi est devenu sensible au coût du travail mais une raison prosaïque qui tient aux conditions actuelles du déversement" (p. 42).
Sans entrer dans les méandres du découpage des activités et de leur nomenclature, on peut assez sommairement découper l'économie en deux types de secteurs : les secteurs à forts gains de productivité et les secteurs à productivité stagnante (Baumol. 1967). Si les "gisements d'emplois" se situent à l'intérieur du deuxième secteur, hypothèse qui reste à valider fermement, se trouve alors posé le problème de la solvabilisation de ces activités, a fortiori si le principal coût qu'elles supportent, le coût de la main d'oeuvre, évolue au même rythme que le coût salarial du secteur où la productivité est croissante.
Le coût du travail est donc central dès lors que les pouvoirs publics entendent faire surgir ces gisements d'emplois. Pour autant, le différentiel de gains de productivité en défaveur de certaines activités de service ne signifie nullement que les embauches se fassent à productivité marginale décroissante, ou bien que les perspectives de croissance de la productivité soient proscrites, contrairement aux hypothèses associées à la théorie traditionnelle de la demande de travail néo-classique.
L'on ne saurait en effet omettre que le secteur des services est loin d'être homogène et que le progrès technique se traduit par des gains de productivité non-négligeables, notamment en raison du décalage temporel avec lequel le progrès technique s'y diffuse par rapport à l'industrie. Ainsi, Petit (1993) a-t-il montré que, au delà des différences nationales, les "services aux ménages" étaient caractérisés par une croissance constante de la productivité malgré le développement de l'emploi en leur sein. Les "services aux entreprises" et "banque, assurance" voient également les gains de productivité décroître avec le développement de l'emploi, tandis que le commerce connaît une baisse des gains de productivité pour une structure d'emploi stable. Par contre, les différences nationales prévalent quant aux gains de productivité dans les "transports et communication".
À partir de ces considérations, l'observation empirique permet de construire quatre types idéaux de modèles de tertiarisation mettant en mouvement chacun des mécanismes différents de solvabilisation des activités à faibles gains de productivité.
La "troisième voie" française parmi quatre modèles de tertiairisation
Le "modèle américain" traite à sa façon la solvabilisation de l'offre de services, à l'aide d'un marché du travail "concurrentiel" où prévaut une grande dispersion des normes de salaire et d'emploi. Cependant, si la tertiarisation est bien un phénomène commun à l'ensemble des pays "développés", une étude plus fine par branche permet de mettre en évidence plusieurs modèles de tertiarisation caractérisés par des enchaînement macro-économiques spécifiques (Petit, 1993).
Un deuxième modèle de tertiarisation obéissant à une tradition plus européenne est un modèle où la formation des salaires est relativement homogène pour tous les secteurs - à l'instar de l'hypothèse retenue dans un modèle théorique de type W. Baumol (1966) ou encore conformément à la "politique solidaire des salaires" du modèle suédois. C'est alors le budget de l'État qui permet de solvabiliser par transfert fiscal une offre de biens collectifs et la création d'emplois à statut public. La Suède et la France correspondaient à ce type idéal durant les années 1950-80. La dispersion salariale est faible et une grande part de l'emploi est située dans les services non-marchands (près d'un quart pour la France, près de 40 % pour la Suède). Les "emplois-jeunes" des associations et collectivités territoriales, financés temporairement à hauteur de 80 % par la dépense publique, obéissent également à ce type de solvabilisation de l'offre publique de services à ceci près que le statut futur de ces emplois est encore indéterminé. Outre qu'elle dépend des marges de manoeuvres budgétaires, la viabilité de ce modèle est également conditionnée par la vigueur de la croissance économique (elle-même soutenue par les dépenses publiques), et donc du degré d'expansion du secteur à productivité croissante 33 ( * ) .
Dans une troisième version, les transferts publics peuvent encore subventionner des emplois de service à faibles gains de productivité dans le secteur marchand pour assurer des conditions de rentabilité suffisantes tout en assurant un statut et des rémunérations rendant cette tertiarisation "qualifiante" 34 ( * ) . Il s'agit d'une sorte de "troisième voie" 35 ( * ) recherchée notamment en France par les politiques publiques de l'emploi. Cette voie se situe quelque part entre le modèle d'emplois administrés et le modèle de solvabilisation de l'offre par le marché. Elle passe, pour le cas français, par une prise en charge des cotisations sociales par l'État, Ce scénario suppose toutefois que soient neutralisés les effets pervers - par exemple les effets d'aubaine, de cannibalisme, de substitution... (Gautié et al., 1994 , infra ), qui accompagnent inévitablement ce type de mesure.
Enfin, dans un quatrième cas de figure, le développement des activités de service est encouragé par l'existence d'une demande solvable, qu'il est d'autre part possible de financer par la politique publique. Celle-ci serait alors orientée non pas vers la stabilisation de l'offre mais en direction de la solvabilisation de la demande. La stabilisation de la demande peut ainsi prendre la forme de chèques services (Gaspard, 1997) à la disposition des ménages (chèques déjeuner, chèques domicile) 36 ( * ) . Le cas peut se présenter dans les pays où le niveau important des coûts de production de services conduit les entreprises de services à pratiquer des prix relatifs élevés ou à fonctionner à taux de marge réduit.
L'observation japonaise est à ce titre riche d'enseignements. Au Japon, bien que la dispersion des salaires soit importante (Cases, 1991), la structure sectorielle des salaires y demeure relativement constante. Ceci explique que le développement de certains services au Japon, et en particulier le commerce et les services aux personnes, s'opère avec des résultats bruts d'exploitation inférieurs à la moyenne nationale , malgré des prix relatifs élevés (Petit, 1993, p. 16). Les normes de redistribution des gains de productivité dans les secteurs à productivité croissante jouent également un rôle essentiel pour assurer une demande privée suffisante, compte tenu des prix relatifs élevés en vigueur.
Le débat français tend à se focaliser sur l'efficacité de la "troisième voie". Les mesures d'abaissement du coût du travail s'inscrivent dans le cadre d'un aménagement dans la réalité européenne du modèle américain de tertiarisation (Piketty, 1997). Ce dernier requiert une dispersion des coûts salariaux et des conditions de "flexibilité" de l'emploi et du temps de travail (sous forme notamment de temps partiel). La réalité française rend socialement délicate l'importation du modèle américain, réputé riche en emploi mais inégalitaire. C'est pourquoi une "troisième voie", supposée se situer entre le modèle de services publics et le modèle américain, consiste à activer les mécanismes de solvabilisation de l'offre tout en tenant compte de l'impératif de "cohésion sociale", qui se traduit par une certaine "préférence" 37 ( * ) de l'opinion pour le salaire minimum ainsi que pour un certain niveau de dépenses sociales.
Cette philosophie motive les recommandations en faveur d'une exonération d'ordre général des cotisations patronales sur les bas salaires. Elle constitue aussi la référence des mesures ciblées visant à modifier l'ordre de la file d'attente des chômeurs ( infra ).
1.1.2. La mise en oeuvre des mesures d'ordre général visant à la réduction du coût du travail
Les recommandations face au risque d'effets de seuil
La mise en oeuvre des exonérations d'ordre général de cotisations patronales sur les bas salaires se heurtent essentiellement au problème des effets de seuil encore appelé "trappe à bas salaires".
Les effets de seuil se produisent lorsqu'une mesure d'allégement du coût salarial est fixée en dessous d'une taux de salaire donné. Dans ce cas, les entreprises peuvent avoir intérêt à ne pas enrichir leur combinaison productive en emplois "qualifiés" rémunérés au dessus de ce taux, ni à mettre en oeuvre des plans de carrières promotionnels au dessus de ce seuil. Il en résulte une concentration de la main d'oeuvre aux bas niveaux de qualification et de salaire, conscient de ces effets pervers, le rapport Minc, favorable à la réduction du coût du travail non-qualifié avait dressé l'inventaire des mesures possibles d'abaissement du coût du travail en fonction de l'existence ou non d'effets de seuils. Ces mesures sont résumées dans le tableau suivant.
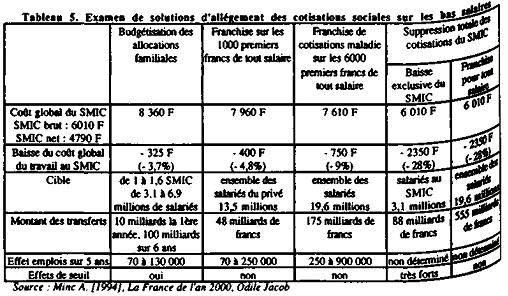
Le rapport se prononçait à l'époque pour une franchise de cotisations sociales applicable à toutes les entreprises dès le premier franc de salaire versé.
La genèse des exonérations d'ordre général sur les bas salaires : entre franchise et trappe à bas salaire
Écartant au départ l'idée d'une franchise, les mesures d'ordre général visant à réduire les "charges sociales" sur les bas salaires ont pris le risque de la création d'une trappe à bas salaire qui peut apparaître dès lors qu'un seuil est fixé pour l'application de la mesure (1,3 fois le SMIC). Cette mesure d'ordre général s'applique sans contrepartie exigée en termes d'embauche.
Les mesures d'ordre général visant à l'abaissement du coût du travail ont pris corps tout d'abord à travers l'exonération des cotisations d'allocations familiales pour les salaires compris entre 1 fois et 1,2 fois le SMIC, décidée le 1er juillet 1993. Le développement progressif de son champ jusqu'à 1,6 fois le SMIC a ensuite été fixé par la loi quinquennale du gouvernement Balladur. Pour réduire encore plus le coût du travail au niveau du SMIC, une ristourne d'un montant de 800 francs au niveau du SMIC, dégressive jusqu'à 1,2 fois le SMIC a été crée le 1er septembre 1995. Ce dispositif a fusionné le 1er octobre 1996 avec l'exonération Balladur sur les cotisations d'allocations familiales pour les salaires allant jusqu'à 133 % du SMIC. Ce seuil est désormais réduit à 1,3 % du SMIC. Le manque à gagner que l'État a dû combler en termes de cotisations pour les allocations familiales était de 4,2 milliards en 1993 et de 11,3 milliards en 1994, 21 milliards en 1995. Les mesures d'ordre général d'abaissement du coût du travail non qualifié représentaient 37,9 milliards en 1996 et 44,8 milliards en 1997. Les flux financiers qui leur sont consacrés dépassaient pour la première fois les flux en direction des mesures ciblées (cf. Tableau 4).
Les autres mesures d'exonérations encore existantes sont (en dehors de l'exonération 2 ème et 3ème salarié, désormais supprimée) :
exo 1er salarié : Cette exonération s'applique pour les embauches en CDI ou CDD de 12 mois au moins pour accroissement temporaire d'activité, à temps plein ou à temps partiel. Elle concerne tous les salariés sauf le conjoint ou le concubin de l'employeur, les personnes fiscalement à sa charge... Elle procure a l'employeur l'exonération de la totalité des cotisations patronales (sécurité sociale, accidents du travail et famille), pendant 24 mois (CDI) ou 18 mois (CDD). Elle est limitée au niveau du SMIC.
exo zones de revitalisation rurale (ZRR) et de redynamisation urbaine (ZRU) : Cette exonération s'applique pour les embauches du 1er au 50ème salarié, en CDI ou CDD de 12 mois au moins pour accroissement temporaire d'activité, à temps plein ou à temps partiel. Elle procure à l'employeur l'exonération d la totalité des cotisations patronales (sécurité sociale, accidents du travail et famille) pendant 12 mois sur la fraction de rémunération jusqu'à 1,5 fois le SMIC.
exo textile-habillement-cuir-chaussures : Cette exonération s'applique pour tous les salariés, quelles que soient la nature du contrat, la date d'embauche ou la durée du travail. Elle procure aux employeurs affiliés à l'UNEDIC appartenant aux secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et la chaussure une réduction dégressive des cotisations patronales (sécurité sociale, accidents du travail et famille) pour les salaires inférieurs ou égaux à 150 % SMIC mensuel. Elle a été supprimée en 1997 car jugée incompatible avec la réglementation européenne interdisant les aides sectorielles.
Crédit impôt-emploi : un crédit d'impôt de 10000 francs peut être accordé depuis 1998 par emploi net cédé dans la limite de 50 emplois créés.
Le tableau ci-dessous retrace l'accroissement du nombre de personnes concernées par les exonérations bas salaires.
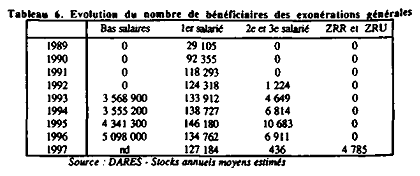
1.2. Les mesures d'ordre général visant à la réduction du temps de travail
1.2.1. Les figures de la réduction du temps de travail : temps partiel versus rédaction de la durée collective du travail ?
La réduction du temps de travail est devenue l'une des mesures de politique structurelle de l'emploi récemment explorée par les pouvoirs publics en France. Selon ses modalités, elle influence la structure de l'emploi, soit qu'elle encourage le développement du temps partiel dans certains secteurs fortement utilisateurs de cette forme d'emploi, ou qu'elle recherche la réduction de la durée collective du travail à temps plein pour tous les emplois (CSERC, 1998 ; Taddéi, 1998).
Pour reprendre les deux configurations extrêmes, les politiques de l'emploi peuvent dans un cas stimuler les emplois "peu qualifiés'' et à temps partiel (en cas de réduction individuelle de la durée du travail), particulièrement demandés par certaines activités de service (commerce, distribution). Dans l'autre cas, celui d'une réduction de la durée collective du travail, c'est au contraire l'intégration des actifs sur des emplois à temps plein et à durée indéterminée dans tous les secteurs d'activité qui est visée.
Certains travaux avancent que, pour ne pas détériorer la rentabilité des entreprises et leur compétitivité-prix, la mesure ne peut que s'accompagner d'une modération du coût unitaire du travail. Le rapport Mine (1994) attirait l'attention sur les mérites du temps partiel, forme de réduction du temps de travail sans compensation salariale.
Cette modération du coût unitaire du travail ne saurait passer, selon Taddéi (1998) par une baisse du salaire horaire, socialement inacceptable et inappropriée dans un contexte de chômage keynésien. La hausse du salaire horaire occasionnée par la réduction du temps de travail pourrait alors être compensée par des subventions de la part des politiques publiques, ou bien contrebalancée par une augmentation des gains de productivité occasionnée par un aménagement du temps de travail.
Ainsi, Taddéi (1998) note-t-il que, si la hausse du coût horaire occasionnée par les 35 heures sans perte de salaire est de 11.4 %, une hausse des gains de productivité induits par les réorganisations du travail réduit cette hausse à 7,6. Comme les salaires des nouveaux embauchés sont plus faibles (pas plus de 80 % du salaire moyen), la hausse du coût salarial n'est alors plus que de 6 %. Elle se réduit à 3 % grâce aux aides publiques et finit par être absorbée par les gains de productivité tendanciels (2 %) et les accords salariaux. D'autres, contestant la thèse de l'excès du coût du travail, estiment que la réduction du temps de travail peut être en partie "autofinancée" par les gains de productivité non-redistribués par les entreprises depuis une décennies et qui ont alimenté le placement du partage des revenus en faveur des profits. Les taux de marge et d'autofinancement étant rétablis à l'échelle macro-économique, le choc d'offre ne concernerait qu'une partie des entreprises ayant à faire face à des difficultés financières. Ces différentes hypothèses seront intégrées dans les simulations qui seront présentées dans le chapitre 3 de ce rapport.
1.2.2. Les flux financiers consacrés à la réduction du temps de travail
Les flux financiers en matière d'emploi concernant la réduction du temps de travail peuvent donc être classés selon qu'ils encouragent le développement du temps partiel ou qu'ils incitent à la réduction de la durée collective du travail à temps plein. À la différence des mesures d'ordre général réduisant les charges sur les bas salaires, les incitations financières proposées sont accordée sous condition d'embauche ou de maintien de l'emploi dans le cadre de ces mesures. Néanmoins, seules les lois Robien et Aubry entrent dans la catégorie des aides faisant l'objet d'une contractualisation entre l'État et les entreprises.
L'incitation au développement du temps partiel fut privilégiée par le plan quinquennal du gouvernement Balladur, pérennisant l'exonération pour l'embauche de travailleurs à temps partiel instauré par le gouvernement Bérégovoy (Hoang-Ngoc et Lefresne, 1994). Avec les lois Robien et Aubry, c'est une logique de développement d'emplois à temps plein à durée réduite qui est au contraire privilégiée.
Le contexte institutionnel dans lequel s'effectue la négociation entre les partenaires sociaux influe fortement sur les modalités de la réduction du temps de travail. Cette question est par nature conflictuelle parce qu'elle touche aux normes de partage de la valeur ajoutée. La faiblesse du tissu contractuel français a conduit l'État à jouer un rôle incitatif important, avec la loi Robien, mais surtout avec la loi d'orientation et d'incitation sur le temps de travail du gouvernement Jospin. Ces dispositifs contractuels, proposant des subventions ou allégements de cotisations sociales sous condition de maintien ou de créations d'emplois, ont pour objet de compenser le choc salarial supposé résulter du passage à un temps de travail collectif réduit.
Les incitations en faveur du temps partiel 38 ( * )
|
Les règles d'utilisation du temps partiel L'explosion du recours au travail à temps partiel date, en France, du début des années 80. L'État a dans un premier temps accompagné le développement de l'utilisation du temps partiel en comblant le vide institutionnel par l'ordonnance du 26 mars 1982. L'ordonnance donne comme limite au temps partiel légal les horaires inférieurs aux 4/5 de la durée conventionnelle, soit 32 heures hebdomadaires si l'on prend 39 heures comme référence. Il n'est limité par aucun plancher légal. L'employeur est libre d'instaurer le travail à temps partiel dans son entreprise à condition qu'un avis préalable des représentants élus du personnels ou de l'inspecteur du travail soit donné et que le principe du volontariat de la part du salarié soit respecté. L'employeur est également tenu de dresser un bilan sur l'utilisation du temps partiel devant les institutions représentatives du personnel. Le contrat doit être écrit. La répartition des horaires doit être stipulée dans un cadre hebdomadaire ou mensuel. Des heures complémentaires peuvent être imposée mais elles doivent être fixée dans le contrat et dans une limite inférieure à la durée conventionnelle. Elles ont l'avantage pour l'employeur de ne pas être payées au tarif des heures supplémentaires. Le recours aux heures complémentaires est cependant doublement encadré. Le nombre des heures complémentaires effectuées au cours d'une semaine ou d'un mois ne doit pas excéder le tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat. Tout dépassement de deux heures par semaine de l'horaire moyen effectif par rapport à l'horaire contractuel, constaté sur une période de douze semaines devait entraîner une modification de l'horaire contractuel correspondant à la différence entre celui-ci et l'horaire moyen effectif. L'ordonnance du 31 mars 1982 relative au temps partiel dans la fonction publique complète le dispositif en autorisant le temps partiel pour les collectivités locales et les établissements administratifs y compris les hôpitaux, sous réserve des nécessités des services. Les fonctionnaires passant à temps partiel ne connaissent aucune modification de leur situation juridique (aucune modification du contrat de travail) mais un simple changement des modalités d'exercice de leurs fonctions. La logique des ordonnances de 1982 relève beaucoup plus de la protection du salarié à temps partiel que dans le cas britannique, on le verra, dans la mesure où, de plus, elle lui accorde les droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs, et en particulier les mêmes droit sociaux. L'ordonnance du 11 août 1986 supprime le mécanisme d'ajustement automatique du contrat en cas de dépassement de l'horaire contractuel sur une période de douze semaine, ce qui ouvre la possibilité d'utilisation d'heures complémentaires dans la limite du 1/3. La loi du 3 janvier 1991 vise, entre autre, la mise en place d'un droit au temps partiel choisi : le temps partiel peut désormais être pratiqué aussi bien à la demande des salariés qu'à l'initiative de l'employeur. Mais la mise en oeuvre des modalités de ce droit est renvoyée à la négociation de branche, sauf dans la Fonction Publique où il est automatique. La négociation collective sur le temps partiel est peu active. Sans doute le cadre légal laisse-t-il peu d'espace à la négociation ? Toujours est-il que dans un premier temps, les acteurs syndicaux et patronaux " n'ont pas souhaité donner d'impulsion visible au développement d'une telle négociation " (Marimbert, 1992. p. 58). Le débat sur le temps partiel est quasiment inexistant au niveau interprofessionnel où les textes renvoient à la négociation de branche et d'entreprise. Celle-ci n'est pas pour autant dynamique au niveau de la branche où le peu d'accords spécifiques sur ce thème contiennent un faible degré d'innovation par rapport à la loi 39 ( * ) . C'est au niveau des entreprises que l'activité contractuelle est la plus importante, tout en restant modeste. Le rapport Marimbert perçoit trois types de logiques parmi les accords recensés. La première est une logique encourageant les accords de temps choisi. La seconde relève d'accords de compromis cherchant à rendre attractif le temps partiel par la mise en place de primes tout en n'améliorant pas le statut des salariés par rapport à la loi. La troisième logique est celle instituant du temps partiel contraint elle surgit essentiellement lorsque apparaissent des difficultés économiques dans les entreprises et devient un nouvel instrument de gestion flexible de la main d'oeuvre. Il serait essentiel à l'analyse de pouvoir disposer d'une évaluation du poids de chacune de ces composantes dans le recours au temps partiel. Source : Hoang-Ngoc et Lefresne (1994) |
La panoplie des dispositifs incitatifs d'accompagnement du temps partiel en France s'est remarquablement diversifiée depuis le début des années quatre-vingt. Néanmoins, avant la période très récente, cet enrichissement n'a pas débouché, à l'exception de la période 1984-1985 40 ( * ) , sur une volonté nettement affirmée. Les mesures mises en oeuvre depuis les dispositions du gouvernement Bérégovoy datant de janvier 1993 peuvent être interprétées comme un pas qualitativement nouveau dans cet édifice.
Deux grandes catégories de mesures peuvent être succinctement présentées, agissant d'une part sur l'offre, d'autre part sur la demande d'emplois à temps partiel :
Les aides aux entreprises visent essentiellement deux mécanismes qui ont été supprimés compte tenu de leur très faible utilisation :
- Le décret du 27 juin 1984, instituait une aide de 6000 francs aux entreprises embauchant un salarié sous CDI, prévoyant une durée hebdomadaire comprise entre 28 et 32 heures à condition de ne pas procéder à des licenciements économiques dans mes douze mois suivant l'embauche.
- Le décret du 5 mars 1985 prévoyait une aide de 6000 francs (3000 francs pour les embauches postérieures à décembre 1986) pour toute embauche de chômeurs indemnisés inscrits depuis plus d'un an à l'ANPE sur des emplois à temps partiel comportant au moins seize heures de travail dans le cas d'un contrat à durée indéterminé.
Au vu du très faible écho qu'il rencontra, ce type d'incitation fut supprimé en 1987. Une désaffection comparable touchait par ailleurs les dispositifs d'incitation à la réduction du temps de travail aménagés pour faire une place au temps partiel 41 ( * )
Les incitations pour le salarié à prendre un mi-temps sont restées relativement inefficaces :
- Les préretraites progressives, instaurées en 1982 et assouplies en 1984, avaient pour objet de favoriser des embauches supplémentaires dans les entreprises par transformation d'emplois à temps plein en mi-temps au bénéfice des plus de 55 ans moyennant un engagement de l'entreprise sur le niveau de ses effectifs. Le contrat passé entre l'État (FNE) et l'entreprise garantit au salarié un complément de salaire à la charge de l'État.
Le relatif insuccès de ce dispositif (quelques milliers de salariés par an) a été imputé à de nombreux facteurs : méconnaissance d'un droit ouvert aux salariés, lourdeur administrative de la convention avec le FNE, dissuasion pour l'entreprise soumis à un engagement sur le maintien des effectifs, utilisation massive du dispositif de préretraite sèche.
- Diverses conventions FNE visent par ailleurs la transformation d'emplois à temps complet en emplois à temps partiel dans un souci de prévention du licenciement dans le cadre d'une diversification des plans sociaux. Ces dispositifs à caractère récent (11 septembre 1989) n'ont connu jusqu'à maintenant que des résultats très modestes.
- Il existe un autre type d'incitations ne supposant pas une convention avec l'entreprise : il s'agit de mécanismes visant à inciter les demandeurs d'emploi à reprendre une activité à temps partiel en leur assurant des compensations financières. Le décret du 5 mars 1985 permet aux chômeurs indemnisés qui reprennent un emploi à temps partiel impliquant une rémunération inférieure à leur allocation chômage, de percevoir une compensation financière égale à la différence entre les deux sommes, pour la durée des droits restants à couvrir, dans la limite d'un an maximum (de deux pour les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans et plus qui perçoivent une compensation double).
- Le régime des activités réduites s'inscrit dans la même logique de lutte contre le chômage de longue durée en favorisant les reprises d'activité à temps réduit. Mais ici, c'est le système d'allocation lui-même qui intègre cette préoccupation en prévoyant que le demandeur d'emploi indemnisé peut conserver le bénéfice d'une indemnisation lorsqu'il reprend une activité à temps partiel.
L'impact de ces dispositifs a été faible voire même déclinant entre 86 et 90. En tout cas, il a été sans commune mesure avec l'ampleur du volume de travail à temps partiel qui s'est développé en dehors de toute aide. Les entreprises et les salariés bénéficiaires des aides ont globalement les mêmes caractéristiques que ceux pour lesquels le travail à temps partiel se développe spontanément et ces dispositifs n'ont pas vraiment permis d'infléchir ce développement vers des secteurs et des catégories de main d'oeuvre ou des emplois encore peu concernés. Le plafonnement du temps partiel entre 1986 et 1991 servira de catalyseur à une nouvelle volonté des pouvoirs publics.
Le débat sur le temps partiel connaît une réactivation depuis 1992. Celui-ci est de plus en plus explicitement présenté comme un support majeur du partage du travail, comme un moyen de favoriser le temps choisi pour les salariés et une façon d'accroître l'efficacité pour les entreprises dans un sens favorable à l'emploi. Deux axes vont guider l'action des pouvoirs publics depuis 1992 :
- Le premier axe concerne l'aménagement des formules actuelles de cessation progressive d'activité. Destinés à transformer des emplois à plein temps en emplois à mi-temps, ces dispositifs garantissent aux salariés volontaires un revenu égal à environ 80 % du salaire brut antérieur et permettent aux salariés de plus de cinquante-cinq ans de bénéficier d'une transition progressive entre vie active et retraite. Les contrats de solidarité de préretraite progressive et l'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi (ASFNE) seront unifiés et assouplis. En outre, une exigence d'embauchés compensatoires sera imposée portant sur des jeunes ou des personnes en difficulté, aux entreprises souscrivant des contrats de préretraite progressive. Cet encouragement est destiné à freiner l'utilisation du dispositif de départ anticipé sans transition ni compensation en termes d'emplois créés.
- Le second axe concerne l'abattement forfaitaire et permanent des cotisations sociales à la charge des employeurs. D'abord fixé à 30 % (loi du 31 décembre 1992) puis à 50 % des cotisations patronales de Sécurité Sociale (depuis janvier 1993), l'abattement porte sur toute embauche sur CDI à temps partiel ou sur la transformation d'un temps plein en temps partiel supérieur ou égal à dix neuf heures hebdomadaires, accompagnée d'une ou plusieurs embauches compensatrices. Une exception aux embauches compensatrices est cependant permise en cas de plan social 42 ( * ) où la loi prévoit que des emplois à temps plein peuvent être ramenés à des emplois à temps partiel avec réduction du volume de travail. Une vérification préalable doit être effectuée pour s'assurer que l'entreprise n'a pas licencié de façon abusive pour bénéficier de cette exonération. Par ailleurs, les employeurs souhaitent bénéficier de cette aide devront signer des contrats de travail fournissant des garanties aux salariés, notamment en matière de déroulement de carrière et de priorité d'affectation aux emplois à temps plein 43 ( * ) .
La loi quinquennale du gouvernement Balladur a élargi les possibilités de recours au temps partiel avec abattement de cotisations sociales. Une ou plusieurs embauches compensatrices ne sont désormais plus nécessaires pour bénéficier de l'exonération lorsque la transformation d'un temps plein en temps partiel constitue une alternative au licenciement économique (qu'il y ait plan social ou non, quel que soit l'effectif de l'entreprise). Par ailleurs, la loi permet de cumuler l'abattement (ramené à 30 %, mais concernant désormais les emplois à temps partiel d'une durée supérieure ou égale à seize heures au lieu de dix neuf heures) et l'exonération de cotisation d'allocations familiales (pour les salaires inférieurs à 1,1 fois le SMIC).
Mais surtout, la loi quinquennale prévoit la fusion du contrat de travail à temps partiel avec le contrat de travail intermittent. Peuvent ainsi être considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée annuelle de travail est inférieure d'au moins un cinquième à la durée légale ou conventionnelle. L'employeur a le droit d'organiser directement le temps partiel annualisé ; il n'est plus tenu de fixer une durée de base sur la semaine ou sur le mois (la durée du travail pourra être nulle certains mois, ce qui était impossible dans le temps partiel classique). L'employeur n'est plus tenu non plus à un accord collectif comme le nécessitait la mise en place d'un contrat de travail intermittent. Se pose évidemment le problème du calcul et du versement de la rémunération ainsi que de la date de paiement des heures complémentaires (qu'on ne peut apprécier qu'au terme de l'année) et les heures supplémentaires (le régime du temps partiel annualisé autorise l'employeur à faire effectuer des heures supplémentaires qui restent appréciées sur la semaine). D'autre part, la loi quinquennale permet aux accords d'entreprise ou d'établissement de prévoir que les heures complémentaires peuvent être portées au tiers au lieu de 10 % l'assouplissement du régime des heures complémentaires. Auparavant cette possibilité n'était ouverte qu'aux accords de branche étendus.
L'abattement de 30 % pour l'embauche d'un travailleur à temps partiel est proratisé depuis 1998.
On le voit, il s'agit par cet ensemble de dispositions d'une inflexion sensible de la législation du temps partiel offrant ainsi aux entreprises de nouvelles possibilités de flexibilisation conjuguée du contrat de travail, du temps de travail et du coût salarial. A la panoplie de mesures d'incitation directe au développement du temps partiel, il faudrait ajouter celles qui visent explicitement des objectifs différents : formation, insertion ou réinsertion mais qui contribuent à diffuser la norme du temps partiel. Ainsi les contrats à durée déterminée de la politique de l'emploi (CES, CRE, contrats d'alternance ou d'apprentissage) s'appuient pour la plupart sur du temps partiel, que celui-ci soit justifié par des critères de temps complémentaire de formation pour le bénéficiaire ou par des critères de contraintes financières du côté des promoteurs des dispositifs. Par ailleurs, les emplois familiaux présentés comme un vaste gisement d'emplois de services aux personnes reposent sur une double logique implicite de faible productivité et de temps partiel. Enfin, la loi du 3 janvier 1991 institue pour le salarié souhaitant conserver une activité professionnelle en cas de congé parental, de le faire à temps partiel.
Ainsi, alors que les politiques publiques ont cherché dans un premier temps à accompagner le développement du temps partiel en définissant les règles de son utilisation, une nouvelle étape semble s'ouvrir avec les années 90 où l'État cherche à encourager cette forme d'emploi grâce à l'utilisation de mesures de politique d'emploi visant à abaisser le coût du recours au temps partiel par l'allégement des cotisations sociales patronales. Les données récentes font apparaître le succès de cette mesure en termes de créations d'emploi (CSERC, 1998).
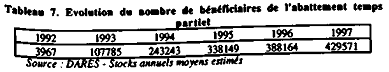
Les incitations à la baisse de la durée collective du travail
Les dispositifs incitant à la réduction de la durée collective du travail ont été en partie inaugurés par la mise en place de la loi Robien. Un ensemble de dispositifs législatifs d'aide à la réduction négociée du temps de travail ont précédé la loi Robien. pour déboucher sur un constat d'échecs répétés (J. Freyssinet, 1997). Leur objectif est d'impulser le dialogue social dans l'entreprise, moyennant une incitation financière, pour enclencher sur dynamique de réduction-réorganisation du temps de travail (2RT) avec compensation salariale partielle ou totale - dont le mécanisme est précisé plus bas dans les simulacre présentées dans le chapitre 3.
. Les contrats de solidarités.
Ainsi, entre 1982 et 1985, dans la continuité de l'ordonnance de janvier 1982 sur la réduction légale du travail à 39 heures, l'État met en place différentes mesures d'aides et d'incitations à la réduction de la durée du travail et à la création d'emplois, regroupés sous le vocable de "contrats de solidarité". En 1988, le gouvernement Rocard adapte l'introduction d'un crédit d'impôt pour l'aménagement et la réduction du temps de travail dont l'échec en terme de nombre d'accords signés et de création d'emplois est encore plus important.
. L'amendement Chamard
Jusqu'à la loi Robien, les gouvernements successifs abandonneront toutes mesures d'incitation publique à la réduction et à la création d'emplois. La loi Robien reprend et modifie l'amendement Chamard relatif à l'article 39 de la loi quinquennale de 1993 sur l'emploi et la formation professionnelle, dispositif d'aide à la réduction négociée du temps de travail qui a eu un impact négligeable 44 ( * ) . En mai 1996, seuls 13 accords d'entreprises avaient été signés, dont 9 dans la seule entreprise des brioches Pasquier. Ainsi, la loi Robien assouplit très nettement les conditions d'entrée dans le dispositif (élargi l'aide aux accords de RTT, sans qu'il y ait une obligation de réduction des salaires, accords d'entreprise et de branche) et renforce l'incitation financière.
. La loi Robien
Votée en juin 1996, cette loi propose la signature de conventions pour une durée de sept ans entre l'État et les entreprises qui s'engagent à réduire la durée du travail et à augmenter les effectifs (volet offensif de la loi) ou à maintenir les effectifs en cas de plan social (voir défensif), sur une période de 2 ans. En contrepartie d'une réduction de 10 % ou 15 % de la durée du travail s'accompagnant d'un accroissement de 10 % ou 15 % de l'effectif, les
Un flux de 1,3 milliards était consacré à cette loi en 1996.
. La loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail (loi Aubry)
La loi Aubry met en oeuvre des conditions d'exonérations des charges sociales et de réduction de la durée du travail plus restrictives que la loi Robien. Elle fera l'objet d'un exposé plus détaillé en deuxième partie.
Dates limites pour la réduction légale du travail
La durée légale du travail est fixée à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, et au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins (ainsi que pour les entreprises qui franchiront le seuil des 20 salariés entre 2000 et 2001.
Aides financières sous conditions
Les entreprises qui réduisent le temps de travail à 35 heures avant la date butoir peuvent bénéficier, sous condition de créations d'emplois, d'aides financières dégressives qui prennent la forme d'un abattement de cotisations sociales patronales.
. En 1998, l'aide est de 9000 F par an et par salarié pour les entreprises qui passent à 35 heures, à condition d'augmenter les effectifs de 6 % (volet offensif) ou dans le cadre d'un plan social qui évite de licencier 6 % des effectifs (volet défensif)
. En 1999, l'aide est de 8000 F
. En 2000, elle est de 7000 F
. En 2000, elle est de 6000 F
. L'aide devient pérenne après cette date à hauteur de 5000 francs.
Majoration des aides
L'aide peut être majorée :
. De 4000 F (maintenue sur 5 ans) par an et par salarié pour les entreprises qui réduisent les horaires de 15 % (32 heures) et qui augmentent de 9 %, ou sauvent 9 % les effectifs
. De 1000 F par an et par salarié (aide maintenue sur 5 ans) pour les entreprises qui réalisent des efforts particuliers en direction de publics en difficulté (jeunes, chômeurs de longue cadre d'un accord durée, handicapés)
. Une majoration dégressive sur 3 ans est également prévue pour les entreprises de main d'oeuvre. Elle concerne les entreprises qui emploient au moins 60 % d'ouvriers et dont 70 % des salariés sont payés entre 1 et 1,5 fois le SMIC. Elle sera de 4000 F par salarié en 1998, 3000 F en 1999, puis dégressive chaque année.
1.3. La formation continue
Les dépenses de formation peuvent obéir à plusieurs logiques. La première est de réduire le chômage frictionnel d'inadéquation de la main d'oeuvre disponible aux emplois vacants. La deuxième est d'améliorer la position des moins qualifiés (les " outsiders " exclus de l'emploi) dans la file d'attente pour leur permettre de concurrencer les travailleurs en place (les " insiders ") en permettant à terme une pression à la baisse du salaire d'équilibre. Ces deux types de mécanismes sont plutôt recherchés par les politiques ciblées de formation en direction des publics peu employables 45 ( * ) . La troisième logique est une logique de type "capital humain" : l'amélioration de la formation améliorera en fin de compte la productivité et donc la rémunération des travailleurs. Les théories de la croissance endogène avancent sur ce point qu'une augmentation des dépenses publiques de formation provoque des effets endogènes positifs sur la croissance potentielle de l'économie. Enfin, les politiques de formation sont susceptibles d'adapter les espaces de qualification sectoriels ou locaux à l'évolution des espaces industriels, notamment dans le cadre de l'avènement de nouveaux paradigmes technico-organisationnels susceptibles de favoriser une compétitivité hors-prix (Gadille, 1993a et 1998). Cette dernière stratégie fut explorée dans le cadre du rapport dirigé par Jean Gandois (1994) dans le cadre de la préparation du XI ème Plan.
|
Compétitivité prix et compétitivité hors-prix Les travaux d'économie industrielle distinguent plusieurs types d'indicateurs de compétitivité. Parmi ces derniers : - La compétitivité-prix repose, pour les entreprises qui sont positionnées sur ce créneau, sur la possibilité d'acquérir des parts de marchés en pratiquant des prix inférieurs à la concurrence. L'organisation taylorienne de la production, dans le but de réaliser des gains de productivité sur une production en grande série, est un moyen d'atteindre cet objectif. Elle repose sur une organisation hiérarchique stricte, une parcellisation des tâches conçue par le bureau des méthodes, la mise en oeuvre d'emplois répétitifs peu qualifiés dont les rémunérations et les taches sont strictement codifiées dans les grilles de classification. - La compétitivité hors-coût met en jeu d'autres facteurs que la possibilité de pratiquer des prix inférieurs. Ces facteurs sont la qualité du produit, l'adaptation à une demande de différenciation, les réseaux de coopération industrielle et de commercialisation. Du point de vue de la gestion de la main-d'oeuvre, la stratégie hors-coût requière généralement une implication forte des salariés, des compétences polyvalentes reconnues dans les classifications et une organisation plus horizontale de la production où certaines décisions opérationnelles sont prises dès le niveau des ateliers. |
Selon cette dernière perspective, la volonté de l'État d'inciter les entreprises à mener conjointement des stratégies de recherche de compétitivité et d'adaptation de la main d'oeuvre favorable à la prévention du chômage, se manifeste à partir de 1984 sur la base de la création d'une mesure préventive de formation des salariés. Insérée dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle (loi Rigout du 24.02.1984), Cette mesure vise à réduire les risques d'inadaptation des salariés à l'évolution des techniques et de l'organisation du travail et des compétences. Cette nouvelle forme de convention de formation institue un double soucis de gestion des ressources humaines dans le long terme et de contrôle syndical, incitant les entreprises, comme pour les plans formation, à lier plus étroitement les perspectives de la formation à la stratégie économique de l'entreprise (Dubar 1985).
Il s'agit d'une convention tripartite (demandeur, offreur et financeur de formation) à partir de laquelle les employeurs peuvent s'acquitter de leur participation obligatoire à la formation en concluant des Engagements de Développement de la Formation - EDDF (tableau 8, ci-après). Ces engagements soumis à l'avis des organisations syndicales, doivent comprendre des objectifs précis notamment sur la formation des jeunes et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes à l'intérieur de l'entreprise, ainsi que des modalités de contrôle des actions concrètement menées au terme de rengagement.
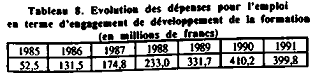
C'est ainsi qu'émergent les prémices d'une politique étatique d'aide publique incitative conditionné par des fondements contractuels qui expriment rengagement de l'entreprise à agir en amont du marché du travail pour réduire les effets externes négatifs des modalités traditionnelles de gestion administrative de la main d'oeuvre et d'organisation du travail selon une division poussée des taches.
Par la suite, les années 1987 et 1988 ont été les années charnières dans le développement de cette politique contractuelle qui a visé à encourager les branches et les entreprises à adopter des démarches innovantes d'investissements immatériels en matière d'organisation du travail, de gestion des emplois et de construction des compétences 46 ( * ) . Ce développement s'est effectué sous les ministères Soisson et Aubry, sous l'égide des politiques dites de la " modernisation négociée " (circulaires du 03.03.1989 et du 05.06.89) et de " changement du travail " (circulaires du 10.02.1993).
Le développement de ces dispositifs publics avait pour double objectif, l'amélioration de la compétitivité des entreprises et de la situation des salariés (santé, emploi, perspectives professionnelles).
Il s'agissait donc d'inciter les entreprises ou les branches à anticiper, à partir d'une analyse des évolutions des technologies et des besoins de leur clientèle, les conséquences des choix stratégiques qu'elles seraient amenés à faire sur l'organisation du travail, la gestion des emplois et des compétences. L'objectif affiché de ces dispositifs s'inscrivait dans une logique de renforcement de la compétitivité hors-coût des entreprises liée à leur capacité à fournir des biens et des services répondant à des besoins diversifiés ainsi qu'à des exigences de qualité et de délais de leur clientèle. L'hypothèse de travail qui sous tendait ces dispositifs reposait dans le constat de l'inadaptation du modèle taylorien-fordien d'organisation du travail aux nouvelles exigences productives. De même les modalités de gestion des ressources humaines associées à une forme de division du travail cloisonnée ne permettaient pas de répondre aux exigences de mobilités professionnelles interne et externe qu'impliquaient la transformation des marchés, sans entraîner des risques de dévalorisation des travailleurs les moins qualifiés rejetés sur le marché du travail lors de modernisations et restructuration d'entreprises.
Pour ces raisons, les transformations dans l'organisation du travail et dans la gestion des compétences et des carrières, envisagées dans le cadre de tels dispositifs, devaient permettre aux salariés de bénéficier d'une adaptation de leurs compétences ou de leur qualification permettant ainsi un maintient ou une amélioration de leur "employabilité ".
Pour atteindre ce double objectif, le financement de ces aides était conditionné à l'engagement de démarches de concertation et de négociation des partenaires sociaux au niveau des branches ou au niveau de l'entreprise, où les démarches d'expression ou de participation des salariés étaient également encouragées (Bouillaguet, 1989).
D'un point de vue historique, les aides actuelles dans ce domaine d'action, sont une généralisation d'un dispositif crées dans le cadre d'une nouvelle convention de la sidérurgie, les Contrats Formation Sidérurgie (CFS), mis en oeuvre en 1987 dans le but de favoriser le reclassement interne des salariés et de développer une gestion anticipée des emplois. Il permettait à certains salariés, en particulier les plus âgés, de recevoir une formation longue (au moins d'un an) afin de remplacer sur les postes, des salariés concernés, à terme, par des mesures d'âge. Par la suite et dans la même logique ont été mis en oeuvre des contrats d'Étude Prévisionnelles (CEP) en 1988, qui avaient pour mission de fournir une prospective sur les transformations économiques, technologiques et socio-organisationelles à moyen terme, afin d'éclairer les politiques de formation pour les branches professionnelles et les pouvoirs publics (Nadel, 1991).
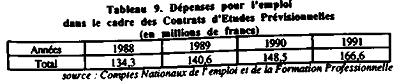
L'intérêt de tels contrats pour les branches est notamment de dépasser, en matière de formation emploi des démarches adéquationistes faisant découler les exigences en formation directement d'une organisation donnée de l'entreprise. Ils peuvent permettre de dégager les conditions de compromis autour de la recomposition de nouvelles normes de travail d'emploi et de formation qui engagent des partenaires diversifiés (entreprises, organismes de formation, institutions de branche, éducation nationale, etc.).
À un niveau encore plus micro-économique, il faut également rappeler toujours dans cette même orientation de modernisation des structures sociales dans le système productif, la création en 1989, de deux aides au conseil. La première est créée dans le cadre du Fond d'amélioration des conditions de travail. Appelée FACT-EP, elle est conçue pour favoriser de façon prévisionnelle l'adaptation de l'organisation de l'entreprise. La seconde et crée dans le cadre des interventions du FNE (Ligne d'innovation pour la gestion de l'emploi : LIGE). Elle a pour objectif d'aider financièrement des actions expérimentales de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences en prenant partiellement en charge le coût d'intervention de consultants extérieurs à l'entreprise. La caractéristique innovante de cette mesure est surtout de conditionner l'aide financière d'une part, à un apport cognitif extérieur à l'entreprise en matière de gestion de l'emploi et également d'organisation du travail, et d'autre part, à un principe de concertation ou de négociation avec les partenaire sociaux, la négociation n'ayant pas un caractère obligatoire pour bénéficier de l'aide (Gadille, 1993b).
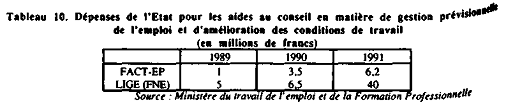
Cette orientation de la politique de l'emploi est soutenue par la loi de 1989 modifiée en 1990, qui rend obligatoire l'information et la concertation du Comité d'Entreprise en matière d'évolution de l'emploi et des qualifications. Celui-ci est informé et consulté sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution économique ou technologique.
Par ailleurs, dans le cadre d'une réflexion plus générale sur la notion "d'investissement formation", le gouvernement met en oeuvre en 1989 un "crédit-d'impôt-formation" qui vise à favoriser la recherche-développement dans les entreprises. Le principe est d'accorder une réduction d'impôt aux entreprises qui accroissent leurs dépenses de formation d'une année sur l'autre.
En 1991, les différentes mesures d'aides à la formation et d'aide au conseil en entreprise sont mises en cohérence et articulées les unes par rapport aux autres. On assiste également à une simplification des aides au conseil destinées aux branches et aux entreprises.
Cette année là, les différentes aides établies dans une perspective de "changement du travail" sont recensées selon deux registres, celui des aides au conseil et celui des aides à l'action, décrits dans le tableau 11, ci après. Cette refonte des aides aux entreprises visait notamment à rationaliser les objectifs et les procédures de chacune d'entre elles étant donné la relative confusion qui régnait dans leur mise en oeuvre entre les objectifs prévus par la loi et ceux qui étaient visés dans la réalité. C'est ainsi par exemple que l'aide attribuée par le Fonds d'Amélioration des Conditions de Travail était élargie à des besoins d'entreprises et de branches en matière d'études prévisionnelles situées en amont des projets d'actions et visant à éclairer les choix concernant l'évolution de nouvelles technologies, l'organisation et le contenu du travail, l'aménagement et la réduction du temps de travail.
|
Tableau 11. Les outils de "changement de travail" |
||||
|
Entreprises visées |
Mesure |
Objectif |
Procédure |
|
|
Aides au conseil |
Petites et moyennes entreprises de moins de 500 personnes, voire établissement de grands groupes |
Diagnostic Court gratuit (durée de trois jours), réalisé par l'ANACT, ce dispositif peut être combiné à une opération plus lourde financée par le FRAC 47 ( * ) . |
Appréhender les conditions et les enjeux de modifications dans l'organisation, les conditions et le contenu du travail, pour mener des actions concrètes. |
L'entreprise transmet sa demande à la DDTEFP. accompagné de la proposition du consultant retenu et l'avis des représentants du personnel (CE ou DP) |
|
Petites entreprises ou établissements |
Aide au Conseil aux Entreprises (financement partiel du coût d'un consultant) |
accompagner des expériences significatives de changement du travail 48 ( * ) |
Le consultant doit accepter le principe d'une démarche participative et l'échange avec les experts publics de l'instruction technique de la DDTEFP |
|
|
Branches professionnelles |
Contrat d'Études Prospectives 49 ( * ) (financement des programmes d'études et de recherche) |
Eclairer les partenaires sociaux pour qu'il se dotent d'un outil de prospective sur l'évolution des systèmes de travail, d'emploi, de qualification et de formation professionnelle |
Au niveau national : consultation des partenaires sociaux dans le cadre des Commissions nationales paritaires des branches Au niveau régional : Le préfet de région introduit ce dispositif dans les outils de prospective existant dans le cadre des Contrats de Plan État-Région |
|
|
Aides à l'action |
Toutes les entreprises qui emploient des salariés y compris les coopératives , syndicats, mais aussi les E.P.l.C 50 ( * ) ., et hôpitaux |
F.A.C.T. 51 ( * ) |
- développer le dialogue social, prendre en compte les composantes du travail dans les projets de modernisation ou de conception des équipements - agir sur les contraintes lourdes de travail dans certains secteurs - susciter des projets inter-entreprises pour les PME |
un avis doit être demandé au CHSCT, Instruction du dossier par la DRTEFP : l'avis de l'inspecteur du travail doit permettre de situer le projet dans le contexte économique et social de l'entreprise (climat social, attitude des partenaires sociaux et situation de l'emploi) |
|
E.D.D.F. 52 ( * ) |
- accroître l'effort de formation quantitatif mais surtout qualitatif en mettant en étroite relation l'élaboration de plans formation avec l'évolution de l'organisation et du contenu du travail, au niveau des branches professionnelles - qualification de la main d'oeuvre, développement de la formation dans les PME |
- l'État aide à la réalisation des plans de formation, les régions peuvent être associées à la procédure, les organisations syndicales doivent être consultées à différentes étapes de conception et réalisation du projet. |
||
|
Tout les salariés potentiellement les plus exposa aux risques d'exclusion, ne bénéficiant pas d'un potentiel de connaissance et de savoirs faire suffisants pour réussir une reconversion (niveaux VI, V bis, V et IV) |
F.N.E. Prévention |
- Inciter les entreprises à traiter en amont leurs problèmes d'emploi, par des actions de conversion interne ou à défaut externe - la formation doit contribuer à la mise en place d'organisation du travail favorisant l'adaptation des compétences des salariés |
- les acteurs publics impliqués sont les DDTEFP et les inspecteurs du travail - consultation du CE ou DP - cofinancement du FSE selon les objectifs - quota minimum et maximum d'heure/salarié - clause de non licenciement de un an |
|
|
Tableau 11 (suite) |
||||
|
Bénéficiaires |
Mesure |
Objectif |
Procédure |
|
|
Aides à l'action |
Employeurs qui ont négocié un plan d'égalité professionnelle avec les organisations syndicales et qui consacrent des efforts à la formation professionnelle continue |
Mixité des emplois et Égalité Professionnelle (prise en charge partielle du coût des stages de formation, des rémunérations des stagiaires et autres coûts liés a l'aménagement du contexte de travail) |
- aider a la mise en oeuvre de plans pour l'égalité professionnelle qui présentent un caractère exemplaire en matière de formation, de promotion professionnelle et de mixité des emplois |
- instruction des dossiers par la chargée de mission ou déléguée régionale aux droits de la femme - consultation du CE ou des DP |
|
Entreprises qui ont un projet d'insertion ou d'élévation des niveaux de compétences des personnels en place |
Nouvelles Qualifications |
- insérer des jeunes ou des demandeurs d'emploi d'un faible niveau de qualification, en les qualifiant et en répondant aux besoins de l'entreprise - requalifier de salariés d'un faible niveau de qualification en élevant leur niveau de compétence et en aidant au changement de l'organisation du travail |
- la mission nouvelle qualification apporte une aide technique et méthodologique, elle peut être sollicitée par les entreprises ou les organismes de formation - possibilité d'action concertée avec plusieurs entreprises - partenariat d'action qui implique hiérarchie, salariés et organisme de formation |
|
1.4. Les aides des collectivités locales
Nous regroupons ici les aides des collectivités locales bénéficiant directement aux entreprises concurrentielles du secteur marchand (industrie, commerce, artisanat...), en excluant les actions en faveur du tourisme, du sport ou de la culture.
Les collectivités locales se sont intéressées de plus en plus directement aux entreprises implantées ou susceptibles de s'implanter sur leur territoire. Mais les aides qualifiées de directes sont théoriquement limitées par la législation, comme étant d'abord dirigées vers les PME et principalement organisées par la région :
• primes régionales à l'emploi (PRE)
montant plafonné à 200 000 f (300 000 f en Corse), non subordonnée à la création d'emplois.
• primes régionales à la
création d'entreprises (PRCE)
montant variant de 10 à 40 000 f par emploi créé ou maintenu, dans limite de 30 emplois. Ne peut dépasser le double des capitaux propres.
Les aides indirectes sont beaucoup moins encadrées, même si les aides au rachat ou à la location d'immobilier sont réglementées (maxima pour les rabais). En outre garanties d'emprunt et prises de participation dans le capital des sociétés commerciales sont très contrôlés. Si le montant des prêts, avances et bonifications d'intérêts n'est pas plafonné, ces procédures sont limitées aux projets créant 30 emplois au maximum par établissement et 10 par extension
Les données disponibles auprès du Ministère du Budget n'intègrent que les collectivités de plus de 5000 habitants (commune, département ou région) et les aides au secteur privé. La difficulté de l'analyse de ces aides part du fait que leur recensement apparaît imprécis, incomplet avec des résultats dont la fiabilité est sujette à caution (Cour des Comptes, 1996). Au total, l'ensemble des aides locales s'est élevé à 14,375 Milliards de Francs en 1994 (10,8 Milliards de Francs en 1989). Elles semblent être en forte croissance par rapport aux dépenses totales des collectivités locales et représentent de 1 à 5 % du total des dépenses (pour les interventions économiques stricto-sensu ) .
Graphique 5. Évolution des aides
financières des collectivités locales
(en millions de F)
(
source : Direction de la Comptabilité
publique
)
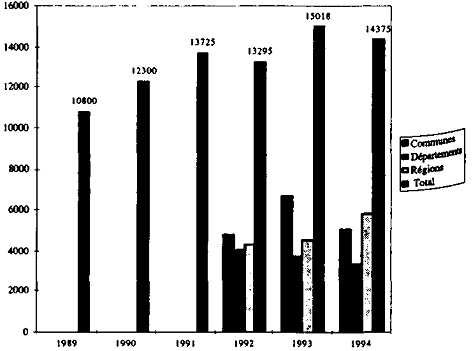
La pression sociale sur les élus et sur les collectivités s'est intensifiée, et les collectivités locales ont tendance à devenir des acteurs du développement économique local, sans avoir forcément le recul suffisant pour évaluer la cohérence globale et l'efficacité dans le temps de leurs interventions économiques.
À côté de ces éléments, il y a l'impact non négligeable des mesures fiscales, puisque le produit de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises représente près de 50 % du produit des impôts locaux.
L'essentiel des interventions reste concentré sur les aides à l'immobilier d'entreprise et aux terrains, celles-ci étant de plus en plus confiées à des structures de droit privé. Cet élément est d'autant plus net que l'on constate une baisse des aides directes. Par exemple, les PRE et PRCE ont chuté de 407 millions de francs en 1987 à seulement 103 millions de francs en 1994.
1.5 La suppression de la taxe professionnelle sur les salaires
Cette mesure est par nature ponctuelle. Engagée à partir de la loi de finances 1999, il s'agit de supprimer en cinq ans la part salariale de l'assiette de la taxe professionnelle.
En effet, jusqu'à la réforme, la base d'imposition à la taxe se compose de deux éléments :
- la valeur locative des immobilisations corporelles utilisées par l'entreprise pour son activité productive
- 18 % du montant des salaires versés.
Ainsi, en 1997, les salaires constituent 35 % de l'assiette globale de la taxe.
L'objectif de la mesure fiscale est de soulager principalement les PME, et surtout les secteurs à forte intensité en main d'oeuvre, comme les services, le bâtiment et le commerce. À l'horizon des 5 ans, on espère favoriser de cette manière la création de 25 000 emplois supplémentaires. Le manque à gagner fiscal pour les collectivités locales sera compensé par l'État au travers d'une augmentation des dotations budgétaires, comme la dotation globale de fonctionnement. Le coût de cette mesure pour les finances publiques, compte tenu de diverses modifications intégrées dans la reforme, est estimé à 7,2 Milliards de francs.
2. Les mesures ciblées de politique de l'emploi
Les mesures ciblées de politique de l'emploi reposent sur le diagnostic d'une inégalité d'employabilité 53 ( * ) entre les individus présents sur le marché du travail, et notamment entre les jeunes (Gautié et Lefresne, 1997).
Mais dans ce cadre elle n'a, par définition, qu'une visée relative, car il est question de modifier la place des uns (les bénéficiaires) par rapport à celle des autres (les non- bénéficiaires). D'une certaine manière, elle reprend à son compte l'idée d'un chômage de file d'attente. Toute mesure fondée sur un critère (âge, durée de chômage...) est susceptible d'aboutir mécaniquement à rendre inemployable les individus qui dépassent le seuil retenu, quelques soient leurs caractéristiques propres. Il s'agit alors de compenser la plus faible productivité de la catégorie cible par des subventions ou des contrats aidés les concernant, ou bien d'améliorer leur capital humain par des mesures de formation afin de leur permettre d'entrer en concurrence avec les travailleurs réputés plus productifs. Ces mesures ciblées possèdent nécessairement une contrepartie en terme d'exigence du public cible concerné. L'effet net sur l'emploi est cependant difficile à évaluer : il faut en effet tenir compte des effets d'aubaine et de substitution (ce point sera traité dans les évaluations traitées dans ce rapport).
Les dispositifs prennent principalement cinq formes (DARES, 1996) :
- l'aide financière directe à l'embauche par exonérations de cotisations sociales ou versement d'une prime,
- l'aide à la formation des publics cibles
- l'aide à la création d'entreprise,
- l'aide à la reconversion dans le cadre de plans sociaux et l'aide à la préretraite progressive
- l'aide à l'insertion dans le cadre d'activités en marge du secteur marchand.
2.1. Les aides à l'emploi dans le secteur marchand
Le premier type de dispositif ciblé entrant dans la catégorie des emplois marchands aidés correspond aux mesures d'allégement du coût du travail qui peuvent être classées parmi les mesures visant à abaisser le coût relatif du travail. Elles consistent à définir des catégories- cibles dont la productivité est postulée inférieure. Elles visent alors à réduire le coût relatif de populations-cibles supportées par les entreprises dans le but de provoquer une modification de la combinaison productive des entreprises pour les inciter à substituer ces catégories cibles à du capital et à du travail qualifié. Les catégories-cibles sont principalement les jeunes et les chômeurs de longue durée.
. Aide au premier emploi des jeunes (APEJ) : cette mesure s'adresse aux entreprises embauchant des jeunes de 16 à 25 ans n'ayant pas encore occupé d'emploi ou sortant de CES. Elle est valable pour un CDD de 18 mois minimum ou pour un CDI. Il s'agit d'une prime de 9000 francs payée lors de l'embauche.
. contrat initiative emploi (CIE) : il concerne les chômeurs de longue durée, les bénéficiaires du RMI, les chômeurs de plus de 50 ans, les travailleurs handicapés et les jeunes de moins de 26 ans sans diplôme. Il s'agit soit d'un CDD (12 à 24 mois) soit d'un CDI, contrat à temps plein ou d'au moins 16 h hebdomadaires, il comprend une formation facultative (200 à 400 heures) et la rémunération du CIE doit être égale au minimum au SMIC ou au minimum conventionnel. L'employeur bénéficie d'une exonération des cotisations patronales jusqu'à 120 % du SMIC (pour 24 mois maximum), jusqu'à l'âge de la retraite pour les plus de 50 ans plus prime mensuelle (1000 à 2000 francs), ainsi qu'une aide à la formation de 50 francs / heure,
convention de coopération de l'UNEDIC : Cette mesure s'applique pour les embauches sous CDI ou CDD (au moins 6 mois) d'allocataires de l'UNEDIC percevant l'AUD depuis au moins 8 mois. L'employeur perçoit pendant un an l'allocation-chômage qui aurait été versée au nouvel embauché.
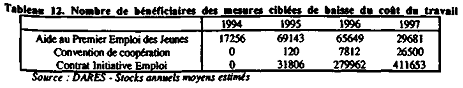
2.2. La formation des publics cibles
Nous traitons ici essentiellement des mesures de formation dont les flux financiers sont dirigés vers les entreprises, c.a.d les contrats en alternance en direction des jeunes. Nous n'aborderons pas les stages de formation en direction des jeunes ou des chômeurs de longue durée.
Les contrats de formation en alternance dispositifs sont mixtes dans leurs objectifs et dans les mécanismes économiques qu'ils souhaitent susciter : formation des bénéficiaires en partie par l'expérience et l'acquisition de savoir-faire sur le tas et baisse du coût relatif du travail.
contrat d'apprentissage : Cette vieille mesure n'est pas au départ un dispositif de la politique de l'emploi, mais plutôt une voie de formation initiale, intégrée dans le système éducatif. Elle a été incorporée dans la dépense pour l'emploi, en particulier dans les dépenses actives, des lors que les employeurs ont bénéficié d'exonérations de cotisations sociales. Elle s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sans qualification ou ayant une qualification inadaptée. Il s'agit d'un CDD (1 à 3 ans), comprenant une formation (400 à 1500 heures) avec certification à la clé (diplôme éventuellement). La rémunération minimale varie de 25 à 78 % du SMIC selon l'âge et l'ancienneté dans le contrat. Elle procure l'exonération totale des cotisation patronales (et salariales pour entreprises moins 10 salariés).

contrat d'adaptation : Ce dispositif concerne les Jeunes de 16 à 25 ans et est organisé sous la forme d'un CDD (6 à 12 mois) ou d'un CDI, incluant une formation (200 heures en CDD à 1 an en CDI) et proposant une rémunération égale à au moins 80 % du minimum conventionnel. L'État verse 50 francs / heure de formation.
contrat de qualification : Visant les Jeunes de 16 à 25 ans sans qualification ou ayant une qualification inadaptée, cette mesure consiste dans un CDD (6 mois à 2 ans), offrant une formation (au minimum 1/4 de la durée du contrat) avec certification à la clé (diplôme éventuellement). Elle permet une rémunération inférieure au SMIC, de 30 a 75 % du SMIC selon l'âge et l'ancienneté dans le contrat. Elle offre à l'employeur une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale, une prime de 5 à 7000 francs à la signature du contrat et 60 francs / heure de formation.
contrat d'orientation : S'adressant aux Jeunes de 16 à 23 ans sans qualification, ce CDD de courte durée (3 à 6 mois) contient une formation (au moins 32 heures / mois) et donne la possibilité à l'employeur de proposer une rémunération allant de 30 à 65 % du SMIC selon l'âge. Il comporte une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale.
Ces mesures ont connu un fort développement au cours des années 1980, à la suite des accords des partenaires sociaux. Mais leur utilisation est fortement soumise aux avantages en termes de baisse du coût salarial, comme en témoigne la variation dans l'évolution du stock de bénéficiaires du contrat d'adaptation, au gré des exonérations et autres primes (cf. Tableau 13).
La loi quinquennale de 1993 sur l'emploi et la formation professionnelle s'est attachée à développer une plus grande articulation entre les différentes voies de la formation professionnelle des jeunes, entre formation initiale et formation professionnelle, d'une part, et entre les différentes voies de la formation par alternance, d'autre part. En ce sens, l'État prend appuie sur les Régions pour impulser la construction de politiques qui mettent en cohérence les différentes voies de la formation des jeunes, initiale, professionnelle et par apprentissage.
2.3. L'aide à la création d'entreprise et d'activité
* L'Aide au Chômeur Créateur ou Repreneur d'Entreprise
L'Aide au Chômeur Créateur d'Entreprise (ACCRE) a progressivement été mise en place de 1977 à 1980. Elle a été modifiée en dernier lieu par la loi de Finances pour 1997 qui supprime l'aide financière de 32 000 francs au maximum.
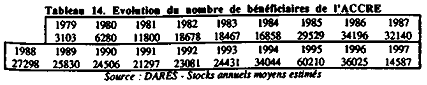
Cette aide porte sur l'exonération de cotisations sociales - ou sur l'allégement des cotisations des travailleurs non salariés - lors de la création ou de la reprise d'une entreprise ou à l'exercice d'une autre profession non salarié.
Les personnes bénéficiaires sont les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des 18 derniers mois, les demandeurs d'emploi indemnisés, les Rmistes (et leur conjoint) et les personnes remplissant ces conditions avant de bénéficier d'un Contrat Emploi Solidarité.
Le chômeur créateur de l'entreprise peut bénéficier d'une aide de l'État pour le financement des actions de conseil ou de formation à la gestion de l'entreprise.
* L'aide à la création d'activité
Il s'agit essentiellement de mesures d'incitation au développement des emplois familiaux. Les ménages peuvent soit devenir employeurs soit avoir recours à une organisation agrée de services aux personnes. Les particuliers employeurs peuvent rémunérer les salariés selon deux modes : soit par bulletin de paye soit par chèques emploi service. Dans ce dernier cas, c'est un organisme national qui traite les formalités administratives. Le chèque emploi service est utilisable depuis 1996 sans limites horaires.
En termes d'avantages fiscaux, les ménages d'employeurs peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt représentant 50 % de la dépense annuelle (salaire et cotisations sociales). Depuis 1998, le plafond des dépenses ouvrant droit à réduction fiscale est de 45 000 francs et le montant de l'AGED (allocation de garde d'enfant à domicile) est diminué de 25 ou 50 % en fonction de l'âge des enfants et des ressources du ménage.
Le nombre total d'employeurs à domicile se ralentit après une phase de croissance forte. Il est d'abord passé de 515 000 en 1991 à 1 147 000 en 1997. La hausse a été de 8,1 % en 1997, après 17,6 % en 1996 et 21,4 % en 1995. Enfin 94 % des ménages n'emploient qu'une seule personne (Cealis et Zilberman, 1998). Les emplois crées par ce biais sont de faible durée, ils ne constituent que des ressources d'appoint et non de "vrais emplois" : leur durée moyenne hebdomadaire est d'environ 9 heure en 1996.
Cependant, à la fin de l'année 1997, 103 300 personnes étaient employées par des organismes agrées de services aux personnes et les quatre-cinquième sont sous contrat à durée indéterminée.
2.4. L'aide à la reconversion dans le cadre de plans sociaux et à la préretraite progressive
Les financements publics des plans sociaux des entreprises ont pris une importance croissante dans la première moitié des années 1990. Les dépenses ont atteint 17,8 milliards de francs en 1995. Leurs bénéficiaires représentent désormais la moitié environ des licenciements pour cause économique. L'essentiel de cette évolution est dû à trois mesures : les conventions de conversion qui coûtent 6,6 milliards en 1995, les allocations spéciales du fond national pour l'emploi (ASFNE) ou préretraites totales qui coûtent 19,8 milliards de francs en 1995 et les préretraites progressives (PRP) 54 ( * ) qui coûtent à l'État 2,2 milliards de francs en 1995 55 ( * ) .
Les aides à la sortie de l'entreprise (conventions de conversion et ASFNE) notamment par mesure d'âge restent à un niveau important par rapport aux aides au maintien dans l'entreprise. Certains dispositifs ont de plus été détournés de leurs objectifs comme, par exemple, les dispositifs de "portage" évoqués plus loin (Liaisons Sociales, n° 117/97-W, citant le rapport à la cour des comptes réalisés en 1995 sur les plans sociaux).
La préretraite progressive
On note cependant l'essor des aides au maintien dans l'entreprise au pris d'un passage à temps partiel. Ainsi en 1995, PRP et aides au passage à temps partiel représentent 18 % des aides du FNE. Le nombre de salariés pris en charge à ce titre par l'UNEDIC est passé de 3610 en 1990 à 26858 en 1995. Pour 1998 les premières estimations font état d'environ 20000 personnes (CSERC, 1998).
Les personnes en PRP associées au temps partiel présentent cinq particularités (CSERC, 1998) :
- ils sont relativement diplômés,
- ils exercent trois professions en général faiblement concernées par le temps partiel : contremaître agent de maîtrise techniciens, ouvriers qualifiés de type industriel et ouvriers qualifiés de type artisanal,
- huit salariés sur dix travaillent entre 15 heures et 30 heures par semaine et autant ne souhaitent pas travailler d'avantage, ce qui représente une part importante du temps partiel non subi,
- ils appartiennent relativement souvent à de grands établissements industriels qui sont les plus nombreux à avoir conclu ce type d'accord,
- ils ont souvent un rythme de travail organisé en cycle et des horaires plus irréguliers que les salariés à temps plein.
|
Préretraites progressives, temps partiel et embauche de jeunes La préretraite progressive créée en 1982. s'est révélée être un moyen pour diminuer le coût que représentaient pour l'État les préretraites définitives (environ 300 000 francs par personne), sur lesquelles convergeaient les compromis des partenaires sociaux lors de plans de réductions d'effectifs des entreprises. Dans le cadre de la loi quinquennale qui reprend le dispositif existant, l'entreprise peut proposer à ses salariés de plus de 55 ans de travailler volontairement à temps partiel s'ils ont plus d'un an d'ancienneté pour faciliter l'embauche de nouveaux salariés. Mais, le temps partiel (jusqu'à 32 heures) qu'effectue le préretraité se répartie sur la durée totale de la préretraite et non plus sur l'année comme cela était le cas auparavant Une allocation compensatrice lui garantit un niveau régulier de revenus à 80 % de son salaire antérieur. Les conditions d'application de l'abattement sur les cotisations sociales sont assouplies : le passage à temps partiel doit s'accompagner d'une ou plusieurs embauches a durée indéterminée permettant de maintenir le volume d'heure initial sauf si la préretraite "constitue une alternative à un licenciement collectif pour motif économique" (auparavant plan social). Ce temps partiel est applicable aux contrats qui appréhendent la durée du travail sur l'ensemble de l'année. De plus les employeurs pourront, par exception au principe de non cumul des exonérations, bénéficier également des exonérations générales sur le allocations familiales (taux d'abattement à 30 % ). Une partie des recrutements doit s'effectuer parmi des publics "prioritaires" (jeunes de moins de 26 ans de faible niveau de qualification, chômeurs âgés de plus de 50 ans, bénéficiaires du RMI etc.). |
La préretraite progressive permet de répondre à deux objectifs principaux qui sont :
- La réduction d'effectif dans le cadre de plans sociaux :
Dans la première moitié des années 1990, la PRP est souvent mise en place comme alternative aux licenciements collectifs dans le cadre de stratégies de restructurations et de recherche de réduction de la masse salariale qui ont mobilisé l'outil "plan social". Dans cette perspective, elle apparaît comme un compromis très acceptable par les partenaires sociaux en diminuant le nombre de licenciements collectifs et de conventions de conversion. On note cependant un problème pour les salariés âgés pour lesquels les entreprises préfèrent une convention de conversion qui leur revient moins cher qu'une mesure de PRP.
Par ailleurs, l'enquête de la Cour des Comptes fait apparaître que du côté des salariés, la PRP étant habituellement considérée comme un sas d'entrée en ASFNE, elle n'est acceptée par eux que s'ils ont la garantie de pouvoir bénéficier ultérieurement de la préretraite totale ; ce qui n'est pas dans l'intérêt de l'État qui visait à réduire l'importance des mesures d'âge. On retrouve en outre cet aspect de compromis entre les salariés et les responsables d'entreprise au détriment de l'État, dans l'importance massive de l'utilisation combinée de dispositifs dits de "portage" où la préretraite progressive est utilisée comme transition (à partir de 55 ans), en attendant que le bénéficiaire ait l'âge pour se voir attribuer une préretraite définitive. Or, cette pratique était en principe proscrite, sauf dérogation dont l'initiative appartient exclusivement à l'administration centrale.
- L'organisation du transfert de savoir-faire dans le cadre d'un "rajeunissement de la pyramide des âges"
La préretraite progressive peut également être un outil de gestion du personnel hors plan social. En effet, l'un de ses principaux intérêts réside dans la transmission du savoir-faire entre les salariés âgés sur le départ et les plus jeunes dont ceux nouvellement recrutés. Elle permet également à l'entreprise de rajeunir la pyramide des âges. Cette utilisation de la préretraite s'est renforcée depuis le milieu des années 1990. Elle est d'autant plus efficace qu'elle se combine à des démarches concertées de construction des compétences et de qualification associées à la réorganisation de services, fonctions et postes.
Mais ce dispositif, que l'entreprise trouve tout de même coûteux (sa participation a été augmentée en 1994) n'est mis en place hors plan social que lorsque les perspectives de marché sont favorables. Tel était le cas des Chantiers Navals de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Selon la convention signée en 1993, entre l'entreprise et trois Syndicats, prés de 600 salariés devaient souscrire à la formule PRP, en échange de l'embauche de 300 jeunes. Mais ce dispositif n'aurait été rendu viable que par la bonne tenue des carnets de commande jusqu'en 1997 (Briec, 1994).
De même, en 1993, la société Spie-Batignolles, filiale du groupe Schneider (33 000 salariés), a indiqué que le départ en préretraite progressive de cadres, d'agents de maîtrise ou d'ouvriers lui permettait d'accueillir des jeunes qui seront formés notamment par les personnes qui auront choisi de profiter de cette mesure. Selon la convention-cadre signée avec le ministère du travail l'entreprise souhaitait transformer 400 emplois à temps pleins en mi-temps, pour embaucher 250 jeunes en contrat à durée indéterminée, contrats d'apprentissage ou contrats de qualification.
Enfin plus récemment, Usinor-Sacilor et les représentants de quatre organisations syndicales ont signé pour les cinq ans à venir un Avenant à l'Accord Collectif sur l'Emploi des Personnels ouvriers et Etam (juillet 1995) qui comprend une convention avec l'État sur la PRP. Ce dispositif est combiné à un dispositif d'offre de temps partiel choisi ainsi qu'à des dispositifs de mobilités internes et externes volontaires. Sur cette base, la direction tente de concilier à la fois l'aspiration de ceux qui souhaitent une réduction du temps de travail, la réalisation d'objectifs économiques et la reprise de l'embauche. Comme la pratique accrue du temps choisi va accentuer les besoins de réorganisation pour la hiérarchie et les salariés, ceux-ci pourront s'appuyer sur la démarche compétence et la mise en oeuvre de "A Cap 2000" sur le terrain (Accord pour la formation, la qualification des salariés et la mobilité professionnelle des salariés).
Le dispositif de convention de conversion
Le recours à cette mesure s'est considérablement développé depuis sa création. En 1994, il a concerné près de 150 000 personnes, ce qui représentait approximativement 60 % des bénéficiaires des mesures d'accompagnement de l'année pour une dépense totale de 7,6 milliard, assumée pour 20 % par l'État, pour 51 % par l'UNEDIC, pour 29 % par les entreprises et les salariés (Liaisons Sociales n° 117/97-W).
|
Procédures de licenciements
économiques
La proposition de convention de conversion est l'un des éléments clés de la procédure de licenciement pour motif économique. La convention de conversion est impérativement proposée par l'employeur au salarié menacé de licenciement pour motif économique. Lorsque le salarié adhère à la convention de conversion, la procédure de licenciement s'arrête et le contrat de travail est interrompu d'un commun accord. Dans le cas contraire le salarié est licencié pour motif économique (Liaisons Sociales, n° spécial 12225, 26 juillet 1996). Institué par un accord des partenaires sociaux en 1986, le dispositif des conventions de conversion vise à favoriser le reclassement rapide des salariés victimes d'un licenciement pour cause économique. Cette aide permet au salarié de bénéficier pendant six mois d'actions personnalisées, principalement de formation. Il perçoit un revenu de remplacement supérieur à celui qu'il aurait touché au titre de l'allocation unique dégressive de l'assurance chômage. Au terme des six mois le salarié est pris en charge par le régime général d'assurance chômage. |
Selon le rapport de la Cour des Comptes réalisé en 1997 sur l'accompagnement par l'État des plans sociaux, l'évolution des conventions de conversion pose un problème de cohérence du dispositif d'intervention de l'État, pour la protection des salariés âgés. Dans le cas des salariés de plus de cinquante ans le recours à la convention de conversion s'avère financièrement avantageux pour les employeurs, qui sont alors exonérés de la contribution supplémentaire renchérissant le coût des licenciements hors Fond National pour l'Emploi (FNE). De plus, ils n'ont pas la charge des éventuelles contreparties que peuvent comporter les conventions d'allocation spéciales dont fait partie la préretraite définitive.
2.5. L'aide à l'insertion dans le cadre d'activités en marge du secteur marchand
Aux marges du secteur marchand, il y a tout d'abord le secteur de l'insertion par l'activité économique. C'est le tiers secteur, combinaison de l'immersion dans la sphère marchande et de productions éthiques. Conformément à l'objectif de création de nouvelles activités, la politique de l'emploi tente de favoriser l'émergence de nouveaux services socialement utiles, et, à défaut de parvenir à solvabiliser la demande, il s'agit de subventionner les structures de production en contrepartie de l'embauche de publics en difficulté.
Les entreprises d'insertion et les associations intermédiaires, correspondent à cette volonté. Ainsi, les entreprises d'insertion peuvent embaucher des personnes défavorisées sur contrat à durée déterminée pour une durée de 24 mois maximum Chaque poste de travail permet à l'entreprise de recevoir 38000 francs d'aide par an.
Les associations intermédiaires bénéficient d'une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi de salariés travaillant moins de 750 heures annuelles (soit un emploi à mi-temps). Ces salariés sont recrutés au sein des publics les plus en difficulté : chômeurs de longue durée et allocataires du RMI.
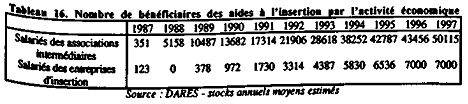
Mais aux marges du secteur marchand, il y a aussi toute la palette des contrats aidés du secteur non marchand en direction des jeunes et des chômeurs de longue durée. Très développées à partir du milieu des années 1980, ces mesures actives sont sources de nombreuses innovations du droit social, sans échapper toutefois aux critiques sur le caractère hybride des statuts proposés.
Ces dispositifs sont les suivants :
contrat emploi solidarité : Jeunes 16 à 25 ans, CLD et titulaire du RMI. Embauche sous statut CDD (3 à 12 mois) d'une durée hebdomadaire de 20 h. La formation est facultative et la rémunération minimale prévue se situe au niveau du SMIC horaire. L'employeur bénéficie d'une exonération des cotisations patronales et d'une prise en charge par l'État de 65 ou 85 % de la rémunération, avec en plus une aide éventuelle de 22 francs / heure pour la formation.
contrat emploi consolidé : Conçu pour les plus de 50 ans au chômage depuis un an, les bénéficiaires ou RMI depuis un an, les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans, les travailleurs handicapés et certains jeunes ayant de grosses difficultés d'insertion (quartiers d'habitat dégradé), tous passés par CES. L'embauche s'effectue sous la forme d'un CDD de 12 mois renouvelable jusqu'à cinq fois ou d'un CDI (durée maximale de 30 h hebdomadaire pour obtenir une participation de l'État). La rémunération prévue est égale au SMIC horaire jusqu'à 120 %. L'employeur bénéficie de l'exonération des cotisations patronales et de la prise en charge partielle du salaire reversé.
contrat emploi ville : Ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans ayant de grosses difficultés d'insertion (quartiers d'habitat dégradé), ce CDD de 12 mois renouvelable jusqu'à cinq fois ou CDI (durée maximale de 30 h hebdomadaire pour obtenir une participation de l'État) prévoit une rémunération égale au SMIC horaire jusqu'à 120 % est offre une exonération des cotisations patronales et la prise en charge partielle du salaire versé.
contrat emploi-jeune : Destiné aux jeunes de 18 à 26 ans (30 ans si aucun droit au chômage), il s'agit d'un CDD de 5 ans à temps plein, avec une rémunération minimale égale au SMC mensuel. L'État prend en charge 92 000 francs de salaire annuel. Les emplois créés doivent correspondre à des activités et emplois nouveaux.
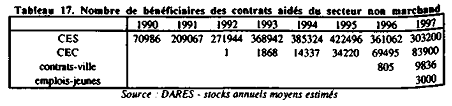
3. Tableau synthétique des objectifs et des instruments de politique de l'emploi
Le tableau suivant récapitule notre typologie des mesures financées par les flux consacrés à l'emploi. Les dispositifs sont classés en fonction de leur objectif (selon qu'il vise à stimuler l'emploi, modifier la structure des qualifications, ou modifier la file d'attente des chômeurs).
Ce tableau ne vise pas l'exhaustivité mais il cherche à fournir un éclairage analytique pour le classement de certaines mesures essentielles de la politique de l'emploi.
|
Objectifs des dispositifs d'aide à l'emploi |
Instruments ou mécanismes économiques induits |
|
|
Mesures d'ordre général sans contrepartie - exonération bas salaires -exonération 1er salarié - exo territorialisées - exo textile, habillement, cuir - abattements temps partiel |
- croissance plus riche en emploi |
- réduction du coût relatif du travail non qualifié - compétitivité-prix - ARTT imposée ou choisi individuellement sans compensation salariale |
|
Mesures d'ordre général dans le cadre de la contractualisation État-Entreprise - abattements dans le cadre de la loi Robien -abattements dans le cadre de la loi Aubry - formation continue - Aide au conseil (branches, entreprises) |
- croissance plus riche en emplois à temps complets - idem - adaptation des compétences et qualifications aux innovations d'organisation |
- 2RT négociée avec compensation salariale mais sans hausse du coût du travail par financement public sous condition d'embauché ou de maintien de remploi - performance globale de l'entreprise et prévention du chômage |
|
Mesures ciblées -APEJ - convention de coopération - stages d'insertion |
- discrimination positive : faciliter l'insertion ou la réinsertion de catégories discriminées |
- baisse du coût relatif du travail des publics ciblés - augmentation du capital humain - augmentation du capital humain |
|
Mesures ciblées avec convention État-Entreprise - contrats en alternance - CIE - CES - convention de conversion - préretraite progressive ... |
- discrimination positive : faciliter l'insertion ou la réinsertion de catégories discriminées Idem idem - employabilité - cessation anticipée d'activité |
- baisse du coût relatif du travail des publics ciblés - augmentation du capital humain - baisse du coût relatif des chômeurs de longue durée et des jeunes - rajeunissement des effectifs, transferts de savoirs |
CHAPITRE 3 - LES ÉVALUATIONS MÉTHODOLOGIES ET RÉSULTATS
L'évaluation des politiques de l'emploi est un champ mouvant où les méthodologies utilisées sont discutées, voire controversées, les résultats sont fragiles et se contredisent parfois.
L'évaluation macro-économique est la reine des méthodes d'évaluations parce qu'elle a pour ambition de fournir des prédictions à partir de simulations chiffrées rigoureuses, à condition d'y inclure les hypothèses appropriées.
Quand bien même cette démarche aboutit à mettre en évidence la faisabilité d'une mesure, la difficulté est alors d'évaluer les conditions concrètement existantes qui permettent ou non la mise en oeuvre du dispositif dont les simulations ont pronostiqué le succès potentiel. Tout dépend alors de la capacité des acteurs, à l'échelle des entreprises, à se saisir desdites mesures, à les interpréter, à construire les règles et tes coopérations qui les rendent applicables. Ces mêmes acteurs sont parfois susceptibles de rejeter les dispositifs proposés, de tes contourner, d'en bloquer ou d'en pervertir la mise en oeuvre. Pour évaluer la portée des mesures de politique de l'emploi, les études micro-économiques et les évaluations monographiques sont alors nécessaires pour compléter les prédictions macro-économiques.
La première section présentera les principales évaluations macro-économiques des différents instruments mis en oeuvre dans le cadre des mesures ciblées et non-ciblées. La deuxième section précisera le profil des bénéficiaires et les entreprises utilisatrices des flux d'aide à l'emploi. La troisième section tentera de cerner les processus d'apprentissage des acteurs à l'oeuvre dans les monographies disponibles portant sur l'utilisation faite des différents dispositifs de politique de l'emploi.
1. Les évaluations macro-économiques
1.1. Politiques de l'emploi et chômage d'équilibre
L'analyse macro-économique dominante des effets de la politique de l'emploi sur le chômage part de l'hypothèse néoclassique du taux de chômage d'équilibre.
Le taux de chômage d'équilibre, encore appelé chômage naturel ou chômage structurel, correspond dans cette optique à l'équilibre spontané du marché du travail compte tenu de la structure des coûts relatifs des facteurs de production. Ce taux de chômage est exclusivement déterminé par des facteurs d'offre. Il n'a aucune raison de bouger tan que le coût relatif réel des facteurs de production (le coût relatif du travail par rapport au coût d'usage du capital) demeure constant et tant que l'offre de travail de la population active est inchangée.
Les politiques de l'emploi agissent sur le niveau du chômage naturel si elles réduisent le niveau de la population active ou influencent l'incitation à la recherche d'emploi des chômeurs (politiques passives), ou bien si elles contribuent à réduire le coût relatif du travail (politiques actives dirigées vers l'abaissement du coût du travail).
Le modèle utilisé pour représenter cette hypothèse est exposé par Layard et Nickell (1986). Le taux d'emploi de l'économie est donné par le point de rencontre entre une courbe de formation des salaires et une courbe d'emploi (figure 1, page suivante).
La courbe de formation des salaires WS incorpore les revendications syndicales. Ces dernières ont d'autant plus de portée que le taux d'emploi est fort et que le chômage diminue, suivant en cela l'hypothèse d'une relation de Phillips. L'emploi (courbe E) est une fonction décroissante du salaire réel, ce qui respecte l'hypothèse d'une courbe de demande de travail néo-classique ( infra ) : l'hypothèse associée à cette courbe d'une productivité marginale décroissante signifie que les employeurs qui maximisent leur profit ont intérêt à embaucher un travailleur supplémentaire (dont la productivité individuelle est supposée plus faible) si et seulement si le salaire diminue.

Figure 1 - Le modèle de Layard et Nickell
Le taux de chômage naturel u* est alors donné par la différence entre le niveau de la population active (donné par la verticale PA à droite du graphique) et le taux d'emploi n*. Toute modération des revendications salariales déplace la courbe de formation des salaires vers le bas, augmente le taux d'emploi. Toute mesure susceptible de réduire le coût du travail accroît de la même façon le taux d'emploi et réduit le taux de chômage naturel. La Plus fréquente des études retenues par l'OCDE reprend les conclusions du modèle de Layard et Nickell en termes d'analyse des déterminants du chômage structurel. Elle tente d'expliquer les différences de niveau du chômage entre les pays membres de l'OCDE 56 ( * ) en reliant le chômage et l'emploi à un ensemble de variables institutionnelles à partir de données transversales.
L'équation testée fait alors dépendre le chômage positivement de la durée et du montant de l'indemnisation chômage, négativement du degré de coordination des Syndicats et négativement du niveau de la dépense publique pour l'emploi (Layard et al , 1991).
On suppose ici que la durée et le montant de l'indemnisation chômage décourage l'incitation au travail des chômeurs. On suppose également que le degré de coordination des Syndicats dans la négociation collective les incite à "internaliser" les conséquences nocives pour l'emploi d'une surenchère salariale. On postule enfin que les dépenses actives sont orientées vers l'abaissement du coût du travail grâce aux subventions et exonérations de "charges sociales".
Les résultats indiquent que les politiques actives exercent un impact sur l baisse du chômage. Les mécanismes par lesquels cet effet se produit ne sont néanmoins pas présents dans les équations estimées (qui sont des formes réduites). La validité statistique des équations 57 ( * ) permet donc seulement de conclure à l'existence ou non d'un impact de la politique de l'emploi sur le chômage, lequel serait alors fondé sur un effet de modération salariale, suivant la logique interne à cette formulation, mais sans que ce canal de transmission ne soit réellement évalué.
|
Les effets de la politique de l'emploi sur le
chômage :
Le problème majeur auquel sont confrontées les études d'impact macro-économiques concerne le sens de la causalité établie. En effet, la vérification de l'hypothèse selon laquelle les politiques actives de l'emploi ont un effet sur le chômage comporte un risque de biais de simultanéité, du fait que la variable d'intensité des politiques de l'emploi est probablement liée à la variable chômage par une relation double. D'une part, comme le suppose l'équation estimée, elle exerce un effet potentiel de réduction du chômage ; mais réciproquement, le taux de chômage est susceptible d'influer sur la détermination du niveau de politique active de l'emploi. Cette relation renvoie au concept de fonction de réaction des pouvoirs publics, qui relie l'intensité de l'intervention volontariste sur le marché du travail à des indicateurs du fonctionnement de celui-ci. Or il apparaît raisonnable de faire l'hypothèse que le chômage constitue le principal déterminant de la réaction des pouvoirs publics, du fait de la lisibilité du taux de chômage et de son incidence politique. Dans ce cas, toute estimation de l'effet des politiques de l'emploi posant le chômage comme variable indépendante comporte un risque de biais de simultanéité, qui dépend de la forme de la fonction de réaction et de la spécification de la variable de politique de l'emploi. On peut distinguer deux types d'approches de ce problème dans les évaluations basées sur une équation de chômage (Bellmann et Jackman, 1996). L'objectif commun à ces analyses est d'isoler la composante "exogène" de l'intensité de la politique active de l'emploi, en éliminant la part cyclique de la réaction politique, susceptible d'être corrélée à la variable chômage. En considérant les valeurs moyennes du chômage et de l'indicateur de la politique active de l'emploi sur le cycle, on résout donc a priori les problème potentiel d'endogénéité dans l'équation de chômage, à condition que la variable de politique active de l'emploi reflète correctement la fonction de réaction politique. Le débat porte alors sur la nature de l'objectif de moyen terme des pouvoirs publics : Layard et al (1991) supposent que ceux-ci cherchent à stabiliser le ratio dépense de politique active par chômeur, tandis que Bellmann et Jackman (1996) retiennent l'hypothèse d'un objectif de dépense en proportion du PIB. Cette dernière option serait en effet validée par Jackman (1995) 58 ( * ) , sur la base de la plus grande stabilité temporelle de l'expression de ratio de dépenses actives en fonction du PIB. Au-delà de ce débat, qui ne semble pas tranché, on peut souligner le caractère approximatif de ce mode de résolution du biais, qui rend nécessaires des recherches plus poussées sur la nature et la forme de la fonction de réaction des pouvoirs publics. Dans l'ensemble, les résultats des évaluations fondées sur une équation de chômage doivent donc être traitées avec prudence, quel que soit le modèle théorique sous-jacent. La variable représentative des politiques actives de l'emploi est également critiquable. L'indicateur retenu est le montant des dépenses consacrées aux politiques actives, rapporté soit au nombre de chômeurs, soit au PIB. Le recours à une telle variable n'est pas satisfaisant, pour deux types de raisons. Premièrement, un tel indicateur agrégé repose sur une définition conventionnelle de la dépense active de l'emploi par les organismes internationaux (l'OCDE dans les travaux cités). Cependant, il n'est pas certain que les données nationales soient directement compatibles avec cette convention, ce qui pose des problèmes de fiabilité des données. De plus, on peut s'interroger sur la pertinence de la référence exclusive à la dépense : elle conduit à mettre sur le même plan une logique d'interventions coûteuses, mais concentrées sur un faible nombre de bénéficiaires, et des mesures extensives du point de vue du nombre de participants, à faible coût. Or le nombre de bénéficiaires des mesures n'est pas neutre à l'égard de leur impact relatif, et l'hypothèse implicite, dans cette perspective, d'une relation dépense efficacité apparaît difficilement tenable. La controverse porte enfin sur les faiblesses économétriques de ces travaux. En effet, la plupart des études comparatives internationales sont menées avec des données transversales, ce qui se traduit par un nombre très réduit d'observations. Or le nombre de variables estimées apparaît, parallèlement, très élevé. Ainsi l'étude de Layard et al (1991) teste 7 variables sur la base de 20 observations ! La plupart des études améliorent toutefois cette caractéristique en considérant un ensemble de données « poolées , c'est-à-dire comportant à la fois une caractérisation transversale, et une dimension de la taille de l'échantillon. Toutefois, les auteurs signalent des problèmes de disponibilité des données réduisant la taille de l'échantillon (voir par exemple Sarfetta (1996), et ne traitent que des données annuelles, la source exclusive de ces données comparatives étant l'OCDE. Ces problèmes de données doivent là encore inciter à la prudence à l'égard des résultats obtenus, notamment du point de vue de la significativité des coefficients, qui n'est pas toujours directement interprétable. En effet, ces évaluations parviennent relativement fréquemment à des coefficients non significatifs : par exemple, dans l'étude de Bellmann et Jackman (1996), aucune des variables mesurant l'effet des politiques de l'emploi sur le taux de chômage n'est significative 59 ( * ) , sur la base de 65 observations (11 variables plus la constante). Or cette non significativité est interprétée économiquement par les auteurs, comme l'indice que les études micro-économiques « exagèrent l'effet des mesures sur l'emploi, puisqu'elles ne prennent pas en compte les effets de déplacement et de substitution. De telles conclusions peuvent être jugées hasardeuses, ou du moins fondées sur un a priori théorique. 60 ( * ) |
1. 2 Les simulations des effets de la réduction du coût du travail
1.2.1. L'élasticité emploi-salaire
L'élasticité de la demande de travail agrégée
La théorie néo-classique de la demande de travail repose, on le sait, sur l'hypothèse d'une fonction de production Cobb-Douglas à facteurs substituables : tout abaissement du coût relatif d'un des facteurs de production accroît l'utilisation de l'autre facteur. Pour valider empiriquement cette théorie, il s'agit de montrer que l'abaissement du coût relatif du travail par rapport au capital se traduit par une substitution du travail au capital. Les études utilisent les séries temporelles mesurant les effets des évolutions relatives du coût du travail par rapport au coût d'usage du capital sur les variations de l'emploi. L'élasticité emploi-salaire dépend alors essentiellement dans les équations testées de l'élasticité de substitution capital-travail. L'élasticité emploi-salaire mesure alors l'effet d'une variation du salaire sur l'emploi : par exemple, si l'élasticité emploi-salaire est de -0,3, cela signifie qu'une hausse de 10 % du coût du travail engendre une réduction de l'emploi de 3 % et, inversement, une baisse de 10 % du coût salarial accroît l'emploi de 3 %.
En dressant le bilan des études portant sur des pays étrangers, Hammermesh (1991) a estimé une élasticité assez forte, comprise entre -0,15 et -0,75. Pour la France, en revanche, le problème est qu'une telle relation ne trouve pas de validation économétrique sur des séries temporelles agrégées au plan macro-économique. Legendre et Le Maitre (1997, p. 112) soulignent ainsi que « les investigations menées à partir de données agrégées ne I parviennent que très difficilement à mettre en évidence un effet du coût relatif des facteurs sur la demande de travail .
A tel point que les grands modèles de simulation macro-économique (Amadeus de l'INSEE,
Métric de la Direction de la Prévision, Banque de France) utilisent une élasticité emploi-salaire nulle.
Sur des données de panel, l'élasticité emploi-salaire peut cependant être mise en évidence, ce qui paraît logique parce que le coût relatif du travail peut être sectoriellement une variable de la décision d'embauche sans forcément constituer l'argument central d'une théorie générale de l'emploi.
Lorsqu'elle est mise en évidence, l'élasticité emploi-salaire est cependant très faible : elle oscille entre -0,06 et -0,08 (Maarek, 1994, p. 51). Cela signifie qu'une baisse des salaires aurait très peu d'effet sur l'emploi (une baisse de 1 % du coût du travail accroîtrait l'emploi de 0,06 ou 0,08 %), ou encore qu'il faudrait baisser énormément le salaire des secteurs concernés pour créer des emplois.
Devant ces résultats qui, pour le cas français, donnent peu de crédit à la demande de travail néo-classique, Dormont (1994 et 1997) propose d'introduire séparément le coût du travail et le coût d'usage du capital dans les équations testées. Elle découvre alors une élasticité significative de l'ordre de -0,5 ou -0,8 selon les hypothèses. Cette élasticité est moins forte pour les emplois qualifiés. Mais cette élasticité demande que les fondements théoriques de cette opération soient précisés. On le sait, la théorie néo-classique de la demande de travail reposait sur une fonction de production à facteurs substituables capital-travail. Or, dès que le salaire est dissocié du coût d'usage du capital dans les équations testées, ce n'est plus cette théorie qui est testée : il n'est plus possible de valider les conséquences d'une baisse du coût relatif d'un des facteurs par rapport à l'autre sur sa demande puisque l'un des facteur a été retiré de l'équation (Husson, 1994). Ce qui ne veut évidemment pas dire que le coût du travail ne joue aucun rôle dans l'explication du chômage, mais que les mécanismes de substitution des facteurs en fonction de leur coût relatif, décrits par la théorie de l'emploi couramment admise, sont invalidés.
Le rapport du CSERC (1996) constate dans ce sens que "les estimations sur données macro-économiques concluent généralement en France à une élasticité nulle ou non significative dans le cas où c'est le coût relatif des facteurs qui détermine l'emploi et à une élasticité de -0.5 dans le cas où c'est le niveau absolu du coût du travail qui importe (p. 80).
Ceci signifie que si le coût du travail exerce un effet sur l'emploi, c'est par l'intermédiaire d'un effet profit et non d'un effet de substitution. Or, il est vraisemblable, au plan macro-économique, que la profitabilité des entreprise soit désormais restaurée à des niveaux tels que de nouvelles baisses du coût du travail ne produisent un effet marginal sur l'emploi. Seules, les unités de productions subissant une contrainte financière pourraient être stimulées par une baisse du coût du travail. Cependant, dans la mesure où une baisse d'ordre général du coût du travail bénéficie indifféremment à tous les types d'entreprises, même lorsqu'elle est ciblée sur les bas salaires, l'instrument approprié serait sans doute une réforme de la fiscalité des entreprises pour stimuler les entreprises aux marges moins fortes souffrant de charges financières importantes.
Coût relatif du travail non-qualifié et emploi
Comme les tests agrégés sont incertains, de nombreux travaux se sont concentrés sur les emplois non-qualifiés 61 ( * ) faiblement rémunérés. Ce sont en effet les travailleurs non-qualifiés qui représentent la majeure partie du chômage de longue durée. En période de reprise, ce sont eux qui se retrouvent en queue de file d'attente. En raison de leur productivité supposée plus faible, ces travailleurs - et en particulier les jeunes - pourraient être employés pour peu que le coût du travail non-qualifié, et en particulier le salaire minimum, soit réduit 62 ( * ) .
Dormont (1997) trouve ainsi une élasticité emploi-salaire plus importante pour les travailleurs non-qualifiés que pour les travailleurs qualifiés en utilisant la même méthodologie que celle décrite précédemment, consistant à exclure le coût du capital des équations estimées à partir de données de panel.
Le rapport Sneessens (1993) fait autorité en la matière. Sneessens montre, sur des données françaises, que l'introduction du progrès technique s'est traduite sur la période 1960-90 par un accroissement de la part de l'emploi qualifié et une baisse de la part de l'emploi non-qualifié. Il indique que le taux de chômage des travailleurs qualifiés est inférieur à la moyenne tandis que le taux de chômage des non-qualifiés est supérieur à la moyenne . D'autre part, aucun rationnement concernant la main d'oeuvre qualifiée, dont la part des salaires a plus diminué que celle des non-qualifiés, ne peut être mis en évidence. Dans ce contexte, le chômage des non-qualifiés en France serait dû à une baisse moins importante des salaires, ce qui aurait conduit à un resserrement de l'éventail des salaires, défavorable à l'emploi non-qualifié. Ici comme dans d'autre rapport, la comparaison est établie avec les
États-Unis où le salaire relatif des non-qualifiés a fortement décru, ce qui irait de pair avec des périodes plus brèves de chômage.
Mais un deuxième facteur, lié à l'accroissement du salaire relatif des non-qualifiés, viendrait aggraver le chômage structurel. A l'aide d'un fonction de production macro-économique avec progrès technique exogène et où le travail non-qualifié et le travail qualifié sont des facteurs substituables, Sneessens indique que la hausse du salaire relatif des non-qualifiés accroît la demande de travail qualifié par rapport à la demande de travail non-qualifié. La demande de travail qualifié vient alors se heurter à une inadéquation des offres et des demandes de qualification : la main d'oeuvre qualifiée disponible est, dans ce cas, totalement employée alors que la main d'oeuvre non-qualifiée, abondante, est inadaptée à la nouvelle structure de la demande de travail. Cette inadéquation est mesurée à l'aide du ratio suivant : nombre d'emplois qualifiés/nombre d'actifs qualifiés.
Après avoir réalisé ses tests, Sneessens en conclut : « l'effet du SMIC et du coin fiscal fut d'augmenter le taux de chômage agrégé de 3,4 points et l'indice d'inadéquation des offres et des demandes de 3,4 points (Sneessens, 1993, p. 151).
(...) « une réduction de 16 points du taux de cotisation des non-qualifiés entraînerait une réduction des taux de chômage qualifié et non-qualifié respectivement de 0,5 et 6,4 points (...). Les mêmes variation de taux de chômage pourraient être obtenues par une réduction du SMIC de 15,4 % (...). (ibid, p. 151).
Le rapport Sneessens, comme les autres travaux du même type (Dormont, 1997), est cependant entaché d'un problème méthodologique non-négligeable que les auteurs ont pu justifier par les limites des sources statistique disponibles sur les qualifications. Pour distinguer les catégories qualifiées et non-qualifiées, il propose en effet de se servir de la nomenclature des PCS de l'INSEE. Il regroupe dans la main d'oeuvre qualifiée... uniquement les cadres et les professions intermédiaires tandis qu'il rassemble parmi les non-qualifiés des catégories aussi hétérogènes que les employés et les ouvriers, qui représentent à elles-deux 58 % de la population active, sans établir de distinction en leur sein !... Autrement dit, il introduit dans son modèle deux catégories de main d'oeuvre aux caractéristiques productives si différentes qu'elles ne sont pas substituables sur le court terme. Ce qui permet de dire bien peu de choses sur la nature des mécanismes de création-destruction d'emplois touchant une catégorie aussi agrégée que celle des non-cadres, c'est-à-dire une majorité de travailleurs.
Plus généralement, si l'on admet la théorie néo-classique de la demande de travail, le plancher que constitue le salaire minimum représente un obstacle à supprimer (dans la version anglo-saxonne) ou à contourner (notamment par les subventions à l'embauche dans la version française) si l'on veut faire émerger certains gisements d'emplois. Les principaux tests économétriques portant sur les effets du salaire minimum sur l'emploi s'effectuent à l'aide de deux types de modèles.
Le premier type de test utilise la fonction d'emploi de Mincer (1976) de la forme :
N = f(SM, C. D. X)
Celle-ci relie un taux d'emploi à une fonction incorporant une mesure du salaire minimum et des variables dites « de contrôle telles que la conjoncture, la démographie de la population étudiée, ainsi qu'un trend temporel.
La mesure du salaire minimum est spécifiée à l'aide du rapport entre le salaire minimum et le salaire moyen. La conjoncture est donnée par le taux de chômage ou un indice de production de la population concernée par l'étude - les jeunes par exemple. La démographie est donnée par la proportion de ladite population dans la population active : elle définit l'offre de travail.
Cette relation a été utilisée pour tester les effets du SMIC sur l'emploi des jeunes Les études faites à ce propos par Wellington (1991) concernant les États-Unis ne décèlent qu'une faible élasticité : une hausse de 10 % du salaire minimum ne diminuerait l'emploi des jeunes que de 0,5 à 0,7 %. Quant au cas français, Bazen et Martin (1991) montrent que les tests en question ne parviennent pas à déceler un effet significatif du salaire minimum. Cette et al. (1995) résument ainsi les limites du modèle de Mincer :
« On peut remarquer que les effets de substitution sont généralement mal pris en compte. Ainsi, la réflexion sur les types de substituabilité entre les facteurs amènerait à mieux s'interroger sur la variable la plus pertinente pour spécifier le facteur démographique. Faut-il seulement retenir la part des jeunes dans la population totale, ou celle des jeunes plus les femmes, les deux catégories étant vraisemblablement substituables ? De même, les effets liés à la substitution du capital au travail sont faussés, lorsqu'on prend comme indice du salaire minimum le rapport SM/salaire moyen. En effet, le SM se répercute sur le salaire moyen doublement : parce qu'il est une de ses composantes (effet purement mécanique) et parce que les hausses du SM se répercutent en partie sur le salaire moyen par le biais des négociations salariales (effet d'indexation). Du coup, le rapport SM/salaire moyen augmente moins que le SM, et on arrive mal à cerner les conséquences de la substitution du coût du travail due à l'augmentation du salaire moyen (d'autant plus que le coût du capital n'est pas pris en compte de façon spécifique) (Cette et al., 1995. p. 200).
Ces limites ont conduit Bazen et Martin à construire un modèle visant à mesurer les effets du salaire minimum sur l'emploi des jeunes et des adultes. Leur approche consiste dans une première étape à établir deux équations de salaire, une pour les jeunes, une pour les adultes Dans une deuxième étape, ils construisent deux équations d'emploi, une pour chaque catégorie, compte tenu du salaire déterminé dans les équations de la première étape, ce qui permet de tenir compte des effets de substitution évoqués précédemment.
Cependant, ici encore, les résultats paraissent fragiles, aux dires des auteurs eux-mêmes : « (...) on constate que les majorations du salaire minimum entraînent une augmentation des salaires réels des jeunes, alors que l'incidence sur le salaire des adultes est beaucoup plus faible. En revanche, il s'avère très difficile d'obtenir des estimations fiables de l'incidence des salaires réels sur l'emploi des jeunes et des adultes. Les résultats dont on dispose font néanmoins entrevoir des élasticités à long terme de l'emploi des jeunes par rapport au salaire minimum de l'ordre de -0,1 à -02, analogues aux chiffres fournis par les études nord-américaines, et de l'ordre de zéro pour les adultes (p. 199).
Les effets de la variation du salaire sur l'emploi des adultes sont donc nuls, tandis qu'ils sont présents, mais faibles pour l'emploi des jeunes 63 ( * ) . Notons que les auteurs relativisent immédiatement cette dernière conclusion : « il est difficile de conclure que les majorations du salaire minimum ont réduit de façon significative l'emploi des jeunes en France. Il se peut que tel est le cas mais les méthodes économétriques utilisées ne permettent pas de déceler d'effets statistiquement significatifs et robustes (p. 206) 64 ( * ) .
Des effets sectoriels différenciés
Ce modèle constitue néanmoins une référence alternative au test de Mincer pour tester les effets sectoriels du salaire minimum sur l'emploi. Ainsi, Bazen et Benhayoun (1995) utilisent-ils une méthodologie analogue pour tester les effets sectoriels du salaire minimum
sur l'emploi, à partir d'une étude portant sur les industries de biens de consommation, les industries agricoles et alimentaires, le commerce, les services marchands. Ces secteurs sont retenus en raison de la stabilité de la proportion de « Smicards depuis 1972, de l'ordre de 12 à 14 % pour ces secteurs. L'étude consiste à estimer en premier lieu l'effet du salaire minimum sur le salaire moyen de chaque secteur, puis, l'effet du salaire moyen sur l'emploi dudit secteur.
Pour une production constante, l'effet d'un accroissement du SMIC sur l'emploi est extrêmement variable d'un secteur à l'autre. L'élasticité emploi-salaire est importante dans le commerce et les services marchands. Elle est respectivement de -0,483 et de -0,320. Elle est presque nulle dans les industries de biens de consommation (-0,046). Les élasticités sont plus importantes sous l'hypothèse d'une production supérieure. Néanmoins, les auteurs, ici aussi, invitent à la prudence car : « comme dans de nombreuses études de la relation SMIC-emploi, nos estimations ne sont pas toujours significatives (p. 252).
1.2.2. Les simulations macro-économiques d'une réduction des cotisations patronales sur les bas salaires
Pour estimer les effets d'une réduction de cotisations sociales patronales, la plupart des simulations utilisent une fonction de production à facteurs substituables de type Cobb-Douglas, en lui assignant une élasticité de substitution capital-travail estimée. L'élasticité emploi-salaire dépend alors de l'élasticité de substitution capital travail, de l'élasticité de substitution inter-catégorielle et de l'élasticité de substitution infra-catégorielle. Ces trois élasticités conféreront une plus ou moins grande force au mécanisme décrit par le modèle.
Le rapport du CSERC (1996) définit ainsi une fourchette de valeurs pour l'élasticité emploi-bas salaires (pour les salaires allant jusqu'à 1,33 % du SMIC comprise entre -0,3 et -0,7). L'élasticité est plus faible dans le cas où la substitution qualifiés - non-qualifiés est faible. Elle est plus forte dans le cas où l'élasticité de substitution entre les facteurs tend vers l'unité. Une réduction de dix milliards des cotisations patronales engendrerait selon cette estimation des créations d'emplois comprises entre 50 000 et 70 000 hors bouclage macro-économique et sans prendre en compte les modalités de financement de la mesure.
La prise en compte des effets du bouclage macro-économique et du type de financement de la mesure donnent les résultats suivants. Si la mesure est financée par un déficit budgétaire, l'emploi total augmenterait à l'intérieur d'une fourchette allant de 60000 à 80000 emplois. Si la mesure était financée par d'autres prélèvements venant remplacer l'allégement des cotisations patronales (CSG, IRPP, impôt sur les sociétés, TVA, cotisations à la valeur ajoutée), l'accroissement de l'emploi se situerait entre 10000 et 50000 emplois.
Dans la mesure où la substituabilité des facteurs paraît faible dans le cas français et où la modification des combinaisons productives s'établit sur un terme plutôt long lié au rythme du renouvellement des équipements, ce sont plutôt les valeurs basses des fourchettes qu'il conviendrait alors de retenir.
1.2.3. Les simulations macro-économiques des mesures spécifiques en vigueur
La DARES (1996) a tenté de chiffrer les effets des mesures ciblées mises en oeuvre dans le cadre des dépenses publiques pour l'emploi entrant dans le cadre de la réduction du coût du travail. Deux catégories de mesures sont évaluées par Chouvel et al. (1996) :
- l'emploi marchand aidé grâce à une réduction du coût du travail ciblée sur certaines catégories de main d'oeuvre dans le but de lutter contre la sélectivité du marché du travail, c'est-à-dire pour modifier l'ordre de la file d'attente en faveurs des publics défavorisés (jeunes, non-qualifiés)
- les créations d'emploi dans le secteur non-marchand.
Pour les emplois marchands aidés, l'étude procède en deux temps. La méthodologie consiste tout d'abord à évaluer l'impact des différentes mesures en termes de réduction du coût du travail. Elle consiste ensuite à r ep rendre l'hypothèse forte d'une élasticité emploi-salaire de -0,6 fondée sur une substituabilité significative entre les facteurs de production et parmi ces derniers entre les différentes catégories de main d'oeuvre. Cette hypothèse optimiste permet alors de calculer un coefficient emploi mesurant l'impact supposé de chaque réduction ciblée du coût du travail sur l'emploi.
Moyennant une telle élasticité emploi-salaire, les auteurs concluent logiquement à un effet positif des mesures ciblées analysées.
Dans un deuxième temps, ces mesures sont analysées dans le cadre du modèle macroéconomique MOSAIQUE de l'OFCE afin de tenir compte des effets sur le bouclage macro-économique que le mode de financement et l'application de ces mesures engendrent (mode de financement, effet sur la structure des prélèvements obligatoires, effets d'offre et de demande, hypothèse sur les taux de change).
Considérant que nombre de dispositifs ciblés sont concernés par ce type de simulation, le modèle simule les effets d'une baisse de 1 % des cotisations sociales sur les bas salaires. L'originalité de l'étude est qu'elle envisage successivement le cas d'une fonction de production néo-classique à facteur substituable (avec élasticité de substitution unitaire) impliquant une élasticité emploi-salaire de -0,4, puis le cas d'une fonction de production à facteurs complémentaires, où les effets de substitution entre les facteurs sont nuls.
Dans le premier cas, l'emploi est sensible au coût du travail. Il augmente fortement : l'impact au bout de dix ans est de 366 000 emplois créés, mais la baisse de la demande de capital (lié à la hausse du coût relatif du capital par rapport au coût du travail abaissé) réduit à moyen terme les investissements.
Dans le deuxième cas, la mesure ne produit aucun effet sur les choix techniques capital-travail des entreprises. Les effets sur l'emploi ne sont perceptibles que via d'autres canaux de transmission. L'emploi total augmente de 20000 personnes la première année et 277 000 au terme de 9 ans. La baisse du coût du travail met ici en jeu un effet profit et un effet compétitivité prix, mais en aucun cas un effet de substitution travail-capital. Les profits et la compétitivité-prix à l'exportation s'améliorent. Les effets sont d'autant plus bénéfiques que les taux de change s'ajustent à la baisse.
Cette mesure s'avérerait coûteuse à court terme, mais la mesure s'autofinance au bout de trois ans compte tenu des gains de PIB - ces derniers étant source de recettes fiscales -qu'elle permet. La mesure réduit même le ratio déficit / PIB au bout de dix ans. Un financement par l'emprunt, puis par un basculement des cotisations vers la CSG est étudié. Ce dernier mode de financement permet de tenir les objectifs de court terme de déficit public mais atténue considérablement la portée de la mesure sur le court terme. En utilisant le modèle mimosa de l'OFCE pour simuler cette mesure. Le Bihan (1998) conclut ainsi : "la mesure n'a d'impact significatif que si elle est financée par une augmentation des déficits publics. La même mesure financée par une hausse de la fiscalité directe conduit à une légère baisse de la production et n'a pas d'impact significatif sur l'emploi." (p. 12).
Dans le cas des emplois non-marchands, les mécanismes de création d'emploi n'obéissent pas à une logique de solvabilisation marchande ; ils dépendent du degré de la contrainte budgétaire. L'État prend en charge 90 % du coût pour un CES et 75 % du coût d'un CEC. Aussi les méthodes d'évaluation sont-elles différentes de celles concernant les emplois marchands aidés. Une première approche consiste à mesurer l'effet de substitution entre ces emplois aidés et les emplois publics typiques qu'auraient permis de financer le montant du financement des nouveaux emplois restant à la charge des administrations (c'est-à-dire la partie non-aidée qui ampute le budget disponible). Les substitutions sont alors plus faibles pour les TUC et les CES que pour les CEC. Dans les simulations "macro-économiquement bouclées", l'hypothèse adoptée est celle d'une absence de substitution. L'effet sur l'emploi résulte alors directement des flux financiers affectés par les pouvoirs publics pour ces emplois. Le modèle envisage le cas d'une augmentation de dix milliards de francs des flux consacrés aux emplois non-marchands aidés.
1.3. Les simulations de la réduction du temps de travail
1.3.1. Le cadre des projections : la Rédaction-réorganisation du temps de travail (2RT)
L'hypothèse 2RT est celle qui sert désormais de base aux simulations économétriques. Elle suppose que la dynamique conjointe de réduction et d'aménagement du temps de travail pourrait enclencher un cercle vertueux qui verrait croître de pair la productivité, les salaires horaires et l'emploi. Parmi les travaux les plus récents, citons ceux de Cette et Taddéi (1992 et 1994). Confais et al. (1993), Rigaudiat (1993), Sterdyniak et al. (1994), Taddéi (1998), CSERC (1998).
Dans le scénario d'une 2RT, au plan micro-économique, une réduction significative (de l'ordre de 10 %) de la durée du travail est susceptible de provoquer une réorganisation du travail dans les entreprises, nécessaire pour maintenir ou allonger la durée d'utilisation des équipements par l'introduction d'équipes supplémentaires. La réorganisation du travail qui en résulte permet d'accroître la productivité du travail et l'efficacité du capital. Elle permet d'ajuster les effectifs en fonction des aléas conjoncturels et de créer des emplois typiques. Si cet enchaînement se produit, la réorganisation du travail favorise des gains de productivité qui allègent le choc salarial dans l'hypothèse où la compensation salariale totale ou partielle, ce qui permet de préserver le taux de marge des entreprises et leur compétitivité.
Au plan macro-économique, un tel schéma est porteur d'un "cercle vertueux" de type keynésien. L'aménagement du temps de travail maintient ou améliore la compétitivité-prix à l'exportation des entreprises. La 2RT (Réduction et Réorganisation du Temps de travail engendre une masse de revenus supplémentaires, via la compensation salariale et via les emplois créés pour allonger la durée d'utilisation des équipements. Cette masse de revenus alimente la consommation, ce qui exerce un effet accélérateur sur l'investissement, la croissance et l'emploi. L'investissement subit une double impulsion. La première provient de l'effet accélérateur, la deuxième résulte d'un effet profit bénéfique, en raison de l'accroissement des gains de productivité, et ce malgré la hausse du taux de salaire horaire. Enfin, quant aux effets macro-économiques indirects, la croissance produit un effet bénéfique sur les déficits publics. Les effets négatifs sur le commerce extérieur dépendeur essentiellement, à côté du montant de la compensation salariale, du contenu en importations de la croissance.
Le scénario sous-jacent à la 2RT n'est donc pas un scénario malthusien de simple "partage du travail" réductible à une "règle de trois" (Cahuc et d'Autume, 1998). La 2RT stimule en effet la productivité et la croissance ; elle accroît le volume horaire qu'il est possible répartir parmi ceux qui désirent participer à l'activité de production.
Les effets sur cinq ans d'une réduction à 35 heures simulées dans le cadre du XIème Plan sont présentés dans le tableau 18. L'ensemble des projections concluait à des effets significatifs d'une réduction du temps de travail. Quels que soient les modèles, le cas d'une réduction du temps de travail avec réorganisation du travail est le plus favorable à l'emploi. Les effets de la compensation salariale dépendent alors des hypothèses retenues. Le cas le moins favorable à l'emploi est celui d'une réduction du temps de travail sans réorganisation ni compensation salariale.
L'effet sur l'emploi est plus fort si la compensation salariale est partielle ou nulle, Cependant le rôle du coût du travail varie selon les modèles, selon que les entreprises sont contraintes par les coûts (Amadeus) ou par les débouchés (Mosaïque).
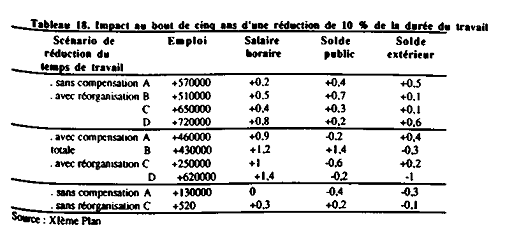
A : INSEE (Micro DMS)
B : Ecole centrale (Hermès)
C : INSE (Amadeus)
D : OPCE (Mosaïque)
1.3.2. De la loi Robien à la loi Aubry
Pour mettre en oeuvre la 2RT, le rôle de la politique publique peut s'avérer décisif, notamment dans les pays où la négociation collective spontanée entre les acteurs est affaiblie. En France, la loi Robien, puis la loi d'orientation et d'incitation du Gouvernement Jospin ont constitué des tentatives d'impulser la réduction de temps de travail comme mesure structurelle de politique de l'emploi.
L'expérience de la loi Robien a montré que le financement temporaire de la réduction du temps de travail sous condition de création d'emploi pourrait produire des effets bénéfiques sur l'emploi, et moins coûteux pour le budget que les traditionnelles mesures d'abaissement du coût du travail.
Les simulations de cette loi (Timbeau, 1997) indiquaient que, pour 100 milliards allégements de cotisations sociales, les effets sur l'emploi seraient, dès la première année de l'ordre de 600000 créations résultant de l'application du volet offensif. L'effet positif sur la croissance serait de 0.4 % avec une légère dégradation du solde extérieur et une dégradation du solde public de 41 milliards, le coût ex post d'un emploi créé serait de 70000 francs la première année et de 39000 francs en moyenne les cinq premières années.
Dans le cadre de la préparation de la loi d'orientation et d'incitation discutée par le parlement français en janvier 1998. deux projections (effectuées grâce aux modèles Banque de France et Mosaïque) - l'une réalisée par Baude et al. (1997), l'autre réalisée par Cornilleau et al. (1997) - ont été commandée par la mission Analyse économique de la Direction de l'Animation de la Recherche des Etudes et des Statistiques du Ministère de l'emploi et de la solidarité (DARES. 1998). Ces simulations reprennent l'hypothèse de 2RT exposée plus haut. Elles explorent chacune 5 scénarii :
. Une réduction à 35 heures sans compensation salariale et sans réorganisation
. Une réduction à 35 heures avec compensation
. Une réduction à 35 heures avec des gains de productivité du travail supérieurs aux gains tendanciels
. Une réduction à 35 heures avec gains d'efficacité du capital
. Une réduction du temps de travail avec réduction de cotisations patronales
Les deux projections s'accordent sur une fourchette de 400 000 à 700 000 emplois créés sur trois ans selon les hypothèses retenues. Elles concluent que l'effet maximal est obtenu si :
. Les gains de productivité ne sont pas trop importants
. Le coût unitaire du travail est maîtrisé. Tout au plus, les salaires horaires peuvent croître plus que la productivité si des aides de l'État compensent le choc salarial
. La réorganisation de la production permet un allongement de la durée d'utilisation des équipements.
Le résultat dépend cependant de la capacité des acteurs économiques à négocier sur le lieu de la production les réorganisations, accords et recrutements appropriés. À cet effet, la Direction de la Prévision du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (1998) a envisagé trois cas de figure à l'aide du modèle METRJC (keynésien).
Dans la simulation 1, qui s'apparente au scénario recherché par la loi, toutes les entreprises de plus de 20 salariés passent aux 35 heures en 2002. Les gains de productivité représentent 3,4 % pour une réduction du temps de travail de 10 %. Les salariés bénéficient d'une compensation salariale partielle (de l'ordre des 2/3 : le salaire mensuel baisse de 3,9 % pour une augmentation du salaire horaire de 7,1 %). Le barème des heures supplémentaire s'élève progressivement à partir de 2000 (5 % en 2000. 10 % en 2001. 15 % en 2002. Les effets sur l'emploi en 2002 sont de 540 000 créations. Elles sont réduites (410000) si les salaires s'accélèrent à la suite d'une réduction du chômage produisant un effet Phillips 65 ( * ) .
Dans la simulation 2 , seuls deux tiers des entreprises de plus de 20 salariés passent aux 35 heures en 2002. Les salariés obtiennent une compensation salariale intégrale mais un gel des salaires jusqu'en 2002 tandis que la majoration des heures supplémentaires est de 15 % à partir de 2000. La hausse du coût salarial unitaire a des effets négatifs sur l'activité et l'emploi. Le nombre de créations d'emplois n'est alors que de 280 000 en 2002. Il se réduit à 210 000 au cas où l'effet Phillips ajoute une pression sur les salaires.
Dans la simulation 3 , scénario "de blocage", les partenaires sociaux "ne parviennent pas à négocier des accords de modération salariale" , où la durée légale est fixée à 35 heures par l'État, où les heures supplémentaires sont majorées de 25 % en 2000 et où le salaire minimum est relevé de 11,4 % à cette date dans toutes les entreprises. Seules 10 % des entreprises passent aux 35 heures en 1999, 50 % en 2002. Les gains de productivité sont plus élevés que dans les deux autres scénarii. Dans le cadre du dispositif légal, les entreprises respectent la stricte obligation légale d'accroître de 6 % l'emploi. Au total, l'emploi n'augmenterait que de 4 % (150 000 emplois en 2002). Mais, en raison de l'augmentation des coûts salariaux, l'économie perdrait 20 000 emplois, l'activité reculerait de -0,3 % tandis que le solde budgétaire se creuserait de -0,3 %.
1.3.4. Le débat sur la compensation salariale
Le débat concernant l'aménagement-réduction du temps de travail touche directement la définition par les acteurs des normes d'obtention et de répartition des gains de productivité dans les entreprises. Le principal argument développé contre la réduction de la durée du travail à temps plein sans perte de salaire porte sur l'élévation du coût salarial qui dégraderait la profitabilité et la compétitivité-prix des entreprises. Ainsi la question du temps de travail bute-t-elle généralement sur le débat sur la compensation salariale (voir Lipietz, 1995). Le statut central accordé à la modération du coût du travail comme paramètre essentiel de la réussite de la 2RT mérite toutefois discussion.
La fonction de production utilisée dans les modélisations n'est pas une fonction à facteurs substituables, mais une fonction à facteurs complémentaires. Ce choix est retenu notamment parce qu'aucune étude économétrique n'a pu démontrer la validité d'une fonction à facteurs substituables sur laquelle repose la théorie néo-classique de la demande de travail en fonction du coût relatif des facteurs. Cette dernière est pourtant invoquée pour justifier la mise en oeuvre des mesures d'abaissement du coût du travail et notamment du coût du travail non-qualifié. Si l'on admet donc l'hypothèse de facteurs complémentaires, le coût du travail n'influe pas sur l'emploi par un effet de substitution des facteurs lié au coût relatif des facteurs, mais par un autre biais. Le coût unitaire influe dans ce cas sur la profitabilité des entreprises qui exerce alors un effet sur l'investissement et l'emploi. Une augmentation du coût unitaire du travail détériore le taux de marge des entreprises ainsi que leur compétitivité-prix. Le maintien du coût unitaire apparaît donc comme la condition nécessaire.
Cette conclusion peut néanmoins être nuancée à l'épreuve de l'évidence empirique. Tout d'abord, dans le cas où l'emploi est lié à la profitabilité, la réduction du coût du travail n'est qu'un élément permettant d'accroître la profitabilité. Ensuite, si l'on considère que le coût unitaire du travail évolue désormais à un rythme inférieur à celui de l'inflation et des gains de productivité et que la profitabilité des entreprises s'est redressée spectaculairement sans que ces faits n'aient produit d'effets substantiels sur l'emploi, il faut peut être modérer le rôle des facteurs d'offre dans l'explication du chômage des années 90.
Soulignons que les pays dont les balances commerciales étaient excédentaires dans les années 80 sont les pays où le coût salarial a le plus augmenté (Allemagne, Japon). Cela signifie que le coût salarial n'est qu'une composante de la compétitivité parmi d'autres. La santé financière des entreprises est désormais rétablie. La compétitivité des entreprises française est devenue forte : le commerce extérieur est excédentaire de 180 milliards de francs, atteignant sans cesse des niveaux records. Le coût unitaire du travail ("charges sociales" comprises) continue de croître à un rythme inférieur à ceux de l'inflation et de la productivité. Enfin les "délocalisations" vers les Nouveaux Pays Industrialisés, sont des phénomènes sectoriels qui ne représentent que 3 % des flux d'investissements directs à l'étrangers qui s'effectuent essentiellement sur le territoire communautaire.
Dans la mesure où les profits sont restaurés, dans la mesure où le salaire est aussi un revenu pour les ménages, certains économistes soutiennent que le passage rapide aux trente-cinq heures sans perte de salaire pourrait alors favoriser simultanément une relance de la consommation et un mouvement général de réorganisation ayant un effet substantiel sur l'emploi.
Une réduction du temps de travail sans perte de salaire est en effet un moyen d'augmenter le salaire horaire dans un contexte de négociation collective peu dynamique. Elle accroîtrait certes la part des salaires dans la valeur ajoutée, celle-ci étant aujourd'hui de l'ordre de 59 % . Mais elle rétablirait la part des salaires à 66 % de la valeur ajoutée, en dessous de ce qu'elle était en 1984 (69 %). Sans être excessif, un tel déplacement aurait un effet macro-économique bénéfique compte tenu de l'atonie de la consommation.
Cette réduction du temps de travail ne produira cependant pas les mêmes effets dans toutes les entreprises. Si un grand nombre d'entre elles ont recouvré des marges confortables, d'autres, parmi lesquelles de nombreuses PME, connaissent des situations moins florissantes. C'est pourquoi l'aide forfaitaire (quelle que soit la nature de l'entreprise) risque de provoquer des "effets d'aubaine" importants parmi les entreprises à marge confortable. Ces effets paraissent certes nécessaires aux yeux des législateurs pour que les entreprises "jouent le jeu" en acceptant la négociation. Les entreprises bénéficieront en outre de l'effet macro-économique supposé d'une demande plus importante liée au maintien des salaires et à l'augmentation de l'emploi résultant de la réduction du temps de travail.
La conférence sur les salaires l'emploi et la réduction du temps de travail organisée par le Gouvernement français le 10 octobre 1997 visait à définir de façon maîtrisée de nouvelles normes de répartition des gains de productivité. "Techniquement faisable", la mesure n'a donc de portée effective que si les acteurs sociaux s'engagent à tous les niveaux dans la négociation, ce qui engage leur capacité à définir les termes d'un contrat social acceptable par les uns et par les autres.
Les monographies d'entreprises présentées plus loin fourniront de premiers éléments d'évaluation des nouvelles normes de salaire et de temps de travail construites par les acteurs sociaux dans les entreprises.
2. Les évaluations micro-économiques
2.1. Qui sont les individus bénéficiaires ?
Les évaluations micro-économiques portant sur les publics bénéficiaires tentent de comparer les trajectoires de deux groupes, l'un constitué de bénéficiaires de la mesure (le groupe "expérimental"), l'autre de non-bénéficiaires (intitulé groupe témoin, ou groupe de contrôle, ou encore groupe de comparaison). Pour pouvoir poser l'hypothèse "toutes choses égales par ailleurs " 66 ( * ) , il est nécessaire d'établir une comparabilité stricte entre les deux groupes, laquelle peut être obtenue soit par sélection aléatoire des membres des groupes expérimental et témoin (méthode expérimentale), soit par contrôle de la nature des bénéficiaires / non-bénéficiaires observés (méthodes non-expérimentales).
Le problème fondamental du principe comparatif qui sous-tend l'évaluation d'impact est donc celui du contrôle de l'hétérogénéité entre deux groupes d'individus, c'est-à-dire le problème du biais de sélection. En première analyse, le biais de sélection existe si les deux conditions suivantes sont réalisées (Gautié, 1996) : (1) bénéficiaires et non-bénéficiaires diffèrent par des caractéristiques non observées par l'évaluateur, (2) ces caractéristiques inobservées ont une incidence sur les variables de résultat. Nous reviendrons sur les fondements et l'étendue de ce problème, qu'il convient de considérer comme un des enjeux méthodologiques fondamentaux de l'évaluation micro-économique.
En France, l'exploitation de données de panel depuis le début des années quatre-vingt-dix a permis d'obtenir des estimations de l'effet net des mesures : les méthodologies utilisées sont principalement le suivi longitudinal d'une cohorte d'individus sortant des mesures, en comparaison de non-bénéficiaires avec des caractéristiques similaires (Aucouturier, 1994 ; Aucouturier et Gélot, 1994 ; Charpail et Zilberman, 1996), et des évaluations reposant sur une modélisation du biais de sélection 67 ( * ) (Pénard et Sollogoub, 1995 ; Bonnal, Fougère et Sérandon, 1995).
De la même manière que dans le cas allemand, l'utilisation de procédures non-expérimentales visant à déterminer l'effet net des mesures aboutit à modifier les résultats antérieurs en termes d'impact sur l'emploi des bénéficiaires, et plus généralement de hiérarchie des mesures du point de vue de leur efficacité relative (Gélot et Simonin, 1997a). Par exemple, pour les jeunes, la comparaison des trajectoires de jeunes bénéficiaires des mesures avec des non-bénéficiaires (panel témoin) fait ressortir le contrat de qualification comme le seul programme aboutissant à un accroissement net du taux d'insertion dans l'emploi 68 ( * ) . A contrario, les jeunes sortant de CES, TUC ou SIVP ont des taux d'emploi inférieurs à ceux des non-bénéficiaires. En contrôlant le biais de sélection, Bonnal, Fougère et Sérandon (1995) confirment cet écart en concluant plus généralement que le contenu en formation des mesures constitue un déterminant essentiel de leur effet sur l'emploi.
Les études des effets des mesures sur les salaires (Sollogoub, 1993) concluent également à un impact net négatif des mesures. Dans l'ensemble, la sophistication des méthodologies utilisées par les études d'impact conduit donc à une accentuation du caractère pessimiste des études d'impact brut existantes. Cependant, les problèmes méthodologiques posés par l'évaluation d'impact micro-économique font l'objet, selon Lechêne et Magnac (1996) ou cause la participation au programme évalué, encore Gautié (1996), d'une prise en compte encore insuffisante, qui nuit à la solidité et aux possibilités d'interprétation des résultats existants : ainsi Gautié (ibid) relève-t-il une seule étude qui traite les problèmes d'hétérogénéité non observée 69 ( * ) .
2.2. Quelles sont les entreprises utilisatrices ?
En 1995, plus de 500 000 établissements du secteur marchand ont recruté près de 940 000 personnes au travers de mesures de la politique de l'emploi. Des enquêtes effectuées par la DARES et notamment des résultats tirés du fichier FAMEU (Fichier Annuel des Mesures de politique d'emploi par Établissement Utilisateur), il apparaît une assez grande hétérogénéité des pratiques suivant la taille des entreprises (Daniel et Picart, 1997). En effet, les taux d'utilisation, de réutilisation et le nombre moyen d'entrées sont d'autant plus importants que le nombre de salariés est élevé (cf. tableau 19).
Les mesures d'aides à l'emploi sont très concentrées puisque les 5 % d'établissements avec plus de 5 contrats aidés pèsent 32 % du stock des aides à l'emploi au 31 Décembre 1996. Cette concentration ne relève pas seulement d'un effet taille de rétablissement et se retrouve dans chaque tranche de taille : ainsi pour les établissements de 50 à 99 salariés, 4 % des entreprises regroupent 34 % des contrats aidés.
Cette hétérogénéité se retrouve pour le découpage par secteurs d'activité, d'autant que des secteurs avec des taux d'utilisation proches peuvent avoir des pratiques très distinctes : la restauration traditionnelle utilise surtout l'apprentissage quand la restauration rapide recourt largement à l'abattement temps partiel.
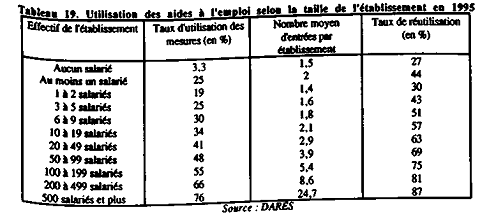
Parfois ces stratégies d'utilisation renvoient à des modes traditionnels d'organisation de la main-d'oeuvre, puisque les secteurs qui fonctionnent avec l'alternance ont tendance à avoir des comportements plus stables que les autres, plus sensibles aux changements de réglementations. Cela vient bien souvent des procédures d'utilisation des mesures elles-mêmes (cf. agrément du maître d'apprentissage), mais illustre aussi les stratégies des entreprises en matière de recrutement.
En ce qui concerne l'aide à la création d'entreprise, l'ACCRE a fait l'objet d'évaluations à partir d'une enquête de l'INSEE sur les entreprises nouvellement crées (Bonneau et Francoz, 1996) et de l'enquête SINE (Aucouturier, 1997).
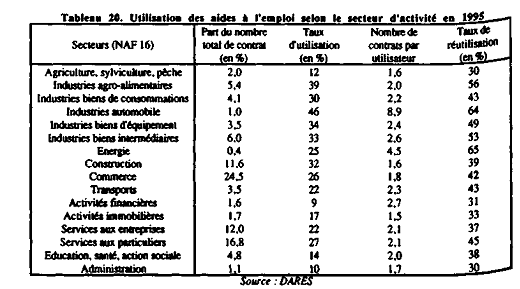
Les résultats de ces évaluations ainsi que de celle de la DARES (1997) montrent que les chômeurs créent le même type d'entreprise que les autres créateurs. Elles sont aussi diversifiées en terme de secteur d'activité, et elles ont également les mêmes probabilités de survie pour une période donnée, que les autres entreprises nouvellement créées. La différence principale se trouve dans les ressources initiales de ces créateurs. En effet, les chômeurs créateurs sont plus démunis en terme de réseaux sociaux et de ressources financières que les autres, enfin ils sont plus fortement mobilisés par le projet de création.
Dans un autre domaine, pour l'utilisation des aides financières des collectivités locales, on retrouve une répartition des secteurs assez différente, qui tient aux types d'aides et notamment aux interventions en faveur du bâti et des infrastructures.
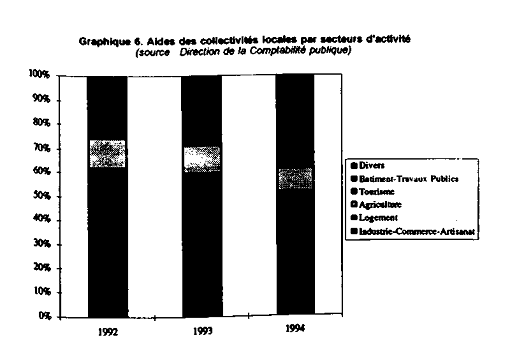
3. Les évaluations monographiques : les stratégies d'entreprises utilisatrices des politiques d'emploi
3.1. Les entreprises et la réduction du coût du travail
3.1.1. Stratégies d'entreprises et politiques de l'emploi
Les travaux du Centre de l'Étude de l'Emploi sont désormais connus pour avoir établi une typologie systématique des logiques d'entreprises (Eymard-Duvemay, 1990) selon le type de coordination interne approprié à leur stratégie. Les mesures de politique de l'emploi produisent alors des effets différents selon le type d'entreprise utilisatrice. Appropriées à un type donnée de stratégie, un dispositif donné peut s'avérer complètement inutile pour les autres entreprises. Plus généralement, les travaux effectués dans le cadre de l'Économie des Conventions (1989) débouchent sur les conclusions suivantes.
Les entreprises adoptant une logique de type marchande sont celles qui sont positionnées sur des marchés concurrentiels où la vitesse des ajustements de prix, de salaires et d'emploi sont des déterminants essentiels de la compétitivité. Ces entreprises sont sensibles à la réduction du coût du travail et les dispositifs allégements de cotisations sociales produisent un effet positif sur l'emploi.
Les entreprises obéissant à une logique industrielle sont des entreprises produisant des biens standardisés en grande série. Leur compétitivité repose sur la possibilité de réaliser des économies d'échelle, d'obtenir des gains de productivité à partir d'une parcellisation taylorienne des tâches dans l'organisation du travail et strictement codifiée à l'aide de grilles de classification des postes et des salaires correspondants. Les entreprises sont dans ce cas insensible au rabais que constituent les allégements du coût du travail. Pire, les emplois aidés peuvent produire un effet de stigmatisation sur les bénéficiaires et sur l'image de l'entreprise car les bas prix sont alors un indicateur de mauvaise qualité.
Les entreprises relevant de la logique domestique sont celles qui jouent sur la marque, la qualité, la réputation, la confiance. Le prix n'est pas fondamentalement un argument de leur compétitivité. L'abaissement du coût du travail est alors peu efficace.
Enfin, les entreprises ayant une logique civique sont celle assurant une mission de service publique pour laquelle le statut des agents requière une logique de continuité dans le rapport au temps (sécurité de l'emploi), de sérénité dans le rapport à l'argent (aversion aux fluctuations des rémunérations), et d'égalité de traitement (vis-à-vis des collègues) dans le rapport à la mission. Le financement public de ces entreprises et administrations ne les expose pas à une logique marchande de solvabilisation des emplois et les mesures de réduction du coût du travail (en l'occurrence les emplois aidés du secteur non-marchand, CES, CEC, emplois jeunes) n'agissent que dans la mesure où elles allègent la contrainte de financement public des nouveaux emplois. Le risque est cependant d'instaurer une nouvelle norme d'emploi à côté des emplois à statut, susceptible de menacer la culture de service publique des corps concernés et l'intégration des nouveaux embauchés.
Les effets positifs et pervers des politiques de réduction du coût du travail peuvent alors être précisées. L'enquête par questionnaire de Gazier et Silvera (1993), réalisée pour la Délégation pour l'emploi et le Service des Études Statistiques, visait à évaluer la réaction des entreprises face aux mesures d'allégement du coût salarial et d'incitation à l'embauche. L'échantillon était composé de 1000 entreprises de tailles et d'appartenances sectorielles différentes. Le principal apport de cette étude est de mettre en évidence ce que les auteurs appellent un "double paradoxe" :
- "les entreprises qui affichent (dans leur discours) le plus de sensibilité au coût du travail, qui évoquent en premier lieu "la faute aux charges sociales" à l'origine de toutes leurs difficultés, sont celles qui connaissent peu et n'utilisent que rarement les mesures d'allégement du coût salarial ;
- les entreprises plus actives, à priori peu sensibles, à ces dispositifs, mais néanmoins "clientes", n'évoquent généralement pas le coût salarial à l'origine de leur problème d'emploi, mais insistent d'avantage sur des problèmes plus structurels de formation et d'adaptation des qualifications à leurs besoins" (Gautié et al., 1994, p. 192).
En outre, les auteurs relèvent 40 effets micro et macro-économiques possibles des dispositifs de réduction du coût du travail sur le comportement des entreprises. Ces effets exercent tantôt un effet positif, tantôt un effet négatif sur l'emploi (encadré).
|
Les 40 effets possibles des dispositifs visait ta réduction du coût du travail (subventions et exonérations de cotisations sociales) Effets micro-économiques 1 . Effet de substitution au capital : l'entreprise recrute davantage de travailleurs dont le prix a baissé relativement au capital. 2. Effet d'échelle : l'entreprise recrute davantage de travailleurs parce qu'il lui est avantageux de produire à plus grande échelle. 3. Effet d'aubaine : l'entreprise touche la subvention pour des embauches qu'elle aurait de toute façon réalisées. 4. Effet de seuil à rejoindre : dans le cas de seuils minima d'effectifs permettant d'obtenir la subvention, les entreprises embauchent des salariés non subventionnés afin de bénéficier, pour d'autres salariés, de la subvention. 5. Effet déplacement catégoriel : l'entreprise substitue une catégorie de salariés à une autre afin de bénéficier de la subvention. 6. Effet de substitution horaire : l'entreprise limite les horaires des salariés non subventionnés afin de bénéficier de postes de travail subventionnés. Ou encore l'entreprise substitue des régimes d'emploi subventionnés à ceux qui ne le sont pas. (exemple : des temps plein face à des temps partiels). 7. Effet de cannibalisme : les entreprises subventionnées jouissant d'un avantage compétitif supplantent leurs concurrentes ou étendent leurs parts de marché à leur dépens : il y a donc substitution du travail subventionné au travail non subventionné à travers cette distorsion de la concurrence. Les effets 5, 6 et 7 sont des effets de substitution travail/travail qui viennent compléter, limiter, voire contrer l'effet 1 et 2. 8. Effet travailleur additionnel ou effet d'appel : l'existence de subventions incite certaines personnes à passer de l'inactivité à l'activité. 9. Effet domino : une entreprise demande la subvention que sa concurrente a obtenue, soit pour compenser une perte de compétitivité, soit à titre de défense préventive, soit à titre d'imitation. 10. Effet de réallocation : un accord conclu par une entreprise lui permet de bénéficier de la subvention des travailleurs qui sont déjà embauchés, en modifiant leur affectation apparente. Par exemple, une entreprise déplace une activité dans une autre entreprise avec laquelle elle s'est entendue afin que les salariés apparaissent comme nouvellement embauchés. 11. Effet de desserrement disciplinaire : si les entreprises cherchent à accroître l'effort de leurs salariés par hausse du salarie relatif et créent du chômage, la subvention rend l'intensification de l'effort plus coûteuse par rapport à son extension, elle accroît l'emploi et fait baisser l'intensité du travail. 12. Effet d'écrémage : les entreprises trient parmi les salariés susceptibles d'être embauchés dans le cadre de la subvention et ne recrutent que les catégories qu'elles auraient spontanément embauchées. 13. Effet de stigmatisation : l'existence d'une subvention en faveur d'une catégorie donnée de salariés les désigne comme travailleurs de faible qualité, et constitue un obstacle à leur embauche, soit dans des cas où la subvention est susceptible d'être obtenue, soit en général 14. Effet d'affaiblissement des insiders : si le chômage résulte d'une rente ou d'un pouvoir de négociation bénéficiant aux salariés déjà embauchés, la subvention limite cette rente ou ce pouvoir et déplace la combinaison salaire/emploi en faveur de l'emploi. 15. Effet de développement ou effet de filière : les entreprises subventionnées dont le développement a été stimulé relancent le développement des autres entreprises par les débouchés qu'elles élargissent. 16. Effet d'embauché anticipée : les entreprises effectuent immédiatement une embauche qu'elles envisageaient d'effectuer plus tard afin de saisir l'opportunité de la subvention. Cet effet est une spécification temporelle de reflet d'aubaine. 17. Effet d'accoutumance / de clientélisme : les entreprises « consomment'' les subventions parce qu'elles sont insérées dans les réseaux administratifs, ont abaissé le coût de gestion des subventions et ont pris des habitudes. 18. Effet de clientèle : les entreprises ont sélectionné certaines catégories de bénéficiaires « abonnés*, et les recrutent préférentiellement au détriment d'autres travailleurs, qu'ils soient susceptibles d'être subventionnés ou non. Cet effet reprend sur un mode persistant l'effet 4 de déplacement catégoriel et l'effet 11 d'écrémage. 19 . Effet canard boiteux : les subventions maintiennent en l'état voire accroissent les effectifs des entreprises faiblement rentables ou faiblement efficientes, et différent l'échéance d'une faillite, d'une restructuration ou d'une réduction du chiffre d'affaires. 20 . Effet anti-hystérésis : les chômeurs réembauchés retrouvent le statut, les habitudes et les motivations qu'ils avaient perdus dans le processus d'éloignement de l'emploi, et brisent la « dépendance d'état ou « dépendance de durée. 21 . Effet de formation : les salariés recrutés grâce aux subventions accroissent leur expérience, actualisent leurs connaissances, et accro is s e nt leurs chances d'occuper un emploi durable. 22 . Effet précarisation de la main d'oeuvre : les entreprises sont incitées à recruter en profitant des avantages salariaux à court terme, et négligent d'entretenir des relations durables avec leurs salariés. 23. Effet d'effort différé : si une subvention n'est accordée que pour une période limitée, les entreprises diffèrent le plus tard possible l'effort qui leur est demandé, pour obtenir la subvention tout en minimisant l'effort. 24. Effet de manipulation du seuil : une entreprise licencie durant une période donnée pour bénéficier de la subvention anticipée pour la période suivante. 25. Effet de manipulation des effectifs : dans le cas d'un seuil fixé une fois pour toutes, une entreprise embauche et produit massivement, pour ensuite licencier et écouler les marchandises ainsi préalablement subventionnées. Ces deux effets sont des effets de substitution cyclique. 26. Effet de gestion modulée : les entreprises modulera leurs programmes de recrutement de manière à optimiser la gestion temporelle conjointe des coûts de la main d'oeuvre et des apports des subventions. Cet effet reprend, en dynamique complexe, l'effet d'embauché anticipée. 27. Effet de rotation ou effet turbine : les entreprises remplacent une personne subventionnée pendant une période par une autre subventionnées pour la période suivante. Effets macro-économiques et sectoriels 28. Effet de substitution capital / travail : le jeu des prix relatifs augmente la part du travail dans la combinaison productive. 29. Effet d'échelle : la baisse des coûts stimule la production. 30. Effet de dépense : les subventions injectent un flux de revenu dans le circuit économique et déclenchent un effet multiplicateur. 31. Effet d'éviction : les sommes affectées aux subventions auraient pu créer des emplois dans le secteur privé ; ces emplois étaient au moins aussi viables économiquement que ceux qui ont été créés par les subventions, et sans doute davantage. 32. Effet de distorsion : les réallocations d'emplois faites via les subventions distordent les choix spontanés qui auraient été faits par le libre jeu du marché : ces emplois subventionnés sont une source d'inefficience. 33. Effet Phillips : le recul du chômage génère des tensions sur le marché du travail, donc des pressions inflationnistes, ce qui limite les gains de croissance et d'emploi. 34. Effet de flexion de la main d'oeuvre : reprise au niveau global de l'effet micro du travailleur additionnel. 35. Effet d'offre différencié : pour les secteurs en situation de " price taker", la subvention opère via la chute du coût marginal : pour les secteurs en situation de "price maker", la subvention opère via l'abaissement en général bien moindre du coût moyen. 36. Effet subvention déguisée à l'exportation : si le commerce international correspond à une situation "price taker", la subvention permet aux firmes d'accroître leurs profits et leurs parts de marché, et de reporter le chômage sur les pays étrangers. Dans les cas les plus oligopolistiques ("price maker"), la subvention obtient le même résultat par baisse des prix. 37. Effet tromperie de la courbe de Phillips : une subvention en faveur de travailleurs peu intégrés sur le marché du travail abaisse le taux de chômage non inflationniste parce qu'on favorise l'embauche des travailleurs peu susceptibles de peser sur les salaires. 38. Effet goulot d'étranglement : les subventions ayant affecté des salariés disponibles lors d'une récession à certaines entreprises ou activités, ils sont indisponibles lors de la reprise pour d'autres entreprises ou activités qui redémarrent. 39. Effet freinage du progrès technique : à long terme les subventions favorisent les combinaison productives moins capitalistiques ou freinent l'embauche du personnel très qualifié, ce qui peut être défavorable à l'emploi au regard de la concurrence internationale. 40. Effet anti-industrie : dans le cas de subventions dont le seuil est fixé de période en période, les secteurs en compression d'effectifs (l'industrie) sont pénalisés par rapport aux secteurs aux effectifs stabilisés voire croissants (les services). Les distorsions entre les deux secteurs sont source d'inefficiences qui à terme nuisent à l'emploi global. Ces effets sont des spécifications temporelles de l'effet de distorsion 32. Source : Gautié, Gazier et Silvera, 1994 |
3.1.2. Enquête sur les entreprises utilisatrices des mesures ciblées : le cas du CIE
Les études menées par la DARES sur le CIE sont importantes, mais peut-être pas encore à la mesure de l'effort financier consacré à ce dispositif. Elles tentent de mesurer l'impact de la mesure sur les comportements des entreprises en matière de recrutement et notamment sur l'embauche de catégories jugées peu employables. Il s'agit de savoir qu'elle aurait été l'attitude des employeurs en l'absence d'incitation financière.
Dans ce cadre, ces enquêtes montrent que c'est un dispositif qui a modifié dans plus d'un cas sur deux l'intention d'embauche en faveur d'un chômeur de longue durée (Gélot, 1997). Cela signifie que le CIE a un effet de substitution assez important et donc, qu'il joue son rôle en tant que mesure ciblée. Cet effet de substitution joue aussi, mais avec une moindre ampleur, en faveur des travailleurs les plus âgés (18 %), des travailleurs moins qualifiés (29 %) et moins expérimentés (32 %).
Néanmoins, pour ce qui concerne les emplois créés, les études révèlent l'existence d'un fort effet d'aubaine (56 %) et d'un effet d'anticipation non négligeable (27 %). L'effet création nette d'emploi ne fonctionne que pour un peu moins d'un employeur sur cinq (Gélot, 1997 ; Gélot et Holblat, 1998). Il apparaît donc que le CIE n'est pas en lui le facteur déclenchant de l'embauche. Les entreprises de main d'oeuvre qui se montrent les plus réceptives sont celles qui ont des contraintes financières.
3.2. Les entreprises et les aides publiques à la formation professionnelle continue : le cas des engagements de développement de la formation
3.2.1. Les objectifs du dispositif, procédures et acteurs impliqués
Les Engagements de Développement de la Formation (EDDF) constituent la composante majeure de la politique qualifiée de contractuelle par la Délégation à la Formation Professionnelle alors en place (Verdier et Brochier, 1997). Il s'agissait pour les entreprises éventuellement regroupées dans un cadre professionnel ou interprofessionnel de s'exonérer de l'obligation légale en souscrivant avec l'État "l'engagement" pour une durée annuelle ou pluriannuelle afin d'accentuer leurs efforts de formation selon des objectifs négociés avec les pouvoirs publics et les représentants des salariés.
Alors que l'attribution de l'EDDF reposait sur un principe de représentation interministérielle, celui ci est annulé en 1989. L'EDDF est alors géré par la Délégation à la formation Professionnelle.
L'objectif de ce dispositif est de contribuer à la recherche de compétitivité de l'entreprise a partir de formations permettant l'acquisition de qualification au service d'une organisation qui serait elle même "qualifiante" (en comparaison d'une division du travail appauvrissante du point de vue d'un ensemble de compétences de métier). L'accent est mis par ailleurs sur le rôle déterminant de la négociation afin de construire des compromis économiques et sociaux efficaces. Il s'agit notamment de construire une meilleure articulation de la branche (qui définie l'orientation des formations) et de l'entreprise sur la base de la négociation entre les partenaires sociaux. Mais ce projet de recherche de compromis dans la négociation en matière de formation doit faire face à l'affaiblissement du syndicalisme en France au sein d'un modèle de relations professionnelles traditionnellement non collaboratif et dominé par une forte action normative de l'État.
Les acteurs impliqués dans la mise en oeuvre de ce dispositif se sont progressivement complexifiés dans l'évolution de la mesure. Il s'est agit d'élargir le public cible initialement composé seulement de grandes entreprises vers un public de PME (circulaire du 07.02.1987) . Pour atteindre cet objectif la DFP s'est engagée dans un processus de recherche de relais pour instrumenter le dispositif de contractualisation auprès des PME. En effet, à partir de la circulaire du 05 juin 1989, le niveau de la branche devient un instrument privilégié de la politique contractuelle en matière de formation professionnelle continue. Elle s'est appuyée sur un renforcement des institutions intermédiaires de type organisations professionnelles patronales, même si des doutes sérieux existaient quant à la capacité de certains de ces acteurs de mettre en oeuvre le dispositif conformément aux objectifs initiaux (K. Mirochnitchenko et E. Verdier, 1997).
Par ce moyen l'intervention publique s'érige en tuteur de cette modernisation sociale et économique (politique de "Modernisation négociée" ; V. Merle et Annandale-Massa, 1992). Elle s'appuie également sur les Contrats d'Études Prévisionnelles conclu entre l'État et une organisation professionnelle de branche. Le but de ces contrats partiellement financés par l'aide publique pour l'emploi est plus précisément de dégager, à partir de travaux d'experts, des référentiels en matière de qualification d'organisation du travail et de perspectives économiques qui tiennent lieu de vision commune aux partenaires sociaux pour l'engagement d'action de formation.
Depuis 1993, les EDDF sont plus clairement positionnés. Ils concernent exclusivement des regroupements d'employeur, les branches en premier lieu, qui dans le cadre de comités technique régionaux et nationaux co-présidés par l'État et l'organisation patronale instruisent les dossiers. Le financement par l'État de ces actions de formation comporte donc deux postes un poste ingénierie et un poste réalisation des formations. Une enquête technique préalable aux EDDF est instruite par L'AFPA ou les GRETA pour le compte de l'État. Enfin le FNE prévention seul peuvent ménager un accès direct d'une entreprise isolée à l'aide publique en matière d'action de formation.
La loi quinquennale de 1993, qui opère une importante réforme de collecte des fonds de la formation professionnelle, affaiblit pour une part le rôle intermédiaire de la branche et des organisations professionnelles. Enfin, il est important de noter qu'à partir de 1996, il est ouvert la possibilité de conclure des EDDF avec des regroupements d'employeurs, en dehors des frontières de la branche, par l'affectation de crédits aux régions. Toutefois, la faiblesse d'utilisation des crédits conduit à majoritairement fonder les EDDF sur les branches professionnelles.
Il faut enfin retenir l'articulation récente de ce dispositif avec l'objectif 4 du Fond Social Européen " sur l'accompagnement de l'effort des salariés dans leurs adaptations aux mutations industrielles ".
3.2.2. Le coût du financement par l'État et les résultats en terme de formation
Les chiffres commentés dans ce passage sont données par le CEREQ dans un rapport d'évaluation commandé par la DFP sur les EDDF et réalisé en 1997 (Vernoux-Marion, 1996). Cette rétrospective effectuée depuis 1989 permet de saisir l'évolution tendancielle des dépenses de formation continue dans le cadre de convention de l'État avec les branches. Le coût pour l'État de ce dispositif, en terme de budget de fonctionnement et de budget d'ingénierie, a augmenté jusqu'en 1990 (410,2 millions de francs), pour ensuite se stabiliser jusqu'en 1992 et diminuer jusqu'en 1994, où il atteint 272,8 million de francs.
Le nombre d'accord s'est également réduit, passant entre 1989 et 1992, de 789 accords à 265. Le nombre de stagiaires concernés après une augmentation entre les années 1990 et 1993, où il atteint 224 500, revient a peu près en 1994 à un niveau inférieur à celui de 1989 : 181 785 (cf. tableau 21).
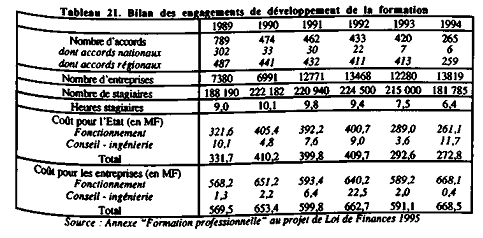
La durée moyenne annuelle des stages est de 41 heures. Plus le public est qualifié plus cette durée est longue. Elle est particulièrement faible pour les stagiaires des entreprises relevant des accords "coopératives agricoles" et "Transports Routiers". Par contre, on dépasse 60 heures de formation pour les accords "Autres types de regroupements" et "Papiers Carton" pour lesquels les ouvriers non-qualifiées et les ouvriers qualifiés bénéficient de durées de stage supérieures en moyenne à 75 heures. Les ouvriers non qualifiés des entreprises de l'accord "Autres type de regroupements" connaissent des durées de formation moyenne de 156 heures.
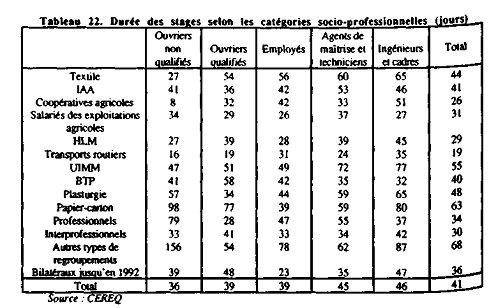
Les durées annuelles de formation observées pour les entreprises bénéficiant d'un EDDF sont en moyenne comparables à celles observées pour l'ensemble des entreprises de plus de 10 salariés remplissant une déclaration fiscale n°24-83 (sur l'aspect plan de formation). Un premier commentaire consiste à se demander qu'elle est la valeur ajoutée réelle du dispositif d'aide publique sur ce point Mais l'aspect quantitatif en termes de durée n'est pas suffisant, il est nécessaire d'appréhender les contenus des formations et leur modalités de valorisation dans l'organisation du travail et la gestion de l'entreprise.
Le second commentaire qu'inspire de tels résultats est que les EDDF visent comme principal public les branches, or on constate que les publics qui se saisissent le mieux de l'objectif de ces accords, celui d'une formation lourde "qualifiante "(voire "diplomante"), en sont pas les acteurs de branche traditionnels. Cependant on distingue une différence de logique . entre la branche de l'UIMM par exemple qui s'efforce de s'approprier le dispositif en fonction d'objectifs propres aux organisations patronales et la branche de plasturgie qui s'inscrit à l'opposé dans une stratégie de partage du référentiel de l'action publique en matière de formation continue. Toutefois, le degré d'association des représentants salariés à l'orientation de la politique contractuelle tend à décliner plus on descend vers le niveau local des commissions territoriales et des entreprises, dans le cas de la métallurgie mais aussi de la plasturgie.
Ces différences de stratégies s'inscrivent dans des histoires différentes de la construction de branches professionnelles. C'est ce que montrent les chiffres du tableau 22 en matière de proportion de salariés formés dans le cadre d'un EDDF selon la CSP et le type d'accord.
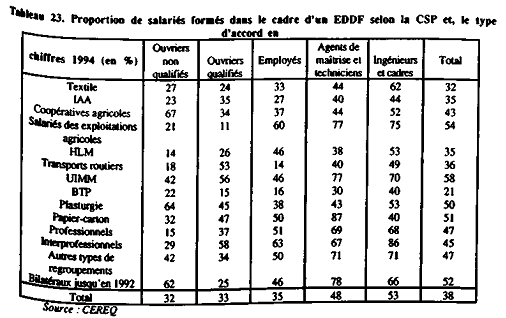
De façon générale, les accords de branche n'ont pas globalement privilégié la formation d'ouvriers non qualifiés qui étaient pourtant un public cible de l'action publique. Pour les ouvriers, dans les cas où les actions menées sont importantes en durée, elles portent généralement sur l'attribution de certifications professionnelles (CQP) et non sur l'accès à des diplômes reconnus par l'éducation nationale et par l'ensemble des entreprises sur le marché du travail. L'attribution de certificat n'est donc pas neutre pour la mobilité d'une main d'oeuvre peu qualifié sur un marché du travail qui sélectionne d'abord par le diplôme, il représente une faible protection en cas de licenciement ou de mobilité volontaire. Enfin, les catégories les plus privilégiées du point de vue des durées de formation sont les ingénieurs et cadres et ensuite les agents de maîtrise et techniciens.
Les évaluations monographiques des conventions de branches et de l'appropriation des orientations de ces conventions au niveau des entreprises, qui sont le niveau-clé de la contractualisation, montrent que la formalisation ou orientation des actions de formation menées au niveau de la branche peut correspondre au sens requis par les acteurs publics, sans qu'elles se traduisent pour autant de la même façon dans les entreprises.
L'exemple de la plasturgie est de ce point de vue intéressant (Cadet, 1996). Il montre que les entreprises concernées par l'accord s'appuient plus souvent sur une approche gestionnaire que stratégique du point de vue de l'adaptation des compétences et des qualifications dans une perspective offensive de recherche de compétitivité et de croissance.
La lourdeur du dispositif, la sélectivité en amont dans les procédures d'attribution de l'aide pour garantir une limitation des problèmes de coopérations entre le niveau de la branche et celui de l'entreprise, sont autant d'éléments qui fragilisent l'impact de l'aide publique par rapport à ses objectifs initiaux, qui sont d'augmenter les efforts de formation des entreprises les moins offensives en matière de formation professionnelle. Enfin le repositionnement des EDDF en 19 % sur un objectif d'employabilité associé à celui de compétitivité risque de renforcer cène sélectivité dans la mesure où peu d'entreprises inscrivent leur stratégie dans ce sens.
Du point de vue de l'entreprise, il s'agit essentiellement d'optique de consommation de crédits publics. L'explication de la différence entre les stratégies d'entreprises de ce point de vue repose essentiellement sur leur inscription dans des trajectoires hétérogènes de reproduction ou de transformation de leur structures productives. Dans ce cadre, l'action des branches et l'aide publique n'induisent pas une inflexion réelle et générale en termes de pratiques de formation. Toutefois, l'accès au dispositif reste dans les faits dépendant de l'activité déployée par les organisations patronales et leur représentation territoriale, importante dans le cas de la métallurgie et la plasturgie, dans le cadre de conventions d'ingénierie de conseil et d'aide aux projets des entreprises en matière de formation professionnelle (K. Mirochnitchenko et E. Verdier, 1997).
Enfin l'implication et le dialogue autour de la gestion de l'EDDF restent limités dans l'entreprise en rapport de ce qui peut se passer au niveau de la branche (ici la plasturgie). La gestion de l'EDDF implique très peu les IRP. Au niveau de l'entreprise, les débats sur les formations à faire ou à soutenir sont inexistants ou très rares. La formation reste l'apanage des directions dans la plupart des entreprises, ce qui est d'ailleurs une caractéristique sociétale.
Contrairement au niveau des branches, l'EDDF n'apparaît pas comme un dispositif particulièrement capable de générer du dialogue social, notamment autour de la question d'une amélioration simultanée de l'employabilité et de la compétitivité. L'exemple de l'industrie agro-alimentaire confirme plus qu'il n'infirme ces conclusions (Brochier, 1997).
3.3. Les entreprises et les aides territoriales
Compte-tenu de la faiblesse et de la dispersion des données sur l'évaluation des aides territorialisées pour l'emploi, nous réaliserons une étude de cas approfondie sur la région Pays de Loire pour le rapport final. Cette évaluation intégrera notamment l'aide européenne dans le cadre de l'objectif 4 du Fonds Social Européen (FSE).
3.4. Les entreprises face à la RTT
Pour analyser les possibilités ou les difficultés d'impulser une négociation globale sur le temps de travail, il faut se tourner vers le contexte social, dont Freyssinet (1994) dresse un panorama détaillé. De nombreux travaux monographiques se sont ainsi attachés à établir des typologies de branches et d'entreprises selon les logiques de réduction et/ou d'aménagement du temps de travail mises en oeuvre par les acteurs (voir notamment dans Rigaudiat, 1993).
3.4.1. Évaluer le rôle de l'apprentissage organisationnel dans les études monographiques
L'observation empirique de l'émergence de nouvelles normes de gestion de l'emploi à l'occasion de la mise en oeuvre de l'expérience française peut être riche d'enseignements.
Sur une base hypothétique, le rapport du CSERC (1998) établit une première typologie distinguant :
- Les entreprises où la hausse des coûts salariaux sera plus que compensée par les baisses
de charges et les gains de productivité (les entreprises de main d'oeuvre notamment)
- Les entreprises qui utilisent systématiquement les heures supplémentaires et qui auront intérêt à attendre le 1er janvier 2000 pour passer aux 35 heures lorsque les heures supplémentaires seront majorées
- Les entreprises "dont les contraintes techniques et organisationnelles ne permettent pas cette réduction et pour qui elle n'est pas avantageuse" (sociétés employant une majorité de cadres, PME où les salariés sont faiblement substituables).
Les premiers effets de la loi Robien et de la loi d'orientation et d'incitation pourront être précisés en détail à l'aide d'études monographiques. Celles-ci pourront être mises sur pied au courant de l'année 1999. Une sélection d'entreprises sera effectuée en fonction de la taille, du secteur d'activité et du contenu des relations industrielles en présence. Dans les entreprises ayant été le théâtre de négociations, elles pourraient confronter les accords conclus avec les hypothèses micro-économiques (réorganisation, compensation) ayant servi à construire les scénarii macro-économiques évoquées plus haut. Dans les entreprises n'ayant pas fait l'objet de négociations concluantes, les facteurs de blocage sociaux ou technico-organisationnels pourraient être précisés ainsi que leurs implications sur la gestion de la main d'oeuvre en vigueur (type de flexibilité, gestion des fluctuations conjoncturelles...). Le choix de l'échantillon s'avère également déterminant. L'échantillon tiendra compte des caractéristiques suivantes : type de secteur (secondaire, tertiaire), type de contrainte technico-organisationnelle, taille de l'entreprise, degré de concurrence, situation financière, présence syndicale. Pour reprendre le langage en vigueur dans le champ des relations industrielles, ces caractéristiques représentent le contexte technico-économique qui n'est pas sans influence sur le contenu des règles construites par les acteurs sur le lieu de la production.
Une première analyse porte sur les stratégies de RTT qui ont été mises en oeuvre à partir d'accords d'entreprises signés entre 1993 et 1995, dont très peu ont signé des conventions avec l'État dans le cadre de loi quinquennale. Cette première analyse permet de saisir le contexte structurel, d'un point de vue social et économique, dans lequel sont venues s'insérer les lois de Robien et Aubry en matière de RTT. Deux types de stratégies d'entreprises sont identifiés. La première stratégie est défensive. Elle est mise en oeuvre par des entreprises qui rencontrent des problèmes de compétitivité importants mais qui cherchent à protéger des emplois. La seconde stratégie est plus offensive, elles tentent justement de s'appuyer sur la RTT dans un contexte de rupture de modèle productif plus favorable à la recherche de compétitivité. Dans leur recherche de croissance elles sont plus que les autres, prêtes à réaliser des investissements matériels et immatériels importants (transformations de l'organisation et des modalités de gestion en profondeur) mais ne font pas toujours appel à l'aide publique. Une deuxième analyse porte sur les résultats des évaluations monographiques réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre de loi de Robien. L'évaluation monographique des premières mises en oeuvre de la RTT dans le cadre de la loi Aubry sera effectuée dans le rapport final.
3.4.2. La négociation sur le temps de travail dans les entreprises en application de la loi quinquennale
Dans le cadre de l'application de la loi quinquennale peu d'entreprises ont signé une convention d'aide avec l'État Une analyse monographique des accords (Milano, 1996) mis en oeuvre entre 1993 et début 1996 permet de distinguer les stratégies offensives des stratégies défensives de RTT effectivement mises en oeuvre. Les premières ont pour objectif la recherche de compétitivité et de rentabilité. Les secondes, plus nombreuses, visent la préservation de l'emploi, mais leurs dispositifs sont néanmoins intéressants, du point de vue de la compréhension de logiques d'acteurs de l'entreprise et du contexte de mise en oeuvre des lois Robien et Aubry.
|
Le temps de travail dans la loi quinquennale du 20 décembre 1993 La loi quinquennale du 20 décembre 1993, "relative au travail à l'emploi, et à la formation professionnelle" introduit la possibilité de négocier une annualisation (ou modulation de type III) de la durée du travail avec une contrepartie obligatoire de réduction de la durée du travail sans toutefois en fixer le volume. Cette loi a également introduit, dans l'article 39, une compensation partielle de charges sociales de l'employeur pour trois ans, dans le cadre d'un accord de modulation annualisée (type III), s'il respecte les conditions suivantes : réduction d'au moins 15 % de l'horaire initial, embauche d'au moins 10 % des effectifs et maintient de leur niveau pendant au moins trois ans, réduction du salaire. Compte tenu des contre parties en terme d'emploi et de réduction d'horaire qu'il exige, ce dispositif sera très peu utilisé puis remplacé par la loi du 11 juin 1996. Mi-juin 1996 seulement 13 accords d'entreprise étaient signés dont 9 dans la société Brioche Pasquier. Du coté des conventions de branches le résultat est encore plus modeste, seulement trois accords ont été négociés dans des branches dites "mineures". Les dispositions qui concernent la RTT viennent s'inscrire dans un ensemble de texte bien plus large qui comporte 83 Articles. On peut dire que l'esprit dominant de la loi est d'échanger aux entreprises une possibilité de flexibilité accrue du temps de travail contre un horaire hebdomadaire de travail susceptible d'être réduit à 32 h et des réductions de charges patronales. Les exonérations peuvent être obtenu à la condition que : - les réductions d'horaires annuels soient supérieur ou égales à 15 % ; - l'embauche dans les 6 mois soit supérieur ou égal à 10 % des effectifs moyens des 12 mois antérieurs ; - les effectifs soient maintenus pendant au moins 3 ans. Si ces conditions sont remplies l'employeur peu bénéficier de réduction de cotisations sociales patronales à raison de :
Par ailleurs, dans son article 42, la loi aménage les conditions d'encouragement au temps partiel prévues dans la "loi Aubry" de 1992 : elle élargit les abattements de charges sociales à des plages d'horaires allant de 16h à 32h contre une limitation antérieure de 19h à 30 heures tout en réduisant les abattements de 50 % des charges sociales des salariés embauchés à la suite de ce passage à temps partiel, à 30 %. Il est important de noter que celle possibilité n'a plus besoin d'être une alternative à des licenciements, n'est plus bloquée en cas de plan social et n'a plus besoin pour être mise en oeuvre de l'existence d'un accord de branche ou d'entreprise. Elle repose donc sur une libre appréciation de l'employeur. On peut signaler que, dans le même esprit, l'article 43 de la loi, crée la possibilité d'une annualisation du travail à temps partiel qui, par opposition à l'annualisation du travail à temps complet n'a pas besoin d'un accord. Cette disposition, qui se substitue aux contrats intermittents, n'implique pas de contrepartie d'embauche et ne fait pas apparaître de seuil minimal de temps de travail hebdomadaire. La critique principale faite à la loi par les employeurs est que les conditions d'obtention des aides sont ultra complexes et donc largement décourageantes. Les syndicats reprochent inversement à la loi d'organiser un premier démantèlement de l'emploi stable dans la mesure où la loi organise le cadre : - d'un chômage partiel de longue durée, - d'une annualisation des horaires (art 38) - d'une semaine de 4 jours (art 39) - d'une exonération de charges sociales au profit des employeurs (9 art sur les 83) |
Un certain nombre d'accords d'entreprise importants ont vu le jour en France en 1993 et 95. Nous en avons sélectionné une vingtaine, qui nous ont semblé caractéristiques des processus en cours (Annexe 1). Les caractéristiques des accords de RTT négociés dans le cadre de la loi quinquennale sont les suivantes (Milano, 1996) :
- la réduction du temps de travail est faible, elle est comprise entre 38 et 36 heures,
- le recours au temps partiel est fréquent, que celui-ci soit hebdomadaire, annualisé, ou sous forme de congés,
- la Préretraite progressive est de plus en plus utilisée en combinaison avec le passage au temps partiel, dans le cadre d'une convention avec les pouvoirs publics, avec une indemnité forfaitaire de passage d'un temps plein à un temps partiel.
Dans une moindre mesure sont utilisés :
- le temps choisi, accompagné de mesures incitatives dont les primes, le retour à temps plein, la retraite (calculée sur temps plein), et accompagné de mesures offrant des salaires proportionnellement plus élevés.
- le Compte Epargne Temps : il est utilisé sur l'initiative de chaque salarié pour tous les jours excédant 25 jours ouvrés annuels. Il est donc alimenté par la transformation en temps de primes et congés supplémentaires. D constitue ainsi, pour chaque salarié, une réserve de congés disponibles tout au long de leur carrière (sous certaines conditions).
- les Congés de Longue Durée
Globalement, les caractéristiques de ces accords sont les suivantes :
- Ils portent souvent sur des mesures individuelles ou catégorielles (les cadres et/ou le personnel forfaité sont généralement exclus de ces dispositions), et concernent rarement l'ensemble du personnel.
- Ils visent à sauvegarder des emplois ou à en créer (phénomène impulsé par les accords de préretraite progressive avec embauches de jeune).
- Ils comprennent une compensation financière totale ou partielle (RTT dégage des gains de productivité).
- Ils sont favorisées par des financements de l'État.
- Les salariés y apportent souvent leur contribution financière.
Pour conclure, les accords défensifs se définissent par la recherche de diminution de la masse salariale et le recours au temps partiel. Tandis que les accords offensifs sont avant tout des cas d'aménagement du temps de travail, et non de la RTT, qui n'apparaît que comme une contrepartie aux horaires atypiques demandés aux salariés. L'objectif est manifestement l'augmentation de la productivité du capital ; la réorganisation du travail induit ainsi des gains de productivité substantiels, pour financer ces processus.
Les RTT sont généralement d'amplitude faible, touchent les personnels travaillant au temps et non à la mission, avec des compensations salariales limitées.
Les accords d'ATT sont plus structurels, que les accords portant sur le temps partiel, que l'on retrouve essentiellement dans les entreprises de services. En effet, celles-ci visent non l'augmentation de leur production, mais la gestion des sureffectifs, de la pyramide des âges et la diminution de la masse salariale.
L'aménagement du temps de travail dans les services existe lorsqu'il s'agit d'allonger l'amplitude de la durée de vente au public, pour accroître le chiffre d'affaires et rentabiliser l'ensemble de l'opération. Mais ce processus n'est pas possible, à l'identique, dans une entreprise dont les fonctions ne sont que du "back-office".
Globalement, l'impact de la loi quinquennale sur la négociation d'entreprise en matière de réduction et d'aménagement du temps de travail reste à nuancer. En effet, il apparaît que les entreprises ont mobilisé faiblement le nouveau dispositif d'annualisation du temps de travail (modulation de type III) introduit par la loi quinquennale 70 ( * ) , et qui permet de faire varier la durée du travail avec pour seule contrainte de respecter les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales (P. Boisard et P. Charpentier, 1997). Le plus souvent, les entreprises préfèrent se référer à des procédures d'aménagement des horaires plus simples, telles que la modulation de type I (1982) ou de type II (1987), qui de plus n'instituent pas une obligation de réduction du temps de travail. De plus, pour répondre aux fluctuations de leur activité ou de la demande, les entreprises mettent en place d'autres modes d'ajustements du temps de travail, tels que le recours aux heures supplémentaires, au chômage partiel, aux CDD et intérims, à la sous-traitance, sans spécifiquement passer par des dispositifs institutionnels (Mirochnitchenko, 1999). La loi quinquennale a augmenté la difficulté de mise en oeuvre des dispositifs dérogatoires d'aménagement du temps de travail par les entreprises.
3.4.3. La réduction de la durée da travail dans le cadre de la loi de Robien
Les principaux résultats de l'analyse statistique des conventions signées dans le cadre de la loi de Robien
Fin novembre 1997, 1442 conventions avaient été signées en application de la loi Robien un peu plus d'un an après sa mise en oeuvre. D'après les résultats d'analyse de ces conventions par la DARES, celles qui ont pour objet la création d'emploi (volet dit offensif) sont plus nombreuses (1030), particulièrement dans les petites entreprises du tertiaire. Mais celles qui visent à maintenir des emplois menacés (volet dit défensif) sont plus fréquentes (412) dans les grandes unités de l'industrie et concernent au moins autant de salariés. En effet, sur 1030 conventions analysées, le nombre de conventions offensives concerne 49 % des salariés, pour 51 % concernés par les conventions défensives.
Les résultats que nous utilisons sont extraits d'une étude de la DARES qui portait sur 1030 conventions, signées entre octobre 1996 et octobre 1997, et qui ont fait l'objet d'une exploitation statistique détaillée (Le Corre et Doisneau, 1998). Il faut noter que ces informations ont été recueillies à la signature de la convention, et ne retracent donc que des intentions ou des prévisions. De plus, certaines valeurs, comme le nombre de salariés concernés par la RTT, sont susceptibles de varier notablement selon l'activité économique des entreprises conventionnées. Les informations exploitées recouvrent donc environ 71 % des conventions signées depuis octobre 1996 et 75 % de salariés concernés.
Le coût d'un "emploi Robien" pour l'État fait l'objet de controverses. Sur la base du volet "offensif" et dans sa version minimale (10 % de RTT pour 10 % d'embauche) les évaluations donnent les résultats suivants :
- L'impact sur le budget de l'État est de 146 000 F à 199 000 F par emploi la première année et de 108 000 F à 149 000 F par an, pour les 6 années suivantes.
- L'impact sur le budget de l'ensemble des organismes publics (hypothèse de prise en compte des rentrées supplémentaires dans les caisses de sécurité sociale, de retraite complémentaire, de L'UNEDIC) de 83 000 F à 113 000 F la première année et de 34 000 F à 86 000 F par an les six autres.
- L'impact avec effet macro-économique induit (calcul de l'OFCE à partir du modèle Mosaïque) est de 70 000 F la première année et 30 à 45 000 F par an les années suivantes.
|
Modalités d'application de la « loi Robien La " loi Robien" était destinée à modifier l'article 39 de la "loi quinquennale"jugé trop "verrouillé". Elle distingue une version offensive et une version défensive. Rappelons que sa version "offensive" prévoyait deux cas : - si la RTT est au moins de 10 % et les embauches compensatoires au moins de 10 %, les allégements de cotisation seront de 40 % la première année et 30 % de la 2ème à la 6ème année ; - si la RTT est supérieure ou égale à 15 % et les embauches compensatoires supérieures ou égales à 15 %, les allégements de cotisation seront de 50 % la première année et de 40 % de la 2ème à la 6ème année. La contrainte est de garder le niveau d'emploi (effectif total annuel moyen) pendant 2 ans. La version "défensive" prévoit une limitation de licenciements pour motif économique dans le cadre de "plans sociaux" grâce à une réduction du temps de travail. En contre partie, l'entreprise peut bénéficier d'un allégement de cotisations patronales. Plus précisément, la diminution du temps de travail doit être au moins de 10 % et les effectifs initiaux (effectifs annuels moyen) doivent être maintenus pendant trois ans. Dans ce cas les abattements de charges sont de 40 % la première année est de 30 % les six autres (au maximum). Si la diminution du temps de travail et les embauches proportionnelles atteignent au moins 15 %, l'abattement peut être de 50 % la première année et de 40 % les six années suivantes. Dans tous les cas, pour pouvoir bénéficier d'un maintien des abattements, l'entreprise doit avoir un rendez-vous au bout de trois ans avec l'administration et signer un avenant à la convention initiale dans lequel elle réaffirme ses engagements. La RTT peut être mise en place au niveau d'une entreprise, d'un établissement ou d'une unité de travail suffisamment cohérente pour être soumise à un horaire collectif. La réduction doit être collective. La RTT doit faire l'objet d'une négociation collective s'appuyant sur un accord d'entreprise ou d'établissement et doit être soumise à l'avis du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans le volet offensif, l'allégement de cotisations sociales se cumule, le cas échéant, avec - notamment - l'abattement de cotisations sociales lié au passage à temps partiel. La RTT doit alors être proportionnelle pour tous. Dans tous les cas, les emplois crées peuvent être des emplois à temps partiel. Les cotisations concernées par la diminution de charge sont : l'assurance maladie, les assurances vieillesses sous le plafond de la sécurité sociale et sur la totalité des salaires, les allocations familiales et les cotisations pour accident du travail. |
En 1997, 11 797 accords d'entreprise ont été conclus, concernant 3,2 millions de salariés. Parmi ceux-ci, les accords sur le temps de travail devancent pour la première fois des accords sur les salaires (51,6 % contre 41,6 %). Par contre les accords stagnent au niveau des branches. Ce mouvement a été accentué sous l'effet de la loi Robien : les accords d'entreprise portant sur le temps de travail sont passé de 4000 à 6061 pour couvrir 1,67 millions de salariés, cette augmentation étant à rapprocher des 1968 accords signés dans le cadre de la loi Robien. Par ailleurs 2200 accords ont traité de l'emploi.
L'impact sur l'emploi
L'ensemble des conventions Robien offensives ou défensives prévoient de créer ou de maintenir en moyenne 11 % de l'emploi sur les effectifs concernés par les mesures aidées de RTT. Le pourcentage de créations d'emplois en moyenne de 11 %, est légèrement inférieur au pourcentage de licenciements évités, de l'ordre de 11,6 % des emplois dont la durée du travail est réduite. Le pourcentage de licenciement évité représente également 44 % des sureffectifs déclarés par l'entreprise. Par ailleurs, lorsque les entreprises signent la convention de maintien ou de création d'emploi selon un minimum de 10 %, leur engagement effectif est de l'ordre de 10,3 %. Lorsqu'elles signent une convention de création ou de maintien d'emploi au minimum de 15 % leur engagement effectif moyen est de l'ordre de 17,7 %.
Cependant ces créations ou maintiens d'emploi ne peuvent être directement interprétés comme des créations nettes à l'échelle de l'ensemble de l'économie puisqu'il faudrait connaître l'évolution des effectifs qui se serait produite en l'absence de réduction de la durée du travail. Dans cette perspective, il serait par exemple intéressant de comparer la hiérarchie des pourcentages de créations d'emplois selon les effectifs des différents secteurs d'activités avec la hiérarchie des pourcentages de création d'emploi gagnés avec l'ensemble des signatures de conventions offensives de RTT avec l'État.
De plus, le jeu de la concurrence entre les entreprises ou entre les établissements d'une entreprise signataire et les non-signataires peut conduire à des résultats nets globalement différents de ceux que l'on s'attend à observer dans le seul champ des unités conventionnées (Le Corre et Doisneau, 1998). Cet effet de substitution sera d'autant plus important que la concurrence est importante et les parts de marché stabilisées ou en déclin. La répartition industrie/services des conventions offensives ou défensives signées dans le cadre de la loi Robien peut être cernée. Les conventions offensives sont en majorité signées dans les services (61 %) par des unités de taille assez réduite. Elles représentent dans ce secteur près de cinq conventions sur six. Les conventions défensives sont plus souvent signées dans de plus grandes unités (31 % ont au moins 200 salariés) appartenant à l'industrie (dans 63 % des cas).
L'impact sur le temps de travail
Les 35 heures sont la cible la plus courante. Parmi les conventions défensives 29,1 % visent une réduction de 4 heures du travail tandis que 62 % des conventions offensives visent cette réduction de 4 heures. Les conventions défensives se trouvent réparties également de façon importante dans les réductions de plus de 6 heures et de moins de 4 heures. Un tel résultat peu être interprété comme d'un côté un besoin de flexibilité de la main d'oeuvre et des coûts compte tenu de la situation économique de ces entreprises et de l'autre par une relative rigidité dont elles peuvent faire preuve en matière de réorganisation liées à la RTT, qu'il serait intéressant d'éclairer à partir des analyses monographiques. On note enfin que les objectifs de 35 heures sont majoritairement exprimés dans les services, tandis que dans l'industrie la proportion de durées plus courtes du travail est plus importante.
En matière d'aménagement du temps de travail, si la réduction est le plus souvent hebdomadaire, la réorganisation des horaires sur l'année est assez répandue, plus souvent signées par de grandes unités de l'industrie dans le cadre de conventions défensives.
L'impact sur les salaires
Maintien instantané et gel ultérieur des salaires apparaissent fortement liés dans les négociations. Les unités de taille importantes sont celles qui recourent le plus au gel des salaires : 31 % des conventions prévoient un gel des salaires et il concerne 40 % des salariés. Enfin ce gel est plus souvent prévu dans les conventions offensives que défensives dans lesquelles il est cependant de plus longue durée.
L'impact sur le changement organisationnel
La prévision de changement d'organisation du travail simultané à la RTT couvrent 87 % des salariés. L'objectif de mise en place du dispositif permettant de moduler te temps de travail en fonction des fluctuations de l'activité est le mode de réorganisation le plus privilégié, il est présent dans 55 % de conventions. Ce sont les conventions défensives qui prévoient le plus la modulation de l'activité (65 % d'entre elles). Tandis que les conventions offensives sont plus nombreuses à prévoir un allongement des heures d'ouverture et de la durée d'utilisation des équipements qui permet d'augmenter la productivité du capital et donc de réduire son coût. Enfin, il faut souligner que seulement 16 % des conventions retiennent encore d'autres changements organisationnels tels que la redistribution des tâches entre salariés, la planification, etc. Ces objectifs sont plus souvent présents dans les conventions offensives (16,7 %) que dans les conventions défensives (14 %). On est donc amené à se demander dans quelle mesure les adaptations organisationnelles prévues par les conventions défensives seront suffisantes pour favoriser le maintien de l'emploi qu'elles prévoient. Il serait de même intéressant de connaître les stratégies de recherche de compétitivité et les projets d'investissements matériels associés aux investissements dits immatériels prévus en faveur de telles unités par les sociétés mères.
Au terme de ce tour d'horizon, le chapitre suivant dressera la synthèse des évaluations rassemblées ici en les classant par types d'objectifs (généraux, ciblés) et par types d'instruments (réduction du coût du travail, formation, préretraites, réduction du temps de travail).
CHAPITRE 4 - SYNTHÈSE DE L'ÉTAT DES LIEUX
L'objet de ce rapport était de fournir un état des lieux des flux financiers en matière d'emploi et de l'évaluation de leur rôle.
La première partie de ce rapport répertoriait les dispositifs selon leur caractère général ou ciblé, et selon la présence d'une contractualisation ou non entre les entreprises et les pouvoirs publics. Les objectifs poursuivis par les mesures successivement mises en place depuis le milieu des années soixante-dix ont longtemps hésité à trouver leur cohérence. Ils ont oscillé entre la gestion sociale du chômage, les politiques spécifiques visant à modifier l'ordre de la file d'attente des chômeurs et les mesures d'ordre général, destinées à rendre la croissance plus riche en emplois.
Après avoir classé les mesures par objectifs poursuivis, l'objet de ce chapitre conclusif sera de fournir une synthèse des évaluations classant les mesures en fonction des mécanismes économiques enclenchés par chaque dispositif.
Les mécanismes économiques à l'oeuvre dans le cadre des mesures financées par les flux en matière d'emploi mettent essentiellement en jeu quatre grands types de mesure :
- la réduction du coût du travail, que celle-ci soit générale ou ciblée,
- la formation, qu'il s'agisse de la formation continue des salariés en place ou des mesures ciblées en direction de publics spécifiques,
- les préretraites, à condition qu'elles s'accompagnent d'un recrutement au moins équivalent de jeunes,
- la réduction de la durée du travail, à temps complet ou à temps partiel.
L'efficacité de chaque dispositif se mesure en référence au nombre d'emplois créés, mais aussi au regard des objectifs qualitatifs d'amélioration de la qualification des travailleurs et des emplois proposés par les entreprises.
|
Précautions nécessaires à la lecture des évaluations Les évaluations des effets des flux financiers en matière d'emploi rencontrent trois types de limites qu'il faut souligner avant d'exposer les résultats. En premier lieu, le nombre de bénéficiaires des flux en matière d'emploi ne correspond pas à la création nette d'emploi, c'est-à-dire celle résultant du solde entre les créations et les destructions d'emploi (licenciements, fins de CDD, etc) sur une période donnée. Ce solde doit ensuite être manié avec précaution car une évaluation rigoureuse des effets sur l'emploi d'une mesure doit isoler les effets pervers engendré s par certaines dépenses tels que les effets d'aubaine ou les effets de substitution mentionnés dans le précédent chapitre. Si ces effets se produisent, la dépense pour l'emploi perd de son efficacité : en son absence, les emplois se seraient tout de même créés (il s'agit dans ce cas d'un effet d'aubaine) même s'ils s'étaient orientés vers d'autres publics (il s'agit alors d'un effet de substitution). Enfin, à supposer que l'on puisse mesurer la création nette d'emplois, un emploi créé ne signifie pas un chômeur évité. Toute création d'emploi exerce un effet d'appel sur la population inactive. La flexion des taux d'activité indique alors la sensibilité de la variation de la population active à la création d'emploi. Les évaluations traitées dans ce rapport se sont essentiellement attachées à mettre en évidence le nombre de bénéficiaires ainsi que, le plus souvent dans les simulations macro-économiques, le nombre brut d'emplois créés sans pouvoir prendre en compte rigoureusement l'ensemble des facteurs agissant sur la création nette d'emplois. |
1. Les flux financiers consacrés à l'emploi, objectifs, instruments : récapitulatif
Les flux financiers consacrés à l'emploi se sont accrus avec le développement du chômage depuis deux décennies et demie. En se limitant aux chiffres de la DPE, la part de la DPE est passée de 1 % en 1974 à 2 % en 1978, 3 % en 1982 pour se situer autour de 4 % du PIB depuis le début de la décennie 1990. Le nombre de bénéficiaires de la DPE représente désormais 10,86 % de la population active.
1.1. Des objectifs incertains : Activation des dépenses, discrimination positive, contenu en emploi de la croissance
Un précédent rapport sur les subventions à l'emploi écrivait : "Force est de constater que le cas français est très complexe, quant à la place accordée aux subventions à l'embauche dans la politique de l'emploi. On relève, en premier lieu, le foisonnement des dispositifs, leur abandon partiel au profit de nouvelles mesures similaires, la superposition de mesures elles-mêmes apparemment proches, etc. Bref, la cohérence de ces mesures n'est, a-priori, pas évidente..." (Gautié et al., 1994).
Partant de ce constat, l'effort de classification a été le souci constant de ce rapport. Ainsi, malgré le caractère désordonné de la politique de l'emploi française, quelques points de repères peuvent être donnés.
Dans un premier temps, une part importante des flux financiers a été consacrée à la gestion sociale du chômage, à l'aide notamment des préretraites. Celles-ci ont néanmoins coexisté avec des mesures ciblées en direction des jeunes, qu'il s'agisse de formation ou d'emplois aidés. Si les mesures ciblées en faveur des jeunes se sont développées entre 1977 et 1981, c'est à partir de 1985 que l'approche des pouvoirs publics s'est résolument orientée vers une activation des dépenses pour l'emploi. Les objectifs poursuivis ont alors oscillé entre deux ensembles de mesures : les mesures d'ordre général et les mesures ciblées.
Les premières visent à améliorer le contenu en emploi de la croissance et/ou la qualification globale de la main d'oeuvre et de l'emploi. Les secondes visent à mettre en oeuvre un principe de discrimination positive en direction des travailleurs les moins employables (chômeurs de longue durée et jeunes principalement). En 1993, les mesures ciblées représentaient 34,8 milliards de francs contre 7,1 milliards pour les mesures non-ciblées. Si elles ont poursuivi leur croissance en valeur absolue, la part relative des dépenses ciblées s'est progressivement réduite au profit des mesures d'ordre général qui représentaient 54,5 milliards de francs (loi Robien incluse) en 1997 contre 50,9 milliards pour les mesures ciblées.
1.2. Les instruments : baisse du coût du travail, formation, préretraites, réduction du temps de travail
Les mécanismes économiques enclenchés par chaque type de mesure ont retenu particulièrement l'attention de ce rapport.
Dans le cadre de l'activation des dépenses pour l'emploi, les mécanismes recherchés relèvent essentiellement de la réduction du coût du travail. Cette réduction passe par des mesures d'ordre général, concernant les bas salaires, ou s'effectue dans le cadre de mesures ciblées en direction des catégories fragilisées.
La formation est un autre volet de la politique de l'emploi. Lorsqu'elle entre dans le cadre des mesures d'ordre général, elle consiste à promouvoir une stratégie industrielle de performance globale (Gandois, 1992) cherchant à placer les industries françaises sur un créneau de compétitivité hors-coût. Lorsqu'elle entre dans le cadre des mesures ciblées, elle vise à accroître le capital humain des travailleurs faiblement employables dans le but de les mettre en état de concurrencer des travailleurs mieux formés.
Les retraits anticipés d'activité ont longtemps été un instrument privilégié de la "politique passive" de l'emploi. Ils ont également une vocation "active" s'ils ont pour contrepartie l'embauche de travailleurs plus jeunes afin de rajeunir la structure de l'emploi, renouveler les qualifications des entreprises et réduire la masse salariale.
Enfin, la période récente a été marquée par la mise en chantier de la réduction du temps de travail dans le cadre des mesures d'ordre général. Ce chantier met en présence deux modalités : le temps partiel et la réduction de la durée collective du travail.
Dans le premier cas, l'objectif d'aménagement du temps de travail et de minimisation des coûts de la main d'oeuvre en fonction des fluctuations de l'activité des entreprises constituent les but recherchés par les entreprises. Le temps partiel est alors assimilable à un aménagement-réduction du temps de travail sans compensation salariale.
Dans le deuxième cas, l'objectif est déclencher une dynamique de créations d'emplois à temps plein sur une base hebdomadaire réduite avec compensation salariale totale ou partielle. Les hypothèses théoriques explorent alors l'idée que des accords "donnant-donnant" signés dans les entreprises (instaurant la réduction du temps de travail avec compensation en contrepartie d'un aménagement du temps de travail) constituent une hypothèse favorable à l'emploi, notamment si les pouvoirs publics financent le passage au 35 heures. C'est pourquoi cette mesure d'ordre général s'est construite dans le cadre d'une contractualisation entre les pouvoirs publics et les entreprises, cadre qui peut être amené à se développer pour créer les liens nécessaires du dialogue entre les acteurs de l'emploi.
La synthèse de l'évaluation de l'efficacité de chacun de ces instruments est présentée dans la section qui suit.
2. L'efficacité des mécanismes économiques mis en oeuvre dans le cadre de la politique de l'emploi
2.1. La réduction du coût du travail
2.1.1 Les exonérations de cotisations sociales généralisées sur les bas salaires
La baisse du coût du travail non-qualifié est devenue le coeur de la politique de l'emploi.
Tous les travaux s'accordent désormais pour dire qu'au niveau macro-économique, il n'y a pas de relation détectable en France entre le coût du travail et le chômage, C'est plutôt, selon l'hypothèse la plus couramment défendue, l'excès du coût relatif du travail non-qualifié qui constituerait la principale cause du chômage.
Le centre de gravité de la politique de l'emploi s'est donc progressivement déplacé en direction de la réduction du coût relatif des travailleurs rémunérés autour du SMIC et de certains publics cibles. L'ensemble des flux financiers consacrées à la réduction du coût du travail du secteur marchand représentaient 66 milliards de francs en 1997 (cf. Annexe 2). Pour le rapport Malinvaud (1998), la réduction du coût du travail non-qualifié devrait plus que jamais constituer l'axe central de la réflexion des politiques publiques de l'emploi.
Les effets sur la baisse du coût du travail de certaines des mesures-phares déjà en place de réduction du coût du travail sont présentés dans le tableau 24.
|
Tableau 24. Classification des mesures d'emploi marchand aidé |
||
|
selon la baisse du coût du travail |
||
|
Groupe |
Mesures |
Baisse du coût du travail (ordre de grandeur) en % _ |
|
1 |
Exonération 50% ( 1986-1987) Primes diverses (PICE. PCEA) APEJ |
10 |
|
2 |
Exonérations bas salaires Exonération 1er, 2ème et 3ème salarié Contrat d'orientation Contrat de retour à l'emploi (sans prime) Exo-jeunes(1992) |
20 |
|
3 |
Contrat de qualification CREavec prime |
30 |
|
4 |
Contrat initiative emploi |
40 |
|
5 |
Apprentissage (exo. + effet salaire) |
60 |
|
6 |
SIVP |
80 |
|
Stages pratiques |
85 |
|
|
Source DARES |
||
L'évidence empirique de la hiérarchie des coûts du travail non qualifié : la France dans la moyenne européenne
Dans les faits, le tableau 25 indique cependant que, tout comme pour le coût moyen de travail, le coût du travail non-qualifié se situe dans la moyenne européenne. Il est même inférieur à celui de certains de nos principaux partenaires communautaires.
Tableau 25. Coût du travail par catégorie en Europe en 1988 (en Ecus)
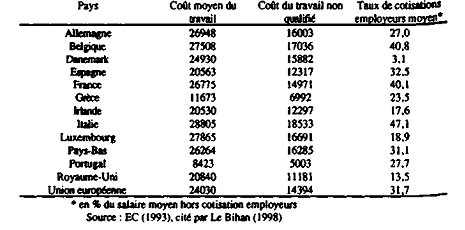
La tableau 26 récapitule la hiérarchie des coûts du travail européen, globalement et pour les secteurs riches en travail non-qualifié.
Tableau 26. Coût horaire de la main-d'oeuvre des secteurs à bas coût de la main-d'oeuvre (indice base 100 dans l'industrie manufacturière)
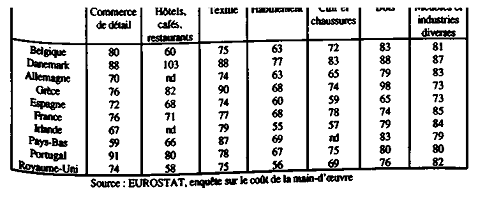
L'on observe que les coûts du travail non-qualifié par secteurs sont loin d'être les plus élevés en France. Ils se situent presque exactement dans la moyenne européenne, sauf pour les secteurs Cuir et chaussures. Habillement et Meubles et industries diverses où ils se situent au dessus de la moyenne.
Les effets sur l'emploi de la baisse du coût du travail non-qualifié : des conclusions prudentes, voire réservées
Les évaluations des effets la réduction du coût du travail non qualifié débouchent sur des conclusions prudentes quant à l'effet cette mesure sur l'emploi. Elles en soulignent les effets négatifs sur la dynamique d'accumulation du capital.
La plupart des études reposent sur l'hypothèse forte d'une substituabilité importante entre les facteurs de production (capital travail qualifié, travail non-qualifié). Elles envisagent néanmoins plusieurs scénarios selon le degré de substituabilité des facteurs.
Les évaluations économétriques indiquent généralement que l'élasticité emploi-salaire des catégories fortement exposées au chômage (jeunes, chômeurs de longue durée) est faible. Elle est souvent peu significative statistiquement
Lorsque l'hypothèse dune forte substituabilité des facteurs est retenue, l'effet sur l'emploi est positif, mais l'effet pervers d'une mesure d'ordre général de réduction du coût du travail non-qualifié est qu'elle engendre une baisse relative sur le moyen-long terme du stock de capital d'une économie, ce qui peut menacer la croissance potentielle et la compétitivité.
En admettant les coefficients mesurant l'élasticité emploi-salaire retenus dans ces études (même lorsqu'ils sont peu significatifs), et en retenant l'hypothèse la plus réaliste intégrée dans ces études d'une faible substituabilité des facteurs, la conclusion qui s'impose est qu'une mesure d'ordre général d'abaissement du coût du travail non-qualifié produirait peu d'effet sur l'emploi à court terme. L'effet se produirait à long terme pour un coût budgétaire élevé.
Plus précisément, les évaluations disponibles font apparaître que le problème du coût du travail non-qualifié se situe au niveau sectoriel, où l'élasticité emploi-salaire varie selon le type de secteur étudié. Il faut noter ici aussi que les études rencontrent parfois des difficultés pour mettre en évidence des coefficients significatifs.
En admettant néanmoins encore que les coefficients trouvés soient "valables", la conclusion qui en découle est qu'une mesure d'ordre général provoque des effets d'aubaine importants dans les secteurs où l'élasticité emploi-salaire est faible. La mesure générale n'est nécessaire qu'à certaines branches, mais profite dans ce cas à d'autres qui n'en n'ont pas nécessairement besoin.
Cette conclusion est complétée par les études monographiques indiquant que les entreprises utilisatrices des dispositifs publics ne sont pas forcément celles qui appartiennent aux secteurs en question qui souffrent d'un problème de coût du travail.
A titre conjectural, on peut alors se demander si une réflexion sur la modulation de la fiscalité des entreprises en matière d'emploi, en fonction de leur situation financière, ne serait pas une voie à explorer dans le but de neutraliser les effets d'aubaine et d'améliorer l'efficacité coût-avantage de la politique publique.
2.1.2. Les dispositifs ciblés
Certains travaux avancent pour leur part que les politiques ciblées sont les seules à même de réellement provoquer un impact, non pas tant sur le volume global de l'emploi, mais sur la sélectivité du marché du travail.
En ce qui concerne les aides à l'emploi marchand, les effets d'une mesure telle que me CIE sur la modification des publics embauchés par les entreprises ont ainsi pu être mis en évidence. Les évaluations disponibles des mesures ciblées en faveur des jeunes indiquent cependant que la discrimination positive s'effectue parfois de façon réduite avec un risque de stigmatisation des publics concernés.
Dans le cas des aides à l'emploi dans le secteur non-marchand, les mécanismes de création d'emploi n'obéissent pas à une logique de solvabilisation marchande ; ils dépendent du degré de la contrainte budgétaire. Aussi les méthodes d'évaluation sont-elles différentes de celles concernant les emplois marchands aidés. Une première approche consiste à mesurer l'effet de substitution entre ces emplois aidés et les emplois publics typiques qu'auraient permis de financer le montant du financement des nouveaux emplois restant à la charge des administrations (c'est-à-dire la partie non-aidée qui ampute le budget disponible). Les substitutions sont alors plus faibles pour les TUC et les CES que pour les CEC. Dans les simulations "macro-économiquement bouclées", l'hypothèse adoptée est celle d'une absence de substitution. L'effet sur l'emploi résulte alors directement des flux financiers affectés par les pouvoirs publics pour ces emplois.
2.2. La formation continue et la gestion de la mobilité professionnelle
Les aides contractuelles à vocation préventive telles que les aides à la formation continue aux branches et aux entreprises, ainsi que les aides au conseil pour l'élaboration de politiques de formation cohérentes avec l'évolution de l'organisation du travail, des technologies et des marchés, n'occupent pas une place privilégiée dans les flux en madère d'emploi. Elles voient même leur importance financière se réduire relativement, tandis que d'autres dispositifs de la politique contractuelle de l'Etat prennent de l'importance (comme l'aide à la réduction du temps de travail).
De façon générale, ces dispositifs étaient novateurs en matière de politique préventive. Cela signifie qu'ils pouvaient favoriser, simultanément, l'amélioration de l'employabilité des salariés dans l'entreprise et la recherche de compétitivité. Mais compte tenu du fait que l'amélioration des capacités de mobilité professionnelle qu'ils visent est conditionnée par des transformations profondes de l'organisation du travail, des modalités de gestion et des relations sociales, ces dispositifs n'ont pas encore trouvé l'environnement institutionnel propice à leur éclosion. Ils étaient pourtant jugés potentiellement les plus à même de favoriser une modification des structures productives des entreprises françaises s'inscrivant initialement dans le cadre de la stratégie industrielle de "performance globale" préconisée par le XIème Plan (Gandois. 1992).
2.3. L'accompagnement des plans sociaux, les conventions de conversion et la préretraite progressive
Les crédits de l'Etat pour l'accompagnement des plans sociaux ont pris une importance croissante au cours des années récentes. Les dépenses ont atteint 17,8 milliards de francs en 1995 (Cour des Comptes, rapport public, 1997) 71 ( * ) . L'accompagnement des plans sociaux est supporté par un ensemble complexe de dispositifs et leurs bénéficiaires représentaient en 1995 environ la moitié des licenciés pour motif économique. Les mesures d'aides à la sortie de l'entreprise, en particulier par mesure d'âge, occupent une place prépondérante par rapport aux aides de maintien dans l'entreprise. Et parmi les dispositifs de sortie de l'entreprise, la préretraite définitive (ou Allocation Spéciale du Fond National pour l'emploi) et la convention de conversion restent des plus sollicitées.
Un certain nombre d'entreprises françaises paraissent abonnées aux conventions nationales dans le cadre de plans sociaux négociés par la Délégation à l'Emploi. Ainsi, plus des deux tiers des allocations spéciales du FNE l'ont été à douze entreprises qui se sont adressées au moins trois fois en six ans au FNE. Ces entreprises ont couvert leur sureffectif à 41% par des préretraites totales, dans des conditions dérogatoires au droit commun dans un tiers des cas (rapport de la Cour des Compte réalisé en 1997 sur l'accompagnement des plans sociaux par l'Etat). Le recours à la convention de conversion s'est considérablement développé, il a concerné environ 150 000 personnes en 1994 soit 60% des bénéficiaires, ce qui représentait une dépense de 7,6 milliards de franc dont 20 % assuré par l'Etat. Par ailleurs le taux de reclassement des personnes en conversion était d'environ 45% en 1990 et de 35 % en 1993 (au huitième mois de la convention).
Cependant sur la période 1990-1995, on remarque l'essor des aides au maintien dans l'entreprise au prix d'un passage au temps partiel. Les mesures les plus sollicitées sont le recours à la convention de passage à temps partiel et à la convention de Préretraite^ <e ^ Progressive (PRP). Alors que la PRP permet d'organiser des transferts de savoir des plus anciens au plus jeunes on remarque qu'elle est essentiellement utilisée comme mesure de transition pour la préretraite totale combinée au temps partiel. Dans cette même perspective, en 1995, 8% seulement des conventions de PRP conclues organisaient le travail du préretraité sur plus d'un an.
2.4. La réduction du temps de travail
Les réflexions autour de la réduction du temps de travail ont récemment connu un second souffle dans de nombreux pays, notamment en Allemagne, en Belgique, en France et en Italie. C'est avec la montée du chômage que la réduction du temps de travail fut explicitement perçue comme un instrument de politique active de l'emploi par l'Etat et certains acteurs sociaux.
Le cas français est un des cas où les pouvoirs publics ont tenté d'impulser par la loi une dynamique massive de réduction du temps de travail. Cette impulsion publique a émergé dans un contexte social où la négociation sur le temps de travail tardait à s'affirmer.
2.4.1. Temps partiel et réduction de la durée collective du travail : deux vecteurs possibles de la réduction du temps de travail
La question du temps de travail est liée d'une part à la poursuite, certes ralentie, de la croissance de la productivité du travail, d'autre part au développement dans le secteur des services d'activités où les horaires de travail collectifs sont plus courts que dans l'industrie ou l'agriculture (Taddéi. 1998). Pour la période récente, dans la mesure où la norme de temps de travail collectif est demeurée inchangée depuis le début des années 80. la réduction du temps de travail a opéré par deux autres canaux :
- la réduction de la durée individuelle du travail (c'est-à-dire le développement du travail à temps partiel, les congés de formation, les congés parentaux, les interruptions volontaires de carrière, les retraites progressives).
- le chômage.
Ainsi la tendance à la baisse de la durée du travail s'est-elle poursuivie malgré le blocage de la durée hebdomadaire légale du travail. Cette tendance s'est traduite par la montée du travail à temps partiel (dont les caractéristiques sont précisées ci-après), et plus particulièrement du travail à temps partiel long (la durée moyenne du temps partiel est de 22h 40 en France, la deuxième plus élevée d'Europe derrière l'Italie), au moment où la durée effective du travail à temps complet ne manifeste aucune tendance à la baisse.
Le taux d'emploi à temps partiel est passé de 5,9% en 1973 à 9,2 % en 1982 et 16,6 % en 1997. L'inflexion marquante date de 1992, date correspondant à la mise en place d'un abattement de 40% des cotisations sociales pour l'embauche d'un temps partiel, cumulable avec les allégements de "charges sociales" sur les bas salaires. Les enquêtes par questionnaire auprès des salariés indiquent aussi que cette montée du temps partiel correspond majoritairement à du temps partiel subi et non choisi (CSERC, 1998) - tel est ainsi le cas pour 66% des jeunes de moins de 25 ans, particulièrement concernés par cette forme d'emploi (cf. Annexe 3).
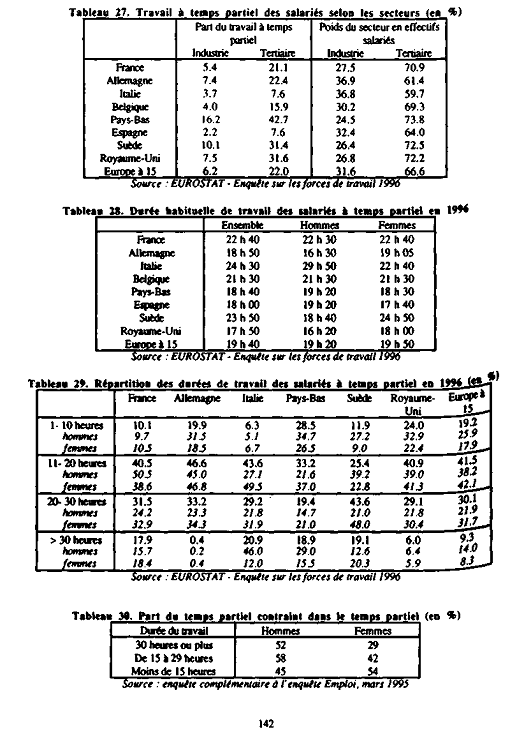
L'ambition des lois Robien et Aubry est d'encourager un autre vecteur de la réduction du temps de travail, celui passant par la baisse de la durée collective du travail à temps plein.
2.4.2. De la durée légale à la durée effective : évaluer l'impact de la contractualisation en matière d'emploi
La loi Robien, puis la loi Aubry marquent une étape particulière dans l'approche du temps de travail par les pouvoirs publics. A côté de l'incitation au temps partiel, il s'agit désormais d'encourager les acteurs sociaux à négocier la réduction de la durée collective du travail dans chaque entreprise dans le but de maintenir ou de stimuler l'emploi. Les directions entreprises y sont encouragée par des allégements de cotisations sociales. Les syndicats sont incités à discuter l'aménagement du temps de travail en contrepartie d'une compensation salariale et de la réduction de la durée du travail à temps plein.
Les mesures d'incitation à la réduction de la durée collective du travail ont la particularité d'être des mesures entrant dans le cadre de ce que nous avons appelé a contractualisation entre les pouvoirs publics et les entreprises en matière d'emploi. L'octroi de flux financiers en direction des entreprises est conditionné par des embauches ou par le maintien de l'emploi. Cet octroi a également comme contrepartie l'engagement de négocier l'aménagement-réduction du temps de travail.
La très grande majorité des expériences de RTT correspondent ainsi à des accords qui ont été signés en application des cadres contractuels existants, depuis la "loi quinquennale" et la "loi Robien". Ce cadre législatif est complété par un accord interprofessionnel du 31 Octobre 1995 qui a pour objectif d'inciter les branches professionnelles à négocier sur le thème de l'annualisation et de la réduction du temps de travail. Quelques accords commencent à être signés dans le cadre de la nouvelle "Loi Aubry". Le recul manque encore pour en évaluer l'impact. Le rapport final présentera les premières monographies disponibles de l'application de cette loi. Signalons quelques accords signés en dehors de ces cadres contractuels.
Les simulations macro-économiques de la réduction-réorganisation du temps de travail (2RT) concluent à un impact positif en termes d'emplois du financement de cette mesure à condition que la réorganisation du travail puisse accompagner la réduction substantielle de la durée du travail et ta compensation salariale.
C'est pourquoi le succès de ces derniers dispositifs dépend essentiellement de la capacité des acteurs à nouer le dialogue sur le lieu de travail, ce que les monographies présentées dans ce rapport ont tenté d'appréhender (Annexe 1).
Ces monographies permettent en outre de s'interroger sur les perspectives de la RTT en matière de gestion de la main d'oeuvre. La RTT ne fera-t-elle que maintenir la parcellisation taylorienne des tâches dans le cadre d'un temps de travail réaménagé ? La RTT aboutit-elle à différer des suppressions d'emploi et geler des gains de productivité ? Peut-elle permettre de travailler autrement en ouvrant la négociation sociale sur la manière d'organiser et d'évaluer le travail ? Permettra-t-elle d'impulser ou d'accélérer les apprentissages organisationnels et de gestion ? (Guinsburger. 1998).
Les aides publiques de la Loi Robien doivent donc être également évaluées à l'aune de leur capacité à générer des dynamiques de négociation d'entreprise, de réorganisation qualifiante du travail et d'accès à l'emplois pour des personnes peu ou faiblement formées. Les aides publiques destinés à favoriser les améliorations structurelles des organisations et compétences ont été fondues dans les dispositifs de court terme "d'aide à l'emploi". Il est donc probable que la réussite que la loi sur la RTT, dans la perspective évoque, sera dépendante de la capacité des pouvoirs publics à restaurer des aides aux conseils - publics ou privés - destinés à accompagner l'application de la loi.
*
* *
La principale limite de la politique de l'emploi est sans doute qu'elle prend la demande de travail des entreprises comme une donnée homogène. Les propriétés de cette demande de travail sont rarement discutées dans les évaluations. Celles-ci considèrent une demande de travail agrégée, simplement affublée d'une hypothèse de substituabilité ou de complémentarité des facteurs. Le problème de la politique de l'emploi serait alors» "simplement'' d'adapter l'offre de travail à cette demande. Dans cette perspective, les mesures générales cherchent à réduire le coût de cette offre de travail, jugé trop élevé. Les mesures ciblées visent à accroître les qualifications des offreurs de travail les moins employables ou à réduire leur coût relatif par rapport à celui des autres travailleurs.
Or rien ne dit qu'en réalité, la demande de travail obéisse aux hypothèses traditionnellement utilisées pour simuler la politique de l'emploi. Les stratégies d'entreprises sont multiples et les déterminants de la compétitivité ne se réduisent pas aux coûts de production. Il s'agit alors d'identifier précisément les différents types d'entreprises, leurs stratégies, leurs attitudes vis-à-vis des dispositifs de politique de l'emploi, les règles et les routines institutionnelles qu'elles utilisent, les compétences et les qualifications qu'elles mobilisent.
L'enjeu est de donner une représentation plus réaliste de l'économie qui soit à même d'aider le décideur à évaluer l'efficacité de la politique de l'emploi afin d'éviter le gaspillage des deniers publics. Cette préoccupation constituera la toile de fond des méthodologies utilisées dans la deuxième partie de ce rapport afin d'évaluer les nouvelles pistes de la politique de l'emploi.
DEUXIÈME PARTIE - LES NOUVELLES PISTES DE LA POLITIQUE DE L'EMPLOI : PREMIÈRES ÉVALUATIONS
Le gouvernement a décidé d'engager la politique de l'emploi dans deux directions : la réforme du financement de la protection sociale et la réduction du temps de travail. Les flux financiers consacres à ces mesures d'ordre général feront l'objet d'un débat dans le cadre de la prochaine loi de finances. Cette dernière partie du rapport vise à fournir un éclairage et une évaluation des hypothèses et arguments motivant le contenu possible ces deux réformes.
En premier lieu, la réforme du financement de la protection sociale a pour objectif de rechercher les modes de prélèvement qui soient les moins pénalisant pour l'emploi. Ce débat oppose un double éventail d'arguments que nous tenterons de sérier. La première opposition met en présence les arguments en faveur d'une assiette de cotisations assise sur le salaire et ceux qui prônent une extension de l'assiette à d'autres revenus, voire une refonte totale de l'assiette. Dans ce sens, deux propositions sont régulièrement évoquées dans le débat public : une assiette fiscale plus large que celle de l'IRPP incluant les revenus du capital et de certaines catégories non-imposables, une assiette reposant sur la valeur ajoutée des entreprises.
La deuxième opposition met en présence les arguments favorables au maintien de l'actuel partage des revenus et à la réduction du coût du travail, et notamment du coût du travail non-qualifié face aux arguments avançant que le problème est de stimuler les entreprises qui développent l'emploi au détriment des entreprises dont la part de la masse salariale dans la valeur ajoutée est plus faible. Quelques travaux considèrent toutefois que ces deux types de mesures doivent être appliquées simultanément.
Ces deux ensembles d'arguments ne se recouvrent pas. Certains arguments sont tout à la fois en faveur d'un changement d'assiette et d'une réduction du coût relatif du travail. D'autres arguments militent pour un maintien de l'assiette salaire et pensent inutiles les mesures de réduction du coût du travail. D'autres encore justifient un changement d'assiette pour stimuler l'emploi sans que le mécanisme recherché soit nécessairement la réduction du coût relatif du travail.
Trois types de mesures d'ordre général sont généralement envisagées :
- La réduction des cotisations patronales sur les bas salaires. Elle vise à réduire le coût du travail non-qualifié.
- La mise en place, en lieu et place ou en complément de l'assiette salaire d'une assiette Valeur Ajoutée ou dérivée de la Valeur Ajoutée. Elle a pour objectif d'instaurer un prélèvement qui fasse dépendre les contributions sociales d'un indicateur comptable de résultat des entreprises.
- La modulation des cotisations patronales en fonction d'un ratio mesurant la part des salaires dans la valeur ajoutée. Cette modulation peut être assise sur une assiette salaire tout aussi bien que sur une assiette valeur ajoutée.
En deuxième lieu, la loi d'incitation et d'orientation sur la réduction du temps de travail avait pour objectif déclencher une dynamique de négociations d'entreprise sur l'aménagement-réduction du temps de travail qui soit préalable à une seconde loi fixant les conditions définitives du passage aux 35 heures La logique de la première loi a été présentée dans la première partie de ce rapport Il s'agit désormais de dresser un bilan des premières négociations afin de préciser les termes du chantier de la deuxième loi. Celle-ci devra délimiter précisément le contenu des règles inhérentes à cinq volets : la durée du travail cadres, le volume autorisé des heures supplémentaires, les modalités de l'aménagement du temps de travail, le statut du temps partiel, la détermination du salaire minimum.
L'objet de cette deuxième partie est de fournir les premières évaluations de ces deux chantiers.
En ce qui concerne la réforme du financement de la protection sociale, le rapport Malinvaud (1998) fait autorité dans le débat public récent. Ce rapport a cherché à évaluer l'impact des différentes propositions, en s'intéressant notamment à celles, inhérentes à la modulation des cotisations patronales ou de la prise en compte de la valeur ajoutée, contenues dans le rapport Chadelat (1997). Edmond Malinvaud en conclut à l'inefficacité de telles mesures. Il recommande pour sa part un allègement d'ordre général cotisations portant sur les bas salaires. Selon l'auteur, cette mesure est la seule qui soit réputée efficace en termes de créations d'emplois à long terme.
Cette conclusion forte suppose que la méthodologie sur laquelle repose le modèle qui débouche sur cette recommandation soit des plus rigoureuses. C'est pourquoi nous avons repris unes par unes les hypothèses ayant servi à l'écriture du modèle de Malinvaud. Une lecture attentive de ce modèle laisse apparaître qu'il a été écrit de façon incomplète. Il ne teste pas les effets d'une réduction du coût du travail non-qualifié mais ceux d'une réduction du coût du travail en général. Il n'a pas fait l'objet d'un bouclage macro-économique : le scénario qu'il décrit est nécessairement inachevé dans la mesure où le modèle n'inclut pas tous les effets que ses propres hypothèses mettent en scène. En particulier, le modèle ne tenait pas compte des effets à long terme des variations de la demande. Nous avons donc poursuivi et complété l'écriture de ce modèle, en reprenant la même structure que celle du rapport Malinvaud. Notre conclusion relativise nettement celles du rapport Malinvaud Le rapport Malinvaud concluait intuitivement à l'inefficacité d'un changement d'assiette ou d'autres scénarios alternatifs à la proposition qu'il privilégie sans procéder à la modélisation de ces scénarios. Dans un deuxième temps, sans modifier la structure du modèle, nous avons donc simulé les effets sur l'emploi de la mise en oeuvre d'une assiette valeur ajoutée, d'une assiette Excédent Brut d'Exploitation et d'une modulation des cotisations patronales en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée (sur la base d'une assiette salaire).
En ce qui concerne la réduction du temps de travail, les rapports et travaux explorant les scénarios de 2RT et ayant servi à l'élaboration de la loi d'incitation et d'orientation sur la réduction du temps de travail ont été analysé en deuxième partie de ce rapport. L'évaluation de la mise en place effective de cette première loi passe par l'analyse des accords conclus durant la période et l'interprétation que les acteurs en font dans l'entreprise, où se met concrètement en oeuvre la réduction du temps de travail. Nous avons procédé pour cela au recensement quantitatif et qualitatif des accords. Nous les avons classés selon les logiques présidant à leur mise en oeuvre dans les entreprises. Le type d'accord, offensif ou défensif, prévus par le dispositif légal est pris en compte. Mais c'est également la capacité de réorganisation sur le long terme dans le cadre de la recherche d'une stratégie industrielle plus ou moins innovante qui délimite le contenu des différents accords. Nous opposerons un tel changement, qualifié d'"organique" aux changements qualifiés de "mécaniques" impliquant uniquement des ajustements de court terme. Cette évaluation, de nature quantitative et qualitative, doit fournir des indications nécessaires à la rédaction de la seconde loi devant fixer les conditions définitives du passage aux 35 heures.
La mise en place des 35 heures s'accompagne de dispositifs incitatifs engageant des flux financiers en direction des entreprises. Ces dispositifs sont assimilables à des mesures visant à annuler la hausse du coût du travail pour les entreprises qui négocient le passage aux 35 heures sans réduire les salaires. Ces dispositifs devraient prendre fin avec la promulgation de la deuxième loi imposant le passage définitif aux 35 heures. Le gouvernement a décidé de coupler cette deuxième loi avec la réflexion sur la réforme du financement de la protection sociale, afin de stimuler les entreprises qui développent l'emploi dans le cadre du passage aux 35 heures.
Nous étudierons donc l'opportunité de mettre en cohérence ces deux ensembles de dispositifs de politique de l'emploi (réforme du financement de la protection sociale et réduction du temps de travail) actuellement à l'étude par les pouvoirs publics. La question centrale est alors de savoir si la réforme des cotisations patronales peut être l'occasion de promouvoir les principes de prélèvements qui encouragent les entreprises s'engageant dans une réflexion de long terme sur l'innovation et l'emploi lors de l'application de la deuxième loi sur les 35 heures.
Le chapitre 5 traite des propositions relatives à la réforme du financement de la protection sociale ayant pour but de stimuler l'emploi. Il propose des évaluations, inédites, des différentes propositions.
Le chapitre 6 fournit un premier bilan des accords de branche et d'entreprise conclus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositifs de la loi d'orientation et d'incitation sur les 35 heures.
CHAPITRE 5 - LA REFORME DU FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE
La réforme du financement de la protection sociale met en jeu deux types de débats.
Le premier met en jeu un choix de société. Le mode de financement des dépenses sociales est en effet étroitement lié à la représentation que construisent les différents acteurs à propos de leur position sociale respective et de leur responsabilité dans la prise en charge collective du risque. La perspective d'une société essentiellement salariale justifiait l'avènement d'un système de financement assis sur les salaires. Ce système est aujourd'hui mis en question par les partisans d'une fiscalisation de certains volets du financement des dépenses sociales.
Le second débat porte sur l'efficacité économique de chaque système. Le critère d'efficacité économique fait évidemment l'objet de nombreuses controverses, quant à l'indicateur qui servirait à le mesurer. Nous soutiendrons pour notre part que le chômage et l'exclusion peuvent être considérés, dans la réalité économique et sociale européenne de cette fin de siècle, comme les principaux indicateurs de dysfonctionnement économique. Il n'est ainsi pas étonnant que les projets de réforme du financement de la protection sociale aient pour motif central de rechercher le mode de financement le moins pénalisant pour l'emploi. C'est donc à cette aune que ce chapitre évaluera l'efficacité de chaque proposition.
La première section établit une topographie des propositions en présence selon les logiques sociales, puis selon les logiques économiques qu'elles sous-tendent. La deuxième section dresse l'inventaire des différentes réformes possibles du financement de la protection sociale. La troisième section expose les simulations que nous avons réalisées pour évaluer les effets sur l'emploi de chaque type de réforme proposée. Elle procédera en utilisant le modèle utilisé par le rapport Malinvaud, en y incluant les éléments manquants, pour donner la représentation la plus complète possible des mécanismes enclenchés dans chaque cas.
1. Les termes du débat
1.1. Le débat de société
La controverse qui porte sur la logique de financement de la protection sociale est un débat de société. Ce débat oppose les partisans d'un financement reposant sur une assiette salaire à ceux qui estiment que cette assiette est devenue trop restreinte et que son maintien est essentiellement pénalisant pour l'emploi parce qu'il taxe le travail et non le capital (cet argument économique sera discuté au point suivant).
Les arguments politiques en faveur d'une assiette salaire se réfèrent à l'opposition traditionnellement établie entre les logiques d'assurance et d'assistance auxquelles sont liés des modes de financement spécifiques. La logique d'assurance sociale repose sur la socialisation du risque dans le cadre de l'activité productive. Elle se matérialise par la cotisation sociale, patronale et salariale. La logique d'assistance obéit à un principe de solidarité nationale. Elle se matérialise par l'impôt prélevant le financement de la solidarité sur le citoyen à mesure de ses capacités contributives. Le système français est certes un mixte de ces deux logiques (communément appelées bismarkienne pour la première, beveridgienne pour la deuxième). Néanmoins la première logique, à l'origine de la gestion paritaire des caisses de sécurité sociale, imprègne fortement une partie du mouvement syndical français.
L'assiette salaire trouve sans doute sa justification théorique la plus complète dans l'ouvrage de Friot (1999) Puissances du salariat. L'argument central est que la protection sociale financée sur une telle assiette représente la reconnaissance sociale du statut salarial comme acteur central de l'économie. Elle constitue une contrepartie forte accordée par l'employeur à la relation de subordination qui caractérise le contrat de travail. Les cotisations et prestations sociales représentent un salaire socialisé (d'où l'idée d'un salaire différé) qui, en tant que tel, résulte de la norme de partage du surplus que le salariat, institutionnellement reconnu grâce au caractère représentatif politiquement conféré à ses organisations syndicales, a pu obtenir collectivement et gérer paritairement. Un tel principe de financement est alors considéré comme un point d'appui pour étendre par la suite la sphère du contrôle salarial sur la répartition du surplus économique. Il est justifié par l'extension du taux de salarisation de la population active, qui n'a cessé de croître au cours de ce siècle.
A contrario, la fiscalisation est perçue comme la méconnaissance de la partition de la société en classes sociales. Elle repose sur le présupposé d'une société composée d'individus rationnels. La fiscalisation est alors perçue comme l'un des termes du couple libéral solidarité-épargne dénoncé par Friot. Dans cette vision du monde, la solidarité, financée par l'impôt, trouve, selon l'auteur, son complément dans l'assurance ou l'épargne individuelle (tels les fonds de pension) pour couvrir les dépenses de santé et de retraite que ne peut assurer la collectivité sur la base trop restreinte d'un impôt que les libéraux entendent par ailleurs réduire.
A l'inverse de la position de Bernard Friot, quatre types d'arguments militant en faveur d'une extension de l'assiette actuelle ou d'un changement d'assiette peuvent être recensés :
- Tout d'abord un argument inhérent à l'objectif d'universalité de certaines prestations. Nombre de revenus échappent au financement de la protection sociale à l'heure où son statut universel est en passe de s'instaurer : un nombre croissant de non-salariés perçoivent les prestations sociales. Ces dernières tendent donc de plus en plus à être déconnectées de leur source de financement. La fiscalisation partielle se justifie donc au moins par le principe de solidarité qui prévaut de plus en plus dans le versement des prestations.
- Un deuxième type d'argument porte sur la charge de financement, croissante, qui pèse sur les cotisations sociales, si l'assiette n'est pas modifiée ou élargie. La pression deviendrait insupportable pour ceux qui financent les dépenses sociales (surtout pour les salariés qui ont supporté l'essentiel de l'effort supplémentaire de financement, soit sous forme de hausses de cotisations, de CSG ou de RDS). La modification ou l'élargissement consisterait alors à intégrer la valeur ajoutée ou ses dérivés, ce qui aurait pour effet d'intégrer le profit des entreprises dans l'assiette de financement de la protection sociale, à côté d'autres types de revenus taxés par la CSG et le RDS (notamment les revenus du patrimoine des ménages).
- Pour certains, en troisième lieu, l'augmentation des cotisations exerce par ailleurs un alourdissement du coût du travail, particulièrement pénalisant pour l'emploi. Ce dernier point sera discuté dans la sous-section suivante. De plus, l'augmentation des cotisations salariales pèse sur le pouvoir d'achat des ménages et pèse sur la consommation. Pour y pallier, certains ont préconisé un basculement des cotisations salariales vers une CSG élargie aux revenus non-salariaux et aux revenus du capital.
- Enfin le dernier type d'argument est un argument redistributif. Il souligne le rôle de la fiscalité dans la définition des normes de répartition et d'utilisation des revenus entre les classes sociales. Ainsi, la question se pose de savoir s'il est normal que les profits d'exploitation et les revenus du capital, qui se sont particulièrement accru dans la dernière décennie, participent si peu au financement de la solidarité sociale nationale.
Une position médiane tente de concilier ces deux logiques. Elle consiste à diversifier les sources de financement. Il s'agit de maintenir une assiette salaire sur certains volets où l'acteur salarial et l'acteur patronal sont au coeur des activités engageant le risque couvert (l'activité de production et le retrait de l'activité, en l'occurrence), et à promouvoir d'autres sources de financement faisant participer d'autres catégories de revenus lorsque l'objectif de solidarité universelle est en jeu.
Cette combinaison a longtemps été celle qui, peu ou prou, a prévalu dans l'évolution du système à la française, pour peu que le compromis qui s'est maintenu jusqu' alors ne soit pas mis en question. C'est ainsi le budget de l'Etat qui décide du taux des cotisations et qui comble les déficits sociaux. L'introduction de la CSG, puis du RDS, en complément des cotisations sociales, correspondait encore à ce type de compromis.
Toutefois, le basculement des cotisations salariales vers une CSG élargie relève d'une logique de fiscalisation progressive du financement des dépenses maladies. Certains auteurs (Sterdyniak et Villa, 1998) proposent dans cette direction de maintenir une assiette salaire pour le financement de l'assurance-chômage et des retraites, mais de fiscaliser progressivement le financement des dépenses familiales et maladies relevant d'une logique universelle.
1.2. Le débat économique ou la nature des transformations de l'économie
Deux ensembles d'arguments économiques peuvent respectivement être distingués, à l'appui des deux principaux types de réformes proposées :
- L'allégement des cotisations sociales sur les bas salaires.
- La prise en compte des stratégies d'entreprises en matière d'emploi au regard de leur situation comptable.
Le premier ensemble d'arguments s'inscrit partiellement dans le cadre de l'interprétation orthodoxe des causes du chômage d'équilibre, exposée en première partie de ce rapport en ce qui concerne les fondements des mesures de réduction du coût du travail.
Le deuxième ensemble d'arguments tient compte du changement structurel qui a présidé à la modification de la norme de la répartition des revenus en faveur des profits. Ce changement structurel se matérialise par le recouvrement de l'autonomie financière des entreprises dans un univers économique incertain où l'innovation industrielle dans la sphère réelle est devenue risquée, d'où un ralentissement des taux d'investissements et de croissance et une montée de l'épargne financière spéculative. Cette analyse, que nous développerons, n'est que partiellement sous-jacente aux propositions du rapport Chadelat.
La proposition du rapport Malinvaud de réduire encore les cotisations patronales sur les bas salaires s'inscrit dans la lignée des hypothèses fondant le premier ensemble d'arguments.
Cette proposition repose sur le diagnostic suivant : le chômage d'équilibre s'explique essentiellement par la structure des coûts relatifs de production tandis que la croissance dépend des capacités d'innovation des entreprises. Ainsi, le chômage des non-qualifiés est-il dû à un coût du travail excessif qu'il convient de réduire. Toute réforme qui préserve la part des profits dans la valeur ajoutée, réputée nécessaire pour assurer le dynamisme de l'investissement, et réduit le coût relatif du travail non-qualifié assure sur le long terme une dynamique soutenue de croissance et d'emploi.
Cette proposition perd de son efficacité si les deux hypothèses-clés qui fondent son diagnostic sont invalidées. Premièrement, les effets d'une baisse du coût relatif du travail non-qualifié sur l'emploi ne sont pas indiscutables. Deuxièmement, le rétablissement de la part des profits dans la valeur ajoutée ne s'est pas matérialisé par un boom des investissements et des innovations, a-fortiori parce que la réaction des entreprises est hétérogène.
Une analyse plus approfondie des comportements des entreprises et des traits du régime de croissance macro-économique qui caractérise l'économie française est alors nécessaire. Elle s'écarte des interprétations orthodoxes des causes de la persistance du chômage d'équilibre. Elle débouche sur un diagnostic et des recommandations différentes de celles du rapport Malinvaud.
1.2.1. L'économie française, ses entreprises, l'emploi
La santé financière de l'économie française diffère radicalement de celle du début des années quatre-vingts. Globalement, la situation financière des entreprises est maintenant rétablie. Les entreprises sont désormais désendettées, aussi bien les grandes entreprises que les PME (Tableau 31). Leur taux d'autofinancement dépassent 110 %. La part des profits dans la valeur ajoutée a gagné onze points depuis 1984, date à laquelle les politiques salariales du secteur public ont donné le signal d'une désindexation des salaires sur les prix qui s'est propagée dans l'ensemble de l'économie. Le coût du travail évolue désormais à un rythme inférieur à celui des gains de productivité et des prix et la flexibilité de l'emploi s'est accrue comme l'indiquent les travaux du CSERC. La cause essentielle du chômage ne tient donc plus dans les facteurs d'offre, ni dans la rigidité du marché du travail. sur la dernière décennie, l'économie française est caractérisée par une situation de croissance inférieure à son taux potentiel en raison de la faiblesse des taux d'investissement et d'une consommation longtemps atone. Cette croissance ralentie est faiblement inflationniste, mais porteuse d'une épargne excédentaire, d'un déficit mécanique de recettes fiscales et d'un chômage de masse persistant. L'incertitude qui règne sur l'ensemble des marchés n'est pas pour rien dans la morosité des anticipations des entreprises et des ménages, comme l'indique la montée historique des taux d'épargne. Ce phénomène traduit la constitution de la part des entreprises et des ménages d'encaisses de précaution ou de spéculation pour faire face à un avenir incertain.
Dès lors, les profits d'exploitation auraient pu constituer la source d'innovations plaçant la France sur une trajectoire de "Performance globale", comme le préconisait le rapport Gandois. Non seulement les monographies d'entreprises existantes (voir notamment celles présentées au chapitre suivant) concluent généralement à la prédominance de logiques de valorisation des fonds propres sur le très court terme, mais surtout les taux d'investissement demeurent faibles au plan macro-économique, tandis que se consolide la financiarisation, c'est-à-dire la part des activités financières dans les activités des entreprises.
Là se trouve sans doute la principale mutation des deux dernières décennies. C'est moins la "révolution informationnelle" 72 ( * ) , provoquant un nouveau clivage entre les qualifiés et les non-qualifiés qui est à l'origine du "chômage structurel" des non-qualifié que la modification de la norme de résultat dominante prise pour référence pour sanctionner les performances des entreprises qui caractérise les évolutions de l'économie européenne. Cette norme est directement liée aux objectifs fixés aux entreprises par les actionnaires, dont la place est autrement plus grande que durant les trente glorieuses. Autrefois financées par endettement auprès des banques, les entreprises désendettées s'engagent désormais dans des stratégies de croissance financière dont le centre de gravité se situe dans la sanction qu'exercent les marchés financiers. Dans une situation de croissance européenne ralentie, réduisant les carnets de commande des entreprises, l'objectif de la valorisation des fonds propre se matérialise inévitablement par un ajustement à la baisse de la part des salaires dans la valeur ajoutée.
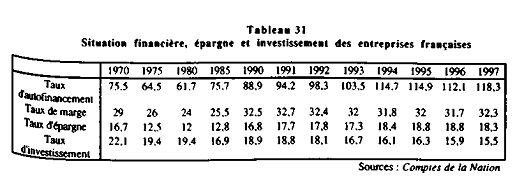
L'évolution parallèle des taux de marge et des taux d'épargne indique que les profits ont alimenté en grande partie l'activité financière des entreprises. L'on retrouve ce phénomène structurel dans l'analyse de la structure de la balance des paiements française. En 1980, les transactions courantes représentaient 71,1 % des flux financiers portés au crédit de la balance des paiements alors que les mouvements de capitaux n'en représentaient que 28,8 %. En 1996, les transactions courantes ne représentent plus que 14,8 % de ces flux alors que les mouvements de capitaux en représentent 85,2 % .
Les profits restaurés n'ont donc pas alimenté de façon significative l'investissement durant la décennie passée, si bien que l'emploi a stagné et la croissance s'est positionnée à un rythme annuel moyen très inférieur à son taux potentiel 73 ( * ) . Les profits ont au contraire été le support d'une financiarisation accrue des entreprises et de stratégies de croissance externe, se traduisant par des fusions-acquisitions, dont les conséquences sur l'emploi ont été parfois néfastes dans un contexte de débouchés en contraction sur les marchés. Nombre d'entreprises ont alors cherché à réduire leur masse salariale (les salaires et l'emploi) pour afficher des résultats nets en progression, conformément aux objectifs requis par leurs actionnaires.
Dans ce contexte, le mode de financement de la protection sociale ne fait qu'amplifier la tendance au déplacement du partage des revenus en faveur des profits. Les entreprises sont d'autant plus poussées à comprimer leur masse salariale que le financement de la protection sociale est assis sur les salaires (le travail est alors plus taxé que le capital et les profits).
1.2.2. Le rôle des politiques publiques de l'emploi
Cela a été dit, les objectifs des politiques actives de l'emploi ont oscillé dans la période récente entre les mesures d'ordre général et les mesures ciblées. Il est abusif d'opposer les objectifs de ces deux ensembles de mesures car ils sont en large partie complémentaires.
Encore faut-il que le diagnostic qui fonde le choix de chaque mesure soit fondé. Or l'apparente inefficacité de l'un ou de l'autre type de mesure peut être dû à une représentation erronée de la réalité économique. L'objet de cette dernière partie était de se centrer sur les mesures d'ordre général que le gouvernement entend mettre en oeuvre.
Dans le contexte structurel analysé ci-dessus, il est clair que les travailleurs les moins qualifiés (les moins diplômés et dotés d'une faible expérience) sont les plus fragilisés dans la file d'attente qui se forme alors. Des mesures ciblées existantes, exposées en première partie de ce rapport, s'avèrent certes nécessaires. Mais notre diagnostic est fondamentalement différent de celui qui a trop souvent été évoqué : celui qui théorise que le changement de la nature du travail aurait engendré un clivage entre les inclus, appelés dans les "nouvelles théories du marché du travail" (Perrot, 1992 ; Lindbeck et Snower, 1986) les insiders, et les exclus, nommés les outsiders.
On débouche à l'évidence sur des recommandations d'une autre nature lorsque l'on aborde le contenu des mesures d'ordre général : le problème est alors moins de réduire le coût du travail non-qualifié 74 ( * ) pour encourager les employeurs à recruter du travail non-qualifié que de chercher à infléchir la répartition et l'utilisation du surplus économique pour stimuler les innovations, l'investissement et l'emploi. Au surplus, même si le diagnostic (à notre sens erroné) d'un clivage technologique était validé, la mesure appropriée ne serait-elle pas d'aménager des filières d'entrée vers l'emploi qualifié et non de stimuler l'emploi non-qualifié ?
L'emploi n'est évidemment pas l'objectif naturel d'entreprises soumises à de tels critères de maximisation du résultat net. Dans ce nouveau contexte structurel, différent de celui des décennies précédentes, il revient par contre aux pouvoirs publics d'assurer un environnement propice à la création d'emplois, ne serait-ce qu'en assurant une croissance la plus proche possible de son taux potentiel, ce qui permet d'accroître les débouchés (les carnets de commande) et donc l'emploi des entreprises restructurées. Ceci passe évidemment par un réglage macro-économique adéquat de la politique monétaire et de la politique budgétaire dont la qualité permettra ou non le soutien à la croissance à moyen terme. Ce facteur est d'importance. Une croissance soutenue de 3,2 % a permis ne serait-ce que la création de 350 000 emplois en 1998. C'est pourquoi il paraît erroné, dans les modèles de représentation de l'économie, de raisonner à croissance inchangée à long terme, comme le fait le rapport Malinvaud. Dans les simulations que nous présenterons, tout en conservant les hypothèses de comportement des individus utilisés dans le modèle Malinvaud, notre modèle tiendra compte de l'impact des fluctuations de la croissance. A long terme l'emploi dépend alors également des variations possibles de la demande et de la production tout autant que de la structure des coûts de production. Ajoutons ici que la croissance française n'a jamais été aussi riche en emplois (elle l'est deux fois plus que durant les "Trente Glorieuses").
Il revient également aux pouvoirs publics d'infléchir la politique de l'emploi des entreprises par une fiscalité qui tiennent compte de l'hétérogénéité des situations financières et des stratégies en matière d'emploi. Il s'agit alors de stimuler les entreprises qui utilisent leurs profits pour l'investissement, l'innovation et l'emploi et mettre à contribution les autres pour le compte de la solidarité sociale ou nationale. En effet, malgré les tendances générales mises en exergue ci-dessus, la situation financière et les logiques de court-long terme des entreprises sont loin d'être homogènes, notamment à l'égard de leurs politiques de gestion de l'emploi.
Deux ensembles de propositions recherchant cet objectif peuvent être répertoriés : changer d'assiette pour tenir compte de la valeur ajoutée ou des profits bruts, conserver l'assiette salaire mais moduler les cotisations en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Ces propositions sont successivement détaillées, après avoir rappelé la recommandation du rapport Malinvaud, plus classique à l'égard de la politique de l'emploi française de la dernière décennie ; cette recommandation s'inscrit dans la lignée des mesures d'allégement du coût relatif du travail sans modification du partage salaire-profit
2. L'éventail des propositions de réforme du financement de la protection sociale
2.1. Réduire le coût du travail non qualifié
La proposition faite par le rapport Malinvaud est une nouvelle réduction des cotisations sociales sur les bas salaires. Elle serait financée par une majoration des cotisations sur les hauts salaires. Les cotisations patronales seraient allégées jusqu'à deux fois le SMIC (au lieu de 1,3 fois actuellement) et accrues au-delà. Cette proposition est préférée à une baisse des cotisations, compensée par une hausse de la CSG ou de la TVA.
De nombreux travaux attirent l'attention sur la poursuite d'un tel "basculement" des cotisations sociales vers une CSG augmentée. En effet, une baisse des cotisations, compensée par une augmentation de la CSG alourdirait la charge relative du financement pesant sur les ménages : elle reviendrait à réaliser un transfert des ménages vers les entreprises. Sterdyniak et Villa (1998) soulignent à ce propos que "ce transfert provoquerait à coup sûr une chute de la consommation ; par contre, son impact sur l'investissement n'est pas assuré dans la mesure où les entreprises manquent actuellement plus de demande que de profit. Il provoquerait une baisse des coûts unitaires, donc des gains de compétitivité mais la France n'a guère besoin d'en rechercher alors qu'elle a déjà un excédent commercial important : la généralisation de cette stratégie en Europe enfoncerait encore la zone de stagnation, par manque de demande. La situation financière actuelle des entreprises est telle qu'il n'y a plus besoin d'augmenter la part des profits dans la valeur ajoutée (p. 167).
La proposition Malinvaud s'inscrit pour sa part dans la lignée des mesures d'ordre général visant à réduire le coût du travail pour réduire le taux naturel de chômage mises en oeuvre tout au long de la présente décennie. L'objectif visé est un effet de substitution décrit par la théorie néo-classique de la demande de travail. En considérant que le chômage structurel de masse touche avant tout les travailleurs non-qualifiés, la baisse du coût relatif du travail non-qualifié est censée modifier le comportement des entreprises dont on suppose qu'elles sont identiques (elles sont supposées avoir la même fonction de production et la même demande de travail). Rationnelles, les entreprises modifient alors leur combinaison productive en substituant du travail non-qualifié, dont le coût relatif s'est réduit, au capital et au travail qualifié, dont le coût relatif s'est élevé.
L'ambition du rapport était cependant de s'inscrire dans un cadre théorique plus large que celui des théories orthodoxes du chômage d'équilibre :
" la compétitivité des productions déterminera la profitabilité et les profits des entreprises : la gestion financière et réglementaire du gouvernement favorisera plus ou moins l'adaptation des entreprises et la productivité des salariés ; les marges dégagées sur les ventes pousseront plus ou moins la croissance des capacités de production ; les coûts relatifs influenceront la structure du système productif national et la combinaison agrégée des facteurs ; la conjoncture de la demande globale, tantôt favorable tantôt défavorable, modulera le contexte dans lequel ces divers facteurs opèreront " (Malinvaud. 1998, p. 35).
L'auteur voulait notamment tenir compte à la fois de la structure des coûts de production, objet de prédilection des explications en termes de chômage d'équilibre, et des facteurs influençant la croissance. Parmi ces derniers, on peut regretter que le rapport ne relie la croissance qu'aux perspectives de profit, réputées récompenser le risque d'entreprendre, selon une perspective schumpétérienne assumée (Malinvaud, 1998, ibid.), et délaisse l'analyse keynésienne des causes de l'instabilité de la croissance européenne. L'ensemble des facteurs expliquant la faiblesse structurelle de la croissance européenne, que nous prendrons en compte ultérieurement, n'est en effet pas intégré dans l'analyse.
Le diagnostic économique qu'établit le rapport Malinvaud repose alors sur deux points-clés :
- Dans leur choix de combinaison productive, les entreprises sont sensibles au coût relatif des facteurs, conformément aux hypothèses néo-classiques.
- L'investissement et l'innovation jouent un rôle central dans la croissance. Ils dépendent en grande partie de la récompense du risque que représente le profit
Le coeur de la proposition du rapport Malinvaud consiste par conséquent à réduire le coût du travail non-qualifié sans modifier l'évolution acquise de la répartition salaire-profit dans chaque entreprise pour ne pas détériorer l'investissement.
Il en résulte que toute baisse du coût relatif du travail non-qualifié est censée susciter des créations d'emplois à la mesure des travailleurs non-qualifiés. Tout prélèvement alourdissant le coût du capital et tout prélèvement sur le profit pur jouent à long terme contre l'innovation technologique et l'investissement.
L'état des lieux des études ayant procédé à l'évaluation de ces mesures a été exposé en deuxième partie de ce rapport. Le rapport Malinvaud prévient néanmoins que les effets seront "lents à se manifester" et propose une projection de long terme. Le modèle utilisé par Malinvaud pour aboutir à cette conclusion est controversé (Sterdyniak et Villa, 1998). Il sera discuté ultérieurement. Rappelons ici que les travaux empiriques exposés en deuxième partie ne valident pas de façon formelle les hypothèses permettant de construire une théorie générale du chômage ayant pour cause essentielle l'excès du coût du travail qualifié et non-qualifié.
Nous avons vu que les mesures d'ordre général de réduction du coût du travail (hors mesures ciblées) coûtent quelques quarante milliards au budget de l'Etat, avec des effets controversés sur l'emploi.
Pour être efficace, la mesure Malinvaud suppose deux conditions :
- Qu'il existe un excès de demande de travail qualifié, ce qui n'est pas le cas.
- Que l'élasticité ( i.e . la sensibilité) de la demande de travail à son coût soit forte, ce qui nous l'avons vu au chapitre 3, n'est pas le cas en France, tant pour le travail qualifié que le travail non-qualifié.
Dans la mesure où elles ne distinguent pas la situation des différentes entreprises, mais sont accordées selon le type de main d'oeuvre utilisée, ces dispositifs sont porteurs d'importants effets pervers.
Leur principal inconvénient est d'ignorer la pluralité des logiques d'entreprises. Ces mesures risquent donc d'être accordées sans tenir compte des besoins financiers réels des entreprises et sont susceptibles de provoquer certains effets pervers. En particulier, trois effets pervers (parmi les quarante effets possible des aides à l'emploi exposées en deuxième partie) sont susceptibles de se produire.
Les effets d'aubaine se produisent lorsqu'une entreprise qui bénéficie d'un dispositif aurait de toute façon procédé aux embauches correspondantes. Les flux financiers accordés aboutissent alors à améliorer la situation financière de l'entreprise sans que l'impact sur l'emploi soit évident.
Les effets de substitution se produisent lorsqu'une entreprise substitue le type de main d'oeuvre faisant l'objet du dispositif à un autre type de main d'oeuvre avec un effet neutre sur l'emploi. Seule, la structure de l'emploi se modifie, mais au détriment de l'emploi qualifié, si les dispositifs allègent le coût du travail non-qualifié et alourdissent le coût du travail qualifié.
Enfin les effets de seuil se produisent inévitablement : au-delà du niveau de salaire faisant l'objet de l'exonération, le coût du travail s'alourdit considérablement. Ceci risque d'entretenir une "trappe à bas salaires". Puisque la mesure favorise les embauches à bas salaires (en raison de l'aubaine qu'elle représente et de l'effet de substitution qu'elle engendre), toute embauche (ou toute promotion) supérieure au seuil défini (1,3 fois le SMIC aujourd'hui, deux fois le SMIC chez Malinvaud) devient si coûteuse que l'entreprise a intérêt à ne verser que des salaires inférieurs à ce seuil.
C'est pourquoi une réflexion s'est développée autour de l'élaboration d'une assiette de prélèvements sociaux qui tienne compte à la fois de la situation financière des entreprises et de leur attitude vis-à-vis de l'emploi. Elle a non seulement fait l'objet d'une réflexion de la part des pouvoirs publics, dans le cadre du rapport Chadelat (1997), mais se développe depuis longtemps déjà parmi les acteurs syndicaux, mutualistes et politiques.
2.2 Prendre en compte la stratégie en matière d'emploi et la situation comptable des entreprises
Le débat sur la recherche d'un mode de financement plus favorable à l'emploi que celui reposant sur l'actuelle assiette salaire étendue par la CSG et le RDS a été relancé à l'occasion d'un rapport commandé à Jean-François Chadelat par le premier ministre au lendemain de sa nomination en juin 1997.
L'argument central développé par le rapport Chadelat n'est au fond pas fondamentalement différent de celui du rapport Malinvaud, ni de celui des partisans d'une baisse du coût relatif du travail par rapport au coût du capital, " le système français de sécurité sociale reste aujourd'hui très majoritairement financé par des cotisations assises sur les revenus du travail, et principalement sur les salaires. En conséquence, il pèse sur le coût du travail et pénalise donc l'emploi, particulièrement l'emploi non-qualifié qui est le plus sensible et le plus touché " (Chadelat, 1997. p. 3). Le diagnostic de Sterdyniak et Villa (1998) n'est pas substantiellement différent S'ils reconnaissent, nous l'avons vu ci-dessus (en 2.1 ). que la part des profits dans la valeur ajoutée est sans doute excessive, ils se rallient néanmoins à l'hypothèse selon laquelle il existerait un problème de coût du travail non-qualifié. Ils défendent l'idée qu'une réforme devrait avoir pour objectif de modifier la structure des coûts relatifs en faveur du travail sans modifier le profit pur moyen des entreprises Ils proposent alors une solution intermédiaire, en l'occurrence le remplacement des cotisations employeurs maladie et famille par une contribution sur la valeur ajoutée exonérant la partie des salaires inférieure au SMIC.
Si tel était le diagnostic, somme toute similaire à celui du rapport Malinvaud, Edmond Malinvaud aurait raison de conclure qu'une baisse générale des cotisations sociales sur les bas salaires est plus simple à mettre en place. Elle est plus lisible et ne modifie pas le partage des revenus au détriment des profits.
Si l'on adopte le diagnostic économique que nous avons établi, le motif central justifiant une réforme des cotisations patronales est ailleurs. Certes, globalement, les changements de mode de financement proposés le rapport Chadelat auraient pour effet, selon les cas envisagés, de modifier plus ou moins la structure des coûts relatifs (c'est-à-dire de provoquer une baisse du coût du travail par rapport au coût du capital). Mais le présent rapport a soutenu que la cause essentielle du chômage tenait moins dans des rigidités du marché du travail (désormais estompées), notamment celles pesant sur le coût du travail, que dans une norme de partage des revenus s'effectuant au détriment de la croissance et de l'emploi. Pour y remédier, les pouvoirs publics disposent de plusieurs instruments pour déplacer le curseur du partage des revenus. L'inflexion du partage des revenus est en premier lieu du ressort de la politique salariale (la désindexation des salaires sur les prix a ainsi contribué au rétablissement des taux de marge), voire des mesures instaurant une nouvelle norme de temps de travail, point qui sera traité au chapitre suivant. Enfin, si problème de coût du travail il y a localement ou sectoriellement, il s'agit d'identifier les entreprises qui en sont victimes, ce que ne peut réaliser une mesure d'ordre général d'abaissement du coût du travail.
La fiscalité est alors un moyen, parmi d'autres, dont les pouvoirs publics doivent pouvoir se saisir pour infléchir la norme de répartition des revenus, en tenant compte de l'hétérogénéité des situations des entreprises. Ceci revient à procéder à un transfert visant à subventionner les entreprises dynamiques en matière d'emploi en ponctionnant les entreprises dont la part des profits dans la valeur ajoutée est excessive.
Dans cette perspective, la réforme du financement de la protection sociale doit avant tout viser à moduler la répartition de la charge du financement de la sécurité sociale entre les entreprises selon leur stratégie en matière d'emploi et leur situation comptable plutôt qu'à accroître la part globale du financement par les entreprises. Ce principe n'exclut évidemment pas un débat éventuel sur la part relative de chaque catégorie de revenu dans le financement futur de la protection sociale.
Les propositions du rapport Chadelat méritent alors d'être étudiées à cette aune, si l'on considère que l'effet d'une réflexion en faveur d'une assiette valeur ajoutée est avant tout d'infléchir la répartition des revenus entre salaire et profit autant que de réduire le coût relatif capital-travail selon la politique de l'entreprise. Les avantages et les inconvénients seront présentés, pour chaque type de proposition.
2.2.1. Les assiettes valeur ajoutée et dérivées
L'assiette Valeur Ajoutée
Le premier type de proposition consiste à modifier radicalement l'assiette des cotisations patronales en substituant à l'assiette salaire une assiette reposant sur la valeur ajoutée des entreprises. Le rapport Chadelat (1997) proposait ainsi de retenir la définition fiscale de la valeur ajoutée utilisée pour le plafonnement de la taxe professionnelle (article 1647 B du code général des impôts) : "l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers". Il préconisait le transfert progressif des 12,8 points de cotisations patronales d'assurance maladie sur une nouvelle contribution assise sur la valeur ajoutée. Ce transfert se traduit par une taxe de l'ordre de 9,2 %, appliquée à une telle assiette pour chaque entreprise. C'est ce que nécessiterait la suppression de l'ensemble des cotisations employeurs afin de prélever 440 milliards.
Le champ d'application serait, dans un premier temps, limité au secteur marchand 75 ( * ) . Une telle assiette équivaudrait à instaurer une sorte de CSG-entreprise assise sur la valeur ajoutée. Des assiettes dérivées étaient également à l'étude, ayant pour objectif de construire une assiette de prélèvements sociaux en fonction du profit (brut ou net) d'exploitation des entreprises.
L'assiette valeur ajoutée posséderait selon le rapport Chadelat les avantages suivants :
- Elle évolue, selon le rapport Chadelat, au même rythme que le PIB, c'est-à-dire la somme des valeurs ajoutées, alors que l'assiette salaire tend à diminuer à raison de la diminution de la part des salaires dans la valeur ajoutée. L'assiette valeur ajoutée est donc plus appropriée à l'objectif d'une régulation des finances sociales. Le rapport Malinvaud défend au contraire l'hypothèse d'une stabilité à long terme de la part des revenus dans la valeur ajoutée et soutient que la valeur ajoutée subira des fluctuations conjoncturelles plus importantes que celles affectant la masse salariale. Sur la période récente, le rapport Chadelat ne fait qu'établir le constat que ne rejette pas le rapport Malinvaud de l'évolution à la baisse de la part des salaires dans le revenu national durant les quinze dernières années. Ajoutons qu'une telle assiette fournirait une solution de rechange au cas où certains partenaires sociaux renonceraient à la gestion partiaire de la sécurité sociale 76 ( * ) . Il reviendrait alors aux pouvoirs publics de définir une nouvelle assiette fiscale appropriée.
Quant aux effets sur l'emploi :
- A court terme, l'effet baisse du coût relatif du travail joue : en se substituant à l'assiette salaire (complètement ou partiellement lorsqu'une baisse des cotisations sociales est compensée par une contribution sur la valeur ajoutée), l'assiette VA réduit le poids des cotisations sociales dans le coût du travail et ralentit la substitution du capital au travail.
- A moyen-long terme, ce n'est pas tant un effet coût relatif qui joue que la répartition de la charge de financement de la sécurité sociale parmi les entreprises. L'assiette VA répartit en effet la charge de financement de la sécurité sociale sur les deux facteurs de production, travail et capital, en proportion de leur contribution à la formation de la valeur ajoutée. C'est donc la répartition de la charge parmi les entreprises qui est modifiée et non pas la charge globale des entreprises : la réforme provoque un transfert des entreprises fortement capitalistiques vers les entreprises riches en main d'oeuvre. Au plan macro-économique, la rentabilité des entreprises n'est pas touchée. A court terme, la taxation supplémentaire du capital (173 milliards) est compensée par la réduction de la taxation du travail de telle sorte que la charge totale des entreprises n'est pas affectée. A moyen terme, le taux de profit après impôt est inchangé, mais les entreprises utilisent plus de travail que de capital , (Sterdyniak et Villa, 1998. p. 175). Cette hypothèse de neutralité vis-à-vis de la rentabilité des entreprises, défendue par Sterdyniak et Villa (1998. p. 175), est contestée dans le rapport Malinvaud au titre des inconvénients majeurs de l'assiette valeur ajoutée.
Les inconvénients de l'assiette valeur ajoutée et de ses dérivées sont les suivants :
- Le rapport Malinvaud souligne tout d'abord que l'assiette valeur ajoutée aurait en effet l'inconvénient de ne pas distinguer la dépréciation du capital, le coût d'usage du capital proprement dit et le profit pur.
- Cette assiette risque de peser sur l'investissement, ce que souligne surtout le rapport Malinvaud. Dans la mesure où se produit un transfert des entreprises capitalistiques vers les entreprises utilisant beaucoup de travail, un tel transfert est susceptible de freiner l'innovation. Ainsi. " du fait du prélèvement qu'il introduirait sur le profit hors intérêt du capital, le recours à une assiette valeur ajoutée risquerait d'affecter défavorablement le dynamisme des entreprises françaises, surtout celui des plus innovantes "(Malinvaud, 1998, p 52). Ce problème est néanmoins atténué si l'on considère le rétablissement de la situation financière des entreprises, d'autant que le rapport Malinvaud ajoute immédiatement après : " Nous manquons malheureusement de base pour avoir une idée grossière de cet effet" (ibid.).
- L'assiette valeur ajoutée serait pénalisante pour les secteurs soumis à la concurrence internationale et tentés par les "délocalisations". Ce que reconnaît le rapport Chadelat. Au sens strict, les délocalisations, entendues comme investissements directs en direction des Nouveaux Pays Industrialisés, ne représentent néanmoins que 3 % des investissements français à l'étranger.
- Elle ferait l'objet d'un risque d'évasion fiscale plus importante que l'assiette salaire, plus facilement contrôlable. Ce risque est cependant inhérent à tout prélèvement fiscal. Le rapport Chadelat propose que le recouvrement de cet impôt soit confié aux services fiscaux, mieux armés que l'URSSAF pour contrôler la valeur ajoutée des entreprises.
Selon le rapport Chadelat, les inconvénients de l'assiette VA seraient amplifiés pour les assiettes EBE ou bénéfice fiscal (c'est-à-dire l'assiette de l'impôt sur les sociétés).
Les assiettes dérivées de la Valeur Ajoutée
Une assiette de type Excédent Brut d'Exploitation (Chiffre d'Affaire - Masse Salariale) est souvent défendue parce qu'elle reviendrait à taxer directement le montant du profit brut de l'entreprise : les entreprises dont la part de la masse salariale dans le chiffre d'affaire est importante seraient moins mises à contribution (autrement dit celles qui ont utilisé leurs profits pour augmenter les salaires et/ou l'emploi).
Cette assiette possède les mêmes avantages que l'assiette valeur ajoutée.
Elle engendre un effet supérieur sur l'emploi en abaissant de coût relatif du travail pour les entreprises riches en main d'oeuvre. A la différence de l'assiette valeur ajoutée qui est relativement neutre à moyen-long terme quant à la structure des coûts de production, l'assiette EBE alourdirait le coût du capital par rapport au coût du travail, ce qui stimule la demande de travail au détriment de la demande de capital.
Cette réforme aurait pour effet de taxer directement l'une des sources des revenus du capital. en l'occurrence les profits d'exploitation non investis dans la sphère réelle et alimentant l'épargne financière des entreprises. Les revenus financiers à proprement parler ne figurent cependant pas dans le compte de résultat des entreprises. Les intégrer dans l'assiette de financement de la protection sociale supposerait d'élargir l'assiette actuelle à cette catégorie de revenus.
Les inconvénients de cette assiette sont les suivants :
- Sa taille est plus réduite que l'assiette valeur ajoutée. Par conséquent le taux facial de contribution devrait être plus élevé, ce qui accroît le risque d'évasion fiscale. Pour faire apparaître un taux de contribution de 9.2% (celui prévu dans le cas d'une assiette valeur ajoutée), il faudrait maintenir une partie des cotisations employeurs assises sur les salaires : une taxe de 9.2 % sur l'EBE pourrait être mise en place avec une réduction de 18,2 à 11,1 % des cotisations employeurs. Tout comme dans le cas d'une contribution sur la valeur ajoutée, 173 milliards seraient alors prélevés sur le capital au lieu de peser sur le travail.
- Elle taxe indifféremment les entreprises qui, à profit brut équivalent, utilisent leurs surplus à des fins différentes, les unes pour l'investissement réel, les autres pour la croissance financière et la spéculation.
Un indicateur de type Résultat net (tel que le bénéfice fiscal) permettrait de donner une estimation des investissements (immobilisations et amortissement) réalisés au cours de l'exercice. Elle constitue la base de l'impôt sur les sociétés. Sa mise en oeuvre reviendrait à substituer aux cotisations sociales un relèvement de l'IS. Elle n'intègre cependant pas les revenus financiers des entreprises, puisqu'ils ne figurent pas dans le compte de résultat. Une telle assiette, critiquée par Malinvaud, pour les raisons indiquées ci-dessus, est aussi écartée par le rapport Chadelat parce qu'elle amplifie, tout comme l'assiette EBE, les inconvénients de l'assiette valeur ajoutée. Cette assiette subirait, selon l'auteur, les mêmes inconvénients que ceux de l'assiette valeur ajoutée. Elle est beaucoup plus fluctuante et difficile à prévoir. En raison de l'étroitesse d'une telle assiette (assimilable, rappelons-le à l'assiette de l'impôt sur les sociétés), le rapport Malinvaud souligne qu'une seule baisse de 3% des cotisations sociales devra être compensée par un relèvement de 20 points du prélèvement sur l'assiette IS. Malinvaud ajoute qu'en raison du prélèvement introduit sur le profit hors intérêt du capital, le recours à l'assiette valeur ajoutée risquerait d'affecter le dynamisme des entreprises les plus innovantes en alourdissant le coût du capital. D'autre part, l'effet serait lent (tout comme, cependant, dans le cas d'une réduction des cotisations sur les bas salaires) et ne serait bénéfique que pour une partie des entreprises, celles dont les profits ne seraient pas affectés.
Rappelons le néanmoins, au-delà des difficultés techniques inhérentes à tout changement d'assiette, les arguments du rapport Malinvaud tombent si le problème macro-économique fondamental n'est pas une insuffisance de profitabilité des entreprises, mais une norme de répartition des revenus excessivement favorables, dans certains cas, à des profits d'exploitation non nécessairement réinvestis dans la sphère réelle.
2.2.2. Moduler les cotisations patronales assises sur les salaires en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée
Le rapport Chadelat établit une deuxième proposition : conserver une assiette salaire, mais moduler les cotisations patronales en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée de chaque entreprise. Cette proposition revient à taxer les entreprises dont la part des profits est jugée excessive, à l'instar de l'assiette EBE. Elle en contourne toutefois certains inconvénients, techniques et économiques. Parmi les avantages économiques, le principal est que ce n'est pas directement le profit qui est taxé, mais la masse salariale des entreprises profitables qui ne créent pas d'emplois qui sont mis à contribution. La critique portant sur le risque de taxer les entreprises technologiquement innovantes tombe dans ce cas.
Trois modalités sont envisagées dans le rapport Chadelat (ibid.) :
- Une modulation nationale : un plancher de référence serait défini en prenant pour référence un ratio masse salariale/valeur ajoutée dont les valeurs serait comprise dans une fourchette définissant une plage neutre où le taux de cotisations resterait inchangé. En deçà de ce plancher, le taux de cotisation augmenterait progressivement jusqu'à un certain seuil (fixé à - 5% du ration de référence par le rapport Chadelat). Au delà de ce plancher, le taux de cotisation serait dégressif jusqu'à un seuil de + 5% du ratio de référence.
- Une modulation sectorielle : le ratio de référence serait défini par la moyenne du ratio de la part des salaires dans la valeur ajoutée du secteur.
Une modulation intertemporelle : le taux de cotisation augmenterait puis diminuerait selon l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée de chaque entreprise dans le temps.
L'inconvénient des deux premières modulation est qu'elles raisonnent en statique, c'est-à-dire un l'instant, sans tenir compte de la politique d'emploi de l'entreprise dans le temps. La deuxième assiette possède l'avantage sur la première de tenir compte des spécificités sectorielles de gestion de la main d'oeuvre. La troisième solution possède l'avantage de tenir compte de l'évolution de la part des salaires dans la valeur ajoutée dans le temps. De la sorte, une entreprise dont la part des profits est importante, mais qui les utilisent à la fois pour l'investissement et pour l'emploi, ne se verrait pas pénalisée.
Le rapport Chadelat privilégie la première solution. Elle ne présente pas de difficultés majeures de mise en pratique ; elle est beaucoup plus simple qu'un changement radical d'assiette. Ses avantages économiques sont de trois ordres :
- Le prélèvement augmente automatiquement pour les entreprises employant peu de main d'oeuvre.
- Le prélèvement est favorable à l'emploi. Les entreprises bénéficient d'une réduction de cotisations au-delà d'un certain niveau d'emploi, à valeur ajoutée constante.
- Les transferts de charges entre les entreprises sont plus limités que dans le cas d'une assiette valeur ajoutée. L'assiette valeur ajoutée modifie les contributions de toutes les entreprises, alors que la modulation ne touche que les entreprises les plus éloignées de la norme de référence.
Cette proposition a par ailleurs l'avantage de veiller à la préservation de la logique assurancielle, associée à l'assiette salaire, à laquelle certains syndicats sont attachés, tout en mettant à contribution les entreprises qui ont ajusté à la baisse la masse salariale sans taxer le profit des entreprises innovantes qui ont créé des emplois. Elle pourrait être assortie d'une extension de l'assiette de financement à d'autres catégories de revenus, tels les revenus financiers des entreprises, qui ne figurent pas dans le compte de résultat des entreprises.
2.2.3. Moduler les contributions sur la base d'une assiette valeur ajoutée ou dérivée
Cela a été souligné, le principal inconvénient économique des assiettes valeur ajoutée et dérivées de la valeur ajoutée est qu'elles ne permettent pas de distinguer les entreprises selon la nature de l'utilisation qu'elles font de leurs profits d'exploitation (par exemple selon qu'elles le convertissent en investissement ou qu'elles s'engagent dans des stratégies de croissance financière). Ces réformes risquent alors de ralentir l'investissement, en taxant involontairement les entreprises qui pourraient avoir l'intention d'utiliser leurs excédents d'exploitation pour l'investissement futur.
Un dernier scénario, inexploré dans le rapport Chadelat, pourrait être celui d'une modulation des contributions assises sur une assiette valeur ajoutée, plus large que l'assiette de l'IS, selon un ratio mesurant la part des salaires dans la valeur ajoutée de chaque entreprise. A côté des propriétés de l'assiette valeur ajoutée, la modulation introduit un élément de progressivité dans le prélèvement en fonction de la politique de l'emploi de la firme et non pas en fonction du montant total du profit brut réalisé. Les entreprises réalisant du profit et l'utilisant pour améliorer la situation de l'emploi bénéficieraient d'un taux de contribution plus faible que les autres. Une modulation des contributions sur la base d'une telle assiette éviterait les effets pervers, soulignés plus haut, quant à la contrainte que ferait peser sur les entreprises profitables innovantes un prélèvement non-modulé sur la base d'une telle assiette.
Le ratio de référence pourrait être le ratio masse salariale sur valeur ajoutée proposé ci-dessus par Chadelat pour le scénario modulation des cotisations patronales assises sur les salaires.
Pour évaluer rigoureusement l'efficacité comparée en termes d'emplois de chaque type de proposition, il faut alors procéder à des simulations tenant compte des effets de court terme et de long terme de chaque mesure.
3. Les simulations
Les simulations complètes des quatre propositions de réforme traitées ci-dessus sont présentées dans l'annexe mathématique jointe en fin de rapport qui présente les écritures mathématiques et étapes intermédiaires du raisonnement (annexe 7). La présentation qui suit propose un exposé pédagogique le plus simplifié possible des résultats de chacune d'elles.
3.1. La réduction des cotisations patronales : Les résultats d'un bouclage à partir du modèle de Malinvaud (modèle 1)
Nous reprenons le modèle de Malinvaud, en le complétant sur certains points, qui seront précisés au fur et à mesure de notre présentation. Au terme de cette modélisation, on aboutit à l'idée que l'effet d'une baisse du coût salarial sur l'emploi n'est pas nécessairement positif à long terme : le sens de l'effet analysable théoriquement dépend des hypothèses que l'on fait sur le financement des dépenses publiques.
Le modèle de Malinvaud comporte deux équations : l'une que l'on peut interpréter comme une équation d'offre de travail, l'autre que l'on peut analyser comme une équation de demande de travail. On suppose que l'économie est dans une situation keynésienne, où le niveau de production dépend de la demande. Les ménages offrent leur travail, en quantité croissante avec le salaire réel. Plus le salaire est élevé, plus l'offre de travail est importante dans l'économie. Les entreprises demandent une certaine quantité de travail, connaissant la demande anticipée : à production donnée, cette demande de travail est liée par une relation inverse au salaire réel. Lorsque celui-ci augmente, la demande de travail des entreprises diminue, et inversement. A long terme, c'est donc l'équilibre entre offre et demande de travail qui détermine le salaire réel. Ces comportements peuvent être représentés graphiquement de manière simple par deux courbes d'offre et de demande de travail, respectivement croissantes et décroissantes avec le salaire, dont l'intersection détermine le salaire et l'emploi d'équilibre. Soulignons ici que Malinvaud ne considère qu'une seule catégorie de travail ; il ne distingue pas le travail qualifié du travail non-qualifié. Ce n'est donc pas l'effet d'une baisse du coût du travail non-qualifié qu'il décrit dans le modèle mais celle d'une baisse du coût global du travail.
Dans ce cadre. Malinvaud obtient un effet positif sur l'emploi de la baisse du coût salarial Celle-ci peut s'interpréter comme une baisse des "charges des entreprises", i.e. des cotisations sociales. Cet effet s'explique de la manière suivante : la baisse du coût salarial entraîne un accroissement de la demande de travail des entreprises, qui accroît l'emploi. Pour un niveau de salaire donné, la demande de travail après baisse des cotisations est supérieure à la demande correspondant à la situation antérieure. Graphiquement, la courbe de demande de travail se déplace vers la droite. A l'équilibre de long terme, le salaire réel doit augmenter pour équilibrer l'offre et la demande sur le marché du travail, ce qui se traduit par une hausse de l'offre de travail.
Il est important de comprendre que cet effet favorable repose sur un raisonnement à production donnée, qui constitue une hypothèse restrictive. Lorsque l'on prend en compte les effets sur la production de la baisse des cotisations sociales, ce que ne fait que partiellement le rapport Malinvaud (il ne tient pas compte des variations à long terme de la demande), le résultat est différent.
Pour analyser ce type d'effets, et leur incidence sur les résultats de l'analyse théorique de l 'impact sur l'emploi de la baisse des charges, nous avons procédé à un bouclage simple, en , économie fermée. Le bouclage repose sur la relation d'égalité comptable entre offre et demande dans l'économie au niveau agrégé, soit l'égalité entre production d'une part consommation, investissement et dépenses publiques (comprenant les dépenses de protection sociale) d'autre part. La fonction de production utilisée est une fonction à deux facteurs substituables, capital et travail. L'hypothèse faite est que la consommation est composée de deux parties, l'une fonction du salaire, et la seconde fonction des autres revenus distribués dans l'économie. Ces revenus divers sont supposés égaux à une fraction de la production.
Dans ce cadre, nous avons repris le modèle de Malinvaud en levant la condition de production constante (c'est-à-dire en procédant au bouclage du modèle initial). Nous avons considéré deux hypothèses sur le niveau des dépenses publiques dans l'économie.
Suivant l'hypothèse 1, la dépense publique est égale à une fraction donnée du PIB : ceci revient à dire que le gouvernement fixe un objectif de dépenses en % du PIB, et que la dépense est financée par un taux de taxation fixe.
L'hypothèse 2 suppose que la dépense publique est financée par les cotisations sociales : si le montant de ces cotisations perçues décroît, la dépense publique diminue et vice-versa. Cette hypothèse paraît réaliste si l'on considère que l'un des objectifs du gouvernement est d'équilibrer les comptes sociaux. Dans le cadre de cette hypothèse, une variante privilégiée dans la simulation des trois propositions alternatives à celle du rapport Malinvaud est de considérer le maintien du niveau des dépenses publiques 77 ( * ) .
Les conclusions du modèle complété dépendent de l'hypothèse retenue pour la dépense publique. Rappelons que le raisonnement qui suit porte sur les conditions d'équilibre de long terme, en incluant les effets sur la production : c'est sur ce point que notre modélisation se distingue de celle du rapport Malinvaud.
Dans le premier cas (hypothèse 1), la baisse des cotisations patronales a un effet négatif sur l'emploi.
Ceci est une conséquence de la baisse de la productivité du travail. La baisse du coût relatif du travail non-qualifié provoque en effet une substitution travail capital et l'embauche de travailleurs à productivité marginale inférieure (dans l'hypothèse faite d'une fonction de production à facteurs substituables où la substitution d'un facteur à un autre se matérialise par une productivité marginale plus faible du facteur remplaçant).
Or, sur le long terme, la productivité du travail est une fonction du coût salarial "charges" incluses. En théorie, cela signifie que l'évolution des salaires suit l'évolution de la productivité. Mais cette relation est vraie également en sens inverse : l'évolution des salaires engendre l'évolution de la productivité. Ce phénomène est décrit par les théories du salaire d'efficience : des salaires élevés exercent un effet incitatif sur l'effort des travailleurs. Il peut également résulter des effets de structure (la baisse du salaire peut être liée à l'embauche de travailleurs à faible productivité).
Par conséquent, dans ce scénario, si l'on diminue les coût du travail en baissant les cotisations patronales sur les bas salaires, la productivité du travail baisse pour toutes les raisons qui viennent d'être indiquées, donc la production baisse.
Si la part des dépenses publiques est inchangée, la consommation des travailleurs doit diminuer (pour maintenir l'équilibre global de l'économie dans le modèle). L'explication est ici qu'il faut prélever sur les ménages l'équivalent du défaut de cotisation résultant de la réduction des cotisations sociales 78 ( * ) , ce qui exerce un effet dépressif sur la consommation Ceci se traduit, dans le cadre du modèle présenté précédemment, une baisse du salaire réel et de l'emploi d'équilibre.
Autrement dit, si l'objectif est le maintien des dépenses publiques, une "baisse des charges sociales" est inefficace pour stimuler l'emploi parce qu'elle nécessite une ponction sur le reste de l'économie pour financer la réduction des cotisations patronales .
Dans le second cas (hypothèse 2), la demande dépend également des cotisations sociales via la dépense publique. Mais, dans l'hypothèse où les dépenses dépendent strictement des prélèvements effectués, une baisse des cotisations engendre une baisse des dépenses, donc de la demande (puisque l'on n'entend pas maintenir ici la part des dépenses dans le PIB). La baisse du coût salarial entraîne le même effet que précédemment, baisse de la productivité, et donc de la production. Mais du fait de l'hypothèse sur la réduction des dépenses publiques, une baisse des cotisations sociales fait baisser la demande par travailleur plus que la productivité du travail, donc plus que la baisse de l'offre. Il en résulte une insuffisance de demande. Dans ce cas, pour équilibrer l'offre et la demande, il faut augmenter les salaires réels, donc l'emploi. La baisse des charges salariales, sous cette hypothèse, a donc un effet positif sur l'emploi.
Autrement dit, ce scénario est celui par lequel les autorités privilégient la réduction des "charges sociales" et des dépenses publiques. Pour être efficace en termes d'emplois, il suppose que les entreprises augmentent les salaires pour soutenir la consommation (face à une demande défaillante du fait de la réduction des dépenses).
On peut noter que les conclusions obtenues dans ce cadre s'appliquent, de manière similaire, au cas de la récente réforme de la taxe professionnelle : la part salariale de la taxe professionnelle est une cotisation proportionnelle à la masse salariale. Sa suppression a donc, analytiquement, les mêmes effets macroéconomiques qu'une baisse des cotisations sociales : l'impact a long terme de la réforme de la taxe professionnelle est ambigu, et dépend de l'hypothèse retenue sur le financement de la dépense publique.
Dans la suite de notre présentation de l'impact des hypothèses de réforme du financement de la protection sociale, nous retrouverons les mêmes enchaînements macroéconomiques de long terme que ceux qui viennent d'être décrits dans cette section : nous nous référerons donc, dans la suite du texte, à la présentation faite ci-dessus, sans détailler les raisonnements sous-jacents.
3.2. Mise en oeuvre d'une assiette assise sur la valeur ajoutée (modèle 2)
La création dune contribution sur la valeur ajoutée globale (CVA) constitue une des principales voies de réforme du financement de la protection sociale (Chadelat, 1997, Sterdyniak. Villa, 1998).
Une propriété essentielle de la contribution valeur ajoutée est sa neutralité vis-à-vis de la combinaison des facteurs de production : elle ne modifie pas le coût relatif capital/travail, puisque le coût de chacun des deux facteurs est alors augmenté d'un même montant. L'effet coût relatif, dans ce cadre, survient seulement au moment du transfert des cotisations assises sur les salaires vers une contribution valeur ajoutée globale.
L'introduction de cette nouvelle contribution modifie donc peu le modèle présenté à la section 1.
Dans le cas du premier bouclage (hypothèse 1, la dépense publique est égale à une fraction donnée du PIB), l'équilibre comptable macroéconomique de long terme est identique à celui du modèle précédent. En effet, la demande de travail et de capital des entreprises, et donc la production, ne sont pas modifiés par l'introduction de la contribution sur la valeur ajoutée, en l'absence d'effet sur le coût relatif des facteurs. En conséquence, une réforme qui consisterait à abaisser le taux de cotisation sur les salaires en transférant cette taxation sur la valeur ajoutée globale aura les mêmes effets négatifs que dans le modèle de Malinvaud bouclé, c'est-à-dire une baisse du salaire réel et de l'emploi d'équilibre.
Dans le cas du second bouclage (c'est-à-dire dans l'hypothèse 2 où les comptes publics et sociaux sont équilibrés), l'équilibre est modifié et dépend désormais de deux taux de taxation, contribution sur la valeur ajoutée et cotisation sur les salaires.
Nous avons testé, dans ce cadre d'analyse, l'impact d'une hausse du taux de taxation de la valeur ajoutée compensant une baisse du taux de cotisation sur les salaires, sous l'hypothèse d'un niveau de dépense publique inchangé. Cette variante est donc différente de l'hypothèse 2 du cas précédent (la baisse du coût du travail recommandée par Malinvaud) ou l'efficacité de la mesure était conditionnée par une réduction des dépenses. Elle se distingue également de l'hypothèse 1 puisque c'est ici le niveau et non la part des dépenses qui est maintenue. Le sens des effets macroéconomiques de long terme dépend des paramètres du modèle : les hypothèses retenues sont présentées en annexe. Pour des valeurs réalistes des paramètres du modèle, cette réforme du financement de la protection sociale engendre des effets positifs sur l'emploi. A l'équilibre, il est ici nécessaire d'augmenter les salaires pour augmenter la demande et l'emploi dans l'économie. Le scénario d'une modulation de la contribution sur la valeur ajoutée en fonction d'un critère tel que la part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises pourrait ici également être exploré. Le résultat de la simulation ne serait pas différent car le mécanisme du transfert des cotisations sociales vers une CVA est le même avec ou sans modulation.
3. 3. La taxation sur l'EBE (modèle 3)
L'excédent brut d'exploitation est défini comme le solde valeur ajoutée moins masse salariale. Le rapport Chadelat envisage ce solde comme une nouvelle assiette possible pour le financement des prestations sociales, ce qui revient à proposer une solution de financement assise sur le profit ou le capital des entreprises (les deux autres variantes d'assiette envisagées étant le bénéfice fiscal -assiette de l'IS-, et un solde intermédiaire entre EBE et bénéfice fiscal -bénéfice comptable ou cash-flow). La mesure la plus souvent préconisée est la taxation de l'EBE, qui a pour avantage de ne pas exiger une évaluation du stock de capital.
L'effet d'une taxation portant sur l'EBE est une augmentation relative du coût du capital, la masse salariale étant exonérée de cette contribution (ce qui n'était pas le cas dans l'hypothèse d'élargissement de l'assiette à la valeur ajoutée, qui équivaut à une taxation au même taux de l'EBE et de la masse salariale), soit une hausse du coût relatif capital/travail.
Nous avons analysé les effets de ce type de taxe dans le cadre d'un modèle identique aux précédents. On étudie l'impact macroéconomique d'un transfert des cotisations sociales portant sur le salaire vers une contribution assise sur l'EBE.
Nous avons limité l'analyse au cas où le niveau des dépenses publiques est égale au produit de la contribution EBE plus le montant des cotisations sociales (hypothèse 2). L'hypothèse retenue est celle de la mise en place d'une contribution portant sur l'EBE (le taux initial de cette contribution est donc nul), compensant une baisse du taux des cotisations sociales : la dépense publique est, dans la variante testée, supposée inchangée comme dans le cas précédent. Sur la base de valeurs courantes des paramètres du modèle, l'impact simule est positif. La réforme ainsi définie entraîne, dans le long terme, une hausse du salaire et de l'emploi dans l'économie. L'impact est plus fort que dans le scénario précédent (transfert vers une assiette valeur ajoutée), car le coût relatif du travail diminue plus. En effet, la baisse du taux de cotisations sociales réduit le coût du travail, tandis que la création de la contribution EBE accroît le coût du capital, d'où un effet global de baisse du coût relatif du travail renforcé. Sur la base de valeurs courantes des paramètres, on peut raisonnablement estimer que cet effet positif est dominant.
Dans le cadre du modèle, et sur la base de valeurs réalistes des paramètres, la création d'une contribution EBE et le transfert d'une partie des cotisations sociales sur cette nouvelle contribution, entraîne un effet positif sur l'emploi, supérieur à celui d'un transfert sur une contribution valeur ajoutée.
On notera, dans le cadre de la comparaison entre les deux hypothèses de transfert des cotisations sociales vers une nouvelle assiette, que sous l'hypothèse de dépense publique inchangée le taux de taxation sur l'EBE est nécessairement plus élevé que celui de la Contribution sur la Valeur Ajoutée, puisque l'assiette est plus réduite.
3.4. La modulation des cotisations patronales en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée (modèle 4)
Le rapport Chadelat envisage une nouvelle perspective de réforme, fondée sur la modulation des cotisations par différents paramètres, en particulier un paramètre valeur ajoutée. Il distingue entre deux options : une modulation de type "vertical", fonction d'un critère de valeur ajoutée externe à l'entreprise, et une modulation "horizontale", fonction de l'évolution par entreprise. La modulation verticale pourrait être réalisée soit sur une base nationale, soit sur une base sectorielle, à partir d'un ratio masse salariale sur valeur ajoutée. Une mise en oeuvre intra-sectorielle apparaît délicate ; sur une base nationale, le principe est relativement simple : à partir d'un ratio englobant tous les secteurs d'activité, on peut déterminer un seuil en deçà duquel une entreprise devrait payer un surplus de cotisations, et un seuil au-delà duquel elle bénéficierait d'une baisse de ses cotisations. On peut envisager une plage neutre, et un plafonnement maximum de la progressivité ou dégressivité des cotisations, de façon à limiter la variation de charge induite par la réforme. Nous avons analysé les effets de ce type de modulation du taux de cotisations employeurs, sur la base du ratio masse salariale sur valeur ajoutée.
La modélisation proposée pour ce scénario de réforme repose sur une représentation simplifiée de l'économie, comprenant deux entreprises représentatives. Afin de simplifier l'analyse, on considère que ces entreprises interviennent sur un même marché, avec une part de marché exogène (c'est-à-dire déterminée hors modèle, et constante) pour chacune d'elle. On suppose que dans l'entreprise 1, le ratio masse salariale sur valeur ajoutée est plus élevé que dans l'entreprise 2. La dépense publique est spécifiée comme dans l'hypothèse 2 des modèles précédents, c'est-à-dire qu'elle est égale au montant des cotisations perçues (cotisations sociales différenciées par entreprise).
On part d'une situation où les taux de cotisations des deux entreprises sont identiques. Le problème posé est de moduler les taux de cotisations proportionnellement au ratio masse salariale sur valeur ajoutée, de manière à obtenir un impact positif sur l'emploi. La résolution du modèle montre que si l'emploi de l'entreprise 1 est supérieur à l'emploi du secteur 2, ce qui apparaît comme une hypothèse raisonnable (on rappelle que l'entreprise est définie comme celle où le ratio masse salariale sur valeur ajoutée est le plus élevé), une modulation consistant en une hausse du taux de cotisation de l'entreprise 1 et une baisse du taux de cotisation de l'entreprise 2 aura des effets favorables sur l'emploi et la production. Cet effet favorable s'explique, dans le cadre du modèle, par la baisse du taux de cotisation moyen résultant de la réforme envisagée : si l'emploi de l'entreprise 1 est plus important que celui de l'entreprise 2, le taux de cotisation de l'entreprise 1 baissera beaucoup plus que la diminution parallèle du taux de cotisation de l'entreprise 2. Le taux de cotisation moyen diminue donc, et l'on retrouve les effets à long terme que nous avons analysés dans le cadre de l'hypothèse 2 du modèle 1. La demande par travailleur baisse du fait de la diminution de la dépense publique consécutive à la réforme. Cette diminution peut être estimée comme plus importante que la baisse de la productivité du travail résultant de la baisse des «charges», du côté de l'offre. Il en résulte une insuffisance de demande. Pour que l'équilibre macroéconomique soit maintenu, il est nécessaire d'augmenter les salaires réels pour augmenter la demande et l'emploi dans l'économie.
La modulation des charges salariales en fonction d'un ratio masse salariale sur valeur ajoutée a donc des effets positifs sur l'emploi si elle est accompagnée d'une hausse des salaires, sous réserve d'une hypothèse raisonnable (les entreprises ayant le ratio masse salariale sur valeur ajoutée le plus élevé sont également celles où l'emploi est le plus important).
*
* *
L'objectif de ce chapitre était de sérier les arguments socio-économiques qui sous-tendent l'ensemble des propositions existantes de réformes du financement de la protection sociale. La difficulté d'une telle réforme est qu'elle doit concilier deux préoccupations :
- Définir la participation de chaque catégorie de revenu au financement des dépenses sociales dont certaines ont pris un caractère universel.
- Rechercher le mode de financement le moins pénalisant pour l'emploi.
Le débat est alors autant social qu'économique. Il porte tout autant sur les catégories de revenus qui doivent contribuer au financement de la protection sociale que sur la mise en balance des avantages et des inconvénients économiques de chaque proposition. Les allégements de cotisation sur les bas salaires proposées par le rapport Malinvaud seraient financées par des hausses de cotisations sur les moyens et hauts salaires sans chercher à infléchir, tant au plan macro-économique que dans chaque entreprise, l'évolution de la répartition salaire-profit engagée depuis une décennies et demi. Au contraire, les prélèvements assis sur une assiette valeur ajoutée ou modulés en fonction de la part des salaires (autrement dit de la part des profits) dans la valeur ajoutée, intégreraient l'évolution du profit et de certaines sources de revenu du capital. L'absence prolongée de participation de ces revenus au financement de la protection du salarié n'est pas nécessairement source de cohésion sociale dans la situation macro-économique actuelle caractérisée par un chômage persistant et le déplacement continu du partage des revenus en faveur des profits et des revenus du patrimoine.
Dans le débat social, parmi les organisations professionnelles, seule la CGT-FO propose de conserver l'assiette de financement assise sur les seuls salaires. Le Medef et la CGPME se prononcent pour une réduction du coût du travail passant par la réduction des cotisations patronales. L'intégration de la valeur ajoutée dans l'assiette de financement de la sécurité sociale est défendue par la CFDT et le FNMF. Une assiette de type EBE est privilégiée par le SNUI et la Confédération paysanne. Le rapport Chadelat semble séduit par la modulation verticale nationale de cotisations qui resteraient assises sur les salaires. La modulation intersectorielle et la modulation intertemporelle sur une telle assiette sont défendues par la CGT, qui propose de leur adjoindre une extension de l'assiette des cotisations patronales aux revenus financiers des entreprises.
Dans un contexte macro-économique et structurel caractérisé par une offre redevenue rentable, mais une épargne excédentaire et une demande insuffisante, la faisabilité économique de chaque type de réforme a ensuite été discutée. Les simulations proposées se sont ensuite concentrées sur les effets économiques, en termes d'emplois, de chaque type de réforme.
La recommandation du rapport Malinvaud (une réduction d'ordre générale des cotisations patronales sur les bas salaires jusqu'à deux fois le SMIC) semblait faire l'unanimité, malgré le risque qu'elle comporte de déqualifier la structure de l'emploi en stimulant l'emploi non-qualifié. Pour en évaluer l'efficacité en termes d'emploi, nous avons procédé à la simulation la plus réaliste possible en reprenant les hypothèses essentielles du modèle Malinvaud et en les complétant. Nous avons ainsi cherché à tenir compte des effets de court terme et de long terme tant sur l'offre que sur la demande. La portée de la baisse des cotisations patronales dépend alors du type de scénario inhérent au niveau des dépenses sociales fixées par le gouvernement. Si la part des dépenses publiques est maintenue constante, ce qui constitue un cas de figure à prendre en considération, compte tenu de l'évolution démographique, de la persistance du chômage et de la demande sociale, la mesure provoque un effet négatif sur l'emploi. La baisse des cotisations patronales doit en effet être compensée par un prélèvement sur d'autres catégories d'agents pour maintenir la part des dépenses dans le PIB, ce qui exerce un effet dépressif sur la consommation et la croissance si l'on tient compte des effets de demande. Les exonérations de cotisations sur les bas salaires ne sont favorables à l'emploi que dans le deuxième scénario où la baisse des cotisations patronales s'accompagne d'une réduction de la part des dépenses publiques dans le PIB, mais à la condition que la consommation des ménages puisse augmenter, ce qui suppose une augmentation des salaires.
Les effets économiques des autres propositions de réformes ont également été testés.
Les assiettes Valeur Ajoutée ou dérivées permettent de comparer la situation comptable de chaque entreprise. Ces indicateurs sont, en toute rigueur, le seul qui justifie, d'un point de vue comptable, l'octroi ou non d'un flux financier en provenance des collectivités publiques en direction des entreprises pour favoriser l'emploi. Une telle taxation en fonction des situations comptables des entreprises évite les effets pervers des "flux aveugles" caractérisant les allègements indifférenciés de cotisations patronales. Une modulation des contributions patronales en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée est envisageable dans ce scénario pour tenir compte de la situation comptable de chaque entreprise.
L'assiette EBE est plus favorable à l'emploi que l'assiette VA parce qu'elle réduit plus le coût relatif du travail par rapport au coût du capital. Mais elle nécessite un taux d'imposition plus élevé. Ces assiettes peuvent prouver leur efficacité en termes d'emplois dans l'hypothèse d'un niveau de dépenses publiques inchangé.
Il convient évidemment de prendre en compte certains inconvénients de cette assiette VA, tout comme ceux de ses dérivés, et notamment de l'assiette EBE. Ces inconvénients portent essentiellement sur les risques d'évasion fiscale et d'alourdissement du coût du capital. En ce qui concerne l'assiette EBE, elle comporte des risques d'évasion fiscale plus élevés dans la mesure où elle est plus réduite et que le taux de taxation est plus élevé. De plus, le transfert d'une partie de cotisations employeurs sur une taxe assise sur l'EBE entraînerait un transfert des entreprises fortement capitalistiques vers les entreprises utilisant beaucoup de travail. Ceci comporte le risque d'un effet négatif sur les capacités d'innovation des entreprises, et à terme sur la croissance. On peut toutefois estimer, a contrario, qu'une modernisation visant à substituer du capital au travail n'est pas souhaitable en période de chômage élevé (Sterdyniak, Villa, 1998, p175).
Conserver l'assiette salaire et moduler les cotisations en fonction d'un ratio de référence indiquant la politique de l'emploi de l'entreprise (tel que la part de la masse salariale dans la valeur ajoutée) permettrait de contourner les éventuels effets pervers de l'assiette valeur ajoutée sur l'investissement tout en mettant à contribution les entreprises qui ont utilisé le profit contre l'emploi, de fait, le mécanisme à l'oeuvre est ici le même que celui d'une réduction globale des cotisations sociales envisagée par Malinvaud, à l'exception près que le financement des entreprises est modulé selon l'indicateur comptable de référence. Toutefois, une telle réforme comporte aussi les inconvénients relevés par Sterdyniak et Villa (1998, p 179). Premièrement, la modulation complique le système de financement. Deuxièmement, si la relation entre le taux de cotisation et le ratio valeur ajoutée sur masse salariale n'est pas linéaire, cette réforme crée une incitation à un dédoublement des entreprises, l'une possédant le capital qu'elle loue à la seconde, qui emploie tous les salariés, et paie donc le taux de cotisation le plus bas. L'objectif d'incitation à la substitution du travail au capital disparaît.
Au total, les effets conjoints des quatre propositions de réforme (baisse des cotisations patronales sur les bas salaires, assiette VA, assiette EBE, modulation des cotisations patronales) sont qu'ils contribuent, à des degrés différents, à modifier la structure des coûts de production en réduisant la taxation sur le travail relativement à celle du capital.
Pour autant, les trois dernières propositions se démarquent de la proposition Malinvaud sur trois points essentiels :
- Elles évitent le gaspillage des flux financiers accordés aux entreprises quelle que soit leur situation financière dans le cas des mesures d'ordre général traditionnelles de réduction des cotisations sociales. Ceci permet d'éliminer les effets pervers tels que les effets d'aubaine et les effets de seuil caractéristiques de ces mesures centrées sur les bas salaires.
- Elles rétablissent un partage des revenus après impôt favorable aux entreprises qui développent l'emploi.
- Elles libèrent des marges de manoeuvre pour augmenter les salaires dans ces entreprises.
En tout état de cause, le succès d'une éventuelle réforme tient, comme toute mesure de politique de l'emploi, à l'interprétation qu'en donneront les acteurs de l'emploi dans l'entreprise.
CHAPITRE 6 - LA RÉDUCTION DE LA DURÉE COLLECTIVE DU TRAVAIL A 35 HEURES
L'objectif de ce chapitre est d'évaluer les effets de la loi Aubry sur dialogue social dans les branches et les entreprises en matière de réduction du temps de travail (RTT).
Le succès de la loi est mesuré à l'aune de trois critères : l'effectivité d'une réduction de la durée du travail à 35 heures, les types de réorganisation du travail qui lui sont associés, le nombre de créations d'emplois.
La nécessité de prendre conjointement en compte ces dimensions, vient du fait que cette mesure législative s'inscrit dans une optique bien précise. Elle considère d'une part qu'il faut un mouvement global et massif de RTT pour que cette réduction ait un impact sur l'emploi (ordonnance de 1982). Elle considère d'autre part que, pour atteindre son objectif en matière de création d'emplois, la loi doit s'accompagner d'un processus négocié et décentralisé de la réduction du temps de travail aux niveaux des branches et des entreprises, cette négociation étant nécessaire pour sa mise en oeuvre effective et adaptée.
Les effets en termes de réduction du chômage de la réduction du temps de travail ne peuvent être analysés sans appréhender les différentes approches des entreprises en matière de recherche de compétitivité. En effet, selon les manières dont les entreprises vont se saisir de la loi, ce n'est pas le nombre annoncé d'emplois créés ou maintenus ou la nature offensive ou défensive de l'accord ou encore la fréquence des accords signés, qui apparaissent être les meilleurs indicateurs de l'effet potentiel du choc de la réduction du temps de travail sur l'évolution structurelle de l'emploi. L'essentiel en la matière sera leurs effets potentiels sur la compétitivité et la viabilité de l'entreprise à moyen long terme. C'est pourquoi il est indispensable de réinterpréter ces accords de ce point de vue. Cette viabilité dépend elle-même de l'évolution des exigences productives pour conquérir des nouveaux marchés et des nouveaux des clients, ainsi que des capacités collectives à construire de nouveau processus de production, au niveau de la firme et entre les firmes dans un même secteur ou territoire, notamment en liaison avec des modalités d'action publique territorialisées.
Dans un premier temps, nous dressons un bilan analytique des accords de branche et des accords d'entreprises sur l'application du dispositif de réduction du temps de travail et de création d'emplois. Dans ce cadre, les principales caractéristiques "sociétales" 79 ( * ) de la négociation collective à la Française sont mises en perspectives pour expliciter les facteurs d'impulsion ou de blocage de l'application de la loi Aubry sur la réduction du temps de travail.
Dans un second temps, afin d'appréhender les effets potentiels des accords négociés sur la viabilité des emplois crées ou maintenus selon des stratégies spécifiques d'entreprises, nous présentons une typologie des accords de branche et d'entreprise selon le modèle analytique retenu que nous aurons précisé au préalable.
Dans un troisième temps, sur la base de ces premières évaluations, nous mettons en perspective les opportunités et les effets pervers de ce dispositif d'aide publique, en s'appuyant sur des cas illustratifs d'entreprises qui sont en train ou qui ont déjà signé un accord sur les 35 heures.
Enfin, différentes recommandations sont avancées dans la perspective de la seconde loi qui doit fixer les conditions définitives du passage aux 35 heures.

Après la seconde loi, une aide structurelle d'un montant de 5 000 F serait accordée à toutes tes entreprises qui décident de réduire leur temps de travail à 35 heures.
|
Modalités d'application de la loi AUBRY du 16 juin 1998 80 ( * ) La loi du 16 juin 1998 prévoit la mise en oeuvre d'un dispositif de réduction du temps de travail en deux étapes, qui joue sur trois registres de l'intervention publique : - une réduction de la durée légale du travail hebdomadaire à 35 heures au 1 er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 50 salariés (9 millions de salariés) et au 1 er janvier 2002 pour toutes les entreprises (13 millions de salariés). La durée légale s'applique à l'ensemble des entreprises privés industrielles et commerciales, aux entreprises publiques qui ne relèvent pas du secteur des transports, des établissements publics à caractère industriel et commercial, des offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les associations, les établissements privés et les établissements familiaux et coopératifs. - la possibilité pour les organisations syndicales et patronales de négocier les modalités de la réduction collective du travail, pour proposer les compromis les plus favorables à l'emploi et les plus adaptés aux besoins de réorganisation des entreprises. Cette procédure contractuelle peut s'opérer par la signature d'accords de branche étendus ou d'accords d'entreprise. La loi ouvre aussi la possibilité que les accords d'entreprises soient signés pas seulement par les délégués syndicaux, mais aussi par des salariés mandatés par une organisation syndicale représentative au niveau national. - la mise en place d'un dispositif d'aide publique pour les entreprises qui s'impliquent avant la seconde loi dans la négociation d'une réduction d'au moins 10 % de la durée collective du travail et dans la réalisation d'embauches d'au moins 6 % des effectifs concernés. Celte incitation financière, sous forme d'abattement forfaitaire dégressif, correspond à un montant d'aide moyen de 7 000 francs sur 5 ans. L'aide financière dont les conditions sont fixées dans une convention entre l'entreprise et l'État (échéances de la RTT. modalités d'organisations et de décompte du temps de travail), est soumis à la signature d'accord d'entreprise. L'aide pourra être majorée de 4 000 F par an et par salarié lorsque la réduction d'horaire atteint au moins 15 % et que l'entreprise accroît ses effectifs d'au moins 9 %. Ce dispositif d'incitation financière ne peut être appliqué à certains organismes publics dépendants de l'État, du fait de leur monopole d'activité. |
1. Une dynamique contractuelle au milieu du guet
La loi Aubry du 16 juin 1998 invite les partenaires sociaux des branches et des entreprises à s'impliquer dans la négociation d'une réduction de la durée du travail à 35 heures.
|
Le temps de travail, un objet régulier de la négociation d'entreprise En matière de réduction et d'aménagement du temps de travail, le niveau organisationnel de l'entreprise et des établissements constitue un lieu central d'élaboration et de négociation de règles de gestion du travail. A l'inverse, la branche ne représente pas un médiateur privilégié des politiques publiques de réduction du temps de travail, ni un niveau de négociation très innovant sur le temps de travail. Les organisations patronales de branche s'impliquent à minima sur la question de la réduction du temps de travail, préférant impulser des accords dérogatoires sur les procédures d'ATT, en renvoyant l'essentiel de la négociation sur le contenu et les modalités d'organisation du temps de travail au niveau des entreprises (Mirochnitchenko, 1999). Ainsi, depuis le milieu des années 1980, le temps de travail est un objet régulier de la négociation d'entreprise, précédant celui des salaires 81 ( * ) . Les différentes mesures législatives engagées sur le temps de travail (loi Seguin de 1987, loi quinquennale de 1993, loi Robien de 1996) s'inscrivent essentiellement dans une logique d'aménagement du temps de travail. Elles privilégient le développement d'une contractualisation à l'intérieur de l'entreprise (négociation d'entreprise, mandatement syndical, accords dérogatoires d'entreprise, aménagement du temps de travail par le contrat de travail), et d'une contractualisation directe entre l'entreprise et l'État (aide financière). La multiplication des accords d'entreprise sur le temps de travail participe d'un mouvement plus général de décentralisation de la négociation collective au niveau de l'entreprise. |
1.1. Les accords de branche sur les 35 heures
Le CNPF avait dénoncé de façon virulente le projet de réduction de la durée légale du travail. Jean Gandois avait été contraint à démissionner lors de cet épisode. Il fut remplacé par Ernest-Antoine Seillière à la tête du Medef. Par la suite, la stratégie patronale adoptée a été de mobiliser largement les accords de branche pour pousser le gouvernement à prendre en compte les procédures particulières de réduction et d'aménagement du temps de travail des branches et considérer l'objectif de flexibilité du travail.
|
La convention de branche, un niveau central de la régulation sociale en crise En France, la branche occupe traditionnellement une place importante dans la régulation du système de relations professionnelles et dans la création de règles conventionnelles (Saglio, 1987). Elle constitue un espace conventionnel d'homogénéisation des conditions de travail des salariés (salaires, classification) et de diffusion d'une norme d'emploi fordienne (Boyer, 1986). Toutefois, les organisations professionnelles intermédiaires demeurent très hétérogènes et peu structurées, à l'inverse de la situation allemande. Ainsi, les négociations de branche font le plus souvent office de "lois supplémentaires négociées", dans le sens où les dispositions conventionnelles de portée générale sont très proches des règles légales minimales (Bonafé-Schmitt, 1988). Depuis le début des années 1980, le niveau de la branche constitue plus difficilement un niveau intermédiaire de régulation sociale entre les normes publiques générales et les politiques de gestion de main-d'oeuvre des entreprises (Mirochnitchenko, 1999). D'une part, la dynamique des négociations de branche s'essouffle par rapport aux accords d'entreprise. La décentralisation de la négociation au niveau de l'entreprise s'opère sans une réelle articulation avec le niveau de la branche. D'autre part, la politique contractuelle de branche révèle le déséquilibre du rapport de force entre les partenaires sociaux avec, d'un côté l'offensivité des politiques sociales patronales et de l'autre, la faible construction et homogénéité des revendications syndicales. |
1.1.1 Principales caractéristiques des accords de branche de réduction du temps de travail
Plus de 30 % des salariés du privé sont concernés par un accord de branche Aubry
Au milieu du mois de février 1999, près de 40 branches sur 172 concernées s'étaient impliquées dans un accord de mise en oeuvre des 35 h.
Ces accords couvrent près de 5 millions de salariés sur les 13 millions de salariés du secteur privé. L'accord métallurgie signé le 28 juillet 1998, soit 1,8 millions de salariés concernés, qui n'a pas bénéficié de la procédure d'extension du ministère du Travail (cf. encadré) n'a pas été comptabilisé dans ce bilan des accords de branche.
Certaines branches de taille importante ont déjà négocié un accord Aubry. On peut signaler les accords de l'industrie textile (143 000 salariés), des services automobiles (400 000 salariés), du Bâtiment et Travaux Publics (1,1 million de salariés), de la grande distribution (600 000 salariés), de la banque (200 000 salariés), ou encore de la chimie (96 000 salariés).
Par contre, pour l'instant le secteur de l'assurance n'a entamé aucune discussion sur la RTT ; la Fédération patronale (FFSA) refuse de s'impliquer dans des négociations de branche sur les 35 heures, reportant cette dynamique au niveau des entreprises.
|
Les types d'accords de branche prévus par la loi Aubry Le dispositif Aubry prévoit deux types d'accords de branche : - Des "accords-cadres", qui fixent les orientations générales et renvoient les conditions d'application de la RTT au niveau des entreprises Des "accords d'accès direct", qui sont directement applicables aux entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés. A ce jour, deux accords de ce type ont été signés : l'accord de la branche du bâtiment artisanal (Capeb) et du secteur de l'agriculture (FNSEA). De la même façon, l'union professionnelle artisanale du Tarn est signataire d'un accord de la RTT qui pourra concerner près de 4 000 salariés des 700 entreprises membres de l'union. |
La dynamique contractuelle engagée par la loi Aubry au niveau des branches est d'ampleur moyenne mais non-négligeable en comparaison des précédentes impulsions législatives en matière de temps de travail. Suite à l'ordonnance de janvier 1982 sur les 39 heures relayant elle même l'accord interprofessionnel de juillet 1981, près de 67 accords de branche d'application de cette mesure législative ont été négociés de janvier à mai 1982, couvrant près de 8,3 millions de salariés 82 ( * ) . Toutefois, l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995 sur l'annualisation-réduction du temps de travail n'avait alors impulsé que 44 accords de branche sur une période de 18 mois. De la même façon, la loi Robien ne s'était concrétisée que par quelques accords de branche (coopératives laitières, experts comptables).
Une majorité d'accords signés dans les Industries Agro-Alimentaires et dans le secteur des services aux entreprises ou aux personnes
Les accords de branche sont principalement signés dans les Industries Agro-Alimentaires (14 accords/36) et dans les secteurs des services aux entreprises ou aux personnes (6 accords).
Les autres branches concernées sont celles de l'industrie textile (4 accords), du BTP (3 accords), de la métallurgie (3 accords, vérifier pour manutention ferroviaire) ou des industries (chimie, équipements thermiques, carrières et matériaux).
Cette première répartition montre qu'un nombre important d'accords est signé dans des branches à main d'oeuvre féminine. Ces branches sont caractérisées par de fortes fluctuations d'activités, telles que les IAA, les services aux entreprises ou aux personnes, ou encore l'industrie textile. En ce sens, la question du temps de travail et de sa répartition est centrale, notamment avec la durée du travail comme variable d'ajustement aux fluctuations d'activité ou encore la part importante du temps partiel dans ces secteurs.
|
Tableau 33 - Principaux accords de branche signés depuis la loi du 16 juin 1998 |
||||||
|
Secteurs |
Branches |
Date accord |
Nombre de salariés |
Organisations signataires |
Heures supplémentaires |
Dispositifs d'ATT |
|
Métallurgie |
Métallurgie UIMM |
28 juillet |
1,8 millions |
FO, CGC |
Contingent porté de 94 h à 180 h. |
Annualisation autour d'une durée de 1645 h. et avec un seuil de 48 h. |
|
Métallurgie |
Bijouterie-joaillerie -orfèvrerie (accord étendu) |
4 décembre |
CFTC, FO, CGC |
Annualisation autour de 35 h., avec un seuil de 44 h |
||
|
Métallurgie |
Matériels agricoles et de BTP |
22 janvier |
60 000 |
FO, CGT, CFDT, CFTC, CGC |
Annualisation, avec un seuil de 44 h. ou 46 h. |
|
|
Industries |
Equipements thermiques |
14 janvier |
CFDT, CGC, CFTC |
Modulation, travail par roulement et cycle |
||
|
Industries |
Imprimerie et communication graphique |
30 janvier |
96 000 |
CFDT, CGC, CFTC |
Contingent limité à 115 h. |
Modulation de type II |
|
Industrie |
Industries chimiques |
05 février |
230 000 |
CFDT |
Contingent porté à 150 h. |
Modulation de type III autour de 1645 h., avec un seuil de 48 h. ou 42 h. |
|
Industries Agro-Alimentaires (IAA) |
Industrie sucrière (accord étendu) |
18 août 1998 |
8 000 |
CFDT, CFTC, CGC |
Horaires qui varient autour des durées maximales, et de 1586 h./an |
|
|
IAA |
Produit du sol (négoce et industrie) (accord étendu) |
29 juillet 1998 |
15 000 |
CFDT, FO |
Maintien des HS à 130 h. et 158 h. en période haute |
Annualisation |
|
IAA |
Coopératives laitières, conserverie de coopérative et Coopératives fleurs, fruits, légumes |
secteur coopératif agricole, 70 000 salariés |
||||
|
IAA |
Coopératives du secteur céréalier (accord étendu) |
1 octobre Volet offensif et défensif |
25 000 |
CFDT, FO, CGC |
Annualisation |
|
|
IAA |
Coopératives bétail et viandes (accord étendu) |
19 octobre Volet offensif et défensif |
14 000 |
CFDT, CGC, CFTC, FO |
Annualisation autour de 35 h., avec un seuil de 45 h. ou 48 h. ; Travail du |
|
|
dimanche de 5 h. |
||||||
|
IAA |
Coopératives de teillage de lin (accord étendu) |
28 octobre |
CFDT, FO |
Annualisation |
||
|
IAA |
Industrie de la viande (accord étendu) |
29 octobre Volet offensif et défensif |
65 000 |
CFDT, CFTC, FO |
Maintien des HS à 100 h. |
Annualisation autour de 35 h., avec un seuil de 21 h. à 45 h. ; Travail du dimanche de 5 h. |
|
IAA (FIC) |
Industries charcutières |
18 novembre |
33 000 |
CFDT, FO |
Contingent des HS porté de 120 h. à 145, puis ramené à 135 h. (2001) et 120 h. (2002) |
Engagement de recruter 1 500 jeunes de moins de 26 ans en 2 ans Annualisation |
|
IAA |
Industrie de la conserve |
2 décembre |
38 000 |
CFDT, FO |
HS variant de 30 h. à 70 h. |
Annualisation autour de 37 h.et de 1586/an |
|
IAA |
Organismes de contrôle laitier |
22 décembre |
2 000 |
CFDT, CGC, CFTC, FO |
Annualisation avec un seuil de 45 h. |
|
|
IAA |
Industrie avicoles |
12 février |
FO, CFTC, CGC |
Annualisation |
||
|
IAA |
Industrie et commerce de vins, cidres, spiritueux et jus de fruit |
05 février |
FO, CFTC, CGC |
Contingent porté de 100 h. à 130 h. |
Travail par cycle Annualisation autour de 35 h. |
|
|
BTP (Capeb) |
Petites entreprises du bâtiment (accord étendu) |
9 septembre 1998 Accord d'accès direct, offensif et défensif |
450 000 |
CFDT, CFTC |
Maintien des HS à 145 h. |
Modulation de type III autour de 35 h., avec un seuil maxima à 42 h. |
|
BTP (FNTP, FFB) |
BTP |
05 novembre |
1,1 millions |
FO, CFTC, CGC |
Contingent des HS porté à 145 h et 180 h. |
Annualisation autour de 1945 h. |
|
BTP |
Industrie des tuiles et briques |
15 décembre |
5 600 |
CFTC, CGC, FO |
Contingent des HS porté de 100 h. à 145 h. (2000) à 130 h. (2003). |
Modulation de type II et III autour d'une durée de 1644 h./an, et un seuil de 48 h. ou 44 h. |
|
Industrie |
Carrières et matériaux |
22 décembre |
FO |
Contingent des HS porté à 180 h. |
Annualisation, avec un seuil de 44 h. ou 48 h. |
|
|
Textile (UIT) |
Industrie textile (accord étendu) |
16 octobre |
143 000 |
CGT, CFDT, FO, CGC |
Contingent des HS porté de 90 h. à 130 h. |
Modulation de type II, avec un seuil à 44 h. |
|
Textile |
Industrie de l'habillement |
1 décembre |
130 000 |
FO, CGC |
Contingent des HS porté à 130 h. |
Modulation |
|
Textile |
Industrie de la chaussure |
21 décembre |
CFTC, CGT, CFDT, CGC |
Contingent des HS porté à 130 h. |
Modulation autour de 35 h., avec un seuil à 42 h. |
|
|
Textile |
Gantene |
18 décembre |
2 000 |
CFDT, CGT, CGC |
Limitation des HS à 90h. |
Durée maximale du travail à 42 h. |
|
Services (FCD) |
Grande distribution |
21 décembre |
600 000 |
CFTC, FO, CGC |
Maintien des HS à 90 h., avec une RTT à 1603 h. |
Annualisation, avec un seuil de 42 h. |
|
Services |
Service de l'automobile (accord étendu) |
20 octobre |
400 000 |
CGC, FO |
Contingent d'HS porté à 182 h à partir de la 2ed loi |
Annualisation, avec un seuil maxima de 46 h |
|
Services (Fep) |
Entreprises de propreté (accord étendu) |
10 novembre (RTT à partir de 07/99) |
286 000 |
CFDT, CGC, CFTC, FO |
Contingent des HS porté de 130 à 190 h. |
Modulation autour de 35 h. , de 00 h à 44 h. |
|
Services |
Transports publics urbains |
30 décembre |
34 000 |
CFDT, CFTC, CGC |
Baisse du contingent des HS à 115 h. |
Cycle de 12 sem. ; Modulation avec un seuil de 42 h. ou 46 h. |
|
Services (AFB) |
Banque |
4 janvier |
200 000 salariés |
CGC |
Contingent des HS fixé à 120 h. et 110 h. (2002) |
Annualisation autour de 1610 h./an |
|
Services |
Experts comptables (accord étendu) |
13 janvier |
120 000 |
Tous syndicats sauf FO |
Contingent HS limité à 90 h., avec une durée de 15996 h. /an |
Modulation autour de 35 h., avec un seuil de 48 h. ou 44 h. |
|
Agriculture |
Exploitations agricoles |
3 février |
900 000 |
FO, CGC |
Durée du travail réelle fixée à 1940 h./an |
Travail par cycle de 6 semaine, annualisation, astreintes |
|
Source : Liaisons sociale |
||||||
FO et la CFDT, principales organisations syndicales signataires des accords de branche
Les principaux signataires des accords de branche sont les syndicats Force-Ouvrière (24 accords/30), la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) et la Confédération Générale des Cadres (19 accords/30). Viennent ensuite les syndicats de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (14 accords/29) et la Confédération Générale du Travail (4 accords/29).
D'une façon générale, l'application contractuelle du dispositif des 35 h révèle de fortes contradictions internes au sein des organisations syndicales et patronales.
D'une part, alors que l'organisation patronale interprofessionnelle, le Medef, anciennement CNPF, a exprimé une très forte hostilité vis-à-vis de cette loi de RTT, les fédérations patronales apparaissent à ce jour largement impliquées dans la dynamique des négociations de branche. En effet, le Medef se félicite de l'ensemble des accords de branche déjà signés qui donnent aux entreprises des possibilités d'application de RTT suffisamment larges, et entend que le gouvernement ne revienne pas sur la signature de ces accords. Cette attitude paradoxale signifie-t-elle que le patronat s'est emparé des 35 heures pour négocier des accords de branche à son avantage en matière de flexibilité ? Existe-t-il des contreparties à la flexibilité pour les salariés ?
Bien que la question reste ouverte selon les branches, il semblerait que le patronat mobilise le thème de la RTT pour instrumenter une politique patronale de flexibilité du travail, et ce dans une logique contrainte de la négociation sur la RTT qui laisse une marge de manoeuvre étroite aux organisations syndicales.
En ce sens, les dernières propositions du patronat vis-à-vis de la seconde loi, notamment en vue d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 à 188 heures, illustrent clairement cette logique.
D'autre part, un écart important existe entre les politiques syndicales ou patronales au niveau local par rapport aux positionnements de leurs organisations au niveau national interprofessionnel ou au niveau des branches.
Dans la branche de la métallurgie, alors que le niveau national de l'UIMM a fortement dénoncé cette mesure législative de RTT, certaines chambres syndicales territoriales de la métallurgie entrevoient ce dispositif de RTT comme une opportunité pour les entreprises.
Elles les incitent à faire un état des lieux de leur organisation du travail et du temps de travail (cf. encadré).
Du côté des organisations syndicales, des tensions s'observent aussi entre les différents niveaux de l'action syndicale. Ainsi, alors que la confédération FO s'est clairement prononcée contre la loi Aubry, FO est l'une des premières organisations syndicales signataire des accords de branche.
À l'inverse, alors que la confédération CFDT fait de la RTT un fer de lance de sa politique syndicale, le niveau local de la confédération (unions territoriales, délégués syndicaux) est beaucoup plus sceptique sur le caractère positif de la dynamique des 35 heures.
Ces écarts entre le niveau national et local de l'action syndicale et patronale confirment l'importance des stratégies d'acteurs dans la négociation sociale et la spécificité de ces stratégies aux différents niveaux de la négociation (Sellier, 1986).
1.1.2 Une application hétérogène du dispositif Aubry dans les branches
L'application de la loi Aubry au niveau des branches s'opère selon un mouvement très hétérogène, tant du point de vue des modalités de mises en oeuvre de la RTT que des thèmes abordés.
Philosophie des accords et jeux des acteurs
Malgré la signature de ces différents accords, dans certaines de ces branches, on ne peut pas réellement parler de l'existence d'un compromis entre organisations syndicales et patronales.
En ce sens, l'accord de la banque signé uniquement par la CGC est dénoncé par les autres syndicats qui contestent la représentativité du syndicat catégoriel CGC (30 % des voix aux élections professionnelles et premier syndicat du second collège des agents de maîtrise techniciens). La fédération patronale rétorque que cet accord ne peut être contesté du fait qu'il n'existe plus de convention collective, celle-ci ayant été dénoncée par l'AFB en février 1998. De la même façon, les fédérations syndicales FO, CGT, CFTC et CGC exercent un droit d'opposition sur l'accord chimie signé par la seule fédération CFDT, notamment en raison de leurs désaccords sur l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires, l'allongement de la durée maximale de la journée de travail ou encore la réduction des temps de pauses.
La question de la conformité des dispositifs conventionnels négociés au droit du travail
Pour bénéficier d'une application large des dispositifs conventionnels négociés, les accords de branche doivent être étendus par le ministère du Travail.
|
La procédure d'extension des accords de branche La procédure d'extension est une décision prise par le ministre du Travail, qui permet aux entreprises de la branche qui ne sont pas adhérentes à la fédération patronale, ainsi qu'à leurs salariés, de bénéficier des dispositifs conventionnels négociés par la branche. Ainsi, l'accord n'est plus seulement applicable aux organisations signataires, mais à tous les employeurs et travailleurs de la branche considérée. Cette procédure d'extension a été instituée par la loi de 1936, qui précisément reconnaît la convention collective de branche comme le principal niveau de négociation collective et de régulation conventionnelle. |
Un certain nombre de réserves a été exprimé par le ministère du Travail dans le cadre de la procédure d'extension des accords de branche sur les 35 heures.
À la fin janvier, 17 accords de branche avaient fait l'objet d'une procédure d'extension, soit 2 millions de salariés concernés et 1,4 millions pour le BTP. Pour procéder à cette extension, le ministère du Travail s'est attaché plus particulièrement à observer l'existence d'une corrélation stricte entre le nombre d'heures dégagées par la RTT et le nombre de jours de congés alloués aux salariés.
Tout d'abord, le ministère du Travail a décidé de ne pas appliquer l'accord métallurgie, en raison de clauses contraires au droit du travail (augmentation du contingent des heures supplémentaires, banalisation du travail au forfait, intégration de jours fériés dans te temps de travail), mais aussi pour donner un signal fort par rapport à d'autres accords de branche qui se situeraient dans te même sillage. En ce sens, il s'agira d'observer l'attitude du ministère du Travail par rapport à d'autres accords de branche proches de celui de la métallurgie, tels que ceux signés dans te BTP ou les services de l'automobile, qui augmentent aussi fortement le contingent des heures supplémentaires et prévoient une annualisation directe.
Par ailleurs, hormis l'accord de l'industrie sucrière, tous les accords ont été étendus avec des réserves portant sur certaines dispositions concernant les modalités de décompte de la RTT (intégration des jours de congés, travail du dimanche, repos compensateur, contingent des heures supplémentaires, compte épargne temps...) ou encore l'application des 35 heures aux cadres par l'octroi de jours de repos supplémentaires. D'une façon générale, une série de dispositions semble devoir être réexaminées lors de la seconde loi.
Illustrations de tensions dans les négociations de branche sur la réduction du temps de travail : la métallurgie et de la plasturgie
Concernant plus particulièrement les branches de la métallurgie et de la plasturgie, des logiques de négociation assez similaires sont à l'oeuvre, même si les tensions apparaissent de façon plus exacerbée dans la métallurgie. Dans les deux cas, les organisations patronales craignent d'inciter les responsables d'entreprise à engager des discussions avec les syndicats sur la RTT.
|
Le "modèle industriel de la métallurgie" La branche de la métallurgie a joué un rôle moteur dans la construction de la convention de branche comme "charte de la profession". Les accords professionnels de la métallurgie en matière de qualification et de hiérarchie salariale (grilles de classification qui ont perduré de 1936 à 1975) ont pendant longtemps constitué une référence conventionnelle pour les autres branches (Saglio, 1991). De plus, l'Union des Industries Minières et Métallurgiques (UIMM) occupe une place particulière dans le monde patronal, influant très largement la politique sociale du CNPF. La compétence sociale de l'organisation patronale et son ancrage territorial (93 chambres syndicales territoriales) sont autant d'éléments qui placent la métallurgie comme une branche phare dans la négociation sociale et dans la politique contractuelle. Toutefois, dans une stratégie patronale de flexibilisation des cadres légaux et collectifs de travail et de temps de travail, l'organisation patronale de la métallurgie abandonne de plus en plus nettement une politique sociale de branche, pour se positionner comme un expert juridique auprès des entreprises (Mirochnitchenko, 1999). |
L'organisation patronale de la métallurgie est une des premières branches à avoir signé le 28 juillet 1998, avec les syndicats FO et CGC, un accord sur la durée et l'organisation du temps de travail qui contourne plus qu'il n'applique le dispositif Aubry. Le syndicat FO s'est impliqué dans cette négociation, considérant qu'il permettait une réelle RTT par l'octroi d'une sixième semaine de congés payés dans le cadre d'une annualisation du travail, sans porter atteinte au pouvoir d'achat des salariés 83 ( * ) . Plus généralement, la signature de cet accord a fait l'objet d'un un compromis entre FO et la fédération patronale concernant un arbitrage favorable en faveur du salaire et non du temps de travail. De plus, par cet accord, l'UIMM a pu introduire un nouveau dispositif d'annualisation des horaires de travail d'application directe et autour d'une durée annuelle de 1610 h.
En ce sens, cet accord reflète le caractère défensif de la stratégie patronale de l'UIMM en matière de temps de travail. L'UIMM dénonce radicalement de toute mesure collective de RTT et s'empare de la négociation comme un outil pour assurer les possibilités d'aménagement du temps de travail. En effet, depuis le début des années 1980, la fédération patronale s'est impliquée dans la négociation de différents accords dérogatoires sur la modulation et l'annualisation du temps de travail (1982, 1986, 1991, 1996). Dans la continuité de cette stratégie de flexibilité du temps de travail, l'organisation patronale s'est emparée des 35 heures pour mettre en oeuvre ses projets d'annualisation du temps de travail, qui sont largement partagés par les chambres syndicales. Cette réflexion faisait l'objet dès 1995 d'un rapport sur le "Travail différencié" rédigé par P. Guillen, président d'honneur de l'UIMM. Le rapport proposait de supprimer la référence à la durée hebdomadaire du travail et de négocier individuellement le temps de travail des salariés.
Ainsi, le positionnement de l'organisation patronale et la non extension de raccord de branche renforcent l'attentisme des entreprises de la métallurgie en matière de négociations sur la RTT. Bien que certaines chambres syndicales adoptent une attitude plus offensive que le niveau national de l'UIMM sur la loi Aubry, en proposant aux entreprises d'établir un état des lieux de leur temps de travail, la dynamique contractuelle dans les entreprises de la branche semble être de faible ampleur.
La branche de la plasturgie n'a pas encore signé à ce jour un accord d'application de la loi Aubry. La plasturgie, souvent présentée comme un contre modèle de la métallurgie, est plus directement impliquée dans la transformation d'un nouveau modèle de gestion du travail. Il s'agit pour cette branche relativement jeune et composée essentiellement de PME d'affirmer une identité professionnelle propre par rapport aux autres branches (notamment celle de la chimie dont elle est issue et celle de la métallurgie, avec qui elle a des activités connexes). Cependant, en matière de RTT, les négociations de branche en cours semblent ne pas être réellement différentes de la logique de la métallurgie.
Globalement, le point de vue de l'organisation patronale est d'envisager une négociation sur les 35 heures, qui permette d'obtenir des avancées non négligeables en matière d'annualisation du temps de travail et de contreparties pour les PME. De plus, l'objectif est de signer un accord-cadre en retrait qui reste suffisamment large pour laisser des marges de manoeuvre aux employeurs dans les entreprises, considérant que ces dernières ne joueront pas sur la baisse du salaire mais d'avantage sur la rationalisation du temps de travail par une réduction des temps de pauses. Le problème essentiel de ce dispositif législatif pour l'organisation patronale de la plasturgie est de ne pas traiter plus globalement de la formation et de l'utilisation de ressources humaines (employeurs multiples, prêts de personnel). Enfin, le patronat est assez réticent à ce que la mise en oeuvre négociée des 35 heures ne conduise à la présence des délégués syndicaux. Ces derniers sont pour l'heure faiblement présents dans la branche composée essentiellement de PME. Le modèle est donc celui d'une négociation individualisée entre le salarié et l'employeur. La question du mandatement des salariés est alors un élément de débat central dans la discussion avec les syndicats.
Pour l'organisation patronale de la plasturgie, il s'agit de mobiliser la loi Aubry en cherchant à développer les pistes les plus larges de flexibilité du travail et d'emploi.
Ces deux cas illustratifs montrent clairement que les fédérations patronales sont en position forte dans la négociation de branche sur les 35 heures, en opposant le principe de réduction de la durée légale du travail à celui d'une forte contrepartie en termes de flexibilité du temps de travail. Les organisations syndicales sont signataires de ces accords, le plus souvent en déplaçant la recherche de compromis sur d'autres objets que celui du thème strict du temps de travail. On peut par exemple citer le cas du syndicat FO dans les branches de la métallurgie et du BTP qui, en contrepartie de sa signature de l'accord sur la RTT et l'annualisation du temps de travail, a demandé l'ouverture de négociation sur l'extension du dispositif de l'Arpe (cessation progressive d'activité contre embauches).
Modalités de la réduction du temps de travail
En premier lieu, la plupart des accords de branche prévoit différentes possibilités de mise en oeuvre de la RTT : RTT hebdomadaire à 35 h., RTT par l'octroi de jours de repos supplémentaires, RTT par annualisation ou modulation.
Dans la quasi-totalité des cas, les accords de branche négocient une RTT couplée d'une procédure de modulation ou d'annualisation du temps de travail, avec un seuil qui s'échelonne de 42 h. à 48 h. Certains accords prévoient une annualisation directe, c'est-à-dire qui est applicable dans l'entreprise sans nécessiter un accord (BTP, services automobiles).
Nombre de ces accords prolongent en fait des dispositifs de modulation négociés précédemment, le plus souvent suite à l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995 sur l'annualisation/réduction du temps de travail. C'est le cas de la métallurgie, des services automobiles, de l'industrie textile, des industries de la viande, des produits du sol. En ce sens, la loi Aubry impulse tant une réduction négociée du temps de travail qu'un renforcement de la flexibilité du temps de travail. La différence entre les branches se situe par rapport à la hauteur de ces contraintes temporelles, en termes d'heures supplémentaires et de compensation salariale.
Dans une proportion non négligeable, les accords de branche envisagent explicitement une RTT sous forme de jours de repos supplémentaires (9 accords/36), dont la hauteur est précisée ou non. Certains de ces accords distinguent les jours de repos individuels, à la disposition des salariés, et les jours de repos collectifs, à la discrétion de l'entreprise, ce qui revient à une quatrième forme de modulation des horaires (exemple de la métallurgie, la grande distribution, la banque, industrie de l'habillement, industrie de la chaussure).
Dans certains cas uniquement, les 35 heures sont explicitement posées comme la nouvelle durée hebdomadaire conventionnelle du travail (industrie sucrière, entreprise de propreté, experts-comptables, produits du sol, carrières et matériaux, équipements thermiques), alors que dans d'autres branches la RTT est calculée sur la base d'une durée annuelle du travail (cas de la métallurgie, du BTP, de la chimie, de la grande distribution, de l'automobile, industrie du sucre, industrie de la conserve).
La plupart des accords de branche évoquent la question des heures supplémentaires et de leur contingent Un accord sur trois environ prévoit une augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires et un accord sur 6 fixe un seuil au-delà du contingent annuel légal, qui est de 130 h. (métallurgie, services automobiles, BTP, entreprises de propreté, industries charcutières, industrie des tuiles et briques, industrie chimique). Dans certains accords de branche, la majoration des heures supplémentaires est prévue dès la 36 eme heure, avec un taux minimal de 25 % (textile, habillement, chaussures). Cette question des heures supplémentaires révèle que l'annualisation ou la modulation du temps de travail n'est pas, pour un nombre d'emploi donné, estimée comme une condition suffisante de flexibilité quantitative du temps travaillé. Ainsi, la possibilité d'augmenter les heures supplémentaires, associée dans une moindre mesure à la possibilité de seuil annuel au delà du contingent légal de 130 heures reste, pour une part importante des représentants patronaux, une marge de manoeuvre non négligeable du point de vue de l'utilisation de la main d'oeuvre en place. Nous reviendrons plus loin, dans l'analyse de la RTT en entreprise sur ces aspects.
Dans certains accords de branche, la question de la compensation salariale est plus précisément traitée, notamment par l'attribution d'une indemnité compensatrice. C'est le cas des industries de la viande, de l'industrie du sucre, des exploitations agricoles. Plus précisément, les accords des organismes du contrôle laitier et de l'industrie des vins et spiritueux envisagent de faire bénéficier aux nouveaux embauchés de cette indemnité, pour limiter l'impact de la RTT sur leurs salaires.
Dans le même sens, différents accords abordent la question des salariés à temps partiel, de leur possibilité de bénéficier de la RTT et de la compensation salariale (organismes de contrôle laitier, grande distribution, entreprises de propreté, artisanat et petites entreprises du bâtiment).
Le temps de travail de l'encadrement est abordé par la totalité des accords de branche, soulignant la difficulté de la RTT pour cette catégorie par rapport à la spécificité de leur activité. Le plus souvent, les branches définissent différents types de forfaits selon les catégories de cadres, en distinguant les cadres supérieurs et les dirigeants soumis à un forfait sans référence horaire "forfait tous horaires", des autres cadres soumis à un forfait avec référence horaire. La RTT de l'encadrement s'opère dans la majorité des cas par l'octroi de jours de congés supplémentaires, avec dans certains cas la possibilité de les cumuler dans un compte-épargne-temps. Alors que certaines branches donnent une garantie d'une réduction effective de la durée du travail, en précisant le nombre de jours de repos (entreprises de propreté, coopératives laitières, industrie de la viande, produits du sol), d'autres restent beaucoup plus floues sur la hauteur de la RTT.
En dernier lieu, certaines branches évoquent la question du temps de travail effectif, qu'il s'agisse du temps de formation, avec des formules de co-investissement formation (carrières et matériaux, grande distribution, industrie des vins et spiritueux), ou une définition plus stricte des temps de pauses (chimie).
Les négociations de branche sur la RTT mettent en perspective deux types d'enjeux. D'une part, la question se pose de savoir dans quelle mesure ces accords seront reconnus par la procédure d'extension et par rapport aux éléments de précisions de la seconde loi (heures supplémentaires, RTT des cadres, annualisation des horaires de travail). D'autre part, l'application effective de la loi dépend de la capacité des accords de branche et des acteurs sociaux à impulser une dynamique durable de la négociation au niveau des entreprises.
Bien que l'existence d'un accord de branche puisse orienter les entreprises dans les modalités de réduction et d'organisation du temps de travail, l'application de ce dispositif Aubry demeure très fortement conditionnée par sa mise en oeuvre localisée au niveau des entreprises. En effet, c'est bien au niveau des entreprises qu'il s'agira à la fois d'évaluer l'impact de la RTT en termes de création d'emplois et la capacité des acteurs sociaux à négocier de nouvelles organisations productives et conventions du travail.
1.2. Accords d'entreprise
La loi Aubry avait explicitement pour objectif d'inciter financièrement à la négociation sur le temps de travail les entreprises qui anticipent la deuxième loi (fixant le cadre définitif du passage aux 35 heures) en réalisant des embauches ou en évitant des licenciements.
|
Volet offensif et défensif de la loi Aubry La mesure législative Aubry, comme la loi Robien, envisage un volet offensif et défensif dans le dispositif de réduction négociée du temps de travail : - "Accord offensif" : réduction négociée du temps de travail (10 % ou 15 %). avec une contrepartie en terme de création d'emplois (6 % ou 9 %). - "Accord défensif" : réduction négociée du temps de travail (10 % ou 15 %) pour préserver des emplois et pour les entreprises qui sont dans le cadre d'une procédure collective de licenciement économique. - " accord non-aidé" : réduction négociée du temps de travail qui s'opère en dehors du dispositif d'aide publique et de ses conditions en terme de pourcentage de RTT et de création d'emplois. |
Les principales caractéristiques des accords signés sont présentées en premier lieu. La diversité des procédures de mise en oeuvre des 35 heures et de la RTT est ensuite mise en perspective.
1.2.1 Caractéristiques générales des accords d'entreprise de RTT
À la mi-février 1999, le ministère du Travail faisait état de 2 200 accords d'entreprises signés , avec 10 % des accords où la RTT est supérieure ou égale à 15%.
|
Tableau 34 - Principales caractéristiques des accords d'entreprise |
|||
|
Types d'accords |
Nombre d'accords |
Nombre d'emplois |
Effectifs concernés |
|
Offensifs Défensifs Non aidés Total |
1885 (86 %) 165 (8 %) 149 (7 %) 2 199 |
16 123 (63 %) 2615(10 %) 7 004 (27 %) 25 543 |
191 158 (47 %) 26 849 (7 %) 186 450 (46 %) 404 458 |
Des accords principalement offensifs...
86 % des accords sont des accords offensifs, au sens défini par la loi.
7 % des accords d'entreprise sont des accords non-aidés, c'est-à-dire signés en dehors du dispositif d'incitations financières à la réduction du temps de travail.
Ce fort pourcentage d'accords offensifs, de RTT avec création d'emplois, dénote cependant de l'existence d'un effet d'aubaine du dispositif, où les entreprises mobilisent l'aide financière pour faciliter des projets de création d'emplois qu'elle devait de toute façon réaliser.
...qui touchent moins de 5 % de salariés du privé
Ces 2 199 accords d'entreprise touchent près de 404 458 salariés, soit 3 % des salariés du secteur privé.
Les salariés d'entreprise se répartissent de façon égale entre ceux concernés par des accords offensifs (47 %) et ceux par des accords non-aidés (46 %).
Le nombre important des salariés concernés par des accords non-aidés s'explique par l'existence d'accords signés dans de grandes entreprises. Une partie de ces grandes entreprises ne sollicitent pas l'aide de l'État, car ayant déjà négocié des réductions de leur temps de travail, il leur est difficile de respecter le seuil fixé par la loi de 10 % de réduction de l'horaire de travail de référence. D'autres entreprises sortent du dispositif d'incitations financières, car elles sont dans une logique de diminution de leur effectif, ne leur permettant pas ainsi de respecter le seuil fixé de 6 % de création d'emplois (Postes). Enfin, pour une large part, il s'agit d'entreprises qui, du fait de leur situation de monopole sur une activité ou un marché, sont exclues du champ d'application de l'aide financière. C'est le cas de l'entreprise publique EDF-GDF, qui compte à elle seule près de 76 % des effectifs concernés par des accords non-aidés.
Un effet sur l'emploi qui reste limité
L'effet annoncé sur l'emploi est de l'ordre d'un accroissement de 6 % de l'effectif concerné, ce qui correspond au seuil fixé par la loi. En ce sens, l'effet direct sur l'emploi reste relativement faible.
La majorité de ces emplois s'inscrit dans une optique d'accord offensifs (63 %) , avec un effet sur l'emploi de 8 % par rapport au nombre d'emplois concernés.
Par ailleurs, près de 27 % des emplois sont inscrits dans le cadre d' accords non-aidés, en majorité dans une logique offensive et avec un effet sur l'emploi de 4 % de l'effectif concerné (98 % des accords non-aidés). L'accord EDF-GDF porte à lui seul sur 70 % des emplois non-aidés, soit 5000 emplois.
Ces chiffres donnent une indication du volume d'emploi impulsé par les accords Aubry de RTT. Toutefois, l'étude plus approfondie des accords d'entreprises doit permettre de préciser le type d'emploi créé. S'agit-il d'emplois en CDD ou CDI, d'emplois à temps plein ou à temps partiel, d'emplois initialement prévus pour couvrir le volume d'activité de l'entreprise, ou de création d'emplois sur de nouveaux postes de travail ?
L'évaluation du dispositif Aubry nécessitera de prendre en considération l'ensemble de ces paramètres pour réellement estimer la dynamique de RTT en termes de création d'emplois.
Une majorité d'accords signés par les PME
La plupart des accords d'entreprises sont signés dans des PME ; 2/3 des accords dans des entreprises de moins de 50 salariés :
- 66 % dans des entreprises de moins de 50 salariés, dont 44 % des accords signés dans des entreprises de moins de 20 salariés,
- 22 % dans des entreprises de 50 à 200 salariés
- 8 % dans des entreprises de 200 à 500 salariés
- 5 % dans des entreprises de plus de 500 salariés
Jusqu'au début de l'année 1999, un nombre limité de grandes entreprises s'étaient lancées dans la négociation des 35 heures. La récente signature d'accords dans de grandes entreprises semble infléchir cette première dynamique. En effet, on peut noter quelques cas illustratifs comme l'accord EDF-GDF avec 111 000 salariés concernés, l'accord signé à Air France qui porte sur 35 000 salariés, l'accord Leroy-Somer qui porte sur 6 000 salariés, l'accord de PSA avec 92 000 salariés, ou encore l'accord signé à la Poste. D'autres grandes entreprises comme la RATP, la SNCF, France Télécom, ou Renault sont aussi en cours négociations. Cette dynamique correspond aussi à une plus grande implication entreprises publiques dans la mise en oeuvre des 35 heures. Toutefois, les logiques de négociation sous-jacentes à ces accords sont très différentes, comme nous le verrons plus loin.
Une majorité d'accords signés dans les activités de services
La majorité des accords d'entreprises sont signés dans le secteur des services aux entreprises et aux particuliers (37 % des accords au total), avec une majorité d'accords offensifs (96 %).
Les différents secteurs de l'industrie représentent ensuite près de 34 % des accordes, avec une majorité d'accords signés dans la métallurgie (26 %). Ce pourcentage doit être rapporté au poids du secteur, notamment pour la métallurgie, qui concentre près de 55 % des salariés de l'industrie. Ceci relativise d'autant plus la place de l'industrie dans la dynamique des négociations d'entreprise sur la RTT par rapport aux activités de services.
Les autres secteurs industriels se répartissent plus particulièrement comme suit :
- 13 % des accords pour les IAA
- 12 % des accords pour le textile-habillement
- 6 % pour la chimie-pharmacie
- 4 % pour le papier-carton
- 40 % pour les autres secteurs industriels, ce qui est une part non négligeable
Une part importante des accords signés dans l'industrie se situe dans une logique défensive (de l'ordre de 12 %). Ce phénomène prévaut dans les secteurs du textile habillement (23 % d'accords défensifs), de la métallurgie (14 %) et des industries agro-alimentaires (14 %).
Cette prédominance d'une logique défensive s'explique par le profil socio-économique de ces branches caractérisées par une activité de main d'oeuvre (dans une moindre mesure pour la métallurgie) et de nombreuses restructuration.
En ce sens, la branche textile avait déjà mené un certain nombre de négociations sur le temps de travail et l'emploi, notamment dans le cadre du plan Borotra de 1996. Pour la métallurgie, le problème est celui de la gestion d'une pyramide des âges vieillissante. Les récentes négociations engagées par les deux grands constructeurs automobiles français, Renault et Peugeot, illustrent précisément ce difficile équilibre entre un plan de préretraite-progressive (visant à faire partir 40 000 salariés de plus de 51 ans pour embaucher 15 000 jeunes) et la mise en place d'une RTT.
Par ailleurs, le secteur du commerce se détache avec près de 17 % des accords signés. Viennent ensuite, le BTP représenté par 8 % des accords et le secteur des transports et de la logistique avec 3 % des accords.
La CFDT, principale organisation syndicale signataire et une présence forte du mandatement
La majorité des accords d'entreprises est signée par le syndicat CFDT, avec un taux de signature de l'ordre de 45 %.
La plupart de ces accords sont signés par des salariés mandatés, à près de 43 % des cas, et ce plus particulièrement pour la CFDT et la CFTC. La CGT et la CGC sont les syndicats les moins impliqués dans cette pratique du mandatement. Le mandatement correspond à la possibilité pour un salarié non syndiqué de signer un accord d'entreprise, en étant mandaté par une organisation syndicale représentative.
La répartition des syndicats signataires est donc de :
- 45 % des accords signés pour la CFDT, dont 47 % par mandatement, avec une proportion à signer de 95 % 84 ( * )
- 21 % des accords signés pour la CGT, dont 34 % par mandatement, avec une proportion à signer de 95 %
- 16 % pour FO, dont 43 % par mandatement, avec une proportion à signer de 89 %
- 15 % pour la CFTC. dont 47 % par mandatement, avec une proportion à signer de 91 %
- 8 % pour la CGC, dont 19 % par mandatement, avec une proportion à signer de 99 %
Cette répartition des organisations syndicales signataires est intéressante à mettre en relation avec le positionnement des confédérations syndicales dans les accords de branche et plus globalement par rapport aux politiques de temps de travail et aux stratégies de négociation des syndicats.
La CGT- FO est en décalage entre une forte propension à négocier au niveau de la branche, et à l'inverse une faible proportion à négocier au niveau des entreprises. Cette tendance s'observe aussi pour le syndicat CGC. Cette tension de la position contractuelle de FO entre le niveau de la branche et le niveau de l'entreprise s'explique largement par son hostilité face à la loi Aubry et par rapport à une intervention législative sur le temps de travail. En ce sens, FO préfère s'impliquer dans une politique contractuelle de branche et à l'inverse rejeter le développement d'une dynamique contractuelle sur la RTT au niveau de l'entreprise. Ceci explique aussi sa faible présence dans la pratique du mandatement.
La CFDT est à la fois très présente dans les négociations de branche sur la RTT et dans les négociations d'entreprises. Cette implication est en cohérence avec une stratégie confédérale privilégiant la négociation sur le temps de travail à tous les niveaux. L'implication de la CFDT dans la pratique du mandatement illustre une stratégie de modernisation de son action syndicale, qui n'est pas totalement nouvelle notamment par rapport à ses anciennes positions motrices sur la création de sections syndicales dans l'entreprise, le droit d'expression des salariés ou encore l'obligation de négocier dans les entreprises.
La CGT se situe dans une position intermédiaire, avec une implication relative tant au niveau des branches qu'au niveau des accords d'entreprise. En effet, bien que l'organisation syndicale soit globalement favorable à la loi Aubry, elle reste plus prudente dans la négociation d'accords de RTT qui entraînent la mise en oeuvre de dispositifs de modulation ou d'annualisation du temps de travail trop larges. Cette attitude dans la négociation correspond à une position confédérale qui s'oppose à l'amendement des principes de flexibilité du temps de travail. Toutefois, cette posture est modulable au cas par cas, selon le rapport de force spécifique au sein des branches et des entreprises et la hauteur des contreparties sociales négociées, ce qui explique sa présence dans les accords de branche et d'entreprises sur la RTT.
La CFTC est dans une situation assez spécifique. En effet, étant un syndicat assez faible, elle se trouve principalement impliquée au niveau des entreprises et dans la pratique du mandatement. Cette nouvelle pratique contractuelle du mandatement représente pour la CFTC une opportunité pour toucher les salariés et éventuellement les amener à s'insérer dans une activité de représentation syndicale.
Une dynamique régionale très diversifiée
La région Ile de France est la plus fortement concernée par le nombre d'accords signés (13 %), suivie des Pays de Loire et de Rhône-Alpes. Toutefois, les salariés plus directement concernés par ces accords par rapport à l'effectif total des salariés de la région se trouvent être non pas dans ces régions, mais dans les régions du Limousin, de l'Alsace ou encore du Nord-Pas de Calais.
Comparaison avec les effets de la loi Robien
La loi Aubry impulse une plus forte dynamique contractuelle, 404 500 salariés concernés contre 154 473 pour Robien (2 % des salariés). Ceci s'explique par la nature même du dispositif.
D'une part, ce dernier engage à plus long terme une action normative sur la durée légale du travail, conduisant une plus large part d'entreprises à être à terme concernées par cette loi (effet cliquet). D'autre part, la loi Aubry prévoit une aide financière plus avantageuse pour les entreprises qui négocieront avant la seconde loi, ce qui renforce le mouvement d'anticipation des entreprises (effet d'aubaine). À l'inverse, la loi Robien n'établissant pas de restriction dans le temps à l'aide financière, ni de norme légale, s'est davantage ciblée sur les entreprises les plus innovantes et déjà inscrites dans une réflexion sur la transformation de leur organisation du temps de travail. Cette plus forte diffusion des accords Aubry se réfère aussi à l'existence d'un important mouvement de négociations de branche, alors que le dispositif Robien s'était essentiellement situé au niveau des entreprises, avec seulement quelques accords de branche (coopératives laitières, experts-comptables).
Ainsi, alors que la loi Robien a pu provoquer des effets d'aubaine, la loi Aubry développe à la fois effets d'aubaine et effets de cliquet.
Une majorité d'accords offensifs
Les deux mesures législatives ont en effet principalement mis en oeuvre des accords offensifs, confirmant le rôle actif des accords d'entreprises dans la négociation sur la RTT. Entre 60 % et 80 % des accords signés sont des accords offensifs.
Toutefois, une nuance peut être entre les deux dispositifs. Alors que dans le dispositif
Robien, les salariés se répartissaient de façon équilibrée entre les accords offensifs (51 %) et défensifs (49 %), dans les accords Aubry, les salariés se répartissent entre les accords offensifs (47 %) et les accords non-aidés (46 %) et une part minime d'accords défensifs (7 %).
Cette importance des accords non-aidés dans le cas Aubry s'explique par la présence de grandes entreprises, qui soit du fait de leur situation de monopole, soit de leur politique de gestion de la main d'oeuvre ne peuvent s'inscrire dans les conditions du dispositif d'incitations financières.
Une majorité de conventions signées dans de petites unités de production et dans le secteur des services aux entreprises et aux commerces.
La loi Aubry est encore davantage concernée par les plus petites entreprises (2/3 des accords dans les entreprises de 50 salariés, contre 50 % pour les conventions Robien). Ceci peut pour une large partie s'expliquer par l'effet cliquet de la loi, tel que nous l'avons décrit ci-dessus. La loi Robien a davantage concerné des entreprises de taille plus moyenne, dotées d'une pratique contractuelle avec les représentants syndicaux.
Une majorité d'accords de RTT dans le cadre de la semaine.
Les deux dispositifs ont opéré une réduction de la durée du travail dans le cadre de la semaine. Toutefois, les modalités associées à la RTT sont d'une nature un peu différente.
En effet, alors que les accords Robien ont principalement impulsé une RTT avec une annualisation des horaires de travail (22 %), dans la loi Aubry, les accords mettent en oeuvre une RTT par des modalités plus diverses et moins concentrées sur l'annualisation : octroi de jours de congés (22 %), horaire hebdomadaire variable d'une semaine sur l'autre, multiplication des horaires de travail.
Le dispositif Aubry a principalement initié une dynamique d'accords offensifs auprès des PME de moins de 50 salariés, situées majoritairement dans le secteur tertiaire des services aux entreprises et aux particuliers. Une large part de la dynamique des 35 heures se situe aussi dans le cadre des accords non-aidés, situés dans une logique offensive et représentés par une majorité de grandes entreprises . Enfin, la dynamique contractuelle engagée par la négociation d'entreprise sur la RTT se caractérise par une forte implication de la CFDT et un développement très marqué de la pratique du mandatement des salariés.
Globalement, la loi Aubry concerne un nombre plus élevé et une palette plus large d'entreprises que la loi Robien. En effet, de nombreuses entreprises qui, jusqu'à lors n'ont jamais réellement engagé de réflexion sur la réduction ou la réorganisation de leur temps de travail, se sentent concernées par ce dispositif. Il s'agit de mesurer le réel "effet cliquet" de cette mesure. En d'autre terme, les entreprises sont-elles poussées, par le dispositif d'incitations financières, à anticiper la négociation d'une réduction de leur horaire de travail, ou à l'inverse attendent-elles les éléments de précision de la seconde loi ?
1.2.2. Une mise en oeuvre diversifiée de la RTT
Différentes études réalisées sur la RTT 85 ( * ) ou d'entretiens effectués avec des acteurs publics ou privés intermédiaires (organisations syndicales et patronales territoriales, services déconcentrés de l'État) nous permettent de mettre en perspective à la fois le caractère actif des accords d'entreprises dans la réduction du temps de travail et la dynamique hétérogène des négociations impulsées par les entreprises sur cette question.
Ampleur de la réduction du temps de travail 86 ( * )
80 % des accords prévoient une RTT à hauteur de 10 % et 70 % une RTT à 35 heures. Ce taux de RTT correspond au seuil minimal prévue par la loi Aubry.
Modalités de la RTT
50 % des accords prévoient une RTT dans le cadre de la semaine de travail, associée dans de nombreux cas à l'octroi de jours de congés supplémentaires (22 %).
Bien qu'un nombre limité d'accords de RTT introduise une modulation des horaires (17 %), telle que définit par le cadre législatif (trois types de modulation), la mise en oeuvre de la RTT développe d'autres formes d'aménagement du temps de travail.
|
Trois types de modulations La modulation permet de faire varier l'horaire collectif autour de la durée légale, sur tout ou partie de l'année, ce qui permet de ne pas payer les heures supplémentaires en période haute et d'éviter le recours supplémentaire en période haute. Modulation de type I Introduite par l'ordonnance du 16.01.82, elle consiste à faire varier la durée de travail autour d'une moyenne de 39 heures sur l'année et avec un maximum de 48 heures. Les heures effectuées au-delà de 39 heures ne s'imputent pas sur le contingent des heures supplémentaires, mais ouvrent droit à majoration ou repos compensateur. Modulation de type II Introduite avec la loi Seguin de 1987, elle permet comme la modulation de type I de faire varier la durée de travail autour d'une moyenne de 39 h. sur l'année et avec un maximum de 44 h ou 48 h. si accord de branche étendu. Les heures effectuées au-delà de 39 h., ni ne s'imputent sur le contingent des heures supplémentaires, ni n'ouvrent droit à majoration ou repos compensateur, mais à une contrepartie négociée. Annualisation ou modulation de type III Introduite par la loi quinquennale de 1993, elle consiste à faire varier la durée de travail sous la seule limite des durées maximales légales, hebdomadaire (48 h.) ou quotidienne (10 h.). Les heures effectuées au-delà de 39 h., ni ne s'imputent sur le contingent des heures supplémentaires, ni n'ouvrent droit à majoration ou repos compensateur. Elle a comme contre partie obligatoire une réduction de la durée du travail. N.B : Dans les trois cas, l'introduction d'une modulation exige un accord d'entreprise ou un accord de branche étendu. |
D'une part, la RTT par l'octroi de jours de congés supplémentaires conduit parfois au développement d'une modulation du travail informelle. En effet, dans certains cas. ces jours de repos sont répartis entre, d'un côté des jours individuels à la disposition des salariés, et d'un autre, des jours collectifs soumis aux besoins de l'entreprise (fermeture de l'entreprise calée sur celle des clients, baisse d'activité...). Il s'agit bien d'une forme de modulation des horaires.
Par ailleurs, une part importante des accords prévoit une multiplication des horaires de travail de référence, avec des durées du travail qui peuvent être différentes d'une semaine à l'autre. L'enquête réalisée par la CFDT sur le "Travail en question" montre précisément que pour 64 % des salariés, la durée hebdomadaire du travail varie selon les semaines ou les périodes. On assiste aussi à une forte individualisation des temps de travail des salariés, qui restent malgré tout dans le cadre d'un horaire collectif de travail à l'inverse des horaires individualisés ou du temps partiel. Dans une entreprise, l'accord sur la RTT conduit à la mise en oeuvre de près de 30 horaires de travail différents selon la période et le type d'activité des salariés.
Une des chambres syndicales de la métallurgie interviewée note que de nombreuses entreprises envisagent d'accompagner la RTT par une gestion annuelle du temps de travail.
Il s'agit d'apprécier les contreparties sociales apportées à cette annualisation du temps de travail.
Réorganisations du travail associées à la RTT
- Un nombre important des accords n'envisage pas avec précision une réorganisation du travail et du temps de travail (30 % des cas).
- 60 % des accords ne prévoient aucune disposition particulièrement sur les heures supplémentaires, son volume et le seuil de déclenchement des majorations
- 45 % des accords n'envisagent pas spécifiquement la question des salariés à temps partiel. Toutefois, dans certains accords le choix est laissé aux salariés de bénéficier ou non de la RTT. Dans le cas d'un maintien à temps partiel, l'accord prévoit un réajustement du salaire.
- 2/3 des accords ne fixent aucune mesure particulière pour le temps de travail des cadres. Si une RTT est envisagée pour cette catégorie de salariés, elle se fait majoritairement sous forme de congés supplémentaire, associé au dispositif du compte-épargne-temps, ce qui permet alors d'envisager la RTT dans un cadre pluriannuel.
- 80 % des accords ne traitent pas de la question du temps de formation.
|
Le compte-épargne-temps Le compte-épargne-temps (CET) est instauré par la loi du 27 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise, visant à favoriser le développement de l'emploi par la prise d'un congé d'au moins 6 mois et à permettre la distribution de gains de productivité aux salariés sous forme de temps libre indemnisé. Il constitue un dispositif de gestion individualisée du temps de travail, qui permet aux salariés d'accumuler des droits afin de bénéficier d'un congé de longue durée rémunéré. Il peut être alimenté par des congés, du repos et des primes dans un compte, par rapport à des congés rémunérés. Ce dispositif vient fréquemment légaliser la pratique courante et informelle du "débit-crédit d'heures". Le CET ne peut être mis en place que par un accord collectif au niveau de la branche ou de l'entreprise. Une étude réalisée sur 790 accords d'entreprises (Ministère du Travail, 1998) montre que ce type de congé est très souvent mobilisé dans le cadre de congés particuliers tels que congés sabbatiques, parental, de création d'entreprise, ou encore de fin de carrière tels que la préretraite progressive (3 accords sur 5). Il s'adresse prioritairement aux salariés qui remplissent certaines conditions d'ancienneté et de statut. Ce dispositif revêt un regain d'intérêt dans le cadre de la loi Aubry, où la RTT s'opère en grande partie par l'octroi de jours de repos supplémentaires. Ainsi, en se réfèrent au bilan des accords Robien (1 accord sur 5 prévoit une RTT par jours de congés), la loi incite les partenaires sociaux à favoriser cette pratique de jours de repos accordés pour la RTT qui alimentent le CET. Les négociations de branche ou d'entreprise d'application de la réduction légale du travail mobilisent largement ce dispositif, notamment pour la catégorie des cadres. |
Compensation salariale
Tous les accords négocient une compensation salariale. La compensation est totale dans 90 % des cas . La question de la baisse de la rémunération liée à la RTT est en effet un élément de crainte importante des salariés.
Les entreprises qui s'engagent dans la RTT ne semblent pas jouer sur la diminution des salaires pour réduire le coût de la RTT, mais davantage sur l'augmentation des gains de productivité ou encore une politique de modération salariale à plus long terme.
Ainsi, un nombre important d'accords, 30 % , prévoient un blocage des augmentations collectives.
Créations d'emplois
Les accords de RTT précisent les catégories d'embauches mais ne définissent pas spécifiquement les postes concernés. 78 % des accords envisagent des embauches en CDI.
La question de la dynamique de création d'emplois nécessite d'être envisagée sur le long terme et au-delà du maintien des embauches prévues sur deux ans dans la loi. Il s'agit d'aborder la réalisation d'embauches dans une réflexion plus globale sur le redéploiement des compétences ou des effectifs sur tel ou tel service ou tel ou tel poste de travail. L'enquête CFDT "Le travail en question" montre que lors de création d'emplois, seulement 10 % des salariés répondent qu'il y a eu une répartition de leur charge de travail. Ainsi, l'évaluation de conventions Robien deux ans après leur signature illustre cette nécessaire prudence. L'accord Robien signé en septembre 1996 par l'entreprise organisme de vacances VVF, prévoyant 2 % d'embauches supplémentaires se transforme en novembre 1998 par l'annonce d'un plan social touchant 140 salariés (40 suppressions d'emplois et 100 mutations).
De plus, il ne faut pas oublier que la loi Aubry n'est pas le seul dispositif d'aide publique à la création d'emploi. Les entreprises sont en capacité d'opérer des arbitrages avec les autres dispositifs existants, tels que les exonérations de cotisations sociales pour le travail à temps partiel ou les différents contrats en alternance, de qualification.
Pratique contractuelle
La pratique du mandatement qui se développe fortement dans les accords de RTT est globalement bien acceptée par les syndicats, qui ainsi ont une plus grande maîtrise et connaissance des négociations, notamment grâce aux procédures de suivi des accords. Certains accords prévoient un double mandatement, pour la négociation d'une part, et pour la signature d'autre part. Le mandatement s'accompagne aussi de la pratique du référendum. Cette pratique est mobilisée par la CFDT et la CFTC.
À l'inverse, la pratique du mandatement ne semble pas totalement convenir aux directions d'entreprise. En effet, la plupart du temps, en l'absence de représentants syndicaux, les entreprises souhaitent négocier avec un salarié élu (délégué du personnel, membres du comité d'entreprise), sans qu'un salarié ne soit mandaté par tel ou tel syndicat. La pratique du mandatement est alors ressentie comme une intervention ou une présence indirecte (et indésirée) d'une organisation syndicale.
Possibilités de conflits
Dans certaines entreprises, l'application de la RTT engendre certains conflits au sujet de la compensation salariale, la suppression des horaires de fin de semaine, ou encore la réduction des temps de pause. En effet, la mise en oeuvre de la RTT entraîne dans certaines entreprises une déstabilisation de l'organisation du temps de travail et des compromis entre salariés et direction sur le système horaire existant.
|
Un modèle de décentralisation négociée incertain Depuis le milieu des années 1980, relayée par l'obligation annuelle de négocier sur les salaires et le temps de travail des lois Auroux de 1982, la pratique contractuelle au niveau de l'entreprise a connu une forte ampleur, avec l'impulsion d'une logique d'accords "gagnant-gagnant". Toutefois, la multiplication des accords d'entreprise ne signifie pas nécessairement l'existence d'une "régulation conjointe" des règles de travail entre direction et syndicats (J. D Reynaud, 1979). En effet, l'institution d'une négociation d'entreprise s'est accompagnée d'un rapport de force moins favorable aux syndicats (crise du syndicalisme et plus faible capacité de négociation dans l'entreprise) et d'une prédominance de politiques sociales patronales offensives. Ainsi, la décentralisation de la négociation vers l'entreprise s'est engagée au profit d'une "autoréglementation de l'entreprise", notamment par le renforcement du pouvoir normatif de l'employeur dans la mise en oeuvre d'aménagements du temps de travail (Supiot, 1989). De plus, le développement des accords dérogatoires d'entreprise, nombreux sur la question du temps de travail, conduit à une autonomisation de la négociation d'entreprise par rapport aux autres niveaux de la régulation (Rotschild-Souriac, 1993). Cette multiplicité des accords d'entreprise renforce dans une certaine mesure une plus forte inégalité entre les salariés des différentes entreprises (grandes entreprises/PME ; secteurs exposés/protégés) et à l'intérieur des entreprises entre les différentes catégories de salariés (salariés au forfait, à temps partiel annualisé, cadres). Ainsi, un cadre de régulation intermédiaire semble nécessaire pour limiter les très grandes disparités de la seule négociation d'entreprise, avec une activité contractuelle plus équilibrée entre le niveau de la branche et de l'entreprise. |
2. Le modèle d'analyse : typologies des accords de branche et d'entreprises
L'objectif de cette section est d'élaborer des catégories d'analyse des accords négociés dans le cadre de la loi Aubry, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de la branche, afin d'accroître la connaissance de leurs effets potentiels sur l'emploi à partir de la façon les acteurs de la négociation se saisissent de la loi et de son dispositif d'aide.
Deux grandes logiques d'entrée des branches dans le dispositif de la loi Aubry, seront distinguées : des logiques "mécaniques" et des logiques "organiques". Chacune d'elles est ensuite subdivisée pour analyser les accords au niveau des entreprises, en distinguant quatre types de stratégies d'entreprises. Pour la logique mécanique, une distinction est faite entre une "stratégie comptable" et une "stratégie productiviste". Pour la logique organique, une distinction est faite entre une "stratégie coopérative" et une "stratégie mutualiste". Ces différents types correspondent à des modes d'entrée dans la loi qui révèlent des formes différenciées de recherche de compétitivité de la part des entreprises et de leurs acteurs. Ils déterminent en partie la viabilité et la dynamique de l'emploi de ces entreprises, à court, moyen ou plus long terme 87 ( * ) .
Ces différentes formes de recherche de compétitivité se repèrent à partir d'ensembles de représentations et de pratiques de gestion, d'organisation et de négociation, construits sur la base d'un socle de règles et de normes sociales au niveau du territoire national. Ces pratiques, représentations, règles et normes, par les effets qu'elles produisent sur la construction des compétences, sur le choix des technologies, sur les niveaux de coûts, sur la qualité des produits et des services ainsi que leur diversité, participent à la viabilité de l'entreprise et de ses emplois dans le temps. Il est donc important de les connaître, même partiellement, à la fois à partir de l'analyse du contenu des accords et des résultats d'enquêtes monographiques complémentaires.
De plus, bien que ces formes de recherche de compétitivité soient distinctes, on suppose qu'elles peuvent se transformer sur la base d'apprentissages collectifs, en particulier du point de vue de la négociation collective, de l'organisation du travail, de la gestion des rémunérations, des formations et des carrières.
La question essentielle qui est alors posée du point de vue de l'évaluation de l'efficacité de la loi en matière de création d'emplois, est celle de sa capacité à agir favorablement sur des processus d'apprentissages des acteurs du point de vue des modalités de gestion, d'organisation et de négociation, pour favoriser la viabilité de long terme des entreprises.
L'interprétation du contenu des accords en rapport avec l'expression de différents types de stratégies globales de compétitivité est donc une démarche incontournable lorsqu'on souhaite augmenter la prédictibilité en matière de création ou maintien d'emploi à moyen long terme dans l'économie, sur la base du choc introduit par une législation de type loi Aubry.
La croissance de l'emploi dans une entreprise dépend non seulement des modalités de construction de la compétitivité par les acteurs à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi des capacités de construction de ressources pertinentes (humaines, financières, cognitives, informationnelles,...) dans un environnement sectoriel ou localisé et plus largement sur le territoire national. Il importe alors de s'intéresser aux formes d'accords et de recherche de compétitivité, capables d'intégrer cette dimension d'un point de vue stratégique.
Cette section propose un modèle d'analyse tenant compte de ces dimensions 88 ( * ) et une typologie des accords de branches et d'entreprises à l'aune de leur aptitude à maintenir l'emploi ou le rendre viable sur le long terme.
2.1. Les conditions de viabilité des emplois créés ou maintenus par les accords : modèle d'analyse
La réduction du temps de travail n'a pas d'effet mécanique sur la croissance de l'emploi ou sur son maintien à moyen-long terme. Ses effets vont dépendre de la manière dont l'entreprise construit sa stratégie de compétitivité dans un contexte de renouvellement des façons de produire. De ce point de vue, deux modalités de recherche de compétitivité qui se combinent dans l'entreprise peuvent être distinguées :
- Une compétitivité qui s'obtient par une rationalisation des coûts de production sur des produits et services dont les marchés sont bien repérés. Cette compétitivité résultera de gains de productivités globaux (travail, capital, énergie,...) qui peuvent eux-mêmes provenir des transformations de l'organisation, des techniques et des savoirs ou des compétences. Cette recherche d'avantages comparatifs en termes de coûts correspond à une phase d'exploitation de processus existants, combinés à une recherche d'amélioration de ces mêmes processus. Cependant cette amélioration peut induire une modification partielle de ce processus de production et de la qualité des produits et services proposés.
- Une compétitivité qui s'obtient par une transformation ou une création de produits, de services et de techniques ou encore par une internalisation de leur production lorsqu'ils sont déjà fabriqués ailleurs. Trois types de stratégies peuvent être repérés sur ce plan : une recherche d'avantages comparatifs en termes de différenciation à l'intérieur d'une gamme de produits et de services, une stratégie de diversification des gammes proposées et enfin, une stratégie de production de nouveauté radicale.
Pour résumer, les exigences productives les plus vives auxquelles sont confrontées les entreprises portent sur la capacité d'intégrer ou de concevoir de nouvelles technologies , la capacité à fabriquer des produits et des services combinés, différenciés, diversifiés ou innovants, selon des contraintes évolutives en termes de délais, de qualité, de coûts. Ces nouvelles exigences impliquent, par exemple, une interactivité ou du moins une attention au client ou aux utilisateurs, plus soutenues qu'auparavant, ainsi qu'un partenariat pour la construction de certaines ressources (par exemple en matière de R&D ou de formation professionnelle de branche). Il s'agit là d'autant d'objectifs qui, pour être menés à bien, supposent des réorganisations, en particuliers des relations internes et externes, et des investissements tant matériels qu'immatériels (Iribame 1989).
Compte tenu de ces évolutions en termes d'exigences de conception, de production et de valorisation des produits et services, on suppose, en s'appuyant sur certains travaux économiques, que la conciliation entre une compétitivité microéconomique et une dynamique positive de l'emploi, n'apparaît possible que sur les bases d'une capacité de l'entreprise à construire de nouveaux processus de production (Gaffard 1989), ce qui exige des capacités d'innovation en termes de techniques d'organisations ou conventions qui concernent l'entreprise mais la dépassent aussi notamment du point de vue de la création institutionnelle ou de normes sociales. En effet, les représentations et pratiques d'acteurs en termes de gestion, d'organisation et de négociation que l'on propose de prendre en considération pour analyser les effets sur l'emploi des accords négociés, dépendent eux-mêmes de la construction historique de normes sociales, de règles et conventions qui homogénéisent d'un certain point de vue l'ensemble des entreprises du territoire national, mais qui contribuent aussi à leur diversité. Cette diversité se traduit notamment dans des formes d'intégration dans des réseaux de nature économique, sociale ou politique, liées en particulier à des spécificités territoriales (en particulier nationales, régionales ou infra-régionales).
Ces capacités à construire la viabilité de la firme reposent sur la trajectoire passée des entreprises 89 ( * ) , mais dépendent aussi de l'évolution des ressources ou des contraintes (financières, humaines, cognitives, informationnelles, législatives,...) qu'elles sont susceptibles d'internaliser, d'externaliser (par exemple en termes de recrutement ou licenciement) ou de co-construire, avec des partenaires privés (partenariat de R&D par exemple) ou publics 90 ( * ) .
La notion de compétitivité créatrice d'emploi mobilisée selon ces hypothèses, correspond en fait à celle d'une compétitivité territoriale dont est supposée dépendre la performance micro-économique de l'entreprise selon sa capacité d'innovation, selon sa capacité de croissance en termes d'emploi ou en fonction d'une capacité à une mobilité professionnelle volontaire entre entreprises, des différents salariés. Elle correspond aussi à la capacité de création de PME ou Très Petites Entreprises (TPE) par des salariés sortant d'entreprises existantes ou du secteur public ou enfin de formations initiales du système éducatif.
Cet ensemble d'hypothèses conduit à évaluer l'impact possible en termes d'emploi à moyen-long terme de la loi sur la réduction du temps de travail en rapport avec les capacités diverses des entreprises ou des branches, à mobiliser les ressources humaines ou construire les compétences nécessaires à la transformation ou l'adaptation de leur processus de production.
C'est pourquoi, les dimensions d'analyse retenues pour caractériser des accords selon des formes de recherche de compétitivité ou de viabilité de l'entreprise sont exprimées d'un côté en termes de stratégies de relations internes et de l'autre en terme de relations externes. Ces différentes dimensions de l'analyse trouvent une expression sous certains aspects dans les accords négociés, soit sous forme d'éléments de préambule, soit sous forme d'article comprenant à la fois des indicateurs plus précis et des procédures de mise en oeuvre spécifiques. Par exemple dans l'accord-cadre de la Poste, une méthode de conduite du changement est proposée par les signataires dans une perspective d'élaboration des nouvelles organisations du travail par le biais d'accords locaux qui prolongent cet accord-cadre.
Les dimensions retenues pour l'analyse des relations internes sont les suivantes :
- La qualité de l'information, de la concertation et de la négociation collective ainsi que leurs objets supports (emplois, compétences, organisation du travail et du temps de travail, relations avec d'autres entreprises,...). Sur ce thème, est précisé ce que signifie la pratique du mandatement selon les entreprises dans le cadre de la loi Aubry.
- La trajectoire technico-organisationnelle de l'entreprise du point de vue de l'organisation du travail (développement d'une coopération horizontale entre différents services, gestion par objectifs, par projets, travail en équipes tournantes, rationalisation des temps de production), de l'intégration ou du développement de nouvelles technologies.
- Les pratiques et référentiels de gestion financière et surtout de gestion de l'emploi, des ressources humaines (en termes de rémunération et formation, et plus généralement en termes de dispositifs de contrôle ou d'incitation des salariés au travail ou à la coopération).
Du point de vue des relations externes et de la relation de l'entreprise à son environnement, les dimensions d'analyse portent essentiellement sur les modalités de relations avec les fournisseurs, partenaires (privés ou publics), clients (ou marchés potentiels) ou enfin avec les donneurs d'ordres. Dans le cadre de ce travail, ces dimensions ne seront que partiellement prises en compte, puisque ce n'est pas l'objet essentiel.
Il faut ajouter de plus que la construction d'un cadre analytique calé sur la notion de compétitivité territoriale conduit à évaluer la façon dont les divers acteurs intermédiaires traduisent la loi ou le dispositif d'aide auprès des entreprises aux différents niveaux territoriaux et s'en saisissent eux-mêmes pour agir dans le cadre de leurs missions. Ces acteurs collectifs sont aussi bien les fédérations syndicales d'employeurs et de salariés et leurs confédérations, que les acteurs publics tels que les services déconcentrés des différents ministères, et enfin des organismes consulaires, paritaires ou associatifs, etc.
Les principaux indicateurs analysés dans les contenus d'accords sont résumés l'encadré ci-dessous.
|
Principaux indicateurs retenus pour l'analyse des accords d'entreprise et de branche - Les modalités de l'annualisation, s'il y est une, (avec les conséquences sur le travail le week-end, les horaires atypiques, le nombre d'heure maximum effectué sur combien de semaines). - Les autres formes de modulations horaires (avec la même question que ci- dessus). Le traitement du paiement des heures supplémentaires et de leur quantité, (sont-elles rémunérées normalement à partir de l'annualisation ? sont-elles augmentées ?). La création ou la transformation du travail en équipes tournantes. La transformation de l'organisation du travail, de l'organisation et des contenus de la formation et de nouvelles filières de carrières (impliquant ou non un décloisonnement des services). La transformation des tâches ou des postes, (du point de vue de la responsabilisation et l'autonomisation des salariés d'exécution, lorsque cela n'était pas le cas, ou des modalités d'expression au travail renouvelées notamment en terme de capacité d'action ou d'expression sur les processus productifs). Les formes de modération salariale ou de compensation sur la base des 39 heures (en particulier existe-t-il des accords qui réduisent les salaires et si tel est le cas comment sont traités les salariés au SMIC et les salariés à temps partiel ?), les modalités de calcul du temps de travail (compte-t-on les pauses, les temps d'habillage, les trajets ?) Les modalités de calcul de la rémunération globale (salaire de base avec suppression des primes ou maintien des diverses primes avec modification des conditions d'attribution ou non). L'aspect aidé ou non des accords. La qualité des emplois créés ou transformés (CDD, CDI, contrats d'apprentissage en alternance....). La façon d'organiser le travail des cadres et les modalités de compensation (en particulier s'agit-il de forfaits pour 35 heures de travail ou de récupérations en terme de jours de congés supplémentaires ?). L'aspect offensif ou défensif de l'accord, même si cette information n'est pas suffisante pour prédire la viabilité de l'entreprise à moyen terme. |
C'est sur la base ce modèle d'analyse et d'une démarche de recueil d'information, qu'une typologie des modalités d'entrées des branches ou des entreprises dans la loi Aubry sera proposée dans la section suivante, pour analyser les effets potentiels sur l'emploi des accords signés.
2.2. Les logiques des négociations de branche sur la RTT
Les accords de branche sur les 35 heures et l'application du dispositif Aubry s'inscrivent dans des logiques relativement différentes. Ainsi, pour caractériser ces négociations branches sur la RTT, la grille d'analyse est celle proposée par J.J Silvestrc (1986) et M. Gadille (1998) pour rendre compte des modalités d'ajustement des politiques de gestion de main d'oeuvre et d'organisation du travail des entreprises :
- Une logique "mécanique", où l'adaptation aux nouvelles contraintes productives s'est effectuée par la recherche de réduction des coûts salariaux, qui s'est traduit par une augmentation de la productivité du travail et l'utilisation accrue de contrats d'emplois précaires . Dans cette logique, la politique publique permet à la norme d'emploi et salariale précédente de se renforcer par l'utilisation massive de dispositifs de préretraite progressive ou de contrats aidés pour certaines catégories d'emplois (temps partiels), sans favoriser une reconstruction collective de compromis sociaux sur l'emploi et le travail.
Dans ce cadre, le dispositif Aubry est vécu comme une contrainte supplémentaire pour les acteurs de la négociation sociale et comme un coût pour les entreprises, qu'il s'agit de réduire notamment par le renforcement des gains de productivité. En ce sens, les négociations de branche sur la réduction du temps de travail sont menées pour renforcer une flexibilité du temps de travail de nature défensive, telle que définie par Robert Boyer (1986), notamment par l'augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires et l'annualisation des horaires de travail. La question de l'effet de la RTT sur l'emploi est substituée par celle de l'augmentation de la productivité du travail.
- Une logique "organique ", où la transformation des systèmes de mobilité s'est mise en oeuvre par de nouvelles formes de gestion des ressources humaines mieux adaptées aux nouvelles contraintes productives. Dans ce cadre, l'action publique met en oeuvre des dispositifs qui visent une transformation plus structurelle des espaces de qualification et une organisation du travail plus qualifiante au sein des entreprises et des branches.
Dans cette perspective, la loi Aubry est mobilisée comme un dispositif ressource, que les acteurs sociaux s'approprient par le jeu de la négociation. Les accords de branche sont engagés pour développer des compromis équilibrés entre réduction et aménagement du temps de travail, et envisager plus généralement la question des durées du travail et de l'organisation des temps de travail dans la branche pour les différentes catégories de salariés (cadres, temps partiel). La transformation des normes d'emploi et de la structure de qualification est également abordée à travers la mise en oeuvre de la RTT.
La mise en perspective d'une logique défensive et offensive ne correspond pas à la distinction telle que définit dans la loi, qui ne s'applique en l'occurrence qu'aux accords d'entreprises. Elle est utilisée dans un sens plus large.
|
Tableau 35 - Logiques d'accords de branche |
||
|
Accords de branche |
Industries |
Services |
|
Logique "mécanique", |
Métallurgie ; BTP : Industries chimiques : Industries de la viande ; Industries charcutières |
Services de l'automobile Banque ; Grande distribution |
|
Logique "organique" |
Industrie textile : Industrie de l'habillement ; Industries du sucre : Industries du secteur de coopératives agricoles ; |
Experts comptables : Entreprises de propreté ; Artisanat du bâtiment |
À l'intérieur de cette grille d'analyse, des groupes de branches peuvent être repérés, dont la philosophie et le contenu de l'accord sont très proches.
Dans une logique mécanique , trois pôles de négociations de branche sur la RTT peuvent être mis en perspective :
- Les branches de la métallurgie et du BTP , qui négocient une forte flexibilité du temps de travail, avec une augmentation du contingent d'heures supplémentaires à 180 h., une annualisation des horaires de travail autour d'une durée de 1645 heures/an, et des durées hebdomadaires du travail pouvant varier jusqu'au seuil maximal de 48 h. Ces accords contournent la philosophie initiale de la loi sur la réduction légale de la durée du travail, en développant de fortes flexibilités du travail qui augmentent les possibilités de gains de productivité des entreprises et limitent ainsi la possibilité d'un impact de la RTT sur la création d'emplois. Ces branches se situent dans une logique conflictuelle de négociation sociale, d'affrontement entre un patronat des grandes entreprises industrielles et le syndicat ouvrier alors majoritaire la CGT, logique traditionnellement présente en France dans les années 1950-80, tel que le "modèle industriel de la métallurgie" le met en perspective (cf. Encadré). L'objectif des accords est moins de représenter un modèle professionnel, que d'organiser à minima les différentes possibilités d'organisations du temps de travail des entreprises.
- Les branches des industries chimiques, des industries des produits du sol et du secteur des IAA -industries de la viande, industries charcutières, industries de la conserve , dont les élément de flexibilité sont importants : annualisation des horaires de travail, RTT comptabilisée autour d'une durée annuelle du travail, réduction du temps de repos quotidien, abandon des congés de fractionnement et d'ancienneté. Cependant, ces accords apportent malgré tout certains garde-fous : maintien du contingent des heures supplémentaires en deçà de la limite légale à 130 h., limitation des durées du travail du dimanche, création d'une indemnité différentielle pour compenser la RTT, engagement de recrutement des jeunes de moins de 26 ans. Les différentes dispositions négociées restent relativement larges, et comme pour la métallurgie ou le BTP, l'accord de branche ne fait pas réellement norme dans la gestion du temps de travail des entreprises. Ces branches se caractérisent à la fois comme des industries de process en amont (production en continue) et des industries de conditionnement (travail en équipes), avec une part importante de la main d'oeuvre féminine. Les marges de manoeuvre de ces branches en termes de gains de productivité sont donc assez faibles.
- Les branches des services automobiles, de la banque et de la grande distribution, caractérisées par des activités de services soumis aux fluctuations de fréquentation de la clientèle, où la négociation du dispositif de réduction de la durée du travail constitue un support non négligeable à la volonté des fédérations patronales de transformation et de régulation de l'organisation des temps travaillés des entreprises de ces branches. En effet, les accords de branche signés abordent de nombreux aspects de mise en oeuvre de la RTT : propositions de différentes possibilités de RTT (hebdomadaire, sous forme de repos supplémentaires, par l'annualisation des horaires), articulation du temps de travail et du temps de formation, organisation du travail pour les salariés à temps partiel ou pour la catégorie des vendeurs. Ils constituent en ce sens une forme de régulation de branche des pratiques de temps de travail des entreprises. Toutefois, l'ampleur de la flexibilité du temps de travail reste importante (annualisation, référence annuelle pour la RTT à 35 heures).
Dans une logique organique, on repère plus spécifiquement trois groupes de négociations de branche :
- Les branches de l'industrie textile, de l'habillement et de la chaussure, qui s'impliquent largement dans le dispositif des 35 heures, dans une optique de la négociation relativement offensive. D'une part, les accords signés incitent très directement les entreprises dans la mise en oeuvre et la négociation d'une réduction effective de la durée du travail D'autre part, les modalités de passage aux 35 heures prévoient des contreparties sociales importantes : modulation et non-annualisation des horaires de travail, avec un seuil horaire maxima assez limité, paiement des heures supplémentaires dès la 36e heure, précision du nombre de jours de repos pour l'encadrement assurant une RTT effective. L'ensemble de ces clauses forme un modèle professionnel de gestion des horaires de travail. Ces branches se caractérisent par une main d'oeuvre fortement féminine, relativement peu qualifiée et une situation de restructuration de l'emploi. En ce sens, la loi Aubry représente donc une opportunité pour poursuivre un travail de réflexion mené par les organisations professionnelles sur la question de l'emploi et du temps de travail.
Les branches de l'industrie du sucre et du secteur des coopératives agricoles (6 accords), qui s'inscrivent assez dans la philosophie initiale de la loi Aubry, en prévoyant une mise en oeuvre de la réduction de la durée légale du travail à 35 heures, sans prévoir une augmentation des heures supplémentaires. En ce sens, l'accord de branche de l'industrie du sucre a été cité comme exemple par Martine Aubry et a été étendu sans aucune réserve par le ministère du Travail. Les autres accords signés dans le secteur des coopératives agricoles prévoient une annualisation du temps de travail, mais qui se situent dans la continuité d'accords de RTT signés dans le cadre de la loi Robien 91 ( * ) . Dans ces branches composées d'entreprises assez hétérogènes, la loi Aubry semble permettre d'aborder par le biais de la négociation sociale des problèmes d'emploi et de transformation des qualifications assez importants.
- Les branches de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, des entreprises de propreté et des experts comptables, qui opèrent une application relativement directe et immédiate de la RTT à 35 heures. En effet, ces branches sont composées en grande partie par des PME. Les acteurs sociaux de la branche mobilisent cette mesure législative pour organiser et réguler les pratiques hétérogènes de temps de travail des entreprises, le plus souvent non dotées de représentants syndicaux. Ainsi, l'objectif des fédérations patronales est que l'accord de branche fasse norme ou modèle la gestion du temps de travail des entreprises.
|
Les logiques de la négociation de branche I Logique "mécanique" Métallurgie (1,7 millions de salariés)
ï Définition de trois types de forfait : forfait à la mission sans référence horaire pour les cadres et non cadres ; forfait avec référence à l'horaire annualisé à 1 610 h. ; forfait assis sur un horaire mensuel, pour les salariés autonomes, ne pouvant estimer un temps de travail ï Exclusion des temps de formation du temps de travail effectif ï Extension du dispositif de l'Arpe (cessation d'activité contre embauche) BTP (1,1 millions de salariés) ï Accord non signé par la CGT et la CFDT ï Annualisation des horaires de travail autour d'une durée annuelle de 1645 h./an, avec un seuil fixé à 46 h. et l'attribution d'une sixième semaine de congés payés
Industries chimiques (230 000 salariés)
Industries des produits du sol (15 000 salariés)
. Redéfinition du "temps de travail effectif", qui exclu les temps de douche, de casse-croûte, et des temps d'attente pour les chauffeurs . Négociation sans délégués syndicaux . Encadrement : RTT par l'octroi de 10 jours de congés supplémentaires Industries de la viande (65 000 salariés) . Accord non signé par la CGT et la CGC . Annualisation des horaires de travail sur la base de 35 h., avec une fourchette entre 21 h. et 45 h. . Maintien des heures supplémentaires à 100 h. . Travail du dimanche ne pouvant excédé 5 h. et avec une majoration de 100 % . RTT avec maintien des salaires par la création d'une indemnité différentielle bénéficiant aux nouveaux embauchés . Abandon des congés de fractionnement et d'ancienneté . Encadrement : RTT par l'octroi de 10 jours/an . Négociation sans délégués syndicaux Services automobiles (400 000 salariés) . Accord non signé par la CFDT . Trois modalités de RTT : un horaire hebdomadaire de 35 h. ; un horaire de 37 h. ou 39 h, avec l'octroi de jours de congés supplémentaires, de 12 à 24 jours ; une annualisation des horaires de travail, avec un seuil de 46 h. et 44 h. en moyenne . Contingent des heures supplémentaires porté à 182 h. pour les entreprises bénéficiant du dispositif d'aide publique de la loi Aubry (applicable à partir de la nouvelle durée légale) et de 130 h., pour celles ne bénéficiant pas des aides de l'Etat . RTT avec maintien des salaires . Deux types de forfait pour les cadres : un forfait annuel et un forfait mensuel avec des obligations sur le décompte des heures de travail . Dispositions précises pour le temps de travail des vendeurs, en limitant le nombre de dimanche travaillés à cinq/an. . Modification du régime des primes de formation-qualification Banque (200 000 salariés) . Accord non signé par la CGT, FO, CFDT et CFTC . Détermination d'une durée annuelle du travail à 1610 h. . Annualisation des horaires de travail . RTT sous forme de jours de repos : au niveau de la branche, 17 jours de repos dont 9 jours à la disposition des salariés et 8 jours ouvrés ; au niveau de l'entreprise : 12 jours de repos . Contingent des heures supplémentaires fixé à 120 h., pouvant être majoré de 70 h. sur les deux prochaines années, puis ramené à 110 h. . Définition de trois groupes d'emploi pour le travail au forfait de l'encadrement : cadres supérieurs avec un forfait sans référence horaire ; cadres de direction et cadres des activités de banque de marché ou d'investissement, avec une RTT de 3 jours de repos supplémentaires, cumulables sur un CET . Dispositif de préretraite progressive, concernant de 15 000 à 20 000 salariés Grande distribution (600 000 salariés) . Accord non signé par la CFDT . Annualisation du temps de travail avec une nouvelle référence conventionnelle horaire à 1603 h., avec la prise en compte des 7 jours fériés chômés et des congés payés . RTT sous forme de jours de repos, dont 30 % réservé au choix individuel du salarié . Annualisation des horaires de travail avec un seuil de 42 h. sur 12 semaines . Contingent des heures supplémentaires limité à 90 h., et 130 h. si accord d'entreprise . RTT avec maintien des salaires, accompagné par un mécanisme d'indemnité compensatrice sur trois ans
. Dispositif du compte-épargne-temps assoupli . Temps partiel : dans le cas dune modulation horaire hebdomadaire, garantie d emploi fixé à 26 h. au lieu de 22 h.
II Logique « organique » Industrie textile (143 000 salariés) . Accord signé par toutes les fédérations syndicales, après modification des propositions patronales . Incitation des entreprises à la mise en oeuvre d'une réduction effective du temps de travail
Industrie de l'habillement (130 000 salariés)
Industrie de la chaussure
Industrie du sucre (8 000 salariés)
. Application immédiate des modalités de RTT, avec un passage à 35 h. dès le 01 juin 1999 pour les salariés postés, et à 37 h. en juin 1999 et 35 h. au 01.01.2000, pour les salariés non-postés . Fixation d'une durée annuelle du travail à 1586 h. . RTT avec maintien des salaires, accompagnée par un mécanisme d'indemnité compensatrice . Encadrement : RTT de 2 h. en moyenne par semaine au 01 juin 1999 et de 4 h. en moyenne/sem. au 01.01.2000. RTT cumulée sur un compte-épargne-temps et co-investissement formation. Artisanat et petites entreprises du bâtiment (450 000 salariés) . Accord d'accès direct pour les entreprises de moins de 20 salariés . Application immédiate des 35 h. avant la 2ed loi . RTT à 35 h/sem, sur 4 ou 5 jours, avec une possibilité d'appliquer un horaire de 39 h. puis de 31 h. sur deux semaines consécutives, ou à 36 h/sem, avec 6 jours de repos supplémentaires . Deux types de modulation des horaires de travail : modulation de type III sur 6 mois, autour de 35 h. et avec un seuil de 42 h. : modulation avec un horaire de 39 h./sem et l'octroi de jours de congés supplémentaires de 24 jours dont certains restent à la discrétion de l'employeur . Maintien des heures supplémentaires à 145 h. . RTT pour les salariés à temps partiel, de l'ordre de 10.26 % . Instauration d'un compte-épargne-temps . RTT avec maintien des salaires Entreprises de propreté (286 000 salariés) . Accord non signé par la CGT. après avoir reconnu les avancées importantes de la fédération patronale . Application de la RTT dès le 01.07.99, avec une durée conventionnelle du travail à 35 h. . Modulation des horaires de travail autour de 35 h. avec un seuil de 00 à 44 h. . Augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires de 130 h. à 190 h. . RTT pour les salariés à temps partiel, avec une revalorisation de leur salaire sur trois ans de 11 %, pour s'aligner sur le personnel à temps plein . Encadrement : RTT par l'octroi de jours de congés, de l'ordre de 2 jours/mois Experts comptables (120 000 salariés) . Accord non signé par la CGT-FO . Application immédiate de la RTT avec une durée conventionnelle du travail ramenée à 35 h . RTT par l'octroi de jours de repos supplémentaires, de 22 jours si maintien d'une durée hebdomadaire de 39 h. . Modulation des horaires de travail autour de 35 h., avec un seuil de 48 h. et 44 h. . Contingent des heures supplémentaires limité à 90 h. ; Majoration de 10 % des heures effectuées entre 35 h. et 39 h., et majoration légale au-delà de 39 h. ; . Deux types de calcul du "temps de travail effectif" : un temps budgété de 1596 h./an pour le personnel itinérant non autonome et un volume d'activité annuel pour le personnel autonome . Accès direct de la RTT pour les entreprises de moins de 50 salariés, avec trois possibilités de RTT : 35 h./sem, attribution de 22 jours de repos supplémentaires ; modulation autour de 35 heures. |
La caractérisation des négociations de branche sur la RTT selon une logique organique ou mécanique nécessite d'être mise en relation avec ce que l'entreprise négocie et met en oeuvre au niveau décentralisé. Il s'agit d'interroger sur le mode d'articulation entre le niveau de la branche et le niveau avec les entreprises dans la négociation sur les 35 heures, sachant que traditionnellement cette relation entre les différents niveaux de négociation n'a jamais été de nature homogène en France.
Ainsi, dans la dynamique contractuelle sur la RTT, on peut envisager deux options : soit les accords d'entreprises se concentrent dans la même logique que celle définie pour les accords de branche, soit les accords d'entreprises se situent dans une logique très différente de celle repérée pour la branche.
2.3. Typologie des accords d'entreprises
La typologie classe les accords selon leur mode de recherche de compétitivité et leurs effets potentiels sur la viabilité des emplois crées ou maintenus
La seule définition institutionnelle des accords offensifs et défensifs ne suffit pas à déterminer le sens et la logique du projet de RTT, inscrit dans la cohérence d'ensemble de l'entreprise par rapport à un projet stratégique et à une implication dans une pratique du dialogue social. Aussi, la typologie proposée "croise" les critères institutionnels défensif/offensif avec différents types de stratégie de compétitivité dont les accords sont une expression partielle. Ces différentes stratégies étaient au nombre de quatre :
- Une stratégie comptable : le mode d'entrée est essentiellement lié à une volonté de réduire le poids des coûts salariaux (qu'il s'agisse d'accords offensifs ou défensifs),
- Une stratégie productiviste : l'objectif est de contourner le plus efficacement possible le principe initial de la loi pour assurer la possibilité d'aménagement du temps de travail à même de garantir la recherche intensive de gains de productivité du travail et du capital (les accords sont ici de nature plutôt défensive),
- Une stratégie coopérative : la direction de l'entreprise cherche par la concertation un compromis équitable entre les différents partenaires sociaux ; parmi les termes de l'accord, sont en jeux l'aménagement du temps de travail, la création d'emplois non précaires et l'amélioration des conditions de vie des salariés en termes de recherche de compatibilité des temps sociaux (temps de travail pour l'entreprise, temps d'activités domestiques, temps de formation, congés familiaux..),
- Une stratégie mutualiste : Elle consiste à inscrire la réduction du temps de travail dans une reconfiguration de l'organisation interne du travail, des modalités de gestion et de construction des compétences, sur la base d'une mise en relation étroite avec son environnement (en terme d'espace territorialisé et de réseaux de partenaires) dans lequel elle puise, et à la transformation duquel elle participe. Cette stratégie globale vise à acquérir une autonomie en termes de capacité d'innovation du point de vue technologique, financier et en termes de services et de produits.
Tableau 36 - Accords d'entreprise et type de recherche de compétitivité
|
Accords offensifs |
Accords défensifs |
Accords non aidés |
||
|
Stratégie comptable |
PME de la Paca |
Tannerie R. |
||
|
Stratégie productiviste |
FBFC, Chausseur CJ |
PSA |
||
|
Stratégie coopérative |
Sans Frontières. |
Entremont |
La Poste F.DF-GDF 92 ( * ) |
|
|
Stratégie mutualiste |
Les Chantiers de l'Atlantique, Cablerie St Antoine |
Carrefour |
Les effets potentiels de la RTT sur l'emploi, à moyen long terme, dépendent des hypothèses faites sur le nombre d'entreprises inscrites dans l'une ou l'autre de ces différents types et des capacités dont elles se doteront pour se déplacer d'une catégorie vers l'autre.
2.3.1. La stratégie comptable
Les modalités d'entrée dans le dispositif des 35 heures décrites ici ne concernent que des accords d'entreprise. Elles correspondent à une stratégie de petites entreprises (principalement entre 20 et 50 salariés) que l'on peut répartir en deux groupes : un groupe de PME indépendantes traditionnelles 93 ( * ) (hôtellerie, restauration, métallurgie) et un groupe d'entreprises entrepreneuriales 94 ( * ) créées dans les nouvelles activités de services (par exemple issus de nouveaux services aux entreprises, aux particuliers ou de l'exercice de professions libérales : cabinets médicaux, de comptables,..) ou modernisées à la suite de succession ou de reprises (agroalimentaire). Deux types de raisonnement qui peuvent se combiner, conduisent ces PME ou ces Très Petites Entreprises à demander l'aide publique pour la réduction du temps de travail. Soit, elles perçoivent l'opportunité de l'aide dans une perspective de croissance importante de l'activité, soit, elles anticipent (effet cliquet) sur le choc d'une loi qui s'appliquera de toute façon, et dont il vaut mieux profiter en termes d'aides dans la phase préparatoire.
Pour les PME traditionnelles, les informations qui remontent des enquêtes de terrain montrent qu'il existe une liaison importante entre une mauvaise connaissance de la loi et le fait que ces entreprises ne manifestent pas de stratégies construites de recherche de viabilité à moyen-long terme en termes de transformation des exigences productives. Cela signifie que les responsables d'entreprises de ce type ne manifestent pas l'intention de s'engager dans des projets liés à des transformations de modalités de gestion, d'organisation du travail ou de leurs relations sociales. Les préoccupations de viabilité de l'entreprise exprimées par ces responsables restent principalement centrées autour de la contrainte très forte du poids des « charges patronales ».
Ces entreprises se trouvent souvent sur des segments d'activité qui peuvent être en croissance ou stabilisés (services aux entreprises et aux particuliers), mais qui peuvent être également menacés par une exigence de délocalisation de la part des donneurs d'ordres (la Tunisie, La Réunion, pour certains segments d'activité dans l'aérospatiale par exemple). Le dispositif d'aide publique qui précède la généralisation de la loi représente pour elles une opportunité leur permettant de modérer à la fois le coût salarial et l'impact du passage obligé à la loi dans un avenir proche. Leur réaction consiste à entrer dans le dispositif, essentiellement du point de vue de la réduction des « charges », permise dans une perspective de gestion des effectifs qui reste quantitative (embauches ou réduction). Cette forme de gestion quantitative des emplois prime sur (voire exclut) la réflexion sur les transformations de l'organisation du temps de travail et encore plus sur l'organisation du travail et des compétences.
De plus, ces PME se caractérisent en majorité par l'absence de représentants syndicaux et d'une pratique de négociation régulière, sur le temps de travail ou d'autres thèmes. La direction est le plus souvent à l'initiative des négociations, invitant fortement un des salariés à prendre en charge le dossier, par la procédure de mandatement. Ainsi, les entreprises ont une très faible connaissance des mécanismes d'aide publique de la loi Aubry, vécue comme un dispositif supplémentaire et complexe à mettre en oeuvre.
Pour illustrer cette logique, peut être cité le cas d'une entreprise qui recrute une personne non pas pour réfléchir à la négociation de la RTT et à la réorganisation du temps de travail, mais pour calculer précisément le coût de la mesure. Elle envisage alors, avec l'aide des contrôleurs de gestion, les façons de réduire ce coût par un calcul des différents temps de travail productifs ou non productifs (temps de pauses, de douche, de casse-croûte, passage des consignes.).
Néanmoins les entreprises de type PME traditionnelles, possèdent des bases de compétences et des savoir-faire artisanaux que des salariés peu qualifiés ont appris sur le tas. Ces savoir-faire se sont transmis et améliorés de génération en génération. En cela, elles restent des ressources importantes pour des marchés de proximité, des co-traitants, ou des donneurs d'ordre, même si ceux-ci manifestent des pressions croissantes en termes de coût des produits, de qualité et fiabilité sur les délais. Certaines d'entre elles sont sur certains aspects en dehors du cadre légal du droit du travail avec ou non l'assentiment des salariés (législation sur les heures supplémentaires, sur l'utilisation intensive de CDD, sur le licenciement). Les compétences du management restent très imprégnées du mode de gestion paternaliste. Cette gestion est caractérisée par une faible capacité à s'intégrer dans des réseaux d'échanges d'informations et de connaissances de nature industrielle pour favoriser l'adaptation de leurs entreprises à l'évolution des contraintes productives. Cependant la forme artisanale de l'entreprise, qui repose sur une faiblesse de la codification de l'organisation et de la hiérarchie intermédiaire, peut procurer des marges d autonomie dans les tâches d'exécution qui favorisent des adaptations progressives du processus de production. Cette capacité d'adaptation est d'autant plus importante que les salariés sont en contact avec des clients ou des fournisseurs. Néanmoins, une partie des responsables de ces entreprises, éprouve des difficultés croissantes à gérer un changement qu'ils perçoivent comme s'accélérant et qu'ils subissent plus qu'ils ne précédent.
Les indicateurs d'analyse des accords sont principalement les suivants 95 ( * ) :
- Lorsqu'il y a compensation salariale la révision du système de prime permet de rattraper cette compensation salariale.
- Les accords sont de nature offensive, ce qui correspond à une double logique d'effet d'aubaine et d'effet cliquet de la loi, le second étant plus important que le premier.
- Les heures supplémentaires ou le temps partiel restent importants.
- Il n'y a pas d'annualisation, mais de nombreux type d'horaires inscrits dans le cadre d'une modulation.
- Il n'y a pas de réelle concertation avec les salariés, c'est la direction qui impose sa démarche et demande à un salarié de se faire mandater.
Les accords, majoritairement de nature offensive, ne sont pas liés à une réflexion sur l'amélioration de l'efficacité productive dans le cadre d'une augmentation des parts de marché. Sur de telles bases, la viabilité des emplois recrutés dépend à moyen terme d'une stabilité des marchés associée à de faibles ruptures dans les évolutions de la concurrence, des technologies et des contextes de valorisation de services et produits.
Pour des entreprises de ce type (par exemple des PME de type artisanal ou commercial des secteurs de la maçonnerie, de la menuiserie-ébénisterie. de la coiffure ou de l'esthétique, du commerce de proximité, de la restauration ou de l'hôtellerie), l'application d'une loi sur la RTT à un effet sur l'emploi d'une très grande incertitude. Il dépendra des stratégies de compétitivité qui, seront retenues. Prenons par exemple le cas de TPE artisanales qui n'embauchent pas alors que leurs carnets de commande sont pleins. En cas de réduction du temps de travail généralisée (comme le prévoit l'application de la loi. en 2002), ces entreprises sont confrontées à trois types de stratégies possibles.
La première dépend du nombre de salariés nécessaires pour qu'une réduction du temps de travail nécessite une compensation en termes d'embauche. Si l'on estime un temps travaillé d'environ 42 heures pour cinq personnes salariées, ce temps correspond à un temps de travail de 35 heures pour six personnes à temps plein, ou 35 heures pour cinq personnes à temps plein et deux à temps partiel. Dans ce cas-limite, ou l'effet de partage peut pleinement jouer, et au-dessous de ce seuil, un ensemble de TPE dont l'activité fluctue de façon imprévisible ne souhaitera pas s'engager dans un recrutement en CDI à temps plein ou partiel En effet, après avoir utilisé le volant d'heures supplémentaires disponibles ou, éventuellement augmenté un temps partiel, en estimant les CDI trop "rigides", elles peuvent être amenées à refuser de satisfaire une demande qu'elles ont suscitée. Dans ce cas, les effets de la loi appliquée correspondront à un "déversement" de cette demande sur de nouvelles entreprises créées ou moins entrepreneuriale. La contrainte de la loi sur la RTT se transforme en contrainte sur la création d'entreprises et sur la capacité entrepreneuriale de PME et TPE à être présentes selon l'évolution de nouvelles exigences productives.
Dans le cas d'effectifs qui tendent à être supérieurs à cinq, ces entreprises se trouvent confrontées à l'alternative suivante.
Elles peuvent être tentées d'embaucher de la main d'oeuvre qualifiée et expérimentée (de type Ouvriers Qualifiés ou Ouvriers Hautement Qualifiés en termes de classification), donc immédiatement opérationnelle et autonome. Dans ce cas, le coût salarial qu'elles vont payer s'élève proportionnellement au niveau d'exigence cette catégorie de salariés (plus rarement au chômage), alors que pour certains secteurs, les prix de ventes peuvent rester trop bas 96 ( * ) par rapport aux prix de revient (exemple de PME dans le secteur du bois et de l'ameublement ou de maçonnerie dans le BTP). De plus, comme elles ont malgré tout des variations d'activité, elles vont appréhender à s'engager dans la conclusion de contrats à durée indéterminée, n'ayant aucune connaissance de ce que signifie l'annualisation en termes de relâchement de contrainte et éprouvant des difficultés à concevoir les horaires de travail dans ce cadre nouveau. Une enquête de l'AGEFOS PME publiée en 1998, montre d'ailleurs que si les PME embauchent en CDI (24 %), la formule de préférence pour recruter un jeune est celle du CDD (31 %) et non celle d'un contrat d'apprentissage (18 %) ou de qualification (22 %). Par rapport à l'emploi, le principal problème posé par cette catégorie d'entreprise est alors celui du non-renouvellement des CDD, donc de leur turn-over. Il les conduit souvent à renoncer au volant d'activité supplémentaire. Elles peuvent également s'engager dans un dispositif de formation professionnelle en alternance, pour pouvoir recruter la main d'oeuvre formée. Dans ce cas, la faiblesse du niveau de qualification des personnes à former est souvent corrélative d'une forte incertitude sur les compétences sociales des personnes (du type respecter les horaires de travail, ne pas avoir peur de faire, mettre en oeuvre une intelligence pratique..) qui limitent leurs capacités socio-cognitives à apprendre le métier. Cette incertitude est alors perçue comme un risque trop important en termes d'investissement et de temps, ce qui pousse à ne pas entrer dans ce type de dispositif de formation sauf dans un objectif délibéré d'aide sociale. C'est ce que montre le résultat de la même enquête réalisée par l'AGEFOS PME en 1998. Selon cette enquête, 46 % des responsables de PME sondés qui ont déjà utilisé un dispositif de formation en alternance, considèrent que ce dispositif correspond à «une aide pour l'insertion ou la formation des jeunes», et 40 % d'entre eux considèrent que cette formation correspond « au premier pas d'un jeune dans l'entreprise». Seulement 12 % d'entre eux considèrent que cette formation correspond à «la réponse d'un besoin interne de qualification». Ce dernier chiffre renvoie à la remarque faite au-dessus quant à l'importance, accordée par les PME susceptibles de recruter, soit à une qualification en termes de combinaison de diplôme et d'expérience acquise, soit à une faible qualification mais corrélative de savoirs d'actions importants associés à des compétences sociales 97 ( * ) .
Ces différentes remarques invitent à être prudent quant aux effets positifs attendus d'une combinaison entre une RTT et une réduction des «charges» payées par les employeurs sur les bas niveaux de qualification, afin d'inciter à l'embauche. En effet, il semble que l'arbitrage réalisé par les entreprises dans cette configuration face au choc introduit par une RTT consiste d'abord à augmenter le nombre d'heures supplémentaires même au-delà de la légalité, soit à embaucher des CDD. Du point de vue de la mise en oeuvre de la loi dans des TPE, l'alternative cohérente avec la création d'emploi paraît être celle d'une annualisation pour des temps partiels. Mais alors se pose la question de la qualité de l'emploi créé pour subvenir aux besoins des salariés et celle de la combinaison de plusieurs emplois que ceux-ci peuvent être amenés à accepter pour l'obtention d'un revenu supérieur. Les entreprises concernées par ce type d'emploi, sont majoritairement des entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50, et dont les effectifs globaux représentent plus de la moitié des effectifs salariés en France. C'est de plus la catégorie d'entreprise qui continue à créer le plus d'emploi (cf. tableau ci-dessous). C'est le constat de la précarité de l'emploi dans ces types d'entreprises, désormais jugée inévitable par certains auteurs, qui les conduit à proposer la solution, controversée, du « contrat d'activité » comme substitut au contrat de travail classique à temps plein et à durée indéterminé dont ils font le deuil (Boissonnat, 1995 ; Supiot, 1995). Une autre alternative serait de créer les conditions d'une plus grande stabilité de l'emploi dans ces entreprises. La fiscalité peut être utilisée à cet effet, à l'instar d'une transformation de l'assiette de financement de la protection sociale ou modulation des cotisations en fonction de la part des salaire dans la valeur ajouté en faveur de ce type d entreprise qui recrute, comme cela a été suggéré dans le chapitre précédent.
Tableau 37 - Structure des effectifs salariés selon la taille de l'établissement
au 1 er janvier de chaque année en France de 1975 à 1995 (en %)
|
1975 |
1980 |
1985 |
1990 |
1995 |
||
|
1 à 9 salariés |
18.4 |
20.8 |
23.2 |
24. |
26.0 |
|
|
10 à 49 salariés |
24.6 |
26.1 |
27.3 |
28.7 |
28.8 |
|
|
50 à 499 salariés |
36.3 |
34.9 |
34.0 |
34.5 |
34.2 |
|
|
500 salariés et plus |
20.7 |
18.2 |
15.5 |
12.6 |
11.0 |
|
|
ensemble |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
Source : Assedic
2.3.2. La compétitivité "productiviste"
Les entreprises inscrites dans ce style de politique témoignent de leur volonté de mettre en oeuvre des politiques actives permettant de regagner des marges de liberté par rapport au code du travail en matière de flexibilisation du temps de travail. Leur caractéristique commune est qu'elles sont des donneurs d ordres ou sous-traitants dans des secteurs ou des marchés globalisés (donc avec des délocalisations ou des investissements à l'étranger importants) avec une concurrence à tendance oligopolistique. Mais, compte tenu des modalités de financement du capital (actionnariat international), elles restent très attentives à leurs coûts de production (notamment salariaux) et à l'importance des marges réalisées. Ces entreprises sont principalement des entreprises du secteur industriel de plus de 500 salariés (exemple de PSA), mais elles peuvent être également des PME qui ont été intégrées dans des groupes ou des holdings et qui rationalisent ou délocalisent leur production (exemple de la chaussure avec Chaussure CI ou de l'énergie avec FBCF).
En termes de relations professionnelles ou de concertation et négociation collective, c'est toujours le modèle traditionnel de négociation «à la française» qui est à l'oeuvre, c'est-à-dire un modèle conflictuel par essence (sur la base de positions idéologiques et non gestionnaires). Comme cela a déjà été souligné dans la typologie des accords de branche, les négociations collectives ne remettent pas fondamentalement en cause la norme d'emploi et la norme salariale issue de la période des «trente glorieuses», avec son noyau dur de salariés en CDI non mobiles. Du coup, le mode d'adaptation de cette norme, que nous avons appelé «mécanique», reste le maintien d'un marché du travail périphérique, en partie externalisé par la sous-traitance, dont la précarité des emplois est récurrente et liée à une faiblesse de l'expérience accumulée dans l'entreprise. Le maintien de cette norme de référence peut être exemplifié par l'historique de la négociation de l'accord de PSA dont le projet initial n'avait finalement reçu l'approbation d'aucune organisation syndicale.
Cependant, ces entreprises, conformément à la logique mécanique de branche, ne se contentent pas d'aménagements à la marge pour mettre en oeuvre une RTT. Elles s'emparent du dispositif selon les accords-cadres négociés et travaillent sur une réorganisation du temps de travail (ou son amélioration lorsqu'il y a déjà eu des transformations importantes dans le cadre d'accords Robien par exemple) (voir ci-dessous, les fiches résumées sur les accords de ce type).
Du point de vue de l'organisation du travail, il faut distinguer les établissements industriels, des établissements ou filiales de type plus artisanal. Dans les établissements de type industriel, l'organisation a déjà été rationalisée dans le courant des années 1980-1990 à plusieurs reprises, en particulier sur la base de départs massifs dans le cadre des plans sociaux, combinés à une automatisation des processus de production et la recherche de principes de gestion de la qualité et des délais. Du point de vue des modalités de gestion des ressources humaines et de construction des compétences, dans les grands établissements industriels, l'implication des personnes au travail se fait par l'attribution d'un statut (ou d'un rang que l'on mérite) (Iribarne et Iribarne, 1999) et non d'un rôle qui peut être évolutif. Il subsiste donc des inerties organisationnelles et des cloisonnements entre différentes catégories de personnels (ingénieurs, techniciens, ouvriers par exemple) et d'activité (commercial, marketing et RD par exemple) sur la base d'une logique de distinction. Les salariés ouvriers et techniciens ont acquis une plus grande autonomie mais l'activité de contrôle persiste, ce qui est cohérent avec l'attribution d'un rôle encore confiné dans une logique d'exécution et non de conception. Ce qui laisse penser qu'au sein de cette forme industrielle de production subsistent des éléments du modèle productif taylorien pour lequel l'intensification du travail (en particulier dit d'exécution) reste un repère fondamental. L'exclusion du temps de pause, et du temps de formation, d'habillage, pour la plupart de ces accords, dans la comptabilisation des heures de travail effectif fait partie de cette logique (cf. les fiches ci-dessous résumées sur les accords).
De ce point de vue, les PME inscrites dans ce type de logique même si elles se sont moins industrialisées, n'ont pas échappé à une forme de division du travail cloisonnée en grandissant. C'est ce dont témoignent par exemple les indicateurs de la réalisation de l'accord dans une entreprise indépendante du secteur du cuir (tanneries R., effectif : 101). La négociation d'un accord défensif dans le cadre de la loi sur les 35 heures et sa mise en oeuvre ont conduit l'entreprise à réfléchir sur la question de la polyvalence entre ses ateliers. On observe donc que la loi atteint bien, dans certains cas, un objectif indirect important pour la viabilité de l'entreprise : celui d'une transformation des compétences et d'une plus grande souplesse organisationnelle. Cependant, le risque encouru dans les entreprises de ce type qui négocient et mettent en oeuvre de tels accords, porte sur les effets pervers, qu'elles peuvent développer, en rationalisant les temps travaillés dans une logique de temps de production au sens strict et donc en limitant les temps d'échanges entre salariés, dont une partie consiste à réguler peu ou prou leur propre système de travail.
Les indicateurs des accords inscrits dans ce type de recherche de compétitivité sont les suivants :
- Annualisation ou modulation avec travail le week-end en principe non basé sur le volontariat.
- Plages d'heures supplémentaires conservées ou même agrandies (même au delà du maximum légal) car peu de traduction de la réduction des 35 heures en emplois, plus de douze semaines consécutives chargées en horaires maximum, etc..
- Les 35 heures ne sont pas reliés à la question de la précarité de l'emploi et faiblement à celle de l'embauche.
- Pour les temps de pause, d'habillement, de casse-croûte, les temps de formation, la tendance est à leur suppression complète dans le temps effectif travaillé.
- La durée d'utilisation des équipements est augmentée.
À ces indicateurs, il faut ajouter ceux relevant de l'analyse du discours du management, qui montre que le travail est perçu comme un facteur qui coûte cher ou auquel sont associées de contraintes qu'il faut relâcher. Ce facteur est par ailleurs considéré comme moins fiable que des machines, auxquelles tendanciellement on continue de le substituer, dans la mesure du réalisable.
Compte tenu de ces différentes remarques, on peut supposer que les effets positifs des accords d'ARTT en termes d'amélioration du taux d'utilisation des équipements et de la productivité du travail sur la base d'une annualisation du temps de travail, permettent des gains en termes de coûts salariaux. Néanmoins, ces effets potentiellement positifs peuvent être contrebalancés par une difficile progression dans la réactivité, en terme d'innovation et de qualité, sur des marchés non expansionnistes. Enfin, du côté des salariés, les accords de nature défensive en particulier dans le cadre de fausses PME (c'est-à-dire d'entreprises appartenant à des groupes) ne laissent rien envisager en maintien d'emploi au-delà d'un terme de deux ans.
La question qui reste alors posée dans ce cadre de l'analyse est celle de la viabilité des emplois ainsi que celle de la capacité à une mobilité professionnelle entre des entreprises, ou d'un secteur vers un autre, dans la mesure où la pérennité de l'emploi à moyen terme dans ces entreprises, appartenant à de grands groupes, n'est plus assurée dans l'ensemble.
|
PSA : stratégie productiviste dans le cadre d'un accord non-aidé Accord cadre sur le temps de travail, l'emploi et la formation, concernant 92 000 salarié, signé par la CFDT, FO, CGC, et accompagné de négociations sur le départ en préretraite de près de 12 500 personnes de plus de 57 ans sur 5 ans, contre le recrutement de jeunes à raison d'une embauche pour trois départs (Arpe, aide publique au titre des départs anticipés de salariés âgés) - Passage aux 35 heures, sans baisse de rémunération, au tiers septembre 1999 - Réduction du temps de travail sous forme de baisse de la duré hebdomadaire, d'une diminution quotidienne ou de l'attribution de jours non travaillés - Engagement de 5 600 embauches, dont 3 000 au titre de la RTT - Annualisation des horaires de travail, avec comme contreparties faisant suite aux négociations avec les syndicats, le paiement d'une prime de 500 F par mois et l'octroi de jours de repos - Introduction du travail du samedi dans la semaine de travail, avec comme compensation la liberté d'utilisation des 11 jours de congés supplémentaires - Modification des règles de décompte des pauses, rémunérés mais non prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif, soit une durée du travail ramenée de 38 h 30 à 36 h 40 - Assouplissement du compte-épargne-temps -Temps de travail des cadres soumis à un régime de forfait sans référence horaire, avec une RTT par l'octroi de 11 jours de congés supplémentaires. Chaussure CJ : accord défensif, stratégie productiviste Cet accord est conclu dans le cadre d'un établissement d'une société qui délocalise son activité vers d'autres pays (Espagne, Italie, Portugal). Sa marque est déposée en Suisse. Les coûts de fonctionnement de cet établissement qui était un siège, comprennent les charges liées à la fabrication des prototypes et à la gestion d'un réseau commercial qui s'autonomise, à partir de la politique globale du groupe. Les caractéristiques principales de l'accord sont les suivantes : - 570 salariés sur le site vont passer à 35 heures payés 37h 30 (ce qui correspond à une baisse de pouvoir d'achat d'un mois de salaire à 5200 frs.). Il n'y a pas de compensation pour les salariés au SMIC qui perdent en pouvoir d'achat un mois de salaire - Les salaires sont gelés sur deux ans - L'annualisation comprend des jours allant de 0 heure à 8h 45 - Il n'y a plus de majoration pour les heures supplémentaires effectuée en dessous de 41 heures, ni de repos compensateur - Les nouveaux embauchés sont payés au temps de travail réduit non compensé - Les syndicats n'ont pas eu le temps de la négociation, signature de l'accord sous la pression du licenciement FBCF (fabricant de combustible pour le nucléaire ) : accord défensif, stratégie productiviste Cette entreprise qui est un établissement de 1100 personnes d'une grande société, est amené à réduire ses effectifs dans le cadre d'un plan social pour faire face à une réduction des commandes. L'accord défensif permet de sauvegarder 83 emplois. Cet accord prévoit : - Une annualisation sans diminution du salaire sur la base des 39 heures - Le pointage dans les ateliers - Une modération des augmentations salariales pendant trois ans - Une variation des primes de poste - L'accord ne vaut que pour deux ans Pour les délégués syndicaux le problème posé par ce type d'accord est l'incertitude sur l'avenir des emplois sauvés ou même sur d'autres emplois, puisque ces emplois dépendent des décisions qui seront prises au niveau du groupe. Tanneries Roux : accord défensif, stratégie productiviste Cet accord est réalisé dans le cadre d'une réduction d'effectif d'une usine répondant à une chute des exportations en Asie. La direction se saisit de l'accord pour réorganiser le travail en vue d'une amélioration de sa productivité. Les principaux éléments de cet accord sont les suivants : - Les 35 heures travaillées sont payés 39 heures - le licenciement de 7 personnes est évité sur un effectif de 101 - L'annualisation du temps travaillé prévoit un horaire minimum de 27 heures et un horaire maximum de 42 heures (qui ne doit pas dépasser 12 semaines par an) - Les heures seront contrôlées par un compteur - Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures seront rémunérées à 120 % - L'augmentation salariale est limitée à 2 % sur cinq ans - Les pauses-café et le temps d'habillage ne rentrent plus dans le l'horaire rémunéré ( 1 h 30 par semaine) - La réorganisation du travail prévoit une augmentation de la polyvalence entre ateliers |
2.3.3. La «compétitivité coopérative»
La politique de l'accord est dite coopérative lorsque les acteurs se saisissent de la loi sur 35 heures pour traiter simultanément de l'évolution des exigences productives l'entreprise, des aspirations des salariés en ce qui concerne les modes de vie, de lutte contre la précarisation ou le chômage. Jusqu'à un certain point, ces trois aspects ne paraissent pas antagoniques pour des entreprises déjà inscrites dans une trajectoire de modernisation de l'organisation et des modes de gestion et de négociation collective.
Dans quelques grandes entreprises industrielles, la mise en oeuvre de la RTT et des 35 heures s'inscrit dans un processus plus large de négociations permanentes sur les horaires de travail, les salaires et primes, l'emploi (Sollac, Eurocopter). Dans certains cas, l'application de la RTT vient perturber l'existence d'un système d'organisation du temps de travail déjà relativement négocié et stabilisé et entraîne des conflits dans l'entreprise (cas d'une grande entreprise de transport, où ont été observés des conflits sur l'organisation des différents temps de travail des chauffeurs).
Dans d'autres entreprises de taille moyenne, la mise en oeuvre des 35 heures infléchit une réflexion plus générale sur l'organisation du temps de travail. C'est le cas d'entreprises du commerce de gros (entrepôts d'habits), avec une majorité de femmes à temps partiel et d'intérimaires, où l'accord a permis d'aborder plus généralement les questions de gestion de main d'oeuvre, d'organisation de la production et de réfléchir sur la qualité du travail. C'est aussi le cas d'une entreprise sous-traitante de donneur d'ordre du nucléaire, où l'accord de RTT a permis de réguler la charge de travail de l'entreprise liée aux commandes d'EDF.
Les principaux indicateurs révélateurs de ce type d'accord sont les suivants :
- Réorganisation concertée du travail en relation en fonction de l'évolution du marché à l'occasion de la négociation sur les 35 heures - Augmentation de la durée d'emploi des temps partiels qui le souhaitent (La poste, Nouvelles Frontières)
- Réduction structurelle du nombre de CDD
- Dans te cas d'accords défensifs, résorption par la seule RTT de l'ensemble des suppressions d'emploi envisagées dans le plan social
- Maintien des salaires et modération salariale
- Aspect stratégique et concerté de la conduite du changement
- Pas d'exclusion des temps de pause dans l'entreprise, ni des temps de formation
- Suppression ou réduction des supplémentaires au-delà des dispositions (exemple de la poste)
- Pratique de la concertation pour préparer la négociation d'accord
- Volonté de ne pas constituer une segmentation dans les statuts d'emplois au sein de l'entreprise (homogénéisation du marché interne).
Ce type d'accord est le fait d'entreprises qui font, preuve d'une capacité d'innovation sociale qui, leur, permet de remettre en question, du point de vue de leur fonctionnement interne, la norme d'emploi atypique associée à une segmentation du marché du travail. La réduction du temps de travail est pour elles le moyen d'opérer cette transformation. On peut prendre pour exemple de ce phénomène La Poste qui se saisit de la loi pour pallier la réduction du noyau dur fonctionnarisé (qui diminue naturellement par les départs à la retraite, les recrutements de contractuels remplaçant les départs de fonctionnaires) pas l'embauche de
contractuels dont la précarité est réduite dans le cadre des accords (CDI au lieu de CDD). En termes d'effet potentiel sur l'emploi, le moyen terme de ce type accord négocié dans une perspective de performance plus globale (adaptation à de nouveaux marchés en termes de produits, services), a entre autres comme enjeu la reconfiguration du rôle de cadres dans l'entreprise à l'occasion de la réduction de leur temps de. Il s'agit en particulier, sur la base d'une réflexion sur de nouvelles formes d'organisation, de créer les conditions d'une catégories socio-professionnelles. De ce point de vue, l'efficacité de la loi en terme de viabilité à moyen terme des emplois créés ou maintenus est bien réelle.
|
EDF-GDF : stratégie coopérative dans le cadre d'une aide structurelle de l'État Accord cadre sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, portant sur 141 000 salariés, signé par les cinq organisations syndicales, et qui vient remplacer l'annulation de l'accord précédemment signé en janvier 1997 sur les 32 heures - Réduction du temps de travail de 38 heures a 35 ou 32 heures au tiers octobre 1999 (au choix du salarié), avec compensation salariale - Création d'emplois de 3 000 à 5 000, avec l'embauche de 18 000 à 20 000 jeunes et le départ de 15 000 agents en retraite ou départ anticipé - Aide structurelle de 600 millions de F sur trois ans - Introduction d'un temps de travail aménagé, avec des amplitudes d'activités élargies sur la journée ou semaine, ou variables sur l'année - Clauses accompagnant la RTT dans un accord de modération salariale, avec une augmentation de 0,6 % du salaire de base au tiers janvier 1999 Nouvelles frontières : accord offensif, stratégie coopérative Cet accord concerne l'ensemble des personnes (1400 salariés concernés) sauf accompagnateurs et animateurs et informaticien (jusqu'à fin 1999) - Il présente trois formules de RTT, la majorité des salariés a choisi b semaine de 40 heures en cinq jours et 28 jours de congés supplémentaires par an, dont un jour par mois et 16 jours bloqués à prendre pendant les périodes creuses - Les salariés à temps partiel peuvent demande un temps plein - Les temps de pause dans l'entreprise sont compris dans l'horaire effectif de travail - Les heures supplémentaires restent soumises aux dispositions légales actuelles - L'entreprise recrute 8 % des effectifs concernés par la RTT (104 personnes) - Les effectifs sont maintenus pendant cinq ans - Aucune distinction en terme salariaux entre nouveaux cl anciens salariés - Modération salariale Entremont : Accord défensif, stratégie coopérative - Sauvegarde de l'emploi par b réduction et l'aménagement du temps de travail dans le cadre d'un plan social à l'issu d'une perte d'un important marché - Maintien des emplois : l'accord permet de résorber par b seule RTT. l'ensemble des suppressions d'emploi envisagées dans le plan social, une convention de maintien de l'emploi à cinq ans est signée avec l'État - Exclusion des cadres : les cadres continuent à bénéficier d'une augmentation salariale mais restent au forfait tout horaire. - -Encouragement au temps partiel choisi : dégressivité et complément de salaire de 5 % versé aux personnes qui passent d'un temps plein à un temps partiel - Temps partiels réduits proportionnellement à leur temps de travail - Achèvement d'une réorganisation interne - Maintien et gel des salaires - Paiement des heures supplémentaires remplacé par un repos compensateur non cumulable d'une année sur l'autre - Temps de pause porté de 15 à 20 minutes pour les postes à activité ininterrompue - Un seul syndicat dans l'entreprise (FO) La Poste : accord non aidé, stratégie coopérative - Passage à 35 heures pour l'encadrement et les commerciaux - Le passage à 35 heures pour ces deux catégories amène l'entreprise à réfléchir sur une adaptation négociée de l'organisation de leur travail et compétences - Cet accord prévoit 20 000 recrutements (dont 6000 fonctionnaires et 14000 contractuels) pour 20000 départs naturels en retraite de fonctionnaires 2000 jeunes sont recrutés en contrats de formation en alternance - Une réduction de 20 % des CDD est prévue - Une réduction des charges en heures supplémentaire est également prévue - Augmentation de la durée d'emploi des temps partiels des agents contractuels pour garantir une couverture sociale - Conduite d'une négociation nationale sur les conditions d'emploi des contractuels et du travail de nuit - Aspect stratégique et concerté de la conduite du changement - Augmentation de 55 % à 65 % du nombre de postiers au contact du public - Cet accord est signé par tous les syndicats sauf CGT et SUD |
2.3.4. Une stratégie de «compétitivité mutualisée»
Les modalités de recherche de performance globale des entreprises qui sont entrées dans les accords de ce type correspondent à un rôle actif dans la reconstruction d'une compétitivité basée sur la création de ressources collectives au niveau de territoires et de réseaux de coopération auxquels elles participent. Ces accords reflètent des ambitions de reconstruction locale de normes collectives qui permettent de mieux mettre en cohérence des pratiques de gestion et des aspirations sociales liées aux divers aspects de temps de travail, d'organisation du travail, de rémunération, d'embauché. L'exemple de Carrefour qui s'engage dans son accord à embaucher 250 personnes handicapées relève à notre sens de cette volonté délibérée, tout comme l'exemple des Chantiers de l'Atlantique qui organisent la réduction du temps de travail pour l'ensemble des 4000 salariés de sous-traitants installés sur le site. Plus généralement ces entreprises manifestent une capacité à nouer de nouveaux types de relations de partenariat au niveau territorial pour la création et l'utilisation de ressources de proximité (exemple des fournisseurs maraîchers de Carrefour, ou de ressources de proximité (exemple des fournisseurs maraîchers de Carrefour, ou de l'organisation de la sous-traitance par les Chantiers de l'Atlantique en vue d'un recentrage sur ses métiers).
Mais au-delà de ces grandes entreprises managériales, ce mode de fonctionnement peut également exister pour des PME. Dans une entreprise de commerce de gros (Câblerie St Antoine), le responsable s'est saisi de la loi pour répondre aux aspirations de ses salariés, en matière de réduction du temps de travail, dans un contexte favorable de croissance de l'activité et des effectifs. Alors qu'il n'y avait pas de représentant du personnel syndiqué, c'est un salarié qui a réalisé le montage de l'accord après avoir administré un questionnaire à ses collègues sur leurs souhaits en matière d'accord de RTT. L'accord conclu a obtenu la satisfaction des salariés. Il est présenté comme exemplaire par le syndicat auquel ce salarié a demandé son mandatement et est utilisé depuis comme support. Il faut toutefois remarquer que le collectif de travail a éprouvé de nombreuses difficultés pour concevoir une modulation satisfaisante des horaires. L'exemple de cette entreprise est d'autant plus intéressant que sa stratégie de compétitivité, basée sur des savoirs tacites, a été également offensive, puisqu'elle a racheté les entrepôts de stockage et embauché le personnel commercial compétent dont les industriels producteurs de câbles, se débarrassaient, au profit d'une stratégie de concentration de leur stockage sur un lieu unique, combinée à une réduction des effectifs commerciaux. De plus à son niveau, cette PME a construit des relations d'échanges entre certains de ses différents clients (montage de câble en fibre optique) qu'elle fidélise de la sorte.
Les indicateurs de ce type d'accord sont les suivants :
- Les entreprises du réseau sont également concernées par la réduction du temps de travail (exemple des Chantiers de l'Atlantique)
- L'entreprise profite de l'accord pour réaliser des expérimentations en termes de nouvelle organisation du travail et d'intégration de nouvelles compétences par la formation et le recrutement.
- La concertation précède les négociations dans le cadre d'une pratique déjà établie.
- Pour ce qui relève des heures supplémentaires, CDD, temps partiel, les dispositions sont aussi favorables que dans la stratégie coopérative, elles visent une harmonisation des statuts des personnels.
- La flexibilité horaire peut aller jusqu'à 41 heures.
- Maintien des salaires.
- Non-suppression du temps de pause dans le calcul du temps de travail effectif.
Les accords d'entreprise inscrits dans cette forme de recherche de compétitivité ne sont pas nombreux, compte tenu des enquêtes quantitatives réalisées, mais ils représentent potentiellement une capacité d'emploi importante et viable à moyen terme. Il faut noter que dans le cas des entreprises les plus grandes, les aides publiques ne sont pas souhaitées. Dans le cas des plus petites dont les résultats sont confortables, elles sont perçues comme une aubaine. De façon générale les entreprises inscrites dans ce type de recherche de compétitivité, conquièrent des parts de marchés existants ou en émergence sur la base d'une transformation de leur organisation interne et de leurs relations externes leur permettant de construire les ressources nécessaires pour de nouveaux processus de production.
|
Les Chantiers de l'Atlantique : accord offensif, stratégie mutualiste Cet accord ramène la durée hebdomadaire du travail entre 32h 40 et 34h 39. Une réorganisation du travail dans une phase d'expansion doit permettre 900 embauches. - Réduction du temps de travail par le biais de la réduction du temps de travail quotidien travaillé, du nombre de jours travaillés, et du développement du travail posté en deux, ou trois équipes ou pour les volontaires, les vendredi, samedi et dimanche. - 250 nouveaux emplois sont crées et 170 salariés intérimaires sont embauchés. Discussions sur le départ à cinquante-cinq ans, via un dispositif de départ de 500 salariés remplacés par autant d'embauche, et qui devrait être financé par l'entreprise - Les horaires des 4000 salariés de sous-traitants présents sur le site sont supposés suivre la nouvelle organisation - Augmentation générale des salaires de 0,4 % et individuelle de 1 % de plus un dispositif de rattrapage des salaires des nouveaux embauché est prévu - La pause quotidienne reste comprise dans l'horaire effectif de travail - L'entreprise se fixe l'objectif de réduire ses coûts de 30 % en trois ans pour lui permettre de prendre des commandes sans recouru aux aides publique. - Elle se recentre sur ses métiers de base avec un recours accru à la sous-traitance et un doublement de son plan de charge. Pour cela, elle réalise un investissement de 200 millions de francs - Le bassin d'emploi sur lequel cette entreprise est implantée ne parvient pas à fournir la main d'oeuvre qualifiée nécessaire Carrefour : stratégie mutualiste, sans aides - Accord réalisé dans le cadre d'une discussion sur la refonte complète des accords de l'entreprise - Cinq syndicats sur six ont donné un avis favorable - Abaissement de la durée du travail autour de 5 %, c'est-à-dire à heures - Une semaine de congés supplémentaire est accordée, ainsi que des facilités pour prendre leurs vacances en même temps que les enfants en âge scolaire - Un compte épargne temps pour les cadres et une semaine de congés supplémentaires également 1000 emplois en équivalent temps plein complet créés en 1999 - Embauche de 250 personnes handicapées - Revalorisation de deux heures pour les contrats à temps partiel avec une augmentation de salaires de 2,1 % - La prime à l'ancienneté est gelée - Une harmonisation des statuts des personnels réclamée par les syndicats est prévue d'ici 2002 - La semaine peut monter jusqu'à 41 h, ou tomber à 29 h. - Extension du système expérimental des «horaires en ilots» (répartition autonome de la charge de travail au sein de l'équipe) - Un projet global de formation est annoncé Câblerie Saint Antoine : accord offensif, stratégie mutualiste Cet accord vise à se saisir de la loi pour rendre conciliable l'adaptation du temps de travail dans une phase de croissance et de réorganisation du temps de travail de l'entreprise, avec l'accès des salariés à un temps de travail plus librement choisi et un recrutement supplémentaire. Les principaux éléments de cet accord sont les suivants : - Durée du travail de 35 heures par semaine, la réduction est de 10 % (2283 salariés concernés par RTT) - Le recrutement de 6 % des effectifs concernés - Augmentation de la polyvalence en termes de fonction et formation si nécessaire - Annualisation pour l'ensemble du personnel, 2 jours de congés par mois sur l'année, ce qui fait 24 jours soit 4 semaines par an prises par trimestre - Information des salariés sur les changements horaires, au moins une semaine - Durée hebdomadaire maximum 48 heures - La nouvelle organisation du travail soit permettre d'éviter le recours aux heures supplémentaires. Les heures supplémentaires au-delà de 39 heures sont rémunérées selon le régime légal - La durée de travail du temps partiel est limitée a 28 heures/semaine - Maintien du pouvoir d'achat des salariés (liée à la réduction des heures supplémentaires) par l'attribution de primes, compensées par un gel des augmentations de salaires - Maintien des effectifs pendant cinq ans au moins |
3. Bilan et perspectives de la RTT
3.1. Effets positifs de la loi Aubry
La viabilité des emplois créés dans le cadre de la négociation sur les 35 heures se mesura sur un moyen-long terme. La loi ne semble cependant pas encore avoir déclenché la dynamique massive simulée par les projections macro-économiques. Néanmoins, la loi a dans de nombreux cas enclenché une réflexion sur des objets tels que l'organisation du travail, le rapport entre le temps de travail et temps hors travail, la reconfiguration des temporalités de travail sur le mois, l'année, la transformation des pratiques contractuelles.
Ainsi, dans certaines entreprises, la négociation d'un accord de RTT est l'occasion de faire un état des lieux sur la gestion et l'organisation du temps de travail : systèmes horaire des différentes catégories de salariés, gestion des horaires individualisés, conditions des réalisation de travail en équipes, modalités de modulation ou d'annualisation des horaires..
En ce sens, les expériences d'expertise et d'ingénierie développées par certains acteurs locaux intermédiaires peuvent être soulignés.
Tout d'abord, dans le cadre d'une convention entre le Ministère du Travail et l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail (ANACT), le réseau des Agences Régionales pour l'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) propose un travail d'appui-conseil et d'informations aux entreprises par rapport au dispositif de RTT de la loi Aubry. De nombreuses entreprises mobilisent cette piste d'information, notamment pour s'informer des conditions concrètes de la loi, de son coût et de la hauteur des incitations financières dont elles peuvent bénéficier. La plupart des entreprises semblent avoir une connaissance très faible de la mesure législative. De plus, ces demandes d'information ne conduisent pas nécessairement à la conduite de négociations effectives sur la RTT. Dans un cas sur 10 seulement, elles débouchent sur l'ouverture de négociations. Ainsi, à travers ces demandes, la plupart des entreprises prennent acte de la mesure, sans réellement souhaiter anticiper la loi.
Par ailleurs, certains acteurs locaux des organisations professionnelles développent des services spécifiques d'expertise et de conseil à leurs entreprises.
Ainsi, dans un souci d'anticipation à la loi Aubry, la chambre syndicale territoriale de la métallurgie du Rhône a mis en place un dispositif particulier d'information et d'intervention sur les questions de temps de travail, en réalisant un pré-diagnostic auprès de 80 entreprises de son territoire. L'objectif était d'aider les entreprises à faire état des lieux de leur temps de travail, par rapport à la réglementation du temps de travail (aspect juridique et social) et par rapport aux questions d'organisation du travail et de la production, de polyvalence (aspect industriel), et ainsi de les préparer à mettre en oeuvre, si elles le peuvent, de façon plus adaptée la mesure législative de RTT. Pour la personne chargée de l'animation de ce dispositif, « le point positif de la loi Aubry est quelle aura au moins permis pour de nombreuses entreprises de prendre conscience de leur temps de travail effectif » .
Dans le même sens, dans le cadre d'un budget d'animation régionale du dispositif Aubry, les Directions Régionales du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle sont amenées à signer des conventions régionales avec le secteur sanitaire et social, l'Union Patronale Artisanale, le Centre des Jeunes Dirigeants, le secteur des coopératives agricoles ou encore la branche artisanale du bâtiment (Capeb).
Ces différentes actions d'informations et d'expertise auprès des entreprises, menées par les acteurs des relations professionnelles, publics (DRTEFP, ARACT) et privés (consultants), restent très fortement cloisonnées, sans conduire à un travail de coopération et de mutualisation des connaissances et des pratiques. Cette absence de maillage entre les différents acteurs intermédiaires, qui interviennent dans l'instrumentation du dispositif d'aide publique de la loi Aubry, est d'autant plus dommageable pour les PME, qui sont faiblement dotées de ressources dans les possibilités de gestion du temps de travail et de la main-d'oeuvre.
3.2. Effets pervers de la loi
3.2.1. RTT et conditions de travail
Comme nous l'avons noté dans la première section de ce chapitre, la RTT à 35 heures s'opère majoritairement par une réduction de la durée hebdomadaire du travail, couplée de l'octroi de jours de congés. Cependant, la RTT peut être appliquée par le développement d'importantes procédures d'aménagement du temps de travail qui augmentent les contraintes temporelles des salariés et posent alors la question du caractère plus ou moins favorable de la RTT pour ces derniers.
Une dérive de la RTT est en effet d'engendrer une intensification du travail. Différentes études menées sur la RTT montrent que dans un certain nombre de cas, la RTT s'accompagne d'une rationalisation du temps de travail, c'est-à-dire par la suppression d'un ensemble de temps informels, non directement productifs, tels que les temps de pause ou de pause-café. Certains accords de branche (chimie) ou d'entreprise (constructeurs automobiles) illustrent précisément ces cas de figures. Ces différents temps non prescrits, qui permettent en fait une régulation de l'activité de travail et des collectifs de travail dans l'entreprise, ont un impact très important sur les conditions de travail des salariés. Leur suppression conduit à un effet contre-productif (augmentation du stress, de la fatigue, de l'absentéisme, des accidents de travail). Une enquête réalisée par la CGT montre que la suppression des temps de pause en 1991 a eu des incidences négatives sur la qualité du travail, notamment par une augmentation du taux d'absentéisme.
L'enquête de la CFDT «Le travail en question», menée sur 6 000 salariés concernés par la RTT, souligne que la RTT pose, pour près de 50 % des salariés, des problèmes dans les relations de travail, qu'il s'agisse de « rencontrer les collègues pour régler les problèmes » , de « passer des informations ou des consignes » , de « traiter des questions avec le responsable hiérarchique » .
De la même façon, l'étude menée par l'ARACT Haute-Normandie auprès de huit cas d'entreprises avant engagé une réduction et un aménagement de leur temps de travail conclut clairement que « la seule RTT, outre ses effets potentiels sur l'emploi, n'est pas un élément suffisant pour conclure à une amélioration des conditions de travail » .
En ce sens, l'étude de la CFDT met en perspective les difficultés posées par la mise en oeuvre d'une RTT dans la vie quotidienne des salariés . En effet, dans une majorité de cas, la charge de travail des salariés qui bénéficient d'une RTT reste la même ou même augmente :
- Pour 54 % des salariés, la RTT n'a pas changé leur charge de travail. Pour 33 %, ils ont dû prendre en charge les activités de leurs collègues. Pour seulement 13 % des salariés, la RTT s'est accompagnée d'une importante réorganisation du temps de travail.
- Pour 50 % des salariés, ils effectuent la même charge en moins de temps. Pour 20 % des salariés, ils doivent rester après le temps normal de travail. Pour seulement 30 % des salariés, ils travaillent moins longtemps et ça se passe bien.
3.2.2. RTT et flexibilité du travail
Le plus souvent l'application de la RTT s'effectue par l'introduction de nouvelles « souplesses dans l'organisation du temps de travail ». Bien que ces transformations puissent impulser une gestion du temps plus productive et plus favorable pour le salarié, dans la plupart des cas, elles conduisent à renforcer les contraintes temporelles des salariés . Quelques cas illustratifs peuvent ainsi être donnés :
- une RTT qui se traduit par une augmentation de l'amplitude de temps de travail (travail nocturne, horaires matinaux) : la normalisation du travail du samedi est un exemple significatif de cette tendance,
- une RTT qui s'opère par une plus forte variabilité de l'horaire de travail : horaires de travail différents selon les semaines, honores décalés selon les postes de travail,
- une RTT couplée par une modulation ou annualisation des horaires de travail
3.2.3 RTT et «temps de travail effectif»
Comme moyen d'améliorer la rationalisation du temps de travail, les entreprises peuvent limiter l'ampleur de la RTT en opérant cette réduction sur la base d'une référence horaire plus limitée, qui est le « temps de travail effectif », strictement limité aux temps de travail productifs et excluant les temps de pause.
En ce sens, le travail de conseil mené par la chambre syndicale de la métallurgie du Rhône sur le temps de travail montre bien que les entreprises s'attachent à mettre en évidence un « temps de travail effectif », qui est moins important que le temps de travail de présence des salariés, pour aborder la RTT, et en limiter ainsi l'ampleur.
De la même façon, dans la mise en oeuvre de la RTT, on note une tendance générale à exclure les temps de formation du temps de travail effectif (discussions présentes à Renault). Cette perspective va directement à l'encontre d'une réflexion sur la recomposition des différents temps qui composent la vie d'un salarié (temps de travail, de formation, congés parentaux..).
3.2.4. L'exclusion de certaines catégories de salariés du champ de la négociation
La mise en oeuvre de la RTT peut renforcer l'existence d'une gestion de la main d'oeuvre de plus en plus hétérogène au sein même des entreprises (salariés permanents/salariés temporaires, salariés à temps plein/à temps partiel). Ainsi, les projets de RTT des entreprises s'effectuent fréquemment en excluant un nombre important de catégories des salariés telles que les cadres, les salariés au forfait, les salariés de la maintenance, les salariés à temps partiel..
D'une façon générale, alors que la philosophie initiale de la loi se centre sur la création d'emplois, les négociations actuelles de branches et d'entreprises sur la RTT semblent déplacer le débat sur les modalités de mise en oeuvre de la RTT et la question de la flexibilité du temps de travail (augmentation des heures supplémentaires, annualisation, gains de productivité). En effet, ces questionnements peuvent en partie s'expliquer par le caractère très ouvert de la première loi, laissant l'initiative aux acteurs sociaux d'inventer des solutions et des compromis sur l'application des 35 heures. Ainsi, d'importantes zones d'ombres demeurent dans le cadre de la première mesure législative. De façon plus structurelle, cette analyse montre que la question de la création d'emplois ne peut être traitée isolément, sans précisément aborder ces différents aspects de l'environnement de la loi.
3.3. Recommandations en vue de la deuxième loi sur les 35 heures
La loi Aubry a voulu instaurer un processus en deux étapes :
- Première étape : inciter les partenaires sociaux à négocier à un niveau décentralisé des expériences innovantes de réduction et d'aménagement du temps de travail dans la perspective d'une deuxième loi fixant les conditions définitives du passage aux 35 heures,
- Deuxième étape : légiférer dans le cadre de cette deuxième loi sur la durée légale du travail et encadrer certaine nonnes d'organisation du temps de travail.
Pour l'élaboration de la seconde loi au 1 er janvier 2000, le gouvernement est confronté à un double enjeu :
- définir une nouvelle norme juridique et sociale de temps de travail qui. limite la précarité
- stimuler l'inventivité des acteurs dans la négociation de branche ou d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.
En d'autres termes, comment définir un nouveau système juridique de régulation du temps de travail qui ne contraire pas la dynamique de la négociation sur le temps de travail ? Les deux objets ne paraissent pas nécessairement contradictoires.
La première loi Aubry n'a pas abordé tous les aspects de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail (SMIC, heures supplémentaires, les cadres), laissant l'initiative aux acteurs sociaux d'inventer des solutions adaptées à leurs situations particulières. Les recommandations faites ci-dessous s'appuient en partie sur les expériences de réduction du temps de travail effectivement menées dans les branches et les entreprises. Elles soulignent certaines conditions nécessaires à l'accompagnement de la diminution de la durée légale du travail à 35 heures.
3.3.1. Le régime des heures supplémentaires
Depuis l'ordonnance de janvier 1981, la réglementation du temps de travail fixe un contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 heures. Sur la base de ce contingent, les heures effectuées à partir de la 42 ième heure donnent droit à un repos compensateur de 50 % pour chaque heure supplémentaire effectuée.
Des études sur les pratiques en matière de temps de travail (P. Boisard et P. Charpentier, 1997), mettent en évidence l'importance accordée aux heures supplémentaires non seulement par les directions d'entreprises (pour l'adaptation rapide et souple des horaires aux variations non prévisibles de l'activité), mais aussi par les salariés (moyen d'augmenter substantiellement les rémunérations pour les plus bas salaires). En 1994, les heures supplémentaires demeurent le mode d'ajustement au volume d'activité le plus utilisé par les entreprises, avec près de 50 % des établissements de l'industrie qui déclarent faire appel aux heures supplémentaires et un volume moyen d'heures supplémentaires de 52 heures au total et 55 heures pour un ouvrier 98 ( * ) .
Ainsi, certaines branches, comme la métallurgie, le BTP, les services automobiles ont négocié une forte augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires, ce qui constitue un moyen d'accroître les possibilités de flexibilité du temps de travail mais, indirectement, de limiter l'effet des 35 heures sur la réduction effective de la durée du travail. Dans la métallurgie, en passant de 90 heures à 180 heures, le nombre moyen d'heures supplémentaires est porté de 2 heures à 4 heures par semaine. Une telle approche est alors de nature à contraindre l'application effective des 35 heures.
Conscient du caractère stratégique des heures supplémentaires pour les entreprises et dans la négociation sociale, le ministère du Travail a d'ores et déjà, dans le cadre de la première loi, souligné la nécessité de « freiner l'excès des heures supplémentaires ». L'objectif est de ne pas supprimer ce moyen d'ajustement ponctuel et conjoncturel au volume d'activité à la disposition des entreprises, mais de limiter la pratique de durées hebdomadaires longues qui se pérenniseraient.
Limiter le contingent des heures supplémentaires
L'abaissement du contingent annuel des heures supplémentaires est dans bien des cas souhaitable. Bien qu'une diminution de ce contingent annuel en deçà de 130 heures permettrait d'envisager plus largement un effet substantiel sur la réduction de la durée du travail, la pratique des entreprises et la dynamique de la négociation semblent conduire à s'orienter vers un maintien de ce contingent à 130 heures. Toutefois, il s'agirait de limiter cette enveloppe à 90 h./an dans le cas d'un recours à la modulation ou l'annualisation des horaires de travail. Une telle modulation permet déjà de faire varier l'horaire hebdomadaire de 00 à 48 heures. Cette proposition n'est pas sans poser problèmes avec un certain nombre de branches qui ont déjà négocié une augmentation du contingent annuel des heures supplémentaires au-delà de 130 heures et que le ministère du Travail a étendu par la procédure d'extension (services automobiles, entreprises de propreté).
La majoration des heures supplémentaires et le développement du repos compensateur
En premier lieu, tels que le prévoient déjà certains accords de branche (industrie du textile, de l'habillement), la majoration des heures supplémentaires dès la 36 e heures constitue un moyen de limiter un recours trop abusif et pérenne aux heures supplémentaires. Toutefois, l'augmentation du coût des heures supplémentaires ne constitue pas nécessairement un frein à l'abus du recours aux heures supplémentaires. En effet, ce système de majoration permet aux employeurs d'augmenter la rémunération des salariés sans augmenter le salaire de base et donc satisfait une bonne parue des salariés, notamment pour les ouvriers non qualifiés dont les rémunérations sont plus faibles. Ainsi, en second lieu, la pratique du repos compensateur, qui existe depuis 1982, paraît souhaitable, pour limiter l'allongement de la durée, effective moyenne du travail des salariés. Le dispositif Aubry envisage déjà précisément le renchérissement des heures supplémentaires par l'augmentation des repos compensateurs, en majorant d'une demi-heure au titre du repos compensateur le surcoût actuel des heures effectuées entre 39 heures et 42 heures. Par ailleurs, il s'agirait de limiter la trop grande souplesse de ce repos compensateur introduite par la loi quinquennale de 1993. Il apparaît nécessaire que les heures compensées s'imputent sur le contingent annuel des heures supplémentaires, et que ce dispositif soit négocié par accord de branche ou d'entreprise, pour assurer la prise effective de ce repos par le salarié sur l'année.
La question des heures supplémentaires, de leur majoration ou de leur compensation en prise de repos, pose un arbitrage plus large entre salaire et temps libre, qui est central dans les négociations entre organisations syndicales et patronales et dans les projets de réduction et d'aménagement du temps de travail des entreprises.
3.3.2. Encadrer les différents types de modulations
La deuxième loi devra surmonter l'obstacle de l'hétérogénéité des pratiques d'aménagement du temps de travail permise par la succession des dispositifs ayant défini le cadre des pratiques de modulation 99 ( * ) . Les différentes mesures législatives prises depuis l'ordonnance de 1982 ont fortement élargi les possibilités d'aménagement du temps de travail des entreprises, et plus particulièrement les possibilités de modulation et d'annualisation des horaires de travail (cf. Encadré sur les trois types de modulation).
La plupart des accords de branche et une grande majorité d'accords d'entreprises prévoient la mise en oeuvre de la RTT par la négociation de différentes procédures de modulation/annualisation du temps de travail. En ce sens, la réduction effective de la durée hebdomadaire du travail à 35 heures risque d'être réduite par rapport au développement de ces dispositifs d'annualisation des horaires, qui permettent de faire varier l'horaire hebdomadaire de 00 heures à 48 heures.
Il faudrait tout d'abord simplifier les trois formes de modulation horaires déjà existantes, qui fixent des conditions et des contreparties de nature différente, notamment en termes de réduction du temps de travail (contrepartie obligatoire de RTT dans le cas de l'annualisation). Il est important de noter que la modulation des horaires est peu pratiquée par les entreprises (3,5 % des établissements en 1994), et encore plus faiblement en ce qui concerne l'annualisation (0,2 % des établissements déclarent mettre en place des horaires annualisés). Cette réorganisation des possibilités dérogatoires de modulation horaire est d'autant plus nécessaire que la mise en oeuvre de la RTT développe d'autres pratiques de modulation, telle que l'octroi de jours de repos supplémentaires dont une partie est à la discrétion de l'entreprise selon les besoins de son activité, constituant ainsi des jours collectifs modulés, ou encore des durées hebdomadaires du travail différentes selon les semaines ou les périodes.
De plus, tout en maintenant le principe d'annualisation des horaires de travail, la seconde loi pourrait représenter un moyen d'assurer l'existence de conditions sociales minimales des pratiques de flexibilités du temps de travail qui comportent des contraintes temporelles importantes pour les salariés :
- Limiter les durées hebdomadaires maximales de la modulation/annualisation des horaires de 48 h. à 44 h., pour freiner l'amplitude horaire par rapport à la nouvelle durée légale du travail,
- Soumettre les modulations de type II et III à la négociation de contreparties en terme de réduction du temps de travail, en distinguant cette dernière de la réduction légale du travail.
- Freiner le développement d'une annualisation directe, où l'accord de branche peut être directement appliqué dans l'entreprise sans négociation.
La question de fond est bien celle d'un équilibre difficile entre une logique sociale, qui est de limiter les contraintes temporelles des aménagements du temps de travail pour les salariés, et une logique économique, où la modulation des horaires de travail constitue un outil de la compétitivité économique des entreprises.
3.3.3. Augmenter le SMIC horaire
La réduction du temps de travail avec compensation salariale était le principe de base de la loi. La deuxième loi devrait en préciser les modalités. Comment assurer le maintien du pouvoir d'achat des salariés qui passent de 39 heures à 35 heures et sur quelle base payer les nouveaux embauchés ? La finalité sociale de la RTT n'est plus plausible aux yeux de nombreux salariés, si elle se traduit par une baisse de leur rémunération.
Dans un premier temps, le Gouvernement avait laissé entendre la possibilité de fixer un double SMIC, un SMIC mensuel pour les entreprises passant à 35 heures et l'application du SMIC actuel pour les entreprises ne passant pas à 35 heures. Cette option s'est rapidement heure. Elle crée de surcroît un décalage entre le salaire minimum horaire perçu par des salariés à temps plein et le taux de rémunération horaire des salariés à temps partiel.
L'augmentation du salaire horaire minimum, estimée de l'ordre de 11,4 %, se révèle être la piste la plus plausible, à partir du moment où la durée légale du travail à 35 heures sera applicable à tous les salariés, de moins et plus de 20 salariés, c'est à dire en 2002.
D'ores et déjà, des pistes et des solutions sont présentes dans les négociations de branche ou d'entreprise sur la RTT, qui majoritairement prévoient une compensation salariale.
Ainsi, certaines branches, comme les industries du sucre ou la grande distribution, envisagent la mise en oeuvre d'une indemnité compensatrice bénéficiant aux nouveaux embauchés ou aux salariés à temps partiel. Dans les entreprises, le principe de la compensation salariale est le plus souvent accompagné d'une politique de modération salariale sur 2 ou 3 ans, ou de modification de la structure de rémunération, entre les augmentations individuelles et collectives et les primes.
La réduction du coût de la RTT peut être aussi opérée en modifiant la base du «temps de travail effectif». En ce sens, les temps de pause, de douche ou de casse-croûte restent payés mais ne sont plus affectes au temps de travail.
3.3.3. Limiter le travail à temps partiel contraint
Le développement du travail a temps partiel nécessite que la loi sur les 35 heures prenne en compte cette catégorie particulière de salarié 100 ( * ) . Le problème majeur pour ces salariés n'est pas celui de la diminution de leur temps de travail, mais à l'inverse celui des augmentations de leur temps de travail et de leur rémunération. En 1997, 43 % des salariés à temps partiel déclaraient souhaiter travailler davantage 101 ( * ) .
En effet, le travail à temps partiel est le plus souvent un temps partiel imposé par l'entreprise et non choisi par le salarié. Il se concentre sur une population féminine peu qualifiée et certains secteurs du tertiaire soumis aux fluctuations de la clientèle (grande distribution, restauration, services domestiques) (Guelaud, 1989 ; Baret, Gadrey et Gallouj, 1998). Les mesures législatives prises depuis 1992 concernant un abattement de 30 % sur les cotisations patronales pour toute création ou transformation d'emploi à temps partiel ne sont pas étrangères à ce développement du temps partiel pour les professions peu qualifiées du secteur tertiaire.
Face à cette situation, la loi Aubry se donne globalement pour objectif de « moraliser le recours au temps partiel » . Le dispositif entend précisément réformer et restreindre le dispositif d'abattement des charges patronales concernant l'emploi à temps partiel (limitation du cumul avec les exonérations de bas salaires, augmentation du plancher d'heures travaillées) et développer de plus larges garanties sociales d'accès ou d'organisation du temps partiel par la négociation de branche (volume d'heures complémentaires, amplitude et fragmentation de la journée de travail).
Ainsi, certaines branches plus particulièrement concernées par cette pratique semblent d'ores et déjà s'inscrire dans cette perspective. Dans ce cas, la grande distribution a signé depuis 1993 différents accords de branche, et dernièrement celui d'application de la loi Aubry, qui précisément relèvent la durée hebdomadaire minimale du travail de 22 heures à 26 heures, ou encore, stipule la nécessité d'organiser le temps partiel pour que le salarié puisse être employé sur un second temps partiel (accord de branche de 1996). Toutefois, l'accord Aubry signé par la grande distribution augmente l'amplitude des temps de coupure dans la journée de 2 heures à 4 heures.
La réduction de la durée légale du travail pose plus précisément deux types de questions. En premier lieu, il s'agit de fixer un nouveau seuil de l'horaire à temps partiel suffisamment éloigné de la nouvelle durée hebdomadaire du travail à 35 heures. En effet, cette distinction entre temps partiel et temps plein est importante, dans le sens où dans le cas d'un temps partiel, les heures complémentaires effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire ne sont pas majorées, alors qu'elles le sont dans le cas d'un temps plein.
En second lieu, se pose la question d'une RTT plus ou moins imposée aux salariés à temps partiel. Certains accords d'entreprises proposent de laisser le choix aux salariés de bénéficier ou non de cette RTT. Cette perspective semble intéressante. Toutefois, on peut craindre que les employeurs n'appliquent la réduction de la durée hebdomadaire du travail aux salariés à temps partiel, pour développer des contrats horaires courts qui répondent plus facilement aux fluctuations de ta clientèle et ainsi renforcer la pratique de temps partiels contraints.
La RTT pour les salariés à temps partiel est étroitement liée au problème de faibles rémunérations de cette catégorie de salarié. Ainsi certains accords de branche développent une approche intéressante, en accompagnant la RTT par un mécanisme de revalorisation des salaires par rapport aux salariés à temps plein (branche des entreprises de propreté).
3.3.5. La RTT des cadres
La loi Aubry sur les 35 heures est venue réactiver la question «épineuse» du temps de travail des cadres. En d'autre terme, comment intégrer la catégorie des cadres dans un mouvement général de réduction de la durée du travail ?
En effet, le type d'activité de cette catégorie 102 ( * ) (autonomie dans le travail, travail par objectif ou par mission), conduit à une situation ou le temps de travail des cadres est considéré comme non comptabilisable par rapport à une tâche donnée. Ainsi, le plus souvent, l'encadrement est majoritairement régi par la pratique de convention au forfait et se trouve exclu de la réglementation du temps de travail (référence à une durée hebdomadaire du travail, majoration des heures supplémentaires ou repos compensateur). Dans cette logique, les cadres sont soumis à de longs horaires de travail et doivent faire preuve d'une forte disponibilité personnelle. Ceci est lié aux pressions exercées par la norme du groupe, au modèle de carrière, au type de travail par objectif ou par mission, à une culture de la compétition (Bouffartigue P. et Bocchino M. 1998).
|
Réglementation du temps de travail et temps de travail des cadres La réglementation de la durée du travail s'applique à tous les salariés, y compris les cadres. Seule la catégorie particulière des cadres dirigeants, qualifiée par leur haut niveau dans la grille de classification, leur fonction de responsabilité, leur degré d'autonomie et leur niveau de rémunération, peut être partiellement écartée de celte réglementation, en ce qui concerne le décompte du temps de travail effectif et les dispositions sur le repos compensateur. Tous les autres cadres sont soumis à la réglementation du temps de travail, relative au décompte de leur horaire de travail, aux heures supplémentaires et aux durées maximales du travail. Le temps de travail des cadres est très fréquemment régi par le forfait, qui peut être de deux types : - «Forfait sans référence horaire» ou «forfait tous horaires», réservé aux cadres dirigeants, qui représente en fait la rémunération totale du travail effectué par le salarié, indépendamment du temps passé. Ce type de forfait permet de ne pas comptabiliser strictement le temps de travail en nombre d'heures travaillées. - «Forfait avec référence horaire», qui permet de tenir compte du nombre et de la récurrence des heures supplémentaires effectuées par le salarié et d'en forfaitiser le paiement. Cette convention n'exonère nullement le salarié et le cadre de la prise en compte et du paiement des heures supplémentaires. |
Récemment, différents arrêts de la chambre sociale de cassation (25.11.98) sont venus remettre en question la pratique du travail au forfait des cadres, en stipulant que les conventions au forfait ne dispensaient nullement de calculer le temps de travail des cadres, ni de percevoir la rémunération correspondante de cet horaire au forfait (intégrant la majoration des heures supplémentaires). Cette jurisprudence se positionne à l'inverse de l'accord métallurgie de juillet 1998, qui étend la convention du forfait à tout salarié libre et indépendant dans l'organisation et la gestion de son temps de travail, en stipulant qu'il n'est pas soumis à un horaire de travail.
Dans la majorité des cas, les accords de réduction du temps de travail s'appliquent à la catégorie des cadres. La RTT s'opère alors par l'octroi de jours de repos supplémentaires, qui dans certains cas peuvent être cumulés dans un compte-épargne-temps. Cette forme de RTT constitue pour les cadres une façon de bénéficier d'une réelle diminution de la durée effective du travail. Cependant, la pratique du CET peut limiter cette réduction effective du temps de travail, dans le sens où les jours de repos ne sont pas pris sur l'année mais cumulés.
En ce sens, le ministère du Travail conçoit le développement de modalités particulières pour les personnels de l'encadrement, de décompte du temps de travail en jours, tout en restant attentif au respect des normes en matière de durées hebdomadaires maximales du travail. Ainsi, dans le cadre de la seconde loi, trois catégories de cadres pourraient être distinguées :
- cadres dirigeants, soumis à un forfait sans référence horaire,
- cadres de droit commun, liés au rythme de production et avec un horaire collectif
- cadres, où le temps de travail peut être décompté en jours.
Le temps de travail des cadres pose une question plus générale du rapport au travail des cadres. En effet, dans la représentation individuelle et collective, il existe une forte corrélation entre le temps de présence des cadres et leur investissement personnel. Ainsi, la réduction du temps de travail des cadres nécessite d'être traitée au-delà du temps de travail effectif et des horaires de travail. Il s'agit d'envisager le problème de la charge de travail des cadres et de l'organisation du travail. Ainsi, certains accords d'entreprises inventent des pistes de réflexions plus larges sur la réorganisation et la réduction des temps de travail des cadres : prise en compte des temps de mission ou de trajets dans le temps de travail effectif, avec des contreparties en jours de repos, développement du temps partiel des cadres, délégation des tâches, embauches d'assistantes (accord EDF-GDF) 103 ( * ) .
3.3.6. Faut-il maintenir l'aide structurelle aux entreprises et les dispositifs incitatifs ?
Jusqu'au vote de la seconde loi au début de l'année 2000, qui fixera une durée légale du travail à 35 heures, les entreprises bénéficient d'une aide financière forfaitaire si elles anticipent la réduction du temps de travail par la négociation d'un accord d'entreprise et sous conditions de création ou de maintien de 1 emploi. Cette aide publique est estimée à 43 milliards de francs pour 1999.
La première loi Aubry mettait en place un dispositif d'incitation à la RTT et à la création d'emploi pour encourager la négociation avant la deuxième loi. Elle incitait les entreprises à se préparer à l'application définitive des 35 heures.
La seconde loi pose alors logiquement la question suivante : faut-il maintenir un dispositif incitatif pour les entreprises qui ne sont pas encore passées à 35 heures et qui n'on pas recouru aux dispositifs précédents ? De même, l'attribution d'une aide pérenne de 5000 F pour toutes les entreprises qui sont déjà passées à 35 heures devrait être discutée. La question posée est de savoir si ces aides conduisent à modifier le comportement des entreprises en matière de gestion de main d'oeuvre ou si, à l'inverse, elles engendrent d'importants effets d'aubaine.
Or, il apparaît que cette aide publique ne modifie pas réellement l'attitude des entreprises en termes de création d'emplois. On aurait pu s'attendre à ce que les entreprises mobilisent massivement l'aide financière avant la seconde loi. Il semble au contraire que le nombre d'accords d'entreprises signés dans le cadre de la loi Aubry aient atteint un rythme de croisière (leur nombre ne devrait plus s'accroître substantiellement).
Dans de nombreux cas, soit les entreprises se sont assez rapidement impliquées dans ce dispositif d'aide publique, ce qui leur permettait d'anticiper ou d'augmenter les embauches qu'elles avaient déjà prévu de réaliser, soit les entreprises ne sont pas dans une situation de croissance interne ou externe et préfèrent attendre la seconde loi. Le dispositif actuel d'aides financières ne constitue pas dans ce cas une incitation à s'engager dans un processus de réduction du temps de travail et de créations d'emplois.
A contrario, lors de la fixation définitive de la durée légale du travail à 35 heures, une réforme des cotisations patronales favorable aux entreprises dynamiques en matière d'emploi (et de négociation sur l'emploi) représenterait pour ces dernières un signal fort et une compensation attrayante, de faible coût pour le budget de la Nation.
|
Résumé des recommandations en vue de la deuxième loi sur les 35 heures 1) Si l'objectif est la généralisation des 35 heures, la loi doit commencer par réduire la durée légale de 39 à 35 heures pour toutes les entreprises. Cette mesure est la seule qui soit à même d'enclencher une dynamique générale de négociation. Cette dernière doit être encadrée par la loi quant aux points suivants. 2) Les heures supplémentaires doivent être majorées dès la 36 ème heure et le contingent des heures supplémentaires doit être si possible limité à 90 heures en cas de recours à la modulation des horaires de travail sur l'année. 3) Les régimes de modulation doivent être harmonisés notamment pour limiter les durées hebdomadaires maximales de la modulation/annualisation à 44 heures au lieu 48 heures. Les modulation de type II et III doivent être soumises à la négociation de contreparties en termes de réduction du temps de travail (en distinguant le réduction du temps de travail ainsi négociée de la durée légale). 4) Dans le cadre du passage aux 35 heures avec compensation salariale, il étai envisagé de fixer le SMIC augmenté sur une base mensuelle pour les entreprises passant aux 35 heures et un SMIC inchangée, fixé sur une base horaire, pour les autres entreprises et les travailleurs à temps partiel. Cette mesure aurait le défaut d'instaurer un salaire minimum à deux vitesses, puisqu'au total, le salaire horaire des travailleurs à temps partiel et à 39 heures serait inférieur au salaire horaire des travailleurs à 35 heures. La solution pourrait donc être d'augmenter tout simplement le SMIC horaire, ce qui aurait pour effet de respecter le principe d'égalité de salaire entre tous les travailleurs effectuant un travail égal. 5) Le temps partiel choisi doit être privilégié au détriment du temps partiel imposé. Pour cela, le cumul de l'abattement de 30 % avec les autres exonérations doit être définitivement interdit. L'abattement lui-même devrait être réduit. La norme maximale de l'horaire à temps partiel doit être fixée à un seuil suffisamment éloigné de la norme du travail à temps plein pour éviter que les entreprises ne privilégient le temps partiel long (assorti d'heures complémentaires) sur le temps plein à 35 heures. 6) La réduction du temps de travail des cadres ne doit surtout pas être oubliée, malgré les réticences plus «culturelles» qu'économiques auxquelles elle se heurte. L'expérience, à première vue paradoxale, des pays anglo-saxons, où tes horaires des cadres sont strictement réglementés atteste de la possibilité de mieux circonscrire les tâches et le temps de travail de cette catégorie. La tradition organisationnelle française se caractérise pour sa part par la difficulté de certaines catégories d'encadrement à déléguer leur pouvoir décisionnel à des employés subalternes pour des tâches données. 7) Enfin, l'aide pérenne doit prendre fin avec les aides accordées dans le cadre de la première loi. Les entreprises qui en bénéficient ont maintenant pu absorber le «choc» des 35 heures grâce à ces aides et grâce aux gains de productivité qu'elles réaliseront. Celles qui n'en ont pas bénéficié préfèrent visiblement attendre la deuxième loi sans bénéficier d'aides dont la contrepartie était un accroissement significatif de l'emploi. Par contre, couplés avec une réforme modifiant la structure des cotisations patronales, les mesures proposées ci-dessus pour définir l'encadrement légal du passage aux 35 heures devraient être à même d'encourager, sans coût pour tes finances publiques, les entreprises qui le souhaitent à s'engager dans une véritable négociation sur l'emploi. L'articulation entre la loi et la négociation est une caractéristique structurelle du système français de relations professionnelles où la négociation décentralisée spontanée n'est pas de tradition. Cette spécificité justifie l'impulsion publique dans bien des dossiers, surtout lorsqu'ils engagent la lutte contre te chômage et l'exclusion. Tout dépend alors de la capacité des acteurs à interpréter les nouvelles normes publiques et à les transformer à bon escient sur le terrain, dans l'entreprise. |
CONCLUSION GÉNÉRALE
La raison d'être des flux financiers provenant des collectivités publiques en direction des entreprises en matière d'emploi ne saurait relever d'une autre logique que celle d'une aide financière aux entreprises dont la situation comptable en justifie le recours, dans la perspective d'atteindre les objectifs fixés par la politique publique de l'emploi.
C'est à cette aune que doivent être évaluées les politiques publiques de soutien à l'emploi. Celles-ci se heurtent inévitablement au problème de la nécessaire sélectivité des financements. L'approche dominante des politiques de l'emploi a été, nous l'avons souligné, de considérer la demande de travail des entreprises comme étant une donnée homogène à laquelle les politiques de l'emploi devaient adapter l'offre de travail, soit en en réduisant le coût, soit en la modelant qualitativement par la formation.
Cette approche permet certes de pratiquer des politiques ciblées en direction de publics (offreurs de travail) fragilisés recherchant l'objectif d'une discrimination positive. Elle ne permet pas d'établir un tri parmi les entreprises «nécessiteuses» d'aides au regard de leur situation comptable, ni de tenir compte de la diversité des stratégies d'entreprises à l'égard de l'emploi.
La réflexion autour de l'assiette des prélèvements sociaux ouvre le chantier, non-creusé jusqu'alors, d'une réforme permettant de stimuler l'emploi tout en discriminant les entreprises selon leur situation comptable et leur stratégie à l'égard de l'emploi. Elle permet de résoudre le problème récurrent des effets pervers (effets d'aubaine, effets de substitution, etc) inhérents aux mesures d'ordre général d'abaissement du coût du travail jusqu'alors indifférenciées selon le type d'entreprise mais accordées uniquement en fonction du type de main d'oeuvre utilisée. Il s'agit en l'occurrence de la main d'oeuvre non-qualifiée pour laquelle les exonérations de cotisations sociales se sont généralisées autour du SMIC. Une telle démarche a, a-fortiori, l'inconvénient de déqualifier la structure de la main d'oeuvre en stimulant l'embauche au niveau du salaire minimum et surtout d'entretenir une «trappe à bas salaires».
Trois propositions de réformes alternatives sont possibles.
La première proposition est de substituer progressivement ou immédiatement une assiette Valeur Ajoutée à l'actuelle assiette. Elle aurait pour avantage de faire participer à égalité le capital et le travail au financement des dépenses sociales, sans modifier la structure des coûts de production. En conséquence, cette assiette n'alourdirait pas le coût du capital par rapport au coût du travail. Le taux de contribution nécessaire serait fixé à 9,2 %. Il est également possible d'envisager une modulation d'une telle Contribution sur la Valeur Ajoutée en fonction d'un critère économique (tel que la part des salaires dans la valeur ajoutée) propre à chaque entreprise.
La deuxième proposition est de procéder de la même façon en créant, plutôt qu'une assiette Valeur Ajoutée, une assiette Excédent Brut d'Exploitation, dérivée de la Valeur Ajoutée. Cette assiette taxe directement les profits d'exploitation des entreprises. Plus restreinte, elle nécessiterait un taux de contribution plus élevé. Elle réduit le coût relatif du travail par rapport au coût du capital, ce qui provoque un effet plus favorable à l'emploi que dans le cas précédent.
La troisième proposition est de conserver une assiette salaire, mais de moduler les cotisations patronales en fonction de la part des salaires dans la valeur ajoutée au regard d'un ratio national de référence (ou, dans d'autres variante, selon un ration sectoriel ou encore un ratio intertemporel propre à chaque entreprise. Cette réforme met en action le même type de mécanisme que celui qui se produit dans le cas de la proposition Malinvaud.
Elle ne taxe pas directement les profits (ce qui atténue le risque, relevé par Malinvaud, de ralentir l'innovation) mais possède l'avantage (sur les exonérations générale classiques) de faire participer au financement de la protection sociale les entreprises ayant une part de faire participer au financement de la protection sociale les entreprises ayant une part importante de profits dans la valeur ajoutée beaucoup plus que les autres. Au contraire, la réforme allège la charge de financement des entreprises ayant développé les salaires et l'emploi.
Les trois réformes envisagées ne modifieraient pas la charge totale de financement de la protection sociale qui pèse sur les entreprises. Ce qui n'exclut pas un futur débat sur le poids souhaitable du financement de chaque catégorie de revenu d'une protection sociale à caractère universel. Dans un contexte où certaines ont retrouvé des taux de marge confortables, alimentant parfois plus l'épargne financière que l'investissement réel, la réforme permet de répartir la charge de financement des dépenses sociales selon la situation comptable de chaque entreprise.
Les avantages et les inconvénients de chaque proposition (y compris la proposition Malinvaud de poursuivre la réduction des «charges» sur les bas salaires) ont été détailles.
Dans les simulations que nous avons effectuées, chaque type de réforme possède son domaine de validité en termes d'efficacité économique (celle-ci étant mesurée à l'aune du nombre de créations potentielles d'emplois). Les simulations tiennent compte de l'ensemble des effets mis en jeu par les mesures, effets d'offre, effets de demande, hypothèses sur les dépenses publiques et sociales.
La proposition Malinvaud de réduire les cotisations sociales sur les bas salaires n'est efficace que si les dépenses publiques diminuent et si les entreprises augmentent les salaires pour compenser le déficit de demande dû à la réduction des dépenses publiques. Si les dépenses publiques sont maintenues, le financement de la mesure exige un prélèvement sur d'autres catégories (Malinvaud suggère de taxer les hauts salaires - sans tester cette mesure dans sa simulation) qui déprime la demande 104 ( * ) . À contrario , la prise en compte de la valeur ajoutée dans l'assiette de financement de la protection sociale, avec ou sans modulation, s'avère efficace même dans le cas où le niveau des dépenses publiques et sociales est maintenu.
Le débat porte en fin de compte autant sur l'efficacité économique de la réforme que sur sa logique sociale. Le choix des différents types de réforme engage alors un choix de société qui amènera la représentation nationale à se prononcer sur les catégories de revenus qui doivent contribuer à une protection sociale poursuivant, sur certain volet, un objectif de couverture universelle.
S'il était mis en place à l'occasion de l'application de la deuxième loi sur la réduction du temps de travail, un tel dispositif représente le complément idéal du passage aux 35 heures, en allégeant la charge de financement des entreprises ayant engagé des négociations à cette occasion se matérialisant par un maintien ou des créations d'emplois. Il s'avère beaucoup plus incitatif que le maintien d'une aide pérenne et des dispositifs incitatifs indifférenciés s'apparentant à des mesures classiques de réduction du coût du travail dont les effets pervers ont été rappelés. Ces effets finissent par coûter une somme non-négligeable au budget de l'État, alors que la situation comptable de nombre d'entreprises leur permet d'autofinancer le passage aux 35 heures, à charge aux pouvoirs publics d'orienter les aides vers les entreprises réellement nécessiteuses et porteuse de véritables négociations engageant des stratégies de long terme.
Cela a été souligné en première partie de ce rapport, la logique de 2RT, sous-jacente aux scénarios testés par les diverses projections macro-économiques, supposait pour réussir qu'une négociation s'enclenche à tous les niveaux. La première loi sur les 35 heures a suscité une certaine dynamique de négociation, sans doute plus faible que ce qui était attendu par les autorités publiques. Cette dynamique est cependant plus forte que celle de la loi Robien. Cette dernière n'a pas motivé la négociation de branche, alors que 40 accords de branche ont d'ores et déjà anticipé la norme des 35 heures. Les accords d'entreprise sont en grande majorité des accords offensifs, ils concernent plus particulièrement les PME (de 20 à 50 salariés) et se développent dans le secteur tertiaire. La négociation d'entreprise a été également plus vive, au plan du nombre d'accords conclus. Ces résultats peuvent être portés au crédit de la loi : il est remarquable que les accords d'entreprises se soient développés là où la négociation d'entreprise est généralement réputée absente. Paradoxalement, les grandes entreprises, habituellement grandes utilisatrices des dispositifs de politique de l'emploi, ont spontanément développé la négociation sans recourir aux aides de l'État. Si les accords sont généralement offensifs, ils n'atteignent en effet pas, dans ce cas, le critère des 6 % de créations d'emplois fixé par la loi pour obtenir les aides.
Pour autant, malgré le caractère offensif (au sens de la loi) des accords, nombre de petites comme de grandes entreprises n'ont fait qu'anticiper la deuxième loi (les entreprises ont voulu se préparer au «choc» des 35 heures), sans véritablement engager la négociation sur le sentier d'un changement organique. Les partenaires sociaux se sont rarement engagés dans une réflexion sur les innovations de long terme en matière d'organisation de la production de qualification et d'emplois.
Cette approche caractérise également les accords de branche, où prévaut cependant une certaine hétérogénéité. Les organisations du Medef se sont impliquées fortement dans la négociation selon des logiques diverses. Certaines ont joué le jeu de la négociation «donnant-donnant». D'autres, telles l'UIMM, ont voulu fixer les règles les plus favorables à un aménagement du temps de travail avec peu de contreparties pour les salariés avec pour but essentiel la réduction des coûts de production. L'objectif est dans ce dernier cas de donner un contenu aux accords qui puisse devenir une norme suffisamment générale pour influencer les ternies de la deuxième loi. En particulier, le volume des heures supplémentaires est allongé, de telle sorte que le passage aux 35 heures soit rendu impraticable dans les entreprises. Cette démarche n'a pas été entérinée par le Ministère dans le cadre des procédures d'extension.
Le bilan détaillé des accords de branche et d'entreprise que fournit ce rapport pourrait aider à préciser le contenu de la deuxième loi, dans la perspective de généraliser la négociation sur la réduction de la durée du travail à temps plein (et, dans ce cadre, réduire le temps partie contraint).
Du strict point de vue de l'analyse du rôle des flux financiers accordés par les collectivités publiques en matière d'emploi à laquelle ce rapport a procédé, l'aide pérenne ne se justifie pas. Elle devrait prendre fin avec les aides accordées dans le cadre de la première loi. Les entreprises qui en bénéficient ont maintenant pu absorber le «choc» des 35 heures grâce à ces aides et grâce aux gains de productivité qu'elles réaliseront. Celles qui n'en ont pas bénéficié préfèrent visiblement attendre la deuxième loi sans bénéficier d'aides dont la contrepartie était un accroissement significatif de l'emploi. Or ces entreprises n'anticipent pas une demande plus importante, elles n'ont aucune raison de croître malgré le caractère incitatif de l'aide. La faible portée de l'aide pérenne est ainsi révélée par la proportion des entreprises qui ne se sont pas saisies de la première loi Aubry, malgré l'incitation, voir l'aubaine que constituaient les aides accordées.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
AGEFOS PME (1998). L'emploi et Information dans les PME : un engagement mesuré. Perspectives 1998.
ARACT. Etude de l'ARACT Haut-Normandie sur 8 expériences de réduction et d'aménagement du temps de travail.
Annandale-Massa D. et. Merle V. (1992). «Négocier la modernisation ou moderniser la négociation». Travail et emploi , n° 51, pp 4-19.
Aucouturier A. L. (1994) : Panels et évaluation des politiques de l'emploi. Cahier Travail et Emploi, La Documentation Française, 136 p.
Aucouturier A.-L. et Gélot D. (1994). «Les dispositifs d'insertion des jeunes : une utilisation massive, des trajectoires diversifiées». Économie et statistiques, n° 277 - 278.
Aucouturier A.-L. (1997). Les chômeurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise bénéficiaires d'une aide Publique, exploitation complémentaire de l'enquête SINE auprès des entreprises créées ou reprises au premier semestre 1994 , Collection des rapports du CREDOC, n° 177, mai.
Audier F., Dang A.-T. et Outin J.-L (1998). «Le RMI comme mode particulier d'indemnisation du chômage», in Méhaut et Mossé, Les politiques sociales catégorielles , L'Harmattan, Paris.
Autès M., Bresson M., Delaval B. et Vernier B. (1996), L'insertion : un moment éternel , rapport pour la MIRE, CLERSE-IFRESI, Novembre.
Autume A. d' et Cahuc P. (1998), «La faille du projet des 35 heures», Le Monde , 10 mars.
Barbier (1997). «Du partenariat dans les politiques d'emploi », La lettre du CEE , n° 46.
Baret et Gadrey (1998) «Le temps de travail dans la grande distribution alimentaire en France, en Allemagne et en Grande Bretagne», Travail et Emploi, n° 74.
Baude J., Clerc L., Dauphin J. F. et Mihoubi F. (1997), «La réduction du temps de travail », Étude réalisée pou le compte et sous la responsabilité du Ministère de l'emploi et de la solidarité , sous la direction de Gilbert Cette, décembre.
Baumol W. (1967), «Macroeconomics of unblanced growth : the anatomy of the urban crisis», American Economic Review , n° 57, June.
Bazen S. et Benhayoun G. (1995). «Les effets du salaire minimum sur l'emploi : analyse sectorielle», in Bazen et Benhayoun (eds), Salaire minimum et bas salaires , L'Harmattan, Paris, p. 245-253.
Bazen S. et Martin J. P. (1991). «L'incidence du salaire minimum sur les gains et l'emploi en France», Revue économique de l'OCDE , n° 16, printemps, p. 199-221.
Bellmann L. and Jackman R. (1996). «The Impact of Labour Market Policy on Wages, Employment and Labour Market Mismatch», in Schmid G. et al , pp 725-743.
Bennhayoun G. (1990), Salaire minimum et emploi des jeunes , Centre d'Économie Régionale, Aix-Marseille III, janvier.
Bentabet E., Michun S., Trouvé P. (1999), Gestion des hommes et formation dans les très petites entreprises, Collection Études, n ° 72. Céreq, Marseille Boisard P. et Charpentier P. (1997). «L'annualisation du temps de travail dans les entreprises», Travail et emploi , n° 73, pp 29-73.
Boissonnat J. (1995). Le travail dans vingt ans . Editions Odile Jacob, La documentation française.
Bonafé-Schmitt J.P (1988), "Les enjeux de la négociation collective ", Travail et emploi, n° 36/37, pp. 85-96.
Bonnal L., Fougère D. et Serandon A. (1995). «Une modélisation du processus de recherche d'emploi en présence de mesures publiques pour tes jeunes «. Revue Economique, vol 46, n°3, pp 537 - 548.
Bonneau et Francoz (1996). «Les créateurs d'entreprise". Données Sociales, INSEE.
Bouffartigue P. et Bocchino M. (1998). «Travailler sans compter son temps ? Les cadres et le temps de travail", Travail et emploi n° 74.
Bouillaguet P. (1989). «Les politiques de l'emploi en 1988«. Dossiers Statistiques du Travail et de l'Emploi, n° 51.
Boyer R (1986). La théorie de la régulation, une analyse critique. La Découverte.
Boyer R (1986). La flexibilité du travail en Europe. Editions La Découverte.
Brochier D. (1997). «La politique contractuelle dans la grande distribution alimentaire, genèse et mise en oeuvre de l'engagement de développement de la formation«. Documents du CEREQ, n° 124. mai.
Brun E (1998). Des salariés de la banque face au temps de travail, une comparaison entre les attitudes des gardés d'une banque et d'un établissement mutualiste, mémoire de DEA, LEST-CNRS, Aix-en-Provence.
Bruno C. et Cazes C. (1997). «Le chômage des jeunes en France : un état des lieux « Revue de l'OFCE, n° 62, Juillet, p. 75-107.
Cadet J.P. (1997). «La mise en oeuvre des engagements de développement de la formation au sein de la branche palsturgie : description et analyse d'une référence«. Documents du CEREQ, n° 124, mai.
Cases C. (1991). «La dispersion des salaires dans neuf pays industrialisés«, la Revue de l'IRES, n° 7. p. 59-79.
Cealis R. et Villalard J. (1998). «Les entreprises d'insertion et les associations intermédiaires«, Premières synthèses. DARES, n° 43.1.
Cealis R. et Zilberman S. (1998). «Les emplois familiaux et les organismes de services aux personnes en 1997", Premières synthèses, DARES, n°43.2. Octobre
Cette G. Cunéo P. Eyssartier D. et Gautié J. (1993). «Les effets sur l'emploi d'un abaissement du coût du travail des jeunes. Quelques éléments d'évaluation«, in Baren et Benhayoun (eds), Salaire minimum et bas salaires.
L'Harmattan, Paris, p. 181-241.
Cette G. et Taddéi D. (1992). «Les effets économiques d'une réduction réorganisation du temps de travail", Futuribles, mai-juin, p. 171-193.
Cette G. et Taddéi D. (1994). Temps de travail, modes d'emplois. Vers la semaine de quatre jours ? . La découverte.
CFDT (1999). Le Travail en question. Enquête auprès de 6 000 salariés concernés par la réduction du temps de travail, CFDT.
Chadelat J.F. (1997). Rapport sur la réforme des cotisations patronales, remis au Premier ministre le 16 juin 1997, inédit, texte rendu public dans Liaisons sociales, n° 79/97, 9 septembre.
Charpail C. et Zilberman S. (1996), «Emploi et chômage avant l'entrée en CES et en SIFE«. Premières Synthèses, DARES. 96-07, n° 30.2.
Charraud A. (1993), «L'aide à l'insertion des jeunes : concilier le social et l'économique«, Données sociales, INSEE. p 138-144.
Chaumette P. et Kerbourc'h J-Y. (1996). «L'accès des jeunes à l'emploi«, in Les jeunes et l'emploi. Cahier Travail et emploi. La Documentation française, (p 185-217).
Chouvel F. Confais E. Corrulleau G. Gubian A. et Roguet B. (1996). Impact macro-économique des politiques spécifiques de l'emploi. Le cas de la France, 1974-1994, in DARES (1996).
Comité interministériel de l'évaluation des politiques publiques (1997). La loi quinquennale relative au travail, à l'emploi el à la formation professionnelle. Rapport d'évaluation. La Documentation Française. Paris.
Confais E. Cornilleau G. Gubian A. et Mathieu C. (1993). «Croissance à l'horizon 2000 : haut niveau de chômage ou réduction de la durée du travail ? « Revue de l'OFCE, n° 44, avril, p. 109-154.
Cornilleau G. Heyer E. et Timbeau X. (1997). Simulations à propos de la réduction du temps de travail, Rapport pour la DARES du Ministère de l'emploi et de la solidarité. Contribution de l'OFCE, décembre.
Cour des Comptes (1996). Les interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises. Rapport public particulier. Les éditions du Journal officiel.
CSERC (1996). Les allégements de charges sur les bas salaires. La documentation française.
CSERC (1998). Durées du travail et emplois les 35 heures, le temps partiel, l'aménagement du temps de travail.
La documentation française.
Daniel C. (1998), «Les politiques de l'emploi : une révolution silencieuse«. Droit social, n° 1, Janvier, p. 3-11.
Daniel C. et Picart C. (1997). «L'usage des politiques de l'emploi par les entreprises«, Premières synthèses, DARES, n° 15.1.
DARES (1996). Quarante ans de politique de remploi. La documentation française.
DARES (1997). La politique de l'emploi. Collection Repères, n°228. La Découverte, Paris.
DARES-INSEE-Liaisons Sociales (1996). Les aides à l'emploi marchand. Editions Liaisons sociales
Dayan J.-L. (1994). La politique de l'emploi : mission impossible ?. Document de travail INSEE, 6 décembre
Direction de la Comptabilité publique (1994). "Les aides des collectivités locales en matière économique en 1992", Les Notes bleues de Bercy, n° 45, 16 Août.
Direction de la Comptabilité publique (1996). «Les aides des collectivités locales en matière économique en 1993", Les Notes bleues de Bercy, n° 83, 16 Mars.
Direction de la Comptabilité publique (1997). "Les aides des collectivités locales en matière économique en 1994", Les Notes bleues de Bercy, n° 106, 1er Mars.
Direction de la Prévision (1998). Comptes prévisionnels de la nation pour 1998 et principales hypothèses pour 1999, avril.
Dossiers pratiques Francis Lefebvre (1998). Aides à l'emploi. Francis Lefebvre, Paris Dubar C. (1985). La formation professionnelle continue. La Découverte, Paris.
Dormont B. (1994). Réexamen de la relation coût salarial-emploi. Rapport final d'une recherche soutenue par le CGP. Convention d'étude n° 7/1993, septembre.
Dormont B. (1997). "L'influence du coût salarial sur la demande de travail", Econome et statistiques, n° 301-302, p.-95-110.
Economie des conventions (1) (1989). Revue économique , mars.
Elbaum M. et Marchand O. (1994). «Emploi et chômage des jeunes dans les pays industrialisés : la spécialité française«, Travail et emploi, n° 58, janvier, p. 111-121.
Eyrnard-Duvemay F. (1990). «Modèles d'entreprises et politiques d'enploi". La lettre d'information du CEE, n° 16, juin.
Favereau O. (1998). «Trente cinq heures : le scénario du New Deal«, Le Monde , 13 mars.
Foucauld J. B. de (1995). «Coût du travail, compétitivité, emploi. L'état de la réflexion économique", Futuribles, avril, n° 197, p. 41-45.
Freyssinet J. (1997). Le temps de travail en miettes : 20 ans de politique de l'emploi et de la négociation collective, Editions de l'Atelier.
Freyssinet J. (1997). «La loi Robien : rupture quantitative ou aubaine éphémère ?", La Revue de l'IRES, n° 23, p. 5-35.
Friot B. (1999). Puissances du salariat. Emploi et protection sociale à la française, la Dispute.
Gabrié H. et Jacquier J. L. (1994), La théorie moderne de l'entreprise, l'approche néo-institutionnelle. Economics, Paris.
Gadille M. (1993a). «Les apprentissages d'acteurs de politiques publiques face au paradoxe productivité/emploi",
Document de travail du séminaire d'analyse économique, n° 93/07 Latapses, CNRS, Université de Nice Sophia-Antipolis.
Gadille M. (1993b). La modernisation négociée : évaluation des aides au conseil LIGE et FACT-EP en matière de gestion prévisionnelle de l'emploi et d'amélioration des conditions de travail. Rapport final pour le compte de la Délégation à l'emploi et à la Formation professionnelle, LEST-CNRS, Aix-en-Provence.
Gadille M. (1998) «Construction sociale du marché du travail et limites de la politique de désinflation compétitive en matière d'emploi«, Economie appliquée, n° 4 (à paraître)
Gaffard J.L. (1989). "Efficacité ou visibilité des systèmes manufacturiers flexibles : une analyse macroéconomique", in Cohendet et LIerena, Flexibilité, information et décision, Economica.
Gandois J. (1992). France : le choix de la performance globale, rapport de la Commission Compétitivité française, Commissariat Général du Plan.
Gaspard M. (1997). Réinventer la croissance : les chemins de l'emploi en Europe, Syros, Paris.
Gautié J., Gazier B. et Silvera R. (1994). Les subventions à l'emploi : analyses et expériences européennes, avec la collaboration de Auer P., Anxo D. et Lefresne F., Document Travail et Emploi. La Documentation française.
Gutié J. (1995 ). Chômage des jeunes et politique active de l'emploi en France : du diagnostic à l'évaluation, Thèse de Doctorat, Université Paris I, Décembre.
Gautié J. (1996). «L'évaluation de la politique de l'emploi en faveur des jeunes en France«. Dossier du Centre d'Etude de l'emploi.
Gautié J. (1997). «Les politiques de l'emploi dans les pays de l'OCDE : quelques éléments de comparaison internationale«. In DARES (1997). pp 95 - 110.
Gautié J. (1998). Coût du travail et emploi. Coll. Repères, n° 241. La Découverte. Paris.
Gautié J. et Lefresne F - (1997). «La politique de l'emploi et sa représentation de l'entreprise «. La revue de l'IRES, n° 23
Gaye M. et Gubian A. (1997). «Les allégements de cotisations employeurs sur les bas salaires«, Bilan de la politique de l'emploi en 1996. Dossiers de la DARES, n° 5-6. Décembre. p187-198.
Gazier B. (1990). «L'employabilité : brève radiographie d'un concept en mutation«. Sociologie du travail, vol 32 (4), p. 575-584.
Gazier B. (1996). Evolution des marchés du travail et des politiques d'emploi : vers une approche comparative, METIS. Université Paris I.
Gavier B. et Silvera S (1993). «L'allégement du coût salarial a-t-il un effet sur l'embauche ? « Travail et emploi. n° 55
Gélot D. (1997). «L'impact du contrat initiative emploi sur les modes de recrutement des entreprises«. Premières synthèses. DARES, n° 04 1.
Gélot D. et Holcblat N. (1998). «Perception et utilisation par les entreprises des aides financières liées au CIE", Premières synthèses. DARES. n° 32.l.
Gelot D., Tuchszirer C. et Zilberman S. (1993). «Les effets des aides publiques à l'emploi des jeunes", Premières synthèses, DARES, n° 26 juin.
Goux D. et Maurin E. (1997), «Les entreprises, les salariés et la formation continue « Economie et Statistiques n° 306, p 41 - 55.
Gubian A. et Holeblat N. (1998). «La politique de l'emploi en 1997«. Premières synthèses, DARES, n° 35.2.
Guelaud (1989). La flexibilité du travail dans les hypermarchés. LEST-CNRS. Aix en Provence.
Guillen P. (1995). Une initiative pour l'emploi : le travail différencié.
Guinsburger F. (1998). La gestion contre l'entreprise : réduire le coût du travail ou organiser sa mise en valeur. La Découverte. Paris.
Hammermesh D. (1991). «Labor Demand : What don't we know ? «NBER working paper, n° 3890.
Hoang-Ngoc L. et Lefresne F. (1994). «Les règles d'utilisation du temps partiel dans les régimes d'accumulation français et britannique « La Revue de l'IRES, n° 15.
Husson M. (1994). «Salaire-emploi : l'économétrie difficile«. Document de travail, IRES, n° 94.01, mars.
Iribarne A. (d'). (1990). «La gestion de l'organisation et des ressources humaines et la diffusion de l'innovation", Revue d'Economie Industrielle. n° 51.
Iribame A. (d'), Iribame P. (d') (1999). «Le système éducatif français comme expression d'une culture politique", Revue européenne formation professionnelle du CEDEFOP, n° 17, mai-août, II.
INSEE (1993), «Présentation des propriétés des principaux modèles macro-économiques du Service Public : AMADEUS (INSEE). Banque de France. METRIC (DP) « Documents de travail du Département des Etudes Economiques d'Ensemble. G 9313, septembre.
Jackman R. (1994). «What can Active Labour Market Policy do ?«, Swedish Economic Policy Review, n° 1, p. 221-257.
Jackman R. (1995). International Evidence on the macroeconomic Effect of Labour Market Policy. Paper presented at the Centre for Economie Performance Annual Conference. UK.
Kuznets S. (1966). Modern Economic Growlh Rate, Structure and Spread. New Haven, Yale University Press.
Lallement M. (1996). Relations professionnelles et régulation de l'emploi : France - Allemagne, allers et retours, Rapport pour l'habilitation à diriger des recherches en sociologie. Université Paris X - Nanterre, 160 p.
Layard R. and Nickell S. (1986) «Un employment in Britain«. Economica, 53 p. 121-169.
Layard R., Nickell S. and Jackman R (1991). Un employment Macroeconomic Performance and the Labour Market . Oxford Universily Press.
Le Bihan H. (1998). "L'impact de la réduction des cotisations employeurs : quelques jalons macro-économiques", Revue de l'OFCE, n° 66, juillet, p. 1-28.
Le Corre et Doisneau, (1998). "La réduction de la durée du travail dans le cadre de la loi de Robien", Premières Synthèses. DARES. n° 03.1. Janvier.
Lechène V. et Magnac T. (1996). «L'évaluation des politiques publiques d'insertion des jeunes sur le marché du travail : questions microéconomiques«, in Les jeunes et l'emploi. Cahier Travail et Emploi. La Documentation Française.
Legendre F. et Le Maître P. (1997). "Le lien emploi-coût relatif des facteurs de production : quelques résultats obtenus à partir de données de panel « Econome et statistiques, n° 301-302. p. 111-128.
Lefresne F. (1995). «Les dispositifs d'insertion professionnelle des jeunes en France". Revue de l'IRES, n° 17, Hiver, p. 97-133.
Liaisons sociales. Les cadres et les 35 heures.
Lindbeck A. and Snower D. (1986). The Insider-Outsider Theory of Employment and Unemployment, The M.I.T.
Press, Cambridge.
Lipietz A. (1995). «Une politique de l'emploi centrée sur la conquête du temps libre", in Brovelli, Lipietz, Moscovici et Quin (eds). Quelle économie pour l'emploi ?. Les Éditions de l'Atelier.
Maarek G. (1994 ). Rapport du groupe "Perspectives économiques", Commissariat Général du Plan, juillet.
Malinvaud E. (1998). Les cotisations sociales à la charge des employeurs : analyse économique. Conseil d'Analyse Economique, juillet.
Marioni P. et Roguet B. (1997). «Les programmes mis en oeuvre depuis 1973 : coûts et bénéfices", in DARES (1997), p. 28 - 51.
Méron M. et Minni C. (1995). «Des études à l'emploi : plus tard et plus difficilement qu'il y a 20 ans", Economie et statistiques, n° 283-284, Mars-Avril, p. 9-31.
Milano J. (1996). La réduction du temps de travail, étude de faisabilité et piste de réflexion chez AXA Assurances, Etude pour le compte de la société AXA Assurances sous la direction d'A. d'Iribarne, LEST-CNRS, Aix-en Provence.
Minc A. (1994). La France de l'an 2000. Commissariat Général du Plan, Odile Jacob, Paris.
Mincer J. (1976). «Unemployment effects of Minimum wages", Journal of Political economy, Vol 84, p. 87-105
Ministère de l'économie des finances et de l'industrie (1998). Impact de quelques simulations de passage aux 35 heures sur les finances publiques et l'emploi, février.
Minni C. et Vergnies J-F. (1994), «La diversité des facteurs de l'insertion professionnelle", Economie et statistique, n° 277-278, Juillet-Août, p. 45-59.
Mirochnitchenko K. Verdier E. (1997), «Contrat et action publique. Le cas de la formation professionnelle continue «, Travail et emploi, n° 72. pp. 51-66.
Mirochnitchenko K. (1999). Le temps de travail dans la métallurgie : configuration de branche, stratégie des acteurs et coordination des entreprises. Thèse en économie et sociologie du travail, LEST-CNRS, Université de la Méditerranée, Aix en Provence.
MISEP (1996a). Rapport d'Information de Base Pays - Bas.
MISEP (1996b). Rapport d'Information de Base. Royaume-Uni.
Morin M.L (1997). «La loi quinquennale, une étape pour le régime du temps de travail". Travail et emploi, n° 73, p. 13-28.
Nadel H. (1991), "Les contrats d'étude prévisionnelles", in Pour une prospective des métiers et des qualifications, rapport du groupe de travail présidé par J. Freyssinel pour le Xème plan. La Documentation Française.
Nelson R. and Winter S. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change.
Niklasson H. (1997). Towards an Intensified Local Level Cooperation in the Design and implementation of Labour Market Policies : The Evaluation of some Swedish Projects and Reforms. Paper for the TRANSLAM Project,
Centre for Labour Market Policy Research, Vaxjo University.
Novelli H. et Péricard M. (1996). Les aides à l'emploi. Rapport n° 2943, Assemblée Nationale.
OCDE (1996). "L'apprentissage du travail : les jeunes et le marché du travail dans les années 1980 et 1990«. Perspectives de l'emploi. Juillet, p 119-172.
OCDE (1998). Perspectives de l'Emploi. Juin.
OFCE (1994). «Pour l'emploi cl la cohésion sociale«, par le Groupe international de politique économique l'OFCE, extrait du chapitre introductif. CFDT Aujourd'hui, n° 112, p. 22-33.
OFCE (1998). L'économie française en 1998. Coll. Repères, n° 231. La Découverte. Paris.
Olivennes D. (1994). «La préférence française pour le chômage«. Notes de la Fondation Saint-Simon, février.
Penard T. et Sollogoub M (1995). «Les politiques françaises d'Emploi en faveur des jeunes : une évaluation économétrique «, Revue Economique, n° 3. vol 46, pp 549 - 559.
Perrot A. (1992). Les nouvelles théories du marché du travail, Paris. La Découverte.
Petit P. (1993). Les modalités de la croissance des services au Japon. Communication au séminaire franco-japonais
«Mode de régulation au Japon et relations internationales : de l'histoire longue aux transformations récentes"
CEPREMAP. Paris, Octobre.
Piketty T. (1997), «Les créations d'emplois en France et aux Etats-Unis, services de proximité' contre petits boulots«, Notes de la Fondation Saint-Simon.
Ponthieux S. (1997), «Débuter dans la vie active au milieu des années 1990 : des conditions qui se dégradent", Economie et statistiques, n° 304-305, 4/5, (p 37-51).
Reynaud J.D (1979). «Conflit et régulation sociale. Esquisse d'une théorie de la régulation conjointe «. Revue française de sociologie, vol XX. n° 2, pp. 367-376.
Rigaudiat J. (1993). Réduire le temps de travail. Syros, Paris.
Roguet B. (1997). «Le coût de la politique de l'emploi en 1996 «Bilan de la politique de l'emploi en 1996.
Dossiers de la DARES, n° 5-6. Décembre, p 221-226.
Roguet B. (1998). «La dépense pour l'emploi en 1996 « Premières synthèses. DARES. n° 21.1.
Rotschild-Souriac M.A (1993). «Autonomic de la négociation d'entreprise «, in Les conventions collectives de branche : déclin ou renouveau ?. Collection Etudes, Céreq. Marseille.
Saglio J. (1987). «Les négociations de branche et l'unité du système français de relations professionnelles : le cas des négociations de classification«, Droit social, n° 1, pp. 20-33
Saglio J. (1991), «La régulation de branche dans le système français de relations professionnelles «. Travail et emploi, n° 47, pp. 26-41.
Santelmann P. (1993). «Insertion et formation professionnelle des jeunes. Quel droit à la qualification ?", Droit social, n° 5. Mai, p. 418-427.
Savatier J. (1997). «L'aide aux emplois-jeunes «. Droit social. n° 11, Novembre, p. 908-914.
Schwartz B. (1981). L'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Rapport au Premier ministre. La Documentation française. Paris.
Sellier F. (1986). «Aménagement du temps de travail, articulation entre niveaux de négociation et conflits entre syndicats«, Droit social, n° 11, pp. 773-778.
Sivestre JJ (1986). Marché du travail et crise économique : de la mobilité à la flexibilité «, Formation et emploi, n° 14.
Scarpetta S. (1996). «Le rôle des politiques du marché du travail et des dispositions institutionnelles concernant le chômage : une comparaison internationale«. Revue Economique de l'OCDE, n° 26, pp 1 - 92.
Schmid G. Reissert B. and Bruche G. (1992). Unemployment Insurance and Active Labour Market Policy : An International Comparison of Financing Systems. Wayne State University Press, Detroit.
Schmid G. (1996), Reform der Arbeusmarktpolitik. Document de travail WZB FS 1 96-204, Berlin.
Schmid G. O'Reilly J. and Schöman K. (eds) (1996). International Handbook of Labour Market Policy and Evaluation, Edward Elgar, Cambridge, G-B.
Skourias N. (1995), «Salaire minimum et emploi des jeunes : l'expérience française « in Bazen et Benhayoun (eds).
Salaire minimum et bas salaires. L'Harmattan, Paris. p. 257-279.
Sneessens H. (1993). Pénurie de main d'oeuvre qualifiée et persistance du chômage. Rapport pour le Commissariat Général au Plan, IRES, Université catholique de Louvain.
Sollogoub M. (1993). L'efficacité du système d'éducation et de formation : effets des structures sociales. Rapport pour le Ministère de l'Education Nationale.
Sterdyniak H. Fourmann E. Lerais F., Delessy H. et Busson F. (1994), «Lutter contre le chômage de masse en Europe«. Revue de l'OFCE, n° 48, janvier, p. 177-236.
Serdyniak H. Villa P. (1998). «Pour une reforme du financement de la sécurité sociale" . Revue de l'OFCE, n° 67. octobre, p. 155-205.
Stiglitz J. (1976). "The Efficiency Wage Hypothesis. Surplus Labour, and the Distribution of Income«. Oxford Economic Papers, vol. 28. p. 194-227.
Supioi A. (1989). "Déréglementation des relations de travail et autoréglementation de l'entreprise ", Droit social, n° 3, pp. 195-205.
Supiot A. (1993). «Le travail, liberté partagée«. Droit social, n° 9/10, pp. 715-724.
Taddéi D. (1998). La réduction du temps de travail. Conseil d'Analyse Economique. La Documentation française.
Timbeau X. (1997), «Réduction du temps de travail : quelles modalités ?".
Vedier E. et Broclùer D. (1997). «Les aides publiques à la formation continue dans les entreprises : quelles modalités d'évaluation ?". Documents du CEREQ, n° 124, mai.
Vernoux-Marion I. (1997). «L'évolution du champs et du poids d'une intervention publique : essai d'approche statistique des EDDF«. Documents du CEREQ, n° 124, mai.
VespaA-M. (1995). «Les contrats d'insertion en alternance en 1994", in DARES, Bilan de la politique de l'emploi en 1994. Cahier travail et emploi. La documentation Française. Paris, Octobre p. 81-93.
Vincens J. (1996). «L'insertion professionnelle des jeunes. Délimiter un champ de recherche ?". Note LIRHE, n° 229 (96.29). Novembre.
Vincens J. (1997). "L'expérience professionnelle des débutants". Note LIRHE , n° 261 (9730), Décembre.
Wellington A. (1991). "Effects of the minimum wage on the employment status of youths". The Journal of Human Ressource, vol. 26, n° 1, p. 27-46.
Werquin P. (1997). «1986-1996 : dix ans d'intervention publique sur le marché du travail des jeunes", Economie et statistique, n° 304-305, p. 121-135.
Williamson O. (1985). Les institutions de l'économie. Economica, Paris.
ANNEXES
Annexe 1 : Les stratégies défensives et offensives dans la négociation sur le temps de travail
Annexe 2 : Montant financier des mesures d'allégement du coût du travail pour l'emploi marchand
Annexe 3 : Temps partiel contraint ou choisi en France
Annexe 4 : Taux de marge des sociétés
Annexe 5 : Dispositifs ciblés et principaux destinataires
Annexe 6 : Historique des mesures
Annexe 7 : Annexes mathématiques
Annexe 1 : Les stratégies défensives
et offensives dans la négociation sur
le temps de travail
I. STRATEGIES DEFENSIVES
1. Réduction des salaires sans réduction du TT
|
Entreprise |
Obiectif emploi |
Modalités |
Evolution |
|
BORDELAISE DE CRÉDIT 790 salariés |
Préserver les emplois |
|
Après 18 mois les salariés ont récupéré leur salaire. |
2. Réduction des salaires avec réduction du TT
|
Entreprise |
salaires avec r Objectif emploi |
Modalités |
Evolution |
|
POTAIN 128 salariés non cadres concernés |
Garantir les emplois car sureffectif (crise de l'immobilier) |
Suite à le chute du CA :
|
9 mois après cet accord, la direction annonçait 58 licenciements Plus 13 cadres et 25 techniciens du SAV. |
3. Stratégies de temps partiel défensif
3.1. les entreprises industrielles
|
Entreprise |
Objectif emploi |
Modalités |
Evolution |
|
SNECMA 13 000 salariés |
Réduction du nombre de poste de travail car évolutions constantes (économique, commercial, technologique) |
(aide FNE) avec incitation financière
an "compensation financière équivalente à 4 mois de salaire brut ou prêt pour formation |
1 an plus tard : un autre accord avec Mobilité géographique et professionnelle construite par une gestion individuelle des carrières (établie par la hiérarchie). |
|
GENERALE SUCRIERE 2 000 salariés |
Sauvegarder des emplois (baisse de consommation et concurrence forte) |
|
Entreprise en situation économique saine, mais déplacements des salarié d'un site à l'autre |
|
LU 535 salariés concernés |
Sauvegarder des emplois et résorber un sureffectif Faire face à un concurrence accrue |
|
77 suppressions d'emplois en décembre 94 |
|
DISCO 500 salariés |
Sauvegarder des emplois |
Convention avec pouvoirs publics pour temps partiel à mi-temps Prime exceptionnelle mensuelle Abonnement retraite S.S. et retraite complémentaire PRP avec prime exceptionnelle au moment du passage Aides financières à la mobilité géographique |
3.2. des entreprises de services
|
BRED 2 250 salariés |
Maintien des emplois |
Afin de réduire les frais de personnel, Pour 1'ensemble du personnel
Et pour le personnel administratif
|
1 an plus tard. 100 administratifs (en sureffectif) ont été réorientés dans des fonctions de commerciaux. |
|
IBM France 15 000 salariés |
Maintien des emplois et création d'un nouveau modèle d'entreprise |
Temps partiel à la carte :
|
Relance du dialogue entre employés et hiérarchie. Aucun conflit et adhésions de plus en plus nombreuses au temps partiel à la carte. |
|
PARIBAS 3 500 salariés |
Adaptation de l'organisation au temps partiel |
- Temps partiel aidé : incitation financière sans réduction des droits à la retraite
|
Temps partiel annualisé : 25 personnes dont 1/3 d'hommes Temps partiel aidé : 38 personnes. |
II. STRATEGIES OFFENSIVES
1. stratégie offensive de RTT
|
Entreprise |
Objectif emploi |
Modalités |
Evolution |
|||
|
AFER 100 salariés |
|
|
|
|||
2. stratégies offensives privilégiant l'aménagement du TT (durée d'utilisation des équipements
2.1. les entreprises industrielles
|
Entreprise |
Objectif emploi |
Modalités |
Evolution |
|
FONDERIE BOUHYER 230 salariés concernés |
Aménagement durée du temps de travail et travail en équipes |
|
|
|
HEWLETT-PACKARD FRANCE 200 salariés concernés |
Flexibilité des horaires de travail en équipes |
possibles) avec horaire moyen de 35 h
|
37 postes crées |
|
KODAK-PATHE 2 700 salariés |
Annualisation du TT |
|
Maintient de 25 emplois permanents |
|
LEFEBVRE 800 salariés |
Annualisation du TT et création de postes (fluctuations saisonnières) |
|
Embauches des - 26 ans en CDI : 20 jeunes en 1994 et 10 en 95 car : implication des cadres, bon climat social, enlacements tenus relatifs à l'emploi |
|
BRIOCHES PASQUIER 1 100 salariés |
Annualiser et aménager le temps de travail en instaurant la semaine de 4 jours, pour :
|
|
|
3. Stratégies offensives privilégiant le temps partiel
3.1. Temps partiel choisi sans compensation versée par l'entreprise
|
Entreprise |
Objectif emploi |
Modalités |
Evolution |
|
RHONE POULENC CHIMIE 13 000 salaries |
Réduction du coûts et création d'emploi |
Consultation salariés et organisations syndicales PRP par FNE Gestion de la mobilité interne Reconversion avec aides personnalisées |
1 000 a 1 200 mutations internes par an |
|
CARREFOUR 678 salariés concernés Accord renouvelé au bout d'un an |
En réponse aux attentes des salariés
|
|
3.2. Temps partiel avec compensation versée par l'entreprise
|
Entreprise |
Objectif emploi |
Modalités |
Evolution |
|
FLEURY MICHON 1 900 salariés |
Favoriser ta modulation d'horaires et limiter le chômage des femmes. |
|
|
|
AGF 6 669 salariés |
|
|
Mise en place d'une GRH accompagnée d'une réflexion sur les aménagements du temps de travail possibles. Temps choisi a surtout concerné les femmes salariés. |
|
GROUPE AZUR 2 000 salaries Accord ne concernant que le personnel sédentaire |
|
|
|
|
UAP 9 600 salariés concernes |
Temps choisi, rajeunir la pyramide des âges et accès i l'emploi |
Programmation annuelle
|
4. Modulation du temps de travail et GRH
4.1. des entreprises industrielles
|
Entreprise |
Objectif emploi |
Modalités |
Evolution |
|
UNIMETAL 4 500 salaries |
Temps choisi |
Temps choisi par convention FNE Indemnité de passage au temps partiel Cotisations retraites calculées sur temps plein TRILD < 5 jours sauf volontariat sur 3 mois consécutifs Indemnité complémentaire pour les bas salaires Commission de SUIVI |
|
|
USINOR SACILOR 53 000 salaries |
Préretraite progressive |
PRP par convention FNE
|
4.2. des entreprises de services
|
AFPA 11 000 salariés |
GPEC |
sans avec indemnité forfaitaire de passage.
|
250 embauchés en 1993 450 au premier semestre 94 Prévision de 1 200 départs sur 3 ans. |
|
LA FRANCE ASSURANCE |
GPE |
|
|
|
LA CONCORDE 900 salariés |
Temps partiel et dispense d'activité |
la retraite (60 % salaire brut)
|
|
|
MACIF 5 500 salariés |
PRP pour les + 55 ans |
|
|
|
LES MUTUELLES DE LOIRE ATLANTIQUE 600 salariés |
Création d'emploi et insertion |
PRP avec embauches compensatrices et cotisations retraite sur temps plein Temps choisi sous forme de repos sans solde Développement formation en alternance |
Annexe 2 : Montant financier des mesures
d'allégement du coût du
travail pour l'emploi
marchand
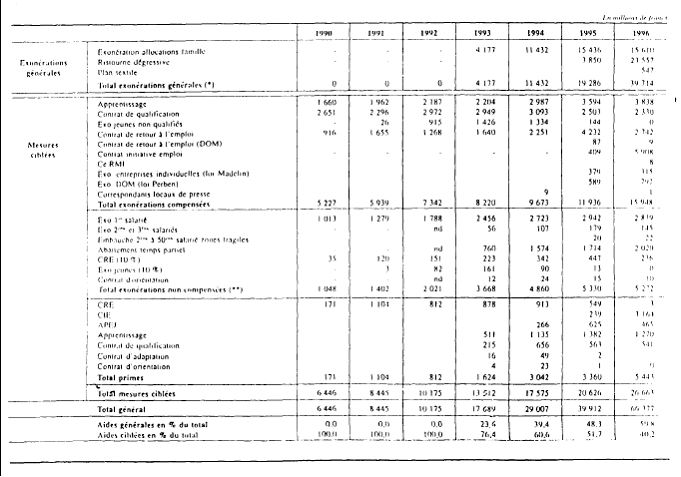
Annexe 3 : Temps partiel contraint ou choisi en France
Actifs à temps partiel « accepté » et à temps partiel « contraint »
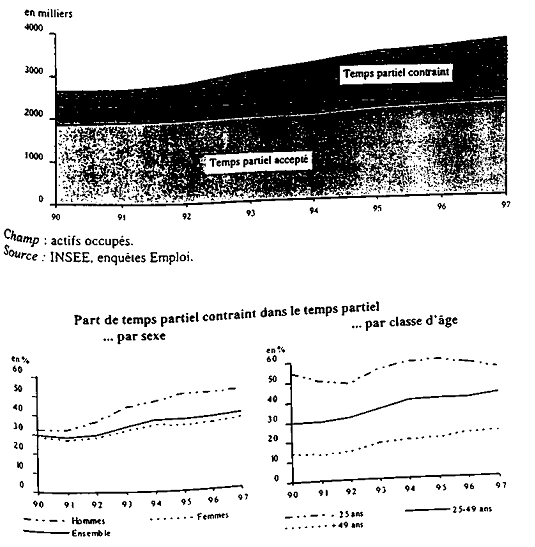
Champ : actifs occupés. Champ : actifs occupés.
Source : INSEE, enquêtes Emploi. Source : INSEE, enquêtes Emploi.
Annexe 4: Taux de marge des sociétés
(Part de l'excédent brut d'exploitation dans la valeur ajoutée)
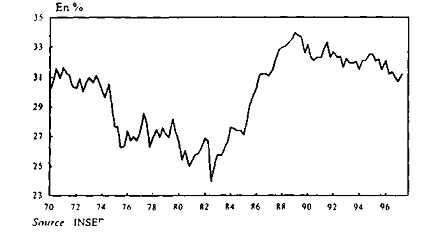
Annexe 5 : Dispositifs ciblés et principaux destinataires
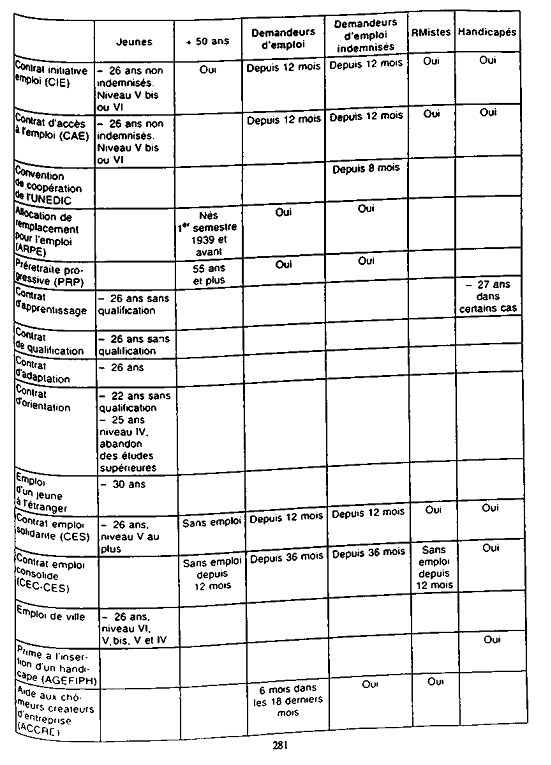
Annexe 6 : Historique des mesures
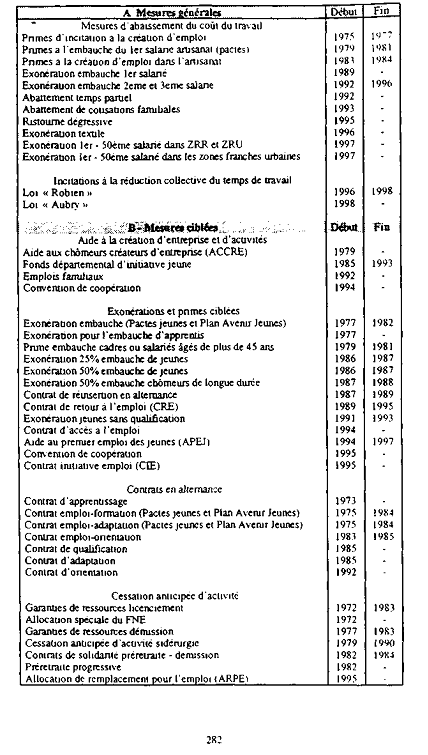
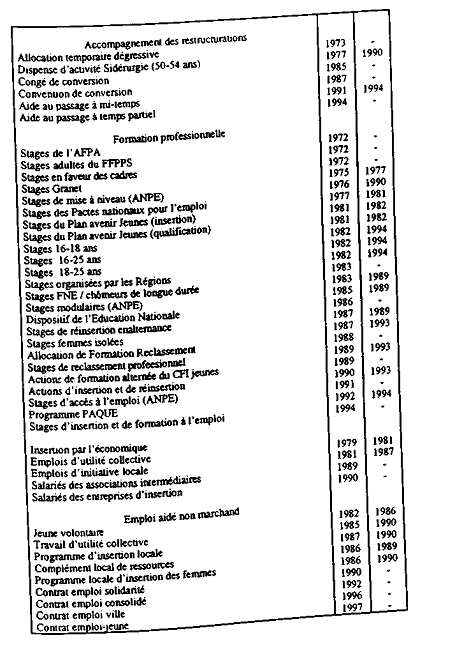
Annexe 7
ANNEXES MATHÉMATIQUES
|
Le « modèle de Malinvaud » revisité : Les effets d'une baisse des cotisations patronales (Modèle 1) |
Nous nous proposons dans cette annexe mathématique de reprendre le cadre d'analyse présenté par Edmond Malinvaud dans son Rapport du Conseil d'Analyse
Économique de juillet 1998 intitulé « Les Cotisations sociales à la charge des employeurs :
analyse économique » ( confer les pages 77 à 92, « Modélisations visant à préciser
quelques ordres de grandeur » ), pour le compléter par quelques éléments permettant un bouclage complet du modèle que l'auteur a esquissé. Notre attention se portera plus
spécifiquement sur les effets de scénarios alternatifs d'ajustement budgétaire du modèle. Par souci de simplification, nos raisonnements seront tenus en économie fermée.
Nous considérons que la production (notée Q) de l'économie nationale peut être représentée par une fonction de production macroéconomique, à rendements d'échelle constants, combinant deux facteurs de production : du capital et du travail. Cette fonction de production, supposée à facteurs substituables, s'écrit traditionnellement sous la forme d'une Cobb-Douglas, de la manière suivante :

avec 0 <á <1, et où K désigne le stock de capital physique, N le travail, et A la productivité globale des facteurs (c'est-à-dire la technologie) ; t étant un indice de temps.
On considère par ailleurs que l'équilibre comptable de l'économie nationale (en On considère par ailleurs que l'équilibre comptable de l'économie nationale (en économie fermée) permet d'écrire classiquement la production comme :
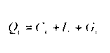
où C représente la consommation. I l'investissement et G les dépenses publiques.
Supposons que la consommation se décompose en une composante de salaires (N) et une composante de revenus non salariaux (R), comme suit :

où < ù > est le taux de salaire réel (hors cotisations sociales), c, et c, étant des paramètres tels que : c 1 + c 2 = 1, avec : 0 < c 1 < 1 et 0 < c 2 < 1.
La dynamique d'accumulation du capital physique, déterminée selon la méthode de l'inventaire permanent, donne l'écriture de l'investissement suivante :
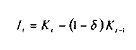
avec < ä > le taux de dépréciation du stock de capital physique, tel que : < ä > 0.
Nous reviendrons plus loin sur les choix d'écritures des dépenses publiques en fonction de leurs modes de financement alternatifs (taxation sur le produit versus cotisations sociales notamment), sur lesquels nous centrerons notre problématique.
Si l'on suppose, par simplification, qu'à long terme, le taux de croissance de l'économie est nul, nous aurons :

Aussi l'équilibre comptable de la production devient-il dans le long terme, sous sa forme développée :
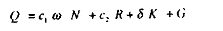
Nous considérons par ailleurs que, dans cette économie, les entreprises cherchent à minimiser intertemporellement leurs coûts de production, selon :
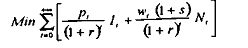
sous la contrainte :
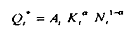
où s désigne le taux de cotisation sociale sur les salaires, p le prix des biens dans l'économie nationale, et r un taux d'actualisation (correspondant au taux d'intérêt nominal). L'exposant * que la variable Q est à considérer ici comme une demande anticipée.
La résolution de ce programme d'optimisation intertemporelle par les entreprises consiste, en utilisant les techniques mathématiques habituelles en la matière, à former le Lagrangien L :
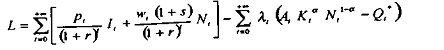
lequel Lagrangien vérifie à l'optimum les conditions de premier ordre suivantes :

où < ë > est le coefficient multiplicateur On a ainsi :
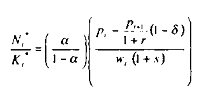
Sur cette base, en réécrivant la fonction de production macroéconomique sous la forme équivalente suivante :

et en posant que le taux d'inflation (ô) de cette économie vaut :

il vient simplement :
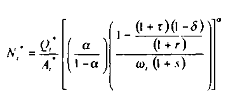
De manière symétrique, en posant :

il s'ensuit que :
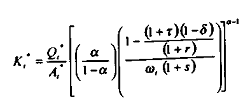
Or, par approximation, on a :
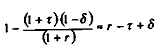
le terme (r-t) correspondant au taux d'intérêt réel. L'expression (r - t + ä) donc au coût d'usage du capital.
Il devient dans ces conditions possible de dériver les équations de demandes de facteurs de production dans le long terme. Nous obtenons par conséquent l'expression de la demande de travail :
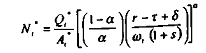
Avec, en dynamique :
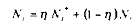
où ç est un paramètre tel que : 0< ç <1.
De même, nous avons l'écriture de la demande de capital suivante :
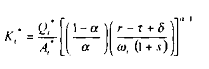
Avec, en dynamique :
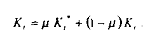
où la valeur paramétrique de ì est telle que o< ì < 1:
Nous reprenons l'équation de salaire proposée par Malinvaud, que l'on peut interpréter comme celle de l'offre de travail :
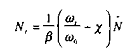
â et ÷ étant des coefficients positifs Le terme « N barre » représente la population disponible à la recherche d'un emploi.
Nous admettrons que les variables anticipées et effectives s'égalisent dans le long terme :


On a alors :
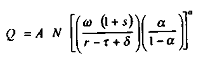
et :
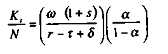
A partir des expressions de la fonction de production d'une part et de l'équilibre comptable de l'économie d'autre part, on obtient la relation suivante :
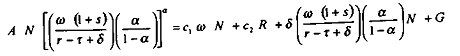
Si maintenant on suppose que les revenus autres que salariaux sont proportionnels au Produit final (î étant un coefficient strictement positif), de sorte que :

de ce qui précède, il est alors possible de déduire simplement :

A ce niveau, deux scénarios alternatifs d'ajustement budgétaire sont examinés, selon que les dépenses publiques G sont supposées financées par une taxation sur le produit (hypothèse 1) ou par des cotisations sociales sur les salaires (hypothèse 2).
Hypothèse 1
Supposons que :
G = ø Q
où le taux d'imposition est un paramètre tel que : 0 < < 1.
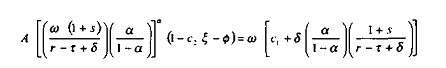
Dans ce premier cas, nous avons :
d'où il vient l'expression du taux de salaire réel :
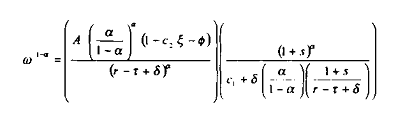
Si ä = 0, alors l'équation précédente peut se réécrire comme :
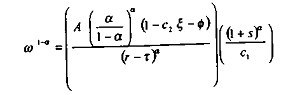
Il apparaît clairement que ù une fonction croissante de s.
Conclusion 1
Toute diminution de s entraîne donc une ù par conséquent une baisse réduction de N. Une diminution du taux des cotisations sociales a dans ces conditions un effet négatif sur l'emploi dans l'économie considérée.
Hypothèse 2
Supposons maintenant que :

où, comme précédemment indiqué, s est le taux de cotisation sociale et ù le taux de salaire réel.
Dans ce second cas, nous avons :
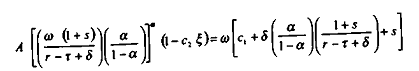
d'où il vient l'expression du taux de salaire réel :
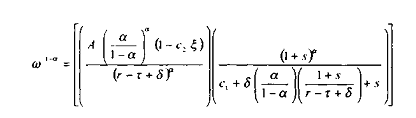
Si ä = 0, alors cette expression de ù devient :
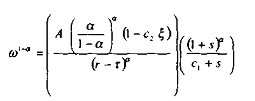
Ici, puisque 0 < á< 1 et 0 < c 1 < 1 , ù devient une fonction décroissante de s.
Conclusion 2
Toute diminution de s entraîne donc une hausse de , et par conséquent augmentation de N. Une diminution du taux des cotisations sociales a dans ces conditions un effet positif sur l'emploi dans l'économie considérée.
|
Le transfert des cotisations sociales
|
Considérons maintenant que, dans l'économie étudiée, les firmes tendent à maximiser intertemporellement leurs profits, selon :
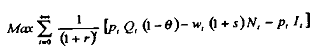
où s désigne toujours le taux de cotisation sociale sur les salaires, è le taux de taxation sur la valeur ajoutée, et r le taux d'intérêt nominal.
Les entreprises sont confrontées au programme d'optimisation suivant :
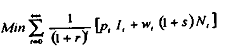
sous la contrainte :
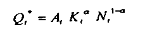
et dont la résolution donne les deux équations de long terme des demandes factorielles (de travail et de capital) suivantes :
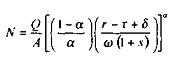
et :
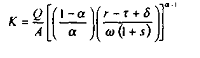
La consommation s'écrit comme la somme des salaires et des autres revenus :
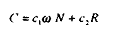
Avec ù le taux de salaire réel (hors cotisations sociales).
L'offre de travail est donnée par :
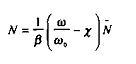
La production en longue période est déduite de l'équilibre comptable de l'économie (en économie fermée), soit :
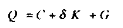
où G sont les dépenses publiques.
Posons des revenus non salariaux proportionnels au produit final, avec î >0 :

d'où :
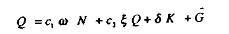
A ce niveau, nous examinons deux scénarios alternatifs d'ajustement budgétaire, selon que les dépenses publiques G sont supposées financées par une taxation sur le produit -- i.e. comptablement, sur la somme des valeurs ajoutées- (hypothèse 1) ou par des recettes provenant à la fois de cotisations sociales sur les salaires et d'une taxe sur la valeur ajoutée (hypothèse 2).
Hypothèse 1
Si l'on suppose que :

avec un paramètre tel que : 0< < 1, la conclusion précédemment mise en évidence par la résolution du scénario n° 1 dans la présentation du « modèle de Malinvaud » est conservée : ù est fonction croissante de s.
Conclusion 1
Toute diminution de s entraîne donc une réduction de ù, et par conséquent une baisse de N. Une diminution du taux des cotisations sociales a dans ces conditions un effet négatif sur l'emploi dans l'économie considérée.
Hypothèse 2
Supposons à présent que :
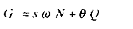
où le terme è s'interprète comme la recette d'une taxe sur la valeur ajoutée, et S ù N comme celle constituée par les cotisations sociales sur les salaires
Dans ce cas, il vient :
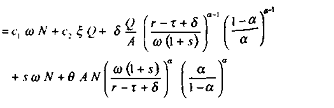
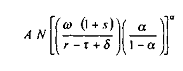
En conséquence, en posant un taux de dépréciation nul du capital, et à niveau de dépenses publiques inchangé, l'expression de la ; de dépréciation nul du capital, et à niveau 1 de la production devient en différenciant :

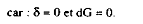
Or, de l'équation de demande de travail, on obtient l'équation suivante :
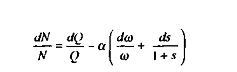
En acceptant la nullité du paramètre ÷ nous dérivons de l'écriture de l'offre de travail ceci :
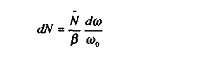
Comme dG = 0, on peut écrire :
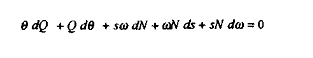
On obtient ainsi :
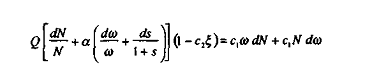
Or :
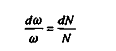
Donc :
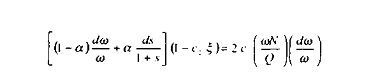
Il vient alors
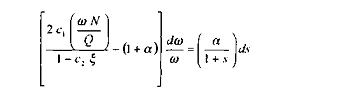
En retenant les valeurs de paramètres suivantes, conformes aux données statistiques disponibles :
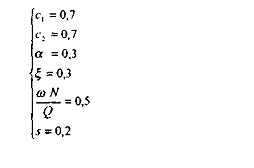
ce calibrage très simple du modèle montre que :
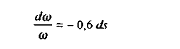
et :
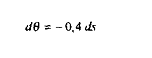
Conclusion 2
Toute diminution de S 2 entraîne donc une hausse de ù et par conséquent une augmentation de N. Une diminution du taux des cotisations sociales a dans ces conditions un effet positif sur l'emploi dans l'économie considérée. Donc, le transfert des cotisations sociales vers une taxe sur la valeur ajoutée est bénéfique pour l'emploi de cette économie, et ce sans détériorer le budget de l'État
|
Le transfert des cotisations sociales
|
Il s'agit maintenant de créer une assiette d'imposition avec une taxe sur l'excédent brut d'exploitation. La question est de savoir si le transfert des charges sociales vers telles taxes a un effet positif sur l'emploi ou non.
Considérons que la firme cherche à résoudre le programme d'optimisation :
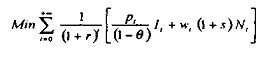
sous la contrainte :
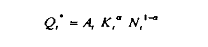
où s est le taux de cotisation sociale sur les salaires, 0 le taux de taxation sur la valeur ajoutée, et r le taux d'intérêt nominal ; avec :
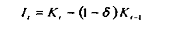
Si l'on pose, pour simplifier les écritures :
alors, dans le long terme, les demandes de facteurs travail et capital sont les suivantes :
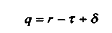
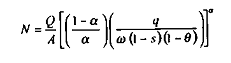
et :
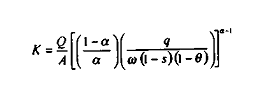
Avec ù le taux de salaire réel (hors cotisations sociales).
Comme précédemment, l'offre de travail est donnée par :
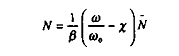
La production s'écrit comme :
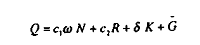
Nous supposerons dans ce qui suit que ä = 0
À ce niveau, nous choisissons d'écrire, dans cette version du modèle, les dépenses publiques comme financées d'une part à partir des cotisations sociales sur salaires. Et d'autre part grâce aux recettes provenant d'une taxe sur l'excédent brut d'exploitation (c'est-à-dire sur une assiette déduisant les salaires des valeurs ajoutées) ; soit :
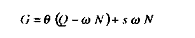
où l'ajustement budgétaire opérera entre è et s de telle manière que les dépenses publiques
demeurent inchangées en niveau (dG = 0).
Ainsi, en différentiant, il vient :
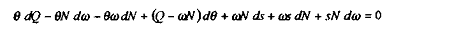
On considère qu'initialement, le paramètre est nul (c'est-à-dire que l'on se retrouve dans le cas de figure précédent où le financement des dépenses publiques n'est couvert que par cotisations sociales sur salaires). En conséquence, on a simplement :
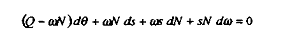
nous avons aussi :
Puisque

Puisque (dG = 0)
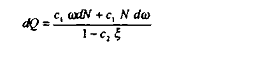
et, par ailleurs, comme, initialement. è = 0
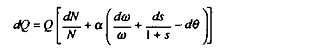
Or, on sait que :
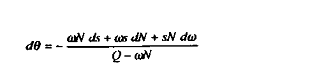
Donc :
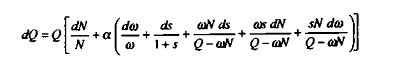
Si ÷ = 0 , alors on a :
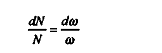
Il vient :
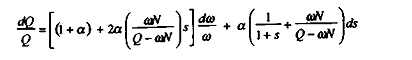
D'où l'on déduit finalement l'expression :
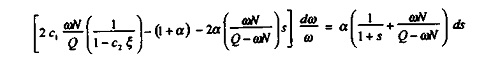
On a :
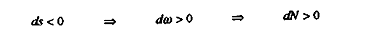
En acceptant les valeurs de paramètres suivantes, selon les données statistiques disponibles :
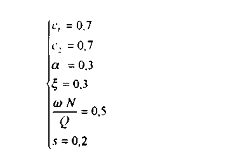
ce calibrage très simple du modèle montre que :
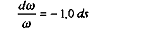
et :
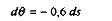
L'impact est donc sensiblement plus fort que dans le modèle avec taxe sur la valeur ajoutée, dans la mesure où le coût relatif du travail diminue davantage dans cette version avec taxe sur l'excédent brut d'exploitation : s diminue et è augmente. L'augmentation de la taxe sur l'excédent brut d'exploitation est plus forte que dans le cas de la taxe sur la valeur ajoutée (car l'assiette d'imposition est plus réduite).
Conclusion
Toute diminution de s entraîne donc une hausse de et par conséquent augmentation de N. Une diminution du taux des cotisations sociales a dans ces conditions un effet positif sur l'emploi dans l'économie considérée. Le transfert des cotisations sociales vers la taxe sur l'excédent brut d'exploitation a un impact positif sur l'emploi de cette économie, sans pour autant détériorer le budget de l'État.
|
La modulation des cotisations sociales
|
Nous considérons maintenant que l'économie est composée de deux firmes indicées 1 et 2, qui se partagent entre elles le marché domestique, selon un paramètre de distribution positif noté ì Ces deux entreprises résolvent un programme d'optimisation identique, prenant la forme de celui présenté précédemment, dans la première version modèle « à la Chadelat ». Ce programme permet de déduire les équations de demande de facteurs de production des entreprises 1 et 2.
et:
Les demandes de facteur travail et de facteur capital dans le long terme pour la firme 1 sont respectivement :
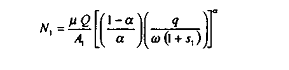
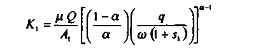
Symétriquement, les demandes factorielles sont pour la firme 2
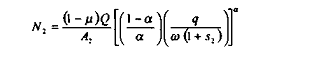
et :
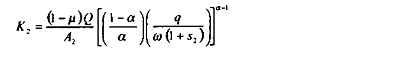
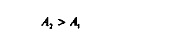
Nous supposons d'une part, qu'initialement, le taux de cotisations sociales sur les salaires est le même dans les deux secteurs :
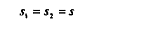
D'autre part, que la proposition de la masse salariale dans la production est plus forte dans le secteur 1 que dans le secteur 2
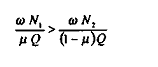
La consommation totale, somme des salaires (versés dans les deux secteurs) et des autres revenus, s'écrit désormais :
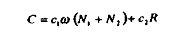
Avec ù le taux de salaire réel (hors cotisations sociales).
L'offre totale de travail est toujours donnée par :
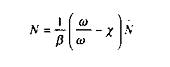
avec :
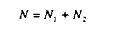
La production totale de l'économie en longue période vaut maintenant :

où G sont les dépenses publiques, et pour un paramètre positif :

Nous choisissons dans la suite du raisonnement un financement des dépenses publiques G par des recettes provenant des cotisations sociales sur les salaires prélevées dans les deux secteurs ; ce qui s'écrit :
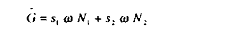
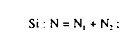
alors :
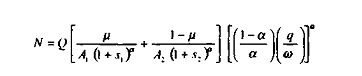
On obtient donc :
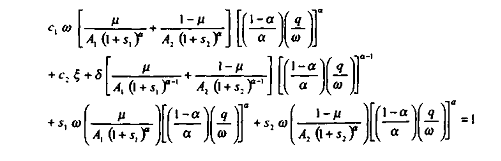
En supposant nul le taux de dépréciation du capital, il vient :
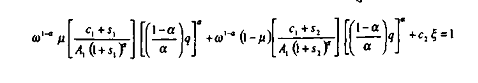
Posons pour simplifier les écritures que :
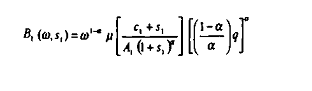
Et
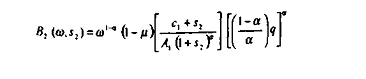
et différentions ces expressions :
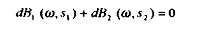
Avec :
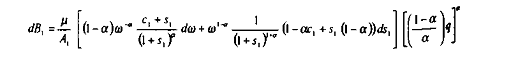
et
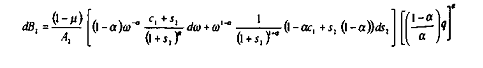
Il vient, par sommation de ces deux dernières expressions, en conservant l'hypothèse de taux de cotisations sociales initialement égaux pour chacune des firmes :
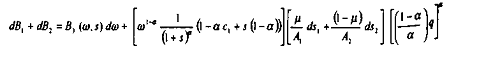
où :
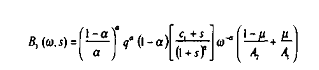
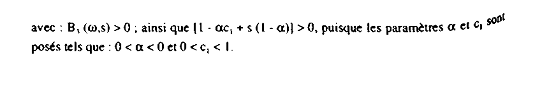
À ce niveau, nous examinons un scénario d'ajustement budgétaire dans lequel les dépenses publiques G sont supposées financées grâce aux cotisations sociales sur les salaires, mais en modifiant la charge respective incombant à chacun des deux secteurs, en faveur du secteur 1 (secteur où la part de la masse salariale dans le produit est relativement plus importante) et en défaveur du secteur 2 (relativement moins « travaillistique »).
On différencie les variations des taux de cotisations sociales selon la règle :
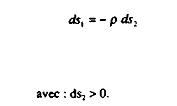
Le paramètre p est proportionnel au contenu en emploi des entreprises. Concrètement, on retient une valeur de ce paramètre telle que :

On trouve :
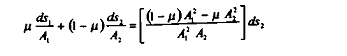
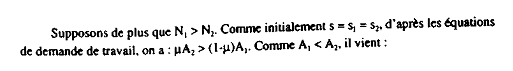
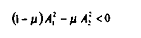
Dans ces conditions, une hausse de S 2 et une baisse de S 1 selon la règle annoncée ci-dessus, entraîne une augmentation de ù et donc aussi de N.
Conclusion
Toute diminution de s 1 , autorisée par un accroissement de s 2 , entraîne donc une hausse de ù et par conséquent une augmentation de N. Une diminution du taux des cotisations sociales dans le secteur où le facteur travail est abondamment utilisé, financée par une augmentation du taux de cotisations sociales dans le secteur où la part de la masse salariale dans la produit est relativement moins importante, a dans ces conditions un effet positif sur l'emploi total dans l'économie considérée.
* 1 Le METIS est devenu en septembre 1998 MATISSE (Modélisations Appliquées, Trajectoires Institutionnelles.
Stratégies Socio-Economiques - CNRS - UMR n° 85 95).
* 2 L'Association pour la Structure Financière est une structure spécifique destinée à financer les conséquences de l'abaissement de l'âge de la retraite, notamment du point de vue de financement du maintien des dispositifs de préretraites garanties de ressources de l'UNEDIC pour les bénéficiaires effectifs et potentiels au 1er janvier 1983 (ces flux, financiers ont existé jusqu'en 1995). Elle est financée par une cotisation sur les salaires, une subvention de l'Etat, et le recours à l'emprunt.
* 3 Ceci renvoi aux exonérations de cotisations sociales accordées par les régimes sociaux (assurance-maladie, retraite...) dans le cadre des politiques actives de l'emploi, et ne faisant pas l'objet d'une compensation par l'État : elles correspondent donc à un manque-à-gagner pour les régimes sociaux, non pris en compte dans la DPE jusqu'en 1995. À partir de cette date, les Comptes de l'Emploi intègrent ces "dépenses".
* 4 À l'oppose, les indemnités de licenciement versées par les entreprises, de nature essentiellement conventionnelle. ont été exclues du compte de l'emploi en France.
* 5 Ces chiffres, ainsi que les suivants en l'absence d'indication contraire, sont ceux de l'année 1996 (source : OCDE. Perspectives de l'emploi, 1998). Voir tableau 1. infra.
* 6 Nous rappelons que les catégories de dépenses distinguées par l'OCDE sont les suivantes :
- dépenses "actives " ; dépenses pour l'administration et le service public de l'emploi : dépenses en faveur de la formation professionnelle des adultes ; mesures en faveur des jeunes ; mesures d'aide à l'embauche (subventions à l'emploi dans le secteur privé, emplois temporaires dans le secteur public ou associatif, aides aux chômeurs créateurs d'entreprises) ;
- dépenses " passives " : indemnisation du chômage, retraites anticipées financées sur fonds publics.
Le " taux d'activité " de la dépense est défini comme le rapport entre la somme des dépenses " actives " et le total de la dépense pour l'emploi.
* 7 Non comptabilisée dans les données OCDE pour 1998.
* 8 Et nos propres calculs.
* 9 Ces calculs de dépense moyenne par chômeur, rapportée au PIB par habitant figurent dans Economi e Européenne, 1996. On doit noter que le fait de rapporter la dépense au nombre de chômeurs présente un caractère problématique. dans la mesure où la composante active de la dépense pour l'emploi est supposée agir sur le nombre de chômeur.
* 10 Structures en pourcentage calculées sur la base des données en pourcentage du PIB. Les totaux sont légèrement différents de 100 en raison des approximations.
* 11 Les caractéristiques présentées dans ce paragraphe sont fondées sur les documents de synthèse publiés par le MISEP pour les pays de la Communauté Européenne. Les éditions consultées sont en général celles de 1996 (MISEP, 1996).
* 12 Nous rappelons que nous nous concentrons ici sur les structures de mise en oeuvre des politiques actives. En France, les partenaires sociaux ont la charge de la gestion de l'indemnisation du chômage.
* 13 Page 11
* 14 Source DARES
* 15 Ou au bénéficiaire lui-même s'il crée sa propre entreprise .
* 16 Jusqu'en 1992 les entreprises de moins de 10 salariés en étaient exemptées. Depuis 1992, la construction s'élève à 0,15 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 10 salariés, et à 1,5 % pour celles de plus de 10 salaries.
* 17 Goux et Maurin (1997), p 54.
* 18 Ceci est en conformité avec les principes généraux des politiques sociales (assurance vs solidarité).
* 19 Le taux de croissance des DEFM (catégorie 1) passe de 8,9 % en 1993 à 5,0 % en 1994.
* 20 Cette hausse fait plus que compenser les conséquences sur le taux d'activité de la croissance des dépenses d'indemnisation du chômage.
* 21 Schmid analyse cet effet d'éviction (overcrowding effect) dans une perspective plus générale : un financement
intégré des politiques actives et passives conduit : selon l'auteur à un risque plus important d'éviction des dépenses actives par les dépenses passives, en cas de montée du chômage C'est ce principe que nous appliquons ici au cas des
préretraites.
* 22 C'est la mesure qui connaît le développement le plus important à cette période. Elle fut créée en 1981, les entrées dans cette mesure étant stoppées en 1983.
* 23 Ce transfert de charges a lieu au travers de la création d'une structure spécifique (l'Association pour la Structure Financière - ASF), financée par une cotisation sur les salaires et par une subvention de l'État.
* 24 La part de l'État dans les dépenses de préretraite passe de 2,6 % en 1978 à 36,4 % en 1983.
* 25 En 1973. elle représentait 56 % du total de la DPE. Cette put relative s'est réduite (29 % en 1995) du fait de l'accroissement des autres catégories de dépenses.
* 26 Elle correspond alors à 16 % du total de U DPE. contre 14 et 13 % pour la formation des jeunes et chômeurs en 1994 et 1995, respectivement.
* 27 Soit 40 milliards en incluant les " exonérations non compensées"
* 28 La liste des mesures créées depuis 1990 dus cette catégorie est la suivante (entre parenthèses les dates de mise en place, et, le cas échéant, de suppression des mesures) :
Emploi non-marchand aidé :
Contrat Emploi Solidarité (90-). Contrat Emploi Consolidé (92-) ; Contrat Emploi de Ville (96-) ;
Emploi non-marchand aidé :
Contrat de Retour à l'Emploi (89-95). Contrat Initiative Emploi (95-). Entreprises d'Insertion (90-). Emploi Familiaux (92-). Allégement des charges sur les bas salaires (93-). exo-jeunes (91-93), exo-premier salarié (89-). abattement temps partiel (92-). [Source : DARES (1997. p 43)]
* 29 Ce qui a été en partie intégré par les pouvoirs publics qui ont développé récemment de nouvelles cibles "jeunes" : "jeunes issus de quartiers à l'habitat dégradé" des contrats-ville, du programme TRACES du plan de lutte contre l'exclusion.
* 30 Un troisième objectif est aussi avancé : la promotion de nouvelles activités et de nouveau emplois, objectif relancé dans le cadre du programme "nouveaux emplois, nouveaux services", qui structure en partie le plan emploi-jeunes.
* 31 LA DARES distingue les dispositifs spécifiques de politique de l'emploi, qui constituent selon elle le noyau dur de la politique de l'emploi (DARES. 1996. p. 77). des dispositifs non-ciblés qui sont, au sein de la DPE :
- L'indemnisation du chômage (exclue du champ de notre étude)
- la formation professionnelle continue des actifs occupés
- les dispositifs destinés aux travailleurs handicapés
- les dispositifs destines aux entreprises, même si les conditions d'attribution font explicitement référence à un nombre d'emplois créés ou maintenus sur une certaine période, comme prime d'aménagement du territoire, les subventions du comité interministériel des restructurations industrielles (CIRI). le chômage partiel ou les conventions pour la réduction ou l'aménagement du temps de travail.
* 32 L'indicateur agrégé de productivité apparente du travail met ainsi en évidence que pour tous les pays, les gains et productivité dans les services sont inférieurs à ceux de l'industrie. Ainsi, en Europe, durant la période 1960-73, les gains de productivité sont en moyenne de 4,7 % l'an dans l'industrie contre 3,1 dans les services. Cet écart s'est agrandi dans la période 1973-90, puisque les gains de productivité de l'industrie sont en moyenne de 2,5 % l'an contre 0,5 pour les services.
* 33 Cette expansion est nécessaire pour financer par transfert fiscal le développement des biens collectifs sans exercer de tensions fiscales excessives.
* 34 La notion de qualification de l'emploi est polysémique parce qu'elle dépend de la convention que se donnent les acteurs de la relation salariale. Ainsi, la qualification est rarement liée à la valeur ajoutée individuelle, celle-ci étant difficilement mesurable et hétérogène selon les secteurs. Elle ne dépend pas non plus de la seule qualification personnelle des travailleurs que représentent leur diplôme et leur expérience. Dans la mesure où elle définit la part de la "qualification personnelle" requise pour un emploi donné, la reconnaissance salariale dans les grilles de classification constitue une approximation de la qualification d'un emploi. C'est dans ce sens que nous utiliserons ici la notion d'emplois "qualifiés".
* 35 Le terme renvoie à un discours de Jacques Chirac.
* 36 Au contraire, les chèques emploi-services peuvent être considérés comme une simplification administrative de l'offre, sans décharger l'employeur de ses obligations légales (congés payés, indemnités de licenciement, etc).
* 37 C'est le terme utilisé par Olivennes (1994).
* 38 Les développement qui suivent sur le temps partiel reprennent la partie historique du travail effectué par Hoang Ngoc L. et F. Lefresne (1994).
* 39 Certains accords définissent cependant des planchers conventionnels, étendent le champ du temps partiel au-delà des 4/5ème de l'horaire normal, ou encore étendent le droit de priorité des salariés en place vers les demandeurs d'emploi.
* 40 La lettre de Matignon du 25 février 1985 : " le temps partiel multiplie les chances dans la lutte pour l'emploi. Il ouvre des voies nouvelles pour accompagner la modernisation des entreprises."
* 41 Le décret du 31 mars 1985 a ainsi instauré des conventions sur l'aménagement du temps de travail et la modernisation, se substituant aux anciens contrats de solidarité de réduction de la durée du travail. Elles offrent une prime pour chaque heure réduite par salarié. Mais très peu de conventions signes en 1987 (cinq réduisant la durée du travail de 249 salariés).
* 42 Le plan social s'applique dans le cadre du licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés.
* 43 Cette mesure semble avoir remporté un réel succès puisque 100.000 salariés étaient concernés par ce dispositif en juin 1993, avec un rythme de 15.000 nouveaux bénéficiaires par mois. Les principaux concernés sont les femmes employées des petites entreprises du secteur marchand et principalement les jeunes (la moitié des bénéficiaires à moins de 30 ans).
* 44 Ce dispositif attribuait précisément une compensation des charges sociales patronales pendant trois ans dans les d'annualisation du travail..
* 45 La notion d'employabilité recouvre la probabilité d'un individu à trouver ou garder un emploi.
* 46 Par la circulaire du 07.02.1987, le dispositif des EDDF est recentré plus explicitement en direction des PME-PMI.
* 47 Fonds Régional d'Aide au Conseil
* 48 Dont l'évolution des compétences pouvant entraîner la définition de qualifications nouvelles ou la mise en place de nouvelles grilles de classification, l'analyse des besoins et la définition d'une politique d'embauche, la conception d'actions permettant une mobilité professionnelle des salariés, la prévention de l'exclusion, la définition des besoins de formation. La conception des plans de formation ainsi que les mesures d'ingénierie de formation susceptibles d'en accroître la cohérence et l'efficacité, l'étude préalable, intégrant les incidences sur l'emploi d'une opération d'aménagement-réduction du temps de travail, etc.
* 49 Aide au conseil aux branches
* 50 Établissement public à caractère industriel et commercial : EDF, CEA,...
* 51 Fonds d'Amélioration des Conditions de Travail
* 52 Engagement de Développement de la Formation 68
* 53 Une définition de l'employabilité est que cette notion recouvre l'inégalité sur " l'appréciation par un employeur des capacités productives d'une personne (Gazier. 1990).
* 54 L'ARPE (Allocation de Remplacement pour l'Emploi) est une mesure financée par l'UNEDIC et non par le budget de l'État. Sa définition relève d'accords entre les partenaires sociaux. Par contre elle vient alléger les pressions qui peuvent être exercée sur le FNE qui finance des départs en préretraites selon différentes modalités (définitive ou progressive). Ce dispositif s'adresse à des salariés et à des chômeurs ayant validés 160 trimestres (40 ans) à l'assurance vieillesse. Selon un bilan dressé par l'UNEDIC à la fin de mai 1997 le nombre total d'entrées dans le dispositif était de 68 500 personnes (le coût moyen brut par bénéficiaire serait de 222 100 fr. pour un coût net moyen de 217 600 fr.). (Liaisons Sociales, cahiers joint au n° 12472, n° 62/97)
* 55 Cette statistique dépasse le cadre strict des plans sociaux, les conventions de conversion étant accessibles aux . entreprises de moins de 50 salariés : plus de 50 % des adhésions en proviennent (Liaison Sociale, doc. n° 117/97-W).
* 56 « Why has unemployement differed between countries ? (Layard et al, 1991, p 48).
* 57 Cette structure d'évaluation, avec certaines variantes quant aux variables incluses dans l'analyse, est reprise par Bellmann et Jackman (1996), Scarpetta ( 1996).
* 58 Cité par Bellmann et Jackman (1996, page 735).
* 59 Voir Bellmann et Jackman (1996, page 739).
* 60 Gautié (1996) propose une critique similaire.
* 61 Le terme travail non-qualifié est utilisé dans tous les tests exposés au sens de la théorie néo-classique. Il est synonyme de faible productivité marginale.
* 62 Il ne faut pas confondre les tests et simulations économétriques, où les coefficients des équations sont estimés à partir de données longitudinales - ce qui constitue un véritable test empirique des hypothèses théoriques - et celles des simulations ou les coefficients retenus relèvent du choix du modélisateur. Ainsi, le modèle de Cette et al. (1995). simulant les effets de la mise en place d'un SMlC jeune, utilise une fonction de production à facteurs substituables de type Cobb-Douglas, en lui assignant une élasticité de substitution capital-travail conforme aux hypothèses néoclassiques propres à ce type de modèle. L'élasticité de l'emploi des jeunes par rapport au SMIC jeune dépend alors de l'élasticité de substitution capital travail, de l'élasticité de substitution inter-catégoriel et de l'élasticité de substitution intra-catégoriel. Ces trois élasticités sont choisies par le modélisateur en fonction des coefficients voulus par le modèle. La simulation en question concernant les effets d'un SMIC jeune, réalisée à l'intérieur d'un tel monde théorique néo-classique, ne peut donc que conclure : « l'instauration d'un Salaire Minimum Jeune, inférieur de 20 %, pourrait aboutir, à terme (au bout de cinq à dix ans), à la création d'environ 100 000 emplois. Pour les jeunes, 150 000 emplois seraient créés au prix de 50 000 pertes d'emplois pour les non-jeunes (Cette et al.. 1995. p. 233).
* 63 En ce qui concerne les jeunes. Skourias (1995) trouve des résultats similaires à ceux de Basen et Martin en utilisant un test de type Mincer. Il en conclut : « Ainsi, pour réduire l'emploi des jeunes, il faudrait, sur la base des élasticités estimées, et d'une inflation de 2,5 %, augmenter le SMIC réel de 5 à 10 %, ce qui impliquerait une revalorisation de 7,5 à 12,5 % du SMIC nominal (p. 273) . Ceci le conduit à suggaérer « qu'une simple modération du rythme de croissance du SMIC, comme tel est le cas depuis une dizaine d'années, suffirait pour contenir les effets négatifs du SMIC sur l'emploi des jeunes dans des fourchettes raisonnablement faibles (ibid.). L'auteur avance d'autre part que le calcul des élasticités pourrait sous-estimer les effets du SMIC sur l'emploi des jeunes car les jeunes bénéficient de mesure de politique d'emploi abaissant leur coût salarial et contournant de fait le SMIC. C'est ce que font remarquer Bourdet et Person (1991) lorsqu'ils mettent en évidence que le déploiement des mesures en faveur des jeunes est corrélé avec l'augmentation du SMIC. Ceci expliquerait par conséquent pourquoi Bazen et Martin n'ont pu mettre en évidence une relation solide. Pour résoudre ce problème, Benhayoun (1990) a retiré les emplois aidés de jeunes de la définition du taux d'emploi dans l'équation testée. Pour Cette et al. (1995. p. 207), cette démarche est appropriée car elle conduit à surestimer les effets négatifs du SMIC sur l'emploi des jeunes. Une partie des emplois aidés font en effet l'objet d'un « effet d'aubaine : ils auraient été de toute façon créés et ils se seraient substitués à des emplois qui auraient été créés.
* 64 La raison technique de cette prudence est donnée en note de bas de page de cet article : « les équations reposant sur un cadre théorique strict, les coefficients estimés dans les deux équations doivent satisfaire certaines conditions restrictives. En fait, les équations de long terme devraient être identiques. Pour tester ces restrictions, les deux équations ont été estimées conjointement, avec la contrainte de rendements constants. Là encore, les résultats n'ont pas été très satisfaisants. Il a fallu exclure la tendance temporelle de l'équation des adultes pour obtenir des estimations paramétriques raisonnables ; quant à la tendance négative dans l'équation des jeunes, elle était anormalement élevée.
* 65 Lorsqu'elle est validée, la relation de Phillips indique que toute réduction du chômage s'accompagne d'une pression à la hausse des salaires (en raison de l'apparition de pénuries sectorelles de main d'oeuvre et d'un rapport de force plus favorable aux travailleurs). Pour les raisons inverses, toute hausse du chômage exerce une pression à la baisse sur les salaires.
* 66 C'est-à-dire, dans ce cas, poser l'hypothèse que l'écart mesurable entre bénéficiaires et non bénéficiaires a pour seule
* 67 Endogénéisation de la participation aux mesures selon le modèle présenté à la section I..
* 68 En décembre 1991, 71 % des bénéficiaires du contrat de qualification sont en emploi contre 67 % pour le panel témoin, constitué de sortants du système scolaire en juin 1989 (Gélot, Simonin, 1997a, p 84, source DARES).
* 69 Bonnal et al 0/(1995)
* 70 En 1994, 0,2 % des établissements du secteur industriel déclarent mettent en place effectivement des horaires annualisés (Premières synthèses, DARES, juillet 1998).
* 71 Cité par Liaisons Sociales. n° 117/97, cahier joint au numéro 12558.
* 72 Voir l'ouvrage de Daniel Cohen (1996), Richesses du monde, pauvreté des nations.
* 73 Le taux de croissance potentiel est le taux de croissance permis par les capacités production disponibles dans de l'économie. Il est aujourd'hui estimé aux alentours de 3 à 35 % en France
* 74 Rappelons (cela a été vu en première partie) que la flexibilité de l'emploi (à travers la montée des CDD et du temps partiel) et du coût du travail est maintenant largement acquise en France et qu'il reste relativement peut de marge à rechercher de ce côté
* 75 En seraient exclus les administrations publiques, les associations, les emplois familiaux, les exploitants agricoles et les entreprises ayant une valeur ajoutée inférieure à 3 millions de francs. La valeur ajoutée des grandes entreprises nationales et les coopératives agricoles seraient incluses dans l'assiette.
* 76 "I.e Medef a ainsi brandi a plusieurs reprises la menace de se retirer du financement de la sécurité sociale.
* 77 Elle n'est pas testée dans le cas de la baisse des cotisations préconisée par Malinvaud car le modèle montre que la proposition Malinvaud n'est efficace que si la part et le niveau des dépenses diminue.
* 78 Malinvaud suggère ainsi d'augmenter les cotisations sociales sur les hauts salaires. Il ne les teste cependant pas cette hypothèse dans son modèle qui ne comporte qu'une catégorie de travailleurs.
* 79 La notion d'effet sociétal se réfère à un programme de recherches mené à la fin des années 1970 par un groupe de chercheurs du LEST (M. Maurice, F. Sellier, J.J Silvestre, 1982) sur une comparaison franco-allemande des systèmes d'éducation et de formation professionnelle, mettant en évidence les spécificités et les cohérences nationales des systèmes de régulation de la relation salariale.
* 80 La loi Aubry propose un dispositif d'aide publique plus direct et plus restrictif que ne le prévoyait la loi Robien : introduction d'un écart entre le pourcentage d'une RTT et le pourcentage de création d'emplois, le principe d'une aide dégressive, qui passe de 7 à 5 ans, le système d'une aide forfaitaire et non plus proportionnelle au nombre de salariés. Cependant, comme la loi Robien, le dispositif Aubry limite à deux ans la période pendant laquelle les effectifs doivent être maintenus et ne précise pas le type d'embauchés à réaliser (CDI ou CDD, temps partiel).
* 81 Le nombre d'accords d'entreprises signés sur le temps de travail a été multiplié par 7 entre 1983 et 1997, passant de 900 accords en 1983 à 6000 accords en 1997. Une très nette progression est à souligner entre 1996 et 1997, de près de 50 %, liée pour une forte proportion à l'augmentation du nombre d'accords sur la réduction du temps de travail, de 500 à 2 000 accords, et à la loi Robien de juin 1996.
* 82 Bilan de la négociation collective. Ministère du Travail. La documentation française.
* 83 La fédération FO Métaux est signataire de tous les accords de branche sur le temps de travail depuis 1982. À l'inverse, les autres fédérations CFDT, CFTC et CGT n'ont pas signé les accords de 1986, 1991 et 1996 sur la modulation des horaires de travail, et de celui de 1982 sur la RTT à 38h30 pour la CGT.
* 84 Fréquence de signature du syndicat, dans le cas où il est représenté dans l'entreprise
* 85 Étude de l'ARACT Haute-Normadie sur l'analyse de 8 cas de pratiques de RTT d'entreprises ; Étude de la DRTEFP réalisée sur 50 accords d'entreprise Aubry ; Étude de la CFDT "Le Travail en questions" par une enquête auprès de 6 000 salariés concernés par la RTT.
* 86 Les pourcentages cités se réfèrent à une étude statistique réalisée par une DRTEFP auprès de 50 accords d'entreprise de RTT dans le cadre de la loi Aubry.
* 87 Bien que l'on ne puisse postuler une cohérence à priori entre le contenu d'un accord sur la réduction du temps de travail et la construction d'une stratégie de recherche de compétitivité au niveau de l'entreprise et de la branche, on suppose que les intentions exprimées dans les accords sont tout à la fois le reflet de compromis (pas forcément équitables) entre les responsables d'entreprises et leurs salariés et la manifestation partielle de représentation et de pratiques des acteurs du management de l'entreprise ou de la négociation de branche en terme de recherche de compétitivité.
* 88 Un modèle d'analyse en sciences sociales, est constitué outre son système d'hypothèses, par différentes dimensions conceptuelles (négociation collective, organisation, gestion... ), elles-mêmes déclinées en indicateurs qui permettent de saisir concrètement l'information au cours de la recherche et préciser le contenu des dimensions.
* 89 C'est à dire leur histoire du point de vue des techniques, de l'organisation du travail, des modalités de gestion financière ou des ressources humaines
* 90 Par exemple en termes de formation professionnelle initiale, ou de formation de jeunes diplômés de troisièmes dans cycles de type convention CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche).
* 91 La branche des coopératives bétail et viande revendique la création de 700 emplois grâce a la loi Robien, comme celle du secteur céréalier qui parle de 1 200 embauches.
* 92 Avec demande d'aide structurelle cependant.
* 93 Elles constituent le modèle générique le plus répandu de la TPE, elle appartient à une configuration d'ordre familial et procède à la banalisation de produits et services et à la recherche d'une réduction des coûts par effet d'expérience L'innovation est faite de "petits plus", donc de façon incrémentale et non radicale (Bentabet et alii, 1999).
* 94 Cette forme d'entreprise se distingue du point de vue stratégique de la forme traditionnelle dans le sens où elle est plus attentive aux fluctuations du marché et manifeste une plus grande capacité de transformation de son activité (Bentabet et alii. 1999).
* 95 Ces informations ne sont pas illustrées par des cas d'entreprises précis, elles résultent d'entretiens réalisés auprès d'acteurs intermédiaires chargés de l'instrumentation ou de la mise en oeuvre du dispositif Aubry (ARACT, représentants syndicaux et patronaux au niveau territorial)
* 96 Ces prix restent bas pour deux types de raison qui se sont cumulées au cours des dix dernières années : elles ont d'une part à faire face à la croissance d'une concurrence de produits plus industrialisés et moins coûteux (exemple des industries et de l'artisanat du bois et ameublement) et d'autre part à un affaiblissement de la consommation des catégories sociales moyennes qui représentaient une part importante de leur clientèle.
* 97 Ce qui justifie le fait que ces entreprises recrutent par connaissance et effets de réseaux de proximité (Bentabet el alii, 1999).
* 98 Les heures supplémentaires sont mises en perspective avec l'utilisation du chômage partiel et des dispositifs de modulation/annualisation du temps de travail. Voir Lecorre V. «Les heures supplémentaires, le chômage partiel et la modulation du temps de travail : trois modes d'ajustement au volume d'activité», Premières synthèses, n° 30.2, Ministère du Travail, juillet 1998.
* 99 Les bilans statistiques du Ministère du Travail sur les accords d'entreprise illustrent en partie la diversification des négociations sur le temps de travail : modulation/annualisation, heures supplémentaire et repos compensateur, travail en équipes successives, travail à temps partiel, équipes de fin de semaine, compte-épargne-temps, horaires individualisés, RTT hebdomadaire.
* 100 Entre 1982 et 1997, la part des salariés dans l'ensemble des secteurs est passé de 8,6 % à 17,4 %.
* 101 Enquête emploi, INSEE
* 102 La catégorie sociale des cadres, qui compte près de 3 millions de personnes, est née du mouvement social de l936, de l'opposition des ingénieurs aux grèves dans l'aviation parisienne et de la constitution du premier syndicat de cadres en juin 1936 dans l'industrie automobile.
* 103 «Les 35 heures et le temps de travail des cadres». Liaisons sociales, n° 36, 26 février 1999.
* 104 Au cas ou l'exonération irait jusqu'à 2 fois le SMIC, c'est plus de la moitié des salaires qui seraient concernes par une exonération totale ou partielle. Il faudrait alors financer ce manque à gagner pour la sécurité sociale par un prélèvement fiscal qui exercerait à terme un effet dépressif sur la demande.







