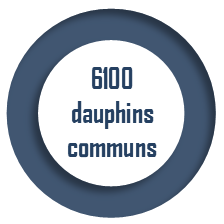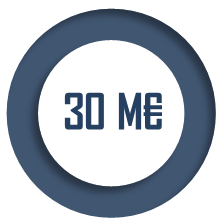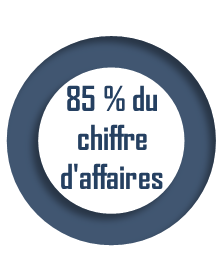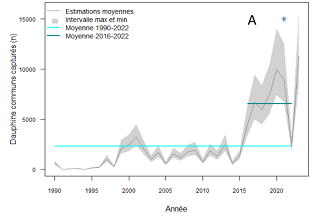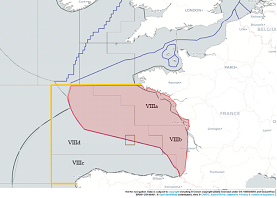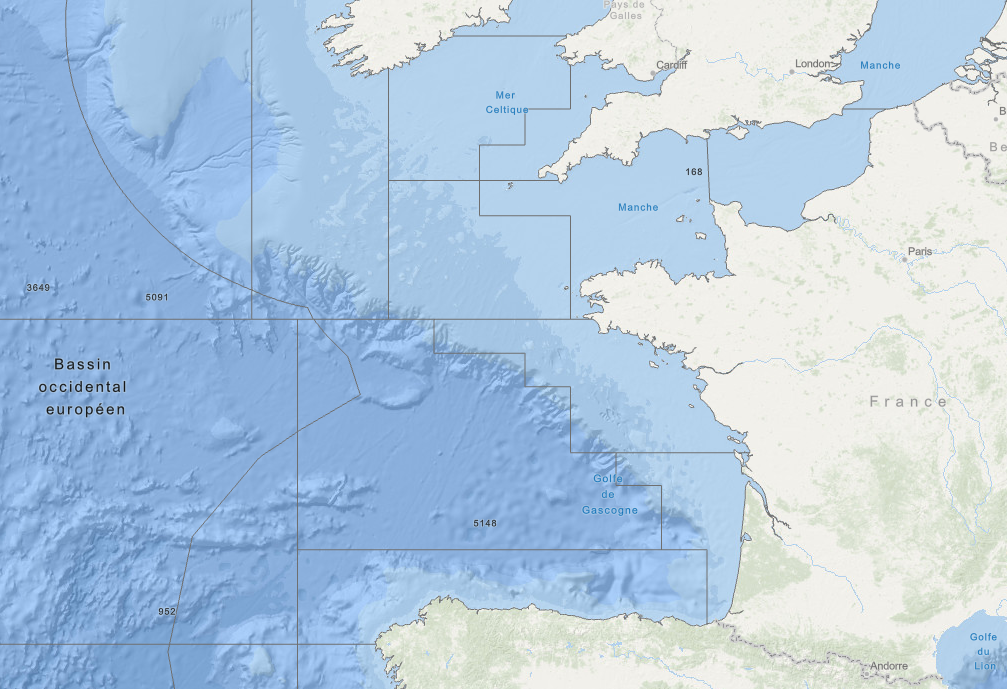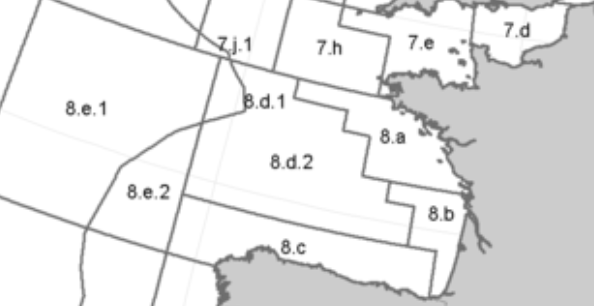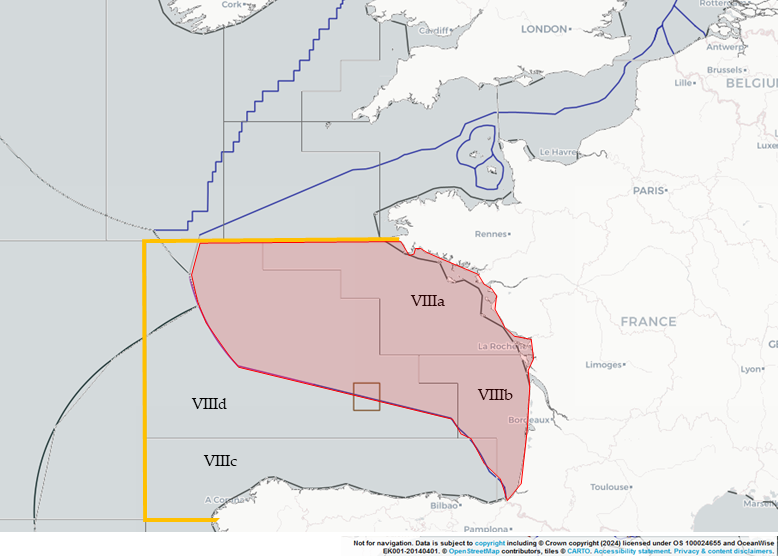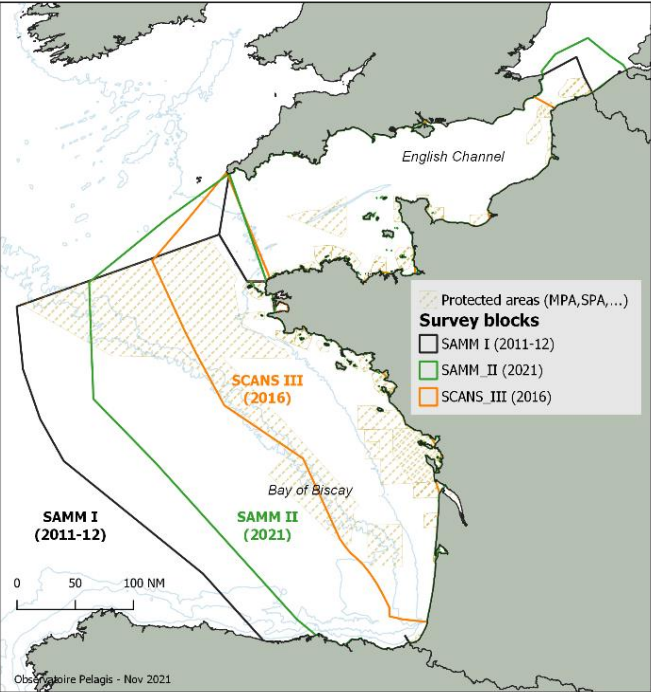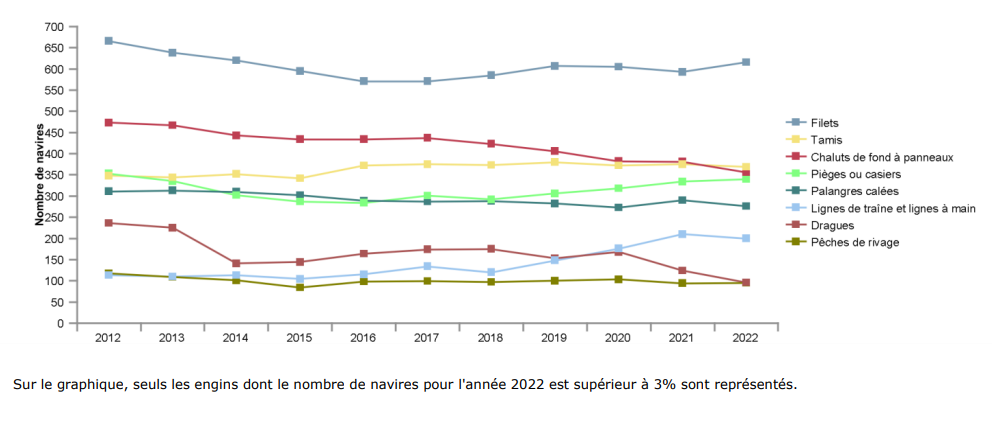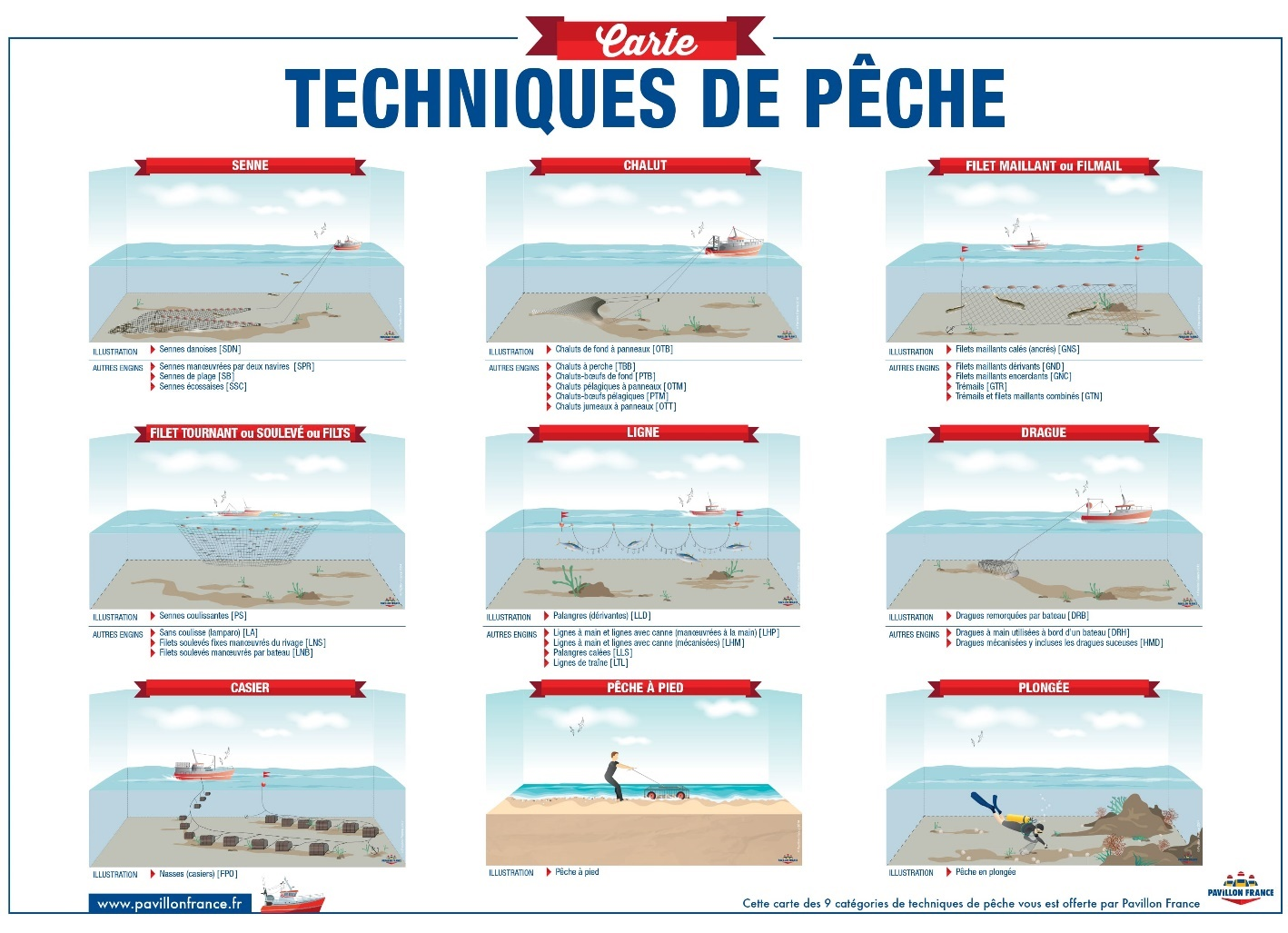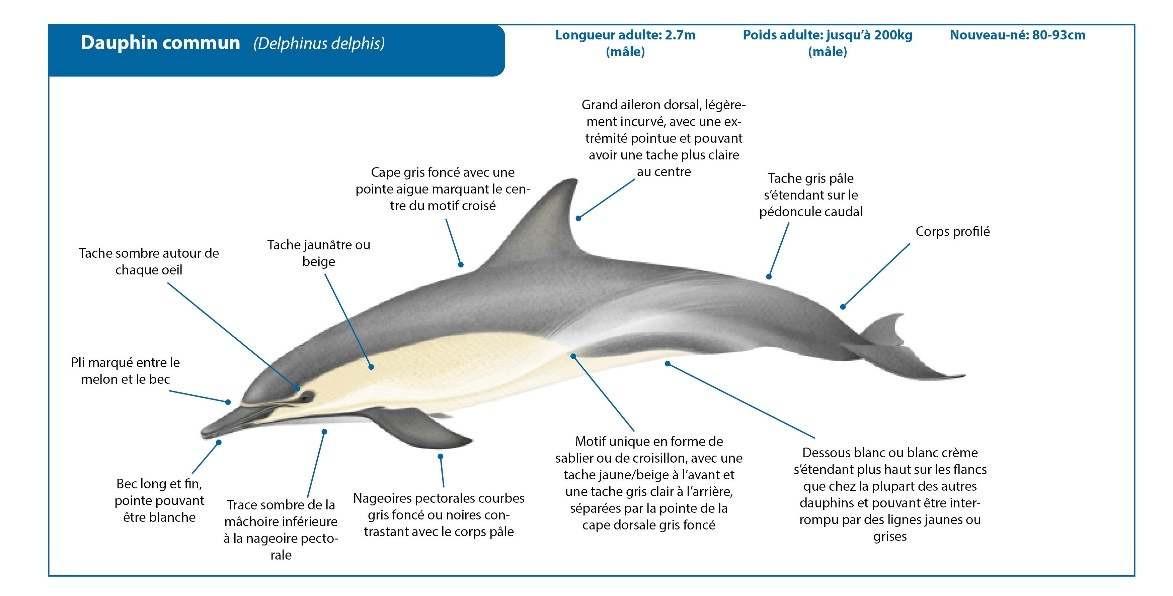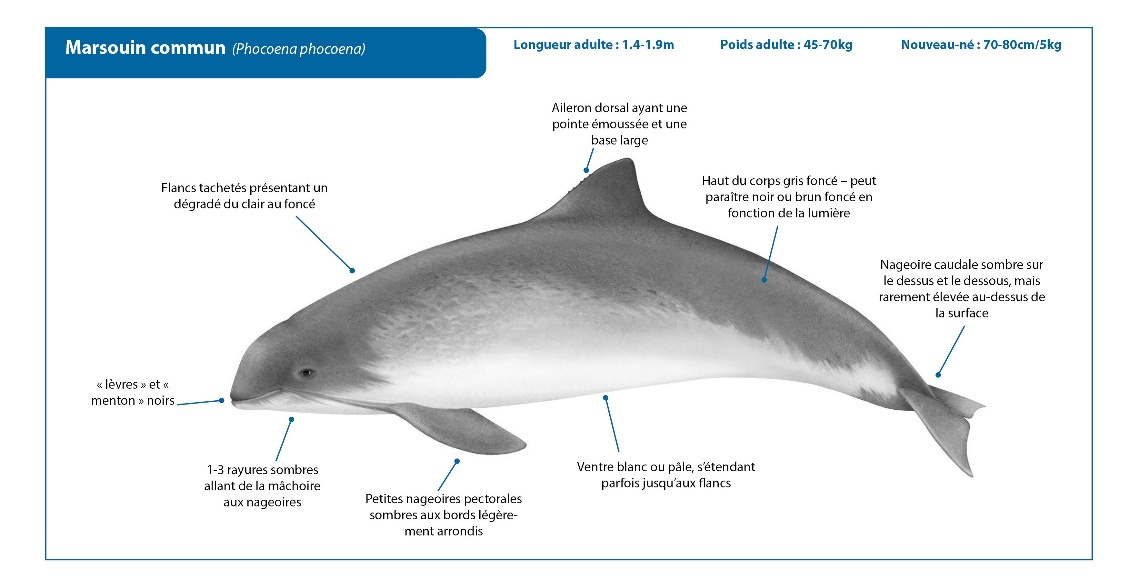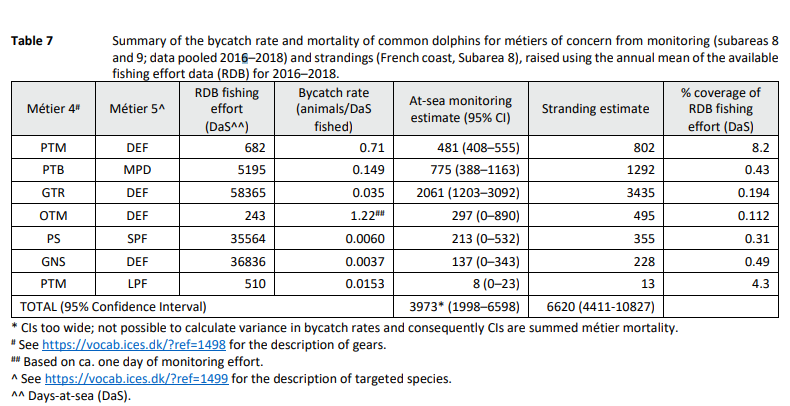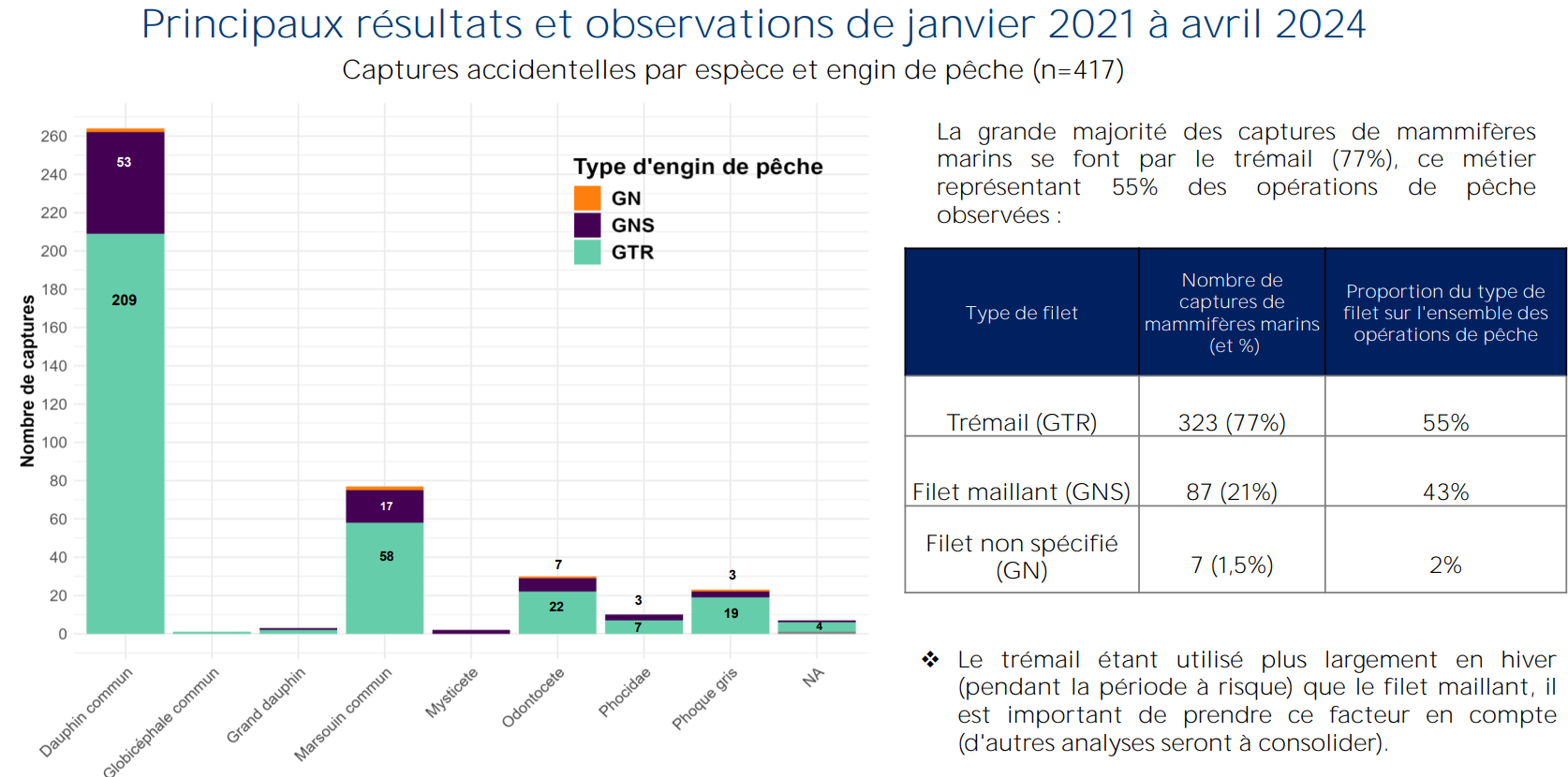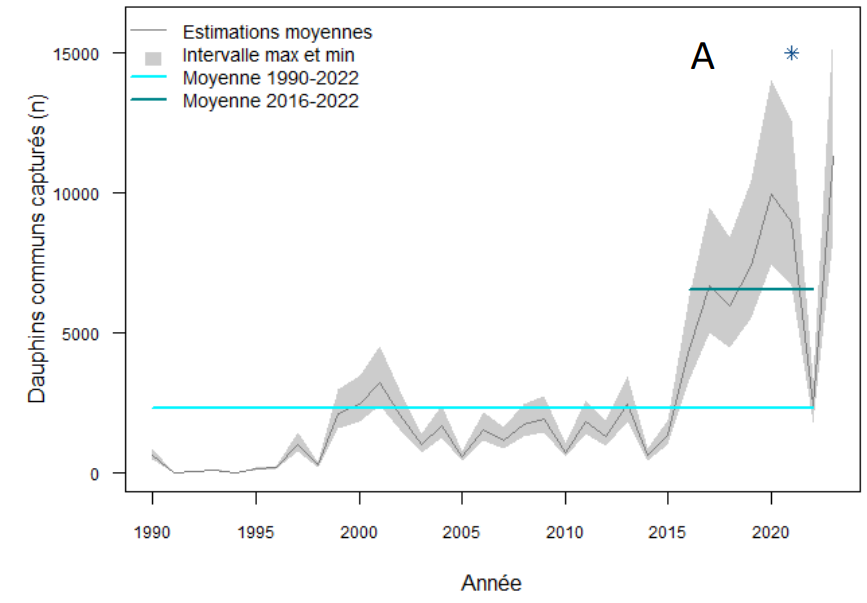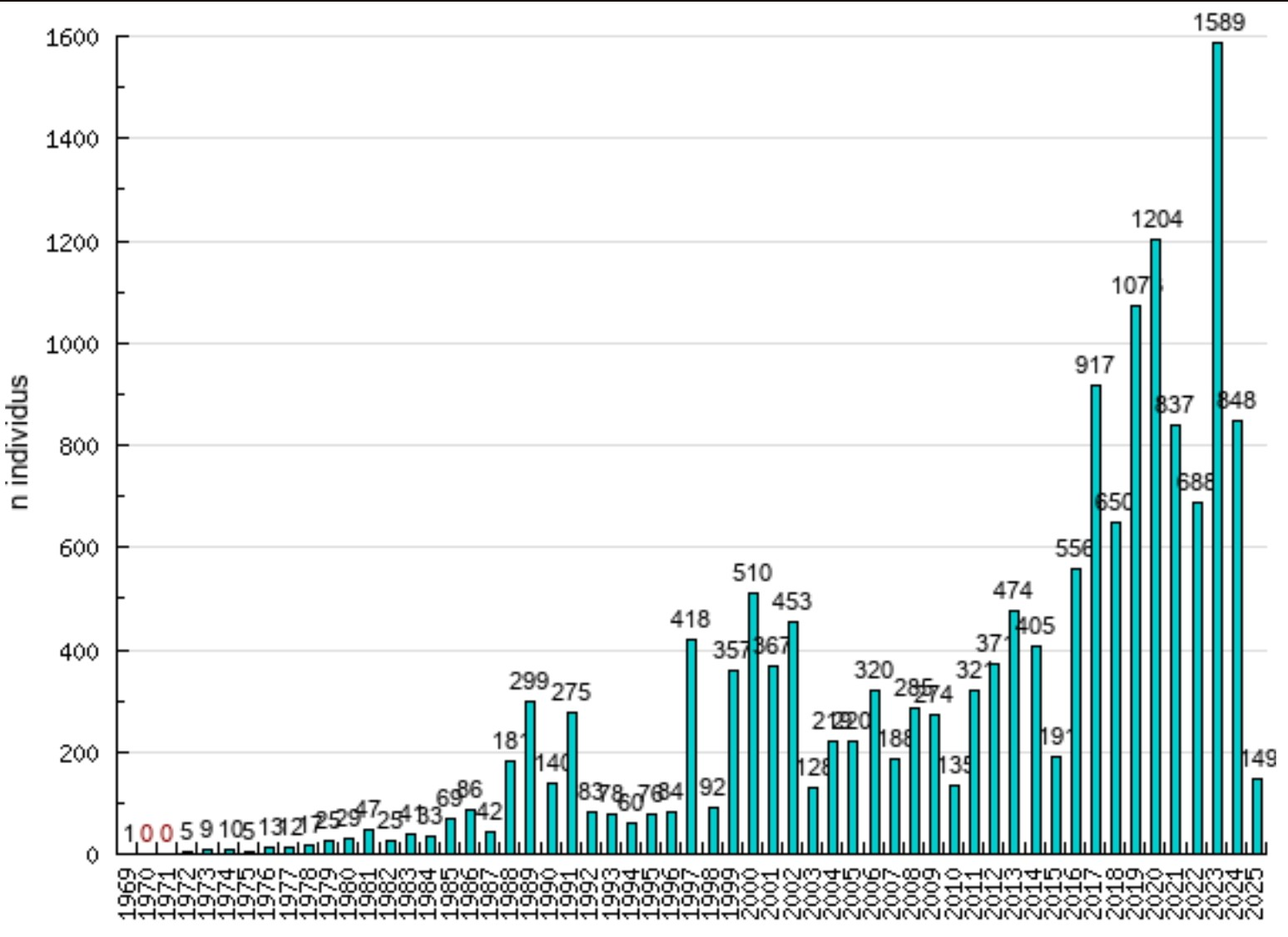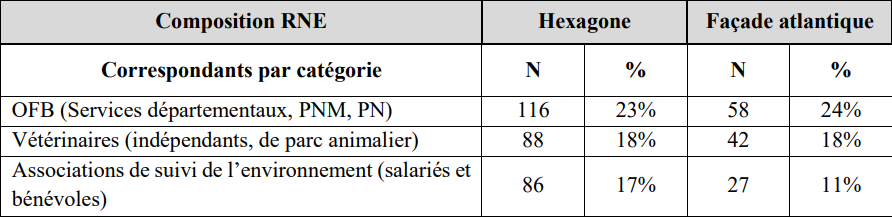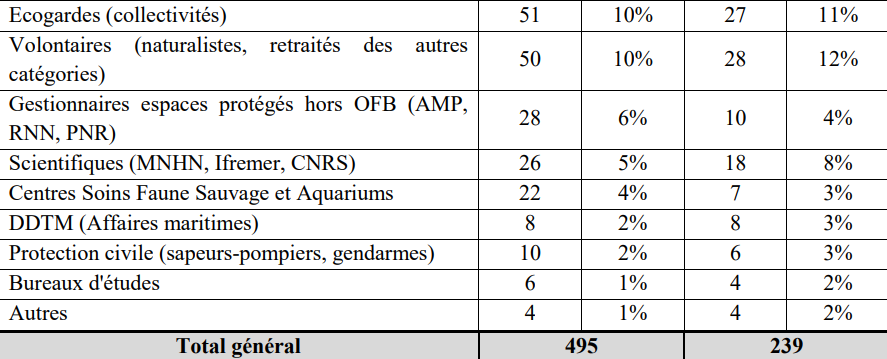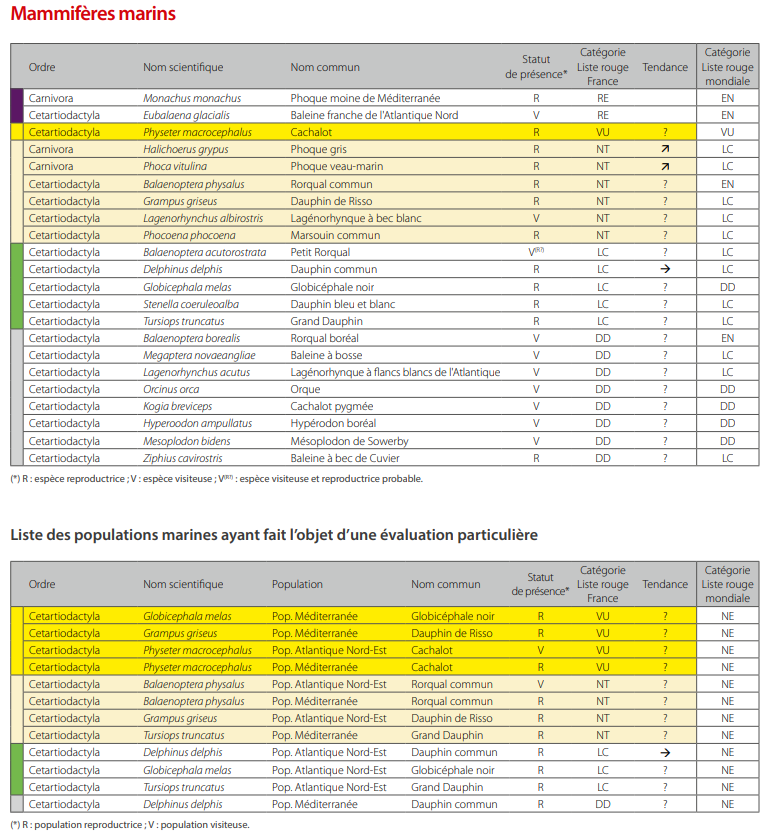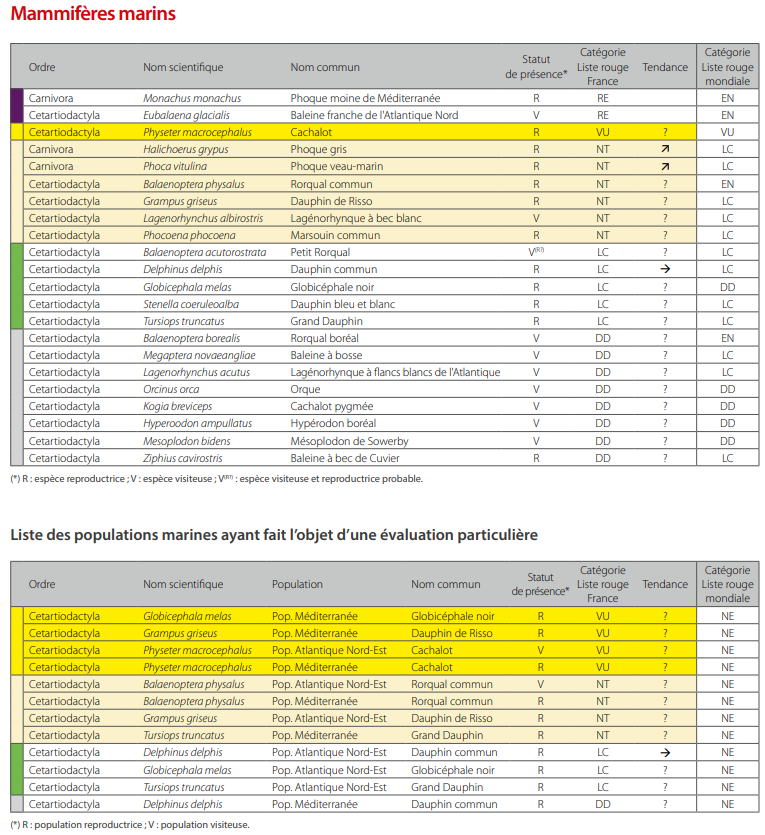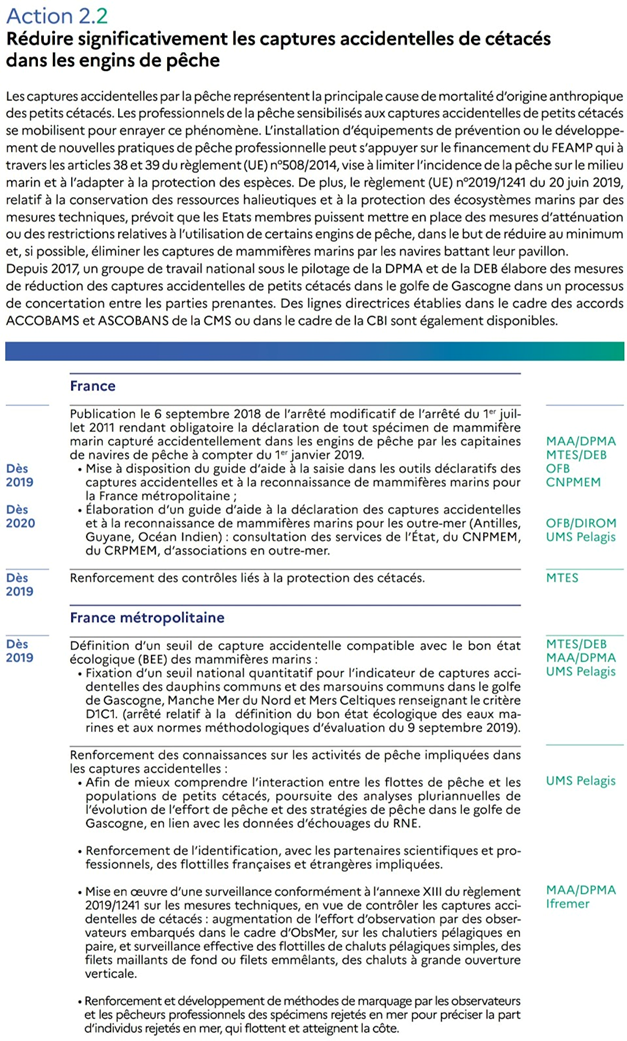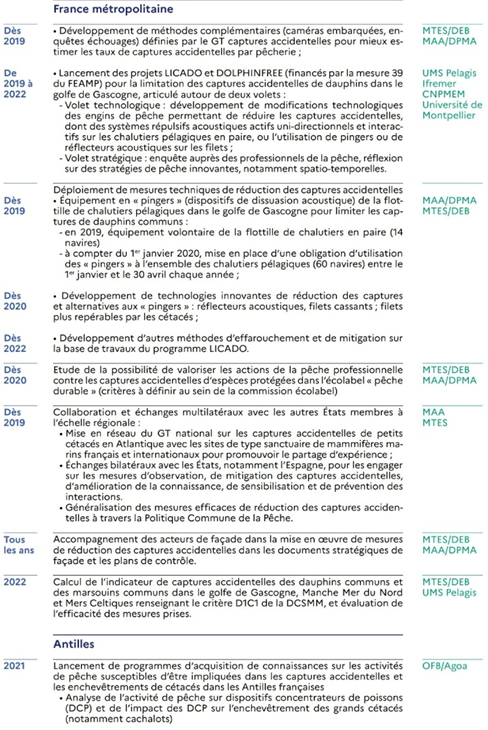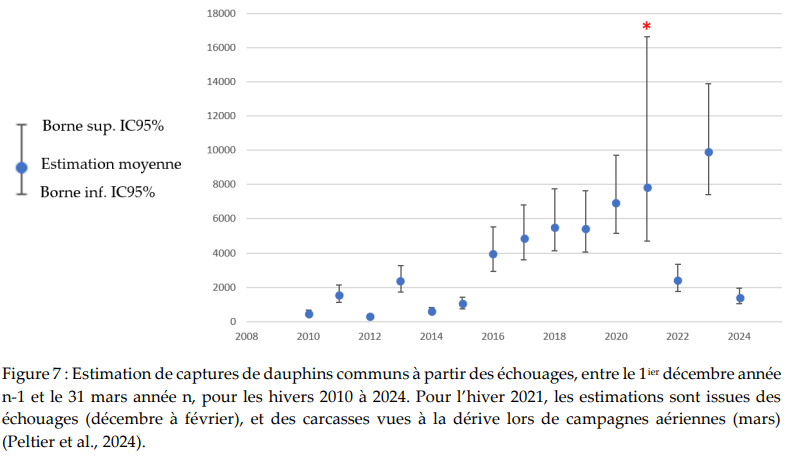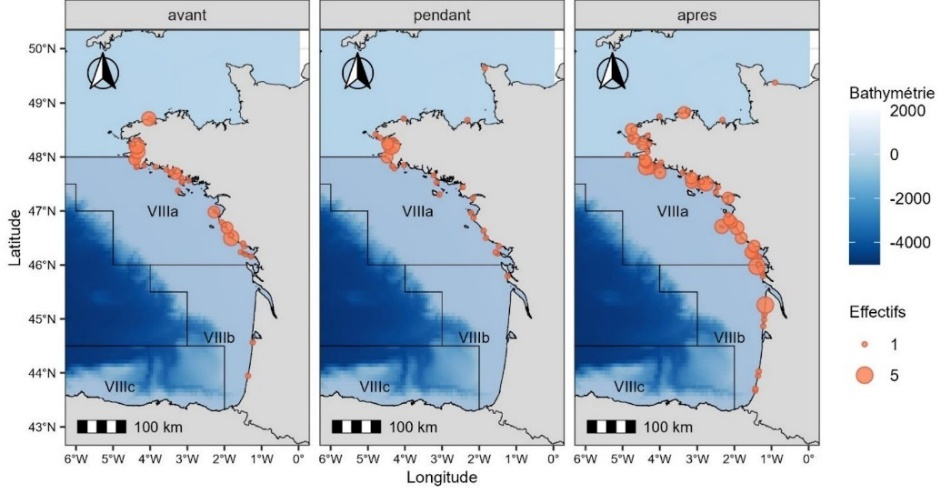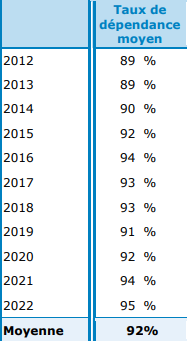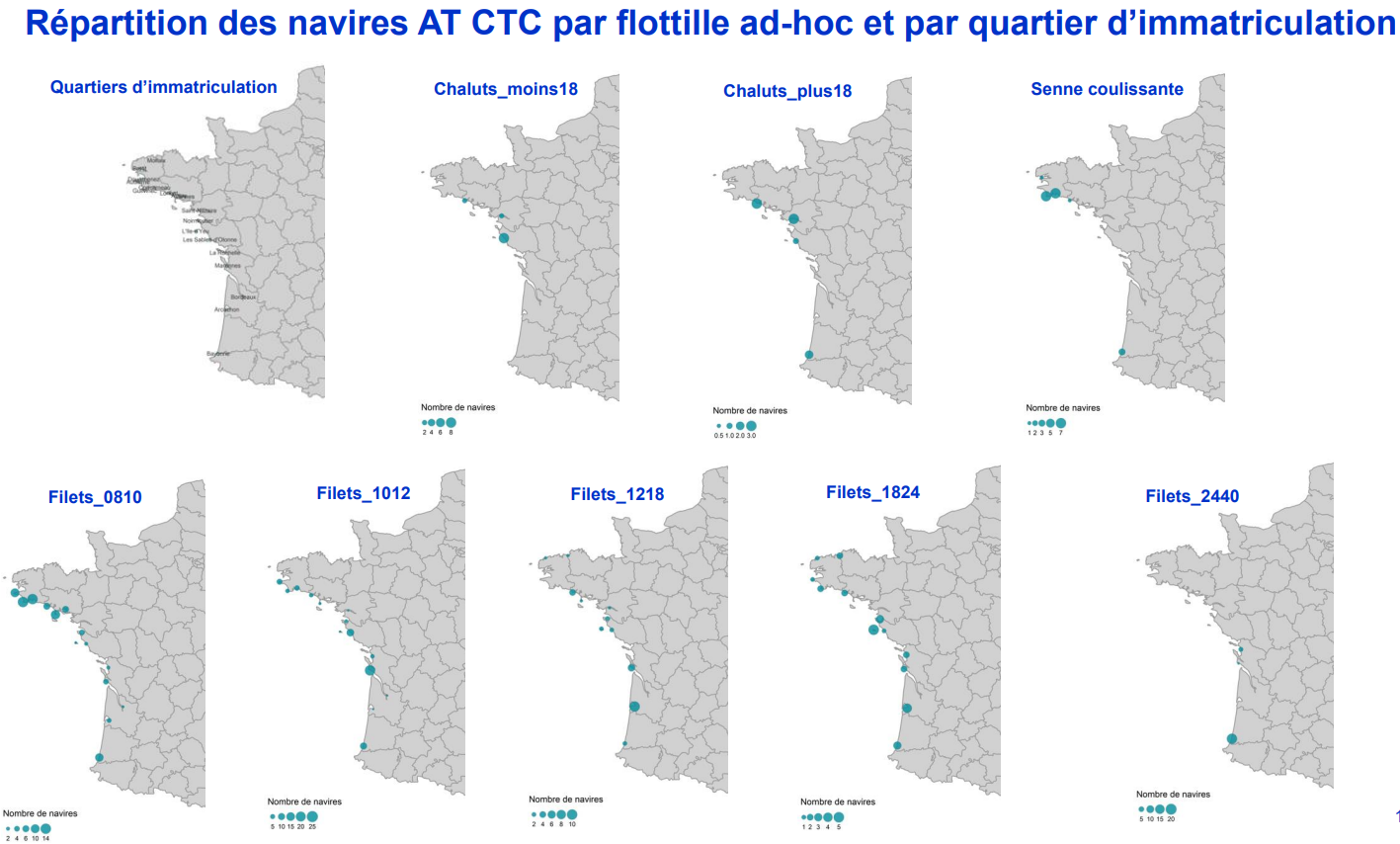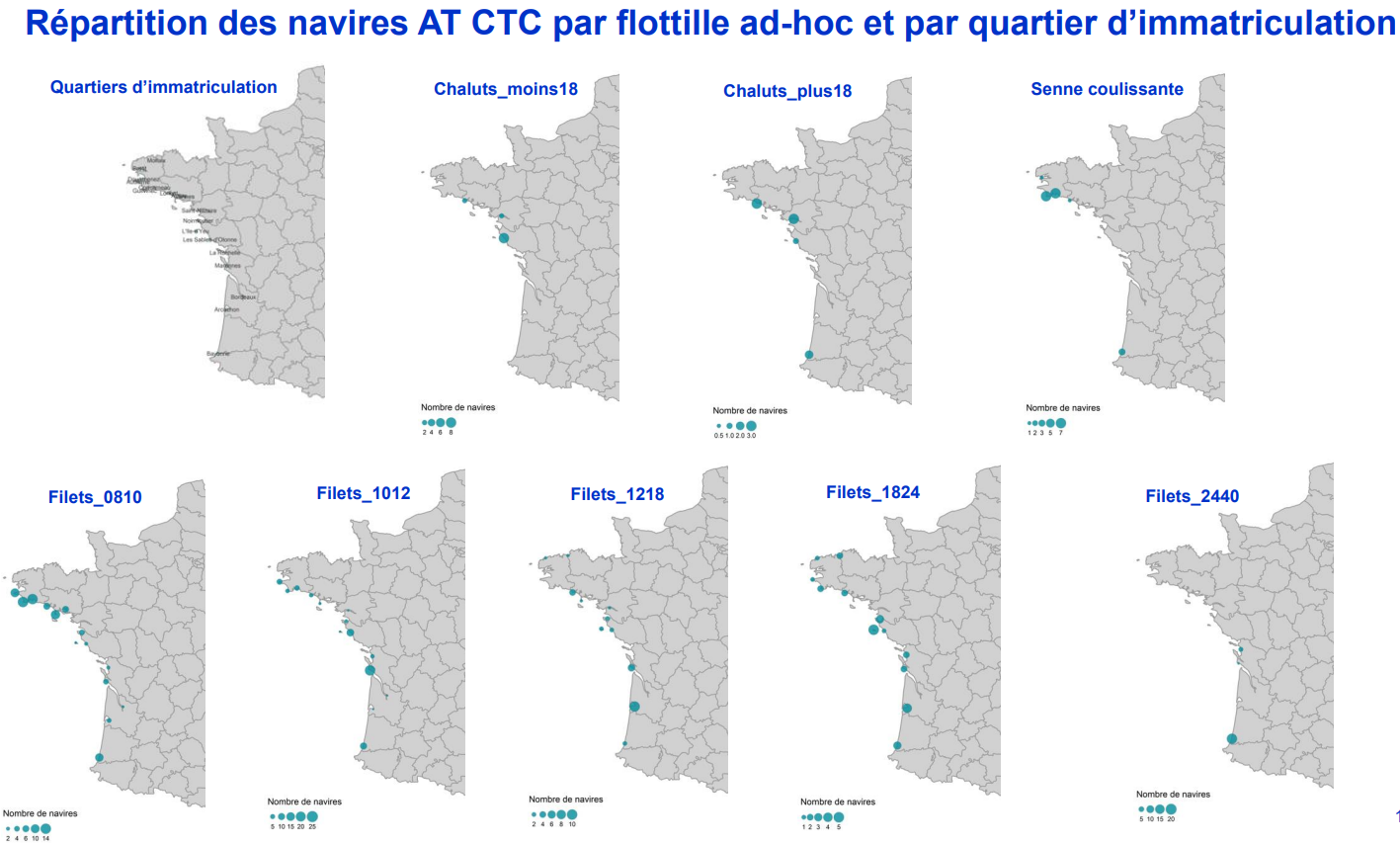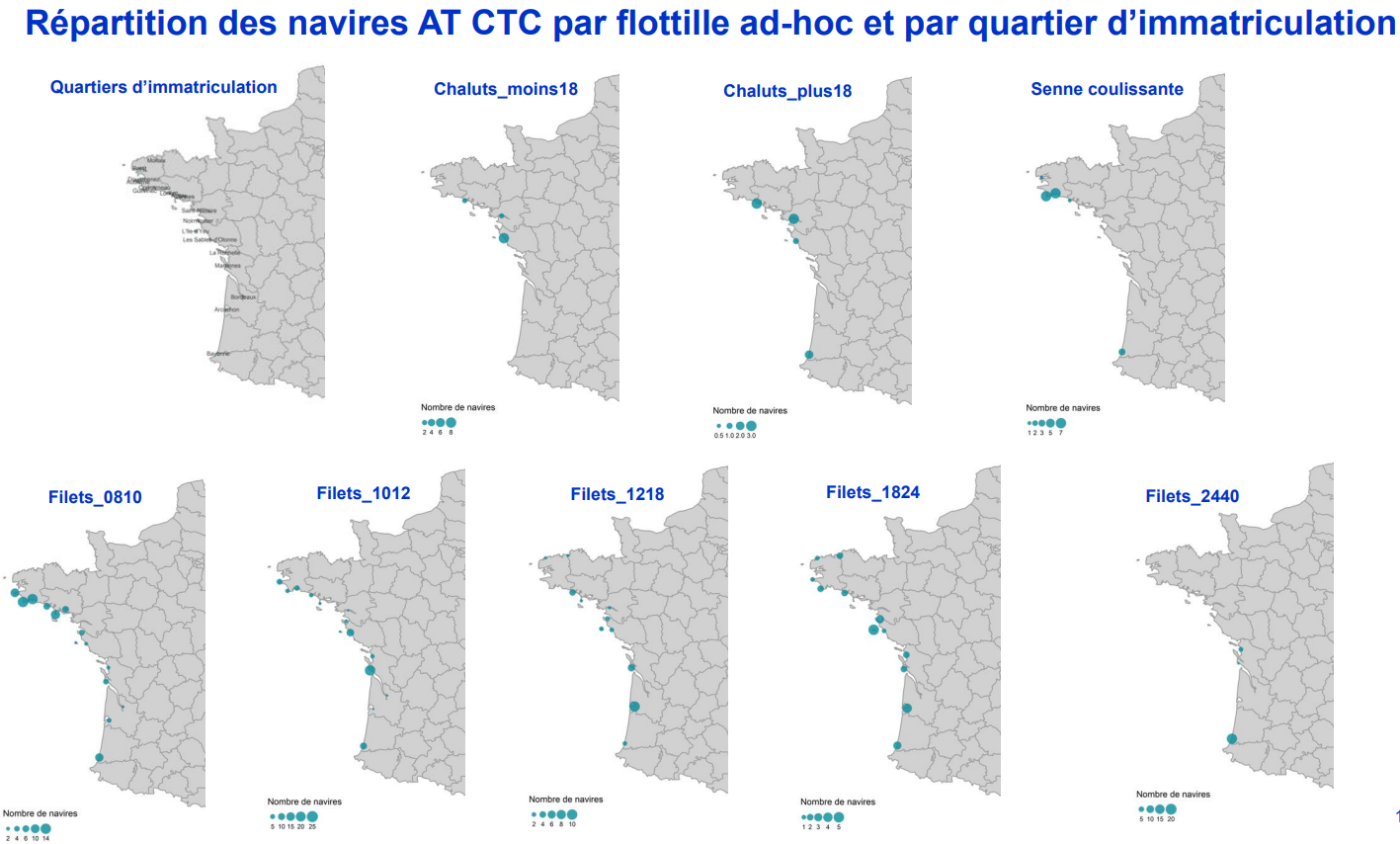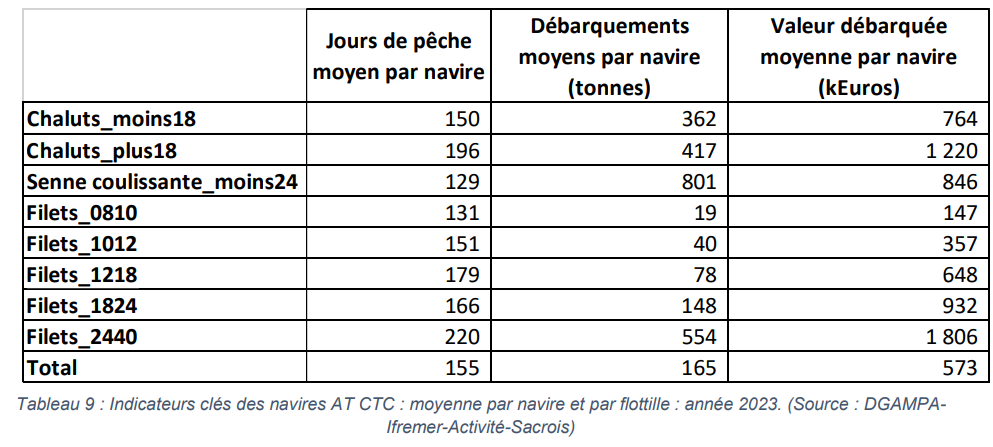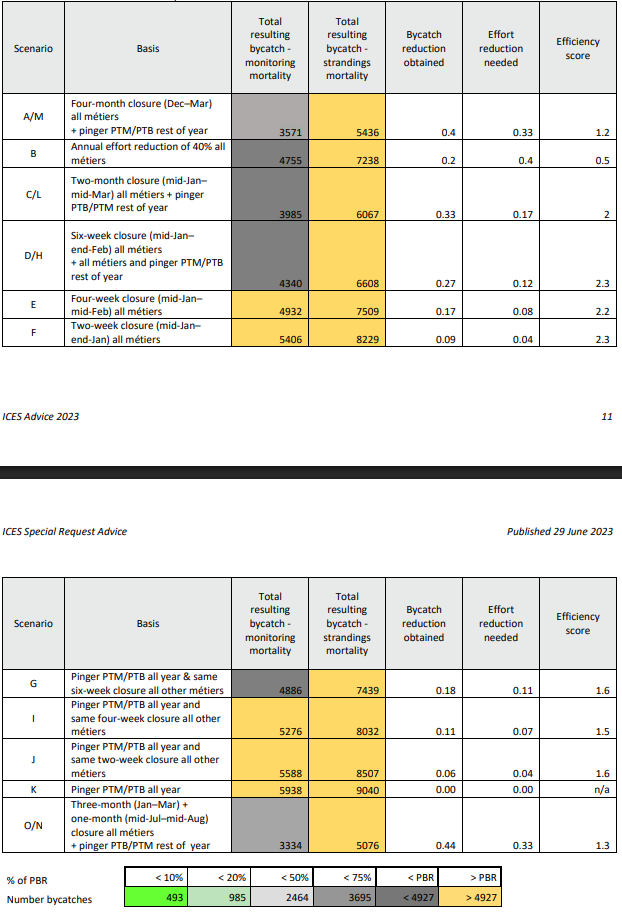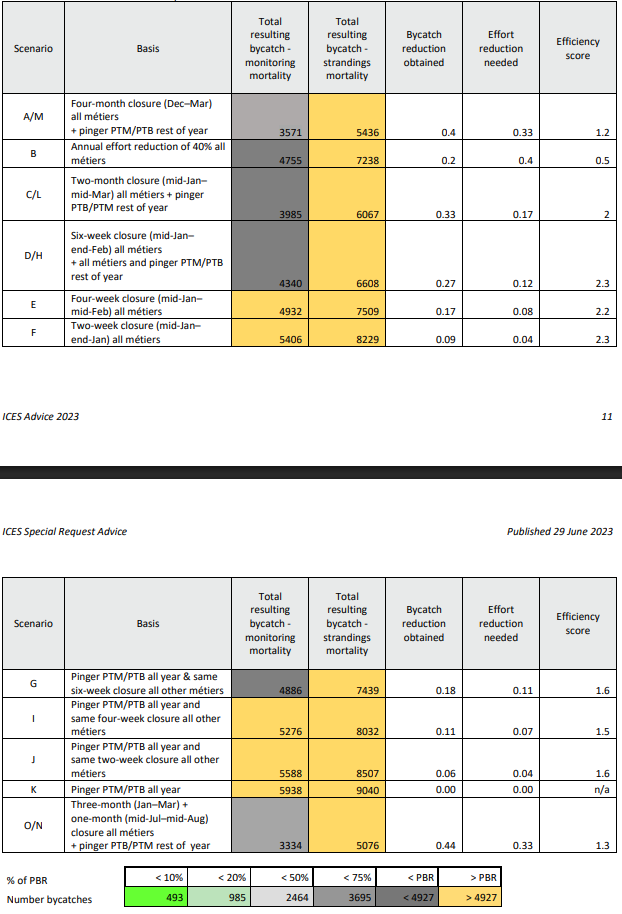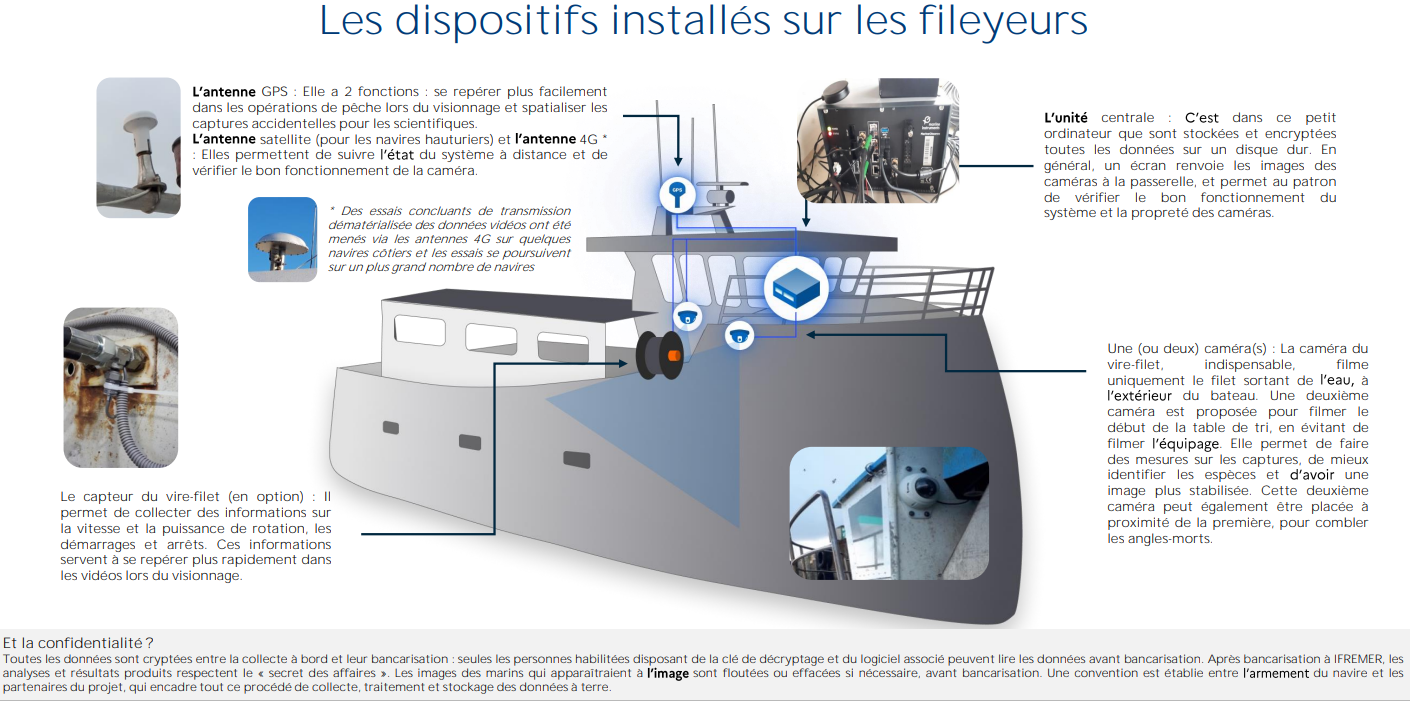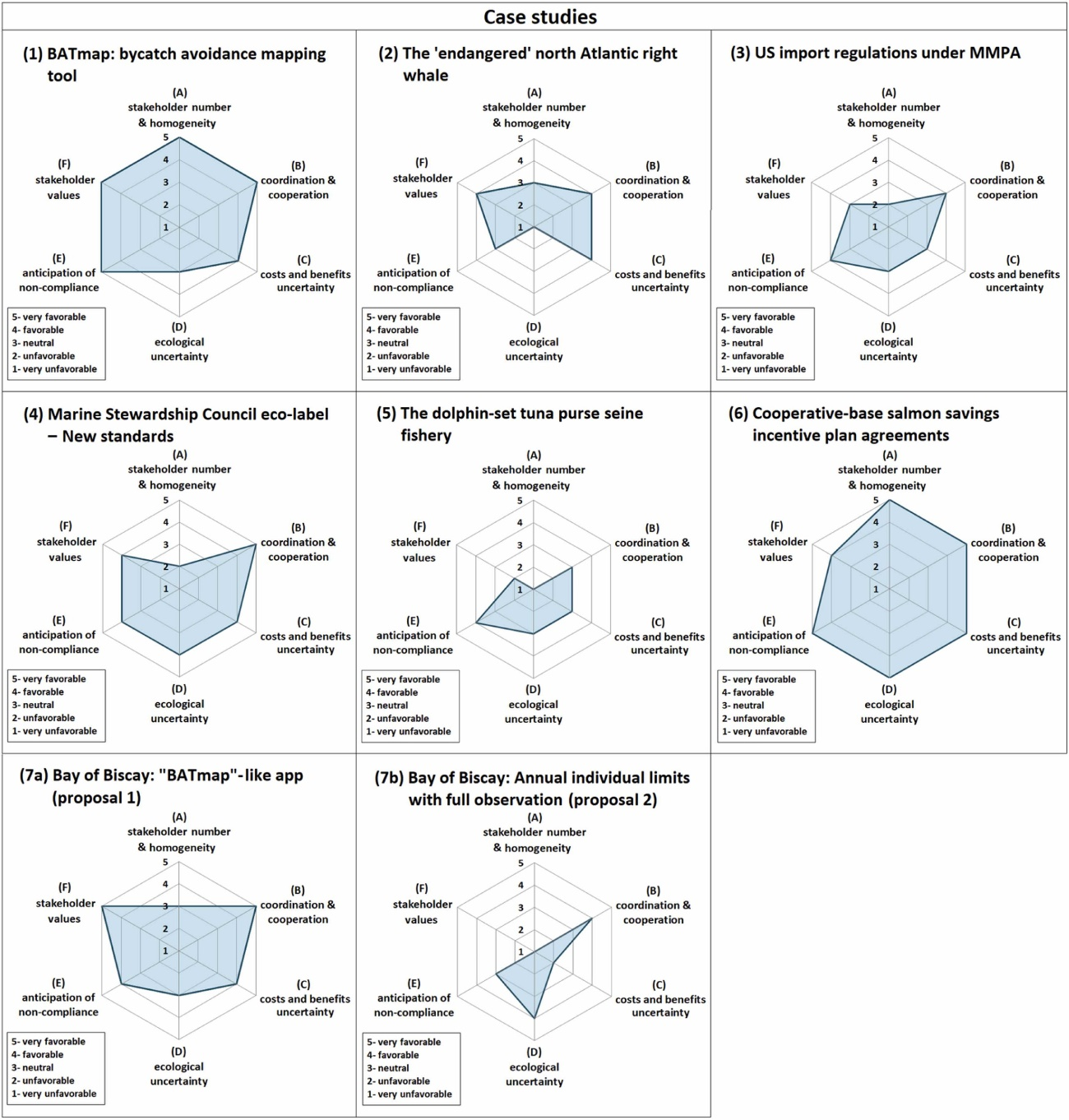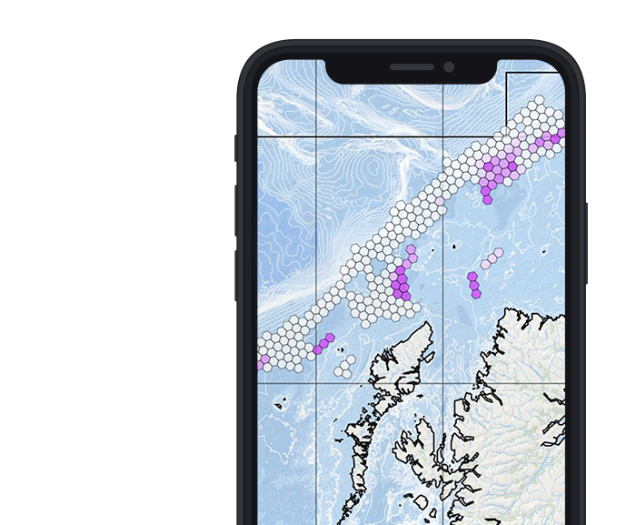- L'ESSENTIEL
- I. 2016-2023 : FACE À LA HAUSSE DES
CAPTURES ACCIDENTELLES, CHRONIQUE D'UNE FERMETURE DE LA PÊCHE
ANNONCÉE
- II. 2024- 2026 : UNE FERMETURE D'UN MOIS
PAR AN QUI SEMBLE EFFICACE, MAIS PRÉCIPITÉE ET DONT LE COÛT
EST DISPROPORTIONNÉ
- III. 2027-... : CRÉER LES CONDITIONS
D'UNE RÉOUVERTURE DE LA PÊCHE COMPATIBLE AVEC LA PROTECTION DES
PETITS CÉTACÉS
- I. 2016-2023 : FACE À LA HAUSSE DES
CAPTURES ACCIDENTELLES, CHRONIQUE D'UNE FERMETURE DE LA PÊCHE
ANNONCÉE
- PÊCHE ET PETITS CÉTACÉS
:
BÂTIR UN AVENIR COMMUN
DANS LE GOLFE DE GASCOGNE
- I. COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ :
CHRONIQUE D'UNE FERMETURE ANNONCÉE
- A. PETITS CÉTACÉS ET ACTIVITÉS
DE PÊCHE COEXISTENT DANS LE GOLFE DE GASCOGNE DEPUIS DE
NOMBREUSES ANNÉES
- 1. Le « golfe de
Gascogne » : de quoi parle-t-on au juste ?
- 2. Panorama de la pêche dans le golfe de
Gascogne : une activité essentiellement côtière
- 3. Combien y a-t-il de petits cétacés
dans le golfe de Gascogne et dans l'Atlantique Nord-Est ?
- a) Une donnée par définition
difficile à établir
- b) Le débat des captures dans le golfe de
Gascogne porte sur le dauphin commun et le marsouin commun
- c) Deux études qui ont procédé
par échantillon et avec une marge d'incertitude importante
- d) Un rapprochement des dauphins des côtes et
une dispersion accrue
- a) Une donnée par définition
difficile à établir
- 1. Le « golfe de
Gascogne » : de quoi parle-t-on au juste ?
- B. LA MORTALITÉ PAR CAPTURE ACCIDENTELLE A
ATTEINT, ENTRE 2016 ET 2023, DES NIVEAUX BEAUCOUP PLUS
ÉLEVÉS QUE PAR LE PASSÉ
- 1. Les petits cétacés font l'objet
d'une protection depuis 1970 dans un cadre national, renforcé
depuis 1992 par un cadre européen et international très
ambitieux
- 2. Pourquoi les interactions entre la pêche
et les petits cétacés dans le golfe de Gascogne posent
problème
- 3. Une augmentation marquée, sur la
période 2016-2023, des captures accidentelles liées à la
pêche, celle-ci expliquant autour de 70 % des
échouages
- 4. Une hausse du nombre d'échouages
observée par le réseau national échouages (RNE), et une
prépondérance des marques de capture dans les examens
externes
- 1. Les petits cétacés font l'objet
d'une protection depuis 1970 dans un cadre national, renforcé
depuis 1992 par un cadre européen et international très
ambitieux
- C. UNE TROP LENTE PRISE DE CONSCIENCE DE LA
SITUATION
- 1. Le niveau des captures accidentelles
estimé ces dernières années ne garantit plus le maintien
dans un « état de conservation favorable » du
dauphin commun
- a) Le juge se prononce sur le maintien de
l'état de conservation favorable d'une espèce, notion plus
stricte que le danger d'extinction
- b) Une procédure précontentieuse
ouverte par la Commission européenne est toujours pendante
- c) De quelles méthodes dispose le juge pour
estimer le maintien en état de conservation favorable d'une
espèce ?
- a) Le juge se prononce sur le maintien de
l'état de conservation favorable d'une espèce, notion plus
stricte que le danger d'extinction
- 2. Les pêcheurs se sont progressivement
saisis de la question, certains se montrant plus proactifs que d'autres
- 3. Un plan d'action national pour réduire
les captures accidentelles de petits cétacés qui a tardé
à se concrétiser
- 1. Le niveau des captures accidentelles
estimé ces dernières années ne garantit plus le maintien
dans un « état de conservation favorable » du
dauphin commun
- A. PETITS CÉTACÉS ET ACTIVITÉS
DE PÊCHE COEXISTENT DANS LE GOLFE DE GASCOGNE DEPUIS DE
NOMBREUSES ANNÉES
- II. PRÉCIPITÉE, LA FERMETURE SEMBLE
DONNER DES RÉSULTATS, MAIS À QUEL PRIX ?
- A. UN PROCESSUS DE DÉCISION INSATISFAISANT
SUR TOUTE LA LIGNE
- 1. Une judiciarisation du processus de
décision qui signe une incapacité collective à anticiper
des mesures qui paraissaient pourtant quasi inéluctables
- 2. Une fermeture actée en octobre 2023
sur injonction du Conseil d'État en mars, encore durcie par le
Conseil d'État à seulement un mois de sa mise en
place
- 3. Un manque de coopération entre
États membres et une décision seulement partiellement
européanisée malgré les efforts de l'administration
française
- 1. Une judiciarisation du processus de
décision qui signe une incapacité collective à anticiper
des mesures qui paraissaient pourtant quasi inéluctables
- B. DES MESURES DE FERMETURE SPATIO-TEMPORELLES QUI
SEMBLENT EFFICACES, MAIS DONT L'EFFICIENCE SERAIT, ELLE, PLUS DISCUTABLE
- 1. Une première fermeture qui semble
efficaces pour réduire le nombre de captures accidentelles de
dauphins
- 2. Mais une mesure relativement
indifférenciée, s'agissant de son périmètre, de sa
période d'application et du champ des engins interdits
- 3. Un bilan coûts socio-économiques -
avantages environnementaux qui n'a pas été établi ex ante
pour les territoires concernés
- 1. Une première fermeture qui semble
efficaces pour réduire le nombre de captures accidentelles de
dauphins
- C. AUX PERTES ÉCONOMIQUES PLUS OU MOINS
BIEN COMPENSÉES LIÉES À LA BAISSE D'ACTIVITÉ,
S'AJOUTENT DE NOMBREUX « COÛTS CACHÉS » DE
LA FERMETURE
- 1. Près de 300 bateaux à
l'arrêt : en dépit d'un régime d'indemnisation
à la hauteur, un désarroi compréhensible des
pêcheurs
- 2. Premier signe de reconnaissance pour ce secteur
charnière, le mareyage n'a cependant été que partiellement
indemnisé
- 3. Les autres maillons de la filière
pêche, au sens large, n'ont pas été
indemnisés
- a) Structures économiques
déjà fragiles, les ports et criées du golfe de Gascogne
ont été affectés par des baisses de volume
- b) Ayant pour clients prépondérants
les pêcheurs, la coopération maritime et la réparation
navale ont enregistré des pertes en grande partie
irrécupérables
- c) Une baisse de rentabilité pour le
transport de produits de la mer, segment aux contraintes logistiques
fortes
- a) Structures économiques
déjà fragiles, les ports et criées du golfe de Gascogne
ont été affectés par des baisses de volume
- 4. Au-delà des indemnisations, de nombreux
« coûts cachés » de la fermeture de la
pêche sont assumés par la société
- 1. Près de 300 bateaux à
l'arrêt : en dépit d'un régime d'indemnisation
à la hauteur, un désarroi compréhensible des
pêcheurs
- A. UN PROCESSUS DE DÉCISION INSATISFAISANT
SUR TOUTE LA LIGNE
- III. COMMENT CRÉER LES CONDITIONS D'UNE
RÉOUVERTURE DE LA PÊCHE COMPATIBLE AVEC LE MAINTIEN DE
L'ÉTAT DE CONSERVATION FAVORABLE DES PETITS
CÉTACÉS
- A. L'ÉPINEUSE GESTION DE
L'APRÈS- 2026
- B. RENOUER LE LIEN DE CONFIANCE ENTRE
SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELS, DANS LEUR INTÉRÊT
RÉCIPROQUE
- 1. Les déclarations et les caméras
embarquées, un « mal »
pour les pêcheurs, mais
« nécessaire » pour que les scientifiques leur
fournissent des données plus fines
- a) Un déploiement obligatoire pour certains
navires
- b) L'intérêt des caméras
réside dans un surcroît de précision et de
représentativité des données
- c) Un rapport coût-bénéfices
favorable
- d) Des modalités d'installation des
caméras qui ne devraient en aucun cas les assimiler à un
dispositif de surveillance des pêcheurs
- e) Sans aller jusqu'à une
généralisation, une extension du nombre
de navires concernés
- a) Un déploiement obligatoire pour certains
navires
- 2. Un besoin impérieux d'améliorer
l'acquisition et la diffusion des connaissances scientifiques pour la
filière pêche
- a) L'importance stratégique d'une
reconduction du projet Delmoges pour des mesures alternatives plus
ciblées
- b) Inviter la filière à créer
un institut technique de la pêche, pour renforcer les interfaces
science-activité économique
- c) La réactivation du groupe de travail
« captures accidentelles de petits
cétacés » sous l'autorité d'un médiateur
désigné par la ministre de la pêche
- a) L'importance stratégique d'une
reconduction du projet Delmoges pour des mesures alternatives plus
ciblées
- 1. Les déclarations et les caméras
embarquées, un « mal »
pour les pêcheurs, mais
« nécessaire » pour que les scientifiques leur
fournissent des données plus fines
- C. DES MESURES D'ATTÉNUATION DOIVENT
ÊTRE TESTÉES À GRANDE ÉCHELLE
- D. MISER SUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET
LA DURABILITÉ POUR ASSURER L'AVENIR DE LA PÊCHE DANS LE GOLFE
DE GASCOGNE
- 1. Le poids des mesures d'atténuation ne
devrait pas porter sur la seule capacité de la flotte de pêche
française, compte tenu du déficit commercial de la France en
matière de produits de la mer
- 2. Mettre au point des mécanismes
incitatifs et non plus punitifs, en lien avec les organisations de producteurs,
afin de mieux valoriser les bonnes pratiques des pêcheurs
- a) L'illusoire mise en place de quotas de captures
ou d'un bonus/malus de quotas de pêche lié aux captures
- b) Le développement d'une application de
partage des informations en temps réel sous la coordination des
organisations de producteurs
- c) Une valorisation plus systématique des
mesures d'atténuation des captures dans les cahiers des charges des
principaux labels
- a) L'illusoire mise en place de quotas de captures
ou d'un bonus/malus de quotas de pêche lié aux captures
- 1. Le poids des mesures d'atténuation ne
devrait pas porter sur la seule capacité de la flotte de pêche
française, compte tenu du déficit commercial de la France en
matière de produits de la mer
- A. L'ÉPINEUSE GESTION DE
L'APRÈS- 2026
- I. COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ :
CHRONIQUE D'UNE FERMETURE ANNONCÉE
- LISTE DES RECOMMANDATIONS
- EXAMEN EN COMMISSION
- LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
- LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- DÉPLACEMENT DE LA MISSION
D'INFORMATION
À LORIENT, PUIS À LA TURBALLE ET AU CROISIC
- TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
des principales recommandations de la mission
N° 525
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025
Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 avril 2025
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des affaires
économiques (1) relatif à la
pêche
dans le
golfe de Gascogne,
Par MM. Alain CADEC, Yves BLEUNVEN et Philippe GROSVALET,
Sénateurs
(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Pierre Médevielle, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mme Martine Berthet, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Éric Dumoulin, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Brigitte Hybert, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Vincent Louault, Mme Marianne Margaté, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.
L'ESSENTIEL
La commission des affaires économiques a adopté le mercredi 9 avril les conclusions de la mission d'information relative aux conséquences de la fermeture de la pêche dans le golfe de Gascogne un mois par an de 2024 à 2026, et aux solutions alternatives à cette interdiction.
Cette fermeture spatio-temporelle, pour de nombreux engins de pêche (filets, chaluts pélagiques, senne coulissante), du 22 janvier au 20 février, a été décidée en octobre 2023 sur injonction du Conseil d'État, une procédure d'infraction étant ouverte par la Commission européenne depuis 2020.
Cela sanctionne une trop lente prise de conscience de la situation et un premier plan d'action « captures accidentelles » manifestement insuffisant. Le pic des prises accessoires estimé depuis 2016 ne garantissait plus le maintien dans un « état de conservation favorable » du dauphin commun, espèce strictement protégée par la directive « Habitats ».
Si l'efficacité des fermetures pour réduire le nombre de captures accidentelles n'est que peu contestée (division par 4 des captures estimée l'hiver 2024), leur efficience est cependant sujette à caution, son caractère indifférencié ainsi que son coût disproportionné pour la filière, les territoires littoraux et l'ensemble de la société ayant concentré des critiques légitimes.
Le caractère précipité de la mesure a alimenté un climat de tension lié à une « rupture de confiance » entre professionnels, scientifiques et associations de protection de la nature, dans un contexte d'incertitude élevée sur les données (population de dauphins, estimation des captures accidentelles).
Les rapporteurs ont souhaité se livrer à un exercice de vérité sur l'inévitable maintien de la fermeture en 2026 et, de façon transpartisane, ont appelé à une réouverture de la pêche après 2026, dans des conditions qui permettent un maintien de l'état de conservation favorable du dauphin commun. La voie étant particulièrement étroite au regard des données scientifiques et du droit existant, la coopération entre l'ensemble des parties prenantes sera l'une des clés de la réouverture. En ce sens, la mission formule 15 recommandations regroupées en 3 axes :
Ø AIDER : gérer la crise et l'aide économique aux professionnels affectés par la fermeture en 2026
Ø CONCILIER : chercher les conditions de conciliation entre pêche et protection des petits cétacés au-delà
Ø CONNAÎTRE : augmenter l'effort d'acquisition et de diffusion des connaissances scientifiques en parallèle
Chiffres clés :
|
captures accidentelles chaque hiver entre 2017 et 2023 dans les eaux françaises et ibériques (sur environ 180 000 sur le littoral atlantique français et 440 000 dans l'Atlantique Nord-Est hors Irlande) |
seuil maximal de captures annuelles jugé compatible avec le maintien d'un « état de conservation favorable » de l'espèce (directive « Habitats ») en application de la règle de gestion « PBR » |
coût estimé de la première fermeture (2024) pour l'ensemble de la filière - pêcheurs, mareyeurs, réparation navale, coopération maritime transport frigorifique |
taux d'indemnisation maximal accordé aux pêcheurs en 2024 et 2025, à maintenir en 2026 |
I. 2016-2023 : FACE À LA HAUSSE DES CAPTURES ACCIDENTELLES, CHRONIQUE D'UNE FERMETURE DE LA PÊCHE ANNONCÉE
Source : observatoire Pelagis
Les captures accidentelles estimées par l'observatoire Pelagis (unité mixte de service CNRS-université de La Rochelle) ont fortement augmenté sur la période la plus récente, la moyenne 2016-2022 ayant été deux à trois fois supérieure à la moyenne 1990-2022.
Le projet scientifique Delmoges (DELphinus MOuvements GEStion), conjoint à Ifremer et Pelagis, met en évidence un double phénomène de rapprochement des dauphins des côtes, probablement dans le but de chasser les petits poissons pélagiques agrégés près du fond sur le plateau continental, et de dispersion accrue des populations de dauphins. Les interactions pêche-dauphins sont donc plus nombreuses : 70 % des échouages sont attribués à des prises accessoires de la pêche par Pelagis.
Ces chiffres sont sujets à une forte incertitude et sont vivement contestés par la filière pêche (faible nombre d'autopsies sur les animaux échoués, extrapolation sur la part des dauphins capturés échouant). Le nombre de dauphins dans le golfe de Gascogne serait compris entre 130 000 et 260 000 (intervalle de confiance à 95 %), et le nombre de captures accidentelles entre 2019 et 2021 compris entre 3 081 et 13 300 par an, selon la méthode retenue ( Ciem, 2023). Toujours est-il que la justice a appliqué le droit (protection stricte du dauphin) en se fondant sur les meilleures données disponibles : le seuil de 4 927 captures admissibles, correspondant à 1 % de l'estimation basse à l'échelle de l'Atlantique Nord-Est, a été largement dépassé (environ 6 620 captures en 2018-20 et 9 040 en 2019-21).
II. 2024- 2026 : UNE FERMETURE D'UN MOIS PAR AN QUI SEMBLE EFFICACE, MAIS PRÉCIPITÉE ET DONT LE COÛT EST DISPROPORTIONNÉ
Mesure inédite par son ampleur, la pêche a été interdite pour de nombreux engins dans la zone économique exclusive (ZEE) française des zones VIII a, b, c et d du golfe de Gascogne [zone rouge] pendant environ un mois en hiver (janvier-février), période à risque. Pelagis estime le nombre de captures accidentelles à 1 450 l'hiver 2024 contre une moyenne de 6 100 sur les hivers 2017-23, soit une réduction de l'ordre de 1 à 4.
Seulement, la décision de fermeture a été prise de façon précipitée (3 mois avant sa mise en oeuvre) et a causé une perte de chiffre d'affaires de 30 M€ pour le secteur ( dont 16 M€ pour la pêche). Plus de 300 bateaux, battant presque tous pavillon français, ont été mis à l'arrêt ( sur environ 1 400 opérant dans le golfe de Gascogne et les eaux ibériques). Au-delà de l'amont, mareyeurs, criées, réparation navale, coopératives d'approvisionnement en accastillage et en engins de pêche, transport frigorifique ont tous, à des degrés divers, été déstabilisés. Si une aide de 20 M€ notifiée à la Commission européenne a été accordée à la pêche (80 à 85 % du chiffre d'affaires) et, dans une moindre mesure, au mareyage (75 % de l'excédent brut d'exploitation), les autres maillons de la filière ont été en grande partie oubliés, ce qui risque de désolidariser la filière et d'augmenter les importations, soit directement pour compenser des pertes de volume, soit indirectement pour réduire les aléas sur l'approvisionnement.
La simple existence de régimes d'indemnisation ne suffit bien évidemment pas à effacer l'aléa juridique et le coût des arrêts « cétacés » pour la filière pêche : le risque réputationnel vis-à-vis des consommateurs et le déclin de l'attractivité des métiers dans un contexte de besoin de renouvellement des générations sont autant de « coûts cachés » qui n'ont pu que difficilement être pris en compte dans des aides publiques.
La société a assumé une double dépense : moindre création de richesse d'une part, et coût de l'indemnisation de l'autre (sans compter les ressources administratives déployées et les inévitables effets de bord des indemnisations).
III. 2027-... : CRÉER LES CONDITIONS D'UNE RÉOUVERTURE DE LA PÊCHE COMPATIBLE AVEC LA PROTECTION DES PETITS CÉTACÉS
Les fermetures spatio-temporelles appliquées au golfe de Gascogne interviennent dans un contexte plus large de fragilisation des capacités de pêche françaises du fait d'une succession de crises depuis cinq ans (arrêts Covid, Brexit, plan de sortie de flotte, flambée du goût du gasoil). L'avenir du golfe de Gascogne n'est envisageable ni sans les dauphins... ni sans les pêcheurs.
Néanmoins, les scientifiques rappellent que la voie est très étroite pour rouvrir la pêche après 2026, en l'état actuel des connaissances et du droit (sur 15 scénarios du Ciem, seuls 6 pourraient être compatibles avec l'état de conservation favorable du dauphin, dont 5 avec des fermetures spatio-temporelles).
Des mesures techniques d'atténuation ont déjà été engagées par les pêcheurs, et c'est sur les « pingers », des dispositifs d'éloignement acoustique, qu'ils fondent le plus d'espoirs. Déjà mis en place sur des chalutiers pélagiques, ils sont en cours de déploiement sur 200 fileyeurs pour confirmer leur efficacité. Une extension du nombre de navires équipés en caméras pour objectiver le débat sur les captures et fournir des données plus fines pour éviter une fermeture sèche devrait être explorée. Toutefois, cela suppose que le lien de confiance entre pêcheurs et professionnels soit rétabli, dans leur intérêt réciproque.
Les 15 recommandations de la mission, regroupées en 3 axes
Ø AIDER : la gestion de la crise et l'aide économique aux professionnels affectés par la fermeture
1. Assumer un devoir de vérité et préparer dès à présent et activement la fermeture spatio-temporelle de 2026, en définissant le plus en amont possible les modalités d'indemnisation et en anticipant les cas particuliers.
2. Maintenir en 2026 le taux d'indemnisation de 80 à 85 % du chiffre d'affaires pour les pêcheurs et négocier avec la Commission européenne le rebasculement du dispositif d'aide au mareyage sur le chiffre d'affaires plutôt que sur l'excédent brut d'exploitation.
3. Garantir en 2026 l'accès au chômage partiel pour les criées et les ports, y compris lorsqu'ils ne sont pas gérés par des chambres de commerce et d'industrie.
4. Maintenir voire étendre, dans le cadre du prochain régime d'aide notifié à la Commission européenne, la possibilité de réaliser des travaux sur les navires pendant la période de fermeture spatio-temporelle.
5. Inviter le secteur du transport frigorifique, dans le cadre d'un accord temporaire, à assouplir ses délais de livraison tout en maintenant la qualité et la fraîcheur des produits, et à explorer la possibilité de mutualiser le transport des produits de la mer et celui d'autres produits agroalimentaires.
Ø CONCILIER : chercher les conditions de conciliation entre activités de pêche et protection des petits cétacés
6. Maintenir sans ambiguïté l'objectif, pour après 2026, d'une réouverture de la pêche dans le golfe de Gascogne dans des conditions permettant un maintien de l'état de conservation favorable du dauphin commun.
7. Lancer un plan européen d'équipement afin notamment d'agrandir le marché d'intérêt pour les entreprises fabriquant des dispositifs d'éloignement acoustique (pingers) et leur permettre d'investir dans la miniaturisation et des gains d'efficience.
8. Pousser l'Union européenne à prendre un acte délégué de fermeture incluant la zone économique exclusive (ZEE) espagnole pour l'année 2026 et, au-delà, à « communautariser » davantage son approche du problème.
9. Prendre exemple sur la loi américaine sur la protection des mammifères marins, pour interdire à l'échelle de l'Union européenne (UE) les importations de poissons ne respectant pas des garanties équivalentes en matière de protection des mammifères marins (mesure miroir).
10. En lien avec les organisations de producteurs (OP), promouvoir des mécanismes incitatifs pour mieux valoriser les pratiques d'atténuation des captures de la part des pêcheurs (renforcement des labels « pêche durable » et MSC, application de partage des informations en temps réel de type BATmap).
Ø CONNAÎTRE : augmenter l'effort d'acquisition et de diffusion des connaissances scientifiques
11. Réactiver à la fin de l'automne 2025 le groupe de travail « captures accidentelles », sous l'autorité d'un médiateur nommé par la ministre chargée de la pêche, avec des modalités de fonctionnement revues - représentation de la DGampa à un plus haut niveau, association plus grande des administrations déconcentrées, confidentialité des échanges et préservation de leur dimension constructive.
12. En concertation avec les capitaines et leurs équipages, et sans aller jusqu'à une généralisation des caméras, étendre le nombre de navires équipés pour ainsi obtenir du projet OBSCame+ un nombre suffisant de données fiables à un horizon de deux ou trois ans.
13. Inciter la profession à mettre en place au plus vite, tel que prévu dans son contrat stratégique de filière, un institut technique de la pêche, interface scientifiques professionnels de nature à favoriser l'acquisition et la diffusion de connaissances en son sein.
14. Reconduire le projet scientifique Delmoges (Delphinus Mouvements Gestion) au-delà de 2025 pour une nouvelle période de trois ans, afin d'approfondir le continuum des connaissances sur les cétacés, les captures et la pêche, à partir des données actuellement collectées. Confier aux scientifiques le soin d'évaluer sur la base des dernières données l'efficacité de mesures alternatives plus ciblées que la fermeture spatio-temporelle de 2024-2026.
15. Améliorer la qualité et la transparence des données issues du Réseau national échouages (RNE) en : renforçant l'accompagnement vétérinaire ; fixant l'objectif d'une hausse du taux d'autopsie ; développant l'attention portée à l'identification des pathogènes ; publiant les données individuelles des échouages dans une logique de science ouverte.
PÊCHE ET
PETITS CÉTACÉS :
BÂTIR UN AVENIR COMMUN
DANS LE GOLFE
DE GASCOGNE
« En mer, pour les marins-pêcheurs, les plaisirs sont rares : contempler des dauphins s'égayer dans les flots est un de ceux-là. » C'est par ces mots que le pêcheur professionnel José Jouneau, président du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire (Corepem), a introduit son propos lors d'une réunion publique en présence de pêcheurs, de scientifiques et de services de l'État, le 27 mars 2025, au Croisic, dans le cadre d'un déplacement de la mission d'information relative aux conséquences de la fermeture de la pêche dans le golfe de Gascogne un mois par an, de 2024 à 2026, et aux solutions alternatives à cette interdiction.
Cette approche sensible de l'interaction pêche-cétacés, au milieu de controverses ayant essentiellement mobilisé des données statistiques et des arguments juridiques, peut sembler déroutante au premier abord, s'agissant d'un sujet pour lequel les pêcheurs sont avant tout identifiés comme une cause, au moins partielle, du regain des échouages de petits cétacés dans le golfe de Gascogne. Elle a pour mérite de sortir des caricatures qui ont pu parfois entourer le traitement du sujet.
La question des interactions pêche-cétacés est une illustration parmi d'autres d'une controverse plus globale mettant aux prises la préservation d'espèces protégées et la viabilité d'activités productives, relevant notamment - mais pas uniquement1(*) - du secteur primaire (agriculture, pêche, sylviculture). Il n'est donc pas inutile de se pencher sur ce sujet.
Les rapporteurs, comme la présidente de la commission des affaires économiques, ont du reste été frappés au cours de leurs travaux par certaines similitudes entre les enjeux de la présente problématique et ceux de la conciliation entre préservation du loup et maintien des activités d'élevage :
Ø comme pour le loup, les pouvoirs publics cherchent, dans le cadre du plan d'action « cétacés » d'une part et du plan national d'actions « loup » de l'autre, le bon équilibre pour préserver une activité traditionnelle participant à l'aménagement du territoire, le pastoralisme dans un cas, la pêche côtière dans l'autre ;
Ø comme le loup, dont la destruction faisait l'objet de primes sous la IIIe République, le dauphin commun a historiquement été détruit sur injonction des pouvoirs publics, et fait désormais l'objet d'une « protection stricte » dans le droit de l'Union européenne, statut juridique résultant d'une dégradation préoccupante de leur état de conservation, et d'une évolution importante des sensibilités ;
Ø comme pour le loup, une forte conflictualité politique s'est développée entre professionnels et associations de protection de la nature, débats d'autant plus vigoureux qu'ils sont attisés par la difficulté - inhérente au monde sauvage -, à estimer avec précision la population des petits cétacés, dont celle du dauphin commun.
La question du dauphin commun est-elle donc aux espaces marins ce que la question du loup est aux espaces de montagnes ? L'analogie est vraie jusqu'à un certain point seulement, puisque dans ce dernier cas, c'est le loup qui attaque les troupeaux d'ovins ou de bovins, tandis que dans le cas étudié par le présent rapport, ce sont les petits cétacés qui sont pris dans les filets des pêcheurs.
Pratiquée dans la nature et ayant pour cible des animaux sauvages - à la différence de l'aquaculture ou plus largement des autres activités agricoles -, la pêche maritime se prête, par définition, à des conséquences sur le milieu naturel.
Ces conséquences ont pour l'heure donné lieu à des efforts de limitation semblant porter leurs fruits2(*), par une gestion proactive des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP3(*)), via :
- une sélectivité accrue des engins de pêche (taille de la maille des filets) ;
- l'attribution de quotas par pêcherie pour une espèce, une zone et une période données, le cas échéant accompagnés d'arrêts temporaires parfois indemnisés ;
- voire, dans certains cas limites, des mesures de fermeture spatio-temporelles, donnant souvent lieu à indemnisation des pêcheurs également.
Dans le cas des petits cétacés, les deux premières mesures semblent difficilement pouvoir fournir des résultats, le dauphin n'étant pas l'espèce cible et étant de plus grande taille que ces espèces cibles. C'est donc une mesure de fermeture spatio-temporelle qui a été ordonnée par la justice, en attendant la démonstration éventuelle de l'efficacité de dispositifs d'effarouchement.
Sensibles à la préservation des petits cétacés, les marins-pêcheurs le sont aussi à l'avenir de leur métier. Ils sont les premiers à déplorer les captures accidentelles4(*), qui créent d'abord un risque de réputation pour la pêche, dans un contexte de remise en cause de plus en plus fréquente de cette activité par certaines associations de protection de la nature, et ensuite un risque juridique, mettant même en péril leur activité dans la zone depuis 2023.
Les pêcheurs ne souhaitent rien plus qu'exercer leur métier dignement, en limitant autant que possible leur impact sur les milieux, sans avoir à craindre pour la viabilité de leur activité. C'est tout le sens de cette mission : s'appuyer sur la science pour rechercher l'ensemble des solutions techniques et réglementaires alternatives à la fermeture du golfe de Gascogne à certains engins de pêche, dans l'objectif de rouvrir la zone à partir de 2027 tout en ayant pour préoccupation constante la protection des cétacés. La reconduction de cette fermeture n'est une solution ni viable ni satisfaisante.
I. COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ : CHRONIQUE D'UNE FERMETURE ANNONCÉE
A. PETITS CÉTACÉS ET ACTIVITÉS DE PÊCHE COEXISTENT DANS LE GOLFE DE GASCOGNE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES
Si les indicateurs recherchés ne sont pas toujours harmonisés à l'échelle exacte du golfe de Gascogne (1), il est certain que l'effort de pêche y est important (2) et que la faune marine, dont les petits cétacés, y est très présente (3).
1. Le « golfe de Gascogne » : de quoi parle-t-on au juste ?
a) Une définition géographique, biologique ou réglementaire
« Coin d'Atlantique enfoncé entre l'Espagne et l'Armorique » selon le géographe Jean-Pierre Pinot, le golfe de Gascogne a pour limite conventionnelle, en géographie physique, « une droite joignant le cap Ortegal, en Galice, à la bouée d'Ar-Men au large de Sein. Sa partie centrale est une plaine abyssale de 4 800 m de fond [en bleu plus foncé ci-dessous], qu'un escarpement continental vigoureux [souvent appelé talus continental] sépare de plateaux continentaux assez vastes [en bleu plus clair ci-dessous] ». Géographiquement, le golfe serait délimité par la diagonale bleue dans la carte ci-dessous.
Source : CIEM
Pour la gestion des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), via notamment les quotas de pêche, le Conseil international pour l'exploration de la mer (Ciem) subdivise l'Atlantique Nord-Est en plusieurs zones et sous-zones, selon des contours assez linéaires (cf. ci-dessous).
Selon cette approche retenant des unités de gestion de ressources halieutiques pertinentes, le golfe de Gascogne correspondrait à la zone VIII (contours rouges ci-dessus), et notamment des sous-zones a, b (sur le plateau continental) ainsi que c et d (sur la plaine abyssale). Il s'agit, du reste, du périmètre théorique de la fermeture spatio-temporelle de la pêche pendant un mois par an, selon l'arrêté du 23 octobre 2024, qui en a été le premier vecteur (cf. infra, partie II.A.).
Source : Ifremer
Encore faut-il tenir compte du fait que les eaux du golfe de Gascogne sont partagées entre juridiction française et espagnole, l'une et l'autre étant délimitées par la limite de leurs zones économiques exclusives (ZEE) (en rouge dans la carte ci-dessous). Or, les mesures spatio-temporelles ne s'appliquent qu'à la zone économique exclusive française, en rouge ci-dessous (cf. partie II.A.3 infra). En pratique la sous-zone c, dont la majeure partie est sous juridiction espagnole, échappe presque intégralement à l'interdiction.
Source : observatoire Pelagis
b) La difficulté de manier des chiffres portant sur des zones et des périodes différentes
À ces différences de définition du « golfe de Gascogne », il faut ajouter que nombre des données discutées au sujet des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne correspondent à des périmètres qui diffèrent parfois considérablement :
Ø pour l'estimation du nombre de dauphins, les deux campagnes d'observation existantes retiennent un périmètre façade atlantique et Manche (étude Samm, cf. ci-dessous) ou un périmètre beaucoup plus large encore, à l'échelle de l'Atlantique Nord-Est (étude Scans) ;
Ø le seuil maximal de captures accidentelles permettant la viabilité du dauphin est calculé à l'échelle de l'Atlantique Nord-Est, tandis que, pour l'estimation du nombre de captures accidentelles, l'observatoire Pelagis fournit des données à l'échelle de la façade Atlantique et Manche de la France ou pour le golfe de Gascogne ;
Ø pour l'estimation de l'effort de pêche, Ifremer retient comme périmètre le golfe de Gascogne et les mers ibériques.
Source : observatoire Pelagis
Si ces différences ont des justifications objectives - la géographie, la biologie, la pêche et la souveraineté des États ayant chacune leur logique propre -, la mobilisation de données portant indifféremment sur l'une ou l'autre de ces dimensions, avec des périmètres de référence pouvant varier considérablement, nuit à leur intelligibilité, est source de confusion et se prête facilement à des manipulations.
Cette même observation vaut d'ailleurs pour la difficulté à mettre en relation des données qui couvrent des périodes différentes. On relève :
Ø réglementairement, une fermeture spatio-temporelle du 22 janvier au 20 février inclus (arrêté du 24 octobre 2023), puis du 22 janvier au 25 février inclus (acte délégué de la Commission européenne) ;
Ø des bilans de mortalité hivernale des dauphins portant du 1er décembre au 31 mars de chaque année ;
Ø des estimations de l'impact économique de la fermeture, fournies par Ifremer et FranceAgriMer, à une échelle seulement mensuelle.
Ces nombreux « faux raccords » rendent moins crédible le « récit » sur les captures accidentelles et fragilisent l'acceptabilité des mesures prises pour les atténuer. Aussi, avant toute chose, les rapporteurs appellent le Gouvernement à faire preuve de plus de pédagogie et de rigueur en mettant à disposition du grand public, sur une unique page en ligne, les données pertinentes (d'effort de pêche, d'estimation de la population des dauphins, de captures accidentelles, d'impact économique...) à des échelles spatiales et temporelles identiques. À défaut, la convertibilité et l'interopérabilité de ces données devraient, autant que faire se peut, être recherchées. En cas d'impossibilité, il faudrait expliquer pourquoi et chercher à y remédier à l'avenir dans la production de ces données.
2. Panorama de la pêche dans le golfe de Gascogne : une activité essentiellement côtière
a) Une pêche côtière et encore très active
Les activités de pêche ont toujours été intenses dans les eaux, poissonneuses, du golfe de Gascogne, en particulier dans les secteurs côtiers de la Bretagne méridionale à la Galice, et dans les eaux peu profondes, jusqu'à la limite du plateau continental. Il s'agit d'une pêche historiquement - et encore aujourd'hui majoritairement - « artisanale5(*) », tout du moins côtière.
En 2023, sur 323 000 tonnes de débarquements de poisson en France hexagonale, 71 000 tonnes l'ont été dans le golfe de Gascogne, soit 22 % du volume de la pêche française.
Figurent, parmi les principales criées françaises, celles de Lorient (2e), du Guilvinec (3e), ou encore de Saint-Jean-de-Luz, de Saint-Guénolé, des Sables-d'Olonne et de La Cotinière.
Une étude datant de 2012 réalisée par M. Alain Biseau, chercheur à Ifremer, décrit les activités de pêche dans le golfe de la manière suivante :
Description des activités de pêche dans le golfe de Gascogne (2012)
« Le golfe de Gascogne est une zone de pêche très fréquentée par les navires français. On y trouve également une activité de flottilles étrangères : quelques navires belges ou hollandais ciblant la sole au chalut à perche, et surtout une flottille espagnole importante ciblant le merlu à la palangre, au chalut et au filet, et des bolincheurs cherchant les petits pélagiques, et plus au large des canneurs à thon.
En 2009, environ 1 700 navires français avaient une activité de pêche dans cette zone. Ces navires sont de petite taille : environ la moitié mesurent moins de 10 m et la moyenne est de 12 m, pour une puissance de 170 kW. La part des navires de taille supérieure à 25 m est très faible.
La plus grande part des captures provient des secteurs très côtiers.
Dans la partie nord du golfe de Gascogne, près de 60 % des débarquements proviennent d'une activité de chalutage de fond avec des chaluts simples ou jumeaux, et un quart provient de la senne coulissante (bolinche) ; cette dernière activité concerne néanmoins peu de navires. En ce qui concerne les espèces débarquées, la sardine Sardina pilchardus domine, suivie par le merlu Merluccius merluccius, les baudroies Lophius sp., le maquereau Scomber scombrus et le chinchard Trachurus trachurus.
Dans le sud, l'activité de chalutage de fond est plus réduite (environ un tiers des débarquements) et les filets fixes, maillants ou trémails, contribuent à environ un quart des débarquements totaux, le reste étant capturé à l'aide de casiers ou de palangres. Les espèces principales sont également différentes puisque la sole Solea solea et le merlu se partagent un quart des débarquements. À noter que l'anchois Engraulis encrasicolus, très présent dans les débarquements jusqu'au début des années 2000, n'apparaît pas dans les débarquements de 2009 du fait de la fermeture de cette pêche.
À l'échelle de la sous-région marine « golfe de Gascogne », la sardine domine largement les débarquements des navires français en termes de tonnage, avec près de 20 000 t en 2009. Le merlu vient en deuxième position avec plus de 8 000 t ; puis les baudroies (5 000 t) et la sole (4 000 t). Le bar Dicentrarchus labrax et la langoustine Nephrops norvegicus, deux espèces à forte valeur commerciale, sont respectivement en 6e et 7e position dans les apports en tonnage. »
Alain Biseau, étude « Pressions biologiques et impacts associés », Ifremer, juin 2012.
Près de quinze ans plus tard, en 2023, 1 283 navires avaient une activité principale dans le golfe de Gascogne ou les mers Ibériques, selon Ifremer, soit une diminution d'à peu près un quart.
b) Des techniques de pêche diversifiées
Les engins de pêche les plus utilisés dans la zone sont, par nombre de navires les utilisant - un navire pouvant utiliser plusieurs engins -, les filets (environ 600 navires) puis, en proportions similaires, les tamis, chaluts de fonds à panneaux et pièges ou casiers (environ 350 chacun). Suivent la pêche à la palangre (environ 300) et à la ligne (autour de 200) ainsi que, pour 100 navires chacun, les dragues et la pêche de rivage. Il est à noter que la catégorie des « filets » recouvre une grande variété d'engins de pêche (calés au fond ou en dérive, trémails ou filets maillants).
Source : Ifremer (projet Delmoges)
Ces « engins de pêche » peuvent être utilisés dans différentes configurations, appelées « métiers » (cf. ces présentations des différents « métiers » de pêche par la FAO ou par le comité interdépartemental des pêches 64-40).
Dans le cadre du projet Delmoges, Ifremer observe qu'« il n'est pas observé d'évolutions majeures dans les pratiques de pêche des navires français dans le golfe de Gascogne sur la période 2010 à 2020 autant sur les pratiques observées durant les périodes hivernales que par année ». De même, bien que partielles, « les données disponibles (présence) ne permettent pas de conclure à d'éventuelles évolutions dans les pratiques de pêche des navires étrangers dans le golfe de Gascogne sur la période 2010 à 2020 ».
c) Des ressources halieutiques assez bien gérées, parfois au prix de mesures difficiles
Dans son bilan 2024 de l'état des populations de poissons exploitées, Ifremer souligne, sur données 2023, que dans cette zone, « la part des populations considérées en bon état n'augmente pas et reste en dessous de la moyenne nationale (39 % des débarquements en 2023 comme en 2022 [contre 46 % en France hexagonale)), malgré une tendance à la baisse des débarquements depuis les années 2000 (de 101 000 tonnes en 2014 à 71 000 tonnes en 2023) ». L'institut souligne néanmoins que les changements de statut de la sardine, celle-ci représentant un cinquième des débarquements du golfe, ont une influence prépondérante sur le bilan global6(*).
Depuis l'an 2000, les pêcheurs du golfe de Gascogne ont été marqués en particulier par deux mesures de gestion des stocks halieutiques ayant laissé un souvenir amer :
Ø à la suite d'un second effondrement du nombre d'alevins d'anchois dans le golfe au début des années 20007(*), une fermeture spatio-temporelle complète de cette pêche a été décidée par la Commission européenne, sur avis du Ciem, en plein milieu de l'année 2006, et ce jusqu'à 2010. Le total admissible de captures (TAC) n'est depuis remonté que progressivement, et la pêche de l'anchois est toujours interdite du 1er janvier au 29 février et du 1er au 31 décembre de chaque année en zone CIEM VIII (art. 1er d'un arrêté du 8 mars 2024 relatif au contrôle de la pêcherie d'anchois), voire également du 1er mars au 30 avril pour le chalut ;
Ø plus récemment, faisant suite à des menaces sur les reproducteurs, la diminution de 37 % du quota de sole commune accordé dans le Golfe en 2022 (de 3 483 à 2 233 tonnes en une seule année) a conduit le Gouvernement à proposer des arrêts temporaires d'une période comprise entre 45 et 90 jours, dont au moins 15 jours du 1er au 31 mars ( arrêté du 30 décembre 2021 relatif à l'arrêt temporaire aidé « sole »), pour les navires dépendant de ces stocks au moins à hauteur de 10 %.
3. Combien y a-t-il de petits cétacés dans le golfe de Gascogne et dans l'Atlantique Nord-Est ?
a) Une donnée par définition difficile à établir
La problématique du nombre de petits cétacés dans le golfe de Gascogne est au coeur de la « rupture de confiance » entre scientifiques et pêcheurs. Il s'agit d'une donnée évidemment essentielle puisque son niveau absolu et son évolution dans le temps sont un élément central d'appréciation du maintien en état de conservation favorable ou non des espèces concernées. Du nombre de petits cétacés, et notamment de dauphins communs, dépend le nombre de captures accidentelles compatibles avec cet état de conservation favorable.
Or, le nombre d'individus d'une espèce sauvage recensés dans un espace géographique donné est, par nature, une information très difficile à établir, quand bien même « il n'existe pas beaucoup d'autres espèces animales qui bénéficient d'un tel niveau et effort de suivi » (France Nature Environnement).
Se pose également la question de la délimitation de cet espace, qui doit correspondre à une unité de gestion pertinente. S'agissant du dauphin commun, cette unité de gestion est actuellement l'ensemble des eaux de l'Atlantique Nord-Est, les scientifiques spécialistes du sujet se posant actuellement la question d'identifier deux populations distinctes (néritique et océanique) au sein de cette aire (cf. infra, au c).
Du fait de son large champ de compétences, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, Mme Agnès Pannier-Runacher, a pu se prêter, devant les rapporteurs, au jeu des comparaisons sur la robustesse des connaissances d'un domaine à l'autre de son action. Il en ressort qu'en matière de biodiversité, les données sont plus difficiles à fiabiliser : le vivant et le sauvage, en effet, ne sont bien sûr pas aussi aisément « capturés » dans les statistiques officielles que des flux physiques de biomasse.
Dans le cas des petits cétacés, s'ajoutent des difficultés méthodologiques de plusieurs ordres, la première étant que ces animaux, pouvant parcourir près de 100 km par jour, sont très mobiles, la seconde étant que la population n'est pas la même en été ou en hiver - saison lors de laquelle les dauphins migrent dans le golfe et se rapprochent des côtes pour se nourrir. La troisième est que les dauphins peuvent nager en profondeur et ne pas être immédiatement visibles. De façon générale, l'océan, « chaotique, envers désordonné du monde8(*) », non immédiatement accessible au regard de l'homme, demeure largement une mare incognita malgré un regain d'intérêt moderne et contemporain9(*) certain.
b) Le débat des captures dans le golfe de Gascogne porte sur le dauphin commun et le marsouin commun
Dans la classification du monde animal, les cétacés constituent un infra-ordre composé d'au moins 81 espèces de mammifères aquatiques, ayant la particularité de respirer à l'air libre grâce à des évents. On distingue en leur sein les mysticètes, dotés d'un fanon, comme les baleines, et les odontocètes, à l'instar des dauphins, qui disposent de dents.
Plusieurs espèces différentes de cétacés sont présentes dans les eaux de l'Atlantique Nord-Est, et en particulier dans le golfe de Gascogne10(*). Il s'en trouve également dans les eaux ultramarines, qui ne font pas l'objet de ce rapport11(*).
Le phénomène des captures accidentelles concerne essentiellement des petits cétacés et, plus particulièrement, le dauphin commun (delphinus delphis) ainsi que, dans une moindre mesure, le marsouin commun (phocoaena phocoaena) - il est à noter que les illustrations ci-dessous ne sont pas à l'échelle, le dauphin commun étant à peu près deux fois plus grand que le marsouin commun. D'autres delphinidés, tels que le grand dauphin ou le dauphin bleu et blanc - ce dernier étant pourtant proche visuellement du dauphin commun - en sont moins victimes, bien que cela puisse survenir plus ponctuellement.
Source : Whale Watching Handbook
c) Deux études qui ont procédé par échantillon et avec une marge d'incertitude importante
Dans l'Atlantique Nord-Est, l'aire de répartition des petits cétacés, et notamment du dauphin commun, est évidemment trop étendue pour se prêter à un inventaire exhaustif. Non seulement le rapport coût financier-bénéfice environnemental d'une telle entreprise serait démesuré, mais elle serait tout bonnement impossible : les zones concernées sont immenses et difficilement accessibles.
Aussi, l'estimation de la dynamique de population de ces espèces est effectuée par le biais d'échantillonnages, faisant ensuite l'objet d'un retraitement statistique à partir de modélisations.
Deux études d'estimation du nombre de petits cétacés sont menées dans l'Atlantique Nord-Est. Comme indiqué supra, elles portent sur des périmètres géographiques distincts et sont, du reste, réalisées à une fréquence et à une période variables :
Ø des campagnes d'observation hivernale françaises intitulées Samm (suivi aérien de la mégafaune marine) sont réalisées par l'observatoire Pelagis, tous les dix ans, pour le littoral atlantique, un second cycle ayant été conduit en 2021 ;
o D'après le deuxième cycle de la campagne Samm (suivi aérien de la mégafaune marine) menée par l'observatoire Pelagis sur les façades Manche et Atlantique, « l'abondance totale des petits delphinidés est estimée à 195 600 individus (138 900-277 200) en hiver 2021, contre 164 100 individus (97 400-278 800) en hiver 2011-12. En appliquant, les proportions de dauphin commun/dauphin bleu et blanc parmi les petits delphinidés, obtenues grâce à l'analyse digitale, l'abondance estimée de dauphin commun est de 181 624 individus (IC à 95 % [128 601-258 052]) au cours de l'hiver 2021 sur l'ensemble de la zone ».
Ø des campagnes d'observation estivale européennes intitulées Scans (Small Cetaceans in Atlantic waters and North Sea) sont réalisées tous les six ans, pour l'ensemble de l'Atlantique Nord-Est. La quatrième et dernière campagne a été réalisée à l'été 2022.
o la campagne Scans III, conduite en 2016, estimait le nombre de dauphins communs dans l'Atlantique Nord-Est (hors ZEE irlandaise) à 467 673 (IC à 95 % [281 129-777 998]). La campagne Scans IV, conduite en 2022, estimait ce nombre (toujours hors ZEE irlandaise, mais en incluant les eaux larges du Portugal) à 439 212 (IC à 95 % [309 153-623 987]).
Ces écarts demeurent élevés pour des intervalles de confiance12(*) à 95 %. Malgré cette forte amplitude, il existe en effet toujours 1 chance sur 20 que le nombre réel ne soit pas compris dans ces intervalles. De fait, d'après les données Samm, les effectifs du dauphin commun dans le golfe de Gascogne et la Manche Ouest se situent dans un intervalle de confiance dont la limite basse est inférieure de 29 % à l'estimation centrale et la limite haute supérieure de 42 % à cette même estimation, de sorte que ces valeurs limites (haute et basse) varient du simple au double13(*).
En raison de cette forte incertitude, il n'est pas possible de conclure sur l'évolution de la population sur la période récente (les nouvelles données restant dans l'intervalle de confiance de la précédente valeur centrale). La population est de ce fait considérée comme stable.
Il est à noter que les projets scientifiques sont en cours sur la pertinence de distinguer, au sein de la population de dauphin commun de l'Atlantique Nord-Est, deux populations différentes de dauphins, les uns néritiques14(*), les autres océaniques. Cette hypothèse de travail est vivement critiquée par le comité national des pêches maritimes et des élevages marins car elle conduirait à réduire les seuils de captures jugés compatibles avec l'état de conservation favorable de cette espèce (en réduisant le dénominateur, par rapport à une unité de gestion aujourd'hui étendue à tout l'Atlantique Nord-Est), alors que la panmixie de ces populations serait avérée. Les deux journalistes entendus par la mission, Erwan Seznec et Géraldine Woessner, ne remettent pas tant en cause les chiffres produits par Pelagis que les déductions qui en seraient faites, au prix de simplifications, dans la presse et dans la communication des associations de protection de la nature. Pelagis s'en défend en expliquant ne pas être comptable de l'utilisation qui est faite du travail de ses équipes, et faire preuve de pédagogie ( article synthétique sur le site The Conversation).
Les difficultés d'interprétation des données sur les populations des dauphins
« Les difficultés de dénombrement de la faune sauvage sont considérables. C'est vrai pour les grands mammifères et encore davantage pour les oiseaux migrateurs et les populations d'insectes. Les chercheurs rappellent toujours les incertitudes des mesures dans leurs publications scientifiques. Vient ensuite la communication vers le grand public et les décideurs. Elle simplifie, par définition, et retient en général les fourchettes basses et les hypothèses pessimistes.
Exemple, l'évaluation des populations de dauphins dans le golfe de Gascogne. Dans la note méthodologique 2020 de l'observatoire Pelagis, rattaché au CNRS et à l'université de La Rochelle, on apprend que les estimations ont été faites par avion, sur quatre journées, en hiver. Pour couvrir 35 000 km2, c'est insuffisant15(*). Les chercheurs le soulignent. Ils concluent avec prudence à « des densités plus élevées à l'intérieur du plateau continental qu'auparavant, et donc potentiellement un risque de capture plus élevé sur les zones de pêche ». Plus de dauphins entraînent plus de prises accidentelles. Cela deviendra, dans le discours formaté pour l'opinion : la pêche fait peser une menace de disparition sur les dauphins dans le golfe de Gascogne... À ce titre, elle a été interdite pendant un mois dans toute la zone pendant l'hiver 2024 !
Géraldine Woessner et Erwan Seznec, Les Illusionnistes,
d) Un rapprochement des dauphins des côtes et une dispersion accrue
Nombre de pêcheurs et de plaisanciers suggèrent, à partir de leurs observations visuelles répétées, une augmentation du nombre de dauphins sur les dernières décennies. Les affirmations telles que : « des dauphins, on n'en a jamais vu autant » ont été prononcées à plusieurs reprises dans le cadre des auditions ou du déplacement sur la façade atlantique, souvent à la fin des échanges, comme expression d'un scepticisme désabusé sur l'ampleur qu'a pris la question dans leur vie.
Les scientifiques expliquent le hiatus entre perception visuelle et estimation statistique du nombre de dauphins par un double phénomène :
Ø le premier est la dispersion accrue des groupes de dauphins observée sur la période récente. Animal éminemment social, le dauphin pouvait évoluer par groupes de dizaines d'individus, ce qui limitait la probabilité de croiser leur chemin. Des groupes de seulement quelques individus peuvent désormais être repérés ;
Ø par ailleurs, les dauphins se seraient rapprochés des côtes, probablement à des fins alimentaires, pour suivre les petits poissons pélagiques, sur le plateau continental moins profond. Cette explication n'est pas contestée par les représentants de pêcheurs, qui l'interprètent même comme le signe de leur bonne gestion des stocks halieutiques, par exemple de l'anchois, après une baisse de la ressource dans les années 200016(*).
Le projet Delmoges (DELphinus MOuvements GEStion)
Projet collaboratif scientifique conjoint de l'observatoire Pelagis (université de La Rochelle et CNRS) et Ifremer, en partenariat avec trois autres organismes, le projet Delmoges (DELphinus MOuvements GEStion) a constitué une première réponse souple, sur une durée de trois ans (2022-25), au défi de l'acquisition de connaissances plus fines sur les populations de dauphins et leurs interactions avec la pêche (captures accidentelles).
Selon les organismes engagés dans ce projet, ce dernier a notamment permis plusieurs résultats nouveaux :
Ø identification de deux populations potentiellement distinctes de dauphins communs dans l'Atlantique Nord-Est ;
Ø distribution des petits poissons pélagiques en hiver, agrégés en bancs denses sur le fond près des côtes, ce qui pourrait expliquer que des dauphins soient capturés dans des filets au fond (pour la sole et le merlu) ;
Ø typologie de stratégies de pêche les plus à risque de capture accidentelle ;
Ø caractérisation plus fine de l'effort de pêche et notamment de la longueur des filets déployés lors du filage et du virage ;
Ø quantification du risque de capture accidentelle en croisant plusieurs sources de données en vue de proposer des cartes de risques pour la gestion ;
Ø étude sociologique de la polarisation des perceptions des différentes parties prenantes.
B. LA MORTALITÉ PAR CAPTURE ACCIDENTELLE A ATTEINT, ENTRE 2016 ET 2023, DES NIVEAUX BEAUCOUP PLUS ÉLEVÉS QUE PAR LE PASSÉ
1. Les petits cétacés font l'objet d'une protection depuis 1970 dans un cadre national, renforcé depuis 1992 par un cadre européen et international très ambitieux
a) En droit français
Aussi étonnant que cela puisse paraître au regard de l'évolution importante des sensibilités depuis lors, il convient de rappeler que des primes ont existé en France pour encourager la destruction du dauphin, à l'instar des récompenses pour la destruction du loup sous la IIIe République. Comme le rappelle cet article du Figaro, entre 1901 et 1931, une prime de dix francs était ainsi attribuée par le ministère de la marine pour chaque dauphin tué.
Des pratiques usuelles ayant par le passé consisté, pour des habitants, du littoral, à se partager le corps échoué d'un dauphin et, pour des pêcheurs, à harponner des petits cétacés pour leur consommation à bord des navires, ont également été rapportées. Seule une consommation opportuniste semble subsister, de façon extrêmement résiduelle.
En France, c'est seulement depuis un arrêté du 20 octobre 1970 relatif à l'interdiction de capturer et de détruire les dauphins qu'« il est interdit de détruire, de poursuivre ou de capturer, par quelque procédé que ce soit même sans intention de les tuer, les mammifères marins de la famille des delphinidés (dauphins et marsouins) ». Cet arrêté a été abrogé et remplacé par un arrêté du 1er juillet 201117(*), qui transpose également le cadre de protection européen.
b) En droit européen
La protection stricte des petits cétacés a en effet été actée entretemps, au sein de l'Union européenne, par l'inclusion de l'ensemble des mammifères marins à l'annexe IV point a) de la directive « Habitats, faune, flore18(*) » de 1992.
L'article 12 de cette directive établit un régime dual, selon que les captures d'espèces animales strictement protégées soient intentionnelles (interdiction) ou accidentelles (système de contrôle et, sur cette base, nouvelles recherches ou mesures de conservation pour éviter une incidence négative). Cette distinction explique que les captures accidentelles ne revêtent pas la qualification d'infraction.
Article 12 de la directive Habitats, faune, flore
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant :
a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ;
[...]
4. Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l'annexe IV point a). Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n'aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question.
S'agissant des réglementations spécifiques au milieu marin et à la pêche, il faut encore relever :
Ø la directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) de 200819(*) impose aux États membres de mettre en place des plans d'action fixant des objectifs pour maintenir un bon état écologique du milieu marin (après un premier cycle 2017-20, la France met en oeuvre un second cycle 2022-27) à partir d'une évaluation de cet état menée dans le cadre d'un programme de surveillance ;
Ø le règlement relatif à la politique commune de la pêche de 201320(*) et le règlement relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins de 201920(*) traduisent ce même principe d'état de conservation favorable.
c) En droit international
La France est partie à plusieurs accords internationaux de protection de la biodiversité marine, et notamment :
Ø l'accord sur la conservation des petits cétacés de la mer Baltique, de l'Atlantique du Nord, des mers d'Irlande et du Nord (Ascobans) du 17 mars 1992, dont la France est devenue partie en 2005 ;
Ø la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique Nord-Est (Ospar) du 22 septembre 1992, fusionnant les conventions d'Oslo et de Paris relatives à la prévention de la pollution marine.
De façon plus générique, le bon état des populations de mammifères marins participe des « objectifs d'Aichi » de 2010 (plan stratégique pour la diversité biologique 2011-20) issus de la COP 10 de Nagoya sur la biodiversité.
2. Pourquoi les interactions entre la pêche et les petits cétacés dans le golfe de Gascogne posent problème
Il est fait état d'interactions anciennes entre les activités de pêche et les petits cétacés. Elles n'étaient cependant pas appréhendées de la même manière qu'aujourd'hui, un article du Figaro expliquant même que « la pêche à la sardine se pratiquait avec un filet de coton très fragile, que les marsouins détruisaient en pourchassant les poissons ». Les filets sont aujourd'hui en nylon ou autres matériaux plus performants, et la flotte est mieux équipée technologiquement (sonars) pour repérer les bancs de poissons (dérive technologique ou technological creep de 2 % par an).
Au coeur des problématiques posées par les interactions entre la pêche et les petits cétacés, se trouve donc le phénomène des « captures accidentelles » (ou accessoires). Une fois pris dans un engin de pêche, les petits cétacés meurent noyés en quelques minutes, sans pratiquement aucune chance de survie.
a) Une diversité d'engins de pêche jugés « à risque de captures »
Si tous les engins de pêche n'ont pas été interdits, c'est que tous ne sont pas considérés comme « à risque » de captures. La lumière n'est cependant pas encore tout à fait faite sur le risque relatif de capture propre à tel engin ou à tel autre, en l'absence de données suffisamment précises (déclarations manquantes, biais liés aux observateurs en mer). Le tableau ci-dessous, du Ciem, ne fournit qu'une estimation imparfaite des captures estimées (codes des métiers de pêche à la première colonne, méthode des échouages à l'avant-dernière colonne, méthode des observateurs en mer à l'antépénultième colonne).
Source : Ciem
Ainsi, lors des premières années de hausse des captures après 2016, il a d'abord été présumé que les chaluts pélagiques, des engins de pêche actifs et en pleine eau, en étaient responsables21(*). Au début des années 2000, le chalut en boeuf (pair trawling), alors bien plus utilisé par la flotte française qu'aujourd'hui, avait parfois été désigné responsable d'une première hausse des captures, bien moindre cependant que le pic récent. Le chalut pélagique continue d'être impliqué dans les captures accidentelles.
Aujourd'hui, les filets, engins de pêche passifs maintenus verticalement dans l'eau, sont également mis en cause. Davantage que la taille du bateau, ce sont la taille des mailles et la longueur de ces filets, pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilomètres - beaucoup moins dans le cas de la pêche artisanale - qui importeraient. Est également évoquée l'hypothèse d'un regain des captures la recrudescence récente de l'utilisation de trémails « pêche-tout » (bar, lieu, dorade), occupant toute la colonne d'eau, ce qui augmenterait le risque de captures.
Le comité national des pêches insiste cependant sur le fait, non contesté par les scientifiques, qu'aucune étude n'a corroboré l'impact de la hauteur des filets, des dauphins étant par exemple capturés dans des filets d'une très faible hauteur (moins d'un mètre) disposés au fond, visant typiquement la sole ou le merlu.
Les travaux conduits dans le cadre du projet Delmoges ont permis d'établir que d'une hauteur pourtant inférieure à 1 mètre, les trémails (code GTR) ou « filets à sole » (composés de trois nappes de filet de mailles différentes, dans lesquels s'emmêlent les poissons d'espèces benthiques) seraient particulièrement en cause. D'une hauteur de plus de 5 mètres, les filets droits (GNS) ou « filets à merlu » (composés d'une seule nappe de filet), disposés entre deux eaux pour pêcher des poissons d'espèces démersales (dorade, bar, lieu), seraient impliqués également, quoique dans une moindre mesure.
Les données de l'Office français de la biodiversité (OFB) à partir des caméras, malgré un faible niveau de représentativité, semblent confirmer cette attribution différenciée.
Source : OFB
Un relatif consensus semble en revanche se dessiner pour ne pas attribuer de captures accidentelles significatives à la senne coulissante (ou bolinche), puisqu'il demeure toujours possible d'abaisser celle-ci pour laisser partir le dauphin.
b) L'hypothèse d'une modification du « paysage alimentaire » des dauphins communs
Les raisons sous-jacentes de la plus grande « cooccurrence spatio-temporelle des dauphins communs capturés et des pêcheries22(*) » (liée au fait que les dauphins se sont rapprochés des côtes et sont plus isolés qu'avant, cf. supra) ne sont elles-mêmes pas complètement élucidées. Les scientifiques n'ont pas fermement établi si les petits cétacés se trouvent simplement « au mauvais endroit, au mauvais moment », s'ils étaient attirés par les mêmes proies ou s'ils étaient même attirés par les engins de pêche, y voyant le présage d'un garde-manger abondant (effet « dinner bell »). Il paraît clair, toutefois, que « les dauphins communs sont capturés lorsqu'ils sont en train de s'alimenter ». Les traits qui auraient favorisé la survie du dauphin au regard de la sélection naturelle se transformeraient ainsi en désavantage (« l'introduction d'engins à risque, c'est-à-dire de conditions nouvelles du point de vue évolutif pour le dauphin commun, peut transformer un comportement sélectionné dans le passé en un piège évolutif aujourd'hui, aboutissant à une réduction de la valeur sélective (évolutivement parlant) de ces individus »).
L'hypothèse intuitive d'un rapprochement des côtes des dauphins communs pour suivre les petits poissons pélagiques (sardines, plutôt en baisse dans le régime alimentaire du dauphin commun, et anchois, au contraire plutôt en hausse) a maintes fois été évoquée au cours de la mission. Les analyses stomacales des dauphins montrent que les dauphins capturés ont davantage ingéré de sardines et d'anchois que la moyenne de leur régime alimentaire. Le changement de distribution spatial pourrait s'expliquer lui-même par une évolution du phytoplancton, en lien peut-être avec le changement climatique.
À la question de savoir à quelle étape adviennent les captures dans ce type de filets23(*), les réponses divergent entre :
Ø certains pêcheurs, pour qui les phases du filage (mise à l'eau) ou du virage (remontée à l'aide d'un vire-filet) seraient les principales à risque, les dauphins pouvant s'emmêler dans le filet provisoirement détendu lors de cette mise à l'eau ;
Ø et certains scientifiques, pour qui les captures ont également lieu lorsque ces engins de pêche sont disposés au fond, dans le cadre d'un comportement de chasse frénétique - ce qui semble attesté par les analyses stomacales des dauphins retrouvés morts. Obnubilés par la forte densité de petits poissons pélagiques, les dauphins seraient conduits à ne plus prêter attention à l'engin de pêche malgré leur sonar, à l'image d'un piéton qui marcherait dans la rue avec des écouteurs.
La pêche d'espèces de fond, telles que la sole et le merlu, serait donc susceptibles d'interactions.
c) Une mortalité connaissant de fortes variations, notamment saisonnières
Il convient cependant de souligner une évidence que l'on a trop rapidement fait d'oublier : le phénomène de captures accidentelles reste, à l'échelle des activités de pêche, un événement rare, sinon marginal. En moyenne environ 1 à 3 % des sorties en mer se traduiraient par des captures accidentelles. Le fait qu'une majeure partie des captures accidentelles soit causée par des activités de pêche n'a pas pour réciproque qu'une majeure partie des activités de pêche se traduise par des captures accidentelles.
Les captures accidentelles sont des événements assez aléatoires et imprévisibles, car encore mal compris, et pouvant de ce fait être très concentrés, le projet Delmoges ayant ainsi montré que « le taux de captures pouvait atteindre 18 % dans une zone à risque restreinte en février 2023 (18 % de chances de remonter au moins un dauphin lorsqu'un filet est mis à l'eau) ».
Une constante est toutefois la plus forte prévalence des captures accidentelles en hiver, les dauphins migrant alors dans le golfe de Gascogne et plus près des côtes. Les échouages et les captures accidentelles dans les engins de pêche qui en sont déduites connaissent de fortes variations saisonnières, des pics d'échouage hivernaux étant constatés de décembre à mars, lors de cette période jugée à haut risque de captures. Ainsi, à titre d'exemple, on relève 9 860 mortalités par capture accidentelle entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023, contre 11 330 sur l'ensemble de l'année 2023.
Au sein de l'hiver, cependant, les variations peuvent être fortes d'une année sur l'autre entre les mois de décembre, janvier, février et mars.
3. Une augmentation marquée, sur la période 2016-2023, des captures accidentelles liées à la pêche, celle-ci expliquant autour de 70 % des échouages
a) Une hausse inédite des captures accidentelles de dauphins communs estimées par Pelagis
Si la pêche et les petits cétacés coexistent dans le golfe de Gascogne depuis longtemps, pourquoi une telle attention s'est-elle soudainement portée sur ces interactions, au point de conduire à la fermeture totale de la pêche pour certains engins, mesure d'une ampleur inédite dans la zone ?
C'est que les captures accidentelles, estimées par l'observatoire Pelagis, ont fortement augmenté sur la période la plus récente, la moyenne 2016-2022 ayant été deux à trois fois supérieure à la moyenne 1990-2022.
Source : observatoire Pelagis
Selon Pelagis, la situation s'est encore détériorée en 2023 : « les estimations de capture issues des échouages sont en 2023 les plus élevées calculées depuis 1990, puisqu'elles atteignent 11 330 dauphins communs capturés (IC95 % [8 490 ; 15 990]). Cette estimation est presque le double de la moyenne des estimations sur la période 2016-2022 et près de cinq fois supérieure à la moyenne des captures annuelles de la période 1990-2022 ».
En 2023, l'observatoire estime en revanche le nombre de captures de marsouins communs à 140 (IC95 % [100 ; 190]), un niveau inférieur, comme en 2022, à la moyenne des captures 2000-2022.
b) Points communs et différences des deux méthodes d'estimation des captures
Selon le Ciem (2023), entre 2019 et 2021, le nombre moyen des captures accidentelles de dauphins communs dans le golfe de Gascogne et sur la côte portugaise (sous-zone VIII et division IX.a du Ciem) a été estimé à 9 040 sur la base des échouages24(*) [IC à 95 %, 6 640 - 13 300] et à 5 938 sur la base des observateurs en mer [IC à 95 %, 3 081 - 9 700]. Selon le même organisme (2020), entre 2016 et 2018, ce nombre était estimé à 6 620 [IC à 95 %, 4 411 - 10 827] sur la base des échouages et à 3 973 [IC à 95 %, 1 998 - 6 598] sur la base des observateurs en mer25(*).
D'une moyenne triennale à l'autre, la tendance a bien été similaire d'une méthode à l'autre : une hausse de 37 % avec la méthode des échouages et de 49 % d'après la méthode des observateurs en mer.
Les scientifiques rappellent que la méthode des observateurs en mer souffre de potentiels biais (notamment liés au fait qu'elle repose sur le volontariat). La méthode des échouages est discutée ci-après.
c) La translation entre échouages et captures dépend d'hypothèses sur la dérive des carcasses
Le protocole à suivre par les pêcheurs en cas de capture accidentelle est, depuis le 1er janvier 2019, de déclarer cette capture, après quoi les pêcheurs doivent rejeter la carcasse à l'eau. Aussi, théoriquement, toutes les captures accidentelles pourraient finir par échouer.
Dans la méthode des échouages, la translation entre échouages observés et estimation de captures accidentelles dépend d'hypothèses sur la part des carcasses de petits cétacés qui dérivent vers le large avant de finir par couler et la part de ces carcasses qui, au contraire, échoue au sur les côtes et est recensée par le réseau national échouages (RNE).
L'observatoire Pelagis estime le taux d'échouage moyen d'animaux capturés accidentellement à 24 % sur les quinze dernières années (IC95 % [17 % ; 32 %]), soit environ une carcasse sur quatre capturée accidentellement qui serait récupérée sur nos côtes.
L'association franco-espagnole, Sybilline Océans, avec laquelle le rapporteur Yves Bleunven est entré en contact, ou le secrétaire général de l'union française de la pêche artisanale (UFPA) Jean-Vincent Chantreau remettent en cause la transposition aux carcasses de cétacés du modèle de dérive Mothy (modèle océanique de transport d'hydrocarbures), emprunté à l'analyse du déplacement d'objets inertes.
Deux études récentes tendent pourtant à montrer que ce taux n'est pas sous-estimé, ce qui accrédite l'idée que la majeure partie des carcasses couleraient et ne seraient jamais relevées par le réseau national échouages (RNE) :
Ø dans le cadre d'une étude de la chercheuse Hélène Peltier, des pêcheurs ont bagué 455 carcasses de dauphins communs et marsouins communs capturés avant de les remettre à l'eau. Sur ces 455 carcasses, seulement 83 ont été repérées sur les côtes dans un délai de 25 jours26(*), soit seulement 18 %, alors que les hypothèses des scientifiques étaient que, compte tenu des marées, des courants et des vents, 309 auraient dû l'être ;
Ø à plus petite échelle, dans le cadre du projet Balphin, porté par l'organisation de producteurs pêcheurs d'Aquitaine et financé par France filière pêche, un seul échouage a été constaté (soit 5 %) sur 22 carcasses remises à l'eau, la moitié d'entre elles ayant coulé soit directement soit après quelques heures ou jours de flottaison. Si cette étude repose sur un échantillon bien trop réduit pour donner des résultats significatifs, elle montre qu'un taux estimé de 24 % d'échouage par capture est tout à fait plausible.
4. Une hausse du nombre d'échouages observée par le réseau national échouages (RNE), et une prépondérance des marques de capture dans les examens externes
a) Une hausse du nombre des échouages observée par le Réseau national échouages (RNE)
Le suivi des échouages et le relevé des causes de mortalité sont effectués par le Réseau national échouages (RNE), dont la coordination scientifique, le fonctionnement opérationnel et l'animation sont assurés par l'observatoire Pelagis.
Toute découverte d'échouage doit être signalée au RNE, comme le rappelait en 2021 un flash de la DGALN. Pelagis met en avant une « pression de signalement (le fait de transmettre la découverte d'un animal échoué) considérée stable et homogène depuis le début des années 1990 » (Authier et al., 2014) et la ligne téléphonique dédiée (05 46 44 99 10) reçoit en moyenne de dix à vingt appels pour un seul dauphin échoué.
La hausse du nombre d'échouages de dauphins communs sur le littoral atlantique et en particulier dans le golfe de Gascogne n'est donc pas contestée.
Échouages de dauphins communs sur la façade atlantique (1969-2024)
Source : observatoire Pelagis / Réseau national échouages
b) Une remise en cause de la compétence du Réseau national échouages (RNE) par les professionnels
Les 530 correspondants du RNE (495 hors outre-mer) sont formés par cette unité mixte de service sur au moins trois jours et se conforment à une charte, notamment déontologique, avant d'être habilités par dérogation à intervenir sur les espèces protégées.
Source : observatoire Pelagis
Les professionnels de la pêche, l'association Sybilline Océans et le journaliste Erwan Seznec reprochent au RNE un manque de compétence, voire d'objectivité, pour la détermination des causes de mortalité ; le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, M. Jacques Guérin, a lui-même publiquement déploré que le RNE « s'appuie sur des associations pour faire pratiquer des autopsies par des personnes dépourvues des compétences qu'une démarche scientifique rigoureuse requiert27(*) ».
Malgré un inévitable biais de sélection (les personnes intéressées par la protection des cétacés s'engagent nécessairement davantage dans une telle action bénévole que d'autres), les statistiques sur sa composition ne témoignent pas avec évidence d'une surreprésentation de militants associatifs : les salariés et bénévoles d'associations de suivi de l'environnement ne représentent que 17 % des correspondants dans l'hexagone, 11 % sur la façade atlantique28(*). La presque totalité des correspondants a une compétence relative aux animaux (vétérinaires, scientifiques...) ou à l'administration déconcentrée en matière d'environnement (OFB, DDT, gestionnaires d'aires protégées...). Par ailleurs, les correspondants ne sont pas chargés de réaliser des autopsies (niveau 4 d'examen), mais seulement des examens externes.
Pour autant, les rapporteurs appellent à fiabiliser les données, au besoin par un encadrement vétérinaire supplémentaire des correspondants, en particulier dans les périodes à risque (période hivernale).
c) L'identification des causes d'échouage aboutit à en imputer 70 % à la pêche
« Identifier les causes d'échouages et/ou de mortalité des mammifères marins constitue », selon Pelagis, « un réel défi ».
L'observatoire Pelagis distingue, dans son rapport annuel sur « Les échouages de mammifères marins en France », cinq grandes catégories de causes de mort :
1. les causes naturelles résultant d'un état pathologique (maladies infectieuses et parasitaires, dénutrition, etc.) ;
2. les causes traumatiques résultant d'une capture dans un engin de pêche ;
3. les causes violentes, traumatiques ou toxiques, excluant la capture ;
4. les échouages accidentels (uniquement pour les cétacés) ;
5. la cause indéterminée, lorsque les éléments sont insuffisants ou non concordants.
Parmi ces causes, sur les années récentes, Pelagis attribue autour de 70 % des échouages en moyenne à des captures accidentelles et donc à la pêche (50 à 80 % d'une année sur l'autre).
La façon dont sont imputées les causes de mortalité fait l'objet, de ce fait, d'une vive polémique, le comité national des pêches maritimes et des élevages marins pointant le faible nombre d'autopsies (autour de 3 % des carcasses). L'organisation représentant les pêcheurs rappelle que des traces externes de filets ne signifient pas nécessairement que les filets ont été la cause de mortalité, des carcasses de dauphins pouvant avoir été pris dans des filets après leur mort.
Elle a donc demandé à la Commission d'accès aux documents administratifs (Cada) et au tribunal administratif de Poitiers d'accéder aux autopsies réalisées avant 2022 ainsi que les noms des vétérinaires les ayant réalisées (un contentieux toujours en cours).
|
Niveaux |
Examen |
Données sur l'état de santé et sur la cause de la mort |
|
1 |
Examen externe complet |
Condition corporelle Description des lésions macroscopiques externes |
|
2 |
Examen externe complet et interne partiel |
Condition corporelle Description des lésions macroscopiques externes Données élémentaires sur l'état de quelques organes principaux |
|
3 |
Examen externe et examen interne complets |
Condition corporelle Description des lésions macroscopiques externes et internes (Diagnostic et interprétation à posteriori par un vétérinaire spécialisé) |
|
4 |
Nécropsie (vétérinaires uniquement) |
Condition corporelle Description des lésions macroscopiques externes et internes (niveau d'expertise maximal par un vétérinaire spécialisé) |
Source : contribution de l'observatoire Pelagis
Pelagis répond en indiquant que le niveau d'examen (allant de 1 à 4) ne préjuge pas nécessairement de la qualité des données et ne change pas la répartition des causes de mortalité.
Par ailleurs, les autopsies sont réalisées en fonction de deux critères uniquement (état de fraîcheur de la carcasse et possibilités logistiques pour réaliser une autopsie) et non en fonction de considérations d'opportunité qui biaiseraient cette mesure. L'observatoire précise également que des autopsies en bonne et due forme n'étaient pas réalisées avant 2022, en l'absence d'un vétérinaire salarié recruté depuis, seuls des « relevés de conclusion », réalisés par des vétérinaires dans des laboratoires départementaux existant jusqu'alors.
L'association Sybilline Océans, entrée en contact avec Yves Bleunven, invite à investiguer davantage les pathogènes comme cause potentielle de mortalité. Les pêcheurs ont formulé la même demande. L'observatoire Pelagis indique qu'il s'agit de l'un de ses axes de recherche prioritaires et précise qu'aucun cas de mortalité par influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) n'a été relevé sur des dauphins à ce jour - contrairement à ce qui a pu être suggéré par certains professionnels.
Recommandation n° 15 : améliorer la qualité et la transparence des données issues du Réseau national échouages (RNE) en :
• renforçant l'accompagnement vétérinaire des correspondants, notamment lors des pics de mortalité ;
• fixant l'objectif d'une hausse du taux d'autopsie sur les cétacés échoués, en activant plusieurs leviers (hausse de la pression de signalement par une campagne de communication pour recruter davantage de correspondants, deuxième vétérinaire mobile lors des pics d'échouage, nouveaux outils diagnostiques pour des autopsies partielles, allègements circonscrits du règlement sanitaire départemental) ;
• développant l'attention portée à l'identification des pathogènes et aux autres espèces que le dauphin commun ;
• publiant les données individuelles des échouages dans une logique de science ouverte.
C. UNE TROP LENTE PRISE DE CONSCIENCE DE LA SITUATION
1. Le niveau des captures accidentelles estimé ces dernières années ne garantit plus le maintien dans un « état de conservation favorable » du dauphin commun
a) Le juge se prononce sur le maintien de l'état de conservation favorable d'une espèce, notion plus stricte que le danger d'extinction
Les rapporteurs considèrent qu'une partie du blocage dans la discussion autour de l'état de conservation du dauphin commun provient de ce que chacune des parties prenantes cherche à affirmer des choses différentes, qui ne sont pas nécessairement contradictoires pour autant. La complexité de la matière et la diversité des sources ne facilite pas non plus la clarté et la sincérité des débats.
Ainsi, les professionnels de la pêche ont souvent indiqué que « le dauphin n'était pas en danger d'extinction ».
À l'échelle mondiale, en effet, le dauphin commun ne semble pas en voie d'extinction, puisqu'il fait l'objet d'une « faible préoccupation » en ce sens dans la liste rouge de l'UICN des espèces menacées de 2020, la tendance ayant semblé stable en France jusqu'à la liste de 2017, la dernière à jour (cf. ci-dessous).
Le Conseil d'État, dans sa décision du 22 décembre 2020, a au contraire rappelé, au sens de l'inventaire national du patrimoine naturel (INPN), que « l'état de conservation des espèces concernées dans la région marine atlantique est « défavorable mauvais » pour le marsouin commun et le dauphin commun, ce qui correspond à un danger sérieux d'extinction au moins régionalement ».
Quoi qu'il en soit, le principe à respecter en droit de l'Union européenne et en droit international est celui, plus strict, du maintien de l'« état de conservation favorable » de l'espèce (article 12 de la directive Habitats, faune, flore). C'est sur ce motif que se prononce le juge.
Or, l'état de conservation d'une espèce sera considéré comme « favorable » lorsque « les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient et l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible et il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme » (article 1er de la directive Habitats, faune, flore).
b) Une procédure précontentieuse ouverte par la Commission européenne est toujours pendante
C'est sur ce fondement que, le 2 juillet 2020, la Commission européenne a fait parvenir une lettre de mise en demeure aux autorités françaises, espagnoles et suédoises [pour ces dernières, la problématique est celle du marsouin dans la Baltique], leur « demandant instamment de prendre des mesures pour réduire les prises accessoires [...] non durables d'espèces de dauphins et de marsouins par les navires de pêche ».
|
Lettre de mise en demeure [formal notice] (2 juillet 2020) « La France, l'Espagne et la Suède n'ont pas pris de mesures suffisantes pour contrôler les prises accessoires dans leurs eaux et par leurs flottes. [...] La France n'a pas intégralement transposé les obligations liées à la mise en place d'un système cohérent de surveillance des prises accessoires ni pris les mesures de conservation nécessaires. [...] Enfin, la France et l'Espagne n'ont pas non plus assuré un contrôle et une inspection effectifs en ce qui concerne l'obligation pour les navires de pêche d'utiliser des « pingers » pour éloigner les marsouins des filets, comme le requiert la politique commune de la pêche afin de prévenir ce type de prises accessoires dans les zones les plus vulnérables. La France, l'Espagne et la Suède n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour remédier à ces lacunes, la Commission adresse des lettres de mise en demeure aux trois pays. » |
Les raisons pour expliquer qu'une procédure précontentieuse, voire contentieuse, n'ait pas été ouverte avant pourraient être les suivantes :
Ø les scientifiques entendus par la mission émettent l'hypothèse que la Commission européenne a attendu la date de 2020, fixée dans la directive-cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM), pour initier une procédure précontentieuse ;
Ø certaines associations présument que, par la suite, la Commission européenne a laissé le juge national appliquer le droit de l'UE, ayant connaissance de recours formés par ces associations.
Le sénateur Arnaud Bazin a relevé, dans une question écrite29(*), qu'« en avril 2021, le conseil scientifique pour la gestion de la pêche de l'Union européenne (CSTEP) a jugé insuffisantes les mesures proposées en octobre 2020 pour réduire les prises accessoires » par les États membres du Sud-Ouest (SWWHL Group), et que la Commission européenne a invité la France à mettre en place des fermetures spatio-temporelles en octobre 2021, refusées par ce même groupe.
Aussi, la Commission a jugé que la France et l'Espagne, à la différence semble-t-il de la Suède, n'avaient « pas pris les mesures nécessaires pour remédier à ces lacunes » et a « par conséquent décidé de leur adresser un avis motivé ».
Avis motivé [reasoned opinion] (juillet 2022)
« La France et l'Espagne n'ont pas pris de mesures suffisantes pour améliorer la surveillance de l'état de conservation de plusieurs espèces et contrôler les prises accessoires dans leurs eaux ou par leurs flottes. [...] La France n'a pas transposé entièrement les obligations prévues par la directive « Habitats » concernant la mise en place d'un système de contrôle des prises accessoires et l'adoption des mesures de conservation nécessaires. Des mesures d'atténuation spécifiques sont également requises dans le cadre de la politique commune de la pêche par le « règlement relatif aux mesures techniques » [règlement (UE) 2019/1241]. Quant à la France et à l'Espagne, elles n'ont pas pris les mesures nécessaires recommandées par la science pour réduire les prises accessoires, telles que des périodes et zones de fermeture des activités de pêche. Ils n'ont pas non plus veillé à l'efficacité des contrôles et des inspections. »
Cette procédure d'infraction est toujours active30(*) lors de la rédaction du présent rapport. Aussi, si la France cessait d'appliquer des mesures de fermeture spatio-temporelles, la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre d'un recours en manquement31(*).
c) De quelles méthodes dispose le juge pour estimer le maintien en état de conservation favorable d'une espèce ?
Dans ses décisions successives, le Conseil d'État s'appuie sur les avis du Ciem, estimant le seuil au-dessus duquel le nombre de captures accidentelles ne serait plus compatible avec un état de conservation favorable du dauphin commun à 4 927 dans l'ensemble de l'Atlantique Nord-Est32(*).
Différentes règles de gestion
Ce nombre est calculé par l'approche du prélèvement biologique potentiel (ou Potential Biological Removal, PBR33(*)), qui fixe comme objectif de préserver ou rétablir au moins 50 % du stock théoriquement maximal d'une population de mammifères marins avec une probabilité très élevée (de 0,95 %) sur un horizon de 100 ans. En appliquant cette règle, le taux de captures ne doit pas dépasser 1 % de la limite basse de l'intervalle de confiance de l'abondance de dauphins communs la plus fiable dans l'unité de gestion (en l'occurrence, 492 652 individus).
Selon la contribution écrite des scientifiques entendus par la mission, « cette règle de gestion, retenue par le groupe de travail du Ciem sur l'écologie des mammifères marins, car elle avait déjà été mise en oeuvre pour le marsouin commun de la Baltique, a été développée dans le cadre du Marine Mammal Protection Act aux États-Unis ». Lors de son déplacement sur la façade atlantique, la mission a entendu des critiques de cette approche, jugée trop prudente.
Elle est toutefois loin d'être la plus prudente. L'objectif, fixé par l'accord Ascobans, ratifié par la France, est de préserver ou restaurer au moins 80 % du stock théoriquement maximal d'une population de mammifères marins. C'est pourquoi, lors de la dixième réunion des parties de l'Ascobans en septembre 2024, les scientifiques ont indiqué que ce seuil de 1 % était trop élevé pour le marsouin ou tout autre petit cétacé pour assurer leur viabilité à long terme. En appliquant cet objectif de préservation de 80 % de la population (avec une probabilité de 80 %), la commission chargée du suivi de la convention Ospar retient, elle, un seuil maximal de 985 captures accidentelles par an dans l'ensemble de la zone.
Or, le nombre de captures accidentelles dans le seul golfe de Gascogne a été estimé à 6 600 par an (entre 2018 et 2020) et même à 9 000 par an (entre 2019 et 2021) (cf. supra, partie I.B.3.), soit un niveau bien supérieur au seuil de 4 927.
En outre, les travaux de thèse de M. Etienne Rouby34(*) ont mis en évidence « une diminution de sept ans de la longévité des dauphins communs femelles entre 1997 (longévité = 24 ans) et 2019 (longévité = 17 ans35(*)) », à partir des dents des carcasses de dauphins conservées par l'observatoire Pelagis. Cette donnée est très préoccupante s'agissant d'une espèce à longue durée de vie et à cycles de reproduction longs (2 à 3 ans en moyenne), et pourrait se traduire par des changements démographiques importants.
Un document d'orientation de la Commission européenne (2021) rappelle que « l'interprétation et l'application des dispositions de la directive devraient tenir compte du principe de précaution36(*), comme établi par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE37(*)) ». Pour autant, le juge n'a pas eu besoin, en l'espèce, d'appliquer le principe de précaution pour fonder sa décision.
2. Les pêcheurs se sont progressivement saisis de la question, certains se montrant plus proactifs que d'autres
C'est dans la deuxième moitié des années 2010 que la problématique des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne a émergé comme un enjeu majeur pour la filière pêche, nécessitant une mobilisation croissante des pêcheurs et de leurs organisations.
Les pêcheurs sont en première ligne du rapprochement des côtes des dauphins, observé par les campagnes Samm, qui a provoqué depuis 2016 une forte augmentation des interactions avec ces mammifères marins. De nombreux professionnels insistent sur le fait qu'il n'est pas dans leur intérêt économique ou pratique de capturer des dauphins : ces derniers endommagent gravement leurs filets lorsqu'ils sont pris accidentellement.
Nombre d'entre eux se sont donc saisis pleinement de la question et collaborent avec les scientifiques, notamment en participant à plusieurs expérimentations, entre autres pour tester des systèmes d'effarouchement. La participation des pêcheurs à un grand nombre de programmes de recherche ou d'expérimentation témoigne même de la proactivité de nombre d'entre eux.
|
Nom du projet |
Date de lancement |
Objectif principal |
Partenaires |
Avancement |
|
PIC |
Février-avril 2018 |
Tester les pingers DDD03H sur chalutiers pélagiques pour réduire les captures accidentelles |
Organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne, Ifremer, Pelagis |
65 % de baisses des captures accidentelles et généralisation des dispositifs aux chalutiers pélagiques du golfe de Gascogne |
|
LICADO |
1er juin 2019 |
Développer des répulsifs acoustiques et réflecteurs pour chaluts et filets maillants |
CNPMEM, Ifremer, observatoire Pelagis, Les Pêcheurs de Bretagne, AGLIA, SAS OCTech |
Tests en mer réalisés, résultats encourageants mais nécessitant des données complémentaires |
|
DELMOGES |
2021 |
Étudier les habitats, mouvements et interactions des dauphins avec les engins de pêche ; co-construire des solutions |
Université de La Rochelle/CNRS, Ifremer, UBO, CNPMEM, OFB |
Utilisation de drones, hydrophones, ADN environnemental ; scénarios en cours d'évaluation |
|
CETAMBICION |
2021-2022 |
Stratégie coordonnée entre la France, l'Espagne et le Portugal pour réduire les impacts sur les cétacés |
Gouvernements français, espagnol et portugais, diverses institutions scientifiques |
Programme terminé, résultats intégrés dans les plans d'action nationaux |
|
OBSCAMe |
2021 |
Observation des captures accidentelles sur fileyeurs via caméras embarquées |
OFB, Directions de l'eau et de la biodiversité, DPMA, Ifremer, Observatoire Pelagis |
Équipement progressif des navires, collecte de données en cours |
|
PECHDAUPHIR |
2021 |
Étudier le comportement des dauphins près des filets et tester divers dispositifs d'éloignement |
CDPM du Finistère, Parc naturel marin d'Iroise, Ifremer, Pelagis, Ensta, Octech. |
Enregistrements acoustiques et tests en mer réalisés sur une douzaine de navires. |
|
APOCADO |
2022 |
Comprendre les captures via enregistreurs acoustiques fixés sur filets pour étudier le comportement des dauphins |
Ensta, Ifremer |
Phase d'analyse en cours ; données utilisées pour ajuster les dispositifs techniques |
|
BALPHIN |
2023 |
Suivre la dérive des carcasses de dauphins via balises pour améliorer la compréhension des échouages. |
France Filière Pêche |
Balises déployées, données en cours d'analyse |
|
PIFIL |
Octobre 2021 |
Tester les pingers CETASAVER sur fileyeurs lors de la phase de filage pour réduire les captures accidentelles |
CNPMEM, Ifremer (suite du projet LICADO) |
Tests à grande échelle réalisés (3 524 opérations suivies), données encore insuffisantes pour conclusions robustes |
|
DOLPHINFREE |
2021-2022 |
Développer des dispositifs acoustiques signalant la présence de filets aux dauphins communs |
Université de Montpellier, LIRMM, Observatoire Pelagis, Ifremer, OCTech, AGLIA, Les Pêcheurs de Bretagne |
Aucun dauphin capturé lors des tests (1 043 opérations), dispositif retenu pour collecter plus de données |
S'ils ont progressivement pris conscience de la nécessité de trouver des mesures d'atténuation, l'attitude de certains a marqué une certaine méfiance vis-à-vis du travail des scientifiques et une plus franche défiance à l'égard des associations de protection de la nature qui se sont saisies du sujet.
Le travail collaboratif entre pêcheurs et scientifiques est indispensable pour progresser sur cette question. Un groupe de travail réunissant différents acteurs (scientifiques, représentants de la pêche, associations de protection de la nature) avait été mis en place en 2017 après les échouages massifs de dauphins communs constatés durant l'hiver sur le littoral atlantique. Cependant, depuis 2020, ce groupe est perçu par les pêcheurs comme étant devenu trop politisé au détriment des discussions techniques initiales. Une fuite d'informations attribuée aux associations de protection de la nature a conduit au départ temporaire des représentants des pêcheurs fin 2023, devenu définitif à l'été 2024. Les pêcheurs accusent certaines associations de vouloir précipiter la disparition de la filière pêche.
Cette situation a provoqué un manque de communication et de collaboration entre pêcheurs et scientifiques provoquant une forte perte de confiance. Cette dernière s'accompagne d'une remise en cause par certains pêcheurs des données scientifiques disponibles sur le nombre réel de dauphins dans les eaux du golfe ou sur le taux exact de captures accidentelles. Ils critiquent également un manque de transparence dans la collecte et la transmission des données par certains instituts comme Pelagis.
Par ailleurs, la difficulté à intégrer pleinement des changements de pratiques dans le quotidien des pêcheurs est réelle. Ainsi, le taux de conformité à l'obligation de déclaration de captures semble compris entre 1 et 2 %, et l'installation des caméras embarquées a suscité de vifs débats parmi les pêcheurs, ces dispositifs étant perçus comme intrusifs par les marins.
Enfin, bien que résignés face aux contraintes imposées par la fermeture spatio-temporelle et la méfiance qui pèse sur eux, les pêcheurs dénoncent ce qu'ils considèrent comme un « constat d'échec » : faute d'avoir trouvé une solution efficace pour réduire les captures accidentelles, on ferme temporairement certaines zones à la pêche. De nombreux pêcheurs souhaitent pouvoir travailler avec les scientifiques en participant aux expérimentations permettant de travailler sur la réouverture de la pêche.
3. Un plan d'action national pour réduire les captures accidentelles de petits cétacés qui a tardé à se concrétiser
L'action de l'État pour limiter les captures accidentelles de cétacés dans les engins de pêche et garantir l'état de conservation de ces animaux dans le golfe de Gascogne ne semble pas avoir été conduite de façon spontanée et structurée, mais plutôt par à-coups, en réaction à la pression d'acteurs extérieurs - alertes des scientifiques, injonctions de la Commission européenne, recours des associations.
Précipitée par la hausse observée des échouages et estimée des captures à partir de 2016, la mise en place en 2017 d'un groupe de travail national piloté par la DGampa et la DEB, réunissant les parties prenantes, témoigne certes d'une prise en compte de la question par l'administration il y a huit ans de cela. Une modification du cadre réglementaire, obligeant à déclarer les captures et à équiper certains navires en dispositifs de dissuasion acoustique, est intervenue sous son impulsion :
Ø un arrêté du 6 septembre 2018 est venu renforcer l'arrêté de 2011 relatif à la protection des mammifères marins, en disposant que « tout spécimen de mammifère marin capturé accidentellement dans un engin de pêche doit faire l'objet d'une déclaration par les capitaines de navires de pêche dans le journal de pêche électronique ou dans les journaux de pêche papier » - cette obligation ne s'appliquait précédemment que dans le cadre de programmes de recherche scientifique ;
Ø un arrêté du 26 décembre 2019 portant obligation d'équipement de dispositifs de dissuasion acoustique pour les chaluts pélagiques38(*) dans le golfe de Gascogne, a été modifié dès l'année suivante par un arrêté du 27 novembre 2020 qui étend cette obligation à l'ensemble de l'année, quelle que soit la taille du bateau, ainsi qu'aux chaluts démersaux en paire (PTB), dans les mêmes conditions39(*).
Ce n'est toutefois qu'un mois avant l'ouverture d'une procédure précontentieuse par la Commission européenne en juillet 2020, que le Comité interministériel de la mer a publié un « plan d'action pour la protection des cétacés », déclinant l'action n° 43 du plan Biodiversité (juillet 2018).
Encore faut-il souligner que le plan d'action n'est pas spécifique à cette dernière : articulé autour de 4 axes stratégiques40(*) déclinés en 18 actions, il comprend simplement à ce sujet une action 2.2 (« réduire significativement les captures accidentelles de cétacés dans les engins de pêche » dans le golfe de Gascogne et dans les outre-mer).
Source : plan d'action pour la protection des cétacés
Si l'État s'est indéniablement mobilisé pour réduire les captures accidentelles, la mise à l'agenda de cette problématique ne s'est faite que graduellement, ce qui s'est traduit par un cadre réglementaire mouvant.
Ainsi, ce n'est que pour « répondre en grande partie à l'avis motivé de la Commission européenne du 15 juillet 2022 » (CNPMEM) que l'État a présenté un plan d'action national spécifique « pour réduire les captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne ». Matérialisé par une simple page internet et non une publication en bonne et due forme, il s'est traduit par un nouveau paquet de mesures réglementaires :
Ø arrêté du 27 décembre 2022 relatif à l'obligation de participer à un programme d'observation embarquée (programme ObsMer) pour les navires de pêche de plus de quinze mètres sous pavillon français41(*), sauf pour les navires équipés de caméra embarquée, dans le golfe de Gascogne et en Manche-mer Celtique ;
Ø arrêté du 29 décembre 2022 relatif à l'amélioration de la collecte de données sur les captures accidentelles d'espèces protégées et à l'expérimentation de dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles de dauphin commun à bord de navires de pêche sous pavillon français ;
Ø arrêté du 31 janvier 2023 rendant obligatoire « l'équipement en dispositifs techniques et d'acquisition de connaissance » pour un certain nombre de navires listés nommément (212 fileyeurs équipés dispositifs de réduction des captures dont 20 en réflecteurs acoustique, 63 en CetaSaver-DolphinFree et 129 CetaSaver-Pifil, ainsi que 100 fileyeurs équipés en caméras embarquées [programme OBSCAMe+]).
Ce sont précisément ces arrêtés qui ont été, partiellement ou totalement, annulés par le Conseil d'État en mars 2023, ce qui conduit à des mesures de fermeture spatio-temporelles, témoignant de l'insuffisance de ce plan d'actions.
À la question de savoir si « la fragilité de ces mesures avait été anticipée » et si « les risques juridiques étaient connus lorsque l'État a refusé de prendre des mesures de protection et de surveillance complémentaire » portées par les associations de protection de la nature, les administrations compétentes n'ont pas souhaité répondre.
II. PRÉCIPITÉE, LA FERMETURE SEMBLE DONNER DES RÉSULTATS, MAIS À QUEL PRIX ?
A. UN PROCESSUS DE DÉCISION INSATISFAISANT SUR TOUTE LA LIGNE
Aboutissement d'un échec collectif que les rapporteurs attribuent à une forme de « démission du politique » (1), plusieurs décisions de justice ont successivement enjoint l'État à prendre des mesures plus complètes de protection des petits cétacés et ainsi défini le cadre de la fermeture spatio-temporelle (2). Ces modalités de prise de décision ont rendu plus complexe la régionalisation (extension à l'Espagne) des mesures de fermeture spatio-temporelles, qui demeure à ce jour très imparfaite (3).
1. Une judiciarisation du processus de décision qui signe une incapacité collective à anticiper des mesures qui paraissaient pourtant quasi inéluctables
Malgré le plan d'action gouvernemental et sa traduction juridique de 2022 constituée de plusieurs arrêtés (cf. supra, partie I.C.2.), la fermeture spatio-temporelle de la pêche dans le golfe de Gascogne a finalement résulté de plusieurs décisions de justice successives (cf. partie suivante pour leur énumération chronologique). Pour les rapporteurs, cette judiciarisation du processus de décision marque un indéniable échec collectif, dont aucune partie prenante ne peut s'exonérer.
Selon les rapporteurs, les associations de protection de la nature sont évidemment les premières responsables, par leur propension croissante à former des recours et à judiciariser un débat qui aurait gagné, à leurs yeux, à se régler par plus de concertation. Cependant, ils ont convenu lors de leur échange avec la ministre chargée de la pêche Agnès Pannier-Runacher, que le juge ne faisait qu'appliquer le droit et qu'il eût été naïf d'escompter le maintien d'illégalités de la seule bienveillance ou de la retenue des requérants potentiels, « les tireurs couchés ne manquant pas ».
Les rapporteurs considèrent le processus judiciaire ayant finalement conduit à la fermeture comme symptomatique d'une forme de « démission du politique ». À cet égard, les rapporteurs ont relevé que chaque échelon de décision avait, en audition, manifesté une tendance à ne pas assumer la décision, si ce n'est à se défausser de ses responsabilités :
Ø ainsi, la DG Mare de la Commission européenne a insisté sur le fait que la décision de fermeture résultait de jugements du Conseil d'État français, de ce fait purement nationales, alors qu'en tant que garante de l'application du droit de l'Union, elle aurait logiquement dû ouvrir une procédure précontentieuse bien plus tôt ;
Ø à l'inverse, la Direction générale des Affaires maritimes, de la Pêche et de l'Aquaculture (DGampa) et la ministre ont souligné qu'il était impossible de faire abstraction du contexte de procédure précontentieuse ouverte par la Commission européenne, et rappelé que la décision de justice n'était pas la leur.
Le président du comité national des pêches et des élevages marins, M. Olivier Le Nézet, a déploré en audition avoir dû pallier le rôle d'un État peu prompt à endosser et expliquer la décision de fermeture spatio-temporelle. Il attribue à cela l'émergence de structures concurrentes des comités des pêches, plus contestataires, telle que l'Union française des pêcheurs artisans (UFPA), créée notamment à l'initiative du pêcheur lorientais David Le Quintrec. La colère de nombreux pêcheurs contre les associations de protection de nature est sans doute en partie la conséquence d'un État central qui n'a pas suffisamment servi de « tampon », et du sentiment d'une « décision sans décideur », qui crée une rupture de confiance.
Plutôt que d'attribuer aux associations ou au juge la responsabilité d'une décision de justice qui se contente d'appliquer le droit, il eût été préférable d'assumer collectivement - France comme Europe - la fermeture comme une décision résultant de choix initialement politiques, que la directive Habitats et les règlements de la politique commune des pêches n'ont fait que traduire juridiquement. Le dauphin commun est strictement protégé car il existe - ou, du moins, il a existé - un consensus social pour sa conservation, du fait d'une évolution des sensibilités, ce qu'une décision politique a entériné.
Si ces normes juridiques peuvent être perçues aujourd'hui comme un corset s'imposant au politique, il convient de rappeler qu'elles ont été un jour adoptées selon un processus lui-même politique. Or, ce que le politique a fait, il pourrait le défaire : l'exemple du projet de la Commission européenne de déclassement du statut du loup, de l'annexe IV à l'annexe III de la directive Habitats, témoigne de cette possibilité, quand bien même le processus de révision est lourd.
Outre cette démission du politique, n'est sans doute pas étranger à l'échec du premier plan « captures accidentelles » un certain flottement, au plus haut sommet de l'État, qui s'est traduit depuis 2022 par de fréquents changements de ministres - quatre secrétaires d'État ou ministres - et de configuration institutionnelle - rattachement au Premier ministre, au ministre de la transition écologique, au ministre du partenariat avec les territoires, ou ministère de plein exercice. Ces changements n'ont pas facilité la continuité de l'action de l'État.
Il faudrait de même examiner en quoi ont pu jouer des divergences entre direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) et direction générale des affaires maritimes, des pêches et de l'aquaculture (DGampa) - deux directions d'administration centrale n'étant sous une même autorité ministérielle que depuis 2024 - dans l'incapacité de l'État à établir une position interministérielle à la hauteur des enjeux.
Les représentants des professionnels ont aussi leur part de responsabilité, en ayant laissé au moins par omission se mettre en place, en lien avec les administrations compétentes, un « jeu du chat et de la souris » avec le juge et la Commission européenne, pensant repousser le problème plutôt que de le prendre à bras-le-corps, modus operandi qui connaît de trop nombreux précédents en matière de gestion des ressources halieutiques, à l'exemple de l'anchois au milieu des années 2000. Aussi déconcertant en soit le principe, des obligations d'auto-déclaration des captures accidentelles ont ainsi été mises en place dans le presque unique but de témoigner à la Commission européenne des meilleurs efforts des pêcheurs.
Les professionnels ont pourtant été les premiers à pâtir, en termes de prévisibilité de leur activité et de capacité d'adaptation à la situation, de ces décisions prises sous les à-coups de recours juridiques. Les délais ont été extrêmement réduits entre la publication de l'arrêté établissant une fermeture spatio-temporelle du golfe de Gascogne (24 octobre 2023) et le début de la première période de fermeture (22 janvier 2024) - et encore plus resserrés, à la limite de l'acceptable pour des opérateurs économiques, s'agissant des navires ajoutés dans le champ de la fermeture du fait de la suspension partielle de l'arrêté (22 décembre 2023).
2. Une fermeture actée en octobre 2023 sur injonction du Conseil d'État en mars, encore durcie par le Conseil d'État à seulement un mois de sa mise en place
Signe d'un premier plan de réduction des captures accidentelles mal construit et pas assez ambitieux, sur requête de France Nature Environnement, Défense des milieux aquatiques et Sea Shepherd France, le Conseil d'État a d'abord, le 20 mars 202342(*), annulé l'arrêté du 24 décembre 2020 et enjoint l'État :
Ø d'assortir les mesures d'équipement des navires en dispositifs de dissuasion acoustique, de « mesures de fermeture spatiales et temporelles de la pêche appropriées », dans un délai de six mois, pour « réduire l'incidence des activités de pêche dans le golfe de Gascogne sur la mortalité accidentelle des petits cétacés à un niveau ne représentant pas une menace pour l'état de conservation de ces espèces » ;
Ø ainsi que, dans le même délai, de « mettre en oeuvre des mesures complémentaires permettant d'estimer de manière fiable le nombre de captures annuelles de petits cétacés, notamment en poursuivant le renforcement du dispositif d'observation en mer ».
En conséquence, le Gouvernement a pris un arrêté le 24 octobre 202343(*), interdisant aux navires battant pavillon français de plus de 8 mètres équipés de certains engins (chalut pélagique, chalut boeuf de fond, filet trémail, filet maillant calé) d'opérer dans le golfe de Gascogne44(*) pendant un mois (du 22 janvier au 20 février), durant trois ans de suite (2024, 2025 et 2026). Des dérogations ont toutefois été prévues pour les navires équipés de dispositifs de dissuasion acoustique ou de caméras embarquées, ainsi que pour les armateurs qui se seraient à engagés à s'en équiper, mais n'auraient pu le mettre en oeuvre dans les temps.
Il semble d'après certains acteurs entendus par la mission que les responsables de la DEB avaient averti la DGampa du risque posé par ces dérogations.
L'arrêté a effectivement été partiellement suspendu par le Conseil d'État, à l'occasion d'un référé-suspension du 22 décembre 202345(*) :
Ø s'agissant de son champ d'application, le Conseil d'État ordonne d'interdire également la recours aux sennes pélagiques - en ce que ces engins de pêche seraient responsable de 20 % des captures accidentelles de dauphins communs dans le golfe de Gascogne entre 2019 et 2021 - mais n'étend l'interdiction ni aux navires de moins de huit mètres, ni aux sennes danoises, ce qui était demandé par les associations requérantes ;
Ø s'agissant des dispositions transitoires de dérogation (pour les fileyeurs équipés en dispositifs d'observation ou ayant signifié leur intention de s'équiper).
Dernier épisode de cette chronique judiciaire, le 30 décembre 2024, le Conseil d'État s'est prononcé « au fond » sur l'arrêté du 24 octobre 2023, confirmant le référé-suspension du 22 décembre 2023.
Encore aujourd'hui, comme l'indique la région Bretagne dans sa contribution, le cadre réglementaire est « assez bancal ». Il résulte en effet de la combinaison de l'arrêté du 24 octobre 2023 et du jugement du Conseil d'État du 30 décembre 2024, et « certaines dispositions qui auraient dû être annulées en cohérence avec le reste de la décision (1. de l'article 4 et article 546(*)) ne l'ont pas été en l'absence de demande en ce sens par les associations mais ne s'appliqueront pas tout de même ». Aussi, cela « rend assez peu lisible ce cadre réglementaire » tant qu'un nouvel arrêté consolidé, que les rapporteurs appellent de leurs voeux, n'est pas pris par la DGampa. C'est pourquoi il conviendrait selon les rapporteurs de prendre un arrêté modificatif de l'arrêté du 24 octobre 2023 pour assumer un portage politique de la décision et toutes les conséquences de la décision du Conseil d'État du 30 décembre 2024, clarifiant ainsi le cadre applicable.
3. Un manque de coopération entre États membres et une décision seulement partiellement européanisée malgré les efforts de l'administration française
Contrairement à ce qui a été avancé par plusieurs des acteurs entendus par la mission, le processus ayant conduit aux mesures de fermeture spatio-temporelles n'a pas été strictement « franco-français », loin s'en faut (cf. partie I.C.1. supra sur la procédure d'infraction ouverte par la Commission européenne à l'encontre de la France, de l'Espagne et initialement de la Suède).
Dans ce contexte, il est pour le moins paradoxal que les mesures de fermeture spatio-temporelles pour certains engins de pêche continuent, finalement, de s'appliquer dans les seules eaux relevant de la juridiction française. Ce « deux poids, deux mesures » accentue le sentiment d'injustice et le désarroi des pêcheurs français, dans un contexte où la coopération franco-espagnole sur la gestion des ressources halieutiques dans le golfe n'a pas toujours été bonne.
Le caractère purement national de la première décision de fermer le golfe de Gascogne pour certains engins de pêche a indéniablement compliqué la tâche des autorités françaises pour faire accepter cette décision. Sous sa première forme, l'interdiction a en effet résulté d'un arrêté ministériel français qui restreignait le champ des navires concernés par la mesure à ceux « sous pavillon français ayant une activité dans le golfe de Gascogne » (art. 1er de l'arrêté du 24 octobre 2023) et répondant aux autres caractéristiques énumérées dans l'arrêté (cf. partie II.B.1.).
Aux termes de la politique commune des pêches, qui relève de la compétence exclusive de l'UE, les autorités françaises ne disposaient en réalité d'aucun levier pour restreindre l'accès des navires battant pavillon étranger à la zone économique exclusive de la France.
Aussi, il convient de souligner les efforts des autorités françaises pour européaniser la mesure, compte tenu de délais extrêmement réduits qui ne le permettaient théoriquement pas. En effet, l'article 13.2 du règlement sur la politique commune des pêches de 2013 prévoit « un délai raisonnable pour la consultation [de la Commission, des États membres concernés et des conseils consultatifs compétents] qui n'est cependant pas inférieur à un mois » lorsque des mesures d'urgence dans le but de parer à une menace pour l'écosystème marin sont susceptibles de concerner les navires de pêche d'autres États membres.
Selon la DGampa « ne s'est pas fait sans heurts avec les autres États membres » ainsi qu'avec le Royaume-Uni. L'Espagne confirme que le non-respect des délais de consultation établis « a posé un problème juridique majeur », mais explique avoir « mis en oeuvre une procédure législative d'urgence obligeant les navires espagnols à se conformer à la réglementation française concernant la fermeture », ce qui est à mettre à son crédit. En France, c'est l' arrêté du 17 janvier 2024 qui a étendu la mesure de fermeture spatio-temporelle aux navires de pêche « battant pavillon d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État tiers », dans les mêmes conditions que pour les navires français.
L'Espagne explique que 37 navires battant son pavillon ont été affectés par la fermeture, 17 étant restés à quai (dont 14 senneurs), les 20 autres ayant pu trouver des alternatives pour pêcher dans d'autres zones.
Comme l'explique la DGampa, « pour la deuxième année, le processus plus classique de régionalisation a pu être mis en oeuvre ». Un règlement délégué47(*) (UE) 2024/3089 - modifiant le règlement « mesures techniques » (UE) 2019/1242 de 2019 - pris par la Commission européenne en septembre 2024 et entré en vigueur le 10 décembre de la même année a confirmé l'interdiction prise par la France pour 2025, en l'étendant jusqu'au 25 février et en l'assortissant de mesures de suivi des captures accidentelles jusqu'à la fin de l'année.
Cependant, la DGampa explique que « les Espagnols ont refusé d'augmenter l'effort d'observation et d'opérer une fermeture analogue dans leurs eaux ». Il en résulte que « la pêche est interdite dans les eaux françaises jusqu'à la limite extérieure de la zone économique exclusive de la France dans la sous-zone CIEM 8 », mais pas dans la ZEE espagnole, ravivant chez les pêcheurs un sentiment d'injustice compréhensible, l'Espagne étant également mise en demeure par la Commission européenne.
Le golfe de Gascogne étant partagé entre les zones économiques exclusives françaises et espagnoles, il est apparu d'autant plus saugrenu aux pêcheurs français d'interdire de façon indiscriminée un grand nombre de pratiques de pêche, quand dans le même temps elles restaient autorisées dans les eaux espagnoles et portugaises. Plus largement, il convient de noter que l'unité de gestion du dauphin commun est l'ensemble de l'Atlantique Nord-Est.
Dans sa contribution écrite, l'ambassade d'Espagne en France se défend en soulignant que ce pays « connaît un nombre d'échouages bien inférieur à celui observé sur les côtes françaises » et précise que « le chalutage pélagique n'est pas pratiqué par la flotte espagnole car il n'est pas autorisé, et que les grands engins à ouverture verticale, tels que le chalutage pélagique, ainsi que le chalutage en boeuf, ont été identifiés comme les modalités à plus grand risque de captures accidentelles de petits cétacés ».
L'insuffisante européanisation de la mesure spatio-temporelle d'interdiction reste encore aujourd'hui l'un des principaux éléments à décharge de la mesure, et pose de nombreux autres problèmes à résoudre (limitation de l'efficacité des mesures de réduction des captures, risque de regain d'importations, réduction du marché d'intérêt pour les fabricants de pingers).
Dans les discussions pour l'élaboration du règlement délégué pour 2025, la France n'a cependant pu faire autrement que d'accepter une application de la mesure à sa seule ZEE, afin d'obtenir l'unanimité des États membres, qui était indispensable.
Elle y était obligée par des décisions de justice nationales, tandis que l'Espagne ne l'était pas. Cette absence de décision de justice en Espagne similaire aux décisions françaises, appliquant le droit de l'Union européenne, ne laisse pas cependant d'étonner les rapporteurs.
La question du périmètre d'application reste donc entière pour l'élaboration du règlement délégué pour l'année 2026.
Recommandation n° 8 : pousser l'Union européenne à prendre un acte délégué de fermeture incluant la zone économique exclusive (ZEE) espagnole pour l'année 2026 et, au-delà, à « communautariser » davantage son approche du problème.
B. DES MESURES DE FERMETURE SPATIO-TEMPORELLES QUI SEMBLENT EFFICACES, MAIS DONT L'EFFICIENCE SERAIT, ELLE, PLUS DISCUTABLE
1. Une première fermeture qui semble efficaces pour réduire le nombre de captures accidentelles de dauphins
a) Une division par quatre du nombre de captures accidentelles
L'efficacité des mesures de fermeture spatio-temporelles applicables à certains engins de pêche pour réduire le nombre de captures accidentelles n'est pas contestée. Cette efficacité relève a priori de l'évidence puisque s'il n'y a pas de bateaux de pêche en mer, alors, par construction, ces derniers ne peuvent capturer aucun dauphin.
Les premières estimations de l'observatoire Pelagis, à partir des observations du réseau national échouages (RNE), confirment que sous l'angle de l'efficacité, c'est-à-dire de la capacité à atteindre un objectif donné (en l'occurrence, la réduction des captures), sans se poser la question de la proportionnalité des moyens mis en oeuvre pour l'atteindre, les mesures semblent porter leurs fruits.
Dans le « Bilan des mortalités par capture : hiver 2024 » de l'observatoire, il est estimé que 1 450 dauphins communs sont morts par capture, entre le 1er décembre 2023 et le 31 mars 2024 dans l'ensemble des eaux du golfe de Gascogne et de la Manche Ouest, ce même nombre ayant été estimé en moyenne à 6 100 par hiver, entre 2017 et 2023.
Autrement dit, il a été observé une division des captures accidentelles par un facteur supérieur à 4, ce qui a permis à la ministre de la transition écologique et de la pêche d'affirmer que la « fermeture de la pêche à l'hiver 2024 s'est avérée très efficace ».
Les intervalles de confiance de ces données ne se chevauchent pas : même en retenant la borne haute de l'intervalle de confiance à 95 %48(*) pour le nombre 2024 (soit 2 050 captures) et la borne basse de ce même intervalle pour la moyenne 2017-2023 (soit 4 400 captures), il demeure un écart du simple au double. Le nombre de captures hivernales est le plus bas calculé depuis 2015 (cf. graphique ci-dessous).
Cela laisse peu de place au doute quant à l'efficacité de la mesure de fermeture spatio-temporelle en 2024 - mais l'observatoire Pelagis souligne qu'il est plus prudent d'attendre une deuxième voire une troisième fermeture pour en tirer des leçons sur l'efficacité des mesures spatio-temporelles face aux captures accidentelles de façon plus générale.
Source : observatoire Pelagis
b) Une hausse du nombre d'échouages troublante mais paradoxale seulement en apparence
Les premiers éléments de bilan publiés à l'issue de la première période de fermeture spatio-temporelle ont été les observations d'échouages, dès février.
L'observatoire Pelagis avait précisé dans un post de blog (février 2025) qu'« il convient donc d'être précautionneux dans l'interprétation des niveaux d'échouages qui seront recensés durant l'hiver 2024, afin d'éviter les conclusions hâtives qui ne prendraient pas en compte l'ensemble du processus ».
Plusieurs critiques, dont le journaliste Erwan Seznec, ont pointé que le nombre d'échouages avait finalement été plus élevé en février 2024 qu'en février 2023 ainsi qu'en février « 2018, 2015, 2012, 2010 et 2009 », quand bien même les engins de pêche les plus à risque n'étaient pas en mer, ce qui relèverait du paradoxe puisque l'observatoire Pelagis attribue 50 à 80 % des captures accidentelles à la pêche.
Pelagis donne dans son bilan deux éléments de contexte qui peuvent permettre d'expliquer ce paradoxe :
Ø d'une part, Pelagis explique dans son bilan de l'hiver 2024 « qu'en 2021 et 2022, les faibles niveaux d'échouages pouvaient être expliqués par des conditions météorologiques ne permettant pas l'échouage des carcasses en mer (vents dominants soufflant de la côte vers le large) (Peltier et al., 2024). [...] Il est donc probable que l'année 2023, à défaut d'être vraiment exceptionnelle, soit juste dans la continuité des événements observés depuis 2017, et plutôt que 2021 et 2022 soient atypiques en termes de conditions d'échouage. » A l'inverse, durant l'hiver 2024, « les échouages sont considérés, à l'échelle de l'hiver, comme étant représentatifs de l'ensemble des mortalités survenues en mer », en raison de la prévalence des vents soufflant vers la terre ;
Ø d'autre part, un nombre important de ces échouages a eu lieu à proximité directe du parallèle 48°N, près de la pointe de Penmarc'h, au nord duquel la fermeture de la pêche ne s'applique pas.
Source : observatoire Pelagis
2. Mais une mesure relativement indifférenciée, s'agissant de son périmètre, de sa période d'application et du champ des engins interdits
Davantage que l'efficacité des mesures de fermeture spatio-temporelles, c'est l'efficience de ces mesures qui a fait l'objet de contestations : si en effet la capacité de cette politique à atteindre l'objectif fixé de réduction des captures est avérée, la disproportion des moyens pour y parvenir a concentré l'essentiel des critiques.
La difficulté provient de ce qu'il n'existe pas de solution évidente pour réduire les captures accidentelles de dauphins communs, en attente de résultats plus probants sur les dispositifs d'éloignement acoustique (pingers). Une approche par le changement de taille de la maille des filets, comme cela a souvent été réalisé par le passé pour régler des problèmes de stocks halieutiques, n'est évidemment pas envisageable dans le cas des dauphins.
La DGampa souligne que « les cas d'études avec des résultats positifs sont ceux où a pu être développée une solution technique simple, peu onéreuse et n'affectant pas la rentabilité des opérations de pêche, comme dans le cas des Terres australes et antarctiques françaises (Taaf) avec les oiseaux, pour les dispositifs d'échappement des tortues, troubles envahissants du développement (TED), ou pour l'échappement des dauphins de surface dans les pêcheries thonières du Pacifique », et que « ces solutions ne sont pas toujours transférables », avec « peu de cas de succès dans le cas des mammifères marins emmêlés dans des filets ou des orins d'arts dormants ».
Les engins identifiés comme « à risque » étant nombreux en l'absence de connaissance plus fine sur les interactions pêche-cétacés, les mesures de fermeture spatio-temporelles ont finalement concerné une partie substantielle des métiers actifs dans le golfe :
Ø les filets maillants calés (code GNS) ;
Ø les filets trémails (code GTR) ;
Ø les combinaisons de filets trémails et de filets maillants calés (GTN) ;
Ø les chaluts pélagiques à panneaux (code OTM) et en boeuf (code PTM) ;
Ø les chaluts boeuf de fond (code PTB) ;
Ø la senne coulissante (code PS).
Ce périmètre large a induit certaines « victimes collatérales » (le comité des pêches ayant souligné que la pleine application des requêtes des associations aurait même conduit à immobiliser 90 % de la flotte).
Ainsi, il semblerait que l'interdiction de la senne coulissante, appelée localement la bolinche, ait été prise sur le fondement de données du CIEM portant essentiellement sur le Portugal, où certaines pratiques induisent davantage de captures. Or, de nombreux observateurs locaux ont expliqué que, si des captures peuvent se produire, elles seraient moins systématiquement létales (le filet coulissant pouvant être abaissé pour laisser passer les cétacés).
De même, les données géographiques manquent pour définir avec précision une zone de fermeture plus ciblée que de la pointe de Penmarc'h dans le Finistère jusqu'à Hendaye dans les Pyrénées-Atlantiques.
Cette interdiction a été prise sans étude d'impact socio-économique préalable et dans un délai extrêmement court. Hormis le cas des navires de moins de 8 mètres, la fermeture souffre de peu de dérogations depuis que le Conseil d'État a suspendu les principales. Or, le taux de dépendance moyen des navires à la zone « golfe de Gascogne » est très élevé, et a crû depuis 2012, comme le montre ce tableau d'Ifremer :
Autant d'éléments qui permettent d'affirmer que la mesure de fermeture spatio-temporelle est un outil relativement rudimentaire, dont l'efficacité se paie à un prix vraisemblablement disproportionné.
3. Un bilan coûts socio-économiques - avantages environnementaux qui n'a pas été établi ex ante pour les territoires concernés
Les activités de pêche jouent un rôle historiquement important dans l'aménagement du territoire à travers le développement économique des zones littorales. L'effet multiplicateur du secteur de la pêche pour les territoires, souvent résumé par un adage connaissant de légères variations selon l'organisme qui l'énonce - « un emploi en mer, à la pêche, génère environ trois emplois à terre » ( Comité national des pêches), « un emploi en mer sur un bateau représente quatre emplois sur la terre » ( mareyeurs de Charente-Maritime) -, n'est pas contesté dans son principe, ni véritablement dans ses ordres de grandeur.
Les richesses induites par la filière dans une acception large - de la pêche à la vente en détail - expliquent que les mesures de fermeture spatio-temporelles aient été accueillies avec inquiétude voire colère dans certains ports et leurs arrière-pays, émotions dont témoigne notamment l'intense couverture de la problématique par la presse quotidienne régionale.
Autre illustration de la forte sensibilité politique du sujet, une « coalition des départements » du Finistère, du Morbihan et de la Vendée s'est constituée à l'initiative du président du conseil départemental du Finistère Maël de Calan, entendu par la mission. Outre des prises de position médiatiques contre la fermeture totale résultant de la suspension partielle de l'arrêté du 23 octobre 2024, et en amont de celle-ci, ladite coalition informelle a présenté, en décembre 2024, un mémoire en intervention, afin de plaider pour le rejet d'un recours de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) devant le Conseil d'État49(*) s'associant ainsi au ministère de l'agriculture dans la défense de l'arrêté.
Dans ce mémoire en intervention, la coalition invoque comme « intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige » au soutien de la recevabilité de sa requête, que « la pêche dans le golfe de Gascogne et les activités économiques qui lui sont liées (celle des ports, des criées, du mareyage, de la logistique, du tourisme...) constituent des enjeux économiques et sociaux majeurs pour les départements limitrophes du golfe ».
Il est expliqué que les treize criées que comptent ces départements50(*) sont « toutes soutenues de façons diverses et complémentaires par les collectivités et notamment les départements », certaines appartenant même directement aux départements au travers d'un « syndicat mixte dont ils sont le financeur principal ».
Il est également rappelé dans le mémoire qu'« au-delà des emplois directs, des milliers d'emplois dans les services associés (construction, réparation navale, avitaillement, finances, assurances, commerces, etc.) sont dépendants de la pêche ». Il est enfin souligné que les emplois menacés dans les criées, le mareyage et la logistique sont « des emplois peu qualifiés, localisés dans des villes petites et moyennes dont la pêche constitue souvent la principale activité ».
Les indicateurs et méthodes pour quantifier le coût économique et social des mesures de fermeture spatio-temporelles de la pêche cités dans ce mémoire ne manquent pas (nombre d'emplois directs et indirects, volumes de vente et valeur de la commercialisation, nombre de ports et de bateaux concernés, dans l'absolu et en proportion à l'échelle nationale...).
S'il est difficile d'appréhender quels ont été les territoires les plus affectés par la fermeture de la pêche, les cartes suivantes en donnent une idée au travers de la répartition géographique du nombre et du type de navires restés à quai en fonction de leur quartier d'immatriculation ( Ifremer).
Source : Ifremer
Compte tenu de ces impacts potentiels, la coalition des départements a notamment proposé dans son mémoire de mobiliser la « théorie du bilan », raisonnement utilisé depuis 1971 en droit administratif français51(*), « mettant en balance les avantages du projet avec ses inconvénients, qu'il s'agisse de son coût, de ses répercussions sur l'environnement [...] ou de l'atteinte portée à d'autres intérêts publics » ( site du Conseil d'État). Dans le cadre de cette théorie, qui s'inspire du contrôle de proportionnalité et que certains ont proposé de mobiliser pour les projets d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes et d'aéroport entre Castres et Toulouse, il peut être jugé que « les inconvénients d'ordre social qu'[une mesure] comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ».
Il ne semble toutefois pas certain que cette théorie trouve effectivement à s'appliquer. Les dispositions du droit de l'UE sur le fondement desquelles les mesures de fermeture spatio-temporelles ont été prises ne semblent pas réellement laisser la possibilité de procéder à une analyse coûts-bénéfices, particulièrement pour les espèces strictement protégées, figurant à l'annexe IV de la directive Habitats.
C. AUX PERTES ÉCONOMIQUES PLUS OU MOINS BIEN COMPENSÉES LIÉES À LA BAISSE D'ACTIVITÉ, S'AJOUTENT DE NOMBREUX « COÛTS CACHÉS » DE LA FERMETURE
Le secteur de la pêche (1) a essuyé des pertes directes et le secteur de la transformation (mareyage) des pertes directes et indirectes (2), qui ont été relativement bien compensées pour les pêcheurs, et seulement partiellement pour les mareyeurs. Les services connexes (réparation navale, équipement, transport et logistique...) n'ont en revanche pas été dédommagés quand bien même ils ont subi une perte d'activité (3). À cela, s'ajoutent de nombreux « coûts cachés » assumés par la société, témoignant du caractère suboptimal de la mesure de fermeture spatio-temporelle (4).
1. Près de 300 bateaux à l'arrêt : en dépit d'un régime d'indemnisation à la hauteur, un désarroi compréhensible des pêcheurs
a) Des pertes d'activité et donc des pertes financières, mais relativement bien compensées
La fermeture en 2024 a affecté directement « 287 navires représentant 10 % de la population de navires français opérant en Atlantique Nord-Est pour 15 % des jours de pêche, 13 % des débarquements et 17 % de la valeur débarquée évaluée à 948 567 K€. Les 254 navires relevant de la région golfe de Gascogne représentaient 20 % de la population totale de navires relevant de cette même région golfe de Gascogne, 28 % des jours de pêche, 50 % des tonnages et 40 % de la valeur débarqués » (Ifremer). Par type de bateau concerné par les mesures de fermeture spatio-temporelles, la répartition de l'effort de pêche (en nombre de jours en mer, en volume et en valeur) était la suivante avant l'arrêt cétacé :
Ainsi, toujours selon le rapport d'impact économique d'Ifremer, la fermeture a engendré une perte estimée à 4 600 tonnes et 16 millions d'euros par rapport à la moyenne des années 2022-2023. Malgré ces pertes importantes, les résultats montrent une atténuation des déficits sur la période janvier-août comparée à janvier-mars. Si le déficit en tonnage demeure élevé (- 27 % par rapport à la moyenne 2022-2023), la perte en valeur est limitée (- 11 %) grâce à un effet prix positif (à hauteur de + 22 %).
FranceAgriMer a réalisé une étude pour analyser l'impact sur le prix de la fermeture sur les espèces les plus touchées par l'interdiction. À titre d'exemple significatif, entre 2023 et 2025, alors que la quantité de merlus pêchés a diminué de 45 % sur la période, le prix a connu une augmentation de 51 %.
Sur le plan social, les impacts sont tout aussi importants. Les pêcheurs subissent une perte d'activité qui fragilise leur emploi et réduit leur attractivité professionnelle. Dans le cadre du projet Delmoges, un vaste programme d'enquêtes et d'interviews a été réalisé fin 2024, directement dans les ports et auprès de différents acteurs. D'après les premiers résultats indiqués par Ifremer, la perception des effets sociaux et effets économiques est majoritairement négative - « pertes de marché, iniquité entre engins, perte d'attractivité de l'emploi ».
Les autorités nationales ont souhaité mettre en place des aides d'État visant à soutenir les pêcheurs touchés par ces fermetures temporaires d'activités de pêche. Ces aides ont été approuvées par la Commission européenne dans deux décisions : SA.111687 pour la fermeture de 2024 et plus récemment SA.116934 pour la fermeture de 2025.
En 2025, une enveloppe totale de 20 millions d'euros a été allouée pour indemniser les pêcheurs et mareyeurs, à une moindre mesure, affectés par cette fermeture. Les taux d'indemnisation restent identiques à ceux de l'année précédente :
• 80 % du chiffre d'affaires pour les chalutiers ;
• 85 % pour les fileyeurs et senneurs.
Les pêcheurs peuvent choisir comme référence une période mensuelle ou trimestrielle pour calculer leur indemnisation. Afin d'accélérer les paiements et éviter les délais prolongés liés au fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (Feampa), FranceAgriMer a ouvert une plateforme d'indemnisation pour l'arrêt temporaire des activités de pêche en application de l'arrêté du 24 octobre 2023, avec une intensité maximale de l'aide de 100 %. La reconduction du mécanisme d'indemnisation n'était pas assurée pour 2025, et une incertitude plane toujours pour l'année prochaine.
Par rapport à la moyenne des valeurs débarquées des années 2022-2023, la fermeture spatio-temporelle de la pêche en 2024 a entraîné une perte estimée à 12,890 M€ sur la période janvier-fin août. Cependant, les compensations spécifiques aux arrêts temporaires (AT CTC 2024), totalisant 16,352 M€, ont permis de couvrir ces pertes et de générer un surplus d'environ 3,462 M€. Néanmoins des différences importantes de compensations reçues, entre les flottilles mais également au sein de chaque flottille sont constatées.
Les indemnisations par types de navires
Les compensations spécifiques aux arrêts temporaires (AT CTC 2024) montrent une forte hétérogénéité entre flottilles selon Ifremer :
• les fileyeurs de 24-40 mètres ont reçu l'aide moyenne la plus élevée - 163 k€ par navire, soit un total de 3,744 millions d'euros ;
• les fileyeurs plus petits, 18-24 m, 12-18 m et 10-12 m ont obtenu des montants globaux similaires - environ 3 millions d'euros chacun - mais avec des aides moyennes très différentes en raison des écarts dans leurs chiffres d'affaires ;
• les filets de 8-10 mètres, bien que nombreux, n'ont reçu qu'un montant total modeste - 1 million d'euros, soit une moyenne de 12 k€ par navire.
Ces disparités s'expliquent par l'hétérogénéité des antériorités de chiffre d'affaires sur les périodes éligibles au calcul des aides.
b) Un préjudice moral important subi par les pêcheurs
Se sentant pointés du doigt et même stigmatisés par des campagnes de communication accusatrices, les pêcheurs ont parfois le sentiment que c'est tout bonnement « la fin de toute activité de pêche » que souhaiteraient certaines associations de protection de la nature, peu de techniques de pêche échappant en réalité aux critiques liées à leur impact sur les milieux naturels. En dépit des indemnisations, les pêcheurs subissent un préjudice moral important.
S'agissant du seul contentieux sur les cétacés, le comité national des pêches a estimé en audition que les requêtes des associations dans le cadre du contentieux sur les cétacés auraient conduit à arrêter 90 % de la flotte pendant quatre mois.
Au-delà de ce cas spécifique, la combinaison des demandes d'interdiction emporterait de fortes limitations pour le secteur. À titre d'exemple, si la senne pélagique est concernée par les fermetures « cétacés », l'ensemble des « arts traînants » sont visés pour leur impact sur les fonds marins dans les aires marines protégées52(*) et même au-delà. S'agissant des deux techniques de senne, la senne pélagique - sans impact a priori sur les fonds marins - serait donc interdite une partie de l'année tandis que la senne danoise (un art traînant) - sans impact significatif sur les captures accidentelles de petits cétacés - le serait dans 33 % des eaux françaises.
2. Premier signe de reconnaissance pour ce secteur charnière, le mareyage n'a cependant été que partiellement indemnisé
Les mareyeurs, maillon essentiel de la filière pêche avec plus de trois cents entreprises en France, incarnent parfaitement les « oubliés » des impacts économiques de la fermeture du golfe de Gascogne. Leur activité repose sur des volumes élevés pour amortir leurs charges fixes, notamment les coûts liés aux ateliers de transformation et aux coûts de la matière première. En 2023, 23 % des entreprises de mareyage étaient déjà déficitaires selon l'Union du mareyage français (UMF), et cette fragilité s'est accentuée depuis les fermetures.
Pendant la période de fermeture en 2024, les mareyeurs ont enregistré selon l'UMF une perte moyenne de 53 % du volume traité par rapport à l'année précédente. Cette chute des volumes a entraîné une baisse significative de leur chiffre d'affaires, tandis que la hausse des prix sur la période de 10 à 15 % n'a pas suffi à compenser ces pertes.
Du fait de l'accumulation de difficultés pour la filière (plan d'accompagnement individuel post-Brexit notamment), auxquelles s'est ajoutée la fermeture de la pêche en 2024-26, certaines entreprises ont fermé définitivement leurs portes, comme cinq en Bretagne en 2024 et une autre en 2025 sur les 80 entreprises bretonnes de mareyage, tandis que d'autres se retrouvent en redressement judiciaire. À la fin de l'année 2025, il est estimé par l'UMF qu'une dizaine d'entreprises supplémentaires pourraient disparaître, soit plus de 10 % du total.
Selon l'Association bretonne des acheteurs de produits de la pêche (Abapp), au-delà des impacts immédiats, la fermeture a des conséquences durables sur les relations commerciales des mareyeurs. En France, les clients comprennent généralement ces interruptions temporaires et reviennent après la reprise de l'activité. Cependant, pour les clients étrangers, la situation est bien différente : ces derniers se tournent vers d'autres fournisseurs, notamment danois et norvégiens, pendant la période de fermeture. Cette perte de crédibilité entraîne une baisse durable des exportations, qui représentent entre 15 et 20 % de l'activité des mareyeurs. Pour reconquérir ces marchés perdus, les entreprises sont souvent contraintes de réduire leurs prix, ce qui limite leurs marges durant plusieurs mois après la réouverture.
Deux exemples d'entreprises de marée sur le port de Lorient-Keroman
L'entreprise Marée Coëffic, située à Lorient incarne les difficultés du secteur. Spécialisée dans le petit pélagique (sardine, maquereau et anchois), cette entreprise a vu sa production chuter de 20 % en raison des fermetures successives en 2024 et 2025. Sur les 25 bateaux qui composent sa flotte habituelle, seuls cinq sont restés en exploitation durant la fermeture, ce qui a entraîné une perte de 30 % de son activité pendant cette période. L'entreprise indique également que les pertes durant la fermeture n'ont pas été récupérées le reste de l'année.
Plus diversifiée, l'entreprise Sogelmer, filiale du groupe d'envergure européenne Ocealliance, a pu adapter son activité de plusieurs manières. D'abord, elle a pu privilégier la transformation d'autres espèces de poissons, non pêchées à l'aide des engins interdits. Ensuite, elle a pu procéder à des transferts d'employés d'un site de production à l'autre, quand la proximité au moins relative le permettait. Elle a tout de même dû recourir au chômage partiel la première année, qu'elle a regretté ne pouvoir utiliser la deuxième année de fermeture, tout en expliquant ne pouvoir compter que sur ce seul dispositif, qui peut mettre en difficulté leurs salariés et créer un déficit d'attractivité.
Le modèle économique des mareyeurs repose sur leur capacité à transformer rapidement le poisson débarqué pour répondre aux exigences du marché. Cela inclut le tri par taille et origine ainsi que le calibrage selon les besoins des consommateurs. Cependant, augmenter le niveau de transformation n'est pas toujours une solution viable : cela nécessiterait davantage de main-d'oeuvre dans un contexte où les charges salariales sont déjà élevées. De plus, le secteur peine à attirer des travailleurs qualifiés en raison d'un manque d'attractivité et d'une instabilité croissante liée aux fermetures répétées. Il faut environ un an pour former un salarié capable de maîtriser la qualité de coupe et la connaissance du poisson.
En outre, le secteur est fortement dépendant des criées locales pour ses approvisionnements. Dans ce sens, pendant la fermeture du golfe de Gascogne, l'UMF a constaté que les acheteurs se seraient finalement peu détournés vers d'autres sources d'approvisionnement, estimant la situation temporaire, bien que les prix aient augmenté dans les autres criées françaises. Seules les grandes entreprises ont pu recourir la première année à des importations pour pallier le manque, représentant environ une entreprise sur quatre en 2025. FranceAgriMer semble confirmer ce phénomène dans ses études, en s'appuyant sur les données des douanes, en 2024 : les importations auraient augmenté de 5 % en volume sur la période de fermeture par rapport à 2023.
Le régime d'indemnisation du mareyage
Depuis la première fermeture du golfe de Gascogne, les mareyeurs ont bénéficié d'un système d'indemnisation spécifique, moins avantageux que celui élaboré pour les pêcheurs. Alors que les aides reposent sur le chiffre d'affaires pour les navires, ce mécanisme d'indemnisation, souhaité par les mareyeurs, est calculé à partir des pertes d'excédent brut d'exploitation (EBE), un critère moins avantageux que le chiffre d'affaires.
« Le dispositif vise à mettre en place, pour les entreprises de mareyage affectées par la baisse des volumes débarqués, une compensation du préjudice constaté sous la forme d'une indemnisation d'une partie des pertes d'excédent brut d'exploitation (EBE). »
« L'aide représente une prise en charge à hauteur de 75 % des pertes d'EBE, au-delà d'une franchise de 5 % de perte d'EBE53(*) subie par l'entreprise au premier trimestre 2024 par rapport à la moyenne d'EBE du premier trimestre des années 2021, 2022 et 2023. 54(*) »
La Commission européenne a autorisé deux aides d'État destinées aux entreprises de mareyage touchées par les fermetures de 2024 et 2025 - décision SA. 111922 et décision SA. 117604 (pas encore publiée). Ces aides d'État sont approuvées en utilisant la section 3.6 « Aide de trésorerie aux pêcheurs » des lignes directrices par dérogation, aucune section des lignes directrices n'étant directement applicable aux entreprises de mareyage.
En raison d'une sous-consommation des aides la première année (inférieure à 50 %), le régime d'aide spécifique au mareyage de 4 M€ la première année n'a pas été reconduit la deuxième année, mais a été intégré dans une enveloppe globale de 20 M€ commune à la pêche et au mareyage, inférieure de 2 M€, donc, par rapport à la première année (18 + 4 M€).
Recommandation n° 2 : maintenir en 2026 le taux d'indemnisation de 80 à 85 % du chiffre d'affaires pour les pêcheurs et négocier avec la Commission européenne le rebasculement du dispositif d'aide au mareyage sur le chiffre d'affaires plutôt que sur l'excédent brut d'exploitation.
En complément et à plus long terme, les rapporteurs invitent à accompagner le secteur du mareyage, au besoin par des aides publiques, dans sa démarche de mutualisation des risques économiques (réplique du fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux, intégration à la déduction pour épargne de précaution...).
3. Les autres maillons de la filière pêche, au sens large, n'ont pas été indemnisés
Si les mesures de fermeture spatio-temporelles ne concernent au premier abord que la pêche, c'est en réalité toute une filière55(*) et un écosystème de services qui ont été affectés, entre ports et criées (a), coopération maritime et réparation navale (b) et transport frigorifié (c).
a) Structures économiques déjà fragiles, les ports et criées du golfe de Gascogne ont été affectés par des baisses de volume
Les criées ou halles à marée occupent une place essentielle dans la filière pêche, et sont le lieu de mise en relation entre les pêcheurs et les acteurs en aval, tels que les mareyeurs et les transporteurs. Ouvertes tous les jours, elles permettent la mise aux enchères des produits de la mer (« vente à la criée »), sauf le dimanche, tout en offrant des services connexes indispensables, comme le stockage frigorifique (salles maintenues entre 0 et 2 degrés toute l'année pour garantir aux pêcheurs la possibilité de débarquer à tout moment).
Toute diminution des apports, comme celle engendrée par la fermeture du golfe de Gascogne, a un impact direct sur leur viabilité financière.
Comme pour les pêcheurs, les salariés des criées peuvent avoir été contraints de prendre des congés forcés à des périodes inadaptées ou voir leurs postes menacés par la baisse d'activité.
Cette instabilité sociale s'ajoute aux défis structurels auxquels font face les criées : elles doivent investir massivement pour moderniser leurs infrastructures dans un contexte économique fragilisé. À Lorient, d'importants travaux sont prévus sur une période de 10 à 15 ans pour rénover les bâtiments portuaires ; toutefois, ces projets sont compromis par l'impact soudain et prolongé des fermetures.
Les ports du golfe ont vu leurs recettes diminuer non seulement à cause de l'immobilisation des bateaux français, mais aussi en raison de l'absence des navires étrangers qui ne s'arrêtent plus dans ses installations pendant la fermeture. Ces navires, habituellement obligés de faire escale dans le port, représentent une source importante de revenus. En chiffres, la criée de Lorient a perdu environ 3 500 tonnes de poissons par an au cours des dernières années en raison de divers facteurs, dont les fermetures successives. Sur une décennie, cette perte cumulée atteint 10 000 tonnes.
Les pertes d'activités - tonnage et
chiffre d'affaires - pendant la périodede fermeture
de la pêche
pour les ports vendéens
2024 vs 2023
Les Sables-d'Olonne : - 427 tonnes soit - 57 %, - 2 537 M€ soit - 57 %
L'Herbaudière : - 169 tonnes soit - 63 %, - 1 029 M€ soit - 63 %
2025 vs 2023
Les Sables-d'Olonne : - 452 tonnes soit - 60 %, - 2 572 M€ soit - 50 %
L'Herbaudière : - 220 tonnes soit - 82 %, - 1 426 M€ soit - 70 %
Lors de la fermeture en 2024, certaines criées avaient pu bénéficier de mesures d'indemnisation, notamment via le recours au chômage partiel pour leurs salariés, grâce à des démarches auprès des services déconcentrés de l'État.
Cependant, cet accompagnement n'a concerné que les criées gérées par des Chambres de commerce et d'industrie (CCI), excluant d'autres structures portuaires administrées par des sociétés d'économie mixte (SEM), société anonyme d'économie mixte locale (SAEML), société publique locale (SPL), communes ou syndicats mixtes. Cette disparité avait déjà mis en lumière une inégalité dans le traitement des acteurs du secteur.
En 2025, la situation s'est encore aggravée : aucune mesure d'indemnisation n'a été reconduite pour les criées et ports du golfe de Gascogne. Ces structures, pourtant centrales dans la filière pêche et déjà fragilisées par la baisse des volumes et des recettes, se retrouvent totalement exclues des dispositifs d'aide. Selon la direction générale du Travail, l'imprévisibilité de la fermeture n'était pas établie en 2025.
Recommandation n° 3 : garantir en 2026 l'accès au chômage partiel pour les criées et les ports, y compris lorsqu'ils ne sont pas gérés par des chambres de commerce et d'industrie.
b) Ayant pour clients prépondérants les pêcheurs, la coopération maritime et la réparation navale ont enregistré des pertes en grande partie irrécupérables
Le secteur de la réparation navale a été l'un des grands oubliés des régimes d'indemnisation. Partie intégrante de cette filière, la flotte française se caractérise par son ancienneté, avec des navires affichant un âge moyen élevé, comme au port de Lorient où les bateaux de pêche ont en moyenne 35 ans. Cette vétusté rend les travaux de maintenance, réalisés annuellement, indispensables.
Ø Refaire la peinture d'un bateau de 12 m représente un coût de 50 000 € pour un armateur.
Du fait des règles européennes sur les aides d'État, il n'a pas été possible la première année d'effectuer des travaux sur les navires à l'arrêt et indemnisés, au motif que cela constituerait sinon un double avantage pour les armateurs concernés (seule la compensation des sorties en mer donnant lieu à indemnisation). Une période normale de maintenance ne peut être indemnisée.
Dans le régime d'aide notifié à la Commission européenne (DG Concurrence) pour la fermeture de 2025, les navires engagés dans un processus d'équipement en caméras embarquées ont pu effectuer de légers travaux à quai pendant la fermeture sans perdre leur éligibilité aux aides en 2025
La question de cette inclusion, sans mise à sec des navires, a été âprement discutée et cette inclusion a été obtenue dans les derniers instants de la négociation avec la Commission, ce qui est à mettre au crédit de la DGampa.
Recommandation n° 4 : maintenir voire étendre dans le cadre du prochain régime d'aide notifié à la Commission européenne, la possibilité de réaliser des travaux pendant la période de fermeture spatio-temporelle.
Les coopératives maritimes sont d'autres acteurs jouant un rôle-clé dans l'organisation de l'amont, fournissant aux pêcheurs des équipements indispensables à leurs activités, tels que câbles, filets et pièces techniques. Ces structures non lucratives fonctionnent sur un modèle solidaire et réalisent des bénéfices très limités. Les coopératives maritimes jouent donc un rôle central dans la structuration de l'amont.
Déjà fortement fragilisées par les pertes d'activité cumulées liées aux arrêts Covid, au plan de sortie de flotte voire aux arrêts « sole », les coopératives maritimes ont été particulièrement vulnérables à ces nouvelles mesures spatio-temporelles.
Cependant, ces structures ne sont pas comprises dans les systèmes d'indemnisations, ce qui aggrave leur situation économique et menace leur capacité à soutenir efficacement les pêcheurs.
La « double peine » subie par la Coopérative maritime des pêcheurs et ostréiculteurs (CMPO) de Lorient-Auray
Visitée par les rapporteurs dans le cadre de leur déplacement à Lorient, la Coopérative maritime des pêcheurs et ostréiculteurs (CMPO) de Lorient-Auray, fondée en 1917, est un concentré des difficultés rencontrées par ces structures puisqu'elle subit une « double peine » liée à sa double fonction :
- de fourniture d'équipements (filets en lien avec son activité de ramendage, accastillage...) aux pêcheurs locaux ;
- de desserte d'autres coopératives sur le territoire national, notamment sur la façade atlantique, via ses deux filiales (Tecnorope, spécialisée dans les câbles et filets, et Lorient Bretagne distribution). Seules deux autres coopératives jouent un même rôle en France.
La coopérative a enregistré une perte de 900 000 € de chiffre d'affaires en cumulant les exercices 2024 et 2025, pour une baisse de marge brute d'environ 250 000 € sur les deux phases de fermeture. Ces pertes économiques ont contraint la coopérative à réduire son personnel : en 2023, elle comptait encore 85 salariés, mais elle prévoit désormais la suppression d'un sixième poste.
Pour compenser ces pertes, la coopérative cherche à diversifier ses marchés. En 2024, sept millions d'euros des vingt millions d'euros de chiffre d'affaires annuel ont été réalisés grâce aux ventes au grand public. Cependant, le nombre de coopérateurs est en baisse, certaines se tournant vers d'autres secteurs comme le fluvial ou l'agriculture.
La CMPO a aujourd'hui comme principale revendication la prise en charge de la marge brute sur la période de fermeture permettant, selon elle, de supporter une partie des charges fixes.
c) Une baisse de rentabilité pour le transport de produits de la mer, segment aux contraintes logistiques fortes
Le secteur du transport frigorifique occupe une place aussi méconnue du grand public que stratégique pour la filière pêche, assurant la livraison rapide et fiable de poisson frais tant en France qu'à l'étranger. La fraîcheur est le critère principal pour les acheteurs, qui se partagent entre grande distribution, poissonneries et parfois restaurateurs haut de gamme. Cette activité repose sur l'importance des volumes pour amortir des coûts logistiques fixes et ainsi maintenir une certaine rentabilité.
Les transporteurs de produits de la mer garantissent des délais d'une précision devenue extrême - certains contrats garantissent une livraison au quart d'heure près d'un bout à l'autre de la France - tout en respectant les contraintes spécifiques à la conservation du poisson, notamment une température de stockage entre 0 et 2 degrés, ce qui limite leur capacité à diversifier leurs activités en les transportant avec d'autres produits alimentaires.
Or, la fermeture spatio-temporelle de la pêche dans le golfe de Gascogne a entraîné une diminution annuelle des volumes de 500 tonnes dans les criées de la région. Cette baisse significative a directement impacté les transporteurs, contraints de réduire leur activité. En conséquence, seule la moitié des camions ont pu continuer à fonctionner, ce qui a limité leur couverture géographique à une partie du territoire français. Par ailleurs, ces transporteurs ont dû maintenir un service minimum pour livrer le poisson provenant des bateaux non concernés par la fermeture. Cela a entraîné une augmentation des charges fixes, en raison de la faible capacité à amortir les coûts logistiques sur des volumes réduits, compromettant ainsi leur rentabilité.
Cette situation met en péril le modèle économique des transporteurs basé sur des flux constants et élevés. L'instabilité croissante de la filière inquiète particulièrement les transporteurs spécialisés comme Olano. Selon l'Association bretonne des acheteurs de produits de la pêche, il existe un risque réel que les gros transporteurs, tels que STEF (1 000 salariés sur les produits de la mer) ou Olano (800 salariés), quittent ce secteur désormais exposé à une grande instabilité. Une telle désertion aurait des conséquences systémiques : sans transporteurs spécialisés capables de garantir des délais stricts et des conditions optimales de conservation, l'ensemble de la chaîne logistique serait fragilisé.
Recommandation n° 5 : inviter le secteur du transport frigorifique, dans le cadre d'un accord temporaire, à assouplir ses délais de livraison tout en maintenant la qualité et la fraîcheur des produits, et à explorer la possibilité de mutualiser le transport des produits de la mer et celui d'autres produits agroalimentaires.
4. Au-delà des indemnisations, de nombreux « coûts cachés » de la fermeture de la pêche sont assumés par la société
La simple existence de régimes d'indemnisation ne suffit bien évidemment pas à effacer l'aléa juridique et le coût des arrêts « cétacés » pour la filière pêche : le risque réputationnel vis-à-vis des consommateurs, la désolidarisation des différents maillons de la filière et le déclin de l'attractivité des métiers dans un contexte de besoin de renouvellement des générations sont autant de « coûts cachés » qui n'ont pu que difficilement être pris en compte dans des aides publiques.
Il convient en outre de souligner que la société a assumé une double dépense en lien avec ces mesures de fermeture spatio-temporelles : pertes d'activités économiques créatrices de richesse d'une part, et coût de l'indemnisation pour les finances publiques d'autre part. C'est du reste sans compter sur les ressources administratives qu'il a fallu consacrer à la mise en place des régimes d'indemnisation. De plus, les aides publiques créent nécessairement des effets de bord ou des effets d'aubaine, compte tenu de critères d'éligibilité ne pouvant tenir parfaitement compte de toutes les situations.
En outre, Ifremer56(*) souligne une augmentation significative des prix résultant des fermetures spatio-temporelles, destinée à compenser le déficit de tonnage. Ainsi, sur la période de janvier à août 2024, les prix ont enregistré une hausse de 22 % par rapport à la même période en 2023. Cette inflation pèse directement sur les consommateurs français, qui subissent les répercussions économiques de ces mesures. Par exemple, selon FranceAgriMer, la pêche au merlu a enregistré une baisse de 40 % durant la période de fermeture entre 2023 et 2024, entraînant une flambée des prix de cette espèce, avec une augmentation de 51 % sur la même période.
Les ménages français ont
diminué leur achat de poisson frais ciblés
sur la
période de fermeture en 2024
Lors de la fermeture du golfe de Gascogne en 2024, la consommation de poisson frais par les ménages français a été affectée. Selon FranceAgriMer, les achats de certaines espèces impactées par la fermeture ont connu une baisse significative :
• merlu frais : diminution de 35 % en février 2024 par rapport à février 2023 ;
• sole fraîche : baisse de 43 % en février 2024 par rapport à février 2023.
Enfin, il ne faudrait pas négliger qu'en termes de « coût d'opportunité », c'est-à-dire ce qui aurait pu être financé si les sommes correspondantes n'avaient pas été immobilisées par les indemnisations. Ces dernières ont empêché le financement d'autres projets, en premier lieu des recherches scientifiques sur cette même question, comme le rappellent les journalistes Erwan Seznec et Géraldine Woessner57(*).
III. COMMENT CRÉER LES CONDITIONS D'UNE RÉOUVERTURE DE LA PÊCHE COMPATIBLE AVEC LE MAINTIEN DE L'ÉTAT DE CONSERVATION FAVORABLE DES PETITS CÉTACÉS
A. L'ÉPINEUSE GESTION DE L'APRÈS- 2026
Si la volonté politique ne manque pas pour rouvrir la pêche après 2026 (1), la question qui se pose est davantage celle de la possibilité juridique de le faire et l'état de l'opinion au sujet de cette perspective (2).
1. Une ambition politique partagée de réouverture de la pêche dans le golfe de Gascogne... après 2026
a) Un devoir de vérité sur le caractère inéluctable de la fermeture en 2026
Au cours de leurs échanges avec les différentes parties prenantes, et en particulier avec les pêcheurs, les rapporteurs ont souhaité se livrer à un exercice de vérité, en rappelant que les espoirs d'une possible réouverture de la pêche pour l'année 2026, faisant l'objet de rumeurs sur les quais de certains ports, n'étaient malheureusement pas fondés. Si les doutes étaient permis tant que la suspension de certaines dérogations de l'arrêté ne reposait que sur une ordonnance de référé (22 décembre 2023), la décision « au fond » a été rendue par le Conseil d'État le 30 décembre 2024, pour les trois années 2024, 2025 et 2026, et ne laisse plus de place aux spéculations.
Par conséquent, les rapporteurs jugent que les efforts de la profession et de l'administration devraient en premier lieu être tournés vers la préparation de la fermeture spatio-temporelle de 2026, pour qu'elle se déroule dans les meilleures conditions, en tenant compte des retours d'expérience des deux années passées. Toute autre posture serait une perte de temps et d'énergie et ne pourrait qu'apporter frustration et désillusions.
Il importe ainsi de définir, bien avant le 20 janvier 2025, le cadre applicable en matière d'indemnisations (traitement des cas particuliers notamment) et en matière de déclarations de captures, ces éléments étant parvenus tardivement aux professionnels non seulement la première année, ce qui est compréhensible, mais également la deuxième année de fermeture, ce qui l'est moins.
Recommandation n° 1 : assumer un devoir de vérité et préparer dès à présent et activement la fermeture spatio temporelle de 2026, en définissant le plus en amont possible les modalités d'indemnisation et en anticipant les cas particuliers.
b) Un objectif politiquement largement partagé de réouverture au-delà de cette date
De bords politiques différents (groupes Les Républicains (LR), Union Centriste et Rassemblement Démocratique et Social Européen (RDSE), les rapporteurs soutiennent, sans aucune équivoque, pour après 2026, la réouverture de la pêche dans des conditions qui permettent un maintien de l'état de conservation favorable du dauphin commun.
La mission a d'ailleurs pu constater lors de son déplacement sur le terrain, à Lorient puis à La Turballe et au Croisic, qu'un fort consensus politique existait localement quant à la volonté de rouvrir la pêche aux navires disposant d'engins concernés par les mesures spatio-temporelles, après 2026.
À l'occasion de ce déplacement, qui a bénéficié d'une importante couverture par la presse locale, les rapporteurs ont ressenti un décalage entre le traitement du sujet par la presse nationale, focalisé à leurs yeux avant tout sur la préservation du dauphin, et sa couverture par la presse quotidienne régionale, davantage préoccupée par le sort des pêcheurs privés de leur activité pendant un mois.
À dire vrai, l'ambition d'une très large partie des acteurs entendus par la mission reste une réouverture de la pêche dans le golfe de Gascogne en 2027, sauf pour les associations de protection de la nature, dont la position oscille d'un soutien conditionnel à la réouverture à une préférence pour la fermeture58(*). Les scientifiques, eux, réservent leur jugement, considérant que leur rôle n'est « pas d'émettre une opinion » sur cette question.
Le Gouvernement l'a du reste clairement énoncé, ainsi que l'a rappelé la ministre chargée de la pêche Agnès Pannier-Runacher : l'objectif est de « nous donner les moyens collectivement de rouvrir le golfe de Gascogne à la pêche dès 2027 ». Les rapporteurs ne peuvent que saluer cette ambition.
Recommandation n° 6 : maintenir sans ambiguïté l'objectif, pour après 2026, d'une réouverture de la pêche dans des conditions permettant un maintien de l'état de conservation favorable du dauphin commun.
2. Pourrait-on vraiment se passer de toute mesure de fermeture spatio-temporelle après 2026 ?
a) Au regard des données scientifiques et du droit existant, la voie est étroite
Si la fermeture de la pêche en 2026 est une question malheureusement réglée d'un point de vue juridique, la question reste encore ouverte au-delà de cette date. Juridiquement, l'arrêté du 24 octobre 2023, et la décision du Conseil d'État, cesseront de s'appliquer après cette date.
Pour parer au pire, il convient tout d'abord de rappeler qu'au regard du droit et des données existants, un durcissement des mesures de fermeture spatio-temporelles ne peut être entièrement exclu. Pour mémoire, la requête des associations de protection de la nature portait initialement sur une fermeture de la pêche de quatre mois (trois mois en hiver et un mois en été).
Comme l'avait jugé le Conseil d'État dans sa décision du 20 mars 2023, « dans son nouvel avis du 24 janvier 2023, le Ciem réaffirme l'urgence de renforcer la protection des petits cétacés ainsi que, pour y parvenir, l'insuffisance des seuls dispositifs de dissuasion acoustique et la nécessité de les combiner avec des fermetures spatio-temporelles, sur plusieurs semaines chaque année et pendant au moins cinq années ».L'évaluation par le Ciem de 15 scenarii de mesures d'atténuation ne permet pas d'écarter cette crainte, loin s'en faut.
Le scénario actuel (4 semaines de fermeture et équipement des chaluts en pingers) semble proche des scenarii G (pingers sur les chaluts toute l'année et fermeture de six mois sur tous les autres métiers) ou H (6 semaines de fermeture sur tous les métiers et pingers sur les chaluts toute l'année), qui seraient compatibles avec le maintien du dauphin commun dans un état de conservation favorable selon une seule méthode d'estimation (celle des « observateurs en mer » en gris dans le tableau ci-dessous, mais pas celle des « échouages », en jaune).
Le risque doit donc être envisagé sans tabou et mesuré avec soin - une étude préalable de son impact économique et social devrait en particulier être réalisée -, les rapporteurs craignant en particulier le retour d'un cycle « arrêté avec dérogations fragiles - recours d'associations - fermeture élargie » qui verrait la justice décider de nouveau du cadre applicable. Comme pour la fermeture 2024-2026, cela ferait perdre le bénéfice de l'anticipation pour les pêcheurs et la filière.
En l'état actuel des connaissances, d'après la contribution conjointe des scientifiques d'Ifremer et de Pelagis, une réouverture est loin d'être évidente « si aucune mesure autre que technologique n'est mise en place », situation qui correspondrait au scénario K (cf. supra, partie I.C.1, sur la décision du Conseil d'État).
En fait, seuls 6 scenarii sur 1559(*) permettent de respecter le prélèvement biologique potentiel (PBR), dont 1 seul sans aucune fermeture spatio-temporelle, dans une seule des deux méthodes d'estimation des captures (méthode des « observateurs en mer »). Ce n'est le cas d'aucun scénario dans l'autre méthode (méthode des « échouages »).
Source : Ciem
Deux éléments de contexte importants permettent toutefois d'interpréter cet avis sous un jour potentiellement plus clément :
Ø il convient tout d'abord de noter que tous ces scenarii prédisent des résultats en termes de captures pour la sous-zone VIII et la division IX.a, mais reposent sur l'application de mesures d'atténuation dans le seul golfe de Gascogne (sous-zone VIII) - ce qui pose donc la question de la bonne coopération avec l'Espagne, sans laquelle les résultats prédits ne pourraient être atteints. On peut cependant déduire qu'une régionalisation des mesures d'atténuation incluant le Portugal (division IX.a) pourrait produire de meilleurs résultats (cf. partie III.D.a. ci-dessous) ;
Ø par ailleurs, il convient de noter que le Ciem ne prend pas en compte certains résultats sur l'efficacité des pingers qui étaient en cours d'obtention au moment de l'avis, et que par ailleurs aucun scénario du Ciem n'inclut l'équipement de fileyeurs en pingers, tel que la France est en train de le déployer.
b) Les pêcheurs doivent continuer à témoigner de leurs meilleurs efforts pour ne pas perdre la « bataille de l'opinion »
Marqué par la forte conflictualité autour du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui s'est soldée par l'abandon de ce dernier, le rapporteur de la Loire-Atlantique Philippe Grosvalet, a souhaité insister tout au long des travaux sur le fait qu'au-delà de ce qu'il est permis de faire en droit, la viabilité d'activités économiques dépend désormais, et dépendra de plus en plus, de leur acceptabilité sociale et de leur image.
La liste rouge des chalutiers et le pouvoir des images
La pêche au chalut de fond a concentré de nombreuses critiques d'associations de protection de la nature ces dernières années. La mission s'est trouvée, à Lorient ainsi qu'à La Turballe et au Croisic, en plein milieu d'une polémique ayant éclaté autour de la publication par l'association Bloom d'une « liste rouge des navires destructeurs », à l'appui d'une campagne de communication invitant les enseignes de la grande distribution à cesser de collaborer avec plus de 4 500 chalutiers qui auraient pêché dans les aires marines protégées en 2024 - une pratique pourtant légale à ce jour.
La publication de cette liste, en raison de certaines inexactitudes et, plus largement, des allégations de Bloom quant au fait que « des décennies de pêche acharnée ont vidé l'océan », a suscité un vif émoi sur les quais et chez les élus.
Les rapporteurs pensent que la pêche au chalut est davantage visée que la pêche au filet car il existerait plus d'images dans le premier cas que dans le second. Ils sont persuadés que la simple diffusion de photographies des navires ciblés dans cette liste montrerait l'écart entre la qualification de pêche « industrielle » voire « destructrice » et ce que le grand public juge acceptable.
Cet exemple, comme celui des captures accidentelles de cétacés, pose la question de la capacité de la filière à ne pas se refermer sur elle-même pour rester audible et à « gagner la bataille de l'opinion » face au discours d'associations de protection de la nature pouvant rencontrer un fort écho dans la population et notamment dans ses franges les plus jeunes (jusqu'à 40 ans).
Les rapporteurs appellent donc les professionnels à convertir un légitime désarroi en initiatives positives et à saisir toutes les occasions pour se montrer proactifs dans la communication sur la réalité de leur activité. Cette communication pourrait notamment porter sur les évolutions passées des pratiques, et sur la comparaison de ces pratiques avec celles observées pour les navires battant pavillon étranger.
Par ailleurs, par leur fine connaissance des milieux marins, les pêcheurs ne manquent pas d'atouts pour participer à des programmes scientifiques, alors que la France s'apprête à accueillir la troisième Conférence des Nations unies sur l'océan (Unoc), à Nice, en juin 2025.
B. RENOUER LE LIEN DE CONFIANCE ENTRE SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELS, DANS LEUR INTÉRÊT RÉCIPROQUE
Pour surmonter la « rupture de confiance » constatée entre scientifiques et professionnels de la pêche, les rapporteurs préconisent de généraliser l'équipement en caméras pour objectiver le débat (1), ainsi que la poursuite de l'acquisition et de la diffusion de connaissances dans le cadre du projet Delmoges et d'un institut technique de la pêche (2).
1. Les déclarations et les caméras embarquées, un « mal » pour les pêcheurs, mais « nécessaire » pour que les scientifiques leur fournissent des données plus fines
Le débat le plus vif au cours des travaux de la mission a certainement porté sur l'opportunité ou non d'embarquer davantage de caméras à bord des navires, afin de recueillir des informations plus précises sur les conditions dans lesquelles les captures accidentelles surviennent (heure et lieu de l'évènement, type d'engin de pêche et partie du filet impliqués...).
a) Un déploiement obligatoire pour certains navires
Mises en place dans le cadre de projets pilotés par l'Office français de la biodiversité (OFB), ces caméras ont d'abord fait l'objet de tests de faisabilité technique sur cinq navires puis d'une expérimentation sur vingt fileyeurs (projet OBSCAMe60(*), 2021-23). L'ensemble des scientifiques entendus par la mission ont souligné les premiers progrès dans la connaissance permis par ces équipements, malgré un échantillon initialement très réduit (cf. ce rapport d'étape de l'OFB, sur la période janvier 2021-avril 2024).
Un élargissement de la flottille concernée via l'équipement de quarante-quatre fileyeurs et bientôt de chalutiers est en cours, avec un objectif en vue de cent fileyeurs et de quinze chalutiers (projet OBSCAMe+, 2024-2026), pour conformer la pêche française à l' arrêté du 13 décembre 2024, qui rend obligatoire l'équipement en caméra pour 100 fileyeurs et 15 chalutiers équipés en pingers d'ici au 30 octobre 2025.
Source : OFB
b) L'intérêt des caméras réside dans un surcroît de précision et de représentativité des données
Les scientifiques ont plaidé avec conviction pour la généralisation de ces caméras embarquées, qui permettent bien plus de précision dans la caractérisation des captures que les déclarations de capture accidentelle, obligatoires pour les pêcheurs. Les rapporteurs doutent en effet du bien-fondé du système actuel d'auto-déclaration, qui astreint les pêcheurs, notamment des navires de moins de 12 mètres, à des démarches administratives et, de surcroît, ne garantit pas l'exactitude des données.
Au-delà du phénomène constaté de sous-déclaration par les pêcheurs - que les rapporteurs peuvent comprendre -, il existerait un biais de sélection lié au fait que les observateurs embarqués dans le cadre du programme ObsMer le sont sur la base du volontariat des pêcheurs.
Par ailleurs, l'OFB relève que 21 % des carcasses de dauphins repérées grâce à l'angle de vue des caméras sont retombées à l'eau, et « peuvent ne pas avoir été observées à bord par l'équipage ou même par un observateur embarqué ». Le nombre de captures observées par ces caméras est en outre bien plus élevé et les enregistrements vidéo ont enfin pour avantage de pouvoir être revisionnés à l'infini.
c) Un rapport coût-bénéfices favorable
L'équipement des navires en caméras embarquées a parfois été critiqué en raison de son coût élevé. Mme Stéphanie Tachoires de l'OFB a en effet indiqué que le matériel installé sur chaque navire coûtait en tant que tel 14 à 15 000 €, et même autour de 20 000 € en incluant le coût de l'installation. En outre, le traitement des données coûte 1 000 à 3 500 € par navire et par mois, en fonction de la taille des navires, du type de filets, du temps passé en mer, etc.
L'enveloppe globale sur la période 2021-2026 (soit les deux projets OBSCAMe 2021-23 et OBSCAMe+ 2024-26) serait de l'ordre de 20 à 22 millions d'euros, une somme que l'OFB qualifie elle-même de « considérable ». Pour autant, ainsi que l'ont rappelé les scientifiques lors des auditions, rapporté au nombre de jours en mer, ce coût demeure bien moindre que celui des observateurs embarqués.
d) Des modalités d'installation des caméras qui ne devraient en aucun cas les assimiler à un dispositif de surveillance des pêcheurs
S'agissant de la confidentialité et du risque d'utilisation des enregistrements à d'autres fins que l'étude des captures, les scientifiques indiquent qu'hormis les données d'intérêt, le reste des images ne fait pas l'objet d'un traitement61(*).
L'OFB précise par ailleurs que « toutes les données sont cryptées entre la collecte à bord et leur bancarisation : seules les personnes habilitées disposant de la clé de décryptage et du logiciel associé peuvent lire les données avant bancarisation. Après bancarisation à Ifremer, les analyses et résultats produits respectent le « secret des affaires ». Les images des marins qui apparaîtraient à l'image sont floutées ou effacées si nécessaire, avant bancarisation. Une convention est établie entre l'équipage du navire et les partenaires du projet, qui encadre tout ce procédé de collecte, traitement et stockage des données à terre ».
La question des modalités d'installation de ces caméras est toutefois sensible, la DG Mare s'étant elle-même dite « consciente de cette sensibilité ».
De fait, la veille de l'audition de l'OFB par la mission, un conflit s'est manifesté dans certains ports du littoral atlantique à ce propos : un nombre plus élevé de caméras, dont certaines tournées vers le pont, ont été proposées par l'OFB à certains marins-pêcheurs, ce qui n'avait pas été anticipé par ces derniers dans les étapes du conventionnement. Si le différend a rapidement été réglé, ils confirment aux yeux des rapporteurs que ces caméras ne doivent pas être synonyme de « flicage à bord » et que « les caméras doivent être tournées vers les filets de pêche et pas vers les personnes qui travaillent sur les navires » (LPO).
Il est vrai que « les caméras ont un côté intrusif qu'il ne faut pas nier », comme le rappelle la DGampa. L'analogie avec les caméras placées dans les abattoirs pour surveiller les conditions d'abattage des animaux de rente est revenue dans les propos de quelques acteurs entendus. Dans ce cas comme dans l'autre, ces caméras suscitent la défiance des professionnels concernés, qui se sentent surveillés et même suspectés de mal agir, quand bien même ils ne feraient qu'exercer leur métier.
Plus philosophiquement, deux types d'arguments, que les rapporteurs jugent également entendables et pertinents, ont été mobilisés contre la généralisation des caméras à bord de navires de pêche :
Ø la pêche, exercée au large, loin du reste de la vie sociale, est une activité associée à la liberté, et de ce fait serait inconciliable dans son essence à une surveillance de tous les instants ;
Ø au contraire, le caractère déjà quasi carcéral de l'espace confiné sur lequel évoluent les pêcheurs à bord d'un bateau rendrait encore plus difficilement supportable la présence de caméras.
e) Sans aller jusqu'à une généralisation, une extension du nombre de navires concernés
De ce fait, selon M. Olivier Le Nézet, président du comité national des pêches, l'obligation de s'équiper en caméras embarquées est une « ligne rouge » pour la filière, qui estime avoir été une force motrice sur ce dossier. Pour M. Jean-Pierre Le Visage, directeur général de la Scapêche, premier armement de France, la perspective d'équiper ses propres navires est « totalement intolérable ». La vigueur de ces mots témoigne d'une acceptabilité des dispositifs d'observation électroniques encore loin d'être acquise.
Signe de l'écho que trouvent ces positions, le président (PS) de la région Bretagne Loïg Chesnais-Girard s'est dit « opposé à titre personnel à la généralisation des caméras », préférant l'option de l'embarquement de scientifiques à bord des navires, dès lors que les pêcheurs sont volontaires.
Dans l'absolu, cette option du volontariat aurait également eu la préférence des rapporteurs. Cependant, les scientifiques rappellent qu'il est nécessaire d'obtenir, dans l'échantillonnage, une certaine diversité par types de navires, afin d'obtenir des données statistiquement significatives. Il faut également bien prendre en considération que cette solution, intégralement prise en charge par l'État, bénéficierait d'abord aux pêcheurs.
En effet, l'utilité de ces caméras pour les pêcheurs serait double :
Ø d'une part, elles permettraient de mieux comprendre le phénomène des captures accidentelles et identifier dans quelles circonstances elles se produisent ou non (par exemple, les dauphins sont-ils attirés par les filets au motif qu'ils signalent des proies ou sont-ils juste « au mauvais endroit au mauvais moment » ?) ;
Ø et d'autre part, évaluer les dispositifs répulsifs pour l'atténuation des captures pour les fileyeurs. Selon Germain Boussarie d'Ifremer, spécialiste de l'analyse des données sur ces dispositifs, il ne sera pas possible de conclure à l'efficacité des pingers sans un plus grand nombre d'observations.
Comme l'indique la DGampa, si l'objectif demeure bel et bien de rouvrir la pêche après 2026, « il faut se donner tous les moyens » d'y parvenir, et les caméras sont l'un des principaux, notamment en ce qu'ils sont les seuls à même d'établir l'efficacité des pingers.
Aussi, la mission en est arrivée à la conclusion que l'extension du nombre de navires équipés, en équipant potentiellement jusqu'à 40 navires supplémentaires, comme le marché public passé par l'OFB semblait l'entrevoir, augmenterait les chances d'une réouverture durable de la pêche dans le golfe de Gascogne. En revanche, une accélération du calendrier d'installation pour les caméras déjà prévues ne semble pas réaliste, la priorité devant être de suivre le bon déploiement de ces caméras pour garantir la qualité et donc la bonne exploitation des données.
Recommandation n° 12 : en concertation avec les capitaines et leurs équipages, et sans aller jusqu'à une généralisation des caméras, étendre le nombre de navires équipés pour ainsi obtenir du projet OBSCame+ un nombre suffisant de données fiables à un horizon de deux ou trois ans.
2. Un besoin impérieux d'améliorer l'acquisition et la diffusion des connaissances scientifiques pour la filière pêche
a) L'importance stratégique d'une reconduction du projet Delmoges pour des mesures alternatives plus ciblées
Le projet scientifique Delmoges - collaboration scientifique entre l'observatoire Pelagis et Ifremer, en partenariat avec trois autres organismes - a permis de nombreux progrès ( cf. une liste des nombreux travaux conduits dans ce cadre) dans le continuum des connaissances entre Pelagis, qui a un angle « mammifères marins » et notamment « cétacés », et Ifremer, qui a un angle « effort et techniques de pêche ».
La publication des résultats complets du programme est prévue pour juillet 2025, sous forme de nombreux « livrables ».
Comme le soulignent les scientifiques, ces travaux ouvrent de nombreuses perspectives. Les administrations centrales notent que « les progrès sur la compréhension du phénomène de capture, obtenus grâce à ces différents travaux, alimentent enfin la réflexion sur des alternatives aux mesures d'urgence actuelles ». Aussi, les rapporteurs appellent à une reconduction de ce programme pour une période supplémentaire de trois ans, ce qui ne doit pas toutefois exonérer l'État de la nécessité d'assurer des moyens suffisants à Ifremer.
Il conviendrait en particulier de confier le soin à ce projet de mettre au point un protocole permettant d'identifier des zonages, périodes, engins ou pratiques de pêche pertinents au regard de leur représentativité, afin d'obtenir des données de comparaisons, pour sortir autant que possible du débat binaire « fermeture »/« ouverture », pour disposer d'un plan de repli, dans l'éventualité où une décision de justice plongerait à nouveau la filière dans l'impasse.
Plusieurs associations de protection de la nature admettent en effet la perspective d'un ciblage accru de mesures spatio-temporelles :
Ø « l'avenir, ce n'est pas la disparition des mesures spatio-temporelles, mais un meilleur ciblage des mesures que cela soit par des zones géographiques plus restreintes ou en ciblant plus précisément les métiers concernés » (France nature environnement) ;
Ø « la mise en place de fermetures ciblées pour certains engins à risques et à une échelle spatio-temporelle plus fine ne doit pas être exclue » (LPO).
Des mesures volontaires pourraient être envisagées, le chercheur Didier Gascuel suggérant que, « plutôt qu'une fermeture générale à date administrative, mieux vaudrait des arrêts décidés par les pêcheurs eux-mêmes, ce qui suppose une politique incitative forte ». Ce scénario de fermetures ciblées volontaires (rolling hotspots volontaires) est du reste favorablement évalué dans une étude portant sur des mécanismes plus incitatifs et moins descendants (cf. partie III.D.2. infra).
Recommandation n° 14 : reconduire le projet scientifique Delmoges (Delphinus Mouvements Gestion) au-delà de 2025, pour une nouvelle période de trois ans, afin d'approfondir le continuum des connaissances sur les cétacés, les captures et la pêche, à partir des données actuellement collectées. Confier aux scientifiques le soin d'évaluer sur la base des dernières données l'efficacité de mesures alternatives plus ciblées que la fermeture spatio-temporelle de 2024-2026.
b) Inviter la filière à créer un institut technique de la pêche, pour renforcer les interfaces science-activité économique
Outre la production de connaissances, dans laquelle le projet Delmoges a permis un saut qualitatif évident, un enjeu crucial réside désormais dans le besoin d'une meilleure diffusion de ces connaissances.
À cette fin, l'idée que le comité des pêches fonde un institut technique de la pêche, comme il peut en exister dans la plupart des filières agricoles62(*), a été évoquée par divers acteurs, et au premier chef par la DGampa, comme levier pertinent pour renforcer les interfaces entre scientifiques et professionnels de la pêche.
Une telle structure, qu'il avait déjà été envisagé de créer au début des années 2010, et pleinement cohérente avec les missions des comités des pêches63(*), aurait en effet pour intérêt de renforcer encore l'appropriation des enjeux scientifiques par la filière et d'accélérer le transfert technologique, en lien avec Ifremer, pour mieux anticiper les éventuels besoins technologiques liés aux normes environnementales.
Elle serait également fort utile en termes de collecte de données. À titre d'exemple, si une telle structure avait pu être partie aux conventions sur les caméras embarquées, en partenariat avec l'OFB, cela aurait renforcé l'acceptabilité de ces équipements pour les équipages - l'implication de l'OFB du fait de sa compétence par ailleurs en matière de police de l'environnement, a pu susciter certaines appréhensions.
La proposition émane davantage de la profession que des scientifiques eux-mêmes, et ne semble pas très bien perçue par les associations de protection de la nature. Elle constitue l'axe 5.2 du contrat stratégique de la filière pêche maritime française signé par la ministre chargée de la pêche, Régions de France, France filière pêche et le CNPMEM. Ce dernier suggère que cet institut soit financé par une affectation des ressources issues de la fiscalité sur les installations éoliennes offshore.
Recommandation n° 13 : inciter la profession à mettre en place au plus vite, tel que prévu dans son contrat stratégique de filière, un institut technique de la pêche, interface scientifiques-professionnels de nature à favoriser l'acquisition et la diffusion de connaissances en son sein.
c) La réactivation du groupe de travail « captures accidentelles de petits cétacés » sous l'autorité d'un médiateur désigné par la ministre de la pêche
Les rapporteurs ont pu constater une forte défiance, renforcée selon eux par le défaut d'une instance de concertation entre scientifiques, professionnels et associations de protection de la nature. Une telle instance existait depuis 2017, sous la forme d'un groupe de travail national sur les captures accidentelles de petits cétacés, mais il a fini par être boycotté par les professionnels de la pêche, qui protestaient contre des fuites de données et ce qu'ils percevaient comme une politisation des échanges en son sein.
Les rapporteurs jugent crucial de réactiver cette instance, à la condition que soient fixées des règles de fonctionnement nouvelles. Pour commencer, ils concluent à la nécessité d'instituer un « médiateur », qui pourrait être une personnalité qualifiée ayant suffisamment d'autorité pour jouer un rôle d'arbitre, nommée par la ministre chargée de la pêche.
En appui, la DGampa devrait assurer au sein de ce groupe de travail un plus haut niveau de représentation (niveau directeur général, plutôt que chargé de mission), et la confidentialité des échanges tenus au sein de cette instance devrait rester une règle intangible.
Si M. Bleunven aimerait recentrer le groupe de travail sur les seuls professionnels et scientifiques pour une période temporaire, MM. Cadec et Grosvalet insistent sur le fait qu'il est préférable de maintenir les associations de protection de la nature autour de la table plutôt que de les placer en dehors de tout cadre institutionnel. Il conviendrait cependant de veiller à la préservation du caractère constructif et loyal des échanges, quitte à redéfinir le format de cette instance, si besoin, en cours de route.
Les rapporteurs invitent notamment chacun à s'abstenir, dans un sens comme dans l'autre, de promesses ou de sentences trop hâtives, la prudence devant rester de mise à ce jour sur les perspectives post-2026.
Les rapporteurs proposent d'attendre la fin de l'automne 2025 pour initier la préparation du cadre post-2026 à partir de bases scientifiques un tant soit peu solides - bien qu'encore non définitives. Dans les mois à venir, deux séries d'informations cruciales aideront en effet à mieux cadrer le champ des possibles pour l'après-2026 :
Ø la publication des résultats complets du projet Delmoges (cf. supra), prévue en juillet 2025, donnera de premiers indices des perspectives post-2026, en resserrant le champ des possibles à partir d'éléments d'analyse plus fins sur les interactions entre activités de pêche et dynamique de population des dauphins ;
Ø les données consolidées Ifremer-Pelagis sur les captures accidentelles de l'hiver 2024-25, qui devraient être publiées à l'automne 202564(*), fiabiliseront les résultats de l'hiver 2023-2465(*).
Même si certaines conclusions - sur l'efficacité des pingers, notamment - ne pourront être tirées que dans un second temps, le groupe de travail ne pourrait cependant être réactivé après cette date pour élaborer différents scenarii, car l'urgence exposerait les parties prenantes à reproduire le processus de décision délétère qui a présidé à la mise en place de la fermeture en 2023.
Recommandation n° 11 : réactiver à la fin de l'automne 2025 le groupe de travail « captures accidentelles », sous l'autorité d'un médiateur nommé par la ministre chargée de la pêche, avec des modalités de fonctionnement revues - représentation de la DGampa à un plus haut niveau, association plus grande des administrations déconcentrées, confidentialité des échanges et préservation de leur dimension constructive.
C. DES MESURES D'ATTÉNUATION DOIVENT ÊTRE TESTÉES À GRANDE ÉCHELLE
Les rapporteurs fondent beaucoup d'espoirs avec la filière sur les dispositifs de dissuasion acoustique (« pingers ») (1), qui doivent encore faire la démonstration scientifique de leur efficacité, parmi un panel de solutions encore à inventer. Ils suggèrent en complément, lors d'une période temporaire de deux ans, des mesures spatio-temporelles ciblées, sur la base du volontariat, dans le cadre d'une expérimentation grandeur nature (2).
1. Les rapporteurs fondent beaucoup d'espoirs avec la filière sur les dispositifs de dissuasion acoustique (« pingers »), parmi un panel de solutions encore à inventer
Toutes les parties prenantes semblent convenir que les moyens de mitigation des captures accidentelles seront la condition nécessaire - mais, selon les scientifiques, pas forcément suffisante - d'une possible réouverture de la pêche à partir de 2027 et au-delà.
a) Une diversité de solutions envisagées
Dans cette perspective, des adaptations très simples sont parfois évoquées, telles que le changement de la couleur des ralingues, parties latérales des filets, l'application de barrettes métalliques et de bandes réfléchissantes sur ces mêmes éléments, ou un changement de l'épaisseur des filets afin de les rendre plus visibles. Le sénateur Alain Cadec insiste sur le fait que la question ne se résume pas aux dispositifs de dissuasion acoustique (« pingers »), et que l'innovation permettra sans doute de mettre au point de nouvelles techniques d'atténuation.
Pour autant, à l'instar des pêcheurs, c'est dans les pingers que les rapporteurs placent aujourd'hui beaucoup d'espoir comme outils d'atténuation. Ces dispositifs jouent sur la pratique de l'écholocalisation par les dauphins.
Il existe à ce jour trois types de dispositifs, qui varient tant dans l'efficacité pour atténuer les captures que dans les contraintes pour les pêcheurs :
Ø les Pifil (pour PIngers au FIlage), projet porté par le Comité national des pêches, sont placés sur la coque du navire, et ne fonctionnent que lors du filage et du virage, une phase donc réduite mais stratégique des opérations de pêche. Les représentants des pêcheurs présument qu'elle est la plus à risque pour les dauphins, quand les scientifiques suggèrent que les dauphins sont capturés au fond dans le cadre d'un comportement de chasse frénétique ;
Ø les balises DolphinFree, placées sur les filets eux-mêmes, tous les 500 m voire tous les 1 km, sont le projet jugé le plus prometteur par les scientifiques et l'administration pour réduire les captures (0 capture sur 1 043 opérations de pêche au filet maillant en 2021-22, mais un potentiel risque de biais ne peut être exclu). Ces balises sont conçues comme interactives, le chercheur Bastien Mérigot de l'université de Montpellier, entendu par la mission, ayant créé des signaux électro-acoustiques bio-inspirés ;
Ø et enfin les réflecteurs acoustiques, fonctionnant comme des radars, jugés moins probants et même peu crédibles par la DGampa.
b) Des dispositifs prometteurs, mais une efficacité encore à démontrer
Sur l'efficacité des pingers, le Ciem estime dans son avis de 2023 que « la prise en compte des résultats des essais d'atténuation est actuellement très incertaine ».
De février à avril 2018, dans le cadre du projet PIC66(*) piloté par l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne en lien avec Ifremer et Pelagis, trois paires de chalutiers pélagiques (PTM) ont testé l'efficacité de pingers de type DDD-03H. Les résultats, obtenus à partir de 218 opérations - avec un observateur embarqué ou auto-déclarations -, ont montré une réduction des captures accidentelles de 65 % (IC 95 % [15-98]) liée aux pingers. Bien que l'expérimentation ait porté sur peu de navires et sur une seule saison, il s'agit à ce stade de la preuve la plus tangible de l'efficacité des pingers, pour les engins de pêche concernés.
En 2020 et 2021, dans le cadre du projet Licado67(*), quatre paires de chalutiers pélagiques ont été équipés en pingers de type DDD-03H ou CetaSaver (développés par l'entreprise brestoise Octech, avec un nouveau signal et plus de batterie), mais les intervalles de confiance ont été trop larges pour conclure, malgré 165 opérations suivies.
De même, les essais sur les fileyeurs depuis 2022 sont considérés par le Ciem comme de simples études de faisabilité ne permettant pas de conclure sur l'efficacité du déploiement de pingers lors du filage (sur près de 3 500 opérations de pêche suivies) ou de réflecteurs acoustiques sur les filets, compte tenu du nombre trop réduit de navires impliqués.
Cependant, les résultats de deux autres essais, au Portugal et en Espagne, semblent très prometteurs, bien que le Ciem ait fait le choix de ne pas les prendre en compte dans les différents scenarii de son avis de 2023, les résultats des analyses n'ayant alors pas encore été publiés :
Ø le premier, s'agissant de la senne coulissante, a montré, sur 518 prises au sud de l'Algarve au Portugal68(*), 38 animaux capturés sur 228 prises sans pingers, et aucun animal capturé sur 233 prises avec pingers ;
Ø le second, conduit en Espagne dans le cadre du programme Miticet, sur des paires de chalutiers de fond, conclut à une réduction de plus de 90 % des prises accessoires, statistiquement significative, avec des pingers DDD-03H.
Pour autant, le Ciem souligne l'« insuffisance des seuls dispositifs de dissuasion acoustique », ainsi que l'a réaffirmé le Conseil d'État dans ses deux décisions successives, au fond et en référé. Les scientifiques préconisent un éventail de solutions, incluant une réduction de l'effort de pêche, les pingers n'étant pas, en tout état de cause, une solution miracle, en raison de certaines limites (signaux monospécifiques, potentiel effet dinner bell pour d'autres espèces).
Les pingers vus par les associations de protection de la nature
Les associations de protection de la nature se montrent beaucoup moins enthousiastes quant à l'efficacité et même quant à la pertinence de ses outils, pour une raison de principe : ce ne sont pas les dauphins qui devraient s'adapter à la pêche, mais la pêche qui devrait s'adapter aux dauphins.
L'association Bloom s'est dite opposée à la généralisation des pingers, proposition qui relèverait, selon son représentant Frédéric Le Manach, du technosolutionnisme et « transformeraient le golfe de Gascogne en discothèque si ce n'est en enfer » pour les dauphins - des images qui ont semblé très exagérées aux yeux des rapporteurs - réglant les problèmes posés par l'interaction pêche-dauphins en « chassant le vivant » de son habitat naturel.
Elles rappellent le paradoxe qu'il y aurait à promouvoir ces solutions quand, dans le même temps, le plan d'actions pour la protection des cétacés de 2020 propose de « réduire l'impact des émissions sonores sous-marines d'origine anthropique sur les cétacés » (action 2.3) - la DG Mare de la Commission européenne se montre moins catégorique, relativisant les émissions sonores de ces dispositifs en comparaison avec d'autres sources anthropiques.
Enfin, d'éventuelles interactions avec des navires militaires ont également été évoquées par ces associations.
c) Un déploiement en cours à plus grande échelle
Depuis 2019, la plupart des chaluts pélagiques se sont volontairement équipés en pingers en hiver, ce qui leur a été imposé les quatre premiers mois de l'année 2020 (arrêté du 26 décembre 2019), et toute l'année depuis 2021 (arrêté du 27 novembre 2020).
Après une première expérimentation menée en 2022 sur les Pifil et les réflecteurs acoustiques pour les fileyeurs, l'arrêté du 29 décembre 2022 a prévu l'équipement dans l'un des trois dispositifs disponibles sur plus de 200 fileyeurs, combiné à des observations à bord ou par caméra embarquée.
La région Bretagne souligne toutefois dans sa contribution qu'« à ce jour seules 1 000 balises sont disponibles, alors que les protocoles envisagés de tests nécessiteraient 1 700 balises ». De ce fait « tous les navires ne pourront pas être équipés tel que prévu par l'arrêté », la DGampa semblant selon la région « ouverte » à faire preuve de compréhension sur le sujet. Il pourrait s'avérer nécessaire d'accorder un soutien financier urgent aux entreprises fabriquant les pingers, afin d'éviter une rupture d'approvisionnement de ces dispositifs, pouvant compromettre le déploiement du plan d'équipement des navires de pêche.
Par ailleurs, les filets pouvant mesurer plusieurs centaines de mètres et jusqu'à des dizaines de kilomètres, le dispositif DolphinFree nécessite davantage de balises, jusqu'à quelques dizaines dans ce dernier cas.
Ce dispositif peut induire en outre de la manutention supplémentaire pour les marins-pêcheurs, les balises ne passant pas nécessairement à travers les vire-filets, imposant de les décrocher puis de les raccrocher une à une lors des opérations de pêche.
La DGampa souligne par ailleurs le risque de blessure à la tête liés au poids actuel des balises du fait de leurs batteries, lors du virage (remontée des filets), qui peut s'avérer brusque69(*).
Pour ces raisons, la région Bretagne va jusqu'à affirmer qu'ils ne sont « pas adaptés d'un point de vue ergonomique à la majorité des pratiques françaises de pêche au filet ». La ministre chargée de la pêche et les scientifiques entendus par la mission invitent à obtenir davantage de données fiables sur l'efficacité de ces dispositifs avant d'investir dans leur miniaturisation (une extension de la durée de vie des batteries a déjà été obtenue). La région Bretagne suggère au contraire de résoudre ces difficultés techniques avant d'évaluer leur efficacité.
Les rapporteurs jugent qu'il n'est pas permis d'attendre et que ces deux défis doivent être menés de front.
Recommandation n° 7 : lancer un plan européen d'équipement afin notamment d'agrandir le marché d'intérêt pour les entreprises fabriquant des dispositifs d'éloignement acoustique (pingers) et leur permettre d'investir dans la miniaturisation et des gains d'efficience.
D. MISER SUR LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET LA DURABILITÉ POUR ASSURER L'AVENIR DE LA PÊCHE DANS LE GOLFE DE GASCOGNE
Déjà fragilisée par l'accumulation d'événements contraires sur les cinq dernières années, la flotte française ne devrait pas supporter seule les efforts de réduction des captures (1). Les organisations de producteurs gagneront cependant à redoubler d'initiatives dans l'atténuation de ces captures par des mesures incitatives et volontaires (2).
1. Le poids des mesures d'atténuation ne devrait pas porter sur la seule capacité de la flotte de pêche française, compte tenu du déficit commercial de la France en matière de produits de la mer
L'ensemble des acteurs entendus par la mission ont commencé par replacer les mesures de fermeture spatio-temporelle appliquées au golfe de Gascogne dans le contexte plus général d'une fragilisation des capacités de pêche françaises, du fait d'une succession de crises depuis cinq ans.
Les rapporteurs ont compris que les mesures de fermeture spatio-temporelles liées aux captures accidentelles ont en réalité constitué « la goutte d'eau » pour un secteur ayant déjà accumulé de nombreuses difficultés ces dernières années.
|
Le dernier épisode d'une série noire pour la filière pêche française Aux arrêts temporaires liés à la pandémie de Covid-19 (2020), initiant une véritable série noire pour la pêche française, se sont ajoutés : Ø les restrictions d'accès aux eaux britanniques faisant suite au Brexit en 2021 (difficultés d'accès aux licences, barrières non tarifaires liées à des réglementations sur la taille de la maille des filets, incertitude liée à la fin de la période de transition en juin 2026, avec la perspective de perdre de nouveaux quotas et de renégocier ceux-ci chaque année après cette date) ; Ø le plan de sortie de flotte intitulé « plan d'accompagnement individuel » (PAI) Brexit, qui a fortement affecté les pêcheurs mais également les mareyeurs de la Manche et de la façade atlantique, en particulier du pays bigouden (Le Guilvinec, Loctudy, Saint-Guénolé), territoire également concerné par les arrêts « cétacés » ; Ø la phase inflationniste de 2022-24 qui, malgré la mise en place de remises à la pompe, cinq fois prolongées, a particulièrement pénalisé un secteur extrêmement dépendant du prix du carburant dans ses charges d'exploitation (c'est « le premier poste de charges dans le compte d'exploitation des navires, qu'il s'agisse de petite pêche côtière, semi-hauturière ou hauturière », comme le rappelait le sénateur Alain Cadec dans une question écrite)70(*), ce qui est encore renforcé par l'ancienneté de sa flotte ; Ø les arrêts temporaires liés à la baisse soudaine de 37 % du quota de sole dans le golfe de Gascogne en 2022 puis en 2023, qui ont concerné en grande partie les mêmes navires que les arrêts « cétacés ». |
Si l'État et les régions ont soutenu le secteur face à ces difficultés, les pêcheurs entendent légitimement vivre de leur métier et non de subventions. Les rapporteurs souhaitent en outre alerter sur le risque d'accoutumance que pourrait engendrer la multiplication des « arrêts temporaires » indemnisés, pour un secteur dans lequel les conditions de travail sont difficiles.
France filière pêche a souligné le défi posé, en termes de renouvellement des générations et d'attractivité des métiers de la filière, par le manque de visibilité et de perspectives données aux jeunes souhaitant s'engager dans le secteur, alors que dans le même temps le succès des lycées maritimes ne se dément pas.
M. Jean-Pierre Le Visage, directeur général de la Scapêche, premier armateur de France, a souligné que « si la pêche est par nature soumise à des aléas dont elle peine à s'accommoder, l'aléa le plus important, récemment, c'est l'aléa réglementaire ».
Les banques du littoral ligérien présentes au Croisic pour échanger avec les pêcheurs ont également souligné la difficulté croissante à accompagner financièrement de jeunes marins-pêcheurs souhaitant engager des investissements importants, à commencer par l'achat d'un bateau de pêche (jusqu'à 250 000 € le mètre, selon Olivier Le Nezet) ou sa modernisation. Elles ont constaté sur la période récente une baisse des encours synonyme de baisse des capacités d'investissement, alors que la nécessité de moderniser la flotte est criante71(*), pour la sécurité à bord des navires ou la réduction de la consommation en carburant.
La déstructuration d'une filière composée pour une grande part d'équipages de taille réduite à l'amont et de PME à l'aval risque d'éroder les capacités de production et de transformation françaises : collectivités tentées de rationaliser le nombre de criées à l'équilibre économique fragilisé, mareyage tenté de s'approvisionner à l'étranger pour plus de sécurité des approvisionnements, transport frigorifié tenté de se désengager de la pêche par manque de rentabilité.
Les approvisionnements de la France en produits de la mer risquent de dépendre encore plus des importations, ces dernières pouvant se substituer durablement aux produits de la pêche française dans les ateliers de transformation ou dans les poissonneries, soit pour pallier directement une rupture d'approvisionnement liée à des arrêts temporaires, soit pour contourner cet aléa de plus en plus souvent matérialisé.
Or, la France est très loin d'être en capacité d'assurer son autosuffisance en matière de pêche et de produits de la mer. Comme l'explique FranceAgriMer, « bien que dotée d'une façade maritime parmi les plus importantes, la pêche française n'est pas suffisante pour pourvoir la totalité de la consommation nationale. Environ trois quarts des volumes consommés sont importés et ce phénomène est renforcé par le fait que les Français consomment majoritairement des poissons (saumon, cabillaud, thon) ou crustacés (crevettes) non produits en France. [...] On constate à la fois un fort taux de dépendance aux importations (plus de 90 %) en même temps que des exportations qui sont très significatives rapportées à la production (plus de 30 %). Là aussi, c'est la différence entre les produits pêchés et ceux consommés en France qui explique ce double phénomène. » Cela témoigne de ce que le beau poisson pêché en France n'y est pas valorisé en prix.
Or, comme l'a souligné le président du conseil départemental du Finistère Maël de Calan, rien ne garantit que la conciliation entre activités de pêche et conservation des petits cétacés soit traitée avec la même rigueur ailleurs dans le monde, et que ces produits importés ne donnent pas lieu eux-mêmes à des captures accidentelles de petits cétacés ou d'autres espèces.
Pour commencer, selon les rapporteurs, un préalable à toute politique sérieuse d'atténuation des captures accidentelles dans le golfe de Gascogne devrait être sa régionalisation, c'est-à-dire son extension à l'Espagne et au Portugal (c'est sur l'ensemble de la sous-zone VIII et de la division IX.a que les captures accidentelles sont estimées supérieures au seuil de prélèvement biologique potentiel), voire son extension à l'ensemble de l'Atlantique Nord-Est, unité de gestion du dauphin commun selon le Ciem.
En parallèle des efforts d'amélioration de la connaissance et d'atténuation des captures qui se déploieraient ainsi à l'échelle de l'Union européenne, les rapporteurs appellent à assurer aux frontières un niveau de garantie équivalent, s'agissant des importations, contre les captures accidentelles de petits cétacés, et de mammifères marins en général. Cette approche ne serait bien sûr envisageable que dans les relations du marché intérieur avec le reste du monde.
Ils souhaitent ainsi prendre exemple sur une disposition de la loi américaine sur la protection des mammifères marins (U.S. Marine Mammal Protection Act) qui entrera en vigueur au 1er janvier 2026, interdisant « l'importation de poissons capturés à l'aide de techniques de pêche entraînant la mort accidentelle ou des blessures graves accidentelles de mammifères marins dépassant les normes américaines » (`in excess of United States standards'). Il s'agirait d'une « mesure miroir », dont il faudrait démontrer le caractère non discriminatoire et proportionné.
La menace d'une perte d'accès au marché américain semble avoir « incité les pays exportateurs à prendre des mesures volontaires en matière de surveillance et d'atténuation des prises accessoires de mammifères marins » ( Bering et al., 2022, Marine Policy). Si d'éventuels reports d'exportations vers des marchés moins exigeants ne sont pas à exclure, limitant l'efficacité de la mesure en termes de biodiversité ( Bellanger et al., 2025, Marine Policy), cela aurait au moins pour mérite d'en favoriser l'acceptabilité au sein de l'Union et d'éviter une concurrence déloyale.
Recommandation n° 9 : prendre exemple sur la loi américaine sur la protection des mammifères marins, pour interdire à l'échelle de l'Union européenne (UE) les importations de poissons ne respectant pas des garanties équivalentes en matière de protection des mammifères marins (mesure miroir).
2. Mettre au point des mécanismes incitatifs et non plus punitifs, en lien avec les organisations de producteurs, afin de mieux valoriser les bonnes pratiques des pêcheurs
Au sein du marché intérieur, les rapporteurs réprouvent une écologie qui serait « punitive », mais ne contestent bien sûr pas la nécessité de préserver le milieu marin, y compris d'un point de vue économique, en tant que capital naturel. Ils appellent seulement de leurs voeux une écologie qui serait plus « incitative ».
Une étude ( Bellanger et al., 2025, Marine Policy) juge que les mesures incitatives sont préférables à des mesures descendantes - tout en précisant que leur efficacité serait renforcée par une combinaison de pressions, de « réglementations traditionnelles et d'instruments basés sur l'incitation ». Huit scénarios sont examinés par cet article :
a) L'illusoire mise en place de quotas de captures ou d'un bonus/malus de quotas de pêche lié aux captures
Dans cet esprit, le chercheur Didier Gascuel72(*) propose dans sa contribution écrite « la mise en place d'une politique de bonus/malus de quotas de pêche73(*) » que les rapporteurs concevraient, dans le cas de la conservation du dauphin, comme :
Ø associé, pour la bonification, à l'équipement en pingers et caméras dans un premier temps, puis le cas échéant à d'autres pratiques d'atténuation si les scientifiques venaient à en identifier sans ambiguïté ;
Ø associé, pour la pénalité, au nombre de petits cétacés capturés d'après les observations des caméras.
La LPO souligne qu'un tel système, en lien avec d'autres mesures a permis de réduire de plus de 90 % les captures accidentelles d'oiseaux marins dans les Terres australes et antarctiques françaises en dix ans. Elle convient toutefois que ce système a été combiné à des observations par des contrôleurs assermentés et à des fermetures pendant les pics de capture - précisément ce que la filière pêche cherche à éviter. La DGampa précise en outre que les mesures techniques d'atténuation étaient plus évidentes dans le cas des prises accessoires d'oiseaux marins que dans celui des captures de dauphins communs.
Se pose de toute façon la question de l'acceptabilité de cette mesure à court ou moyen terme, la profession ne semblant, dans son ensemble, pas mûre pour une telle approche, quand bien même elle a été habituée à la logique des quotas depuis de nombreuses années. Pour cette raison, les quotas de captures ou quotas de pêche liés aux captures sont qualifiés de solution peu réaliste (scénario 7b dans le graphique ci-dessus) et ne retiennent pas la préférence des rapporteurs.
b) Le développement d'une application de partage des informations en temps réel sous la coordination des organisations de producteurs
Selon cette même étude, l'une des mesures jugées les plus pertinentes au regard notamment de son faible coût et de son acceptabilité consisterait à développer une application de type « BATmap » (by-catch avoidance map74(*)), pour collecter des informations sur les mammifères marins et leurs captures en temps réel, afin d'établir des cartes de risque et de diffuser des alertes (scénario 1 dans le graphique ci-dessus).
L'utilisation sur la base du volontariat d'une telle application, qui pourrait être gérée directement par les organisations de producteurs, serait un levier intéressant pour pallier le faible nombre actuel de déclarations des captures.
Source : BATmap
c) Une valorisation plus systématique des mesures d'atténuation des captures dans les cahiers des charges des principaux labels
La littérature économique conforte les approches de régulation par les prix plutôt que par des interdictions, des réglementations ou même des quotas - ces trois options pouvant provoquer une perte sèche, des effets de seuil ou encore des effets d'aubaine.
On pourrait donc imaginer que les pratiques préservant la biodiversité et ses services écosystémiques pour le milieu marin puissent faire l'objet d'une rétribution directe, la puissance publique étant fondée à intervenir, pour corriger des « externalités » (situation dans laquelle le coût marginal pour un producteur diffère du coût marginal pour la société). Se pose toutefois la question du coût d'une telle solution pour les finances publiques, dès lors qu'il paraît difficile de mettre en place les pénalités, dans une logique « pollueur-payeur », pour des raisons d'acceptabilité.
Il convient donc, préférablement, de rechercher une meilleure valorisation des bonnes pratiques des pêcheurs par le marché, afin de compenser les inévitables surcoûts liés à la mise en place de pratiques d'atténuation. La labellisation des produits pêchés dans le cadre de ces bonnes pratiques permettrait une hausse du consentement à payer du consommateur pour ces mêmes produits75(*). Le consommateur à l'aval assumerait ainsi en partie la charge de ces bonnes pratiques qui, à défaut, auraient reposé sur les seuls pêcheurs à l'amont.
À titre d'exemple, une proposition ambitieuse de score de durabilité de la pêche allant de A à E, sur le modèle du Nutriscore, a été émise dans le cadre du Comité scientifique, technique et économique des pêches ( Grati et al., 2024).
Pour autant, à ce stade, le CNPMEM se montre très prudent sur cette perspective, estimant d'une part qu'il n'est « pas automatique que le prix à la première vente augmente » et, si c'était finalement le cas, jugeant « illusoire qu'une labellisation vienne compenser les pertes d'exploitation liées à un changement d'activité. Les prix du poisson étant globalement élevés, le consommateur aura probablement du mal à consentir une augmentation du prix d'achat ». Il pointe également d'inévitables coûts de gestion.
Il convient en outre de veiller à la possible confusion qu'un nouveau label entraînerait, alors que France filière pêche a consacré beaucoup d'efforts dernièrement au développement de la marque « Pavillon France ». En matière d'information du consommateur, la commission des affaires économiques du Sénat a en effet76(*) plusieurs fois appelé à « privilégier la qualité à la profusion », celle-ci pouvant rapidement conduire à une « jungle des labels » et nuire à leur efficacité. Les rapporteurs proposent donc de s'appuyer sur des démarches existantes afin de mieux partager avec le consommateur le coût des mesures d'atténuation :
Ø FranceAgriMer a rappelé que depuis 2010, « les produits issus de la pêche durable peuvent bénéficier d'un écolabel77(*) », sous la forme du label public « Pêche durable », dont le cahier des charges est le plus exigeant à ce jour sur ce segment. Il intègre des critères de réduction des captures d'espèces protégées, qui pourraient être mis à jour à la lumière des travaux en cours. Malgré une hausse du nombre de certifications, il souffre cependant d'un déficit de notoriété ;
Ø plus connu, le label « MSC » (Marine Stewardship Council) a renforcé son cahier des charges en matière de captures d'espèces protégées dans sa troisième version (2023), qui entrera en vigueur entre 2026 et 2030 - cette option a été positivement évaluée dans l'étude précitée (cf. scénario 4 du graphique ci-dessus) ;
Ø à plus long terme, une réflexion pourrait être ouverte pour intégrer dans le cahier des charges de la marque « Pavillon France » un item spécifique à la réduction des captures accidentelles.
Recommandation n° 10 : en lien avec les organisations de producteurs (OP), promouvoir des mécanismes incitatifs pour mieux valoriser les pratiques d'atténuation des captures de la part des pêcheurs (renforcement des labels « pêche durable » et MSC, application de partage des informations en temps réel de type BATmap).
LISTE DES RECOMMANDATIONS
Ø AIDER : la gestion de la crise et l'aide économique aux professionnels affectés par la fermeture
1/ Assumer un devoir de vérité et préparer dès à présent et activement la fermeture spatio-temporelle de 2026, en définissant le plus en amont possible les modalités d'indemnisation et en anticipant les cas particuliers.
2/ Maintenir en 2026 le taux d'indemnisation de 80 à 85 % du chiffre d'affaires pour les pêcheurs et négocier avec la Commission européenne le rebasculement du dispositif d'aide au mareyage sur le chiffre d'affaires plutôt que sur l'excédent brut d'exploitation.
3/ Garantir en 2026 l'accès au chômage partiel pour les criées et les ports, y compris lorsqu'ils ne sont pas gérés par des chambres de commerce et d'industrie.
4/ Maintenir voire étendre, dans le cadre du prochain régime d'aide notifié à la Commission européenne, la possibilité de réaliser des travaux sur les navires pendant la période de fermeture spatio-temporelle.
5/ Inviter le secteur du transport frigorifique, dans le cadre d'un accord temporaire, à assouplir ses délais de livraison tout en maintenant la qualité et la fraîcheur des produits, et à explorer la possibilité de mutualiser le transport des produits de la mer et celui d'autres produits agroalimentaires.
Ø CONCILIER : chercher les conditions de conciliation entre activités de pêche et protection des petits cétacés
6/ Maintenir sans ambiguïté l'objectif, pour après 2026, d'une réouverture de la pêche dans le golfe de Gascogne dans des conditions permettant un maintien de l'état de conservation favorable du dauphin commun.
7/ Lancer un plan européen d'équipement afin notamment d'agrandir le marché d'intérêt pour les entreprises fabriquant des dispositifs d'éloignement acoustique (pingers) et leur permettre d'investir dans la miniaturisation et des gains d'efficience.
8/ Pousser l'Union européenne à prendre un acte délégué de fermeture incluant la zone économique exclusive (ZEE) espagnole pour l'année 2026 et, au-delà, à « communautariser » davantage son approche du problème.
9/ Prendre exemple sur la loi américaine sur la protection des mammifères marins, pour interdire à l'échelle de l'Union européenne (UE) les importations de poissons ne respectant pas des garanties équivalentes en matière de protection des mammifères marins (mesure miroir).
10/ En lien avec les organisations de producteurs (OP), promouvoir des mécanismes incitatifs pour mieux valoriser les pratiques d'atténuation des captures de la part des pêcheurs (renforcement des labels « pêche durable » et MSC, application de partage des informations en temps réel de type BATmap).
Ø CONNAÎTRE : augmenter l'effort d'acquisition et de diffusion des connaissances scientifiques
11/ Réactiver à la fin de l'automne 2025 le groupe de travail « captures accidentelles », sous l'autorité d'un médiateur nommé par la ministre chargée de la pêche, avec des modalités de fonctionnement revues - représentation de la DGampa à un plus haut niveau, association plus grande des administrations déconcentrées, confidentialité des échanges et préservation de leur dimension constructive.
12/ En concertation avec les capitaines et leurs équipages, et sans aller jusqu'à une généralisation des caméras, étendre le nombre de navires équipés pour ainsi obtenir du projet OBSCame+ un nombre suffisant de données fiables à un horizon de deux ou trois ans.
13/ Inciter la profession à mettre en place au plus vite, tel que prévu dans son contrat stratégique de filière, un institut technique de la pêche, interface scientifiques professionnels de nature à favoriser l'acquisition et la diffusion de connaissances en son sein..
14/ Reconduire le projet scientifique Delmoges (Delphinus Mouvements Gestion) au-delà de 2025 pour une nouvelle période de trois ans, afin d'approfondir le continuum des connaissances sur les cétacés, les captures et la pêche, à partir des données actuellement collectées. Confier aux scientifiques le soin d'évaluer sur la base des dernières données l'efficacité de mesures alternatives plus ciblées que la fermeture spatio-temporelle de 2024-2026.
15/ Améliorer la qualité et la transparence des données issues du Réseau national échouages (RNE) en : renforçant l'accompagnement vétérinaire ; fixant l'objectif d'une hausse du taux d'autopsie ; développant l'attention portée à l'identification des pathogènes ; publiant les données individuelles des échouages dans une logique de science ouverte.
EXAMEN EN COMMISSION
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Nous accueillons nos trois rapporteurs sur la mission d'information relative aux conséquences de la fermeture de la pêche dans le golfe de Gascogne, un mois par an de 2024 à 2026, et aux solutions alternatives à cette interdiction. Leur rapport, intitulé Pêche et petits cétacés : bâtir un avenir commun dans le golfe de Gascogne, est très attendu. Lors de nos déplacements dans le Morbihan comme en Loire-Atlantique, nous avons constaté combien ces sujets étaient prégnants sur ces territoires.
M. Yves Bleunven, rapporteur. - Nous avons le plaisir de vous présenter à trois voix les conclusions de notre rapport d'information sur la fermeture de la pêche dans le golfe de Gascogne de la fin janvier à février, en 2024, 2025 et 2026.
Cette fermeture - inédite par son ampleur - visait à réduire les captures accidentelles de petits cétacés, en particulier de dauphins communs, une problématique bien réelle et qu'il ne s'agit pas ici de minimiser. D'après les données scientifiques, lesquelles présentent toutefois un très fort degré d'incertitude, allant parfois du simple au double, 6 100 dauphins communs en moyenne auraient fait l'objet de captures accidentelles par des engins de pêche chaque hiver, entre 2017 et 2023, sur la façade atlantique de la France, sur un total d'environ 180 000 dauphins dans la zone, et d'environ 440 000 dans l'ensemble de l'Atlantique Nord-Est hors eaux irlandaises.
Or, au regard de la directive Habitats qui place tous les mammifères marins sous protection stricte, et de la règle de gestion du potentiel de prélèvement potentiel (PBR), un taux de capture supérieur à un taux équivalant en pratique 1 % par an compromettrait le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable. Ce pic de captures conduisant au dépassement du seuil est à l'origine de la fermeture.
Les conditions dans lesquelles cette décision a été prise - sur injonction du Conseil d'État, et de façon précipitée, trois mois avant la fermeture - ont fortement déstabilisé le secteur, déjà fragilisé par les à-coups successifs du covid, du Brexit, des plans de sortie de flotte et de la hausse du prix du gazole.
La perte de chiffre d'affaires de la première fermeture spatio-temporelle a été estimée à 30 millions d'euros, touchant la filière dans son ensemble : 16 millions d'euros pour les pêcheurs, mais aussi des pertes pour les mareyeurs, les criées, les coopératives maritimes, la réparation navale et les transporteurs frigorifiques.
Notre première préoccupation, puisque nous sommes encore au milieu des périodes de fermeture, a été de gérer leurs conséquences et de garantir qu'une aide soit apportée aux professionnels affectés. Cela correspond au premier axe de notre rapport, qui contient cinq recommandations.
La première d'entre elles est de préparer dès à présent et activement la fermeture spatio-temporelle de 2026. Comme élus, nous sommes soumis à un devoir de vérité : la pêche restera fermée en 2026. Il nous faut définir des modalités d'indemnisation, afin de donner de la visibilité aux pêcheurs et de traiter tous les cas particuliers, par exemple ceux d'entre eux qui n'ont pas eu d'activité sur la période de référence 2019-2023. Nous devons agir le plus en amont possible pour ne pas revivre le scénario de 2024, voire de 2025.
La deuxième recommandation est de négocier avec la Commission européenne un maintien du taux d'indemnisation à 85 % du chiffre d'affaires pour les pêcheurs et une révision du mode de calcul de l'aide au mareyage, aujourd'hui basé sur l'excédent brut d'exploitation, ce qui est moins avantageux et a conduit à une sous-consommation d'environ 50 % la première année. Ces indemnisations ont été rapides, relativement généreuses, mais elles ne suffisent pas à effacer le préjudice moral profond ressenti par la filière. Elles doivent être à la hauteur ; à défaut, le mareyage sera de plus en plus tenté de s'approvisionner à l'étranger. Actuellement, nous importons déjà 75 % de ce que nous consommons.
Au-delà des pêcheurs et de la première étape de transformation que constitue le mareyage, nous avons souhaité prêter une attention particulière dans nos travaux aux conséquences indirectes de la fermeture pour les criées, la réparation navale ou encore le transport, et sur l'ensemble de l'écosystème économique côtier.
Les criées et les ports sont les grands oubliés des indemnisations. Notre troisième recommandation est de leur garantir l'accès au chômage partiel, qui n'a pas été possible pour la plupart des formes juridiques, hormis pour celles gérées par des chambres de commerce et d'industrie.
Par ailleurs, durant la première année, l'encadrement des aides d'État a empêché les exploitants des bateaux concernés de profiter de l'arrêt pour conduire des travaux, au motif que cela constituerait une « double indemnisation ». Cette règle est un non-sens ! Si la deuxième année, de menus travaux ont été possibles, il convient d'aller encore plus loin dans le prochain régime d'aide notifié à la Commission, afin de permettre aux pêcheurs d'optimiser leur arrêt et à la réparation navale de continuer de tourner. C'est notre quatrième recommandation.
Une cinquième recommandation est plus exploratoire et nous mesurons les difficultés de mise en oeuvre qu'elle présente : nous avons été frappés, lors du déplacement à Lorient, par les contraintes pesant sur le transport frigorifique de produits de la mer, avec parfois des assurances sur la livraison à quinze minutes près. En 2024, pendant la fermeture, la couverture du territoire en livraison a dû être réduite et la consommation de poisson a diminué. Nous craignons que la répétition des arrêts pousse les grandes entreprises de transport à se désengager du secteur, faute de rentabilité sur ce segment. Aussi pensons-nous qu'un accord temporaire de filière pourrait conduire à des assouplissements des délais de livraison, voire à des mutualisations avec d'autres produits agroalimentaires. Cela pose des défis logistiques et sanitaires, bien sûr, mais rendez-vous compte que nous en sommes rendus au point où des camions quasiment vides circulent dans toute la France. Il y a matière à optimiser cela.
Les propositions que je viens d'émettre pour bien gérer la dernière année de crise sont une condition sine qua non pour préparer l'après-2026, ce dont va vous parler Alain Cadec.
M. Alain Cadec, rapporteur. - Le point que j'aborde est sans doute moins consensuel : comment concilier les activités de pêche et la protection des petits cétacés ? J'émettrai également cinq recommandations sur ce volet. Nous sommes sur une ligne de crête, mais nous avons la conviction que celle-ci est praticable, c'est pourquoi le rapport que nous vous présentons s'intitule Pêche et petits cétacés : bâtir un avenir commun dans le golfe de Gascogne. Un tel avenir n'est envisageable ni sans les pêcheurs ni sans les dauphins.
Nous avons mené de nombreuses auditions dans le cadre de cette mission d'information : professionnels, scientifiques, administrations, mais aussi associations de protection de la nature. Chacune de ces catégories nous a fait part de visions et de préoccupations différentes ; en tant que responsables politiques, nous avons pour fonction de tenir compte de cette diversité pour fixer un cap. Celui-ci est clair : la réouverture de la pêche après 2026, dans des conditions qui permettent un maintien de l'état de conservation favorable du dauphin commun. Tel est l'objectif fixé et c'est ma première recommandation. Avec mes collègues, de différents groupes politiques, nous l'assumons sans équivoque.
Des mesures techniques d'atténuation ont déjà été engagées par les pêcheurs. La question ne se résume pas aux pingers, ces engins d'effarouchement, puisque le changement de couleur des ralingues a également été envisagé et que l'innovation permettra sans doute de mettre au point de nouvelles techniques pour éloigner les cétacés des engins de pêche. Le problème est que ces animaux, bien que particulièrement intelligents, oublient les signaux d'alerte dès lors qu'il y a de quoi manger.
M. Yannick Jadot. - Ou à l'inverse, ils sont suffisamment intelligents pour comprendre, à l'écoute d'un pinger, où se trouve la ressource !
M. Alain Cadec, rapporteur. - C'est sur les pingers, dispositifs d'éloignement acoustique, que les pêcheurs fondent le plus d'espoir. Déjà utilisés sur des chalutiers pélagiques, ils sont en cours de déploiement sur deux cents fileyeurs pour confirmer leur efficacité. Cependant, il faut équiper des filets pouvant faire des dizaines de kilomètres tous les cinq cents mètres et les entreprises ne parviennent pas à honorer les commandes.
Il existe deux types de dispositif : les pifils, pour pingers au filage, qui sont fixés sur la coque du bateau, empêchant le dauphin d'approcher quand on file le filet, et les balises Dolphin Free posées sur les filets eux-mêmes. Le second dispositif semble plus prometteur, mais n'est pas commode, voire peut être dangereux pour le virage, car les boîtiers sont lourds et qu'il faut les détacher un à un.
Le défi est donc la miniaturisation de ces équipements, or le marché d'intérêt est trop petit pour que les entreprises investissent en ce sens ; il convient donc d'envisager un plan d'équipement européen pour l'agrandir. C'est ma deuxième recommandation, qui permettra de rentabiliser la fabrication et la vente de ces petits pingers.
Cela m'amène à une troisième recommandation, qui devrait aller de soi, mais qui, malheureusement, n'a pu aboutir jusqu'à présent : celle de régionaliser davantage, voire d'européaniser, la politique de protection. L'Union européenne a pris un acte délégué en 2025 pour étendre la fermeture dans les eaux françaises aux navires battant pavillon étranger, mais, comme il fallait l'unanimité et que seule la France était sous le coup d'une décision de justice, à la différence de l'Espagne, elle n'étend pas la fermeture aux eaux espagnoles. Le bon sens serait d'inclure la zone économique exclusive (ZEE) espagnole et la ZEE portugaise, voire davantage, dans la fermeture spatio-temporelle de 2026, car les dauphins communs ne s'arrêtent pas à notre ZEE... Dans la mesure où l'unité de gestion du dauphin commun est l'Atlantique Nord-Est, l'enjeu est non seulement l'efficacité de la mesure, mais aussi son équité.
Toujours dans cette recherche d'équité et d'efficacité dans la protection des cétacés, ma quatrième proposition consiste à prendre exemple sur la loi américaine visant la protection des mammifères marins, dont une disposition de type « mesure miroir » entrera en vigueur en 2026, pour interdire les importations de poissons ne respectant pas des garanties équivalentes en matière de protection des mammifères marins. En effet, pendant que nous empêchons nos pêcheurs de pêcher, nous continuons d'importer des poissons de zones où aucune norme n'est respectée. Une telle interdiction ne pourrait évidemment être envisagée qu'à l'échelle du marché intérieur, et il faudrait en démontrer le caractère non discriminatoire et proportionné. Ce serait un comble que la baisse de notre capacité de pêche se traduise par des importations de poissons pêchés à l'aide de techniques ayant entraîné des captures accidentelles. Surtout eu égard à l'état déjà très dégradé de notre balance commerciale en produits de la mer : je rappelle que nous importons entre 70% et 75 % des produits de la pêche et de l'aquaculture que nous consommons.
Enfin, une cinquième recommandation est plus exploratoire : elle consiste à mettre au point des mécanismes incitatifs, et non plus punitifs, en lien avec les organisations de producteurs, afin de mieux valoriser les pratiques d'atténuation des captures de la part des pêcheurs. Plusieurs dispositifs sont envisageables.
Premièrement, la labellisation, afin de permettre une hausse du consentement à payer du consommateur pour mieux partager avec lui le coût des mesures d'atténuation des captures. On pourra, pour cela, s'appuyer sur des démarches existantes : le label public « pêche durable », qui est le plus exigeant en la matière, voire le label MSC (Marine Stewardship Council) qui, depuis 2023, intègre aussi des critères de réduction des captures d'espèces protégées. Ces critères pourraient être mis à jour et renforcés à la lumière des travaux scientifiques en cours - je pense aux travaux de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) et à ceux de l'observatoire Pelagis dans le cadre du projet Delmoges.
Deuxièmement, on pourrait confier aux organisations de producteurs le soin de développer une application de partage des informations en temps réel sur les cétacés et les captures accidentelles. Cela existe dans les eaux écossaises sous le nom de BATmap (By-Catch Avoidance Map, carte d'évitement des captures accidentelles) : en temps réel, les pêcheurs savent où il y a des concentrations de dauphins pour les éviter. Cela semble une piste intéressante pour mieux associer les pêcheurs, qui ont pu faire l'objet de « pêche bashing », à la protection des cétacés.
Vous l'aurez compris, pour nous, l'enjeu est d'offrir une sortie par le haut à tout le monde, dans le respect de ce que nous enseigne la science, dont va parler Philippe Grosvalet.
M. Philippe Grosvalet, rapporteur. - Ce sujet de la fermeture de la pêche dans le golfe de Gascogne est passionnant, mais aussi déroutant, en raison de la forte incertitude qui entoure plusieurs données du débat dans sa dimension scientifique.
Je vous assure qu'il n'a pas toujours été facile d'y voir clair, mais nous avons essayé de faire la part des choses entre ce qui relève de la perception, du ressenti ou des opinions personnelles des acteurs concernés, d'une part, et ce qui est le fruit de la méthode scientifique avec des protocoles d'analyse quantitative les plus rigoureux et documentés possibles, d'autre part - même si nous pouvons penser que la science est encore balbutiante en ce qui concerne ces données.
Les scientifiques ont fait l'objet d'une certaine défiance - en réalité, d'une défiance totale -, car les associations de protection de la nature ont repris leurs données et en ont tiré, pour certaines, des conclusions trop définitives sur la pêche. Mais rien ne sert de s'acharner sur le baromètre quand le temps est mauvais.
Aussi, notre première proposition serait de demander à la ministre chargée de la pêche de nommer un médiateur, qui pourrait être une personnalité qualifiée ayant suffisamment d'autorité pour jouer un rôle d'arbitre. Celui-ci présiderait le groupe de travail « captures accidentelles », qui regroupe pêcheurs, scientifiques, administration et associations, qu'il est absolument indispensable de réactiver pour surmonter la rupture de confiance constatée. Des règles de confidentialité renforcées et un haut niveau de représentation de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGampa) seraient à même de faire revenir tous les acteurs concernés à la table des discussions. Pour l'instant, il n'y a plus aucun espace de dialogue.
Notre deuxième recommandation consiste à étendre le nombre de navires équipés en caméras pour objectiver le débat sur les captures - sujet brûlant dans le monde de la pêche. Le processus est en cours pour cent fileyeurs équipés en caméras embarquées dans le cadre du programme OBSCame+ porté par l'Office français de la biodiversité (OFB). En équipant davantage de navires, nous pourrions obtenir des données fiables à un horizon plus court, ce qui est dans l'intérêt des pêcheurs. Cela devra bien sûr se faire en concertation avec les capitaines et leurs équipages, et en tournant les caméras vers les filets, et non vers les pêcheurs, qui craignent à juste titre le côté intrusif de la présence de caméras à bord.
Pour la poursuite de l'acquisition et de la diffusion de connaissances, nous proposons ensuite d'inciter la profession à mettre en place, tel que prévu dans son contrat stratégique de filière, un institut technique de la pêche qui servirait d'interface entre les scientifiques et les professionnels pour ouvrir la voie à davantage de recherche appliquée. Une telle structure aurait par exemple pu contribuer à améliorer l'acceptabilité de la pose de caméras. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de créer un « machin » de plus, puisque ce serait complètement à la main de l'interprofession.
Une autre proposition consiste à reconduire le projet scientifique Delmoges (Delphinus mouvements gestion), entre l'Ifremer et Pelagis, au-delà de sa première période 2023-2025. Ce premier programme a permis de nombreux progrès que nous avons constatés dans le continuum des connaissances entre Pelagis, qui a un angle « cétacés », et l'Ifremer, qui a un angle « pêche », notamment sur le fait que les petits poissons pélagiques s'agrègent en bancs denses sur le fond près des côtes, ce qui pourrait expliquer que des dauphins soient capturés dans des filets au fond, par exemple dans la pêche à la sole ou au merlu. Reconduire ce programme permettra d'alimenter la réflexion sur des alternatives aux mesures d'urgence actuelles : nous proposons de confier aux scientifiques le soin de mettre en place des protocoles pour évaluer l'efficacité de mesures alternatives, qui seraient en tout cas plus incitatives et ciblées qu'une fermeture sèche pour un aussi grand nombre d'engins, sur la base des dernières données. Rappelons que les décisions actuelles sont prises sur la base du nombre estimé de dauphins en 2016 et d'un avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (Ciem) de 2023 selon lequel la plupart des scénarios sans fermeture spatio-temporelle ne suffiraient pas à assurer la conservation du dauphin commun.
Une dernière recommandation consiste à améliorer la qualité et la transparence des données issues du Réseau national échouages (RNE). Ce réseau d'environ 500 correspondants est chargé d'imputer les échouages à différentes causes de mortalité, sous la coordination de l'observatoire Pelagis, unité mixte de service du CNRS et de l'université de La Rochelle. Comme il ressort qu'environ 70 % des échouages seraient attribuables à la pêche, les pêcheurs demandent légitimement que cette imputation s'appuie sur des observations solides. Or la plupart des observations reposent sur un examen externe de l'animal par des correspondants habilités, mais qui, selon les pêcheurs, n'ont pas nécessairement toutes les qualifications. Nous n'entendons pas remettre en cause le travail effectué par ce réseau, mais au contraire le fiabiliser. Nous pensons y parvenir en renforçant l'accompagnement vétérinaire, notamment lors des pics d'échouage hivernaux, en fixant l'objectif d'une hausse du taux d'autopsie, en développant l'attention portée à l'identification des pathogènes comme autre cause de mortalité, et enfin en publiant les données individuelles des échouages dans une logique de science ouverte.
Nous considérons que cela pourrait contribuer à abaisser le niveau de défiance envers cet organisme, qui fait un travail essentiel. C'est seulement main dans la main que les pêcheurs et les scientifiques pourront atteindre l'objectif de concilier l'activité de pêche et la protection des petits cétacés.
M. Pierre Médevielle. - Je remercie nos collègues de ce rapport sur un sujet sensible dans le golfe de Gascogne.
Plusieurs choses me gênent. Vous avez parlé tous les trois d'incertitudes sur les chiffres. Alain Cadec nous a assurés que personne n'avait dit que la biomasse était en danger. Dans ce cas, pourquoi prendre de telles mesures ? Je peux en témoigner : à Arcachon, Capbreton, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, nous n'avons jamais vu autant de dauphins depuis dix ans !
En outre, pourquoi ne pas parler dans le rapport de différenciation entre les types de bateaux ? Dans les quatre ports que j'ai cités, les bateaux de pêche sont de douze mètres en moyenne. Les dégâts ne proviennent pas de ces bateaux, alors pourquoi les mettre dans la nasse ? On n'a pas affaire à des pélagiques qui traînent à deux un filet comme dans la ZEE espagnole, et qui font effectivement des dégâts.
Les pêcheurs qui sont bloqués touchent une indemnisation de 85 % du chiffre d'affaires - c'est bien, mais ce n'est pas 100 %. Pourquoi ne pas parler des dégâts en aval dans les criées et dans les coopératives ? Nous dépensons 20 millions d'euros par an pour protéger une espèce qui n'est même pas menacée : c'est marcher sur la tête !
Par ailleurs, la plupart des pêcheurs sont équipés de dispositifs d'éloignement acoustique et doivent perfectionner leurs équipements. Or cela a un coût qui représente une contrainte. J'ai rencontré plusieurs pêcheurs qui m'ont dit devoir faire face à de gros problèmes de trésorerie. Par conséquent, quand la pêche est ouverte, ils sortent par tous les temps. Serge Larzabal, premier vice-président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM), a dû vous en parler.
Interdire les grands chalutiers pélagiques pendant un mois, soit. Mais céder à certaines organisations qui réclament une interdiction pendant quatre mois, en janvier, février, mars et juillet, ce serait aller vers un naufrage complet ! Il faut complètement revoir la copie.
La zone est coupée en diagonale entre la France et l'Espagne. Interdire la pêche seulement dans la ZEE française, c'est marcher sur la tête ! Le Conseil d'État a pris une décision qui n'est pas logique alors même que le Gouvernement n'était pas favorable à la fermeture... Il reste beaucoup de travail à faire.
M. Daniel Salmon. - L'incertitude porte sur le nombre de cétacés qui meurent du fait des actions de pêche. Lors de l'audition de la mission d'information à laquelle j'ai assisté, j'ai été interloqué, voire choqué, de constater la défiance qui s'exprimait à l'égard de l'Ifremer et du CNRS. On ne peut pas mettre sur le même plan les chiffres des organismes scientifiques et ceux des pêcheurs. Les organismes scientifiques s'appuient sur une méthodologie qui permet de ne pas avoir d'incertitude. Ils ont le souci de travailler en coopération avec les pêcheurs, malgré un manque de bonne volonté de la part de ces derniers.
L'intervention d'un médiateur pourrait être une solution, mais il y a un réel problème de compréhension des méthodes.
Nous ne pourrons pas voter ce rapport tel qu'il est. Nous pourrons choisir de nous abstenir, car il y a des données scientifiques qu'il faut continuer d'étayer. Mais l'acceptabilité des programmes de recherche par les professionnels de la pêche n'est pas une notion que nous pouvons envisager.
M. Yannick Jadot. - L'efficacité pour la ressource et les cétacés des fermetures spatio-temporelles est incontestable : on constate une baisse des captures accidentelles. La science et les autorités politiques ont considéré qu'il y avait une menace et ont mis en place un dispositif certes dur, mais on connaît l'histoire : c'est à force de ne pas avoir de politique de gestion de la ressource que nous en sommes arrivés là. Tant mieux s'il y a aujourd'hui un esprit constructif pour gérer la ressource !
Je trouve positif que les rapporteurs encouragent le dialogue avec la science.
Certaines choses restent à améliorer dans le programme pour l'année prochaine, mais reconnaissons que la couverture des coûts pour la profession est correcte - il y a eu pire dans le passé.
La situation n'est pas facile. Avec Alain Cadec, nous avons beaucoup travaillé au Parlement européen sur ces sujets. Nous nous sommes toujours battus pour différencier la pêche artisanale de la pêche industrielle. Il est difficile de demander aux artisans d'utiliser des caméras embarquées, et il y a toujours eu des différenciations dans le recours à ce type d'outil.
Quoi qu'il en soit, nous considérons qu'il est bon que la science et les acteurs concernés puissent trouver les moyens de protéger la ressource, donc les pêcheurs.
M. Franck Montaugé. - Je ne suis pas spécialiste du sujet, mais j'en mesure l'importance. Est-il possible de replacer cette problématique dans le cadre général des difficultés économiques auxquelles la pêche est confrontée et de prendre également en compte la problématique environnementale des réserves halieutiques ? Il faut examiner le sujet dans un panorama global.
M. Gérard Lahellec. - Je m'associe aux compliments adressés à nos rapporteurs. Il faut s'emparer de ce sujet, eu égard à l'insatisfaction qu'il engendre.
Il n'est pas neutre de se référer à la science par les temps qui courent : j'observe une tendance à remettre en cause les avis des scientifiques et des agences. Personnellement, je considère que j'ai besoin de plus savants que moi pour savoir, donc pour prendre une décision. Nous gagnerions à conforter l'objectivation à partir de l'avis des scientifiques, ce que vous avez commencé à faire.
Je me demande s'il ne faudrait pas, dans les préconisations, différencier les approches, car l'on ne protège pas la ressource de la même manière selon que l'on racle le fond des océans ou que l'on pêche avec des bateaux de douze mètres. La pêche artisanale disparaîtra si on ne la préserve pas. Je m'achemine vers une position d'abstention bienveillante et d'encouragement à poursuivre le travail d'objectivation.
M. Alain Cadec, rapporteur. - La différenciation existe, puisque l'interdiction ne vaut pas pour les navires de moins de huit mètres, mais les scientifiques constatent que les prises accidentelles sont moins faites par les pélagiques que par les fileyeurs. Les pêcheurs dont parle M. Médevielle ...
M. Pierre Médevielle. - Ce sont de petits fileyeurs.
M. Alain Cadec, rapporteur. - Ils n'ont pas des kilomètres de filets, bien sûr.
Mais nous nous rendons compte que nous nous étions trompés au départ. Les navires de pêche mis en cause ne sont pas les pélagiques. Les bolincheurs commencent à s'équiper de caméras, comme ceux qui pêchent en boeufs, c'est-à-dire avec deux bateaux qui tirent un seul chalut. Nous avons rencontré un artisan qui pratique ce type de pêche à La Turballe et qui s'est équipé. Il a constaté qu'il pêchait moins de dauphins. La bolinche est encore moins dangereuse, car elle se pratique avec une senne qui est un filet qui se referme ; il permet donc, en cas de besoin, de rejeter le cétacé. En revanche, si le cétacé est maillé dans un filet, il se noie rapidement. Or malheureusement, les cétacés recherchent la nourriture, qui peut être dans un filet à soles, lequel mesure un mètre cinquante.
La nourriture des dauphins communs, c'est la sardine, l'anchois ou le sprat. Mais ces poissons, pour des raisons liées notamment au réchauffement climatique, se rapprochent des côtes au lieu d'être au large. Le cétacé a donc plus de risques d'être pris.
Certains d'entre vous ont parlé des autopsies. Or seulement 2 % des échouages sont autopsiés, ce qui est bien trop peu. S'il y a des marques de maille, il est clair que le cétacé a été pris et rejeté. Dans le cas contraire, rien ne le prouve tant qu'une autopsie n'a pas été pratiquée, mais l'état de conservation de la carcasse ne permet pas toujours de le faire...
En ce qui concerne la trésorerie, en 2025, les autorités françaises ont fait diligence, ce qui n'était pas le cas en 2024. En 2026, je pense que ce sera la même chose. Nous en avons parlé avec Serge Larzabal qui semble avoir bien compris l'enjeu.
La différenciation spatio-temporelle est impossible à mettre en oeuvre : comment pourrait-on autoriser la pêche depuis Arcachon et l'interdire depuis la Cotinière !
M. Pierre Médevielle. - Et sur les tailles des bateaux ?
M. Alain Cadec, rapporteur. - C'est un critère pris en compte, mais qui n'est pas suffisant. Des petits bateaux pêchent des cétacés, alors que de plus gros n'en pêchent pas.
L'installation de caméras est une solution possible. Avec Yannick Jadot, nous connaissons bien le sujet : nous avons oeuvré dans ce sens au Parlement européen. Les pêcheurs commencent à intégrer que c'est nécessaire, à condition que l'on filme le filet et non pas leurs visages, ce que nous pouvons tout à fait comprendre.
M. Philippe Grosvalet, rapporteur. - Le climat est extrêmement tendu, même si les pêcheurs ont plus de mal à se faire entendre que les agriculteurs, car ils sont moins nombreux.
M. Alain Cadec, rapporteur. - Quand ils veulent faire du bruit, on les entend...
M. Philippe Grosvalet, rapporteur. - Je suis un élu du littoral : la filière est au bord de la rupture. C'est une chaîne solidaire : si un maillon craque, toute la filière s'écroule. Des chefs d'entreprise qui investissent 1 million d'euros dans un bateau ont des raisons de s'inquiéter.
Notre rapport s'appuie uniquement sur des données scientifiques, et non sur des données subjectives. L'incertitude n'est pas liée au fait que nous mettrions en doute ces données, mais à la difficulté qu'il y a à mesurer une faune dans un espace aussi complexe que l'océan. La tâche est même plus difficile que pour les oiseaux. Les scientifiques en sont encore à l'étape des balbutiements pour l'établissement des données. Les représentants de Pelagis, de l'Ifremer et du CNRS nous l'ont dit : ils ont beaucoup progressé en trois ans.
Ces difficultés vont jusqu'à susciter des comportements complotistes. Certains pêcheurs, qui restent minoritaires, sont dans une telle remise en cause des scientifiques que nous devons absolument parvenir à rétablir un dialogue avec eux ; sinon, le fossé se creusera encore plus.
Monsieur Montaugé, vous avez raison, il faut parler de l'avenir de la pêche. Nos pêcheurs embarquent sur des bateaux qui ont entre 35 et 40 ans d'âge. C'est non seulement dangereux, mais c'est aussi inefficace, car ils consomment trois fois plus de carburant que des bateaux modernes. En outre, cela n'incite pas les jeunes générations à investir dans la pêche. Par conséquent, la filière n'aura aucun avenir si nous ne sommes pas capables de retrouver une formule compatible avec les règles européennes pour soutenir l'investissement dans les navires de pêche.
M. Franck Montaugé. - Si l'on raisonne en part de PIB, la pêche ne représente pas grand-chose ; mais ce sujet ne mériterait-il pas une proposition de loi de notre commission ? Vous parlez de difficultés d'accès au crédit pour moderniser la flotte. Nous n'avons aucun intérêt à laisser cette filière disparaître petit à petit. L'enjeu est économique, territorial et culturel.
M. Yves Bleunven, rapporteur. - Dans le cadre de cette mission d'information, nous avons veillé à prendre en considération tout l'écosystème et tous les acteurs. Ainsi, pour les transporteurs, le mareyage ne représente qu'un faible pourcentage de leur activité. Ils sont prêts à laisser tomber l'excellence de leur service parce que cette activité est déficitaire. Nous nous sommes rendus dans la coopérative maritime de Lorient et nous avons constaté les dégâts. Pour les collectivités qui gèrent des criées, cela fait des recettes en moins, sans même parler du tonnage qui diminue d'année en année. Nous avons formulé des préconisations sur ce sujet.
Monsieur Salmon, vous avez assisté à l'audition que nous avions organisée avec les pêcheurs, qui ont des revendications très fortes vis-à-vis des scientifiques. Mais nous avons également organisé des auditions pour entendre les scientifiques. En effet, nous nous sommes fixé pour règle de faire preuve d'objectivité et d'aborder ce dossier sans a priori, en écoutant tous les acteurs. Certaines ONG sont très radicales et le sont de plus en plus, d'autres sont plus modérées et proposent des solutions. Ce serait un raccourci que de tirer des conclusions à partir d'une seule audition.
M. Alain Cadec, rapporteur. - Monsieur Montaugé, je précise que la pêche est une politique commune totalement intégrée : tout se décide à Bruxelles et à Strasbourg.
M. Franck Montaugé. - Cela n'empêche pas d'agir.
M. Alain Cadec, rapporteur. - Certes. En matière d'aménagement du territoire, l'absence de bateaux de pêche dans nos ports serait un drame absolu.
Grâce aux décisions prises par l'Union européenne ces dernières années, nous arrivons au rendement maximal durable (RMD) pour 58 % des espèces. Pour expliquer brièvement cette notion, elle consiste, si l'on considère que la biomasse est un capital, à ne toucher qu'aux intérêts. Nous sommes passés en quinze ans de 12 % à 58 % des espèces grâce à la politique commune de la pêche.
M. Franck Montaugé. - Et le nombre de professionnels ?
M. Alain Cadec, rapporteur. - Il diminue parce que notre capacité à pêcher diminue. En effet, l'Union européenne organise des plans de sortie de flotte (PSF), dont le dernier en date est directement lié au Brexit, avec pour conséquence qu'un certain nombre de navires - sans doute beaucoup trop - ont été détruits.
M. Franck Montaugé. - Cela signifie-t-il que la filière est en extinction ?
M. Alain Cadec, rapporteur. - Non, car elle forme beaucoup de jeunes. Mais il faut fournir aux pêcheurs des bateaux qui consomment et qui polluent moins.
M. Franck Montaugé. - C'est l'Union européenne qui doit agir ?
M. Philippe Grosvalet, rapporteur. - Pour l'instant, le cadre de la politique commune de la pêche nous bloque, mais nous constatons des avancées significatives.
M. Alain Cadec, rapporteur. - Nous devrions pouvoir y arriver. On ne peut pas imaginer notre pays sans pêcheurs.
M. Philippe Grosvalet, rapporteur. - D'autant plus que nous avons des ressources financières nouvelles, liées notamment à l'éolien offshore, qui pourraient être réorientées.
M. Franck Montaugé. - Cela pose le même genre de problèmes que pour une partie de l'agriculture...
M. Alain Cadec, rapporteur. - Nous ne nous permettrions pas de mettre en doute les constats des scientifiques. En revanche, les conclusions qu'ils en tirent ne sont pas toujours certaines et peuvent parfois être contestées. Les calculs de biomasse se font par survol ; c'est tout de même très compliqué de compter des dauphins de la sorte ! Des modalisations sont possibles, mais ce n'est pas parfait.
M. Philippe Grosvalet, rapporteur. - Chacun d'entre nous est un acteur politique, avec sa propre sensibilité, mais ce rapport se fonde exclusivement sur les données scientifiques. Notre objectif commun a été d'essayer de définir des pistes permettant à la fois de sauver la filière et de répondre aux besoins de protection de la faune. À un moment politique où des tensions très vives se font jour, on pourrait craindre des actes de violence sur nos ports, où l'on relève parmi les pêcheurs un très fort rejet des scientifiques, sans parler des ONG. Il faut recréer du dialogue et remettre de la rigueur scientifique dans le débat. L'adoption par notre commission de ce rapport équilibré serait de nature à restaurer la paix sociale et à convaincre le Gouvernement de l'importance de ce sujet ainsi que de la nécessité d'y consacrer des moyens importants et de mener une action d'influence à l'échelle européenne.
M. Pierre Médevielle. - Il serait sans doute inopportun de parler de mesure miroir aux pêcheurs, car cela relève du fantasme. Je pense aux flottes de pêche venues de Chine ou d'autres pays asiatiques que l'on arraisonne parfois au large de la Nouvelle-Calédonie : quelque cinquante bateaux ayant tous le même numéro d'immatriculation, qui pillent allégrement toutes nos ressources marines.
Que fait-on aujourd'hui pour les jeunes ? On leur impose contrainte sur contrainte, on les écoeure, alors qu'ils sortent d'écoles d'excellence. Alors, soit on continue de leur appuyer sur la tête et on se résout à tout importer, soit on se décide enfin à aider cette filière de pêche artisanale qui fait vivre tant de nos ports !
M. Yannick Jadot. - Je suis d'accord avec Franck Montaugé, mais il faut aussi réfléchir aux choix des techniques de pêche. Avec Alain Cadec, nous nous sommes battus, avec succès, contre la pêche électrique et la pêche en eau profonde, pour préserver nos pêcheurs et les territoires qu'ils font vivre et structurent de tous les points de vue. Le débat existe sur ces questions au sein de la profession, même si les pêcheurs sont moins enclins à s'exprimer publiquement que les agriculteurs. Renforcer l'approche scientifique est essentiel pour que tout le monde se détende. Il faut trouver les moyens de valoriser la pêche artisanale. Je pense à la belle renaissance du bar de ligne, dont les frayères avaient beaucoup souffert du chalutage en boeuf. Ce poisson fait vivre nos artisans pêcheurs, mais aussi la gastronomie française !
M. Daniel Salmon. - Les propos que j'entends ici ce matin sont beaucoup plus apaisés que ce que j'avais relevé lors des auditions du CNRS et de l'Ifremer. Concernant les causes de mortalité, j'ai retrouvé les chiffres : avant la fermeture, 70 % des cétacés échoués portaient des traces très nettes de filets ; depuis, il n'y a presque pas eu de captures accidentelles.
M. Alain Cadec, rapporteur. - « Les plaisirs sont rares pour les marins pêcheurs ; contempler les dauphins s'égayer dans les flots est l'un d'entre eux » : c'est ce que m'a dit José Jouneau, président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire, qui n'est pourtant pas un tendre... Clairement, les pêcheurs ne sont pas contre les dauphins !
Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente. - Je remercie une nouvelle fois nos trois rapporteurs de leur beau travail, sur lequel nous pourrions discuter encore longtemps !
Les recommandations sont adoptées.
La commission adopte le rapport d'information et en autorise la publication.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
Mercredi 19 février 2025
- Table ronde « contexte historique »
· Observatoire Pelagis : Mmes Hélène PELTIER, ingénieure de recherche et Sarah WUND, ingénieure de recherche, vétérinaire ;
· CNRS : M. Thomas BOREL, responsable des affaires publiques et Mme Fabienne AUJARD, directrice adjointe scientifique écologie et environnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
· Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) : Mme Clara ULRICH, coordinatrice des expertises halieutiques.
- Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche (MTEBFMP)
· Direction de l'eau et de la biodiversité (DEB) : M. Matthieu MOURER, adjoint au sous-directeur de la protection et de la restauration des écosystèmes littoraux et marins (ELM) ;
· Direction générale des Affaires maritimes, de la Pêche et de l'Aquaculture (DGampa) : MM. Olivier CUNIN, adjoint au directeur, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, et Sébastien COUDERC, adjoint au chef du service Pêche maritime et aquaculture durables.
- Union française des pêcheurs artisans (UFPA) : M. David LE QUINTREC, président national.
Jeudi 20 février 2025
- Table ronde d'élus locaux
· Association des maires de France (AMF) : M. Hervé BOUYRIE, coprésident du groupe de travail Littoral, et Mme Louise LARCHER, conseillère au département aménagement du territoire ;
· Régions de France : MM. Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président, et Justin AMIOT, conseiller agriculture alimentation, pêche, forêt ;
· Départements de France : M. Maël DE CALAN, président du conseil départemental du Finistère.
- Table ronde « associations de protection de la nature »
· Sea Shepherd : Mmes Lamya ESSEMLALI, présidente, et Marion CRECENT, juriste et collaboratrice ;
· France nature environnement (FNE) : Mme Elodie MARTINIE-COUSTY, responsable du réseau Océans, mer et littoral ;
· Défense des milieux aquatiques : M. Philippe GARCIA, président ;
· Ligue de protection des oiseaux (LPO) : MM. Cédric MARTEAU, directeur général, et Louis DORÉMUS, responsable plaidoyer - pôle protection de la nature ;
· Bloom : M. Frédéric LE MANACH, directeur scientifique.
Mardi 11 mars 2025
- Commission européenne :
· Direction générale des affaires maritimes et de la pêche (MARE) : Mmes Maja KIRCHNER, cheffe d'unité MARE.C1 Gestion des pêches dans l'Atlantique, la mer du Nord et la mer Baltique, Caroline ALIBERT-DEPREZ, chargée des politiques, gestion des pêches dans l'Atlantique Nord-Est, et Amanda PEREZ PERERA, chargé de mission Soutien des politiques de pêche, d'environnement et de conservation ;
· Direction générale de la concurrence (COMP) : M. Koen VAN DE CASTEELE, directeur, et Mme Maria MUÑOZ DE JUAN, chef d'unité Agriculture et pêche.
- Table ronde de personnalités qualifiées : Mme Géraldine WOESSNER et M. Erwan SEZNEC, journalistes au Point, auteurs du livre Les Illusionnistes.
Mercredi 12 mars 2025
- Table ronde « comités des pêches » :
· Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) : M. Olivier LE NEZET, président du CNPMEM et président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Bretagne, Philippe DE LAMBERT DES GRANGES, directeur général, et Mme Anne CHAUSSE, chargée de mission ;
· CRPMEM de Bretagne : M. Julien DUBREUIL, secrétaire général adjoint et vice-président, et Sébastien LE PRINCE, vice-président du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Finistère (CDPMEM 29) ;
· CRPMEM des Pays de la Loire : M. José JOUNEAU, président ;
· CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine : MM. Serge LARZABAL, président, Franck LALANDE, vice-président, et Mme Magali LASSERRE, secrétaire générale ;
· Fédération des organisations de producteur de la pêche artisanale (Fedopa) : MM. Jérémie SOUBEN, secrétaire général, et Aurélien HENNEVEUX, chargé de missions de l'OP Pêcheurs d'Aquitaine, en charge du suivi technique de la problématique des captures accidentelles de cétacés dans le réseau des OP ;
· Association nationale des organisations de producteur (Anop) : M. Julien LAMOTHE, secrétaire général.
- Table ronde « impact économique de la fermeture / solutions »
· Université de Montpellier : M. Bastien MÉRIGOT, maître de conférences ;
· Ifremer : Mme Clara ULRICH, coordinatrice des expertises halieutiques, MM. Germain BOUSSARIE, chargé de recherche sur les interactions pêche-prédateurs ;
· Observatoire Pelagis : Mme Hélène PELTIER, ingénieure de recherche à La Rochelle Université ;
· Office français de la biodiversité (OFB) : M. Fabien BOILEAU, directeur des aires protégées et des enjeux marins, et Mme Stéphanie TACHOIRES, chargée de mission pêche et activités maritimes ;
· FranceAgriMer : Mme Julie BRAYER MANKOR, directrice générale adjointe, M. Jean CHIBON, délégué filière, et Mme Agnès OLRY CHIFFOLEAU, cheffe de l'unité pêche et aquaculture.
Mardi 18 mars 2025
- MTEBFMB : petit déjeuner avec Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et son cabinet.
Mardi 25 mars 2025
- Table ronde de la filière pêche
· France filière pêche : Mme Hélène KERAUDREN, déléguée générale ;
· Union du mareyage français (UMF) : M. Peter SAMSON, secrétaire général ;
· Société centrale des armements des mousquetaires à la pêche (Scapêche) : M. Jean-Pierre LE VISAGE, directeur général ;
· Association des directeurs et responsables de halles à marée (ADRHM) : M. Sébastien LE REUN, co-président,
· La Coopération maritime : M. Jean-Luc HALL, directeur général.
LISTE DES CONTRIBUTIONS ÉCRITES
- Ambassade d'Espagne
- Ambassade de Suède
- Chambres de commerce et d'industrie (CCI) France
- M. Didier Gascuel, institut Agro de Rennes-Angers, directeur du pôle halieutique, mer et littoral
- Association Sibylline Océans
- Région Bretagne
DÉPLACEMENT DE LA MISSION D'INFORMATION
À LORIENT, PUIS
À LA TURBALLE ET AU CROISIC
PROGRAMME
LORIENT
Mercredi 26 mars 2025
- Dîner avec le vice-président mer et littoral de la région Bretagne et des représentants des services déconcentrés de l'État (direction interrégionale Nord-Atlantique-Manche Ouest, délégation à la mer et au littoral) ;
Jeudi 27 mars 2025
- Visite de la criée de Lorient-Keroman pour les ventes aux enchères du jour ;
- Petit-déjeuner avec les responsables du comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM), du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Bretagne, de l'organisation de producteurs « Pêcheurs de Bretagne », sur la question des impacts économiques, en présence de responsables de la criée, de l'Association bretonne des acheteurs de produits de la pêche (Abapp), de l'union du mareyage français (UMF), de la coopérative maritime des pêcheurs et ostréiculteurs (CMPO) Lorient-Auray, d'entreprises du transport frigorifique (Stef, Olano) et des services déconcentrés de l'État (direction interrégionale Nord-Atlantique-Manche Ouest, délégation à la mer et au littoral).
- Visite de deux entreprises de mareyage de taille et de spécialisation différentes : Marée Coeffic (petit pélagique), Sogelmer - groupe Océalliance (divers) ;
- Visite de la coopérative maritime des pêcheurs et ostréiculteurs (CMPO) Lorient-Auray (ramendage, vente d'accastillage, de filets, panneaux et chaluts) ;
- Rencontre avec des représentants de l'union française des pêcheurs artisans (UFPA) ;
LA TURBALLE
- Présentation d'équipements d'éloignement (pingers) et d'observation (caméras embarquées) à bord du Magayant (chalut pélagique), à quai ;
- Déjeuner avec les autorités portuaires (La Turballe et Le Croisic), des élus locaux et des pêcheurs ;
- Échanges avec la Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM).
LE CROISIC
- Réunion avec Ifremer, l'Office français de la biodiversité (OFB) et le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) sur les données scientifiques, l'acquisition de connaissances et les mesures d'atténuation des captures ;
- Réunion avec le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM), des services déconcentrés de l'État et des banques du littoral ligérien sur les conséquences économiques des fermetures spatio-temporelles et le contrat stratégique de filière.
PERSONNES RENCONTRÉES LORS DU DÉPLACEMENT
- Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) : M. Olivier LE NÉZET, président, président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) Bretagne et du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Morbihan (CDPMEM 56) ;
- SEM Lorient-Keroman : MM. Benoît JAFFRÉ, directeur général, Yonel MADEC, responsable du pôle halieutique et Andres MEJIA, directeur cellule commercial ;
- Organisation de producteurs (OP) Les Pêcheurs de Bretagne : M. Ludovic LEROUX, président, armateur à La Turballe et Mme Quiterie SOURGET, ingénieure halieute et chargée de mission ;
- Organisation de producteurs (OP) Vendée : Mme Fiona BIGEY, chargée de mission ;
- CRPMEM Bretagne : MM. Jacques DOUDET, secrétaire général et Bertrand TARDIVEAU, chargé de communication ;
- CDPMEM 56 : M. Romain FAGEOT, collège chef d'entreprise, catégorie non-embarqué, Mmes Audrey OLIVIER, chargée de mission énergies marines renouvelables et Marine BARBIER, secrétaire générale Gestion et coordination, réglementation, sécurité, pouce-pieds et ikejime ;
- Association bretonne des acheteurs de produits de la pêche (Abapp) : M. Guénolé MERVEILLEUX, président, et Mme Jennifer LEROUX, responsable filière ;
- Fret express transport : M. Sébastien MOALIC, directeur ;
- STEF Transport : M. Xavier LANGLET, directeur commercial chez STEF Seafood ;
- Olano : M. Iñaki OSTIZ, responsable exploitation, technico-commercial ;
- Coopérative maritime des pêcheurs et ostréiculteurs (CMPO) Lorient-Auray : Mme Valérie HARTEMANN KERAUDRAN, responsable juridique, MM. Gilles MELIN, technicien pêche et Olivier LAURIN, directeur ;
- Groupement des pêcheurs artisans lorientais (GPAL) : M. Laurent TREGUIER, patron du Côte d'Ambre ;
- Union française des pêcheurs artisans (UFPA) : MM. David LE QUINTREC, président et Jean-Vincent CHANTREAU, secrétaire général ;
- Coeffic Marée : M. Lionel STEPHAN, directeur ;
- Société Sogelmer : MM. Guénolé MERVEILEUX, président, Romain KERBELLEC, directeur, et Mme Stéphanie OLLIVIER, directrice générale ;
- Conseil départemental de la Loire-Atlantique : Mme Lydia MEIGNEN, en charge des ports, M. Jean-Luc SÉCHET, vice-président agriculture, mer, littoral, voies navigables et ports, et Mme Aurélie MADELIN, chargée de mission en charge de ces sujets auprès du cabinet du président du département ;
- Syndicat mixte des ports de Loire-Atlantique : M. Gildas GUGUEN, directeur général ;
- Mairie du Croisic : Mme Michèle QUELLARD, maire, et M. André BOUCHER, conseillé subdélégué ;
- Mairie de La Turballe : MM. Didier CADRO, maire et Didier MARION, adjoint aux ports ;
- Cap Atlantique : M. Nicolas CRIAUD, président, maire de Guérande ;
- SAEML Loire Atlantique pêche et plaisance : M. Eric LE MÉRO, directeur général, Mme Sylvie LE BEC, directrice adjointe et M. Sébastien VOGNE, responsable ports de pêche, des criées de La Turballe et du Croisic ;
- Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Vendée : M. Sébastien LE REUN, directeur des concessions portuaires ;
- Association centre Atlantique des acheteurs des produits de la pêche (Acaapp) : Mme Marie-Christine LAHARY, directrice ;
- Ifremer : MM. Youen VERMARD, halieute à l'Ifremer de Nantes, et Germain BOUSSARIE, chargé de recherche sur les interactions pêche-prédateurs ;
- Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Pays de la Loire (Corepem) : MM. José JOUNEAU, président, Adrien DELAVAUD, 2ème vice-président, pêcheur de l'île d'Yeu, et Mme Fanny BRIVOAL, directrice ;
- Organisation professionnelle des pêcheurs artisans de Noirmoutier (Oppan) : M. Christian CLOUTOUR, directeur ;
- M. Thierry EVAIN, pêcheur au Croisic ;
- Mme Monique LEBEAUPIN, mareyeur à Nantes ;
- Mme Caroline STEPHAN, mareyeur à La Turballe ;
- M. Anthony LE HUCHE, armateur à La Turballe, patron du Magayant ;
- M. Stéphane DANDIN, armateur au Croisic ;
- M. Christopher QUÉMÉNER, armateur au Croisic ;
- Crédit maritime : M. Yvon DENIEL, directeur de la filière maritime ;
- Crédit mutuel : M. Gaétan JOSSO, chargé d'affaires à Guérande ;
- Secrétaire Général pour les Affaires Régionales (SGAR) : Mmes Urwana QUERREC, secrétaire générale et Maud CORLU, chargé de mission transport, mobilité, mer, énergies marines renouvelables ;
- Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest (Dirm Namo) : M. Eamon MANGAN, directeur adjoint des activités maritimes (Rennes) ;
- Direction régionale des finances publiques (DRFIP) : M. Jean-Marc BOUCHET, directeur du pôle gestion publique ;
- Banque de France : Mme Simone KAMICKY, directrice régionale ;
- Délégation à la mer et au littoral (DML) du Morbihan : M. Arnaud LE MENTEC, directeur adjoint de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan, délégué mer et littoral ;
- Délégation à la mer et au littoral (DML) de Loire-Atlantique : Mme Éloïse PETIT, directrice adjointe de la DDTM de Loire-Atlantique, déléguée à la mer et au littoral, et M. Valentin ANNE, chef du pôle économie et contrôle des activités maritimes à la DDTM de Loire-Atlantique ;
- Délégation à la mer et au littoral (DML) de Vendée : François-Régis BERTAUD du CHAZAUD, directeur adjoint de la DDTM de Vendée, délégué à la mer et au littoral ;
- Office français de la biodiversité (OFB) Pays de la Loire : Mme Nathalie FRANQUET, directrice régionale ;
- Société nationale de sauveteurs en mer (SNSM) : MM. Gérard LE CAM, président de la station, Laurent ALLANIC, patron titulaire du navire, Patrick LE BESCOND, patron de la sortie, Serge PAULAY, mécanicien, Yvon JOFFRAUD, équipier de pont.
TABLEAU DE MISE EN oeUVRE ET DE SUIVI
des principales
recommandations de la mission
|
N° de la proposition |
Proposition |
Acteurs concernés |
Calendrier prévisionnel |
Support |
|
AIDER (axe 1) : la gestion de la crise et l'aide économique aux professionnels affectés par la fermeture |
||||
|
1 |
Assumer un devoir de vérité et préparer dès à présent et activement la fermeture spatio-temporelle de 2026, en définissant le plus en amont possible les modalités d'indemnisation et en anticipant les cas particuliers. |
Administrations centrale (DGampa) et déconcentrée (DML), Commission européenne, filière pêche, FranceAgriMer |
Dès 2025 |
Retours d'expérience, notification du prochain régime d'aide, décision du directeur général de FranceAgriMer |
|
2 |
Maintenir en 2026 le taux d'indemnisation de 80 à 85 % du chiffre d'affaires pour les pêcheurs et négocier avec la Commission européenne le rebasculement du dispositif d'aide au mareyage sur le chiffre d'affaires plutôt que sur l'excédent brut d'exploitation. |
Administration centrale (Dgampa), filière pêche |
Dès 2025 |
Notification du prochain régime d'aide |
|
3 |
Garantir en 2026 l'accès au chômage partiel pour les criées et les ports, y compris lorsqu'ils ne sont pas gérés par des chambres de commerce et d'industrie. |
Administration centrale (Dgampa en lien avec la DG Travail), collectivités territoriales |
Dès 2025 |
Arrêté en application de l'article L. 5122-1 du code du travail |
|
4 |
Maintenir voire étendre, dans le cadre du prochain régime d'aide notifié à la Commission européenne, la possibilité de réaliser des travaux sur les navires pendant la période de fermeture spatio-temporelle. |
Administrations centrale (Dgampa) et déconcentrée (DML), Commission européenne, filière pêche |
Dès 2025 |
Notification du prochain régime d'aide, décision du directeur général de FranceAgriMer |
|
5 |
Inviter le secteur du transport frigorifique, dans le cadre d'un accord temporaire, à assouplir ses délais de livraison tout en maintenant la qualité et la fraîcheur des produits, et à explorer la possibilité de mutualiser le transport des produits de la mer et celui d'autres produits agroalimentaires. |
Entreprises de la grande distribution et du transport, filière pêche, filière agro-alimentaires |
Dès 2025 |
Accord sectoriel entre acteurs privés sous l'égide de l'État |
|
CONCILIER (axe 2) : chercher les conditions de conciliation entre activités de pêche et protection des petits cétacés |
||||
|
6 |
Maintenir sans ambiguïté l'objectif, pour après 2026, d'une réouverture de la pêche dans le golfe de Gascogne dans des conditions permettant un maintien de l'état de conservation favorable du dauphin commun. |
Ministre chargée de la pêche, élus locaux, filière pêche, scientifiques |
Dès 2025 |
Déclarations officielles |
|
7 |
Lancer un plan européen d'équipement afin notamment d'agrandir le marché d'intérêt pour les entreprises fabriquant des dispositifs d'éloignement acoustique (pingers) et leur permettre d'investir dans la miniaturisation et des gains d'efficience. |
Commission européenne (DG Mare), fabricants de dispositifs d'effarouchement, administration centrale, régions |
Dès 2025 |
Financement par le fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (Feampa) |
|
8 |
Pousser l'Union européenne à prendre un acte délégué de fermeture incluant la zone économique exclusive (ZEE) espagnole pour l'année 2026 et, au-delà, à « communautariser » davantage son approche du problème. |
Ministre chargée de la pêche, Commission européenne (DG Mare) |
Dès 2025 |
Règlement délégué de la Commission modifiant le règlement (UE) 2019/1241 |
|
9 |
Prendre exemple sur la loi américaine sur la protection des mammifères marins, pour interdire à l'échelle de l'Union européenne (UE) les importations de poissons ne respectant pas des garanties équivalentes en matière de protection des mammifères marins (mesure miroir). |
Union européenne |
Dès 2025 |
Règlement européen |
|
10 |
En lien avec les organisations de producteurs (OP), promouvoir des mécanismes incitatifs pour mieux valoriser les pratiques d'atténuation des captures de la part des pêcheurs (renforcement des labels « pêche durable » et MSC, application de partage des informations en temps réel de type BATmap). |
Organisations de producteurs, FranceAgriMer (label pêche durable), acteurs privés (label MSC), scientifiques (projet Delmoges) |
Dès 2025 |
Révision des cahiers des charges des labels, initiative privée |
|
CONNAÎTRE (axe 3) : augmenter l'effort d'acquisition et de diffusion des connaissances scientifiques |
||||
|
11 |
Réactiver le groupe de travail « captures accidentelles », sous l'autorité d'un médiateur nommé par la ministre chargée de la pêche, avec des modalités de fonctionnement revues - représentation de la DGampa à un plus haut niveau, association plus grande des administrations déconcentrées, confidentialité des échanges, préservation de leur dimension constructive. |
Ministre chargée de la pêche, administrations centrale (DGampa) et déconcentrée (DML), filière pêche, scientifiques, associations de protection de la nature |
À l'automne 2025 |
- |
|
12 |
En concertation avec les capitaines et leurs équipages, et sans aller jusqu'à une généralisation des caméras, étendre le nombre de navires équipés pour ainsi obtenir du projet OBSCame+ un nombre suffisant de données fiables à un horizon de deux ou trois ans. |
Administrations centrale (DEB, DGampa) et déconcentrée (DML), OFB, filière pêche, scientifiques, groupement Sinay et Isi-Fish |
2026 |
Arrêté modificatif de l'arrêté du 13 décembre 2024 relatif à l'amélioration de la collecte de données sur les captures accidentelles de mammifères marins |
|
13 |
Inciter la profession à mettre en place au plus vite, tel que prévu dans son contrat stratégique de filière, un institut technique de la pêche, interface scientifiques professionnels de nature à favoriser l'acquisition et la diffusion de connaissances en son sein. |
Filière pêche (France filière pêche, comité national des pêches et des élevages marins) |
Dès 2025 |
Initiative privée, Financement par le fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (Feampa), éventuellement affectation de la taxe sur l'éolien offshore |
|
14 |
Reconduire le projet scientifique Delmoges (Delphinus Mouvements Gestion) au-delà de 2025, pour une nouvelle période de trois ans, afin d'approfondir le continuum des connaissances sur les cétacés, les captures et la pêche, à partir des données actuellement collectées. Confier aux scientifiques le soin d'évaluer sur la base des dernières données l'efficacité de mesures alternatives plus ciblées que la fermeture spatio-temporelle de 2024-2026. |
Observatoire Pelagis, Ifremer, université de Bretagne occidentale, Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, Office français de la biodiversité |
2026 |
Co-financement DEB-DGampa-France Filière Pêche |
|
15 |
Améliorer la qualité et la transparence des données issues du Réseau national échouages (RNE) en : renforçant l'accompagnement vétérinaire ; fixant l'objectif d'une hausse du taux d'autopsie ; développant l'attention portée à l'identification des pathogènes ; publiant les données individuelles des échouages dans une logique de science ouverte. |
Administration centrale (direction de l'eau et de la biodiversité) et déconcentrée, observatoire Pelagis |
Dès 2025 |
Instructions de la direction de l'eau et de la biodiversité, projet de loi de finances |
* 1 L'exemple du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, ou plus récemment du projet d'autoroute A69, reliant Castres à Toulouse.
* 2 Selon Ifremer, en France, « 58 % des volumes de poissons débarqués en 2023 proviennent de populations exploitées durablement » (« en bon état » et « reconstituable ») contre seulement 18 % en 2000.
* 3 « La conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche » relève de la compétence exclusive de l'Union européenne, selon les termes de l'article 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
* 4 Jusqu'à preuve du contraire, aucune capture intentionnelle de petits cétacés n'a été relevée sur la période récente. Ce serait, du reste, pénalement répréhensible au regard de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, transposant la directive Habitats.
* 5 Sujette à débat, cette notion est souvent résumée à grands traits par la taille « hors tout » des bateaux (la limite retenue par opposition à la pêche « industrielle » étant en général établie à 8, 10 ou 12 m - cette dernière longueur correspondant au seuil au-dessus duquel la géolocalisation des navires est généralisée, et les flux déclaratifs dématérialisés). La notion ne trouve en réalité qu'une seule définition juridique, aux termes de laquelle une « société de pêche artisanale est une société dont au moins 51 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction et sont embarqués sur le ou les deux navires » ( article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime).
* 6 En 2023, elle a progressé d'« effondrée » à « reconstituable ».
* 7 Un premier effondrement avait été observé dans les années 1980.
* 8 Alain Corbin, Le Territoire du vide. L'Occident et le désir de rivage, Flammarion (Champs histoire), 2018.
* 9 L'« investissement dans le champ des fonds marins » est l'un des dix objectifs assignés au plan France 2030, au sein de l'item « mieux comprendre le monde ».
* 10 Il s'en trouve également, plus largement, dans l'espace maritime français, mais les eaux ultramarines n'entrent pas dans le champ du présent rapport.
* 11 Pour autant, il n'est pas inutile de souligner que « l'espace maritime sous juridiction française de la Manche-Mer du Nord et de l'Atlantique, avec environ 250 000 km², ne représente que 2,5 % de l'espace maritime français ».
* 12 Cette notion statistique signifie qu'il y a 95 % de chances que la valeur recherchée soit comprise entre cette borne haute et cette borne basse.
* 13 Depuis la précédente campagne (cycle I de l'étude Samm, en 2011-12), cet intervalle s'est pourtant resserré, grâce à des appareils photos placés sous les avions, de 12 points par rapport à l'estimation centrale pour la limite basse, et, de façon plus significative encore, de 27 points par rapport à l'estimation centrale pour la limite haute.
* 14 Relatif à la zone marine peu profonde, située au-dessus de la plateforme continentale.
* 15 Il est à noter que ces données portent sur un échantillonnage de la partie centrale du plateau continental du golfe de Gascogne réalisé en effet en quatre sessions totalisant 50 heures de vol dans le cadre du projet Capecet (2020), et non sur la campagne aérienne Samm II, qui s'est étendue sur deux mois et demi.
* 16 Une interprétation a priori concurrente, donnée par le pêcheur Arnaud Le Quintrec à Lorient, serait un effet de report des dauphins, lié à la pêche hauturière, à laquelle M. Le Quintrec oppose la pêche artisanale et côtière.
* 17 Arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection.
* 18 Directive de l'Union européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages.
* 19 Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin
* 2 Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche (PCP).
* 20 Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques.
* 21 C'est ce qui explique qu'ils aient fait l'objet de programmes d'équipements en pingers de façon plus précoce.
* 22 « Au mauvais endroit au mauvais moment : identification de la cooccurrence spatio-temporelle des dauphins communs capturés et des pêcheries dans le golfe de Gascogne (Atlantique Nord-Est) de 2010 à 2019 ».
* 23 La réponse à cette question, on le verra (cf. partie III.B.A. infra), n'est pas sans conséquence pour ce qui est des résultats comparés à attendre des différents types de dispositifs d'effarouchement.
* 24 Approche complétée par des estimations de captures basées sur des survols aériens dans le cadre de la campagne Samm II en mars 2021
* 25 Il n'est pas possible de « croiser » ces intervalles de confiance en retenant un intervalle combiné compris entre 6 640 et 9 700 captures. Le nombre réel de captures est situé, avec 95 % de chances, entre 3 081 et 13 300 captures.
* 26 Au-delà de 25 jours, l'hypothèse est faite que les chances de retrouver une carcasse baguée sont nulles.
* 27 « Je n'évoquerai pas non plus, à titre d'exemple, le réseau national échouage des cétacés qui repose sur l'université de la Rochelle et s'appuie sur des associations pour faire pratiquer des autopsies ou réaliser des prélèvements à des fins diagnostiques par des personnes dépourvues des compétences qu'une démarche scientifique rigoureuse requiert et sans maîtrise des risques de santé publique associés. »
* 28 Il ne peut cependant être exclu de double appartenance à ces catégories.
* 29 Question écrite n° 02 084 - 16e législature.
* 30 INFR(2020)4036.
* 31 Article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
* 32 3 695 captures en retenant 75 % de ce seuil, 2 464 en retenant 50 % et 493 en retenant 10 %, ce qui correspond à des approches de précaution.
* 33 Des approches alternatives sont celles dites du PBR modifié, ou encore du « removal limit algorithm » (RLA).
* 34 Soumis à Conservation Letters, une revue scientifique à comité de relecture et à fort facteur d'impact.
* 35 Il convient de noter que l'espérance de vie et la longévité ne sont pas une même notion : la longévité désigne ici l'âge auquel parviennent 5 % de la population des dauphins.
* 36 La Cour de justice de l'UE a jugé en 2019, en matière de « dérogations espèces protégées » ( affaire C-674/17), que « conformément au principe de précaution consacré à l'article 191, paragraphe 2, TFUE, si l'examen des meilleures données scientifiques disponibles laisse subsister une incertitude sur le point de savoir si une telle dérogation nuira ou non au maintien ou au rétablissement des populations d'une espèce menacée d'extinction dans un état de conservation favorable, l'État membre doit s'abstenir de l'adopter ou de la mettre en oeuvre. »
* 37 Article 191 : « La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement [...] est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur. »
* 38 Chaluts en boeuf pélagiques (PTM), chaluts pélagiques à panneaux (OTM) et chaluts de fond non spécifiés (TB) d'une longueur hors-tout supérieure à 12 mètres, soit environ 60 navires, entre le 1er janvier et le 30 avril.
* 39 Jusqu'alors, 14 navires de ce type s'étaient équipés sur la base du volontariat.
* 40 Renforcer la connaissance des populations de cétacés et des impacts des activités humaines (axe 1), réduire les pressions anthropiques sur les cétacés par la mise en place de mesures appropriées (axe 2), renforcer l'action internationale en matière de protection des cétacés en promouvant la vision française dans les différentes instances internationales et européennes (axe 3), mobiliser les différents acteurs et parties prenantes et sensibiliser le grand public à la protection des cétacés (axe 4).
* 41 Fileyeurs maillants et emmêlants (GNS, GTR, GTN), chaluts pélagiques (PTM, OTM), chaluts à grande ouverture verticale des catégories OTT et OTB, chaluts démersaux en paire (PTB).
* 42 Conseil d'État, décision n° 449788.
* 43 Arrêté du 24 octobre 2023 établissant des mesures spatio-temporelles visant la réduction des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne pour les années 2024, 2025 et 2026.
* 44 Dans les sous-zones Ciem VIII a, b, c et d relevant de la juridiction française.
* 45 Sur des requêtes de France nature environnement (FNE), de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et de Sea Shepherd France.
* 46 Article 4 (1er paragraphe) : « Les armateurs font remonter à la DDTM de rattachement de leur navire : - au plus tard 15 jours après la publication du présent arrêté, les informations suivantes : - la liste des navires s'engageant à s'équiper des dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles ou d'un système actif d'observation électronique à distance ; - le choix entre le type de dispositifs retenu et le système actif d'observation électronique à distance. Un formulaire en ligne sera mis à disposition des armateurs afin qu'ils indiquent les informations sus-citées ; - avant le 14 janvier 2024 pour les navires non équipés de VMS : - les dates des deux périodes d'arrêt distinctes de 10 jours, en cas d'impossibilité d'équipement avant le 15 janvier 2024. » Article 5 (1er paragraphe) : « Pour les navires ayant recours à l'exemption instaurée au point 1 de l'article 4 : 1. Le capitaine de pêche s'assure : - du fonctionnement effectif et veille au maintien en l'état des dispositifs techniques de réduction des captures accidentelles et/ou du système d'observation électronique à distance ; - du suivi du protocole scientifique validé d'évaluation de l'efficacité des dispositifs techniques par l'Etat et transmets les informations nécessaires et suffisantes selon les modalités du protocole. »
* 47 Règlement délégué (UE) 2024/3089 de la Commission du 30 septembre 2024 modifiant le règlement (UE) 2019/1241 en ce qui concerne des mesures visant à réduire les captures accidentelles de dauphin commun (Delphinus delphis) et d'autres petits cétacés dans le golfe de Gascogne.
* 48 Cette notion de statistique signifie qu'il y a 95 % de chances que le nombre réel soit bien compris entre la borne haute et la borne basse.
* 49 Dans l'instance n° 489928 qui, jointe à d'autres instances, a finalement conduit à la suspension partielle des dérogations prévues par l'arrêté du 23 octobre 2024.
* 50 Brest, Concarneau, Douarnenez, Le Guilvinec, Loctudy, Saint-Guénolé, Audierne et Roscoff (Finistère), Lorient et Quiberon (Morbihan) ainsi que Les Sables-d'Olonne, Noirmoutier et Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée).
* 51 Conseil d'État, Assemblée, 28 mai 1971, Ville Nouvelle-Est.
* 52 Rapport législatif n° 633 (2022-2023) de M. Alain Cadec sur la protection de la filière pêche et les mesures préconisées dans le cadre du « Plan d'action de l'Union européenne : protéger et restaurer les écosystèmes marins pour une pêche durable et résiliente » présenté le 21 février 2023 par la Commission européenne.
* 53 Pourcentage de la perte d'EBE non pris en compte dans le calcul de la compensation.
* 54 Décision de la directrice générale de FranceAgriMer, le 12 juin 2024.
* 55 Il n'est pas anecdotique à cet égard que le terme « filière » soit un terme technique communément utilisé en matière de pêche.
* 56 Rapport Ifremer du 31 octobre 2024, « Évaluation de l'impact socio-économique de la fermeture spatio-temporelle en 2024 dans le cadre du Plan d'action de réduction des captures accidentelles de petits cétacés dans le golfe de Gascogne. Réponse à une demande d'expertiser.
* 57 Les Illusionnistes : « Le gâchis n'en est pas moins immense. Les dédommagements versés aux centaines de pêcheurs français, espagnols et portugais immobilisés [ceux opérant dans les eaux françaises] pendant un mois se chiffraient en dizaines de millions d'euros. Une somme qui aurait pu financer dix ou quinze projets Delmoges ».
* 58 Pour les associations de protection de la nature, tant qu'une indemnisation est prévue en contrepartie de la fermeture, c'est le signe que la décision est temporaire et qu'une issue durable n'a pas été trouvée. Dans le détail, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) « partage cette volonté [de réouverture] à la seule condition que des mesures de gestion soient prises afin de réduire les captures accidentelles de petits cétacés en-deçà d'un seuil mettant en péril leur conservation ». France Nature Environnement (FNE) « ne partage pas vraiment cette volonté » et juge « difficile de s'engager à ce sujet tant qu'il n'y a pas de bilan de l'efficacité des mesures engagées ». Bloom « ne partage pas cette volonté [de réouverture], évidemment, puisque le problème n'a pas été réglé ».
* 59 « En tenant compte des estimations de captures accidentelles basées sur les données d'échouage, aucun des quinze scénarios proposés appliqués à la sous-zone VIII ne peut réduire les captures accidentelles de dauphins communs dans la sous-zone VIII et la division IX.a en dessous de la limite de prélèvement biologique potentiel (PBR) pour la population de l'espèce dans l'Atlantique du Nord-Est (c'est-à-dire 4 927 animaux par an). » « Sur la base des estimations de captures accidentelles dérivées des données de surveillance en mer, six des quinze scénarios appliqués à la sous-zone VIII sont susceptibles de réduire les captures accessoires dans le golfe de Gascogne et sur la côte ibérique (sous-zone VIII et division IX.a) en deçà de la limite de prélèvement biologique potentiel. »
* 60 OBServation, pour mieux comprendre les Captures Accidentelles d'espèces Marines protégées au travers du dispositif d'observation Électronique à distance (caméras embarquées).
* 61 Hormis pour la collecte de données pour d'autres espèces sensibles, si l'armateur donne son accord en ce sens.
* 62 Ces instituts techniques, financés par des cotisations professionnelles ainsi que par le compte d'affectation spéciale développement agricole et rural, sont regroupés dans une fédération dénommée Acta.
* 63 À l'article L. 912-3 du code rural et de la pêche maritime, il est notamment précisé que les comités régionaux ont pour mission « d'apporter un appui scientifique et technique à leurs membres ».
* 64 Pour mémoire, les données 2023-24 consolidées n'ont été rendues publiques que le 31 octobre 2024. Le calendrier devrait logiquement être similaire cette année.
* 65 Il faudrait cependant une forte anomalie statistique, dans l'estimation des captures accidentelles survenues l'hiver 2024-25, pour qu'une reconduction, au moins partielle, des mesures de fermeture spatio-temporelles soit une option complètement écartée - encore que le caractère ponctuel de ces données ne suffirait sans doute pas à tirer une conclusion générale sur l'inefficacité de ces mesures, après une première année au contraire particulièrement concluante. Au-delà des résultats de la deuxième année de fermeture, une grande partie des acteurs entendus a en effet souligné le besoin de disposer de moyennes triennales pour déterminer son efficacité.
* 66 Analyse de l'utilisation des PIngers à Cétacés pour les activités de pêche des chalutiers pélagiques et des fileyeurs (PIC).
* 67 LImitation des Captures Accidentelles de Dauphins cOmmuns dans le golfe de Gascogne.
* 68 Projet Mar2020-iNOVPESCA.
* 69 Il ne semble pas que des cas avérés d'accidents du travail aient été relevés en lien avec le maniement de ces équipements à ce stade. Il convient cependant de rappeler que le secteur de la pêche détient le triste record en termes de morts sur le lieu de travail, ce qui s'explique autant par les dangers inhérents à la mer que par l'isolement et les difficultés d'accès des secours en cas d'accident.
* 70 Question écrite n° 08 424 - 16e législature.
* 71 Une mission d'information de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale relative à cet enjeu rendra ses conclusions dans le cours de l'année 2025.
* 72 Auteur du livre La Pêchécologie. Manifeste pour une pêche vraiment durable, 2023, Quae.
* 73 Ce chercheur propose de généraliser cette logique à l'ensemble des problématiques de conciliation des activités de pêche et de la biodiversité.
* 74 Du nom d'une application utilisée sur la côte Ouest de l'Ecosse depuis 2020.
* 75 Une expertise scientifique collective Inrae-Ifremer « Agriculture, aquaculture, pêche : impacts des modes de production labellisés sur la biodiversité » rendra ses conclusions fin avril 2025.
* 76 Rapport d'information n° 742 (2021-2022) de M. Fabien Gay, Mmes Françoise Férat et Florence Blatrix Contat, « Information du consommateur : privilégier la qualité à la profusion ».
* 77 Article L. 644-15 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l'environnement.