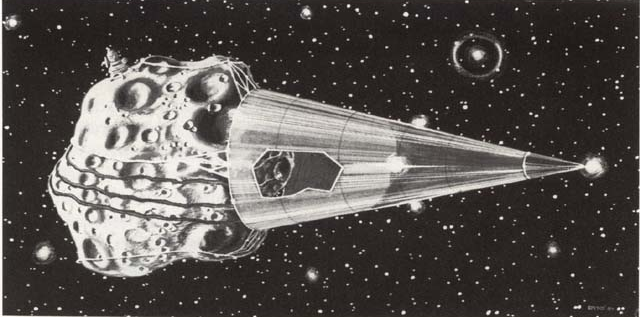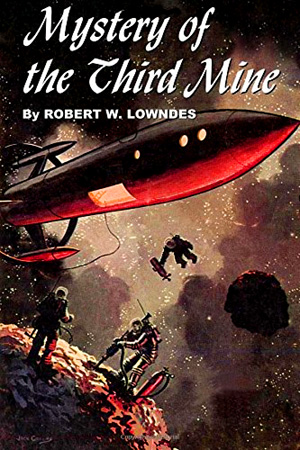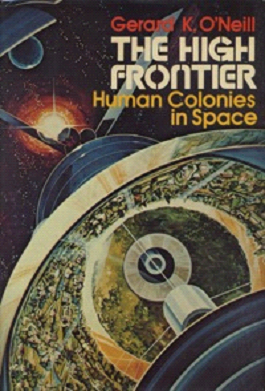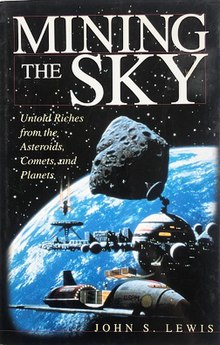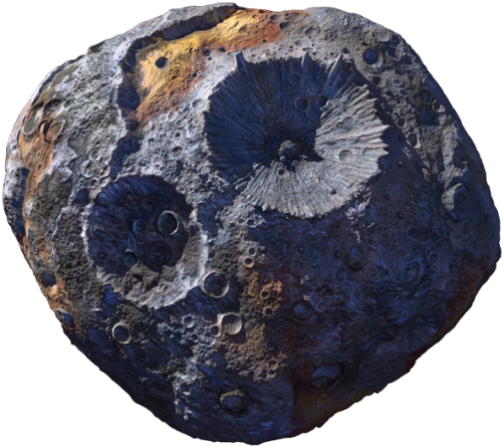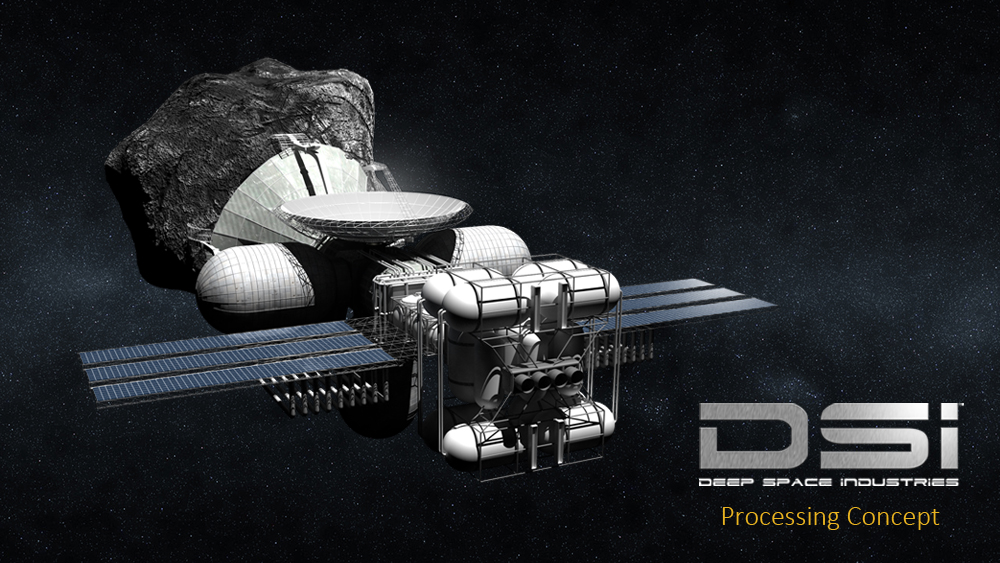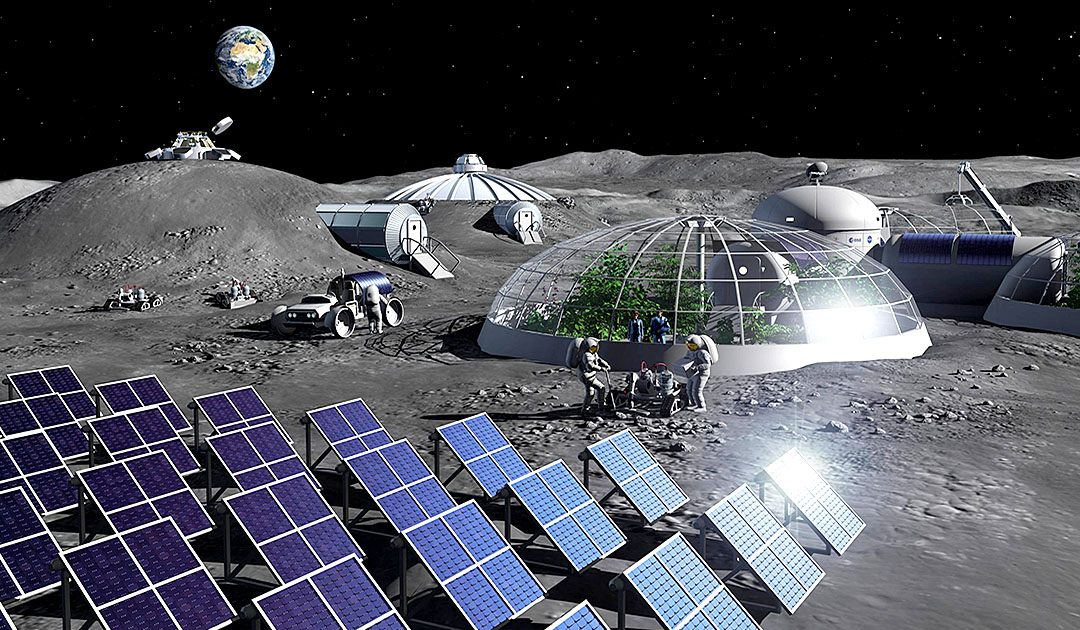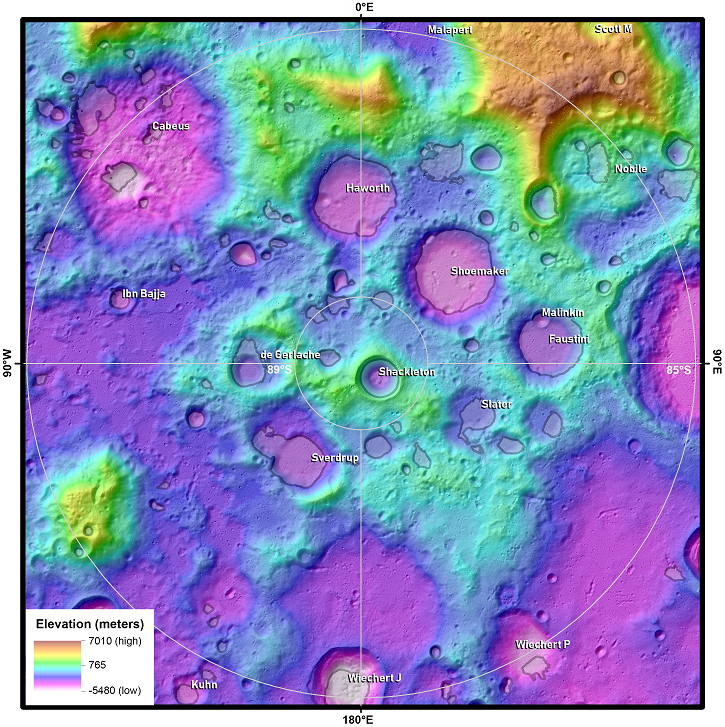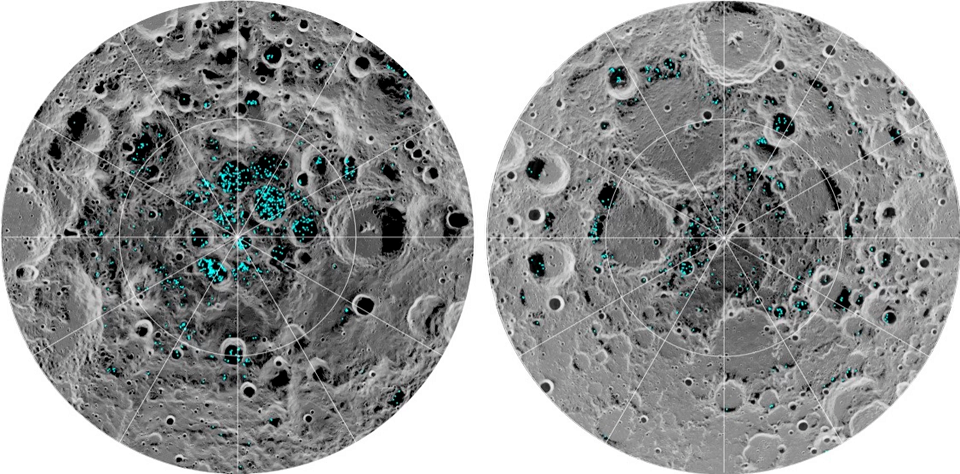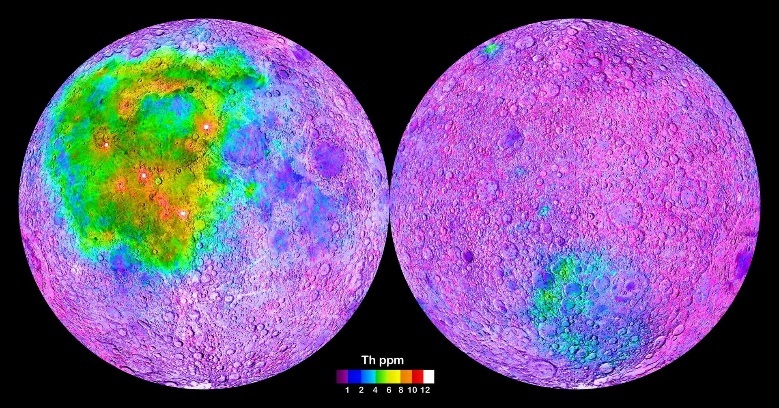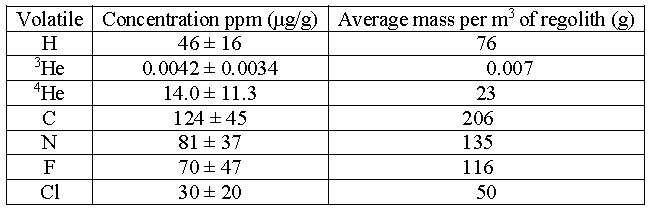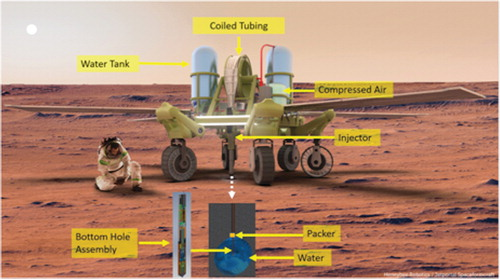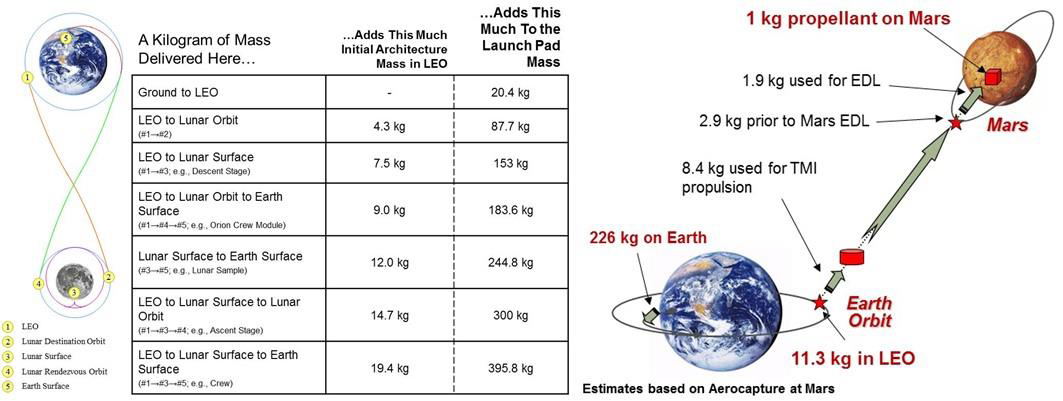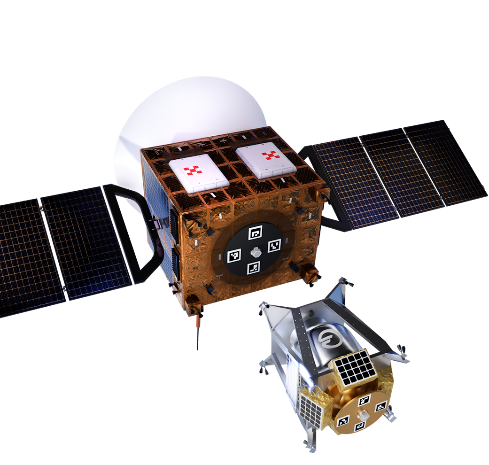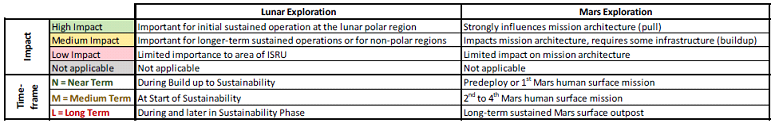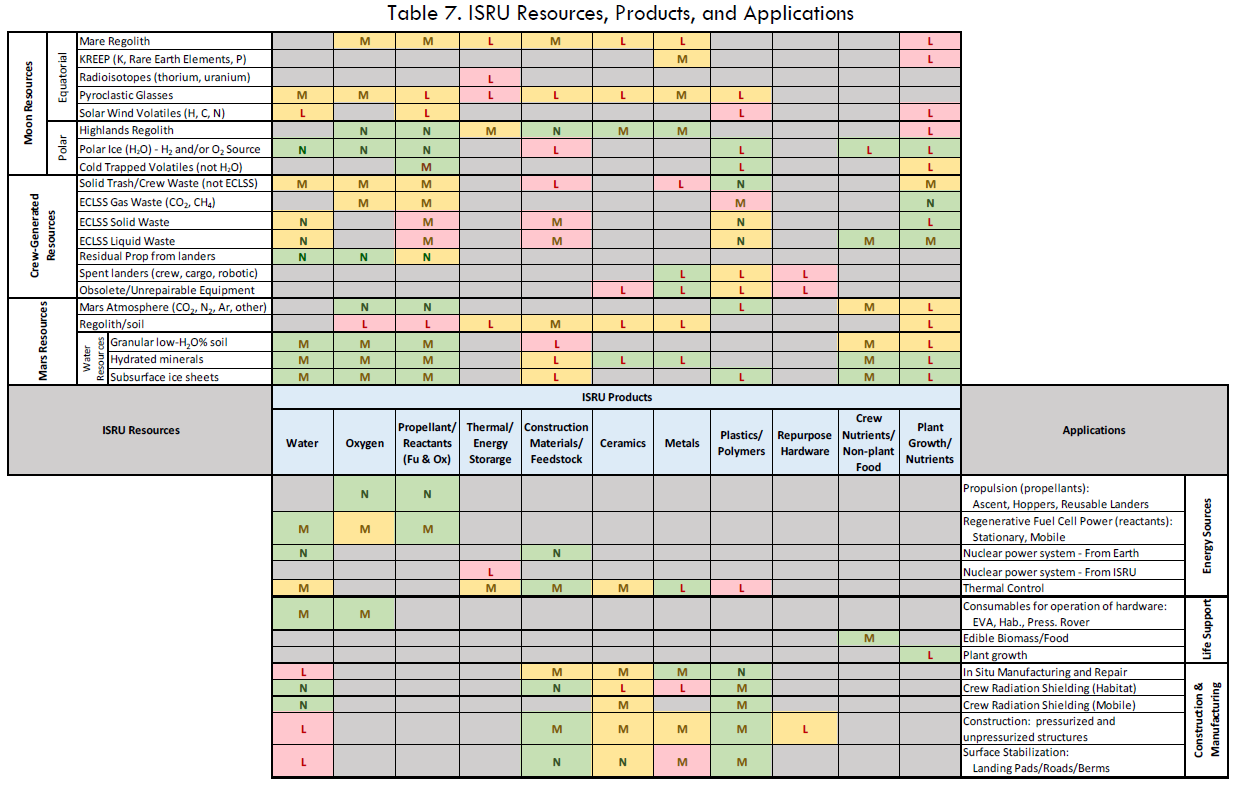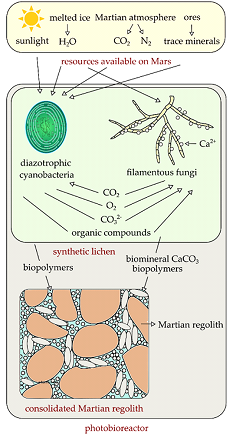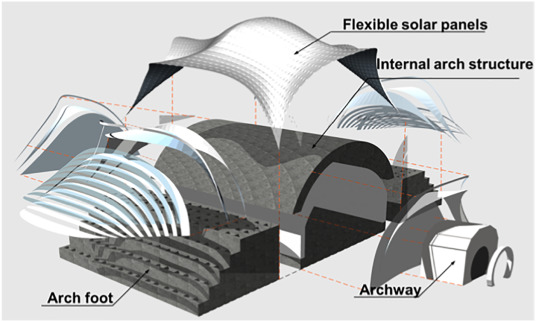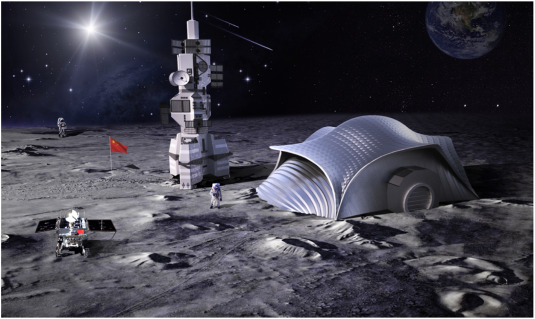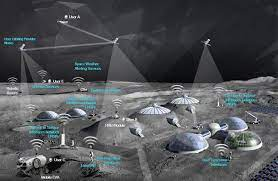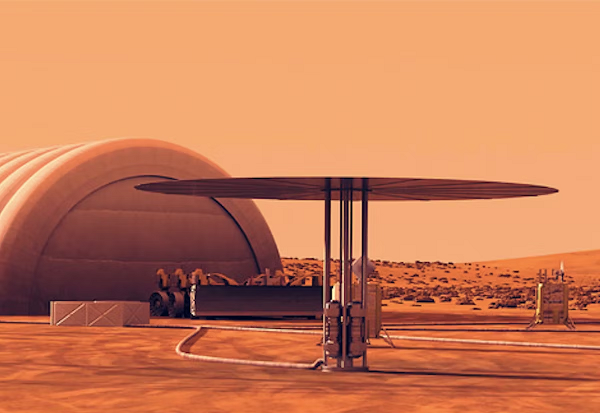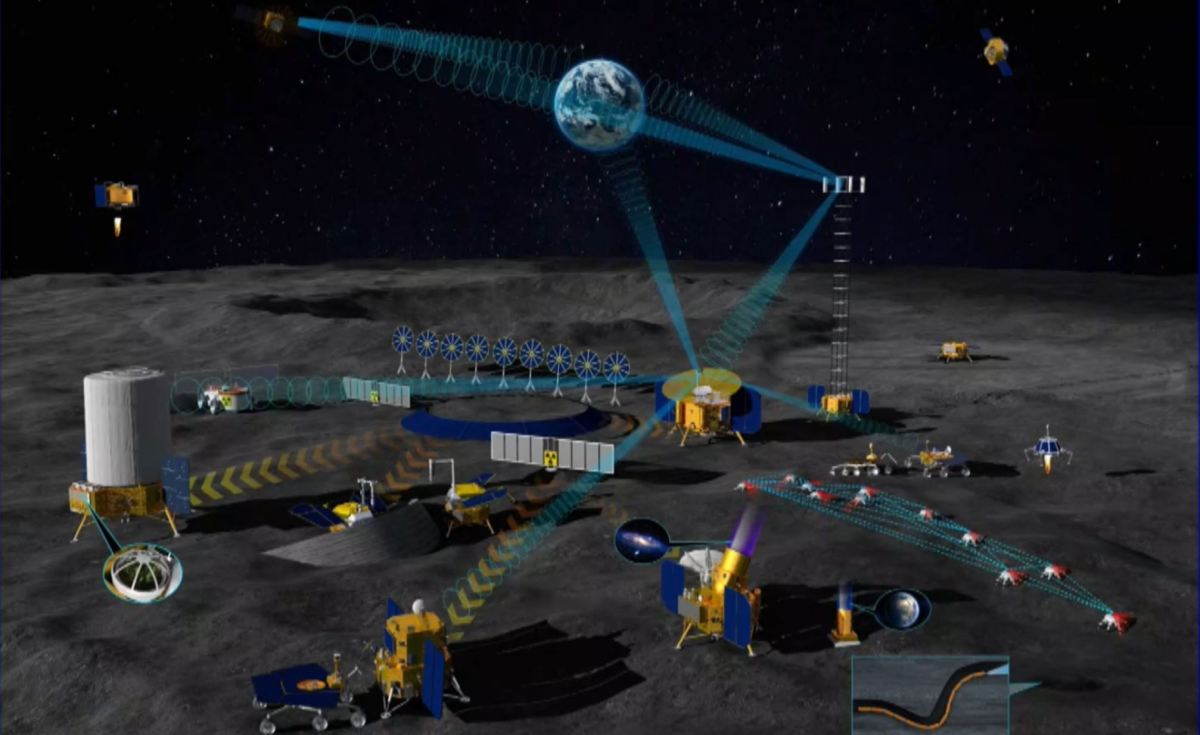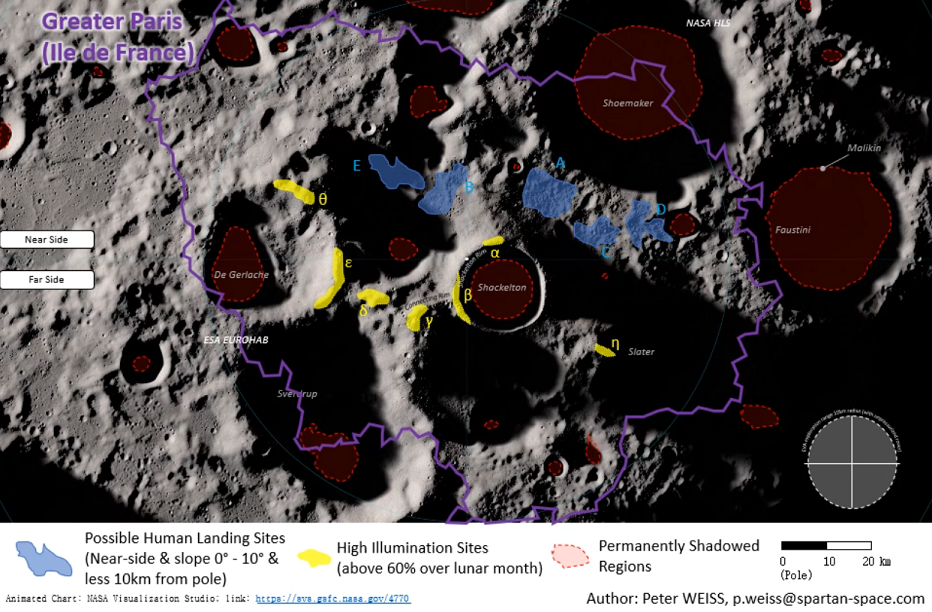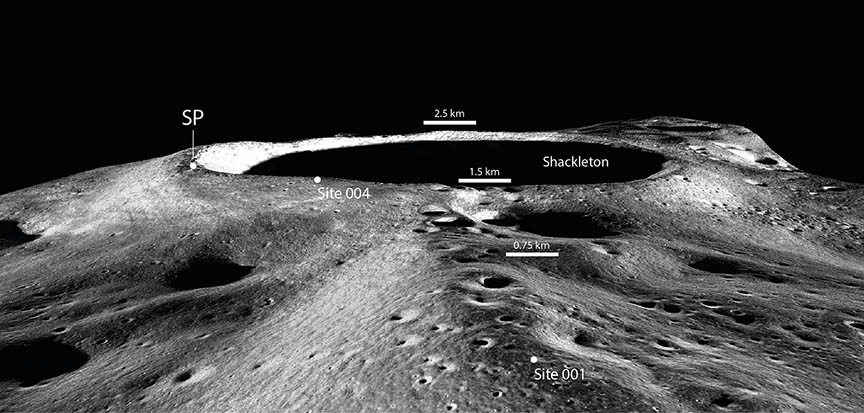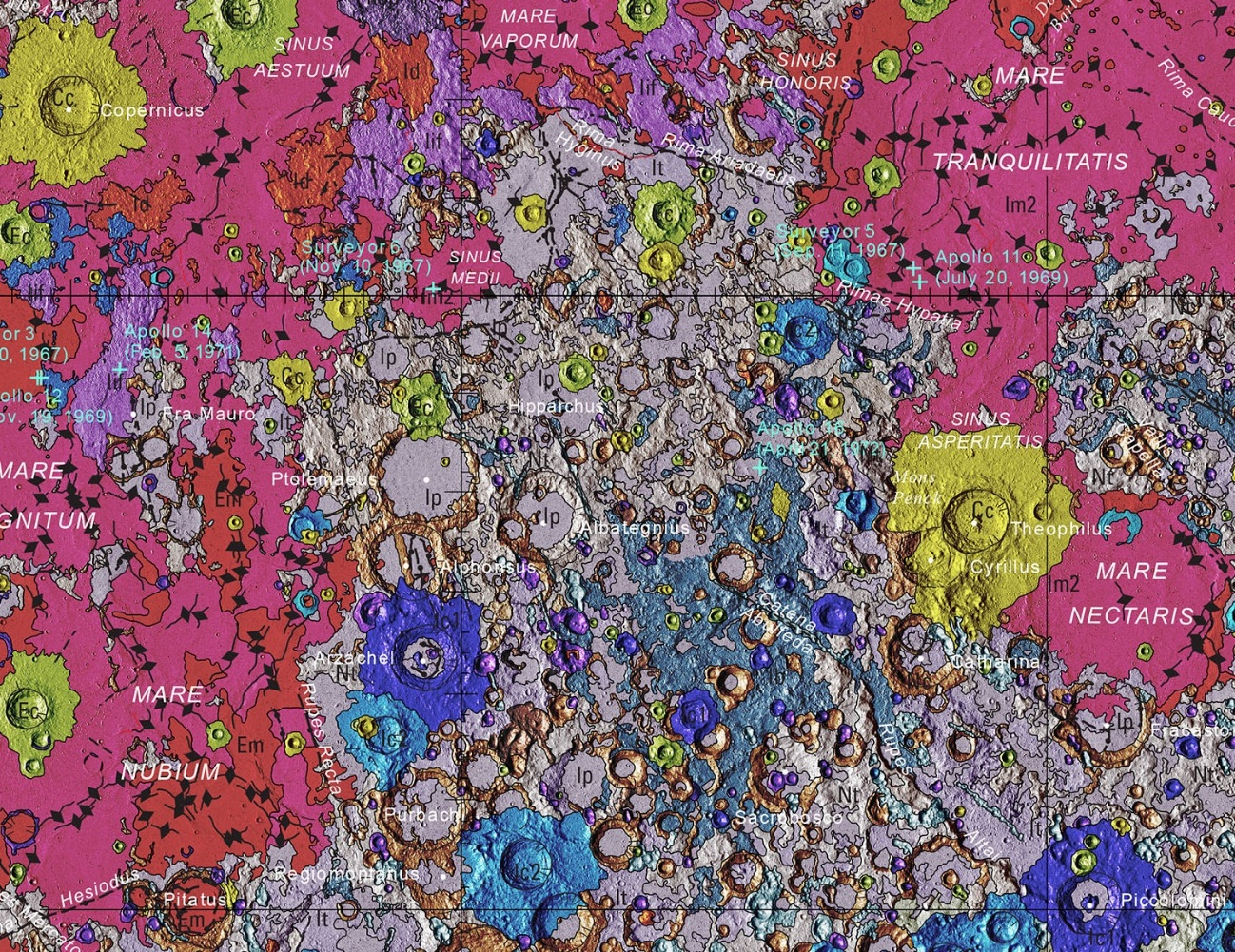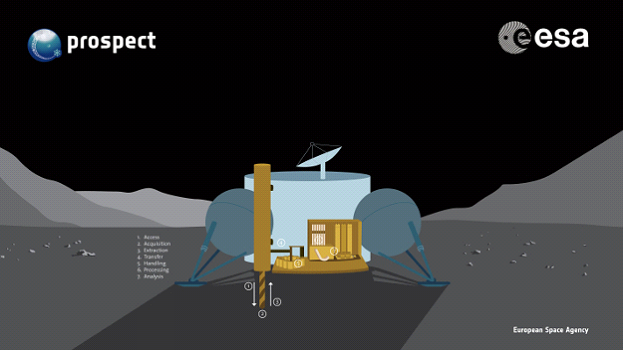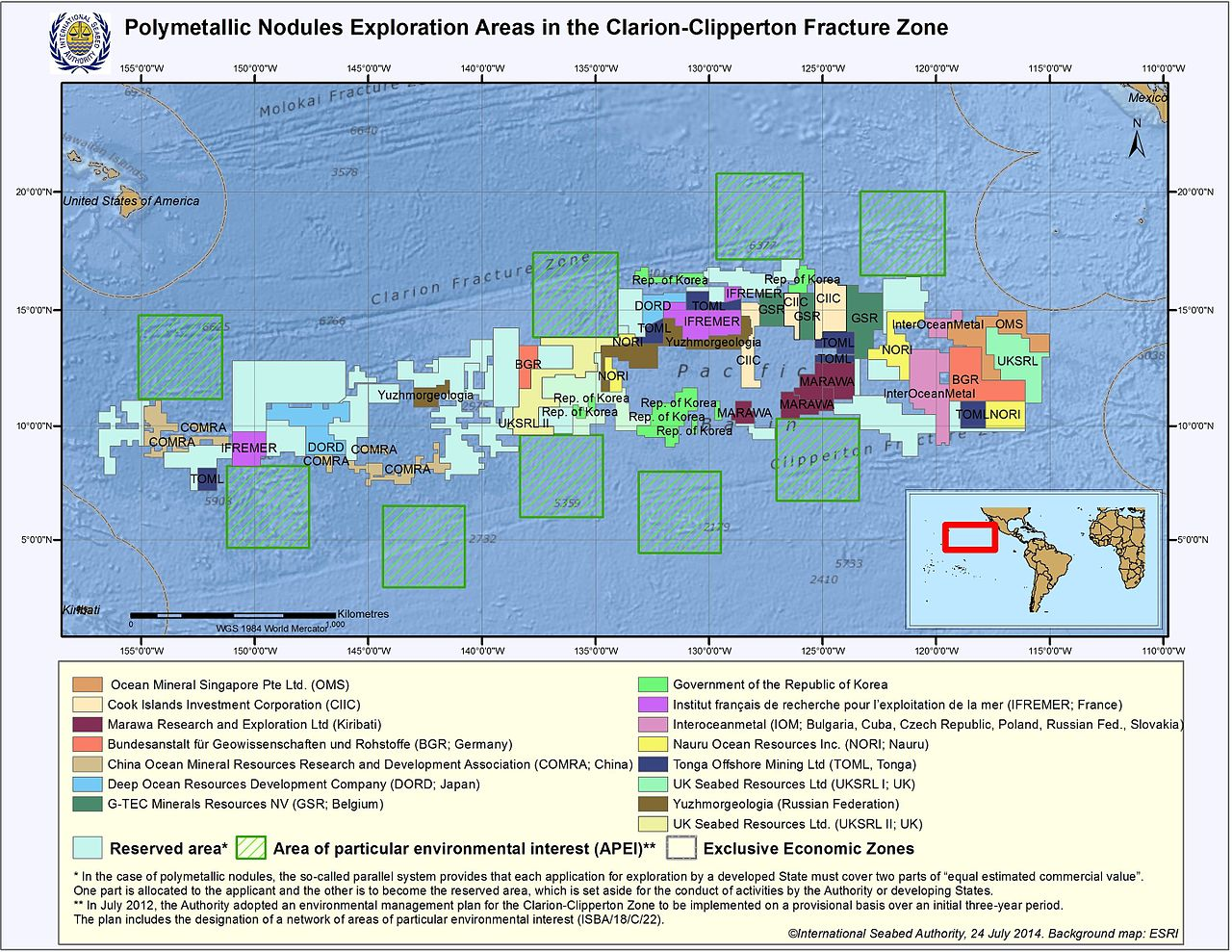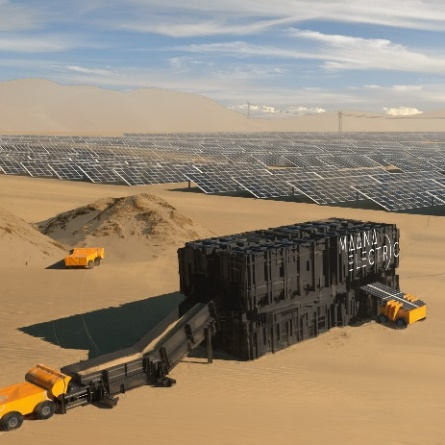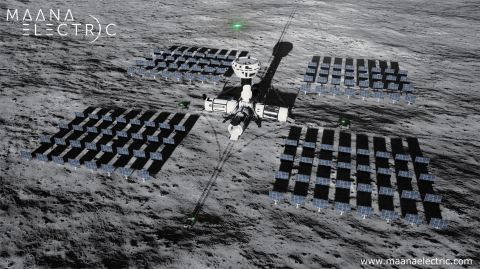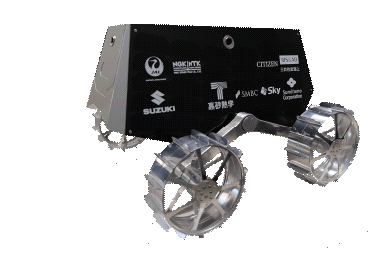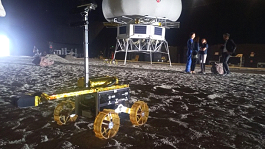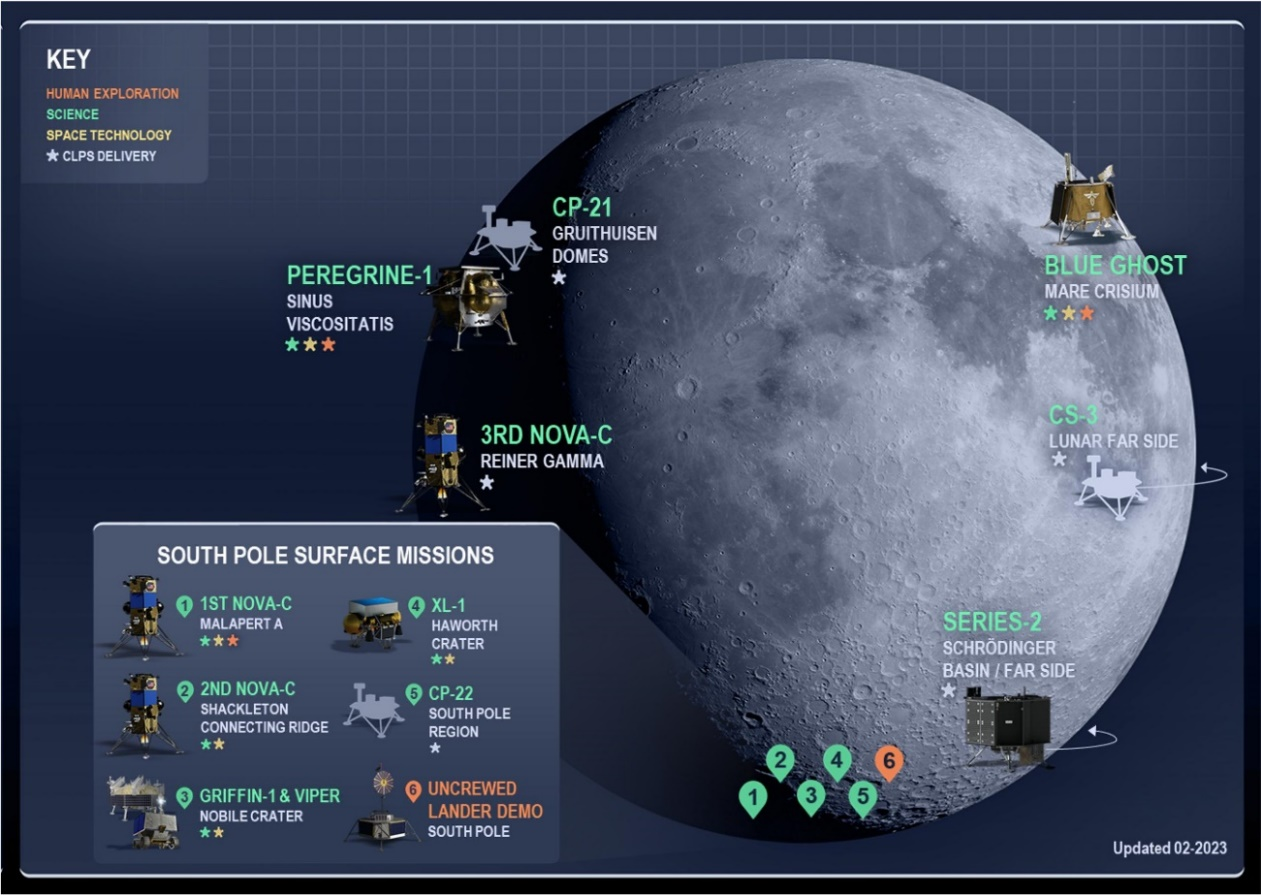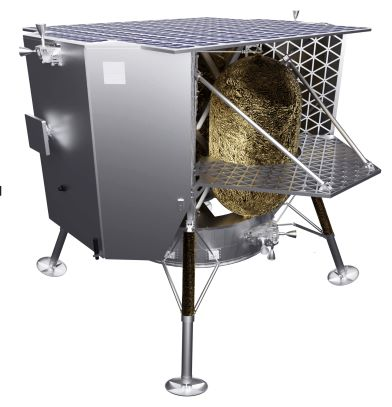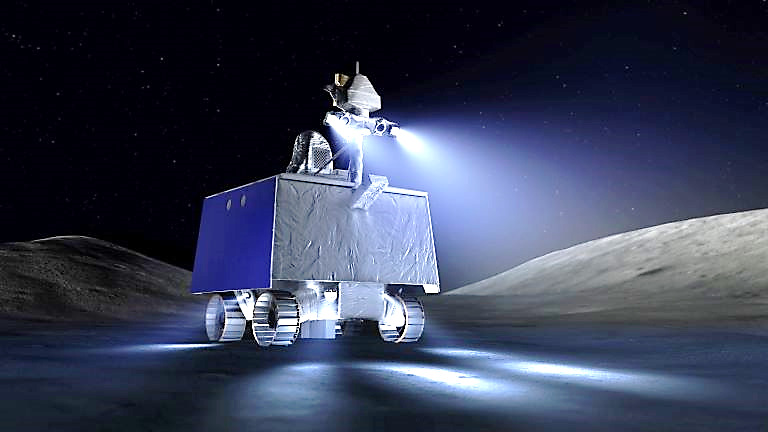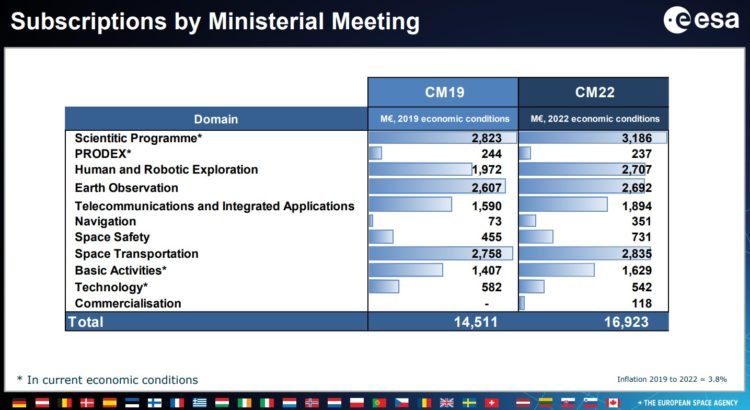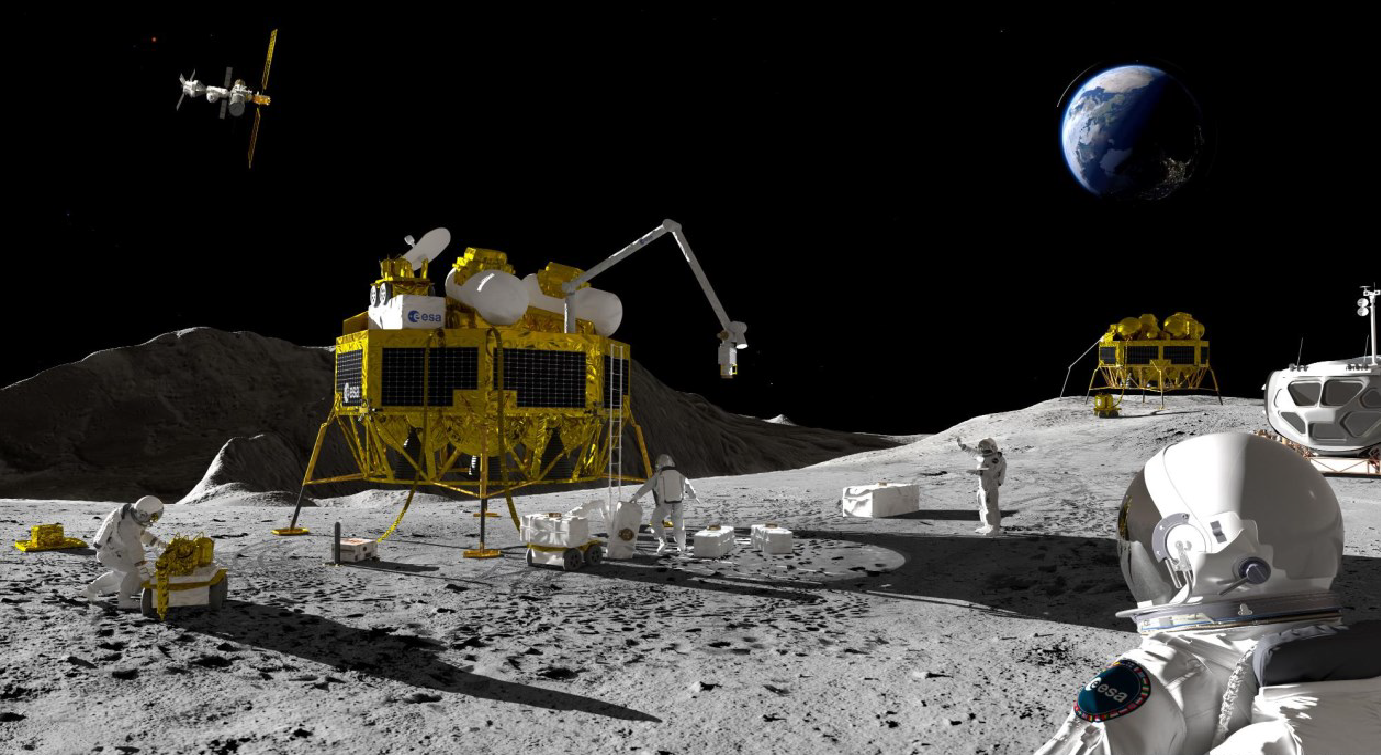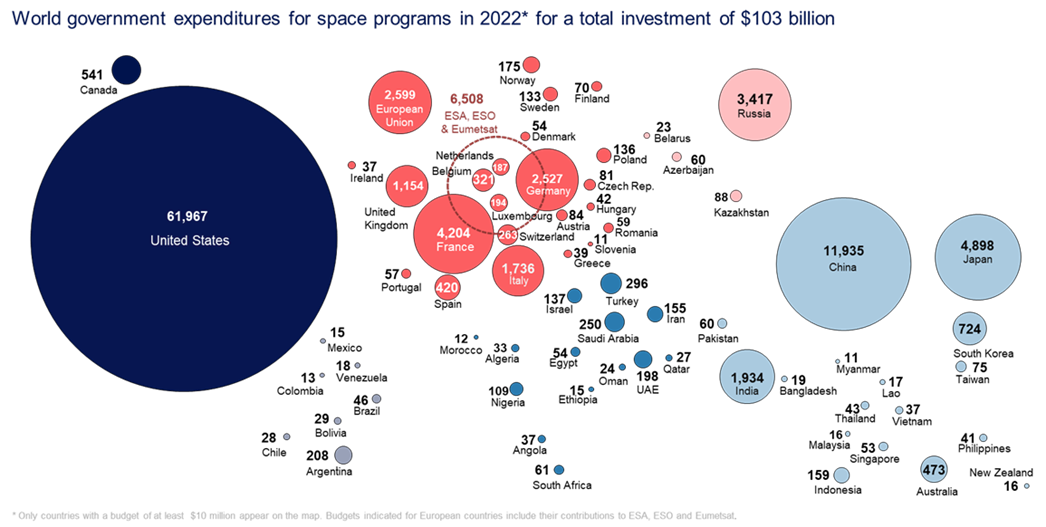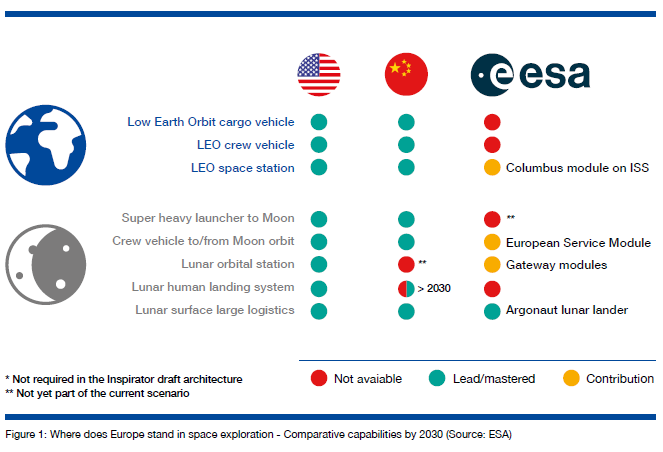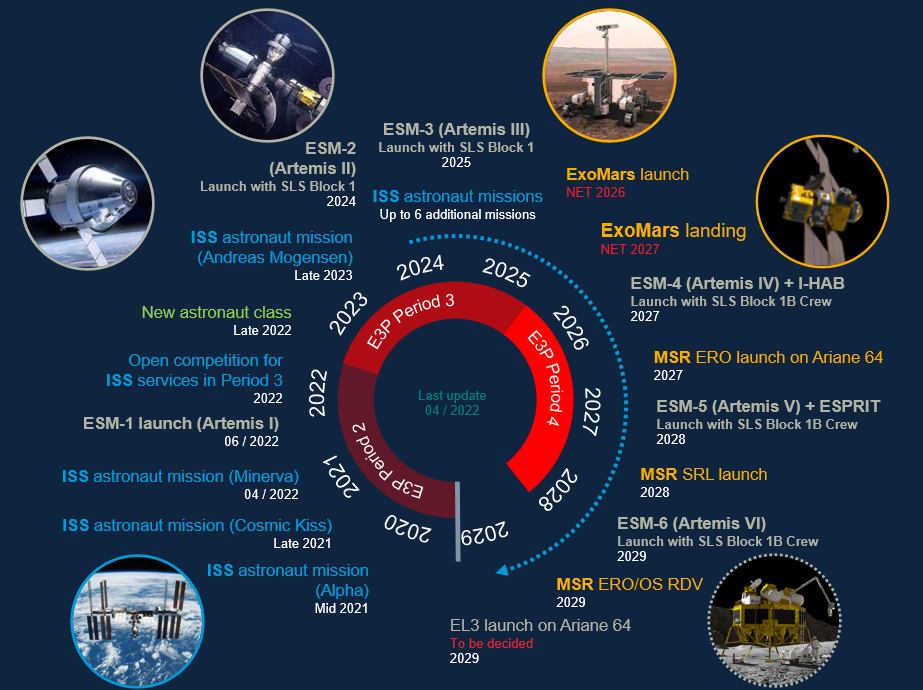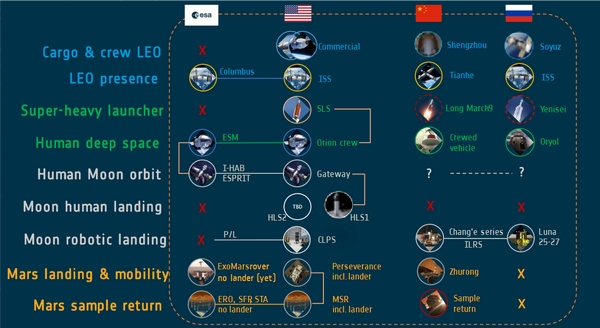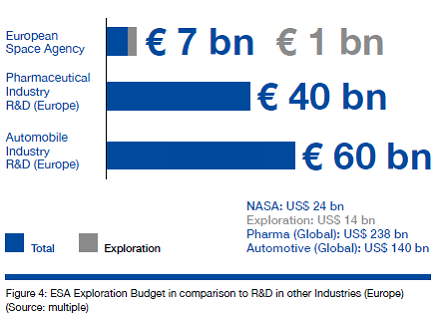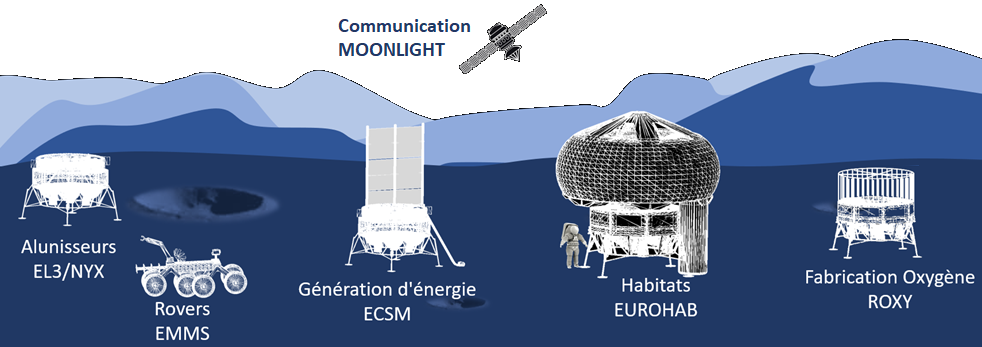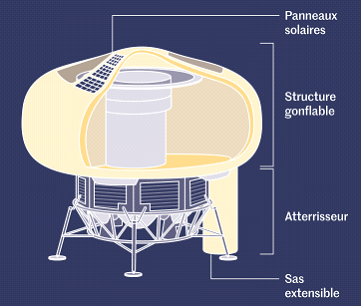- I. I. LES RESSOURCES SPATIALES : UN
THÈME DE SCIENCE-FICTION DEVENU IMPÉRATIF TECHNIQUE
- A. LE POIDS DE L'HÉRITAGE : ENTRE
DYSTOPIE LITTÉRAIRE ET SOLUTIONNISME TECHNOLOGIQUE
- B. UN ENJEU SOUDAIN CONCRET ET IMMÉDIAT, AU
CoeUR DES NOUVELLES AMBITIONS SPATIALES
- C. L'UTILISATION DES RESSOURCES IN-SITU
(ISRU) : UN ENSEMBLE DE TECHNOLOGIES AU POTENTIEL DISRUPTIF
- A. LE POIDS DE L'HÉRITAGE : ENTRE
DYSTOPIE LITTÉRAIRE ET SOLUTIONNISME TECHNOLOGIQUE
- II. EXTENSION DU DOMAINE DE LA LUNE :
L'IMPORTANCE STRATÉGIQUE ET ÉCONOMIQUE DES RESSOURCES
SPATIALES
- A. ASPECTS STRATÉGIQUES : AU CoeUR DE
LA RIVALITÉ ENTRE LA CHINE ET LES ÉTATS-UNIS
- B. ASPECTS JURIDIQUES : LA FIN DES ILLUSIONS
MULTILATÉRALES
- C. ASPECTS ÉCONOMIQUES : LA COMMANDE
PUBLIQUE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
- A. ASPECTS STRATÉGIQUES : AU CoeUR DE
LA RIVALITÉ ENTRE LA CHINE ET LES ÉTATS-UNIS
- III. LES RESSOURCES SPATIALES, UNE CARTE À
JOUER POUR LA FRANCE ET POUR L'EUROPE ?
- A. UN LEVIER AU SERVICE DE NOTRE AUTONOMIE
STRATÉGIQUE ET DE NOTRE SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE
- B. QUE FAIRE ? DEUX PROPOSITIONS
CONCRÈTES POUR AVANCER
- C. TABOUS POLITIQUES ET PANIQUE MORALE : LE
PREMIER COMBAT DES EUROPÉENS
- A. UN LEVIER AU SERVICE DE NOTRE AUTONOMIE
STRATÉGIQUE ET DE NOTRE SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE
N° 668
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023
Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er juin 2023
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation sénatoriale à la prospective (1) sur l'exploitation des ressources spatiales,
Par Mmes Christine LAVARDE et Vanina PAOLI-GAGIN,
Sénateurs
(1) Cette délégation est
composée de : M. Mathieu Darnaud, président ; MM.
Julien Bargeton, Arnaud de Belenet, Mmes Catherine Conconne, Cécile
Cukierman, M. Ronan Dantec, Mme Véronique Guillotin, M. Jean-Raymond
Hugonet,
Mmes Christine Lavarde, Catherine Morin-Desailly, Vanina
Paoli-Gagin, MM. René-Paul Savary, Rachid Temal,
vice-présidents ; Mme Céline Boulay Espéronnier, MM.
Jean-Jacques Michau, Cédric Perrin, secrétaires ; M.
Jean-Claude Anglars, Mme Catherine Belrhiti, MM. Éric Bocquet,
François Bonneau, Yves Bouloux, Patrick Chaize, Patrick Chauvet,
Philippe Dominati, Bernard Fialaire, Daniel Gueret, Mme Laurence Harribey, MM.
Olivier Henno, Olivier Jacquin, Roger Karoutchi, Jean-Jacques Lozach, Alain
Richard, Stéphane Sautarel, Jean Sol, Jean-Pierre Sueur, Mme Sylvie
Vermeillet.
L'EXPLOITATION DES RESSOURCES SPATIALES
L'exploitation des ressources spatiales n'a, aujourd'hui, plus rien du scénario de science-fiction. Certes, la capture d'astéroïdes métalliques et l'agriculture martienne ne sont pas pour tout de suite, mais le retour sur la Lune, lui, est prévu pour 2030 - autrement dit pour demain. Or aucune présence durable n'est possible sans utiliser les ressources locales, principalement l'eau glacée des cratères et le régolithe qui couvre la surface lunaire, pour produire de l'oxygène pour l'équipage, du carburant pour le vol retour ou des matériaux pour la construction.
Les enjeux ne sont pas seulement technologiques, ils sont aussi géopolitiques et économiques. La course aux ressources spatiales est au coeur de la rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis, et pour les entreprises, elle ouvre de nouvelles opportunités dont se saisissent des industriels et des start-up bien au-delà du secteur spatial traditionnel.
Mieux encore : la France et l'Europe, qui peinent à exister dans cette nouvelle course à l'espace, pourraient bien disposer là d'une précieuse carte à jouer. C'est en tout cas ce que propose le rapport : faire des ressources spatiales un levier d'autonomie stratégique et de souveraineté économique - mais cela n'ira pas sans avoir levé au préalable un certain nombre de tabous.
I. I. LES RESSOURCES SPATIALES : UN THÈME DE SCIENCE-FICTION DEVENU IMPÉRATIF TECHNIQUE
Évoquer le sujet de l'exploitation des ressources spatiales au-delà d'un cercle de spécialistes, et a fortiori dans le débat public, c'est d'emblée se heurter à la difficulté de faire comprendre qu'il ne s'agit pas, ou plus, de science-fiction.
Certes, le sujet est longtemps resté l'apanage de la littérature et du cinéma d'anticipation, et même s'il n'a rien d'irréaliste à long terme, le moins qu'on puisse dire est que les premiers projets concrets n'ont pas apporté la preuve de leur viabilité (I-A).
Tout a changé avec le lancement du programme Artemis et l'objectif d'établir une présence durable sur la Lune à horizon 2030, l'utilisation des ressources in situ (ISRU) devenant soudain un élément indispensable et un besoin à court terme. Les nouvelles perspectives ainsi ouvertes dépassent toutefois le seul retour sur la Lune, et concernent à la fois l'exploration lointaine et l'économie orbitale en développement (I-B).
Pour mieux saisir ces nouvelles perspectives, il est aujourd'hui utile d'avoir une approche systématique des différentes ressources, applications et technologies en jeu (I-C).
A. LE POIDS DE L'HÉRITAGE : ENTRE DYSTOPIE LITTÉRAIRE ET SOLUTIONNISME TECHNOLOGIQUE
1. Miner l'espace : un bon filon... pour Hollywood
a) Un motif ancien et récurrent des oeuvres de fiction
L'idée pour l'humanité d'exploiter les ressources naturelles d'autres corps célestes est ancienne, mais elle est longtemps restée cantonnée au domaine de la science-fiction, si ce n'est du fantastique.
La littérature regorge de tels exemples, parmi lesquels on peut citer le roman Edison's Conquest of Mars (1898) de Garrett Serviss, première apparition du minage d'astéroïdes - en l'occurrence un astéroïde composé d'or et exploité par les Martiens - ou encore la nouvelle The Asteroid of Gold (1932) où Clifford Simak propose une transposition de la ruée vers l'or du Klondike des années 1890.
Trois exemples : A Second chance at Eden de Peter Hamilton (1998), Mystery of the Third Mine (1953) de Robert Lowndes et Salvage in Space de Jack Williamson (1933).
Dans la bande dessinée, on pense immédiatement aux Aventures de Tintin d'Hergé, non pas tant aux albums Objectif Lune (1953) et On a marché sur la Lune (1954), où il est davantage question de fusées que de ressources, mais à L'Étoile mystérieuse (1942), où un banquier cupide cherche à s'emparer du métal inconnu (le « calystène ») d'un aérolithe tombé dans l'océan Arctique, qui finalement coule - non sans que Tintin ait pu en prélever un échantillon aux seules fins de la recherche scientifique.
Le thème est également très présent au cinéma : dans Alien (1979), de Ridley Scott, le vaisseau sur lequel est embarqué l'équipage du lieutenant Helen Ripley, le Nostromo, transporte du minerai pour le compte d'une compagnie que l'on devine peu soucieuse du droit du travail interstellaire dès lors que sa précieuse cargaison est en jeu.
Dans la série télévisée The Expanse (2015-2022) de Mark Fergus et Hawk Ostby, adaptée des romans de James Corey, l'accès aux ressources d'un Système solaire colonisé par l'humanité constitue l'enjeu principal de la lutte entre la Terre, Mars et l'Alliance des Planètes extérieures, en particulier l'eau et les matériaux extraits de la ceinture d'astéroïdes.
Le thème des ressources spatiales dans la fiction ne se limite pas à l'extraction minière : on peut citer le recyclage de carcasses de vaisseaux spatiaux (Isaac Asimov, The Martian Way, 1952) ou des composés complexes comme la « Protomolécule », un agent infectieux extraterrestre figuré dans The Expanse, ou l'« Épice » qui, dans le roman Dune (1965) de Frank Herbert, confère immortalité et aptitudes mentales supérieures.
b) Le grand méchant mineur de l'espace
Le plus souvent, toutefois, l'analogie avec l'industrie extractive est présente, et ce n'est pas un hasard : bien avant de devenir un objet d'étude scientifique ou un défi technique, l'exploitation des ressources spatiales a fourni à la fiction un excellent archétype, tenant dans l'espace le « mauvais rôle » dévolu à l'industrie minière sur Terre.
On y retrouve les mêmes grands thèmes : la cupidité et la course au profit, l'accaparement des richesses, l'oppression des peuples, la violence et la guerre, etc. C'est typiquement le cas de Dune, où l'exploitation de l'Épice se fait par la spoliation des habitants originels de la planète Arakis, et au seul profit d'une oligarchie lointaine incarnée par la Guilde du commerce. Beaucoup d'oeuvres se lisent d'ailleurs comme une critique du capitalisme, de la colonisation ou encore de la technologie.
Le thème de la destruction de la nature et de l'environnement est par conséquent lui aussi très présent. L'un des exemples les plus éloquents est le film Avatar (2009) de James Cameron : sur la planète Pandora, ce n'est pas seulement un peuple autochtone et pacifique (les Na'vis) qui est attaqué militairement par des humains assoiffés de ressources énergétiques, mais aussi son environnement avec lequel il vit en symbiose - un environnement forcément intact et luxuriant, incarné par un arbre géant.
Par l'imaginaire négatif qu'il associe à l'extraction minière, le genre du space opera apparaît en fait comme symétrique de celui de la fantasy : dans Le Seigneur des anneaux (1954-1955) de J. R. R. Tolkien, les mines souterraines, la métallurgie et l'industrie sont en toute subtilité associées... au Mal lui-même. Du reste, même dans le « futur », nul besoin d'aller dans l'espace pour trouver le même motif dystopique : ainsi, dans les films Soleil vert (1973) de Richard Fleischer ou Matrix (1999) des Wachowski, ce sont les humains eux-mêmes qui constituent la « ressource », dans un cas sous forme de poudre alimentaire pour nourrir le reste de l'humanité sur une planète exsangue, dans l'autre comme source d'énergie dans un monde dominé par des robots.
Certes, il arrive également que l'exploitation des ressources spatiales soit présentée de façon moins négative dans la fiction, mais son rôle est alors souvent limité à celui d'un décor, prétexte narratif ou contexte technologique davantage que message moral ou politique1(*).
Comme on le verra (cf. Partie III), l'imaginaire négatif généralement associé à l'industrie extractive dans la fiction n'est pas étranger aux difficultés qu'éprouvent aujourd'hui les décideurs politiques à assumer clairement une stratégie en matière d'exploitation des ressources spatiales, quand bien même cet imaginaire fantasmé n'aurait rien à voir avec la réalité et tout à voir avec des préjugés moraux, des malentendus scientifiques et des transpositions politiques hasardeuses.
2. La douloureuse épreuve du réel
a) Travaux de prospective et space advocacy
Le thème des ressources spatiales, pourtant, n'est pas l'apanage des auteurs de fiction : c'est aussi l'objet de nombreux travaux de prospective, c'est-à-dire d'études, ouvrages et autres rapports qui, sans pour autant prétendre au réalisme à court terme, élaborent des propositions techniques et suivent une démarche scientifique - une rigueur qui exclut, par exemple, de s'arranger avec les lois de la physique. Du reste, ces travaux sont souvent menés par des experts, chercheurs ou ingénieurs, et bénéficient pour certains d'un véritable soutien institutionnel, par exemple dans le cadre du NASA Institute for Advanced Concepts (NIAC), un programme de l'agence spatiale américaine qui permet de financer des recherches sur les technologies de rupture2(*), dont certaines concernent l'exploitation des ressources.
À l'inverse des oeuvres de fiction, ces travaux offrent généralement une vision positive et optimiste de l'exploitation des ressources spatiales, présentée comme une solution technique à un problème bien terrestre - la pollution, l'épuisement des ressources, la surpopulation, etc. - ou comme un élément-clé en vue de la conquête spatiale et de la colonisation du Système solaire par l'humanité.
Ce dernier aspect se rattache à la tradition de la space advocacy, très présente aux États-Unis où elle fait écho au mythe de la « Nouvelle frontière », et qui consiste à promouvoir le développement des activités humaines dans l'espace, notamment par et pour l'exploitation de ses ressources.
Parmi ses représentants les plus célèbres, on peut citer le physicien Gerard K. O'Neill, professeur à l'université de Princeton, fondateur du Space Studies Institute et auteur d'un ouvrage à l'influence majeure, The High Frontier : Human Colonies in Space (1976). On lui doit notamment le concept du « cylindre d'O'Neill », qu'on voit dans le film Interstellar (2014) de Christopher Nolan, qu'il proposait de construire à partir de matériaux extraits de la Lune et des astéroïdes, ainsi que plusieurs autres concepts liés à la fabrication spatiale et à l'établissement de colonies.
Robert Zubrin, fondateur de la Mars Society et inspirateur du projet Mars Direct de la NASA, en est un autre exemple (cf. infra).
Dans la période plus récente, des entrepreneurs comme Jeff Bezos ou Elon Musk se réclament également de la space advocacy - avec des moyens financiers sans commune mesure et des technologies nouvelles.
Il reste que, pour l'instant, les promesses d'une économie florissante fondée sur l'exploitation des richesses extraterrestres ne sont pas réalisées, et les différents projets présentés, pour stimulants qu'ils soient, n'ont jamais quitté la sphère abstraite des concepts futuristes, bien loin des capacités techniques, des moyens financiers et des priorités politiques des gouvernements.
Ces dernières années, toutefois, plusieurs projets concrets ont vu le jour en matière d'exploitation minière des astéroïdes et, dans une moindre mesure, d'hélium-3 lunaire.
b) Le minage d'astéroïdes : beaucoup d'or et peu de dollars
En dépit d'évidentes difficultés liées aux distances à parcourir, aux technologies à maîtriser et à l'incertitude des connaissances, l'exploitation minière des astéroïdes est depuis longtemps envisagée comme une réponse possible à la raréfaction des ressources terrestres, si ce n'est comme l'avenir même de la conquête spatiale.
Trop peu massifs pour avoir subi un processus de différenciation planétaire, les astéroïdes et autres planétoïdes du Système solaire conservent en effet à leur surface les matériaux présents à leur formation3(*), y compris les éléments métalliques susceptibles de servir à des applications de fabrication spatiale. Les cibles les plus évidentes sont les astéroïdes géocroiseurs (NEO, pour Near-Earth Objects), dont l'orbite autour du Soleil croise celle de la Terre à une distance relativement faible, et les rend donc potentiellement plus accessibles4(*). Environ 30 000 astéroïdes géocroiseurs ont été identifiés à ce jour5(*).
Parmi les ouvrages proposant leur exploitation, on peut citer Mining the Sky: Untold Riches from the Asteroids, Comets and Planets, publié en 1997 par le chimiste et professeur de planétologie John S. Lewis.
|
Soutenant que « l'épuisement des ressources n'est pas un fait, mais une illusion produite par notre ignorance », Lewis propose différents scénarios précis visant à répondre aux besoins sur Terre comme dans l'espace, et évalue chacun d'eux sous l'angle de ses bénéfices pour l'humanité, de sa faisabilité physique et de sa viabilité économique. À l'appui de son propos, il cite le cas de l'astéroïde 3554 Amun, qui bien qu'étant le plus petit des astéroïdes métalliques alors connus contiendrait à lui seul l'équivalent de 20 000 milliards de dollars6(*) de fer, nickel, cobalt et autres métaux précieux. |
Dans la période récente, l'exemple le plus cité est celui de l'astéroïde Psyché, le plus massif des astéroïdes métalliques connus, qui serait composé pour moitié de fer, de nickel, d'or et d'autres métaux précieux7(*) -représentant l'équivalent de 700 trillions de dollars, ou encore 93 milliards de dollars par personne, soit suffisamment pour subvenir aux besoins de l'humanité tout entière pendant des millions d'années.
|
Signe de l'intérêt porté au sujet, la sonde Psyché, financée par la NASA dans le cadre du programme d'exploration Discovery, devrait être lancée cette année pour étudier la composition de l'astéroïde et tenter de mieux comprendre les conditions de sa formation. La sonde devrait se placer en orbite en 2026. Vue d'artiste de Psyché. Source : NASA. |
Plusieurs missions de retours d'échantillons ont même été menées ces dernières années, comme les missions Hayabusa et Hayabusa2 de l'agence spatiale japonaise (JAXA) et OSIRIS-Rex de la NASA, et d'autres sont prévues, y compris par la Chine avec Tianwen-2, dont le lancement vers l'astéroïde Kamo'oalewa est prévu en 2024, et un projet sur Cérès. Les missions de retour d'échantillons, sur des astéroïdes comme sur la Lune ou sur Mars (cf. infra), constituent l'un des enjeux majeurs de la compétition entre grandes puissances spatiales.
Il ne faut toutefois pas confondre exploration et exploitation. Ces missions, comme du reste toutes celles envoyées à ce jour dans le Système solaire, sont des missions à vocation scientifique, et même si elles peuvent s'interpréter comme une forme de « prospection », elles sont très loin de démontrer la faisabilité d'une exploitation commerciale - rappelons à cet égard que l'ensemble des échantillons d'astéroïdes rapportés sur Terre à ce jour représente moins de sept grammes8(*), pour un coût cumulé de plus de deux milliards de dollars. À l'inverse, à supposer qu'il soit un jour possible de rapprocher de la Terre un astéroïde riche en métal précieux, le prix de celui-ci chuterait drastiquement. En d'autres termes, le minage d'astéroïdes pose à la fois un problème de faisabilité technique et de viabilité économique.
Cela n'a pas empêché plusieurs projets concrets de voir le jour depuis les années 2010, portés par des acteurs privés issus du New Space et visant une rentabilité économique.
Fondée en 2012, la société Planetary Resources, qui comptait parmi ses investisseurs et dirigeants Larry Page et Eric Schmidt (Google) ou encore le réalisateur James Cameron, projetait d'extraire l'eau d'un astéroïde afin de produire de l'hydrogène et de l'eau par électrolyse (cf. infra), afin d'alimenter un dépôt de carburant en orbite terrestre, à horizon 2020. La société Deep Space Industries (DSI), fondée en 2013, espérait quant à elle être en mesure d'extraire de l'eau et des métaux sur un astéroïde avant 2023.
L'un des concepts proposés par la société Deep Space Industries
Aucune de ces initiatives n'a toutefois abouti, et les entreprises ont fait faillite9(*), faute d'avoir pu démontrer aux investisseurs la viabilité de leur modèle économique. À ce jour, le minage d'astéroïdes se réduit donc à une bulle spéculative favorisée par le contexte porteur de l'émergence du New Space et la disponibilité du capital.
c) L'hélium-3 lunaire, un scénario de science-fusion
L'autre grande « promesse » souvent évoquée ces dernières années concerne l'utilisation de l'helium-3 lunaire pour la fusion nucléaire.
Cet isotope léger et stable (non-radioactif) de l'hélium pourrait en effet constituer un carburant idéal pour les centrales nucléaires à fusion contrôlée, car il permet de produire une quantité considérable d'énergie sans aucun déchet toxique ni sous-produit radioactif, sa fusion produisant seulement de l'hélium-4 et de l'hydrogène.
Repoussé par son champ magnétique, l'hélium-3 est rare sur Terre10(*), mais il est présent à la surface de la Lune, où les vents solaires le déposent en continu et où il se mélange au régolithe. D'après les données de la sonde orbitale chinoise Chang'e-1, les dépôts lunaires d'hélium-3 atteindraient quelque 100 000 tonnes, contre seulement 500 kg à la surface de la Terre, à une profondeur moyenne de 5 à 6 mètres et à des concentrations plus élevées dans les régions équatoriales. Or on estime que 200 tonnes d'hélium-4 suffiraient à satisfaire les besoins énergétiques de l'Europe et des États-Unis pendant une année complète : les réserves lunaires suffiraient donc à satisfaire les besoins de l'humanité en énergie propre pendant des siècles, voire des millénaires.
|
Concentration en hélium-3 (3He)
du régolithe lunaire, Source : Fa W. et Jin Y-Q, Icarus vol. 190, 2007. |
Figurant parmi les avocats les plus enthousiastes de cette cause, le géologue et astronaute Harrison Schmitt, dernier homme à poser le pied sur la Lune avec la mission Apollo 17, devenu par la suite sénateur, y a consacré un ouvrage entier en 2006, intitulé Return to the Moon : Exploration, Enterprise, and Energy in the Human Settlement of Space. D'après lui, le coût d'exploitation d'une tonne d'hélium-3 lunaire serait d'environ 1,5 milliard de dollars, contre 10 milliards de dollars pour la même quantité d'énergie en équivalent pétrole11(*), ce qui justifierait amplement le projet sur le plan économique.
Il existe toutefois deux bonnes raisons de ne pas partager cet optimisme.
D'une part, si la Lune offre davantage d'hélium-3 que la Terre, celui-ci est en réalité présent à des concentrations extrêmement faibles, de l'ordre de 4 parties par milliard12(*), et nécessiterait donc l'extraction et le traitement de quantités considérables de régolithe, sans compter la difficulté posée par son inégale répartition.
D'autre part, l'intérêt de l'hélium-3 est conditionné à la maîtrise de la fusion nucléaire, qui n'est pas attendue avant plusieurs décennies, voire pas avant la fin du siècle pour son utilisation à grande échelle, alors même que le projet ITER13(*), dont c'est l'objectif, constitue le plus grand programme scientifique mondial depuis Apollo. Dans ces conditions, l'intérêt à investir des sommes considérables dans son extraction sur la Lune pour un usage très hypothétique sur Terre apparaît peu évident.
3. Des perspectives qui demeurent crédibles à long terme
Si aucun projet concret n'a à ce jour abouti, il serait imprudent d'en conclure que l'exploitation des ressources spatiales est destinée à demeurer un thème de science-fiction. Bien au contraire, et en dépit des premiers échecs, elle demeure une perspective tout à fait réaliste à long terme, pour deux raisons : d'une part, elle est techniquement possible, d'autre part, elle pourrait devenir économiquement rationnelle.
S'agissant de la faisabilité technique, il est important de comprendre qu'il n'existe aucune limitation théorique ou obstacle de principe : pour immenses qu'ils soient, les défis à relever consistent pour l'essentiel à transposer des technologies déjà utilisées sur Terre au milieu spatial, où s'appliquent les mêmes lois physiques et où se déroulent les mêmes réactions chimiques. À cet égard, l'exploitation des ressources spatiales n'a strictement rien à voir avec des hypothèses fantaisistes comme le voyage interstellaire ou encore la colonisation d'exoplanètes - pour ne citer que quelques « classiques » de la science-fiction qui impliquent soit de violer les lois fondamentales de la physique (pour voyager plus vite que la lumière, se téléporter, etc.), soit de se placer dans un horizon temporel qui n'est ni celui d'une vie humaine, ni même sans doute celui de l'humanité, voire de la vie tout court. La ceinture d'astéroïdes, en comparaison, est à portée de main.
Deuxièmement, la limitation des ressources terrestres pourrait faire des ressources spatiales une alternative attractive, voire une solution incontournable. S'il existe une véritable limite à long terme, celle-ci ne concerne pas les ressources spatiales et les défis techniques à relever pour y accéder, mais bien les ressources terrestres. Or, de ce point de vue, les choses pourraient s'accélérer. Certes, les besoins de l'humanité en fer, cuivre ou aluminium, bien qu'à l'origine de tensions croissantes, ne devraient pas suffire à justifier les investissements considérables qu'impliquerait une production extraterrestre à grande échelle, toujours plus coûteuse - du moins dans un futur prévisible - qu'une amélioration des techniques d'extraction et de recyclage sur Terre.
Tel n'est pas le cas, en revanche, des métaux précieux entrant dans la composition des composants électroniques, en particulier les métaux du groupe du platine14(*) (iridium, osmium, palladium, platine, rhénium, rhodium, ruthénium). Compte tenu de leur disponibilité extrêmement limitée sur Terre et de l'augmentation des tensions internationales liées aux difficultés d'approvisionnement, l'exploitation minière des astéroïdes pourrait constituer une alternative économiquement viable à moyen terme.
À ces deux raisons fondamentales (faisabilité technique et rationalité économique), on pourrait ajouter une troisième, plus immédiate : la relance des programmes d'exploration spatiale, avec la Lune pour premier objectif.
B. UN ENJEU SOUDAIN CONCRET ET IMMÉDIAT, AU CoeUR DES NOUVELLES AMBITIONS SPATIALES
1. La condition sine qua non d'un retour sur la Lune
a) Le programme Artemis, point de bascule majeur
En avril 2019, le président des États-Unis Donald Trump annonce le retour d'une mission habitée sur la Lune pour 2024, cinquante ans après le premier pas de l'humanité dans le cadre de la mission Apollo 11. Formalisé l'année suivante par la NASA, le programme Artemis, qui vise désormais une première mission en surface en 2025, constitue de loin le programme spatial le plus ambitieux des dernières années15(*), et relance la course à l'espace entre les grandes puissances.
Son objectif à terme est d'établir la première base permanente habitée à la surface de la Lune, dans un triple but de recherche scientifique, de développement commercial et d'inspiration des générations futures, et afin de préparer « le prochain pas de géant » dans l'exploration du Système solaire : envoyer des astronautes sur Mars.
|
Le programme Artemis Prenant la suite et réutilisant des éléments du programme Constellation, lancé par George W. Bush en 2004 et annulé par Barack Obama en 2010 pour des raisons budgétaires, le programme Artemis est mené par la NASA, en partenariat avec les agences spatiales européenne (ESA), canadienne (CSA) et japonaise (JAXA), et comprend une importante contribution du secteur privé, ainsi qu'un volet international via les accords Artemis (cf. infra). Sur le plan technique, il repose sur les principaux éléments suivants : - le lanceur lourd Space Launch System (SLS) ; - le vaisseau spatial Orion, composé d'un module de commande (Crew Vehicule) et d'un module de service, de développement européen (European Service Module - ESM, cf. infra), qui permet de transporter quatre astronautes au-delà de l'orbite basse et de revenir sur Terre ; - la station spatiale Lunar Orbital Platform-Gateway (LOP-G), qui servira de relais avec la surface de la Lune ; - le vaisseau lunaire Human Landing System (HLS), un vaisseau entièrement nouveau chargé de transporter le fret et les hommes à la surface de la Lune depuis le Gateway. Pour effectuer cette mission, il sera dans un premier temps placé en orbite terrestre, puis ravitaillé en ergols, avant de rejoindre l'orbite lunaire où il prendra en charge le fret (jusqu'à 100 tonnes) et l'équipage. À la fin de chaque mission (jusqu'à 100 jours), il remontera en orbite lunaire ; - les atterrisseurs, rovers et équipements des missions robotiques. La phase I du programme Artemis (jusqu'en 2025) comprend trois missions principales : - Artemis I, dont le vol inaugural a eu lieu le 16 novembre 2022, et qui a permis de placer la capsule Orion (vide) en orbite lunaire puis de la faire revenir sur Terre ; - Artemis II, prévue pour 2024, sera la première mission habitée, d'une durée de 10 jours, avec quatre astronautes à bord de la capsule Orion ; - Artemis III, prévue pour 2025, permettra d'amener un équipage sur la Lune depuis le Gateway, grâce au Starship HLS. Elle devrait durer une trentaine de jours, dont six jours sur la Lune. À cela s'ajoutent plusieurs missions robotiques, afin d'assembler la station Gateway, de ravitailler le HLS ou encore de tester des équipements en surface, pour un total cumulé de 37 lancements. Le budget du programme Artemis pour la seule période 2021-2025 est estimé à 53 milliards de dollars16(*), voire à 93 milliards de dollars en incluant les développements antérieurs (programme Constellation notamment). La phase II du programme Artemis devrait débuter à partir de 2026, avec pour objectif final d'établir une base humaine permanente au pôle Sud. Les étapes intermédiaires, dont le calendrier et le financement restent à préciser, incluront des missions humaines et robotiques pour l'exploration, l'assemblage de la station lunaire et l'utilisation des ressources in situ. Pour remplir ses objectifs ambitieux dans les délais et éviter les dérives budgétaires, la NASA a fait le choix de sous-traiter aux entreprises privées une part importante du programme Artemis. C'est notamment le cas du vaisseau HLS, attribué en avril 2021 à la société SpaceX avec son Starship HLS17(*) pour les missions Artemis III et IV ; au-delà, la NASA pourra disposer d'un deuxième alunisseur, le Blue Moon de la société Blue Origin, comme cela vient d'être annoncé18(*). Le recours aux acteurs privés concerne aussi les modules de la station Gateway, les atterrisseurs et rovers des missions robotiques, ainsi que les prestations de lancement, de ravitaillement et de dépôt d'équipements à la surface, notamment dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS), destiné à préparer les futures missions habitées (cf. infra). |
Or, en matière d'exploitation des ressources spatiales, le lancement du programme Artemis a tout changé : il ne s'agit plus de science-fiction, ni d'un concept abstrait issu d'un laboratoire de prospective, mais d'un objectif de nature technique, et d'un impératif de court terme. Il s'agit aussi, derrière un même vocable, d'un changement d'objet, puisqu'il n'est plus question ici d'astéroïdes ou de fusion nucléaire, mais de poussière et d'eau lunaires.
En effet, contrairement aux missions Apollo menées dans les années 1970, qui ne duraient que quelques heures - le temps de planter un drapeau, de prendre quelques photos et de collecter des échantillons -, le programme Artemis, pour reprendre la formule désormais consacrée, consiste à « aller sur la Lune pour y rester », c'est-à-dire pour y établir une présence humaine durable, voire permanente.
C'est ce qui fait toute son ambition, mais aussi toute sa difficulté, les défis techniques à relever pour assurer la survie d'un équipage sur longue période étant incomparablement plus complexes. Il faudra en effet assurer son approvisionnement continu en oxygène, en eau et en nourriture, une source d'énergie fiable pour les bases, installations et véhicules, ainsi que la construction d'un habitat suffisamment protecteur, compte tenu des conditions extrêmes qui règnent à la surface de Lune : des nuits de 14 jours terrestres, une amplitude thermique de 300 °C (de -150 °C la nuit à +150 °C le jour), une poussière extrêmement abrasive (le régolithe), qui grippe les machines, s'infiltre dans les combinaisons et attaque les voies respiratoires, sans compter l'absence d'atmosphère qui expose les astronautes aux radiations et aux impacts de micrométéorites.
Tous ces besoins demandent des ressources, qu'il est théoriquement possible de faire venir depuis la Terre par une multiplication des lancements cargos, mais le coût d'un tel modèle apparaît rapidement insoutenable, d'autant que celui-ci s'accompagne de risques supplémentaires (échec d'un lancement, d'un alunissage, etc.), sans même parler de son impact sur l'environnement. Le problème pourrait être résolu en utilisant les ressources disponibles sur place, plutôt qu'en les faisant venir de la Terre.
Ceci implique la maîtrise d'un ensemble de technologies que l'on désigne collectivement sous le terme d'utilisation des ressources in-situ - ou ISRU, pour In-Situ Resource Utilization. Si ses applications potentielles vont bien au-delà du maintien d'une présence durable sur la Lune (cf. infra), c'est bien le programme Artemis qui a changé la donne, l'ISRU étant dans ce cadre à la fois indispensable - en l'absence d'alternative viable - et urgent -la Chine a aligné ses ambitions lunaires sur celles des États-Unis, et les deux puissances sont désormais engagées dans une course de vitesse.
Toutes ces considérations n'auraient pas lieu d'être s'il n'y avait, à l'origine, une double bonne nouvelle : d'une part, il y a bien sur la Lune des ressources exploitables, principalement l'eau et le régolithe, d'autre part, celles-ci permettent en théorie de répondre aux besoins les plus importants des premières missions humaines permanentes.
Vue d'artiste de la base lunaire Artemis. Source : NASA
b) L'eau : de l'oxygène pour l'équipage, du carburant pour les fusées
À défaut d'être la mieux documentée, l'eau présente à la surface de la Lune constitue, de loin, la ressource naturelle la plus intéressante. Si les échantillons rapportés par les missions Apollo ont un temps laissé penser que la Lune en était totalement dépourvue, les missions d'observation menées ultérieurement, en particulier Chandrayaan-119(*) en 2008 puis LCROSS20(*) et Lunar Reconnaissance Orbiter21(*) (LRO) en 2009 ont permis de conforter l'hypothèse d'une présence d'eau sous forme de glace, sans toutefois pouvoir trancher formellement entre eau et hydroxyle22(*).
En octobre 2020, le télescope stratosphérique SOFIA a permis une confirmation définitive23(*) en détectant directement sa signature moléculaire dans le cratère Clavius, où sa concentration est estimée entre 100 et 400 parties par millions, soit l'équivalent d'une canette de soda par mètre cube de régolithe, ou encore 0,4 gramme par litre. Par comparaison, le sable du Sahara contient environ 100 fois plus d'eau, mais de telles quantités restent suffisantes pour envisager une utilisation dans le cadre de l'exploration.
La ressource est toutefois loin d'être uniformément répartie. Les réserves les plus importantes se trouveraient sous forme de glace au fond des cratères du pôle Sud, du fait de la combinaison entre l'axe de rotation de la Lune, légèrement incliné24(*), et la topographie particulière des cratères, qui permet à certaines régions de ne jamais recevoir la lumière du Soleil et de conserver une température basse et constante, celle-ci ne dépassant jamais les -170 °C. Ces conditions permettent à l'eau de demeurer stable sous forme de glace pendant des millions, voire des milliards d'années, probablement sous forme de dépôts mêlés au régolithe, alors que sur le reste de la surface de la Lune, elle est rapidement dégradée par le rayonnement solaire25(*).
|
Carte topographique du pôle Sud de la Lune Source : Stopar J. and Meyer H., Regional
Planetary Image Facility, 2019, |
Les cratères du pôle Sud représentent à eux seuls la moitié de la surface des régions ombragées en permanence (PSR, pour Permanently Shadowed Regions) de la Lune, où règnent des conditions similaires. On estime que la Lune compte quelque 324 régions ombragées en permanence, inégalement réparties.
|
Répartition estimée de la glace d'eau à la surface de la Lune Pôle Sud Pôle Nord Source : NASA, d'après les données
du spectromètre |
Si sa présence en quantités suffisantes était confirmée, l'eau (H2O) pourrait, par un simple procédé d'électrolyse, être séparée en hydrogène (dihydrogène, H2) et oxygène (dioxygène, O2), ce qui permettrait de répondre à deux besoins majeurs.
Le premier est la production de carburant utilisable par les fusées, ces deux éléments constituant le mélange d'ergols liquides le plus utilisé par les moteurs-fusées actuels (LOX/LH2, cf. infra). Il serait ainsi possible de fabriquer sur place le carburant nécessaire au vol retour de l'équipage au lieu de l'apporter depuis la Terre, mais aussi d'en disposer pour d'autres services de transport (vol habité ou fret), dans le cadre de la mission ou non (cf. infra). L'atterrisseur Blue Moon de Blue Origin est d'ailleurs précisément conçu pour une utilisation dans le cadre de l'ISRU : ses moteurs utiliseront le mélange LOX/LH2, et son alimentation électrique sera assurée par des piles à hydrogène, ce dernier étant fabriqué sur place.
Le deuxième besoin concerne le support de vie (life support), c'est-à-dire l'approvisionnement de l'équipage en eau et en oxygène.
L'unité d'électrolyse, équipement relativement simple qui pourrait être livré et assemblé en amont par une mission robotique, a seulement besoin d'une source d'énergie pour fonctionner : là encore, l'hydrogène issu de l'électrolyse pourrait être utilisé dans un cercle vertueux, le cas échéant en combinaison avec les autres sources d'énergie envisageables (panneaux solaires, mini-réacteur nucléaire, etc.).
Par leur importance, ces deux applications suffisent à démontrer le rôle crucial de l'utilisation des ressources in situ.
c) Le régolithe : une poussière aux applications multiples
L'autre grande ressource de la Lune est son régolithe, c'est-à-dire la fine couche de poussière présente à sa surface, sur une épaisseur moyenne de trois à huit mètres, et composée à près de 45 % d'oxygène (O), principalement lié à d'autres éléments sous forme de silicates. Le régolithe est formé par le bombardement continu de la roche-mère par des météorites et par le dépôt d'autres éléments par les vents solaires et interstellaires. En raison de l'absence d'atmosphère, ces éléments ne sont pas soumis à l'érosion et tendent à s'accumuler.
Dans le détail, on distingue le régolithe des « mers lunaires » (Mare regolith), riche en fer et autres métaux qui lui donnent sa couleur sombre26(*), et le régolithe des « hauts plateaux » (Highlands regolith)27(*), plus pauvre.
Source : Wikipedia. Échantillons rapportés par les missions Apollo.
Sous sa forme brute, le régolithe peut d'abord servir de matériau de construction, soit directement (pistes, remblais, réservoirs, protection contre les radiations, etc.), soit pour la fabrication de briques ou l'impression 3D, entre autres techniques possibles (cf. infra).
À partir du régolithe lunaire, il est également possible de produire de l'oxygène, mais aussi des métaux, comme l'a démontré Airbus en 2020 avec le projet ROXY, qui constitue une première mondiale en la matière et ouvre d'importantes perspectives.
Le projet ROXY d'Airbus
Conduit par les ingénieurs d'Airbus Defence and Space et des chercheurs de l'Institut Fraunhofer pour les technologies de fabrication et les matériaux avancés (Dresde), de l'Université de Boston et d'Abengoa Inovacion (Séville), le projet ROXY (pour Regolith to OXYgen and Metals Conversion) a permis de démontrer la faisabilité d'une production d'oxygène et de métaux à partir de poussière lunaire simulée.
Le réacteur ROXY est une petite installation de conversion par réduction chimique, qui pourrait être utilisée dans le cadre de futures missions d'exploration. À l'exception du réacteur lui-même, aucun autre matériau ne doit être envoyé depuis la Terre.
Cette technologie pourrait avoir une place centrale dans la chaîne de valeur de l'ISRU, avec des applications telles que la fabrication d'oxygène pour l'équipage et/ou le carburant des fusées (en combinaison avec la glace des pôles), et la production d'alliages utilisés pour la construction ou la fabrication (notamment par impression 3D).
Source : Airbus Defence and Space, 27 octobre 202028(*)
Le régolithe lunaire est également riche en éléments tels que le potassium (K), les terres rares (rare-earth elements - REE) et le phosphore (P), collectivement désignés par l'acronyme KREEP, qui pourraient présenter un intérêt dans le contexte de l'ISRU, mais surtout, à plus long terme, dans le cadre d'une exploitation commerciale. Les dépôts riches en KREEP sont aussi relativement plus riches en uranium et en thorium, des éléments radioactifs utilisables - à plus long terme - pour la production d'énergie nucléaire.
|
Carte de la concentration en thorium de la surface
lunaire, La concentration en thorium est corrélée à la présence des KREEP. Source : NASA 200629(*) |
Enfin, le régolithe contient divers composés volatils déposés en continu par les vents solaires, tels que l'hydrogène (H), l'hélium (He) - dont l'hélium-3 évoqué précédemment -, le carbone (C), l'azote (N) et le fluor (F), qui sont tous susceptibles de trouver un usage, et qui sont parfois présents en des quantités significatives, sous forme d'agglutinats30(*) mêlés au régolithe. Hors des régions ombragées en permanence, les vents solaires sont ainsi les seules sources d'hydrogène et de carbone sur la Lune.
Concentration moyenne du régolithe lunaire en composés volatils
Source : ISRU Gap Assessment Report, 2021
Vue d'artiste d'une activité d'extraction de régolithe lunaire. Source : Dassault Systèmes
2. Objectif Mars : le futur de l'exploration spatiale
a) Mars : la Lune en plus loin
Le retour sur la Lune est explicitement présenté par les États-Unis, mais aussi par la Chine, comme une première étape permettant de préparer l'envoi d'une mission habitée sur Mars. Dans cette perspective, les missions lunaires permettent de développer, de tester et d'améliorer des technologies qui serviront ensuite aux missions martiennes, en particulier celles qui concernent l'utilisation des ressources locales pour assurer l'autosuffisance de l'équipage sur place et lors du vol retour.
Pour prendre la mesure des enjeux, rappelons que dans le scénario de conjonction31(*), la durée totale d'une mission sur Mars est de 30 mois, dont 18 mois sur place et 6 mois pour le vol aller et le vol retour, contre une durée totale de 12 jours pour les missions Apollo, le séjour sur place n'ayant jamais dépassé 3 jours. Ces conditions excluent tout ravitaillement régulier, toute intervention d'urgence ou toute assistance en temps réel32(*) depuis la Terre.
Comme sur la Lune, les besoins prioritaires seront la production de carburant pour les voyages et d'oxygène pour l'équipage (life support), et éventuellement la construction et la fabrication à partir de matériaux locaux. À cet égard, la capacité d'emport inédite du Starship - plusieurs dizaines de personnes ou 100 tonnes d'équipement dans un volume de 1 100 m3 -, candidat le plus crédible à ce jour pour les premières missions, permet d'envisager des applications nécessitant des installations assez importantes33(*) (forages profonds, « usines » relativement complexes, culture en système fermé ou hydroponie, etc.).
Si les besoins d'une mission martienne sont sans commune mesure avec ceux d'une mission lunaire, Mars offre également des ressources beaucoup plus intéressantes que la Lune, ce qui a conduit certains avocats de l'exploration spatiale à défendre une « priorité martienne » (d'où le nom du projet Mars Direct de la NASA, cf. infra).
Deux seront déjà familières au lecteur : le régolithe et l'eau.
b) Le régolithe : la Lune en plus rouge... et en plus vert
Bien qu'aucun échantillon du sol martien n'ait à ce jour été rapporté sur Terre (cf. infra), sa composition est connue, certes très partiellement, grâce aux missions orbitales et surtout aux rovers de la NASA, dont les deux plus récents, Curiosity (2012) et Perseverance (2021), sont toujours actifs. Ils ont été rejoints par le rover chinois Zhurong (2021).
Le sol martien, recouvert de sable, de fine poussière et de morceaux de roche, contient de nombreux éléments potentiellement utiles dans le cadre des futures missions34(*) : du fer, bien sûr, qui lui donne sa couleur rouge, mais aussi d'autres métaux et minéraux, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène35(*), et des argiles, ce qui permet d'envisager la fabrication d'acier, de plastique, de verre et de céramique, l'impression 3D constituant ici une technologie cruciale.
Utilisé comme matériau de construction, le régolithe martien offre davantage de possibilités que son équivalent lunaire, et plusieurs techniques sont à l'étude pour la fabrication de briques de régolithe, voire d'un véritable « béton martien » à l'excellente résistance (cf. infra).
Surtout, le sol martien permet l'agriculture, car il contient déjà les nutriments nécessaires aux plantes36(*) : magnésium, sodium, potassium, calcium, zinc, fer, soufre, etc. Des chercheurs ont d'ores et déjà démontré qu'il était possible de cultiver des plantes (pommes de terre, légumineuses, laitues, tomates, blé, etc.) dans le sol martien sans ajouter aucun nutriment, au cours de plusieurs expériences menées avec un régolithe martien simulé37(*) - le régolithe lunaire produisant des résultats sensiblement moins bons.
|
Dans un premier temps au moins, les plantes pourraient être cultivées en environnement contrôlé, dans des modules dédiés. De nombreux projets sont en développement, des synergies existant entre usages spatiaux et terrestres. |
Source : NASA |
Les plantes pourraient aussi être cultivées directement dans le sol martien (purifié), à l'abri de serres permettant de conserver la chaleur38(*) et de les protéger des rayonnements ultra-violets, ceux-ci n'étant pas suffisamment absorbés par la fine atmosphère de Mars (cf. infra). Celle-ci a cependant le mérite d'exister, offrant à la fois du dioxyde de carbone nécessaire à la photosynthèse et de l'azote pouvant servir à fertiliser les sols, tout comme les excréments humains et le compostage des déchets alimentaires, pratiqués à bord de l'ISS. Certes, tout ceci ne suffit pas à reproduire l'environnement auquel les plantes sont habituées sur Terre, mais celles-ci pourraient être adaptées à l'environnement martien par modification génétique (on sait par exemple accroître la capacité de photosynthèse par cette technique).
Outre l'alimentation de l'équipage, l'agriculture in situ ouvre des perspectives en matière de fabrication de médicaments ou de construction à partir de composés organiques (cf. infra).
Le sol martien n'a toutefois pas que des avantages. Tout d'abord, il est toxique, à la fois pour les plantes et pour les humains, du fait de sa forte concentration (0,6 %) en perchlorates, et devra donc être purifié en vue d'un usage agricole.
La poussière martienne présente également un danger pour la santé humaine, et pourrait être cancérigène, à l'instar du régolithe lunaire. Or la surface de Mars est régulièrement balayée par des tempêtes de poussière.
c) L'eau : la Lune en plus blanc
On sait aujourd'hui que l'eau, sous forme de glace, est abondante à la surface de Mars39(*), dans des quantités sans commune mesure avec celles qui pourraient - sous toutes réserves - exister à la surface de la Lune. Près de 5 millions de km3 d'eau ont été détectés à ce jour, ce qui permettrait en théorie de couvrir la totalité de la planète sur une épaisseur de 35 mètres.
Si la calotte glacière du pôle Nord40(*) est le seul endroit où elle est directement visible, elle est également présente à faible profondeur à des latitudes plus tempérées, dans le permafrost. En 2016, la NASA a annoncé avoir détecté un vaste dépôt de glace sous la surface d'Utopia Planitia, le cratère où s'était posé le rover Viking 2 en 1976 et qu'explore aujourd'hui Zhurong ; le volume d'eau détecté permettrait de remplir le Lac Supérieur, le plus grand lac d'eau douce terrestre41(*). Plus récemment, fin 2021, une météorite de 200 tonnes s'est écrasée à la surface de Mars : autour du cratère, pourtant situé dans l'une des régions les plus chaudes, la sonde InSight a observé de petits points blancs - des blocs de glace -, qui laissent penser que l'eau pourrait être encore plus abondante que supposé.
En revanche, elle n'existe pas, ou plus42(*), à l'état liquide, et la surface est donc très sèche.
Comme sur la Lune, l'eau pourrait être utilisée pour les besoins de l'équipage et pour la production d'ergols, avec de nouvelles possibilités sur ce dernier point (cf. infra, réaction de Sabatier). Elle est aussi indispensable à l'agriculture, et pourrait, entre autres usages, entrer dans la fabrication de briques et autres matériaux de construction.
Son extraction constitue naturellement un important défi technique, mais sans doute moindre que sur la Lune, la transposition de méthodes utilisées sur Terre étant ici plus facile. Par exemple, le système RedWater, développé spécifiquement pour l'extraction d'eau martienne par la société Honeybee Robotics, repose sur des technologies déjà utilisées dans les stations polaires en Antarctique ou au Groenland, dont le procédé Rodwell, qui consiste à faire fondre la glace à la profondeur où elle se trouve, et à pomper directement l'eau dans le réservoir ainsi créé. Le rover RedWater est capable de forer jusqu'à 25 mètres de profondeur, ce qui devrait être plus que suffisant sur Mars.
Le rover RedWater. Source : Honeybee Robotics / Jennifer L. Heldmann et al., 2022.
d) L'atmosphère : les promesses de la propulsion au méthane
Enfin, et contrairement à la Lune, Mars possède une atmosphère, qui, bien que ténue, avec une pression de l'ordre de 1 % de celle de la Terre, a l'avantage d'être composée à 95 % de dioxyde de carbone (CO2), avec de l'azote (2 %) et d'autres gaz.
À partir du CO2, il est possible de fabriquer de l'oxygène, comme l'a démontré sur place l'expérience MOXIE du rover Perseverance, avec les applications déjà évoquées en matière de production de carburant et de support de vie. Il s'agit à ce jour de la seule expérience d'extraction d'une ressource naturelle sur une autre planète en vue d'une utilisation dans le cadre d'une mission habitée.
L'expérience MOXIE du rover Perseverance
Menée par les chercheurs du Haystack Observatory (MIT) et du Jet Propulsion Laboratory (JPL - NASA/Caltech) avec l'entreprise OxEon Energy, l'expérience MOXIE (pour Marx Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) consiste en un démonstrateur embarqué à bord du rover Perseverance dans le cadre de la mission Mars 2020 de la NASA.
Le 20 avril 2021, MOXIE a produit 5,37 g d'oxygène (O2) à partir du CO2 de l'atmosphère martienne grâce à un procédé d'électrolyse à oxyde solide, soit l'oxygène nécessaire à un astronaute pour respirer pendant environ 10 minutes.
La capacité du démonstrateur est toutefois supérieure, avec une production théorique maximale de 12 g par heure, et d'après la NASA, il est envisageable d'envoyer sur Mars une unité de production 200 fois plus grosse que MOXIE qui, avec la même technologie, pourrait atteindre une capacité de 2 kg d'oxygène par heure.
Dans la perspective d'une mission martienne habitée dans les années 2030, cette unité pourrait être envoyée en amont dans le cadre d'une mission robotique, afin de produire et stocker l'oxygène en des quantités suffisantes pour assurer non seulement le support de vie de l'équipage43(*) (une tonne d'oxygène correspond aux besoins de quatre personnes pendant un an) mais aussi le redécollage de la fusée pour le retour (25 tonnes d'oxygène).
Source : NASA / Hecht, M., Hoffman, J., Rapp, D. et al. Mars Oxygen ISRU Experiment (MOXIE). Space Sci Rev 217, 9 (2021). https://link.springer.com/article/10.1007/s11214-020-00782-8
Surtout, le CO2 de l'atmosphère martienne permet de produire du méthane (CH4) grâce à la réaction de Sabatier, ouvrant la voie à l'utilisation de moteurs fonctionnant avec un mélange méthane liquide d'oxygène liquide (LOX), un couple d'ergols bien plus intéressant que les mélanges LOX/LH2 (oxygène et hydrogène liquides44(*)) et LOX/RP-1 (oxygène liquide et kérosène45(*)) traditionnellement utilisés par les lanceurs moyens/lourds et super-lourds.
Or c'est précisément ce mélange qu'utilisent les moteurs Raptor qui équipent le Starship de SpaceX, et ces moteurs à combustion étagée, performants, moins polluants que les moteurs au kérosène et entièrement réutilisables, sont explicitement conçus pour permettre l'exploration et la colonisation de Mars et pourraient, à en croire Elon Musk, diviser le coût du voyage par cent. Le moteur Prometheus, prototype étudié par l'ESA pour équiper Ariane Next à horizon 2030, fonctionne également au méthane - avec l'objectif de diviser les coûts de lancement par deux par rapport à Ariane 6, grâce à la réutilisabilité partielle.
La réaction de Sabatier,
Robert Zubrin
et le projet Mars Direct
Découverte en 1897 par les chimistes français Paul Sabatier et Jean-Baptiste Senderens, la réaction de Sabatier est un procédé qui permet de produire de façon simple du méthane (CH4) et de l'eau (H2O) à partir du dioxyde de carbone (CO2) et de l'hydrogène (H2), en les soumettant à des conditions de pression et de température élevées (300 °C à 400 °C).
Ce procédé, déjà utilisé à bord de l'ISS46(*), pourrait être utilisé pour produire du carburant sur Mars à partir des ressources in situ : le CO2 de l'atmosphère, disponible en abondance, et un peu d'hydrogène, lui-même issu de l'électrolyse de l'eau glacée du sol martien. La réaction produit du méthane et de l'eau, cette dernière étant à son tour électrolysée pour produire de l'oxygène, utilisé comme comburant (LOX) pour la propulsion, et de l'hydrogène, réinjecté en début de cycle pour la réduction du méthane.
Dans son ouvrage paru en 1996, The Case for Mars, l'ingénieur américain Robert Zubrin présente ce procédé comme la clé de voûte d'une possible mission habitée vers Mars, ou à tout le moins comme un élément permettant d'en réduire considérablement le coût, et donc de la rendre possible.
L'un de ses principaux avantages est en effet de pouvoir être mise en oeuvre en amont de l'arrivée de la mission habitée, par l'envoi d'une mission robotique emportant seulement l'unité de production (relativement simple), une source d'énergie (un petit réacteur nucléaire47(*)), et un peu d'hydrogène pour amorcer le cycle. En quelques mois, cette unité pourrait produire près de 100 tonnes de propergol méthane-LOX, utilisables pour le vol retour de la mission habitée, après un séjour de 18 mois en surface48(*).
Spécialiste de la propulsion spatiale, Robert Zubrin est aussi le fondateur de la Mars Society, une association à but non lucratif qui s'inscrit dans la tradition américaine de space advocacy, et dont l'objectif est de promouvoir l'exploration et la colonisation de la planète Mars. Elle compte parmi ses soutiens des scientifiques, mais aussi James Cameron ou l'auteur de science-fiction Kim Stanley Robinson.
Le plan de Robert Zubrin a été étudié par la NASA dans le cadre du projet Mars Direct dès les années 1990, ce qui a permis d'en approfondir les aspects techniques et d'en réviser certaines modalités. Si le projet a ensuite été abandonné pour des raisons budgétaires et du fait de la priorité donnée à la Lune, son influence sur les projets actuels, dont ceux d'Elon Musk, est manifeste49(*).
3. Le nouvel Eldorado de l'économie cislunaire
L'exploitation des ressources spatiales n'ouvre pas seulement de nouvelles perspectives en matière d'exploration lointaine : plus proche de nous, elle est aussi au coeur du développement économique et commercial de l'espace cislunaire50(*), avec d'importantes retombées terrestres.
Le sujet du présent rapport est en effet indissociable d'une tendance plus générale : la place croissante des activités spatiales commerciales, avec l'émergence de nouveaux services et de nouveaux acteurs privés, dans le sillage du New Space américain (cf. Partie II). Après une première phase d'ouverture commerciale dans les années 1990, principalement limitée au secteur des télécommunications, le spatial, historiquement marqué par le poids du secteur public (programmes scientifiques, observation de la terre, renseignement, sécurité et défense, etc.), s'ouvre désormais à toute une nouvelle gamme de services commerciaux : lanceurs privés, constellations, mais aussi bientôt stations spatiales privées et divers services de transport, de logistique, d'approvisionnement, de réparation, de fabrication ou encore de production d'énergie en orbite.
Or l'exploitation des ressources spatiales constitue un élément-clé, de ces nouvelles activités, bien au-delà de celles qui sont directement liées aux missions d'exploration.
a) Les stations-service de la banlieue spatiale
Le principal avantage apporté par l'ISRU concerne la production de carburant à partir des ressources locales, qui permet une réduction drastique de la masse des lancements depuis la Terre, et donc leur coût ou de leur nombre, ainsi que des risques associés et de l'impact sur l'environnement.
En matière d'exploration spatiale, l'effet est déterminant, les coûts de lancement constituant de loin la principale limite à laquelle se heurtent les missions actuelles, en raison de l'énergie nécessaire pour échapper à la gravité terrestre d'abord, à laquelle il faut ajouter le carburant utilisé pour les trajets entre l'orbite basse (LEO) et la surface lunaire ou martienne. On estime ainsi qu'il faut entre 7,5 kg et 13,1 kg de carburant et étages associés pour déposer 1 kg de charge utile à la surface de la Lune ou de Mars depuis l'orbite basse. Reste ensuite à redécoller : chaque trajet depuis la surface lunaire vers le Lunar Gateway devrait nécessiter entre 25 et 30 tonnes de propergols, et entre 40 et 50 tonnes pour l'équivalent sur Mars51(*).
Le « Gear Ratio52(*) » en fonction du lieu de départ
Source : ISRU Gap Assessment Report, 2021
Disposer de carburant fabriqué sur place étendrait considérablement la portée des missions d'exploration, en leur permettant d'aller plus loin et/ou de durer plus longtemps. La masse économisée pourrait en outre être utilisée pour l'emport d'instruments scientifiques et autres équipements ou consommables pour les besoins de l'équipage et la sécurité de la mission.
Mais une telle capacité pourrait tout autant bénéficier aux activités de l'orbite terrestre. En effet, pour atteindre l'orbite basse (LEO) depuis la Lune, il faut seulement 40 % du carburant nécessaire à un départ depuis la Terre. Pour atteindre l'orbite géostationnaire (GEO), il en faut trois fois moins.
Véritables « stations-service », des dépôts de carburant orbitaux, alimentés directement depuis la Lune (ou dans un premier temps depuis la Terre), permettraient de réapprovisionner satellites, stations et vaisseaux spatiaux, ouvrant la voie à l'exploration lointaine (« faire le plein » avant le voyage vers Mars), mais aussi et surtout à toute une nouvelle gamme de services commerciaux en orbite.
|
Le Tanker-002 d'Orbit Fab, un projet de dépôt d'hydrazine en orbite géostationnaire. |
Ravitaillement d'un satellite (en haut) par une « navette-citerne » d'Orbit Fab (en bas). |
L'impact environnemental serait majeur. Utilisé en combinaison avec d'autres services (maintenance, réparation, recyclage, etc.), le refueling permettrait de prolonger la durée de vie des satellites, alors que ceux-ci sont aujourd'hui « jetables » : une fois leur carburant primaire épuisé, ils ne peuvent plus être maintenus sur leur orbite et cessent finalement de fonctionner, constituant autant de nouveaux débris spatiaux dangereux (ou dans le meilleur des cas, lorsqu'ils sont désorbités, des équipements coûteux qu'il faut remplacer). Le refueling permettrait de réduire le nombre de lancements, et donc les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi lutter contre le grave problème de l'encombrement spatial.
Sur le plan économique, ce modèle pourrait présenter un potentiel disruptif comparable, voire supérieur, à celui de la révolution des lanceurs réutilisables introduite par SpaceX - surtout si le carburant est fabriqué sur la Lune dans le cadre de l'ISRU.
Mais le refueling pourrait aussi être un modèle économiquement viable à bien plus court terme, avec du carburant produit sur Terre et stocké dans des dépôts orbitaux. C'est en tout cas le pari de la start-up Orbit Fab, qui devrait proposer un premier service de ravitaillement en hydrazine dès 2025 pour les satellites en orbite géostationnaire (GEO), à partir d'un dépôt situé 300 km plus loin. Le « plein » de 100 kg coûtera 20 millions de dollars53(*).
L'entreprise a déjà signé plusieurs contrats avec des acteurs publics mais aussi des clients privés : à partir de 2026, Orbit Fab ravitaillera les vaisseaux LEXI (Life Extension In-Orbit) de l'entreprise Astroscale, qui elle-même propose un service d'intervention afin de prolonger la durée de vie des satellites (repositionnement, réparation, etc.). Le contrat porte sur la fourniture d'une tonne de propergol à base de xénon54(*).
L'étape suivante pourrait consister, toujours en amont de la maîtrise de la production d'ergols sur la Lune, à fabriquer du carburant en orbite à partir d'eau terrestre. Appelant à intensifier les efforts de R&D, le groupe « Objectif Lune » de l'ANRT propose par exemple le scénario suivant :
« Un dépôt d'ergols cryogéniques (O2/H2) en orbite basse pourrait être mis en place dans les cinq prochaines années. De l'eau serait envoyée en passager depuis la Terre dans les volumes non utilisés des lanceurs existants, puis stockée en orbite, électrolysée et séparée, puis O2 et H2 seraient liquéfiés et stockés sous forme cryogénique, puis transférés dans les étages supérieurs des lanceurs. Ceci permettrait d'avancer sur le développement de briques technologiques clefs (électrolyse, liquéfaction, adaptation des étages supérieurs des lanceurs, transfert ergols), de développer des standards d'interopérabilité pour le réapprovisionnement en carburant des lanceurs en orbite, de démontrer et créer un usage commercial à court terme, et donc de motiver l'investissement sur cette nouvelle filière.
« En parallèle, les briques technologiques associées aux chaines de valeur O2/H2O/H2 pourraient être développées, permettant d'envisager une production d'oxygène, puis d'eau et enfin d'hydrogène, en surface lunaire d'ici les années 2030. L'eau, l'oxygène et l'hydrogène pourraient être utilisés sur la Lune pour la survie à la nuit lunaire, pour tout besoin d'énergie, la mobilité et en support de vie, et/ou être transportés dans les différents dépôts en orbite en profitant de la faible gravité lunaire.
« Enfin, ces développements technologiques, pourraient être faits en synergie au plan de transition H2 vert sur Terre puisque l'innovation spatiale permettrait sans doute d'accélérer certains développements terrestres. »
Source : « L'ambition lunaire,
défi stratégique pour l'Europe du XXIe
siècle »,
Livre blanc du groupe « Objectif
Lune » de l'ANRT, 2021.
b) D'autres services en orbite liés à l'utilisation des ressources spatiales
Parmi les très nombreux projets de nouveaux services commerciaux en orbite, la plupart ne sont qu'indirectement liés à l'utilisation des ressources spatiales (via le refueling, par exemple). Certains sont toutefois plus directement concernés.
C'est le cas de la fabrication en orbite (in-space manufacturing), par exemple. La « ressource » principale, ici, est la microgravité, qui permet de fabriquer des alliages métalliques extrêmement homogènes ou de synthétiser des molécules complexes. En France, la start-up Space Cargo Unlimited (SCU, cf. infra) mais aussi Airbus développent des projets en ce sens. À plus long terme, la fabrication et la construction en orbite pourraient également impliquer des matières premières elles-mêmes issues d'autres corps célestes (métaux extraits du régolithe lunaire, etc.).
C. L'UTILISATION DES RESSOURCES IN-SITU (ISRU) : UN ENSEMBLE DE TECHNOLOGIES AU POTENTIEL DISRUPTIF
1. Un essai d'approche systématique
Indispensable à l'établissement d'une présence humaine sur la Lune et à l'exploration de Mars, clé de voûte du développement de nouveaux services commerciaux en orbite, l'utilisation des ressources in situ (ISRU) correspond à un vaste ensemble de ressources, techniques et applications, envisageables à plus ou moins long terme.
Ce constat a conduit l'International Space Exploration Coordination Group (ISECG), un forum de coopération technique entre agences spatiales55(*), à mettre en place en 2019 un groupe de travail spécifiquement consacré au sujet de l'ISRU, avec pour mission d'identifier et de prioriser les besoins des prochaines missions d'exploration, ainsi que les défis technologiques restant à relever pour y répondre le moment venu et les opportunités de coopération entre agences spatiales et entre industriels. Bien que de nature technique, le travail de l'ISECG témoigne en soi d'une prise de conscience importante, puisqu'il considère l'ISRU comme un ensemble cohérent, défini par ses finalités, au-delà de la diversité de ses technologies, disciplines et acteurs.
Publié en avril 2021, l'ISRU Gap Assessment Report56(*) est le fruit d'un travail de recensement minutieux des ressources, produits et applications envisageables, présentés de façon synthétique dans le tableau ci-après.
Le rapport propose une définition générale de l'ISRU :
« L'ISRU implique tout équipement ou opération qui [...] utilise les ressources locales ou disponibles sur place pour créer des produits ou des services servant à l'exploration robotique et humaine de l'espace et au maintien d'une présence durable, plutôt que de les apporter depuis la Terre.
« L'objectif immédiat de l'ISRU est de réduire drastiquement le coût directement lié à l'envoi d'humains sur la Lune et sur Mars et à leur retour, de viser l'auto-suffisance sur longue durée de bases spatiales habitées permettant de repousser les limites de la recherche scientifique et de l'exploration, et d'ouvrir la voie à la commercialisation de l'espace.
« Pour tirer tous les bénéfices d'une intégration de l'ISRU à l'architecture des missions, les autres systèmes doivent être conçus autour de la disponibilité et de l'utilisation de produits issus de l'ISRU. Par conséquent, l'ISRU constitue une capacité disruptive, et sa conception requiert une approche systématique et une intégration dès l'origine à l'architecture des missions. »
L'une des limites du travail conduit par l'ISECG tient à la définition même de l'ISRU, plus restrictive que la notion d'exploitation des ressources spatiales. En effet, si l'ISRU n'implique pas de limiter a priori le champ des ressources pouvant être utilisées, elle conduit en revanche à ne considérer que les seules applications qui correspondent à un usage sur place, c'est-à-dire dans le cadre d'une mission d'exploration et afin de répondre à ses propres besoins, ou éventuellement pour un usage ailleurs dans le milieu spatial (refueling, etc.), mais pas sur Terre.
L'exploitation de ressources à des fins commerciales extérieures à la mission elle-même n'entre donc pas dans le champ de l'ISRU stricto sensu, ce qui exclut, entre autres, l'extraction de métaux rares sur des astéroïdes, sur la Lune ou sur Mars pour des applications terrestres. L'exercice de définition atteint ici ses limites, dans la mesure où les technologies sont en grande partie les mêmes, non seulement pour l'extraction des ressources en tant que telle, mais aussi pour les autres aspects de la mission (transport, stockage, analyses, télécommunications, énergie, etc.).
En outre, des modèles économiques « mixtes » devraient émerger, rendant la distinction entre ISRU et non-ISRU quelque peu artificielle. La fabrication en microgravité sur des stations orbitales en donne un bon exemple : à quelle catégorie faudrait-il rattacher un alliage issu à la fois de métaux terrestres et lunaires, ou servant à la fois à des applications dans l'espace et sur Terre ?
Ces remarques ne remettent pas en cause l'intérêt d'une approche systématique du sujet. Les développements qui suivent reviennent donc de façon transversale, quoique non exhaustive, sur les différentes ressources et technologies concernées par l'exploitation des ressources spatiales.
2. Les ressources : de quoi parle-t-on ?
a) Les ressources physiques naturelles : eau, gaz et minéraux
D'une manière générale, la notion de « ressource spatiale » n'est pas limitative : tout peut a priori constituer une ressource, dès lors que son utilisation répond à un besoin et qu'il existe une technologie permettant de l'exploiter. En pratique, toutefois, le terme fait principalement référence aux ressources naturelles qui se trouvent sur les autres corps du Système solaire57(*) comme la Lune, Mars, les autres planètes et leurs satellites, les astéroïdes, les comètes, etc.
En fonction de leur localisation et de leurs caractéristiques physiques et chimiques, on peut les regrouper en quatre grandes catégories :
- l'eau, présente en particulier sous forme de glace à la surface de la Lune et de Mars, mais aussi sous forme gazeuse, voire liquide - détecter sa présence est l'un des objectifs de la mission JUICE de l'ESA (cf. infra). Comme sur la Lune, les zones ombragées en permanence (PSR) des autres corps du Système solaire, surtout sur ceux dépourvus d'atmosphère, pourraient être propices à la concentration d'eau glacée. Si la Lune compte un nombre exceptionnel de PSR, d'autres ont été détectées sur Mercure ou sur Cérès (le cratère Juling par exemple) ;
- les composés volatils apportés par les vents solaires : hydrogène, hélium, carbone, azote, etc. Ils se trouvent en surface à des concentrations variables, l'existence d'une atmosphère ou d'une activité géologique étant déterminante ;
- les composés atmosphériques : trois des quatre planètes telluriques du Système solaire sont dotées d'une atmosphère58(*) (la Terre, Mars et Vénus, mais pas Mercure), ainsi que plusieurs satellites et planétoïdes (Titan, Encelade, Triton, Europe, Io, etc.). On y retrouve à peu près les mêmes éléments, mais dans des proportions très variables ;
- les minéraux, et notamment les métaux, extraits du sol ou des roches des autres corps célestes.
b) Les ressources d'origine humaine : recyclage et circularité
Les ressources utiles et disponibles pour l'exploration spatiale ne se limitent pas aux ressources physiques « naturelles ». Les déchets produits par l'équipage (composés organiques, rejets de CO2, etc.) et par les activités humaines, en particulier les équipements usagés ou inutilisés (véhicules, électronique, matériaux de construction, etc.) constitueront aussi une ressource précieuse, accessible et complémentaire des ressources naturelles.
Pour ces ressources d'origine humaine, le défi technologique n'est pas celui de l'extraction, mais celui du recyclage, de la réutilisation, de la réparation et de la circularité en général, via des systèmes dont l'efficacité conditionnera le degré d'autosuffisance des futures bases spatiales. Pour la plupart, ces technologies ne sont ni nouvelles, ni spécifiques : elles sont par exemple développées et améliorées de façon continue à bord de la Station spatiale internationale (ISS), et bénéficient d'importantes synergies avec leurs équivalents terrestres59(*), même si leur adaptation au contexte d'une base permanente à la surface de la Lune ou de Mars constitue en soi un défi technique important. Par exemple, on estime qu'il sera nécessaire d'atteindre un taux de recyclage de l'eau d'au moins 80 % pour assurer la viabilité d'une base lunaire ou martienne, y compris si elle est disponible sur place.
L'enjeu du recyclage concerne aussi l'espace orbital, où satellites en fin de vie, étages de fusées et autres déchets et débris constituent autant de « ressources spatiales » potentielles à utiliser - pour autant que les investissements soient réalisés pour développer les technologies nécessaires. La réutilisation pourrait se faire de plusieurs manières :
- localement, via la réparation ou le réemploi de matériaux ou de composants usagés sur un même objet, comme cela se pratique déjà sur l'ISS ou dans les vols habités mais en élargissant les possibilités (intervention sur des satellites, recyclage des métaux, etc.) ;
- en orbite, après recyclage de la matière première et réutilisation à des fins de construction ou de fabrication ;
- à la surface de la Lune, les déchets et débris orbitaux étant alors collectés, déposés sur la Lune puis transformés en vue de leur réutilisation ou réexpédition, plutôt qu'abandonnés ou désorbités.
Comme le refueling ou l'extension de la durée de vie des satellites, la réutilisation des débris pourrait ainsi contribuer à réduire drastiquement l'encombrement spatial.
c) Les ressources rares au sens large
Enfin, en retenant une définition encore plus large fondée sur la théorie économique, on peut considérer comme des « ressources spatiales » les éléments suivants, dès lors qu'ils sont caractérisés par leur rareté :
- l'espace utile effectif à la surface des corps célestes, qui peut être très restreint (cf. infra) : sites d'atterrissage et de décollage, lieux suffisamment ensoleillés, proximité des ressources et autres points d'intérêts, etc. ;
- les orbites et les fréquences de télécommunication, ressources rares par excellence, et régulées à ce titre (attribution des fréquences, immatriculation des satellites, gestion du trafic, etc.) ;
- tout autre ressource limitée contribuant à la mission spatiale, y compris en amont : budget, disponibilité du lanceur, créneaux de lancement, temps utile de chaque astronaute, formation, etc.
Si ces raisonnements sont tout à fait valables sur le plan théorique, ils sont aussi d'application très générale et conduisent, en pratique, à perdre de vue les enjeux spécifiques du sujet, qui se concentrent sur l'extraction des ressources naturelles et ses implications. Tous ces enjeux demeurent cependant indissociables : il n'est pas envisageable, par exemple, d'établir une unité d'exploitation du régolithe dépourvue de télécommunications.
3. Les technologies
a) L'extraction des ressources : une chaîne de valeur en six étapes
Si l'exploitation des ressources spatiales ouvre des perspectives à la fois nombreuses et crédibles, aucune application concrète n'existe encore à ce jour, sinon sous la forme de prototypes et autres démonstrateurs, principalement sur Terre. Or les défis technologiques à relever se trouvent à tous les niveaux de la chaîne de valeur et impliquent des investissements et des efforts de R&D dans de multiples domaines.
Si l'on s'en tient au cas de l'exploitation des ressources minérales, cette chaîne de valeur comprend, de façon simplifiée, six grandes étapes60(*) :
|
Accès |
1° La prospection : recherche et identification de la matière première, caractérisation physique et chimique, estimation de sa présence et de sa variabilité dans l'environnement immédiat, etc. C'est la seule étape qui, sur place, a déjà commencé ; 2° L'extraction de la matière première, par la transposition des techniques de l'industrie minière ; |
|
Transformation |
3° La préparation de la matière première par différents procédés physiques ou chimiques pour séparer les composés utiles du reste : broyage, concassage, raffinage, filtrage, etc. Les composés ciblés étant souvent présents à des concentrations très faibles, les installations devront être dimensionnées pour traiter des quantités très importantes de matière première puis de déchets ; 4° La production, c'est-à-dire la transformation à proprement dite de la matière première en produit utilisable dans le cadre de l'ISRU, là encore au moyen de divers procédés : réduction chimique, électrolyse, réaction de Sabatier, etc. |
|
Logistique |
5° Le transport aux différents stades de la chaîne : l'enjeu majeur est ici le recours à grande échelle à des rovers autonomes ou semi-autonomes à la fois fiables et capables d'opérer de façon continue pendant de longues périodes dans un environnement hostile ; 6° Le stockage aux différents stades de la chaîne de valeur, qui représente un défi technique majeur compte tenu de l'hostilité de l'environnement, de la volatilité voire de la dangerosité de certains gaz61(*), et des conséquences majeures d'une perte ou d'un accident. |
b) Les applications : l'exemple de la construction
L'exploitation des ressources spatiales, une fois celles-ci extraites et transformées, ouvre la voie à de nombreux usages, dont les principaux sont évoqués au fil du présent rapport. D'autres, encore insoupçonnés, pourraient apparaître par la suite, surtout si le marché demeure ouvert aux acteurs innovants. On s'en tiendra donc ici à un exemple, celui de la construction à partir des ressources locales.
Il s'agit, d'abord, d'une priorité dans le cadre de l'ISRU stricto sensu, c'est-à-dire pour les missions d'exploration de la Lune puis de Mars, avec le régolithe pour principale ressource.
Comme on l'a vu, celui-ci peut être utilisé directement, pour la construction d'infrastructures (aires d'atterrissage, pistes pour les rovers, remblais, réservoirs, etc.) et pour la protection de l'équipage contre les radiations62(*) et les autres risques environnementaux (température, vent, micrométéorites, etc.). Si ce rôle de protection peut être rempli par des galeries souterraines, ou par le simple dépôt de matériaux bruts par des engins mécaniques, la plupart des scénarios envisagent plutôt de transformer le régolithe en matériau de construction à proprement parler.
Vue d'artiste d'un module d'habitation lunaire
protégé par une couche de
régolithe
déposée par impression 3D. Source :
Foster & Partners (concours ESA 2013).
Deux technologies semblent ici particulièrement prometteuses, et pourraient être combinées afin de compenser leurs limites respectives : les briques de régolithe et l'impression 3D.
Les briques de régolithe peuvent être obtenues par frittage, un procédé usuel63(*) qui consiste à chauffer un matériau (la poudre de régolithe) par un apport d'énergie (laser, micro-ondes, etc.), sans aller jusqu'à la fusion d'au moins un de ses composants, ses grains étant alors soudés entre eux par les composants fondus. Les oxydes métalliques présents dans le régolithe lunaire comme martien constituent à cet égard un avantage précieux.
Un autre procédé consiste à fabriquer ces briques à partir d'un « béton », soit un mélange de granulats, de sable et d'eau, agglomérés par un liant hydraulique (le plus souvent du ciment). Compte tenu de la faible disponibilité de l'eau sur la Lune, cette technique apparaît surtout pertinente sur Mars, et plusieurs projets de « béton martien » ont déjà été présentés.
Quel que soit le procédé, toutefois, il devrait être difficile d'obtenir des matériaux présentant les caractéristiques requises (résistance mécanique, isolation, protection contre les radiations, etc.) sans l'ajout d'adjuvants, qu'il faudrait alors apporter depuis la Terre, ce qui rend ces solutions moins avantageuses dans le cadre de l'ISRU. Cela dit, l'opposition entre ressources locales et ressources apportées n'est pas un obstacle indépassable.
Ainsi, un projet lauréat 2023 du programme NIAC de la NASA porte sur des briques de régolithe martien « auto-fabriquées » grâce à des bactéries ou des champignons capables de se développer sur Mars, les biominéraux et polymères naturellement fabriqués par ces organismes servant de liant (colle) à l'ensemble64(*).
Ce procédé de bio minéralisation existe déjà sur Terre, où il est utilisé depuis une vingtaine d'années dans la construction, y compris pour des applications courantes, comme alternative moins coûteuse, plus isolante et plus écologique à la brique de terre cuite65(*).
Le processus de bio minéralisation des briques de régolithe martien. Source : NIAC.
L'impression 3D, ou fabrication additive, est également envisagée de longue date dans le cadre de l'ISRU, et a fait l'objet de nombreuses études et propositions. Cette technologie est aujourd'hui largement employée sur Terre, y compris dans le domaine de la construction où elle a l'avantage de ne produire aucun déchet et d'être automatisable, mais aussi plus largement dans la fabrication industrielle, avec des applications transposables à l'ISRU (petits outils, pièces de rechange et instruments divers « imprimés » en métal ou en plastique).
Il reste que les difficultés techniques sont loin d'avoir été levées pour l'instant. En particulier, l'impression 3D requiert une maîtrise précise de la composition du « mélange » de base, et celui-ci a besoin d'un liant qui, a priori, devrait être apporté depuis la Terre - en des quantités substantielles s'il s'agit de construction.
Toutes ces technologies sont également développées par la Chine. Présenté en 2019 par des chercheurs de l'Université de Huazhong, le « Super maçon chinois » (CSM, Chinese Super Mason) est un robot autonome capable de construire des structures complexes avec des « briques LEGO planétaires », en régolithe, avec une technologie combinant laser et impression 3D66(*).
|
Signe que les choses avancent vite, l'agence spatiale chinoise, la CNSA, a publiquement annoncé en avril 2023 que le « Super maçon » serait envoyé sur la Lune dès la mission Chang'e-8, prévue pour 2028 et destinée à tester diverses technologies d'ISRU dans la perspective de la future mission habitée (cf. infra). |
Les métaux contenus dans le régolithe présentent aussi un intérêt en matière de construction. Autre lauréat 2023 du programme NIAC, le projet Lunar South Pole Oxygen Pipeline (L-SPoP) propose par exemple de remplacer les rovers autonomes envisagés pour transporter l'oxygène extrait de la surface lunaire, source de coûts et de risques considérables67(*), par un réseau de tuyaux fabriqués et assemblés in situ à partir de l'aluminium lui-même extrait du régolithe68(*), sur le modèle des oléoducs et gazoducs terrestres.
Vue d'artiste d'un habitat construit par le « Super maçon ». Source : CNSA 2019.
c) Les fonctions support : logistique, télécommunications et énergie
À ces différentes étapes de la chaîne de valeur stricto sensu s'ajoutent les défis techniques transversaux, liés à la mission dans son ensemble mais spécifiquement adaptés à l'extraction et à la transformation des ressources : construction des installations et infrastructures, protection des équipements, sécurité du personnel, transport, télécommunications ou encore production d'énergie.
En matière de télécommunications, la conduite des opérations à la surface de la Lune, dans le cadre de missions gouvernementales ou d'activités commerciales, nécessite de disposer d'une infrastructure complète et résiliente : communications avec la Terre, services de positionnement et de navigation pour les rovers, météorologie spatiale (pour la surveillance des éruptions solaires), datation, etc. À cette fin, la NASA développe le projet LunaNet, une constellation en orbite lunaire. Des projets similaires sont menés par la Chine (station ILRS, cf. Partie II) et par l'ESA (projet Moonlight, cf. Partie III).
|
Comme Starlink ou OneWeb autour de la Terre, LunaNet fournira un service commercial de navigation et de télécommunication par satellite. Le système utilisera des technologies comme le GPS, le WIFI ou la 5G. La navigation en surface avec LunaNet. Source : NASA 2022. |
Enfin, il faudra disposer d'une source d'énergie fiable et puissante, non seulement pour alimenter la base elle-même, mais aussi et surtout parce que l'électrolyse, qui permettra de fabriquer du carburant ou des piles à hydrogène à partir de l'eau, est un processus simple mais très consommateur d'électricité.
Dans un premier temps, c'est l'énergie solaire qui devrait fournir l'essentiel de l'électricité - mais sur la Lune, les sites ensoleillés sont rares et les nuits sont longues, tandis que sur Mars, qui reçoit déjà moins d'énergie car elle est plus éloignée du Soleil, les panneaux photovoltaïques sont rapidement recouverts de poussière69(*).
À terme, la plupart des projets reposent donc sur l'utilisation de petits réacteurs nucléaires modulaires, à l'instar de KRUSTY, un réacteur expérimental d'un kilowatt développé par la NASA dans le cadre du projet Kilopower, initialement pour la propulsion spatiale mais aujourd'hui surtout envisagé pour une utilisation dans le cadre de séjours prolongés sur la Lune ou sur Mars. Des projets similaires existent en Europe (cf. Partie III avec le projet de Rolls Royce, par exemple), et la Chine en a fait l'une de ses priorités.
|
En juin 2022, cinq entreprises ont été sélectionnées par la NASA et le Département américain de l'Énergie pour développer un premier réacteur opérationnel répondant aux besoins du programme Artemis. Vue d'artiste d'un réacteur à fission de type Kilopower utilisé sur Mars. Source : NASA. |
Le combustible de ces réacteurs devra être apporté depuis la Terre. À long terme, il n'est pas impossible que l'on parvienne à le trouver sur place, mais l'extraction du minerai, son traitement et son enrichissement constituent des défis technologiques encore largement inaccessibles.
4. La création d'une nouvelle filière industrielle
La maîtrise de la chaîne de valeur de l'ISRU, de ses applications et des technologies liées aux fonctions support constitue un défi scientifique et technologique majeur, d'autant qu'elles sont indissociables les unes des autres, et que les délais sont très courts : avant de pouvoir être utilisées par des humains sur la Lune, toutes ces technologies devront avoir été testées et validées, d'abord sur Terre avec des démonstrateurs, puis sur la Lune dans le cadre de missions robotiques, ce qui suppose des échéances très proches.
Concrètement, cela implique la structuration de toute une filière industrielle de l'exploitation des ressources spatiales, dont l'enjeu majeur est la coordination entre acteurs traditionnels du secteur spatial et acteurs venus du secteur des « ressources » et activités associées : industrie minière et gazière, construction, fabrication, transport, énergie, logistique, etc. Une autre particularité concerne l'implication de start-up innovantes au côté des acteurs établis, le New Space étant ici également un « New Non-Space ». Ces différents points seront abordés en détails en Partie II et en Partie III du présent rapport.
*
* *
Le sujet des ressources spatiales a donc bel et bien quitté la science-fiction pour entrer dans le monde réel.
Pourtant, il reste à ce jour largement absent du discours politique, notamment en France, et méconnu de l'opinion publique.
C'est un tort, non seulement car ses implications géopolitiques et économiques sont majeures et dépassent largement le seul domaine spatial (Partie II), mais aussi parce que la France et l'Europe pourraient avoir là une carte à jouer - pour peu qu'elles s'en donnent les moyens et affrontent leurs tabous (Partie III).
II. EXTENSION DU DOMAINE DE LA LUNE : L'IMPORTANCE STRATÉGIQUE ET ÉCONOMIQUE DES RESSOURCES SPATIALES
Le sujet des ressources spatiales illustre, voire cristallise, les grandes transformations à l'oeuvre depuis quelques années dans le secteur spatial, avec, d'une part, une rivalité entre la Chine et les États-Unis de plus en plus structurante, et d'autre part, une dimension de plus en économique et commerciale, incarnée par les entreprises privées du New Space.
Les développements qui suivent aborderont successivement les implications géopolitiques et stratégiques du sujet (II-A), ses conséquences sur le droit international (II-B), et son importance sur le plan économique et industriel (II-C).
A. ASPECTS STRATÉGIQUES : AU CoeUR DE LA RIVALITÉ ENTRE LA CHINE ET LES ÉTATS-UNIS
À en juger par les moyens techniques, juridiques et financiers mobilisés, l'importance stratégique des ressources spatiales n'a échappé ni à la Chine, ni aux États-Unis.
À l'échelle de l'histoire, d'ailleurs, la lutte pour les ressources spatiales n'est rien d'autre que la continuation, sur d'autres corps célestes, de la lutte pour les ressources terrestres, qui n'a jamais cessé de structurer l'ordre international. Ainsi le régolithe et l'eau pourraient-ils être demain dans l'espace ce que furent en leur temps sur Terre le charbon et le pétrole.
La dimension stratégique du sujet concerne à la fois :
- l'accès aux ressources, c'est-à-dire non seulement l'accès physique aux sites d'intérêt et aux matières premières elles-mêmes, mais aussi la connaissance préalable de leur existence, et la maîtrise des technologies permettant de les exploiter ;
- l'usage fait de ces ressources : les applications possibles vont au-delà de la seule réponse aux besoins directs d'une base et de son équipage, et pourraient inclure des usages à des fins militaires.
Quelques éléments de contexte doivent tout d'abord être rappelés, en particulier s'agissant de la rivalité entre la Chine et les États-Unis - la place de l'Europe sera pour sa part abordée en Partie III.
1. La géopolitique hors-la-Terre
Relativement préservé au cours des décennies précédentes, l'espace est aujourd'hui au coeur de la géopolitique mondiale, qui est de plus en plus structurée par la rivalité entre les États-Unis et la Chine.
En effet, pour être une grande puissance sur Terre, il faut être une grande puissance spatiale : la maîtrise de l'espace est un enjeu stratégique vital, qu'il s'agisse des télécommunications, des systèmes de géolocalisation, des satellites d'observation et de renseignement, de défense anti-missile et de dissuasion nucléaire - sans même parler de l'importance de l'espace sur le plan économique et scientifique.
À cet égard, les États-Unis restent la première puissance spatiale, que leur avance se mesure en termes de budgets civils et militaires, de maîtrise technologique, de recherche scientifique, de retombées économiques et bien sûr de leadership international. Le programme Artemis illustre tout cela à la fois, mais l'on pourrait aussi évoquer le dynamisme du New Space et le succès d'un acteur comme SpaceX, par exemple.
a) La Chine, une puissance qui se donne les moyens de ses ambitions
Pour autant, l'écart se resserre avec la Chine, qui est aujourd'hui une puissance spatiale complète, disposant d'un accès autonome à l'espace extra-atmosphérique avec sa gamme de lanceurs Longue Marche, de sa propre station spatiale, Tianong70(*), d'un projet de constellation de 13 000 satellites en orbite basse destinée à concurrencer Starlink et OneWeb, et de son propre programme d'exploration de la Lune et du Système solaire.
Comme l'explique Marc Julienne dans une note de l'Ifri71(*), « la doctrine spatiale chinoise repose sur trois piliers principaux : le développement national, l'autonomisation militaire et la compétition entre grandes puissances. (...) L'espace a été pleinement intégré dans le « rêve chinois de grande renaissance de la nation chinoise », cher au secrétaire général Xi Jinping. Il doit contribuer à faire de la RPC la « grande puissance technologique » mondiale d'ici 2049 ».
En matière d'exploration spatiale, la Chine n'a plus grand-chose à envier à ses rivaux. Son programme lunaire, Chang'e72(*), consiste en une série de missions robotiques qui ont déjà permis d'importants succès :
- les missions orbitales Chang'e-1 (2007) et Chang'e-2 (2010) ont permis à la Chine de cartographier la surface de la Lune avec une résolution sans précédent, permettant d'identifier les ressources, d'en évaluer la disponibilité, et de repérer de potentiels sites d'atterrissage ;
- après avoir démontré sa capacité à poser un rover à la surface de la Lune avec la mission Chang'e-3 (2013), la Chine est devenue, avec la mission Chang'e-4 (2018) et son rover Yutu-2, le premier pays au monde à réussir un alunissage sur sa face cachée, dans le Bassin Pôle Sud-Aitken, l'un des plus grands cratères du Système solaire ;
- Avec la mission Chang'e-5 (2020), la Chine est devenue le troisième pays à rapporter des échantillons lunaires sur Terre (environ 2 kg), une première depuis la mission soviétique Luna 24 de 1976.
Surtout, la Chine s'est fixé comme objectif d'envoyer une mission habitée sur la Lune à l'horizon 2030, puis d'y établir une base permanente d'ici 2035, se posant ainsi en concurrent direct des États-Unis et du programme Artemis. L'échéance de 2030 pour l'envoi des trois premiers taïkonautes vient même d'être officiellement avancée à 2029, sans doute pour célébrer le 80e anniversaire de la République populaire73(*), alors même que la date de 2025 pour la mission Artemis III n'est plus considérée comme réaliste.
À l'instar du programme CLPS de la NASA, la dernière phase du programme Chang'e est conçue pour préparer le futur programme habité74(*) :
- la mission Chang'e-6 (prévue pour 2025) effectuera de nouveaux relevés topographiques et géologiques dans le sous-sol du Bassin Pôle Sud-Aitken, et rapportera des échantillons de la face cachée ;
- la mission Chang'e-7 (prévue pour 2026) aura pour but la prospection des ressources du pôle Sud. Outre l'atterrisseur et son rover, elle emportera un drone similaire à l'hélicoptère martien Ingenuity, envoyé par la NASA avec le rover Perseverance ;
- enfin, la mission Chang'e-8 (prévue pour 2028) testera, en conditions réelles, différentes technologies d'ISRU, dont un mini-écosystème fermé (avec de l'air, des plantes et autres organismes) et le « Super maçon chinois » pour la construction (cf. supra).
C'est peu dire que les choses avancent vite, et que les ambitions de la Chine sont crédibles - afin d'épargner au lecteur européen une comparaison cruelle, on se contentera ici de le renvoyer à la Partie III du présent rapport. C'est peu dire, aussi, que la Chine a, comme les États-Unis, une conscience aiguë du caractère stratégique de l'accès aux ressources spatiales.
Par ailleurs, la CNSA mène un ambitieux programme d'exploration planétaire, Tianwen75(*), avec Mars pour premier objectif :
- la mission Tianwen-1 (2020) a permis à la Chine d'accomplir en une seule fois les trois objectifs d'une mission robotique, c'est-à-dire la mise en orbite, l'atterrissage et le déploiement d'un rover, Zhurong, qui explore le cratère d'Utopia Planitia, qui pourrait contenir de la glace d'eau sous forme de permafrost ;
- la mission Tianwen-2 (prévue pour 2025) vise quant à elle à prélever des échantillons sur un astéroïde, et à les rapporter sur Terre ;
- la mission Tianwen-3 (prévue pour 2028) est la mission chinoise de retour d'échantillons martiens, comparable à la mission menée par la NASA et l'ESA, avec la même date de retour annoncée (2031) ;
- la mission Tianwen-4 (prévue pour 2029) devrait être consacrée à l'exploration de Jupiter et de sa lune Callisto, ce qui n'est pas sans rappeler la mission européenne JUICE (cf. infra).
La Chine a également annoncé une mission d'exploration de Vénus, prévue pour 2026, et bien entendu un programme d'exploration humaine de Mars, avec de premiers lancements entre 2033 et 2041, même si ces dates doivent être prises avec précaution.
b) Quelle place pour les autres ?
Les États-Unis et la Chine sont aujourd'hui les seuls pays capables de mener un programme visant à établir une base permanente sur la Lune, en exploitant les ressources locales : c'est donc par rapport à eux que les autres puissances spatiales doivent se positionner.
Seule, la Russie n'a plus guère les moyens de rivaliser avec les États-Unis comme l'URSS au temps de la Guerre froide. Puissance spatiale déclinante, elle n'est pas en mesure de mener un programme d'exploration autonome ni d'acquérir un avantage dans les technologies de rupture (lanceurs réutilisables, constellations, nouveaux services orbitaux, ISRU etc.). Elle conserve toutefois une place importante, ne serait-ce qu'en raison de son savoir-faire historique, de sa flotte de satellites et de la dépendance des autres pays envers ses lanceurs Soyouz (quoique l'essor d'entreprises comme SpaceX rende ce dernier point moins pertinent à présent). Coopérant avec les pays occidentaux sur certains programmes, à commencer par celui de la Station spatiale internationale (ISS), la Russie n'en contribue pas moins à la montée des tensions et à la militarisation de l'espace - la destruction volontaire de son ancien satellite Cosmos-1408 en novembre 2021 constituant à cet égard un épisode particulièrement regrettable76(*).
La Russie est peu concernée par le sujet des ressources spatiales, celui-ci étant directement lié à la relance des programmes d'exploration. Si le programme Luna (1959-1976) avait permis à l'URSS de remporter certains succès, avec notamment trois missions de retour d'échantillons réussies, son lointain successeur, le programme Luna-Glob, ne s'est jamais concrétisé.
Plusieurs missions robotiques restent cependant prévues, et elles visent elles aussi le pôle Sud et ses ressources : Luna 25 (atterrisseur, officiellement en 2024), Luna 26 (orbiteur, 2024), Luna 27 (atterrisseur, 2025) et Luna 28 (atterrisseur et retour d'échantillons, 2028). Toutefois, celles-ci devaient avoir lieu en partenariat avec l'ESA ; c'est par exemple elles qui devaient emporter les instruments PROSPECT de l'ESA (cf. infra), entre autres charges utiles confiées par la NASA, la CNSA et d'autres agences. La guerre en Ukraine ayant conduit l'ESA à suspendre sa coopération avec Roscosmos77(*), l'avenir de ces missions est désormais incertain.
Il en va de même, bien sûr, avec la mission ExoMars de l'ESA, dont la Russie devait fournir le lanceur et l'atterrisseur et la NASA le rover (Rosalind Franklin). Annulée par l'ESA en mars 2022, la mission devrait finalement être reprise sous forme de partenariat entre la NASA et l'ESA.
Si la Russie a perdu son autonomie en matière d'exploration spatiale, elle pourrait en revanche retrouver un rôle en tant qu'allié de la Chine : les deux pays sont, en effet, associés dans le cadre du projet ILRS (International Lunar Research Station) - même si le poids réel de la Russie au sein de cette alliance semble, à terme, incertain.
|
La station russo-chinoise ILRS À l'instar des États-Unis, la Chine s'est fixé l'objectif d'établir une base humaine permanente à la surface de la Lune, à proximité du pôle Sud et de ses ressources. Il s'agit de l'ILRS (International Lunar Research Station). Elle doit permettre d'étudier la Lune (topographie, géologie, chimie, etc.) et son environnement, d'observer la Terre et l'espace lointain, de réaliser des expériences (biologie, médecine, etc.) et de tester des technologies d'ISRU. Le 16 juin 2021, lors du sommet à Saint-Pétersbourg de la Global Space Exploration Conference (GLEX 2021), la CNSA et Roscosmos ont annoncé leur partenariat en vue de construire l'ILRS, et invité les pays volontaires à les rejoindre. À ce jour, le Pakistan, l'Argentine, l'Organisation de coopération spatiale Asie-Pacifique78(*) ont signé les accords, et la Chine indique être en discussion avec une dizaine d'autres pays, dont le Vénézuela. À l'instar du programme Artemis, l'accord ILRS est en fait un projet global qui, outre la base stricto sensu, comprend aussi le transport Terre-Lune, le transport à la surface, la réponse aux besoins de la mission (life support, énergie, etc.), les infrastructures de recherche ou encore les télécommunications. Fin avril 2023, le concepteur du programme lunaire chinois, Wu Weiren, a annoncé79(*) qu'une version « basique » de l'ILRS serait assemblée dès 2028, avant une version améliorée avant 2040 et une version complète au plus tard vers 2050. Vue d'artiste de la phase 3 de l'ILRS. Source : CNSA 2021. |
|
Vue d'artiste de la phase 3 de l'ILRS. Source : CNSA 2021. La feuille de route présentée en 2021 prévoyait quant à elle trois phases avec le calendrier suivant : reconnaissance (2021-2025), construction (2026-2035) et utilisation (à partir de 2036). Les missions Chang'e-4 (rover Yutu-2 sur la face cachée) et Chang'e-5 (retour d'échantillons) sont donc considérées comme ayant contribué à la phase de reconnaissance. Les phases suivantes correspondent à la suite du programme Chang'e et aux missions Luna-5, Luna-26 et Luna-27. Il faut donc s'attendre à une révision de cette feuille de route, qui ne se fera sans doute pas dans le sens d'une plus grande influence de la Russie. |
D'autres puissances spatiales sont également impliquées (au moins indirectement) dans des programmes d'exploration, et sont donc concernées par la question de l'utilisation des ressources. On se limitera ici à quelques rappels au sujet de trois pays (cf. Partie III pour les pays européens) :
- l'Inde : après les États-Unis et la Chine, c'est sans doute le pays dont les projets de base lunaire autonome sont les plus crédibles. Son agence spatiale, l'ISRO (Indian Space Research Organisation) s'en donne en tout cas les moyens, avec ses missions robotiques Chandrayaan et son projet de vaisseau habité Gaganyaan. Ceci dit, l'échec de la mission Chandrayaan-2, dont l'atterrisseur s'est écrasé en 2019 au pôle Sud (où son rover devait rechercher la présence d'eau), rappelle que l'Inde est encore loin de maîtriser toutes les technologies nécessaires ;
- le Japon : très impliqué dans les sujets liés à l'ISRU, via son agence spatiale (la JAXA) ou des acteurs privés (ispace), le Japon se positionne avant tout comme un partenaire des États-Unis. Le pays fait d'ailleurs partie des huit premiers signataires des accords Artemis, le 8 octobre 2020 ;
- les Émirats arabes unis : le pays, qui figure aussi parmi les premiers signataires des accords Artemis, ne s'interdit pas pour autant une coopération ouverte, considérée comme un outil d'influence régionale. Son agence spatiale, le Mohammed bin Rashid Space Centre (MBRSC), coopère donc aussi bien avec les États-Unis que la Chine (mission Chang'e-7) et le Japon (ispace).
c) De la guerre des étoiles aux tranchées sur la Lune ?
Pour finir, avant d'en venir à la question de l'accès aux ressources, il est utile de rappeler que celle-ci se pose dans un contexte plus général de militarisation de l'espace. Celle-ci n'est ni récente, ni spécifique au champ du présent rapport, mais elle s'accentue nettement et pourrait prendre, avec la course aux ressources spatiales, des formes nouvelles.
Tout d'abord, le principe d'utilisation de l'espace à des fins pacifiques n'a jamais constitué une garantie absolue contre la militarisation de l'espace extra-atmosphérique, ni en droit, ni dans les faits.
|
L'utilisation pacifique de l'espace : Sur le plan juridique, d'abord, la portée de ce principe est limitée. Certes, l'article IV du Traité de l'espace de 1967 (cf. infra) dispose que « tous les Etats (...) utiliseront la Lune et les autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques », et interdit en conséquence les bases, manoeuvres et essais militaires (mais pas la présence de personnel militaire en tant que tel, ce qui est le cas de nombreux astronautes). Si la notion d'utilisation pacifique n'est pas précisément définie, il existe un consensus entre les États sur le fait qu'est pacifique toute utilisation qui n'est pas agressive - ce qui laisse, déjà, une certaine marge de manoeuvre quant à la définition d'une « agression ». Surtout, les seules armes expressément interdites en orbite terrestre et dans l'espace extra-atmosphérique sont les « armes nucléaires ou tout autre type d'arme de destruction massive », en vertu du même article IV. En d'autres termes : toutes les autres armes sont permises dans l'espace, et tout autre type d'activité militaire peut être mené en orbite terrestre. Et dans les faits, les États ne s'en privent pas : c'est la deuxième fragilité. Si les activités militaires menées dans l'espace relèvent pour l'essentiel du renseignement (satellites espions) ou du soutien aux forces conventionnelles (navigation), des projets d'armes offensives ou défensives existent depuis le début de l'ère spatiale (y compris en violation du traité de 1967, dans le cas des projets, certes non aboutis, d'armes nucléaires), et se multiplient depuis les années 2000 (satellites équipés de lasers pour détruire les missiles balistiques intercontinentaux, missiles antisatellites, etc.). Comme l'URSS pendant la Guerre froide, la Chine semble aujourd'hui être le seul pays capable de rivaliser avec les États-Unis en la matière - même si les moyens dont ces pays disposent sont, naturellement, tenus secrets. Si aucun affrontement militaire n'a à ce jour eu lieu dans l'espace, les démonstrations de force, elles, n'ont pas manqué, de l'essai nucléaire Starfish Prime mené par les États-Unis en orbite basse en 1962 (qui détruisit alors un tiers des satellites existants) au laser Terra-3 pointé depuis une base soviétique sur la navette spatiale américaine en 1984. Dans la période récente, les plus inquiétantes sont sans doute les destructions de vieux satellites par des tirs de missile - un exercice à l'intérêt tactique douteux mais à l'impact environnemental et politique majeur, dans lequel se sont illustrés la Chine (2007), les États-Unis (2008), l'Inde (2019) et plus récemment encore la Russie (2021), chacun s'offusquant bien sûr du comportement des autres. |
Alors que la compétition entre les grandes puissances se fait chaque jour plus aiguë, il est peu probable que la nouvelle course à l'espace - on peut ici parler de « conquête spatiale » - échappe, comme par miracle, à la militarisation, ou du moins à la montée des tensions et des périls. On ne peut donc pas exclure que la bataille pour l'accès aux ressources spatiales prenne une tournure militaire ou qu'elle conduise à l'emploi de la force.
À ce stade, on ne peut rien prédire mais on peut tout imaginer, de la simple escarmouche à flanc de cratère au missile anti-rover, en passant par le brouillage des télécommunications ou la capture des dépôts de carburant. Il est aussi possible que tout se passe bien. Ou alors très mal : après tout, un cratère de plus ou de moins sur la Lune...
Tout ceci reste très spéculatif, mais pas pour autant absurde. En effet, si aucune arme nucléaire n'a jamais été utilisée en orbite autour de la Terre, c'est sans doute moins grâce à l'interdit moral posé par le Traité de 1967 que par crainte des effets indésirables, à commencer par les retombées radioactives - surtout si par malheur la fusée venait à exploser sur le pas de tir ou au-dessus du territoire national. Or sur la Lune, il n'y a ni population civile, ni atmosphère, et déjà beaucoup de radioactivité80(*).
À la fin des années 1950, les États-Unis, ébranlés par les premiers succès remportés par l'URSS dans la course à l'espace, en particulier la mise en orbite de Spoutnik 1 en 1957, avaient très sérieusement envisagé de faire exploser une bombe nucléaire à la surface de la Lune : l'explosion, visible depuis la Terre, devait constituer une démonstration de force et permettre de remonter le moral de l'opinion publique. Ce projet, à l'intérêt scientifique somme toute assez limité81(*), a finalement été abandonné en 1959 après la création de la NASA, au profit d'un ambitieux programme de vol habité qui allait déboucher sur les missions Apollo. L'URSS a développé un projet identique à peu près à la même époque.
Le voyage dans la Lune,
film de Georges
Méliès (1902).
L'explosion d'une « grosse » bombe - nucléaire ou non - sur la Lune aurait certes des effets indésirables (et pas seulement pour ses destinataires immédiats) : poussières endommageant les équipements et brouillant les communications, contamination d'une zone d'intérêt et de ses ressources, débris en orbite lunaire, etc. Mais ses effets seraient incomparablement moins sévères que sur Terre ou en orbite terrestre : c'est moins intéressant pour une « vraie » guerre, mais idéal pour une démonstration de force à peu de frais - autrement dit, c'est Cosmos-1408 sans les débris et Mururoa sans les dégâts.
Dans une perspective militaire, les « ressources spatiales » sont à la fois un objectif (dont il faut s'emparer), une cible (à détruire ou à protéger), et potentiellement une arme (défensive ou offensive). Nul besoin pour cela de savoir enrichir de l'uranium sur Mars (même si le sol en contient) : on peut aussi fabriquer un bunker en régolithe et une bombe avec les ergols82(*). Cela dit, la fabrication d'armes ou de munitions à partir des ressources spatiales n'aura pas d'intérêt tant qu'il sera plus facile, moins coûteux ou plus efficace d'utiliser des armes terrestres. De ce point de vue, on peut être rassuré.
2. « Premier arrivé, premier servi »
a) Sur la Lune, la course vers le pôle Sud a commencé
Pour le profane, le spatial est un domaine où l'on s'habitue vite à l'idée d'infini, tant les distances, le temps, la matière ou l'énergie s'expriment en des ordres de grandeur peu comparables avec la réalité quotidienne.
Rien de tel, pourtant, avec les ressources : celles qui sont à la fois connues, utiles et accessibles sont extrêmement limitées, et sauf à ce que l'état de nos connaissances et de nos technologies change radicalement, elles devraient le rester pendant encore longtemps. C'est particulièrement vrai des ressources lunaires, les seules que l'on puisse raisonnablement considérer comme accessibles à court terme, et non sans de fortes incertitudes.
Sur la Lune, c'est donc le pôle Sud qui concentre toutes les attentions, suscite les convoitises et nourrit les rivalités. Comme évoqué précédemment, c'est là que devraient se trouver les réserves d'eau les plus importantes, piégées au fond des cratères plongés dans l'obscurité. Mais c'est aussi là, sur la crête de ces mêmes cratères, que se trouvent les sites offrant l'ensoleillement le plus important, et donc les meilleurs emplacements pour installer des panneaux solaires, indispensables pour alimenter une base permanente. Ces conditions permettent aussi d'échapper à la longue nuit lunaire (14 jours) et aux écarts de température extrêmes des latitudes plus proches de l'équateur.
Or tous ces points d'intérêt se concentrent dans une région qui n'est pas plus grande que l'Île-de-France83(*) :
Source : NASA / Spartan Space.
Aucun lieu n'illustre mieux cette concentration des ressources et des tensions potentielles que le cratère de Shackleton, représenté en vue oblique sur la photo ci-dessous. Situé exactement au pôle Sud (« SP »), il a une profondeur de 4,2 km mais seulement 21 km de diamètre - ce qui lui donne à peu près trois fois la superficie de Paris intra-muros. Sur sa crête, une mince bande de terrain bénéficie d'un ensoleillement quasi-permanent (80 % à 90 % du temps), le plus élevé de toute la Lune. Le fond du cratère pourrait quant à lui contenir de l'eau glacée et plusieurs minéraux utiles, même si l'obscurité dans laquelle il est plongé rend les estimations incertaines.
Le cratère de Shackleton
Source : David A. Kring et al., 2022, données LRO.
Sans surprise, le caractère de Shackleton fait donc partie des 13 sites d'alunissage potentiels sélectionnés par la NASA en août 2022 pour la mission Artemis III (« site 001 » et « site 004 »), mais aussi par la Chine pour ses futures missions habitées. D'une manière générale, tous les sites envisagés par les États-Unis et par la Chine se situent à moins de six degrés de latitude du pôle Sud.
b) L'enjeu de la prospection
Bien entendu, la course aux ressources lunaires ne débutera pas avec l'arrivée des premiers équipages humains : elle est d'ores et déjà engagée, avec pour enjeu principal la prospection des ressources lunaires, et d'abord des ressources en eau.
On dispose aujourd'hui d'une carte géologique unifiée de la surface lunaire, notamment grâce aux relevés effectués depuis 2009 par la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), et plus généralement d'une assez bonne connaissance d'ensemble de la surface et de la composition du régolithe, dont les missions Apollo avaient rapporté des échantillons.
|
Extrait de la carte géologique unifiée de la Lune Source : United States Geological Survey (USGS).
Données LRO et Kaguya. |
En revanche, notre connaissance des ressources du pôle Sud reste à ce jour très insuffisante, car au fond des cratères, l'absence totale de lumière du soleil rend les satellites aveugles. Or aucune mission robotique ni a fortiori humaine n'a pour l'instant exploré cette région difficile d'accès. Depuis plusieurs années, d'importants efforts sont donc engagés par les agences spatiales en vue de cartographier, quantifier et caractériser ces ressources, notamment par des prélèvements sur place, ceux-ci constituant un préalable indispensable à la sélection des futurs sites d'alunissage et au choix puis à la validation des différentes technologies d'ISRU.
C'est précisément l'objectif du rover VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) de la NASA qui devrait être envoyé en 2024 au fond du cratère Nobile, dans le cadre du programme CLPS (Commercial Lunar Payload Services, cf. infra). Ce rover, à la mission particulièrement complexe et ambitieuse, sera équipé de trois spectromètres et d'un bras capable de forer jusqu'à un mètre de profondeur dans un sol composé, du moins comme on l'espère, de régolithe et de glace d'eau.
La Chine poursuit les mêmes objectifs avec sa mission Chang'e-7, prévue pour 2026 dans le cratère de Shackleton. Elle n'est pas pour autant en retard sur les États-Unis, puisque le seul rover actuellement présent sur la Lune est chinois. Elle est même en avance en ce qui concerne les retours d'échantillons, avec près de 2 kg rapportés en 2020. Les derniers échantillons rapportés par les États-Unis datent de 1972 (Apollo 17), et par l'URSS de 1976 (Luna 24) et sont largement « périmés » (car contaminés par des éléments terrestres au fil du temps). Sur Mars et sur les astéroïdes, les ambitions et les échéances sont similaires.
Disposer d'échantillons de régolithe est crucial pour la préparation des prochaines missions, qu'il s'agisse d'en étudier la composition, de valider les technologies d'ISRU ou de tester la résistance et la fiabilité des rovers, combinaisons et autres équipements. C'est pourquoi, à défaut de disposer de « vrai » régolithe lunaire ou martien en quantités suffisantes, l'accès au régolithe de synthèse (regolith simulant, ou regolith analog) constitue un enjeu majeur pour la R&D en matière d'ISRU (cf. infra).
Sur Mars, la « prospection » est plus simple, compte tenu de la relative abondance de la glace d'eau à faible profondeur. La compétition n'en est pas moins rude, notamment pour les missions de retour d'échantillons, avec d'un côté la mission Mars Sample Return (MSR), menée par la NASA en collaboration avec l'ESA, et de l'autre la mission Tianwen-3 de la CNSA, toutes deux ayant pour objectif de récupérer les échantillons en 2031.
c) Un travail d'équipe ?
Les instruments ProSEED et ProSPA du programme PROSPECT. Source : ESA.
La prospection est un domaine où l'Europe est bien positionnée, notamment grâce au programme PROSPECT de l'ESA (Package for Resource Observation and in-Situ Prospecting for Exploration, Commercial exploitation and Transportation)84(*). Celui-ci comprend deux instruments destinés à extraire et à analyser des échantillons des régions du pôle Sud : un outil de forage (ProSEED) capable de percer un sol très dur car très froid (-150 °C à -200 °C) et un laboratoire d'analyses chimiques (ProSPA) permettant de chauffer les échantillons à 1 000 °C pour en extraire l'eau et les autres volatiles piégés dans le régolithe. S'y ajoute l'EMS-L (Exospheric Mass Spectrometer L-band), un spectromètre spécifiquement conçu pour analyser la - très - fine atmosphère de la Lune.
Ces instruments devaient initialement faire partie de la mission russe Luna 27, prévue pour 2025 dans le bassin Pôle Sud-Aitken. La guerre en Ukraine ayant conduit à la suspension du partenariat entre Roscosmos et l'ESA, les instruments ProSEED et ProSPA seront finalement envoyés dans le cadre du programme CLPS de la NASA à partir de 2025.
L'EMS-L, pour sa part, devrait être intégré à la mission LUPEX (Lunar Polar Exploration), également dite Chandrayaan-4, prévue par les agences spatiales indienne (ISRO) et japonaise (JAXA). Si la date de 2025 est encore incertaine, l'objectif, lui, est clair : il s'agit là encore d'explorer le pôle Sud à la recherche des ressources en eau.
Étape préparatoire indispensable aux futures missions habitées, la prospection des ressources mobilise donc de nombreux pays, au-delà de la Chine et des États-Unis. Le Japon, l'Inde, les pays membres de l'ESA et d'autres disposent en effet de compétences précieuses et développent des technologies complémentaires. Toutefois, ces projets dépendront in fine des décisions prises par les deux grandes puissances spatiales. À ce stade, la coopération demeure ouverte : la Chine a par exemple annoncé que la mission Chang'e-6 emporterait des charges utiles fournies par la France, l'Italie, la Suède ou encore le Pakistan, et que la mission Chang'e-7 avait reçu des demandes de la part de onze pays.
La même remarque vaut pour l'étape suivante, c'est-à-dire le test « en conditions réelles » des technologies d'ISRU : de nombreux pays mènent des recherches, mais deux seulement enverront prochainement des missions. C'est notamment l'objectif de plusieurs contrats du programme CLPS (à partir de 2027-2028) et de la mission Chang'e-8 (prévue pour 2028).
B. ASPECTS JURIDIQUES : LA FIN DES ILLUSIONS MULTILATÉRALES
La bataille pour le contrôle des ressources spatiales se joue aussi sur le terrain juridique, et principalement au niveau international autour d'une question déjà ancienne : peut-on s'approprier les ressources spatiales ?
Ses implications sont à la fois géopolitiques et économiques :
- du point de vue géopolitique, il s'agit de savoir si le premier pays « arrivé » sur Lune (ou sur Mars) pourra légitimement revendiquer les ressources qui se trouvent à proximité du site où il s'est établi, et si oui, à quelles conditions ;
- du point de vue économique, il s'agit de savoir si les entreprises qui proposent des services liés à l'extraction et à l'utilisation des ressources (sur la Lune, sur Mars, sur un astéroïde, etc.) disposent de droits sur celles-ci, à commencer par le droit d'en faire commerce.
1. Le droit de l'espace et l'appropriation des ressources spatiales
a) Une question ancienne
Le Traité de l'espace de 1967, principal instrument du droit spatial international, proclame à son article II un principe de non-appropriation nationale des corps célestes : « l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen ».
L'espace extra-atmosphérique85(*) se distingue ainsi de l'espace aérien, ou s'exerce la souveraineté des États, et peut être comparé à la haute mer, où s'applique le même principe de non-appropriation (cf. infra). Ce dernier est l'un des trois principes fondamentaux du droit de l'espace, avec le principe de la liberté d'exploration et d'utilisation et le principe d'utilisation à des fins pacifiques86(*).
|
Les sources internationales du droit de l'espace87(*) Cinq traités internationaux ont été négociés dans le cadre des Nations Unies. Le principal est le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, dit Traité de l'espace, signé le 27 janvier 1967 et entré en vigueur le 10 octobre 1967. Il a été signé et est utilisé par la quasi-totalité des membres de l'ONU. Il a été suivi de quatre traités d'application : - l'Accord sur le sauvetage des spationautes, le retour des spationautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique (1968) ; - la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (1972). Par dérogation au droit commun international, ce texte prévoit une responsabilité des États qui font procéder à un lancement ou qui prêtent leur territoire ou leurs installations aux fins d'un lancement. Cette responsabilité est absolue (sans faute) en cas de dommage causé à la surface de la Terre ou à un aéronef en vol ; - la Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique (1975) ; - l'Accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes, signé en 1979 et entré en vigueur en 1984. Seuls dix-sept pays l'ont toutefois ratifié, dont aucune puissance spatiale (cf. infra). Outre les cinq traités négociés dans le cadre de l'ONU, il existe d'autres accords multilatéraux, tels que l'Accord intergouvernemental pour le développement et l'utilisation de la Station spatiale internationale (ISS), conclu en 1988 et révisé en 1998, ainsi que de nombreux accords bilatéraux entre États, agences spatiales, organisations internationales, etc. Les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU88(*), la jurisprudence, voire les lois nationales adoptées par certains pays constituent également, de jure ou de facto, des sources du droit spatial international. |
Buy Land on the Moon
$44.99 - $1004.80
On pourrait en déduire que l'appropriation des ressources spatiales est tout aussi contraire au droit international, et que la question est tranchée - mais il n'en est rien. En effet, si le traité de 1967 interdit l'appropriation des corps célestes, il ne dit rien, en revanche, des ressources qui pourraient en être tirées.
Le problème, à vrai dire, ne se posait pas vraiment à l'époque de la négociation du traité, l'exploitation des ressources, bien que théoriquement possible, étant alors techniquement hors de portée. Pour les deux grandes puissances spatiales de l'époque, les États-Unis et l'URSS, le Traité de l'espace offrait l'occasion de mettre en scène à peu de frais leur « détente », en s'accordant sur des obligations consensuelles (immatriculation, assistance aux astronautes, etc.) ou des principes généraux ne remettant en cause aucun intérêt établi (exploitation des ressources spatiales).
À cet égard, le Traité sur la Lune de 1979 est bien moins ambigu puisqu'il inclut expressément les ressources naturelles dans le champ du principe de non-appropriation.
L'article 11 considère en effet que « la Lune et ses ressources naturelles constituent le patrimoine commun de l'humanité91(*) ». Il en résulte que « ni la surface ni le sous-sol de la Lune, ni une partie quelconque de celle-ci ou les ressources naturelles qui s'y trouvent, ne peuvent devenir la propriété d'États, d'organisation internationales, intergouvernementales ou non gouvernementales, d'organisations nationales ou d'entités gouvernementales, ou de personnes physiques92(*) ».
Il ne s'agit pas, pour autant, d'empêcher l'utilisation des ressources de la Lune, dont les avantages potentiels étaient déjà clairement identifiés à l'époque93(*). Par conséquent, l'article 11 prévoit que « les États parties (...) s'engagent à établir un régime international, y compris des procédures appropriées, régissant l'exploitation des ressources naturelles de la Lune lorsque cette exploitation sera sur le point de devenir possible ». Ce régime a notamment pour but d'assurer la mise en valeur des ressources naturelles, d'assurer leur gestion rationnelle, de développer les possibilités d'utilisation de celles-ci, et enfin de ménager une répartition équitable entre tous les Etats parties des avantages qui en résulteront94(*).
À la différence des accords précédents, et précisément en raison de ses dispositions relatives à la propriété et à l'exploitation des ressources naturelles, le traité sur la Lune n'a cependant été ratifié par aucune grande puissance spatiale - la France et l'Inde étant les seuls pays dotés d'un programme autonome en matière de vol habité à l'avoir signé (en 1980 et en 1982), sans pour autant le ratifier. Ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie, ni la plupart des membres de l'ESA ne sont donc liés par ce texte.
La notion de « patrimoine commun de l'humanité » est pourtant loin d'être inconnue en droit international : elle est notamment utilisée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) pour qualifier les grands fonds marins, et justifier la mise en place d'une autorité internationale de régulation.
|
La haute mer et les grands fonds
marins : Longtemps coutumier, le droit de la mer est aujourd'hui principalement régi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM, ou UNCLOS en anglais) du 10 décembre 1982, dite Convention de Montego Bay. Négociée sous l'égide de l'ONU et ratifiée par la quasi-totalité des pays industrialisés du monde (à l'exception notable des États-Unis), elle est entrée en vigueur en 1994. Au regard du droit international, la Convention de Montego Bay distingue : - les eaux territoriales, où l'État côtier exerce sa pleine souveraineté. Il s'agit principalement des eaux intérieures (rades, ports, etc.), de la mer territoriale (jusqu'à 12 milles marins de la côte95(*)) et des détroits internationaux (où tous les navires disposent d'un droit de passage) ; - la zone économique exclusive (ZEE), jusqu'à 200 milles marins (370 km), où l'État côtier dispose de « droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ». Ses droits ne sont cependant pas exclusifs en matière de recherches scientifiques et de protection de l'environnement, et il doit assurer la liberté de navigation et de survol. Le régime de la ZEE peut être étendu sous conditions à tout le plateau continental de l'État côtier, mais pour les seules ressources des fonds marins et de leur sous-sol ; - la haute mer, qu'on appelle couramment les « eaux internationales », et qui correspond à tout le reste - soit près de 64 % des océans. Comme les corps célestes, la haute mer n'est sous la juridiction d'aucun État souverain : elle ne peut pas faire l'objet d'une appropriation nationale, et le principe de liberté y prévaut (navigation, survol, pêche, recherche scientifique, pose de câbles et de pipelines, etc.). Comme les corps célestes, la haute mer dispose de ressources naturelles, dont l'exploitation présente à la fois un intérêt économique majeur et une menace pour l'environnement (ressources non renouvelables, perte de biodiversité, pollution, etc.), ce qui justifie une régulation internationale. Il existe donc de nombreuses conventions internationales destinées à réglementer la pêche en haute mer et à protéger certaines espèces (baleine, thon, etc.). Plus bas dans la colonne d'eau, ce sont les « ressources génétiques marines96(*) » qui suscitent le plus de convoitises et d'inquiétudes ; c'est pour protéger celles-ci que le premier traité international de protection de la haute mer a été adopté le 4 mars dernier, par 51 pays, à l'issue de près de vingt ans de négociations. Ce texte, quoique très imparfait, constitue une avancée majeure. * Mais c'est la zone des grands fonds marins (« la Zone ») qui fournit, au regard du droit de l'espace, l'analogie la plus pertinente. Elle dispose en effet d'importantes ressources minérales, notamment les nodules polymétalliques, ces concrétions de 1 à 15 cm de diamètre riches en manganèse, cobalt, cuivre, nickel et autres métaux rares ou précieux qui tapissent le fond des océans en certains endroits. La zone de Clarion-Clipperton, soit 4,5 millions de km² situés entre Hawaii et l'Amérique centrale, contiendrait à elle seule 340 millions de tonnes de nickel (contre 300 millions pour les réserves terrestres estimées) et 275 millions de tonnes de cuivre (275 millions de tonnes sur terre)97(*). La Zone et ses ressources naturelles sont qualifiées de « patrimoine commun de l'humanité » (art. 136 de la Convention). Il en découle, entre autres conséquences, que ni la Zone ni ses ressources ne peuvent faire l'objet d'une appropriation par un État ou une autre personne physique ou morale (art. 137)98(*), que la Zone ne peut être utilisée qu'à « des fins exclusivement pacifiques » (art. 141) et « l'exploration et l'exploitation de ses ressources se feront dans l'intérêt de l'humanité tout entière » (préambule, cf. aussi art. 140). Prévue par la Convention de 1982 et établie en 1994, l'Autorité internationale des fonds marins (AIFM, ou ISA) a pour mission d'organiser et de contrôler les activités relatives à l'extraction des ressources minérales des fonds marins, afin d'éviter la surexploitation au détriment des générations futures, la captation des richesses par les seuls pays développés et les atteintes à l'environnement (notamment à la biodiversité). Il est prévu que l'AIFM assure, par un mécanisme de taxation, « le partage équitable, sur une base non discriminatoire, des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la Zone » (art. 140). L'AIFM n'a pour l'instant octroyé aucun permis d'exploitation, et n'a de toute façon pas la possibilité de le faire tant que les États ne se seront pas accordés sur le « code minier sous-marin » en négociation depuis 2011 (les négociations pourraient aboutir prochainement). Elle a en revanche déjà attribué 31 permis d'exploration, principalement dans la zone Clarion-Clipperton, d'une durée de 15 ans renouvelables et couvrant près de 1,5 million de km². Ces permis, dont l'objectif est à la fois la prospection des ressources et le test des technologies d'extraction, bénéficient à un petit nombre de pays : la Chine, la Corée, la Russie, le Canada, le Japon, l'Inde, la Norvège, l'Allemagne ou encore la France (deux permis pour l'IFREMER), ainsi que quelques « petits pays » de l'Indopacifique (Nauru, Tonga, Kiribati, etc.) - ces derniers attribuant en pratique leurs droits à des entreprises étrangères. Carte des permis accordés par l'AIFM en 2014 Les opérations menées sur place ont permis de montrer deux choses : - d'une part, l'extraction de ces ressources demeure extrêmement complexe sur le plan technique, et donc extrêmement coûteuse, au point qu'elle ne devrait pas devenir rentable avant longtemps ; - d'autre part, cette extraction causera quoi qu'il en soit des dommages considérables à l'environnement : il s'agit, rappelons-le, de draguer la vase par quelque 6 000 mètres de fond pour en extraire les nodules, au moyen d'une sorte de « moissonneuse-batteuse » de plusieurs dizaines de tonnes, détruisant au passage la biodiversité locale et soulevant d'importants nuages de sédiments sur plusieurs centaines de mètres de hauteur, sans compter les rejets toxiques dus au nécessaire traitement sur place du minerai, soit directement au fond, soit sur le navire. C'est pourquoi la France, après avoir dans un premier temps soutenu l'exploitation des nodules polymétalliques, a finalement décidé en novembre 2022 de s'opposer à « toute exploitation des grands fonds marins » (Emmanuel Macron), avec d'autres pays (Allemagne, Espagne, Nouvelle-Zélande, Chili, Costa-Rica, Palaos, Vanuatu, etc.) soutenus par le Parlement européen et une coalition d'ONG. À l'inverse, l'entreprise canadienne The Metals Company a indiqué qu'elle allait solliciter une licence d'exploitation dès 2023, et débuter son activité dès 2024 - avec ou sans « code minier ». Ses difficultés financières, toutefois, ne sont pas sans rappeler celles de Deep Space Industries ou de Planetary Resources. * L'analogie entre les grands fonds marins et les corps célestes est donc bien valable : ces zones ne relèvent de la souveraineté d'aucun État, et leurs ressources minérales, à la fois précieuses et limitées, suscitent autant de convoitises que d'inquiétudes, justifiant une régulation internationale. Mais alors, si l'exploitation des nodules polymétalliques est à la fois complexe, coûteuse et dommageable à l'environnement, pourquoi ne pas envisager d'aller chercher ces métaux là où il n'y a ni biodiversité à détruire, ni atmosphère ou mer à polluer ? C'est bien entendu un calcul de rentabilité qui permettra de trancher entre les deux options, et rien n'est évident à long terme - si ce n'est que le coût réel de l'exploitation des grands fonds marins, en tenant compte des externalités liées aux dommages environnementaux, sera bien plus élevé que le coût assumé par les entreprises. Un tel écart ne se retrouvera pas pour l'exploitation spatiale. Par ailleurs, il existe entre les deux d'importantes synergies. Pour conclure, si l'exemple des grands fonds marins apporte un éclairage utile en vue de l'élaboration d'un cadre juridique adapté à l'exploitation des ressources spatiales, il ne doit pas conduire à en tirer les mêmes conclusions. Bien au contraire, le désastre environnemental qui pourrait résulter de l'exploitation des grands fonds marins constitue un argument puissant en faveur de l'exploitation des ressources spatiales. |
b) Un problème récent
La question de l'appropriation des ressources spatiales est pendant longtemps demeurée très théorique, alimentant les controverses doctrinales davantage que les échanges diplomatiques.
Avec l'imminence d'un retour sur la Lune, il en va tout autrement : comme le souligne la géographe Isabelle Sourbès-Verger, « l'installation d'une base lunaire, prévue pour après 2025, voire à plus longue échéance d'une base martienne, est de fait indissociable de la question de l'exploitation des ressources in situ, de même que celle de l'exploitation minière des astéroïdes99(*) ». Dès lors, la compétition prévisible entre quelques acteurs (États et entreprises privées) pour accéder en premier à des ressources à la fois vitales et limitées appelle à trancher rapidement la question du caractère appropriable de celles-ci, mais aussi à s'accorder sur un ensemble de règles et de normes permettant, concrètement, d'encadrer les futures activités d'extraction, d'utilisation et de commercialisation.
En 2022, le Comité des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique (COPUOS), principal forum multilatéral en matière d'élaboration du droit spatial, s'est donc officiellement saisi de la question, en constituant un « Groupe de travail sur les aspects juridiques des activités relatives aux ressources spatiales », chargé de recommander un ensemble de principes et de lignes directrices100(*). Ces recommandations pourraient ensuite, le cas échéant, être reprises par l'Assemblée générale des Nations Unies sous la forme d'une résolution, elle-même pouvant déboucher sur un nouveau traité international.
|
Le COPUOS et les autres institutions
internationales Le Comité sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique (CUPEEA, ou COPUOS en anglais) est un comité permanent (depuis 1959) de l'Assemblée générale des Nations Unies. Son secrétariat est assuré par le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies (UNOOSA). Il compte une centaine de pays membres et se réunit chaque année en juin pour une session de dix jours. Il comprend deux sous-comités qui se réunissent en amont : le sous-comité scientifique et technique (SCST), et le sous-comité juridique (SCJ). C'est à ce dernier qu'est rattaché le groupe de travail sur les ressources spatiales. Le COPUOS est à l'origine des cinq grands traités du droit de l'espace, ainsi que d'autres textes majeurs (résolutions associées, lignes directrices en matière de débris spatiaux, de soutenabilité des activités spatiales, etc.). D'autres institutions internationales jouent également un rôle dans l'élaboration et de suivi de l'application du droit de l'espace, parmi lesquelles : - l'Assemblée générale des Nations Unies, via sa Première commission (désarmement et sécurité internationale). L'ONU compte 193 membres ; - la Conférence du désarmement : créée en 1979 et comptant 65 membres, c'est l'instance informelle des Nations Unies où se déroulent les négociations en matière de désarmement, y compris dans l'espace ; - l'Union internationale des télécommunications (UIT) : créée en 1865 et composée de 196 membres, l'UIT est aujourd'hui une institution spécialisée des Nations Unies, qui attribue notamment les fréquences et les orbites de satellites et élabore des réglementations techniques. |
Toutefois, les négociations multilatérales au sein du COPUOS ont peu de chances d'aboutir à court terme. De telles négociations sont lentes, et les premières recommandations ne sont pas attendues avant 2027 au mieux101(*), c'est-à-dire dans l'hypothèse d'un consensus entre les pays membres. Or un tel consensus n'existe pas, notamment du fait de la forte opposition de la Russie à un cadre juridique dont elle estime qu'il serait dicté par la vision et les intérêts des États-Unis. Sur ce point précis, il est difficile de lui donner complètement tort.
2. Le SPACE Act et les accords Artemis : un cas d'école de l'unilatéralisme juridique américain
a) Le SPACE Act : projet économique et arme stratégique
L'exploitation des ressources spatiales devenant une perspective de plus en plus réaliste à relativement court terme, les États-Unis ont choisi de prendre l'initiative et d'avancer de façon unilatérale, sans attendre la fin -ni même le lancement - des négociations au niveau multilatéral.
Signé par Barack Obama le 25 novembre 2015, le SPACE Act102(*) prévoit ainsi qu'« un citoyen américain engagé dans l'exploitation commerciale d'une ressource astéroïdale ou d'une ressource spatiale a le droit de posséder, de transporter, d'utiliser et de vendre la ressource obtenue103(*) », ce qui revient à affirmer que les ressources spatiales sont susceptibles d'appropriation en vue d'une exploitation commerciale. Simultanément, le Congrès prend soin d'affirmer que cette loi « ne constitue pas, de la part des États-Unis, une déclaration de souveraineté, de juridiction exclusive ou d'appropriation nationale de quelque corps céleste que ce soit104(*) », et n'est donc pas contraire au principe de non-appropriation posé par le Traité de l'espace de 1967.
Contestée par une partie de la doctrine et par certains pays, cette interprétation se fonde, pour résumer, sur le raisonnement suivant : l'appropriation des ressources tirées des corps célestes n'étant pas interdite par le traité de 1967, et le traité sur la Lune de 1979, non ratifié, n'étant pas applicable, elle est par conséquent permise. Du reste, il n'est pas ici question d'une appropriation nationale, par un État, mais bien d'une autorisation accordée à un acteur privé - à l'instar de celle donnée aux exploitants de la « ressource spectre-orbite » en matière de télécommunications.
Sur le plan économique, ce texte manifeste la volonté des États-Unis de développer la dimension commerciale de l'exploration et des activités spatiales, en garantissant aux potentiels investisseurs un droit de propriété sur les ressources tirées des corps célestes, et sur les revenus correspondants. De même, ce sont d'abord des raisons économiques qui ont conduit certains pays comme le Luxembourg, le Japon ou les Émirats arabes unis à se doter d'une législation inspirée du SPACE Act (cf. infra). À l'époque, c'est principalement l'exploitation minière des astéroïdes qui était visée, le programme lunaire Constellation ayant été annulé cinq ans plus tôt par Barack Obama. Avec le programme Artemis, les perspectives sont à la fois plus importantes et plus immédiates - aussi le SPACE Act, qui bénéficie d'un soutien bipartisan, a-t-il été confirmé par Donald Trump par son executive order (décret présidentiel) du 6 avril 2020.
Mais le SPACE Act n'a pas qu'une dimension économique : sur le plan géopolitique, il s'analyse d'abord comme la manifestation de l'unilatéralisme juridique des États-Unis, ce précédent - quoique relevant du droit interne - ayant vocation à s'imposer de facto comme la norme internationale. Cette dimension politique est d'ailleurs bien plus assumée dans l'executive order du 6 avril 2020, qui vise à encourager « le soutien international à la récupération et à l'utilisation des ressources spatiales ».
En réalité, l'interprétation américaine s'impose aussi de jure dans une large mesure, puisqu'elle est reprise par les accords Artemis.
b) Les accords Artemis et les zones de sécurité
Les accords Artemis, ou Principes de coopération pour l'exploration et l'utilisation civiles à des fins pacifiques de la Lune, de Mars, des comètes et des astéroïdes, sont un accord international qui regroupe les pays participant au programme Artemis mené par les États-Unis, dans le but de ramener les humains sur la Lune - et plus généralement de préparer les futures missions d'exploration spatiale, y compris vers Mars, les comètes et les astéroïdes.
Ils prennent la forme d'une série d'accords bilatéraux entre les États-Unis et chaque pays partenaire, représentés par leurs agences spatiales respectives. Obligatoires pour participer au programme Artemis, ces accords ont été signés par huit pays le 13 octobre 2020, et vingt-quatre pays à ce jour (outre les États-Unis), dont la France (le 7 juin 2022), mais pas l'Allemagne. L'Espagne est le dernier pays à les avoir signés (le 8 juin 2023).
Les pays signataires des accords Artemis au 8 juin 2023. Source : NASA.
Ces accords, qui constituent un engagement politique plus qu'une obligation juridique, établissent une série de principes, de lignes directrices et de bonnes pratiques en vue du retour sur la Lune et, plus largement, du développement de nouvelles activités spatiales. Certains principes sont déjà prévus en droit international (utilisation pacifique, échange d'informations, assistance aux astronautes, immatriculation, prévention des débris, etc.), et d'autres sont nouveaux (ressources spatiales, zones de sécurité, préservation des sites historiques de l'exploration spatiale, etc.).
Le paragraphe 10, consacré aux ressources spatiales, reprend l'esprit du SPACE Act, tout en évitant de faire expressément référence aux notions d'« appropriation » ou de « possession ». L'exploitation à des fins commerciales est non seulement autorisée, mais aussi présentée comme compatible avec le Traité de l'espace de 1967 et les négociations à l'ONU, et plus généralement comme source de progrès pour l'humanité tout entière.
|
Les accords Artemis (extraits) Paragraphe 10 - Ressources spatiales 1. Les signataires notent que l'utilisation de ressources spatiales peut profiter à l'humanité en offrant un soutien essentiel pour la réalisation d'activités sûres et durables. 2. Les signataires rappellent que l'extraction et l'utilisation des ressources spatiales, y compris tout prélèvement sur ou sous la surface de la Lune, de Mars, de comètes ou d'astéroïdes, sont censées être effectués conformément au Traité sur l'espace extra-atmosphérique et en vue d'appuyer des activités spatiales sûres et durables. Les signataires affirment que l'extraction des ressources spatiales ne constitue pas en soi une appropriation nationale aux termes de l'article II du Traité sur l'espace extra-atmosphérique et que les contrats et autres instruments juridiques liés aux ressources spatiales sont censés concorder avec ce traité. (...) Paragraphe 11 - Prévention des interférences 7. Afin de mettre en oeuvre leurs obligations en vertu du Traité sur l'espace extra-atmosphérique, les signataires entendent aviser tout acteur concerné de leurs activités et s'engagent à se coordonner avec lui pour éviter les interférences nuisibles. La « zone de sécurité » est la zone dans laquelle ces mesures d'avis et de coordination seront mises en oeuvre pour éviter les interférences nuisibles. Une zone de sécurité devrait représenter une zone dans laquelle les opérations normales d'une activité pertinente ou un événement anormal pourraient raisonnablement causer des interférences nuisibles. (...) 11. Les signataires s'engagent à utiliser des zones de sécurité, qui sont censées changer, évoluer ou être abolies en fonction du statut de l'activité visée, de façon à encourager la recherche scientifique et la démonstration de technologies ainsi que l'extraction et l'utilisation sûres et efficaces des ressources spatiales en vue d'appuyer l'exploration spatiale durable et d'autres activités. (...) Source : traduction officielle par le Département d'État américain |
Si le paragraphe 10 traite de l'exploitation des ressources spatiales sous l'angle des opportunités économiques, tous les risques et toutes les tensions que le sujet implique sur le plan stratégique, voire sur le plan militaire, sont lisibles en creux dans le paragraphe 11.
C'est ce dernier, le plus contesté, qui introduit le concept de « zone de sécurité », ou « safety zone », dans lequel il est difficile de voir autre chose que les prémices d'une militarisation de l'espace, ou à tout le moins d'une occupation exclusive, si ce n'est d'une appropriation territoriale de facto - quoique le texte s'en défende en multipliant les références à la coopération et au multilatéralisme. Il s'agit en effet de permettre à un pays de définir unilatéralement les zones où il mène des opérations, et ceci afin de les protéger de toute « interférence nuisible » de la part d'un autre acteur, si besoin en prenant les « mesures d'avis et de coordination » qui s'imposent.
Tout ceci est bien sûr défini de manière très vague, mais il ne fait guère de doute qu'à court terme, ce concept a surtout vocation à s'appliquer au périmètre entourant les bases lunaires, la zone de « protection » définie par le premier pays arrivé - et comprenant son accès aux ressources - étant alors synonyme de zone d'exclusion pour les suivants, exception faite de ses alliés et partenaires autorisés.
Sur une zone aussi restreinte que le cratère de Shackleton, il n'est pas difficile d'imaginer ce qu'il adviendrait alors de l'harmonie et de la concorde dont chacun se fait aujourd'hui le défenseur - d'autant que le principe d'utilisation de l'espace à des fins pacifiques est en réalité bien fragile (cf. supra).
3. La politique du fait accompli
a) Les intérêts bien compris de la Chine
Le SPACE Act et plus encore les accords Artemis illustrent le retour de la realpolitik et des rapports de force dans le domaine spatial, le recul du multilatéralisme et l'affirmation d'une logique de blocs.
À cet égard, il n'est pas exagéré de comparer les accords Artemis à l'OTAN pendant la Guerre froide, la liste des pays signataires étant ce qui se rapproche le plus d'une liste des pays qui se considèrent comme « alliés des États-Unis », dans l'espace comme sur Terre. D'ailleurs, les notions de « zone de sécurité » et de « prévention des interférences nuisibles » ne sont pas sans rappeler l'esprit du traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 1949, qui a lui aussi une vocation défensive, et qui lui aussi affiche un objectif de concorde internationale105(*).
Il n'en a pas fallu davantage à Dmitri Rogozine, le directeur de l'agence spatiale russe Roscosmos, pour comparer les accords Artemis à l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan, c'est-à-dire à une coalition mise en place par les Etats-Unis au mépris du droit international. Sur le sujet, la Russie est toutefois isolée : son opposition s'explique assez facilement par le contexte de la guerre en Ukraine, et serait sans doute moins bruyante si le pays pouvait encore espérer, lui aussi, exploiter les ressources in situ dans le cadre d'un programme d'exploration spatiale autonome.
À vrai dire, si les accords Artemis peuvent à certains égards rappeler le Traité de l'Atlantique Nord, ce n'est plus du côté de la Russie mais bien du côté de la Chine qu'il faudrait chercher le « nouveau Pacte de Varsovie ». On ne trouve pourtant rien de tel pour l'instant. L'accord de mars 2021 relatif à l'International Lunar Research Station (ILRS, cf. supra), qui s'en rapprocherait le plus, n'a pas l'ampleur des accords Artemis, et il contient d'ailleurs un volet relatif à l'exploitation des ressources in situ.
De fait, la Chine reste largement silencieuse sur le sujet et se garde bien de prendre formellement position dans les négociations. Cet attentisme s'explique aisément106(*) : l'évolution poussée par les États-Unis correspond in fine à ses intérêts, et il lui suffira d'en récolter les fruits « sur place » le moment venu, sans avoir eu à s'exposer. Du reste, la Chine a clairement dit son intention d'exploiter les ressources extra-atmosphériques, et son droit interne ne fait plus obstacle à ce que cela se fasse dans un cadre commercial107(*).
Enfin, la Chine a conscience que la légalité internationale importe finalement moins que le fait accompli : le cratère de Shackleton sera peut-être à la Lune ce que les îles Spratleys sont à l'Indopacifique - un rocher isolé transformé en base militaire, dont il vaut mieux ne plus s'approcher.
b) Les hésitations de la France : une perte de temps
Dans les faits, l'initiative américaine a globalement suscité peu de réactions au sein de la communauté internationale : peu de pays sont fondamentalement hostiles au principe même de l'exploitation commerciale, et beaucoup n'en ont de toute façon pas les moyens. Pour autant, à ce jour, les pays prêts à soutenir la mise en place d'un cadre juridique effectif sans attendre la fin des négociations multilatérales sont peu nombreux - même si l'on peut considérer que la signature des accords Artemis revient à cela108(*).
La position officielle de la France, en particulier, n'a pas évolué : elle appelle toujours à une solution multilatérale, c'est-à-dire à l'adoption d'un accord international sous l'égide de l'ONU et issu des négociations menées au COPUOS109(*). C'est également la position défendue par la mission d'information sur l'espace110(*) de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale dans son rapport de 2022 (recommandation n° 31) : « Utiliser le CUPEEA [le COPUOS] pour établir un régime juridique mondial sur l'exploitation des ressources spatiales111(*) ».
Il s'agit d'une position de principe - la préférence de la France pour le multilatéralisme - mais pas seulement. En effet, l'absence d'évolution de la position internationale officielle de la France s'explique aussi par les débats en cours au niveau national, entre administrations, qui s'ils n'ont pas (encore) abouti à un arbitrage politique, n'en ont pas moins lieu. Or il existe, au sein des administrations chargées de la politique spatiale, des sensibilités différentes112(*).
Il n'en demeure pas moins que la position officielle de la France apparaît de plus en plus problématique, pour trois raisons :
- d'abord, le multilatéralisme ne fonctionne pas dans ce cas précis. En continuant à appeler à un accord international qui est de toute évidence illusoire, la France fait au mieux preuve de naïveté ;
- ensuite, cette position est en partie hypocrite, dans la mesure où la France a rejoint les accords Artemis le 7 juin 2022 : elle a donc d'ores et déjà souscrit à l'interprétation américaine ;
- enfin, et surtout, cette position est totalement contre-productive, car l'exploitation des ressources spatiales va de toute façon avoir lieu : d'une part, elle est indispensable, aucune mission habitée n'étant viable sans recours à l'ISRU (ce que du reste personne ne conteste) ; d'autre part, elle sera de toute façon permise d'une manière ou d'une autre, l'initiative américaine suffisant à elle seule à fixer de facto la norme internationale.
Dans ces conditions, les hésitations de la France ne sont rien d'autre qu'une perte de temps, de surcroît à un moment où tout s'accélère. Ce n'est un service rendu ni à nos intérêts politiques, ni à notre compétitivité économique.
Pire encore : tout le temps passé à discuter du principe même de l'appropriation est autant de temps perdu pour en négocier les modalités, qui sont le véritable enjeu (attribution, redistribution, contrôles, etc.). Ici, tout reste à définir, et rien dans les accords Artemis n'exclut a priori la mise en place, par exemple, d'un organisme ayant une mission équivalente à celle de l'Autorité internationale des fonds marins. Pour le coup, l'Europe a ici une vision singulière à défendre (cf. Partie III), mais encore faudrait-il pour cela qu'elle se saisisse du sujet. Rien de tout cela n'arrivera si la France, avec les autres puissances spatiales européennes, ne prend pas ses responsabilités.
C. ASPECTS ÉCONOMIQUES : LA COMMANDE PUBLIQUE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Si la construction d'un cadre juridique adapté est nécessaire, c'est aussi parce que l'exploitation des ressources spatiales pourrait constituer une opportunité économique majeure, quoique de long terme, qui s'inscrit dans le contexte plus large d'une ouverture de l'espace extra-atmosphérique à de nouveaux acteurs et services commerciaux. En Europe, le Luxembourg est le premier pays à avoir parié sur le New Space des ressources spatiales.
Il faut ici se garder de toute naïveté : comme ailleurs dans le secteur spatial, l'émergence de modèles économiquement viables dépend d'abord, et pour longtemps encore, de la commande publique - c'est-à-dire largement des États-Unis.
Pour autant, les perspectives de rentabilité sont crédibles, et s'il est bien trop tôt pour se prononcer sur la viabilité de tel ou tel modèle, on peut néanmoins rappeler quelques raisons d'être optimiste.
1. Le nouveau business des ressources spatiales
a) Un marché important et bien identifié
Le secteur spatial dans son ensemble représente aujourd'hui un marché d'environ 400 milliards de dollars, un montant qui pourrait plus que doubler d'ici 2040, à près de 1 000 milliards de dollars113(*). La perspective est impressionnante, et elle est consensuelle. En effet, elle s'explique en grande partie par l'apparition de nouveaux services commerciaux en orbite, portés par l'abaissement des coûts de lancement, les constellations, les projets de stations spatiales privées et de véhicules de service modulaires, les progrès du vol habité et la relance des grands programmes d'exploration.
Ces dernières années, de nombreuses études se sont penchées sur le potentiel de développement économique et commercial de l'orbite basse. La NASA, qui en a fait l'un de ses grands objectifs, a même commandé une étude sur le sujet à douze entreprises différentes en 2019114(*). Dans un rapport de 2022, le cabinet Deloitte estime par exemple que le marché commercial de l'orbite basse pourrait atteindre 312 milliards de dollars en 2035, soit huit fois plus qu'aujourd'hui (environ 40 milliards de dollars par an), et compare la révolution actuelle à celles du rail, de l'automobile et d'Internet115(*).
Plusieurs de ces nouveaux services commerciaux sont directement ou indirectement liés à l'exploitation des ressources spatiales, à commencer par le refueling et les dépôts de carburant orbitaux (cf. Partie I). Le retour sur investissement, ici, s'apprécie à court terme : il ne s'agit pas d'aller miner de l'or sur un astéroïde entre Mars et Jupiter.
D'autres études portent plus spécifiquement sur le potentiel de l'économie lunaire et cislunaire, comme celle du cabinet PwC qui évalue le marché lunaire à plus de 170 milliards de dollars entre 2020 et 2040 en valeur cumulée116(*), soit environ :
- 100 milliards de dollars pour le transport Terre-Lune, avec un marché principalement tiré par les États-Unis, la Chine, le Japon et l'Europe, et une participation croissante des acteurs privés ;
- 63 milliards de dollars pour l'ISRU, correspondant principalement à la fabrication de carburant (les activités liées au life support et à la construction/fabrication étant appelées à croître par la suite), avec des acteurs privés positionnés sur l'ensemble de la chaîne de valeur ;
- 8 milliards de dollars pour le marché des données, en particulier celles liées à l'environnement (topographie et géologie, composition chimique, mesure des radiations, etc.).
Quelques entreprises impliquées dans la chaîne de valeur de l'ISRU. Source : PwC 2021.
Le « Lunar Commerce Portfolio » publié en 2022 par la Moon Village Association (MVA) livre quant à lui une analyse détaillée de neuf secteurs de marché de l'économie lunaire117(*), en passant en revue les aspects techniques, les potentiels débouchés commerciaux, les principaux acteurs, etc.
|
Ce rapport très complet doit beaucoup aux travaux techniques de l'ISRU Gap Assessment Report de 2021 (cf. Partie I), qu'il actualise et auquel il ajoute une dimension commerciale. Créée en 2017, la Moon Village Association (MVA) réunit environ 600 participants (entreprises, chercheurs, investisseurs, société civile, etc.) et 30 institutions (agences spatiales, ISECG, etc.) issus de 65 pays différents. La MVA est basée à Vienne, là où se réunit le COPUOS, où elle dispose d'un statut d'observateur118(*). |
Les neufs secteurs de marché 1. Transport depuis/vers la Lune 2. Transport en surface 3. Communication et navigation 4. Energie et électricité 5. Logistique et services 6. Construction et fabrication 7. Extraction minière 8. Habitat et stockage 9. Agriculture et nourriture |
En décembre 2021, la MVA a également publié un rapport119(*) sur les principaux « concepts architecturaux du Village lunaire », qui passe en revue les spécifications techniques attendues des différentes « briques » de celui-ci : production d'énergie, systèmes de life support, protection, modules d'extraction des ressources, de production, de recyclage, d'agriculture, etc.
Les « briques » du village lunaire selon Thales Alenia Space. Source : MVA 2021.
Pour l'instant, le marché lunaire commercial est balbutiant et dépend des commandes de la NASA dans le cadre du programme Artemis. Les choses devraient cependant s'accélérer rapidement, et plusieurs missions privées sont d'ores et déjà prévues, prenant la suite de la mission Hakuto-R de la société japonaise ispace.
|
ispace et la mission Hakuto-R Fondée en 2010, ispace est une société japonaise privée qui développe des atterrisseurs et rovers lunaires pour des missions commerciales de transport et d'exploration spatiale. Elle ne vend donc pas un véhicule mais un service, et ses clients potentiels sont à la fois les agences spatiales et les clients privés. Elle vise explicitement le marché des ressources spatiales et de l'ISRU : « la mission d'ispace est de permettre à ses clients de découvrir, cartographier et utiliser les ressources naturelles de la Lune ». L'atterrisseur et le rover avaient initialement été développés par Hakuto, une équipe de chercheurs, dans le cadre du Google Lunar X Prize, une compétition internationale organisée entre 2007 et 2018 - par un autre acteur privé - visant à récompenser l'équipe qui réussirait à concevoir, fabriquer et poser un engin à la surface de la Lune. Aucune équipe n'ayant atteint l'objectif fixé, la compétition a été annulée, mais l'équipe Hakuto, finaliste, qui était entretemps devenue la société ispace et était parvenue à lever des fonds, a poursuivi ses travaux. Ceux-ci ont abouti en 2023 au lancement de la mission Hakuto-R 1, qui peut être considérée comme la première mission lunaire privée, dans la mesure où ni son lanceur (un Falcon 9 de Space X), ni son atterrisseur (Hakuto-R d'ispace) ne dépendent d'une agence spatiale. Sa charge utile comprenait notamment le rover Rashid, premier rover des Émirats arabes unis120(*), ainsi qu'un rover japonais développé par la JAXA et l'entreprise privée Tomy. Première mission lunaire privée, impliquant de surcroît deux des quatre pays dotés à ce jour d'une législation autorisant l'exploitation commerciale des ressources spatiales (le Japon et les Émirats arabes unis), la mission Hakuto-R 1 aurait pu constituer un premier « crash test juridique ». Ce fut plutôt un crash test tout court : après un lancement réussi en décembre 2022 et un voyage de 1,4 million de kilomètres, l'atterrisseur s'est finalement écrasé le 25 avril 2023 dans le cratère Atlas. Il semble qu'une erreur du système de télémétrie, liée à la décision tardive de modifier le site d'atterrissage, soit à l'origine de cet échec. En 2019, l'atterrisseur israélien Beresheet, lui aussi développé pour le Google Lunar X Prize, avait connu le même sort. À ce jour, seuls les États-Unis, l'URSS et la Chine ont donc réussi à poser un véhicule sur la Lune. L'avenir est toutefois loin d'être sombre pour ispace : la société japonaise et sa filiale ispace Europe font partie d'un consortium sélectionné en 2022 par la NASA dans le cadre du programme CLPS (cf. infra). Ce consortium est mené par Draper et comprend également Spaceflight Industries et General Atomics. |
b) Synergies terrestres et fertilisation croisée
L'une des raisons de croire à la viabilité de l'économie des ressources spatiales est l'existence d'importantes synergies entre activités spatiales et activités terrestres.
Pour les start-up, d'ailleurs, l'existence de débouchés commerciaux « terrestres » à court terme est souvent le principal gage qu'elles ont à donner aux investisseurs pour qu'ils financent le développement de leur offre « spatiale », dont l'horizon est forcément plus lointain et incertain. C'est aussi ce que demandent des incubateurs comme l'ESRIC au Luxembourg ou TechTheMoon en France (cf. infra).
La société Maana Electric, fondée en 2018 et installée au Luxembourg, développe par exemple une telle technologie qui permet de fabriquer des cellules photovoltaïques soit à partir de sable du désert - c'est la TerraBox, dont un premier prototype a déjà été construit -, soit à partir de régolithe lunaire dans le cadre de l'ISRU.
Les panneaux de Maana Electric sur Terre (G) et sur la Lune (D) (vue d'artiste).
La particularité de l'ISRU est qu'il s'agit d'un domaine impliquant non seulement des acteurs traditionnels du secteur spatial, mais aussi des acteurs issus d'autres secteurs d'activité. C'est ce que le groupe « Objectif Lune » de l'ANRT appelle « l'interdépendance spatial/non-spatial », ou ISNS, dans une récente note consacrée à la fertilisation croisée entre les deux secteurs121(*) : « l'ISNS assure la collaboration étroite entre des acteurs terrestres qui disposent de savoir-faire terrestres déjà développés ou en cours de développement, sur Terre, avec des acteurs spatiaux qui disposent d'une connaissance fine des exigences particulières du milieu spatial ».
De fait, les bénéfices technologiques mutuels sont évidents et les transferts se font dans les deux sens :
- l'adaptation de technologies terrestres au milieu spatial (spin in) : panneaux photovoltaïques, réacteurs nucléaires modulaires, piles à combustible, électrolyse, impression 3D, recyclage de l'air et de l'eau, culture en milieu fermé, etc. En matière de mobilité, des constructeurs comme General Motors et Toyota ont signé des partenariats avec la NASA et la JAXA pour développer des rovers lunaires, et Michelin travaille sur des pneus résistant aux agressions du régolithe ;
- les retombées terrestres des technologies développées pour l'espace (spin off) : les recherches menées dans l'espace ont permis des avancées en de nombreux domaines (médecine, biologie, agriculture, chimie, optique, etc.), sans parler bien sûr des services qui dépendent des satellites de télécommunication, de navigation et de détection.
Le meilleur exemple de fertilisation croisée est sans doute celui de l'industrie minière et extractive : en effet, les technologies développées pour l'exploitation des grands fonds marins ou les zones polaires et les déserts reculés sont, à bien des égards, transposables à l'ISRU - et réciproquement.
Les rovers autonomes développés par OffWorld pour l'exploitation minière en milieu extrême, y compris sur la Lune et sur Mars. La start-up américaine OffWorld a ouvert une filiale au Luxembourg début 2023.
|
Le cas de l'industrie minière L'industrie minière et extractive est concernée à différentes étapes de la chaîne de valeur de l'ISRU, avec à chaque fois des synergies terrestres : - au stade de la prospection, avec le développement d'instruments de spectrométrie avancés. Les radars CRIS (Crack Identification System) et PRIS (Potash Roof Inspection System), développés par la société suisse RTS et utilisés dans les mines canadiennes pour inspecter les tunnels et détecter les fissures, sont par exemple issus d'un radar initialement développé par l'ESA pour étudier le sol de la Lune122(*) ; - au stade de l'extraction : la compagnie canadienne Agnico Eagle teste par exemple dans sa mine de LaRonde au Québec une technologie de forage autonome en conditions extrêmes qui pourrait être transposée au milieu arctique, mais aussi sur la Lune ou sur Mars ; - en matière de robotisation et d'autonomie d'une manière générale : la compagnie Rio Tinto, en particulier, a développé au cours des dix dernières années un ensemble de solutions permettant à ses camions et machines de forages d'opérer de manière entièrement autonome pour ses opérations dans le désert australien, grâce à un recours à l'intelligence artificielle et à l'analyse en temps réel des données. À la fois puissance spatiale et doté d'une importante industrie minière, le Canada123(*), à l'instar de l'Australie, a pris conscience depuis longtemps de ce potentiel. L'exploitation des ressources spatiales figure ainsi en bonne place dans le Canadian Minerals and Metals Plan présenté conjointement en mars 2019 par le gouvernement et les entreprises124(*), et des partenariats entre le secteur minier et l'agence spatiale canadienne (CSA) existent depuis plusieurs années, avec des transferts de technologies dans les deux sens : - de la Terre vers l'espace : en 2008, la compagnie Ontario Drive & Gear Limited a ainsi été sélectionnée par la CSA pour développer des prototypes de rovers en vue des missions Juno et Artemis, et l'entreprise Deltion Innovations développe pour le compte de la CSA un outil de forage rotatif susceptible d'être utilisé sur la Lune et sur Mars ; - de l'espace vers la Terre : forte de l'expérience acquise avec la CSA, la même compagnie Ontario Drive & Gear Limited a ensuite développé l'ARGO J5, un rover amphibie utilisé pour ses opérations sur Terre au Canada, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Bien sûr, les ressources spatiales offrent à court terme moins de perspectives que les ressources terrestres, même pour les plus difficilement accessibles (nodule polymétalliques, climats extrêmes, etc.). Il n'en demeure pas moins que, du seul fait de l'existence de synergies, ces entreprises préparent pour ainsi dire le terrain. Les perspectives pour l'industrie minière vont donc au-delà de l'ISRU et concernent aussi l'extraction des ressources pour une commercialisation sur Terre ; d'ailleurs, si les recherches en matière d'ISRU (production d'oxygène ou de carburant à partir du régolithe, etc.) sont principalement financées par le secteur public, les recherches sur les KREEP (potassium, terres rares et phosphore) sont principalement dues à l'industrie minière. À plus long terme encore, ce sont bien les industries extractives qui seront concernées par les astéroïdes métalliques. |
2. Le Luxembourg : un paradis spatial ?
a) Une stratégie d'attractivité économique
En février 2016, à peine trois mois après la signature du SPACE Act aux États-Unis, le Luxembourg a lancé l'initiative SpaceResources.lu, visant à faire du pays le « hub européen pour l'utilisation et l'exploitation des ressources spatiales ». L'année suivante, le Grand-Duché est devenu le deuxième pays au monde à se doter d'une loi permettant l'exploitation des ressources spatiales à des fins commerciales. Il a été suivi par les Émirats arabes unis (2019) et le Japon (2021).
L'objectif de ces pays n'était pas le leadership géopolitique, mais bien la compétitivité économique. En décidant, sous l'impulsion de son ministre de l'économie Etienne Schneider, conseillé par l'ancien directeur de l'ESA Jean-Jacques Dordain, de se positionner très tôt sur le sujet des ressources spatiales, le Luxembourg espérait trouver là un relais de croissance et un levier d'attractivité, en tirant parti d'une double opportunité :
- d'une part, une spécialisation économique existante à la fois dans le secteur aérospatial, avec notamment le groupe SES, premier opérateur de satellites au monde, et dans des secteurs industriels traditionnels (sidérurgie, métallurgie, chimie, etc.) dont le savoir-faire pourrait être précieux pour l'exploitation des ressources spatiales ;
- d'autre part, un contexte mondial porteur pour le spatial, avec la relance des ambitions américaines et le dynamisme du New Space, et une « lace à prendre » au niveau européen, voire au niveau mondial, sur le « créneau » des ressources spatiales.
À l'origine, l'initiative visait surtout l'exploitation des astéroïdes riches en métaux, avec l'idée de transposer le savoir-faire des industries minières traditionnelles : c'était l'époque des grandes promesses de sociétés comme Deep Space Industries (DSI) et Planetary Resources, dans lesquelles le Luxembourg avait d'ailleurs investi125(*), et qui ont rapidement fait faillite (cf. Partie I). Avec le programme Artemis et la perspective d'un retour sur la Lune à court terme, la priorité a changé : il s'agit désormais de relever le défi technologique de l'utilisation des ressources in situ (ISRU).
La stratégie SpaceResources.lu vise à offrir aux entreprises souhaitant développer des projets liés à l'exploitation des ressources spatiales un environnement favorable, afin de les convaincre de s'installer dans le pays, avec leurs emplois et leurs brevets. Elle est pilotée par la Luxembourg Space Agency (LSA), créée en 2018.
|
La Luxembourg Space Agency (LSA) Si le Luxembourg est membre de l'ESA depuis 2005 (le pays figure parmi les premiers contributeurs par tête), la création de la Luxembourg Space Agency (LSA) date seulement de 2018, dans la foulée du lancement de l'initiative SpaceResources.lu, qui est le coeur de la stratégie spatiale du Grand-Duché. La LSA assure le lien entre acteurs publics et privés du secteur spatial, et représente le Luxembourg auprès de l'ESA, de la Commission européenne, de l'ONU (COPUOS) et des autres instances du secteur. Si le Luxembourg est présent depuis longtemps dans le domaine des satellites de télécommunications, le reste de sa politique spatiale est pour l'essentiel très récent et orienté vers le soutien aux activités commerciales. Aussi la LSA constitue-t-elle une sorte de « guichet unique » en la matière, là où en France, par exemple, les compétences - et les priorités - sont réparties entre le CNES, le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et ministère des armées. C'est sans doute la direction générale des entreprises (DGE) qui, au sein de l'administration centrale française, se rapproche le plus de la LSA. Celle-ci a pourtant changé de statut juridique récemment : auparavant simple service du ministère de l'économie, elle est désormais une fondation (entièrement publique), ce qui lui permet notamment de recevoir des financements privés (par exemple pour l'organisation d'événements). Les effectifs de la LSA se limitent à quelques dizaines de personnes. Elle est dirigée par Marc Serres, ingénieur en télécommunications et ancien directeur des affaires spatiales au ministère de l'économie du Grand-Duché. |
La stratégie SpaceResources.lu repose, concrètement, sur deux grands piliers : la sécurité juridique et le soutien à l'écosystème.
b) La loi sur les ressources spatiales de 2017
Inspirée du SPACE Act, la loi du 20 juillet 2017 sur l'exploration et l'utilisation des ressources de l'espace a pour but d'offrir aux entreprises un cadre juridique sécurisé.
Son article 1er tient en une phrase : « les ressources de l'espace sont susceptibles d'appropriation ».
Le reste du texte institue un régime d'agrément préalable pour les entreprises souhaitant exploiter des ressources spatiales dans le cadre d'une activité commerciale126(*). L'agrément, délivré par le ministre chargé de l'économie et de l'espace, est subordonné à plusieurs conditions (viabilité technique, solidité financière, police d'assurance, etc.), et réservé aux entreprises ayant leur siège au Luxembourg. Il est accordé pour une seule mission, non cessible et valable trois ans : en pratique, il doit donc être demandé lorsque le projet est déjà mature.
À ce jour, aucun agrément n'a été délivré, mais plusieurs entreprises ont fait part de leurs intentions à cet égard. La société ispace Europe pourrait être la première à le solliciter (cf. infra).
c) Un écosystème attractif et dynamique
L'autre pilier de la stratégie luxembourgeoise est le soutien apporté à l'écosystème : il s'agit, là encore, d'offrir un environnement favorable aux entreprises souhaitant développer des projets, qu'il s'agisse d'acteurs établis ou de start-up innovantes.
Ce soutien est d'abord apporté via l'ESRIC (European Space Resources Innovation Centre), une structure hybride créée avec le soutien de l'ESA, à la fois centre de recherche mutualisé et incubateur de start-up, dont l'objectif est de faire émerger des modèles économiques viables.
Au-delà de l'ESRIC, le soutien public à l'écosystème passe par différents mécanismes et mobilise divers acteurs. La commande publique stricto sensu passe exclusivement par l'ESA, via ses programmes optionnels ou via le programme national dont la gestion lui a été déléguée. Le pays dispose aussi de véhicules d'investissement, notamment le fonds Orbital Ventures, doté de 120 millions d'euros apportés par la SNCI - l'équivalent de Bpifrance - et des investisseurs privés127(*).
|
Le rôle de l'ESRIC L'ESRIC a été créé en 2020 à l'initiative de la Luxembourg Space Agency (LSA) et du Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), en partenariat stratégique avec l'Agence spatiale européenne (ESA). Il est installé dans les locaux du LIST à Belvaux. Présenté comme « le premier centre d'innovation au monde entièrement dédié à la question des ressources spatiales », l'ESRIC est à la fois : - un centre de recherche mutualisé, avec la mise à disposition d'installations et d'équipements au sein des laboratoires du LIST et de l'ESA (régolithe simulé, machines d'analyse, chaînes d'assemblage des prototypes, etc.). Priorité est donnée aux projets de transformation du régolithe lunaire en oxygène, mais d'autres projets sont menés (chaîne de valeur ISRU, construction et fabrication à partir de matériaux locaux, etc.) ; - un incubateur de start-up dans le domaine des ressources spatiales, en vue de faire émerger des modèles commercialement viables, destinés à la fois au marché spatial et aux applications terrestres. Les trois phases du programme (pré-incubation, incubation et post-incubation) incluent une validation des développements techniques, un accompagnement dans l'élaboration du business plan, un accès aux investisseurs et clients potentiels, et le cas échéant, un soutien direct de 200 000 euros. À partir de la deuxième phase, les start-up doivent s'installer au Luxembourg ; - un centre de partage des ressources en matière d'évolution de la législation, de connaissance du marché et de recherche scientifique ; - un centre d'animation de la communauté, avec en particulier la Space Resources Week. L'ESRIC est dirigé depuis 2022 par le Dr. Kathryn Hadler, ingénieur chimiste spécialiste du traitement et de la valorisation des minéraux par l'industrie minière, qui s'intéresse notamment à la transposition des technologies utilisées sur Terre au domaine de l'ISRU. Une quinzaine de chercheurs et ingénieurs spécialistes de différents domaines (planétologie, chimie, mécanique, géologie, extraction minière, etc.) travaillent au sein de l'ESRIC, et les effectifs devraient doubler d'ici 2024. |
Plus généralement, l'écosystème bénéficie de tous les avantages du pays en matière d'attractivité économique, qu'il s'agisse de la qualité des services publics, de la présence de grandes entreprises et de centres de recherches - et bien sûr d'une fiscalité et d'un droit des sociétés avantageux.
La stratégie spatiale luxembourgeoise a porté ses fruits et le Grand-Duché est aujourd'hui effectivement considéré comme le « hub » européen en matière de ressources spatiales. Ainsi, entre 2018 et 2022, le nombre d'entreprises relevant du secteur spatial établies dans le pays est passé de 32 à 75, et le nombre d'employés de 840 à 1 150 - et la tendance se poursuit. La LSA indique être en contact direct avec une centaine d'entreprises chaque année.
Le Start-up Support Programme (SSP) de l'ESRIC compte déjà deux « promotions », soit dix start-up sélectionnées pour la phase de pré-incubation. Les 50 candidatures étaient issues de 30 pays différents. Elles s'adressent à la fois au marché spatial (ISRU) et terrestre :
|
Promotion 2022 · Adventus Interstellar (Suisse) : systèmes d'atterrisseurs de rovers à bas coût ; · Anisoprint (Luxembourg) : impression 3D d'outils, de composants et de pièces détachées pour l'ISRU ; · Astroport (États-Unis) : briques de régolithe et impression 3D ; · Four Point (Pologne) : technologies pour les rovers miniers autonomes sur Terre et sur la Lune ; · Orbit Recycling (Allemagne) : collecte de débris spatiaux et transport sur la Lune en vue de leur recyclage. |
Promotion 2023 · Above Materials (États-Unis) : transformation des déchets métaboliques humains en polymères (pour fabriquer des outils, des protections, etc.) ; · Aurora Connect (Pologne) : connecteur (électricité/données) adapté aux conditions lunaires, en particulier au régolithe ; · Lightigo Space (Rép. Tchèque) : analyse spectrométrique des matériaux et ressources de l'ISRU ; · Lunar Outpost EU (Luxembourg) : production d'énergie thermique sur la Lune et sur Terre ; · Terra Luna Resources (Canada) : transformation de la glace lunaire en eau purifiée. |
Parmi les entreprises installées dans le pays, on peut également citer Maana Electric (cf. supra) ou encore la biotech germano-luxembourgeoise Blue Horizon, qui développe une gamme de Biological Soil Crusts (BSC), des terreaux à base de micro-organismes sélectionnés (bactéries, algues, champignons, etc.) avec diverses applications non seulement dans le cadre des missions spatiales (production d'oxygène, recyclage des déchets, agriculture en système fermé, médicaments, etc.) mais aussi sur Terre (pour fertiliser des terres arides ou capturer du CO2).
Le rover d'ispace, conçu pour le Google Lunar X Prize.
Le Luxembourg est aussi le siège d'ispace Europe, qui construit de petits rovers lunaires modulaires à vocation commerciale, complémentaires des alunisseurs développés par la société-mère japonaise ispace (cf. supra). Associée à ArianeGroup, ispace Europe a d'ailleurs été sélectionnée par l'ESA pour le programme scientifique PROSPECT, dont l'objectif est de développer des technologies permettant d'extraire de l'eau sur la Lune.
Le dynamisme de l'écosystème tient aussi à la présence de grands groupes industriels et d'acteurs établis comme Airbus Defence and Space, qui travaille avec l'ESRIC sur des technologies d'impression 3D à partir des métaux extraits du régolithe par la technologie ROXY (cf. Partie I), ou encore Air liquide Advanced Technologies (cf. Partie III). Plusieurs de ces acteurs, notamment français, se sont regroupés au sein d'EURO2MOON, une association créée en octobre 2021 au Luxembourg :
|
· Airbus Defence and Space · Air Liquide Advanced Technologies · ispace · Spartan Space · l'ESRIC |
· le CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) · l'ANRT (Association nationale de la recherche et de la technologie) · Arthur D. Little (cabinet de conseil) |
|
|
« EURO2MOON vise à positionner l'industrie européenne comme un acteur de premier plan de l'économie lunaire montante, en créant un écosystème industriel fort basé sur une vision ambitieuse de l'utilisation des ressources in situ (ISRU) « L'objectif est de créer une plateforme d'échange afin de construire une vision commune et de la promouvoir parmi les écosystèmes industriels et institutionnels européens, de proposer des recommandations sur les feuilles de route globales, des concepts de démonstration et des programmes commerciaux. Les sujets abordés seront notamment le transport de longue durée, le support à la vie, et les besoins énergétiques pour les applications scientifiques et commerciales ». Source : communiqué de presse du 26 octobre 2021 |
||
Au-delà des entreprises installées sur place, la stratégie luxembourgeoise confère au pays un véritable « soft power » dans le domaine de l'exploitation des ressources spatiales.
Le Space Resources Challenge ESA/ESRIC.
On aperçoit au fond l'habitat gonflable
de
Spartan Space. Photo : Radio France.
En partenariat avec la Colorado School of Mines (États-Unis) et l'International Space University (ISU, Pays-Bas), l'ESRIC organise chaque année la Space Resources Week, devenue l'événement majeur de ce secteur émergent. L'édition de 2023 a rassemblé plus de mille participants, issus d'agences spatiales, organismes de recherche, start-up et industriels de différents pays128(*).
En septembre 2022, l'ESA et l'ESRIC ont organisé le Space Resources Challenge, un véritable « concours de robots lunaires » sur l'ancien site sidérurgique d'Esch-sur-Alzette, où cinq rovers finalistes s'affrontaient pour retrouver et extraire des minerais dissimulés dans un environnement lunaire reconstitué. Le gagnant a remporté 500 000 euros.
Image d'illustration pour l'édition 2023 du Space Resources Challenge, qui portera cette fois sur l'identification et la caractérisation des ressources lunaires. Source : ESA/ESRIC.
Sur le plan juridique, la loi de 2017 constitue elle aussi un instrument de soft power. Elle est régulièrement évoquée lors des échanges au sein du COPUOS, auxquels le Luxembourg contribue, avec des pays comme la Chine, le Japon, les Émirats arabes unis, la Russie, la Belgique, la Pologne, la République tchèque ou encore le Portugal129(*). L'Université du Luxembourg propose pour sa part un Master en droit de l'espace, avec un module spécifiquement consacré aux ressources spatiales.
Plusieurs enseignements utiles peuvent être tirés du succès de la stratégie luxembourgeoise, notamment dans la perspective d'une initiative française ou européenne (cf. Partie III).
Tout d'abord, il n'est pas nécessaire de disposer des moyens des États-Unis et du budget de la NASA pour tirer parti des opportunités économiques en matière d'exploitation des ressources spatiales. Une simple loi clarifiant le régime juridique applicable peut suffire à envoyer un signal et à offrir une sécurité juridique aux entreprises et aux investisseurs : cela ne coûte rien et peut rapporter beaucoup. Une telle loi n'a, en outre, pas besoin d'être compliquée : il reste bien assez de temps pour étoffer ou ajuster ses dispositions. Dans l'idéal, cela ne serait même plus nécessaire, le « signal » ayant permis de susciter une initiative à l'échelle européenne.
Ensuite, s'il n'est pas nécessaire de disposer de moyens importants, il est en revanche impératif de disposer d'une volonté politique forte et d'une vision de long terme, clairement exposée et maintenue dans la durée. Seul un tel engagement permet de mobiliser sur le long terme les différents acteurs du soutien public - ministres et parlementaires, agence spatiale, institutions financières, centres de recherche, régulateurs, diplomates, etc.
À cet égard, le Luxembourg a clairement fait le pari de la commercialisation de l'espace et du soutien au développement de modèles rentables et d'acteurs privés comme il l'a fait dans les années 1980 en matière de satellites de télécommunication. Ce pragmatisme est la vertu de son modèle, mais aussi l'une des limites de la comparaison avec d'autres pays européens, dont la France : il n'est ici question ni d'autonomie stratégique, ni de souveraineté économique. La LSA n'a pas de leadership à disputer à la NASA, pas de priorité scientifique ou de doctrine juridique à défendre, et le Luxembourg n'a pas davantage l'intention d'établir sa propre base lunaire qu'il ne souhaite construire son propre Starship.
Pour le dire autrement, si le développement de l'économie lunaire et cislunaire dépend finalement des seules commandes de la NASA, parce que les Européens n'auront pas su se donner les moyens de leurs ambitions, le Luxembourg n'aura pas pour autant perdu son pari économique.
Car c'est bien le coeur du sujet : les vastes perspectives commerciales qui s'ouvrent actuellement aux entreprises privées ne seraient absolument pas viables sans une commande publique massive et pérenne. Or celle-ci est, pour l'essentiel, américaine.
3. Une leçon de colbertisme spatial : le modèle américain
Lorsqu'elle signe en 2006 son premier contrat avec la NASA, pour le transport d'astronautes et de fret vers l'ISS, la société SpaceX, fondée quatre ans plus tôt, n'a encore réalisé aucun lancement. Il lui faudra encore deux ans et plusieurs échecs avant que le Falcon 9 ne réussisse son premier vol, en 2008. La NASA lui maintient pourtant sa confiance et lui accorde de nouveaux contrats, auxquels viennent bientôt s'ajouter ceux du Département de la Défense. Quinze ans plus tard, le Falcon 9 est devenu, de très loin, la fusée la plus fiable et la plus utilisée de l'histoire, avec plus de 200 vols réussis130(*). À elle seule, SpaceX a effectué 60 des 180 lancements de 2022, et a annoncé plus de 100 vols pour 2023, soit davantage que tous les lancements effectués dans le monde il y quatre ans.
Le cas de SpaceX est le plus célèbre, mais il est loin d'être le seul : ainsi, n'en déplaise aux milliardaires libertariens de la Silicon Valley et aux adeptes du mythe de l'entrepreneur visionnaire, le succès du New Space américain est avant tout le résultat du soutien massif, constant et réfléchi apporté par la puissance publique, et ceci depuis les débuts de la politique spatiale américaine. Si de nouveaux acteurs plus agiles et innovants viennent aujourd'hui contester les positions des Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman et autres géants du complexe militaro-industriel, c'est avant tout parce que l'État et la NASA l'ont voulu, parce qu'ils y trouvent leur intérêt131(*).
Cette politique relève d'un véritable « colbertisme spatial », assumé par les États-Unis, et dont l'Europe gagnerait à s'inspirer.
Bien sûr, tout n'est pas transposable, et bien d'autres facteurs, dont l'Europe ne bénéfice pas, contribuent à expliquer le succès des États-Unis : un marché vaste et très concurrentiel, un accès facilité au capital, une culture du risque, des pôles d'excellence universitaire, technologique et industrielle, etc. Tout ceci ne se décrète pas en Conseil des ministres. En revanche, une politique industrielle volontariste et constante, disposant d'outils bien conçus pour atteindre ses objectifs, devrait être à notre portée.
Avant d'en venir aux propositions (Partie III), il n'est pas inutile de rappeler les trois principaux éléments qui, au-delà de l'ampleur des moyens budgétaires, font le succès de la politique spatiale américaine132(*) :
- une stratégie spatiale définie et structurée au niveau national ;
- une commande publique fiable et ouverte au risque ;
- une préférence nationale assumée.
a) Une stratégie spatiale définie et structurée au niveau national
Le premier élément est l'existence, de longue date, d'une stratégie spatiale clairement définie au niveau national, maintenue sur la durée et traduite de façon cohérente dans les différents programmes spatiaux et par les différents acteurs concernés : en d'autres termes, les États-Unis savent où ils vont, ils le disent, et ils s'en donnent les moyens.
Cette stratégie est définie au plus haut niveau politique, avec la publication par chaque Administration d'une feuille de route pour le secteur spatial, la National Space Policy. Sa dernière mise à jour date du 9 décembre 2020, à la fin du mandat de Donald Trump : parmi les grandes priorités fixées par ce document se trouvent le développement d'un secteur spatial commercial et le retour sur la Lune, dans la perspective d'une mission habitée sur Mars. L'Administration Biden n'a pas encore publié de mise à jour complète, mais a repris les mêmes priorités dans le US Space Priorities Framework133(*) présenté le 1er décembre 2021.
Cette politique est élaborée et suivie par le National Space Council (NSpC), devenu un véritable « ministère de l'Espace » depuis sa relance par Donald Trump en 2017. Placé sous l'autorité directe du Vice-Président des États-Unis (Mike Pence, puis Kamala Harris), le NSpC assure, par son rôle de coordination des différents acteurs - la NASA, mais aussi les autres agences et les Départements de la Défense, du Renseignement, du Commerce, de l'Énergie et des Transports -, la mise en oeuvre cohérente des orientations définies au niveau politique.
Les travaux du NSpC ont débouché sur l'adoption d'une série de Space Policy Directives (SPD) : en engageant la puissance publique dans la durée sur certaines priorités, ces décrets présidentiels permettent aux acteurs privés de se positionner, aux investisseurs de se mobiliser et à la filière de se structurer.
|
Les Space Policy Directives · SPD-1 (2017) : lancement du programme Artemis ; · SPD-2 (2018) : simplification de la réglementation relative aux activités spatiales commerciales (dans la continuité du SPACE Act) ; · SPD-3 (2018) : surveillance et gestion du trafic spatial civil et commercial ; · SPD-4 (2019) : création de l'US Space Force (USSF) ; · SPD-5 (2020) : cybersécurité des systèmes spatiaux ; · SPD-6 (2020) : utilisation de l'énergie nucléaire dans l'espace ; · SPD-7 (2021) : systèmes de positionnement et de navigation. |
b) Une commande publique fiable et ouverte au risque
Le budget spatial américain s'élève à 62 milliards de dollars en 2022 - soit près de 60 % du total mondial et dix fois plus que celui de l'ESA134(*) -, et 80 % du budget de la NASA revient directement à l'industrie américaine135(*) : la première vertu de la commande publique américaine est d'être massive.
Pourtant, les crédits consacrés à la politique spatiale ne représentent qu'une faible part du budget fédéral américain, soit environ 0,5 %, un montant relativement stable depuis 2011 (date de la fin du programme de la navette spatiale), contre plus de 4 % à la fin du programme Apollo en 1972.
En d'autres termes, la commande publique américaine n'est pas seulement massive, elle est aussi intelligente, avec des objectifs clairs et des outils adaptés.
Dans la période récente, l'élément le plus déterminant est sans doute le recours accru aux contrats de services, qui tendent à se substituer aux traditionnels « contrats d'infrastructure » : au lieu d'acheter un produit ou un équipement dont elle conserve la propriété (un lanceur, un satellite, etc.), l'administration achète une prestation (un lancement, un service de transport de fret ou d'équipage, etc.). L'achat se fait à l'unité, de façon flexible, dans les conditions prévues par un contrat-cadre.
Il s'agit d'un modèle gagnant-gagnant.
Pour l'administration, l'achat de services permet de réduire les coûts et les risques en adaptant les commandes à l'évolution de ses moyens, en s'épargnant les coûts liés à la possession de ses propres infrastructures et en faisant jouer la concurrence dans la durée, ce qui stimule l'innovation et l'emploi sur le territoire américain et lui permet de disposer de solutions alternatives (par exemple, le choix entre le Starship HLS et le Blue Moon pour l'alunisseur du programme Artemis).
Pour les entreprises, les contrats de services sont d'abord un gage de stabilité et de visibilité, la puissance publique, sans capacités propres, leur assurant une activité à long terme - à condition qu'elles fassent leurs preuves. Cette garantie leur permet de lever des fonds pour financer leur développement initial ou leurs projets suivants. Ces contrats sont d'ailleurs très adaptés à la construction d'une offre commerciale complète, puisque les services peuvent la plupart du temps être également proposés à d'autres acheteurs publics (agences spatiales) comme privés.
La NASA a commencé à recourir de façon importante aux contrats de services à partir de 2006 pour transporter du fret et des astronautes à bord de l'ISS, avec le programme Commercial Orbital Transportation Services (COTS), qui sera suivi des programmes Commercial Resupply Services (CRS) et Commercial Crew Program (CCP). Ce sont ces contrats qui ont permis à SpaceX d'émerger. Constatant l'efficacité du système et son intérêt budgétaire, la NASA a choisi de l'utiliser encore davantage pour le programme Artemis (cf. Partie I) : lanceurs (Space Launch System - SLS), alunisseurs (Human Landing System - HLS), combinaisons spatiales, etc.
En ce qui concerne les ressources spatiales, c'est le programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS) qui est le plus important.
On notera toutefois que celui-ci ne porte pas stricto sensu sur l'ISRU, mais sur la livraison de charges utiles à la surface de la Lune, dont la plupart sont effectivement liées à la prospection et à la validation des technologies. Il est possible qu'à l'avenir, un programme spécifiquement dédié à l'ISRU apparaisse - ouvrant de nouvelles opportunités aux acteurs européens.
De même, la NASA vient d'ouvrir un programme spécifiquement dédié aux nouveaux services commerciaux en orbite basse136(*), le programme Commercial Low Earth Orbit Destinations (CLD). Si celui-ci concerne avant tout les services liés aux futures stations privées (Axiom Space, etc.) et autres activités en orbite (fabrication, tourisme, recherche privée, etc.), on peut imaginer qu'à terme, les services de refueling et de dépôt de carburant en orbite, plus directement liés au sujet des ressources spatiales, fassent l'objet d'un programme dédié.
|
Le programme CLPS Lancé en 2018, le programme CLPS (Commercial Lunar Payload Services), littéralement « Services en matière de charges utiles lunaires », permet à la NASA d'optimiser ses coûts en sous-traitant à des opérateurs privés l'ensemble des opérations permettant de livrer des charges utiles sur la surface de la Lune, notamment dans le cadre des missions robotiques destinées à préparer les missions habitées du programme Artemis. L'objectif principal des missions du programme CLPS est donc la prospection des ressources - en particulier celles du pôle Sud - et le test de différentes technologies d'ISRU. Les contrats portent sur des prestations « tout compris » : la conception des alunisseurs et des rovers, les services de transport et de livraison à proprement parler, mais aussi tous les services d'intégration de la charge utile, de lancement et de déploiement à la surface et de retour sur Terre, ainsi que tous les systèmes permettant d'opérer la charge utile (confiée par la NASA ou d'autres prestataires). Les contrats-cadre CLPS sont des instruments flexibles : ni le nombre de prestations ni leur prix unitaire ne sont fixés à l'avance ; seule l'enveloppe globale allouée au programme par la NASA est limitée, à 2,6 milliards de dollars sur dix ans - un montant déjà important, qu'il sera toujours possible de revoir à la hausse si nécessaire. En 2019, trois premières sociétés ont été sélectionnées pour de premières missions : Astrobotic (et son atterrisseur Peregrine, pour un montant de 80 millions de dollars), Intuitive Machines (atterrisseur Nova-C, 77 millions de dollars) et OrbitBeyond (atterrisseur Z-01, 97 millions de dollars137(*)). Ces entreprises ont depuis été rejointes par d'autres138(*) : Blue Origin, Ceres Robotics, Deep Space Systems, Draper, Firefly Aerospace, Lockheed Martin Space, Masten Space Systems, Moon Express, Sierra Nevada Corporation, SpaceX et Tyvak Nano. Onze missions sont programmées à ce jour, dont la moitié au pôle Sud. Les premiers lancements devraient avoir lieu dès 2024, et s'intensifier par la suite. |
Les missions du programmes CLPS
Source : NASA - https://www.nasa.gov/commercial-lunar-payload-services
La première mission prévue dans le cadre du programme CLPS est Peregrine Mission One. Son lancement, initialement prévu en mai 2023, a été repoussé mais devrait avoir lieu prochainement. Le contrat a été accordé à la société américaine Astrobotic Technology, une autre finaliste du Google Lunar X Prize, pour un montant de 80 millions de dollars. Lancé par une fusée Vulcan, l'atterrisseur Peregrine devra déposer à la surface du Mons Gruithuisen Gamma, une montagne de 20 km de diamètre, quelque 28 charges utiles, dont 14 confiées par la NASA.
|
L'atterrisseur Peregrine |
Le rover VIPER de la NASA |
Prévue pour 2024 et également confiée à Astrobotic, mais cette fois-ci avec son atterrisseur Griffin lancé par un Falcon Heavy, la mission VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) est la plus complexe et la plus importante du programme CLPS à ce jour. À l'instar des prochaines missions chinoises, elle a pour objectif de cartographier précisément les ressources en eau du cratère Nobile, au pôle Sud de la Lune ; les données collectées seront indispensables au développement des futures technologies d'ISRU.
Pendant 100 jours, le rover VIPER, développé par la NASA, équipé de trois spectromètres et capable de forer jusqu'à un mètre de profondeur, parcourra ainsi près de 20 km dans un environnement très difficile (terrain accidenté, obscurité permanente et températures extrêmement basses). La mission VIPER, facturée 68 millions de dollars, porte le montant total du contrat CLPS d'Astrobotic à plus de 320 millions de dollars.
c) Une préférence nationale assumée
Le dernier pilier de la politique spatiale - voire de toute la politique industrielle - des États-Unis, est une préférence nationale assumée dans la commande publique. Celle-ci permet de faire émerger non seulement des « champions » industriels, mais aussi tout un écosystème bénéficiant d'une commande publique importante et diversifiée - et, bien sûr, d'attirer sur le territoire américain les entreprises, les technologies et les emplois des pays qui, eux, ne veulent surtout pas entendre parler de protectionnisme.
Sans entrer ici dans le détail, on rappellera que cette politique de préférence nationale repose sur un arsenal complet de mesures tarifaires et réglementaires, à la fois de portée générale et spécifiques au secteur spatial. Ces mesures font l'objet d'un consensus national et bénéficient d'un soutien bipartisan.
III. LES RESSOURCES SPATIALES, UNE CARTE À JOUER POUR LA FRANCE ET POUR L'EUROPE ?
Dans cette nouvelle course à l'espace dominée par la rivalité entre la Chine et les États-Unis, comme ailleurs sur la scène internationale, l'Europe peine à trouver sa place. Avec les ressources spatiales, elle pourrait bien avoir une carte à jouer, un atout qu'il serait irresponsable de ne pas utiliser.
Pourquoi ? Parce que les pays européens disposent dans ce domaine de réels avantages technologiques et industriels, qui peuvent se convertir en poids politique, en dynamisme économique et en influence juridique (III-A).
Comment ? En faisant de l'exploitation des ressources spatiales une priorité stratégique, à la fois portée au niveau politique et sécurisée sur le plan juridique (III-B).
Le sujet met cependant les Européens face à leurs contradictions politiques habituelles, et bouscule leurs conceptions morales - autant de tabous qu'il faudra, au préalable, avoir affrontés (III-C).
A. UN LEVIER AU SERVICE DE NOTRE AUTONOMIE STRATÉGIQUE ET DE NOTRE SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE
1. Une Europe spatiale en voie de marginalisation
a) De grandes ambitions
En matière spatiale, l'Europe ne manque pas d'ambitions.
Lors du Conseil ministériel de l'Agence spatiale européenne (ESA) qui s'est tenu à Paris les 22 et 23 novembre 2022, les représentants des États membres139(*) ont décidé d'augmenter de 17 % son budget, portant celui-ci à un niveau record de 16,9 milliards d'euros sur cinq ans, contre 14,5 milliards d'euros pour le budget adopté en 2019140(*).
|
Le budget de l'ESA (par programme) Le Conseil ministériel (CM) décide, tous les trois ans, du budget de l'ESA pour une période de cinq ans : 2020-2024 pour le CM 2019 et 2023-2027 pour le CM 2022. La trajectoire des deux dernières années étant indicative, le « vrai » budget de l'ESA est un budget triennal. - Le « Programme scientifique » (3,2 milliards d'euros) reste le premier poste budgétaire, avec notamment les deux ambitieuses missions que sont JUICE (sonde - lunes glacées de Jupiter) et Euclid (télescope orbital - étude de la matière noire et de l'énergie noire). - Le programme « Transport spatial » (2,8 milliards d'euros) correspond pour l'essentiel au financement des lanceurs Ariane 6 (moyen) et Vega C (léger), afin de garantir à l'Europe un accès autonome à l'espace. - Le programme « Exploration humaine et robotique » (2,7 milliards d'euros) voit ses les moyens augmenter, en ligne avec la stratégie Terrae Novae 2030+. Il porte notamment les crédits liés à la prolongation de l'ISS jusqu'en 2030 et à la participation aux programmes de la NASA. - Le programme « Observation de la Terre » (2,7 milliards d'euros), point fort historique de l'Europe spatiale, joue un rôle majeur en matière de suivi du changement climatique et comprend notamment la contribution de l'ESA au programme Copernicus, ainsi que le financement de deux nouvelles missions liées aux océans, Harmony et Magic. - Le programme « Télécommunications » (1,9 milliard d'euros) comprend notamment la contribution de l'ESA à la première phase de développement de la constellation Iris² de l'UE, ainsi que le programme Moonlight (cf. infra). - Le programme « Technologie » (542 millions d'euros) vise à promouvoir le développement de nouvelles activités spatiales commerciales, notamment via le programme ScaleUp. |
Au-delà de l'effort financier, ces dernières années ont été marquées par un renouveau des ambitions de l'Europe spatiale, et par une évolution notable de sa vision.
D'une part, dans un contexte de relance de la course à l'espace au niveau mondial, l'ESA s'est dotée, avec sa stratégie Terrae Novae 2030+, d'une ambitieuse feuille de route en matière d'exploration spatiale, à la fois humaine et robotique. Ce document présenté en juin 2022, se projette sur trois destinations : l'orbite terrestre basse (LEO), la Lune, et Mars.
En ce qui concerne la Lune, les pays européens sont pour l'essentiel engagés comme partenaires des États-Unis dans le programme Artemis, via la fourniture du module de service (ESM) de la capsule Orion, les éléments i-Hab et ESPRIT du Gateway, et le satellite Lunar Pathfinder qui servira de relais entre la Terre et la surface lunaire.
Vue d'artiste de l'Argonaute. Source : ESA.
Le Conseil ministériel a également décidé de financer les premières études en vue de développer un alunisseur européen à grande capacité logistique (E3L), l'Argonaute, conçu pour déposer 1,5 tonne de fret à la surface de la Lune dans le cadre du programme Artemis. Le premier lancement est prévu d'ici la fin des années 2020, par la fusée Ariane 6.
Pour l'exploration de Mars, l'ESA fournira l'atterrisseur du rover américain Rosalind Franklin, et coopère avec la NASA pour préparer le retour des échantillons prélevés en 2022 par le rover Perseverance.
D'autre part, les pays européens semblent désormais convaincus des vertus du New Space et de la « commercialisation » de l'espace, et résolus à soutenir l'émergence de nouveaux services et de nouveaux acteurs. Cette orientation, déjà sensible dans l'Agenda 2025 de l'ESA présenté en 2021141(*), a trouvé une première traduction lors du Conseil ministériel avec le lancement du programme ScaleUp. Celui-ci comprend deux programmes d'accompagnement qui complètent, en amont et en aval, les dispositifs traditionnels de l'ESA en matière de soutien à la R&D :
- ScaleUp INNOVATE : incubation, accélération, transferts de technologies et de propriété intellectuelle, etc. ;
- ScaleUp INVEST : aide à la recherche de débouchés commerciaux et d'investisseurs publics et privés.
|
« Nous construisons une Europe dont l'agenda spatial reflète la force politique actuelle et la vitalité économique future. Nous donnons une nouvelle impulsion au spatial européen, en ouvrant une ère caractérisée par l'ambition, la détermination, la force et la fierté. Les enjeux climatiques et le développement durable resteront la première priorité de l'ESA ; nos activités scientifiques et d'exploration seront source d'inspiration pour les générations à venir et nous allons construire un cadre dans lequel les entrepreneurs européens du secteur spatial pourront prospérer. » Josef Aschbacher, directeur général de l'ESA (Conseil ministériel de 2022). |
L'Union européenne (UE) dispose aussi d'un programme spatial, doté de 13,2 milliards d'euros pour la période 2021-2027, soit un peu moins de 2 milliards d'euros par an142(*). Les programmes phares de l'UE sont le système d'observation de la Terre Copernicus et le système de navigation Galileo, auxquels s'ajoute désormais le projet de constellation Iris2, lancé en 2023 par la Commission européenne, à l'initiative de son commissaire au marché intérieur Thierry Breton. Cette constellation est destinée à fournir, d'ici 2027, des services de télécommunication rapides et sécurisés à toute l'Europe, afin de renforcer sa résilience et sa souveraineté, mais aussi à d'autres zones privées d'Internet haut débit dans le monde, et notamment à toute l'Afrique. Son coût est évalué à 6 milliards d'euros143(*).
L'UE joue également un rôle majeur dans l'élaboration de normes en matière de gestion du trafic spatial et de lutte contre l'encombrement des orbites (cf. infra). Elle a aussi fait du soutien au New Space européen l'une de ses priorités, l'émergence de nouveaux services commerciaux et de nouveaux acteurs (spatiaux et non-spatiaux) étant considérée comme un atout pour la compétitivité économique et dans la lutte contre le changement climatique144(*). À cet effet, la Commission européenne a mis en place le fonds CASSINI, un incubateur et accélérateur doté d'un milliard d'euros (sur la période 2021-2027) pour soutenir les start-up et PME du New Space.
b) De petits moyens
Pourtant, au-delà des intentions et des discours, auxquels on ne peut que souscrire, force est de constater que l'Europe n'a tout simplement pas les moyens de ses ambitions en matière spatiale - elle est même, à vrai dire, très loin du compte.
Le budget de l'ESA, en y incluant la contribution du budget de l'UE, s'élève à 6,5 milliards de dollars en 2022 : c'est à peu près dix fois moins que le budget spatial américain (62 milliards de dollars), qui représente à lui seul près de 60 % du total mondial (103 milliards de dollars). C'est aussi presque deux fois moins que celui de la Chine (12 milliards de dollars), qui a été multiplié par dix en dix ans. Même en combinant l'ensemble des budgets publics européens, on n'arrive guère au-delà de 9 milliards d'euros par an145(*), soit toujours sept fois moins que les États-Unis.
Les programmes spatiaux publics dans monde en 2022
Dépenses civiles et militaires. Le budget de
l'ESA inclut les contributions des pays membres et de l'UE.
Source :
Euroconsult, « Government Space Programs »,
édition 2022146(*)
Ce n'est pas qu'un problème de montant total - après tout, la Chine, rival crédible des États-Unis à bien des égards, dispose d'un budget cinq fois moindre -, mais aussi un problème de priorités. En effet, les dépenses spatiales mondiales ont atteint un record historique en 2022 (+ 9% en un an), et cette tendance, qui se poursuit, s'explique avant tout par la hausse des dépenses militaires147(*) et, en ce qui concerne le volet civil, par un effort inédit sur les programmes de vol habité, d'exploration et de soutien au nouveau secteur spatial « commercial ».
Or en Europe, on ne constate rien de tel. Bien au contraire, l'examen détaillé du budget adopté par l'ESA en 2022 tendrait plutôt à démentir les grands discours sur le renouveau des ambitions européennes.
Ainsi, le budget consacré au développement du New Space européen et aux nouvelles activités commerciales, déjà modeste (542 millions d'euros), est le seul à afficher une baisse par rapport à 2019 (-7,2 %). Un comble pour un budget qui porte notamment le programme ScaleUp - qui lui-même n'est doté que de 120 millions d'euros sur cinq ans à l'échelle européenne, un montant à comparer avec celui du fonds CASSINI (un milliard d'euros) ou de France 2030 (1,5 milliard d'euros), sans même parler des moyens sans commune mesure que mobilise la NASA.
Quant au budget consacré à l'exploration spatiale, la forte hausse affichée (+37 %), censée traduire les grandes ambitions de la stratégie Terrae Novae, s'explique en fait largement par le sauvetage coûteux de la mission ExoMars ainsi que par l'inclusion très discutable des programmes en orbite basse dans le champ de « l'exploration spatiale » - ce qui permet d'y compter les dépenses liées à la prolongation de l'ISS jusqu'en 2030, aux enjeux stratégiques désormais réduits, et laisse finalement peu de place aux deux autres « destinations » de Terrae Novae, c'est-à-dire la Lune et Mars.
En réalité, la hausse de 17 % du budget de l'ESA décidée en 2022 est très largement absorbée par ses priorités traditionnelles et par les efforts consentis pour mener le développement d'Ariane 6 à son terme.
S'il est un domaine où l'Europe affiche de grandes réussites, c'est la recherche scientifique : après les succès de Rosetta et Philae en 2014, c'est au tour de la sonde JUICE, lancée cette année, de porter l'ambition européenne. Mais les programmes scientifiques se traduisent plus difficilement que les autres en influence géopolitique et stratégique, d'autant que les plus ambitieux d'entre eux, comme le Télescope spatial James Webb (JWST), sont conduits sous leadership américain, avec l'ESA comme partenaire secondaire.
Quant aux programmes Copernicus et Galileo portés par l'UE, les précieux services qu'ils rendent ne se sont pas traduits à ce jour en influence politique, et ils peinent en outre à trouver leur positionnement commercial. La constellation Iris², pour sa part, poursuit plus explicitement un objectif d'autonomie stratégique, mais son développement a à peine débuté et elle est déjà concurrencée par Starlink et OneWeb.
Mais il y a bien plus inquiétant que tout cela : en effet, l'Europe est aujourd'hui menacée jusque dans son accès autonome à l'espace, pourtant considéré comme une « nécessité absolue » au niveau européen comme au niveau national, en raison des difficultés du lanceur Ariane 6, qui accumule surcoûts et retards, et par l'échec récent du premier lancement de Vega-C, alors qu'Ariane 5 effectuera son dernier lancement en juin 2023 et que la dépendance au lanceur russe Soyouz n'est plus une option acceptable.
Plus fondamentalement, la révolution technologique introduite par SpaceX appelle un sursaut technologique et industriel qui, pour l'instant, tarde à se concrétiser.
Si la France, l'Allemagne et l'Italie se sont finalement accordées en novembre 2022 sur une aide supplémentaire de 1,1 milliard d'euros pour assurer la transition entre Ariane 5 et Ariane 6 et achever le développement de Vega C, il est peu probable que ce compromis, obtenu dans la douleur, suffise à assurer la viabilité commerciale à long terme de ces nouveaux lanceurs, dont plus personne n'espère qu'ils puissent un jour rivaliser avec ceux de SpaceX, bien plus compétitifs. Officiellement, le vol inaugural d'Ariane 6, initialement prévu en 2020, est toujours prévu pour fin 2023.
c) L'exploration par procuration
Dans ces conditions, faut-il s'étonner que l'Europe soit incapable de relever le défi de l'exploration spatiale ?
Privée de lanceur à court terme et menacée dans son accès souverain à l'espace à moyen terme, affichant de grandes ambitions mais n'accordant que peu de moyens réels, l'Europe est, en matière d'exploration humaine et robotique, entièrement dépendante des États-Unis.
Elle ne dispose d'une capacité autonome pour aucun des éléments-clés d'un programme comme Artemis, et même en 2030, au moment où Américains et Chinois devraient s'être posés sur la Lune, il est douteux que son alunisseur « souverain », l'Argonaute, soit achevé et opérationnel.
Comparaison des capacités
américaines, chinoises et européennes
en matière
d'exploration spatiale à horizon 2030
Source : ESA/HLAG 2023
|
Contribution de l'ESA aux missions
d'exploration Comparaison des capacités attendues Source : ESA, Stratégie Terrae Novae 2030+ |
La contribution européenne aux programmes menés par la NASA, pour importante qu'elle soit, n'est pas synonyme d'autonomie et ne lui donne pas véritablement voix au chapitre. Cette contribution est d'ailleurs exclusivement robotique, la partie « humaine » mise en avant dans la communication de l'ESA correspondant non pas à ce qu'elle apporte, mais à ce qu'elle obtient, c'est-à-dire trois places pour ses astronautes à bord des prochaines missions Artemis, dont une seule place permettant de poser le pied à la surface de la Lune.
La seule mission véritablement dirigée par l'ESA était ExoMars, annulée à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie148(*). Afin de « sauver » l'envoi du rover américain Rosalind Franklin, désormais prévu pour 2028, l'ESA a décidé de financer la construction d'un atterrisseur destiné à remplacer celui de Roscosmos, mais la mission devrait désormais dépendre d'un lanceur américain, et passer de facto sous la direction des États-Unis. Enfin, le partenariat entre l'ESA et la Russie dans le cadre des missions Luna 25 et Luna 27, qui devaient emporter les instruments PROSPECT (cf. supra), est définitivement annulé.
À ce stade, l'Europe semble donc hors-jeu en matière d'exploration spatiale, et donc - pour en revenir au sujet du présent rapport - incapable de saisir l'opportunité stratégique, politique et économique que représente l'exploitation des ressources spatiales.
Plus de cent missions lunaires sont prévues d'ici 2030, à la fois par des agences nationales et des acteurs privés. Sur ces cent missions, l'Europe en mènera deux.
Faut-il s'en étonner ? Le budget annuel consacré par l'Europe à l'exploration spatiale ne dépasse pas un milliard d'euros, pour un budget spatial total de 7 milliards d'euros149(*).
Le budget annuel de la seule NASA, lui, dépasse les 24 milliards de dollars, dont 14 milliards consacrés à l'exploration spatiale - et d'ici 2025, c'est-à-dire dans un an et demi, les États-Unis auront déjà dépensé plus de 100 milliards de dollars dans le seul programme Artemis. Chaque année, celui-ci génère pour l'économie américaine des retombées comprises entre deux et trois fois le montant de l'investissement public initial, et permet la création de près de 93 000 emplois150(*).
Source : ESA/HLAG 2023
Pour l'Europe, la situation est d'autant plus frustrante qu'au regard d'autres secteurs d'activité ou d'autres politiques publiques, les sommes consacrées à l'exploration spatiale apparaissent en fait assez ridicules : dépenser ne serait-ce qu'un milliard d'euros de plus permettrait de doubler le budget européen en matière d'exploration spatiale.
d) Et pourquoi pas les ressources spatiales ?
Peut-être n'a-t-on pas suffisamment pris la mesure de l'enjeu que représente la révolution de l'exploration spatiale.
Le 23 mars 2023, le Groupe d'experts de haut niveau (High-Level Advisory Group - HLAG), mis en place au lendemain du sommet de l'Espace de Toulouse de février 2022, a présenté son rapport, intitulé « Revolution Space: Europe's Mission for Space Exploration151(*) », rédigé par douze personnalités indépendantes dont l'ancien secrétaire général de l'OTAN et ancien Premier ministre danois Anders Fogh Rasmussen, et l'ancien secrétaire d'Etat chargé du numérique en France, Cédric O.
Comparant la révolution spatiale actuelle à la révolution numérique ou à celles du rail et de l'automobile, le rapport appelle l'Europe à ne pas manquer sa chance et à viser l'autonomie en matière d'exploration humaine et robotique - au risque, sinon, d'être définitivement marginalisée dans l'espace comme sur Terre.
|
Le rapport Revolution Space « Le secteur spatial connaît une révolution comparable à celle de l'Internet il y a vingt ans. Comme Internet, la révolution spatiale affectera tous les domaines de notre vie. « Les pays et les régions qui ne s'assureront pas un accès indépendant à l'espace et une utilisation autonome de celui-ci deviendront stratégiquement dépendants et seront économiquement privés d'une partie importante de cette chaîne de valeur. » « La question est simple : l'Europe peut-elle se permettre de passer à côté d'une nouvelle révolution technologique ? La réponse est non. « L'Europe doit concevoir et mettre en oeuvre une Mission spatiale européenne avec pour objectif d'établir une présence indépendante en orbite terrestre, en orbite lunaire, à la surface de la Lune et au-delà dans le Système solaire. Cela passe par une Station commerciale européenne en orbite basse, une capacité autonome en matière de transport de fret et d'équipages, et une présence durable à la surface de la Lune. « Pour cela, il est crucial d'investir massivement et rapidement. (...) Les activités spatiales représentent aujourd'hui entre 350 et 650 milliards d'euros. En 2040, ce sera 1 000 milliards d'euros : l'Europe doit en prendre le tiers ». |
Toutefois, en l'absence d'un sursaut politique sans précédent et d'un effort financier sans commune mesure avec les moyens actuels, ces ambitions risquent de rester lettre morte.
On ne peut pas éluder le problème : si l'enjeu est à ce point vital pour l'avenir de l'Europe, pourquoi le sursaut ne vient-il pas ?
Voici un début de réponse. La priorité absolue, c'est de disposer d'un lanceur, car sans lanceur, il n'y a pas d'accès autonome à l'espace, donc pas d'indépendance stratégique, et pas de souveraineté économique. Mais le lanceur n'est pas seulement le chantier le plus important : c'est aussi, de très loin, le plus difficile à faire avancer, précisément parce que tout est « bloqué » au niveau politique, où la mésentente est notoire entre la France, l'Allemagne et l'Italie, dont les intérêts et les objectifs divergent. Les dirigeants européens ne semblent ni disposés à prendre le risque de déstabiliser encore davantage ArianeGroup et le tissu industriel qui en dépend, ni capables de s'accorder sur la suite d'Ariane 6 ou de s'entendre sur la place à donner à de nouveaux acteurs. Par conséquent, les retards et les surcoûts s'accumulent, et pendant ce temps, le programme Artemis avance et les fusées de SpaceX décollent.
À défaut d'une solution, le présent rapport propose une forme de détour : si l'Europe veut montrer qu'elle est, elle aussi, capable d'innover, de se réinventer, de faire émerger de nouveaux acteurs et de nouveaux services en jouant sur une saine concurrence, peut-être devrions-nous commencer par essayer dans un domaine « vierge », où tout reste à faire, où les enjeux sont moindres pour l'orgueil et le budget des États, et où nous partons avec des avantages. Il n'y a pas grand-chose à perdre, et beaucoup à gagner.
L'exploitation des ressources spatiales pourrait être ce domaine : en se positionnant sur le sujet de l'ISRU et de la logistique lunaire dans le cadre du programme Artemis, l'Europe :
- gagnerait en poids politique ;
- bénéficierait de retombées économiques ;
- et pourrait défendre sa vision juridique.
Elle retrouverait des marges de manoeuvre, sans doute une meilleure entente en son sein, et une plus grande confiance en l'avenir.
2. Une contribution technologique synonyme de poids politique
Le programme Artemis est un programme « total » : il comprend un lanceur (le SLS), un vaisseau spatial (Orion), une station orbitale (le Lunar Gateway), un alunisseur (le HLS), mais aussi des équipements (combinaison, etc.), des systèmes (télécommunications, etc.) et tous les éléments des missions robotiques (lanceurs, alunisseurs, rovers, instruments et autres charges utiles) et à terme de la future base lunaire.
L'Europe contribue à ce programme, notamment via la fourniture des six premiers modules de service de la capsule Orion (fabriqués par Airbus) et des modules i-Hab et ESPRIT du Gateway (fabriqués par Thales Alenia Space), qui lui permettent d'« acheter » trois sièges à bord. Cette contribution est importante, mais elle n'est pas suffisante, notamment parce que ces éléments sont potentiellement redondants et substituables au profit de solutions américaines. Disposer de plusieurs solutions alternatives est d'ailleurs un objectif explicite de la NASA, et celle-ci mène une politique de préférence nationale : il n'est pas difficile de percevoir le risque...
L'ISRU et la logistique lunaire, de ce point de vue, présentent un intérêt notable. En effet, il s'agit d'un ensemble composite de « petites » briques technologiques, variées et modulaires (une unité d'électrolyse, un rover d'impression 3D, un instrument de prospection, un module d'habitat, etc.), ce qui emporte plusieurs avantages.
Premièrement, les choix techniques, politiques et financiers sont beaucoup moins verrouillés : ces « petites briques » ne sont certes pas moins substituables ou potentiellement redondantes que les « gros morceaux » que sont le lanceur ou l'alunisseur, mais les enjeux individuels sont moindres. C'est d'ailleurs précisément pour cela que l'ISRU et la logistique lunaire sont adaptés aux contrats de services : les occasions manquées sont rattrapables, les positions acquises sont contestables, et les nouvelles idées sont valorisables.
Deuxièmement, l'effort budgétaire nécessaire est limité, parce qu'il s'agit de « petites » briques d'une part, et surtout parce que les activités lunaires se prêtent bien à un modèle de services commerciaux, proposés par des acteurs privés, qui s'adressent en même temps au marché privé. Pour simplifier, c'est au démarrage que le soutien public est crucial (incubateurs, accélérateurs, premiers tours de table et premiers contrats), mais ensuite, le New Space européen a vocation à s'autonomiser : si un produit trouve son marché, tant mieux, et sinon, le contribuable n'aura pas perdu grand-chose.
Troisièmement, le blocage politique est improbable. L'ISRU et la logistique lunaire peuvent se résumer ainsi : petits projets, nouveaux acteurs et financeurs privés. Soit tout l'inverse d'un projet comme Ariane 6, où les enjeux budgétaires, les risques industriels, les rigidités administratives et les susceptibilités nationales sont d'une telle ampleur qu'ils aboutissent finalement à un blocage et à une rupture de la confiance.
Surtout, les pays européens partiraient ici avec de réels avantages technologiques et industriels à faire valoir, grâce à des acteurs établis non seulement dans l'industrie spatiale mais aussi dans les autres domaines-clés de l'ISRU, auxquels s'ajoutent de nombreuses start-up innovantes et dynamiques : c'est l'objet de la partie suivante, consacrée aux avantages économiques.
Toutefois, pour transformer des opportunités économiques (pour les entreprises) en influence politique (pour les États), il faudra disposer d'une stratégie cohérente.
Dans les faits, l'ISRU et les domaines associés font déjà partie de la contribution européenne au programme Artemis : les instruments ProSEED et ProSPA du programme PROSPECT, par exemple, seront envoyés dans le cadre des prochaines missions robotiques de la NASA pour extraire et analyser in situ des échantillons de glace du pôle Sud (cf. supra). Avec son programme Moonlight, l'ESA développe une « constellation lunaire » similaire au projet LunaNet de la NASA : ces solutions sont concurrentes, mais elles pourraient également s'avérer complémentaires.
Pour autant, il n'y a pas encore de stratégie d'ensemble - d'ailleurs, les instruments PROSPECT devaient initialement faire partie des missions russes Luna 25 et Luna 27. La suite du programme CLPS, et surtout la phase II du programme Artemis, qui vise à installer une base permanente à la surface de la Lune, devraient être pour l'Europe l'occasion de formuler une « offre de services » cohérente et structurée en matière d'ISRU et de logistique lunaire. Celle-ci constituerait, au même titre que le module de service d'Orion ou les éléments du Gateway, un levier de négociation au niveau politique - ce qui bien sûr n'interdirait nullement aux entreprises de proposer un service commercial et de s'adresser au marché privé.
L'exploitation des ressources spatiales présente un autre intérêt dans le cadre d'une stratégie politique. Historiquement, les Européens ont fait le choix de privilégier les programmes scientifiques et d'observation de la Terre, au détriment du vol habité notamment. Or ce qui constituait un handicap évident dans le cadre de l'exploration spatiale « traditionnelle » se transforme ici en avantage, puisque les technologies développées dans ce cadre sont d'un intérêt majeur pour la prospection des ressources.
Quelques projets européens en matière d'ISRU et de logistique lunaire. Source : ESA/Spartan Space.
3. Les avantages comparatifs des entreprises européennes
a) Des acteurs établis dans les domaines-clés de l'ISRU
On l'a vu, l'ISRU et plus largement l'économie lunaire et cislunaire constituent, au regard du secteur spatial traditionnel, un domaine à part, notamment du fait de l'implication conjointe d'acteurs « spatiaux » et d'acteurs « terrestres », ceux-ci apportant par exemple un savoir-faire lié à l'extraction, à la transformation et à l'utilisation des ressources. Or il se trouve que l'Europe, et la France en particulier, disposent à la fois d'acteurs « spatiaux » et d'acteurs « terrestres » de premier plan dans les domaines-clés de l'ISRU et de la logistique lunaire.
Parmi les acteurs spatiaux, on trouve Airbus Defence & Space. L'entreprise est bien sûr impliquée via sa division Space Systems au titre de son activité traditionnelle en matière de satellites (pour les communications Terre-Lune, la cartographie des ressources, etc.), mais aussi très directement dans les technologies d'ISRU, via son prototype ROXY qui permet de fabriquer de l'oxygène et des métaux à partir du régolithe (cf. supra).
L'entreprise est aussi avancée dans le domaine de la fabrication dans l'espace (in-space manufacturing). En 2022, Airbus a présenté Metal3D, le premier dispositif de métallurgie par impression 3D en microgravité152(*) : chauffé à 1200 °C, le métal peut être utilisé pour imprimer directement des outils, pièces de rechange et autres boucliers thermiques. Développé pour l'ESA, Metals3D sera testé dès cette année à bord de l'ISS, et pourrait servir à la construction d'habitats ou d'équipements sur la Lune ou sur Mars - le cas échéant en utilisant directement le métal extrait par ROXY, ou en recyclant sur place des composants usagés. Airbus développe aussi une technologie d'assemblage de satellites en orbite (in-space assembly).
La société Air Liquide, leader mondial des gaz industriels et de la cryogénie, est aussi un partenaire traditionnel du secteur spatial, notamment via sa division Air Liquide Advanced Technologies qui fournit des équipements cryogéniques aux pas de tir, aux lanceurs, aux satellites, à l'ISS, etc. Depuis plusieurs années, elle développe aussi des produits spécifiquement destinées à l'ISRU et à l'économie cislunaire : le module d'électrolyse lunaire RFCS (Regenerative Fuel Cell System), un système de purification d'eau et d'oxygène in situ, des solutions de stockage et de refueling, etc.
Des organismes publics sont également impliqués de longue date dans plusieurs projets, à l'instar du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).
Au-delà du secteur spatial, l'Europe et la France disposent de « champions » dans d'autres domaines-clés de l'ISRU : la prospection minière et pétrolière, l'industrie chimique et pharmaceutique, le recyclage et la valorisation des déchets, la construction, l'intelligence artificielle, etc. En matière de mobilité, plusieurs industriels européens travaillent à des rovers lunaires ou martiens, et Michelin développe des pneus adaptés au régolithe. En matière de production d'énergie, les projets sont également nombreux, qu'il s'agisse de panneaux solaires légers (Thales), de piles à combustible (Airbus, Air Liquide) ou d'autres technologies liées à l'hydrogène. D'ailleurs, la filière de l'hydrogène vert, dans laquelle la France comme l'Europe investissent massivement, présente d'évidentes synergies entre applications terrestres et lunaires.
Plusieurs industriels du spatial et du non-spatial ont déjà saisi l'importance du sujet, et la filière commence à se structurer. En France, le groupe « Objectif Lune » de l'Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) joue un rôle majeur à cet égard.
|
Le groupe « Objectif Lune » de l'ANRT Créé en 2019, le groupe « Objectif Lune » de l'ANRT « réunit les acteurs du spatial et du non spatial pour conjuguer vision, innovation et communication sur le projet d'une base vie en expansion durable sur la Lune. La transformation de l'industrie spatiale servie par les nouvelles technologies ouvre de nouveaux possibles et redonne du sens à l'exploration habitée de la Lune ». Parmi les contributeurs à ses travaux figurent des représentants de grandes entreprises du spatial et du non-spatial (Air Liquide, Airbus, Michelin, ArianeGroup, etc.), de start-up du New Space (Exotrail, etc.), d'organismes de recherche publics (INRAE, CEA), ainsi que des juristes et des chercheurs. En 2021, le groupe « Objectif Lune » a publié un livre blanc, L'Ambition lunaire, défi stratégique du XXIe siècle, fruit du travail collectif mené dans le cadre de six groupes de travail : - Gouvernance - Stratégie industrielle et économique - Ethique et société - Habitat et support de vie - Exploitation des ressources - Défense et sécurité Parmi ses autres publications153(*), on peut citer une note sur le programme Moonlight de l'ESA (2022) et une note sur la fertilisation croisée entre spatial et non-spatial (2023). Le groupe « Objectif Lune » est présidé par Claudie Haigneré, astronaute et ancienne ministre, et soutenu par le Moonshot Institute du CNES. Il est coordonné par Alban Guyomarc'h, sous la direction de Clarisse Angelier, déléguée générale de l'ANRT. Le groupe « Objectif Lune » était représenté à la table ronde du 3 novembre 2022 sur l'exploitation des ressources de la Lune, organisée par la délégation à la prospective du Sénat dans le cadre du présent rapport. |
Ailleurs en Europe, parmi de nombreux exemples, on peut encore citer le motoriste britannique Rolls Royce, qui développe un mini-réacteur nucléaire pour alimenter les missions longues, sur le même principe que le Kilopower de la NASA (cf. supra).
Le projet est soutenu par l'ESA (via le programme Moonlight) et par l'agence spatiale britannique, qui voit dans les nouveaux marchés liés à l'économie lunaire une opportunité à saisir pour la space tech du pays154(*).
b) Le New Space des ressources spatiales
Outre les acteurs établis issus de différents domaines industriels, de nombreuses start-up européennes développent des produits et services liés à l'IRSU et à la logistique lunaire, dont elles ont saisi le potentiel disruptif. Un véritable « New Space des ressources spatiales » émerge en Europe, avec l'ancien bassin minier luxembourgeois pour Silicon Valley. Il aura besoin de soutien pour se développer, et de contrats pour prospérer.
De nombreux exemples ayant déjà été cités, on se limitera ici à trois exemples français.
Fondée en 2021 et installée à Marseille, Spartan Space développe un module d'habitat lunaire gonflable, EUROHAB, qui pourrait servir d'habitat secondaire ou de refuge aux astronautes dans le cadre des futures missions habitées. Déposé par un alunisseur dans le cadre d'une mission robotique en amont de l'arrivée de l'équipage, le module pourra se gonfler automatiquement. Il est déplaçable et réutilisable. Ses piles à combustible sont alimentées par des panneaux solaires souples, et il est équipé d'un système de purification d'air. Certaines pièces de rechange pourraient être fabriquées sur place par impression 3D à base de régolithe, et l'oxygène produit par électrolyse de l'eau lunaire. Un équipage de deux à quatre personnes peut y séjourner deux semaines.
EUROHAB est développé avec le soutien du CNES, en partenariat avec l'université de Strasbourg, le CEA et Air Liquide. Si son premier « marché » est évidemment celui des missions Artemis, il pourrait être facilement loué à d'autres acteurs publics ou privés de l'écosystème lunaire - Peter Weiss, le PDG de Spartan, le qualifie d'ailleurs volontiers d'« Airbnb sur la Lune ».
EUROHAB s'adresse aussi au marché terrestre, par exemple pour des interventions en milieu hostile (climat extrême) ou en cas de catastrophe naturelle. Il a d'ailleurs été testé dans le désert d'Abou Dhabi - et exposé dans le décor lunaire du Space Resources Challenge de l'ESRIC.
Vue d'artiste de l'habitat EUROHAB de Spartan Space sur la Lune.
Fondée en 2021 et installée à Munich et Mérignac, The Exploration Company (TEC) développe une capsule modulaire et réutilisable, destinée à assurer des trajets réguliers entre l'orbite terrestre et la Lune. Le Nyx pourra être ravitaillé en orbite avec des ergols produits in situ.
Le Nyx
Le « petit » modèle devrait effectuer son premier vol en 2024. Le « grand » modèle, qui pourra emporter quatre tonnes de charge utile, est prévu pour 2026.
Comme SpaceX avec son Dragon, The Exploration Company, s'adresse au marché commercial de la logistique cislunaire. La start-up, cofondée par Hélène Huby, ancienne responsable du programme Orion chez Airbus, a levé 40 millions d'euros en 2023.
Enfin, la start-up Space Cargo Unlimited (SCU), cofondée en 2014 par Nicolas Gaume, entrepreneur venu de l'industrie du jeu vidéo, s'adresse au marché de la fabrication en microgravité (in-space manufacturing). Les applications potentielles sont nombreuses. En l'absence de gravité, il est en effet possible de fabriquer des alliages métalliques très homogènes, alors que sur Terre le métal le plus lourd a tendance à aller vers le bas, et le plus léger vers le haut. Il en va de même pour la fibre optique en verre fluoré (ZBLAN), qui offre un débit cent fois supérieur à la fibre optique classique : découverte accidentellement en France en 1974, elle est presque impossible à fabriquer sur Terre, mais la NASA en produit à bord de l'ISS. D'autres applications existent en matière de développement accéléré de cellules souches, d'agriculture, d'impression 3D médicale, de synthèse de molécules pour l'industrie chimique, pharmaceutique ou cosmétique, etc.
Space Cargo Unlimited louera son REV1, une « usine spatiale » entièrement automatisée aménagée dans une capsule conçue par Thales Alenia Space, aux entreprises souhaitant fabriquer leurs produits en microgravité. Le premier vol est prévu pour 2025. Pour tester son concept, mais aussi pour lui donner de la visibilité, SCU a choisi la viticulture spatiale : douze bouteilles de Petrus et 300 pieds de vigne ont ainsi été envoyés pendant 14 mois à bord de l'ISS, en partenariat avec l'Institut des sciences de la vigne et du vin (ISVV), afin de déterminer si le stress du milieu spatial avait modifié les caractéristiques du vin, et surtout si l'apesanteur avait rendu les plans de vigne plus résistants. Il semble que oui - les bouteilles ont en tout cas été vendues, et les vignes plantées et cultivées avec succès.
Un Château Petrus de l'espace,
millésime 2000 : 5 000 euros la bouteille au
décollage,
un million d'euros à l'atterrissage.
c) Le rôle du soutien public et des investisseurs privés
Pour émerger, le New Space européen a besoin du soutien public. Des incubateurs, accélérateurs et autres programmes d'accompagnement, comme l'ESRIC au Luxembourg ou TechTheMoon en France, jouent ici un rôle important avec des moyens pourtant très modestes.
|
L'incubateur TechTheMoon Créé en 2021 par le CNES et l'incubateur Nubbo de la région Occitanie, TechTheMoon se présente comme « le premier incubateur exclusivement dédié à l'économie lunaire » en Europe. Les start-up candidates peuvent proposer un projet dans trois domaines de l'économie lunaire - « infrastructures », « ressources » et « support vie » - qui répondraient en même temps à un marché terrestre avec un business model viable. Le programme d'incubation dure 12 mois. La première sélection était composée de : - Spartan Space : habitat lunaire gonflable et mobile - The Exploration Company : véhicule orbital lunaire réutilisable - Anyfields : mesure de la performance des antennes radio (rovers, drones, satellites, machines autonomes, etc.) - Lumetis : solution d'imagerie in situ (et non en laboratoire) pour l'analyse de composants ou d'équipements - Orius Technologies : production végétale en environnement contrôlé. Les applications concernent l'agriculture en milieu spatial, la sélection variétale accélérée, la production de composés pour l'industrie pharmaceutique ou cosmétique, etc. |
Si les incubateurs offrent aux start-up la possibilité de valider leur technologie et leur modèle économique, ils ne sauraient toutefois suffire. D'autres dispositif, publics comme privés, peuvent prendre le relais.
Le fonds CASSINI de l'UE ou le programme ScaleUp de l'ESA sont deux instruments adaptés, mais ils restent peu dotés à l'échelle européenne.
Lancé en novembre 2021, le volet spatial du plan France 2030 pourrait jouer un rôle important : doté de 1,5 milliard d'euros, dont deux tiers réservés aux acteurs émergents, il a pour objectif de soutenir le développement d'un « New Space français » et de positionner le pays sur des technologies de rupture et de nouveaux marchés, dans un secteur historiquement structuré par la demande publique. Piloté par la direction générale des entreprises (DGE) avec les directions de la recherche et de l'innovation (DGRI) et de l'armement (DGA) et l'appui du secrétariat général pour l'investissement (SGPI), le volet spatial de France 2030 est opéré conjointement par Bpifrance (appels à projets) et le CNES (appels d'offres).
Les premiers résultats présentés fin 2022 semblent encourageants, avec 7 dispositifs lancés, 34 projets candidats et 15 lauréats d'ores et déjà sélectionnés, représentant un engagement de 65 millions d'euros. Toutefois, ni l'ISRU ni les services liés l'économie cislunaire ne font partie des priorités - celles-ci concernent plutôt les mini-lanceurs, les constellations, les données spatiales (environnement, surveillance, etc.), les sciences ou encore les services de communication et de navigation.
En matière de capital-risque, le retard de l'Europe sur les États-Unis est une faiblesse bien identifiée. D'importants progrès ont toutefois été réalisés en une dizaine d'années, et l'on peut espérer que le secteur spatial en bénéficie.
En France, un premier fonds de capital-risque spécifiquement dédié au New Space a été lancé en avril 2022 à l'initiative de Charles Beigbeder (fonds Audacia, spécialisé dans l'immobilier et les technologies quantiques) et de François Chopard (accélérateur Starburt, spécialisé dans l'astronautique). Essentiellement privé, le fonds Expansion avait lors de son lancement pour objectif de lever « plus de 300 millions d'euros sur la période 2022-2023 » et de financer 100 start-up en quatre ans, dont une moitié de start-up françaises.
Mais les tours de table successifs ne suffiront pas aux entreprises du New Space européen : pour se développer, il leur faudra des clients et des contrats. S'il n'émerge finalement en Europe ni commande publique, ni marché commercial, il restera toujours les États-Unis, et notamment les contrats de services de la NASA - mais au risque que nos entreprises ne soient alors pas de taille à affronter la concurrence, ou qu'elles doivent localiser leurs activités, leurs emplois et leurs brevets aux États-Unis pour se conformer aux règles américaines de préférence nationale.
Il est probable, en tout état de cause, que le New Space des ressources spatiales connaisse, après sa phase actuelle d'éclosion d'une multitude d'acteurs, une phase de consolidation et de concentration.
4. Une influence normative au service de la durabilité
a) Pour une approche pragmatique
L'exploitation des ressources spatiales aura lieu, elle aura besoin d'un cadre juridique adapté, et les Européens ont non seulement des intérêts en jeu, mais aussi une vision à défendre.
Une chose est sûre : ce n'est pas en évitant le sujet, ou en rejetant toute solution qui ne ferait pas l'objet d'un traité contraignant adopté sous l'égide des Nations Unies, que l'on pourra défendre cette vision. Le temps s'accélère, et le futur « code minier » de l'espace sera défini par les mineurs - et les vendeurs de pioches. C'est pourquoi il faut permettre aux acteurs européens de prendre part à ces nouvelles activités, d'autant plus qu'en ces domaines extrêmement techniques, ce sont les pratiques des industriels qui dictent la norme (standards d'interopérabilité, bonnes pratiques, etc.).
À cet égard, le débat sur la compatibilité avec l'esprit du Traité de 1967 est l'archétype du faux problème, où une question de principe (celle du caractère appropriable ou non des ressources), en réalité déjà tranchée dans les faits, complique les avancées sur les modalités, là où se trouvent les véritables enjeux.
C'est pourquoi le présent rapport est favorable à l'adoption rapide d'un premier cadre juridique autorisant et organisant les activités liées à l'exploitation des ressources spatiales, qui pourrait prendre la forme :
- d'une part, d'un texte européen (ou à défaut national) ;
- d'autre part, d'un accord « plurilatéral », c'est-à-dire un accord international, contraignant ou non, entre pays volontaires, sans attendre l'hypothétique aboutissement des négociations en vue d'un accord « multilatéral » - mais en espérant qu'une première initiative permette in fine d'atteindre cet objectif.
Les accords Artemis constituent à cet égard une première base, mais il faut bien insister sur le fait que ceux-ci ne posent que des principes généraux et n'interdisent donc en aucun cas d'imaginer des mécanismes garantissant un accès durable et équitable aux ressources à d'autres acteurs et à d'autres pays - pourvu qu'il se trouve quelqu'un, à la table des négociations, pour défendre ces principes.
De même, accepter l'idée d'un accord plurilatéral n'empêche pas de bénéficier de tous les travaux menés dans le cadre du COPUOS, qui reste, quoi qu'il en soit, le forum international le plus pertinent et le plus légitime. De nombreuses réflexions, propositions et contributions ont déjà été formulées au sein de son sous-comité juridique.
Parmi les contributions les plus notables, on peut citer le rapport155(*) présenté fin 2022 au COPUOS par le GEGSLA, le Groupe d'experts pour la durabilité des activités lunaires (Global Expert Group on Sustainable Lunar Activities) de la Moon Village Association (cf. supra), qui rassemble des représentants d'agences spatiales, d'administrations, d'entreprises, d'ONG, d'institutions internationales, de centres de recherche, etc. Présentées en 2020 par l'Outer Space Institute, les Vancouver Recommendations on Space Mining sont un autre exemple de contribution précise et détaillée156(*).
Des échanges informels ont également lieu au niveau européen ou de façon bilatérale, impliquant notamment les pays déjà dotés d'une ébauche de cadre juridique (États-Unis, Luxembourg, Émirats arabes unis, Japon) ou ceux qui mènent des réflexions en interne sur le sujet (Pays-Bas, Belgique, Inde, Arabie saoudite, etc.). En France, les membres du groupe « Objectif Lune » de l'ANRT conduisent également des réflexions sur le sujet.
b) Pour une exploitation durable et équitable
Le présent rapport est un travail de prospective : il n'a pas vocation à entrer dans le détail des différentes règles, normes et bonnes pratiques envisageables au niveau national, européen ou plurilatéral, ni a fortiori à se prononcer sur leur opportunité. Il faut d'abord qu'une discussion ouverte puisse avoir lieu.
À titre indicatif, on peut toutefois mentionner une première liste, non exhaustive, de sujets à aborder.
|
Quelques aspects d'un futur cadre juridique L'objectif est d'abord d'assurer le respect des grands principes du droit de l'espace : non-appropriation nationale des corps célestes, utilisation à des fins pacifiques, liberté d'exploration et d'utilisation, responsabilité internationale exorbitante des États, principes de non-interférence, de non-dégradation et de non-contamination, assistance mutuelle, etc. Si ces principes doivent s'appliquer, il est évident que la nature particulière des activités liées à l'exploitation des ressources naturelles des autres corps célestes appelle des dispositions particulières. Ces dispositions concernent notamment : - les conditions d'accès aux ressources : règles d'attribution (« premier arrivé, premier servi », licences, quotas, etc.) et de redistribution (taxation, compensation, etc.), à définir en fonction des ressources (minerais, volatiles, fréquences radio, etc.) et de leurs caractéristiques (en distinguant notamment les ressources renouvelables et non renouvelables) ; - la compétence des États et les obligations des entreprises : modalités d'agrément, compétence juridictionnelle (civile et pénale), mécanismes de règlement des différends, régime de responsabilité au titre des activités et des dommages, régime fiscal, propriété intellectuelle, assurance, immatriculation, pouvoirs et organismes de contrôle, sanctions, etc. ; - les standards d'interopérabilité : composants et pièces de rechange, protocoles de communication, carburants utilisés, etc. ; - les règles de transparence et l'échange d'informations : connaissances scientifiques (géologie, cartographie, analyses chimiques, etc.), prévention des risques (météo spatiale, bombardements d'astéroïdes, installations et activités dangereuses, etc.), registre public des bases et des activités (un « cadastre lunaire » sans propriété foncière), géolocalisation en temps réel des rovers, etc. ; - la protection de l'environnement : prévention et élimination des débris en orbite lunaire, réduction des dangers liés aux émissions de poussière et aux rejets dangereux (toxiques, radioactifs, etc.), devenir des sites après cessation de l'exploitation, protection planétaire157(*), protection des sites patrimoniaux remarquables158(*) (natural and cultural heritage), etc. |
En prenant toute sa place dans la nouvelle économie des ressources spatiales, l'Europe pourrait défendre une vision normative fondée sur l'idée de durabilité (ou soutenabilité).
Cette notion apparaît en effet particulièrement pertinente au regard des enjeux soulevés par l'exploitation des ressources spatiales, dans ses deux dimensions que sont la protection de l'environnement (spatial et terrestre) et l'équité (entre pays et générations).
S'agissant de l'environnement, la notion de durabilité constitue une « boussole » utile à la fois :
- sur Terre : l'exploitation des ressources spatiales doit être favorisée dès lors qu'elle permet d'éviter la surexploitation des ressources ou les atteintes à l'environnement sur Terre (moins de lancements et de débris grâce au carburant fabriqué in situ, attribution des orbites et des fréquences aux projets à raison de leur utilité environnementale, etc.) ;
- dans l'espace : il s'agit d'éviter que la surexploitation des ressources (eau, minerais, composés volatils, orbites, fréquences, etc.) ou les dommages causés à l'environnement local (débris orbitaux, radiations, poussières, rejets toxiques, etc.) ne compromettent les usages futurs, y compris ceux qui ne sont pas encore identifiés. On pourrait, par exemple, imaginer un principe de « pollueur-payeur ».
S'agissant de l'équité, la notion de durabilité permet une prise en compte de l'intérêt des autres pays et des générations futures. L'exploitation des ressources spatiales est un problème de riches, que peu de pays peuvent se permettre d'envisager aujourd'hui, et dont les bénéfices pourraient être largement captés par les États-Unis et la Chine du fait de leur rôle de « gatekeepers » (barrières à l'entrée).
Les Européens, finalement relativement bien positionnés, pourraient avoir intérêt, avec d'autres pays comme l'Inde, à constituer une alliance plus large, notamment avec les pays émergents, compte tenu des bénéfices mutuels à retirer dans le futur. Plusieurs mécanismes sont envisageables, y compris dans un cadre plurilatéral (et non multilatéral), comme par exemple des accords commerciaux, des compensations dans d'autres domaines ou encore la mise en place d'une autorité régulatrice sur le modèle de l'AIFM (cf. supra).
Une « stratégie européenne pour une exploitation durable des ressources spatiales » ne serait pas seulement une approche pertinente : c'est également un objectif consensuel, et un domaine où l'Europe est crédible.
L'objectif de durabilité se retrouve à peu près dans toutes les notes, contributions, propositions et stratégies en matière de politique spatiale, à commencer par les stratégies de l'ESA et de l'UE. La Commission européenne installée en 2019 a d'ailleurs construit son programme politique autour d'une « approche globale en matière de durabilité et de développement durable », déclinée dans tous les secteurs159(*).
Enfin, l'Europe est ici un acteur crédible, comme le prouve sa mobilisation en matière de lutte contre les débris spatiaux.
Nombre de charges utiles lancées chaque
année de 1957 à 2021.
Les minisatellites
sont en rouge. Source : ESA 2022.
ClearSpace-1 (vue d'artiste)
|
Diverses solutions techniques de « satellites-éboueurs » sont actuellement à l'étude, et c'est l'ESA qui finance, avec sa mission ClearSpace-1, la première mission de ce type au monde168(*). Le contrat de 86 millions d'euros a été confié à un consortium mené par la start-up suisse ClearSpace. L'objectif est de désorbiter le VESPA, un étage de 100 kg d'une fusée Vega, en orbite depuis 2013. Le test devrait avoir lieu en 2026. Ces solutions sont complémentaires des nouveaux services en orbite (in-orbit servicing) visant à prolonger la durée de vie des satellites : refueling, inspections, réparations, repositionnement, voire recyclage et récupération. Plusieurs entreprises européennes se positionnent dans ces domaines, comme dans celui de l'exploitation des données spatiales (par exemple les start-up françaises SpaceAble et Look Up Space). Enfin, s'il est peu réaliste d'espérer un accord international contraignant en matière de débris spatiaux à court terme, le sujet se prête en revanche très bien à des discussions informelles et à des engagements volontaires. Signalons à cet égard le travail mené par le Forum de Paris pour la Paix dans le cadre de son initiative Net Zero Space, qui rassemble des acteurs divers (agences spatiales, administrations, entreprises, société civile, chercheurs, etc.) issus de différents pays (UE, États-Unis, Chine, Inde, etc.) atour d'un intérêt commun : la préservation de la ressource rare que constituent les orbites terrestres. Chaque acteur doit, en rejoignant l'initiative, annoncer des engagements concrets169(*). |
B. QUE FAIRE ? DEUX PROPOSITIONS CONCRÈTES POUR AVANCER
L'Europe aurait tout à gagner à se positionner dans le domaine de l'exploitation et de l'utilisation des ressources spatiales : elle a des atouts à faire valoir, une voix à faire entendre, et des bénéfices à retirer - en bref, elle dispose d'une carte à jouer. Il reste à s'en saisir, et cela ne pourra se faire sans un soutien politique, au niveau européen comme au niveau national.
Une précision s'impose : le présent rapport n'a en aucun cas pour objet de préempter les choix technologiques à venir en matière d'ISRU, la sélection des projets les plus pertinents ou des entreprises les plus capables ne relevant ni de sa compétence technique, ni de son mandat politique. Il n'a pas non plus vocation à déterminer le montant ni a fortiori l'allocation des financements publics correspondants, lesquels relèvent des gouvernements nationaux, de l'Union européenne et de l'ESA. De même, et comme indiqué supra, il ne s'agit pas de préempter les débats sur le contenu ou la portée des différentes normes envisageables.
Ce que ce rapport peut faire, en revanche, c'est contribuer à élever ce sujet technique au rang de priorité politique, et engager le débat sur les solutions juridiques.
À cette fin, il formule deux propositions qui sont à la fois générales et envisageables à court terme :
1) adopter une stratégie européenne des ressources spatiales ;
2) modifier rapidement le cadre juridique national et européen pour autoriser l'exploitation commerciale des ressources spatiales.
1. Adopter une stratégie européenne des ressources spatiales
Pour que sa voix compte dans le programme Artemis et dans le futur de l'exploration spatiale, et pour que ses entreprises puissent se saisir des opportunités de la nouvelle économie cislunaire, l'Europe doit rapidement se doter d'une stratégie explicite et ambitieuse en matière de ressources spatiales.
Cela implique, d'abord, de le dire : le sujet doit être traité au niveau politique et figurer parmi les « priorités » des différentes « stratégies » présentées par l'ESA et l'UE en matière de politique spatiale, au même titre170(*) par exemple que l'accès autonome à l'espace, la recherche scientifique ou le suivi du changement climatique. Il doit aussi trouver sa place dans « l'offre » européenne au titre de sa contribution au programme Artemis, au côté notamment du module de service de la capsule Orion.
Le prochain sommet de l'espace, qui se tiendra à Séville en novembre 2023, pourrait être l'occasion de formuler une telle stratégie. À défaut d'un accord entre tous les pays membres de l'UE ou de l'ESA, rien n'empêche certains États de formuler une stratégie commune.
Cela implique, ensuite, de s'y tenir. Une stratégie maintenue dans la durée et régulièrement confirmée et précisée est une condition nécessaire pour que les chercheurs, les investisseurs, les industriels, les administrations et tous les acteurs de la politique spatiale s'engagent pleinement. C'est l'une des grandes leçons du modèle américain.
Cela implique, enfin, d'y mettre les moyens. Leur chiffrage ne relève pas du présent rapport, mais il est certain que plus l'objectif sera « identifié », plus les financements seront susceptibles d'être « débloqués ». En outre, l'ISRU et la logistique cislunaire sont particulièrement adaptés aux activités commerciales, financées par des acteurs privés qui en espèrent un retour sur investissement plutôt que par le contribuable.
En résumé, l'Europe doit savoir où elle va, le dire, et y aller.
On peut ajouter à cela deux précisions. D'abord, des « moyens » importants ne suffiront pas : il faudra aussi des « outils » intelligents, par exemple sur le modèle des contrats de services utilisés aux États-Unis. L'UE, l'ESA et les États membres n'ont toutefois pas attendu la NASA pour s'interroger sur le sujet, et des évolutions sont en cours.
Ensuite, si la « stratégie » formulée se résume à des termes vagues et à des ambitions creuses, elle n'aura servi à rien. Laissons ici la parole au groupe « Objectif Lune » de l'ANRT171(*) :
|
« Au titre des considérations stratégiques, il est intéressant de comparer les documents de stratégie européens et ceux adoptés par la NASA. « Outre-Atlantique, ces documents (ex : NASA Technology Roadmaps, Technology Taxonomy, Strategic Technology Intergation Framework, etc.), généralement de plusieurs centaines de pages, décrivent précisément les briques technologiques à développer et peuvent directement servir de guides pour les appels d'offres visant des développements technologiques complexes (ex : le réacteur 1-10 kW KRUSTY). « À l'inverse, les documents stratégiques européens (ex : Terrae Novae 2030+, ESA Strategy for Science on the Moon, etc.) sont beaucoup plus courts, s'en tiennent aux objectifs programmatiques et évoquent très peu les développements technologiques nécessaires. Or ce sont ces documents stratégiques qui permettent de dégager précisément les domaines dans lesquels acteurs spatiaux et non-spatiaux pourraient collaborer. Plus encore, ces mêmes documents sont la garantie d'une élaboration cohérente et stratégique d'une politique d'appel d'offres ambitieuse. » |
2. Modifier rapidement le cadre juridique national et européen pour autoriser l'exploitation commerciale des ressources spatiales
La seconde proposition du présent rapport consiste à adapter le plus vite possible le droit national et européen afin de permettre l'exploitation commerciale des ressources spatiales, comme l'ont fait les États-Unis ou, à leur échelle, le Luxembourg, les Émirats arabes unis et le Japon.
L'exploitation des ressources spatiales aura de toute façon lieu, et du reste, au-delà des querelles doctrinales, des positions de principe et des blessures d'ego national, les raisons qui justifieraient de ne pas autoriser leur exploitation commerciale n'ont rien d'évident. Au contraire, il est difficile d'imaginer comment les investissements nécessaires, à la fois considérables, de long terme et très risqués, pourraient être suscités en l'absence de modèles économiquement viables.
En attendant d'avancer sur les modalités encadrant l'exploitation des ressources spatiales, il est urgent de confirmer sa possibilité.
Il faut idéalement pour cela négocier un accord plurilatéral, voire à terme multilatéral, mais en attendant, c'est au niveau européen qu'il est le plus pertinent d'agir - ou, à défaut, au niveau national.
a) Une législation de l'UE sur les ressources spatiales
Les bénéfices pour l'économie, l'emploi et l'autonomie stratégique seront plus importants si les pays européens se dotent d'un cadre unifié.
Le 10 mars 2023, la Commission européenne a annoncé qu'elle « envisagera de proposer une législation spatiale de l'UE ». Si l'annonce a été faite à l'occasion de la présentation de la stratégie de l'UE pour la sécurité et la défense172(*), les enjeux stratégiques et économiques sont intimement liés, et la communication comprend un important volet consacré au New Space.
La Commission européenne indique que « certains États-membres ont mis en place des règles nationales pour réglementer les opérations spatiales, y compris les aspects liés à la sécurité. En l'absence d'un cadre commun, ces règles peuvent différer. Cette divergence pourrait affecter la compétitivité spatiale de l'UE et la sécurité de l'UE ». La mission d'information sur l'espace de l'Assemblée nationale173(*) va dans le même sens, en estimant que la loi française de 2008 sur les opérations spatiales (LOS) (cf. infra), « extrêmement précise et ambitieuse, (...) est un outil de régulation et de respect de l'environnement très important. Mais les exigences demandées par la loi française grèvent la compétitivité des seules entreprises françaises qui y sont soumises et rendent plus difficile la concurrence avec les entreprises étrangères ». La mission recommande par conséquent de « transposer la LOS en directive européenne puis défendre le droit européen dans les instances internationales » (recommandation n° 16).
Le même raisonnement s'appliquerait à un texte sur l'exploitation des ressources spatiales.
Le sujet ne fait toutefois pas partie des priorités de la Commission, qui se concentre sur les enjeux réglementaires liés aux constellations de télécommunications et de navigation et aux services en orbite basse. C'est tout à fait justifié, mais rien n'interdit d'ajouter une disposition de principe sur les ressources spatiales, qui serait à ce stade suffisante.
Enfin, si l'échelon européen est le plus pertinent, il présente aussi quelques spécificités qu'il faut avoir à l'esprit.
|
La compétence spatiale de l'Union européenne Tout d'abord, c'est bien au niveau de l'Union européenne que la question du cadre juridique a vocation à être traitée, l'ESA, organisation internationale distincte, n'ayant pas de compétence normative. L'UE elle-même ne dispose pas de compétence propre en matière spatiale, mais d'une compétence partagée avec les États-membres depuis le traité de Lisbonne de 2007, base juridique du programme spatial de l'Union européenne174(*). Celui-ci permet le financement de plusieurs programmes, le cas échéant en partenariat avec l'ESA (Copernicus, Galileo, Iris², etc.), mais il ne constitue pas un cadre réglementaire commun entre les États-membres. L'UE peut aussi intervenir sur le fondement d'autres compétences que la politique spatiale, par exemple le marché intérieur, la concurrence, la protection de l'environnement ou, comme en l'espèce, la politique de sécurité et de défense. Enfin, la mise en place d'un cadre juridique européen devra tenir compte du fait que ce sont bien les États qui demeurent ultimement responsables des dommages causés par les activités spatiales aux termes des traités internationaux, de même que ce sont eux qui signent - ou non - les accords Artemis, sur une base bilatérale avec les États-Unis. Aucune de ces spécificités ne fait obstacle à ce que l'UE se dote d'un cadre juridique favorable à l'essor d'une économie des ressources spatiales, et plus généralement d'une économie orbitale et cislunaire innovante et diversifiée, les États-membres conservant les compétences les mieux exercées à leur niveau. |
b) Une révision de la loi française sur les opérations spatiales (LOS)
Pour faire émerger une priorité politique à l'échelle européenne, rien de tel qu'une initiative nationale : même si l'objectif à terme est celui d'une législation de l'UE complétée par accord international, agir au niveau de la loi française a du sens, ne serait-ce que pour envoyer un signal.
En outre, le risque d'une hétérogénéité réglementaire entre pays européens est ici limité, puisqu'il ne s'agirait dans un premier temps que d'une disposition principielle et d'une procédure d'agrément, sur le modèle de la loi luxembourgeoise par exemple.
Il suffirait de modifier un texte existant : en effet, en matière de droit des activités spatiales commerciales, la France fait figure de modèle depuis l'adoption de la loi relative aux opérations spatiales (LOS) en 2008, entrée progressivement en vigueur entre 2010 et 2020.
La loi n° 2008-518 du 3 juin 2008
relative
aux opérations spatiales (LOS)
Adoptée en 2008 après une dizaine d'années de travaux préparatoires, la LOS vise à traduire en droit national les obligations qui découlent des engagements internationaux de la France, alors que les années 1990-2000 avaient été marquées par une première phase de libéralisation des activités spatiales dans le domaine des télécommunications.
L'article VI du traité de l'espace de 1967 institue en effet une responsabilité des États pour les activités menées dans l'espace extra-atmosphérique, non seulement par des organismes gouvernementaux mais aussi par des entités non gouvernementales, donc des acteurs privés, par exception aux règles habituelles du droit international.
La loi définit la notion d'opérateur spatial, et encadre les opérations spatiales par l'institution d'un régime d'autorisation préalable, soumis à des conditions et susceptible de faire l'objet de sanctions pénales en cas de manquement des opérateurs à leurs obligations. Elle établit aussi la tenue par le CNES du registre national d'immatriculation des objets spatiaux, et lui confie une mission de police de l'exploitation des installations du centre spatial guyanais (CSG).
Seule révision intervenue au niveau législatif à ce jour, l'ordonnance du 23 février 2022175(*) vise à adapter la LOS à la militarisation croissante de l'espace, en élargissant son périmètre aux activités d'exploitation de données d'origine spatiale et en associant le ministère des Armées à la procédure d'autorisation.
Face aux évolutions majeures qu'a connu le secteur spatial au cours des quinze dernières années (nouveaux acteurs, nouveaux services orbitaux, vols suborbitaux, constellations, lanceurs réutilisables, débris spatiaux, etc.), le Gouvernement a entrepris une révision de la LOS, des décrets associés et de la réglementation technique (RT).
Considérant que « la LOS doit accompagner les initiatives issues du New Space en leur donnant un cadre réglementaire lisible et stable, nécessaire à la pérennité de leurs activités176(*) », il a organisé une consultation des acteurs du secteur entre janvier et mars 2023, sous l'égide du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en concertation avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère des Armées et le CNES. Celle-ci devrait aboutir prochainement à de premières mesures législatives.
Toutefois, d'après les informations dont disposent les rapporteurs, la question de l'exploitation des ressources spatiales ne figure pas à ce jour parmi les modifications envisagées. Le sujet manque de soutien politique, car il n'est pas « identifié » : il est donc utile que le Parlement s'en saisisse. On ne peut qu'approuver la recommandation n° 9 du rapport de l'Assemblée nationale, qui appelle à « organiser un débat au Parlement sur le ou les textes qui remplaceront la loi relative aux opérations spatiales (LOS) ».
Une première solution, intermédiaire, consisterait à modifier la loi afin d'autoriser les activités spatiales commerciales dans leur ensemble, sauf exceptions limitativement énumérées, et d'en encadrer les modalités.
Cette solution permettrait déjà aux industriels français de participer dans un cadre sécurisé à différents volets du programme Artemis, avec des rovers, des modules d'habitation, des systèmes de télécommunication ou encore de production d'énergie, tout en évitant de trancher frontalement la question de l'extraction et de l'utilisation des ressources naturelles. Plus largement, elle permettrait aux entreprises françaises de prendre leur part au développement actuel de l'économie orbitale et cislunaire177(*), en proposant des services de transport et de logistique, de fabrication en microgravité, de production d'énergie solaire en orbite, etc. Une telle évolution est de toute façon nécessaire, le sujet particulier de l'exploitation des ressources n'étant que l'un des aspects du développement de nouveaux services commerciaux dans l'espace.
Il reste que cette solution intermédiaire, si elle a l'avantage de ne pas traiter frontalement la question des ressources elles-mêmes, a aussi pour effet de priver nos entreprises d'un aspect essentiel de la chaîne de valeur de l'économie lunaire, l'ISRU, et a fortiori de la possibilité de proposer des modèles intégrés, synonymes à terme d'autonomie stratégique.
C'est pourquoi le présent rapport propose d'aller plus loin en autorisant dès maintenant et expressément l'exploitation commerciale des ressources spatiales.
Certes, une telle modification irait au-delà de la position actuelle de la France au niveau international, qui appelle à une solution au niveau des Nations Unies. Il n'y aurait toutefois aucun obstacle juridique à procéder ainsi178(*), d'autant que cette position pourrait évoluer, et qu'elle est de toute façon fragile depuis la signature des accords Artemis par la France.
C. TABOUS POLITIQUES ET PANIQUE MORALE : LE PREMIER COMBAT DES EUROPÉENS
Avec les ressources spatiales, l'Europe et la France disposent d'une précieuse carte à jouer pour « revenir dans le jeu ». Et pourtant, le sujet est totalement absent du discours politique, et ne figure dans aucun document stratégique. Pourquoi ?
Il y a, de toute évidence, une part de méconnaissance. Le sujet est largement ignoré du grand public comme du Parlement. Mais les experts, les administrations nationales et européennes et les responsables politiques en charge du sujet, eux, peuvent difficilement ignorer ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs dans le monde, les études publiées, les projets lancés, les contrats signés.
En guise de conclusion, on émettra ici une hypothèse : si le sujet est si difficile à assumer dans le débat public, c'est aussi parce qu'au fond, il nous renvoie à nos faiblesses politiques et malmène nos certitudes morales. Ce n'est pas une raison pour l'ignorer - bien au contraire.
1. Où sont les États-Unis d'Europe ?
En matière spatiale comme en d'autres domaines, le problème de l'Europe est, d'abord, un problème d'unité politique. La comparaison avec le modèle américain est, à cet égard, éloquente.
a) Gouverner, c'est choisir179(*)
La grande faiblesse de l'Europe, c'est qu'elle ne parle pas d'une seule voix : là où la stratégie spatiale américaine est définie au plus haut niveau politique et mise en oeuvre de façon cohérente par le National Space Council, la politique spatiale européenne est éclatée entre les États membres, l'ESA et l'UE, sa formulation résulte de compromis âprement négociés entre des responsables politiques et des acteurs industriels aux intérêts divergents, et sa mise en oeuvre est entravée par la rigidité des procédures et la complexité des projets. Rien n'illustre mieux ce problème que les difficultés rencontrées pour faire aboutir le programme Ariane 6.
Malgré cela, il arrive que l'Europe spatiale fasse de grandes choses, et avec peu de moyens. Mais au regard des 100 milliards de dollars du programme Artemis et de la détermination de la NASA, ce n'est pas suffisant.
Dans le domaine spatial, la difficulté des Européens à dépasser leurs intérêts nationaux s'incarne dans le mécanisme du « retour géographique », en vertu duquel l'ESA investit dans chaque Etat membre, sous la forme de contrats attribués à son industrie spatiale, un montant à peu près équivalent à la contribution de ce pays. Ce mécanisme doit être réformé, et de premières propositions en ce sens sont sur la table. Il ne faut toutefois pas en attendre des miracles - d'ailleurs, l'Union européenne, qui n'est pas liée par ce système, n'échappe pas pour autant à la logique du compromis.
Le sursaut politique dont l'Europe a besoin est d'une toute autre ampleur, mais chaque sujet, chaque avancée peut y contribuer.
b) Gouverner, c'est prévoir180(*)
De l'incapacité des Européens à parler d'une seule voix découle une autre grande faiblesse : l'absence de vision crédible à long terme. L'Europe spatiale navigue à vue, ou presque, puisque le budget de l'ESA se décide pour trois ans et le cadre financier pluriannuel de l'UE pour cinq ans - sans même parler du cycle électoral et de l'annualité budgétaire au sein de chaque État membre.
C'est bien peu de visibilité donnée aux entreprises, d'autant que l'exploration spatiale et l'exploitation des nouvelles ressources impliquent des investissements massifs et des choix technologiques qui les engageront pour des dizaines d'années - rappelons qu'il ne s'agit rien de moins que d'aller, littéralement, « décrocher la Lune » (en tout cas quelques morceaux).
Par contraste, les États-Unis, comme d'ailleurs la Chine, s'engagent sur la durée. La stratégie spatiale est définie et maintenue à long terme. Les Space Policy Directives (SPD) rendent les engagements crédibles et précisent les besoins, tandis que les contrats de services apportent de la visibilité et de la sécurité aux entreprises, qui peuvent ainsi prendre davantage de risques.
2. Astrologie de la morale
Le sujet questionne aussi le bien-fondé de nos conceptions morales : le terme même d'« exploitation des ressources spatiales » est pour ainsi dire un concentré d'imaginaire négatif (capitalisme, colonialisme, extractivisme), qui menacerait d'un coup tous les fondements de l'identité spatiale européenne. C'est pourquoi le concept est si difficile à manier dans le débat public.
Pourtant, cette idée est fausse, et se fonde en grande partie sur des préjugés moraux et des transpositions hasardeuses, qui prospèrent sur une méconnaissance du sujet.
La culture générale scientifique fait bien trop souvent défaut au débat public, le sujet des ressources spatiales est, à cet égard, un cas d'école.
a) Le profit contre la Science ?
Oui, les activités commerciales génèreront des profits, et non, ce n'est pas un problème - c'est même une bonne chose, pour l'économie, pour l'emploi et pour l'avenir, et cela n'exclut ni la régulation, ni la redistribution.
Ne vouloir aller dans l'espace qu'au nom de la science pure et du progrès désintéressé, c'est prendre le risque de ne pas y aller du tout, et d'y laisser la place aux autres. Il y aura toujours de la science, du commerce et des lois, mais tout cela se fera sans nous.
Quant au débat juridique sur l'appropriation des ressources, il doit s'analyser, froidement, comme la simple recherche d'une solution technique permettant de susciter l'investissement dans l'intérêt général - et non comme une question morale sur le bien-fondé de la propriété privée ou les vertus du capitalisme.
b) La force contre le Droit ?
Le retour des rapports de force et la compétition pour les ressources est un fait : on peut le déplorer, mais pas y échapper. On peut en revanche tenter de peser sur le cours des choses, de défendre nos intérêts et de promouvoir notre vision - celle d'une exploration spatiale pacifique, au service de la durabilité, de l'équité et du progrès humain. Mais encore faut-il être du voyage.
Pour le reste, il n'y a pas de peuples à « coloniser » sur la Lune, ni de richesses à « piller » sur Mars, et la « conquête » spatiale n'est qu'une formule qui, si elle inspire certains, n'oblige personne.
c) L'homme contre la Nature ?
« Nous avons déjà pollué la Terre, n'allons pas faire la même chose dans l'espace » : rien n'est plus faux et plus dangereux que cette idée qui, pourtant, semble issue des meilleures intentions.
Ce que l'humanité a déjà bien trop abîmé sur Terre, c'est la vie, la biodiversité, les écosystèmes. Le problème, ce sont les eaux polluées, les sols contaminés, l'atmosphère dégradée. Rien de tout cela n'a de sens ailleurs que sur Terre. Il n'y a pas de vie sauvage sur la Lune, pas de forêts primaires sur Mars, et pas d'oiseaux migrateurs en orbite géostationnaire. Le régolithe lunaire est déjà radioactif, et les rejets de CO2 ne feront pas de mal à l'atmosphère martienne.
Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas se soucier de protection de l'environnement spatial. Les enjeux sont majeurs : débris orbitaux, rejets dangereux, protection planétaire, surexploitation des ressources empêchant leur partage équitable ou leurs usages futurs, etc. Les leçons de nos erreurs sur Terre seront précieuses.
En revanche, cela veut dire qu'on ne peut pas transposer tels quels des concepts terrestres comme la « nature » ou la « pollution ». Ce qui pollue sur Terre n'est pas ce qui pollue sur une autre planète, si tant est que le mot ait le moindre sens en l'absence de vie.
Si l'humanité ne risque pas de « polluer » la Lune, Mars ou les astéroïdes, en revanche, la Lune, Mars et les astéroïdes peuvent nous aider à ne pas polluer la Terre.
Rappelons les perspectives : fabriquer du carburant sur la Lune, c'est fabriquer moins de carburant sur Terre, et donc diminuer drastiquement le nombre de lancements polluants et de débris dangereux. Fabriquer du carburant sur Mars, c'est permettre à l'humanité d'aller plus loin qu'elle n'est jamais allée auparavant, pour le plus grand bénéfice de la connaissance, de la science et du progrès. Enfin, tout astéroïde contenant du platine est bon à prendre s'il permet d'épargner les forêts, les banquises et le fond des océans, et d'éviter tout ce que l'extraction des ressources terrestres implique de tensions, de pillages et de conflits.
Et si rien de tout cela ne fonctionne, ce qui est possible, l'humanité n'en aura pas moins appris sur l'univers et sur elle-même, elle aura acquis des connaissances nouvelles et développé des technologies utiles qui, sur Terre, permettront de résoudre des problèmes et de sauver des vies.
Une base européenne sur la Lune (vue d'artiste). Source : ESA 2013.
COMPTES-RENDUS
I. AUDITION PUBLIQUE SUR L'EXPLOITATION DES RESSOURCES DE LA LUNE (3 NOVEMBRE 2022)
M. Mathieu Darnaud, président. - Nous sommes réunis ce matin pour aborder un sujet assez méconnu mais néanmoins passionnant : l'exploitation des ressources spatiales, à commencer par celles de la Lune, puisqu'il n'aura échappé à personne que les Américains entendent y retourner d'ici à 2025, dans le cadre de la mission Artemis, et que les Chinois, associés aux Russes, n'entendent nullement se laisser distancer sur ce terrain.
La Lune pourrait bel et bien offrir des ressources exploitables, d'abord en appui direct aux missions d'exploration, pour fabriquer de l'oxygène pour l'équipage ou du carburant pour le retour, mais aussi, pourquoi pas, à la place ou en plus des ressources terrestres.
Disons-le tout de suite, ce n'est pas pour demain : on peut évidemment rêver à des centrales nucléaires tournant à l'hélium-3 lunaire, ou à des voitures dont les batteries seraient faites de métal d'astéroïde, mais pour l'instant nous ne sommes même pas capables d'envoyer des hommes sur la Lune. Alors de là à espérer y produire quelque chose en quantité industrielle...
Pour autant, ce n'est pas de la science-fiction : plusieurs projets concrets sont déjà annoncés, les États-Unis et la Chine sont entrés dans la course, et des entreprises privées travaillent à des solutions utiles à relativement court terme. Nous aurions tort de ne pas prendre cela au sérieux, comme nous avons pu le faire à propos des lanceurs réutilisables d'Elon Musk...
L'exploitation des ressources de la Lune, c'est un sujet prospectif par excellence, encore assez loin de nous pour que l'on puisse tout imaginer, mais déjà assez proche pour qu'on puisse le faire avec rigueur et réalisme. Nos collègues Christine Lavarde et Vanina Paoli-Gagin s'y attachent dans le cadre du rapport qui leur a été confié, et dont l'audition de ce matin, centrée sur la Lune, constitue en quelque sorte le lancement. Mais qu'il s'agisse d'exploitation des ressources ou du reste, chacun sait que la Lune n'est qu'un premier pas vers Mars, et sans doute plus loin encore.
Il est naturel, sur un sujet comme celui-ci, de croiser le regard des chercheurs, des grandes agences gouvernementales et des entreprises. C'est pourquoi nous avons le plaisir d'accueillir ce matin :
- Isabelle Sourbès-Verger, géographe, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
- Pascale Ultré-Guérard, directrice adjointe des programmes au Centre national d'études spatiales (CNES) ;
- Clarisse Angelier, déléguée générale de l'Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) ;
- Alban Guyomarc'h, doctorant en droit et coordinateur du programme Objectif Lune à l'ANRT.
Mme Christine Lavarde. - Je souhaiterais pour ma part insister sur la dimension géopolitique du sujet. Si l'exploitation effective des ressources spatiales n'est pas pour demain, elle s'envisage dès aujourd'hui. Or tout ceci arrive dans un contexte bien particulier, qui ne vous a pas échappé, de renouveau des tensions internationales, de militarisation de l'espace, de retour des rapports de force au détriment de la coopération. On l'a bien vu avec la guerre en Ukraine, qui a conduit à la remise en cause de plusieurs programmes importants - et encore ceci n'est-il pas grand-chose au regard de la rivalité entre les États-Unis et la Chine, qui structure chaque jour un peu plus les questions spatiales.
La course à l'exploitation des ressources spatiales fait partie de cette nouvelle équation géopolitique. Il y a des signes qui ne trompent pas, par exemple lorsque les Américains décident, dans le cadre des accords Artemis, d'instituer des « zones de sécurité » sur la Lune afin, je cite, « de réduire les interférences ou les conflits entre les opérations rivales ».
De ce point de vue, il y a sans doute quelques enseignements à tirer du cas de la première des « ressources spatiales », la véritable ressource rare, ou le « bien rival » comme disent les économistes : l'orbite basse, cet espace de plus en plus encombré avec l'essor des constellations de satellites et l'augmentation exponentielle des débris spatiaux. En principe, la seule manière de préserver cette ressource, ce sont la coopération et la régulation. Pourtant, on ne peut pas dire que les résultats soient très satisfaisants, en dépit des efforts menés depuis longtemps au niveau international, au sein du COPUOS, le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, comme nous l'a raconté son ancien président, Gérard Brachet, lors de la réunion interparlementaire sur l'espace qui s'est tenue au Sénat en septembre dernier.
Comment cela va-t-il se passer pour les « autres » ressources spatiales, celles qu'on pourrait exploiter sur la Lune ou sur Mars ? En tout cas, le COPUOS, le Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique de l'ONU, vient tout juste de se saisir officiellement de la question, que l'on pourrait résumer ainsi : le droit de l'espace est-il « prêt » pour l'exploitation des ressources, ou sommes-nous, pour ainsi dire, dans un nouveau Far West, avec ses mines d'or, ses cowboys, mais pas vraiment de shérif ?
Mme Vanina Paoli-Gagin. - Christine Lavarde vient d'évoquer les aspects politiques et juridiques du sujet, mais il comporte aussi une forte dimension économique, sur laquelle je souhaiterais insister. Avec les ressources spatiales, on parle bien « d'exploitation », et non plus seulement « d'exploration » de l'espace. C'est important, car ceci revient à admettre qu'il puisse y avoir dans tout cela une logique commerciale, ce qui suppose une forme de rentabilité pour les entreprises, un retour sur investissement, une viabilité des modèles économiques. Car au final, c'est bien cela qui permettra de faire le tri entre les projets « réalistes », et ceux qui resteront du domaine de la science-fiction.
Aux États-Unis, dire cela relèverait de l'évidence, et c'est bien dans cette perspective que se positionnent les acteurs du New Space : ils y vont parce qu'ils pensent qu'il y a un business. Par contre, en France et en Europe, où la politique spatiale est traditionnellement menée au nom d'objectifs plus « nobles » comme la connaissance scientifique ou le progrès humain, cela revient à s'attaquer à une forme de tabou.
Cela me semble pourtant nécessaire, car le plus difficile, ce n'est pas de lever le tabou, c'est tout ce que cette levée provoque, toutes les questions auxquelles il faudra répondre : comment favoriser l'innovation ? Quel rôle pour les grandes entreprises et pour les start-up, pour les acteurs du spatial et les autres (je pense par exemple aux compagnies minières, dont le savoir-faire pourrait être précieux) ? Quid de la politique de concurrence, de la commande publique ? Quel régime de propriété sur la Lune, et quel régime de responsabilité sur Mars ?
Tous les débats que nous avons ici-bas sur la souveraineté économique, industrielle et technologique de la France et de l'Europe se retrouvent en quelque sorte « là-haut ». La question est de savoir si, oui ou non, nous souhaitons y avoir une place.
Mme Isabelle Sourbès-Verger, géographe, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). - La question de l'occupation de l'espace est entrée depuis peu dans les préoccupations des chercheurs en sciences humaines et sociales. Je suis d'ailleurs la seule géographe à travailler sur ce sujet en France, ce qui, vu mon âge, n'est pas sans m'inquiéter pour l'avenir.
La question des ressources de l'espace a été tenue à l'écart parce que la géographie c'est en principe l'analyse de la Terre, Gê, mais il suffit de s'intéresser à l'orbite basse pour constater que des activités humaines sortent de l'enveloppe terrestre, notamment grâce à des engins artificiels non habités. On se souviendra que dès 1956, soit avant le lancement du premier Spoutnik, le géographe Jean Gottman affirmait qu'il y aura nécessairement une géographie de l'espace, puisque l'homme a une propension à se saisir de tous les milieux et à y installer une compétition économique et géopolitique, et cela à partir du point d'ancrage qu'est la Lune, le seul point où l'on pouvait alors se projeter pour y envisager une activité pérenne.
Pour mémoire, la première photo de la face cachée de la Lune, en 1959, est une photo soviétique. Lorsque Neil Armstrong pose le pied sur la Lune en 1969 et plante le drapeau américain, en faisant accomplir « un pas de géant pour l'humanité », cela marque le fait que les États-Unis appréhendent cet astre comme une nouvelle frontière, car leur expansion dans l'espace leur semble naturelle. La vision actuelle de la Lune, sous la forme de la carte américano-japonaise Unified Geologic Map of the Moon de 2020 qui répertorie toutes les ressources géologiques de la Lune, prépare évidemment une exploitation de ses ressources minières. Reste à savoir à quel coût il sera possible de forer, et si ce sera rentable.
Une photo de la Terre en arrière-plan prise en 2014 depuis l'orbite de la Lune par la mission chinoise Chang'e ravive la prise de conscience, qu'avaient permise les missions Apollo, de la nécessité de la préservation écologique du « vaisseau Terre ». Cette dimension concerne aussi la Lune, à 400 000 kilomètres de nous, aussi inhospitalière soit-elle.
Autour de la Terre, l'activité humaine présente de fortes densités au niveau des orbites des satellites à défilement en orbite basse et de l'orbite géostationnaire, avec entre les deux de grandes zones assez vides, de sorte que la question du trafic ne se pose pas partout avec la même acuité.
Si la Lune et Mars nous apparaissent comme des destinations familières, elles n'ont pas été souvent fréquentées. La grande période d'exploration de la Lune s'achève en 1976 avec la dernière sonde soviétique Luna. On remarque une chose : cette période a été marquée par un grand nombre d'échecs, qui étaient considérés comme faisant partie du développement de l'activité spatiale. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, comme en attestent les reports multiples du lancement du SLS (Space Launch System), par souci de minimiser les risques au maximum. Après les missions vers la Lune des années 1990, qui ont été des échecs, puis la mission européenne SMART en 2004, celles qui ont suivi dans les années 2010 ont été le fait des nouveaux acteurs japonais, chinois et indien. À partir de 2019 et jusqu'en 2024-2025, on assiste à une nouvelle multiplication des missions lunaires, avec la Corée du Sud, l'Inde, la Chine, les États-Unis, peut-être la Russie et l'Europe en coopération. Quant aux rovers martiens, ils sont tous Américains à l'exception d'un véhicule chinois, tandis que la sonde européenne Mars Express a vu son lancement retardé par la crise Covid, avant d'être reportée sine die, puisqu'elle reposait sur une coopération avec les Russes que les tensions géopolitiques ont remise en question.
Deux mots clés caractérisent le projet américain de retour sur la Lune : d'une part, le leadership, hier face aux Soviétiques et aujourd'hui face à la Chine, qui reconnaît cependant qu'elle est encore en retard ; d'autre part, la nécessité de la commercialisation, ce qui suppose d'investir pour permettre à des acteurs privés de trouver leur place, à l'instar d'Elon Musk avec SpaceX, qui se positionne en sous-traitant de la NASA pour assurer les transports en orbite basse et vers la Lune, ou de Jeff Bezos avec Blue Origin.
La mission du gros lanceur SLS de la NASA est d'ouvrir la voie, en faisant notamment alunir, dans le cadre de la mission Artemis, la première femme et la première personne de couleur - cette dimension « politiquement correcte » étant davantage mise en avant, en termes de communication, que les enjeux commerciaux.
S'agissant des grilles de lecture, il importe de découpler les ambitions chinoises et leur perception par les Occidentaux dans le contexte global des relations terrestres entre la Chine et les États-Unis. La Chine décline, que ce soit au sujet de la Lune ou de Mars, le slogan de Xi Jinping sur « le rêve chinois ». L'objectif affiché est d'arriver à la parité avec les États-Unis à l'horizon 2049, en cochant d'ici-là toutes les cases de ce que les anciennes puissances spatiales ont su faire, dont la conquête de la Lune, mais en s'appuyant sur les nouveaux moyens de l'informatique, de l'électronique et de l'intelligence artificielle. Le face-à-face entre les États-Unis et la Chine est tel que la décision de Barack Obama de ne pas donner suite au programme lunaire lancé par Georges Bush Jr., sous prétexte que cela n'avait plus aucun intérêt cinquante ans après Apollo, a, par effet miroir, grandement déprécié le programme lunaire chinois, avant que Donald Trump ne le ranime par ses prises de position. La propagande chinoise a ensuite beau jeu de citer le New York Times lorsqu'il pose la Chine comme principal concurrent des États-Unis.
S'agissant des autres acteurs, l'Europe doit encore confirmer ses ambitions, qui figurent dans l'étude lancée par l'Agence nationale de la recherche et de la technologie (ANRT), en lançant un programme majeur, avec l'adhésion du public, ce qui suppose de mettre en avant les valeurs d'indépendance européenne, d'image de haute technologie - les discours sur la compétitivité et la militarisation seront en revanche plus difficiles à développer.
Les missions japonaises sont très fortement intégrées dans le programme Artemis américain.
L'effacement de la Russie reste à confirmer, car elle n'acceptera sans doute pas, malgré ses difficultés de financement, de disparaître de la scène spatiale. Elle a bien passé un accord avec la Chine en vue de l'implantation d'une station dans le cadre de la mission Luna 25, mais seulement à des fins de recherche, et ce projet devrait avoir dix ans de retard sur le programme américain.
La politique spatiale indienne n'est pas sans ambiguïtés : les missions Chandrayaan 3 et Gaganyaan reposent sur un budget d'un milliard d'euros par an, contre 13 à 14 milliards d'euros pour l'Europe et 50 milliards d'euros pour les États-Unis, et privilégient a priori un vol spatial habité sur l'envoi de robots sur la Lune.
Les ambitions de la Corée du Sud se traduisent par la mission Danuri, lancée en août 2022 grâce à SpaceX.
Les nouveaux explorateurs sont aussi des financiers. C'est le cas des Émirats arabes unis, qui mènent une coopération très ouverte avec les États-Unis et le Japon, et sont impliqués dans la mission lunaire chinoise Chang'e 7 pour 2026. C'est aussi le cas du Luxembourg, où ont été récemment organisés, à Esch-sur-Alzette, une compétition de robots lunaires, par l'ESA et l'ESRIC, le Centre européen d'innovation en matière de ressources spatiales, ainsi que l'exposition Esch-Mars, de terres rouges en terres rouges.
Le mode d'exploitation des ressources est un choix essentiel. Comme il est peu probable que l'on ramène des minerais de la Lune pour les exploiter sur terre (même si c'est envisagé pour les astéroïdes), l'exploitation et l'usage des ressources se feront sans doute essentiellement in situ. La question des débouchés commerciaux se pose, ainsi que l'organisation des flux entre les sites miniers et les sites d'usage et le statut public ou privé des acteurs, dans l'optique de la mise en place d'une véritable économie orbitale - voilà un sujet de prospective ! La question des utilisateurs non autonomes, dont fait partie l'Europe, se pose aussi.
Au-delà de la question de la rentabilité, qui doit être évaluée en intégrant les retombées technologiques, se pose la question de la durabilité : le coût en carbone, le devenir des sites lunaires après la période d'exploitation, et, d'une manière générale, les questions de protection planétaire qui préoccupent beaucoup les astronomes et le public - l'émission de poussières autour de la Lune, par exemple, perturberait grandement les observations. Sur tous ces sujets, nous commençons à peine à construire notre réflexion ; cela se fait notamment dans le cadre du projet de révision de la loi sur les opérations spatiales (LOS) de 2008, entrepris par le CNES.
Enfin se pose la question de la relation entre la puissance publique, les médias et l'opinion publique, alors que le discours des médias européens est souvent calqué sur celui des médias anglo-saxons.
Mme Pascale Ultré-Guérard, directrice adjointe des programmes du Centre national d'études spatiales (CNES). - Pour parler des « ressources », nous allons partir des éléments du tableau périodique de Mendeleïev, c'est-à-dire des atomes et des molécules qui en dérivent, comme l'eau, l'hydrogène, l'oxygène et les minéraux. Or notre connaissance des ressources spatiales n'est que très parcellaire, car acquise par des observations à distance, notamment grâce à la spectrométrie ; elle est aussi macroscopique et ne couvre que la surface, sauf à l'occasion d'observations in situ très locales et limitées à la proche surface de la Lune.
Des missions robotiques ou habitées in situ ont en effet permis d'effectuer des prospections en surface, mais avec assez peu de points d'observation, en ayant parcouru à peine quelques dizaines de kilomètres sur la surface de la Lune. Les retours d'échantillons ont atteint quelques centaines de kilos de roches lunaires dans le cadre des missions Apollo, et quelques grammes lors de missions sur des astéroïdes comme la mission japonaise Yakuza ou la mission américaine Osiris-REX sur l'astéroïde Bennu. Des retours d'échantillons de Mars sont par ailleurs prévus pour 2030.
Comme ces missions coûtent plusieurs centaines de millions d'euros, voire plusieurs milliards, le coût rapporté des échantillons de matières extraterrestres est très largement prohibitif, de sorte que ce n'est pas demain que l'on fera un usage terrestre de ces ressources. Même le Luxembourg, un pays très en pointe sur ce sujet, se projette à un horizon à vingt ans et au-delà.
C'est pourquoi les efforts portent essentiellement sur l'utilisation in situ des ressources, soit l'ISRU (In situ Resource Utilization), que ce soit pour du support vie en cas de vol habité, pour produire de l'eau ou de l'oxygène pour l'équipage, ou pour des éléments de construction - métaux, minéraux, régolithe - afin de construire des habitats et des infrastructures, ou encore pour produire du carburant, la Lune faisant office de tremplin pour explorer des corps plus lointains comme Mars.
Les enjeux technologiques associés portent sur le forage, le conditionnement, le stockage et l'usinage des ressources, en tenant compte de toutes les contraintes liées à l'environnement spatial. Pour l'ISRU, l'horizon de mise en oeuvre est de dix ans.
S'agissant des activités actuelles et à venir, un travail de prospection est en cours, comme c'est le cas au niveau européen avec le projet Prospect, qui s'appuie sur le lanceur Luna 27, pour un forage et un laboratoire d'analyse in situ afin d'étudier la présence d'eau dans le sous-sol martien. Des expérimentations en conditions réelles ont déjà été menées, à l'image de la mission Moxie de la NASA qui est parvenue à produire en avril 2021 quelque 10 grammes d'oxygène à partir du CO2 de l'atmosphère martienne, soit l'équivalent de 10 minutes de respiration pour un astronaute, au prix d'une consommation d'énergie très élevée.
Des simulations autour du régolithe de la Lune sont par ailleurs menées par l'ESA dans le cadre de l'European Astronaut Center (EAC), à partir de roches basaltiques. Un consortium français mené par l'INRAP et l'ONERA cherche à faire la même chose à partir de roches de volcans d'Auvergne. Il reste que le régolithe est une substance très abrasive qui pose beaucoup de difficultés dans l'environnement des astronautes.
L'International space exploration coordination group (ISECG), qui rassemble les agences spatiales gouvernementales, a produit en 2021 un rapport intitulé ISRU gap assessment report qui dresse l'inventaire des problématiques et des innovations associées à l'exploitation des ressources spatiales in situ.
Sur le plan juridique, il s'agit de mener cette activité dans le respect des traités existants, dont le Traité de l'espace de 1967, qui a posé le principe de non-appropriation par un État des ressources issues de corps extra-terrestres. Ma collègue Clémence Lambrecht, spécialiste du droit spatial, pourra répondre à vos éventuelles questions sur ce sujet.
Plusieurs pays se sont dotés de lois nationales sur l'exploitation des ressources extraterrestres, dont les États-Unis avec un executive order en 2020, le Luxembourg dès 2007, et les Émirats arabes unis en 2020. Ces lois visent à autoriser l'exploitation des ressources spatiales et leur appropriation.
La loi relative aux opérations spatiales (LOS) votée par la France en 2008, qui vise à protéger les biens et les personnes dans le cadre de l'accès et de l'utilisation de l'espace, ne couvre pas les aspects d'exploitation des ressources. Une révision de cette loi est en cours pour prendre en compte les évolutions récentes des activités spatiales.
Sur le plan multilatéral, les accords Artemis ont été proposés par les États-Unis à leurs partenaires internationaux et la France les a signés en juin 2022. Ils comportent une section dédiée à l'exploitation des ressources, qui met en avant le bénéfice pour l'humanité, l'importance du support aux opérations, la nécessaire cohérence avec le traité de 1967 et le besoin d'informer les Nations Unies de telles activités, tout en incitant à des efforts multilatéraux dans ce domaine.
La France a signé les accords Artemis en insistant beaucoup sur le besoin de continuer les travaux dans un cadre multilatéral plus large, au sein du COPUOS, en poussant à la création d'un groupe de travail qui couvre l'exploration, l'exploitation et l'utilisation des ressources spatiales. Celle-ci a été actée lors de la 68e réunion du comité juridique du COPUOS, avec pour mandat : l'échange d'informations ; la définition des activités de recherche-développement et d'innovation nécessaires ; la prise en compte des aspects juridiques et le respect des traités existants ; les avantages de nouveaux instruments de gouvernance ; l'adoption de principes de base susceptibles de faire l'objet d'une résolution des Nations Unies. Ce processus est assez long, mais il présente l'avantage d'embarquer toutes les grandes puissances spatiales.
En ce qui concerne la stimulation du secteur privé, de nombreuses initiatives ont été prises par les Américains, avec de multiples challenges et prix, et avec le programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS) mis en place en 2019, de sorte que les acteurs privés agissent très majoritairement sur fonds publics.
L'ESA mène des programmes similaires de stimulation des acteurs commerciaux, mais cela reste une démarche émergente. Côté français, on peut citer l'initiative de l'ANRT Objectif Lune qui vous sera présentée tout à l'heure. Le CNES est associé à l'incubateur Nubbo, qui accompagne huit start-up sélectionnées dans le cadre du programme Tech The Moon. Le CNES mène également des activités de prospective à travers Spaceibles, tout en travaillant à l'élaboration d'une feuille de route technologique qui recouvre, outre l'aspect ressources spatiales, le vol habité et le support vie aux astronautes, c'est-à-dire comment se nourrir, boire et respirer dans l'espace.
Comme vous le voyez, ces activités en sont encore à un stade préliminaire au niveau européen, mais les agences spatiales, dont le CNES, font preuve d'une volonté de s'y impliquer de plus en plus. La France a toujours été assez exemplaire dans ses activités spatiales, notamment en se dotant très tôt d'une loi relative aux opérations spatiales. À mon sens, le souci de la protection des biens et des personnes et de la durabilité des activités doit rester notre marque de fabrique.
Mme Clarisse Angelier, déléguée générale de l'Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT). - Je souhaiterais commencer par saluer les propos introductifs du Président et des rapporteurs, car vous y osez des mots comme « souveraineté », « militarisation », « géopolitique » ou encore « commercialisation », et c'est assez nouveau. Je le salue au nom des membres de l'ANRT qui ont participé aux travaux menés avec le CNES, sous la présidence de Claudie Haigneré, et qui ont débouché sur un livre blanc qui aborde tous ces sujets. Il est en effet essentiel de « dégoupiller les tabous ».
Bien que la France soit un acteur historique du spatial, il est impératif de développer une approche européenne, puisque c'est à ce niveau seulement que nous pourrons discuter avec les États-Unis et la Chine, qui ont décidé de s'emparer de la « maison Lune ». Car, à moins que l'humanité ne disparaisse à l'horizon 2100, l'humain ira bien sur la Lune. La question est donc de savoir si l'Europe doit participer ou non à cette aventure, sur l'autel du bien commun, de l'humanisme, des valeurs de durabilité et de la protection de la « maison Terre » - car il ne s'agit évidemment pas de détruire notre berceau au bénéfice de quelques happy few qui iraient sur la Lune.
Pour en être, il ne suffit pas de beaux discours, il faudra actionner le levier scientifique et technologique. Les entreprises du spatial historique sont prêtes à le faire, mais aussi des acteurs du non-spatial - j'en veux pour preuve le fait que l'organisation du gala Objectif Lune du 7 juin dernier ait pu être autofinancée, notamment grâce à des industriels automobiles, du bâtiment et de la communication. Et nous avons milité ensemble pour une constellation européenne de télécommunications autour de la Lune, et pour que nos entreprises privées du spatial et du non-spatial assument ensemble la dimension française et européenne d'un tel objectif stratégique, qui se déclinerait au niveau militaire, scientifique, technologique, d'exploration et peut-être d'exploitation.
Nous avons encore à apprendre de l'exploration spatiale à partir de la face cachée de la Lune, mais aussi sur la physiologie et la psychologie de l'humain dans l'espace, alors même que la Station spatiale internationale va être fermée.
Qu'elles le disent ou qu'elles ne le disent pas, pour des raisons d'image, toutes les entreprises du CAC 40 ont pensé à ces champs de recherche, et s'y investissent au travers de programmes souvent organisés par la NASA. La clé est de financer des projets pour le spatial avec un retour sur investissement terrestre, en lien par exemple avec les capacités de recyclage ou de survie dans les milieux extrêmes.
Le fait d'assumer ces enjeux est tout à fait compatible avec nos valeurs humanistes. Cela nécessite aussi de renforcer les compétences scientifiques au sein des entreprises, que ce soit au niveau de l'ingénieur ou du doctorat, pour construire un spatial « propre » avec les jeunes générations.
M. Alban Guyomarc'h, doctorant en droit, coordinateur d'Objectif Lune à l'ANRT. - Permettez-moi de commencer par deux remarques. Tout d'abord, quand on envoie des objets dans l'espace, on n'a pas la même conception du temps que le commun des mortels : le « demain » d'ici-bas n'est pas le « demain » de l'espace, qui renvoie à une grosse dizaine d'années. Ensuite, ce qui caractérise ces nouvelles ambitions lunaires, c'est le projet d'installer une base lunaire permanente, avec des besoins en énergie, en support de vie et en espace beaucoup plus importants que lors d'un aller-retour Terre-Lune, tout en assurant un retour sécurisé des astronautes. Contrairement à ce qu'a pu laisser penser Barack Obama, il ne s'agit pas seulement de retourner sur la Lune, mais bien de s'y installer.
Les ressources étant au coeur des nouveaux programmes lunaires américain et chinois, il ne s'agit pas seulement d'un sujet de prospective lointaine. Malgré les barrières technologiques qui subsistent pour exploiter ces ressources et y trouver une logique économique avec les financements qui en découlent, l'exploitation des ressources spatiales n'est pas pour après-demain, mais pour demain, et ce « demain » s'élabore dans l'immédiat.
À mon sens, il faut distinguer deux types d'exploitation des ressources spatiales. L'une qui relève de la prospective pure, et qui n'est pas à considérer dans l'immédiat, à savoir l'exploitation des ressources à des fins terrestres, et l'autre qui relève d'enjeux beaucoup plus concrets, soit l'exploitation de ressources spatiales à des fins spatiales, en particulier la production de carburant.
Les États-Unis ont déjà investi un milliard de dollars dans l'ISRU - soit un demi-budget spatial annuel français -, qui repose sur des technologies en cours de développement ou développées pour la Terre, notamment dans l'optique de la transition énergétique à l'hydrogène.
Si le juriste que je suis est incapable de construire des machines capables d'exploiter les ressources lunaires, l'ANRT a la chance de compter dans ses rangs, au sein du groupe Objectif Lune, des scientifiques qui ont produit dans son livre blanc un mode d'emploi partiel sur le sujet. En quelques mots, il s'agit d'extraire de l'oxygène à partir du régolithe lunaire, en le chauffant dans un réacteur catalyseur, pour obtenir de l'eau lunaire par électrolyse, puis de l'hydrogène. Or si vous mettez de l'hydrogène et de l'oxygène dans le réacteur d'une fusée, elle démarre ! Il s'agit donc de transformer la Lune en une sorte de station-service pour fusées qui, après un voyage Terre-Lune, partiraient au-delà, vers une destination « Lune vers l'infini », ce qui est beaucoup plus facile qu'en partant de la Terre pour un voyage « Terre vers l'infini ». Les ressources lunaires auront d'autres applications dans le domaine de la construction de l'habitat et du support de vie.
L'exploitation des ressources spatiales ne s'oppose pas à la durabilité ; au contraire, elle la sert pour trois raisons. D'abord, contribuer à fabriquer du carburant dans l'espace, c'est encourager le réapprovisionnement en carburant des objets spatiaux et des missions spatiales, et donc la réutilisation des équipements. Ensuite, ponctionner le maximum de ressources sur la Lune, c'est évidemment préserver les ressources terrestres. Enfin, dans le cadre d'une transition énergétique terrestre qui reposerait sur l'exploitation de l'hydrogène, les technologies développées pour l'ISRU et pour la Terre sont à peu près les mêmes : catalyseur, électrolyse, utilisation de l'hydrogène.
En ce qui concerne l'encadrement juridique de l'exploitation des ressources, la relance de la course à l'espace et l'apparition d'un nouvel affrontement est-ouest, cette fois-ci entre les États-Unis et la Chine, s'inscrivent dans un contexte où la guerre des grands traités spatiaux n'est plus. En effet, depuis 1979 et l'échec de l'accord sur la Lune, le dialogue multilatéral qui pourrait aboutir à des grands traités sur l'espace est au moins compromis, au mieux impossible. Aussi la plupart des juristes s'accordent-ils pour conserver l'acquis des grands traités spatiaux sans les remettre en négociation.
Quand les Américains ont initié les accords Artemis, ils ont d'ailleurs contribué à renforcer cette logique de l'impossible accord multilatéral sur la Lune et sur l'exploitation des ressources spatiales. Il ne s'agit en effet pas d'un accord multilatéral, mais au mieux d'une constellation d'accords bilatéraux dominés par les Américains, soit en quelque sorte un contrat d'adhésion où la marge de négociation est très limitée, ces derniers imposant à leurs partenaires leur interprétation du droit de l'espace. C'est le cas en particulier sur la remise en question du principe de non-appropriation des ressources, qui a choqué beaucoup de juristes. Ainsi la nouvelle conquête de la Lune est-elle bien aussi une nouvelle conquête du droit.
Et nous dans tout cela ? Pourquoi les Européens ne se sont-ils pas mis autour de la table pour mettre en place une charte de l'engagement européen vers la Lune d'une dizaine d'articles ? Quant à la révision de loi française sur les opérations spatiales évoquée par Pascale Ultré-Guérard, elle devra composer avec le fait que la France a signé les accords Artemis en juin dernier, lesquels mettent en avant l'exploitation des ressources lunaires. Nous avons cependant besoin d'une telle loi pour clarifier le cadre français d'une exploitation des ressources, pour sécuriser un environnement d'innovations en France autour de ces mêmes ressources, et enfin pour attirer les projets des entreprises dans ce domaine.
Et pourquoi ne pas imaginer une loi européenne sur l'exploitation des ressources spatiales ? Certes, l'article 189 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) relatif à l'élaboration d'une politique spatiale européenne semble être une barrière difficilement contournable, puisqu'il stipule que « le Parlement européen et le Conseil établissent les mesures nécessaires, [...] à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres ». Toutefois, rien n'empêche de s'accorder entre partenaires ESA sur un texte de quelques articles, en gageant que chacun des États membres saura les intégrer dans son droit interne.
Il est impératif de nous armer économiquement, techniquement et juridiquement pour exister dans le cadre de la nouvelle conquête de la Lune. Il est urgent de s'engager dans cette voie, car l'affrontement entre États-Unis et Chine a besoin d'une tierce partie qui croie en la durabilité, en la science et au progrès, pour se poser en puissance d'apaisement.
Inquiétons-nous, enfin, de la baisse de l'investissement des jeunes lycéens dans les disciplines scientifiques et mathématiques, car ces jeunes étudiants sont nos ingénieurs de demain. Or si pour le spatial dix ans c'est demain, dix ans c'est aussi le temps qu'il faut à un jeune bachelier pour obtenir son doctorat et pouvoir se mettre au service des ambitions spatiales européennes. On le constate donc, les enjeux de l'exploitation des ressources lunaires sont immédiats, et à quelques mètres d'ici.
M. Mathieu Darnaud, président. - Je vous remercie grandement pour vos interventions respectives.
Mme Christine Lavarde. - Merci beaucoup pour vos exposés très complémentaires. Pourquoi, selon vous, l'Europe n'arrive-t-elle pas à émerger en tant que troisième puissance spatiale ? Est-ce lié au fait qu'en Chine, le parti est capable d'impulser une politique puissante dans la durée, tout comme l'État fédéral américain à sa façon, alors que l'ESA, qui n'est pas l'Union européenne, doit faire cohabiter 25 ou 30 avis individuels, avec des priorités qui divergent. Comment, par exemple, les Pays baltes, qui sont confrontés à une inflation de plus de 20 %, vont-ils convaincre leur population qu'il est important d'alimenter le budget de l'Agence pour exploiter des ressources dans le futur ?
S'agissant du droit, un acteur privé a besoin, pour s'engager, d'être certain d'être protégé dans le temps. Or on ne sait pas encore qui sera propriétaire des ressources lunaires. Le premier qui développera une technologie d'exploitation va-t-il tout capter, ou voit-on s'élaborer les prémices d'une régulation prenant en compte les enjeux de développement durable ?
M. Alban Guyomarc'h. - L'Europe a développé une culture de la négociation entre plusieurs États autour des grands projets spatiaux, c'est heureux même si c'est coûteux en temps, et que cela conduit parfois à des discussions de marchands de tapis. Nous devons conserver cette fierté de pouvoir coopérer. À cet égard, il faut souligner que le spatial n'est pas qu'un coût : la NASA a estimé que le programme Artemis générait 37 000 emplois aux États-Unis et 2 milliards de dollars d'impôts directs. Il faut donc expliquer aux contribuables européens que l'investissement réalisé pour la Lune a des bénéfices terriens immédiats : on parle d'emplois locaux, de PME qui fabriquent des câbles dans le sud de la France et de contrats pour des entreprises du CAC 40.
Mme Vanina Paoli-Gagin. - Merci beaucoup pour vos interventions passionnantes : on aurait envie de vous écouter toute la journée. Pensez-vous que la commande publique européenne devrait être mobilisée pour permettre un passage à l'acte des acteurs que vous avez cités ?
Je partage à 100 % votre opinion selon laquelle il faut faire valoir l'avantage compétitif de l'Europe, qui consiste à privilégier le dual et la durabilité. Notre seul moyen de retrouver une avance est d'être porteurs d'une approche éthique de la technologie et de la science.
M. Bernard Fialaire. - En quoi consiste la singularité du Luxembourg ? Vous avez parlé de faire une escale sur la Lune avant d'aller vers l'infini, mais ne peut-on trouver sur Terre des ressources qui permettent d'éviter cette escale ?
M. Alain Richard. - Vous avez évoqué des projets scientifiques économiquement coûteux, qui sont menés dans un contexte d'insécurité juridique. Nous sommes dans un cas extrême de législation extraterritoriale, où les États qui légifèrent n'ont aucune légitimité pour le faire, et où le seul instrument juridique envisageable serait comparable au traité de l'Antarctique. Dans la mesure où ce type de traité universel est très certainement hors d'atteinte, l'ensemble des activités touchant le corps lunaire va se faire sous des régimes étatiques terrestres qui autoproclament leur capacité à fixer des normes, alors que n'importe quel autre des 195 États des Nations Unies peut la leur contester. Tout indique que cette prétention à légiférer va se démultiplier. Cela nous promet un Far West potentiellement prospère pour les avocats et les assureurs, étant entendu que si cela rendra beaucoup plus fragiles les opérations d'investissement dans l'espace, cela ne les arrêtera pas.
L'appel obligé à une contribution plus forte de l'Union européenne est bienvenu, mais il ne nous protégera pas de la réalité du rapport de force économique et juridique actuel.
M. Daniel Gueret. - J'ai bien compris que la question n'est pas de savoir si l'homme retournera sur la Lune, car ce sera le cas, mais de savoir si l'Europe participera ou non à ce voyage. Quel est votre ressenti sur le degré de mobilisation de pays européens comme l'Allemagne par exemple ?
Mme Pascale Ultré-Guérard. - En matière d'exploitation des ressources, l'Europe a fait le choix, notamment à travers l'ESA, de la coopération, en apportant des briques à des missions d'envergure internationale. Le Président de la République Emmanuel Macron a évoqué la possibilité pour l'Europe de se doter d'une autonomie en matière de vols habités pour l'orbite basse, mais ce type d'approche ne fait pas l'unanimité. Il s'avèrerait sans doute difficile - si tant est que cela soit souhaitable - de passer de la coopération internationale à la souveraineté.
En tant que telle, l'Union européenne n'est pas très impliquée dans l'exploration spatiale, contrairement à l'ESA, qui n'est cependant qu'une agence intergouvernementale de recherche-développement, sans ambition politique et sans capacité à légiférer. Une implication plus grande de l'UE me paraît incontournable.
Mme Clarisse Angelier. - La collaboration entre l'ESA et la Commission européenne doit passer, comme le souhaite le commissaire Thierry Breton, par des dialogues, des intégrations et des modes de coopération susceptibles de faire émerger une méta-gouvernance de cet ensemble dont les frontières ne sont pas cohérentes.
J'ai le sentiment que l'Allemagne mène une démarche intéressante de mobilisation de son industrie privée du non-spatial, notamment dans le domaine de la robotique et de la mobilité. L'Italie est aussi assez présente, y compris en dehors du lanceur spatial historique. On nous invite d'ailleurs, au sein de l'ANRT, à travailler avec des entreprises non-spatiales européennes, même si cela sort parfois de notre domaine de légitimité.
En réponse à Alain Richard, je dirai que le fait d'être certain d'aller quelque part malgré un contexte d'incertitude économique et juridique est fréquent dans le monde de la recherche-développement, comme on a pu le constater récemment pour la recherche de vaccins. S'y ajoute l'incertitude des comportements humains et des choix politiques, car rien n'est jamais acquis en la matière !
M. Alban Guyomarc'h. - La privatisation et la commercialisation des activités spatiales se sont effectuées dans un cadre juridique en partie produit par l'industrie elle-même, dans la mesure où les lois spatiales nationales déclinent les engagements pris dans les traités : surveillance et autorisation d'opérations, immatriculation, etc. Il en résulte trois grands traits du droit des activités spatiales privées : un recours systématique à l'arbitrage ; l'importance de la source contractuelle ; la diversification des sources de financements, notamment via le capital-risque.
Alors que la négociation d'un droit public interétatique spatial relatif à la Lune est à l'arrêt, gageons que la régulation contractuelle et la régulation des assurances permettront de trouver une souplesse suffisante.
À propos du droit de propriété dans l'espace, je m'intéresse actuellement à l'histoire juridique de la conquête du Nouveau Monde, qui s'est appuyée sur un passage du Second traité du gouvernement civil de Locke pour faire valoir que les Indigènes, ne travaillant pas leur terre puisqu'ils étaient selon les colons des chasseurs-cueilleurs, n'avaient aucun titre de propriété ou de souveraineté sur le territoire qu'ils occupaient. De manière similaire, le premier à utiliser un site d'alunissage pourrait bien bénéficier d'un droit exclusif sur le territoire attaché.
Sans doute le débat sur la propriété spatiale et la propriété des ressources aurait-il pu se dérouler de façon plus apaisée si les États-Unis n'avaient pas glissé dans les accords Artemis la notion de safety zone, ou zone de sécurité, qui pourrait s'apparenter à une forme de titre de propriété. On pourrait aussi imaginer un modèle de non-propriété du territoire sous-jacent à un module lunaire avec néanmoins un droit exclusif à l'exploiter à l'instar du mobile-home qui « exploite » un terrain sans être propriétaire du sol. Au-delà de la question des titres de propriété lunaire, il me semble plus important de réfléchir aux questions de propriété intellectuelle et de propriété des découvertes faites à partir des ressources. C'est pourquoi j'aimerais savoir quels accords ont été passés, dans le cadre d'Artemis, sur l'immatriculation des objets spatiaux utilisés et des activités réalisées. Ces enjeux sont beaucoup plus immédiats que celui de la propriété du sol.
Mme Isabelle Sourbès-Verger. - Le Luxembourg a été le premier à suivre la loi américaine sur la commercialisation des ressources. Il a donc très tôt mis en place des incitations pour les sociétés qui seraient domiciliées au Luxembourg, en se portant pour elles garant de leurs activités en tant qu'État, puisque ce sont les États qui sont signataires du traité de 1967. La politique luxembourgeoise a consisté à permettre une continuité entre la ressource minière, la ressource financière et l'innovation.
Mme Pascale Ultré-Guérard. - S'agissant de la question de Vanina Paoli-Gagin sur la commande publique, il est possible de faire émerger un secteur autour des activités lunaires, avec un retour sur investissement pour les activités terrestres, au travers d'un programme comme TechTheMoon auquel le CNES participe via l'incubateur Nubbo. Nous encourageons beaucoup l'ESA à passer des contrats avec ces acteurs émergents de l'exploration et de l'exploitation des ressources lunaires.
M. Mathieu Darnaud, président. - Je vous remercie pour ces échanges passionnants et riches, qui appellent beaucoup d'autres questionnements dans le cadre des travaux qui sont les nôtres, et qui sont une première pour le Sénat. Nous aurons certainement à échanger encore sur ces questions dans les semaines à venir.
II. AUDITION PUBLIQUE DU GÉNÉRAL MICHEL FRIEDLING (25 MAI 2023)
M. Mathieu Darnaud, président. - Mes chers collègues, nous avons le plaisir de recevoir le général Michel Friedling, qui est à la fois ancien commandant de l'espace et cofondateur de la société Look Up Space spécialisée dans les données de surveillance de l'espace. Nos collègues Christine Lavarde et Vanina Paoli-Gagin travaillent depuis près d'un an sur un rapport consacré à l'exploitation des ressources spatiales qu'elles présenteront la semaine prochaine. Je veux les remercier car je sais qu'elles ont beaucoup travaillé sur ce sujet.
Peut-être avez-vous l'impression qu'il relève de la science-fiction, mais il n'en est rien. Avant d'aller chercher du lithium sur des astéroïdes ou de construire des usines sur Mars, nous irons sur la Lune. Si nous voulons y rester plus de quelques heures, nous devrons forcément utiliser les ressources disponibles sur place, à commencer par l'eau glacée située au fond des cratères pour fabriquer de l'oxygène et du carburant. De telles actions sont envisagées pour 2030, autrement dit pour demain.
En revanche, tandis que les États-Unis et la Chine font la course en tête, nos entreprises voient les opportunités leur échapper. Le sujet des ressources spatiales n'est qu'une nouvelle illustration de deux tendances : d'une part, la militarisation de l'espace, terrain d'affrontement stratégique ; d'autre part, la place croissante des acteurs privés avec l'émergence du New Space.
Mon général, vous avez été le premier commandant de la Space Force à la française créée en 2019. Si vous êtes aujourd'hui retraité, votre expérience n'en est pas moins précieuse pour prendre la mesure des nouveaux défis et menaces que représente l'espace. Avec Look Up Space, vous êtes désormais du côté des entreprises. Quel est votre marché ? À quels besoins répondez-vous ? Le soutien public en France et en Europe est-il à la hauteur de son équivalent américain ? Comment ne pas passer à côté des futures opportunités économiques qui sont autant de leviers d'importance stratégique pour notre pays ?
L'un des points communs entre ces deux univers réside dans l'importance cruciale de la maîtrise des données. Je vous laisse la parole pour nous parler de ce sujet et d'autres.
Général Michel Friedling, ancien commandant de l'Espace, cofondateur de Look Up Space - Mesdames et Messieurs les Sénateurs, je vous remercie de votre invitation. Le sujet est vaste et son intitulé m'a beaucoup donné à réfléchir. J'ai décidé de commencer par planter le décor et de terminer par Look Up Space et les enjeux de surveillance de l'espace, tout en ouvrant la porte sur d'autres sujets.
Je commencerai par rappeler un événement historique. En mai 1960, au-dessus de l'URSS, un U-2 américain a été abattu par les Russes et son pilote, Gary Powers, fait prisonnier. Au paroxysme de la Guerre froide, l'enjeu consistait pour les deux protagonistes à connaître le territoire ennemi, ses dispositifs, l'emplacement des sites de lancement des missiles balistiques, etc. Le renseignement était fait grâce aux avions.
Cependant, les Américains ont arrêté de survoler le territoire soviétique aussitôt après l'arrestation de Powers. En contrepartie, ils ont accéléré leur programme spatial. Le programme Corona a ainsi donné lieu peu après au premier lancement de satellite de reconnaissance américain, le Discover 14. En quelques heures de mission, celui-ci a rapporté des photographies de quatre millions de km2 de territoire soviétique, surface qu'un avion U-2 aurait couverte en 24 missions. Les analystes américains ont ainsi pu reconnaître 64 aérodromes militaires et identifier 26 sites de missiles sol-air. Le programme Corona a donné lieu, en une dizaine d'années, à plus de 145 missions ayant couvert plus de 88 fois le territoire soviétique. Celles-ci ont permis d'élaborer une cartographie exhaustive, de localiser tous les sites de missiles balistiques soviétiques, les sites antimissiles, les bases navales et sous-marines ainsi que des sites militaro-industriels ignorés jusqu'alors.
Cette anecdote montre combien, dès l'origine, le spatial et la donnée ont été intrinsèquement mêlés. Tous ces renseignements sont en effet fondés sur des téraoctets de données.
Aujourd'hui, que ce soit pour des applications militaires ou civiles, l'espace offre des infrastructures démocratisées, de plus en plus mises en oeuvre par des acteurs privés à des fins commerciales. Celles-ci fournissent des quantités extraordinaires de données utilisées à des fins institutionnelles, gouvernementales, commerciales, dans tous les domaines.
Ce phénomène s'accélère, comme en témoigne le dernier rapport consacré au marché aval d'observation de la Terre et au GNSS (géolocalisation et navigation par un système de satellites), c'est-à-dire au système de navigation, de positionnement et de synchronisation par satellite donné par GPS (Global Positioning System), Galileo, Glonass et Beidou. Ce rapport de l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial (EUPSA) montre que le marché des dispositifs GNSS passera de 6 milliards d'unités en 2021 à 11 milliards en 2031. Les recettes du marché aval devraient passer de 200 à 500 milliards d'euros et les livraisons de récepteurs GNSS de 2 à 2,5 milliards d'unités annuelles sur la même période.
Le marché d'observation de la Terre comporte deux volets : les données et les services élaborés à partir de la donnée. Ce marché présente une croissance régulière et devrait doubler durant la prochaine décennie sous l'impulsion de différents facteurs :
- les évolutions politiques européennes et mondiales en matière de climat (Green Deal, Accord de Paris) ;
- les besoins croissants dans tous les domaines ;
- le recours de plus en plus large aux opérateurs privés et commerciaux par des acteurs institutionnels, notamment en matière de défense ;
- les avancées technologiques, notamment le développement très rapide du cloud computing, du storage, du machine learning et de l'intelligence artificielle.
Le spatial est devenu l'élément central de la digitalisation du monde via ses infrastructures de plus en plus accessibles mais aussi grâce aux ruptures permises par le cloud computing et la connectivité.
L'usage du cloud computing est un fait majeur : les fonctions de servitude, comprenant le stockage des données et les logiciels, sont séparées des fonctions d'exécution. Les grands acteurs américains ont une position ultra dominante dans ce domaine. Ils déploient de grandes infrastructures de cloud computing nécessitant une connectivité mondiale. Aujourd'hui, celle-ci repose essentiellement sur des câbles sous-marins où transitent 99 % des échanges intercontinentaux.
Les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) possèdent, en pleine propriété ou en copropriété 37 des câbles continentaux sous-marins existants ou en projet. Alphabet et Meta ont fait le choix des câbles sous-marins. Alphabet en possède 21, tandis que Meta en possède 17. À l'inverse, Amazon et Microsoft ne disposent que de 6 et de 5 câbles sous-marins respectivement, dont aucun en propriété exclusive, puisqu'ils ont fait le choix des infrastructures spatiales.
Ainsi, nous assistons à une alliance entre SpaceX, avec Starlink, et Microsoft, deuxième acteur mondial du cloud computing. Celle-ci bénéficie du très fort soutien du Département de la Défense américain, qui a signé un contrat Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) de dix milliards d'euros pour la réfection des systèmes d'information basés sur les infrastructures spatiales. Elle est fondée sur une vision commune : le développement technologique et numérique spatial, qui forme le pivot du projet Joint All-Domain Command and Control (JADC2) alliant la connectivité à l'échelle mondiale et des besoins de traitement, de stockage et de dissémination en masse.
Microsoft a également développé Azure Orbital, une offre de services à destination du secteur spatial qui, avec la santé, constitue le plus gros fournisseur de donnés mondial.
De son côté, Amazon déploie également une infrastructure avec le projet Kuiper, qui accuse un peu de retard sur celui d'Elon Musk. Amazon est le leader mondial du cloud computing avec 33 % de parts de marché et déploie une constellation de 3 000 satellites, tout en développant AWS Space, une offre de cloud computing assez semblable à celle d'Azure Orbital.
Ces deux acteurs sont en passe d'acquérir une position très dominante dans ce domaine et présentent leurs offres dans tous les salons spatiaux.
Le nombre de satellites actifs en orbite connaît par ailleurs une croissance quasiment exponentielle. Le dernier rapport de l'Agence spatiale européenne (ESA) sur l'environnement orbital de la Terre est assez effrayant : nous sommes passés en quelques années de moins de 2 000 à environ 8 000 satellites actifs. À la fin de la décennie, plusieurs dizaines de milliers de satellites seront actifs dans la même zone orbitale, soit entre 400 et 1 200 km, ce qui pose des problèmes de congestion du trafic spatial.
De plus, Iris2, le projet souverain européen de connectivité poussé par le Commissaire Thierry Breton, doit encore être mis en oeuvre. La Chine mise sur un projet équivalent, Guo Wang, qui devrait compter 13 000 satellites. Absente de ce segment jusqu'à maintenant, la Russie lance également un projet de connectivité à l'échelle mondiale. Ces projets se situent dans les orbites basses afin de bénéficier de temps de latence très faibles entre les stations au sol et les satellites. À l'inverse, les satellites géostationnaires que nous connaissions se situent à 36 000 km de la Terre.
Les perspectives sont donc importantes. Les technologies de communication optique, entre satellites, permettent désormais de se passer de structures au sol. Un basculement s'initie des infrastructures terrestres, vulnérables et coûteuses, vers des infrastructures spatiales.
Les satellites chinois développent actuellement des capacités de vol en orbite. Le deuxième vol expérimental longue durée de l'avion spatial chinois vient de se terminer. Dernièrement, une situation conflictuelle a eu lieu entre des satellites russes et américains. Elle a duré quelques mois. Depuis fin 2022, une nouvelle situation de ce type est apparue. Cependant, le rapprochement orbital est une technologie maîtrisée de longue date. Elle avait été un peu délaissée, mais revient aujourd'hui avec des applications militaires importantes.
J'en viens à présent à Look Up Space, société que j'ai cofondée avec l'ancien chef du service de surveillance du CNES, Juan Carlos Dolado Pérez. Celui-ci était chargé du suivi des objets en orbite basse et des calculs de conjonction de collision possibles entre ces objets à des fins civiles. Il fournissait un service d'anticollision, qui a été incorporé dans le European Space Surveillance and Tracking (EUSST), un service de la Commission européenne.
Juan Carlos est un expert international de la question des débris. En effet, depuis le début de l'activité spatiale humaine, les débris spatiaux se sont multipliés. Ainsi, lorsque Spoutnik 1 est lancé dans l'espace en 1957, la capsule, la coiffe et le dernier étage de la fusée ayant lancé le satellite sont restés dans l'espace, soit trois objets.
En orbite basse circulent des milliers d'objets de grande taille, souvent d'anciens satellites morts, non désorbités, ou des étages de fusée, mais également des objets de taille inférieure, de quelques millimètres seulement. Ces objets se déplacent à 28 000 km/h. Un débris métallique d'un centimètre possède ainsi la même énergie cinétique qu'une boule de bowling lancée à 100 km/h.
En orbite sont présents plus de 36 000 débris de plus de dix centimètres, dont 22 000 seulement sont répertoriés et suivis, plus d'un million d'objets de plus d'un centimètre et environ cent millions d'objets de moins d'un centimètre selon les évaluations statistiques. Nous savons protéger les infrastructures spatiales contre ces derniers grâce à des blindages. Nous savons également détecter les objets de plus de dix centimètres et manoeuvrer pour les éviter. Cependant, nous ne savons ni détecter ni arrêter les objets entre un et dix centimètres.
Les débris résultent soit de l'activité humaine classique, soit d'incidents comme les collisions entre satellites, soit de tirs de missiles comme ceux effectués par la Chine en 2007 ou par la Russie en 2021.
Nous avons décidé de contribuer à résoudre ce problème. Look Up Space est une société engagée en faveur de la pérennité des activités spatiales en orbite, compte tenu de leur importance pour notre activité économique et notre avenir terrestre. En effet, l'avenir de la Terre se joue dans l'espace et l'avenir de l'espace se joue sur Terre, notamment pour contribuer à comprendre les enjeux climatiques.
Notre solution consiste dans le développement d'un radar dédié à la surveillance de l'espace. Celui-ci sera capable de détecter les objets de taille centimétrique, ce qui n'est pas encore possible en Europe.
Ensuite, nous développerons un réseau de radars en bénéficiant de l'avantage stratégique de nos territoires d'outre-mer. Ce réseau permettra de détecter l'ensemble des objets en orbite. Ainsi, il collectera des quantités phénoménales de données que nous devrons rapatrier, sécuriser et traiter pour en tirer de l'information.
Nous avons ainsi constitué un consortium avec deux acteurs industriels et neuf sous-traitants qui regroupent des PME, des ETI et des centres de recherches français pour développer la partie radar. Concernant la partie digitale, nous développons une plateforme numérique assez innovante, avec la capacité à traiter des données massivement. Nous n'utilisons pas les buzzwords « machine learning » et « intelligence artificielle » mais nous disposons d'algorithmes propriétaires pour calculer en temps réel des conjonctions de collisions possibles et pour détecter et caractériser les comportements inhabituels dans l'espace. Ces besoins relèvent plutôt de la défense.
Nous souhaitons devenir un des leaders mondiaux de la surveillance de l'espace et de la sécurité des activités spatiales en orbite. Le marché n'est pas encore structuré. Nous terminons actuellement notre levée de fonds, qui s'adresse à des fonds français et européens exclusivement, pour des raisons de souveraineté. Le seul acteur aujourd'hui capable de réaliser ces activités est une start-up américaine créée en 2017, qui a déjà levé 82 millions de dollars. Notre levée de fonds est beaucoup plus modeste, mais nous sommes soutenus par l'État français : nous attendons la décision finale de France 2030 pour la subvention du projet. En effet, le ministère des Armées est fortement intéressé par Look Up Space.
Lors de la levée de fonds, nous avons été confrontés à deux difficultés. D'abord, la souveraineté n'est pas un atout du point de vue des fonds d'investissement, contrairement à ce que nous pensions au départ. Au contraire, elle constitue un handicap car elle empêche la revente à des acteurs étrangers. Ensuite, l'existence même d'un marché suscite de fortes inquiétudes, celui-ci restant relativement réduit. Néanmoins, d'année en année, les études rehaussent son montant global à l'horizon 2030 : en deux ans, il est passé de 600 millions à 2 milliards de dollars. Ces chiffres restent cependant faibles : à titre de comparaison, le marché du jeu vidéo en France représente 5 milliards d'euros.
Nous avons la conviction que le marché, néanmoins, se constituera, du fait des besoins très forts qui se font déjà sentir. De nombreux acteurs se soucient peu de ce qui se déroule dans l'espace. Pour le moment, certains acceptent de perdre des plateformes et de les remplacer. Néanmoins, un besoin de régulation se fera sentir, en raison de la pollution de l'espace et des pertes engendrées par les débris.
De plus, plusieurs entreprises américaines souhaitent développer des stations spatiales orbitales privées qui coûteront des dizaines de milliards de dollars. Ces entreprises ne pourront pas se permettre de perdre leurs infrastructures et auront besoin d'acteurs comme Look Up Space pour assurer leur sécurité.
Le marché d'observation de la Terre a suivi la même dynamique. Ce marché n'existait pas : l'observation était faite par des satellites de renseignement gouvernementaux et institutionnels. Petit à petit, des acteurs privés se sont installés. Aujourd'hui, ce marché brasse des sommes considérables et soutient régulièrement les acteurs publics, comme nous l'avons vu récemment en Ukraine.
Des débats sont en cours concernant la structuration du marché. Je reviens de Bruxelles, où j'assistais à une séance de travail entre la Commission européenne et les acteurs industriels de la surveillance de l'espace. Au même moment, un communiqué de la réunion des ministres de l'Espace à Bruxelles affirmait l'importance du space traffic management qui couvre la partie surveillance et régulation. Il présage sans doute l'arrivée de fonds de financement européens pour soutenir l'émergence d'un écosystème privé dont Look Up Space fera partie.
Mme Vanina Paoli-Gagin, rapporteure. - Nous avons déjà perdu la bataille des données personnelles en Europe. Vos propos laissent penser que nous allons perdre celle des données professionnelles. Je m'inquiète que nous en soyons encore au stade de la réflexion, sachant que la basse orbite constitue un espace limité. Les first movers vont occuper le terrain, laissant peu d'espace aux acteurs européens.
Par ailleurs, j'aimerais savoir si des sociétés comme SpaceAble, qui déploient des logiciels de régulation du trafic en basse orbite, et tout l'écosystème New Space français sont suffisamment financés. Ne faudrait-il pas structurer des fonds européens de première importance pour répondre au manque de capitaux empêchant l'émergence d'acteurs français et européens ? Le nouveau marché européen devrait selon moi aider à trouver des financements. Qu'en pensez-vous ?
Général Michel Friedling. - Les orbites basses sont en effet des espaces convoités et contestés. J'avais l'habitude de parler de foncier spectro-orbital. Une course de vitesse est engagée : le premier arrivé sera le premier servi. Je salue l'énergie que le Commissaire Thierry Breton a mise dans le déploiement d'une constellation de connectivité européenne souveraine, qui répond à la fois à des besoins civils, institutionnels et militaires. Une partie peut rentrer dans le programme de communication satellitaire gouvernementale, mais il s'agit aussi d'un instrument de soft power. L'Europe pourra ainsi offrir de l'Internet haut débit à des zones reculées partout dans le monde et concurrencer les États-Unis et la Chine.
Néanmoins, la question est aussi celle des infrastructures numériques. Déployer une constellation ne suffit pas : l'infrastructure numérique doit permettre de stocker les données et de faire des calculs au sein du cloud. Les consortiums en cours de constitution dans le cadre d'Iris2 devraient intégrer les grands acteurs du numérique, et pas seulement des acteurs du spatial et de la télécommunication. Il faut faire émerger des équivalents de Microsoft et de Google.
J'ai un peu abordé cette question lorsque j'ai parlé de l'offre et de la demande : nous avons rencontré des difficultés à convaincre certains fonds d'investissement qu'un nouveau marché se constituera. En Europe, nous pensons que la demande génère l'offre, alors qu'aux États-Unis, l'offre crée la demande. Les Américains prennent donc plus de risques, alors qu'en Europe, les fonds d'investissement refusent de suivre les projets qu'ils jugent trop prospectifs.
J'ai participé, il y a deux ou trois ans, aux débats concernant la nécessité de créer une constellation de connectivité européenne. J'ai défendu ce projet, tandis que ses détracteurs pointaient l'absence de marché, de modèle économique, les coûts, etc. Je ne pense pas que ce soit de bons arguments. L'enjeu de souveraineté et l'enjeu technologique l'emportaient.
Le débat européen concernant le vol habité et l'exploration spatiale suit la même pente. Nous étions très fiers d'avoir ajouté une caméra sur un rover américain, alors qu'une telle action n'inspire pas les citoyens, contrairement au vol habité ou aux stations spatiales. À l'échelle européenne, il n'est pas impensable de promouvoir de tels projets. Il faut convaincre de leur utilité.
Je prends souvent l'exemple des grandes découvertes. Quand le roi Henri du Portugal lance des vaisseaux, il prend un risque. Or, ce risque a fait du Portugal une grande nation pendant deux siècles. Il faut prendre à notre tour un risque, sans toujours savoir objectiver ce que nos actions nous rapporteront. Les pays absents, en tout cas, prendront un retard colossal.
Concernant les fonds d'investissement, j'ai pu constater en recherchant des investisseurs que la Deep Tech, en France, est très compliquée à financer en cas de développement d'infrastructures demandant des investissements lourds. Le développement du réseau de Look Up Space nécessite 100 millions d'euros. Les fonds d'investissement Deep Tech français préfèrent les projets de « SaS », software as service, qui reposent sur une équipe de développeurs, sans investissements lourds ni infrastructure. Beaucoup de fonds d'investissement nous proposaient de revenir lors de la deuxième levée de fonds, une fois les premiers risques amortis.
Par ailleurs, beaucoup de fonds d'investissement sont mal à l'aise avec les idées de défense et de souveraineté.
En outre, nous manquons en Europe de fonds d'investissement ayant des capacités équivalentes aux fonds américains, britanniques ou moyen-orientaux. La recherche de développements rapides et d'investissements puissants nécessite d'aller dans ces pays.
Néanmoins, la volonté politique est très forte et des mécanismes ont été mis en place. Le Commandement de l'espace a été créé en France. La Commission européenne fait preuve d'un fort intérêt pour l'espace et le directeur de l'ESA fait preuve d'ambition. Une dynamique a été créée. Néanmoins, les outils et les courroies de transmission manquent encore, en termes d'organisation de la gouvernance comme en termes de financement.
Ensuite, nous pourrions aller plus loin. France 2030 est un outil formidable. Nous allons bénéficier de 60 % de subvention pour développer nos démonstrateurs. Mais, pour obtenir un euro de subvention, il faut lever un euro de fonds propres. Or, dans d'autres pays, ces conditions de fonds propres n'existent pas, tant que le projet est jugé crédible.
Aux États-Unis, la commande publique, qui ressemble à des subventions déguisées, finance généreusement les projets. Ainsi, en quelques années, des géants peuvent naître. Outre SpaceX, Axiom, Voyager et Sierra Space développent des programmes de stations spatiales financés par le Département de la Défense américain ou par la NASA sans conditions particulières, ce qui leur permet de lever des fonds par la suite. De même, des géants de l'imagerie satellitaire comme Maxar ou Planet ont bénéficié de contrats très importants du Département de la Défense pour l'achat d'imagerie. Ce principe est vertueux car il est réversible et permet aux entreprises de se développer et d'innover, engendrant des retours sur investissement pour le client institutionnel.
Ainsi, lors de la discussion que nous avons eue hier à Bruxelles avec la Commission, nous avons exprimé notre crainte que le service public proposé par l'Europe en matière de surveillance de l'espace soit trop ambitieux. En effet, nous partageons la volonté parfaitement légitime de développer la souveraineté européenne dans ce domaine tout en fournissant une forme de service public d'anticollision. Cependant, la volonté de la Commission d'acheter des données issues des capteurs que nous déploierons à des prix assez modestes pour un service de très haut niveau, non limité aux États membres de l'Union européenne, empêchera de faire émerger un réel écosystème privé. Un tel fonctionnement tuerait les acteurs émergents sur lesquels la Commission compte pourtant.
Il existe en France de nombreux acteurs privés. Certains sont des industriels installés comme Safran ou Ariane, d'autres des acteurs émergents comme SpaceAble, Share My Space ou Look Up Space. Comme dans le domaine du lancement, les acteurs sont trop nombreux : d'une manière ou d'une autre, le marché se consolidera.
Mme Christine Lavarde, rapporteure. - Vous avez évoqué la réunion qui s'est tenue lundi au niveau européen. Outre les acteurs privés, pourriez-vous revenir sur le rôle des acteurs institutionnels et étatiques en matière d'espace. Quelle place la France occupe-t-elle parmi eux ? Sommes-nous en retrait, absents, ou au contraire chefs de file sur certains secteurs spécifiques ?
Général Michel Friedling. - J'ai publié avant-hier une tribune avec Jean-Baptiste Djebbari sur ce sujet, dans laquelle nous poussons la France vers plus d'ambition. Comme disait Churchill, « Visez la Lune, vous finirez dans les étoiles ».
La France est une grande nation spatiale : elle est même la troisième nation spatiale. En 1965, elle maîtrisait l'accès à l'espace avec ses fusées Diamant et Véronique et elle a mis en orbite le satellite Astérix. La France continue d'avoir des atouts considérables. Nous possédons deux des plus grands industriels mondiaux en matière de satellites, de télécommunication et d'observation, à savoir Airbus et Thales Alenia Space. Nous possédons une volonté politique forte, un écosystème, dit New Space, d'acteurs émergents et une agence spatiale qui concentre des compétences techniques extrêmement fortes.
Néanmoins, nous nous sommes un peu endormis sur nos lauriers. Ce constat a été fait dès 2016 dans le rapport de Geneviève Fioraso. Nous devons prendre exemple sur les Américains : la NASA est passée à une logique de « faire faire » en favorisant l'émergence d'acteurs privés aujourd'hui en pointe. Ainsi, SpaceX a prévu pour 2023 et 2024 environ 200 lancements, alors que l'Europe n'en réalise que cinq cette année.
Tout n'est pas perdu. Néanmoins, comme nous l'avons écrit dans notre tribune, nous sommes en situation de disparition gravitaire.
France 2030 prévoit 1,5 milliard d'euros à destination de l'espace, dont 1 milliard pour des acteurs émergents. Cependant, l'organisation de la gouvernance en France pourrait être améliorée. Par ailleurs, la France ne peut pas porter seule des projets de station spatiale, contrairement à des pays comme les Émirats arabes unis. La question est donc celle de l'ambition européenne et de la place qu'y occupe la France. Nous devons résoudre la question de la gouvernance et de l'organisation au niveau européen, c'est-à-dire articuler les agences nationales et les États membres avec la Commission et l'ESA. Si nous parvenons à avancer sur ces sujets-là, l'Europe peut avoir une véritable ambition spatiale et la France jouer un rôle prépondérant dans ce domaine.
Par ailleurs, la France a été précurseur en matière de surveillance de l'espace et reste leader incontesté en Europe. La France joue un rôle central au sein de l'EUSST, consortium constitué vers 2017 fournissant des services d'anticollision, de rentrée à risque, de fragmentation en orbite. C'est elle qui fournit le plus de données grâce au radar GRAVES développé par le ministère des Armées et que le Commandement de l'espace met en oeuvre. De plus, les calculs de conjonction de collision sont effectués par le CNES.
Ce dispositif évolue. Il se structurera pour monter en gamme et fournir de nouveaux services. Il faut cependant que la France reste leader au sein de l'EUSST. Celui-ci constitue le pendant d'une capacité américaine qui existe déjà au travers du catalogue Space Track et des messages de conjonction de collision fournis gratuitement par les Américains. Dans le secteur commercial, ces derniers détiennent le monopole avec des acteurs comme LeoLabs, ExoAnalytics, SpOC, etc. L'enjeu de compétitivité cache donc un enjeu plus profond de souveraineté.
M. René-Paul Savary. - Vous avez comparé l'exploration spatiale aux grandes découvertes. Une comparaison identique peut-elle être faite entre les infrastructures terrestres et spatiales, entre le cuivre et la fibre ? Les câbles sous-marins disparaîtront-ils à terme ? Les pays sont-ils propriétaires de certains d'entre eux ou dépendons-nous essentiellement des GAFAM ?
Général Michel Friedling. - Je ne suis pas spécialiste des câbles sous-marins. J'imagine qu'il existe des câbles gouvernementaux. Néanmoins, alors que les câbles étaient essentiellement déployés par les opérateurs des télécommunications, ces derniers ont été remplacés par les acteurs du numérique, les GAFAM.
De plus, la constellation Starlink d'Elon Musk compte déjà 1,5 million d'abonnés. Starlink voulait répondre à un appel d'offres du Gouvernement américain pour équiper des zones reculées des États-Unis en accès Internet haut débit, mais n'a pas été autorisé à le faire. Suite à une action en justice, Starlink a remporté une partie de l'appel d'offres. Cet exemple pose la question du remplacement des infrastructures terrestres par des infrastructures spatiales.
J'ai moi-même une modeste propriété en Normandie. Des poteaux en bois qui amenaient le téléphone jusqu'aux zones les plus reculées subsistent encore aujourd'hui, mais ne servent plus. Cependant, des relais 5G sont disponibles un peu partout. La 5G sera bientôt disponible par satellite. Ce changement pose d'autres questions, notamment concernant la soutenabilité de ces infrastructures. À titre personnel, je m'équiperai sans doute d'un terminal Starlink afin d'avoir accès à Internet.
Mme Christine Lavarde, rapporteure. - Nous aimerions recueillir votre réaction sur certains propos que nous avons pu entendre au cours des auditions que nous avons menées.
La gouvernance française de l'espace est passée d'une tutelle du ministère de la Recherche à une tutelle du ministère de l'Économie en 2019. De plus, le ministère des Armées s'est vu adjoindre la terminologie « Espace ». Qu'en est-il de la lutte d'influence entre les différents pans de l'action gouvernementale ?
Par ailleurs, les questions de contrôle européen et de respect des réglementations sur les aides d'État, dans un secteur qui est bien plus européen que français, brideraient certaines initiatives. Qu'en est-il selon vous ?
Ensuite, que pensez-vous de la règle non écrite du retour géographique dans les discussions entre États membres pour financer des projets ? Certains États ont mis en place un droit particulier sur l'exploitation des ressources lunaires. Nous avons conscience que le premier arrivé bénéficiera de conditions d'implantation très favorables. Des zones militarisées seront-elles créées sur la Lune pour faire respecter le droit de propriété, alors même qu'il subsiste une incertitude juridique sur le cadre qui entoure l'espace lunaire ?
Mme Vanina Paoli-Gagin, rapporteure. - À un niveau plus philosophique, ces sujets sont conditionnés par l'acceptabilité sociale des nouvelles générations. Sentez-vous émerger des forces de résistance ou le sujet est-il encore si particulier pour le grand public que personne ne s'en soucie pour le moment ? N'allons-nous pas nous fracasser sur des forces qui souhaiteraient laisser ces espaces vierges et ne pas reproduire dans l'espace les comportements qui ont généré le dérèglement climatique sur Terre ?
Général Michel Friedling. - Concernant la gouvernance, je pense que nous pouvons toujours faire mieux, comme le soutient notre tribune publiée avec Jean-Baptiste Djebbari. Notre ambition doit être revue à la hausse. Le ministère de l'Économie est devenu le ministère de l'Espace : ce n'est ni une bonne ni une mauvaise chose.
L'espace peut être abordé sous trois angles : scientifique, militaire et économique. Ce dernier concerne le développement du marché aval, le downstream market : il est parfaitement logique. La logique n'est pas de faire mais de « faire faire » en aidant des acteurs émergents à développer ces secteurs économiques. Ces trois tropismes perdurent, sans se rejoindre totalement. Il est difficile en tout cas d'en faire une synthèse.
Le ministère de l'Économie est aujourd'hui responsable de la « politique Espace de la France ». En réalité, le fonctionnement est plus complexe. Il manque en France un organisme interministériel capable de proposer une politique spatiale nationale articulée avec nos partenaires européens et d'en faciliter la mise en oeuvre dans une perspective de co-construction. Il ne s'agit pas d'organiser, comme disait le Général de Gaulle, un comité Théodule, mais de créer une structure fonctionnelle.
Cette structure pourrait s'appeler le Conseil national de l'espace ou le Secrétariat général pour l'espace. Certains pays comme les États-Unis se sont dotés d'une telle structure dès le début de l'aventure spatiale. Le Conseil national de l'espace américain a toujours été présidé par le Vice-Président des États-Unis. Le film L'Étoffe des Héros montre ainsi Lyndon B. Johnson chapeautant les programmes Gemini et Mercury. Ce Conseil national de l'espace a été mis en sommeil puis ravivé tour à tour par Reagan et par Trump. Il a été maintenu par Biden. Il réunit autour de la table tous les ministères concernés : éducation, transports, défense, industrie, économie et commerce. Il s'appuie sur un groupe d'experts associant les industries et les astronautes et produisant des recommandations. Sa structure permanente, très légère, est pilotée par un Secrétaire général, qui est le bras droit du Vice-Président américain. Il en coordonne les travaux et organise ses réunions.
Depuis sa recréation par Trump, le Conseil national de l'espace a émis six ou sept space policy directives qui traitent de sujets aussi divers que la cybersécurité des systèmes spatiaux, la création de la space force américaine, le retour sur la Lune, l'intégration des partenaires commerciaux, la politique de propulsion nucléaire dans l'espace, etc. Il donne des directives qui doivent ensuite être mises en oeuvre par les acteurs institutionnels et privés.
Nous manquons aujourd'hui d'un organisme de ce type qui serait capable, sous l'autorité du Président de la République ou du Premier ministre, d'avoir un rôle équivalent de stimulation du secteur. En effet, nous sommes très forts pour faire des commissions de régulation, moins pour créer des commissions de libération. La création d'un Conseil national de l'énergie et non d'une Commission de régulation de l'énergie aurait sans doute permis d'éviter certaines difficultés actuelles. Néanmoins, mon propos ne vise pas à jeter la pierre aux différents acteurs qui réalisent un travail formidable.
Je ne suis pas certain d'avoir saisi le sens de la question concernant les réglementations. Certains domaines nécessitent évidemment de la régulation, notamment celui du trafic spatial. Il s'agit moins de faire du contrôle spatial, comme le soulignent les débats entre space trafic management et space trafic coordination, que d'imposer un certain nombre de normes. Aujourd'hui, rien n'oblige un opérateur spatial à souscrire à un service d'informations qui contribuera pourtant à sauver ses satellites, et ainsi à la soutenabilité de l'espace futur. Un travail doit être effectué entre les institutions, les assureurs et les opérateurs spatiaux afin de faire émerger des normes de soutenabilité. Il s'agit d'une des conditions d'émergence du secteur privé de surveillance de l'espace.
Concernant la militarisation de la Lune, le traité de l'espace de 1967 l'interdit en principe. Les accords Artemis définissent plusieurs principes. Ils ont été rejoints par un certain nombre de pays, dont la France, et établissent des règles de cohabitation pacifique comparables à celles qui existent en Antarctique, où les bases scientifiques russes, américaines et européennes cohabitent pacifiquement. La question de la militarisation se posera peut-être le jour où l'exploitation des ressources créera des tensions.
La question de l'acceptabilité est suspendue au manque de connaissance du grand public sur le rôle que joue l'espace dans divers domaines comme l'aide au développement, la vie quotidienne ou la lutte contre le réchauffement climatique. Notre tribune avec Jean-Baptiste Djebbari a suscité un certain nombre de commentaires affirmant, en substance, que nous ferions mieux de nous occuper de ce qui se passe sur Terre. Or, la situation sur Terre dépend de celle de l'espace, beaucoup plus que les gens ne le pensent.
Il faut faire de la pédagogie auprès du grand public. J'essaierai d'y contribuer modestement à travers un livre qui doit paraître en octobre et qui expliquera notamment à quoi sert l'espace.
Même si l'espace fait de nouveau rêver grâce à Thomas Pesquet et à Elon Musk, un manque de compréhension des enjeux demeure, même au niveau parlementaire ou au niveau médiatique. Par exemple, un seul journaliste était présent à la conférence de presse ayant suivi la réunion des ministres de l'Espace à Bruxelles hier. La plupart des gens ignorent que le GPS est donné par des systèmes spatiaux, que la synchronisation des transactions bancaires mondiales est faite par satellite ou encore que des horloges atomiques se trouvent à bord des satellites GPS ou Galileo.
M. Mathieu Darnaud, président. - Merci beaucoup, Général. Nous essaierons de faire oeuvre de pédagogie afin de médiatiser ce sujet passionnant. Votre contribution a éclairé les travaux de cette délégation. Je vous remercie de votre présence.
III. EXAMEN DU RAPPORT (1ER JUIN 2023)
M. Mathieu Darnaud, président. - Merci pour vos explications et pour la qualité de votre travail, sur un sujet original qui porte l'image de notre délégation et du Sénat auprès de nouveaux interlocuteurs. Lors de l'audition de la semaine dernière, le Général Michel Frielding pointait un paradoxe : alors que les solutions à la plupart des problèmes que nous aurons à résoudre demain, ici sur Terre, se trouvent dans l'espace, le sujet est pourtant peu présent dans le débat public. Pourquoi ? Quelles solutions pourrait-on imaginer, par exemple en matière de lutte contre le changement climatique ? Ma deuxième question concerne l'horizon temporel : entre la prise de conscience et les décisions concrètes, le chemin est très long. Voyez-vous de possibles mesures à court terme, y compris dans le domaine législatif, que nous pourrions proposer ?
Mme Christine Lavarde, rapporteur. - Je suis cette année auditrice à l'IHEDN, dans la spécialité « sécurité et défense économique ». Dans toutes nos conférences, dont le fil rouge était la souveraineté, l'espace était présent en filigrane, mais jamais comme un thème en soi. Par exemple, lors d'une conférence sur la criticité des métaux, les intervenants ont évoqué les tensions liées à l'approvisionnement, les solutions envisageables comme la réouverture d'anciennes mines, ainsi que les questions d'acceptabilité sociale, mais jamais il n'a été dit, même sous forme d'ouverture, que ces ressources pouvaient aussi exister ailleurs que sur Terre, dans l'espace.
Certes, l'horizon n'est pas le même : les besoins sur Terre sont à court terme, et les enjeux des ressources spatiales sont à moyen terme. Mais pour la Lune, c'est aussi du court terme, car nous y serons d'ici 2030 - je dis « nous », mais ce sera les États-Unis et la Chine, et vous pouvez ici oublier les Européens. Nous n'avons même pas de lanceur, et notre filière industrielle ne va pas se transformer du jour au lendemain pour se mettre à fonctionner « à l'américaine ». Cela prendra des années.
Une fois que nous serons sur la Lune, il sera plus simple d'aller sur Mars. Quant aux astéroïdes, à défaut de pouvoir les exploiter, nous savons déjà y aller : je vous rappelle le succès de l'ESA avec la mission de Rosetta et Philae.
S'agissant des évolutions juridiques, ce que nous retenons de notre déplacement au Luxembourg, c'est le pragmatisme de leur initiative : le gouvernement cherchait à diversifier l'économie, il avait identifié les ressources spatiales comme un sujet d'avenir, et personne d'autre en Europe ne s'était encore positionné sur le sujet. C'est ce qui a conduit à la loi adoptée en 2017, qui dispose que les ressources spatiales sont susceptibles d'appropriation par toute entreprise engagée dans une activité d'exploitation commerciale. À ce jour, le Luxembourg n'a été suivi par aucun autre pays européen, mais d'autres pays dans le monde, comme le Japon et les Émirats arabes unis, ont adopté des lois similaires.
Pour l'instant, la France se contente d'en appeler à un traité international, mais nous pensons que nous n'avons plus le temps d'attendre, car l'espace est un enjeu géostratégique vital, pour nos télécommunications, pour notre sécurité. Il ne faut pas passer à côté des évolutions actuelles.
Mme Vanina Paoli-Gagin, rapporteur. - Le paradoxe que vous évoquez, c'est-à-dire le relatif désintérêt que l'espace suscite dans le débat public, me semble aussi pouvoir s'expliquer par la chute drastique de la culture générale scientifique dans la population. Nous avons les yeux rivés sur nos téléphones mais nous ne réalisons pas à quel point toutes les technologies dont nous bénéficions sur ces appareils dépendent de l'espace. Pour améliorer la culture scientifique, il y a des mesures à prendre dès l'école.
Une autre explication à ce paradoxe, c'est notre incapacité à comprendre et à agir vite. Le Luxembourg est un petit pays, mais il a tout de suite compris que c'est dans l'espace que se trouvaient les actifs valorisables de demain. Ce n'est pas un hasard si les acteurs qui bouleversent aujourd'hui le secteur spatial, comme SpaceX ou Blue Origin, ont été créés par des entrepreneurs du numérique : ils comprennent bien toute la valeur du big data, tout ce qu'on pourra faire demain grâce aux données - je pense par exemple à l'agriculture ou à la viticulture. Ils pratiquent aussi le test and learn, ils acceptent l'échec, ils apprennent et ils avancent. Nous en sommes incapables. Résultat : cette année, SpaceX fera décoller 100 fusées, et nous ne sommes mêmes pas sûrs qu'Ariane 6 puisse effectuer un seul vol.
Sur la question des évolutions juridiques, je suis sûr que si nous parvenons à faire du sujet un « objet politique », nous trouverons sans peine un véhicule législatif.
Mme Christine Lavarde, rapporteur. - Sur ce sujet, une révision de la loi de 2008 sur les opérations spatiales est en préparation. Le Gouvernement a ses propres priorités, et les ressources spatiales n'en font pas partie. Ceci dit, si le Parlement se saisissait du sujet, le Gouvernement pourrait tout à fait se montrer ouvert. Cela pourrait par exemple prendre la forme d'une proposition de loi.
M. Mathieu Darnaud, président. - Se pose aussi la question de l'harmonisation juridique. Mais une chose est sûre : si on ne fabrique pas le droit ici, on devra se conformer au droit fabriqué par ceux qui auront pris l'initiative.
Mme Vanina Paoli-Gagin, rapporteur. - Il en va du cadre légal comme des normes techniques et de tout le reste : les premiers arrivés fixeront les règles du jeu.
M. René-Paul Savary. - Tout cela me semble relever, au final, d'une absence de vision. Je suis membre d'une mission d'information sur les biocarburants : les échéances sont comparables, pas avant 2050 nous dit-on, les sujets se rejoignent - produire de l'électricité avec de l'eau, de l'hydrogène, de la biomasse, etc. N'y aurait-il pas un lien à faire ? Transformer les ressources de la Terre nous coûtera très cher : ne pourrait-on pas aller en trouver ailleurs ?
Mme Vanina Paoli-Gagin, rapporteur. - Vous avez raison sur le principe, mais ensuite se pose la question de la rentabilité économique et de la faisabilité technique : en l'état actuel des technologies, rapatrier sur Terre des ressources spatiales en grandes quantités aurait un coût astronomique - sans mauvais jeu de mots - et donc rédhibitoire. En revanche, sur d'autres sujets, l'horizon est beaucoup plus court. C'est notamment le cas de la production en microgravité : le rapport évoque par exemple du vin produit à partir de plants de vigne qui avaient été envoyés à bord de l'ISS pour augmenter leur résistance. Beaucoup de choses peuvent se faire dans ce domaine, en médecine, production de matériaux, etc.
Mme Christine Lavarde, rapporteur. - La comparaison avec l'horizon temporel de la transition énergétique est également pertinente car, en effet, les technologies sont parfois les mêmes. À plus long terme encore, il y a la possibilité d'utiliser l'hélium-3 lunaire pour la fusion nucléaire sur Terre, mais cela reste extrêmement hypothétique. Une chose est sûre : pour les lancements, il faut renoncer à l'idée de la propulsion électrique, qui ne fournira jamais assez de puissance. On retrouve d'ailleurs le même problème pour le transport routier sur Terre : les constructeurs ont bien compris que pour les plus gros véhicules, la solution n'était pas dans l'électricité, mais plutôt dans le GPL ou l'hydrogène.
Les pieds de vigne envoyés pendant plus d'un an à bord de l'ISS ont développé naturellement une plus grande résistance à de nombreux facteurs, y compris des maladies. Pourquoi ? Parce qu'avec la microgravité, ils ont été soumis à un stress encore plus important, et se sont adaptés. La microgravité permet aussi de fabriquer des médicaments, de mener des expériences impossibles sur Terre, etc.
M. François Bonneau. - Merci pour ce rapport qui nous permet de prendre de la hauteur et de prendre la mesure d'un nouveau potentiel. Cependant, on agrège ici beaucoup de choses techniquement faisables, mais à quelles conditions et dans quel délai ? Il y a certes des ressources sur la Lune et sur Mars, mais les conditions y sont très hostiles pour un équipage.
M. Bernard Fialaire. - Dans cette nouvelle conquête de l'Ouest, le problème qui va bientôt se poser est celui de la patrimonialité : les premiers arrivés vont-ils s'approprier les ressources ? Ne pourrait-on pas promouvoir une approche différente, fondée sur l'idée d'un patrimoine commun ? Nous pourrions ici trouver des alliés parmi les pays émergents, notamment en Afrique. Il faut faire de la diplomatie.
M. Daniel Gueret. - Le problème fondamental, c'est celui de la volonté politique. Le sommet de l'espace de novembre 2023 serait pour l'Europe l'occasion d'affirmer au moins une direction, de lancer un signal. Au niveau national, je comprends de vos propos qu'il ne faut pas attendre d'initiative de la part du Gouvernement. Va-t-on attendre que le droit nous soit imposé par d'autres, comme la Chine ?
Mme Cécile Cukierman. - Bravo pour la synthèse de votre rapport qui permet de se plonger avec attention dans un sujet qui, sinon, pourrait ne pas être simple. S'agissant des coûts d'accès à l'espace, quel est le blocage aujourd'hui ? Est-ce le prix du carburant, qu'on pourrait alors fabriquer dans l'espace pour faire des économies ? Est-ce le manque de volonté politique en France et en Europe, qui a abouti à ce que nous soyons aujourd'hui privés d'un lanceur ? Et est-ce qu'il n'est pas trop tard ?
Mme Vanina Paoli-Gagin, rapporteur. - S'agissant de la diplomatie internationale, nous pourrions en effet trouver des alliés parmi les pays émergents, en Afrique, en Amérique du Sud et ailleurs. Mais avancer dans le cadre des Nations Unies sera difficile, dès lors que d'autres grandes puissances spatiales ont décidé de faire cavalier seul.
Ce sera d'autant plus difficile que nous ne sommes même pas capables de nous mettre d'accord au niveau européen. En faisant ce rapport, j'ai pris la mesure du blocage franco-allemand au sujet des lanceurs, et cela m'effraie énormément, car tout le reste en dépend. Nous avons tellement peur que nos acteurs historiques s'écroulent que nous en sommes paralysés. De fait, ceux-ci sont très dépendants des programmes publics, et le contraste est frappant avec les nouveaux acteurs américains : l'agilité, la rapidité, la jeunesse de leurs ingénieurs, le droit du travail aussi. C'est l'histoire de la révolution numérique qui se répète.
Alors, comment fait-on pour revenir dans la course ? Combien cela coûtera-t-il ? Eh bien cela coûtera cher, et le retour sur investissement est purement hypothétique. Mais cela correspond à un modèle - celui des pays qui ont confiance en eux, comme la Chine et les États-Unis. Il faut y aller, il faut tester, il faut avancer - et à un moment, le retour sur investissement est là, et entre-temps, vous aurez réussi à abaisser les coûts. C'est une sorte de prophétie auto-réalisatrice. Mais en Europe, nos sociétés historiques, souvent issues d'entreprises publiques, ne sont pas adaptées à cette manière de penser.
Mme Christine Lavarde, rapporteur. - Une petite lueur d'espoir, tout de même : on nous dit souvent que l'espace coûte cher, mais en réalité, les sommes en jeu ne sont pas si importantes. Aujourd'hui, le budget de l'exploration spatiale en Europe, c'est un milliard d'euros par an, à comparer avec les 40 milliards d'euros de R&D de l'industrie pharmaceutique, et les 60 milliards d'euros de la R&D de l'industrie automobile. Les États-Unis, eux, dépensent 14 milliards d'euros par an pour l'exploration spatiale.
Si nous ne dépensions ne serait-ce qu'un milliard d'euros supplémentaire chaque années, nous pourrions doubler notre budget en matière d'exploration spatiale. Et avec le peu que nous dépensons aujourd'hui pour notre politique spatiale, nous sommes déjà capables de faire énormément de choses, par exemple en matière d'observation de la Terre : c'est très encourageant.
Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un sursaut : il faut décider de faire de ce sujet un enjeu de compétitivité, y mettre un tout petit peu de moyens, y aller vraiment. Nous avons tout le reste, et notamment des talents, à qui il manque seulement un environnement qui leur permette d'oser.
M. Mathieu Darnaud, président. - Vous avez su faire preuve de pédagogie sur un sujet dont tout le monde conviendra qu'il est à la fois technique et complexe. Nous serons très attentifs aux suites qui pourront être données à votre rapport, notamment sur le plan législatif.
Le rapport est adopté à l'unanimité.
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
I. AUDITIONS PUBLIQUES
- Clarisse Angelier, déléguée générale de l'Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT)
- Alban Guyomarc'h, doctorant en droit, coordinateur du groupe « Objectif Lune » de l'ANRT
- Isabelle Sourbès-Verger, géographe, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
- Pascale Ultré-Guérard, directrice adjointe des programmes du Centre national d'études spatiales (CNES)
- Michel Friedling, général de division aérienne (R), ancien commandant de l'Espace, cofondateur de Look Up Space
II. AUDITIONS PAR LES RAPPORTEURS
- Philippe Achilleas, professeur de droit public à l'Université Paris-Saclay, directeur de l'Institut du droit de l'espace et des télécommunications (IDEST)
- François Alter, directeur adjoint à la stratégie, Centre national d'études spatiales (CNES)
- Berylia Bancquart, Strategy Analyst Officer, Agence spatiale européenne (ESA)
- Bertrand Baratte, Directeur Marché spatial Global, Air Liquide
- Jérôme Barbier, responsable des questions spatiales, numériques et économiques, Forum de Paris pour la Paix
- Charles Beigbeder, cofondateur, Expansion Ventures
- Betty Blom, Strategy Analyst Officer, ESA
- Alain de Boisséson, délégué aux affaires juridiques, CNES
- Pierre Cavelan, responsable Affaires publiques France, Air Liquide
- Jean-Jacques Dordain, ancien directeur général de l'ESA
- Colin Ducrotoy, directeur de projets Espace, sous-direction du spatial, de l'électronique et du logiciel, direction générale des entreprises (DGE)
- Cécile Gaubert, avocate au barreau de Paris, spécialiste du droit des activités spatiales
- Nicolas Gaume, PDG, Space Cargo Unlimited
- Stéphane Gemble, PDG, Anyfields
- Alban Guyomarc'h, doctorant en droit, coordinateur du groupe « Objectif Lune » de à l'Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT)
- Pierre Henriquet (@astropierre), médiateur scientifique, conférencier, chargé de projets
- Pierre-Alexis Joumel, directeur affaires internationales et nouvelles activités, Airbus Defence & Space - Space Systems
- Rémy Lambertin, directeur relations institutionnelles France, Airbus Defence & Space - Space Systems
- Antoine Latif, responsable affaires publiques, innovation et R&D, Air Liquide
- Pascal Legai, conseiller Sécurité du directeur général de l'ESA, expert à l'Institut français des relations internationales (Ifri)
- Mathieu Luinaud, consultant en stratégie, PwC
- Éric-André Martin, responsable de l'Initiative sur la gouvernance spatiale européenne de l'Ifri
- Cédric O, ancien secrétaire d'Etat chargé du numérique, membre du Groupe d'experts de haut-niveau (HLAG) sur le futur de l'exploration spatiale pour l'Europe
- Paul-Hector Olivier, PDG, Orius
- Alexis Paillet, chef du projet Spaceship FR, CNES
- Xavier Pasco, directeur, Fondation pour la recherche stratégique (FRS)
- Maria Roa Vicens, chargée de mission Espace, Forum de Paris pour la Paix
- Quentin Robert, associé, Expansion Ventures
- Delphine Roma, Vice-Présidente Fusion, Aéronautique et Spatial, Air Liquide
- Arthur Sauzay, avocat au barreau de Paris, expert des questions spatiales à l'Institut Montaigne
- Carole Vachet, sous-directrice du spatial, de l'électronique et du logiciel, direction générale des entreprises (DGE)
- Elodie Viau, ancienne directrice des télécommunications et des applications intégrées de l'ESA, responsable du projet Moonlight
- Florian Vidal, chercheur associé au centre Russie/NEI de l'Ifri
- Peter Weiss, PDG, Spartan Space
III. DÉPLACEMENT AU LUXEMBOURG
Luxembourg Space Agency (LSA)
- Marc Serres, CEO
- Bob Lamboray, policy officer
European Space Resources Innovation Centre (ESRIC)
- Kathryn Hadler, director
- Lari Cujko, startup program lead
Entreprises
- Fabrice Testa, co-founder & CFO, Maana Electric
- Julien Lamamy, CEO, ispace Europe
* 1 Cette remarque générale vaut particulièrement pour les livres et les films grand public. Il existe en réalité de nombreuses oeuvres de science-fiction et d'anticipation fondées sur une vision optimiste de l'exploitation des ressources, qu'on peut alors rapprocher des travaux de prospective évoqués ensuite - du reste, il s'agit souvent de romans relevant de la « hard science », un sous-genre de la science-fiction à forte plausibilité technique et scientifique, ou dont les auteurs sont eux-mêmes chercheurs ou ingénieurs. L'oeuvre de Gerard K. O'Neill en est un bon exemple.
* 2 Lancé en 1998, le NIAC sélectionne chaque année une dizaine de projets portant sur des concepts révolutionnaires ou des technologies disruptives en matière d'exploration spatiale ou d'aéronautique. Si certains projets célèbres, comme l'ascenseur spatial, la voile solaire ou la propulsion par laser, sont encore loin d'offrir des perspectives concrètes, d'autres ont d'ores et déjà trouvé des applications dans les missions actuelles.
* 3 C'est aussi ce qui fait leur grand intérêt scientifique.
* 4 Mais aussi plus dangereux, quoique le risque de collision avec la Terre soit extrêmement limité. Ces objets sont en tout cas surveillés et leur trajectoire est connue très longtemps à l'avance.
* 5 Ainsi qu'une centaine de comètes, ce qui justifie le terme plus général de « Near-Earth Object ».
* 6 Au cours de l'époque. Ces estimations ne sont naturellement pas à prendre au pied de la lettre.
* 7 Découvert en 1852 et mesurant près de 200 km de diamètre, l'astéroïde (16) Psyché est l'un des astéroïdes les plus massifs de la ceinture principale du Système solaire. Les hypothèses concernant son origine et sa composition ont beaucoup varié, l'étude la plus récente estimant que le métal représente entre 30 % et 60 % de sa masse totale. Source : L. T. Elkins-Tanton, E. Asphaug, J. F. Bell III, H. Bercovici et B. Bills, « Observations, Meteorites, and Models: A Preflight Assessment of the Composition and Formation of (16) Psyche », JGR Planets, vol. 125, no 3,ý mars 2020, article no e2019JE006296 (DOI 10.1029/2019JE006296).
* 8 Auxquels devraient s'ajouter les 60 grammes collectés par OSIRIS-Rex.
* 9 Planetary Resources n'a jamais obtenu les 50 millions de dollars initialement promis par les investisseurs, et réorienté ses activités après son rachat en 2018 par une entreprise spécialiste de la blockchain. Deep Space Industries a été rachetée en 2019 par une entreprise spécialisée dans les systèmes de vol orbital.
* 10 On estime sa concentration dans l'atmosphère terrestre à 1,38 partie par millions (ppm). Il est davantage présent dans le manteau terrestre, à une concentration estimée entre 200 et 300 ppm.
* 11 Pour un baril à 100 dollars.
* 12 Plus précisément, la concentration du régolithe en hélium-3 est estimée à 0,0042 parties par millions (ou 0,007 g par m3), soit beaucoup moins que l'isotope hélium-4 (14 ppm, ou 23 g par m3) ou que les principaux volatiles déposés par les vents solaires. Source : ISRU Gap Report (cf. infra).
* 13 ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) est un projet de réacteur de recherche civil à fusion nucléaire situé à Cadarache (France). Lancé en 2007, il associe 35 pays, dont les États-Unis, la Russie et la Chine. La production du premier plasma n'est pas attendue avant 2030. D'autres projets, fondés sur des technologies différentes, sont également en cours.
* 14 Et dans une moindre mesure le lithium, l'or, l'argent ou encore les terres rares.
* 15 S'il semble aujourd'hui peu probable que la NASA et ses partenaires puissent se tenir à l'échéance de 2025, un décalage d'un an ou deux n'aurait que peu d'importance au regard de l'ampleur du défi.
* 16 Le budget 2021-2025 de la NASA spécifiquement dédié à la phase I du programme Artemis est de 28 milliards de dollars (dont 16 milliards de dollars consacrés au seul HLS), auxquels s'ajoutent les développements liés aux phases suivantes (25 milliards de dollars). Source : rapport de l'Inspector General de la NASA du 15 novembre 2021 : https://oig.nasa.gov/docs/IG-22-003.pdf
* 17 Le premier vol d'essai du Starship, dont le Starship HLS sera une variante, a eu lieu le 20 avril 2023 et s'est terminé par l'explosion de la fusée peu après le décollage. Composé de deux éléments, le premier étage Super Heavy et l'étage Starship lui-même, il s'agit du plus grand vaisseau spatial jamais conçu pour le vol habité. Le contrat attribué à SpaceX par la NASA en 2021 est d'un montant de 2,9 milliards de dollars.
* 18 Afin de ne pas dépendre du seul atterrisseur fourni par SpaceX, la NASA a été contrainte de sélectionner un deuxième projet. Il s'agira de Blue Moon, développé par la National Team, un consortium rassemblant la société de Jeff Bezos Blue Origin (qui avait formé un recours contre la décision de 2021), Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic et Honeybee Robotics. Peu de détails sont connus à ce jour sur Blue Moon, si ce n'est qu'il devrait reposer sur des technologies différentes du Starship. Le contrat, d'un montant de 3,4 milliards de dollars, prévoit pour l'instant un vol d'essai à vide et une mission habitée (Artemis V).
* 19 Première sonde d'exploration lunaire de l'agence spatiale indienne (ISRO), Chandrayaan-1 a été lancée en 2008. Les poussières émises par le crash intentionnel de son impacteur dans le cratère de Shackleton, au pôle Sud, ont permis au spectromètre Moon-Mineral Mapper (M3) de la NASA de détecter la présence d'eau ou d'hydroxyle.
* 20 Lancé par la NASA en 2009 juste après la découverte de la mission Chandrayaan-1, le satellite LCROSS (Lunar CRater Observation and Sensing Satellite) a permis une première observation directe, via l'analyse des poussières projetées par le crash intentionnel d'un étage de son lanceur dans le cratère Cabeus, situé à proximité du pôle Sud. D'après les premières estimations (Colaprete, 2010), ces poussières seraient composées à environ 5,5 % d'eau (en masse), des études ultérieures allant jusqu'à suggérer une proportion de 30 % (Li, 2018).
* 21 Lancé en même temps que LCROSS, Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) est un satellite d'observation de la NASA spécifiquement dédié à la cartographie du pôle Sud en préparation des prochaines missions d'exploration.
* 22 Les spectromètres de ces missions n'étant pas en mesure de distinguer la signature de l'eau (H2O) de celle de l'hydroxyle (HO), une molécule proche.
* 23 Le télescope SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) est embarqué à bord d'un Boeing 747 modifié qui vole de nuit jusqu'à 45 000 pieds, ce qui lui permet d'échapper aux composés de l'atmosphère qui bloquent le rayonnement infrarouge.
* 24 L'axe de rotation de la Lune n'est pas perpendiculaire à son plan orbital et l'équateur lunaire est incliné de 1,543° sur l'écliptique.
* 25 Du fait de l'absence d'atmosphère, les radiations solaires séparent la molécule d'eau H2O en hydrogène (H) et oxygène (O), ces éléments plus légers s'échappant ensuite dans l'espace.
* 26 Les mers lunaires recouvrent environ 16 % de la surface de la Lune et se trouvent principalement sur la face visible depuis la Terre. Leur régolithe est principalement d'origine basaltique et composé de roches (plagioclase/feldspath, pyroxène, olivine) et de métaux, dont l'ilménite, un oxyde de fer et de titane qui a l'avantage de pouvoir être réduit par des procédés relativement simples. On estime que l'ilménite représente 15 % du régolithe des mers lunaires.
* 27 Le régolithe des hauts plateaux est également d'origine magmatique, mais relativement moins riche en pyroxène, olivine et métaux.
* 28 https://www.airbus.com/en/newsroom/press-releases/2020-10-roxy-turns-moon-dust-into-oxygen
* 29 https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1410/1410.6865.pdf
* 30 Petits amas de minéraux, de verre et de roche agrégés par le verre résultant des impacts de micrométéorites.
* 31 La durée de la mission dépend du choix de la trajectoire retenue, l'objectif principal étant de minimiser les dépenses de carburant en jouant sur la distance relative entre la Terre et Mars, qui varie considérablement (de 56 à 400 millions de kilomètres). Le « scénario de conjonction », privilégié par les agences spatiales, correspond à une durée totale de 910 jours, dont 550 jours sur place et 180 jours pour chaque vol (aller et retour). Le « scénario d'opposition » a l'avantage de réduire la durée totale de la mission (640 jours, soit 20 mois), mais au prix d'un séjour sur place très réduit (30 jours) et d'un trajet retour dans des conditions très défavorables (430 jours), malgré l'assistance gravitationnelle de Vénus.
* 32 Les télécommunications sont discontinues et le temps d'acheminement varie de 3 à 20 minutes.
* 33 Voir à ce sujet : Jennifer L. Heldmann, et al., “Mission Architecture Using the SpaceX Starship Vehicle to Enable a Sustained Human Presence on Mars”, New Space, 2022 : https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/space.2020.0058
* 34 Voir le blog de Pierre Brisson : https://blogs.letemps.ch/pierre-brisson/2023/02/11/si-le-starship-de-spacex-peut-voler-mars-sera-a-notre-portee/ et https://blogs.letemps.ch/pierre-brisson/2017/12/19/lisru-clef-de-lexploration-de-mars-par-vols-habites/
* 35 Carbone, hydrogène et oxygène sont notamment présents dans les dépôts de glace l'eau (H2O) et de dioxyde de carbone (CO2).
* 36 Pas forcément dans des proportions correspondant à leurs besoins, mais il est relativement facile
* 37 Sources : G. W. Wieger Wamelink, Joep Y. Frissel, Wilfred H. J. Krijnen et M. Rinie Verwoert, « Can Plants Grow on Mars and the Moon: A Growth Experiment on Mars and Moon Soil Simulants », PLOS ONE,ý 2014, ainsi que deux expériences menées par la NASA, en milieu contrôlé ( https://www.nasa.gov/feature/can-plants-grow-with-mars-soil) et à bord de l'ISS ( https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/meals_ready_to_eat).
* 38 La température à la surface de Mars étant très froide (-68 °C en moyenne), un système de chauffage complémentaire sera indispensable. Les pommes de terre, par exemple, se développent à partir de 7 °C, mais la température idéale est de 15 °C à 20 °C.
* 39 De l'eau sous forme de gaz a également été détectée, en faibles quantités, dans l'atmosphère.
* 40 Mars possède deux calottes polaires, qui connaissent d'importantes variations saisonnières. Toutefois, au pôle Sud, la calotte de glace d'eau reste en permanence recouverte d'une couche de glace de dioxyde de carbone.
* 41 Il contient à lui seul 10 % de l'eau douce de surface de la Terre.
* 42 La planète a peut-être abrité un océan couvrant les trois quarts de sa surface il y a quelque 3,8 milliards d'années, et des formations géologiques caractéristiques (vallées, deltas, lits de rivière et anciens lacs, etc.), comme celles détectées par Curiosity dans le cratère Gale, suggèrent que l'eau a pu exister à l'état liquide dans une période plus récente.
* 43 En y ajoutant de l'azote, également présent dans l'atmosphère martienne (2 %), afin de le stabiliser et d'éviter le risque d'hypoxie, dommageable à long terme pour les organismes vivants.
* 44 Utilisé par exemple par Ariane 5 (moteur Vulcain 2) et Ariane 6 (moteur Vinci). Ce mélange demeure le plus pertinent dans le cadre de l'ISRU lunaire.
* 45 Utilisé par exemple par le Falcon 9 (moteur Merlin) et le lanceur super-lourd Saturn V (F-1).
* 46 La production d'oxygène à bord de l'ISS se fait en apportant de l'hydrogène, issu de l'électrolyse de l'eau, au CO2 rejeté par les astronautes.
* 47 Le projet Kilopower développé par la NASA dans le cadre de l'ISRU lunaire pourrait convenir.
* 48 Le plan proposé par Robert Zubrin comprend aussi l'envoi en amont du module d'habitation, par une deuxième mission robotique.
* 49 La proposition de Mars Direct sert de base au film Mission to Mars de Brian de Palma (2000).
* 50 On désigne par espace cislunaire l'espace sphérique se trouvant autour de la Terre jusqu'à la limite de l'orbite de la Lune.
* 51 Source : ISRU Gap Assessment Report, 2021.
* 52 Soit le rapport entre la charge utile et la charge correspondant au carburant et aux réservoirs et étages de la fusée.
* 53 https://spacenews.com/orbit-fab-announces-in-space-hydrazine-refueling-service/
* 54 https://astroscale.com/astroscale-u-s-and-orbit-fab-sign-first-on-orbit-satellite-fuel-sale-agreement/
* 55 Fondé en 2007 par 14 agences spatiales nationales, l'ISECG permet à celles-ci d'échanger et de coopérer dans l'élaboration de leurs programmes d'exploration spatiale, de façon volontaire et sur les aspects consensuels. L'ISECG a son siège à Montréal et regroupe aujourd'hui 27 agences, dont la NASA, l'ESA, le CNES, mais aussi la CNSA (Chine) ou encore Roscosmos (Russie).
* 56 Soit « Rapport d'évaluation de l'écart technologique en matière d'ISRU ». Lien vers le rapport : https://www.globalspaceexploration.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/ISECG-ISRU-Technology-Gap-Assessment-Report-Apr-2021.pdf.
* 57 Les ressources du milieu interstellaire, que constituent par exemple la lumière (pour l'alimentation en énergie), les particules de vent solaire (pour la propulsion à voile solaire) ou encore la gravité elle-même (pour les manoeuvre d'assistance gravitationnelle) ne sont donc pas abordées ici. Les corps célestes situés hors du Système solaire (exoplanètes, etc.), inaccessibles, sont également exclus.
* 58 Sans compter, par définition, les planètes gazeuses comme Saturne et Jupiter.
* 59 Par exemple s'agissant des technologies de purification de l'air ou de recyclage des déchets organiques en milieu confiné, notamment dans les sous-marins.
* 60 D'autres typologies, plus complexes, sont proposées par l'ISRU Gap Assessment Report.
* 61 Le mélange d'oxygène et d'hydrogène est explosif, par exemple.
* 62 Il n'existe cependant à ce jour aucune étude permettant de déterminer précisément l'épaisseur de la couche de régolithe nécessaire à une protection suffisante, ni même les limites de radiations admissibles dans le cadre d'un séjour prolongé.
* 63 La cuisson de la poterie, par exemple, se fait par frittage.
*
64
https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2023
/Biomineralization_Enabled_Self_Growing_Building_Blocks/
* 65 Voir par exemple : https://www.domofinance.com/actualites/materiaux/materiaux-ecologiques-une-brique-en-champignon-et-un-parpaing-en-bois
* 66 Source : https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926580519312841?via%3Dihub
* 67 Ces coûts et risques correspondent à l'envoi depuis la Terre d'un grand nombre de rovers, à leur opération en continu et à leur maintenance dans des conditions difficiles, d'autant que la distance moyenne entre les sites envisagés pour l'extraction et l'électrolyse du régolithe d'une part, et de stockage et d'habitation d'autre part, est évaluée à 110 km en moyenne. Source : https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2023/Lunar_South_Pole_Oxygen_Pipeline/
* 68 Lors du même processus d'électrolyse du régolithe permettant de produire de l'oxygène.
* 69 C'est le principal problème rencontré par les rovers présents sur place.
* 70 Littéralement « palais céleste ». La Chine est en revanche exclue de l'ISS.
* 71 ICI https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/julienne_china_ambitions_space_2021.pdf
* 72 Du nom de la déesse chinoise de la Lune.
* 73 Annonce faite le 3 mai 2023 par Wu Weiren, concepteur du programme Chang'e.
* 74 https://www.globaltimes.cn/page/202304/1289758.shtml. Les dates sont celles annoncées par Wu Weiren le 28 avril 2023 :
* 75 Littéralement « Questions aux Cieux ».
* 76 Le satellite a été détruit par un tir de missile. Les milliers de débris produits par l'explosion (dont 1 500 objets de plus de 10 cm) se sont retrouvés sur la trajectoire de l'ISS, contraignant les sept occupants à s'enfermer dans les modules d'évacuation d'urgence pendant plusieurs heures.
*
77
https://www.esa.int/Newsroom/Press_Releases/Redirecting_ESA_programmes_in_response_to_geo
political_crisis
* 78 L'Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO) est une organisation internationale dont le siège est situé à Pékin. Ses membres sont notamment la Chine, le Bangladesh, l'Iran, la Mongolie, le Pakistan, le Pérou, la Thaïlande, l'Indonésie ou encore la Turquie.
* 79 https://www.globaltimes.cn/page/202304/1289758.shtml
* 80 On estime qu'il faudrait moins d'une dizaine d'années au sol lunaire pour retrouver son état « normal » à l'endroit d'une explosion nucléaire de puissance comparable à celle d'Hiroshima.
* 81 Connu sous le nom de « Project A119 », ce projet de l'US Air Force n'a été révélé que 45 ans plus tard, notamment par une indiscrétion de l'astronome Carl Sagan, père de l'exobiologie et acteur majeur de plusieurs programmes de la NASA (Pioneer, Voyager, etc.), qui faisait partie de l'équipe scientifique. En effet, le projet n'était pas totalement dénué d'intérêt scientifique : l'observation spectrométrique des poussières soulevées par l'explosion aurait pu révéler des informations cruciales sur la composition de la surface lunaire et l'histoire de sa formation. Les missions Chandrayaan-1 (2008) et LCROSS (2009), qui ont permis d'établir la présence d'eau sur la Lune en y précipitant volontairement un impacteur, reposent exactement sur le même principe.
* 82 Techniquement, un lanceur spatial est un missile (qui transporte des astronautes).
* 83 La région Île-de-France a une superficie de 12 000 km². Par ailleurs, on estime que la superficie cumulée de l'ensemble des 324 régions ombragées en permanence de la Lune représente environ 31 000 km², soit l'équivalent de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).
* 84 Source : https://exploration.esa.int/web/moon/-/59102-about-prospect
* 85 Aucun traité international ne définit la limite entre l'atmosphère et l'espace. En pratique, on retient généralement la « ligne de Kármán », située à 100 km au-dessus de la surface de la Terre, soit pour simplifier à l'altitude approximative à partir de laquelle la densité de l'air devient si faible que, pour conserver sa portance, un avion devrait voler à une vitesse qui correspond à la vitesse orbitale d'un satellite (qui ne dépend pas de la portance mais de la pesanteur et de la force centrifuge). Cette limite de 100 km est celle retenue par la Fédération aéronautique internationale (FAI), mais elle est contestée par les États-Unis (qui lui préfèrent celle de 80 km).
* 86 La doctrine ajoute parfois d'autres principes : principe de conformité au droit international, principe d'assistance mutuelle, principe de responsabilité internationale, principe de juridiction sur les objets spatiaux, principe de non-interférence, de non-dégradation et de non-contamination, etc.
* 87 Voir notamment les travaux de Philippe Achilleas, professeur de droit public à l'Université Paris-Saclay et directeur de l'Institut du droit de l'espace et des télécommunications (IDEST).
* 88 Dépourvues de force obligatoire, celles-ci n'en constituent pas moins d'importantes références normatives. C'est par exemple la résolution XVIII du 13 décembre 1963 qui a posé les principes qui, plus tard, allaient inspirer le Traité de l'espace.
* 89 Pour un prix modique, le lecteur intéressé pourra ainsi devenir l'heureux propriétaire d'un terrain sur la Lune, sur Mars, sur Mercure ou sur Vénus (au choix !), en commandant directement son titre de propriété sur le site https://lunarembassy.com/. Dennis Hope, par ailleurs président du Galactic Government depuis 2004, délivre également des passeports extraterrestres.
* 90 Voir notamment à ce sujet : Isabelle Sourbès-Verger, « Conquérir du foncier dans l'espace », Constructif 2020/3 : https://www.cairn.info/revue-constructif-2020-3-page-52.htm#re3no3
* 91 Article 11, alinéa 1.
* 92 Article 11, alinéa 3. Le texte se poursuit ainsi : « L'installation à la surface ou sous la surface de la Lune de personnel ou de véhicules, matériel, stations, installations ou équipements spatiaux, y compris d'ouvrages reliés à sa surface ou à son sous-sol, ne crée pas de droits de propriété sur la surface ou le sous-sol de la Lune ou sur une partie quelconque de celle-ci ». L'article 6 prévoit toutefois une exception pour le prélèvement d'échantillons, de minéraux et d'autres substances ainsi que leur utilisation « en quantités raisonnables » dans le cadre de recherches scientifiques.
* 93 Comme le montre le préambule de l'Accord : « Reconnaissant que la Lune (...) joue un rôle important dans l'exploration de l'espace, (...) Fermement résolus à favoriser dans des conditions d'égalité le développement continu de la coopération entre États aux fins de l'exploration et de l'utilisation de la Lune et des autres corps célestes, (...) Tenant compte des avantages qui peuvent être retirés de l'exploitation des ressources naturelles de la Lune et des autres corps célestes (...) ».
* 94 Article 11, alinéa 7. Il est précisé : « une attention spéciale étant accordée aux intérêts et aux besoins des pays en développement, ainsi qu'aux efforts des pays qui ont contribué, soit directement, soit indirectement, à l'exploration de la Lune ».
* 95 Un mille marin ou nautique est égal à 1 852 mètres. Dans la Convention de Montego Bay, la côte correspond à la notion de « ligne de base ».
* 96 Longtemps ignorées, car méconnues et de toute façon peu ou pas accessibles, celles-ci correspondent au « matériel génétique » issu de plantes, animaux et autres organismes qui ont évolué dans des conditions extrêmes de température, de pression, d'absence de lumière, d'acidité, etc. Ce matériel génétique présente donc un intérêt majeur pour des secteurs comme la médecine, la pharmacie, la cosmétique ou encore la chimie. Or les ressources génétiques marines échappent à l'interdiction générale de « breveter le vivant », et leur exploitation risque donc de se faire au seul profit de quelques pays ou entreprises (l'entreprise BASF détient à elle seule 47 % des quelque 13 000 brevets déposés à ce titre). Voir à ce sujet : https://reporterre.net/BASF-le-geant-de-la-chimie-mondiale-s-approprie-la-biodiversite-des-oceans
* 97 Source : AIFM. Voir à ce sujet : https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/01/06/metaux-rares-ces-entreprises-lancees-dans-la-course-aux-abysses_6156802_3234.html
* 98 Comme le Traité sur la Lune, la Convention de Montego Bay exclut non seulement toute appropriation nationale (par un État), mais aussi par une personne privée : « Aucun État ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droits souverains sur une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources ; aucun État ni aucune personne physique ou morale ne peut s'approprier une partie quelconque de la Zone ou de ses ressources » (paragraphe 1). En revanche, elle opère une distinction entre les « ressources » (dans le sol) et les « minéraux » (après leur extraction), qui peuvent quant à eux « être aliénés » dans les conditions prévues par le texte (c'est-à-dire via l'AIFM) (paragraphe 2).
* 99 Isabelle Sourbès-Verger, « Conquérir du foncier dans l'espace », Constructif 2020/3 : https://www.cairn.info/revue-constructif-2020-3-page-52.htm#re3no3
* 100 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V22/022/50/PDF/V2202250.pdf
* 101 C'est la date fixée par le « plan de travail quinquennal » du groupe de travail sur les ressources spatiales, qui doit auparavant recueillir les contributions des pays membres, étudier le cadre juridique existant, et surtout parvenir à un consensus.
* 102 Spurring Private Aerospace Competitiveness and Entrepreneurship Act.
* 103 Paragraphe 51303. Traduction Sénat.
* 104 Traduction Sénat.
* 105 Il ne faut toutefois pas exagérer la comparaison : il n'y a dans les accords Artemis ni dimension militaire explicite, ni bien sûr solidarité entre alliés en cas d'attaque (article 5 du Traité de l'Atlantique), les « zones de sécurité » et les intérêts à protéger des « interférences nuisibles » ne s'entendant qu'au niveau de chaque pays individuel.
* 106 En revanche, sur le sujet plus ancien de la militarisation de l'espace, les positions de la Chine et de la Russie sont traditionnellement alignées, mais là encore, leur opposition tient moins de convictions pacifistes que d'une volonté de ne pas laisser les États-Unis prendre un avantage décisif.
* 107 Comme le souligne Isabelle Sourbès-Verger, la Chine a modifié en 2004 sa constitution afin de consacrer la protection de la propriété privée en tant que droit d'usage du terrain.
* 108 On peut également citer le cas de l'Arabie saoudite, qui s'est officiellement retirée en janvier 2023 du Traité sur la Lune de 1979, qu'elle avait ratifié en 2012.
* 109 Le Sénat de Belgique a aussi adopté une résolution en ce sens le 24 juin 2022.
* 110 Rapport d'information n° 4991 du 3 février 2022 présenté par Pierre Cabaré et Jean-Paul Lecoq en conclusion d'une mission d'information sur l'espace de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale.
* 111 Voir aussi la recommandation n° 32 : « Envisager une révision du Traité sur la Lune de 1979 dans le cadre de cette nouvelle réflexion sur l'exploitation des ressources spatiales ».
* 112 Longtemps tutelle principale du CNES, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche est traditionnellement plus sensible à la vocation scientifique des programmes spatiaux. Le ministère des affaires étrangères, qui mène les négociations diplomatiques, est avant tout garant de la cohérence juridique de la position française, et le ministère des armées est moins concerné par le sujet. En revanche, le ministère de l'économie et des finances, devenu tutelle principale du CNES depuis 2020, est pour sa part plus sensible aux aspects économiques et aux nouvelles opportunités commerciales liées à l'exploitation des ressources spatiales, et plus généralement aux nouveaux services de l'espace orbital et cislunaire. Il s'agit là, bien sûr, d'une vision très simplifiée.
* 113 Morgan Stanley, « Space: investing in the final frontier », juillet 2020. La NASA et l'ESA évoquent des ordres de grandeur comparables.
* 114 Source : https://www.nasa.gov/leo-economy/what-is-the-commercial-low-earth-orbit-leo-economy. On trouve parmi ces entreprises des acteurs traditionnels du spatial (Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, etc.), des nouveaux entrants (Blue Origin, Axiom Space, etc.) et des cabinets de conseil (Deloitte, McKinsey, etc.).
* 115 Deloitte, « The Commercialization of Low Earth Orbit », vol. 1 « The Time is Now », 2022.
* 116 PwC, « Lunar Market Assessment: market trends and challenges in the development of a lunar economy », août 2021.
* 117 Moon Village Association (MVA), « The Lunar Commerce Portfolio », First Edition, 2022 : https://moonvillageassociation.org/download/copuos-stsc-technical-session-presentation-february-7-the-lunar-commerce-portfolio/
* 118 En 2022, la MVA a présenté au COPUOS les recommandations de son groupe d'experts pour la durabilité des activités lunaires (GEGSLA, pour Global Expert Group on Sustainable Lunar Activities) : https://moonvillageassociation.org/gegsla/about/
* 119 https://moonvillageassociation.org/wp-content/uploads/2021/04/2020-MV-Architecture-Workshop-Report-vF2-02Apr21.pdf
* 120 Le rover Rashid, d'un poids de seulement 10 kg, a été construit par des entreprises européennes et est équipé de trois caméras CASPEX fournies par le CNES, également impliqué dans la phase opérationnelle. Son objectif est d'analyser les propriétés thermiques, physiques et chimiques du régolithe. Il s'agit de la première mission lunaire du Mohammed bin Rashid Space Centre (MBRSC), l'agence spatiale émiratie.
* 121 « Fertilisation croisée spatial/non-spatial : un axe stratégique majeur pour un avenir commun Terre-espace. Le cas de l'exploitation lunaire à venir », Groupe « Objectif Lune » de l'Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT), février 2023 : https://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/anrt_gtol_note_vfinal_cross-fertilisation_spatial_non_spatial_fev_2023_0.pdf
* 122 https://www.esa.int/Applications/Technology_Transfer/Space_radar_to_improve_miners_safety
* 123 Le Canada est membre de l'ESA.
* 124 https://natural-resources.canada.ca/sites/nrcan/files/CMMP/CMMP_The_Plan-EN.pdf
* 125 L'accord de novembre 2016 entre Planetary Resources, le Gouvernement et la Société Nationale de Crédit et d'Investissement (SNCI) portait sur un investissement de 25 millions d'euros, sous forme de prises de participation (12 millions d'euros) et d'aides à la R&D (13 millions d'euros).
* 126 La loi ne concerne pas les activités liées aux satellites de télécommunication et de navigation, qui relèvent de la loi du 15 décembre 2020 portant sur les activités spatiales.
* 127 Source : https://tech.eu/2021/10/25/with-a-new-e120-million-space-fund-orbital-ventures-loves-startups-to-the-moon-and-back/
* 128 Voir https://www.spaceresourcesweek.lu/. Les vidéos des différentes conférences sont disponibles ici : https://www.youtube.com/playlist?list=PLNUvZweBqVASl-Ivy_Tzz547OSNddMgiw
* 129 Cette liste indicative, qui ne comprend pas la France, provient du site internet de la LSA : https://space-agency.public.lu/en/agency/international-collaboration.html
* 130 Le 20e vol a eu lieu en juin 2023. Le précédent record était celui de l'ancienne fusée américaine Delta II avec 100 vols.
* 131 Cela n'interdit pas d'imaginer qu'à plus long terme, le rapport de force puisse s'inverser. Si par exemple les projets de colonisation martienne d'Elon Musk venaient à aboutir - ce que le présent rapport ne se risquera ni à prédire, ni à exclure -, on pourrait voir apparaître une société privée disposant d'un accès exclusif aux ressources, d'une hégémonie technologique, et en pratique de tous les attributs de la souveraineté (un territoire, une armée, le pouvoir d'édicter des lois, de rendre la justice ou de battre monnaie, etc.), comparable à ce que furent, au XVIIe siècle, les Compagnies des Indes. En 1952, le père du programme spatial américain, l'ingénieur allemand Wernher von Braun, publiait The Mars Project : dans cette oeuvre de science-fiction qui décrit la colonisation de Mars par l'humanité, les pionniers sont menés par un chef, élu au suffrage universel pour cinq ans, qui s'appelle Elon.
* 132 Cette typologie reprend en partie celle de la synthèse très complète réalisée par le bureau du CNES à l'Ambassade de France à Washington : « L'émergence et le développement du New Space aux États-Unis », note rédigée par Diane Zajackowski et Nicolas Maubert, juin 2022 : https://france-science.com/38923-2/
* 133 https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/12/united-states-space-priorities-framework-_-december-1-2021.pdf
* 134 Source : Euroconsult, « Government Space Programs », édition 2022 : https://www.euroconsult-ec.com/press-release/new-record-in-government-space-defense-spendings-driven-by-investments-in-space-security-and-early-warning/. Cf. Partie III pour les comparaisons.
* 135 Le budget de la NASA s'élève à 24 milliards de dollars en 2022, son niveau le plus élevé depuis 1991. Le reste du budget spatial américain correspond essentiellement aux programmes militaires.
* 136 https://www.nasa.gov/leo-economy/what-is-the-commercial-low-earth-orbit-leo-economy
* 137 OrbitBeyond a finalement renoncé à son premier contrat mais demeure éligible aux suivants.
* 138 Les entreprises citées sont, la plupart du temps, à la tête d'un consortium qui associe d'autres partenaires.
* 139 L'ESA compte 22 États membres, 4 États associés, et un Etat coopérant (le Canada).
* 140
https://www.esa.int/Newsroom/Press_Releases/Les_ministres_soutiennent_les_grandes_ambitions
_de_l_ESA_en_lui_octroyant_un_budget_record_en_hausse_de_17
* 141 L'Agenda 2025 de l'ESA a été présenté par son directeur général, Josef Aschbacher, lors de sa prise de fonction en mars 2021 : https://www.esa.int/About_Us/ESA_Publications/Agenda_2025
* 142 Une grande partie correspondant à des programmes menés via l'ESA, les deux budgets de l'UE et de l'ESA se superposent largement et ne doivent pas être additionnés.
* 143 Ce montant représente le financement public total estimé pour la période 2023-2027, partagé entre l'Union européenne (2,4 milliards d'euros) et l'ESA (750 millions d'euros).
* 144 Voir à cet égard les conclusions sur « l'espace pour tous » adoptées le 26 novembre 2021 : https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/11/26/council-stresses-the-importance-of-participation-of-all-in-the-space-sector/
* 145 Budgets de l'ESA, de l'UE, des autres organismes intergouvernementaux et des programmes civils et militaires des États membres, en éliminant les doubles comptes. En raison de la complexité de la gouvernance du spatial européen, personne ne se risque à donner une estimation précise.
* 146 https://www.euroconsult-ec.com/press-release/new-record-in-government-space-defense-spendings-driven-by-investments-in-space-security-and-early-warning/
* 147 Les programmes civils sont traditionnellement plus importants que les programmes militaires, mais l'écart se réduit et le rapport devrait s'inverser à partir de 2031, d'après Euroconsult.
* 148 A l'initiative des Européens, tandis que les États-Unis poursuivaient leur coopération avec la Russie sur l'ISS.
* 149 En combinant le budget de l'ESA et de l'UE.
* 150 Source : NASA 2022, « Budget, Economic Output and Jobs supported by the NASA Moon to Mars Campaign 2021 ».
* 151 Ou « La révolution spatiale : la mission de l'Europe en matière d'exploration spatiale ». Le HLAG a présenté son rapport lors de la 315ème session du Conseil de l'ESA, le 23 mars 2023. Il est disponible ici : https://esamultimedia.esa.int/docs/corporate/h-lag_brochure.pdf
* 152 https://www.airbus.com/en/newsroom/news/2022-05-in-space-manufacturing-and-assembly
* 153 La liste est disponible ici : https://www.anrt.asso.fr/fr/objectif-lune-32335
* 154 https://www.gov.uk/government/news/uk-space-agency-backs-rolls-royce-nuclear-power-for-moon-exploration
* 155 GEGSLA, « Recommended Framework and Key Elements for Peaceful and Sustainable Lunar Activities », 2022 : https://moonvillageassociation.org/download/recommended-framework-and-key-elements-for-peaceful-and-sustainable-lunar-activities/. Le GEGSLA participe aux réunions du COPUOS avec le statut d'observateur.
* 156 https://www.outerspaceinstitute.ca/docs/Vancouver_Recommendations_on_Space_Mining.pdf
* 157 La protection planétaire désigne un ensemble de recommandations destinées à empêcher la contamination d'autres planètes et corps célestes par des micro-organismes terrestres afin de ne pas compromettre l'étude scientifique de celles-ci. Elles concernent également le retour sur Terre d'échantillons d'autres corps célestes dans le but de ne pas contaminer notre propre planète. Ces recommandations sont édictées et régulièrement mises à jour par le COSPAR (Committee on Space Research), un organisme basé à Paris (au CNES) qui rassemble des institutions scientifiques nationales et internationales et travaille par consensus.
* 158 Par exemple un site naturel présentant un intérêt scientifique, voire esthétique majeur, ou les sites d'alunissage des missions Apollo (traces de pas, plaques commémoratives, etc.).
* 159 Listés ici : https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-holistic-approach-sustainable-development_fr. Entre autres exemples : « pacte vert », « stratégie pour une croissance durable », stratégies relatives à la durabilité en matière de produits chimiques ou à l'économie circulaire, etc.
* 160 L'ESA publie un rapport annuel sur l'état de l'environnement spatial : https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/Point_de_situation_sur_les_debris_spatiaux
* 161 La collision entre les satellites Iridium-33 et Kosmos-2251 en 2009 a créé plus de 1 400 débris de plus de 10 cm, et bien davantage de débris d'une taille inférieure.
* 162 Les tirs antimissiles auraient, collectivement, produit plus de 10 000 débris de plus de 10 cm.
* 163 Ce « syndrome de Kessler », du nom du physicien de la NASA qui l'a théorisé en 1978, a été popularisé par le film Gravity d'Alfonso Cuarón en 2013.
* 164 « Space Debris Mitigation Guidelines », COPUOS, 2007 : www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/topics/space-debris/index.html
* 165 « Guidelines for the Long-Term Sustainability of Space Activities », COPUOS, 2019 : www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/topics/long-term-sustainability-of-outer-space-activities.html
* 166 A défaut d'un accord contraignant, de telles lignes directrices seraient, en matière d'exploitation des ressources spatiales, une avancée bienvenue.
* 167 Il est aujourd'hui fréquent que les anciens satellites, bien que « non conformes » aux lignes directrices internationales, tentent des manoeuvres de désorbitation à l'issue de leur mission, avec le carburant restant. Toutefois, un tiers seulement aboutissent.
* 168 Dans le cadre du programme ADRIOS (Active Debris Removal - In Orbit Servicing), lancé au conseil ministériel Space19+ de novembre 2019.
* 169 La liste est disponible ici : https://www.netzerospaceinitiative.org/
* 170 L'expression n'implique ici aucune hiérarchie.
* 171 Groupe « Objectif Lune » de l'ANRT, note sur la fertilisation croisée spatial/non-spatial, février 2023 : https://www.anrt.asso.fr/sites/default/files/anrt_gtol_note_vfinal_cross-fertilisation_spatial_non_spatial_fev_2023_0.pdf
* 172 « Stratégie spatiale de l'Union européenne pour la sécurité et la défense », Communication conjointe de la Commission européenne au Parlement et au Conseil du 10 mars 2023 : https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=JOIN(2023)9&lang=fr
* 173 Rapport d'information n° 4991 du 3 février 2022 présenté par Pierre Cabaré et Jean-Paul Lecoq en conclusion d'une mission d'information sur l'espace de la commission des affaires étrangères.
* 174 Celle-ci est prévue par l'article 189 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)
* 175 Ordonnance n° 2022-232 du 23 février 2022 relative à la protection des intérêts de la défense nationale dans la conduite des opérations spatiales et l'exploitation des données d'origine spatiale.
* 176 https://presse.economie.gouv.fr/23012023-cp-consultation-aupres-des-operateurs-spatiaux-sur-les-enjeux-du-new-space/
* 177 Les services de refueling ou de réparation en orbite sont pour leur part déjà possibles dans le cadre fixé par la LOS.
* 178 En effet, le traité sur l'espace de 1967 est muet sur ce point, et la France n'a pas ratifié le traité sur la Lune de 1979.
* 179 Pierre Mendès-France (discours à l'Assemblée nationale, 3 juin 1953).
* 180 Émile de Girardin (La politique universelle, 1852).