TABLE-RONDE N° 2 - APPARTENANCES SOCIALES ET SOCIABILITÉS
Présidente : Renée Nicoux, sénatrice de la Creuse
Modératrice : Nadia Belrhomari, Public Sénat
Les mondes ruraux contemporains apparaissent socialement très diversifiés, l'activité agricole n'occupant qu'une minorité d'actifs. Aperçus de cette diversité sociale, au sein du monde agricole et en dehors.
1. Que deviennent les enfants d'agriculteurs ? - Christophe Giraud - Jacques Rémy
(Université Paris 5 - INRA)
Depuis le début des années 1960, le niveau scolaire des fils et des filles d'agriculteurs n'a cessé de progresser. Les enfants d'agriculteurs ont été la population qui a le plus modifié son comportement par rapport à l'école. Le niveau de formation des fils d'agriculteurs s'est accru plus vite et est devenu plus élevé que celui des enfants d'ouvrier ou d'employé 69 ( * ) . Mais les enfants d'agriculteurs ont adopté des stratégies tournées vers les formations techniques, jugées plus efficaces ou plus opérationnelles que les formations générales longues (Davaillon, 1998) 70 ( * ) .
Mais ce qui s'est le plus transformé c'est le rapport subjectif des familles et des individus à l'école :
Témoignage d'un petit agriculteur de Mayenne en 1975 sur la formation agricole de ses enfants : « C'est peut-être pas mauvais quoi, mais enfin c'est pas ça qui... Je crois qu'ils apprennent encore davantage chez eux »
(Champagne, 2002).
Témoignage à trente ans de distance d'un agriculteur de Vendée en GAEC (2007) : « Ce qui est bien c'est de passer par un bac pro, puis après de faire un BTS gestion par exemple. Gestion d'entreprise, c'est bien parce qu'après ça aide à regarder les cahiers, à lire un bilan... Parce que si le comptable vous dit : « Ah bah, ça va bien... », bah oui mais si vous savez pas lire votre bilan... »
(Alarcon, 2008)
Trois facteurs expliquent ces transformations dans les pratiques et les mentalités :
- la scolarisation prolongée des jeunes (passage de 14 à 16 ans depuis 1959) ;
- le renforcement dans les années 60 et 70 d'un système de formation agricole qui s'est aligné sur les diplômes de l'enseignement scolaire de l'éducation nationale (avec la création de diplômes comme le CAPA ou le BEPA, les brevets agricoles, BTSA...) ;
- une politique qui, à partir de 1974, a conditionné l'obtention des aides à l'installation (DJA, prêts bonifiés) à la détention d'un niveau de diplôme minimal 71 ( * ) .
L'école a aujourd'hui une double action sur les enfants d'agriculteurs : elle « acculture », c'est-à-dire apporte des connaissances générales qui rompent avec la clôture d'une certaine culture locale et professionnelle (elle « dépaysannise »), ce qui peut conduire les enfants « cultivés » à quitter le milieu agricole, le milieu rural ; en même temps elle « professionnalise » puisqu'elle est un instrument indispensable pour l'installation en agriculture.
Nous allons voir quelles ont été les conséquences de cette culture scolaire spécifique sur les trajectoires sociales des enfants d'agriculteurs (les positions) mais aussi sur l'appartenance sociale et culturelle de ceux-ci (la sociabilité et leur mode de vie). Nous traiterons en détail des trajectoires des fils (1 et 2) avant de passer plus rapidement à celles des filles (3) en nous concentrant notre attention pour chaque sexe sur la génération des personnes âgées de 40 à 49 ans, classe d'âge où l'appartenance professionnelle est relativement stabilisée.
a) L'école, créatrice de clivages à l'intérieur de l'agriculture
Indispensable à l'installation aidée de nouveaux agriculteurs, le diplôme est à la source de clivages profonds parmi les nouveaux installés. Il donne accès à certaines positions au sein du milieu agricole (a), de même qu'il donne accès à des univers sociaux et culturels très contrastés (b).
a) Le diplôme, en donnant accès aux aides à l'installation, apporte une dynamique très différente aux exploitations tenues par les diplômés et par les non-diplômés. Des données de 2003 72 ( * ) montrent que les premiers ont ainsi eu plus tendance que les seconds à se retrouver entre 30 et 50 ans à la tête d'exploitations de taille économique importante.
« En 2003, pour les agriculteurs fils d'exploitants sur petite et moyenne exploitation, âgés de 30 à 49 ans, les chances de devenir eux-mêmes exploitants sur grande exploitation passent de 51,2 % pour les fils pourvus au mieux d'un BEPC à 67,1 % pour ceux qui possèdent un diplôme supérieur ».
Ces perspectives économiques différentes basées sur la reconnaissance et l'adoubement de la profession et l'octroi d'aides financières expliquent pour partie les chances différenciées des fils d'agriculteurs de choisir la profession d'agriculteur selon leur niveau de diplôme 73 ( * ) . Les détenteurs d'un diplôme technique qui donne l'accès aux aides à l'installation sont plus enclins à choisir l'agriculture que les fils sans diplôme (ou peu diplômés) qui seront exclus de ces aides.
Choix de la profession d'agriculteur selon le niveau de diplôme des fils et des filles âgés de 40 à 49 ans ayant un parent agriculteur
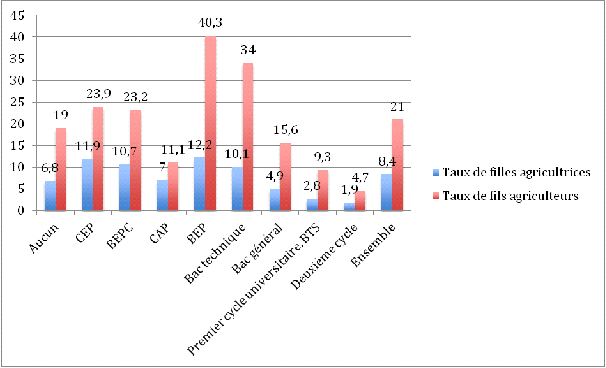
Source : EHF1999
Champ : Hommes et femmes âgés de 40 à 49 ans dont l'un des deux parents est agriculteur (ou ex-agriculteur).
Lecture : 19% des fils d'agriculteur âgés de 40 à 49 ans n'ayant aucun diplôme ont choisi la profession d'agriculteur.
Au fil des générations, le cas de fils d'agriculteurs qui ne réussissaient pas à l'école et devenaient agriculteurs « à défaut de mieux » apparaît de moins en moins fréquent. Les fils qui choisissent le plus souvent l'agriculture sont ceux qui « sont choisis » par l'agriculture, et ce choix est conditionné pour partie par la formation.
Le diplôme est donc central dans l'accès à l'agriculture et aux positions élevées dans la hiérarchie des exploitations agricoles.
Avec le contrôle de l'installation par la profession (Rémy, 1987) et le conditionnement des aides économiques de toutes sortes par le niveau de diplôme, il est possible d'évoquer la coexistence de deux « modes de reproduction » distincts en agriculture :
- un mode de reproduction familial, où la famille est au coeur de l'exploitation : on y travaille ensemble ; on transmet les connaissances, le métier en travaillant en famille ; on hérite surtout des biens familiaux... On reste dans une forte dépendance par rapport aux parents qui doivent décider à quel moment et dans quelles conditions ils transmettent leur patrimoine ;
- un mode de reproduction à composante scolaire : la famille a toujours un rôle important, mais l'école devient l'institution centrale qui donne, valide, certifie ces connaissances, ce qui d'une certaine façon relativise celles apportées par la famille, ainsi que l'autorité des ascendants. Dans ce mode de reproduction, on hérite certes des biens familiaux mais surtout on investit pour acquérir de nouvelles superficies, pour créer tel ou tel atelier sur les exploitations, en rapport au projet formulé lors de la préparation à l'installation. On s'endette auprès de la banque et on gagne ce faisant en indépendance vis-à-vis de ses parents (qui peuvent cependant se porter caution). Les individus sont moins étroitement définis par leur appartenance agricole et les conjointes choisies sont plus souvent éloignées socialement du milieu agricole que dans le mode de reproduction strictement familial.
b) D'un point de vue culturel, les agriculteurs « diplômés » disposent d'une socialisation et d'une expérience des contacts avec d'autres groupes sociaux, notamment lors des études agricoles (où une majorité d'enfants désormais n'est pas de milieu agricole), qui les rendent aptes à une sociabilité diversifiée. Témoin de cette nouvelle capacité à gérer les interactions avec des personnes venant d'autres groupes sociaux, les agriculteurs diplômés (et leur famille) ont plus tendance à développer sur leur exploitation des activités de diversification tournées vers les clients urbains (tourisme à la ferme, activité de vente directe).
D'un point de vue social, enfin les contacts des diplômés sont aussi plus diversifiés et moins limités à l'agriculture ou aux mondes populaires que ceux des non diplômés. Indicateur de ces nouvelles « aires de sociabilité », mais aussi de la valeur sociale des agriculteurs, les conjointes des diplômés font plus souvent partie des classes moyennes que les conjointes des non diplômés (qui appartiennent plus souvent aux mondes populaires des ouvriers ou employés, si elles n'ont pas suivi leur mari dans l'agriculture).
Deux fractions de l'agriculture se dessinent :
- celle des « diplômés » de l'agriculture qui possèdent une formation technique (agricole) élevée (Bac Pro, BTSA). C'est ce profil « formé » de fils d'agriculteurs qui a le plus tendance à choisir l'agriculture comme profession. Ils sont proches culturellement et socialement des milieux moyens salariés, mais ils ont une position sociale caractérisée par l'indépendance professionnelle et des capitaux économiques très élevés ;
- celle des « non diplômés » qui, encore nombreux, sortent du système scolaire avec un niveau de diplôme relativement faible. Ils choisissent moins souvent que les premiers l'agriculture mais constituent cependant une frange non négligeable des agriculteurs aujourd'hui. Pour eux, l'école n'était qu'un passage obligé, souvent mal vécu. Ils ont le sentiment assez net qu'« on apprend tout de même mieux en famille » 74 ( * ) , et sur le terrain (pendant les stages de formation) 75 ( * ) . Ces agriculteurs « peu formés » sont proches culturellement des milieux populaires et du milieu local dans lequel ils vivent. Leur position économique les situe plutôt à la tête de petites exploitations 76 ( * ) . On voit combien les deux modes de reproduction de l'agriculture sont aussi liés à une ouverture plus ou moins orientée vers les autres milieux sociaux de la société.
b) L'école, créatrice de clivages hors de l'agriculture
L'école génère également des clivages importants parmi les enfants qui ne choisissent pas professionnellement l'agriculture. L'école et ses titres scolaires conditionnent fortement les positions sociales des individus (a) mais aussi le milieu culturel dans lequel ils évoluent (b). Prenons ces deux caractéristiques tour à tour :
a) Du point de vue des positions occupées, l'école clive considérablement les trajectoires des enfants d'agriculteur. Deux populations se distinguent là encore : celle des enfants qui sont sortis sans diplôme ou avec un faible niveau scolaire et qui vont alors souvent rejoindre le monde ouvrier 77 ( * ) . Celle des enfants qui disposent d'un certain niveau de diplôme technique ou général (le niveau d'un bac technique) qui va leur permettre d'occuper des professions intermédiaires (parfois dans l'encadrement de l'agriculture : ils seront plus souvent que les autres techniciens ou agents de maîtrise) 78 ( * ) .
b) Du point de vue de l'univers culturel, les premiers restent proches du milieu agricole (et en tout cas des milieux populaires) : ils vivent plus souvent dans leur région d'enfance que les précédents et continuent à donner des coups de main dans le milieu agricole, voire à maintenir une double activité 79 ( * ) . Ils conservent plus facilement un ancrage fort dans une culture locale, paysanne ou populaire. Pour les seconds, la prise de distance par rapport au milieu agricole est plus nette : ils ont connu plus souvent une mobilité géographique. Cela ne conduit pas forcément à une rupture des liens avec l'agriculture. Des participations dans des sociétés agricoles peuvent perdurer en dépit de professions assez différentes.
c) Du côté des filles
Elles sont moins souvent agricultrices que les garçons 80 ( * ) car elles sont moins souvent construites comme des « successeures » (Barthez, 1982 ; Bessière, 2008). Les jeunes femmes ont également plus de mal à s'installer car elles héritent moins souvent que les garçons du capital productif professionnel (Barthez, 1994).
Cependant le profil scolaire des filles agricultrices quarantenaires diffère de celui des fils agriculteurs du même âge (cf. graphique ci-dessus) : pour ces filles, avoir un diplôme technique (comme le BEP) n'a pas plus favorisé le choix de l'agriculture qu'un diplôme de l'enseignement général court (CEP, BEPC).
Si l'impact du diplôme est moins net pour les filles de cette génération, c'est surtout parce qu'à la différence des fils, celles-ci entrent surtout dans le métier d'agricultrice par le mariage : en 2003, 46,5 % des filles d'agriculteur en couple avec un agriculteur se déclarent agricultrices contre 1,8 % des filles d'agriculteur en couple avec un homme qui n'est pas agriculteur. La composition du couple parental pèse également sur les choix des enfants : avoir deux parents agriculteurs prédispose plus fortement à une union avec un homme agriculteur qu'avoir un seul parent agriculteur. Avoir baigné dans une culture familiale pleinement agricole renforce donc le goût conjugal féminin pour ce milieu (Giraud, 2013).
Si les filles d'agriculteur continuent d'entrer dans la profession agricole par le mariage, le sens du travail conjugal sur les exploitations change cependant avec le développement de nouveaux statuts professionnels qui protègent mieux les conjointes (comme celui de « conjoint collaborateur ») ou avec les formes sociétaires d'exploitations agricoles qui permettent de donner à l'épouse un statut égal à celui d'un mari agriculteur. Toutefois, la majorité des jeunes compagnes choisissent de travailler en dehors de l'exploitation agricole du conjoint. Pour une conjointe d'agriculteur la pression normative pour épouser également le métier est moins pressante qu'il y a cinquante ans (Bessière, 2010). Devenir agricultrice aux côtés de son mari peut alors être vécu aujourd'hui davantage comme un choix que comme un destin 81 ( * ) .
Du côté des filles d'agriculteurs qui sortent de l'agriculture, le diplôme joue un rôle très important (comme pour les filles issues d'autres milieux sociaux). Le faible niveau de diplôme conduit à des positions peu élevées dans l'échelle sociale (employées de commerce, ouvrières, ouvrières agricoles, ou inactives qui représentent 77,3 % des filles d'agriculteurs sans diplôme âgées de 40 à 49 ans en 1999). Les diplômes courts de l'enseignement général ou technique (BEPC, CAP) favorisent plus que les autres diplômes des emplois dans le monde indépendant de l'artisanat, le commerce ou l'entreprise ou des employées de la fonction publique. Les diplômes plus élevés permettent l'accès à des emplois plus élevés (le niveau bac donne accès plus souvent aux professions intermédiaires administratives ou au monde des employées administratives ; le niveau université aux emplois les plus valorisés de cadres ou des professions intermédiaires de la fonction publique ou de la santé ou des techniciennes).
d) Conclusion
L'agriculture qui se dessine dans cette période de scolarisation prolongée est une agriculture particulièrement hétérogène socialement et culturellement :
- la première fraction, celle des diplômés, se trouve dans des conditions et avec des niveaux culturels qui la rapprochent des classes moyennes salariées : les diplômés ont suivi une formation longue à l'école qui les a mis en contact avec des enfants de milieux sociaux très variés. Ils sont donc plus facilement prêts à gérer des interactions avec des personnes des classes moyennes avec lesquelles ils partagent certains codes culturels ;
- la fraction des non-diplômés reste, elle, proche des milieux populaires. Peu scolarisée, porteuse d'une éducation essentiellement familiale portée par des familles avec deux parents agriculteurs, elle demeure aussi plus étroitement attachée à une culture populaire, agricole et locale qui tranche avec le groupe précédent 82 ( * ) . Du côté des fils qui ne choisissent pas l'agriculture, il y a aussi cette même opposition entre diplômés et peu diplômés. Enfin des circulations persistent entre ces petits agriculteurs et les fils qui ont choisi le monde ouvrier. Ces derniers peuvent conserver un « travail à côté » agricole ou prêter main-forte occasionnellement dans l'exploitation familiale.
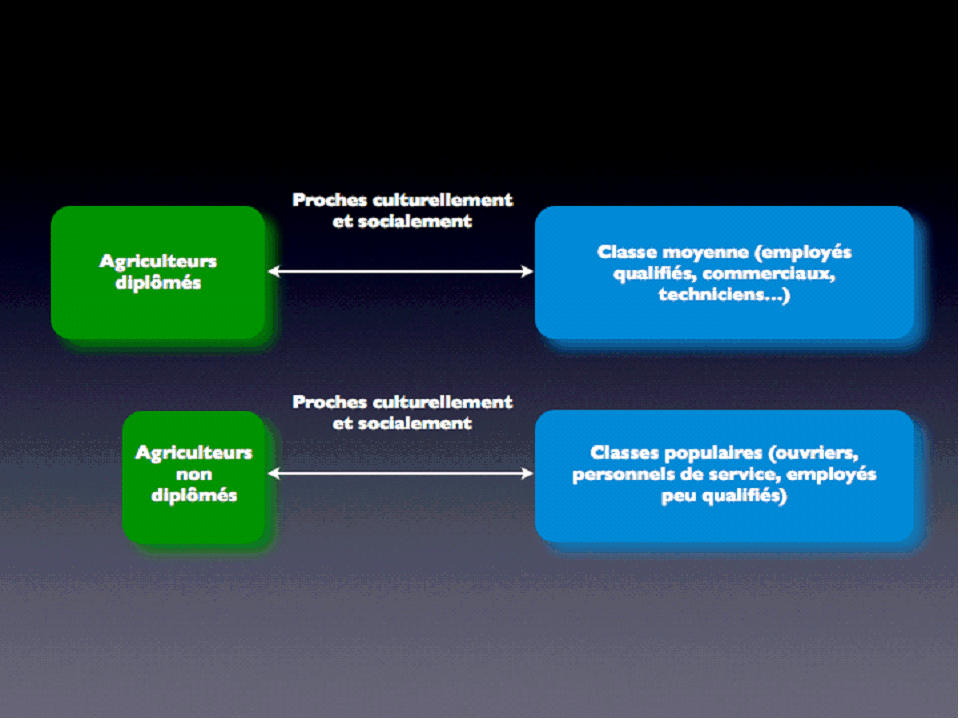
Cette présentation s'attache à exposer combien l'agriculture constitue un univers hétérogène dont les acteurs s'intègrent de manière très contrastée au reste de la société : la fraction des agriculteurs diplômés est proche des classes moyennes, et tire le meilleur parti des systèmes d'aide dans le cadre de la politique agricole commune, tandis que la fraction des agriculteurs peu diplômés s'inscrit dans un milieu local plus populaire et souffre d'un manque de reconnaissance des mêmes politiques agricoles.
Du côté des filles d'agriculteur, si les dernières études montrent que leur situation évolue fortement puisqu'elles accèdent plus souvent au monde agricole, comme les jeunes hommes, par la formation et l'installation professionnelle, indépendamment de tout projet conjugal (Dahache, 2012), si l'on considère l'ensemble de la population des filles (et plus particulièrement les quarantenaires), cette voie d'entrée dans la profession se révèle peu fréquentée et l'entrée par le mariage apparaît encore dominante.
|
Bibliographie : Alarcon L ., 2008, « `Maintenant, faut presque être ingénieur pour être agriculteur', Choix et usages des formations professionnelles agricoles dans deux familles d'agriculteurs », Revue d'études en agriculture et environnement , vol. 88, n°3, pp. 95-118. Barthez A ., 1982, Travail, Famille et agriculture , Paris, Economica. Barthez A ., 1994, « Le patrimoine foncier des agriculteurs vivant en couple », Agreste Analyses et Études Cahiers , n°17-18, mars, pp. 23-36. Bessière C. , 2010 , De génération en génération. Arrangement de famille dans les entreprises viticoles de Cognac , Paris, Raisons d'Agir, 215 p. Champagne P. , 2002, L'héritage refusé. La crise de la reproduction sociale de la paysannerie française 1950-2000 , Paris, Seuil, Points. Dahache S. , 2012, La féminisation de l'enseignement agricole , Paris, L'harmattan. Davaillon A. , 1998, « Parcours scolaires des élèves ruraux et des enfants d'agriculteurs : spécificités et évolutions », Education et formations , n°54, déc., pp. 97-107. Dufour A., Giraud C. , 2012, « Le travail dans les exploitations d'élevage bovin laitier est-il toujours conjugal ? », in Hostiou N., Dedieu B., Baumont R. (eds.), numéro « Travail en élevage », INRA-Productions animales , vol. 25, n°2, juin, pp. 169-180. Giraud C. , 2013, « Une distance sociale intime », in Boudjaaba F. (dir.), Au-delà de la terre. Famille, travail, formation et mobilités sociales en milieu rural (16ème-21ème siècles) , Rennes, PUR, à paraître. Laisney C. , 2012, « Les femmes dans le monde agricole », Analyse , Centre d'études et de prospective, n°38, mars, 4 p. Rémy J. , 1987, « La crise de la professionnalisation en agriculture : les enjeux de la lutte pour le contrôle du titre d'agriculteur », Sociologie du Travail , vol. 39, n°4, pp. 415-441. |
* 69 83% des fils d'agriculteurs nés avant 1940 ont quitté le système scolaire sans diplôme ou avec, au mieux, le CEP contre 59% seulement des hommes nés avant 1940. 8% des fils d'agriculteurs nés après 1970 sont sortis avec, au mieux, le seul CEP contre 12,3% des hommes de la même génération.
* 70 24,9% des fils d'agriculteurs nés après 1970 ont acquis un niveau de bac technologique, professionnel ou un brevet de technicien. 14,8% des hommes de moins de 30 ans sont dans ce cas. Les fils d'agriculteurs ont deux fois plus de chance que l'ensemble de la population d'accéder à ces diplômes des filières techniques longues. Et on sait aujourd'hui avec les premiers résultats du Recensement agricole 2010 que les BTS deviennent des diplômes de plus en plus prisés par les fils d'agriculteurs.
* 71 Le pourcentage de diplômés s'est accru au fur et à mesure de l'élévation du niveau exigé pour l'obtention des aides (passant du CAPA au bac professionnel gestion d'exploitation agricole).
* 72 Enquête Formation et Qualification Professionnelle (FQP) 2003 de l'INSEE.
* 73 Les diplômés : 51,7% des fils d'agriculteurs âgés de 40 à 49 ans en 1999 et titulaires d'un BEP, sont devenus agriculteurs. Les non-diplômés : 22,2% des fils d'agriculteurs âgés et de 40 à 49 ans et titulaires au mieux d'un BEPC ont choisi le métier d'agriculteur.
* 74 Il ne s'agit pas ici de laisser penser que les agriculteurs non-diplômés ne sont pas assez « doués » scolairement. C'est l'école qui ne fait pas sens. La transmission des compétences passant essentiellement par la famille. D'une certaine manière, c'était le sentiment dominant avant les années 1960 parmi les agriculteurs.
* 75 Nous forçons le trait au risque d'être schématique. Une frange des « diplômés » peut avoir le même sentiment et éprouver des difficultés scolaires importantes mais a pu mieux gérer sa scolarité par le choix de formations en alternance (en Maisons familiales rurales par exemple).
* 76 Notons toutefois que le clivage culturel n'oppose pas strictement les petits exploitants aux grands, mais qu'il traverse chaque catégorie d'exploitation.
* 77 Ainsi 43% des fils âgés de 40 à 49 ans sortis sans diplôme ou avec le CEP et 45,9% des titulaires d'un CAP ont un emploi d'ouvrier (plus particulièrement dans les emplois industriels de l'artisanat pour ces derniers) contre 31,6% de l'ensemble des fils de cette génération en moyenne.
* 78 Ainsi 30,9% des fils âgés de 40 à 49 ans disposant d'un bac professionnel ont une profession intermédiaire contre 15,3% des fils disposant d'un CAP.
* 79 Parmi les hommes de 40 à 49 ans en 2000 qui participent au travail dans les exploitations agricoles sans y être salariés, 30,1% déclarent une autre profession principale qu'agriculteurs.
* 80 Le recensement agricole de 2010 fait état d'un taux de 27% des chefs ou des coexploitants d'exploitations agricoles qui sont des femmes. Si l'évolution par rapport à 1970 est saisissante (le même taux n'était que de 8%), c'est essentiellement parce que les femmes de 1970 avaient un statut d'aide familial, de travailleur à titre gratuit. L'agriculture n'est pas plus « féminine » qu'il y a 40 ans comme on a pu l'entendre dans la presse récemment. Il faudrait plutôt dire qu'elle donne aujourd'hui plus souvent qu'avant un statut professionnel reconnu aux conjointes qui travaillent sur l'exploitation. En 2010 cependant, 62% des conjoints actifs sur l'exploitation et qui n'ont pas le statut de coexploitant sont des femmes (Laisney, 2012).
* 81 Et même un choix réversible s'il n'est pas satisfaisant pour la conjointe (Dufour, Giraud, 2012).
* 82 Il faudrait ajouter un troisième groupe qui est celui des agriculteurs sans ascendance familiale agricole qui représente, en 1999, environ 15% des agriculteurs.







