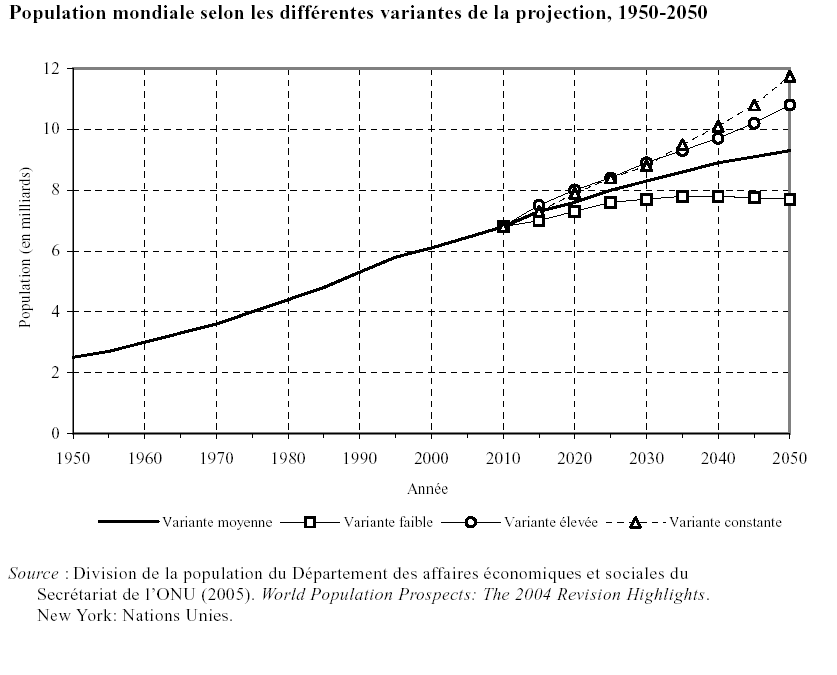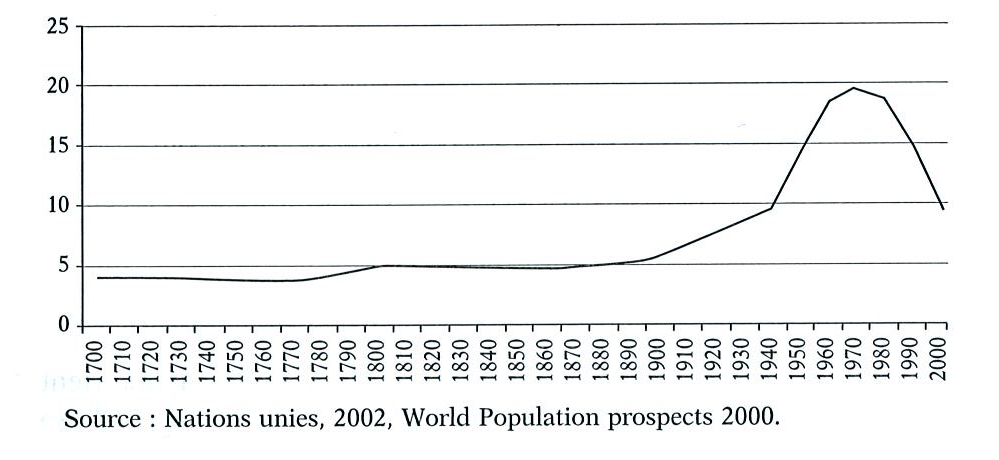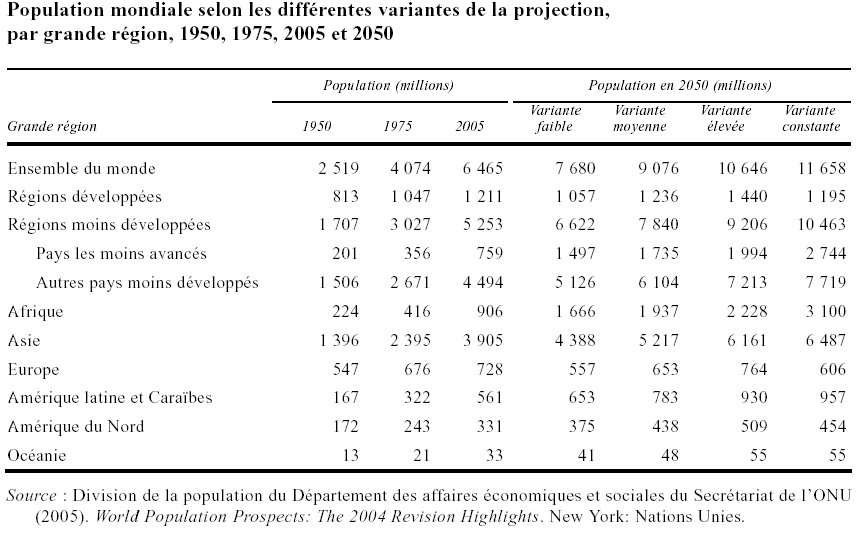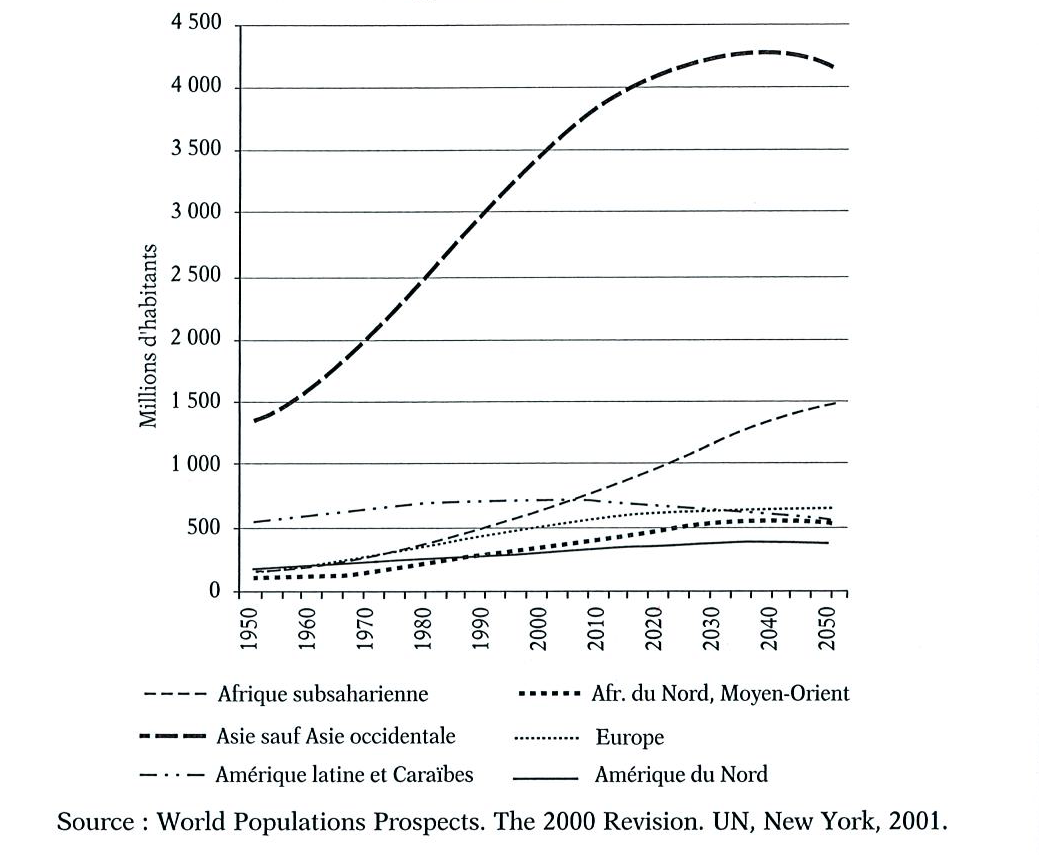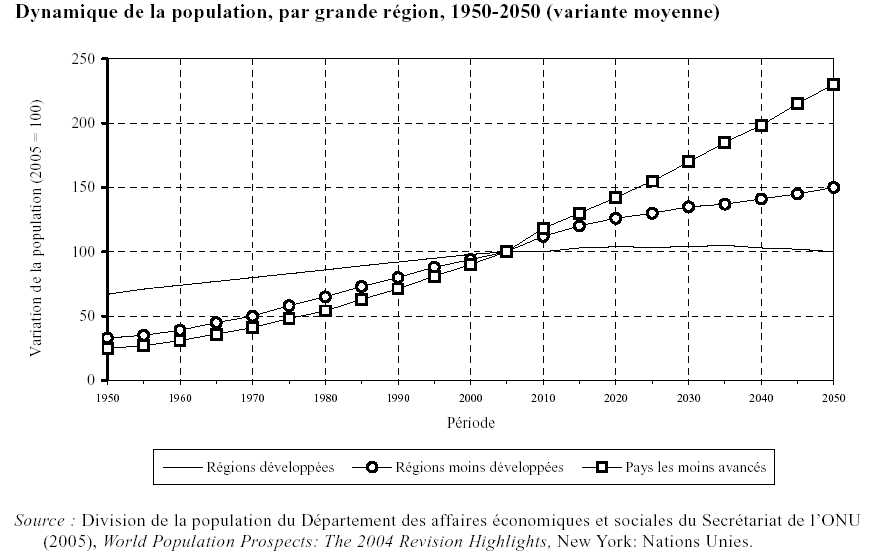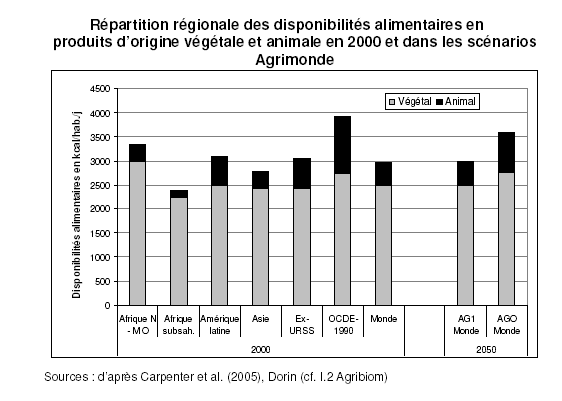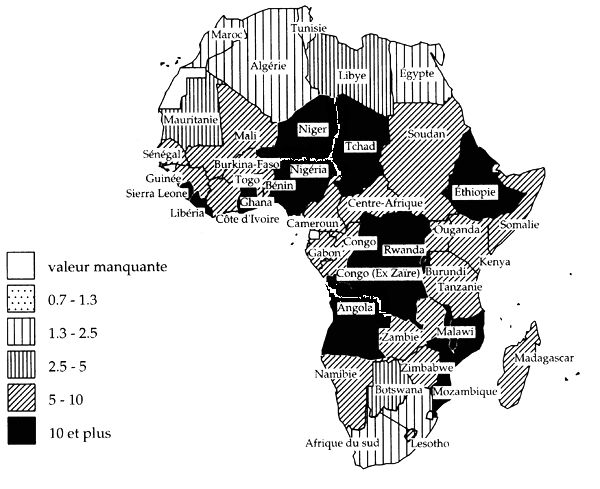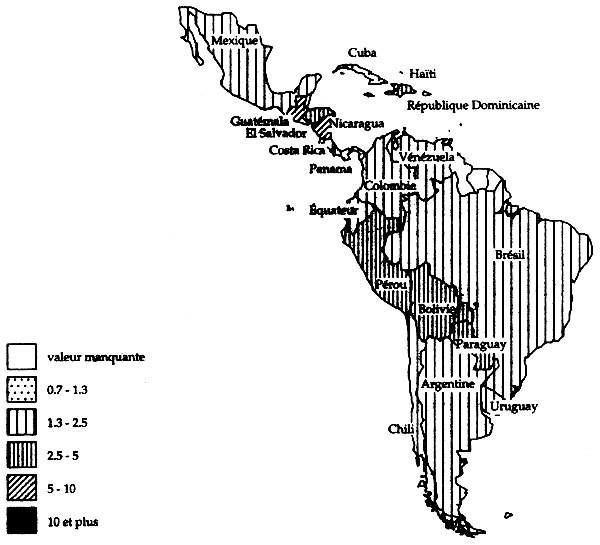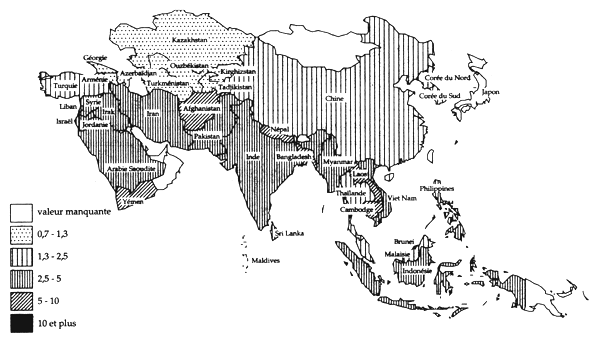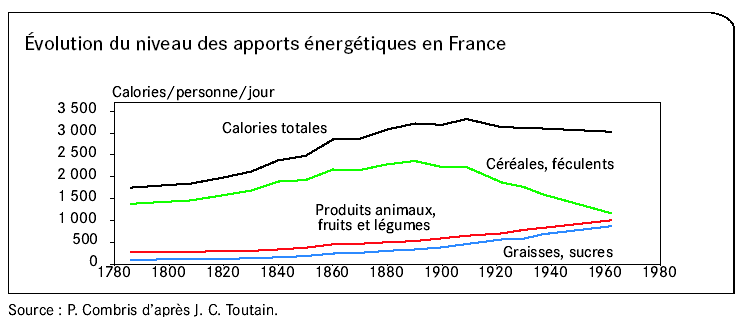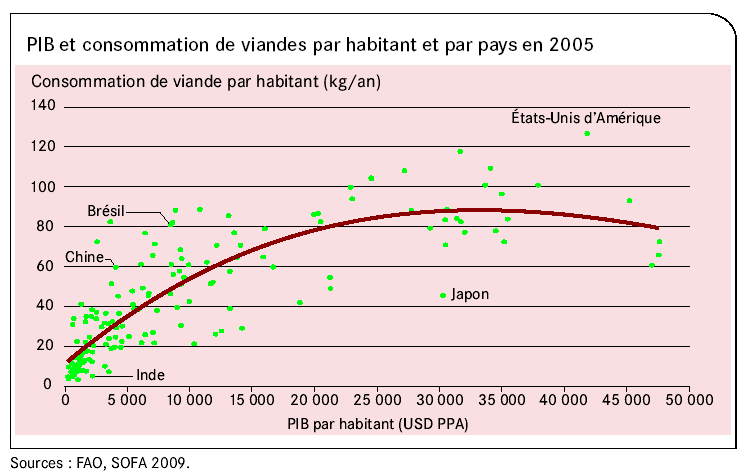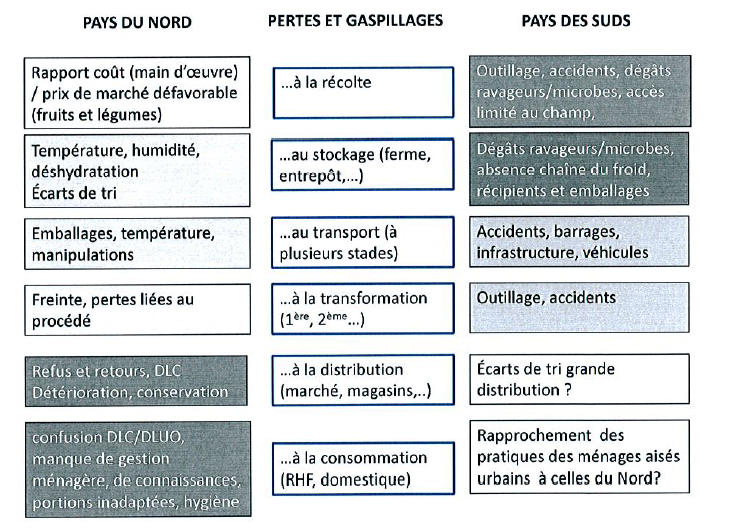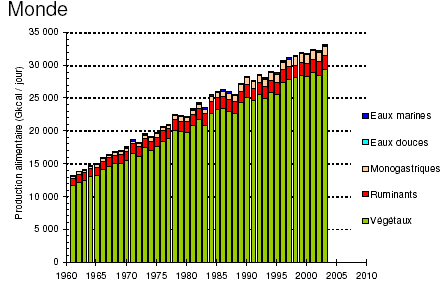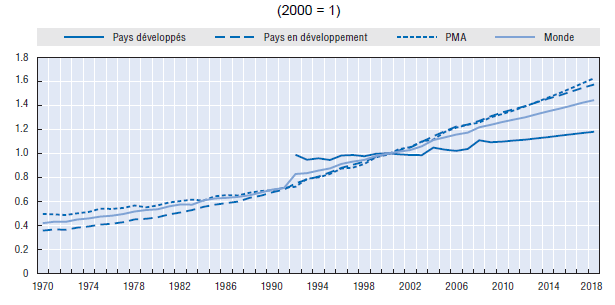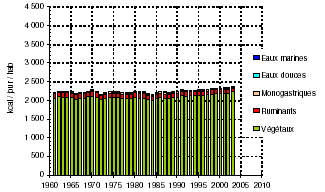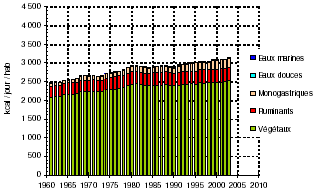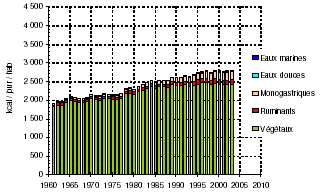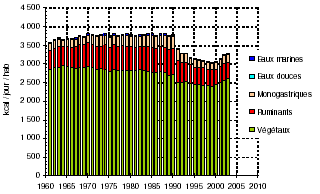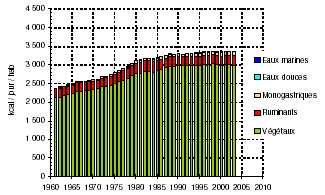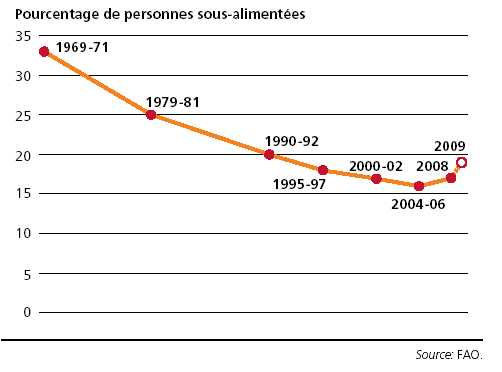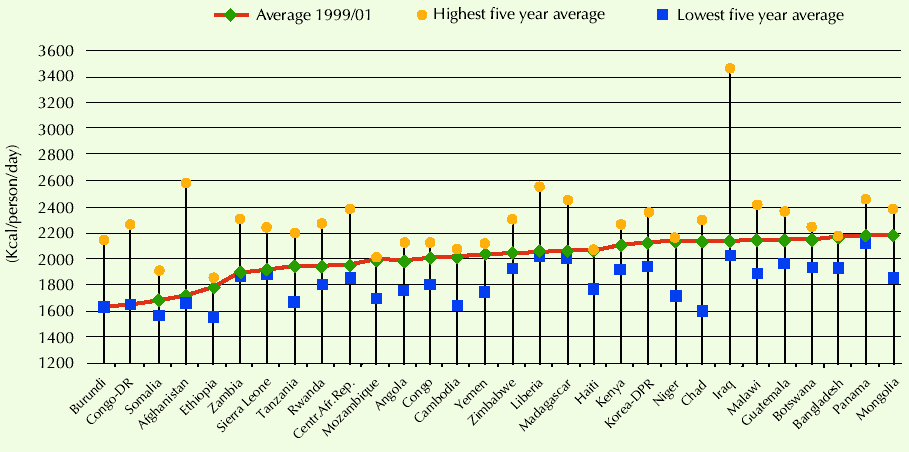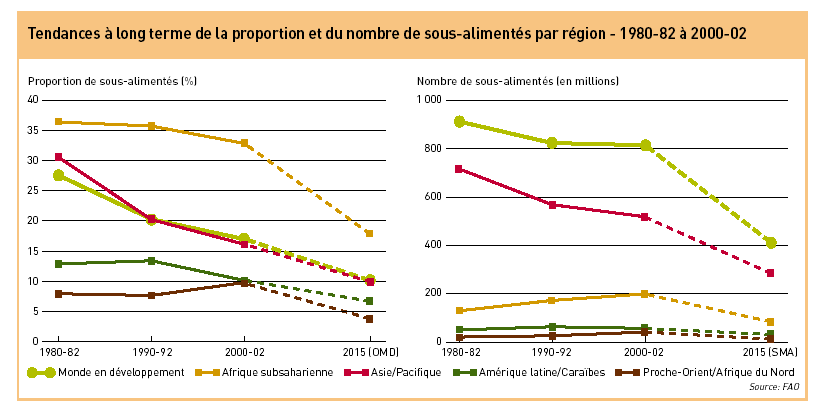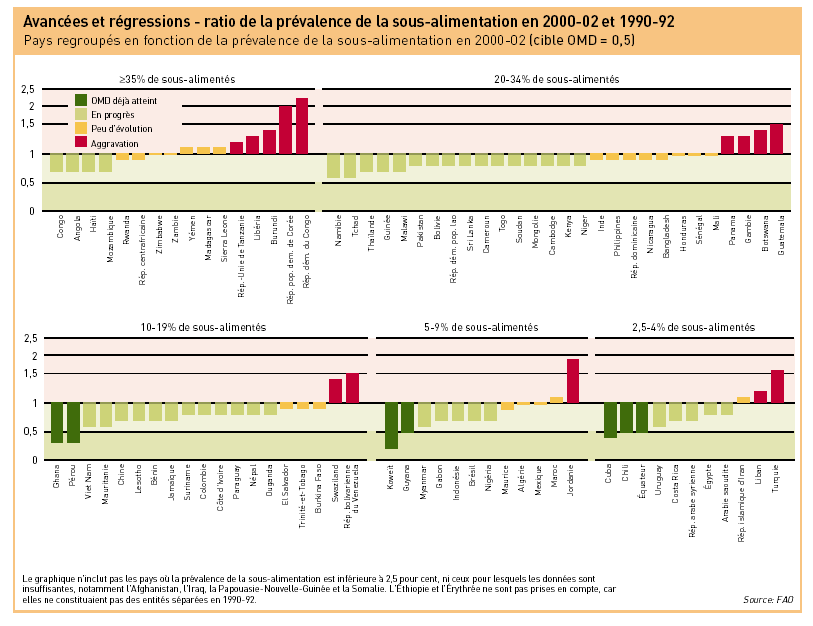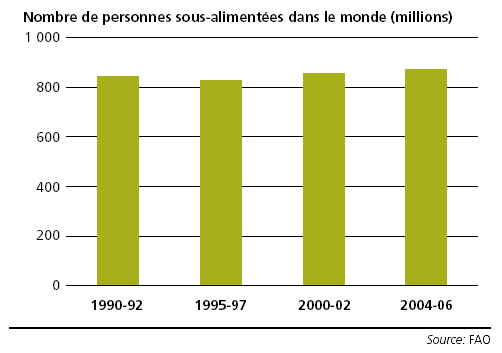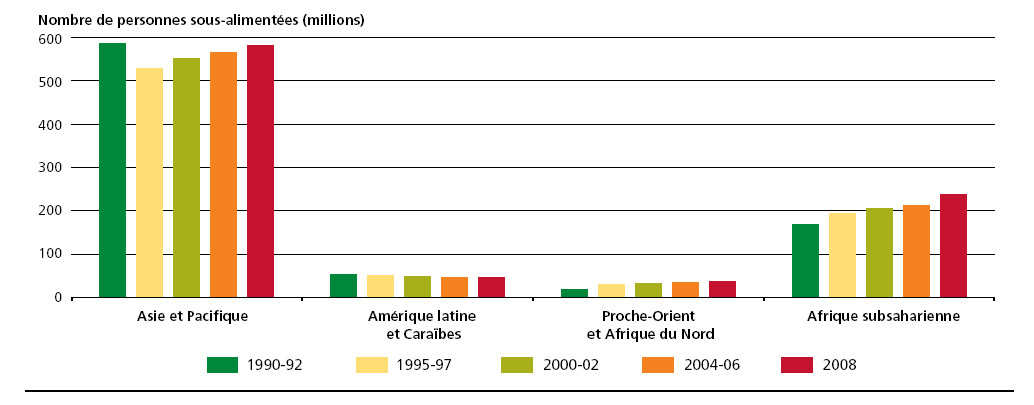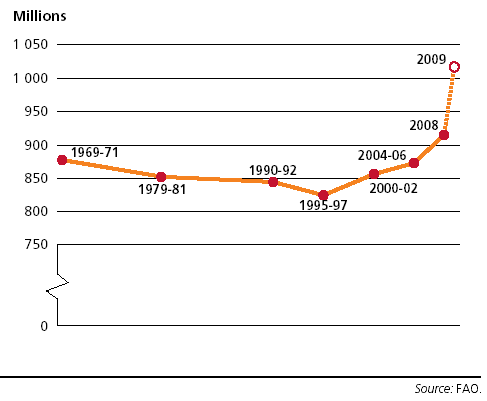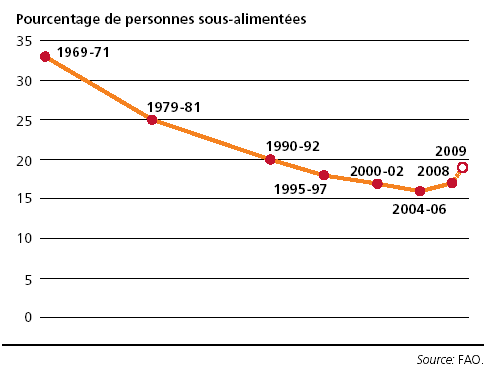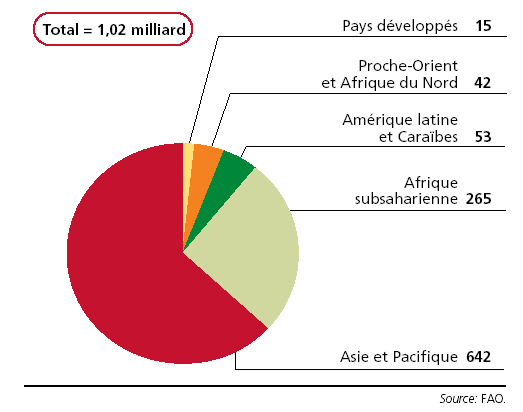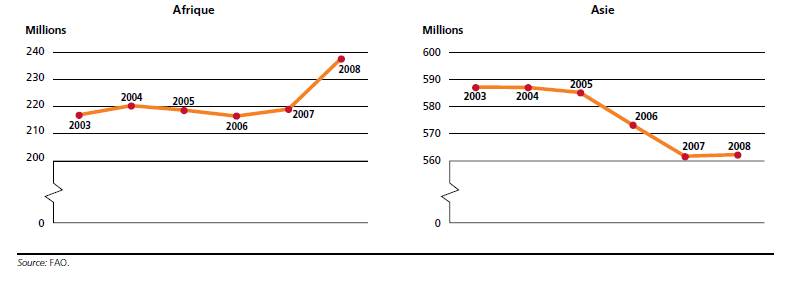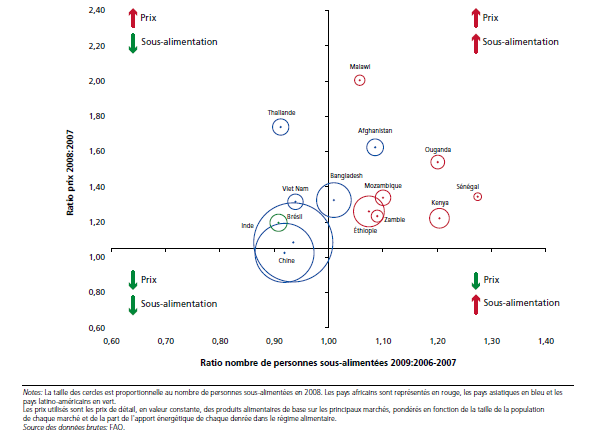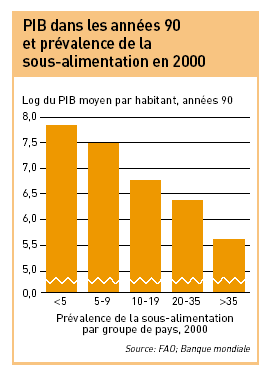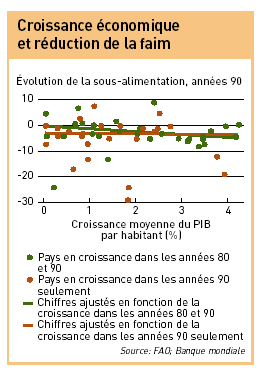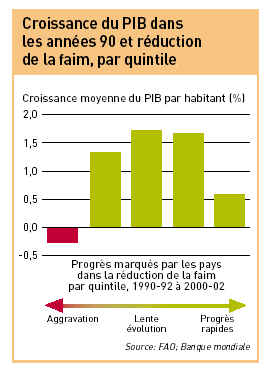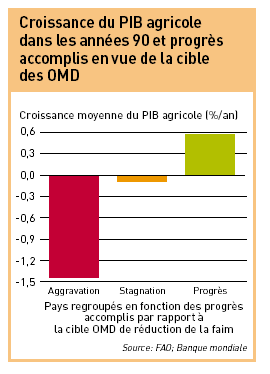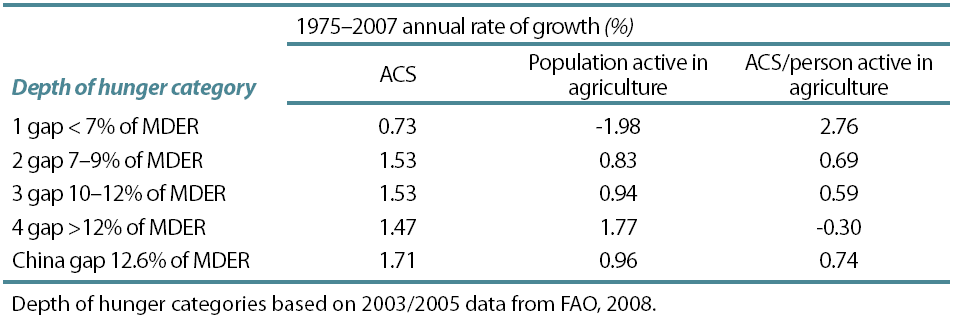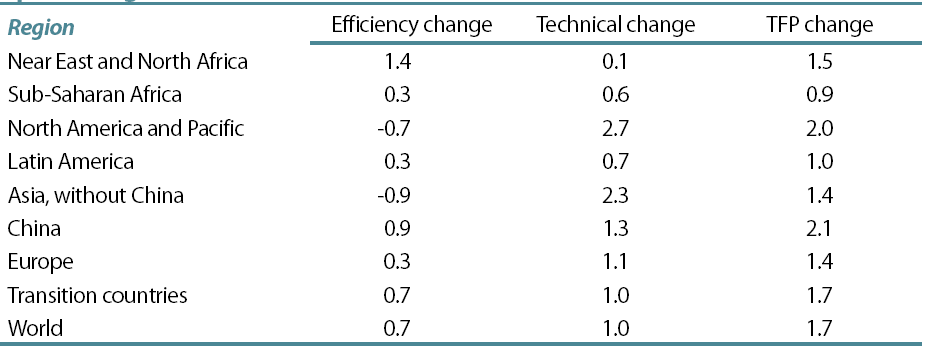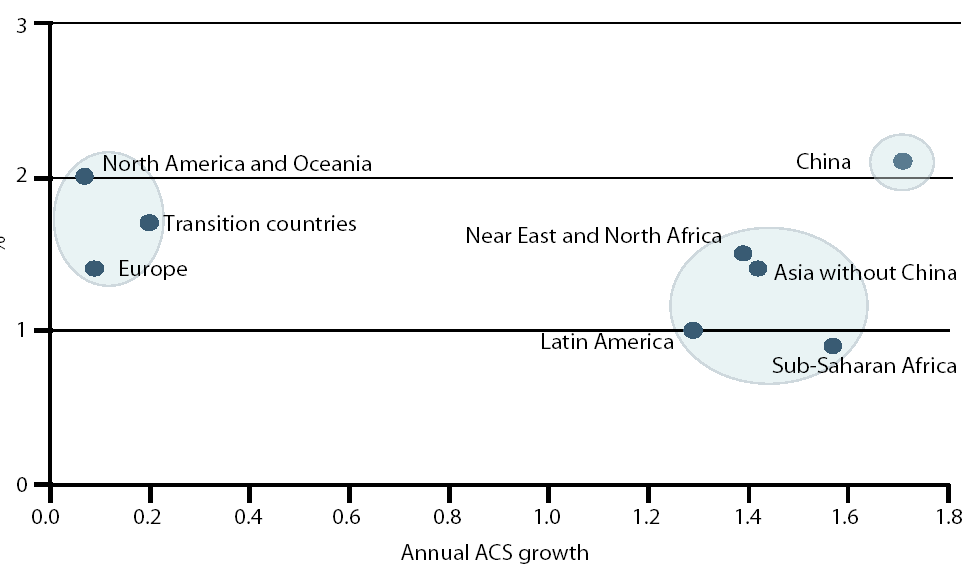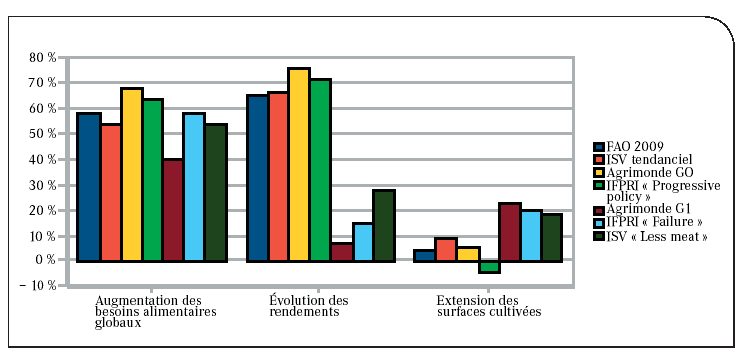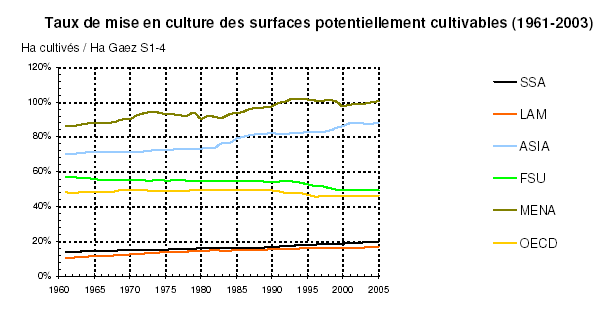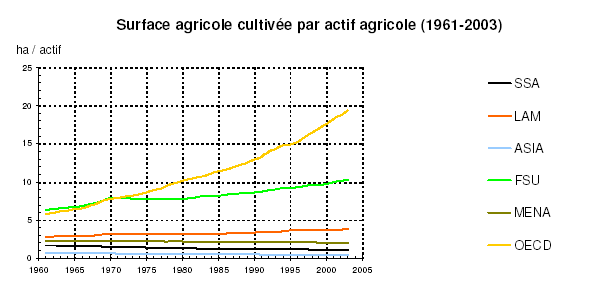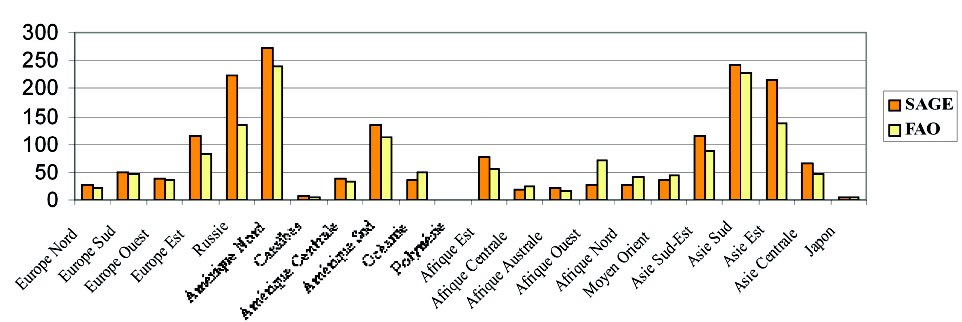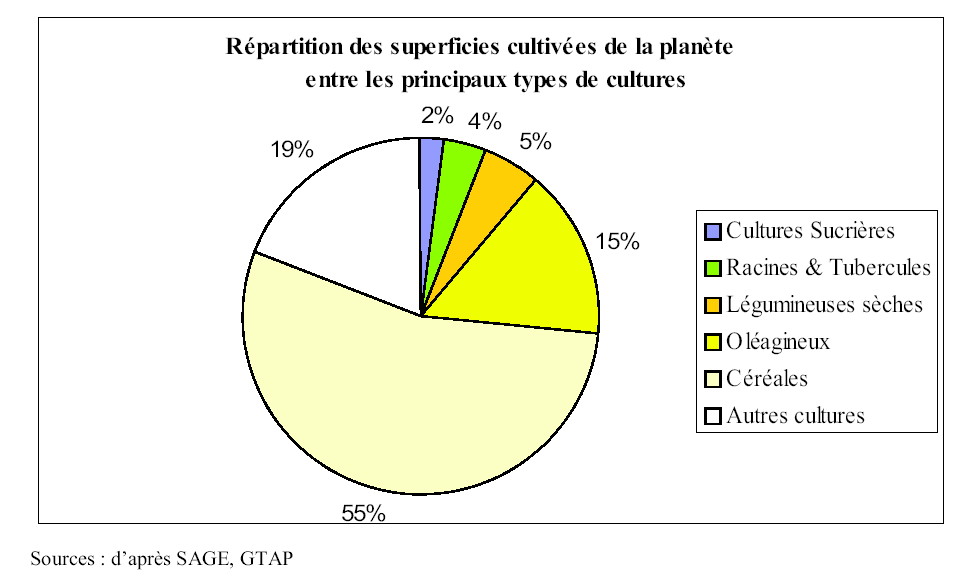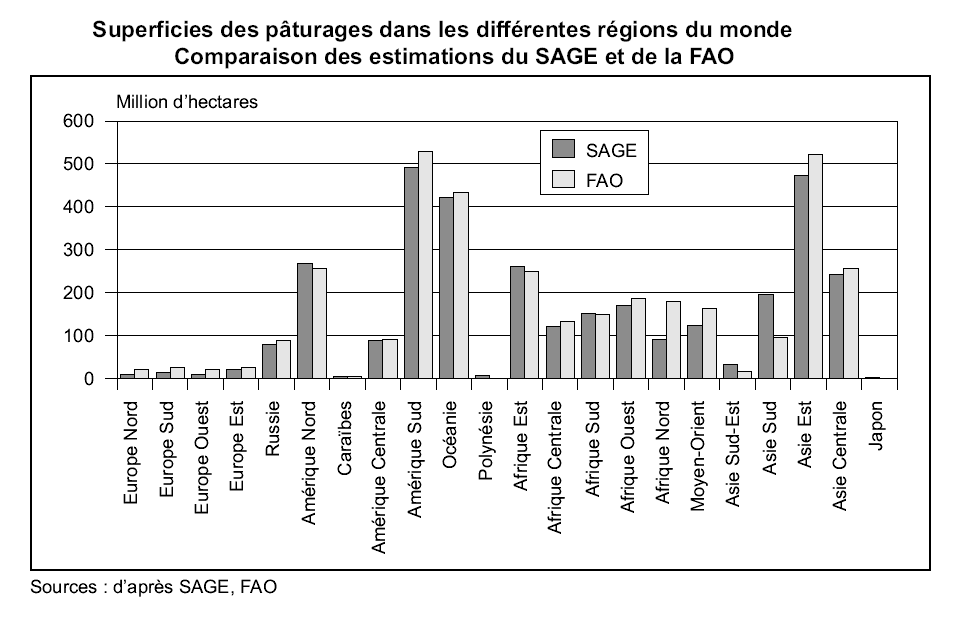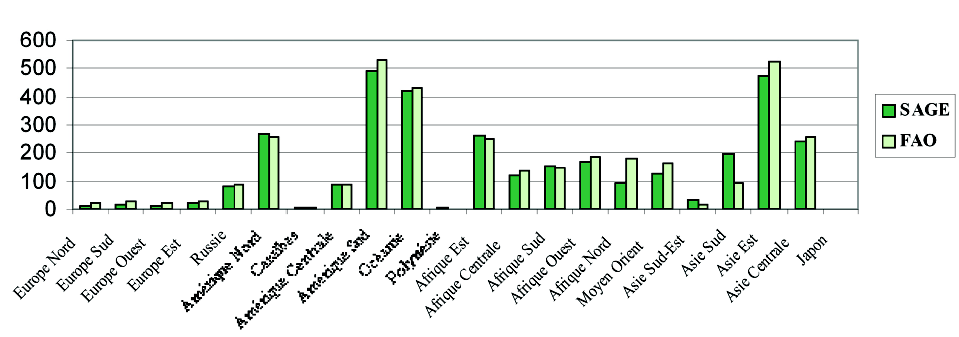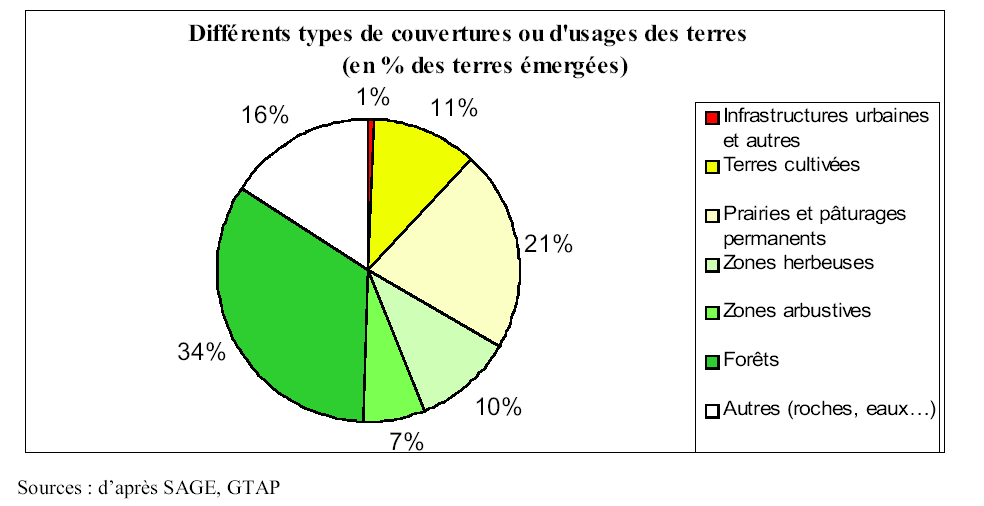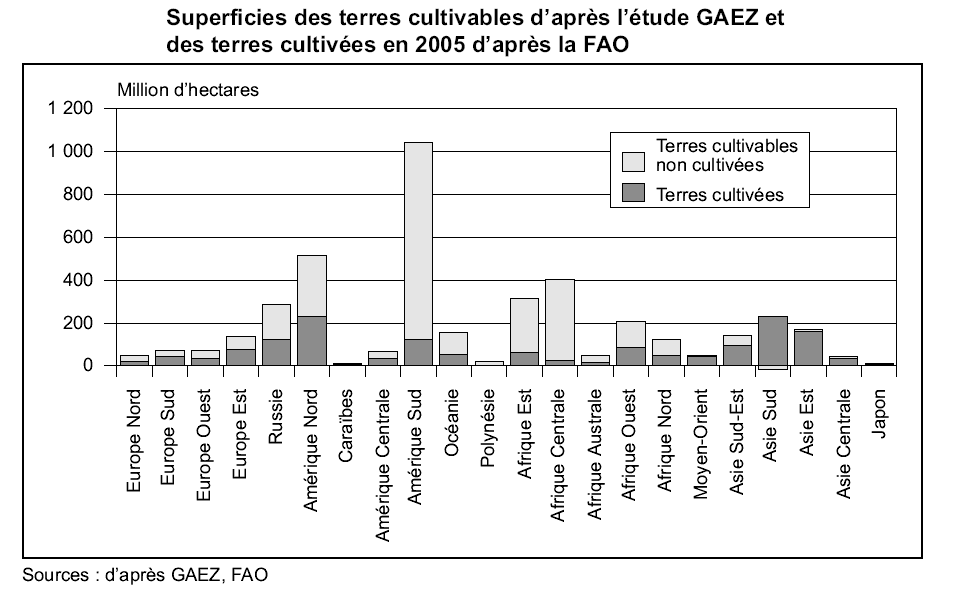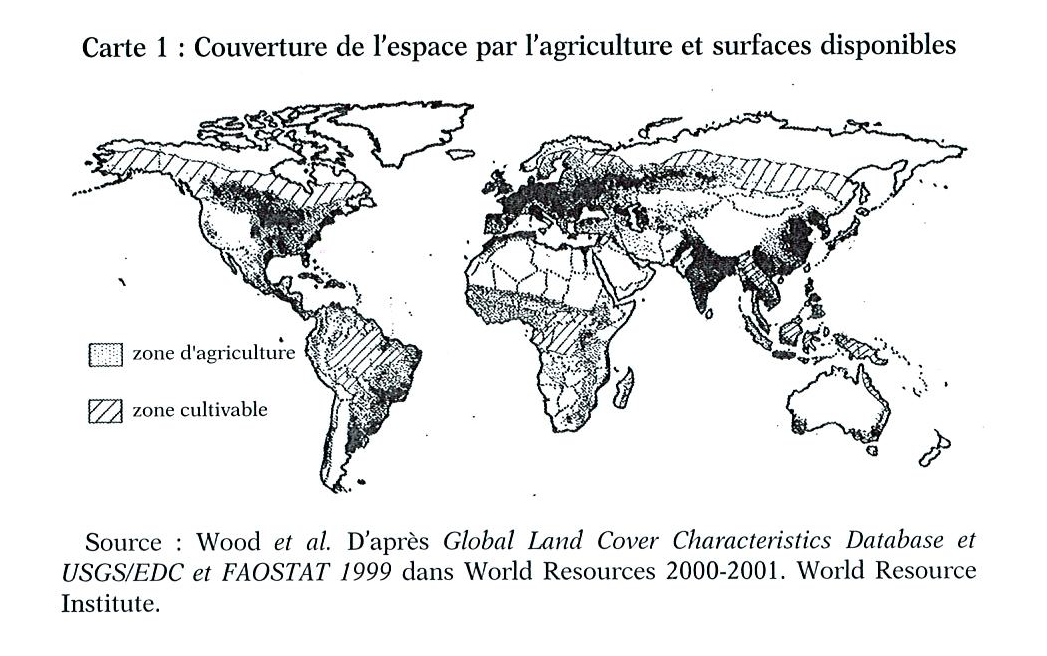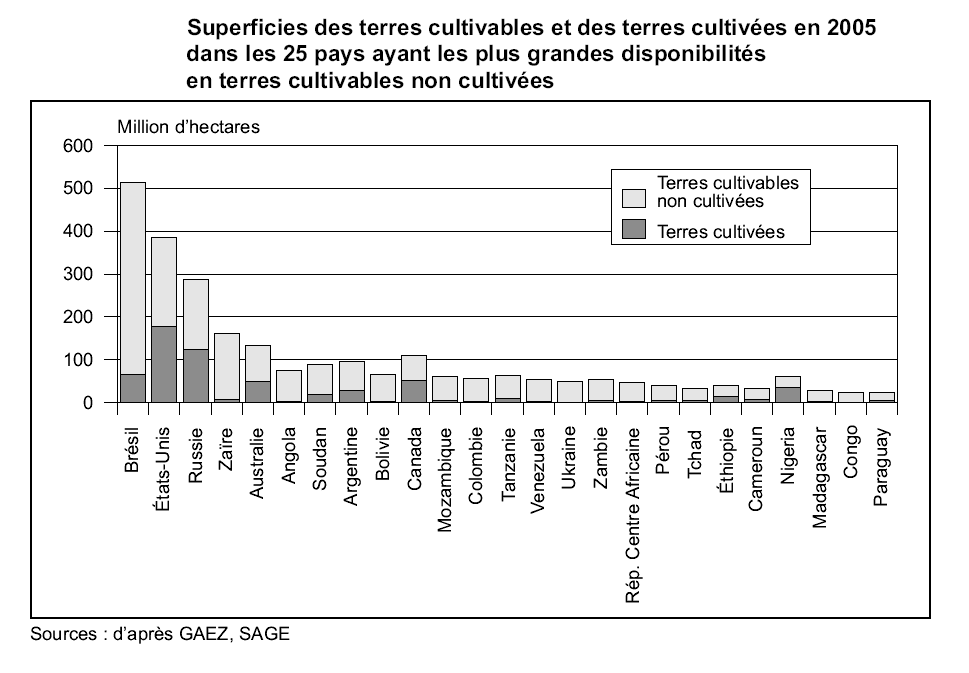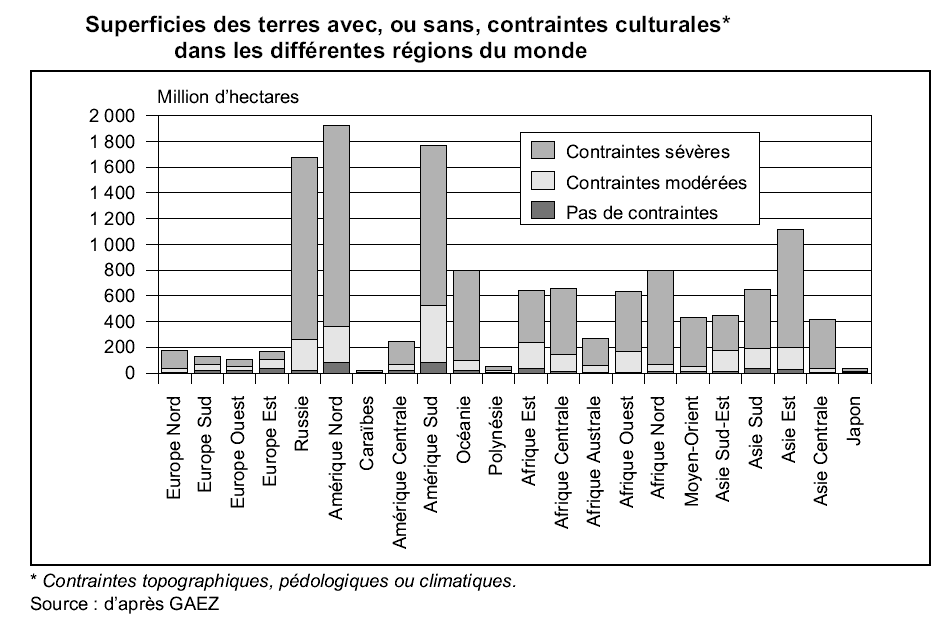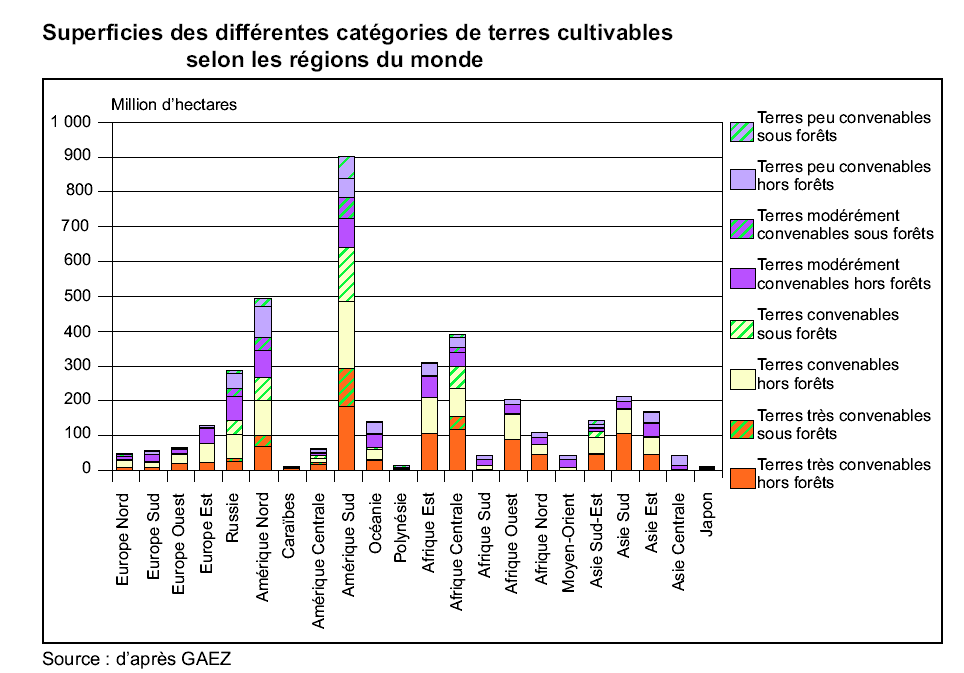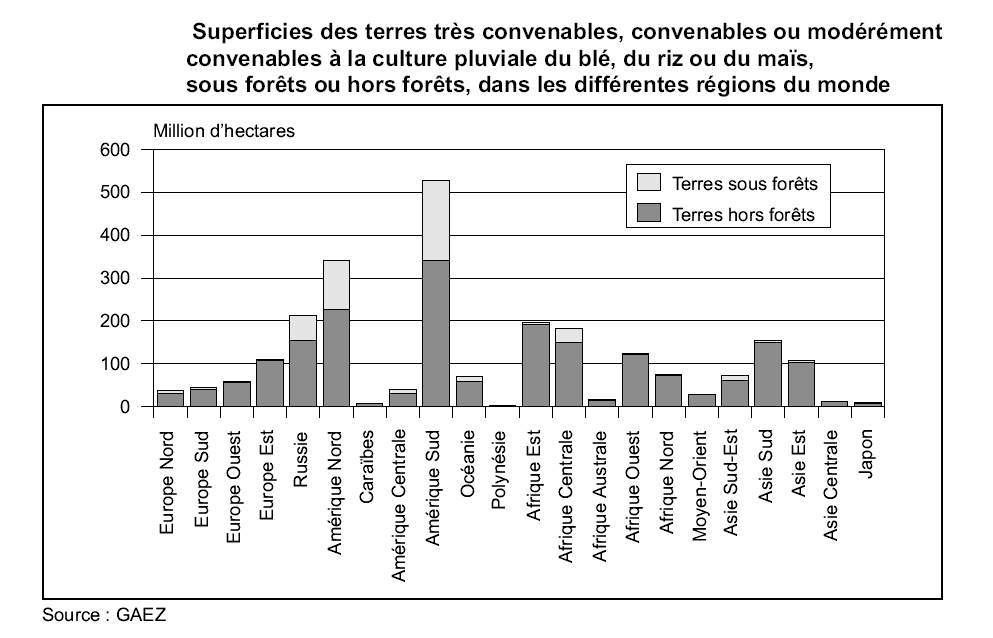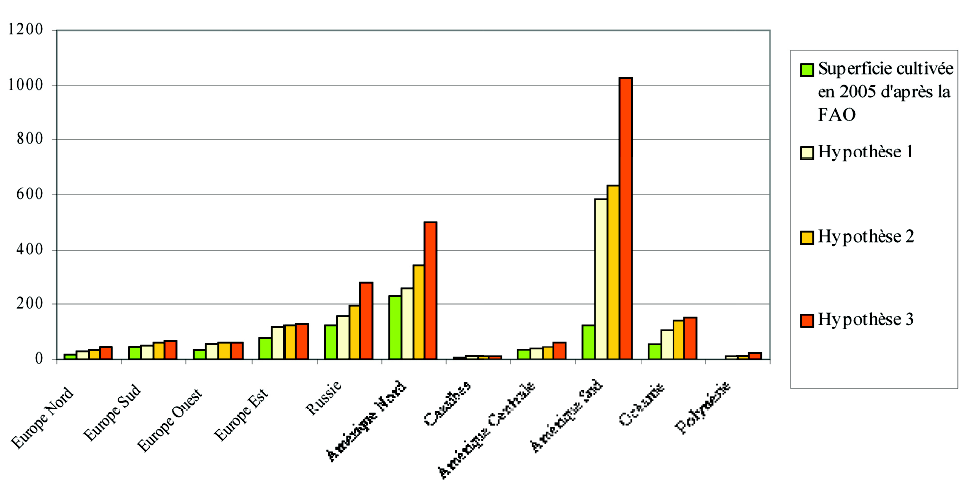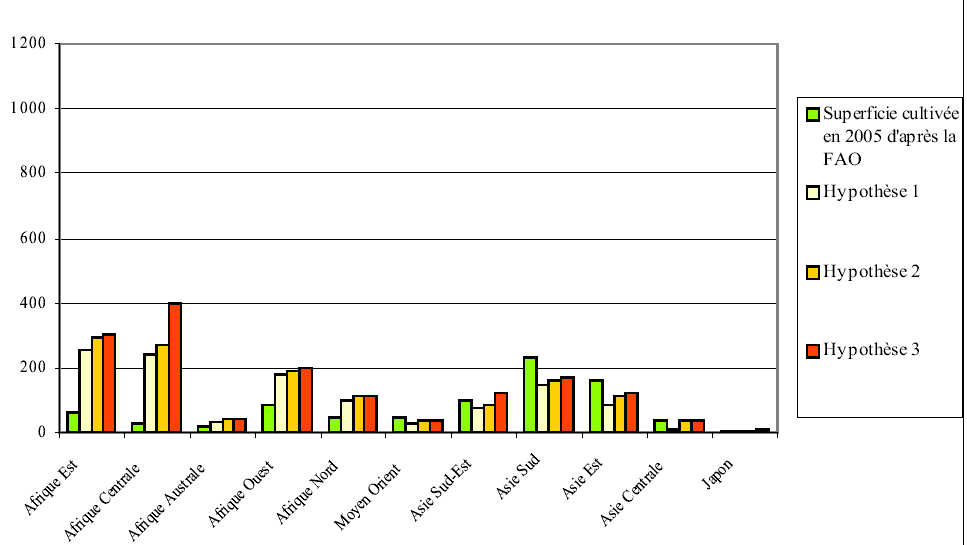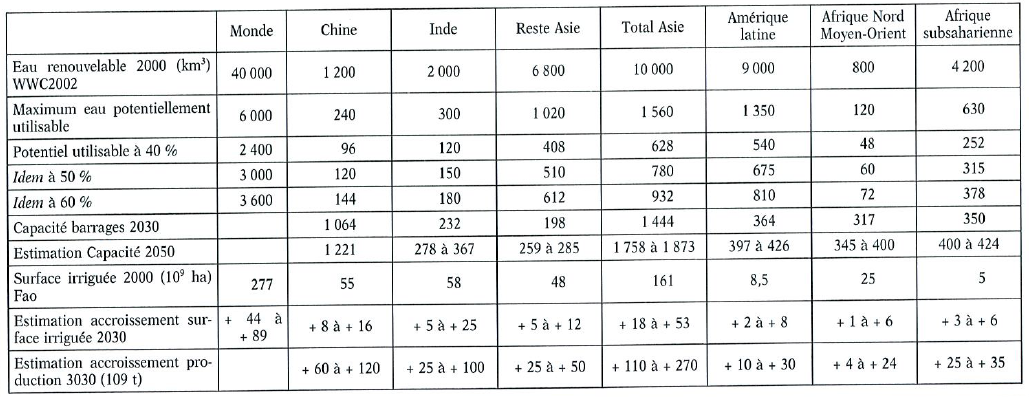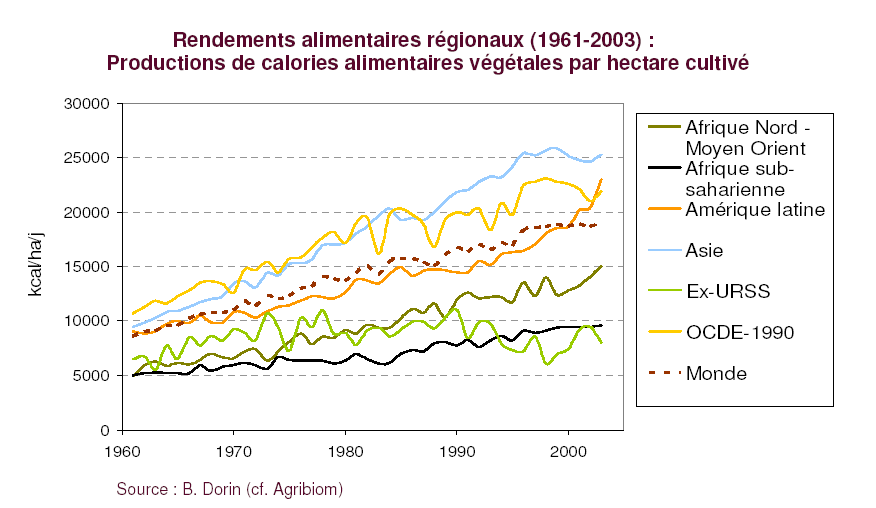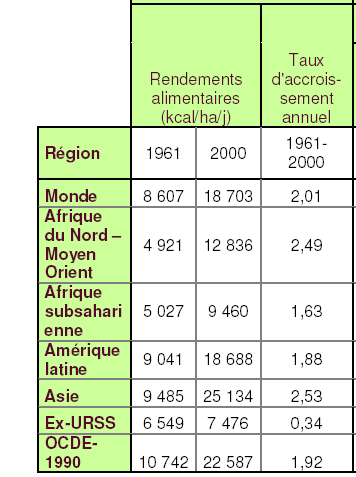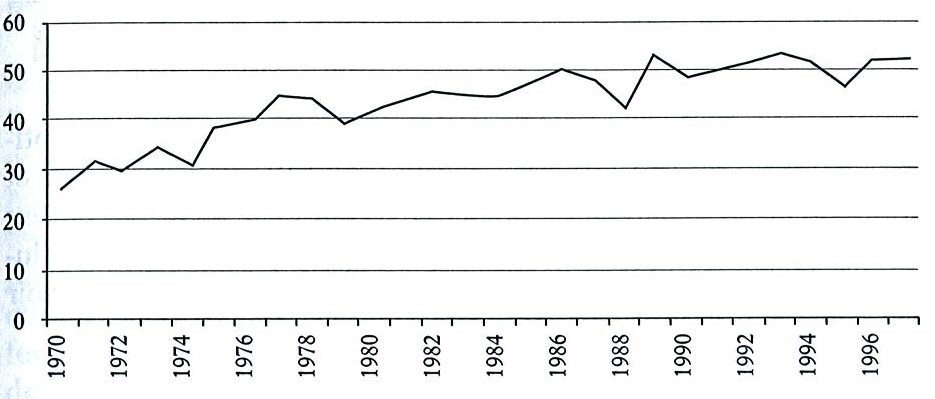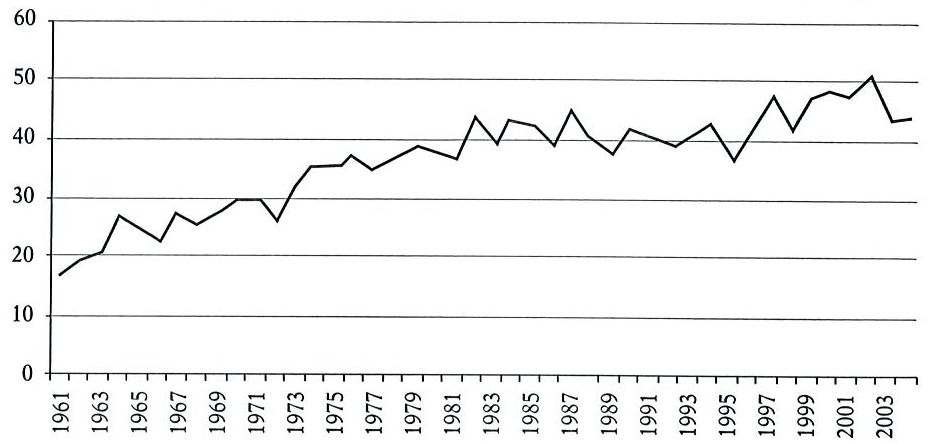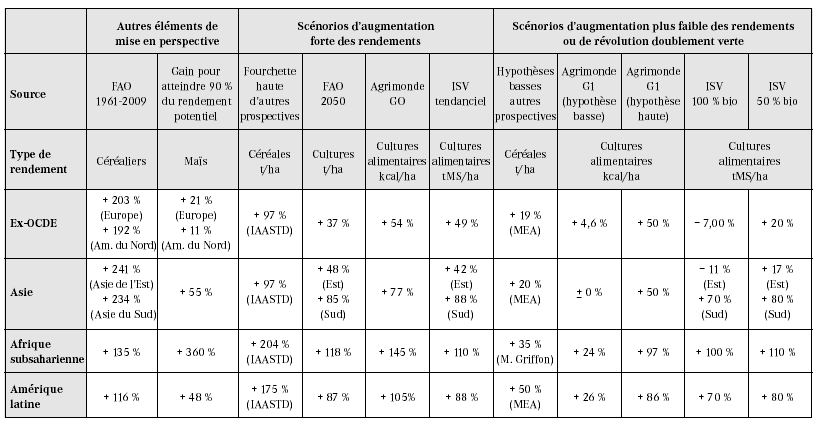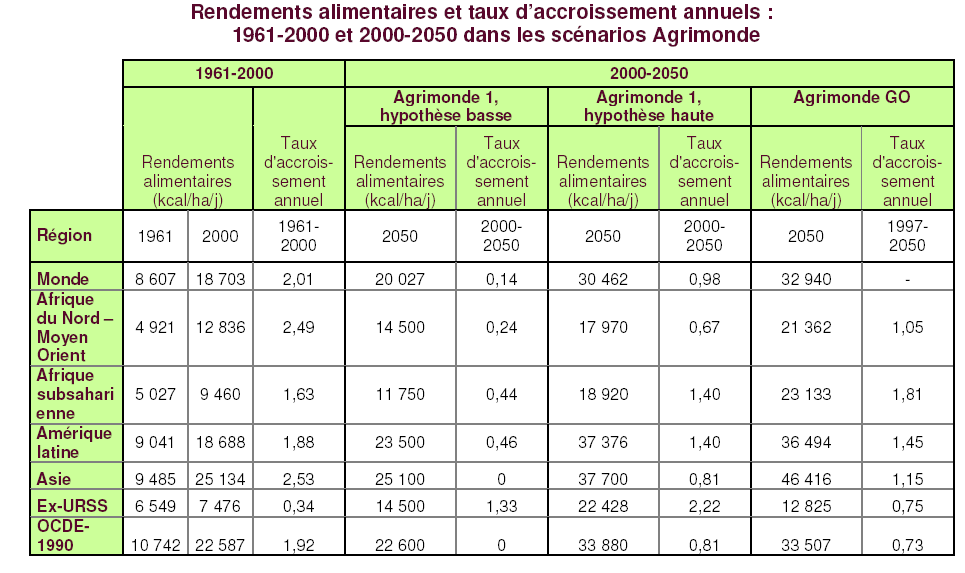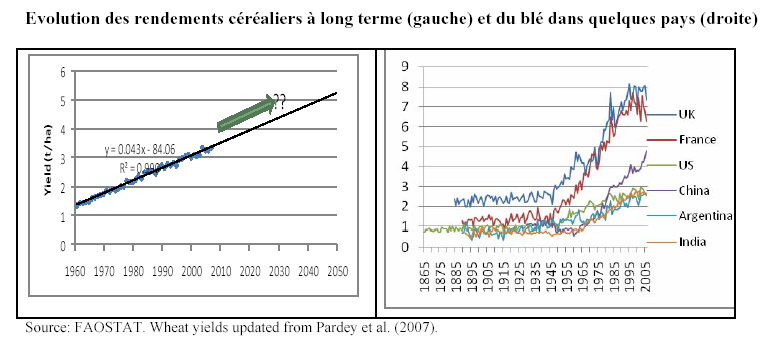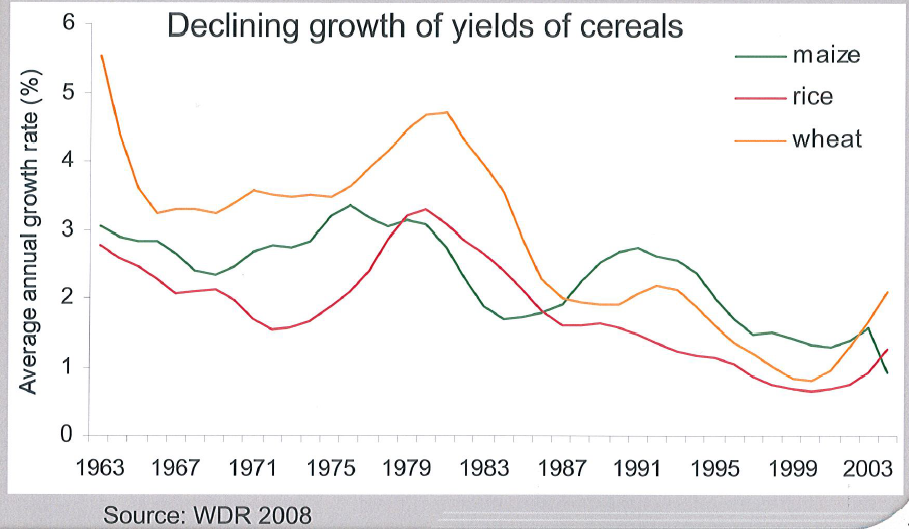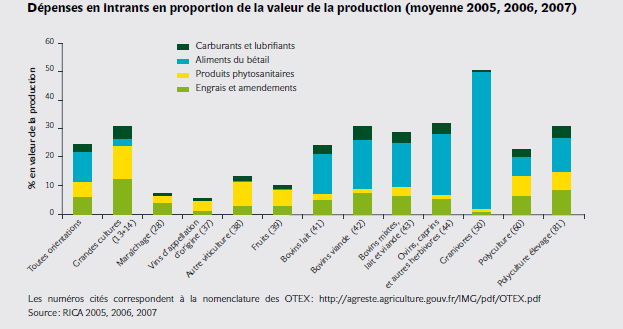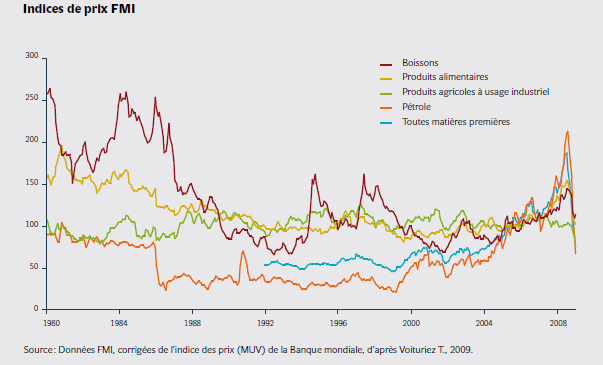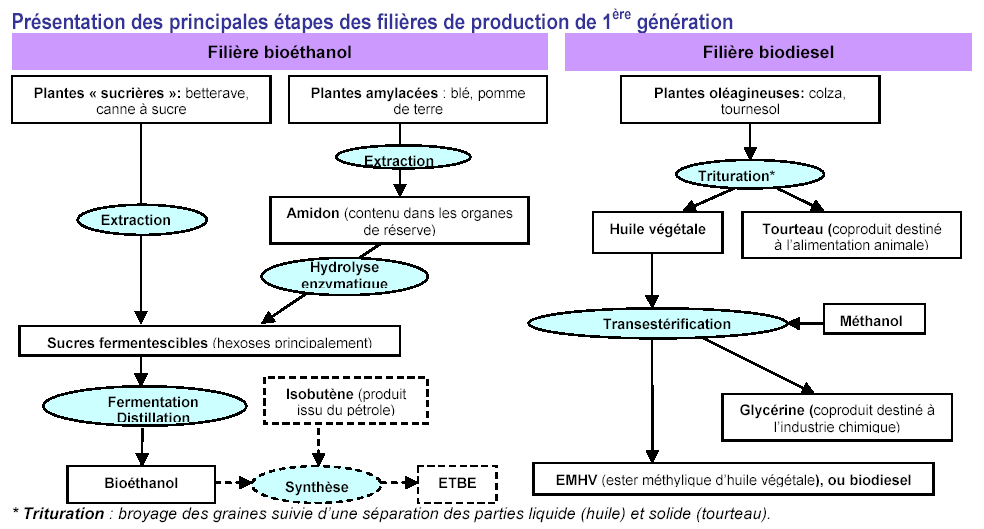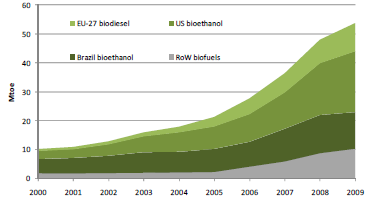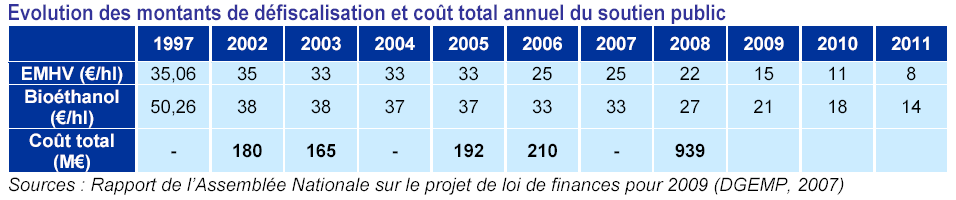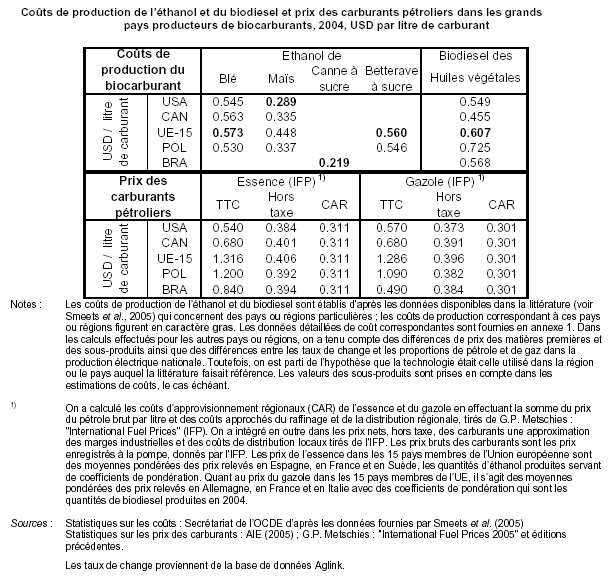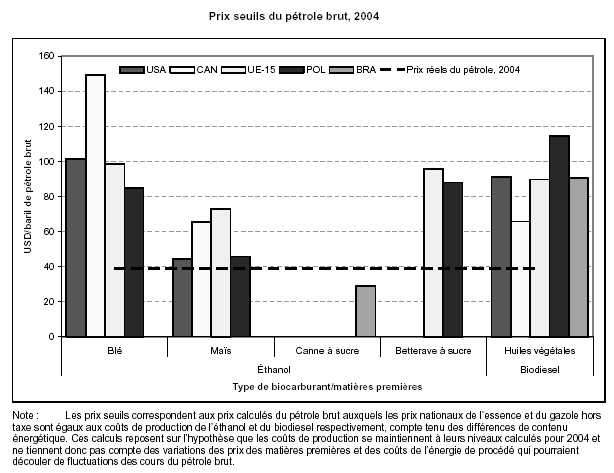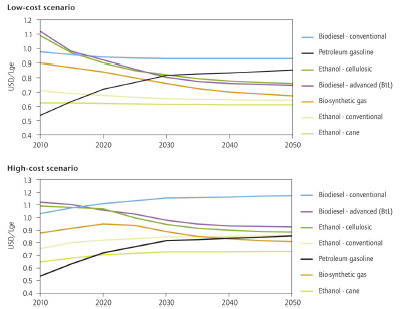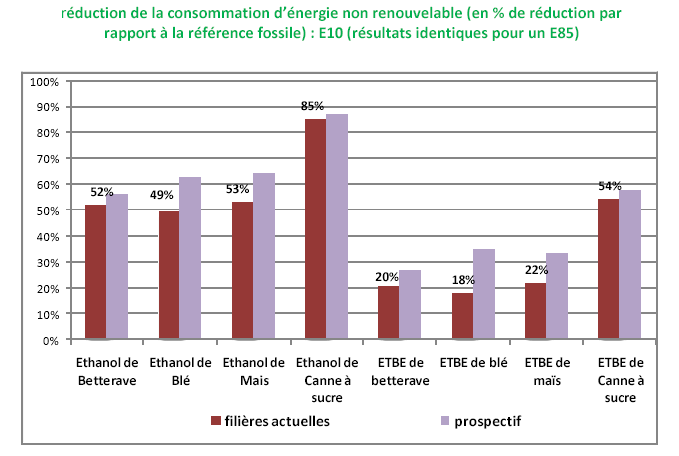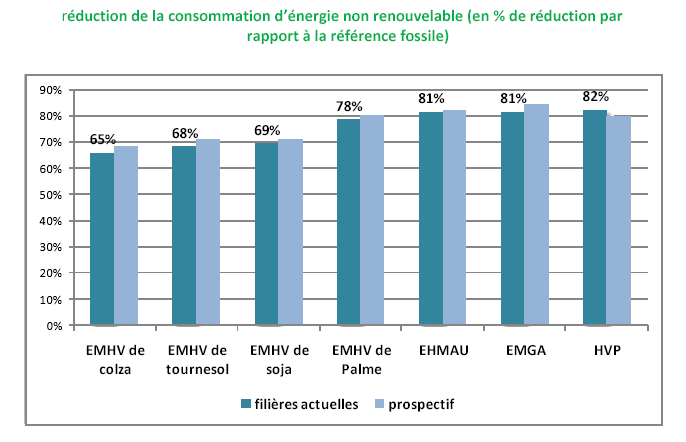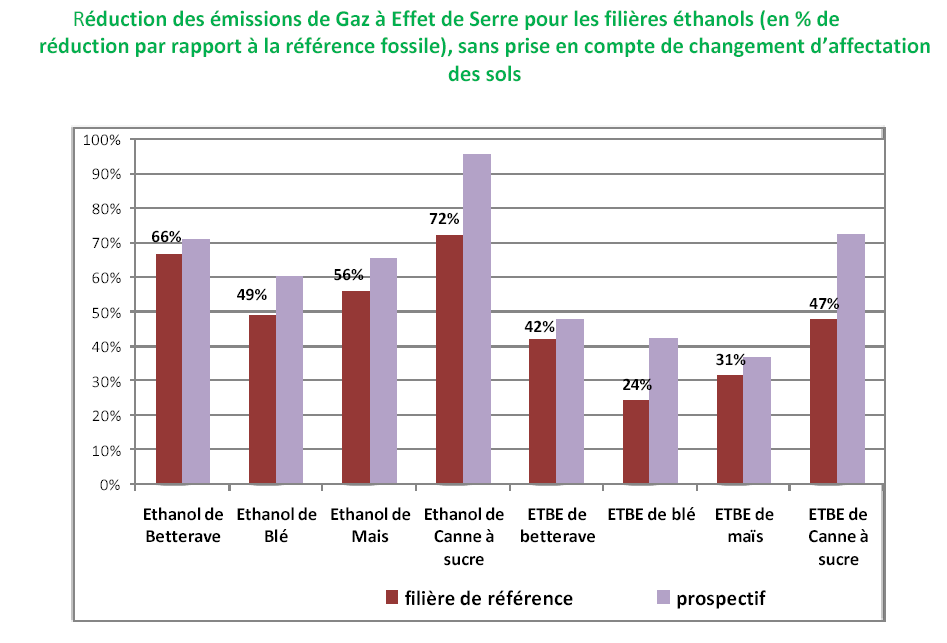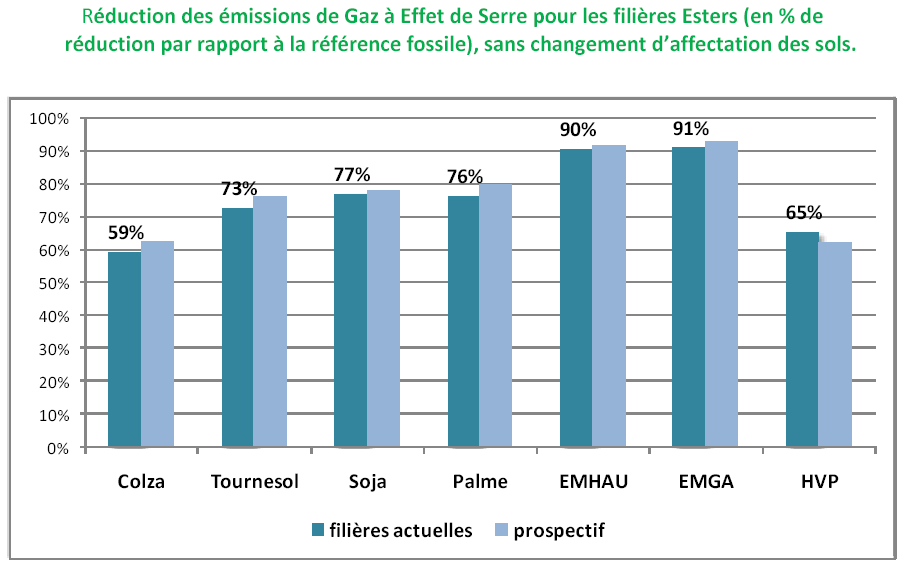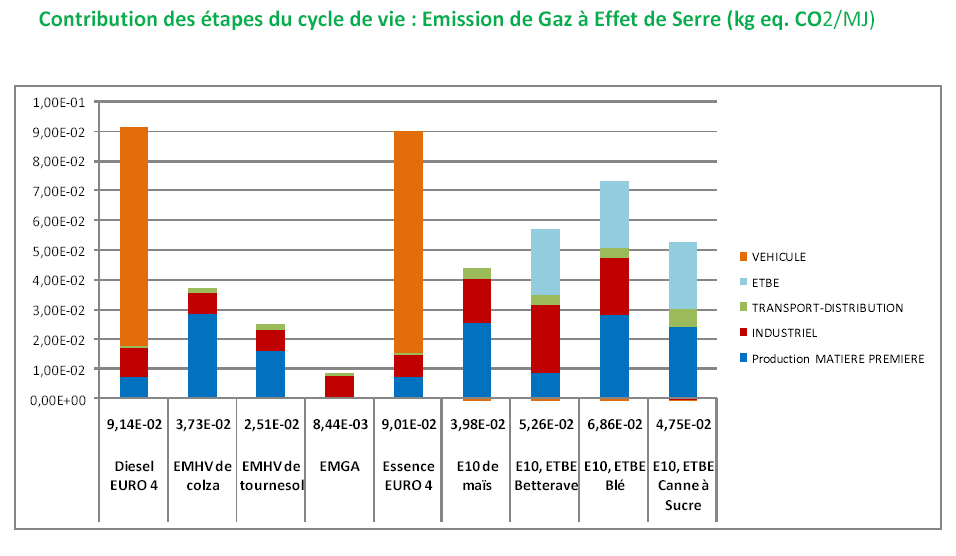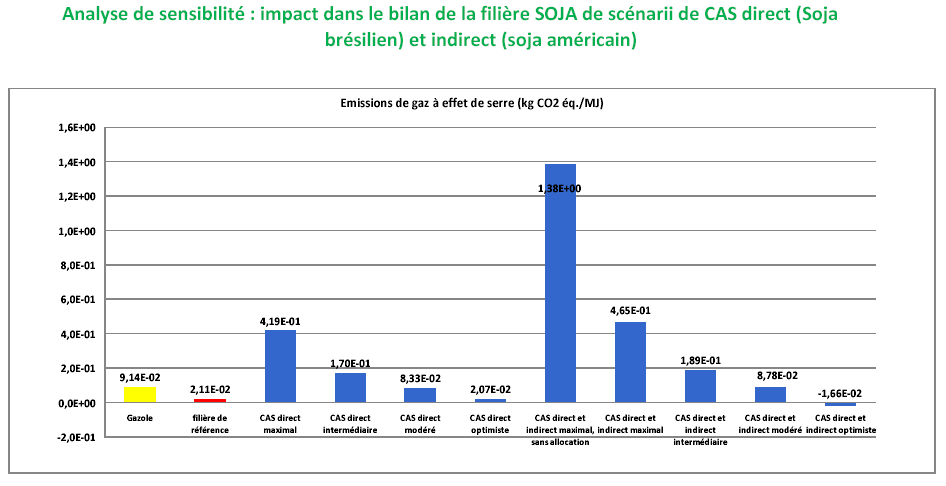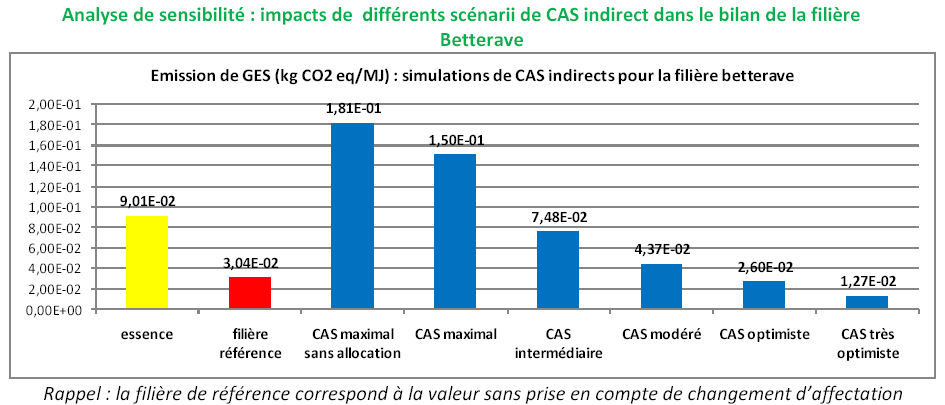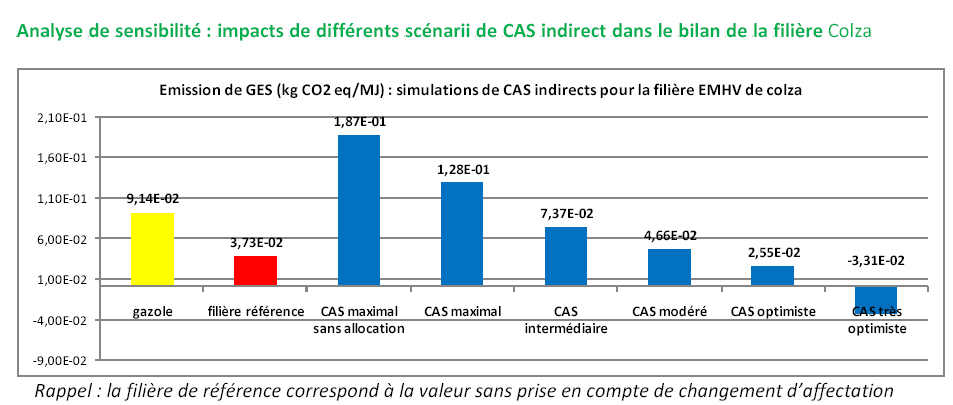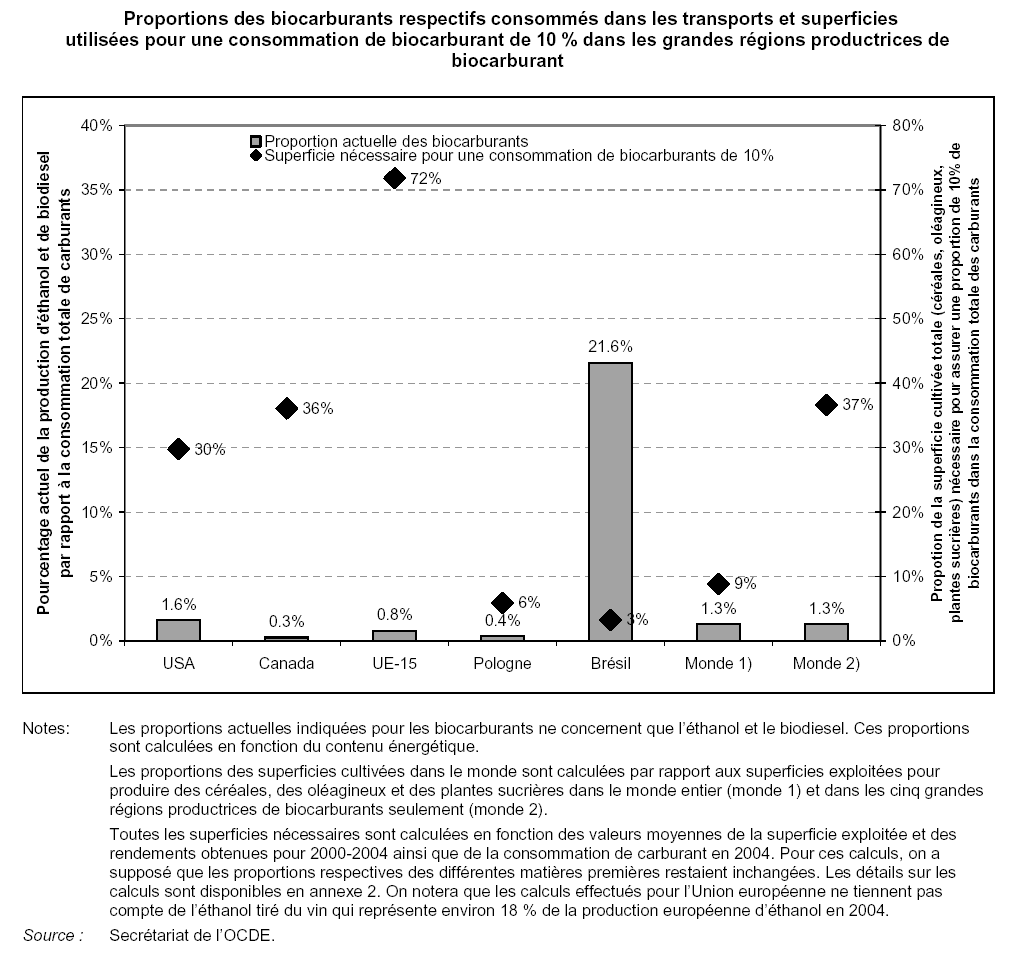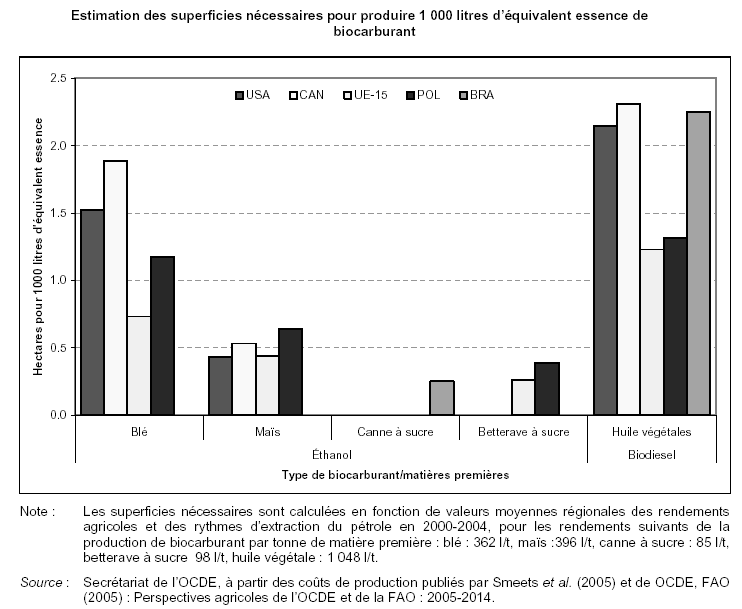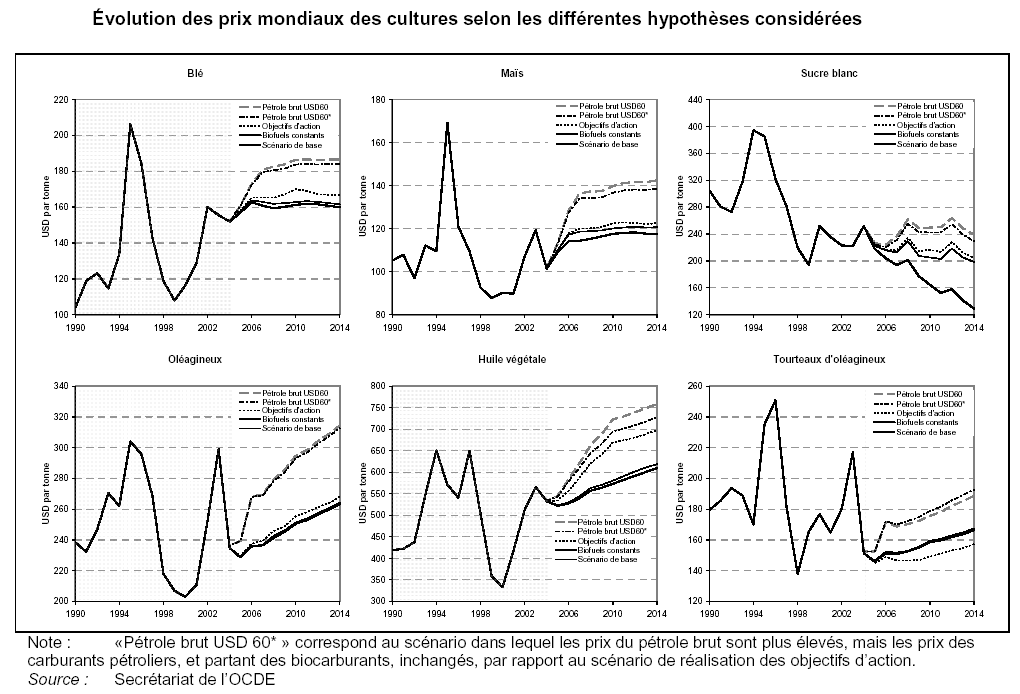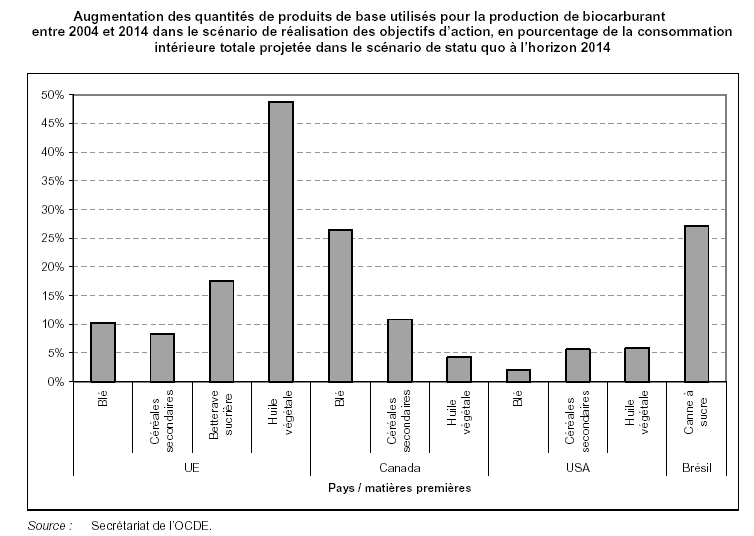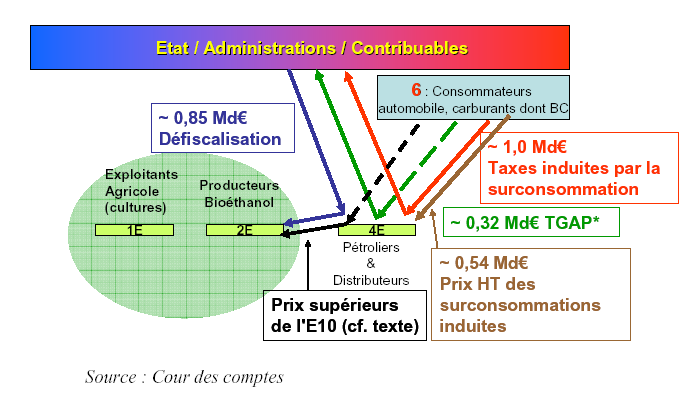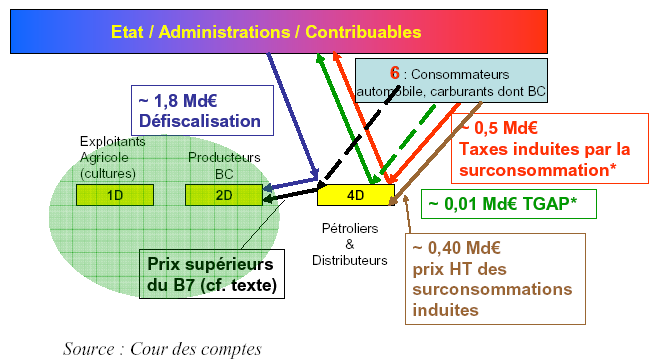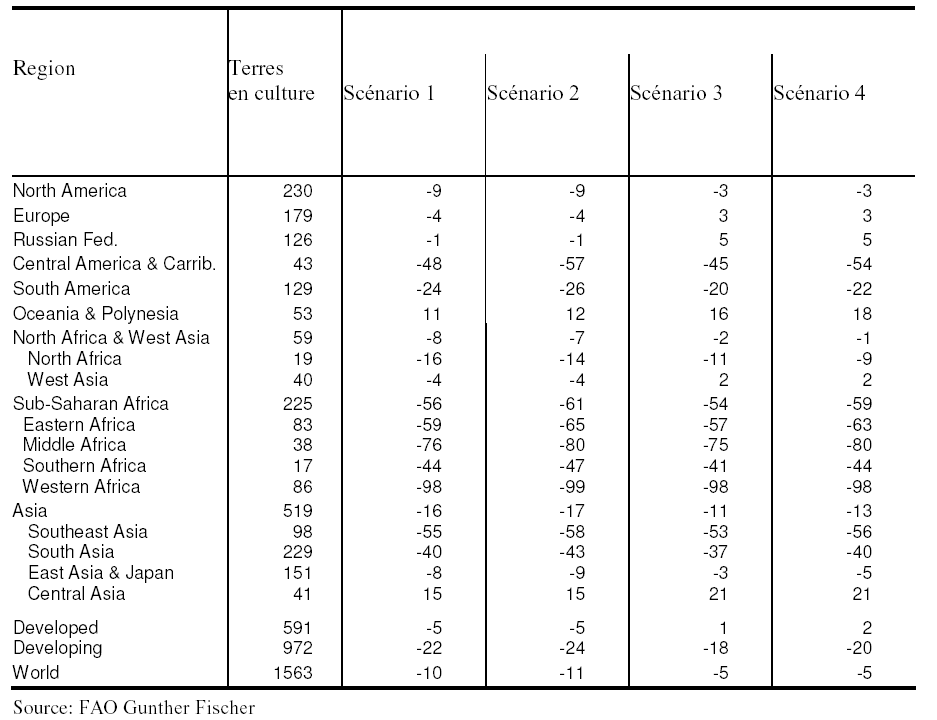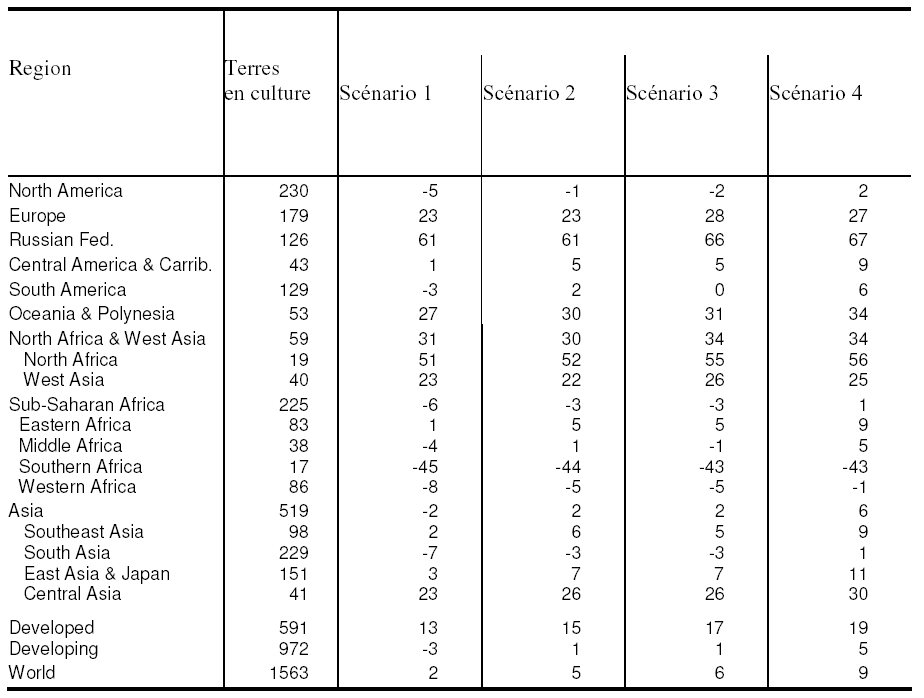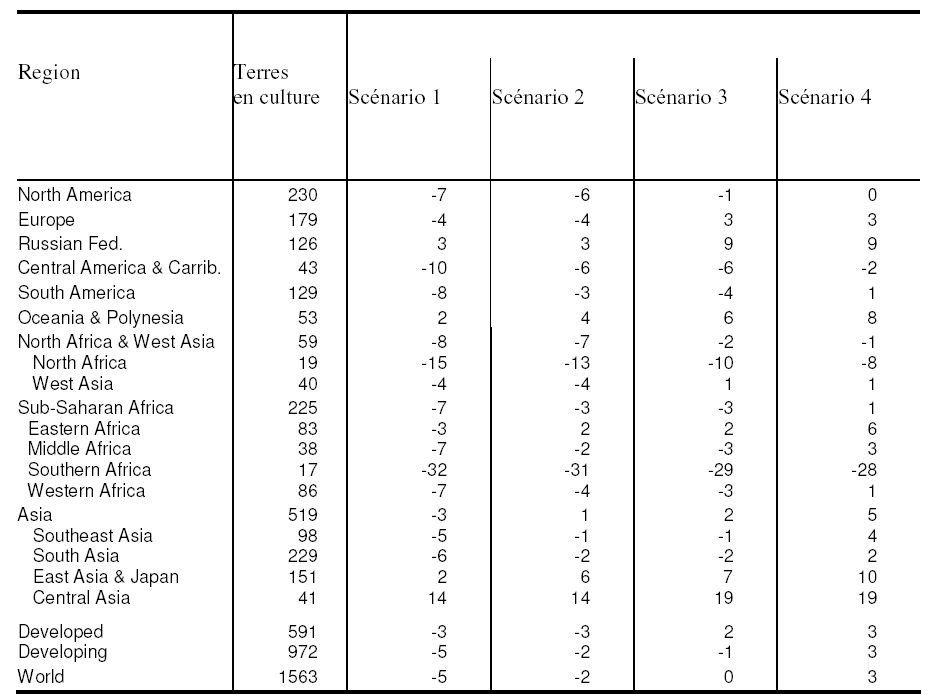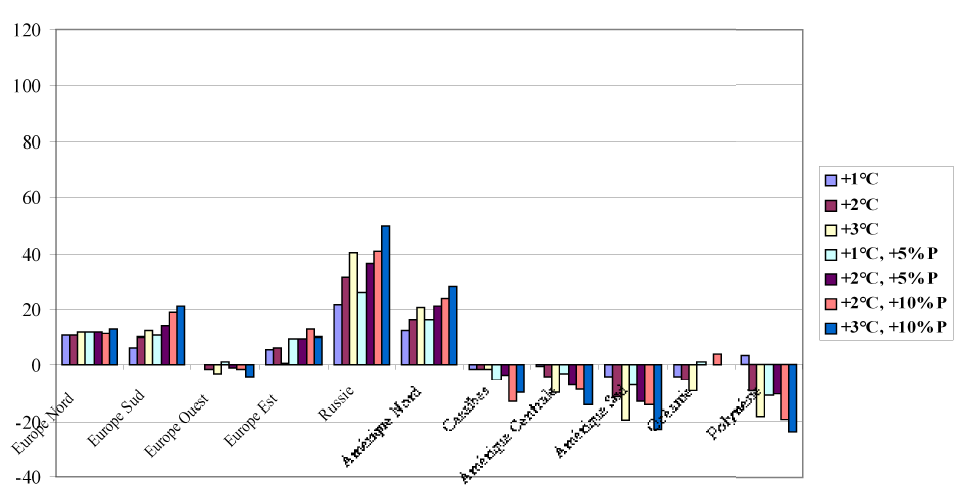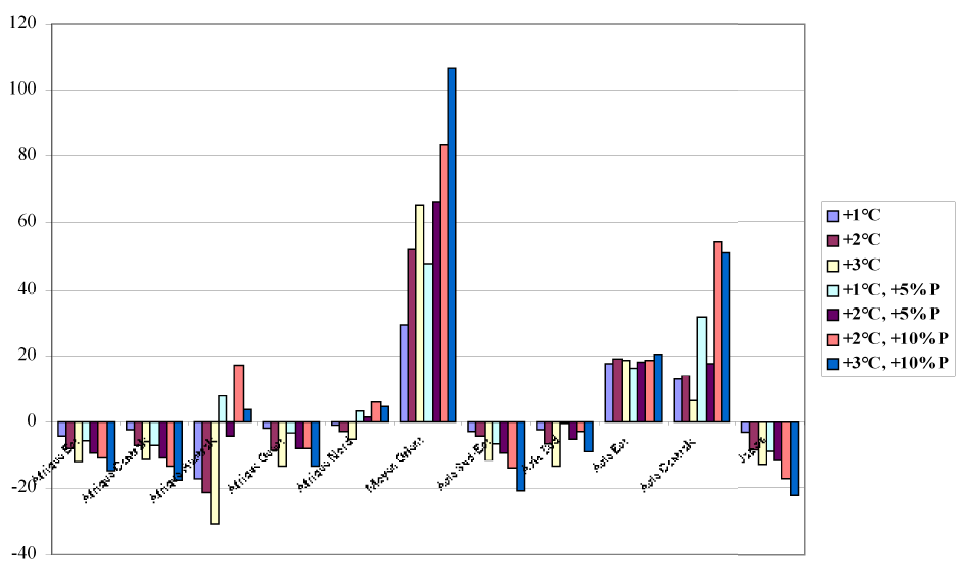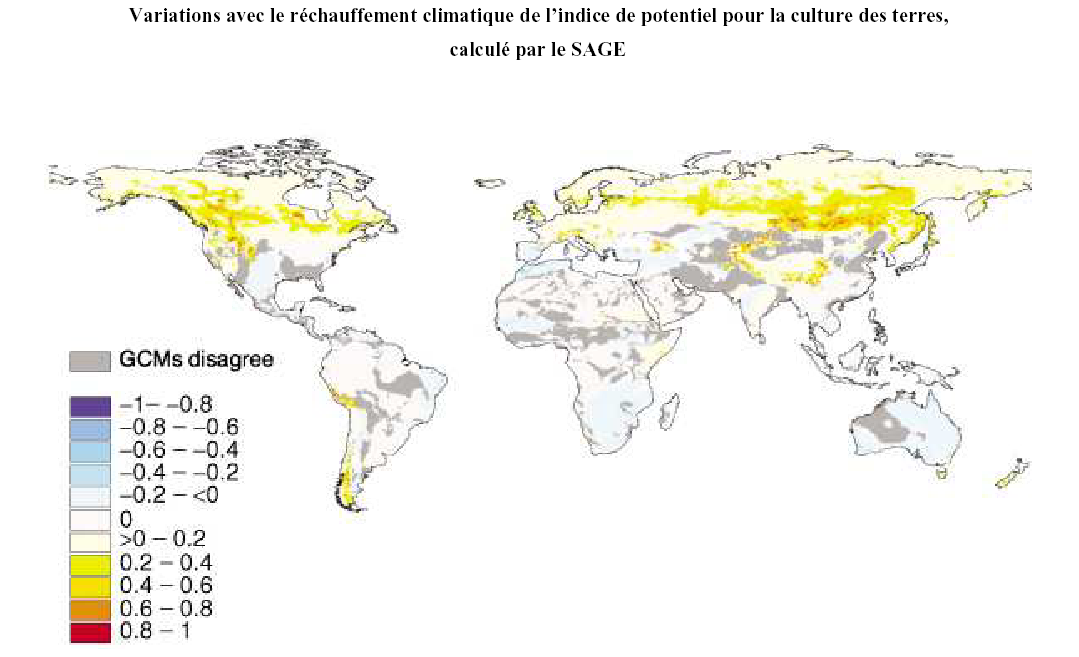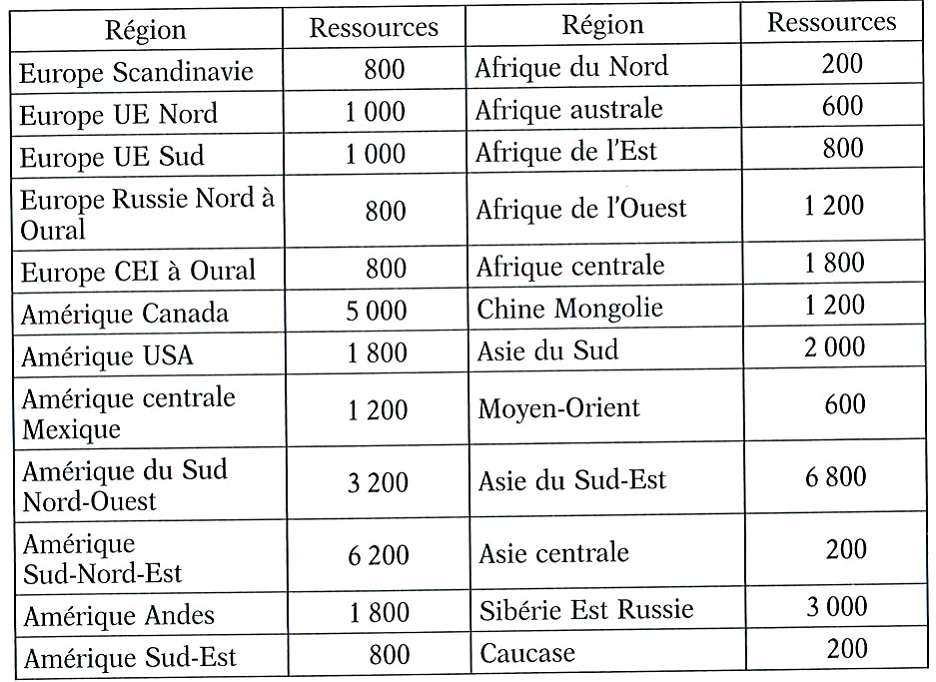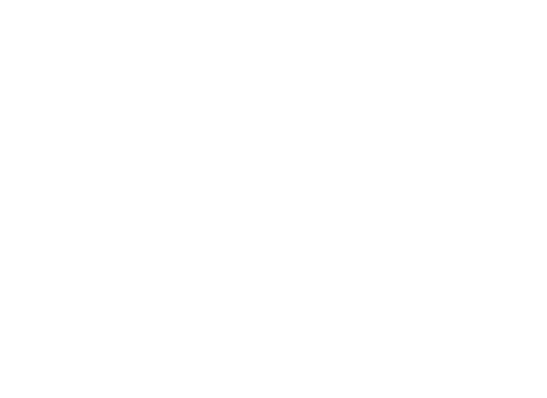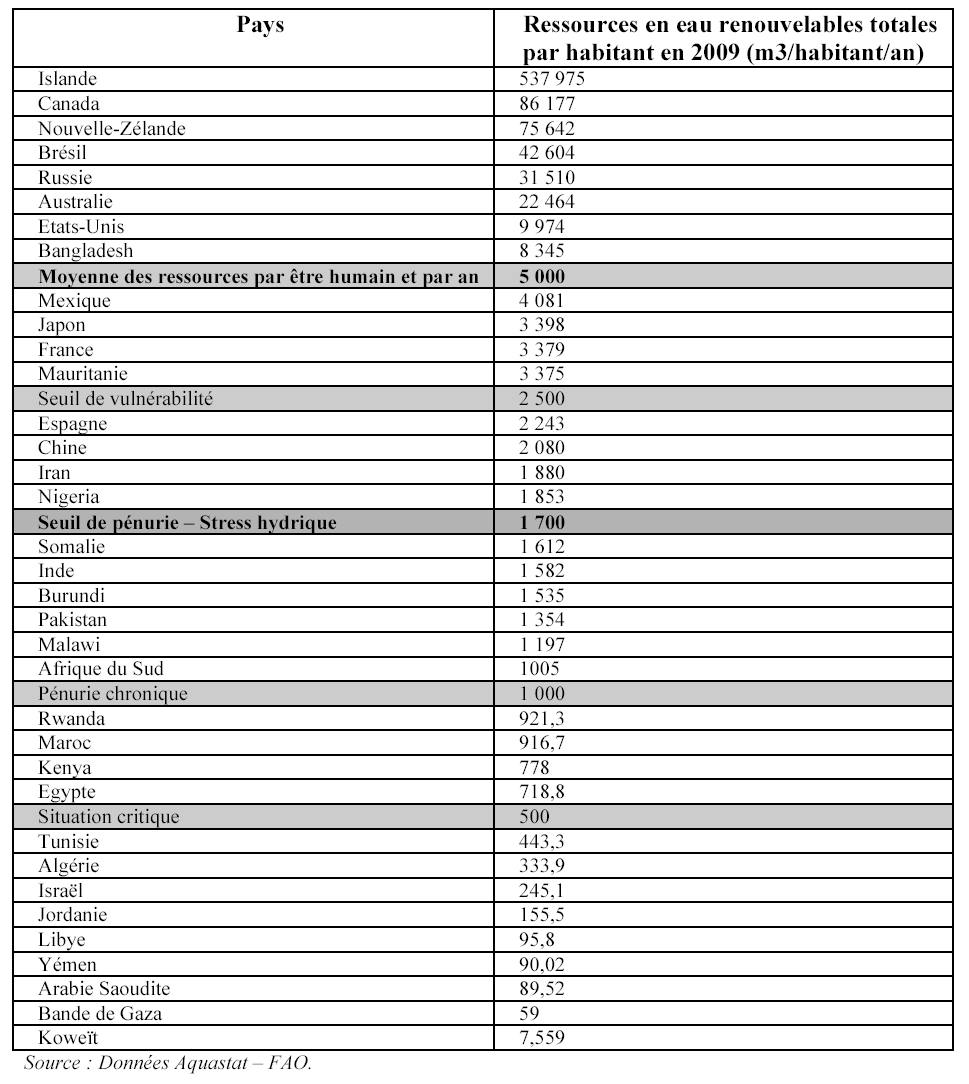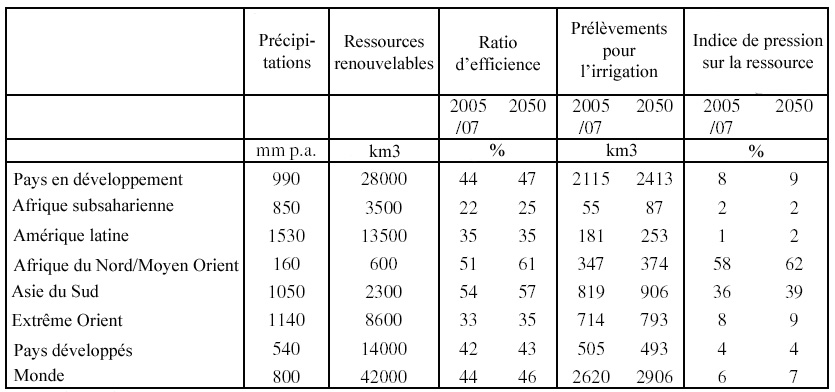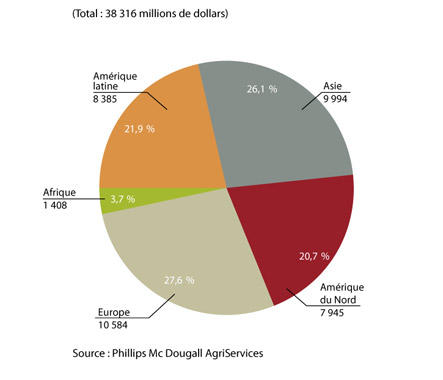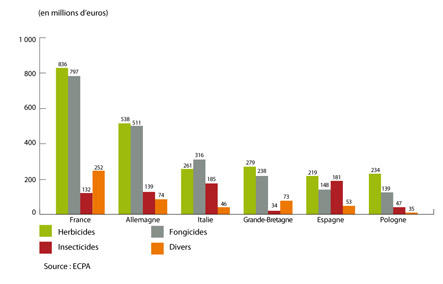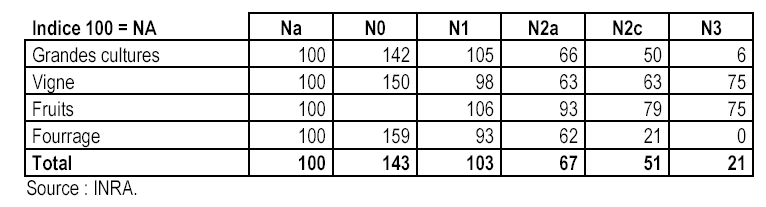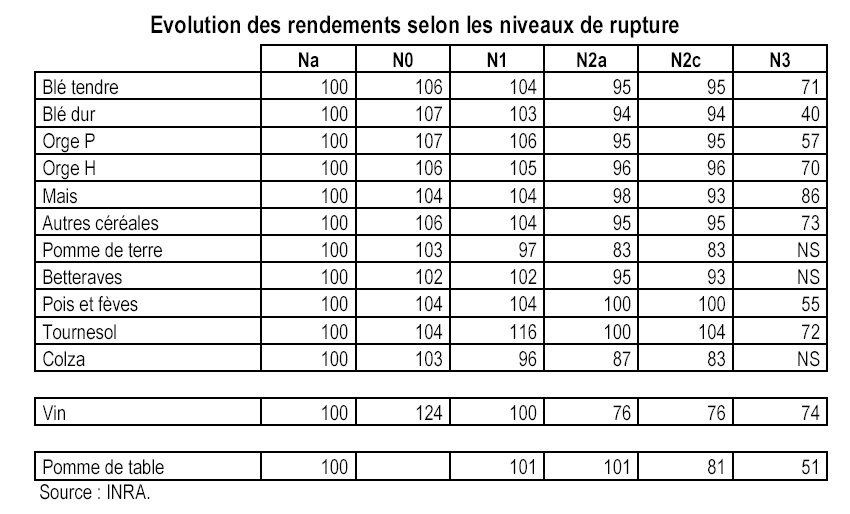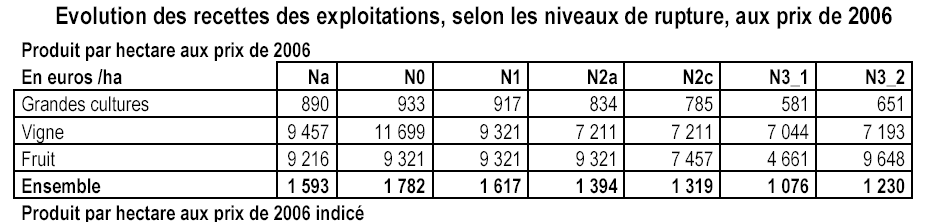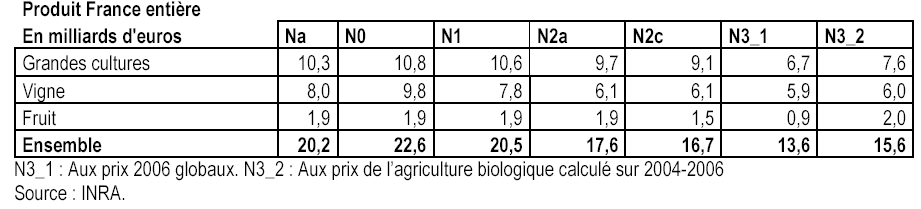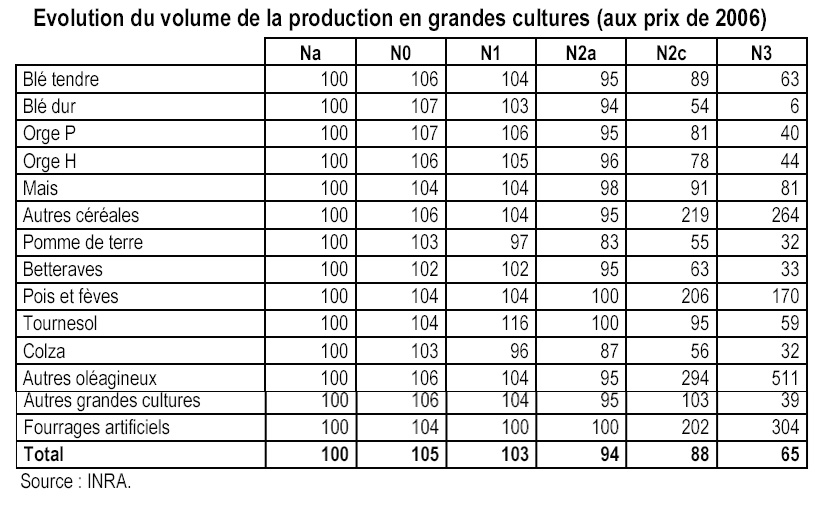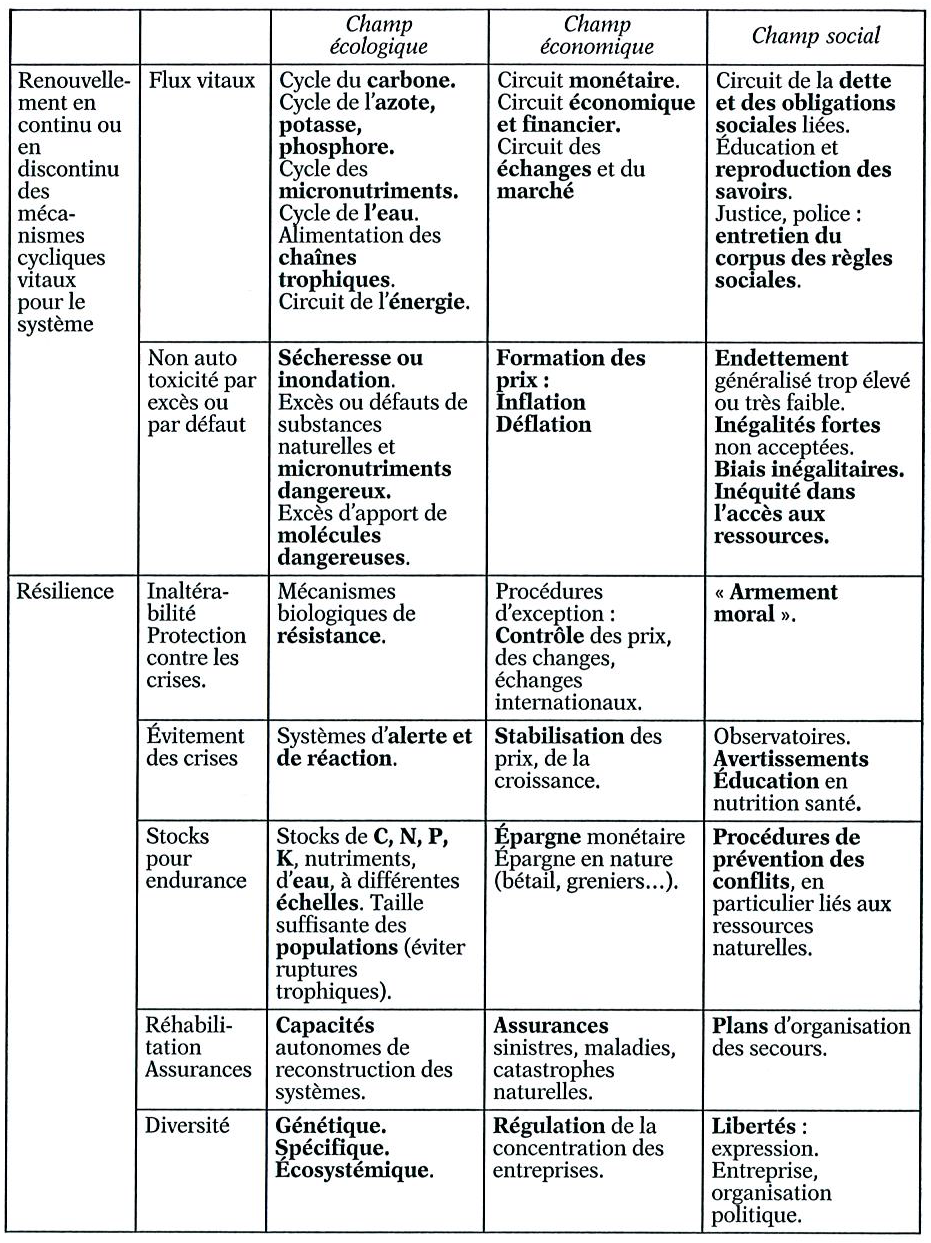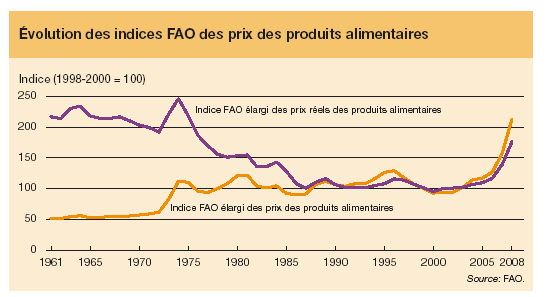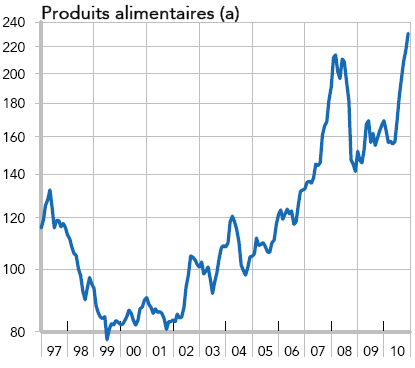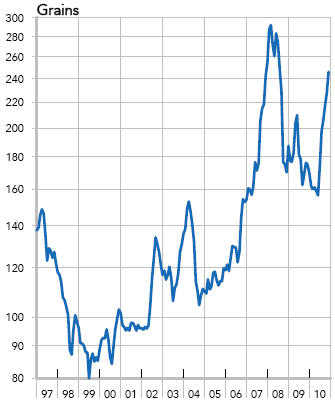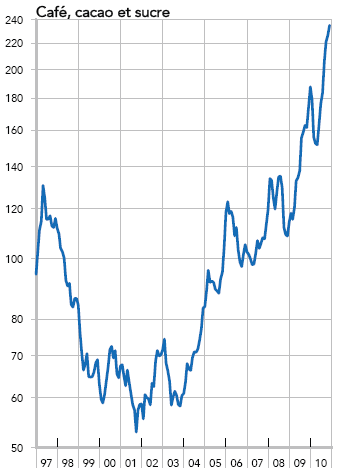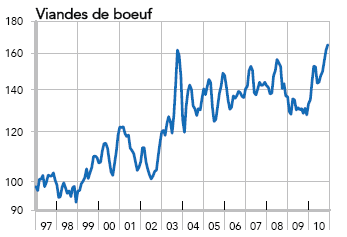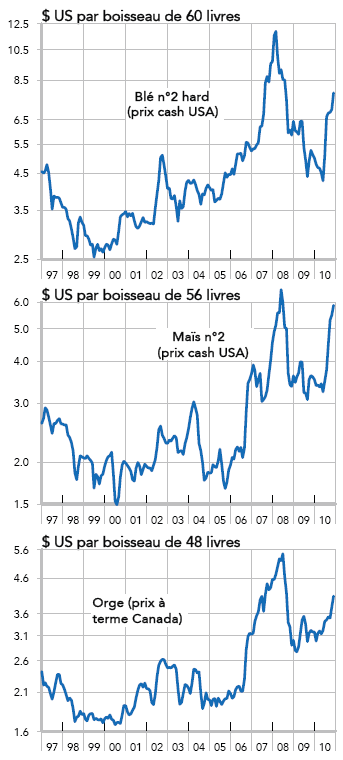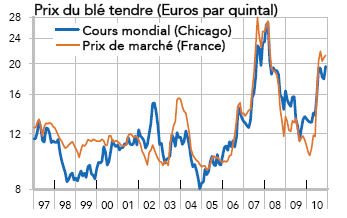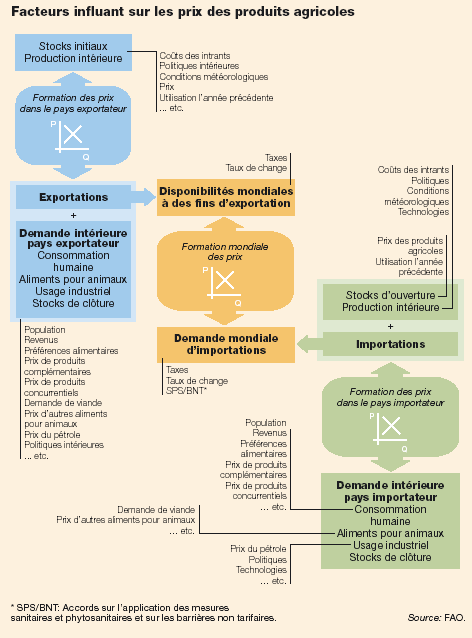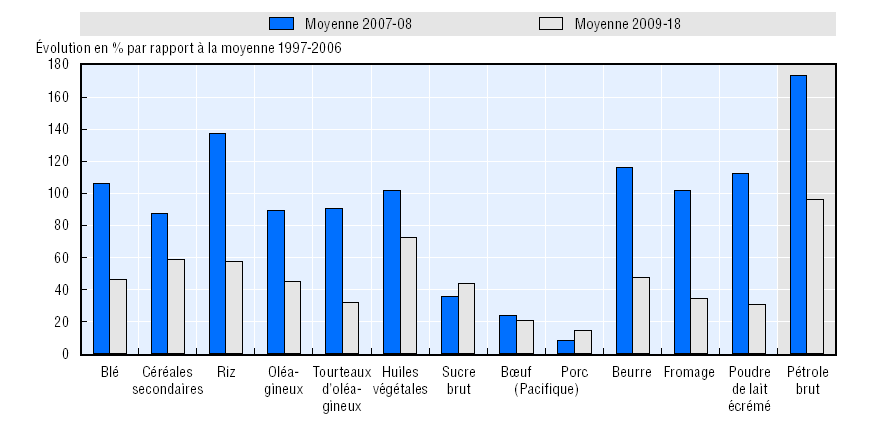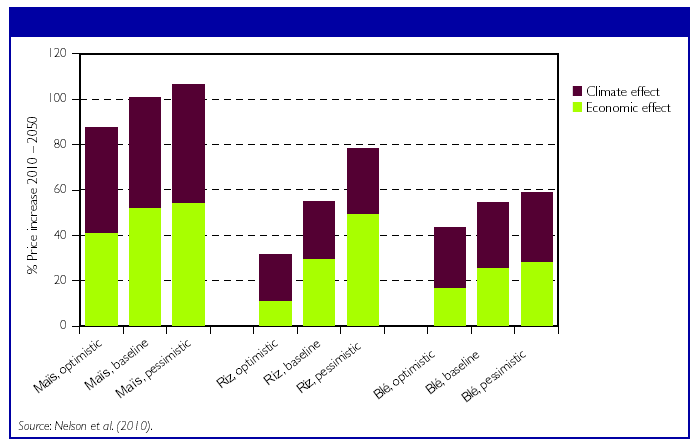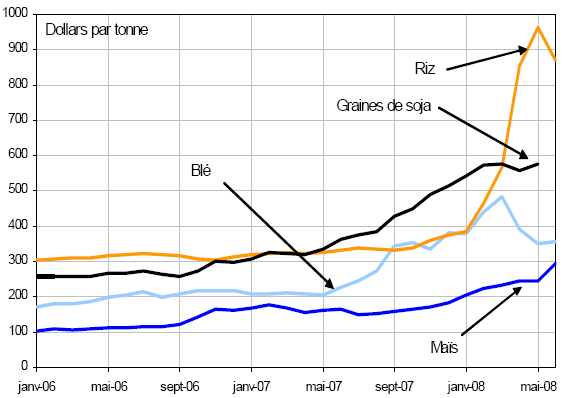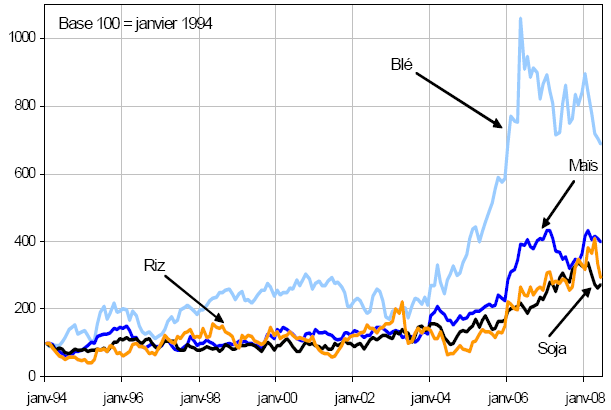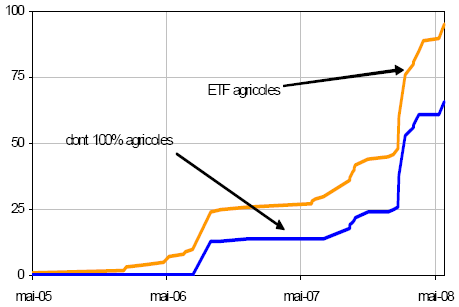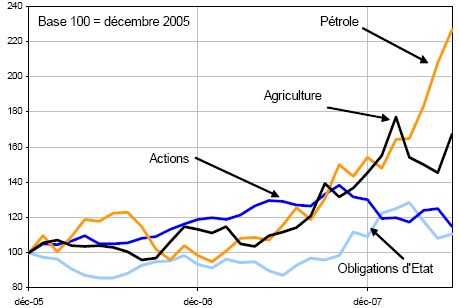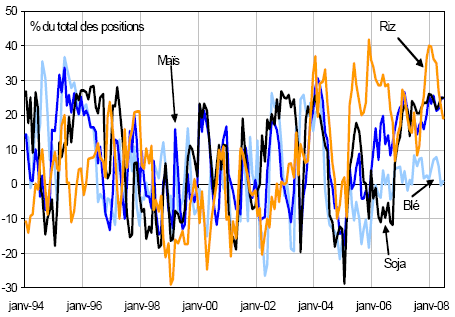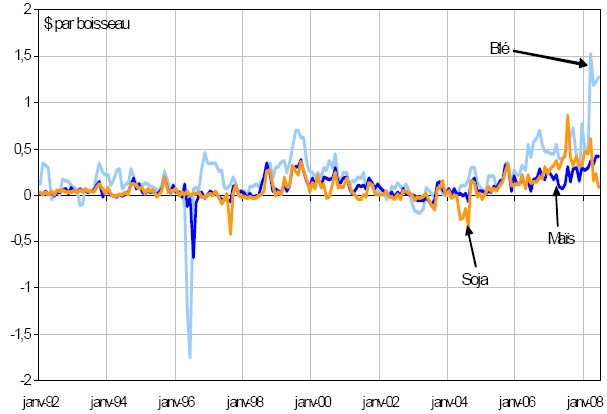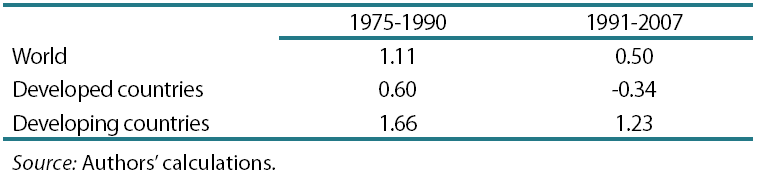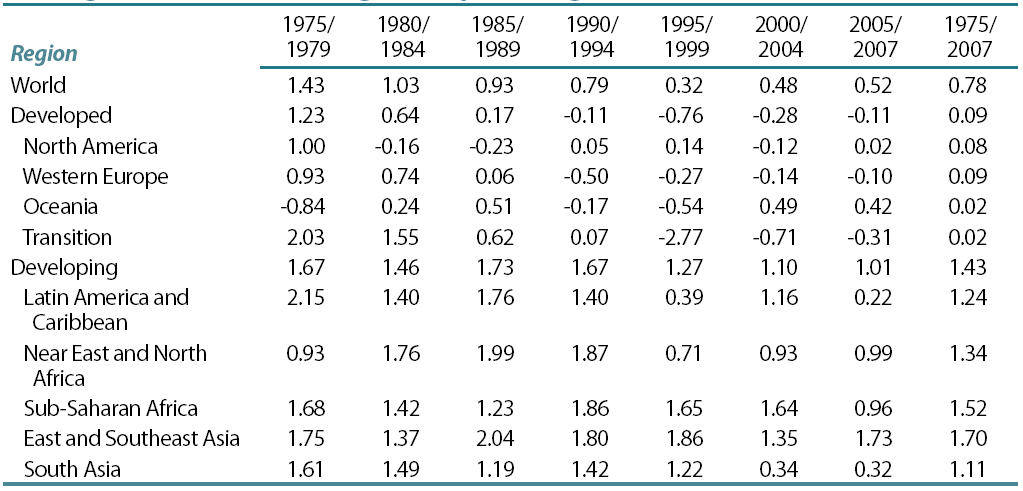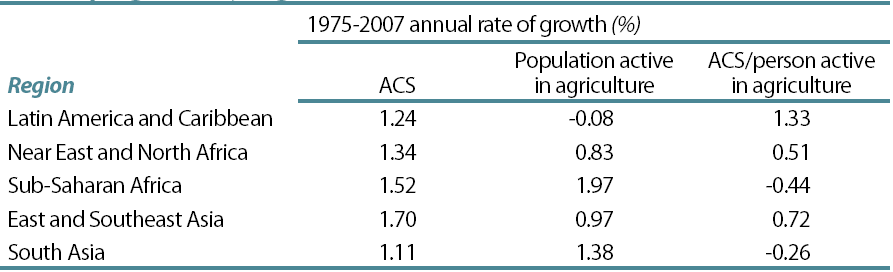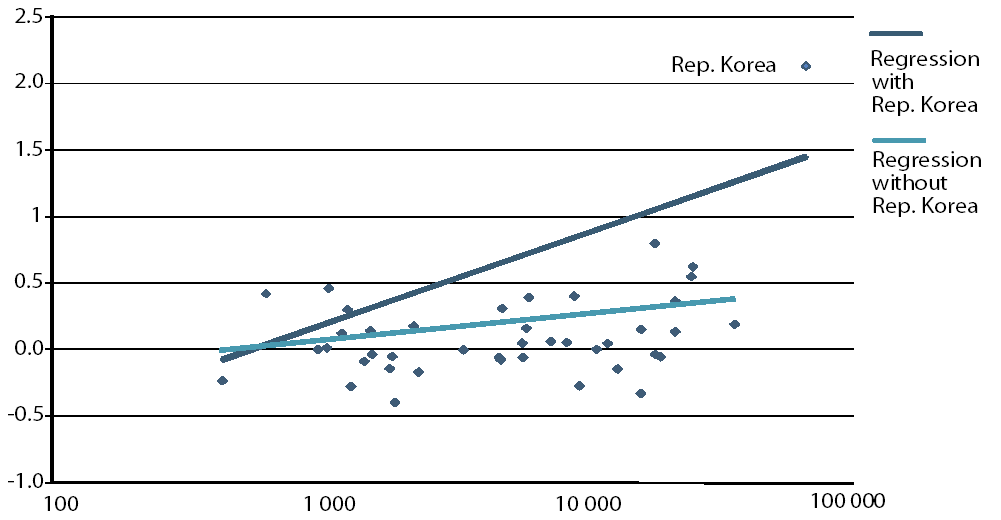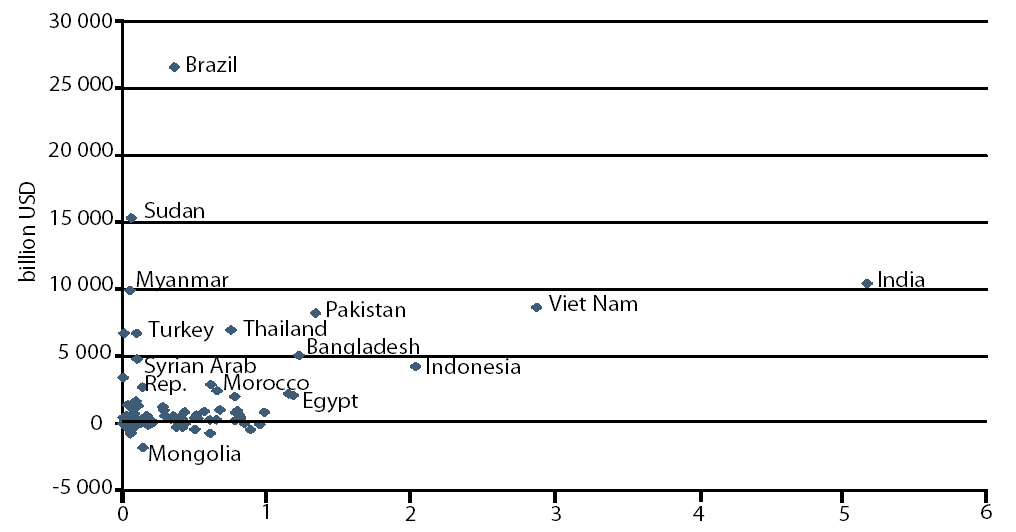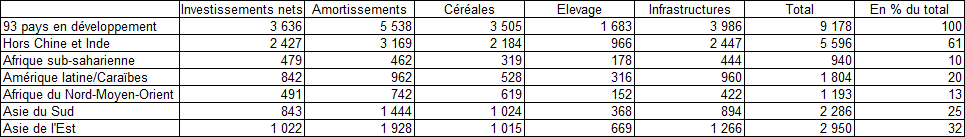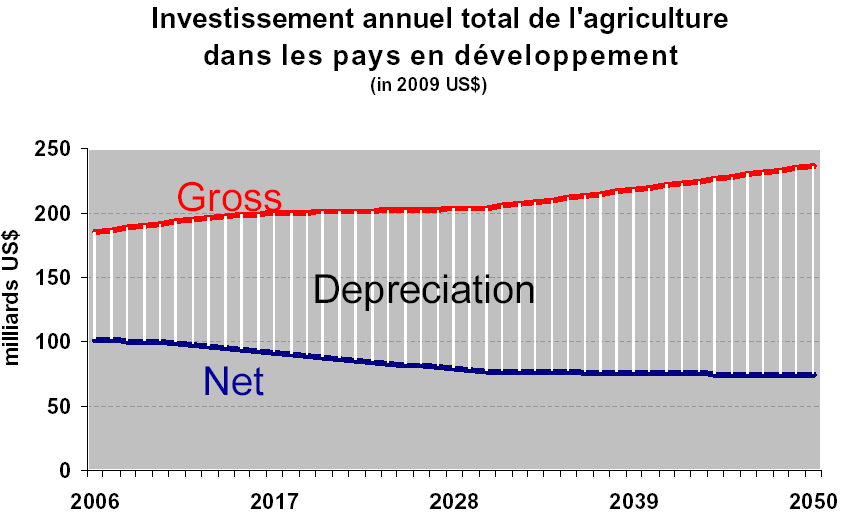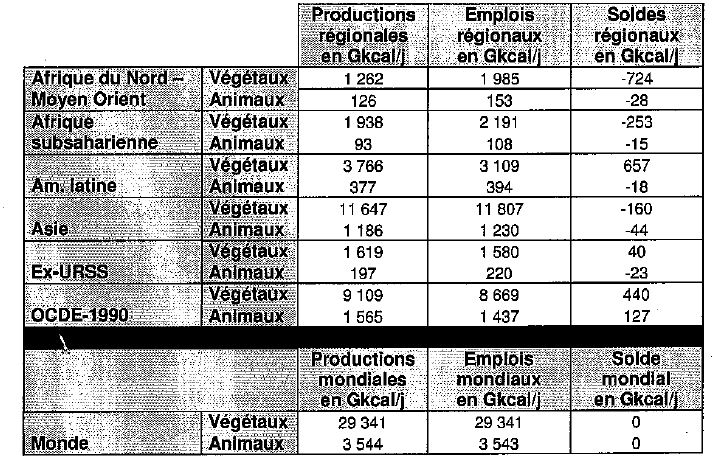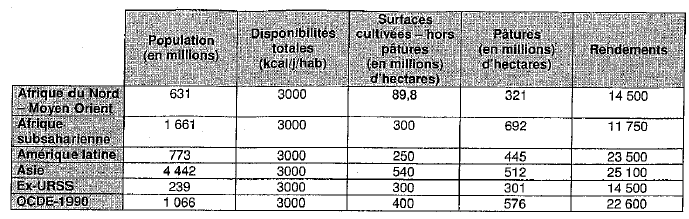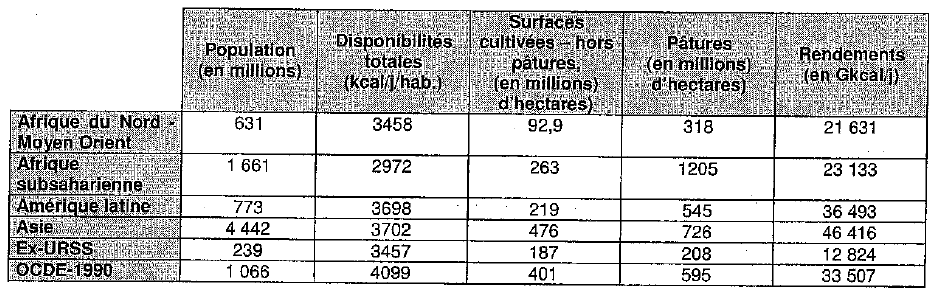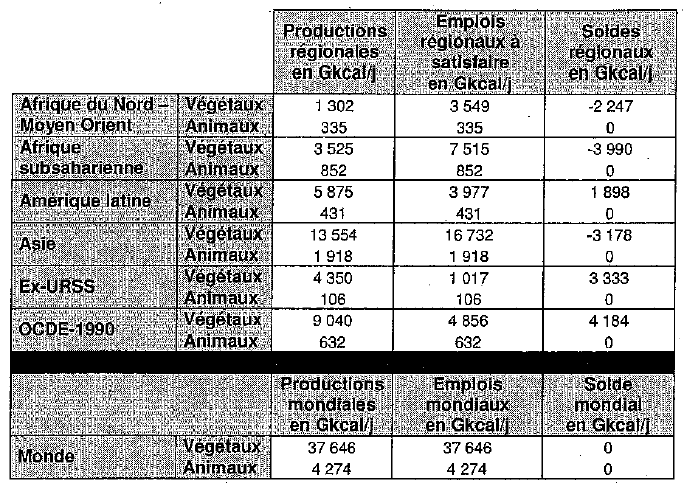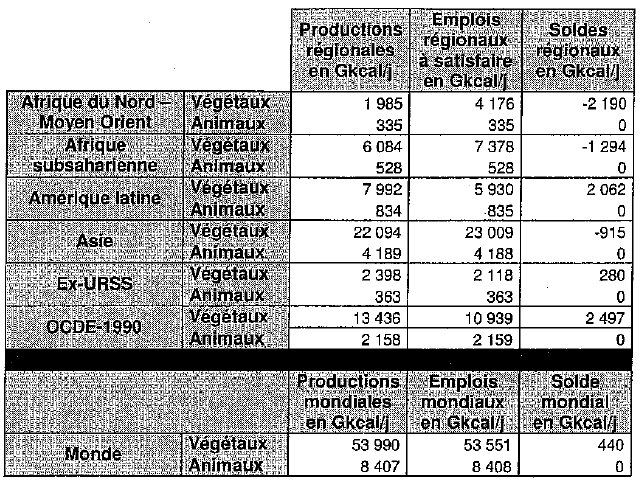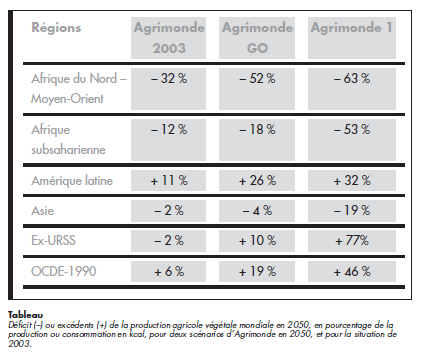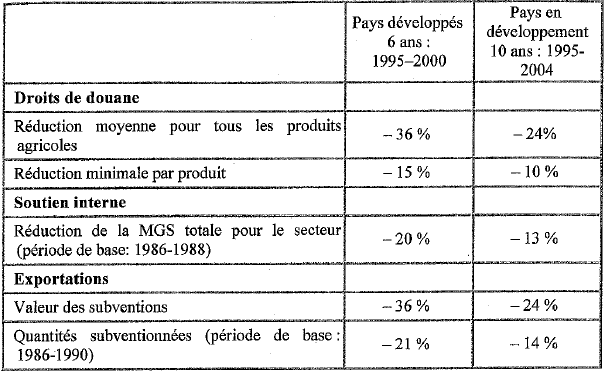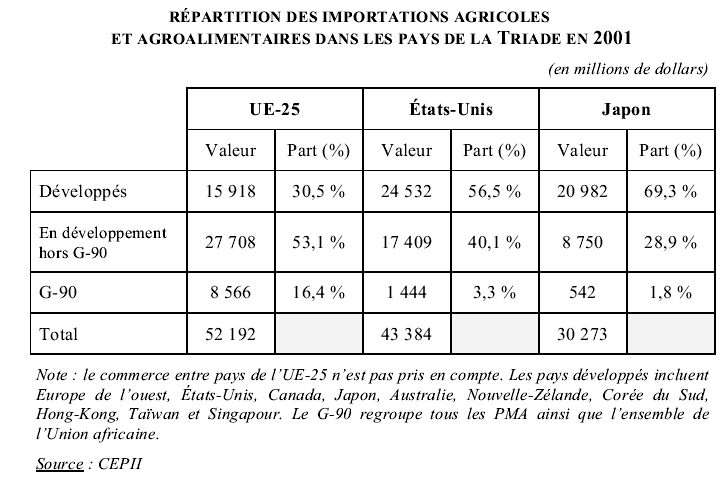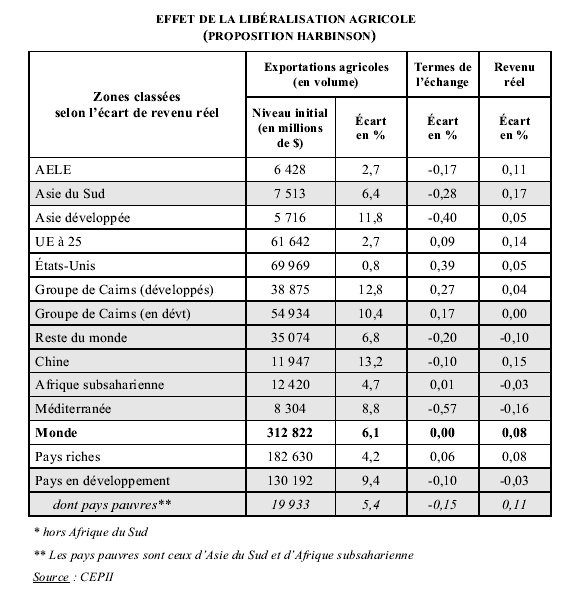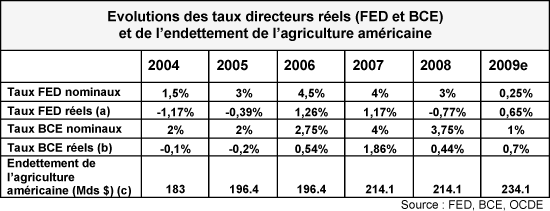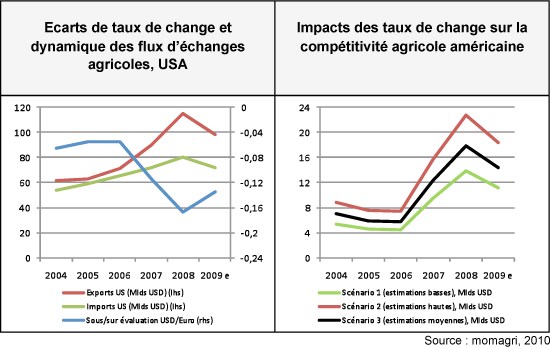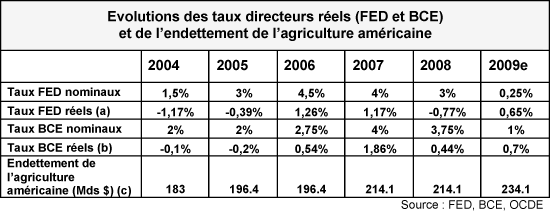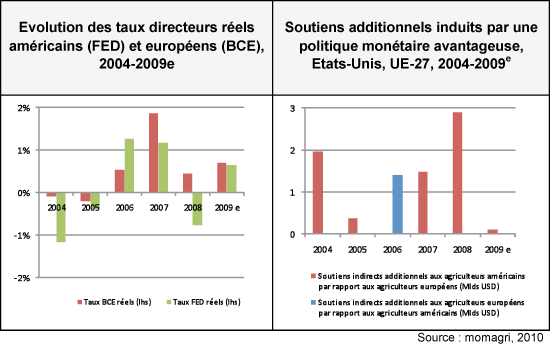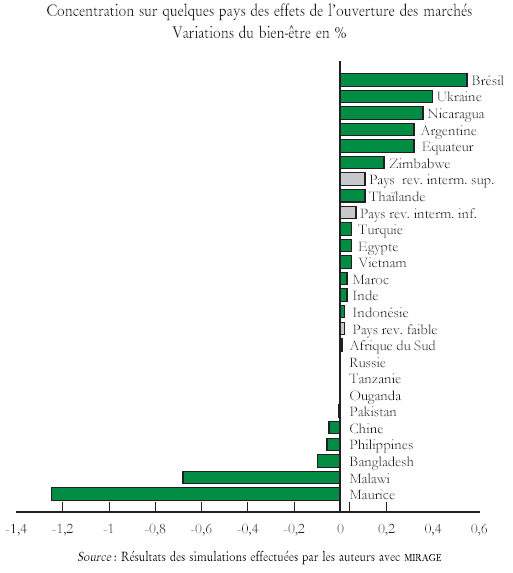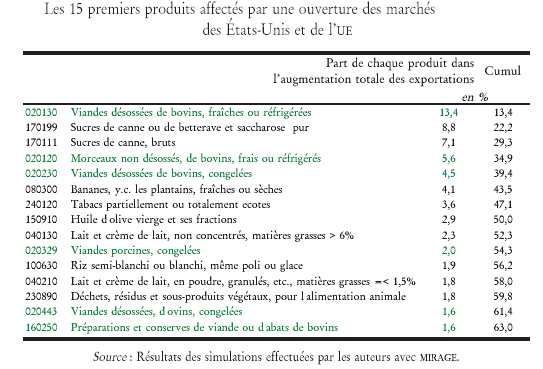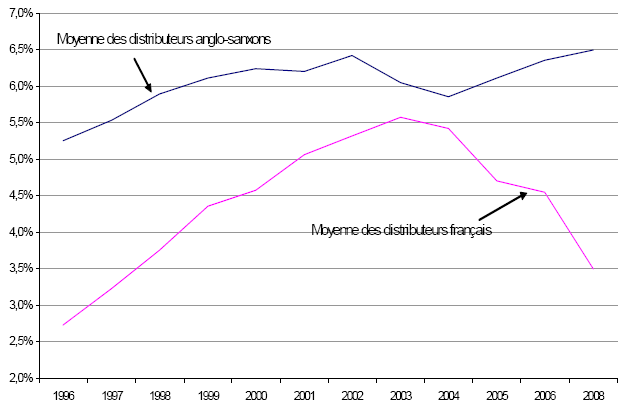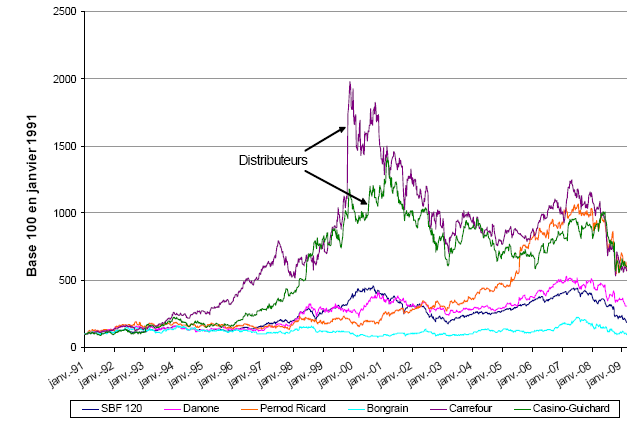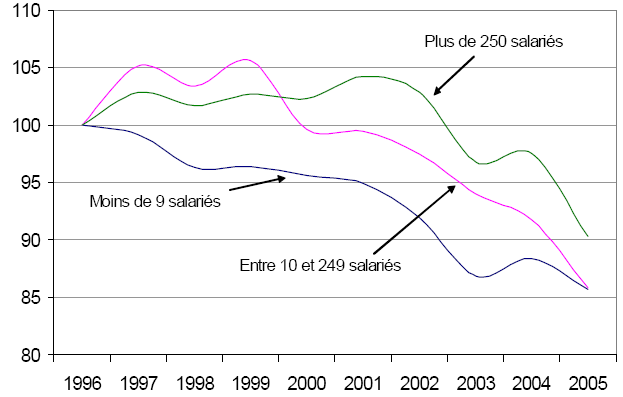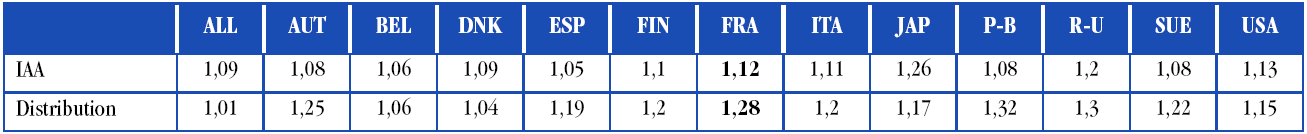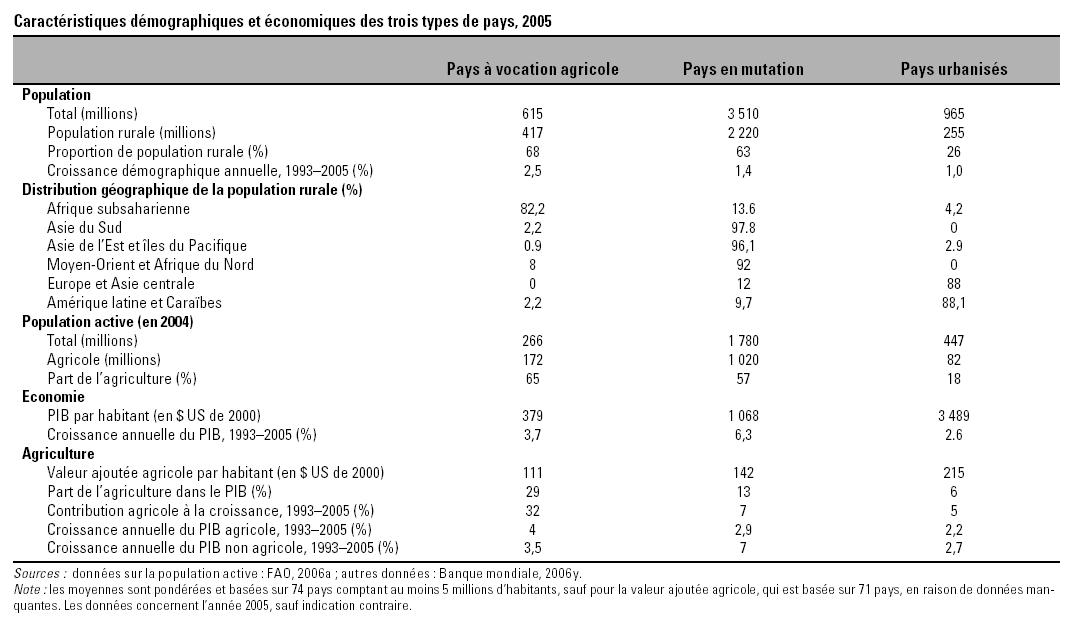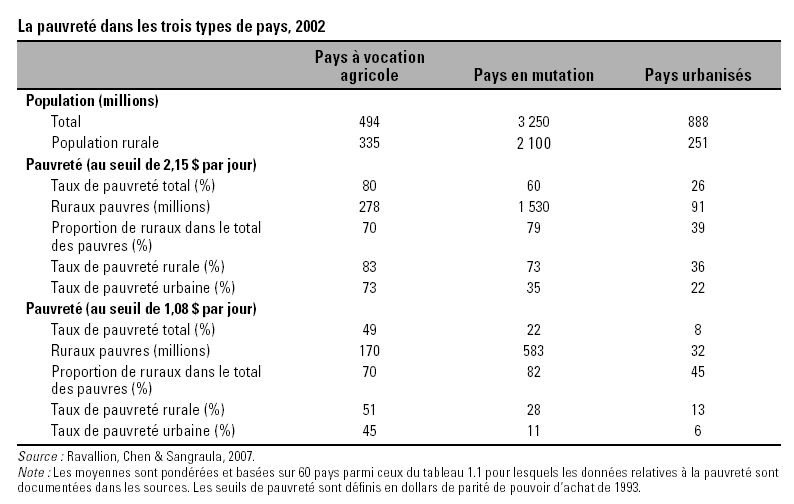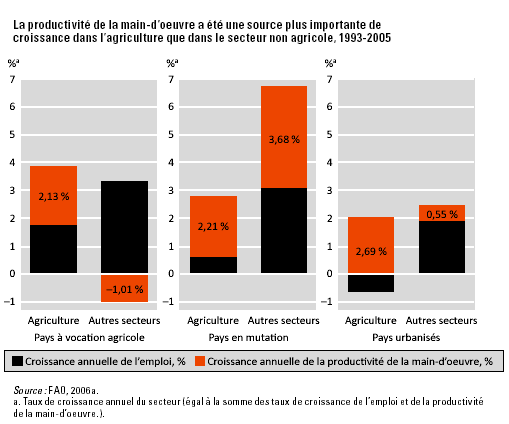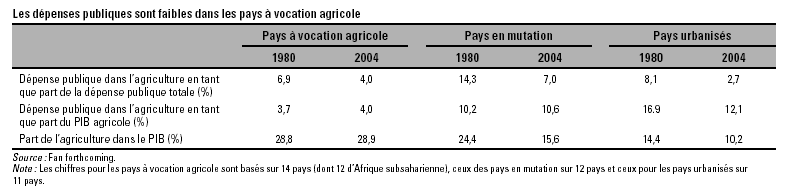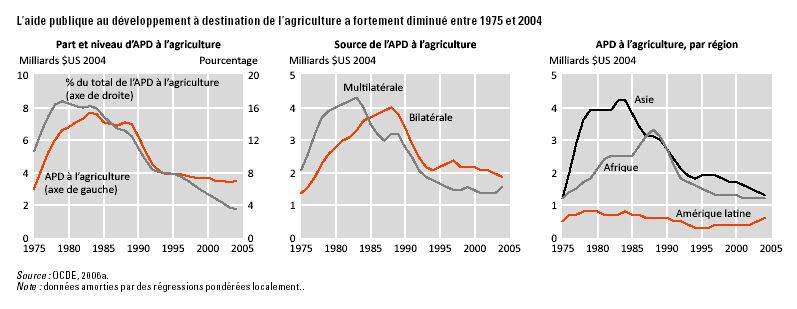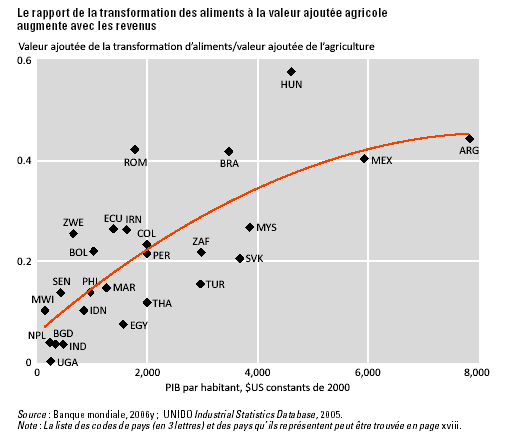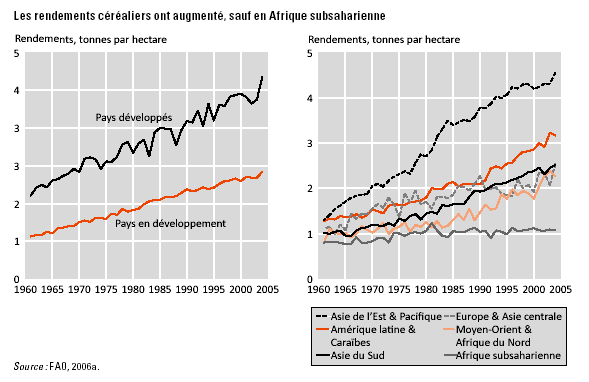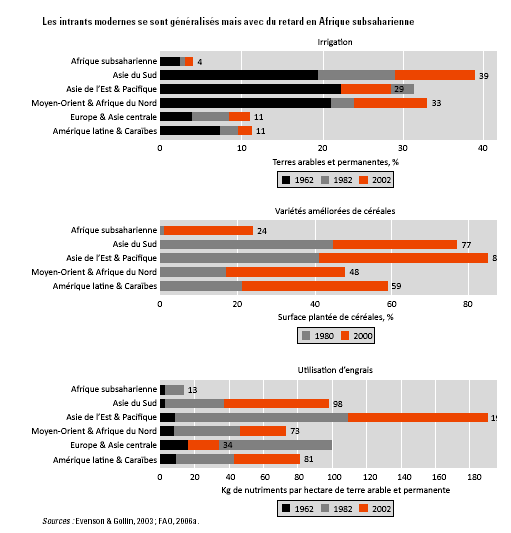- INTRODUCTION
- PREMIÈRE PARTIE :
LA FAIM : UNE MENACE QUI S'AGGRAVE
- CHAPITRE I :
VERS UNE CROISSANCE DES BESOINS ALIMENTAIRES
- I. UNE CROISSANCE DE LA POPULATION AUX CONTOURS
INCERTAINS
- II. DE LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE AUX
BESOINS ALIMENTAIRES : UNE CLEF DE PASSAGE QUI DÉPEND
ÉTROITEMENT DES REVENUS
- I. UNE CROISSANCE DE LA POPULATION AUX CONTOURS
INCERTAINS
- CHAPITRE II :
L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE A PROGRESSÉ
DANS LE MONDE
- I. PROPOS LIMINAIRES : UNE MESURE DE LA FAIM
DANS LE MONDE QUI GAGNERAIT À ÊTRE PRÉCISÉE ET
ÉLARGIE
- II. MALGRÉ UNE AUGMENTATION DE LA PRODUCTION
ALIMENTAIRE...
- III. ... LA « FAIM DANS LE
MONDE » N'A PAS DIMINUÉ DANS LES PROPORTIONS
PROCLAMÉES COMME AUTANT D'OBJECTIFS PAR LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE
- IV. LA CRUELLE IRONIE DE LA FAIM : LES PAYSANS
SONT LES PREMIERS TOUCHÉS
- I. PROPOS LIMINAIRES : UNE MESURE DE LA FAIM
DANS LE MONDE QUI GAGNERAIT À ÊTRE PRÉCISÉE ET
ÉLARGIE
- DEUXIÈME PARTIE :
UN POTENTIEL INCERTAIN
- CHAPITRE I :
Y-AURA-T-IL DES TENSIONS SUR LES TERRES ?
- I. LA CROISSANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE DES
DERNIÈRES DÉCENNIES N'A REPOSÉ QUE MARGINALEMENT SUR LA
MOBILISATION DE NOUVELLES TERRES
- II. LES RÉSERVES FONCIÈRES
MOBILISABLES, DE L'IMPRESSION D'UNE SURABONDANCE AU CONSTAT DE
DISPONIBILITÉS SOUS CONTRAINTES
- III. UNE « COURSE AUX
TERRES » ?
- IV. L'IRRIGATION SERA-T-ELLE UNE SOLUTION ?
- I. LA CROISSANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE DES
DERNIÈRES DÉCENNIES N'A REPOSÉ QUE MARGINALEMENT SUR LA
MOBILISATION DE NOUVELLES TERRES
- CHAPITRE II :
QUELLES PERSPECTIVES
POUR LES RENDEMENTS AGRICOLES ?
- TROISIÈME PARTIE :
UN CONTEXTE NOUVEAU ET INQUIÉTANT
- CHAPITRE I :
AGRICULTURE ET ÉNERGIE
- I. UN SECTEUR FORTEMENT CONSOMMATEUR
D'ÉNERGIE CONFRONTÉ À UN DOUBLE DÉFI
ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
- II. UN SECTEUR DE PLUS EN PLUS PRODUCTEUR
D'ÉNERGIE : OPPORTUNITÉ OU MENACE ?
- I. UN SECTEUR FORTEMENT CONSOMMATEUR
D'ÉNERGIE CONFRONTÉ À UN DOUBLE DÉFI
ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
- CHAPITRE II :
UNE AGRICULTURE CONFRONTÉE
À DES DÉFIS NATURELS NOUVEAUX
- I. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE COMPLIQUE LA
DONNE
- II. LA MONTÉE DES STRESS HYDRIQUES
- III. LES PROBLÈMES DE SOUTENABILITÉ
DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
- A. LES EFFETS NON DÉSIRABLES DE LA
« RÉVOLUTION VERTE » SUR LES RESSOURCES
NATURELLES
- B. INQUIÉTUDES POUR LA
BIODIVERSITÉ
- C. DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES DE PLUS EN
PLUS CONTESTÉS
- A. LES EFFETS NON DÉSIRABLES DE LA
« RÉVOLUTION VERTE » SUR LES RESSOURCES
NATURELLES
- IV. VERS UNE NOUVELLE AGRICULTURE ?
- I. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE COMPLIQUE LA
DONNE
- CHAPITRE III :
QUELLES PERSPECTIVES
POUR LES PRIX ALIMENTAIRES ?
- I. SUR UNE LONGUE PÉRIODE UNE CHUTE DES
PRIX AGRICOLES RÉELS MAIS DEPUIS LE MILIEU DES ANNÉES 2000 UNE
FORTE VOLATILITE
- II. LE CADRE D'ANALYSE DES PRIX AGRICOLES CONDUIT
À ENVISAGER PLUSIEURS SCÉNARIOS AVEC UN SCÉNARIO PLUS
PROBABLE DE HAUSSE DES PRIX
- A. PLUSIEURS SCÉNARIOS DE PRIX SONT
ENVISAGEABLES
- 1. Toutes choses égales par ailleurs, la
hausse de la demande devrait exercer une tension sur les prix agricoles
- 2. La hausse de la productivité comme
variable d'équilibre ?
- a) En pratique, l'élévation du
niveau des prix peut être une condition préalable à des
progrès de productivité censés ... peser sur les prix
surtout quand il n'existe pas d'aide publique ou d'accès au
crédit
- b) Les progrès de productivité
peuvent se heurter à des limites physiques
- c) Les progrès de productivité
peuvent se faire à coûts croissants
- a) En pratique, l'élévation du
niveau des prix peut être une condition préalable à des
progrès de productivité censés ... peser sur les prix
surtout quand il n'existe pas d'aide publique ou d'accès au
crédit
- 3. Que peut-on attendre de la hausse des prix
agricoles ?
- 1. Toutes choses égales par ailleurs, la
hausse de la demande devrait exercer une tension sur les prix agricoles
- B. LA CONFIRMATION PAR PLUSIEURS
PROSPECTIVES
- A. PLUSIEURS SCÉNARIOS DE PRIX SONT
ENVISAGEABLES
- III. LA VOLATILITÉ, UNE QUESTION UN PEU
SECONDE, MAIS IMPORTANTE
- I. SUR UNE LONGUE PÉRIODE UNE CHUTE DES
PRIX AGRICOLES RÉELS MAIS DEPUIS LE MILIEU DES ANNÉES 2000 UNE
FORTE VOLATILITE
- QUATRIÈME PARTIE :
QUEL INVESTISSEMENT ?
- CINQUIÈME PARTIE :
DEMAIN, QUELLE GEO-ALIMENTATION ?
- I. AUTOSUFFISANCE OU SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE ?
- II. DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET
LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES AGRICOLES INTERNATIONAUX
- III. QUELLE PLACE POUR LES HOMMES ?
- IV. QUEL PARADIGME ?
- A. UNE INITIATIVE POUR LE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE : L'EXEMPLE DE LA « DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DANS LE NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE (NEPAD) »
- B. UNE RÉHABILITATION DE
L'AGRICULTURE ? LE RAPPORT DE LA BANQUE MONDIALE SUR LE
DÉVELOPPEMENT 2008
- C. DES POINTS DE VUE QUI MANQUENT DE
COHÉRENCE
- D. LES ÉTATS ACTEURS OU AGENTS DU
SYSTÈME ALIMENTAIRE MONDIAL ?
- A. UNE INITIATIVE POUR LE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE : L'EXEMPLE DE LA « DÉMARCHE DE
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DANS LE NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE (NEPAD) »
- I. AUTOSUFFISANCE OU SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE ?
- CONCLUSION
- EXAMEN EN DÉLÉGATION
- ANNEXES
SOMMAIRE
Pages
INTRODUCTION 9
PREMIÈRE PARTIE : LA FAIM : UNE MENACE QUI S'AGGRAVE 13
CHAPITRE I : VERS UNE CROISSANCE DES BESOINS ALIMENTAIRES 15
I. UNE CROISSANCE DE LA POPULATION AUX CONTOURS INCERTAINS 16
A. UNE AUGMENTATION DE LA POPULATION DONT L'AMPLEUR EST CONJECTURALE 16
B. UNE DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE GÉOGRAPHIQUEMENT CONTRASTÉE AVEC D'IMPORTANTS SUPPLÉMENTS DE POPULATION DANS LES PAYS LES MOINS AVANCÉS 19
II. DE LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE AUX BESOINS ALIMENTAIRES : UNE CLEF DE PASSAGE QUI DÉPEND ÉTROITEMENT DES REVENUS 23
A. LA PROSPECTIVE DES BESOINS ALIMENTAIRES DÉPEND DE L'HYPOTHÈSE SUR L'ENRICHISSEMENT DE LA RATION ALIMENTAIRE 25
B. UNE DYNAMIQUE FORTEMENT CONTRASTÉE PAR GRANDE RÉGION DU MONDE 30
C. DES RÉSULTATS SENSIBLES AUX MODES DE CONSOMMATION 38
1. Quelle diversification des régimes alimentaires ? 38
2. Des perspectives de demande sensibles à l'évolution des pertes et des gaspillages 43
D. LES PRIX ALIMENTAIRES, UNE VARIABLE CRUCIALE 47
CHAPITRE II : L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE A PROGRESSÉ DANS LE MONDE 49
I. PROPOS LIMINAIRES : UNE MESURE DE LA FAIM DANS LE MONDE QUI GAGNERAIT À ÊTRE PRÉCISÉE ET ÉLARGIE 49
II. MALGRÉ UNE AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE... 51
III. ... LA « FAIM DANS LE MONDE » N'A PAS DIMINUÉ DANS LES PROPORTIONS PROCLAMÉES COMME AUTANT D'OBJECTIFS PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 58
A. GLOBALEMENT, DES PROGRÈS ENTRE 1970 ET LE MILIEU DES ANNÉES 90 59
B. ... MAIS DES PROGRÈS INSUFFISANTS 61
C. DEPUIS LE MILIEU DES ANNÉES 2000 UNE NETTE DÉGRADATION DE LA SITUATION S'EST PRODUITE 63
IV. LA CRUELLE IRONIE DE LA FAIM : LES PAYSANS SONT LES PREMIERS TOUCHÉS 71
A. SURTOUT DES PAYSANS 71
B. DANS LES PAYS EN RETARD DE DÉVELOPPEMENT 71
1. L'impact de la croissance globale 71
2. Le poids particulier de la croissance du secteur agricole 73
3. Les effets de l'investissement agricole 74
4. Le rôle de la productivité 75
C. UN CONSTAT FORT : LA CROISSANCE NE SUFFIT PAS, SES MODALITÉS ET LA RÉPARTITION DES REVENUS COMPTENT BEAUCOUP 76
DEUXIÈME PARTIE : UN POTENTIEL INCERTAIN 83
CHAPITRE I : Y-AURA-T-IL DES TENSIONS SUR LES TERRES ? 85
I. LA CROISSANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE DES DERNIÈRES DÉCENNIES N'A REPOSÉ QUE MARGINALEMENT SUR LA MOBILISATION DE NOUVELLES TERRES 86
II. LES RÉSERVES FONCIÈRES MOBILISABLES, DE L'IMPRESSION D'UNE SURABONDANCE AU CONSTAT DE DISPONIBILITÉS SOUS CONTRAINTES 88
A. LE POTENTIEL THÉORIQUE : ENTRE L'IMAGE D'UNE SURABONDANCE... 89
1. Au premier regard, d'importantes disponibilités à l'échelle du monde 89
2. Des potentiels régionaux très inégaux 93
B. ...ET DES RÉALITÉS PLUS FORTEMENT CONTRAINTES 96
1. Le poids des contraintes naturelles 96
2. De fortes tensions locales 100
3. Des doutes sur les méthodes 103
4. Le poids des facteurs socio-économiques 104
5. Quels équilibres « hommes-terres » ? 104
III. UNE « COURSE AUX TERRES » ? 107
A. LES ACQUISITIONS INTERNATIONALES DE TERRES 107
B. LA QUESTION DE LA RARÉFACTION DES TERRES AGRICOLES : LE CAS FRANÇAIS 112
IV. L'IRRIGATION SERA-T-ELLE UNE SOLUTION ? 114
CHAPITRE II : QUELLES PERSPECTIVES POUR LES RENDEMENTS AGRICOLES ? 119
I. LA QUERELLE DE LA COMBINAISON PRODUCTIVE : Y-A-T-IL UNE ALTERNATIVE ENTRE TERRES OU RENDEMENTS ? 121
A. UNE QUESTION THÉORIQUE PLUS COMPLEXE QU'ON NE LE PRÉSENTE SOUVENT... 121
B. ... DONT LES DIFFICULTÉS S'ACCROISSENT QUAND ON LA MET EN PERSPECTIVE 122
C. UNE QUESTION EN PARTIE VIDE DE PORTÉE ? 124
II. DES RENDEMENTS DONT LA PROGRESSION S'ESSOUFFLE ? 125
A. D'UNE FORTE PROGRESSION DES RENDEMENTS... 125
B. ... À UN TASSEMENT ? 127
1. Constats 127
2. La hausse des rendements, jusqu'à quel point ? 129
3. La progression des rendements ne devraient plus venir principalement d'une augmentation du potentiel mais d'un rattrapage des pays en retard 132
TROISIÈME PARTIE : UN CONTEXTE NOUVEAU ET INQUIÉTANT 135
CHAPITRE I : AGRICULTURE ET ÉNERGIE 137
I. UN SECTEUR FORTEMENT CONSOMMATEUR D'ÉNERGIE CONFRONTÉ À UN DOUBLE DÉFI ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE 137
A. UN SECTEUR À TROP FORT CONTENU ÉNERGÉTIQUE 138
B. QUELS LIENS ENTRE PRIX DE L'ÉNERGIE ET PRIX AGRICOLES ? 139
II. UN SECTEUR DE PLUS EN PLUS PRODUCTEUR D'ÉNERGIE : OPPORTUNITÉ OU MENACE ? 143
A. UNE PRODUCTION D'AGRO-CARBURANTS EN FORTE CROISSANCE 143
1. Une forte croissance, surtout dans certains pays 143
2. Des politiques d'encouragement à la production d'agro-carburants 145
B. UNE VIABILITÉ ÉCONOMIQUE EN QUESTION 148
1. Aujourd'hui, les agro-carburants dépendent généralement de l'intervention publique 148
2. Demain, les scénarios de prix des énergies fossiles mais aussi les progrès techniques pourront justifier plus largement la production d'agro-carburants 151
C. QUELS EFFETS SUR LES ÉQUILIBRES ALIMENTAIRES ? 153
1. Quels effets sur le prix de l'énergie ? 154
2. Quels effets sur les changements climatiques ? 157
3. Récapitulatif 162
a) Vers un grave problème foncier 162
b) Un facteur autonome de hausse des prix 167
D. APERÇUS POUR LA FRANCE 173
CHAPITRE II : UNE AGRICULTURE CONFRONTÉE À DES DÉFIS NATURELS NOUVEAUX 179
I. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE COMPLIQUE LA DONNE 179
A. APERÇU GÉNÉRAL : PEU D'EFFETS GLOBAUX MAIS DES IMPACTS RÉGIONAUX SIGNIFICATIFS DÉCRITS PAR DES SCÉNARIOS SANS DOUTE INCOMPLETS 180
1. Peu d'effets globaux mais des incidences régionales significatives 180
2. Des scénarios qui semblent incomplets 182
B. LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES SCÉNARIOS 183
1. L'étude de la FAO 183
2. L'étude de GAEZ sur les superficies cultivables 187
II. LA MONTÉE DES STRESS HYDRIQUES 189
A. LES ESTIMATIONS RELATIVES À L'ACCESSIBILITÉ DE L'EAU VARIENT AVEC DES EFFETS SUR LE POTENTIEL ENVISAGEABLE 190
B. LES DISPONIBILITÉS EN EAU RENOUVELABLE SONT TRÈS INÉGALEMENT RÉPARTIES 192
C. QUELLES PERSPECTIVES POUR L'AGRICULTURE D'IRRIGATION ? 195
III. LES PROBLÈMES DE SOUTENABILITÉ DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 198
A. LES EFFETS NON DÉSIRABLES DE LA « RÉVOLUTION VERTE » SUR LES RESSOURCES NATURELLES 198
B. INQUIÉTUDES POUR LA BIODIVERSITÉ 200
C. DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES DE PLUS EN PLUS CONTESTÉS 203
1. Une utilisation très inégale des produits phytopharmaceutiques 204
2. Une utilisation contestée 207
3. Une tendance à la rationalisation ? 209
a) La législation européenne 209
b) La législation française 211
4. Le plan « Ecophyto-2018 » : la question de la faisabilité d'une politique de réduction des phytopharmaceutiques 212
IV. VERS UNE NOUVELLE AGRICULTURE ? 217
A. LES VOIES D'UNE AMÉLIORATION DES RENDEMENTS SONT PLURIELLES 219
1. Une « super-Révolution verte » est-elle réaliste ? 219
2. L'agriculture raisonnée ? 221
3. La mise en oeuvre d'une Révolution doublement verte ? 221
B. LA RÉVOLUTION DOUBLEMENT VERTE POURRA-T-ELLE NOURRIR LE MONDE ? 228
CHAPITRE III : QUELLES PERSPECTIVES POUR LES PRIX ALIMENTAIRES ? 233
I. SUR UNE LONGUE PÉRIODE UNE CHUTE DES PRIX AGRICOLES RÉELS MAIS DEPUIS LE MILIEU DES ANNÉES 2000 UNE FORTE VOLATILITE 235
A. UNE BAISSE STRUCTURELLE MAIS DE FORTES TENSIONS À LA FIN DES ANNÉES 2000 235
B. LE CONSTAT DE MOUVEMENTS DE PRIX DIFFÉRENCIÉS PAR PRODUIT 238
C. DES DIFFÉRENCES PAR MARCHÉ 240
II. LE CADRE D'ANALYSE DES PRIX AGRICOLES CONDUIT À ENVISAGER PLUSIEURS SCÉNARIOS AVEC UN SCÉNARIO PLUS PROBABLE DE HAUSSE DES PRIX 243
A. PLUSIEURS SCÉNARIOS DE PRIX SONT ENVISAGEABLES 246
1. Toutes choses égales par ailleurs, la hausse de la demande devrait exercer une tension sur les prix agricoles 248
2. La hausse de la productivité comme variable d'équilibre ? 250
a) En pratique, l'élévation du niveau des prix peut être une condition préalable à des progrès de productivité censés ... peser sur les prix surtout quand il n'existe pas d'aide publique ou d'accès au crédit 251
b) Les progrès de productivité peuvent se heurter à des limites physiques 252
c) Les progrès de productivité peuvent se faire à coûts croissants 252
3. Que peut-on attendre de la hausse des prix agricoles ? 254
B. LA CONFIRMATION PAR PLUSIEURS PROSPECTIVES 256
III. LA VOLATILITÉ, UNE QUESTION UN PEU SECONDE, MAIS IMPORTANTE 257
A. APERÇUS THÉORIQUES 257
B. L'ÉPISODE DE FIÈVRE DES PRIX AGRICOLES DES ANNÉES 2006-2008 261
C. LES ORIENTATIONS DU G20 SOUS PRÉSIDENCE FRANÇAISE 271
1. La nécessaire augmentation de la production et de la productivité agricoles 272
2. L'information et la transparence des marchés 273
3. Le renforcement de la coordination politique internationale 273
4. La réduction des effets de la volatilité des prix pour les plus vulnérables 277
5. La régulation financière 278
QUATRIÈME PARTIE : QUEL INVESTISSEMENT ? 279
I. COMBINER LES POLITIQUES D'OFFRE ET DE DEMANDE 281
II. L'INVESTISSEMENT : 83 MILLIARDS DE DOLLARS NE SUFFIRONT PAS 283
A. UN RALENTISSEMENT DE L'INVESTISSEMENT AGRICOLE... 285
B. DES BESOINS D'INVESTISSEMENT À RÉESTIMER 288
1. L'estimation de la FAO 289
2. Une estimation qui, au total, minore sans doute l'effort à entreprendre 291
CINQUIÈME PARTIE : DEMAIN, QUELLE GEO-ALIMENTATION ? 301
I. AUTOSUFFISANCE OU SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ? 303
A. QUELLES TENDANCES POUR LA DIVISION AGRONOMIQUE DE LA PRODUCTION ? 304
1. Un scénario de renforcement modéré des interdépendances 305
a) L'existant : des interdépendances dont témoignent les bilans ressources-emplois 305
b) Le futur : vers un accroissement des déséquilibres régionaux et des échanges internationaux 306
2. Conditionné à des hypothèses fragiles 311
B. UN RÔLE DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX VARIABLE SELON LES SUCCÈS DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 313
II. DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES AGRICOLES INTERNATIONAUX 316
A. UN PROCESSUS PROGRESSIF DE LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES AGRICOLES 318
1. Au niveau mondial, l'Uruguay Round et Doha 318
2. À l'échelon européen, les réformes successives de la PAC 321
B. QUELS EFFETS DE LA LIBÉRALISATION DU COMMERCE AGRICOLE ? 323
1. Les enseignements des modèles 326
a) Rappels sur le contexte 326
b) Des résultats contrastés quand on diversifie les techniques de simulation 329
(1) De la vision irénique de la Banque mondiale... 329
(2) ... à l'approche plus réaliste de la délégation du Sénat à la planification 331
2. « Considérations hors-modèles » 335
a) Les avantages comparatifs ne sont pas figés et ne doivent pas être considérés comme tels 335
b) Ne pas négliger les risques d'une spécialisation tournée vars la demande étrangère 337
C. QUELQUES CONCLUSIONS AUTOUR DE CERTAINES CERTITUDES DANS UN CONTEXTE D'INCERTITUDES 342
1. La libéralisation du commerce agricole international peut compliquer l'équation alimentaire pour les pays en développement 342
2. Les effets de la libéralisation seraient asymétriques 344
3. La libéralisation du commerce agricole pose de redoutables problèmes de transition 346
III. QUELLE PLACE POUR LES HOMMES ? 348
A. LA PLUPART DES PAYSANS SONT PAUVRES 348
B. LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS LA FILIÈRE AGRO-ALIMENTAIRE EST GLOBALEMENT DÉFAVORABLE AUX PRODUCTEURS DE BASE 350
C. LES AGRICULTEURS DU MONDE CONNAISSENT DES SITUATIONS TRÈS DIFFÉRENCIÉES QUI POURRAIENT S'ACCENTUER 357
IV. QUEL PARADIGME ? 357
A. UNE INITIATIVE POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE : L'EXEMPLE DE LA « DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DANS LE NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE (NEPAD) » 358
B. UNE RÉHABILITATION DE L'AGRICULTURE ? LE RAPPORT DE LA BANQUE MONDIALE SUR LE DÉVELOPPEMENT 2008 364
1. Les trois catégories de pays identifiées par la Banque mondiale 365
2. Un appel à la réhabilitation de l'agriculture comme levier du développement 369
3. Des stratégies différenciées 372
C. DES POINTS DE VUE QUI MANQUENT DE COHÉRENCE 378
D. LES ÉTATS ACTEURS OU AGENTS DU SYSTÈME ALIMENTAIRE MONDIAL ? 379
CONCLUSION 387
EXAMEN EN DÉLÉGATION 395
ANNEXES 401
INTRODUCTION
« Il ne faut pas faire des enfants quand on ne peut pas les nourrir. » Pardonnez-moi, madame, la nature veut qu'on en fasse puisque la terre produit de quoi nourrir tout le monde; mais c'est l'état des riches, c'est votre état qui vole au mien le pain de mes enfants.
Lettre de Jean-Jacques Rousseau à Madame de Franceuil - 20 avril 1751
Aujourd'hui encore c'est un devoir d'être un abolitionniste de la faim. C'est de ce devoir que votre rapporteur est parti et c'est ce devoir qui le conduit à affirmer que la priorité des priorités, quand on s'occupe du défi alimentaire, c'est de réfléchir aux conditions d'une mise en oeuvre effective du droit à l'alimentation.
Le « défi alimentaire » occupe de plus en plus le monde. Les sommets internationaux, les ouvrages, l'émotion de l'opinion publique face aux famines, aux crises chroniques, la persistance endémique de la faim dans le Monde... tout témoigne que ce défi existe dès aujourd'hui.
Mais, avec le défi alimentaire, de quoi parle-t-on au juste ?
Très souvent, la question posée est celle des capacités du Monde à produire les ressources nutritives nécessaires pour alimenter correctement 9 milliards d'individus, nombre des terriens prévu généralement pour 2050. Elle renvoie à une estimation du potentiel agricole. Il faudra produire entre, 2010 et 2060, 733 exacal1(*) de nourriture, soit plus qu'entre l'an 1500 et 2010 (630 exacal).Le pourra-t-on ?
Sur ce point, les prospectives du défi alimentaire donnent des images des tensions physiques qui s'exerceront sur le système alimentaire. Elles montrent, qu'à technologies inchangées, ces tensions se renforceront. Face à des besoins alimentaires croissants, l'offre sera fortement sollicitée alors que ses conditions actuelles de soutenabilité sont remises en cause et que, dans le futur, de nouvelles contraintes devraient apparaître (conflits d'usage, nouvelles conditions environnementales...).
Cette contrainte d'objectif, les prospectives la décrivent comme plus ou moins critique. Elles convergent vers l'idée que le chemin pour obtenir l'autosuffisance alimentaire du Monde se rétrécira.
Elles suggèrent aussi qu'il n'existe pas un seul chemin mais plusieurs, avec chacun ses avantages et ses risques, chacun ses limites de soutenabilité.
Cette pluralité des options techniques pose un problème, difficile, de choix. Mais là ne réside sans doute pas la plus lourde des difficultés qu'il faut surmonter pour relever le défi alimentaire.
C'est quand on élargit le raisonnement, comme il faut le faire, aux questions économiques, sociales, juridiques, politiques qu'apparaît vraiment l'ampleur du problème.
Ces dernières dimensions doivent impérativement être croisées avec les données physiques, que privilégient souvent trop exclusivement les prospectives, ce qui accentue la complexité du problème mais, oriente aussi utilement la réflexion par l'épreuve de la cohérence qu'elles imposent.
Certains modèles techniques envisageables sur la base de leur faisabilité agronomique deviennent fragiles dès qu'on en élucide les conditions socio-économiques.
Celles-ci, d'ores déjà, ressortent comme critiques ce qui ternit l'image rassurante d'une offre qui pourrait moyennant quelques solutions techniques bien conçues répondre aux besoins.
Or, il faut considérer que, demain plus encore qu'aujourd'hui, la mise en pratique du droit à l'alimentation pourrait être entravée par les transformations des conditions socio-économiques des agriculteurs du Monde
Manquent fondamentalement à ceux qui ont fin, les ressources financières pour se nourrir. Plus encore, comme cette pauvreté est surtout paysanne, on peut dire que, si l'agriculture ne nourrit pas le monde, c'est parce que trop souvent elle ne « nourrit pas son monde ». Ainsi va le défi alimentaire aujourd'hui.
Tout l'enjeu est d'en sortir alors que le futur pourrait aggraver les forces qui font que ce défi est, avant tout, une affaire de pauvreté et de pauvreté assez largement rurale.
Le présent rapport se situe sans hésitation dans cette vision élargie du problème alimentaire.
Ce qui est devant nous c'est un défi agricole, peut-être, mais c'est plus qu'un défi agricole, c'est, sûrement, un défi alimentaire, et un défi de l'accès à la nourriture pour les pauvres de ce monde et ainsi, fondamentalement, c'est le défi du développement.
Mesurer comment l'agriculture pourra contribuer à ce que ce défi soit relevé c'est sans doute s'interroger sur son potentiel agro-alimentaire, d'un point de vue technique, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est examiner à quelles conditions ce potentiel sera exploité et comment faire en sorte que le développement de la production agricole s'accompagne d'un développement pour chacun de ses capacités d'accès à la nourriture, de ses revenus.
La vision de votre rapporteur s'inscrit pleinement dans la démarche popularisée par A Sen, dont il faut affirmer toute la pertinence pour comprendre les enjeux du futur et situer l'action.
Convenons-en ces interrogations sont formidables. Et elles le sont d'autant plus que, sans être peut-être tout à fait « neuves », elles sont en voie de complet renouvellement.
Comme ailleurs, la réflexion sur l'agriculture a souffert de la diffusion d'un cadre d'analyse ultra-simplificateur, celui de l'efficience des marchés. Or, la main de la semeuse n'est pas une main invisible. Les marchés peuvent ne pas apporter ce qu'on attend d'eux. Et les mêmes pays qui, dans les institutions de Bretton Woods l'oubliaient, savaient très bien s'en souvenir, qui à Genève à l'OMC, qui à Bruxelles ou à Washington, à quelques « blocs » de distance du FMI et de la Banque mondiale.
L'épreuve des faits propage aujourd'hui l'idée que l'agriculture cela compte et que l'équilibre alimentaire et l'équilibre des marchés peuvent différer.
La réflexion sur le développement agricole a donc repris. Et la Banque mondiale elle-même dans un rapport, qui est tout un symbole de ce processus a resitué en 2008 « l'agriculture au service du développement ».
Pour autant, tout est-il désormais clarifié ?
Certainement pas, et il est douteux que toute la clarté puisse être faite avant quelque temps. Il faut savoir reconnaître que le passage d'une matrice d'analyse un peu paresseuse, celle qui fait fi de la complexité du réel, à un projet plus réaliste, qui peut ne pas compter pour rien, au contraire, les mécanismes spontanés de fonctionnement de l'économie, est en soi une ambition. L'essentiel est que cette ambition ne reste pas sans effet pratique.
Il faut coupler la réflexion stratégique et l'action avec pour horizon d'inventer un système agricole mondial qui permette d'avancer, le plus rapidement possible, vers la résolution du défi alimentaire, vers la fin de la faim.
PREMIÈRE PARTIE :
LA FAIM : UNE MENACE
QUI S'AGGRAVE
CHAPITRE I :
VERS UNE CROISSANCE DES BESOINS
ALIMENTAIRES
Si l'on parle aujourd'hui couramment de défi alimentaire c'est largement en raison des perspectives démographiques qui ressuscitent le spectre du darwinisme alimentaire convoqué par Malthus et son « principe de population ».
Pour autant si les prospectives du défi alimentaire sont sensibles aux perspectives de population, à l'évidence, la modélisation de la demande de produits agricoles est une opération qui réclame de poser un très grand nombre d'hypothèses que le champ purement démographique n'épuise pas.
|
Prospective et hypothèses Dans les exercices2(*) portant sur le futur, il importe moins que les hypothèses auxquelles on est contraint de recourir soient exactes, - nul ne peut se targuer à l'avance de remplir strictement cette condition sans, à un degré au moins, le devoir à la chance - que robustes. Elles doivent pouvoir résister à la discussion raisonnable de leur vraisemblance. En outre, elles doivent être intéressantes c'est-à-dire déboucher sur des résultats permettant d'identifier des problèmes et des voies d'action. La plupart des prospectives de la sécurité alimentaire sont conformes à ces critères. L'observateur est cependant fondé à formuler son appréciation en exposant ses doutes sur les choix réalisés et, en montrant en quoi les hypothèses choisies « prédéterminent » les résultats des projections et, avec eux, les priorités d'action à privilégier. Autrement dit, il importe d'être transparent sur les présupposés des prospectives, ce qui n'est pas toujours le cas. |
Les tendances de la demande de nourriture dépendent a priori principalement de trois variables : la croissance démographique est une variable quantitative lourde mais qu'il faut « qualifier » en considérant l'évolution des revenus des populations mais aussi les évolutions touchant leur répartition.
Par ailleurs, des facteurs importants doivent être considérés en plus de ces variables comme susceptibles d'influer sur la demande en orientant son cours : les régimes alimentaires ; le niveau des pertes et gaspillages3(*)...
Les prospectives disponibles s'appuient sur des perspectives de demande estimées à l'aide de modèles qui, outre qu'ils sont tributaires des hypothèses posées pour chaque variable exogène, ne présentent pas nécessairement toutes les garanties techniques permettant de leur attribuer une robustesse sans failles.
Retenons une observation fondamentale : il existe une relative indétermination quant à l'ampleur de l'augmentation prévisible de la demande alimentaire.
Il faut souligner que cette indétermination réside pour une part importante dans la portée des politiques publiques mises en oeuvre pour transformer les besoins alimentaires en une demande effective qui, contrairement aux besoins - qui relèvent du domaine de la nature - est un enjeu social.
Il ne suffit donc pas de raisonner sur des besoins ; il faut apprécier l'écart entre ces besoins et leur expression en tant que demande alimentaire, savoir convertir la demande notionnelle, comme disent les économistes, en une demande effective, opération qui dépend principalement de la « solvabilisation » de la demande.
I. UNE CROISSANCE DE LA POPULATION AUX CONTOURS INCERTAINS
À l'horizon 2050, il semble probable que l'augmentation de la population ralentira. Pour autant, la population mondiale devrait franchir des seuils historiquement élevés.
En outre, les dynamiques démographiques, qui sont entourées d'incertitudes assez lourdes, seront régionalement contrastées : les régions les plus en retard de développement (agricole notamment) connaîtront des suppléments très significatifs de population qui placeront la trajectoire de leurs besoins alimentaires sur des pentes parfois fortement ascendantes.
A. UNE AUGMENTATION DE LA POPULATION DONT L'AMPLEUR EST CONJECTURALE
Les perspectives démographiques de l'ONU sur lesquelles sont fondées la quasi-totalité des exercices de prospective de l'alimentation retiennent une population de 9 milliards d'individus à l'horizon de 2050.
Ceci correspond à une augmentation de 50 % de la population mondiale entre 2000 et 2050 et de 28,6 % entre 2011, où la population mondiale est de 7 milliards d'habitants, et 2050.
On néglige souvent que cette projection centrale est accompagnée d'autres scénarios, l'un avec une population de l'ordre de 7,9 milliards d'habitants, d'autres où la population atteindrait de 11 à 12 milliards d'individus.
Ainsi, derrière la perspective démographique généralement admise et qu'on présente souvent comme quasi-certaine, il existe des scénarios alternatifs qui invitent à prendre en considération l'incertitude qui caractérise cette variable fondamentale.
Or, selon l'hypothèse démographique adoptée, le problème alimentaire change non seulement de degré mais de nature.
Dans l'état actuel de la population mondiale, on reconnaît, sous certaines réserves importantes, que la contrainte alimentaire que subissent trop d'individus n'est pas le résultat d'une insuffisance de production.
L'hypothèse d'une population mondiale à 9 milliards brise ce consensus : pour certains, les perspectives d'offre risquent de buter alors sur des limites quantitatives difficilement dépassables ; pour d'autres, des actions réalistes permettent de les franchir pour satisfaire les besoins alimentaires liés à la progression de la population.
Si la perspective d'une progression démographique plus limitée renforce la crédibilité de ce dernier point de vue, à l'inverse, une population mondiale proche de 11 milliards d'individus obligerait à un aggiornamento beaucoup plus radical que celui nécessité par l'hypothèse démographique moyenne.
Il y a ainsi un risque à négliger l'un des enseignements principaux des prospectives démographiques qui réside bien dans l'incertitude sur les besoins alimentaires associés à la dynamique de la population mondiale.
Il serait donc sage de prolonger systématiquement ces variantes de population dans les projections proposées par les prospectives alimentaires.
D'un point de vue pratique, il n'apparaît pas plus pertinent de se fonder sur le scénario démographique moyen pour concevoir les orientations des mesures à mettre en oeuvre que d'envisager le scénario où la croissance démographique serait la plus élevée.
Les délais nécessaires à l'efficacité des actions à entreprendre font apparaître ce choix comme au moins aussi risqué que celui qui consisterait à se baser sur une population de 7,9 milliards d'habitants plutôt que des 9 milliards du scénario moyen.
Le choix d'un biais démographique systématiquement haussier dans les conceptions des politiques destinées à calibrer les progrès de la production alimentaire n'apparaîtrait pas dénué de prudence.
Ce « choix de pensée » est d'autant plus recommandable que nombre de prospectives sont construites sur d'autres hypothèses qui reviennent à minorer les exigences du développement agricole. Tel est le cas des objectifs qu'on se donne sur le niveau de la sous-alimentation ou de la ration alimentaire individuelle.
Par ailleurs, l'inertie de la variable démographique doit être prise en compte.
Ainsi, M. Michel Griffon paraît-il fondé à estimer que la limitation des naissances qui, pour Malthus, représentent une nécessité pour prévenir les famines, ne saurait offrir de réelles solutions.
À supposer même qu'il soit admis de l'imposer, les marges sont réduites d'autant que les projections démographiques l'incluent déjà à leurs scénarios en considérant que la limitation des naissances se fera naturellement (v. le graphique ci-dessous) à mesure du développement économique.
Évolution du taux de croissance de la population pour mille par an
Comme on le voit, la projection démographique centrale admet une inflexion prononcée de la croissance de la population par rapport aux tendances passées puisque son rythme serait divisé par deux.
Alors que la population mondiale avait progressé de 1,7 % par an entre 1970 et 2000, elle n'augmenterait plus que de 0,8 % l'an jusqu'en 2050 avec un profil temporel incluant le passage d'une croissance annuelle de 1 % entre 2000 et 2030 à un rythme de 0,5 % au-delà.
B. UNE DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE GÉOGRAPHIQUEMENT CONTRASTÉE AVEC D'IMPORTANTS SUPPLÉMENTS DE POPULATION DANS LES PAYS LES MOINS AVANCÉS
La croissance démographique mondiale ne sera pas homogène.
L'augmentation de la population mondiale sera concentrée dans les pays en développement mais, parmi ceux-ci, les rythmes de progression devraient aussi être fortement contrastés, ainsi qu'il est figuré dans le graphique ci-dessous qui retrace l'évolution de la population mondiale et sa répartition dans l'hypothèse basse des projections de l'ONU de 2001.
Évolution de la population mondiale 1950-2050 hypothèse basse
Dans tous les scénarios, c'est la population des pays moins développés qui tire l'accroissement démographique et, parmi ceux-ci, ce sont les pays les moins avancés qui enregistrent les plus nettes progressions.
Perspectives démographiques à l'horizon 2050 par grande région (en millions)
|
1970 |
2000 |
2015 |
2030 |
2050 |
|
|
Monde |
3 692 |
6 071 |
7 197 |
8 130 |
8 919 |
|
Pays en développement dont : |
2 603 |
4 731 |
5 802 |
6 809 |
7 509 |
|
Afrique sub-saharienne |
262 |
607 |
853 |
1 134 |
1 509 |
|
Afrique du Nord, Moyen-Orient |
183 |
392 |
521 |
643 |
774 |
|
Amérique latine-Caraïbes |
281 |
515 |
623 |
705 |
762 |
|
Asie du Sud |
708 |
1 340 |
1 685 |
1 972 |
2 208 |
|
Asie du Sud-Est |
1 169 |
1 877 |
2 119 |
2 256 |
2 256 |
|
Pays industrialisés |
727 |
905 |
965 |
1 003 |
1 019 |
|
Pays en transition |
351 |
411 |
399 |
380 |
345 |
Source : FAO « L'agriculture mondiale en 2030/2050 » juin 2006
Le poids de la population des pays en développement dans la population mondiale largement prédominant aujourd'hui devrait encore s'accroître à l'horizon 2050 passant de 77,9 à 84,2 %.
Sur les 2,848 milliards de personnes supplémentaires en 2050 par rapport à 2000, 2,778 milliards vivront dont les pays en développement.
Ces personnes seraient pour un peu plus de la moitié (1,584 milliard) localisées en Afrique. La population de l'Asie du Sud devrait également progresser de façon soutenue avec 868 millions d'habitants supplémentaires.
Évolution de la population mondiale
à l'horizon 2050
(Croissance annuelle en pourcentage)
|
1970/2000 |
2000/2030 |
2030/2050 |
2000/2050 |
|
|
Monde |
1,7 |
1 |
0,5 |
0,8 |
|
Pays en développement dont : |
2 |
1,2 |
0,6 |
0,9 |
|
Afrique sub-saharienne |
2,9 |
2,1 |
1,4 |
1,8 |
|
Afrique du Nord, Moyen-Orient |
2,6 |
1,7 |
0,9 |
1,4 |
|
Amérique latine-Caraïbes |
2 |
1,1 |
0,4 |
0,8 |
|
Asie du Sud |
2,2 |
1,3 |
0,6 |
1 |
|
Asie du Sud-Est |
1,5 |
0,6 |
0 |
0,4 |
|
Pays industrialisés |
0,7 |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
|
Pays en transition |
0,5 |
- 0,3 |
- 0,5 |
- 0,4 |
Source : FAO « L'agriculture mondiale en 2030/2050 » juin 2006
Le tableau ci-dessus confirme la perspective de différentiels de croissance marqués selon la région considérée qu'illustre également le graphique ci-après.
Dynamique de la population, par grande
région, 1950-2050
(variante moyenne) Indice : 100 en
2050
Le taux de croissance démographique des pays les moins avancés atteindrait 1,84 % dans le scénario moyen contre + 0,05 % dans les pays développés (0,75 % pour l'ensemble du monde).
La population des pays les moins avancés ferait plus que doubler avec une multiplication par quatre quand les pays développés verraient leur population stabilisée. Pour les pays en développement la croissance de la population atteindrait 50 %.
Des régions du monde, c'est l'Afrique qui connaîtrait la plus forte dynamique (+ 1,69 % par an) suivie de l'Océanie (dont la population est aujourd'hui peu élevée - 33 millions) et de l'ensemble Amérique latine et Caraïbes (+ 0,74 % l'an).
En revanche, l'Asie progresserait à peu près comme l'Amérique du Nord mais avec des effets numériques autrement plus importants.
Variation numérique de la population
mondiale entre 2005 et 2050
par région dans un scénario
à 9 milliards d'habitants
(en millions)
|
Ensemble du monde |
+ 2 611 |
|
Régions développées |
+25 |
|
Régions moins développées |
+ 2 587 |
|
dont pays les moins avancés |
+ 976 |
|
autres |
+ 1 610 |
|
Afrique |
+ 1 031 |
|
Asie |
+ 1 312 |
|
Europe |
- 75 |
|
Amérique latine et Caraïbes |
+ 222 |
|
Amérique du Nord |
+ 107 |
|
Océanie |
+ 15 |
La concentration du développement démographique n'est pas entièrement retracée à ce niveau d'analyse.
Dans les faits, elle sera plus forte puisqu'une partie importante de l'accroissement démographique devrait intervenir dans quelques pays, 19 au total.
Les 19 pays aux perspectives de croissance
démographique les plus fortes
(en milliers)
|
2000 |
2050 |
Population rurale en % |
|
|
Afghanistan |
23 739 |
97 324 |
79 |
|
Bénin |
7 198 |
22 123 |
58 |
|
Burkina Faso |
11 289 |
39 093 |
81 |
|
Burundi |
6 487 |
25 812 |
92 |
|
Tchad |
8 217 |
31 497 |
76 |
|
Congo DR |
50 056 |
177 271 |
73 |
|
Éthiopie |
68 538 |
170 190 |
81 |
|
Madagascar |
16 191 |
43 508 |
71 |
|
Mali |
11 647 |
41 976 |
67 |
|
Niger |
11 781 |
50 156 |
80 |
|
Somalie |
7 011 |
21 329 |
73 |
|
Ouganda |
24 311 |
126 950 |
85 |
|
Angola |
13 838 |
43 501 |
70 |
|
Congo |
3 439 |
13 721 |
30 |
|
Érythrée |
3 557 |
11 229 |
80 |
|
Irak |
25 669 |
63 693 |
32 |
|
Libéria |
3 066 |
10653 |
55 |
|
Mauritanie |
2 644 |
7 497 |
43 |
|
Yémen |
17 936 |
59 454 |
77 |
|
Total |
321 300 |
1 056 700 |
La population de ces 19 pays qui représente 5,3 % de la population mondiale en 2000 augmenterait de 735,6 millions d'habitants à l'horizon 2050, soit le quart de l'accroissement démographique prévu entre 2000 et 2050.
Ces différentes données situent le poids de la pression démographique à venir. Elles montrent qu'elle différera considérablement selon les régions et les pays considérés. Toutefois, il faut encore considérer que cette projection de la population mondiale suppose une certaine maîtrise de la fécondité permettant de sortir de la période de transition démographique, et, à ce titre, n'est pas particulièrement contraignante au regard du défi alimentaire.
II. DE LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE AUX BESOINS ALIMENTAIRES : UNE CLEF DE PASSAGE QUI DÉPEND ÉTROITEMENT DES REVENUS
Moyennant une population mondiale qui connaîtrait un pic à 9 milliards d'habitants en 2050, la production agricole devrait augmenter dans des proportions globalement beaucoup plus importante pour satisfaire la demande.
Il n'y a pas d'homothétie entre l'augmentation de la population et l'augmentation des besoins alimentaires mondiaux en raison de trois facteurs principaux.
La structure démographique doit être prise en considération. Ainsi, la pyramide des âges va évoluer et le régime alimentaire étant différent d'une classe d'âge à l'autre, le volume total de la demande par continent et par pays sera influencé pour ces « repyramidages ». L'Europe aura une plus faible proportion de jeunes et donc consommera moins au contraire de l'Afrique. Par ailleurs, il faut aussi considérer le nombre de femmes enceintes qui modifie le volume des besoins alimentaires théoriques.
Le régime alimentaire change en fonction de la localisation urbaine ou rurale du consommateur : les urbains cherchent à consommer plus de viande et de produits faciles à l'emploi (riz, pâtes, pain), ce qui modifie le contenu de la demande car il faut de 3 à 10 calories végétales, selon les cas, pour produire une calorie animale (il faut en effet alimenter les animaux pour produire de la viande). En fonction de l'ampleur des phénomènes d'urbanisation, il en résultera une demande plus ou moins forte de surface agricole destinée à des productions pour l'alimentation animale susceptible d'entrer en concurrence directe avec les surfaces destinées à alimenter directement les populations humaines.
La demande alimentaire évolue en fonction des revenus : dans les pays en développement, l'accroissement des revenus va accroître la demande alimentaire, sauf dans les pays les plus riches où la proportion des revenus consacrés à l'achat d'aliments tend à diminuer. Par ailleurs, plus les revenus sont élevés, plus l'alimentation tend à se diversifier, et la part des protéines animales dans les régimes alimentaires tend à augmenter. Les perspectives de demande alimentaire sont ainsi tributaires du cadrage macro-économique des exercices de prospective. Si la demande alimentaire est, en moyenne, peu sensible aux prix et aux revenus dans les pays développés, il en va autrement dans les pays qui seront, théoriquement, les plus gros contributeurs à l'augmentation de la demande.
Tout écart significatif entre les variables macro-économiques servant de cadrage aux prospectives et leur profil effectif peut affecter la projection de la demande. À cet égard, la croissance du PIB par tête, et sa distribution effective dans les populations concernées4(*) ainsi que les prix doivent être tenues comme des variables particulièrement décisives, à quoi il faut ajouter la considération du taux de change5(*).
À cet égard, les prospectives disponibles procèdent par simplification puisqu'elles déduisent souvent de la pression démographique une hausse de la demande. Or, la demande solvable est suspendue à des hypothèses de croissance économique qui, le plus souvent, sont considérées comme exogènes. Cette méthode revient à poser ces hypothèses comme s'il s'agissait d'un cadre indépendant de l'équation à résoudre, alors qu'à l'évidence elles en sont largement le résultat, en particulier pour les pays en développement où la population est appelée à augmenter.
Étant donné la place de l'agriculture dans ces pays et les liens entre le revenu et la production agricole on ne peut se satisfaire d'une méthode où la demande n'est pas endogénéisée, c'est-à-dire au moins partiellement considérée comme tributaire de l'offre et de ses perspectives.
Ainsi, s'il existe un consensus sur la tendance à l'augmentation des besoins alimentaires, les prospectives disponibles offrent un panorama assez diversifié de son ampleur, cette diversité reflétant les choix de modélisation de la demande alimentaire6(*).
A. LA PROSPECTIVE DES BESOINS ALIMENTAIRES DÉPEND DE L'HYPOTHÈSE SUR L'ENRICHISSEMENT DE LA RATION ALIMENTAIRE
Les prospectives débouchent ainsi sur des estimations de besoins alimentaires à l'horizon 2050 qui offrent des contrastes parfois prononcés.
Estimation des besoins alimentaires à l'horizon 2050 dans quelques prospectives (évolution en %)
|
FAO 2009 |
Agrimonde GO |
Agrimonde G1 |
IFPRI Scénario 1 |
IFPRI Scénario 2 |
IFPRI Scénario 3 |
|
|
Augmentation des besoins alimentaires généraux |
+ 58 |
+ 68 |
+ 40 |
+ 64 |
+ 58 |
+ 52 |
|
Évolution de la demande en produits animaux |
+ 85 |
+ 151 |
+ 40 |
+ 95 |
+ 49 |
+ 29 |
|
Évolution de la demande en produits agricoles végétaux incluant l'alimentation animale |
+ 66 (en tonnes) |
+ 83 |
+ 28 |
+ 65 (céréales) |
+ 43 (céréales) |
+ 30 (céréales) |
1) Scénario « croissance agricole et développement »
2) Scénario « échec des politiques »
3) Scénario « ruptures techno-naturelles »
Les estimations de croissance des besoins alimentaires globaux varient dans une fourchette assez large de 1 à 1,7 avec toutefois une concentration autour de 60 à 70 %
Pour une part importante, cette variabilité est attribuable aux perspectives concernant la ration alimentaire disponible par tête.
Les projections de la FAO s'appuient sur une augmentation modérée de la ration individuelle disponible (+ 11 % entre 2005 et 2050).
Dans la projection réalisée en 2006, la ration alimentaire disponible moyenne s'élèverait à 3 130 kcal par jour et par personne en 20507(*).
Cette hypothèse n'est qu'une de celles qui conduisent à estimer l'augmentation de la production agricole nécessaire pour relever le défi alimentaire, la variable la plus lourde résidant dans l'accroissement démographique, mais c'est une hypothèse essentielle.
En effet, à dires d'experts, l'augmentation de 11 % de la ration alimentaire individuelle implique une augmentation de 22 % de la production agricole par tête du fait notamment des perspectives de changements des régimes alimentaires.
À cet égard, deux modifications sont modélisées : la hausse de la part des aliments faiblement caloriques (fruits et légumes) et celle de la viande dont le bilan est, sous l'angle des besoins de production, peu optimal puisque la conversion calorique des céréales en viande est l'occasion de pertes par rapport à une consommation directe8(*).
Selon des estimations raisonnables, 11 calories végétales sont nécessaires pour produire 1 calorie de boeuf ou de mouton, 8 calories végétales pour 1 calorie de lait et 4 calories végétales pour produire 1 calorie de porc, de volaille ou d'oeuf9(*).
Il faut ajouter que ces chiffres sont des moyennes qui dépendent des modalités d'élevage. Il semble que plus l'élevage recourt à des procédés intensifs plus il est économe en calories végétales.
Ainsi, des élevages bovins pratiqués dans des conditions traditionnelles peuvent réclamer 50 calories végétales pour 1 calorie bovine.
Dans la prospective de la FAO, aucune région du monde ne rejoindrait le niveau de la ration alimentaire atteint dans les pays industrialisés en 2000, ce qui peut être considéré comme témoignant d'une assez faible ambition.
En dépit du poids des grands émergents qui rejoignent le régime alimentaire occidental, l'amélioration de la ration alimentaire individuelle dans les pays en développement ne s'élèverait qu'à 15 %, plusieurs grandes régions continuant de subir en 2050 une situation précaire : le sud de l'Asie (hors Chine) et l'Afrique subsaharienne.
Projections de la FAO de consommation par
tête par région
(en kcal/personne et par jour)
|
1999 |
2005 |
2015 |
2030 |
2050 |
|
|
Monde |
2 725 |
2 771 |
2 884 |
2 963 |
3 047 |
|
Pays en développement |
2 579 |
2 622 |
2 770 |
2 864 |
2 966 |
|
Afrique subsaharienne dont hors |
2 128 |
2 167 |
2 319 |
2 494 |
2 708 |
|
Nigeria |
2 016 |
2 061 |
2 206 |
2 406 |
2 643 |
|
Afrique du Nord - Moyen Orient |
2 991 |
2 995 |
3 072 |
3 134 |
3 197 |
|
Amérique latine Caraïbes |
2 798 |
2 899 |
2 953 |
3 084 |
3 151 |
|
Asie du sud |
2 334 |
2 344 |
2 532 |
2 656 |
2 843 |
|
Asie du Sud-est hors |
2 764 |
2 839 |
3 034 |
3 112 |
3 144 |
|
Chine |
2 475 |
2 538 |
2 614 |
2 740 |
2 870 |
|
Pays industrialisés |
3 429 |
3 462 |
3 501 |
3 548 |
3 569 |
|
Pays en transition |
2 884 |
3 045 |
3 043 |
3 159 |
3 283 |
Source : FAO
Ces perspectives modérées, favorisent naturellement l'atteinte de l'équilibre alimentaire dans le monde10(*).
On le vérifie en observant que ce sont les différences portant sur la ration individuelle qui expliquent l'essentiel des écarts dans l'estimation des besoins alimentaires par les deux scénarios Agrimonde (de l'INRA et du CIRAD) ainsi que l'étude citée le précise
Le scénario Agrimonde GO reprend les hypothèses du scénario Global Orchrestration de l'exercice d'évaluation des écosystèmes pour le Millénaire lancé par l'ONU dans lequel la croissance économique explique largement que les niveaux de consommation de calories alimentaires suivent une tendance soutenue. La croissance économique y tire la consommation dans toutes les régions pour atteindre une disponibilité moyenne mondiale de 3 590 kcal/hab/jour et la sous-alimentation y est considérablement réduite.
Le scénario Agrimonde G1 se distingue très nettement de cette évolution tendancielle par une hypothèse de disponibilité alimentaire retenue pour 2050 qui est de 3 000 kcal/hab/jour dans toutes les régions.
Agrimonde G1 se singularise ainsi par la quasi-stabilité de la disponibilité alimentaire par personne qui, au prix d'une redistribution des régimes alimentaires locaux à l'échelle mondiale, resterait en 2050 au niveau atteint en 2000.
Cette dernière hypothèse est clairement présentée comme une rupture majeure par rapport aux tendances observées entre 1961 et le début du XXIe siècle.
« Elle correspond à de faibles évolutions des disponibilités alimentaires par personne dans la plupart des régions d'ici à 2050, sauf en Afrique subsaharienne, pour laquelle la disponibilité alimentaire par habitant a augmenté de 25 % en 50 ans, et dans la région OCDE-1990 pour laquelle elle a diminué d'un quart. Ces 3 000 kcal sont décomposées en 2 500 kcal de produits végétaux et 500 kcal de produits animaux, la répartition entre monogastriques et ruminants variant selon les régions. »
Elle est très contraignante, voire héroïque, pour certaines populations, en particulier pour les pays de l'OCDE qui doivent réduire la ration individuelle de leur population de plus de 30 % par rapport à la situation de 2000.
Cet effort est encore plus considérable quand on l'apprécie par rapport aux évolutions tendancielles décrites dans le scénario AGO.
Récapitulatif des hypothèses quantitatives relatives aux emplois des productions agricoles en 2000 et 2050 dans les scénarios Agrimonde 1 et Agrimonde GO
|
Disponibilités totales (kcal/hab./j) |
|||
|
2000 |
2050 Agrimonde 1 |
2050 Agrimonde GO |
|
|
Afrique du Nord - Moyen Orient |
3 343 |
3 000 |
3 458 |
|
Afrique subsaharienne |
2 392 |
3 000 |
2 972 |
|
Amérique latine |
3 106 |
3 000 |
3 698 |
|
Asie |
2 776 |
3 000 |
3 702 |
|
Ex-URSS |
3 050 |
3 000 |
3 457 |
|
OCDE-1990 |
3 931 |
3 000 |
3 590 |
|
Monde |
2 962 |
3 000 |
3 690 |
Sources : d'après Carpenter et al. (2005), Dorin (cf. I.2 Agribiom)
Et on mesure plus complètement le caractère très « tendu » de l'hypothèse lorsqu'on garde à l'esprit qu'il y a un écart entre la ration disponible et la ration ingérée. Celle-ci est inférieure à la première à hauteur du niveau des pertes, qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de points de pourcentage, quand il est admis que les besoins énergétiques nets des hommes en termes d'ingestion se situent entre 2 000 et 3 000 kcal/jour selon les caractéristiques individuelles.
Quoiqu'il en soit, les différences dans les hypothèses concernant le niveau de la ration alimentaire moyenne (avec celle portant sur sa répartition entre végétaux et produits carnés) contribuent aux écarts d'estimation des productions nécessaires dans les deux scénarios écarts qui sont très élevés :
dans Agrimonde G1 le supplément de production végétale doit atteindre 28 % à l'horizon 2050 et 20 % pour la production animale ;
dans Agrimonde GO, la production végétale doit augmenter de 84 % et la production animale de 137 % par rapport aux niveaux de 2003.
B. UNE DYNAMIQUE FORTEMENT CONTRASTÉE PAR GRANDE RÉGION DU MONDE
La totalité des prospectives montrent que les besoins alimentaires augmenteront dans des proportions très variables selon les régions du monde.
Par exemple, l'étude de M. Philippe Collomb mentionne les coefficients multiplicateurs suivants, à l'horizon 2050 pour les différentes régions du monde, par rapport à une base 1 en 2000.
Besoins alimentaires à l'horizon 2050
(base 1 en 2000)
|
Afrique |
Asie |
Europe |
Amérique |
Amérique |
Océanie |
|
|
Croissance de la population |
3,14 |
1,69 |
0,91 |
1,80 |
1,31 |
1,61 |
|
Composition population |
1,07 |
1,02 |
0,98 |
1,03 |
0,99 |
1,00 |
|
Modification Régime aliment |
1,64 |
1,38 |
1,00 |
1,07 |
1,00 |
1,00 |
|
Effet d'ensemble |
5,14 |
2,34 |
0,91 |
1,92 |
1,31 |
1,61 |
En fonction des différentes composantes : population, composition (âge, sexe) et régime alimentaire
Source : « Une voie étroite pour la sécurité alimentaire d'ici à 2050 », M. Philippe Collomb
Un effort d'accroissement de la production très élevé serait nécessaire pour satisfaire la croissance des besoins alimentaires dans certaines régions.
Si ces besoins devaient être couverts par des productions locales, entre 2000 et 2050, l'Afrique devrait plus que quintupler sa production, l'Asie devrait plus que la doubler, et l'Amérique latine presque la doubler.
Seule l'Europe verrait sa contrainte alimentaire se détendre.
Ces données sont reprises avec quelques nuances de présentation par M. Michel Griffon pour lequel les besoins de production supplémentaires par région seront les suivants dans le cadre de l'hypothèse centrale déjà mentionnée (hypothèse de Collomb).
Estimation du déficit mondial à combler à l'horizon 2050
|
Asie |
Amérique latine |
Afrique du Nord et Moyen-Orient |
Afrique subsaharienne |
Pays industriels |
|
|
Coefficient multiplicateur des besoins alimentaires 2050/2000 |
2,34 |
1,92 |
Estimé à 2,5* |
5,14 |
Fixé à 1 : on suppose que les pays industriels n'ont plus besoin d'accroître leur alimentation. |
|
Production 2000 (109t) |
1 700 |
272 |
154 |
260 |
/ |
|
Consommation 2000 |
1 770 |
260 |
220 |
262 |
/ |
|
Production nécessaire en 2050 (109t) arrondi |
4 140 |
370 |
550 |
1 340 |
Inchangée |
|
Différence 2050/2000 |
2 440 |
98 |
396 |
1 080 |
Inchangée |
|
* La catégorie ANMO (Afrique du Nord/Moyen-Orient) n'existe pas dans les travaux de Philippe Collomb. Le chiffre proposé est une estimation à partir des chiffres nationaux. |
|||||
Source : « Nourrir la planète » - Michel Griffon
Par rapport à la situation de 2000, la production des zones hors-OCDE devrait passer de 2 386 à 6 400 millions de tonnes (4 014 millions de plus) dont 61 % en Asie et 27 % en Afrique subsaharienne (soit plus qu'un doublement).
En revanche, dans les pays industriels de l'OCDE les besoins n'augmenteraient pas ce qui se traduit par l'absence de pression à l'augmentation de la production locale du fait des besoins alimentaires indigènes.
Quant à elles, les projections de la FAO, hors prise en compte de biocarburants, sont résumées dans les tableaux ci-après en ce qui concerne la demande de céréales.
Projections de la FAO de consommation de
céréales
(en millions de tonnes)
|
1999 |
2015 |
2030 |
2050 |
|
|
Consommation (hors biocarburants) dont : |
1 866 |
2 287 |
2 677 |
3 010 |
|
Pays en développement |
1 125 |
1 472 |
1 799 |
2 096 |
|
Pays développés |
741 |
815 |
877 |
914 |
Source : FAO
Projections de la FAO de consommation de
céréales
(Évolution annuelle en %)
|
1980/1990 |
1999/2008 |
1999/2015 |
2015/2030 |
2030/2050 |
|
|
Consommation dont : |
1,9 |
1,6 |
1,4 |
1,1 |
0,6 |
|
Pays en développement |
3 |
1,8 |
1,8 |
1,3 |
0,8 |
|
Pays développés |
0,8 |
1,4 |
0,6 |
0,5 |
0,2 |
Source : FAO
Hors biocarburants, la consommation de céréales, qui augmenterait de 32 % entre 2015 et 2050, connaîtrait un accroissement de 61 % entre 2000 et 2050.
La consommation suivrait un rythme d'augmentation plus dynamique dans les pays en développement11(*).
Entre 1980 et 1990, la demande de céréales a augmenté au rythme annuel de 1,9 %, moyennant un différentiel entre les pays en développement où la croissance a atteint 3 % et les pays développés (+ 0,8 % par an).
Pour l'avenir, la FAO escompte un ralentissement du rythme d'expansion de la consommation qui prolongerait l'atténuation observée dans les années 2000 (+ 1,6 % pour le monde, avec + 1,8 % pour les pays en développement et + 1,4 % pour les pays développés).
De 1,1 % par an entre 2015 et 2030 la croissance de la consommation se réduirait de moitié entre 2030 et 2050 (+ 0,6 % l'an).
La demande deviendrait progressivement plate dans les pays développés (+ 0,2 % l'an entre 2030 et 2050) et elle passerait de 1,3 à 0,8 % de progression annuelle dans les pays en développement.
Pour les viandes, l'inflexion de la croissance de la consommation pour être moins prononcée, est également le trait marquant des prospectives de la FAO.
Projections de la FAO pour
l'élevage
(en millions de tonnes)
|
1999 |
2015 |
2030 |
2050 |
|
|
Consommation dont : |
228 |
305 |
380 |
463 |
|
Pays en développement |
127 |
191 |
258 |
334 |
|
Pays développés |
101 |
113 |
123 |
130 |
Source : FAO
Projections de la FAO pour la
viande
(Évolution annuelle en %)
|
1981/1990 |
1999/2008 |
1999/2015 |
2015/2030 |
2030/2050 |
|
|
Consommation dont : |
3,3 |
2,3 |
2 |
1,5 |
1 |
|
Pays en développement |
5,2 |
3,1 |
2,8 |
2 |
1,3 |
|
Pays développés |
2,3 |
1,3 |
0,8 |
0,5 |
0,3 |
Source : FAO
Ainsi, la distribution des besoins en énergie végétale fait apparaître une forte dispersion entre régions.
Cette dispersion est encore considérablement accentuée quand on considère les besoins de chaque pays.
Les travaux présentés par M. Philippe Collomb en témoignent avec une particulière netteté.
Évolution des besoins en énergie
d'origine végétale
selon le pays entre 1995 et 2050 :
Afrique
(nombre par lequel il faut multiplier les besoins de l'année
1995
pour obtenir les besoins de l'année 2050)
Source : « Une voie
étroite pour la sécurité alimentaire d'ici à
2050 »
M. Philippe Collomb - FAO
Évolution des besoins en énergie
d'origine végétale
selon le pays entre 1995 et 2050 :
Amérique latine
(nombre par lequel il faut multiplier les besoins de
l'année 1995
pour obtenir les besoins de l'année
2050)
Source : « Une voie
étroite pour la sécurité alimentaire d'ici à
2050 »
M. Philippe Collomb - FAO
Évolution des besoins en énergie
d'origine végétale
selon le pays entre 1995 et 2050 :
Asie
(nombre par lequel il faut multiplier les besoins de l'année
1995,
pour obtenir les besoins de l'année 2050)
Source : « Une voie
étroite pour la sécurité alimentaire d'ici à
2050 »
M. Philippe Collomb - FAO
Ces cartes régionales des besoins en énergie végétale situent les problèmes :
- la croissance des besoins régionaux pourra excéder de beaucoup la valeur moyenne obtenue à l'échelle mondiale ;
- les pays les plus concernés se regroupent principalement en Afrique.
La liste ci-dessous qui propose une classification des pays selon le niveau de croissance annuelle des besoins en énergie végétale à l'horizon 2050 en témoigne.
Les plus fortes croissances de besoins en énergie d'origine végétale entre 1995 et 2050 (*) (classement par valeurs décroissantes)
|
Rang |
Pays |
Accroissement des besoins (*) |
Rang |
Pays |
Accroissement des besoins (*) |
|
Croissance annuelle moyenne de 4 à 5 % entre 1995 et 2050 |
|||||
|
1 |
Éthiopie |
15,42 |
13 |
Nigéria |
10,04 |
|
2 |
Mozambique |
14,52 |
14 |
Congo |
9,85 |
|
3 |
Congo (ex-Zaïre) |
13,87 |
15 |
Haïti |
9,81 |
|
4 |
Libéria |
12,65 |
16 |
Côte d'Ivoire |
9,61 |
|
5 |
Burundi |
12,23 |
17 |
Zambie |
9,51 |
|
6 |
Malawi |
12,21 |
18 |
Ouganda |
9,34 |
|
7 |
Angola |
12,11 |
19 |
Afghanistan |
9,16 |
|
8 |
Rwanda |
11,58 |
20 |
Guinée |
9,13 |
|
9 |
Sierra Leone |
10,92 |
21 |
Togo |
9,07 |
|
10 |
Niger |
10,58 |
22 |
Cameroun |
8,78 |
|
11 |
Ghana |
10,57 |
23 |
Centrafricaine (Rép.) |
8,68 |
|
12 |
Tchad |
10,34 |
24 |
Burkina-Faso |
8,66 |
|
Croissance annuelle moyenne de 3 à 4 % entre 1995 et 2050 |
|||||
|
25 |
Bénin |
8,27 |
35 |
Sénégal |
6,24 |
|
26 |
Yémen |
8,25 |
36 |
Guatemala |
6,12 |
|
27 |
Tanzanie |
7,99 |
37 |
Gabon |
5,87 |
|
28 |
Kenya |
7,34 |
38 |
Nicaragua |
5,73 |
|
29 |
Cambodge |
7,09 |
39 |
Laos |
5,68 |
|
30 |
Madagascar |
7,02 |
40 |
Namibie |
5,53 |
|
31 |
Mali |
6,95 |
41 |
Népal |
5,45 |
|
32 |
Bangladesh |
6,80 |
42 |
Zimbabwe |
5,40 |
|
33 |
Lesotho |
6,53 |
43 |
Soudan |
5,29 |
|
34 |
Somalie |
6,43 |
|||
|
Croissance annuelle moyenne de 2 à 3 % entre 1995 et 2050 |
|||||
|
44 |
Honduras |
4,80 |
53 |
Salvador |
3,79 |
|
45 |
Viêt-nam |
4,73 |
54 |
Botswana |
3,70 |
|
46 |
Bolivie |
4,38 |
55 |
Jordanie |
3,55 |
|
47 |
Irak |
4,23 |
56 |
Syrie |
3,53 |
|
48 |
Birmanie |
4,19 |
57 |
Sri Lanka |
3,50 |
|
49 |
Pérou |
4,02 |
58 |
Inde |
3,37 |
|
50 |
Philippines |
3,89 |
59 |
Mauritanie |
3,22 |
|
51 |
Libye |
3,87 |
60 |
Iran |
3,05 |
|
52 |
Pakistan |
3,80 |
|||
|
Croissance annuelle moyenne de 1 à 2 % entre 1995 et 2050 |
|||||
|
61 |
Dominicaine (Rép.) |
2,90 |
73 |
Algérie |
2,14 |
|
62 |
Indonésie |
2,81 |
74 |
Malaisie |
1,99 |
|
63 |
Paraguay |
2,55 |
75 |
Jamaïque |
1,93 |
|
64 |
Thaïlande |
2,48 |
76 |
Chine |
1,90 |
|
65 |
Équateur |
2,39 |
77 |
Tunisie |
1,88 |
|
66 |
Afrique du Sud |
2,33 |
78 |
Trinité et Tobago |
1,86 |
|
67 |
Corée du Sud |
2,30 |
79 |
Chili |
1,84 |
|
68 |
Panama |
2,27 |
80 |
Liban |
1,81 |
|
69 |
Venezuela |
2,25 |
81 |
Colombie |
1,80 |
|
70 |
Maroc |
2,24 |
82 |
Mexique |
1,79 |
|
71 |
Égypte |
2,18 |
83 |
Brésil |
1,75 |
|
72 |
Costa Rica |
2,16 |
|||
(*) Nombre par lequel il faut multiplier les besoins de l'année 1995 pour obtenir les besoins de l'année 2050.
C. DES RÉSULTATS SENSIBLES AUX MODES DE CONSOMMATION
On peut a priori imaginer détendre les contraintes quantitatives de la production en limitant la demande par des actions visant à modifier les modes de consommation.
Deux questions distinctes peuvent être abordées à ce propos :
- la composition du régime alimentaire ;
- les gaspillages12(*).
Ces sujets renvoient à l'objectif d'adopter des modes de consommation plus sobres.
1. Quelle diversification des régimes alimentaires ?
Il faut remarquer que dans de nombreux scénarios prospectifs, celle-ci est déjà très « normée » puisque la ration alimentaire moyenne est fixée autour de 3 000 calories finales/tête soit, pour 2050, un régime alimentaire calqué sur celui du Mexique en 1990, ce qui ne constitue pas une valeur-cible particulièrement élevée.
Cette hypothèse est cependant compatible avec une substitution de la viande à des végétaux dans la ration alimentaire.
Les implications des hypothèses sur le régime alimentaire en termes de besoins moyens en énergie végétale diffèrent selon les pays.
Selon M. Michel Griffon, en Asie, des modifications des régimes alimentaires (l'augmentation de la ration moyenne et la diversification des régimes) à l'horizon 2050 s'élèveraient à 36 % pour la Chine, 50 % pour l'Inde, 65 % pour l'Indonésie, 81 % pour le Vietnam et 124 % pour le Bangladesh. En Afrique du Nord, les chiffres correspondants sont de 13 % pour l'Égypte et 22 % pour le Maroc. En Amérique centrale, les principaux pays concernés sont les pays les plus pauvres où l'accroissement serait de 50 % et, en Amérique du Sud, les pays andins pour 30 à 50 %. Mais c'est en Afrique que cet accroissement serait le plus général et massif : de 60 à 150 % en Afrique de l'Est et de 80 à 140 % en Afrique centrale.
Accroissement des besoins en calories
végétales totales
entre 2000 et 2050 en fonction de la
démographie, de l'obtention d'une ration suffisante et de la progression
de l'alimentation carnée (en %)
|
Afrique |
Asie |
Amérique latine |
|
|
Effet de tous les facteurs démographiques |
214 % |
69 % |
80 % |
|
Effet de complément |
33 % |
14 % |
8 % |
|
Effet de diversification vers des régimes carnés |
23 % |
21 % |
0 % |
Source : « Nourrir la planète » M. Michel Griffon
Ces estimations coïncident avec celles proposées par M. Philippe Collomb qui, outre une décomposition par continent des facteurs d'augmentation des besoins d'énergie végétale à l'horizon 2050, propose une décomposition par type de régime alimentaire selon la dominance des produits dans chacun d'eux.
Effets de l'ensemble des facteurs démographiques et nutritionnels sur les besoins moyens en énergie d'origine végétale des populations des pays en développement en 2050, selon le continent (*)
|
|
Continents et sous-continents |
|||||
|
1 Afrique |
2 Asie |
3 Europe |
4 Amérique latine et Caraïbes |
5 Amérique du Nord |
6 Océanie |
|
|
Composition |
Effet des facteurs influant sur les besoins moyens |
|||||
|
Âges |
1,07 |
1,02 |
0,99 |
1,02 |
1,00 |
1,00 |
|
Tailles physiques |
1,02 |
1,02 |
1,00 |
1,02 |
1,00 |
1,01 |
|
Proportion femmes enceintes |
1,00 |
0,99 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
Urbaine rurale |
0,97 |
0,96 |
0,99 |
0,98 |
0,99 |
0,99 |
|
Toutes structures |
1,07 |
1,02 |
0,98 |
1,03 |
0,99 |
1,00 |
|
Effet de l'accroissement de la population |
||||||
|
Accroissement de la population |
2,94 |
1,66 |
0,93 |
1,74 |
1,33 |
1,61 |
|
Tous effets démographiques |
3,14 |
1,69 |
0,91 |
1,80 |
1,31 |
1,61 |
|
Effet des modifications de régimes alimentaires |
||||||
|
Complètement d'énergie |
1,33 |
1,14 |
1,00 |
1,08 |
1,00 |
1,00 |
|
Diversification de régime |
1,23 |
1,21 |
1,00 |
0,99 |
1,00 |
1,00 |
|
Toutes modifications de régime |
1,64 |
1,38 |
1,00 |
1,07 |
1,00 |
1,00 |
|
Effet résultant de tous les facteurs |
||||||
|
5,14 |
2,34 |
0,91 |
1,92 |
1,31 |
1,61 |
|
Effets de l'ensemble des facteurs démographiques et nutritionnels sur les besoins moyens en énergie d'origine végétale des populations des pays en développement en 2050, selon leur régime alimentaire (*)
|
|
Classes de régime alimentaire des pays |
|||||
|
1 Riz |
2 Maïs |
3 Blé |
4 Lait, viandes et blé |
5 Mil, millet, sorgho, etc. |
6 Manioc, igname, taro, etc. |
|
|
Composition par |
Effet des facteurs influant sur les besoins moyens |
|||||
|
Âges |
1,02 |
1,02 |
1,05 |
0,99 |
1,08 |
1,08 |
|
Tailles physiques |
1,01 |
1,02 |
1,01 |
1,00 |
1,01 |
1,02 |
|
Proportion femmes enceintes |
0,99 |
1,00 |
0,99 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
Urbaine rurale |
0,96 |
0,98 |
0,97 |
0,99 |
0,97 |
0,97 |
|
Toutes structures |
1,02 |
1,04 |
1,05 |
0,99 |
1,06 |
1,08 |
|
Effet de l'accroissement de la population |
||||||
|
Accroissement de la population |
1,57 |
1,71 |
2,31 |
1,15 |
3,23 |
3,26 |
|
Tous effets démographiques |
1,60 |
1,78 |
2,42 |
1,13 |
3,43 |
3,51 |
|
Effet des modifications de régimes alimentaires |
||||||
|
Complètement d'énergie |
1,15 |
1,10 |
1,15 |
1,00 |
1,38 |
1,40 |
|
Diversification de régime |
1,29 |
1,00 |
1,02 |
1,00 |
1,02 |
1,46 |
|
Toutes modifications de régime |
1,48 |
1,10 |
1,17 |
1,00 |
1,41 |
2,04 |
|
Effet résultant de tous les facteurs |
||||||
|
2,37 |
1,96 |
2,84 |
1,13 |
4,82 |
7,17 |
|
(*) Nombre par lequel il faut multiplier les besoins de l'année 1995, pour obtenir les besoins de l'année 2050, si l'on prend en compte chaque facteur pris séparément (les modifications de la répartition par âges, de la taille physique des populations, de la proportion des femmes enceintes, du degré d'urbanisation, le complètement d'énergie alimentaire nécessaire pour éradiquer la sous-alimentation, la diversification de régime nécessaire pour éliminer la malnutrition), ou ensemble.
On observe que sans être le facteur le plus important, la diversification des régimes alimentaires joue un rôle non négligeable dans les besoins que devra satisfaire la production agricole.
Nonobstant le type d'approche adopté, c'est toujours la variable démographique qui exerce le plus d'influence sur les besoins à venir. Les effets de structure démographique jouent globalement plutôt à la hausse tout en restant modérés et c'est l'accroissement de la quantité de population qui agit principalement.
Sous l'angle démographique, les résultats par continent ne diffèrent pas de ceux déjà exposés mais la considération de la partition du monde selon les régimes alimentaires dominants montre une hétérogénéité de la pression démographique plus grande que lorsqu'on ne considère que les ensembles continentaux.
Les populations consommant du blé mais surtout celles qui consomment du mil, du sorgho ou du manioc et de l'igname suivent une croissance particulièrement forte.
Pour autant, la division par deux de la diversification carnée ne créerait pas beaucoup de marges : le coefficient multiplicateur des besoins passerait de 5,14 à 5 pour l'Afrique et de 2,34 à 2,16 pour l'Asie.
Par ailleurs, les productions animales ont des rendements caloriques différents : les élevages bovins étant les moins rentables, comme on l'a indiqué.
Mais si les pays végétariens aujourd'hui acceptaient de le rester, ou (et) si des pays fort consommateurs de produits carnés réduisaient cette consommation, l'effort à entreprendre serait bien moins important.
Cette observation vaut également quand on considère l'influence des modifications des régimes alimentaires, si bien que tous les facteurs se combinent pour que les régions où dominent le mil et le manioc connaissent une pression alimentaire particulièrement forte.
En témoigne le tableau ci-après où les prospectives Agrimonde G1 de l'ISV13(*) « less meat fair » et « less meat » (moins de viande) situent les gains d'une telle variante.
Source : CEP - Analyse n° 27 - Février 2011
Les enjeux s'élèvent à plusieurs dizaines de points de pourcentage. La question de la faisabilité d'une telle inflexion des régimes alimentaires vers une plus grande maîtrise des consommations carnées se pose donc avec acuité.
Il existe une forte corrélation globale entre le niveau de revenu et la consommation de viande.
L'exemple de la diversification du régime alimentaire en France montre que sur très longue période, l'augmentation de niveau des apports caloriques a été pour une part importante le résultat de la progression des produits animaux.
De même, à l'échelle du monde, la consommation de viande suit généralement le revenu.
Toutefois, comme l'illustre le graphique ci-dessus, il existe des singularités.
La consommation de viande aux États-Unis ressort comme atypiquement élevée de même que celle du Japon est symétriquement faible.
S'agissant des grands pays émergents le Brésil et la Chine se distinguent nettement de l'Inde.
Les singularités locales - qui parfois sont attribuables à des pratiques religieuses - peuvent donc être accusées.
L'évolution des modes de consommation en Inde pourrait se révéler particulièrement déterminante à l'avenir dans toute la mesure où l'on attend généralement de ce pays qu'il reste plutôt végétarien. Cette perspective est évidemment incertaine puisqu'elle ferait de l'Inde une exception historique.
Faut-il escompter que les habitudes alimentaires des pays où l'alimentation carnée est installée inversent leur tendance séculaire ?
Les arguments relatifs à la santé publique pourraient agir puisque des liens sont de plus en plus suggérés entre la nature du régime alimentaire et la santé humaine.
Tel est en particulier le cas pour l'obésité et les affections connexes comme l'a exposé un récent rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques14(*).
C'est en effet l'une des composantes paradoxales de la situation alimentaire mondiale que de voir se côtoyer une malnutrition persistante et la diffusion de la sur-nutrition, le nombre de personnes concernées par le surpoids, de 1,6 milliards d'adultes en 2005 devait passer, selon l'OMS, à 2,3 milliards (dont 700 millions d'obèses contre 400 millions l'année de base).
Mais, la portée des messages destinés à promouvoir une « consommation raisonnée » n'a rien d'évident dans un contexte où ces messages peuvent contrarier ce qui ressemble à des aspirations confortées, voire amplifiées, par les messages promotionnels des intérêts commerciaux.
Dans ces conditions, sauf à ce que des incitations économiques soient mises en place - dont l'éventualité n'est pas négligeable au vu des tensions sur les prix qui pourraient intervenir dans le futur - la tendance à une croissance de la consommation de viande plus forte que celle, plus directe, de calories végétales paraît offrir une forte probabilité malgré quelques exemples de retour en arrière (comme, par exemple, en Finlande et au Royaume-Uni).
2. Des perspectives de demande sensibles à l'évolution des pertes et des gaspillages
Une partie des productions alimentaires donne lieu à des pertes et gaspillages.
En raison de problèmes de délimitation et de mesures, l'ampleur du phénomène ne peut être qu'approchée.
Mais elle semble assez importante pour justifier que des actions interviennent pour réduire son incidence.
S'il n'existe pas de consensus sur la définition des pertes et gaspillages alimentaires, on s'accorde pour reconnaître que les phénomènes qu'ils recouvrent se situent pour une part importante au niveau du consommateur15(*).
Les pertes sont définies par la FAO comme « une modification de la disponibilité, de la comestibilité ou de la qualité d'un aliment qui le rend impropre à la consommation humaine ». Cette acception fait entrer dans les pertes les aliments donnés aux animaux car impropres à la consommation humaine quand bien même ces aliments contribuent à l'élevage d'animaux consommés par les hommes. Elle tend ainsi à exagérer quelque peu l'estimation des pertes.
Le gaspillage est « la mise au rebut de ressources alimentaires comestibles ». Il intervient généralement aux stades ultimes de la chaîne alimentaire de la distribution et du stockage pour restauration domestique ou hors domicile. On relève que les sur-consommations ne sont pas systématiquement intégrées aux gaspillages, ce qui conduit à des évaluations plutôt conservatrices mais sans doute appropriées à un état des cultures alimentaires dans le monde.
À ces difficultés touchant le périmètre du phénomène, s'ajoutent les problèmes de la mesure sur le terrain.
Les mesures sont dispersées. L'exercice est soumis au défi de l'exhaustivité dans un monde où les réseaux d'observation existants sont partiels et laissent des chaînons entiers dans l'ombre. Ainsi, les phénomènes de pertes et gaspillage dans les systèmes de distribution urbaine des pays du Sud restent inobservés alors qu'on peut a priori leur attribuer une forte incidence.
Les estimations disponibles procèdent donc nécessairement par l'extrapolation des quelques expériences concrètement analysées.
Cette lacune, dans la mesure quantitative du phénomène, n'est pas la seule. Pour tirer des leçons pratiques des analyses sur les pertes et gaspillages, il faudrait que ces analyses permettent, qualitativement, d'identifier les éléments du système alimentaire qui favorisent ces déperditions.
Or, si une connaissance schématique en est accessible, il n'est pas certain qu'elle soit véritablement mobilisable pour concevoir, en pratique, les actions nécessaires à l'optimisation des systèmes agricoles in situ.
À cet égard, le programme lancé par la FAO en 1974 dans les pays du Sud « Prevention of food losses » après la Conférence mondiale de l'alimentation, n'a pas empêché que les problèmes restent prégnants.
Le schéma suivant rend compte des différentes pertes que subit le système à la récolte ou après :
Source : INRA-CIRAD-DuALIne - juillet 2011
Les nuances de gris sont censées indiquer le degré d'importance des pertes et gaspillages d'un gris clair (faible) au gris foncé (élevé).
On constate que les occasions de pertes alimentaires sont diversifiées ce qui justifie la mise en oeuvre d'une pluralité d'interventions.
Cependant, des différences apparaissent entre pays. Les pertes interviennent plutôt dans les pays du Sud et les gaspillages, dans les pays du Nord. Les échelons de déperdition maximale diffèrent : plutôt en amont dans les pays du Sud ; plutôt en aval pour les pays du Nord.
Dans ce contexte, il faut prendre les estimations des pertes et gaspillages avec prudence.
Les évaluations disponibles sont impressionnantes puisque, selon le Foresight britannique par exemple, les pertes et gaspillages le long de la chaîne alimentaire s'élèveraient à près de la moitié de la production agricole d'aujourd'hui.
Pour la seule alimentation humaine (hors autres usages agricoles) la proportion serait de l'ordre de 30 % de la production initiale. Toujours selon les études britanniques, les pertes et gaspillages représenteraient au Royaume-Uni 8,3 millions de tonnes de nourriture (et boissons) soit 25 % des achats alimentaires en volume.
D'autres auteurs situent les pertes et gaspillages dans une fourchette entre 208 et 300 kg par tête et par an dans les pays d'Europe et d'Amérique du Nord et entre 120 et 170 kg dans les pays d'Afrique sub-saharienne et d'Asie du Sud et du Sud-Est.
Pour le riz, les pertes globales représenteraient 15 % de la production avec une grande variabilité selon les pays (1 % au Malawi ; 12 à 13 % au Bangladesh).
L'élimination des pertes et gaspillages représenteraient un pas vers la solution des problèmes posés par le défi alimentaire.
En théorie, elle pourrait couvrir jusqu'à près de la moitié des besoins de production additionnelle (tels que la FAO) les estime pour satisfaire la demande anticipée en 2050.
Par ailleurs, elle résoudrait une partie des problèmes environnementaux que peuvent poser certains modèles de croissance de la production agricole. Les déperditions constatées ne sont pas seulement des pertes de nourriture. Ils sont des gaspillages de ressources naturelles et ont un coût en énergies consommées. En bref, ils constituent une gabegie d'inputs à quoi il faut ajouter le coût des nuisances associées à des produits développés en pure perte.
Enfin, il faut compter avec les effets économiques des pertes et gaspillages. Les producteurs subissent des réductions de revenus nets puisqu'ils supportent des coûts qui n'engendrent pas toutes les recettes anticipées. Quant aux consommateurs, ils consacrent une partie de leur revenu à des achats qui n'auraient pas d'autres satisfactions que celles tirées de leurs actes d'achat... L'effet des pertes et gaspillages sur leur pouvoir d'achat effectif n'est pas négligeable puisqu'il a pu être estimé au Royaume-Uni à 480 livres par an et par foyer et jusqu'à 680 livres pour les foyers avec enfants, soit une moyenne de 50 livres par mois.
La lutte contre les déperditions de nourriture devrait théoriquement être un instrument majeur de la politique visant à relever de défi alimentaire.
Les aménagements à entreprendre semblent devoir varier selon les pays avec, dans les pays du Sud, des investissements agronomiques et d'infrastructures réclamant des moyens financiers pesant sur les exploitants ou les collectivités publiques et, dans les pays du Nord des actions plus qualitatives impliquant souvent des changements de comportements.
Les leviers de tels changements sont culturels mais aussi économiques et techniques.
Les campagnes d'éducation en sont l'un des aspects. Leur cohérence pourrait sans doute progresser d'autant que les messages qu'elles diffusent rentrent souvent en collision avec ceux des publicités pour les produits alimentaires dont la régulation n'est certainement pas au niveau où elle devrait se situer.
Sur le plan économique, on peut penser que des prix plus élevés pourraient contribuer à une utilisation plus mesurée de l'alimentation. Mais, la sensibilité aux prix n'est pas la caractéristique principale des demandes alimentaires principalement dans les pays où le gaspillage prédomine.
En outre, les relations entre fournisseurs et distributeurs peuvent jouer un rôle en incitant les premiers à préférer une surproduction qui les préserve des pénalités, voire des remises en cause de leurs contrats de livraison suite à des ruptures d'approvisionnement par rapport à leurs obligations contractuelles, plutôt qu'une production calibrée plus justement.
Des pistes plus techniques pourraient être suivies parmi lesquelles il conviendrait d'évaluer les mesures concernant l'étiquetage des produits, l'information délivrée sur les dates limites pouvant, par exemple, amener une certaine confusion dans l'esprit des consommateurs.
Pour conclure sur ce point, si la limitation des pertes « post récolte » et pendant la production représente a priori un gisement d'offre important, de bons experts (M. Michel Griffon, par exemple) estiment que, même en imaginant des progrès et notamment l'adoption de techniques innovantes, l'augmentation du reste disponible due à la lutte contre les pertes serait limitée (5 à 10 % de production en plus).
Certaines de ces pertes paraissent difficiles à éviter : ainsi, pour les céréales précoces, qui perdent leurs graines lors des récoltes ; le stockage sur pied qui expose aux oiseaux prédateurs ou aux attaques biologiques... tandis que le développement urbain augmente les pertes au stade de la consommation notamment du fait des modes de distribution des aliments.
Il y a du reste plus préoccupant, car, ainsi qu'on le montre ci-après, il convient de tenir compte de la montée des oppositions à l'usage des pesticides, qui réduisent les pertes, du fait de leurs responsabilités présumées dans un certain nombre d'altérations environnementales. Il en va de même pour les antibiotiques utilisés par l'élevage.
Enfin, la perspective de l'enrichissement des pays sous-développés si elle est plutôt favorable à la réduction des pertes par ses effets éventuels sur l'équipement agricole pourrait, en contrepartie, s'accompagner d'une augmentation des gaspillages comme le monde occidental en offre l'exemple.
D. LES PRIX ALIMENTAIRES, UNE VARIABLE CRUCIALE
Le niveau des prix des produits alimentaires est souvent présenté comme une variable inégalement déterminante pour la consommation effective.
Dans les pays développés, il n'affecterait que médiocrement la dynamique de la demande alors que dans les pays en développement le niveau des prix serait nettement plus prédictif.
Ces observations paraissent refléter la réalité à condition d'ajouter que, même dans les pays développés, il existe des populations pour lesquelles les tensions sur les prix de l'alimentation se répercutent sur la demande effective à travers la désolvabilisation qu'elles font subir à certains ménages.
Les raisons pour lesquelles dans le futur c'est plutôt à une hausse des prix agricoles et alimentaires qu'il faut s'attendre sont détaillées dans le chapitre consacré dans le présent rapport à ce problème particulier.
Or, la mise en oeuvre du droit à l'alimentation passera demain comme aujourd'hui, par le maintien de prix effectifs permettant aux consommateurs de disposer d'un pouvoir d'achat alimentaire compatible avec cette mise en oeuvre.
Il faut donc s'attendre à ce que les moyens de défendre ce pouvoir d'achat soient une variable essentielle de l'équation alimentaire à l'avenir.
Évidemment, cette condition peut apparaître contradictoire avec l'objectif d'assurer un prix rémunérateur aux producteurs afin de favoriser l'essor de l'offre agricole16(*).
C'est une observation triviale que de souligner combien les actions publiques visant à assurer des prix de consommation accessibles aux urbains sacrifient souvent les intérêts des ruraux dans les pays en développement.
Il existe pourtant des voies de conciliation entre les deux objectifs a priori contradictoires, à savoir la mise en oeuvre d'instruments de redistribution ou (et) l'élévation de la productivité des exploitants.
Mais, les enjeux attachés au système de prix ne s'arrêtent pas là. Son fonctionnement peut poser problème au regard d'objectifs qu'il conduit à négliger, qu'ils soient environnementaux ou de santé publique.
Dans le système de prix tel qu'il fonctionne un certain nombre de coûts, qu'il s'agisse de dommages environnementaux ou d'effets sur la santé humaine, ne sont pas intégrés. À cet égard, il est par exemple, insupportable qu'alors que l'obésité ou des maladies « épidémiques » comme le diabète se répandent comme une calamité dont les liens avec l'alimentation sont particulièrement suspectés, rien n'ait été sérieusement entrepris pour utiliser les prix comme instrument d'intervention. Il est vrai que ce stade suppose une volonté politique et que soient formulées de véritables politiques publiques de lutte contre ces nouveaux fléaux qui manque en fait.
Mais, il paraît évident à votre rapporteur qu'un jour ou l'autre - le plus prochain sera le mieux - on remédiera à cette grave défaillance. Dans cette perspective, comme pour le tabac et l'alcool, il ne fait guère de doute que des taxes alimentaires seront appliquées, que préfigurent déjà les taxes sur les boissons sucrées ou, à leur manière, les cotisations que peuvent exiger certains assureurs des clients victimes des « affections alimentaires » qui se répandent.
Tout comme pour les taxes écologiques, il faudra traiter les effets contre-redistributifs de cette fiscalité.
CHAPITRE
II :
L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE A PROGRESSÉ
DANS
LE MONDE
La réduction de la faim a été promue au rang d'objectif prioritaire - avec des formules différentes - par les grands sommets du développement. Elle a été au coeur d'événements parmi les plus spectaculaires organisés à la fin du XXe siècle autour de méga-happening rock.
La sécurité alimentaire avait progressé jusqu'au seuil des années 90 sous l'effet d'une croissance régulière de la production agricole. Au-delà de 1990, année qui correspond à l'adoption du consensus de Washington consacrant une conception libérale du développement sous l'influence de l'École de Chicago17(*), la production agricole a continué à croître mais sans que cette tendance ne s'accompagne d'un recul numérique des victimes de la faim.
Les années 2000 ont vu se produire une dégradation très préoccupante qui conduit à remettre en cause les tendances et le cadre du développement agricole.
Dans le Monde, ce sont les paysans qui sont majoritairement les victimes de la malnutrition même si les pauvres urbains partagent, ce sort insupportable.
La croissance économique apparaît comme un cadre favorable à la régression de cette plaie, tout particulièrement la croissance agricole18(*), mais ce n'est pas une condition suffisante.
La répartition des revenus compte, non seulement par ses effets de solvabilisation de la demande mais aussi parce que le partage des revenus agricoles est, à coup sûr, une variable déterminante pour la situation agricole des pays.
I. PROPOS LIMINAIRES : UNE MESURE DE LA FAIM DANS LE MONDE QUI GAGNERAIT À ÊTRE PRÉCISÉE ET ÉLARGIE
La mesure de « la faim dans le monde » est complexe et pour partie « inobservée », c'est-à-dire qu'elle résulte de conventions statistiques ou d'enquêtes et non d'un décompte physique systématique.
La FAO mesure la faim à partir d'une norme de besoins énergétiques quotidiens minima correspondant à la quantité de calories nécessaires pour une activité légère et un poids minimum acceptable pour la taille atteinte.
Les disponibilités caloriques sont calculées à partir de la production agricole à quoi s'ajoute le solde des exportations et des importations diminué des pertes.
Elles sont rapportées à la population qui est pondérée par ses caractéristiques pertinentes pour établir un chiffre global de besoins en calories.
À partir de ces données, un ratio donne l'évaluation des disponibilités théoriques individuelles et, après application d'un modèle de répartition des disponibilités, le chiffre des personnes susceptibles de ne pas disposer les 1 800 kilocalories journalières nécessaires à un apport minimal en énergie.
Le phénomène de « sous-alimentation » regroupe les personnes qui sont sous cette barre énergétique.
On pressent les obstacles auxquels se heurte une estimation précise du phénomène le décompte des disponibilités théoriques et l'estimation de leur distribution effective ne présentant pas toutes les garanties d'exactitude souhaitables.
On peut même évoquer, au-delà d'un simple problème d'imprécision, une forme d'ignorance de l'ampleur du phénomène de la faim.
On peut certes considérer que les variations de la mesure de la sous-alimentation donnent des informations sur ses tendances mais, là également, il existe quelques doutes en ce sens que la mesure des disponibilités et de leurs évolutions restent très incertaine.
Mais, le problème le plus sérieux est ailleurs. Il réside dans l'inadéquation partielle du critère énergétique pour mesurer les phénomènes que recouvrent les concepts de « faim dans le monde » ou de « sécurité alimentaire pour les individus ».
En premier lieu, les qualités nutritives des rations alimentaires sont largement négligées dans l'approche énergétique. Or, quand on passe d'un critère de « sous-alimentation » à un critère de « sous-nutrition » le nombre de personnes concernées augmente considérablement. Une fois prises en compte les carences en micronutriments, en iode, en vitamine A et en fer (par exemple), la cohorte des individus sous-alimentées, qui est de l'ordre de 925 millions se transforme en des groupes humains pouvant compter plus de 2 milliards de personnes.
En second lieu, manque dans cette approche la mesure du sentiment de sécurité alimentaire. À cet égard, la mesure des personnes privées du bénéfice effectif du droit à l'alimentation pourrait présenter une façon plus réaliste, et plus politique, d'appréhender le phénomène.
La définition de ce droit donné par l'Observation générale 12 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, chargé de contrôler la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, pourrait fournir une bonne base de départ à un tel décompte.
Elle indique que « le droit à une nourriture suffisante est réalisée lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d'autres, a physiquement ou économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer »19(*).
II. MALGRÉ UNE AUGMENTATION DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE...
Dans le passé (1961-2003) la dynamique de la production alimentaire a été forte avec plus d'un doublement (une multiplication par 2,4) et une croissance de plus de 6 % par an.
La production alimentaire mondiale 1961-2003
(en Gkal/jour)
Sur une plus longue période (1970-2010), la production agricole mondiale a connu un triplement principalement sous l'effet de la croissance intervenue dans les pays en développement.
L'évolution de l'indice de la production agricole de la FAO en témoigne.
Indice de la production agricole par région
Source : Projections FAO-OCDE - Perspectives
agricoles de l'OCDE
et de la FAO 2009-2018. Edition 2009
Dans ce contexte, les différentes régions mondiales ont toutefois connu des trajectoires diversifiées.
Évolution mondiale des productions
alimentaires
(en dollars)
|
1961 |
2003 |
Variation en points |
|
|
Monde |
13 550 |
32 550 |
X 2,4 |
|
OCDE |
5 800 |
10 200 |
75,9 % |
|
AN-MO |
400 |
1 400 |
X 3,5 |
|
Amérique du Sud |
1 000 |
4 200 |
X 4,2 |
|
Asie |
3 800 |
13 000 |
X 3,4 |
|
Afrique subsaharienne |
750 |
20 000 |
X 2,7 |
|
Ex-URSS |
1 800 |
1 750 |
- 2,8 |
Source : B. Dorin à partir de données FAO
Évolution de la production agricole dans
les pays en développement
(en % par an)
|
1961/2007 |
1981/2007 |
1991/2007 |
|
|
Pays en développement |
3,5 |
3,6 |
3,5 |
|
hors Chine et Inde |
3 |
3 |
3,1 |
|
Afrique subsaharienne |
2,6 |
3,3 |
3,1 |
|
Moyen Orient |
3 |
2,7 |
2,5 |
|
Amérique du Sud |
3 |
3 |
3,4 |
|
Asie du Sud |
2,8 |
2,8 |
2,4 |
|
Asie du Sud-Est |
4,3 |
4,5 |
4,3 |
Source : FAO - Josef Schmidhuber, Jelle Bruinsma, Gerold Boedeker
Globalement, la croissance annuelle de la production des pays en développement a atteint un rythme à peu près constant de l'ordre de 3,5 % par an, soit un rythme plus rapide que celui de l'accroissement démographique.
La croissance a été particulièrement forte en Chine et en Inde. Elle a été relativement faible en Afrique du Nord-Moyen Orient et dans de nombreux pays asiatiques.
C'est en Amérique du Sud et en Asie, en comptant la Chine, que le différentiel entre la croissance de la production agricole et de la population a été le plus élevé à la faveur de la première citée.
L'augmentation de la production a été particulièrement élevée en Amérique du Sud, suivie sur ce plan par l'Afrique du Nord-Moyen-Orient et l'Asie.
La production a plus que doublé en Afrique subsaharienne tandis que dans la zone OCDE elle a progressé de façon plus mesurée pour reculer légèrement dans les pays de l'ex-URSS (avec toutes les réserves qu'impliquent les limites des connaissances statistiques).
Lorsqu'on compare ces évolutions avec celles de la population mondiale qui est passée de 3 à 6,2 milliards au cours de la période, on observe que la production alimentaire a progressé à un rythme plus rapide que celui de la croissance démographique (avec un multiplicateur autour de 2,5 contre une croissance de 2,1 pour la population).
En conséquence, la disponibilité alimentaire théorique par personne a progressé de l'ordre de 20 % (de 2 500 à 3 000 kcal/par habitant).
Une redistribution de la géographie de la production alimentaire mondiale est intervenue.
Au terme de ces quarante années, l'Asie est devenue la première productrice devant l'OCDE alors qu'elle était largement distancée au début des années 60.
Évolution de la structure de la production
alimentaire mondiale 1961-2003
(en % du total)
|
1961 |
2003 |
Variation en points |
|
|
Monde |
100 |
100 |
- |
|
OCDE |
42,8 |
31,4 |
- 11,4 |
|
AN-MO |
2,9 |
4,3 |
+ 1,4 |
|
Amérique du Sud |
7,4 |
12,9 |
+ 5,5 |
|
Asie |
28 |
40 |
+ 12 |
|
Afrique subsaharienne |
5,5 |
6,1 |
+ 0,6 |
|
Ex-URSS |
13,4 |
5,3 |
- 0,3 |
En quarante ans, la dépendance alimentaire mondiale aux performances de la zone OCDE qui, en 1961, réalisait plus de 40 % de la production a été considérablement atténuée.
Désormais, l'Asie est en tête des régions du monde avec une proportion de la production alimentaire mondiale à peu près au niveau de celle de l'OCDE il y a quarante ans.
Une sorte d'échange des positions de même nature mais plus faible en niveau s'est produite entre l'ex-URSS et l'Amérique du Sud.
Mais la structure de la population mondiale a elle-même sensiblement évolué au cours de cette période.
Évolution de la structure de la population
mondiale 1961-2003
(en % du total)
|
1961 |
2003 |
Variation en points |
|
|
Monde |
100 |
100 |
- |
|
OCDE |
22 |
16,1 |
- 5,9 |
|
AN-MO |
4,2 |
6,1 |
+ 1,9 |
|
Amérique du Sud |
6,7 |
8,9 |
+ 2,2 |
|
Asie |
50 |
54,8 |
+ 4,8 |
|
Afrique subsaharienne |
7,3 |
11,6 |
+ 4,3 |
|
Ex-URSS |
7,5 |
4,3 |
- 3,2 |
La prédominance démographique de l'Asie s'est renforcée tandis que les populations de l'OCDE et de l'ex-URSS reculaient en termes relatifs, de 9 points au total. La troisième position de l'Afrique subsaharienne s'est affirmée puisque sa part dans la population mondiale a progressé de plus de 4 points.
On peut souligner l'existence d'une corrélation entre la restructuration de la production alimentaire et celle de la population mondiale. Toutefois, cette corrélation n'a pas été parfaite, si bien que la structure de la production alimentaire n'a pas évolué à due proportion de celle de la population mondiale.
Sur ce point, la mise en regard de la répartition de la production alimentaire et de la population mondiale fournit des informations sur la hiérarchie des niveaux de satisfaction alimentaire apparents (inversement de stress alimentaire théorique).
Cependant, il faut garder à l'esprit que les ratios qu'on en tire ne doivent pas être considérés comme des mesures de l'état de nutrition d'un pays ni même de l'autosuffisance alimentaire des régions qu'ils couvrent. Un cas-type permet de le comprendre aisément : une valeur unitaire de chaque ratio signifie qu'il y a une parfaite égalité entre la part de la population mondiale de la région et sa part dans la production alimentaire mondiale. Ainsi, dans l'hypothèse où la production alimentaire mondiale ne permettrait pas de satisfaire les besoins de nutrition des terriens, on voit qu'un ratio unitaire signifierait que la population concernée n'atteindrait pas le niveau nécessaire à une nutrition suffisante.
Plutôt que comme des mesures, les ratios mentionnés ici doivent donc être pris comme indicateurs d'aisance ou, au contraire, de stress alimentaire.
Rapports entre la part dans la production
alimentaire mondiale
et la part dans la population
totale
Évolutions 1961-2003
|
1961 |
2003 |
Variation en points |
|
|
Monde |
100 |
100 |
- |
|
OCDE |
1,94 |
1,95 |
+ 0,01 |
|
AN-MO |
0,69 |
0,70 |
+ 0,01 |
|
Amérique du Sud |
1,10 |
1,45 |
+ 0,35 |
|
Asie |
0,56 |
0,73 |
+ 0,17 |
|
Afrique subsaharienne |
0,75 |
0,53 |
- 0,22 |
|
Ex-URSS |
1,78 |
1,23 |
- 0,56 |
En les considérant, le sentiment se dégage que la baisse de la part de la production alimentaire mondiale attribuable à la zone OCDE a été indolore tandis que pour la zone de l'ex-URSS elle s'est traduite par une nette dégradation de la capacité théorique à satisfaire les populations locales.
Pour autant, cette capacité subsiste ce qui place cette région parmi les trois régions du monde où une telle situation se vérifie (avec l'OCDE, largement en tête, et l'Amérique du Sud qui a fait d'importants progrès sous cet angle).
Pour toutes les autres zones, il existe des excédents significatifs entre le poids relatif de leur population et celui de la production agricole mondiale qui est le leur.
Ces écarts sont plus ou moins importants selon les régions et ont connu des évolutions différenciées.
La situation de l'Afrique subsaharienne s'est fortement dégradée tandis que l'Asie a progressé.
En conséquence de ces évolutions, si la ration alimentaire disponible théoriquement pour chaque individu a progressé à l'échelle mondiale, les différentes zones ont enregistré des progrès très disparates.
Pour une augmentation moyenne de 20 %, les performances régionales ont varié comme indiqué ci-après :
|
OCDE : |
+ 23,1 % |
|
AN-MO : |
+ 41,7 % |
|
Amérique du Sud : |
+ 25 % |
|
Asie : |
+ 42,1 % |
|
Afrique subsaharienne : |
+ 9 % |
|
ex-URSS : |
- 5,7 % |
L'évolution de cet indicateur montre, avec les données sur l'évolution de la production alimentaire par région, la très grande diversité des effets des performances du développement agricole au cours de la période 1961-2003.
Évolutions des rations alimentaires individuelles théoriques entre 1961 et 2004
1. Afrique subsaharienne
2. Amérique latine
3. Asie
4. Ex-URSS
5. Afrique du Nord-Moyen-Orient
Source : Rapport Agrimonde - Annexe n° 4
À partir d'une situation initiale où les rations individuelles étaient équivalentes, l'Asie a pu développer celles-ci nettement plus que l'Afrique sub-saharienne grâce aux effets combinés d'une progression démographique moins forte (X 2,3 contre 3,5) et d'une croissance de la production plus élevée (X 3,4 contre 2,7).
L'enrichissement de la ration disponible en Amérique du Sud (+ 25 %) a été plus contenu qu'en Asie, malgré une augmentation de la production plus forte du fait d'une dynamique de la population plus élevée.
Une très forte progression de la ration alimentaire s'est produite en Afrique du Nord-Moyen-Orient en dépit de l'essor démographique de la zone.
III. ... LA « FAIM DANS LE MONDE » N'A PAS DIMINUÉ DANS LES PROPORTIONS PROCLAMÉES COMME AUTANT D'OBJECTIFS PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
Le « cycle du Millenium » avait proclamé en 2000 un engagement ferme des États de faire tous leurs efforts pour « libérer les hommes des conditions abjectes et déshumanisantes de l'extrême pauvreté » prolongeant la Déclaration de Rome de 1996 de réduire de moitié en 2015 le nombre des humains souffrant de sous-nutrition et d'éradiquer la faim dans le monde.
Ces objectifs n'ont pas été atteints, et ne le seront pas en dépit des assurances volontaristes régulièrement formulées dans les rapports de la FAO sur la faim dans le monde jusqu'au milieu des années 200020(*).
Pire encore, la sous-alimentation, loin de régresser, a en fait progressé à mesure que la population mondiale s'étendait.
A. GLOBALEMENT, DES PROGRÈS ENTRE 1970 ET LE MILIEU DES ANNÉES 90
Au cours des années 70, 80 et 90, des progrès avaient été réalisés pour réduire la faim chronique dans le monde. Ils avaient profité aux pays en développement qui regroupent la plupart des personnes touchées par la faim.
En dépit de l'augmentation de la population mondiale, le nombre de personnes sous-alimentées avait légèrement baissé (de 880 millions en 1970 à 830 millions en 1995).
Cette évolution s'était traduite par une baisse plus sensible de la proportion des personnes sous-alimentées dans les pays en développement, baisse qui s'est prolongée au-delà de l'année 2000 alors que le nombre des personnes sous-alimentées avaient déjà commencé à ré augmenter.
Elle avait pu passer de 35 % de leur population à un peu plus de 15 % au milieu des années 2000, la tendance à la baisse du pourcentage des personnes sous-alimentées se poursuivant malgré une légère reprise de la hausse numérique de la population concernée.
Dans le même temps, la consommation apparente par tête a connu une progression dans les trente années entre 1970 et 2000. Elle a augmenté de 2 411 à 2 789 kcal par personne et par jour, soit une croissance de 16 %. Des progrès très sensibles ont notamment été réalisés en Asie du Sud-Est.
Évolution de la consommation apparente par
tête entre 1970 et 2000
(kilocalories (kcal) par
personne et par jour)
|
1969/1971 |
1979/1981 |
1989/1991 |
1999/2001 |
|
|
Monde |
2 411 |
2 549 |
2 704 |
2 789 |
|
Pays en développement dont : |
2 111 |
2 308 |
2 520 |
2 654 |
|
Afrique sub-saharienne |
2 100 |
2 078 |
2 106 |
2 194 |
|
Afrique du Nord, Moyen Orient |
2 382 |
2 834 |
3 011 |
2 974 |
|
Amérique latine-Caraïbes |
2 465 |
2 698 |
2 689 |
2 836 |
|
Asie du Sud |
2 066 |
2 084 |
2 329 |
2 392 |
|
Asie du Sud-Est |
2 012 |
2 317 |
2 625 |
2 872 |
|
Pays industrialisés |
3 046 |
3 133 |
3 292 |
3 446 |
|
Pays en transition |
3 323 |
3 389 |
3 280 |
2 900 |
Source : FAO
B. ... MAIS DES PROGRÈS INSUFFISANTS
Ces performances doivent toutefois être relativisées.
En premier lieu, il existe un doute sur la signification des données sur lesquelles le diagnostic d'un progrès de la situation alimentaire mondiale est posé. Il pourrait s'agir d'une performance partiellement apparente puisque les statistiques disponibles concernent des disponibilités et pas nécessairement des consommations effectives. Or, pour différentes raisons, parmi lesquelles les problèmes de mesure mentionnés précédemment et la dynamique des pertes et gaspillages21(*), il peut y avoir entre les deux données un écart substantiel.
En outre, les chiffres disponibles sont des moyennes qui peuvent cacher une dispersion plus ou moins forte des progrès réalisés.
À cet égard, plusieurs constats s'imposent.
Les performances ont varié entre grandes régions, ce que montre le tableau ci-dessus. Les progrès effectués par l'Afrique sub-saharienne ont été modestes tandis que la situation s'est dégradée dans les pays en transition.
Par ailleurs, au sein des grandes régions identifiées, des pays sont restés à l'écart du progrès.
Sans doute, doit-on observer que la population des pays en développement touchée par la sous-nutrition sévère a reculé22(*).
En 1970, près de 2 milliards de personnes vivaient dans 47 pays où la consommation journalière par habitant était inférieure à 2 200 kcal. Trente ans plus tard, la population concernée est passée à 584 millions regroupés dans 32 pays.
De son côté, la population des émergents dépassant le seuil considéré généralement comme représentatif de la sous-nutrition (2 700 kcal par jour)23(*) a beaucoup progressé passant de 100 millions à 2,4 milliards de personnes vivant désormais dans 30 pays (contre 6 en 1970).
Ainsi, la population considérée comme correctement nourrie représente dorénavant 51 % du total des pays en développement (contre 4 % en 1970), ces évolutions retraçant pour une large part les progrès réalisés dans les pays fortement peuplés que sont l'Inde et la Chine.
Pourtant, la croissance de la population des pays en développement s'est également soldée par le maintien d'une situation précaire pour un très grand nombre d'individus.
Les personnes vivant dans des pays où les ressources accessibles s'étagent entre 2 200 et 2 700 kcal par jour sont au nombre de 1,7 milliard contre 540 millions trente ans plus tôt.
Par ailleurs, les 32 pays concernés par une sous-nutrition sévère ont souvent connu une dégradation de leur situation.
Les pays en développement sous la barre de 2 200 kcal en 2000 en perspective avec leur meilleure et leur pire performance dans la période 1960-2000
L'Afghanistan et l'Irak témoignent de ce phénomène qui paraît avoir particulièrement touché des pays confrontés à des conflits.
Une partie importante des pays en déclin sont situés en Afrique sub-saharienne qui est la région du monde où la situation alimentaire s'est le moins améliorée.
Elle partage avec l'Asie du Sud la position la plus dégradée dans un monde où les situations des grandes régions restent contrastées malgré les progrès réalisés.
Enfin, et surtout le nombre absolu des personnes subissant la sous-alimentation n'a pas beaucoup régressé. Il s'élevait à 813 millions en 2000 contre 960 millions en 1970 ce qui représente une amélioration non négligeable mais qui doit être relativisée. Les progrès réalisés semblent s'essouffler : en 1990 la sous-alimentation touchait 823 millions d'individus. Le recul dix ans plus tard, est minime.
En tout état de cause, la prévalence de la sous-alimentation doit être appréciée très différemment selon qu'on s'intéresse à des proportions ou à des valeurs absolues.
Prévalence de la sous-nutrition dans le
monde
(en %, en millions)
|
1990 |
2000 |
1990 |
2000 |
|
|
Pays en développement dont : |
20,3 |
17 |
823 |
813 |
|
Afrique sub-saharienne |
35,7 |
32,7 |
170 |
209 |
|
Afrique du Nord, Moyen Orient |
7,6 |
10,1 |
24 |
40 |
|
Amérique latine-Caraïbes |
13,4 |
10,2 |
60 |
53 |
|
Asie du Sud |
25,9 |
22,1 |
291 |
301 |
|
Asie du Sud-Est |
16,5 |
11,5 |
277 |
217 |
Source : FAO
C. DEPUIS LE MILIEU DES ANNÉES 2000 UNE NETTE DÉGRADATION DE LA SITUATION S'EST PRODUITE
À partir du milieu des années 2000, l'augmentation du nombre absolu des personnes sous-alimentées s'accélère à un point tel que la proportion des personnes souffrant de la faim dans les populations des pays en développement s'accroît à nouveau. Entre 2000 et 2008, les personnes sous-alimentées augmentent de 65 millions (850 à 915 millions).
La crise globale détériore encore les perspectives associées à cette inflexion de tendance, déjà à l'oeuvre avant elle, laissant présager le dépassement du seuil d'un milliard d'être humains en situation de péril nutritif.
L'écart entre les objectifs des Nations et les réalisations est gigantesque : il atteint 600 millions d'hommes pour lesquels les promesses de leur épargner la faim n'auront pas été tenues.
Dans le passé, la baisse de la sous-alimentation a été tributaire des performances de la zone Asie-Pacifique.
Le graphique de droite ci-dessus montre que si la réduction de la sous-alimentation, entre 1980 et 2000, s'est appuyée sur la seule réduction du nombre des asiatiques touchés par elle24(*), c'est malgré tout cette région qui concentre le plus grand nombre de personnes sous-alimentées dans le monde (environ 80 % en 1980) On y observe également que la situation de l'Afrique subsaharienne ressort comme particulièrement préoccupante avec une élévation du nombre absolu de personnes touchées par la faim.
Le graphique de gauche confirme cette préoccupation particulière puisque l'Afrique subsaharienne est la région du monde où la prévalence de la faim - bien qu'en légère diminution - est la plus haute (entre 34 et 36 % de la population de la zone). Pour les autres régions, la baisse de la prévalence de la faim est plus prononcée, hormis toutefois pour l'Afrique du Nord-Proche-Orient où elle s'aggrave de 3 points de pourcentage. Sous l'angle de la prévalence de la faim c'est dans la zone « Asie-Pacifique » que les plus grands progrès ont été accomplis puisqu'elle a été divisée par deux.
Le graphique ci-dessous décompose ces tendances par pays en récapitulant les variations, en pourcentage, de la population sous-alimentée. Surtout, il permet d'identifier les pays, les plus soumis à la faim à l'aube du XXIe siècle.
La FAO distingue cinq catégories de pays selon la proportion de leurs populations souffrant de sous-alimentation.
La catégorie qui regroupe le plus grand nombre de pays est celle où le pourcentage de la population concernée s'étage entre 20 et 34 % suivie par celle juste précédente dans la hiérarchie (entre 10 et 19 % de la population). Ces deux catégories recouvrent également la majorité de la population des pays en développement du fait notamment de la présence en leur sein de deux poids lourds de la démographie mondiale, l'Inde dans la première d'entre elles, la Chine dans la seconde.
Pour l'essentiel, hormis ces deux pays-continent, les catégories en question regroupent des pays d'Afrique subsaharienne auxquels s'ajoutent des pays d'Amérique latine ou du sud (Bolivie, Nicaragua, Honduras, Panama, Guatemala, Pérou, Colombie) de l'Asie du Sud-Est (Thaïlande, Cambodge, Vietnam) et les pays jouxtant le sous-continent indien (Pakistan, Bangladesh).
Les pays les plus affectés par la sous-alimentation (avec une proportion supérieure à 35 %) sont, quant à eux, quasiment tous des pays d'Afrique subsaharienne.
Les pays où le pourcentage des personnes sous-alimentées dépasse 2,5 % sans excéder 9 % appartiennent surtout à la zone Afrique du Nord-Moyen-Orient (Égypte, Maroc, Algérie...) mais comptent également de grands pays d'Amérique latine (Mexique) ou du sud (Brésil), d'Asie (Indonésie) et un grand pays africain (le Nigéria).
Alors que la décennie 90 fut une année de progrès sur le front de la faim avec une réduction de la proportion de l'humanité affectée par la sous-alimentation, le graphique montre que rares sont les pays qui ont fait reculer celle-ci à hauteur des objectifs du Millenium (une baisse de 0,5 soit de 50 % de la population touchée).
Seuls sept pays auraient atteint cet objectif : Cuba, le Chili, l'Équateur, le Koweït, le Guyana, le Ghana et le Pérou. Tous ces pays appartenaient aux zones déjà les moins touchées par la faim (les trois premiers à la première catégorie, les deux suivant à la deuxième, les deux derniers à la troisième). Dans ces zones du reste, la plupart des pays ont fait des progrès dont, pour un assez grand nombre, des progrès substantiels. Mais quelques pays ont vu leur situation se dégrader (Liban, Turquie, Jordanie, Swaziland, Venezuela), souvent à la suite d'événements politiques.
Pour les pays relevant des deux catégories les plus touchées par la faim, il y eut également pour nombre d'entre eux des progrès mais insuffisants pour atteindre l'objectif du Millénaire. En revanche, la situation s'est significativement dégradée pour un petit nombre de ces pays. La détérioration a été particulièrement importante pour quelques pays déjà particulièrement exposés à la sous-alimentation : la République démocratique du Congo et la République démocratique de Corée. Mais, au total, dix-neuf pays ont subi une aggravation de leur situation. Si la plupart sont situés en Afrique, toutes les zones hors OCDE sont concernées.
L'état de la sécurité alimentaire s'est encore dégradée dans les années 2000, y compris avant les crises (celle des prix alimentaires et la crise globale en cours) comme le montre le graphique ci-après.
Le nombre des personnes souffrant de la faim a augmenté dans toutes les régions entre 1995 et 2000, excepté dans la zone Amérique latine et Caraïbes.
Après la crise des prix alimentaires, dont l'inflation a réduit l'accessibilité de l'alimentation, cette tendance s'est accentuée touchant également cette dernière zone.
La crise a été jusqu'à provoquer une inversion de la tendance à la décrue de la prévalence de la faim dans le monde, le nombre de personnes sous-alimentées augmentant davantage que la population mondiale.
Nombre de personnes sous-alimentées dans le monde
Au total, le nombre de personnes souffrant de la faim atteint des sommets même si l'estimation ci-dessous a pu être parfois légèrement révisée à la baisse.
Nombre de personnes souffrant de la faim en 2009, par région (millions)
L'exposition des pays aux tensions sur les prix alimentaires s'est révélée variable.
Globalement, les tensions sur les prix agricoles ont contribué à aggraver l'état de l'insécurité alimentaire dans le monde, mais les pays ont été inégalement touchés.
La sous-alimentation a progressé en Afrique mais elle serait restée stable en Asie.
La sous-alimentation dans le monde après les crises
Le graphique ci-dessous précise ces évolutions par pays.
Comparaison de la capacité de rebond des pays confrontés à la crise des prix alimentaires
Quatre catégories de pays peuvent être théoriquement distinguées.
Deux d'entre elles - celles où les prix ont baissé mais où la sous-alimentation a connu des évolutions de sens opposés - sont presque vides comme il est normal compte tenu de la nature de l'épisode décrit. Cependant, on remarque la situation singulière de la Chine où, malgré les tensions sur les prix agricoles, les prix alimentaires ont baissé, la sous-alimentation poursuivant son recul.
Dans les autres pays, les prix ont augmenté, mais plus ou moins, avec une concentration autour d'un pourcentage de l'ordre de 20 à 30 %. Dans certains pays, la hausse des prix a été particulièrement forte (l'Afghanistan - malgré la situation particulière du pays où l'on aurait pu s'attendre à ce que l'intervention internationale soit accompagnée d'une attention particulière portée à l'évolution des prix alimentaires -, la Thaïlande et le Malawi pour lesquels l'inflation des prix alimentaires a dépassé 60 %).
Mais face à ces hausses, la sous-alimentation a évolué de façon contrastée. Dans les pays du cadran supérieur gauche, elle a reculé (Brésil, Vietnam et Thaïlande, malgré la très forte hausse des prix alimentaires survenue dans ce dernier pays). Dans les pays situés dans le cadran supérieur droit, la sous-nutrition a progressé, dans des proportions parfois très élevées (Ouganda, Kenya, Sénégal).
L'analyse des facteurs de cette diversité d'enchaînements présentée par la FAO propose comme variables explicatives : la position commerciale nette des pays mais aussi la nature des institutions en place.
« Les pays les plus exposés aux variations de prix sur les marchés internationaux ont été généralement les pays pauvres et importateurs de produits alimentaires : ils étaient dépourvus de réserves suffisantes, leurs moyens budgétaires ne leur permettaient pas d'acheter des denrées alimentaires au prix fort et ils n'avaient pas non plus l'option de limiter leurs exportations ».
Les pays dans lesquels l'augmentation des prix est restée modérée et s'est accompagnée d'un repli de la sous-alimentation ont recouru simultanément à des restrictions commerciales, à des mécanismes de protection sociale et à l'utilisation de réserves.
Les pays où la hausse des prix a été importante mais où la sous-alimentation a, malgré cela, diminué, moins nombreux, sont ceux qui, exportateurs nets de produits alimentaires, ont vu s'améliorer le revenu des paysans pauvres.
Ces pays sont caractérisés par l'importance relative de leur population agricole mais aussi par une distribution des terres qui permet aux paysans de profiter de la hausse des cours mondiaux en leur permettant de disposer de surplus à écouler.
IV. LA CRUELLE IRONIE DE LA FAIM : LES PAYSANS SONT LES PREMIERS TOUCHÉS
A. SURTOUT DES PAYSANS
La sous-alimentation touche des personnes pauvres et ces personnes sont majoritairement des paysans.
Les personnes sous-alimentées sont pour 50 % d'entre elles des paysans pauvres, 22 % des paysans sans terre et 8 % des ruraux suivant des modes de vie traditionnels.
À ces ruraux - 80 % des « sous-alimentés » - s'ajoutent 20 % d'urbains pauvres.
Une partie considérable des personnes confrontées à la faim sont des femmes ou des enfants ce qui pose un problème de santé particulièrement aigu du fait de la transmission héréditaire d'un état de fragilité physique qui se répercute sur la vie - souvent précocement interrompue - des personnes concernées.
B. DANS LES PAYS EN RETARD DE DÉVELOPPEMENT
1. L'impact de la croissance globale
Il existe une corrélation entre la prévalence de la sous-alimentation et la croissance économique globale mais celle-ci ne garantit pas pour autant son recul.
Il existe une étroite corrélation entre la dynamique du PIB par habitant et la proportion de la population exposée à la faim.
Cette corrélation est d'autant plus forte que la croissance est installée sur une période longue.
On peut en déduire qu'il faut du temps pour que la croissance permette de « mordre » sur la sous-alimentation. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les effets de la croissance économique sur la situation alimentaire des pays n'apparaît décisive que pour certains d'entre eux lorsqu'elle est vérifiée sur une période courte (ici une décennie).
Le graphique ci-dessus montre ainsi pour les années 1990 que s'il existe une étroite corrélation entre un recul du PIB et l'aggravation de la situation alimentaire, l'existence d'une croissance relativement soutenue du PIB par tête ne garantit pas que des progrès substantiels soient réalisés sur le front de la faim. Inversement, des pays à croissance relativement modérée peuvent réaliser des performances plus rapides sur ce point.
2. Le poids particulier de la croissance du secteur agricole
La composition sectorielle de la croissance économique renforce la corrélation entre croissance et réduction de la sous-alimentation quand elle assure une progression de la valeur ajoutée agricole.
Il existe un paradoxe qui veut que les pays où le secteur agricole pèse le plus lourd dans le total de l'activité économique et absorbe une part prédominante de la population sont les plus exposés à la sous-alimentation. Celle-ci recule d'autant plus que la valeur ajoutée agricole est dynamique. Le graphique ci-après confirme globalement ce résultat intuitif.
3. Les effets de l'investissement agricole
Cette corrélation se retrouve au niveau des investissements agricoles. Les données de la FAO accréditent l'existence d'un lien étroit entre l'évolution du capital agricole par tête et la prévalence de la faim.
Taux de croissance moyen annuel en ACS* par travailleur dans l'agriculture, dans les pays en développement
* Stock de capital agricole Source : FAOSTAT
Les pays dans lesquels la prévalence de la faim est la plus élevée sont ceux où le capital/tête a été le moins bien orienté.
Le capital agricole a pu y augmenter de façon soutenue (moins toutefois que dans les pays où la prévalence de la faim est relativement basse) mais cette croissance a été inférieure à celle de la population employée dans l'agriculture. Dans ces conditions, le capital par tête diminue malgré la croissance de l'investissement.
4. Le rôle de la productivité
Les gains de productivité agricole entre 1975 et 2007 ont été variables.
Estimation des changements TFP* et ses composantes
selon la région 1975 à 2007
* Productivité globale des facteurs Source : FAOSTAT
Avec une moyenne mondiale de 1,7 % l'an, c'est en Chine qu'ils ont été les plus élevés (+ 2,1 %). Celle-ci a été suivie par l'Amérique du Nord (+ 2 %) quand l'Europe connaissait une progression inférieure à la moyenne mondiale (+ 1,4 %).
Les progrès réalisés dans les pays en développement en dehors de la Chine ont été relativement modestes, en particulier en Afrique subsaharienne.
Ces résultats montrent que l'augmentation du capital agricole n'aboutit pas toujours à une augmentation de la productivité totale des facteurs.
Inversement, celle-ci peut être relativement forte alors même que le capital mis en oeuvre dans le secteur décline ou ne progresse que modérément.
Taux annuels d'augmentation du stock de capital
agricole et croissance de TFP
par région de 1975 à
2001
Source : FAOSTAT
La qualité du capital engagé et le contexte dans lequel s'exerce l'activité agricole différencient les effets de l'augmentation du capital sur la production agricole.
Le développement agricole réclame certes du capital mais aussi un ensemble de facteurs plus qualitatifs sans lesquels l'investissement ne produit pas tous ses effets.
C. UN CONSTAT FORT : LA CROISSANCE NE SUFFIT PAS, SES MODALITÉS ET LA RÉPARTITION DES REVENUS COMPTENT BEAUCOUP
La croissance de la production agricole, pas plus que l'importance relative de l'agriculture ne saurait suffire à assurer le recul de la faim.
Aujourd'hui, comme dans le passé, le problème de la faim n'est pas seulement, ni même essentiellement, un problème de production au sens où le potentiel de production existe et peut même être considéré comme à peu près suffisamment exploité pour apporter au monde les quantités de nutriments qui lui sont nécessaires.
Les obstacles à la mise en oeuvre du droit à l'alimentation semblent résider plutôt du côté de la répartition des revenus qui, elle-même, est étroitement dépendante des modalités concrètes de la croissance du secteur agricole.
Celles-ci ne permettent pas d'assurer un accès convenable à la nourriture à une proportion de la population mondiale comprise entre 15 et 30 %.
S'agissant des modèles de production agricole, il faut évidemment évoquer ici la situation des pays où les besoins de la population ne sont pas satisfaits par la production intérieure alors que celle-ci serait plus que suffisante.
La Thaïlande, grande exportatrice de riz, illustre cette hypothèse.
À l'avenir, des situations comme celles-ci pourraient devenir plus nombreuses sous l'effet de trois processus :
- une partie de plus en plus élevée de la production agricole pourrait être consacrée à des productions non alimentaires (énergétiques en particulier) pour répondre à une demande extérieure qui se reporterait sur les produits non pétroliers une fois passé le « pic pétrolier » ;
- les décalages entre les productions internes et la demande alimentaire pourraient gagner en ampleur du fait de la progression des demandes alimentaires nationales non satisfaites par les productions locales de sorte que les échanges internationaux prendraient plus d'importance avec des prix supérieurs à ceux des marchés domestiques tandis que des comportements spéculatifs joueraient contre l'approvisionnement du marché domestique25(*) ;
- la concentration du secteur agricole pourrait progresser renforçant les phénomènes de rente dont l'emploi pourrait ne pas nourrir nécessairement le développement d'un secteur agricole à la rentabilité comparativement limitée.
Cette dernière éventualité souligne l'importance de la répartition du revenu engendré par l'activité agricole.
Il faut d'abord relever que le revenu agricole peut ne pas progresser à proportion de la production en volume. En effet, l'accroissement du volume de la production agricole peut ne pas s'accompagner d'une progression parallèle des revenus des différents actifs agricoles, à due proportion, si les prix agricoles diminuent ou si la répartition des revenus est concentrée au profit de quelques uns.
S'agissant des prix, qui mobilisent un chapitre particulier du présent rapport, on se bornera ici à rappeler qu'en moyenne la baisse des prix agricoles relatifs a pesé sur le revenu agricole qui n'a pu résister que moyennant une augmentation de la production en volume fondée sur des progrès de productivité. Mais ces données moyennes s'accompagnent d'une nette dispersion des situations qui, en dépit de la contraction de la population agricole et de la rationalisation des exploitations, s'est soldée par une montée des inégalités dans le secteur agricole. Dans un contexte de réduction des prix agricoles relatifs, les moyens d'assurer les progrès de productivité (qui réclament des moyens financiers) n'ont pas été accessibles à tous.
En retour, du fait de facteurs divers allant dans le sens d'une plus forte segmentation des producteurs agricoles, la répartition des revenus peut être très inégalitaire dans le secteur. Cette situation et les différentes modalités de l'emploi des profits peuvent bloquer plus ou moins durablement la mise en oeuvre pratique du droit à l'alimentation.
La segmentation de l'agriculture est nette.
À l'échelle du monde, il n'y a rien de commun entre la reine d'Angleterre et le paysan du Bénin. Mais, même dans chaque pays, les écarts de situation sont considérables. Ces différences résultent de l'existence de potentiels économiques des exploitations très disparates. Sur ce point, il existe sans doute, du fait des phénomènes structurant la production agricole (concentration, normalisation, effets boule de neige des écarts de compétitivité, montée des échanges internationaux...) une tendance à l'accentuation de ces écarts. On doit particulièrement relever l'inégale capacité à capter le revenu agricole en raison en particulier d'une disparité très nette des « pouvoirs de négociation » entre les différents acteurs, qu'elle concerne les tiers (fournisseurs d'intrants, clients, gouvernements...) ou les acteurs de la production agricole eux-mêmes.
À cet égard, le défaut fréquent de protection du travail agricole est une variable-clef dont l'observation n'est pas limitée aux pays en développement. Le cas des États-Unis est fréquemment mentionné avec notamment le recours à une immigration illégale pour la récolte des melons. En Europe, plusieurs pays où le revenu par tête est pourtant élevé n'offre aucun salaire minimum aux salariés agricoles. Cette situation crée des effets distorsifs sur la concurrence mais contribue aussi à éloigner l'Europe des objectifs qu'elle prétend poursuivre en matière de lutte contre la pauvreté.
L'inégale répartition des revenus abordée sous l'angle de ses effets de plus long terme est souvent présentée comme pouvant receler des effets positifs. Si, à court terme, une répartition inégalitaire du produit agricole peut être critiquée comme s'accompagnant d'une persistance paradoxale de la faim, on prétend qu'à plus long terme l'inégale répartition des revenus agricoles peut être un facteur de progrès. En contribuant à situer la rentabilité du capital agricole au bon niveau (celui qui incite à investir en agriculture) et en permettant de réunir les conditions de financement de l'investissement agricole et d'orienter celui-ci vers les producteurs les plus efficaces, elle favoriserait structurellement le progrès de la production et, ainsi, à terme, le recul de la faim.
Cette approche est plus que discutable.
Il faut d'abord réduire à sa juste dimension l'argument de l'autofinancement en observant que l'idée que l'épargne de l'exploitant est un préalable à son expansion ne vaut que pour des organisations économiques primitives où les institutions de financement sont défaillantes. C'est d'ailleurs l'une des priorités du développement, du développement agricole en particulier, que d'instituer des institutions efficaces de financement externe de la croissance.
Cette observation est directement liée à la question soulevée par le premier argument envisagé, celui de la rentabilité du capital agricole.
Si cette rentabilité dépend d'une déformation continue du partage des revenus du secteur elle n'est à l'évidence pas soutenable et l'argument tombe. Une autre question est de savoir si la rentabilité offerte par l'agriculture peut être une incitation efficace à développer la production agricole, si bien qu'à un stade particulier du développement, une répartition inégalitaire des revenus permettant d'atteindre un certain seuil de rentabilité dans le secteur pourrait être justifiée. Cette question est évidemment particulièrement complexe puisqu'elle renvoie à toute la problématique de la contribution de l'agriculture au développement global mais aussi à celle d'un développement agricole auto-entretenu, problématiques qui sont liées, notamment à travers le problème de l'allocation du capital (et du travail).
Ces interrogations sont lourdes d'enjeux puisque, selon certaines réponses à elles données, on pourrait présenter la persistance de la faim comme une étape obligée sur une trajectoire de développement qui, à sa fin, réussirait à éliminer ce fléau.
En dehors de toutes considérations morales (pourtant hautement légitimes sur ce sujet) votre rapporteur doute fortement qu'une telle analyse soit robuste.
Outre que le développement agricole pourrait ne pas précéder mais suivre le développement économique général (ce qui atténue la portée des arguments favorables à la rente), il faut considérer :
- que la demande solvable est une condition du développement agricole ;
- et que l'existence de rentes en agriculture procédant de la concentration des revenus agricoles par quelques exploitants, loin de garantir le développement agricole auto-entretenu peut conduire à une déplétion agricole.
Cette situation recèle des enseignements pour l'avenir.
Elle conduit à envisager des scénarios où la croissance de la production agricole pourrait être élevée sans pour autant que la famine ne recule significativement, à côté d'autres scénarios où le monde paysan pauvre subirait une forme d'effondrement, qui rejaillirait sur les perspectives d'augmentation de la production agricole en les dégradant, et réduirait ainsi les opportunités offertes par l'agriculture, avec pour effet des crises alimentaires aiguës et à répétition.
Les développements qui précèdent ne font qu'illustrer un problème fondamental qui est celui de l'indétermination des équilibres de marché dans le secteur agricole.
Or, si cette indétermination peut être acceptable dans bien des secteurs économiques où les producteurs ne satisfont pas des besoins vitaux, tel n'est évidemment pas le cas pour une activité qui a pour fonction d'assurer une nécessité vitale.
La complexité des problèmes vient de quelques caractéristiques importantes qu'il faut prendre en considération :
- les offreurs sont également les demandeurs ;
- les niveaux de développement et de compétitivité sont extrêmement inégaux entre pays mais aussi dans chaque pays ; autrement dit, que ce soit sur le marché mondial ou sur les marchés domestiques, les producteurs sont dans des situations concurrentielles incommensurables ;
- les prix ne jouent pas nécessairement le rôle qu'on en attend dans l'économie théorique ou, quand ils le jouent, exercent des effets qui, souhaitables dans d'autres secteurs sont dommageables en agriculture.
Sur ce point, on peut observer, en cas de hausse des prix, des phénomènes de désolvabilisation de la demande non compensés par des hausses immédiates, ou pérennes, de la production. Dans le sens inverse, la baisse des prix agricoles peut intervenir non du fait d'un nouvel équilibre entre les volumes d'offre et de demande mais de modifications dans les pouvoirs de marché des acteurs de la chaîne alimentaire.
Même si la baisse des prix provient d'un nouvel équilibre des volumes, celui-ci peut s'accompagner d'effets asymétriques sur les offreurs et les demandeurs. Ces effets peuvent être non souhaitables, si, par exemple, la baisse des prix est insupportable pour les producteurs marginaux, très nombreux dans l'agriculture d'aujourd'hui, ou si elle ne profite qu'à des demandeurs solvables, qui captent l'effet-prix des progrès de productivité des producteurs les plus performants sans bénéficier à tous les segments de la demande.
En bref, rien ne dit que les rentes du producteur ou du consommateur sont distribués de sorte que la perspective de voir mieux mis en oeuvre le droit à l'alimentation y gagne quoi que ce soit.
* *
*
Votre rapporteur estime ainsi que, sans négliger les aspects les plus positifs des signaux de marché, il faudra pour remporter le défi alimentaire non seulement créer les conditions d'une croissance de la production agricole que le marché seul ne permet pas de réunir mais encore réguler les équilibres de ce sentier de croissance de sorte que ses fruits soient partagés entre les producteurs, et entre ceux-ci et les consommateurs, dans une dynamique où les singularités du défi alimentaire doivent être pleinement prises en compte sans pour autant se crisper sur le maintien de situations insoutenables.
Par rapport au débat réducteur entre dérégulation et interventionnisme, que les échecs des deux « modèles » obligent à considérer comme étant largement un faux débat, c'est aux modalités de la régulation du système alimentaire mondial qu'il faut consacrer toutes les énergies afin que le droit à l'alimentation soit effectivement mis en oeuvre.
DEUXIÈME
PARTIE :
UN POTENTIEL INCERTAIN
CHAPITRE I :
Y-AURA-T-IL DES TENSIONS SUR LES
TERRES ?
Dans la plupart des prospectives, les besoins alimentaires sont principalement couverts dans le futur par l'augmentation des rendements, ce que permet de visualiser le graphique ci-dessous.
Source : Centre d'études et de prospective du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire - Analyse n° 28 Juin 2011
Seule la prospective Agrimonde 1, qui a précisément été conçue pour illustrer un scénario extensif26(*), voit une augmentation des surfaces mobilisées de plus de 20 %, tandis que les autres scénarios où ce processus occupe une place notable sont des scénarios d'échec des politiques agricoles.
Dans quatre prospectives, dont celle de la FAO, l'extension des surfaces ne dépasse pas 10 %.
Globalement, les prospectivistes semblent inspirés par une contrainte, qui n'est pas toujours explicitée, d'économie de la mise en culture de terres nouvelles.
Cette option implicite peut étonner alors que l'accroissement des surfaces cultivées en agriculture pluviale semble présenter un eldorado potentiel puisque la surface disponible est actuellement loin d'être cultivée en totalité.
La question se pose de savoir s'il en va bien ainsi.
À l'examen, la réponse est particulièrement incertaine et dépend d'un assez grand nombre d'hypothèses dont certaines sont d'ordre « géo-agronomiques » quand d'autres portent sur des questions socio-économiques ou relatives à certains conflits d'usage.
Mais, le problème des terres agricoles conduit aussi à envisager des thèmes plus transversaux :
- la perspective d'une « course aux terres » est-elle un vrai problème ?
- comment penser le couple « population-terres » dans le futur ?
I. LA CROISSANCE DE LA PRODUCTION AGRICOLE DES DERNIÈRES DÉCENNIES N'A REPOSÉ QUE MARGINALEMENT SUR LA MOBILISATION DE NOUVELLES TERRES
La croissance de la production agricole des années 60 à nos jours a été assurée moins par la mobilisation des terres que par l'élévation des rendements.
Évolution des surfaces agricoles
cultivées (1961-2003)
(en millions d'hectares)
|
1961 |
2003 |
Variation |
|
|
OCDE |
430 |
410 |
- 4,7 % |
|
Afrique subsaharienne |
140 |
200 |
+ 42,9 % |
|
AN-MO |
70 |
90 |
+ 28,6 % |
|
Amérique latine |
100 |
160 |
+ 60,0 % |
|
Asie |
370 |
460 |
+ 24,3 % |
|
Ex-URSS |
240 |
200 |
- 16,7% |
|
Total |
1 350 |
1 520 |
+ 12,6 % |
Globalement, de 1961 à 2003, les terres mobilisées pour les cultures ont augmenté de 12,6 %.
Mais, dans le passé le plus récent, les sols consacrés aux céréales ont rétrogradé de 28 millions d'hectares, principalement du fait de la diversification des usages des sols dans les pays développés et en Asie que n'a pas compensée l'extension des surfaces agricoles en Amérique latine et en Afrique subsaharienne.
En quarante ans, l'Asie est devenue le continent qui rassemble le plus grand nombre de terres cultivées juste devant l'OCDE, ces deux zones regroupant plus de la moitié des terres cultivées.
C'est pourtant en Amérique du Sud que celles-ci ont le plus progressé (+ 60 %) mais cette région ne réunit encore que 10,6 % des terres cultivées en 2003.
Au terme de ces évolutions, où l'on note le recul très net des terres cultivées sur les territoires de l'ex-URSS, le taux de mise en culture des surfaces potentiellement cultivables n'a que peu progressé.
Source : Agrimonde
Dans ce contexte, l'Afrique du Nord-Moyen-Orient et l'Asie se seraient rapprochées du niveau de quasi-saturation des espaces cultivables (du moins si l'on tient pour exactes les estimations qui en sont faites par l'étude GAEZ exposée plus en détail dans la suite de ce chapitre.
En revanche, pour les autres régions des marges importantes demeurent, notamment en Afrique subsaharienne et en Amérique du sud, alors même que les besoins alimentaires insatisfaits localement peuvent rester massifs (comme c'est particulièrement le cas dans la première zone mentionnée).
S'agissant du couple « hommes-terres », l'extension des surfaces cultivées a moins progressé que la population active agricole dans trois des six grandes régions (l'Afrique subsaharienne, l'AN-MO et l'Asie) si bien que la surface agricole cultivée par actif agricole y a diminué. Inversement, cette surface a légèrement augmenté en Amérique du Sud et connu des progressions beaucoup plus substantielles sur les territoires de l'ex-URSS et, surtout, dans la zone OCDE où, malgré une réduction des terres mises en culture, elle a presque triplé.
Source : Agrimonde
Ces évolutions très disparates révèlent quelques éléments structurels fondamentaux pour la question du développement agricole.
II. LES RÉSERVES FONCIÈRES MOBILISABLES, DE L'IMPRESSION D'UNE SURABONDANCE AU CONSTAT DE DISPONIBILITÉS SOUS CONTRAINTES
Moyennant quelques incertitudes sur la quantité actuelle des terres cultivées, le constat qu'il existe des disponibilités foncières abondantes paraît s'imposer.
Toutefois, le niveau précis de ces disponibilités, qui est discuté, est sensiblement inférieur aux estimations résultant du solde entre les terres disponibles et les terres cultivées.
Pour l'évaluer, il faut tenir compte de différents facteurs dont certains - liés au contexte économique et social - sont particulièrement difficiles à quantifier.
Au total, la question de la disponibilité foncière pour résoudre le problème alimentaire est beaucoup plus ouverte qu'on ne l'indique parfois.
À un niveau d'analyse moins global, une certitude s'impose : certaines régions du monde ne pourront pas compter sur leur espace pour relever les défis alimentaires qu'elles rencontrent.
A. LE POTENTIEL THÉORIQUE : ENTRE L'IMAGE D'UNE SURABONDANCE...
1. Au premier regard, d'importantes disponibilités à l'échelle du monde
Les estimations relatives aux terres déjà cultivées et aux terres disponibles diffèrent selon les organismes dans des proportions assez élevées mais indiquent un potentiel assez élevé.
Entre les chiffres de la FAO qui évalue les terres cultivées à 1 525 millions d'hectares et ceux du SAGE (Center for Sustainability and the Global Environnement) de l'Université du Wisconsin qui les estimait à 1 805 millions d'hectares en 1992 l'écart atteint 17 % (280 millions d'hectares soit sept fois la superficie agricole cultivée de l'Europe de l'Ouest).
Les estimations des terres utilisées de la FAO rapportées aux terres utilisables en culture pluviale (selon l'étude GAEZ) montrent que seules 38 % des terres disponibles (4 152 millions d'hectares) sont cultivées (1 563 millions d'hectares).
Les estimations du SAGE ne sont pas très éloignées mais réservent un peu moins de marges : 45 % des terres cultivables sont effectivement cultivées selon le SAGE ce qui est un peu supérieur aux chiffres combinés de la FAO et de l'étude GAEZ.
Le potentiel de terres cultivables non utilisées demeure donc important.
Superficies des terres cultivées dans les différentes régions du monde
Comparaison des estimations du SAGE et de la FAO (millions d'hectares)
Source : « Terres cultivables et terres cultivées : apports de l'analyse croisée de trois bases de données à l'échelle mondiale » - Mme Laurence ROUDART
Les estimations du SAGE globalement supérieures à celles de la FAO leur sont toutefois inférieures pour l'Afrique de l'Ouest et l'AN-MO, qui sont, chacune à leur manière, deux régions de tensions alimentaires.
La répartition des terres cultivées voit les céréales occuper une part prédominante (55 % du total) devant un ensemble « d'autres cultures » et les oléagineux.
En plus des terres cultivées, il faut compter avec les superficies en pâturages permanents pour lesquelles, là aussi, les estimations diffèrent, quoique plus légèrement.
La FAO les estime à 3 370 millions d'hectares et le SAGE à 3 272 millions, soit un écart de 3 %.
Superficies des pâturages dans les différentes régions du monde
Comparaison des estimations du SAGE et de la FAO (millions d'hectares)
Source : d'après SAGE, FAO
Ces données situent la part des terres de la planète cultivées à 11 % (le double pour celle des pâturages et 17 % pour les zones arbustives) des 16 360 hectares de terres émergées, ainsi qu'il apparaît dans le graphique ci-dessous où ressort également la prédominance des forêts dans l'occupation des espaces.
Par rapport aux terres cultivées en culture pluviale (entre 1 500 et 1 800 millions d'hectares), la superficie des terres irriguées apparaît modeste avec 287 millions d'hectares.
Cependant, si elles ne représentent qu'environ 18 % des terres cultivées en régime pluvial, les surfaces irriguées produisent entre 30 et 40 % de la production alimentaire mondiale et, au cours des cinquante dernières années, elles ont doublé ce qui constitue une progression nettement plus forte que pour les surfaces arrosées par la seule nature.
Tous les dix ans, elles ont progressé de 50 millions d'hectares dans les trente dernières années.
De ces données, une conclusion paraît s'imposer : soit un objectif de multiplication par deux de la production agricole, la disponibilité des terres ne semble pas constituer a priori une contrainte.
Les estimations de surfaces mobilisables pour les cultures pluviales ne laissent pas globalement entrevoir l'existence d'une limite physique des sols à la production nécessaire à l'alimentation du monde dans le futur.
On sait que les prospectives varient selon qu'elles reposent sur une intensification des rendements économes en terres ou, plutôt, sur une économie des « méthodes productives », scénarios plus exigeants en superficies.
Le tableau ci-dessous décrit le « bouclage » par la mobilisation des surfaces dans différentes prospectives.
Panorama des hypothèses de mobilisation des terres dans différents exercices prospectifs
|
FAO 2009 |
Agrimonde GO |
Agrimonde G1 |
ISV « trend » |
ISV « highe rmeat » |
ISV « less fair meat » |
ISV « less meat » |
IFPRI « progressive policy » |
IFPRI « failure » |
IFPRI « techno failure » |
|
|
Évolution des surfaces cultivées |
+ 4,5 % net |
+ 6 % alimentaire |
+ 23 % alimentaire |
+ 9 % ou + 19 % (si 50 % de surfaces bio) |
+ 19 % |
+ 9 ou + 19 % |
- 4 % de surfaces céréalières cultivées |
+ 20 % de surfaces céréalières cultivées |
+ 13 % de surfaces céréalières cultivées |
|
Source : extraits des rapports cités et calculs des auteurs
On relève qu'il existe des marges élevées entre les niveaux des mises en culture nécessaires et le potentiel décrit dans les différentes estimations présentées ci-dessus y compris quand on recourt au scénario de mobilisation des terres le plus restrictif.
Soit le scénario de la FAO qui relève de la catégorie des scénarios les plus « productivistes », (90 % de la production nécessaire y sont assurés par la hausse des rendements contre 10 % par l'extension des surfaces cultivées contre, dans la période 1960 à 2000, une répartition de 85 et 15 % respectivement), le nombre d'hectares à mobiliser s'élève à 128 millions (pour un besoin de terres pour les agro-carburants de 58 millions d'hectares soit 70 millions d'hectares pour les seuls besoins alimentaires).
Dans le scénario Agrimonde 1, plus extensif, le besoin de terres est estimé à 590 millions d'hectares (dont 224 millions pour les agro-carburants).
Rapportées aux différents scénarios de disponibilité des terres, ces besoins de mobilisation de surfaces supplémentaires ne semblent pas excessifs et paraissent même laisser des marges, importantes parfois.
Globalement, les réserves foncières semblent surabondantes mais un coup d'oeil, plus fin conduit à relever la grande disparité des disponibilités selon les régions.
2. Des potentiels régionaux très inégaux
De fait, les marges disponibles apparaissent très variables selon les zones et, à l'intérieur de chacune d'elles, selon les régions et les pays, ainsi que le rapporte avec précision M. Michel Griffon, dans son ouvrage « Nourrir la planète ».
Pour ce qui est des zones, la mobilisation effective du potentiel n'atteint que 12 % en Amérique du Sud, 20 % en Afrique subsaharienne et autour de la moitié en Amérique du Nord, Russie et Europe. Par contraste, certaines zones (AN-MO, Asie) offrent peu de marges.
Ces données peuvent être visualisées dans l'illustration ci-dessous.
Couverture de l'espace par l'agriculture et surfaces disponibles
Pour les régions et les pays, de grandes disponibilités en terres cultivables non cultivées existent au Brésil (environ 450 millions d'hectares) aux États-Unis (200 millions d'hectares) au Zaïre (plus de 100 millions d'hectares) en Australie, au Soudan et en Angola.
Incidemment, il faut relever que la situation de ces deux derniers pays qui sont au nombre de ceux où la sous-alimentation est tout particulièrement sévère n'en apparaît que plus choquante.
En Asie, la surface agricole exploitée représente 75 % de la surface apte à l'agriculture, mais avec des différences régionales : 95 % en Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh où presque tout l'espace est occupé), et 63 % en Asie de l'Est (Indonésie, Malaisie, Philippines) où persistent des espaces libres souvent forestiers.
En Amérique du Sud et dans la région « Caraïbes », l'agriculture n'occupe que 19 % des surfaces potentiellement utilisables avec là aussi de grandes différences selon les régions. Sous cet angle, l'Amérique du Sud tropicale, recèle sans doute les plus grandes marges. La surface agricole totale y a augmenté de 110 millions d'hectares en 30 ans mais ne représente que 10 % d'un potentiel très largement occupé par la forêt amazonienne.
L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient sont des régions où les populations sont concentrées sur les plaines irriguées : plaines côtières du Maghreb, région du Croissant fertile (Palestine, Jordanie, Syrie, Irak), collines d'Anatolie et d'Iran, et le sud de la péninsule arabique. L'accroissement de la population a conduit à accroître les surfaces cultivées d'environ 3 millions d'hectares sur un total qui atteint en 2002 environ 90 millions d'hectares. Les surfaces en pâturages ont beaucoup augmenté (environ 100 millions d'hectares en raison de la forte demande de viande, en particulier ovine), mais en utilisant des terres de parcours à faible productivité. Au total, cette région aurait épuisé ses ressources en espace productif.
L'Afrique subsaharienne est caractérisée par une occupation très hétérogène de son espace alternant des zones de haute densité, et des zones presque vides.
En Afrique centrale, les populations sont concentrées dans l'ouest du Cameroun et autour de Brazzaville et de Kinshasa, et dispersées autour du vaste bassin forestier du Congo.
En Afrique de l'Est, les densités élevées se situent en Éthiopie et dans l'« Afrique des hautes terres » : Rwanda, Burundi, Est-Congo, Ouganda, Ouest-Kenya, Malawi.
D'autres concentrations élevées se trouvent ponctuellement autour des capitales d'Afrique australe situées dans des régions côtières. Historiquement, c'est toujours la migration qui a permis aux populations manquant de terre d'utiliser des espaces peu cultivés.
L'Afrique a été dans le passé un continent où les migrations ont été la réponse principale à l'insécurité alimentaire. Ces migrations sont encore très présentes, et la raréfaction progressive de l'espace provoque des conflits fonciers et politiques. Au total, en 30 ans, les surfaces en terre arable ont augmenté de 40 millions d'hectares pour atteindre environ 150 millions d'hectares en 2002 sur une superficie agricole totale de 900 millions d'hectares essentiellement pastorale. Les surfaces agricoles totales n'occupent que 22 % de l'espace potentiellement utilisable pour l'agriculture.
Pour résumer, le potentiel existant pour élevé qu'il paraisse est très irrégulièrement réparti, certaines régions (l'Asie et l'Afrique du Nord-Moyen-Orient) paraissent avoir d'ores et déjà mobilisé la plus grande partie de leurs disponibilités quand d'autres (l'Afrique subsaharienne, l'Amérique du Sud, l'ex-URSS) ont des réserves théoriques élevées.
Il faut toutefois tenir compte de plusieurs éléments supplémentaires qui viennent encore nuancer le diagnostic de l'existence d'un potentiel élevé de terres disponibles.
B. ...ET DES RÉALITÉS PLUS FORTEMENT CONTRAINTES
Le nécessaire affinement des estimations conduit à un potentiel plus restreint.
1. Le poids des contraintes naturelles
Il convient de tenir compte des contraintes agronomiques, d'ordre climatique, topographique ou pédologique.
L'étude GAEZ (Global Agro-Ecological Zones) de l'International Institute for Applied Systems Analyses (IIASA) et de la FAO distingue cinq catégories de terres :
- les terres très convenables (à l'une au moins des 154 variétés de culture envisagées dans l'étude) ;
- les terres convenables ;
- les terres modérément convenables ;
- les terres peu convenables ;
- les terres non convenables.
La distinction entre ces catégories se fait selon un critère de rendement par rapport au meilleur rendement accessible dans la zone climatique à laquelle appartiennent les terres considérées (tropicale, subtropicale, tempérée, boréale).
Selon cette étude, 78 % des terres émergées présentent des contraintes sévères, seules 3,5 % des terres étant sans contraintes. Le solde, soit 18,5 %, sont des terres subissant des contraintes plus ou moins modérées.
En mobilisant quelques unes des terres jugées « peu convenables », ce sont 27 % des terres émergées, généralement classées dans les trois premières catégories mentionnées ci-dessus, (5 % des terres étant considérées comme peu convenables) qui constituerait le potentiel disponible.
Alors que les trois premières catégories mentionnées ci-dessus regroupent 3 573 millions d'hectares en ajoutant une petite partie des terres « peu convenables » on aboutit à un total de terres disponibles pour la culture qui s'élèverait à quelque 4 152 millions d'hectares.
Les estimations des terres cultivables par l'IIASA et la FAO ne diffèrent pas fondamentalement de celles du SAGE excepté pour l'Amérique du Sud et l'Afrique centrale (où le SAGE est plus restrictif). Mais, au total, les deux organismes convergent vers un niveau de terres cultivables de l'ordre de 4 000 millions d'hectares (4 152 pour GAEZ, 4 022 pour le SAGE).
Ce potentiel est inégalement réparti comme le montre le graphique ci-dessus qui présente la répartition géographique des terres selon le niveau de contraintes. La plupart des terres sans contraintes (ou à contraintes modérées) sont situées en Amérique du Nord et du Sud (plus de 80 millions d'hectares chacune) en Asie du Sud, en Europe de l'Est et Afrique de l'Est (autour de 30 millions d'hectares).
Ces terres présentent toutefois une particularité : nombre d'entre elles sont recouvertes de forêts, et ce dans des proportions parfois élevées.
Les régions les plus forestières sont également celles qui regroupent le plus de terres propices à la culture (l'Amérique du Nord et du Sud, l'Afrique centrale et la Russie).
Cette contrainte implicite est renforcée quand on ne considère que les trois grandes céréales (blé, riz, maïs). Les superficies qui se prêtent à leur culture pluviale s'élèvent à 2 430 millions d'hectares (soit environ les deux tiers des terres mobilisables).
Mais, 20 % de ces terres sont recouvertes de forêts.
Là également, la proportion des terres où la culture pluviale des trois céréales est possible mais couvertes par des forêts est particulièrement élevée en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Russie.
Dans ce contexte, des considérations évidentes obligent à tenir compte de différents scénarios de mise en culture, selon qu'elles concernent ou non les forêts et les terres considérées comme peu convenables (soit les terres où le rendement se situe entre 20 et 40 % du meilleur rendement de la zone), pour approcher les disponibilités foncières
Cette scénarisation a été effectuée par Mme Laurence Roudart dans l'étude précitée commandée par le ministère de l'agriculture et de la pêche et à laquelle cette partie de notre rapport doit beaucoup.
|
La scénarisation des terres cultivables Trois hypothèses contrastées sont posées impliquant une plus ou moins forte mobilisation des terres : dans l'hypothèse 1, sont considérées comme pouvant être mis en culture les terres « très convenables » à « modérément convenables » sauf celles qui sont recouvertes de forêts et celles qui sont nécessaires aux infrastructures urbaines « et autres ». dans l'hypothèse 2, les « terres peu convenables » sont mobilisables excepté celles sous forêts ; dans la troisième hypothèse, toutes les terres cultivables sous forêts sont mises en culture (ce qui correspond à un tiers des forêts du monde). |
Les calculs présentés montrent que l'extension possible des terres va d'un coefficient de 1,7 (dans la première hypothèse jugée très conservatrice) à 2,5 dans la troisième hypothèse en passant par un doublement (dans l'hypothèse 2 où les terres sans forêts restent inexploitées).
Synthèse des résultats de la projection
|
En niveau (*) |
En % |
|
|
Hypothèse 1 |
+ 1 000 |
+ 70 % |
|
Hypothèse 2 |
+ 1 450 |
+ 100 % |
|
Hypothèse 3 |
+ 2 350 |
+ 150 % |
|
(*) en millions d'hectares |
||
Source : G. Fisher 2009 « World
Food and Agriculture to 2030/50 »
Centre d'études et
de prospective - MAAP Analyse n° 18 mai 2010. Mme Laurence
Roudart
Si, globalement, la disponibilité des terres cultivables resterait suffisante, on se rapproche dans certains scénarios d'une situation où des tensions pourraient apparaître si l'on devait miser sur la mobilisation des terres pour combler les besoins alimentaires futurs.
2. De fortes tensions locales
Localement, des tensions très fortes interviendraient.
Ces contraintes locales ainsi que quelques observations sur les estimations des terres disponibles obligent à se demander si les constats selon lesquels, la disponibilité des surfaces de cultures pluviales ne serait contraignante, ni du point de vue quantitatif de la production nécessaire à l'alimentation d'un monde de 9 milliards d'habitants, ni de celui, plus qualitatif, du choix du modèle agricole est réellement incontestable.
Le poids des contraintes locales doit être pleinement pris en compte. La scénarisation proposée dans l'étude de Mme Laurence Roudart permet d'affiner les potentiels régionaux et montre que ceux-ci sont très inégaux.
Superficies cultivées en 2005 et superficies cultivées dans trois scénarios de mobilisation des terres
Source : Laurence Roudart
Dans l'hypothèse de mobilisation du potentiel la plus restrictive, l'Amérique du Sud concentrerait 46 % des 1 000 hectares de terres mobilisables, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale 20 % chacune et l'Afrique de l'Ouest 9 %.
Dans les autres régions, les terres mobilisables seraient, ou peu importantes, ou même négatives, puisqu'on admet qu'en Asie les surfaces cultivées excédent, dès aujourd'hui, les terres relevant des meilleures catégories.
La confrontation entre l'évolution des besoins locaux et l'augmentation de la production dans différents scénarios d'extension des terres cultivées - selon les limites choisies pour assurer certains objectifs environnementaux - aboutit au constat que la mobilisation des terres n'offre pas systématiquement de solution locale au défi alimentaire.
La situation se présente comme suit selon M. Michel Griffon.
|
Pour l'Asie on peut théoriquement augmenter la surface de 33 % mais avec les rendements actuels cette extension serait insuffisante et ne deviendrait efficace que moyennant une forte élévation des rendements. A fortiori, dans un scénario de préservation de l'environnement, avec moins de nouvelles surfaces engagées, la contrainte sur les rendements augmenterait dans des proportions qui ne sont pas réalistes. La Chine bute sur une contrainte particulière. Elle doit doubler sa production alors que les ressources en terres nouvelles sont très limitées et que l'urbanisation concurrence les terres exploitées. Les besoins des pays du sous-continent indien ne rencontrent pas d'offres plus flexibles. L'Inde, le Pakistan et le Bangladesh occupent complètement leur espace productif agricole. Il ne reste donc pratiquement plus d'espace à conquérir, sauf la jachère dans les régions sèches. Pourtant, l'Inde devrait multiplier sa production en 2050 par plus de 3, le Pakistan par presque 4, et le Bangladesh par plus de 6. En Asie du Sud-Est il existe des marges inégales. En tout cas, les besoins de la Thaïlande, de la Malaisie et de l'Indonésie qui seraient être multipliés par 2 à 4, sont trop élevés pour être satisfaits par l'extension des terres. En Amérique du Sud et centrale la production doit être doublée et les possibilités offertes par le foncier semblent élevées. L'Amérique du Sud dispose des surfaces nécessaires pour doubler la production agricole afin d'assurer la subsistance de sa population en 2050. Sans changer les rendements, il faudrait augmenter les surfaces cultivées de 200 %, soit environ 400 millions d'hectares, ce qui est possible ; sur les 860 millions d'hectares disponibles en 2000, il en resterait encore 460 disponibles en 2050. Ce qui reste de l'Amazonie forestière en 2000, soit près de 600 millions d'hectares, serait alors réduit de moitié ou des deux tiers. Mais un accroissement des rendements réduirait cette pression sur la forêt. C'est donc de cet accroissement des rendements que dépendra en grande partie le sort de l'Amazonie. Les pays qui auront le plus besoin d'accroître leurs surfaces dans la région amazonienne sont le Pérou et la Bolivie. L'Argentine connaît aussi une extension de ses terres arables (5 millions d'hectares supplémentaires en 30 ans pour arriver à environ à 35 millions d'hectares en 2002), mais à un rythme plus réduit que le Brésil qui a accru ses terres arables de 40 millions d'hectares en 30 ans pour en avoir aujourd'hui 60 millions. Mais ces deux pays disposent d'abondantes surfaces en pâturages dont 140 millions d'hectares pour l'Argentine et 200 millions pour le Brésil. Une partie peut être reconvertie en terre arable. Au total, l'Amérique du Sud peut donc augmenter fortement ses surfaces et ses rendements pour faire face à l'accroissement de ses propres besoins alimentaires, sans trop dégrader son patrimoine forestier qui est aussi celui de l'humanité. Pour l'Amérique centrale, la situation est moins favorable. Elle dispose de possibilités de colonisation dans les plaines côtières atlantiques qui ont un climat tropical humide. La pression foncière élevée à l'Ouest fait que le mouvement de colonisation des zones tropicales de l'Est est rapide. Cette colonisation se fait sur une base d'élevage et d'agriculture extensive, c'est-à-dire utilisant beaucoup d'espace et produisant peu. Rapidement, l'espace aura été saturé au détriment de la forêt déjà très fortement dégradée. Cette saturation devrait se traduire rapidement par la nécessité d'accroître les rendements car les besoins alimentaires seront multipliés par 4 à 6 dans les quatre pays suivants : Guatemala, Salvador, Honduras et Nicaragua. Le développement de l'irrigation deviendra donc de plus en plus nécessaire. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, la région est caractérisée par un climat méditerranéen ou aride. La production agricole dépend des zones irriguées (maraîchage, petite agriculture, fourrages et productions animales intensives) et des grandes zones de plaine à faible pluviométrie où sont cultivées les céréales (blé, orge, fourrages secs). Le climat limite l'extension potentielle des surfaces cultivées : les zones les moins mal arrosées connaissent des rendements qui restent faibles, et les zones à pluviométrie aléatoire connaissent des rendements encore plus faibles. Il y a donc saturation complète de l'espace agricole et une impossibilité d'accroître les surfaces cultivées en agriculture pluviale. En Afrique subsaharienne où il faudrait quintupler la production, l'espace est potentiellement productif et la réponse dépend des régions. Pour l'Afrique de l'Ouest, le sud et le nord du Nigéria sont très denses, et les surfaces disponibles se raréfient. Seules les zones de savanes entre le Sahel et les zones forestières ont des potentialités intéressantes. Cette région devrait multiplier sa production entre 6 et 12 selon les pays entre 2000 et 2050. Sur un total d'environ 200 millions d'hectares disponibles dans la région pour l'agriculture, 50 millions sont cultivés en 2000 (soit de l'ordre de un quart). Multiplier la production entre 6 et 12 signifierait occuper la totalité de l'espace disponible et multiplier les rendements par 1,5 à 3 en moyenne, ce qui reviendrait à faire peser l'essentiel de l'effort sur les zones de savane et de forêt en multipliant les rendements par 2 à 5. Si l'on veut préserver la forêt dans l'état où elle est actuellement, il faut alors renoncer à mettre en culture entre 10 à 20 millions d'hectares et accroître les rendements en proportion, soit entre 5 à 10 % supplémentaires. Techniquement, ces contraintes apparaissent hors de portée. L'Afrique centrale est beaucoup moins peuplée, mais assez préservée si bien qu'un accroissement de la consommation de 8 à 12 en 50 ans est prévisible. L'agriculture utilise en 2000 environ 20 millions d'hectares de terres arables sur environ 550 millions d'hectares potentiels, soit près de 5 % seulement des surfaces. Il faudrait donc en 2050, sans changement de rendement, occuper de 120 à 240 millions d'hectares, soit 20 à 50 % de l'espace, l'essentiel de l'espace disponible se situant dans la grande forêt du bassin du Congo. La contrainte de préservation de la biodiversité paraît empêcher ce scénario. L'Afrique orientale comprend des populations relativement pauvres mais les besoins alimentaires à l'horizon 2050 devraient y être multipliés de 8 à 14, ce qui est le plus haut niveau d'accroissement de l'Afrique subsaharienne. L'agriculture utilise environ 50 millions d'hectares de terre arable, soit de l'ordre du tiers du potentiel cultivable. Les rendements sont en général relativement élevés bien qu'utilisant des techniques traditionnelles. Pour subvenir aux besoins, il faudrait donc d'abord utiliser la totalité de l'espace arable et plus que tripler les rendements. Cette hypothèse est peu vraisemblable en agriculture pluviale. En agriculture irriguée, il faudrait des investissements importants. Le plus vraisemblable est donc la pérennité de crises alimentaires et la migration vers l'Afrique centrale. Quant à l'Afrique australe, ses besoins devraient être multipliés par 2 à 5. La surface agricole utilisée est de l'ordre de 5 millions d'hectares, soit environ 10 % du potentiel en agriculture pluviale. En 2050, il faudrait donc de 10 à 25 millions d'hectares supplémentaires avec les mêmes rendements qu'aujourd'hui. C'est sans doute possible mais au prix d'une redistribution foncière importante entre les grandes exploitations et les petites. Au total, on observe que les situations africaines sont très contrastées. En simplifiant, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est ont des efforts très importants à consentir en termes de rendements sans commune mesure avec ce que ces régions ont fait jusqu'alors. Il faudra donc qu'il y ait une rupture dans l'évolution technique. Source : M. Michel Griffon « Nourrir la planète » |
3. Des doutes sur les méthodes
Certains problèmes de méthode peuvent exagérer l'image du disponible.
La méthode employée pour apprécier le potentiel en surfaces agricoles distingue celles-ci selon leurs capacités productives.
Les corrections ainsi apportées contribuent à un plus grand réalisme des estimations de potentiel. Pour autant, elles n'offrent pas toutes les garanties souhaitables.
En premier lieu, quelques difficultés de cohérence peuvent résulter de ce qu'une terre jugée « peu convenable » ici serait, située ailleurs, considérée comme « convenable ». Autrement dit, la méthode relativiste qui est utilisée - la comparaison du potentiel de chaque surface avec le meilleur rendement atteignable dans la région concernée - pose un problème d'agrégation des différents résultats obtenus. L'estimation est sensible à des erreurs.
En second lieu, les marges de rendement délimitant chaque catégorie peuvent être jugées assez larges (20 points de rendement) ce qui laisse subsister une certaine indétermination sur le potentiel concret des terres appartenant aux différentes catégories identifiées. En outre, des problèmes de seuil ne sont pas à exclure en cas d'erreur très marginale, le niveau de cette incertitude ne pouvant être précisé puisque la distribution précise des terres sur l'ensemble du spectre n'est pas connue.
Sur un plan technique toujours, on doit relever que le critère d'identification des terres potentiellement cultivables - l'adéquation de la terre à la culture de l'une des 154 espèces envisagées - peut apparaître excessivement favorable. En effet, il peut conduire à considérer comme propre à n'importe quelle culture des terres qui ne sont utilisables en réalité que pour quelques unes, voire l'une seulement, d'entre elles. Cette difficulté est d'autant plus sérieuse que la question de l'adaptation de ces cultures à la demande internationale et, a fortiori, locale, n'est pas réellement élucidée.
4. Le poids des facteurs socio-économiques
Les estimations concernant les terres mobilisables négligent des considérations socio-économiques fondamentales.
De fait, les études de cas conduites sur le terrain aboutissent systématiquement à minorer les estimations réalisées à partir d'un point de vue plus lointain.
Cette discordance suggère que les différentes estimations auxquelles on se réfère le plus souvent dans les organisations qui conçoivent les voies de la résolution du défi alimentaire - à savoir des évaluations globales - exagèrent les disponibilités foncières.
L'écart entre les observations globales et les observations locales ne provient pas seulement de ce que les premières, fondées sur des observations satellitaires ou des déclarations des administrations centrales des États concernés sont, de ce fait, techniquement imparfaites ou biaisées pour des raisons opportunistes. Il résulte également de ce que les problèmes pratiques liés, soit au statut juridique des terres, soit à leur éloignement des structures de consommation aggravé par l'absence d'infrastructures de transport, sont généralement plus ou moins négligés quand on observe le problème de la disponibilité des terres de trop haut.
In fine, les questions les plus sensibles pourraient être ailleurs. Les concurrences pour occuper les surfaces à potentiel alimentaire paraissent plus redoutables encore que la question habituellement posée du potentiel théorique de terres.
5. Quels équilibres « hommes-terres » ?
Il convient de s'interroger sur la dynamique du couple « hommes-terres »
Sur ce point, on doit, en premier lieu, observer que la croissance démographique pourrait excéder à l'avenir celle des terres cultivées, tout particulièrement dans certaines régions.
Ce constat ne vaut pas considéré au niveau le plus global. Dans l'hypothèse démographique la plus élevée, la population s'accroîtrait de l'ordre de 85 % (50 % dans le scénario moyen à 9 milliards d'individus) alors que dans la projection des terres pouvant être cultivées la plus restrictive l'augmentation de la superficie serait de 70 %.
On relève bien une tension si la population devait suivre sa tendance actuelle mais elle serait « gérée » dans un scénario de progression des terres cultivables moyen (avec alors un doublement possible des terres cultivées).
En revanche, localement des tensions plus fortes devraient intervenir même dans un scénario recourant à l'extension des terres.
Ceci conduit à considérer un aspect généralement négligé des perspectives associées à celles portant sur la croissance démographique et à ses effets sur les équilibres agricoles. On se concentre surtout sur l'impact de l'augmentation de la population sur la demande alimentaire en omettant trop souvent que le choc démographique à venir représentera également un défi relatif au sort des populations rurales qui vivent majoritairement de l'agriculture.
À cet égard, deux scénarios très contrastés peuvent être imaginés :
- l'un, plutôt tendanciel, de fort exode rural, qui verrait la population des campagnes se déverser dans les villes ;
- l'autre où, au contraire, la population supplémentaire, hors migrations, devrait provenir essentiellement du monde rural, se fixerait dans cet environnement.
Le choix du scénario souhaitable est particulièrement épineux puisqu'il suppose de trancher entre des stratégies qui accordent à l'agriculture des rôles tout à fait opposés dans la problématique générale du développement.
Fondamentalement, il s'agit de savoir si l'agriculture peu être le socle du développement, et, en particulier, de la lutte contre la pauvreté ou si, au contraire, le développement doit reposer sur la croissance d'autres secteurs économiques dont dépend à son tour l'essor de la production agricole.
Ce point, particulièrement discuté, est envisagé dans d'autres parties du présent rapport. Mais, à ce stade, quelques observations peuvent être mentionnées :
- les différentes enceintes internationales où se dessinent les politiques d'aide au développement semblent avoir convergé dans les années 2000 vers une position où le développement agricole est considéré comme un vecteur à part entière du développement et, sur ce point, on souligne, en particulier, la conversion de la Banque mondiale à cette approche ;
- en l'état, il existe dans le secteur primaire un très grand nombre d'agriculteurs qui sont pauvres et, parmi les pauvres, les agriculteurs sont majoritaires ;
- dans le contexte d'un essor de la production agricole, si la proportion des pauvres a eu tendance à baisser, le nombre absolu de pauvres n'a pas reculé, la production par actif agricole ayant évolué de façon très différenciée ainsi que le revenu par agriculteur ;
- dans le monde, l'intégration des agriculteurs aux circuits économiques qui leur permettent de vivre de leur activité est marquée par une très grande diversité ; sur ce point, certaines agriculteurs, les plus pauvres, subissent une série d'obstacles structurels ;
- dans le futur, la perspective d'un déversement réussi, c'est-à-dire garantissant à ceux qu'il concernerait, de sortir de la pauvreté qui est aujourd'hui le premier facteur d'insécurité alimentaire, est hautement incertaine ;
- de même, le niveau de ce déversement ne peut être qu'hypothétique si bien qu'on doit raisonnablement imaginer que la population agricole progressera ;
- dans ces conditions, il faudra que la production par actif agricole augmente afin de dégager les revenus indispensables pour que les agriculteurs sortent de la pauvreté ;
- l'élucidation des conditions de ces progrès constitue une clef pour la résolution du problème alimentaire mondial et, sur ce point, les avis divergent ;
- toutefois, l'augmentation de la surface moyenne par actif agricole paraît dans tous les cas un préalable, qu'elle se réalise dans des exploitations familiales ou dans des unités de production plus « intégrées » ;
- le revenu agricole en dépend, que son essor passe par une extensification de la production ou par une intensification ;
- sur ce dernier point, il semble nécessaire de disposer d'une surface suffisante pour réaliser les investissements qu'une telle stratégie suppose, même si la mutualisation des moyens de production peut offrir quelques marges ;
- ainsi, à l'avenir, la surface agricole qu'il faudra mobiliser devra excéder l'augmentation de la population active dans le secteur, les deux variables - la population active et les terres disponibles - étant logiquement appelées à s'influencer mutuellement.
Il existe ainsi un rapport de proportionnalité entre l'évolution de la population agricole et celle des terres à mettre en valeur si l'on veut résoudre le problème de la pauvreté qui est le facteur principal de l'insécurité alimentaire et du défaut, observé en pratique, de mise en oeuvre du droit à l'alimentation.
Il s'agit d'une condition nécessaire, mais pas suffisante, dont les prolongements concrets dépendent crucialement des perspectives d'évolution de la population active agricole, perspectives qui sont dépendantes d'un grand nombre de variables parmi lesquelles figure l'accessibilité des terres agricoles.
III. UNE « COURSE AUX TERRES » ?
Un problème essentiel doit être envisagé : celui des effets d'une éventuelle « course aux terres ». On entend par là le phénomène d'achats de terres mais aussi la question des conflits d'usage27(*). Ces processus n'ont pas la même dimension. Mais tous deux traduisent une tendance à la banalisation des surfaces agricoles, notamment sous l'effet du renforcement des mécanismes marchands et d'assouplissement corrélatif des liens traditionnels très serrés entre les territoires agricoles et les États.
A. LES ACQUISITIONS INTERNATIONALES DE TERRES
La multiplication des cessions internationales d'actifs fonciers n'est qu'une des manifestations, à côté des questions plus épineuses posées par les conflits d'usage pouvant fragiliser la production agricole à des fins alimentaires.
Les cessions internationales d'actifs agricoles se développent, témoins des processus de globalisation en cours dans l'agriculture.
Le Centre d'analyse stratégique leur a consacré, en juin 2010, un rapport dont les principaux « messages » sont les suivants :
« Les actifs agricoles considérés correspondent aux facteurs de production agricole au sens large ce que concerne les terres mais également les unités de production (exploitations et usines de transformation à différents niveaux de la chaîne de valeur agroalimentaire), ainsi que les récoltes, dont l'achat peut être contractualisé à l'avance.
Le terme « cession d'actif » ne doit pas être pris dans un sens étroit. Toutes les formes de transactions impliquant des transferts de propriété à long terme peuvent être impliquées. Elles voient de plus en plus d'investisseurs étrangers conclure des contrats de long terme, portant sur des actifs de grande ampleur : de la location à long terme (option la plus fréquente) à l'acquisition effective des terres ou aux ententes bilatérales (comme le « Partenariat stratégique » entre la Chine et de nombreux pays africains).
Les investisseurs étrangers sont des acteurs économiques issus des secteurs public ou privé. Dans le premier cas, les fonds souverains et les entreprises d'État sont les véhicules privilégiés des gouvernements investisseurs. Dans le second cas, les investisseurs peuvent être des multinationales issues des secteurs de l'agroalimentaire et de l'énergie, ou des acteurs financiers (banques, fonds d'investissement). »
Au cours des années écoulées depuis la seconde guerre mondiale c'est plutôt la tendance à un repli ou à une stagnation des investissements internationaux dans le secteur agricole des pays en développement qu'on a pu observer.
Ce processus a été parallèle à celui qui a limité l'ampleur de l'investissement agricole dans le monde.
L'agriculture a été un secteur marginal de la vie économique et financière de ces dernières années et notamment dans le processus de développement spectaculaire des flux de capitaux.
Si la globalisation l'a concerné, ce n'est pas tant par ce dernier truchement que par l'essor du commerce international des produits agricoles ou par les interdépendances de marché qui se sont renforcées notamment pour ce qui est des prix.
Mais les « signaux faibles » observables ainsi que les perspectives portant sur les variables pertinentes conduisent à envisager un net développement des investissements internationaux dans le domaine agricole.
Les estimations des cessions d'actifs agricoles sont imprécises étant donné le caractère souvent confidentiel de ces opérations. Par ailleurs, les observations faites à partir des annonces récentes et de leur concrétisation montrent qu'il existe un écart considérable entre les deux dont l'ampleur a pu être influencée par la multiplication des initiatives28(*) lancées suite à la crise alimentaire de 2007-2008, puis abandonnées.
Selon la CNUCED, le flux d'investissements directs étrangers à destination des pays en développement (PED) se serait élevé à 3 milliards de dollars entre 2005 et 2007 (secteurs de l'agroforesterie et de la pêche).
L'investissement international en direction des PED aurait quintuplé depuis 1990 contre une stagnation dans les pays développés.
L'IFPRI évalue entre 15 et 20 millions d'hectares de terres cultivables les cessions foncières consenties dans les PED à des investisseurs étrangers (soit une contrevaleur de 20 à 30 milliards de dollars).
Les terres concernées se trouvent majoritairement en Afrique (Soudan, Éthiopie, Congo, etc.) mais l'Amérique du Sud, l'Europe de l'Est et l'Asie sont également concernées.
D'autres « dires d'experts » soulignent l'écart entre les annonces et les cessions effectives mais relèvent que la course aux terres s'accentue avec des motifs variés. Il ne s'agit pas toujours de contribuer à renforcer la sécurité alimentaire des pays acheteurs. D'autres motifs économiques peuvent intervenir : l'exploitation de la biomasse à des fins non-alimentaires, la production alimentaire destinée aux marchés locaux, la spéculation foncière ou l'acquisition de « crédits-carbone »...
Par ailleurs, les investisseurs ne sont pas nécessairement publics. De plus en plus, particulièrement pour les opérations concernant des surfaces importantes, ils sont privés.
Ces données très incertaines et qui ne concernent que des opérations impliquant des actifs fonciers stricto sensu représentent l'équivalent de la surface agricole utile de la France mais à peine 1 % des terres cultivées dans le monde.
Toutefois, l'accélération du rythme des cessions, l'exemple du développement des opérations internationales portant sur d'autres ressources (le pétrole, les terres à minerais...) ainsi que l'accentuation des contraintes de production locales laissent entrevoir un possible essor de cette catégorie d'opérations.
Des perspectives d'amplification des opérations d'investissements étrangers dans le secteur agricole.
En effet, les motifs de ces opérations devraient devenir plus pressants.
Ainsi, la sécurité énergétique ou, plus banalement, les préoccupations commerciales des entreprises de production de produits énergétiques pourraient pousser à des opérations plus vastes et nombreuses destinées à s'assurer les moyens de produire des agro-carburants.
Si la majorité des projets d'IDE sont aujourd'hui à vocation alimentaire, 20 % des projets sont déjà dédiés aux cultures d'agro-carburants. Les préoccupations énergétiques pèsent dès maintenant assez lourd et pourraient s'alourdir à mesure que le renchérissement des prix du pétrole se produirait.
De même, les acquisitions d'actifs agricoles correspondant à la volonté des importateurs de produits agricoles contraints par leurs disponibilités foncières devraient devenir plus attractives à mesure que la rareté des terres locales confrontée à l'essor de la demande menacera leur sécurité alimentaire.
Dans la recherche de nouvelles stratégies de sécurité alimentaire, l'augmentation des actifs fonciers à l'étranger offre des potentialités.
Le rapport du CAS mentionne la Chine qui confrontée à la diminution de ses surfaces agricoles fait partie des quatre pays dont les entreprises d'État acquièrent ou louent de plus en plus de terres agricoles, principalement en Afrique, en Russie, en Asie du Sud-Est et en Amérique Latine.
Mais c'est également le cas de certains pays arabes.
Les investissements internationaux dans le secteur ne sont évidemment pas réservés aux puissances souveraines. Ils peuvent correspondre à des stratégies entrepreneuriales bien comprises :
les pays en développement peuvent présenter des avantages comparatifs qui ne sont pas encore systématiquement exploités ou pourraient mieux se révéler dans le futur ;
les actifs agricoles peuvent représenter une opportunité de diversification des patrimoines et entre à ce titre dans les plans des nouveaux intervenants sur ce marché qui semblent devoir être de plus en plus les gestionnaires de portefeuilles financiers.
La question des effets de l'augmentation des investissements directs étrangers dans les surfaces agricoles doit être envisagée sans oublier au préalable de mentionner les troubles politiques qu'ils peuvent engendrer.
À ce sujet, on peut rappeler que le projet dit « Daewoo » à Madagascar a illustré la très forte sensibilité de l'enjeu que représente traditionnellement la terre.
Or, les IDE qui les concernent sont d'autant plus susceptibles de créer des conflits qu'ils se plaquent sur des réalités juridico-politiques mal stabilisées et proviennent d'acteurs qui peuvent ne pas maîtriser l'ensemble des paramètres d'une réalité incertaine.
L'identification du titulaire des « droits sur la terre » est ainsi particulièrement cruciale puisque les titulaires proclamés - souvent les États - peuvent se voir contester ces droits par une série d'intervenants, au rang desquelles les populations locales. En outre, les conditions d'insertion des terres convoitées dans des ensembles qui les englobent peuvent être difficiles à appréhender alors que le conflit traditionnel entre les éleveurs nomades et les cultivateurs sédentaires peut être particulièrement vif.
Mais, la question principale est probablement celle des effets des IDE sur le foncier des pays en développement et leur capacité à suivre une stratégie agricole conforme durablement à leurs intérêts.
Globalement, les cessions internationales de terres impliquant les pays en développement ne semblent pas s'inscrire a priori dans le cadre des stratégies de ces pays.
Que l'acheteur (ou le loueur) soit public ou privé, ce sont ses intérêts qu'il poursuit, ce qui ne signifie pas que ceux-ci ne concordent systématiquement pas avec les intérêts des acteurs du pays d'accueil.
Mais, les opérations concrètement réalisées paraissent porter essentiellement sur des exploitations de grande taille qui sont susceptibles de déséquilibrer encore un peu plus les équilibres déjà très fragiles de l'offre locale caractérisée par la difficile cohabitation entre une agriculture tournée vers les marchés, souvent d'exportation, et les petits exploitants qui, lorsqu'ils ont accès aux marchés, ont un très faible pouvoir de négociation sur ceux-ci, auprès de leurs « clients » mais aussi comparativement aux producteurs plus « intégrés ».
Autrement dit, la multiplication des IDE peut, dans les pays en développement :
- se traduire par l'essor de la production agricole par l'apport de capital dont ils sont la manifestation et le support ;
- mais avec des effets ambigus si la production ne profite ni aux consommateurs locaux, aux agriculteurs concernés, perspective d'autant plus redoutée qu'ils accroissent la segmentation de la production locale.
Dans ce processus, la hausse du prix des terres tout comme la sélection par des investisseurs dotés de moyens financiers supérieurs aux opérateurs locaux des meilleures surfaces ne sont que deux des canaux par lesquels les IDE peuvent agir comme un facteur destabilisant.
À cet égard, le Centre d'études et de prospectives (CEP) du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche distingue entre les grands investissements dans l'agriculture industrielle aux effets incertains, selon les effets durables du revenu qu'ils exercent sur les populations locales et les projets concertés avec ces populations qui, pour pourvoir porter sur des exploitations relativement importantes, impliquent plus systématiquement une association des producteurs locaux. Le CEP relève cependant la dimension essentielle que représente le degré atteint par le pouvoir de négociations des agriculteurs locaux, même dans cette dernière catégorie d'opérations.
Dans ce contexte, le CEP suggère qu'il pourrait y avoir une justification à mieux réguler les IDE dans le foncier agricole.
|
Voies pour une meilleure régulation des
cessions internationales Les contrats liés aux investissements fonciers pourraient comporter une clause prioritaire d'approvisionnement des marchés locaux en cas de crise alimentaire. Cette suggestion suppose que le foncier ainsi approprié soit destiné à la production alimentaire ce qui ne va pas de soi quand on observe l'importance relative des surfaces dédiées à des productions industrielles ou énergétiques. Elle pose à l'évidence le problème de sa conciliation avec les intérêts poursuivis par les investisseurs sans compter les difficultés juridiques de tous ordres de ce type de clause. Des accords volontaires liant les États et les investisseurs sont préconisés par la Banque mondiale, la FAO, l'IFAD ou la CNUCED pour inciter les opérateurs à entrer dans les démarches de responsabilité sociale (et environnementales). On connaît les limites de cette démarche juridique, innovante, mais très inégalement contraignante. La sanction de l'inexécution des obligations - qu'il faudrait d'ailleurs pouvoir adapter à chaque situation ou presque - peut être difficile à obtenir en dehors des procédures informelles de stigmatisation. Or, il n'est pas sûr qu'elles aient une pleine efficacité s'agissant d'un secteur où les intervenants ne sont pas nécessairement exposés au verdict de la crédibilité. |
Il n'empêche que l'on pourrait confier, au-delà des responsabilités que prennent, souvent les ONG du domaine, une mission de magistère aux organisations internationales les mieux à même de contrôler les effets des cessions foncières internationales sur le développement agricole des pays d'accueil.
Sur ce point, l'aide bilatérale offerte par des pays comme la France à la constitution de cadastres et à l'élaboration de lois foncières est souvent citée comme particulièrement stratégique.
La question des conflits d'usage se pose tout particulièrement avec les perspectives de voir se développer la production d'agro-carburants.
Cette problématique qui est susceptible de modifier très substantiellement le diagnostic posé sur les réserves foncières mobilisables pour la production alimentaire qui sera nécessaire pour combler les besoins est traitée dans la partie du présent rapport consacrée aux interdépendances entre l'agriculture et l'énergie.
C'est à la question de l'artificialisation des terres qu'on consacre les quelques développements qui suivent.
B. LA QUESTION DE LA RARÉFACTION DES TERRES AGRICOLES : LE CAS FRANÇAIS
La proportion du territoire métropolitain occupée par l'agriculture a connu une chute spectaculaire depuis 1950 qui s'est toutefois ralentie au cours du temps.
Elle s'élevait à 72 % du territoire en 1970, et n'est plus que de 54 % en 2009.
De 1960 à 2007, la France a perdu 5,1 millions d'hectares de terres agricoles, soit 14,8 % de la superficie initiale.
Ce phénomène n'est pas propre à la France puisqu'en Europe (à 22) 30 millions d'hectares ont été « perdus » entre 1961 et 2003 (770 000 hectares par an) seules l'Espagne et la Belgique ayant vu s'accroître leur surface agricole.
Le ralentissement de la déprise agricole entre 1970 et 2009 par rapport au rythme atteint entre 1950 et 1970 doit être nuancé. Dans la dernière décennie, la pression sur le foncier due à l'artificialisation des sols s'est accélérée. Entre 1992 et 2003 les sols artificialisés ont gagné 61 000 hectares par an, ce qui correspond à l'absorption d'un département tous les dix ans, mais depuis 2006, la progression atteint 86 000 hectares (soit un département tous les sept ans).
À ce rythme, en 2050, la surface agricole naturelle reculerait de 3,4 millions d'hectares, soit 12 % de la surface occupée actuellement par les exploitations (20 % des terres arables) et même un pourcentage supérieur en termes de potentiel agricole.
En effet, les surfaces concernées sont souvent les plus productives agronomiquement ; les sols de très bonne qualité agronomique représentent déjà un tiers des surfaces artificialisées.
Et par ailleurs, il devrait s'agir des terres les mieux dotées en réserves utiles en eau.
Pour mieux apprécier ces perspectives une première précision doit être apportée sur l'origine du recul de la surface agricole. Il faut distinguer ici l'abandon et l'artificialisation même si les deux processus peuvent résulter de facteurs partiellement communs.
L'abandon de terres agricoles se manifeste par la conversion de terres auparavant exploitées en friches ou en forêts.
Il peut correspondre à la marginalisation économique de l'activité agricole, qu'elle soit globale ou concerne plus directement les terres impliquées. Des phénomènes démographiques peuvent intervenir aussi de façon plus ou moins autonomes.
Ces motifs diffèrent de ceux qui déterminent l'artificialisation des sols agricoles même s'il existe des zones intermédiaires où l'abandon précède l'artificialisation.
Dans ces conditions, les politiques à entreprendre si l'on souhaite lutter contre les deux phénomènes peuvent différer malgré l'existence de traits communs.
La répartition des deux processus est discutée.
Pour ce qui est de l'artificialisation, le chiffre de 66 000 hectares par an semble assez robuste. Il correspond globalement aux flux de ventes observés dans les opérations qui motivent l'artificialisation des terres (42 000 hectares à quoi s'ajoutent 20 000 hectares pour l'espace résidentiel et de terres non bâties)29(*).
Pour les abandons de terres, les estimations varient entre 101 000 ha/an et 49 000 ha, si l'on défalque les abandons constatés en zones urbaines, supposés dictés par des projets d'artificialisation.
L'idée générale qui se dégage de ces phénomènes est qu'alors que la crainte portait essentiellement sur la perspective d'un retour à la friche de la surface agricole française, ce sont aujourd'hui les concurrences dans les usages économiques des terres qui jouent le plus sur leur destination.
Dans cette perspective, on souligne en particulier les effets de la diffusion du modèle de « maison individuelle sur 1 100 m2 ».
Dans l'avenir, la pression démographique pourrait s'accompagner d'une perte de 1 225 000 d'hectares (période 2000-2020) à la condition toutefois que le « coefficient de la ressource en sol » diminue de 40 % (pour l'Union européenne à 22, la perte serait alors de 5,7 millions d'hectares). Une stabilisation de ce coefficient augmenterait d'autant les pertes liées à l'artificialisation des sols qui pourraient atteindre de l'ordre de 84 000 hectares par an (soit les 3,4 millions d'hectares déjà mentionnés).
IV. L'IRRIGATION SERA-T-ELLE UNE SOLUTION ?
À défaut de disposer de surfaces naturellement arrosées, la question se pose du potentiel de surfaces qui pourrait receler une bonification par irrigation.
Si les terres irriguées ont augmenté de l'ordre de 50 millions d'hectares par décennie dans les trente dernières années, les progrès pourraient n'être plus que de 15 à 30 millions d'ha tous les dix ans à l'horizon 2025 et, en 2030, 60 % du potentiel pourrait avoir été mobilisé, selon la FAO (soit au total de 550 à 600 millions d'hectares) avec pour principale limite la disponibilité de l'eau.
Au total, deux scénarios de mobilisation de l'eau disponible, avec un passage de 40 à 50 ou à 60 % du potentiel, sont envisageables.
Leurs résultats sont les suivants à la fois en termes d'accroissement des surfaces irriguées et d'accroissement de la production agricole.
Les chiffres des deux dernières lignes présentent des bornes constituées, l'une sous l'hypothèse d'une irrigation complète, l'autre sous celui d'une irrigation d'appoint moins consommatrice.
LES POTENTIALITÉS EN IRRIGATION PAR GRANDE RÉGION DU MONDE
Source : « Nourrir la planète » Michel Griffon
Au total, l'accroissement des surfaces irriguées pourraient atteindre entre 44 et 85 millions d'hectares à l'horizon 2030.
Ces données peuvent être mises en perspective avec les besoins de terres supplémentaires en 2050 dont les estimations oscillent entre 128 et 590 millions d'hectares et qui, prises globalement, semblent pouvoir être satisfaits par les terres pluviales.
Mais c'est à un niveau plus fin qu'il convient de détailler et les besoins et les possibilités d'irrigation.
Les résultats de la confrontation entre potentialités offertes par les surfaces irriguées et la couverture des besoins de production varient selon les régions.
Pour la Chine, les surfaces irriguées sont passées en 30 ans de 30 à 55 millions de km3. En 2025 on atteindrait entre 50 et 160 km3 supplémentaires.
Ceci permettrait d'accroître la production de 15 à 25 % de la récolte annuelle de céréales en 2000 soit moins que le doublement nécessaire.
L'Inde a programmé un nouveau réseau de 30 canaux reliant des fleuves les uns aux autres pour irriguer 34 millions d'hectares supplémentaires. Le sous-continent indien reçoit environ 2 000 km3 de pluies qui permettent d'irriguer 58 millions d'hectares contre 25 millions d'hectares il y a 30 ans.
Les capacités de stockage pourraient beaucoup augmenter en 30 ans, passant de 232 km3 à un volume allant de 278 à 367 km3, soit une augmentation de 20 à près de 60 % selon les hypothèses. Ces réserves nouvelles réparties sur l'ensemble du territoire permettraient d'irriguer de 5 à 25 millions d'hectares selon les formes d'irrigation, et produire de 25 à 100 millions de tonnes d'équivalent céréales, soit de l'ordre de 10 % de la récolte annuelle de produits de base.
Ce supplément serait pourtant très insuffisant pour faire face au doublement des besoins en 2030.
Pour le Pakistan, qui doit presque quadrupler sa production en 2050, et le Bangladesh, qui doit la multiplier par plus de 6, le rythme d'accroissement de production attendu par l'irrigation est tout à fait insuffisant pour faire face aux besoins de 2050.
Pour le reste de l'Asie de l'Est et du Sud-Est, le stress hydrique est moins contraignant. Mais, au total, l'ensemble paraît devoir rester en deçà des besoins alimentaires qui devraient presque tripler.
En Amérique latine, la situation est plus favorable qu'en Asie.
Au total, la surface irriguée atteint seulement 8,5 millions d'hectares, et les réservoirs stockent 364 km3. Les prévisions pour 2025 vont de 397 à 426 km3 de stockage, soit un accroissement de 33 à 62 km3.
Ces accroissements permettraient d'irriguer de 2 à 8 millions d'hectares et de produire 10 à 30 millions de tonnes d'équivalent céréales supplémentaires. Ces accroissements de production sont des contributions complémentaires ou intervenant en substitution à ceux que permet l'agriculture pluviale.
L'ensemble permet sans difficulté de faire face au doublement des besoins alimentaires.
En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, la faiblesse des pluies a poussé les États à réaliser des barrages depuis très longtemps. Les surfaces irriguées sont passées de 11 à 25 millions d'hectares en 30 ans. Le stockage de l'eau atteint 317 km3 dont l'essentiel se trouve sur le Nil (146 km3) et en Turquie (139 km3). Cette capacité serait étendue à un niveau compris entre 345 et 400 km3, avec un accroissement essentiellement en Turquie (de 18 à 58 km3). Ces ressources nouvelles permettraient à l'horizon 2025 de réaliser une irrigation allant de 1 à 6 millions d'hectares supplémentaires pour une production de 4 à 24 millions de tonnes d'équivalent céréales. Pour les autres pays que l'Égypte et la Turquie, les capacités de production ne pourront pas s'accroître beaucoup, alors qu'en moyenne il faudrait doubler la quantité de nourriture en calories en Afrique du Nord et tripler au Moyen-Orient.
L'eau ne permettra donc pas à cette région d'améliorer son taux de couverture des besoins alimentaires car l'accroissement des capacités d'irrigation restera inférieur à l'accroissement des besoins, l'Égypte (sous des conditions géopolitiques) et la Turquie tirent mieux que les autres pays leur épingle du jeu.
En Afrique subsaharienne, l'irrigation est peu développée. Elle est passée en 30 ans de 3 à 5 millions d'hectares, et depuis 10 ans ce chiffre n'a presque pas augmenté. Les potentialités de stockage de l'eau sont encore très importantes car peu utilisées. À l'horizon 2025, le stockage atteindrait entre 400 et 424 km3, soit de 50 à 74 km3 supplémentaires permettant d'irriguer de 3 à 6 millions d'hectares et de produire de 15 à 25 millions de tonnes d'équivalent céréales supplémentaires. Il ne s'agit-là que de 10 à 15 % de l'accroissement de production nécessaire à l'horizon 2025.
Ce rythme serait aussi très insuffisant pour que l'irrigation ait une contribution significative à l'horizon 2050.
Les besoins alimentaires nouveaux dans les pays en développement seraient les suivants :
|
Asie |
Amérique latine |
Afrique du nord, Moyen-Orient |
Afrique sub-saharienne |
|
|
Coefficient multiplicateur des besoins alimentaires 2050/2000 |
2,34 |
1,42 |
environ 2,5 |
5,14 |
|
Idem modèle Image |
1,9 à 2,1 |
2,7 à 3,4 |
3 à 3,1 |
3,4 à 3,8 |
|
Production 2000 (109 t)8 |
1 700 |
274 |
154 |
260 |
|
Consommation 2000 (109 t)9 |
1 770 |
260 |
220 |
262 |
|
Production nécessaire en 2050 arrondie (109 t) |
4 140 |
370 |
550 |
1 340 |
|
Différence 2050/2000 |
2 440 |
98 |
396 |
1 080 |
La confrontation de ces besoins et des capacités de production supplémentaires offertes par une irrigation poussée à son terme fait ressortir les déficits de l'Asie, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. L'Afrique sub-saharienne pourrait être autosuffisante et l'Amérique du Sud serait exportatrice. Mais ce serait aussi le cas d'autres régions du monde : l'Australie (sous réserves) et l'Amérique du Nord.
Compte tenu des contraintes de réalisation des programmes d'irrigation, les capacités des régions d'exportations peuvent être a priori considérées comme de bonnes nouvelles.
* *
*
En conclusion, si l'on s'en tient aux capacités de production en agriculture pluviale, sur les trois continents qui vont connaître une forte progression démographique, le premier, l'Asie, devra à coup sûr importer des aliments, le deuxième, l'Amérique du Sud, pourra à coup sûr en exporter massivement, et pour le troisième, l'Afrique, les avenir possibles sont indéterminés. Il y existe bien des capacités régionales de production importantes, mais leur mobilisation suppose de lever des obstacles socio-économiques qui paraissent extrêmement résistants tandis que, dans ces zones, l'accroissement des rendements qui est nécessaire est si important qu'il peut apparaître comme hors de portée.
CHAPITRE
II :
QUELLES PERSPECTIVES
POUR LES RENDEMENTS AGRICOLES ?
Les prospectives agricoles accordent généralement un rôle majeur aux rendements pour élever le niveau de la production aux seuils nécessaires à la résolution de l'équation quantitative entre la demande et les ressources.
En cela elles ne font que prolonger les tendances du passé qui ont vu la progression des rendements expliquer l'essentiel de l'augmentation de la production agricole.
La FAO estime que dans les 30 ans à venir l'augmentation de la production viendra pour les 2/3 de l'augmentation des rendements et pour 1/3 de celle des surfaces.
En Asie, il faudrait, en Chine, augmenter les rendements de 50 à 65 %, en Inde les tripler (idem au Pakistan) ; en Indochine les tripler aussi et en Indonésie les doubler.
En Afrique du Nord, il faudrait doubler les rendements des cultures irriguées et les accroître de moitié dans les zones sèches.
En Afrique subsaharienne, l'accroissement des surfaces à rendement inchangé suffirait à peine en 2050 à faire face aux besoins. Pour conserver les ressources en forêt et ménager l'environnement, il faudra doubler ou tripler les rendements.
Dans l'Afrique des hautes terres (Est), il faudrait au moins multiplier les rendements par 5 à 8, ce que l'on a de la peine à imaginer. Dans les autres régions, comme les régions sahéliennes ou le Nigéria, ils devraient être multipliés par 3 à 6.
En Amérique centrale et dans les Caraïbes, l'ampleur des besoins alimentaires obligera en moyenne à tripler les rendements.
Toutefois, la contribution future des rendements à la résolution de l'équation alimentaire n'est pas sans soulever des discussions.
On remarque que la croissance des rendements s'essouffle en plusieurs points du globe.
Ces constatations appellent des analyses systématiques. Peut-être doivent-elles être comprises en fonction d'une grande distinction dont il faut faire état d'emblée.
Théoriquement, la croissance de la production agricole est tributaire d'une augmentation du potentiel et (ou) de la réduction des écarts entre les rendements observés et ce potentiel30(*).
Chacun de ces objectifs est plus ou moins fiable et chacun a un coût propre. Ce n'est pas la même chose d'élever le potentiel de production et de combler un retard par rapport à un potentiel.
Ces différences doivent être prises en considération au stade de la conception des politiques de développement agricole. Par ailleurs, elles jouent un rôle pour préciser les prospectives envisageables de l'équilibre alimentaire dans le monde.
Les pays « à la frontière technologique » sont aujourd'hui ceux qui dominent les marchés agricoles mondiaux tant par les capacités de production que par les positions concurrentielles qu'offre l'avance technologique. Ce sont souvent (pas toujours) les pays exportateurs.
Plus généralement, les perspectives d'évolution du potentiel comptent :
- pour apprécier la contribution potentielle des producteurs à la satisfaction d'une demande en expansion ;
- et pour estimer la compétitivité relative des productions agricoles.
Mais cette dernière est tributaire des progrès réalisés par les pays en retard, compte tenu des coûts du rattrapage.
Or, l'étude de Fisher et al sur les perspectives des rendements semble établir que l'augmentation du potentiel pourrait se faire à l'avenir à coûts fortement croissants dans le futur.
Dans ces conditions, les pays à la frontière technologique ne pourraient pas suivre le rythme d'expansion de la demande alimentaire et les coûts marginaux de leur production s'alourdiraient. Cette dernière situation confère aux prix agricoles à venir un rôle déterminant pour la contribution à l'équilibre alimentaire que pourraient apporter ces pays en même temps qu'elle peut impacter les prix alimentaires dans le futur si d'autres producteurs n'interviennent pas sur les marchés.
En bref, dans l'hypothèse où le potentiel des pays à la frontière technologique ne pourrait pas être aisément élevé - qui semble une observation assez consensuelle -, il faudrait compter sur le comblement du retard des pays éloignés de leur potentiel. Cette considération plaide puissamment pour la mise en oeuvre de tous les moyens nécessaires au rattrapage agricole des pays en retard de développement. Elle trouve son pendant dans les appels à accroître l'investissement dans le secteur agricole, de ces pays notamment, celui-ci étant entendu dans un sens assez large puisqu'il comprend les investissements dans l'exploitation mais aussi dans son environnement.
Mais alors l'attention doit se porter sur les conditions de cet investissement.
Avant de les envisager, il convient de peser les termes d'un débat omniprésent : celui portant sur l'arbitrage entre l'extension des terres et les rendements.
I. LA QUERELLE DE LA COMBINAISON PRODUCTIVE : Y-A-T-IL UNE ALTERNATIVE ENTRE TERRES OU RENDEMENTS ?
A. UNE QUESTION THÉORIQUE PLUS COMPLEXE QU'ON NE LE PRÉSENTE SOUVENT...
À quel type d'investissement agricole doit-on procéder ?
La question est souvent vue à travers l'alternative entre l'intensification de la production par hectare (l'élévation des rendements) et des orientations où l'on procéderait plutôt par la mobilisation des terres et qui correspondent à l'extensification de la production agricole.
Ainsi, deux modèles de développement agricole s'opposent :
- l'un où la productivité par hectare serait le moyen prioritaire du développement ;
- l'autre où la mobilisation de nouvelles terres, l'extension des sols cultivés, constituerait la réponse au défi de l'augmentation de la production agricole.
Cette opposition semble procéder essentiellement de considérations écologiques et agronomiques et est présentée comme ayant une portée normative ou, du moins, constituant un cadre d'action.
Les partisans de la première solution revendiquent la préservation des terres et sa contribution environnementale : lutte contre l'effet de serre, maintien de la biodiversité... L'emblème de cette position pourrait être la forêt amazonienne.
L'extensification des terres, de son côté, se recommande de l'évitement des nuisances liées aux process de l'agriculture « productiviste », et son horizon est celui de l'intégrité des milieux (sols, ressources en eau...).
Ces questions sont évidemment importantes et doivent être pleinement prises en compte. Pourtant, il est certain qu'une approche pertinente du sujet oblige à dépasser les propos globalisants pour se tenir au plus près de réalités qui sont diverses et nuancées.
Le bilan des coûts environnementaux de chaque modèle devrait être clarifié ce qui peut supposer souvent de le resituer dans des contextes très locaux. Il va de soi que dans la plupart des pays les moyens de cette clarification manquent en fait si bien qu'à ce stade la « querelle » est essentiellement théorique.
B. ... DONT LES DIFFICULTÉS S'ACCROISSENT QUAND ON LA MET EN PERSPECTIVE
De surcroît, une perspective dynamique paraît s'imposer pour établir ce bilan ce qui complexifie encore le problème.
À cet égard, deux variables au moins paraissent devoir être particulièrement prises en compte :
les changements prévisibles des conditions naturelles ;
les innovations technologiques.
Les scénarios de modification des conditions naturelles du développement agricole amènent à élargir le questionnement sur les effets des modes de production agricole sur l'environnement en portant plus d'attention à certains de ces effets considérés comme les plus critiques (effet de serre, dégradation des sols et des ressources en eau..), mais aussi en anticipant les rétroactions des modifications de la biosphère sur la production agricole elle-même.
Cette compréhension large des phénomènes appelle une mobilisation des moyens accordés non seulement aux études qu'elle implique mais encore à leur transformation en guides d'action. De ce point de vue aussi, une institutionnalisation performante s'impose. Elle manque aujourd'hui.
Quant aux innovations technologiques, elles appellent, elles aussi, la combinaison d'un effort de recherche le plus ouvert possible et d'une organisation des choix dont on sait qu'ils ne doivent être confisqués par personne sauf à accepter de naviguer à vue entre les positions, nécessairement irréconciliables des groupes de pression.
Dans un domaine à externalités fortes, s'il n'est pas légitime que les intérêts du complexe « techno-productif » s'imposent sans autre examen, il ne l'est pas davantage que les « socio-affects » bloquent le progrès. La démocratie, enrichie par les procédures de délibération le plus pleinement informées et « informantes » possible, doit prévaloir, problématique qui, pour n'être pas propre à l'agriculture, doit être reconnue comme particulièrement digne d'attention dans cette activité.
Ces considérations doivent avoir à l'avenir des prolongements pratiques tant en France qu'au niveau international où manque un système de pilotage des innovations technologiques les plus lourdes d'enjeux alors même que les effets des innovations sont mondiaux.
Par ailleurs, la formalisation des choix du modèle agricole doit prendre pleinement en compte les dimensions socio-économiques de ces choix.
S'agissant de l'alternative « rendements/extension des surfaces » la seule considération des questions techniques est trop étroite et ne suffit pas.
Une fois dit qu'à l'échelle planétaire les objectifs d'élévation et la production agricole peuvent être atteints moyennant des combinaisons « terres-capital technique » diversifiées, l'observation plus locale conduit à nuancer le propos. Dans certaines régions, les terres sont déjà saturées ; dans d'autres, les perspectives d'une augmentation de la production par engagement de capitaux supplémentaires ressortent comme très incertaines.
Par ailleurs, la composante environnementale, sous l'angle de la durabilité mais aussi des risques, doit être vue comme un élément à part entière, de ces conditions techniques (à côté de l'innovation ou de la disponibilité effective de sols raisonnablement cultivables...).
Idéalement, la combinaison terre/capital technique devrait être construite à partir d'une évaluation complète des coûts et des risques, ce qui implique d'estimer les consommations du capital naturel associées à la mobilisation de chacun de ces facteurs productifs et d'intégrer des hypothèses de risques environnementaux.
On conçoit que l'entreprise n'est pas simple du fait des problèmes de délimitations des nuisances et de scénarisation des risques. Il est dès lors possible de douter de l'efficacité d'estimations tendant à une complète précision scientifique.
Il n'en reste pas moins que, localement, l'aversion à certains risques peut jouer un rôle non-négligeable dès le choix de la combinaison productive et contribuer à définir plus globalement les stratégies mises en oeuvre.
Mais, la dimension socio-économique des choix du modèle agricole va au-delà de la question des risques par les contraintes logiques qu'elle comporte notamment dans la perspective du présent rapport qui est celle de la mise en oeuvre du droit à l'alimentation.
Autrement dit, votre rapporteur estime que plutôt que d'une démarche essentiellement technique les choix effectués sur ce point doivent procéder d'une approche combinant cette dimension et les composantes socio-économiques du développement.
À cet égard, les questions démographiques doivent être considérées avec d'autres problèmes aigus comme le financement, l'assurance, la formation...
Les contraintes de financement des différentes catégories de combinaisons productives peuvent n'être pas toujours équivalentes si les risques pesant sur ces deux classes d'actif diffèrent et si, du fait des conditions de marché, les coûts actualisés de leur mise en oeuvre ne sont pas égaux.
Par ailleurs, les rendements des deux facteurs peuvent différer offrant des perspectives de rémunération dissemblables. L'intensité capitalistique et les rendements semblent corrélés mais, d'un autre côté, les rendements d'échelle positifs paraissent jouer en agriculture comme dans d'autres activités, malgré quelques particularités.
En bref, on oscille entre deux modèles, l'un avec beaucoup de capital par hectare, l'autre avec beaucoup d'hectares par unité de capital. C'est dans ce cadre théorique qu'il faut déterminer une taille optimale d'exploitation ou (et) du parc capitalistique accessible tout en tenant compte des spécificités locales et des particularités des productions agricoles.
C. UNE QUESTION EN PARTIE VIDE DE PORTÉE ?
L'opposition doctrinale entre agriculture « de rendement » et extensification, pour importante qu'elle soit, pourrait être largement indifférente, en pratique, au regard de l'objectif d'augmentation de la productivité.
En effet, il semble que l'augmentation de la production implique une augmentation des rendements quelque soit le scénario de mobilisation des terres :
- en cas d'économie sur les terres, parce que la hausse des rendements est alors sans discussion possible une condition physique de l'augmentation de la production ;
- en cas d'extensification notamment, parce que l'amortissement économique des terres suppose globalement que la productivité par actif augmente, augmentation nécessaire au maintien des agriculteurs sur les terres en tant que condition économique de ce maintien, sauf à accepter une pauvreté persistante du monde agricole.
Ainsi, même dans un scénario recourant à davantage de terres, les rendements devraient augmenter, tout particulièrement dans les régions du monde où la productivité de l'agriculture est en retard.
On peut ainsi se demander s'il existe bien une alternative entre extension des surfaces cultivées et croissance des rendements ou, au contraire, si ces deux processus ne sont pas intrinsèquement complémentaires.
Sans doute des modèles agricoles « à succès » coexistent avec des niveaux de rendement inégaux. Il existe ainsi des marges mais dans de très nombreux systèmes agricoles dans le monde l'exploitation de nouvelles terres paraît être conditionnée à une élévation des rendements.
Il faut ajouter une ultime observation. En l'état, la portée pratique de cette opposition de vues risque fort d'être assez « résiduelle ».
En premier lieu, le problème principal est celui de l'investissement agricole avant d'être celui de son contenu.
En second lieu, les forces économiques et sociales à l'oeuvre dans l'agriculture mondiale laissent présager en pratique la combinaison des deux processus sous l'effet de l'implication grandissante des agriculteurs en situation d'optimiser leurs choix ou, à l'inverse, un processus avec contraction des terres et parallèlement, un plafonnement des rendements.
II. DES RENDEMENTS DONT LA PROGRESSION S'ESSOUFFLE ?
L'essor de la production agricole dans le passé est venu principalement de la progression des rendements et la plupart des prospectives lui accorde, pour l'avenir, un rôle majeur.
Toutefois, la croissance des rendements pourrait considérablement ralentir de sorte que cette variable pourrait ne pas suffire à combler l'augmentation des besoins.
A. D'UNE FORTE PROGRESSION DES RENDEMENTS...
Il paraît établi que la « Révolution verte » a été le déterminant technique (à côté d'autres plus institutionnels) de l'essor de la production agricole observée dans le passé. De fait, celle-ci a davantage procédé de l'augmentation des rendements que de l'extension des terres et, là où la « Révolution verte » n'a pas infusé, la production agricole a beaucoup moins progressé. On avance donc souvent que l'éloignement par rapport à la frontière technologique explique les retards de développement agricole constatés ici ou là.
Pour combler ce retard, il suffirait de se rapprocher de cette frontière. Les productivités agricoles s'élèveraient pour égaliser la meilleure performance possible ce qui, selon certaines appréciations, mais pas pour toutes, suffirait pour atteindre le niveau de production nécessaire à la satisfaction des besoins alimentaires du monde.
Dans le passé, les rendements agricoles ont fortement augmenté.
Par exemple, la production de calories végétales par hectare a doublé entre 1961 et 2000 (de 8 600 kcal/ha/jour en 1961 à 18 700 en 2000).
Toutefois, cette évolution moyenne s'est accompagnée de dynamiques différenciées selon la région considérée.
Au point de départ, les régions du monde étaient regroupées en deux catégories, l'ex-URSS s'intercalant entre elles.
Au bas de l'échelle, les rendements atteignaient 5 000 kcal/ha/jour en Afrique tandis qu'au sommet ils se situaient autour du double (10 000 kcal/ha/jour) en Amérique latine, en Asie et dans la zone OCDE.
Au cours des vingt années suivantes, les rendements ont doublé dans ces deux dernières régions (pour une croissance de seulement 50 % en Amérique latine).
En Afrique subsaharienne et dans « l'ex-URSS », les progrès ont été beaucoup plus incertains alors que la situation de départ était déjà relativement peu favorable.
Seule l'Afrique du Nord-Moyen-Orient a connu un certain décollage. Les rendements y ont également doublé mais comme cette zone était en retard par rapport aux régions les plus avancées, l'écart de rendement, apprécié en termes absolus, entre l'AN-MO et celles-ci s'est accru. Il est passé de 5 à 10 000 kcal/ha/jour.
À partir des années 80, la croissance des rendements a ralenti sauf en Afrique subsaharienne et en Amérique latine où elle a accéléré. Cette dernière région a connu la dynamique la plus continûment forte tandis que dans la zone OCDE les évolutions se sont faites plus chaotiques. On remarque la situation particulière de l'Asie où, dès le milieu des années 80, les rendements dépassent ceux de la zone OCDE.
Mais dans ces deux régions, qui ont réalisé les meilleures performances sur le long terme, les rendements semblent ne plus progresser en fin de période tandis qu'alors l'Amérique latine dépasse à son tour l'OCDE.
B. ... À UN TASSEMENT ?
1. Constats
Au total, si le taux d'accroissement annuel des rendements a été de 2 % entre 1960 et 2000 en moyenne pour le monde (soit un doublement des rendements en quarante années), les performances productives ont été nettement dispersées.
Évolution des rendements alimentaires par région 1961-2000
Source : Agrimonde
M. Michel Griffon y voit le signe d'un essoufflement des résultats de la « Révolution verte » qu'il décrit notamment à partir de quelques analyses locales concernant le Punjab, Java-Ouest ou encore le Mexique.
Évolution du rendement en grain (riz et blé) de 1970 à 1997 (qx/ha)
AU PUNJAB (INDE)
À JAVA-OUEST
Évolution du rendement en blé au Mexique (qx/ha)
Source : « Nourrir la planète » Michel Griffon
Seraient en cause la dégradation des sols avec la montée des phénomènes de salinisation, l'engorgement hydrique des sols en lien avec l'usage gratuit de l'eau, l'augmentation du prix des engrais ou la dévastation plus aisée des monocultures par les nuisibles...
Autrement dit, on assisterait dans des régions assez diversifiées à un plafonnement des rendements agricoles qui signalerait l'épuisement des effets des progrès culturaux, voire un contre-choc subi par un système insoutenable.
2. La hausse des rendements, jusqu'à quel point ?
Or, les prospectives tablent globalement sur une élévation des rendements pour combler, dans le futur, les besoins alimentaires.
Pourtant, les hypothèses de rendement varient significativement et il existe un consensus sur la perspective d'un ralentissement de leur progression.
Dans quatre prospectives importantes, les rendements augmentent de plus de 60 % à l'horizon 2050.
Seule la prospective Agrimonde G1 envisage une progression des rendements inférieure à 10 %. Mais ce scénario n'est compatible avec les besoins de production à venir que sous l'effet d'hypothèses ad hoc (notamment sur les régimes alimentaires) et d'une mobilisation comparativement forte des surfaces cultivables.
Comparaison des hypothèses de gains de
rendement
dans quelques grands exercices de prospective
Augmentation de rendement (en %) par hectare cultivé (incluant l'intensité culturale)
Source : Centre d'études et de prospective Analyse n° 28 - Juin 2011 - Extraits des rapports cités et calculs des auteurs
La gamme des perspectives de rendements apparaît particulièrement large même à l'intérieur de chacune des deux classes de scénarios (soit celle où l'augmentation des rendements est plutôt forte et celle où elle est plutôt faible, qui correspond globalement à la mise en oeuvre d'une « révolution doublement verte »).
Soit le scénario central de la FAO, qui appartient à la première de ces deux classes de scénarios, les rendements (des cultures) y augmentent nettement moins que n'augmentent les rendements (des céréales) dans les hauts de fourchette des autres projections appartenant à la même classe de prospective.
Cette diversité se retrouve dans les exercices de prospective où l'accroissement des rendements est relativement faible.
Toutefois, les prospectives tablent globalement sur la prévision que certaines zones connaîtraient un fort rattrapage (l'Afrique subsaharienne et l'ex-URSS, en particulier) tandis que les rendements pourraient continuer à progresser fortement en Amérique latine.
Ce dernier résultat qui peut sembler étonnant au vu des résultats déjà acquis dans cette région s'explique par la spécialisation culturale qui est la sienne (le maïs) et qui la distingue à la fois de l'Europe (la zone du blé) et de l'Asie (la zone du riz). En effet, la marge de rattrapage par rapport au rendement potentiel du maïs apparaît encore élevée en Amérique latine (en tout cas plus élevée qu'en Europe et en Amérique du Nord).
Cette observation conduit à souligner les liens entre rendements et spécialisations culturales. Ainsi, l'obligation d'augmenter les rendements pourrait s'accompagner d'un renforcement des tendances à la concentration des cultures autour des produits les plus susceptibles de la satisfaire. Cette tendance pourrait poser des problèmes de résilience du système alimentaire mondial.
En tout cas, il y aurait différenciation des perspectives régionales de rendement. Celle-ci peut être illustrée en considérant les différentes hypothèses de l'exercice Agrimonde.
Source : Agrimonde
Une étude de Fischer, Byerlee et Edmeades réalisée dans le cadre de la FAO mentionne quelques estimations de progression des rendements à l'horizon 2050 qui confortent la prospective d'un ralentissement de leur progression.
Dans le passé, les rendements céréaliers ont suivi un rythme linéaire permettant de gagner une production par hectare, à peu près constante chaque année, de 43 kg avec toutefois des performances régionales contrastées.
Mais, cette augmentation régulière s'est accompagnée d'un ralentissement du rythme de croissance qui est passé de 3,2 % dans les années 60 à 1,5 % dans les années 2000.
L'accélération des rendements dans les grands pays en développement n'a pas été homogène mais elle a été un trait marquant de leur agriculture à compter des années 60.
Cependant, la progression des rendements a freiné à partir du milieu des années 80, du moins pour le blé et le riz.
Dans les années 2000, la croissance des rendements du blé et du riz n'a plus dépassé 1 % dans les pays en développement et a laissé place à une stagnation dans les pays développés. Seul le maïs a continué à profiter d'une augmentation soutenue des rendements, tout en subissant une inflexion.
L'extrapolation des tendances passées permet selon une étude de Tweeten et Thompson d'augmenter la production de 1,4 milliard de tonnes, soit un accroissement de 71 %. Ce serait insuffisant pour satisfaire des besoins dont l'augmentation est estimée à 79 %. Ils en déduisent un accroissement des prix de 44 % pour équilibrer le marché. Cette dernière estimation est cependant fragile, en particulier parce qu'elle dépend d'une hypothèse de non extension des terres. Cependant, elle donne un aperçu des tensions que pourrait susciter l'essoufflement des progrès des rendements à l'avenir.
3. La progression des rendements ne devraient plus venir principalement d'une augmentation du potentiel mais d'un rattrapage des pays en retard
L'étude de Fischer et al évalue les écarts de rendement entre les rendements observés et plusieurs critères de référence, l'un technique, le rendement potentiel, qui correspond à la frontière technologique (raffiné pour tenir compte de la limitation des ressources en eau) et, l'autre, plus économique, le rendement atteignable qui tient compte en plus des conditions économiques et se trouve donc à un niveau inferieur à celui du rendement potentiel.
Idéalement, l'écart à combler est celui entre le rendement observé et le rendement potentiel, mais, dans les faits, les contraintes économiques (estimées aux conditions réelles ou dans les conditions de marché efficient) obligent à une moindre ambition qui est de combler l'écart entre le rendement observé et le rendement atteignable.
La simulation des auteurs est enrichie d'analyses visant à déterminer les conditions d'un comblement des écarts de rendement, parmi lesquelles une attention particulière est portée à l'élévation du rendement potentiel lui-même (la frontière technologique) comme susceptible d'avoir des effets favorables sur les performances observées en pratique.
Les auteurs constatent qu'il existe des marges élevées entre les rendements obtenus et les rendements potentiels.
Écarts entre les rendements obtenus et les
rendements potentiels
(en % par rapport au rendement
obtenu)
|
Moyenne |
Éventail |
|
|
Blé |
40 |
25-50 |
|
Riz |
75 |
15-110 |
|
Maïs |
ND |
30-200 |
Par ailleurs, ils soulignent que les progrès du « potentiel » sont modérés, de l'ordre de 0,5 % par an pour le blé et le riz et de 1 % pour le maïs.
Ces progressions sont insuffisantes pour atteindre les taux de croissance de la production nécessaire pour satisfaire la demande en expansion.
Les auteurs en concluent que davantage d'efforts de recherche-développement sont souhaitables tout en laissant transparaître un certain scepticisme sur les effets de cette orientation :
- les coûts de la recherche seront fortement croissants ;
- un assez grand nombre d'options techniques, parmi lesquelles les modifications génétiques pourraient avoir épuisé leur potentiel31(*) ;
- seules les méthodes de sélections culturales apparaissent comme susceptibles de forts gains d'efficience.
Mais, l'essentiel est bien que c'est par la mise à niveau des rendements dans les pays où ils accusent le plus grand retard que pourrait intervenir le supplément de production nécessaire au monde.
TROISIÈME
PARTIE :
UN CONTEXTE NOUVEAU ET INQUIÉTANT
CHAPITRE I :
AGRICULTURE ET ÉNERGIE
L'agriculture est un secteur à la fois consommateur et producteur d'énergie.
Comme consommatrice d'énergie l'agriculture est soumise au défi économique de disponibilité d'une énergie à un prix le plus bas possible et au défi écologique de sa contribution à un modèle énergétique durable qui implique essentiellement le maintien des sources d'énergie et une réduction, plus ou moins totale, des nuisances environnementales, dont les émissions de gaz à effet de serre.
Le développement des agro-énergies offre à la production d'énergie par l'agriculture des perspectives qui pourraient contribuer à relever ces deux défis tout en assurant une diversification de la production agricole et de ses débouchés.
Toutefois, le passage de perspectives théoriques à des réalisations pratiques passe par des conditions dont la nature doit être explicitée mais qui ne peuvent toutes être élucidées.
En outre, la diversification des débouchés agricoles résultant du développement des agro-carburants n'est pas nécessairement une bonne nouvelle alors que l'expansion des besoins alimentaires du monde pourrait déjà se heurter à une offre trop limitée, ou n'être satisfaite qu'au prix d'un renchérissement sévère des prix de l'alimentation.
En bref, les conflits d'usage entre énergie et alimentation pourraient se renforcer ce qui invite à promouvoir une combinaison énergétique économe du potentiel agricole disponible pour satisfaire les besoins alimentaires.
I. UN SECTEUR FORTEMENT CONSOMMATEUR D'ÉNERGIE CONFRONTÉ À UN DOUBLE DÉFI ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
L'agriculture est un secteur fortement consommateur d'énergie, sensible à ce titre aux variations des prix énergétiques. Une agriculture plus sobre permettrait d'atténuer pour le secteur l'effet des tensions exogènes et de leurs incidences sur les prix alimentaires associées aux perspectives de hausse des prix de l'énergie.
Par ailleurs, l'éventualité d'une élévation des coûts de transport doit être prise en considération pour penser le système alimentaire ; elle plaide pour des circuits courts et la limitation du recours aux échanges internationaux.
A. UN SECTEUR À TROP FORT CONTENU ÉNERGÉTIQUE
Une part importante des consommations intermédiaires de l'agriculture est liée à l'énergie qui représenterait (en 2008) en France le quart des consommations intermédiaires agricoles.
Le poste « énergie et lubrifiants »32(*) représente 8,3 % des consommations intermédiaires. Cette part est de 13,1 % pour les engrais et de 21,6 % pour les aliments pour animaux achetés.
La consommation d'énergie directe et indirecte par l'agriculture atteindrait chacune 5,3 Mtep, soit 10,6 Mtep au total, représentant environ 7 % de la consommation énergétique finale de la France.
3,4 Mtep sont constitués par les engrais et amendements dont 2,95 Mtep pour les seuls engrais azotés.
La consommation d'énergie varie selon les types d'exploitation à proportion de la diversité de la structure par postes des consommations intermédiaires de chacune d'entre elles.
La dépendance de l'élevage est particulièrement prononcée mais les consommations d'intrants dépassent encore 30 % de la valeur moyenne de la production des grandes cultures.
On observe également que ces consommations sont très variables au sein d'une même spéculation, ce qui suggère que des marges d'optimisation existent.
La confrontation du poids de l'agriculture dans la consommation d'énergie et de sa part dans la valeur ajoutée nationale conduit souvent à estimer que l'agriculture est un secteur excessivement consommateur d'énergie.
Sans en être nécessairement le résultat mécanique, cette situation peut être favorisée par les incitations plutôt favorables dont bénéficie le secteur en matière de consommation d'énergie.
En l'état, le secteur agricole supporte une fiscalité allégée sur les produits énergétiques qu'il utilise avec des effets importants de soutien du revenu agricole.
Il s'agit, d'une part, d'un taux réduit de 5,66 €/hl (le taux normal est de 42,84 €/hl) de taxe intérieure sur la consommation (TIC) applicable au fioul domestique utilisé comme carburant. Cette mesure a été introduite dans les années 1970 pour encourager la mécanisation.
D'autre part, les agriculteurs sont partiellement remboursés de la même TIC sur les produits énergétiques, à hauteur de 5 €/hl. Cette mesure a été mise en place en 2004 avec la hausse du prix du prix du pétrole. Elle est annuellement prolongée en loi de finances.
Cette détaxation quasi-complète du carburant à usage agricole génèrerait un avantage de l'ordre de 3 000 € par exploitation et par an avec, bien entendu, une assez forte dispersion autour de cette moyenne.
Concernant le gaz naturel, les exploitants agricoles bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) acquittée pour le chauffage de serres (0,71 €/Kwh).
L'industrie de fabrication des engrais minéraux est également exonérée de la TICGN, au titre d'entreprises faisant un « double usage du gaz » (matière première et énergie).
Enfin, la vente de certains engrais à usage agricole et des aliments pour le bétail est soumise à une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % depuis 1966.
B. QUELS LIENS ENTRE PRIX DE L'ÉNERGIE ET PRIX AGRICOLES ?
Quoiqu'il en soit de ces avantages fiscaux, le contenu élevé en énergie des consommations intermédiaires du secteur agricole rend celui-ci vulnérable aux variations du prix du pétrole.
Par exemple, la hausse du prix du pétrole entre 2006 et 2008 a provoqué en France une augmentation de 46 % des prix des carburants, de 62 % pour les engrais et de 38 % pour l'alimentation animale achetée.
Compte tenu des perspectives structurelles des énergies fossiles c'est une question cruciale de savoir si prix de l'énergie et prix des matières premières agricoles sont susceptibles d'évoluer parallèlement.
Dans le passé, la corrélation entre les prix agricoles et du pétrole a été plutôt lâche sur longue période. Toutefois, depuis les années 2000, surtout à partir de 2004, ces prix semblent plus étroitement corrélés.
Évolution des prix des matières premières
On relève que la forte corrélation des prix des matières premières agricoles avec celui du pétrole s'observe dans la phase de hausse de celui-ci, ce qui suggère l'existence de fluctuations asymétriques selon le sens des prix des énergies fossiles.
Quoiqu'il en soit, une corrélation n'est pas une causalité et sur longue période le prix de l'énergie, s'il a pu influencer le prix des produits agricoles, n'a pas exercé d'effets entièrement déterminants.
De même, le resserrement de la corrélation depuis les années 2000 ne peut être attribué sans précaution à l'instauration d'un lien resserré entre prix du pétrole et prix agricoles.
Il n'empêche que plusieurs variables pourraient aller à l'avenir dans ce sens.
Du côté des conditions de l'offre, la variation des coûts de production agricole pourrait être fortement influencée par des hausses importantes du prix du pétrole. Il est, en effet, possible que leurs effets ne soient pas strictement linéaires, autrement dit qu'au-delà d'un certain seuil les prix agricoles régissent davantage aux prix des énergies fossiles.
Par ailleurs, le développement des biocarburants pourrait resserrer considérablement le lien entre prix de l'énergie et prix agricoles.
En effet, la production de biocarburants dépend toutes choses égales par ailleurs de l'écart entre leur prix et celui des produits agricoles.
Or, les premiers dépendent des prix du pétrole. Dès lors, une augmentation du prix du pétrole conduit à résorber l'écart entre le prix des biocarburants et celui des produits agricoles et à rapprocher la production de bioénergies de la situation où celle-ci est rentable.
Au demeurant, si le coût de production de la biomasse utilisée pour produire les biocarburants est inférieur à celui des aliments, le seuil de rentabilité au-delà duquel l'exploitation des surfaces agricoles pour les biocarburants devient justifiée économiquement par rapport à une destination alimentaire peut être rejoint assez vite dans un contexte d'élévation du prix de l'énergie.
|
Prix des énergies fossiles-prix alimentaires Le schéma de propagation des hausses de prix de l'énergie fossile aux prix des produits alimentaires passe par deux canaux : le renchérissement des consommations intermédiaires de l'agriculture induit une augmentation des coûts de production que les producteurs essayent de répercuter dans les prix ; la hausse du prix de l'énergie fossile permet aux produits énergétiques de l'agriculture de concurrence ou les énergies traditionnelles et l'écart entre les prix des bioénergies et des produits alimentaires se réduit à un point tel que les productions de l'agro-énergie sont une alternative profitable par rapport aux productions agro-alimentaires. La réduction de la production alimentaire crée des tensions sur les prix. Celle-ci peut engendrer un mécanisme autorégulateur dès lors que la hausse des prix des produits alimentaires suscite un supplément de production - mais les conditions techniques des exploitations n'en garantissent nullement l'immédiateté du fait d'une certaine inertie des systèmes productifs. |
Là aussi, des phénomènes de rupture peuvent intervenir une fois le seuil de rentabilité de la culture des biocarburants atteint.
Il en résulterait un déplacement de la production agricole des productions alimentaires vers des produits énergétiques, qui pourrait être massif.
La réduction de la production alimentaire qui s'en suivrait, en restreignant l'offre, pourrait provoquer une élévation des prix des produits alimentaires dont l'ampleur est partiellement incertaine mais pourrait être particulièrement élevée à court terme.
Autrement dit, sur une tendance haussière des prix des produits alimentaires la volatilité pourrait augmenter et aggraver sporadiquement les tensions sur les prix.
* *
*
Pour conclure sur ce sujet, plusieurs observations peuvent être avancées.
Globalement, la corrélation entre prix du pétrole et prix agricoles n'apparaît pas linéairement étroite. Elle semble beaucoup plus forte lorsque les prix de l'énergie accélèrent nettement.
Il semble que ce phénomène soit attribuable aux propriétés particulières d'une croissance élevée des prix du pétrole :
- elle a tendance à se diffuser plus généralement dans les économies si bien que les écarts concurrentiels ex ante offrent moins d'occasion de points de résistance par lesquels les producteurs les plus compétitifs peuvent contraindre leurs concurrents à maintenir leurs prix ;
- elle réduit la faisabilité des efforts de marge et contraint les producteurs à répercuter davantage les hausses des coûts de production dans leurs prix ;
- elle pourrait aussi affecter la production alimentaire en favorisant des substitutions entre productions agricoles à destination alimentaire et à destination énergétique.
Ce dernier processus, qui a été incriminé au cours de l'épisode de flambée des prix alimentaires de la fin des années 2000, pourrait devenir structurel et appelle un examen particulier (v. le II du présent chapitre).
Quoi qu'il en soit la perspective d'une accélération des prix de l'énergie résultant d'un épuisement de l'offre pétrolière annonce un équilibre des prix alimentaires marqué par leur augmentation.
La diversification de l'offre énergétique pourrait atténuer cette menace mais, comme elle est tributaire de prix plus élevés et pourrait impliquer la mobilisation d'une partie du potentiel agricole, il ne faut pas attendre de miracle.
Une agriculture plus sobre serait une solution. Les marges de manoeuvre pour y aboutir doivent être systématiquement explorées. Certains pays paraissent plus avancés que le nôtre dans la voie d'une immunisation du secteur agricole contre la dépendance énergétique. La méthanisation est particulièrement développée en Allemagne. Son bilan complet reste toutefois incertain.
Quoi qu'il en soit, la dépendance énergétique de l'agriculture et l'objectif de voir celle-ci réduire sa contribution au réchauffement climatique invitent à inscrire la production agricole mais aussi les échanges dans le cadre d'un objectif d'économie d'énergie. La réhabilitation des circuits courts, trop souvent décriée, ainsi que la limitation du recours aux échanges internationaux comme clef de voûte du système alimentaire mondial sont cohérents avec cet objectif. En bref, la variable énergétique et sa prospective, doivent être pleinement mesurées.
II. UN SECTEUR DE PLUS EN PLUS PRODUCTEUR D'ÉNERGIE : OPPORTUNITÉ OU MENACE ?
Ces dix dernières années ont été marquées par un fort développement des agro-carburants33(*).
Celui-ci a été voulu par les pouvoirs publics - dans plusieurs régions du monde, dont l'Europe - comme un élément important de leur politique énergétique et environnementale mais aussi comme représentant une source nouvelle de revenus pour les agriculteurs.
L'agro-énergie a donc été considérée comme une diversification souhaitable de l'offre agricole. Cependant, cette approche pose problème à l'heure du défi alimentaire.
L'impact du développement des biocarburants sur la sécurité alimentaire passe par l'effet d'éviction qu'il peut exercer sur un usage des terres destiné à satisfaire les besoins de consommation alimentaire.
Cette inquiétude est légitime, mais deux autres effets méritent un examen particulier :
les effets des biocarburants sur les prix de l'énergie et leur incidence sur les prix des productions alimentaires doit être considéré ;
de même, la contribution des biocarburants à la prévention des changements climatiques et, par conséquent, à l'évitement des conséquences qu'ils pourraient avoir sur les équilibres alimentaires ne sauraient être occultés.
A. UNE PRODUCTION D'AGRO-CARBURANTS EN FORTE CROISSANCE
1. Une forte croissance, surtout dans certains pays
|
Les deux filières de biocarburants34(*) Les biocarburants se partagent principalement en deux filières, correspondant aux deux grands types de moteurs à explosion : la filière de l'alcool pour les moteurs à allumage commandé, qui fonctionnent à l'essence, et la filière de l'huile pour les moteurs Diesel à allumage par compression, fonctionnant au gazole. Source : DG Trésor La filière de l'alcool comprend le bioéthanol et l'ETBE. Le bioéthanol est obtenu par fermentation du sucre extrait des plantes, soit directement, à partir de la betterave sucrière en Europe ou de la canne à sucre sous les tropiques, soit indirectement, par transformation de l'amidon contenu dans les graines de céréales. L'ETBE (Ethyl Tertio Butyl Ether) est le résultat d'une réaction chimique entre l'éthanol et l'isobutène, produit dérivé du raffinage du pétrole. L'incorporation de bioéthanol ou d'ETBE dans l'essence présente l'avantage d'augmenter l'indice d'octane du carburant, ce qui diminue le risque d'autoallumage qui abîme le moteur à la longue. La filière de l'huile comprend d'une part, les huiles végétales pures, obtenues en Europe à partir des graines de colza ou de tournesol, et qui peuvent éventuellement être utilisées directement par certains moteurs Diesel dans les pays où cette pratique est autorisée, en Allemagne notamment, et d'autre part, le biogazole ou EMHV (Ester Méthylique d'Huile Végétale), issu d'une réaction chimique de l'huile végétale avec du méthanol, lui-même fabriqué à partir du méthane ou d'autres hydrocarbures. L'EMHV présente des caractéristiques chimiques proches du gazole qui permettent son incorporation dans ce carburant sans difficulté et même avec certains avantages techniques, l'EMHV présentant un pouvoir lubrifiant permettant l'économie d'additifs. Á l'échelle mondiale, la production de biocarburants avoisine 1 % de la consommation mondiale de pétrole dans les transports. La production de bioéthanol, aux trois quarts réalisée aux États-Unis et au Brésil, est dix fois supérieure à celle de biogazole, à 90 % d'origine européenne. L'Allemagne produit à elle seule autant de biodiesel que le reste de l'Europe. |
La production de biocarburants est en plein essor. Elle a plus que quintuplé entre 2000 et 2009.
Évolution 2000-2009 de la production de biocarburants
Source : AIE - RoW reste du monde
En 2009, les biocarburants représentent 3 % des carburants utilisés pour les transports routiers (2 % des carburants mobilisés par l'ensemble des transports).
La production est concentrée aux États-Unis, au Brésil et dans l'Union européenne. C'est aux États-Unis que la production a le plus augmenté suivi par le Brésil alors que seul l'éthanol de ce dernier pays est réellement compétitif par rapport aux sources d'énergie fossile.
2. Des politiques d'encouragement à la production d'agro-carburants
Mais, dans tous les pays considérés des politiques de soutien à la production de biocarburants ont été mises en oeuvre.
Ces politiques emploient des instruments divers. La combinaison d'obligations d'incorporation avec des régimes d'incitation fiscale35(*) est particulièrement employée pour ses propriétés d'optimalité. Les obligations d'incorporation sont en oeuvre dans une cinquantaine de pays dont ceux de l'Union européenne.
Les biocarburants ont été encouragés par des incitations publiques.
Aux États-Unis, la politique fédérale a reposé sur des objectifs nationaux de consommation, sur des subventions au prix à la pompe, et sur des aides directes aux producteurs.
Au Brésil, l'obligation d'incorporer un minimum d'éthanol dans l'essence se combine avec une subvention au prix à la pompe, et des aides à l'achat des véhicules pouvant fonctionner avec de l'éthanol pur ou en mélange (Fuel Flexible).
Dans l'Union européenne, la directive 2003/30/CE du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants a imposé aux États membres une part minimale de biocarburants, en teneur énergétique, dans la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur leur marché : 2 % en 2005 et 5,75 % en 2010.
La directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, cible un taux de 10 % en 2020 pour les transports et de 20 % pour l'ensemble de l'énergie36(*).
En France, l'article 4 de la loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique a prévu des objectifs d'incorporation encore plus ambitieux que les objectifs européens, renforcés par l'article 48 de la loi du 5 janvier 2006 d'orientation agricole : 5,75 % en 2008, 7 % en 2010, 10 % en 2015.
Ce plan repose sur un dispositif fiscal incitatif avec :
une exonération partielle de la taxe intérieure de consommation. Cet avantage fiscal ne bénéficie qu'aux biocarburants issus des unités de production ayant reçu un agrément pour un volume déterminé à travers une procédure d'appels à candidature communautaire37(*) ;
Le montant d'exonération de la TIC a été fixé jusqu'en 2011 par la loi de finances pour 2009. Son objectif étant de compenser les surcoûts, il diminue progressivement avec l'augmentation de la rentabilité des biocarburants.
Par exemple, en 2008, les carburants fossiles étaient soumis en France à une taxe de 42,84 €/hl pour le gazole et 60,69 €/hl pour l'essence sans plomb. Cette taxe s'élevait à 20,44 €/hl pour le biodiesel, et 33,69 €/hl pour le bioéthanol, qui bénéficiaient donc respectivement d'une exonération de 22 €/hl et 27 €/hl.
un supplément à payer au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) par les distributeurs de carburants ne respectant pas les taux d'incorporation ;
une autorisation dès 2006 de l'autoconsommation d'huile végétale pure (HVP) non transformée chimiquement comme carburant agricole. L'HVP est exonérée de la taxe intérieure de consommation ;
depuis le 1er janvier 2007, les HVP peuvent être commercialisées comme carburant agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche38(*).
Les deux premiers outils ont été mis en place pour agir de façon complémentaire. La TGAP doit assurer un développement quantitatif de la filière, permettant ainsi d'atteindre les objectifs établis nationalement, et la défiscalisation vise à compenser les producteurs à raison des surcoûts de production.
Les montants de la défiscalisation accordés aux deux principaux biocarburants de première génération, le biogazole (EMHV) et le bioéthanol sont présentés ci-dessous.
Un rapport effectué par une mission confiée au Conseil Général des Mines, à l'Inspection générale des Finances et au Conseil général du GREF (2005) sur la politique de soutien aux biocarburants, a suggéré que depuis plusieurs années les montants de défiscalisation compensaient les producteurs au-delà des surcoûts de production.
La directive communautaire de 2009 tient compte d'une partie des débats suscités par le développement des énergies renouvelables en imposant des critères de durabilité aux biocarburants.
La production de biocarburants doit respecter des critères de durabilité et la production de biocarburants de deuxième génération doit être opérationnelle en 2020.
Les principaux critères de durabilité à respecter sont les suivants :
- la réduction d'au moins 35 % des émissions de GES en 2010, puis 50 % en 2017 ;
- l'exclusion, pour le calcul des quotas d'incorporation des biocarburants produits sur des terres de grande valeur en terme de biodiversité (forêts primaires, zones protégées, zones de protection d'espèces, prairies à forte biodiversité), ou sur des terres présentant un important stock de carbone ou des tourbières (qui sont donc réputés ne pas respecter le mécanisme mis en place) ;
- les biocarburants (européens) doivent être issus de productions agricoles respectant les règles d'éco-conditionnalité de la PAC ;
- s'agissant des pays tiers, une obligation de provenance « de pays devant avoir ratifié et mis en oeuvre certaines conventions internationales relatives au travail et à l'environnement en relation avec les critères de la directive » est posée ;
- les opérateurs doivent pouvoir justifier de mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, et la restauration des terres dégradées.
La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement prévoit quant à elle que « la production en France des biocarburants est subordonnée à des critères de performances énergétiques et environnementales comprenant en particulier leurs effets sur les sols et la ressource en eau. »
Les opérateurs économiques des différentes filières biocarburants devront démontrer le respect des critères de durabilité et en assurer un contrôle régulier. À défaut, les biocarburants produits ne pourront pas être comptabilisés dans les objectifs, Ils ne pourront pas non plus bénéficier d'aides publiques. Ces critères s'appliquent aux productions nationales comme aux importations, même si, à l'évidence, il peut être malsain d'en contrôler le respect lorsque les pays de provenance de la matière première sont étrangers.
B. UNE VIABILITÉ ÉCONOMIQUE EN QUESTION
1. Aujourd'hui, les agro-carburants dépendent généralement de l'intervention publique
Une étude réalisée par l'OCDE montre qu'en l'état des marchés, en 2004 les coûts de production des biocarburants excédent généralement les prix des carburants fossiles hors taxes, ce qui explique les mesures prises pour en aider la production.
Source : OCDE
Cependant, l'éthanol fabriqué à partir du maïs aux États-Unis peut être produit à des coûts inférieurs aux coûts d'approvisionnements régionaux (CAR) et l'éthanol est compétitif au regard de ce dernier coût mais aussi du prix de l'essence (hors taxes) à la pompe.
L'écart entre les coûts des différentes énergies s'explique principalement par le coût des matières premières utilisées par la consommation d'énergie nécessaire à la production et par les prix des sous-produits de chaque procédé.
Les biocarburants sont vendus moins cher au litre que les carburants pétroliers.
Dans le graphique ci-dessus, les prix sont corrigés pour tenir compte de l'inégale teneur énergétique des produits.
Source : OCDE Groupe de travail des politiques et
marchés agricoles
6 février 2006
Cet avantage de prix vient des régimes fiscaux.
À ce propos, on peut rappeler qu'en 2004, seul l'éthanol brésilien était en mesure de concurrencer l'essence classique sans avantage fiscal39(*). L'avantage du maïs brésilien provient essentiellement du prix de production de la céréale.
Le graphique retrace l'avantage compétitif du Brésil sur le marché des biocarburants qui paraît assez important pour se maintenir longtemps à l'avenir. Il montre aussi que les producteurs européens n'ont pas d'avantages comparatifs sauf à importer les matières premières nécessaires à la production des biocarburants, avec toutefois des perspectives plus favorables pour le biodiesel que pour l'éthanol.
Le seuil de rentabilité économique des biocarburants varie considérablement selon les filières et les pays considérés.
Le graphique ci-après en figure la diversité, aux conditions technologiques du moment et aux cours des matières premières végétales de 2004.
Source : OCDE Groupe de travail des politiques et
marchés agricoles
6 février 2006
Dans les conditions d'alors (prix du baril à 39 dollars), le seuil de viabilité économique n'était atteint que par l'éthanol de canne à sucre brésilien. Ce n'est qu'autour de 100 dollars le baril que la plupart des biocarburants devenaient viables.
2. Demain, les scénarios de prix des énergies fossiles mais aussi les progrès techniques pourront justifier plus largement la production d'agro-carburants
Les perspectives de prix du pétrole de l'Agence internationale de l'énergie conduisent à envisager que le seuil de viabilité des biocarburants puisse être franchi, sous certaines réserves toutefois.
Projection des coûts des biocarburants comparés au prix du carburant pétrolier selon différents scénarios
Source : AIE
Note : la ligne bleue représente le coût du biodiesel conventionnel ; la ligne noire, le prix du carburant pétrolier ; la ligne en vert foncé représente le coût de l'éthanol cellulosique ; la ligne mauve du biodiesel de seconde génération, les lignes en vert clair de l'éthanol conventionnel et de l'éthanol de canne à sucre.
Lge : litre d'équivalent essence
Le scénario pétrolier de l'AIE prévoit une hausse du prix du pétrole de l'ordre de 65 % qui serait presque complètement acquise dès 2030.
À ce niveau de prix un assez grand nombre d'agro-carburants deviendront compétitifs mais à la condition que leurs coûts de production baissent.
Dans cette perspective, l'une des variables majeures réside dans les hypothèses de prix des matières premières agricoles utilisées. Ces hypothèses paraissent dépendre de manière cruciale des progrès réalisés dans le développement des nouveaux agro-carburants. Ceux-ci sont également une variable essentielle pour apprécier les effets d'éviction des biocarburants sur les surfaces agricoles. En particulier, le développement de biocarburants de deuxième génération (voire de troisième génération) est un horizon nécessaire du raisonnement prospectif, même s'il faut s'abstenir de succomber à tout irénisme techno logico-scientifique et préférer un volontarisme réaliste.
|
Les biocarburants, perspectives technologiques Un certain nombre de technologies nouvelles pourraient être développées dans le domaine des biocarburants dont certaines concernent les agro-carburants eux-mêmes. Les biocarburants de deuxième génération, voire de troisième génération, sont regroupés par l'Agence internationale de l'énergie sous la dénomination de « biocarburants avancés » par opposition aux « biocarburants conventionnels » actuellement disponibles. Certaines innovations portent sur les agro-carburants tandis que d'autres en sont indépendantes. Pour le bioéthanol, le progrès technique pourrait consister à utiliser la matière première végétale dans sa totalité à partir de la lignocellulose qui est le principal constituant des parois secondaires des cellules végétales par thermochimie ou par biochimie. La voie thermochimique nécessiterait de réorganiser les investissements en place pour produire la première génération de biocarburants tandis que la voie biochimique pourrait être empruntée avec les infrastructures actuelles. Toutefois, dans les deux cas, des investissements importants devraient intervenir qui viendraient compenser une partie des économies que ces nouvelles techniques semblent promettre du côté des coûts des matières premières végétales utilisées. Pour le biodiesel, plusieurs techniques innovantes sont en phase plus ou moins avancées, la moins invasive pour le potentiel alimentaire étant sans doute celle offerte par les micros algues qui demeure toutefois aujourd'hui à un stade de recherche fondamentale. D'autres carburants et additifs, sans effet notable pour l'alimentation, sont, pour certains, en phase de commercialisation sommaire, comme le méthanol, le bio méthane étant de son côté déjà utilisé à travers la production d'anérobie du bio-gaz en attendant le bio-gaz synthétique. Enfin, les potentialités de l'hydrogène qui sont encore au mieux en phase de démonstration paraissent épargner totalement le potentiel alimentaire. |
L'essor des agro -carburants de deuxième génération se traduirait en soi par une augmentation des matières premières disponibles pour fabriquer des carburants.
En dehors des effets sur les prix de production des agro-carburants qui pourraient être compris dans les proportions figurées dans les graphiques ci-dessus, ces innovations limiteraient l'éviction que pourrait provoquer la production de biocarburants la production alimentaire.
C. QUELS EFFETS SUR LES ÉQUILIBRES ALIMENTAIRES ?
Le développement des biocarburants pose la question essentielle de ses effets sur les équilibres alimentaires.
Est-il susceptible de réduire les quantités produites ? A-t-il des effets inflationnistes sur les prix alimentaires ?
À l'évidence, à technologies inchangées, la théorie oblige à relever que le déclenchement d'un effet d'éviction des produits alimentaires par les cultures énergétiques se traduit par une raréfaction des surfaces exploitées à des fins alimentaires, réduit cette production, et crée des tensions sur les quantités et sur les prix.
Pourtant, les données du problème sont plus complexes.
1. Quels effets sur le prix de l'énergie ?
L'essor de la production de biocarburants est susceptible de limiter les tensions sur les prix de l'énergie.
Si la viabilité économique de la production de biocarburants dépend d'un seuil de prix des énergies fossiles - au demeurant variable selon les filières et les pays d'origine des matières premières impliquées dans les filières -, leurs effets sur les prix de l'énergie sont de nature à en stabiliser la dynamique.
Ce mécanisme est conforme au schéma classique d'équilibre sur les marchés où la confrontation de l'offre et de la demande détermine le niveau et les mouvements des prix.
Or, compte tenu des liens entre l'agriculture et l'énergie et, plus largement, de ceux entre l'énergie et l'alimentation, - qui pourraient se resserrer encore si la sécurité alimentaire devraient être acquise dans le futur par une amplification des échanges internationaux - cet effet de la production de biocarburants peut contribuer à détendre le stress alimentaire.
Cet enjeu, qui contraste avec la crainte de voir les agro-carburants contribuer à une hausse tendancielle des prix alimentaires ainsi qu'à des épisodes plus sporadiques de tension sur les prix, n'est que très partiellement évaluable puisqu'aussi bien il dépend de variables hautement conjecturales.
Parmi celles-ci figurent les perspectives de voir se constituer à l'avenir de nouveaux cartels énergétiques ayant pour but d'augmenter la rente de production dans un monde où la diversité énergétique se réduirait mais aussi d'autres évolutions, plus favorables, elles, comme l'élévation du niveau de l'efficacité énergétique.
Encore faut-il pour valider cette approche que les biocarburants contribuent effectivement à augmenter la disponibilité des ressources énergétiques.
Sur ce point, un rapport présenté par l'ADEME en février 2010 conclut à l'existence d'un apport énergétique net des biocarburants par rapport aux énergies fossiles.
Les graphiques ci-après illustrent ces conclusions pour les éthanols et pour les biodiesels respectivement.
L'effet d'abattement de la consommation d'énergies fossiles est inégal puisqu'il va de 18 % pour l'ETBE de blé à 85 % pour l'éthanol de canne à sucre40(*).
Les résultats relatifs aux rendements énergétiques des biocarburants peuvent aussi être appréhendés en rapportant l'énergie contenue dans le carburant à l'énergie non renouvelable nécessaire à sa production.
Les rendements varient considérablement mais sont positifs (ratio de 1,7 pour les éthanols en consommation directe et de 5,5 pour les éthanols de canne à sucre).
Dans le futur, en fonction de l'équation économique du secteur énergétique, le bilan des biocarburants comme substituts renouvelables à une énergie non renouvelable pourrait s'améliorer.
En effet, le paradoxe, qui voit aujourd'hui l'énergie nécessaire à la production de biocarburants provenir de sources fossiles du fait de leur avantage économique, pourrait s'effacer lorsque la viabilité économique de la filière ne sera plus suspendue à des aides publiques.
Par ailleurs, les scénarios prospectifs à 5 ans montrent des potentiels d'amélioration du rendement énergétique de 10 % pour les biodiesels, conduisant à une valeur moyenne de réduction de 70 %. L'amélioration serait de 15 % pour la filière éthanol, ce qui permettrait d'atteindre une réduction moyenne de 60 % par rapport aux carburants fossiles. Pour les ETBE, les améliorations énergétiques envisagées pourraient permettre d'atteindre des réductions de l'ordre de 26 à 58 %.
Le problème de la contribution des biocarburants à l'indépendance énergétique est plus ardu.
Sans doute peut-on observer qu'actuellement la plupart des matières premières agricoles mobilisées pour les produire sont issus de productions locales.
|
Les biocarburants en France en 2009 En 2009, environ 2,7 millions de tonnes de biocarburants (2 540 ktep) ont été consommées sur le marché français, représentant 6,04 % (en pouvoir énergétique) de la consommation nationale annuelle d'essence et de diesel. Ils se répartissent entre biodiesel (2,1 millions de tonnes, 2 070 ktep) et éthanol (619 milliers de tonnes, 471 ktep). Les biodiesels diffusés en France sont majoritairement issus de colza. Les approvisionnements des unités de production en colza et en tournesol se font prioritairement au niveau local puis au niveau européen. La part d'huile de soja, importée, est toutefois en progression (jusqu'à 25 % des approvisionnements en huile). L'utilisation d'huile de palme importée demeure très marginale. L'éthanol est majoritairement incorporé à l'essence après transformation en ETBE (68 % en masse en 2008). La part d'éthanol incorporé directement, encore marginale, augmente régulièrement depuis 2006. L'approvisionnement des usines d'ETBE est constitué majoritairement d'éthanol produit en France (autour de 70 %). |
Toutefois, la soutenabilité de ce modèle est improbable.
Les productions agricoles nationales nécessaires ne paraissent pas pouvoir résister à la concurrence des productions réalisées dans les pays tiers.
Par ailleurs, à technique constante, les besoins de terres pour produire la quantité de matières premières nécessaires à l'atteinte d'objectifs moyens d'incorporation (10 % des carburants utilisés dans les transports) excéderaient de beaucoup le niveau nécessaire au maintien de la vocation alimentaire de l'agriculture européenne.
Au total, la dimension prospective - sauf changements technologiques - oblige à considérer qu'il existe un choix entre l'indépendance énergétique acquise par les agro-carburants et l'indépendance alimentaire en Europe et en France.
2. Quels effets sur les changements climatiques ?
La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) est l'une des justifications apportées à l'emploi des biocarburants et aux dispositifs de soutien public dont ils bénéficient.
En favorisant la lutte contre le changement climatique à travers la limitation d'une de ses variables explicatives principales, les biocarburants exerceraient des effets favorables sur les équilibres alimentaires dans le futur dont on a indiqué dans quelle mesure ils pourraient être perturbés par le réchauffement climatique.
Apparemment, les biocarburants exerceraient des effets très favorables sur les GES.
Source : ADEME « Analyse du cycle de vie des biocarburants de première génération en France » Février 2010
Pour les éthanols, la baisse des émissions par rapport à la filière fossile va actuellement de 24 à 72 % avec des perspectives favorables. Les réductions sont plus nettes pour les plantes à sucre que pour les céréales du fait de la supériorité des rendements à l'hectare des premières.
Pour les esters, la réduction des émissions est encore plus importante allant de 59 % pour les graines de colza à plus de 91 % pour les esters de graisse animale (EMGA).
On doit relever que les filières les plus performantes au regard de la question des GES sont plutôt celles qui sont développées en dehors de la France.
Une part prépondérante des gains de GES intervient lors de l'utilisation des véhicules comme le montre le graphique ci-dessous.
Source : ADEME « Analyse du cycle de vie des biocarburants de première génération en France » Février 2010
L'abattement de GES par les biocarburants vient de la neutralisation du CO2 émis lors de cette utilisation du fait de son origine biogénique. Autrement dit, le CO2 libéré étant celui que les plantes avaient capté depuis l'atmosphère, est réputé n'ajouter rien aux GES en ne modifiant pas leur bilan global.
Ce n'est que grâce à cet « effet de recyclage » que l'usage des biocarburants est considéré comme favorable, une question étant de savoir si le déstockage de CO2 emprisonné dans les plantes est réellement neutre sur le bilan des GES.
En effet, pour les autres phases, celles de la production de la matière première, de son raffinage, de sa distribution ou de la fabrication d'ETBE, les biocarburants offrent un bilan moins favorable que les carburants fossiles (principalement du fait de la consommation de produits fossiles qu'accompagne chacune de ces phases).
Au total, sous la réserve importante que le bilan en protoxyde d'azote (N2O) des cultures énergétiques est mal appréhendé alors qu'il a un potentiel d'effet de serre trois cents fois supérieur au CO2 les biocarburants paraissent susceptibles de contribuer à réduire les GES.
Mais, un bilan complet des gains de GES apportés par les agro-carburants doit prendre en compte les changements d'affectation des sols (CAS)41(*).
L'analyse des CAS peut distinguer les CAS directs quand une surface (cultivée ou non) est mobilisée pour la culture de plantes destinées aux biocarburants et les CAS indirects résultant de la nécessité de mobiliser une terre nouvelle pour la culture de produits alimentaires auparavant réalisée sur la surface désormais vouée aux biocarburants.
Les changements d'affectation des sols peuvent entraîner des libérations plus ou moins massives de CO2.
Mme Marion Guillou et M. Gérard Matheron indiquent ainsi que la conversion d'un hectare de prairie en terre cultivée pour la fabrication d'un biocarburant de première génération peut libérer, sous certaines conditions climatiques et pédologiques, jusqu'à 300 tonnes de CO2 par hectare, et celle d'un hectare de forêt de 600 à 1 000 tonnes de CO2.
À ce sujet, l'ADEME mentionne des analyses de sensibilité qui ne concerne que trois filières : le soja (brésilien ou américain) la betterave et le colza.
Source : ADEME « Analyse du cycle de
vie des biocarburants
de première génération en
France » Février 2010
La prise en compte des changements d'affectation des sols change l'appréciation des gains de GES résultant des biocarburants.
La filière la plus affectée est celle du soja dont le bilan devient défavorable sauf dans un scénario optimiste. Pour la betterave, seules les hypothèses les plus pessimistes se traduisent par un renversement du bilan des GES tandis que pour le colza le bilan est plus mitigé.
Une bonne partie de l'impact des CAS passe par la mobilisation de surfaces forestières pour assurer les productions alimentaires évincées par le développement de la biomasse à vocation énergétique.
Cet impact ne peut être déduit simplement puisque son évaluation dépend de variables plurielles aux premiers rangs desquelles figurent les hypothèses posées sur le type de surfaces concernées et sur les rendements agricoles (actuels et futurs).
De son côté, le bilan des biocarburants sous l'angle de l'eutrophisation ressort selon l'ADEME comme franchement défavorable.
Source : ADEME « Analyse du cycle de
vie des biocarburants
de première génération en
France » Février 2010
Le potentiel d'eutrophisation est entre deux et dix fois celui des carburants fossiles surtout du fait de l'étape agricole de la filière qui accroît les risques de lessivage des nitrates et, à un moindre degré, de relâchement d'ammoniac. Même dans une hypothèse sans nitrate le bilan demeure largement défavorable par rapport à celui des carburants fossiles.
3. Récapitulatif
a) Vers un grave problème foncier
Les effets négatifs du développement des biocarburants pour la production alimentaire dépendent en premier lieu de l'ampleur de « l'effet d'éviction »42(*) qu'ils peuvent exercer aux dépens des utilisations du foncier destinées à produire des matières premières alimentaires.
Il existe, de ce point de vue, une situation idéale où les terres agricoles mobilisées pour produire des biocarburants seraient systématiquement des terres résiduelles que les producteurs de matières premières alimentaires n'auraient pas utilisées. Dans cette hypothèse, qui laisse ouverts les débats sur les autres conflits d'usage potentiels suscités par l'utilisation de terres à des fins de production énergétique (effets sur le prix du foncier destiné à l'habitation, effets environnementaux...) il n'y aurait, par définition, nul effet d'éviction des bioénergies sur la production alimentaire.
Les prospectives relatives aux besoins de terres que pourraient susciter dans le futur la demande alimentaire et les comparaisons avec les surfaces mobilisables qu'on peut en tirer n'abordent en détail que rarement la question des conflits d'usage avec les surfaces que pourraient mobiliser les productions nécessaires aux agro-carburants.
Le scénario Agrimonde 1, qui est un scénario où l'accroissement de la production agricole provient pour une part significative de la mobilisation de terres, est l'un des rares à inclure une hypothèse d'essor des agro-carburants se distinguant en cela du scénario central construit par la FAO.
Il ne conclut pas à l'existence d'un conflit d'usage irrémédiable.
Pourtant, dans les conditions techniques actuelles des biocarburants de première génération, la couverture de 10 % des besoins en carburants des transports par des biocarburants d'origine locale conduirait à étendre considérablement les superficies consacrées à la culture des végétaux à vocation énergétique43(*).
Dans l'état actuel, seul le Brésil « roule aux biocarburants ». Ils représentaient en 2004 21,6 % des carburants utilisés au Brésil pour les transports contre 1,3 % pour le monde.
La surface agricole employée au Brésil afin de produire les matières premières nécessaires tourne autour de 6 % des surfaces exploitées pour produire des céréales, des oléagineux et des plantes sucrières dans le pays.
Par contraste, pour assurer une proportion de 10 % des carburants utilisés par les transports provenant des productions locales, l'Europe devrait mobiliser 72 % des terres qu'elle exploite à ces fins, les États-Unis 30 % et le Canada 36 %.
Avec quelques approximations, on mesure par là l'effet d'éviction que provoquerait l'atteinte des objectifs d'incorporation de biocarburants tels qu'ils sont généralement formulés, sur la production céréalière, d'oléagineux et de plantes sucrières dans les pays de l'OCDE si ces objectifs devaient être atteints sur la base des seules productions locales.
Ces pays deviendraient des importateurs nets de produits alimentaires. Cette proposition est réversible : s'ils souhaitent atteindre leurs objectifs d'incorporation de biocarburants, il faudra que les pays considérés deviennent des importateurs nets des matières premières agricoles nécessaires à la production de biocarburants44(*).
La simulation montre que le recours à de telles importations limiterait l'augmentation des superficies qui devraient être consacrées à ces matières premières - elles devraient atteindre 9 % des surfaces actuellement cultivées - contre 37 % dans l'hypothèse où l'on opterait pour une autosuffisance région par région mais l'allègement de la contrainte n'empêcherait pas que l'Union européenne doive consacrer une énorme proportion de son potentiel à cette production.
Par ailleurs, il faut bien voir que les différences dans les contraintes de mobilisation des surfaces entre pays sont, pour partie, dues à des niveaux très inégaux de consommation d'énergie par les transports (qui sont nettement plus élevés dans les pays de l'OCDE qu'au Brésil).
Ainsi, dans l'hypothèse, probable, d'une hausse de l'énergie consommée par les transports au Brésil, une augmentation de la proportion des surfaces cultivées à mobiliser pour produire des biocarburants se produirait. Elle se répercuterait sur la proportion des terres affectées dans ce pays, mais aussi dans le monde, à des cultures non-alimentaires qui augmenterait nettement.
Les contraintes particulières qui pèsent sur l'Union européenne viennent principalement des surfaces agricoles disponibles mais également de sa spécialisation dans des cultures utilisées dans la filière biodiesel plutôt que dans l'éthanol. Il existe en effet une forte différence de rendement énergétique par hectare selon les matières premières agricoles.
Ces résultats sont confirmés par les travaux de M. Michel Griffon pour lequel la perspective du « peak oil » annonce une séquence d'augmentation structurelle des prix du pétrole et de besoins de sources énergétiques alternatives.
Parmi celles-ci, la biomasse occupe une place importante dans les scénarios de diversification énergétique, rappelle-t-il indiquant que ces scénarios tablent pour l'ensemble des énergies renouvelables sur un besoin moyen par an compris entre 3,6 et 4,6 Gtep/an45(*) (dont 80 % proviendrait de la biomasse), soit de 3 à 3,7 Gtep/an, besoins pouvant atteindre 5 à 6 Gtep/an en fin de période (2050).
Sur cette base, et en faisant l'hypothèse d'un rendement productif moyen de 5 tep/ha/an, pour produire ce qui est suggéré il faudrait 10 millions de km², soit environ dix fois la surface du territoire français. Mais le coefficient de 5 tep/ha/an quelquefois utilisé constitue sans doute une estimation assez élevée avec les technologies d'aujourd'hui.
Performances de différentes filières issues de la biomasse
|
Plante |
Rendement/ha |
Taux d'extraction |
Rendement |
|
Canne à sucre |
65 à 85 t/ha |
10 % : 7 à 9 t sucre/ha² |
3 à 4 tep/ha/an |
|
Betterave |
70 à 80 t/ha |
13,5 % : 11 t sucre/ha |
5 tep/ha/an |
|
Blé |
7 à 8 t/ha |
5 % : 0,4 t sucre/ha² |
2 tep/ha/an |
|
Cultures spéciales |
10 t mat.sèche/ha |
3 tep/ha/an |
|
|
Colza |
3,2 à 3,4 t/ha |
50 % : 1,6 t huile/ha |
1 tep/ha/an |
|
Palmier à huile |
3 (nat) à 16 t/ha |
10 à 28 % : 3,6 à 4,5 t h/ha |
2 à 3 tep/ha/an |
|
Bois tropique humide |
33 m3/ha |
0,2 tep/m3 |
6,6 tep/ha/an |
Les surfaces agricoles à mobiliser en les décontractant par grande région à partir des scénarios énergétiques mondiaux disponibles en 2003 en découlent.
Sous ces hypothèses, tous les continents sont potentiellement dans une situation où leur espace agricole ne suffit pas pour produire assez d'énergie issue de biomasse, sauf l'Amérique latine et l'Afrique subsaharienne.
Les déficits les plus importants se situent dans les pays du Nord (Amérique du Nord, Europe, Japon, CEI) avec un déficit de 2,5 à 3,4 Gtep, puis vient l'ensemble Asie, Afrique du Nord et Moyen-Orient avec un déficit de 0,6 à 1,1 Gtep. Aussi, pour combler ce déficit, l'Amérique latine et l'Afrique devraient-elles exporter de 3,1 à 4,5 Gtep, ce qui représenterait avec une espérance de rendement de 4 tep/ha une surface de 10 à 11 millions de km², soit la totalité de l'Amazonie et du bassin du Congo.
Hypothèses de production de biomasse
énergétique
et de surface agricole utilisée à
l'horizon 2050
|
Région |
Besoins en énergie min et max (106 tep) |
Besoins en ha |
Rendement |
Déficit |
|
Amérique du Nord et UE |
1 664 à 2 080 |
830 à 1 040 |
2 |
1 330 à 1 770 |
|
Japon |
480 à 600 |
Supposé négligeable |
- |
480 à 600 |
|
Ex-URSS |
1 056 à 1 320 |
1 056 à 1 320 |
1 |
740 à 1 030 |
|
Total Nord |
3 200 à 4 000 |
1 886 à 2 360 |
2 550 à 3 400 |
|
|
Am. Latine |
80 à 176 |
36 |
5 |
0 |
|
AN et |
64 à 140 |
Supposé négligeable |
- |
80 à 176 |
|
Afrique |
152 à 334 |
37 à 85 |
4 |
0 |
|
Inde |
184 à 404 |
60 à 100 |
3 |
150 à 360 |
|
Chine |
192 à 422 |
63 à 140 |
3 |
142 à 374 |
|
Total Sud |
800 à 1 760 |
196 à 361 |
- |
547 à 1 085 |
|
Total monde |
4 000 à 5 760 |
2 082 à 2 721 |
- |
3 097 à 4 485 |
Source : Données de Benjamin Dessus
Dans un scénario au fil de l'eau, les sols ne suffiraient pas à satisfaire l'ensemble des besoins alimentaires et énergétiques.
b) Un facteur autonome de hausse des prix
Globalement, plus la production d'agro-carburants sera forte, plus les prix agricoles seront sous pression. Telle est du moins la leçon des scénarios disponibles.
Elle paraît difficilement récusable. Toutefois, sa portée doit être convenablement appréciée. À cet effet, la question des alternatives est évidemment centrale.
Les effets sur les prix des matières premières agricoles concernées représentent une deuxième préoccupation. Différents scénarios d'évolution de la production de biocarburants ont été simulés par l'OCDE, avec trois scénarios variantiels par rapport à une projection centrale proposée par la FAO et l'OCDE.
un scénario où la production de biocarburants reste à son niveau de départ alors que dans le scénario central de la FAO et de l'OCDE, leur production augmente aux États-Unis et au Brésil ;
un scénario d'atteinte des objectifs qui étaient posés au moment de la réalisation de l'exercice (2004) et, par conséquent, inférieurs à ceux désormais en vigueur ;
un scénario simulant les effets d'un prix du baril de pétrole à 60 dollars.
Les résultats de ces scénarios sont figurés dans les graphiques ci-dessous.
Dans le scénario central, les prix des produits concernés sont globalement stables avec toutefois une tendance haussière pour les oléagineux (contre une stabilité pour les céréales et le sucre blanc).
Des trois scénarios simulés, seul ce premier, qui voit la production de biocarburants légèrement réduite par rapport à la projection centrale, enregistre une baisse, modeste sauf pour le sucre blanc pour lequel elle est forte, des prix.
La baisse des prix est imputable au supplément de disponibilités libérées par une demande plus faible en raison de la moindre production de biocarburants qui est posée en hypothèse de ce scénario.
Les exportations mondiales des États-Unis et du Brésil pour les produits concernés sont supérieures avec toutefois des effets assez modestes sur les prix mondiaux (sauf pour le sucre).
Ces résultats sont tributaires d'hypothèses sur la réduction des besoins de matières premières agricoles du fait d'un niveau de production plus faible au Brésil et aux États-Unis qui, n'étant pas complètement explicités, ne peuvent voir leurs effets sur le surplus exportable entièrement précisés.
En théorie, l'ampleur des ajustements de prix dépend de la baisse de la consommation par l'industrie des biocarburants des matières premières qui lui sont nécessaires. Ces ajustements ne se limitent pas à ces matières premières mais se répercutent sur les prix de la viande et du lait à mesure de l'utilisation qui en est faite dans ces productions.
Il existe toutefois une incertitude liée aux incidences concrètes d'un ajustement à la baisse de la production de biocarburants sur la production des matières premières agricoles.
Dans la simulation, on estime que la réduction de la demande de produits agricoles qui l'accompagne n'impacte pas la production ce qui revient à estimer que le niveau de la production agricole est insensible à la composante de la demande attribuable aux biocarburants.
Autrement dit, la baisse de la demande des industriels est sans effet sur la production agricole.
Cette hypothèse est une hypothèse lourde dont il faut remarquer qu'elle tranche avec l'hypothèse posée sur le compartiment strictement alimentaire de la demande de produits agricoles.
Pour celui-ci, la stabilité des prix décrite dans la projection centrale de la FAO et de l'OCDE témoigne que la production suit le rythme de croissance de la demande alors que la demande de produits agricoles pour fabriquer des biocarburants entraîne une élévation des prix.
La fragilité de cette hypothèse - pourquoi choisir deux régimes d'élasticité de l'offre et des prix différents selon la destination de la demande ? - rejaillit dans une certaine mesure sur les résultats des deux autres scénarios où la production de biocarburants augmenterait soit (à prix des carburants fossiles inchangés) pour atteindre les objectifs (modestes) d'incorporation alors en vigueur, soit en réponse à une hausse des prix des carburants traditionnels.
Dans le premier de ces deux scénarios, la demande supplémentaire de matières premières augmenterait par rapport au scénario de statu quo dans les conditions figurées ci-dessous.
Ce scénario ne diffère pas beaucoup du scénario de statu quo pour le Brésil et les États-Unis mais il est beaucoup plus exigeant en matières premières pour l'Europe et le Canada. Pour l'Europe, l'effet le plus marqué concerne les huiles nécessaires à la production de biodiesel qui représenteraient 49 % de la consommation projetée.
Les besoins nouveaux de matières premières sont censés devoir être satisfaits à travers une modification des échanges internationaux : hausse des importations d'huiles végétales et baisse, jusqu'à 41 %, des exportations de blé. Cet ajustement exerce des effets importants sur les prix internationaux qui augmentent sensiblement (entre 15 et 20 % selon les produits). Mais, ce résultat est tributaire de l'hypothèse d'absence de réaction de la production à la demande, hypothèse qu'on peut juger d'autant moins « robuste » que les tensions sur les prix devraient inciter à élever la production des produits concernés.
Néanmoins, il est utile pour apprécier la portée du scénario de préciser que la hausse des taux d'incorporation ici simulée est particulièrement modérée par rapport aux objectifs aujourd'hui en vigueur, d'autant qu'on y suppose que l'augmentation des prix agricoles se répercuterait sur les incorporations effectives en en freinant le rythme par rapport aux objectifs officiels.
De ce fait, la part des carburants remplacée par l'éthanol et le biodiesel dans l'UE-15 progresse d'un peu moins de 1 % en 2004 à 5,2 % en 2010 pour atteindre 5,5 % en 2014, chiffre légèrement inférieur à l'objectif de 5,75 % fixé pour 2010 par la directive de la Commission européenne mais très inférieur du chiffre retenu par la France, aux États-Unis et au Canada, ces pourcentages passeraient de 1,6 % en 2004 à 2,2 % en 2014, et de 0,3 % à 3,0 %, respectivement, tandis qu'au Brésil ils devraient passer, selon les estimations, de 22 % à plus de 26 % durant cette période.
Le dernier scénario, celui d'une expansion des biocarburants en réponse à une hausse durable du prix du pétrole (à 60 dollars le baril) implique un plus fort développement de la production de biocarburants, dans l'Union européenne en particulier, avec un pourcentage de 6 % de la consommation totale de carburants.
Deux effets différents interviennent :
la hausse des coûts de production agricole diminue l'offre, ce qui accroît le coût de production des biocarburants du fait de l'augmentation du prix des intrants (dont l'énergie représente une part variable selon les pays, généralement non déterminable mais connue pour les États-Unis - 25 % et l'Argentine - 43 %) ;
en cas d'augmentation des prix de vente des carburants fossiles, les producteurs de biocarburants sont incités à produire davantage malgré la hausse des prix des matières premières utilisées par eux.
Ce scénario est celui où les tensions sur les prix agricoles sont les plus fortes puisqu'il cumule tous les enchaînements qui y conduisent (sur le potentiel agricole et les coûts d'exploitation...).
Il illustre les problèmes auxquels « l'effet de seuil » peut conduire. À partir d'un certain niveau de prix des énergies concurrentes, les biocarburants pourraient devenir si compétitifs que l'augmentation des coûts de production des matières premières agricoles (résultant de l'augmentation des prix des énergies fossiles) n'en empêcherait pas l'essor (dopé par la hausse des prix des débouchés énergétiques).
Dans ce scénario, sur fond de réduction de l'offre agricole à usage alimentaire, une proportion plus élevée de l'offre agricole serait consacrée à produire des biocarburants. Les prix des matières premières agricoles à destination alimentaire connaîtraient de fortes tensions qui pourraient réguler la répartition des productions entre les différents usages au prix d'une élévation du niveau des prix alimentaires.
Mais, sans doute faudrait-il mieux « boucler » ce scénario pour évaluer les effets des biocarburants sur ces prix. Les dynamiques conduisant à augmentation des prix pétroliers obéissent à un décalage entre la demande et l'offre des produits considérés.
L'adjonction d'une offre complémentaire peut contribuer à atténuer l'ampleur de ce déséquilibre et de ses effets sur les prix énergétiques. Cet effet peut exercer une sorte de rétroaction sur le système alimentaire en modérant des effets-prix, potentiellement explosifs, et en stabilisant la demande adressée au secteur via une relative préservation du pouvoir d'achat des consommateurs par rapport à un contrefactuel où les prix de l'énergie déraperaient.
Ces enchaînements dépendent essentiellement de la contribution des agro-carburants à une trajectoire plus stable des prix de l'énergie.
* *
*
Quoiqu'il en soit, l'avenir de l'agriculture sera très certainement de plus en plus marqué par un futur énergétique qui est de plus en plus incertain. Dans la volonté, qu'il faudrait « muscler », de mieux maîtriser ce dernier, il paraît hasardeux de se reposer sur les solutions aujourd'hui offertes par la biomasse.
Celle-ci ne serait une issue qu'à la condition que les progrès technologiques vers une exploitation plus sobre en surfaces que permet d'envisager la prospective se trouvent réalisés.
À cet égard, les incitations publiques pourraient être utilement réorientées de la production des biocarburants de première génération vers la recherche et le développement des biocarburants de deuxième et troisième génération.
D. APERÇUS POUR LA FRANCE
Les agro-carburants en France n'échappent pas aux interrogations précitées. Un rapport d'évaluation de la Cour des comptes permet de le mesurer.
En France, les productions agricoles à des fins énergétiques occupent environ 6 % de la surface agricole utile totale mais comme c'est le cas en particulier pour les oléagineux, cette proportion peut être beaucoup plus élevée quand on ne considère que la surface spécifiquement dédiée.
|
een 1000 ha |
Surface |
1993 |
2004 |
2009 |
|
SAU |
29 907 |
29 222 |
29 408 |
|
|
Biodiesel |
Oléagineux (95 % de colza, 5 % tournesol) |
|||
|
Surface consacrée aux oléagineux tout usage |
1 458 |
1 807 |
2 264 |
|
|
Surface estimée pour le biodiesel 2010 (ONIGC) |
1 450 |
|||
|
% de la surface oléagineux |
64,05 % |
|||
|
% de la SAU en oléagineux pour le biodiesel |
4,93 % |
|||
|
Maïs + blé tendre |
||||
|
Bioéthanol |
Surface consacrée au blé tendre et maïs tout usage |
6 067 |
6 596 |
6 413 |
|
Surface estimée pour le bioéthanol blé + maïs 2010 (ONIGC) |
223 |
|||
|
% de la surface blé + maïs pour le bioéthanol |
3,48 % |
|||
|
% de la SAU blé + maïs pour le bioéthanol |
0,76 % |
|||
|
Betteraves |
||||
|
Surface consacrée à la betterave tout usage |
439 |
385 |
373 |
|
|
Surface estimée pour le bioéthanol betteraves 2010 (ONIGC) |
40 |
|||
|
% de la surface betteraves pour le bioéthanol |
10,74 % |
|||
|
% de la SAU betteraves pour le bioéthanol |
0,14 % |
|||
|
Surface estimée pour les biocarburants 2010 |
1 713 |
|||
|
% de la SAU |
5,82 % |
|||
Source : Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires (ministère de l'agriculture) d'après AGRESTE, jusqu'à 2004, métropole, puis France entière. Changement de méthode en 2005
Les filières d'agro-carburants bénéficient d'un cadre d'incitations publiques en Europe et en France tout en étant largement ouvertes aux importations des matières premières agricoles nécessaires.
Cette configuration doit être prise en compte pour estimer les effets que pourrait avoir le soutien public aux agro-carburants sur les producteurs de biomasse français étant donné les écarts de compétitivité existant entre eux et certains de leurs concurrents étrangers.
Ainsi que le rappelle la Cour des comptes, « les subventions à la production sont traitées dans deux accords de l'OMC, celui sur l'agriculture d'une part, celui sur les subventions et mesures compensatoires (ASCM) d'autre part.
De ce point de vue, l'éthanol entre dans le champ de l'accord sur l'agriculture alors que le biodiesel est considéré comme un produit industriel, notamment parce qu'il est produit à travers le processus chimique de la transestérification.
Cette différence de classification n'entraîne pourtant que peu de conséquences pour le moment au regard de la légalité des subventions à la production de biocarburants dans la mesure où les États membres ne distinguent pas les soutiens particuliers aux biocarburants des subventions générales à l'agriculture.
Au regard des échanges internationaux les produits agricoles peuvent bénéficier, en règle générale, d'une protection assez supérieure à celle des produits industriels et le marché de l'éthanol devrait ainsi être solidement protégé contre les importations à la différence de celui du biodiesel. Mais la pratique montre qu'il n'en est rien.
Dans la plupart des cas, les biocarburants produits à l'étranger entrent sur le marché européen avec des droits de douane proches de zéro.
La Cour rappelle que ces règles sont par ailleurs l'enjeu de négociations.
Deux points concernent l'agenda de développement de Doha :
- dans la partie de la négociation consacrée à l'agriculture, le volet des subventions à la production donne lieu pour l'instant à des propositions de réduction de 70 à 80 % par rapport aux plafonds acceptés lors de la précédente négociation. Un accord éventuel à l'OMC sur de telles bases se traduirait, de manière certes indirecte mais néanmoins certaine, par des contraintes fortes sur les subventions au bioéthanol ;
- dans un autre chapitre concernant les liens commerce/environnement, il a été prévu « d'engager des négociations concernant la réduction ou l'élimination des obstacles tarifaires visant les biens et services environnementaux ». Dès 2007, le Brésil a proposé d'inscrire les biocarburants dans la catégorie de ces biens. Cette proposition a pour le moment rencontré l'opposition tant des États-Unis que de l'UE, mais son acceptation pourrait, à un moment donné, être une concession de l'UE ou des États-Unis en échange d'un gain dans un autre domaine. Il en résulterait alors la quasi-disparition de tout ce qui reste de protection du marché intérieur européen vis-à-vis des biocarburants étrangers.
Des questions similaires se posent dans les négociations UE/Mercosur où le Brésil maintient une attitude très offensive sur cette question, à la fois sous l'angle agricole et sous celui de l'environnement, d'autant que ce pays effectue un effort important pour renforcer le caractère durable des biocarburants. »
La Cour rappelle également que, si les règles européennes de protection non spécifiques aux biocarburants qui s'appliquent, peuvent être assez strictes comme c'est le cas pour l'éthanol qui supporte des droits ad valorem de 25 à 45 %, sont dans les faits nettement moins protectrices soit en raison du contournement des protections par le recours à la technique du mélange soit du fait des accords préférentiels appliqués par l'Union européenne et dont profitent particulièrement le Brésil, l'Argentine, l'Indonésie et la Malaisie.
La politique en faveur des biocarburants aurait été supportée, selon la Cour des comptes, par le consommateur du fait :
- de l'augmentation des volumes consommés en raison de la moindre teneur énergétique des agro-carburants ;
- et de la répercussion des pénalisations (de TGAP) pour non-incorporation par les distributeurs.
Les schémas ci-dessous illustrent les incidences de la politique mise en oeuvre pour les différents acteurs.
Le premier graphique ci-dessus illustre le bilan de financement de la filière à l'éthanol tandis que le second concerne le biodiesel.
Selon la Cour des comptes, les circuits impliqués sont les suivants respectivement pour la filière éthanol et la filière biodiesel :
Pour l'éthanol :
- les producteurs ont reçu 0,85 Md€ de défiscalisation réglée par la collectivité (mais aucune contribution au titre du partage de la prime de TGAP évitée) ;
- l'État (le contribuable) a payé la défiscalisation (0,85 Md€) mais a perçu des taxes supplémentaires : 1,0 Md€, la TGAP répercutée : 0,32 Md€. L'État a donc bénéficié de 0,47 Md€ de rentrées fiscales supplémentaires ce qui signifie que la politique sur l'éthanol est un gain pour lui ;
- le chiffre d'affaires du pétrolier ou distributeur s'est accru de 0,54 Md€ ;
- le consommateur a payé le prix fort, soit 1,54 Md€ de consommation supplémentaire et 0,32 Md€ de TGAP répercutée, soit au total : 1,86 Md€.
Pour le biodiesel :
- les producteurs ont récupéré 1,8 Md€ de défiscalisation sur 2005-2010. Le chiffre d'affaires du pétrolier ou distributeur s'est accru de 0,4 Md€ de consommation HT supplémentaire.
- le contribuable a payé 1,29 M€, solde entre une défiscalisation de 1,8 Md€ et 0,5 Md€ de recettes fiscales supplémentaires dues à la surconsommation de carburant (la TGAP répercutée est négligeable).
- le consommateur a payé au total 0,91 Md€ se décomposant comme entre 0,5 Md€ de taxes supplémentaires, 0,01 Md€ de TGAP répercutée et 0,4 Md€ de consommation HT supplémentaire.
Globalement, comme le rappelle utilement la Cour des comptes, les grandes fédérations de producteurs agricoles, excepté la Confédération paysanne, mais aussi les chambres d'agriculture, défendent la politique de soutien aux biocarburants.
Ces organisations considèrent que les biocarburants représentent un débouché supplémentaire pour les agriculteurs qui peut de plus avoir une influence favorable sur leur prix de vente. Il est admis notamment pour la betterave que la production destinée à alimenter la filière des agro-carburants a représenté une solution de remplacement permettant de compenser la part de surface cultivée résultant de la réforme du marché mondial du sucre qui a restreint la capacité exportatrice de la France. Ils font également valoir que les biocarburants ont permis d'élargir les surfaces cultivées, en oléagineux tout particulièrement, sans impact sur les autres cultures ni effet d'éviction sur les exportations. De fait, l'existence de coproduits générés par la filière (tourteaux, drêches et pulpes) destinés à l'alimentation animale aurait libéré des surfaces pour d'autres productions et pourrait atténuer la dépendance à l'égard de produits importés. On cite en ce sens le fait qu'en 2009, les tourteaux de soja importés ne représentaient plus que 50 % des besoins de l'alimentation animale contre 66 % en 2003. Les effets sur l'emploi sont encore mentionnés à l'avantage des biocarburants, une étude montrant que 1 000 tonnes de biocarburants occupent 6 emplois (directs et indirects) en France contre 0,01 emploi pour 1 000 tonnes d'essence.
Ces arguments appellent considération. Mais plusieurs observations doivent également intervenir.
Le coût de la politique de soutien aux biocarburants sans laquelle la filière ne serait pas viable, en l'état des prix de l'énergie fossile, doit être pris en compte pour apprécier les effets de la filière qu'il s'agisse de l'adjonction de revenu ou des emplois mobilisés.
Le « contrefactuel » à partir duquel on évalue les impacts de la politique de développement des biocarburants, est souvent simplifié à outrance. Par exemple, l'argument sur l'absence d'effet d'éviction sur les terres se recommande d'un fait historiquement daté, à savoir l'existence de la jachère. Or, celle-ci était imposée à des terres auparavant cultivées alors même que les biocarburants étaient encore dans les limbes. Il est assez peu probable que les surfaces exploitées par la filière ne l'auraient systématiquement point été sans celles-ci. Autrement dit, en France comme ailleurs, les cultures énergétiques se substituent aux cultures alimentaires, au moins pour une partie. La France contribue ainsi, d'autant qu'elle importe par ailleurs une partie des matières premières agricoles nécessaires à la filière, à compliquer, du moins sous un certain angle, la résolution de l'équation alimentaire mondiale.
Le développement des coproduits afin de nourrir les animaux n'est pas nécessairement une bonne nouvelle compte tenu des doutes sur les effets sanitaires d'une nourriture animale qui n'est pas inscrite dans les processus privilégiés par la nature.
La répartition des effets de la politique de soutien aux filières agro-énergétiques semble particulièrement déséquilibrée entre les filières et entre les acteurs des filières au point que la Cour des comptes a pu évoquer l'existence de « rentes de situation ». L'appréciation des effets sur les revenus des producteurs de produits de base peut varier selon les débouchés alternatifs et selon les prix de livraison. En tout état de cause, ils sont concentrés au bénéfice des plus gros producteurs ce qui signifie que les coûts de cette politique sont supportés à leur profit.
* *
*
La France appelle tout particulièrement les observations faites précédemment sur l'utilité d'orienter les soutiens publics plutôt vers la recherche de biomasses énergétiques avancées que vers la production de produits agro-énergétiques non durables.
CHAPITRE II :
UNE AGRICULTURE CONFRONTÉE
À DES DÉFIS NATURELS NOUVEAUX
L'augmentation de la production agricole a procédé très largement de la « Révolution verte » c'est-à-dire de la mise en oeuvre de technologies ayant permis d'accroître les rendements. On estime que 85 % du supplément de production acquis depuis la seconde guerre mondiale auraient découlé de l'augmentation des rendements.
Or, la question de la soutenabilité du système productif mis en oeuvre pour atteindre ce résultat se pose au moment même où il semble que seuls des progrès de productivité exigeant d'augmenter les rendements puissent permettre de relever le défi alimentaire à l'avenir tant pour des raisons quantitatives (l'augmentation physique de la production) que pour des raisons plus qualitatives (la viabilité économique et sociale des exploitations).
C'est généralement sous l'angle de la soutenabilité environnementale de l'agriculture intensive que ce problème est abordé.
S'ajoutent à cette approche les questions que suscitent la raréfaction des ressources naturelles, questions qu'aggrave la perspective des changements climatiques.
Force est d'ajouter à ces dimensions la considération systématique des impacts économiques d'un renforcement des préoccupations sous revue.
I. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE COMPLIQUE LA DONNE
Les perspectives ouvertes par les changements climatiques sont abordées ici sous l'angle, non de la contribution de l'agriculture à la maîtrise du phénomène mais de ses impacts sur la production agricole.
Les scénarios disponibles laissent présager des effets globaux assez modérés. Il faut toutefois tempérer leurs enseignements.
En premier lieu, ces scénarios sont incomplets dans la mesure où ils n'intègrent pas systématiquement les effets en boucle des incidences économiques des risques climatiques, que ceux-ci se produisent ou non. En second lieu, les effets régionaux ou locaux des changements du climat pourraient être importants, voire dramatiques, s'agissant de pays qui sont déjà en retard de développement agricole.
A. APERÇU GÉNÉRAL : PEU D'EFFETS GLOBAUX MAIS DES IMPACTS RÉGIONAUX SIGNIFICATIFS DÉCRITS PAR DES SCÉNARIOS SANS DOUTE INCOMPLETS
1. Peu d'effets globaux mais des incidences régionales significatives
L'impact du changement climatique sur le potentiel de production agricole a fait l'objet d'évaluations qui aboutissent à deux résultats.
Globalement, le changement climatique n'aurait pas d'effets désastreux sur le potentiel agricole et pourrait même dans certaines trajectoires s'avérer bénéfique.
Vus plus localement, les effets du changement climatique seraient contrastés et accentueraient les handicaps de régions déjà déficitaires, représentant ainsi une force tendant à amplifier la dépendance de la résolution de l'équation alimentaire envers les échanges internationaux.
Ces résultats sont hypothétiques. Ils dépendent d'une correcte anticipation des événements engendrés par le réchauffement climatique.
À cet égard les variables à considérer sont principalement l'ampleur du réchauffement du climat, de la montée des eaux marines, du déplacement des zones climatiques et de la survenance de phénomènes extrêmes.
À l'horizon 2050, la montée des eaux serait encore réduite limitant ses effets aux zones très basses (Gange, Mékong, plaines côtières de Java). Il n'empêche que ces régions agricoles seraient durement touchées.
Les événements extrêmes, quant à eux, sont difficiles à modéliser, ce qui conduit souvent à en négliger l'étude qui se concentre alors sur l'installation de nouveaux régimes climatiques considérés comme les plus probables.
Cependant, la probabilité d'événements extrêmes devrait se renforcer. Or, les catastrophes climatiques sont susceptibles de provoquer des crises sporadiques de très grande ampleur qui constituent autant de risques qui devraient aller s'amplifiant.
C'est un champ d'incertitudes différent de celui qui s'ouvre alors avec la question des effets des nouveaux régimes climatiques sur le potentiel agricole. À leur sujet, les aléas sont renforcés du fait que ceux-ci pourraient susciter, ou non, des adaptations plus ou moins efficaces des méthodes productives.
Géographiquement, les régions les plus concernées seraient les suivantes : les régions boréales et australes verraient leurs capacités de production augmenter ; les régions tropicales baisser. Ainsi, le Canada, la Chine du Nord et la Sibérie tireraient avantage du changement climatique tandis que les régions pénalisées seraient le Brésil, en particulier le quart nord-est, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, le sous-continent indien et la Chine du Sud.
On doit souligner que la plus grande part de ces régions est fortement peuplée. Les régions tempérées sont encore dans l'incertitude. Un accroissement de la variabilité climatique interannuelle pourrait entraîner une variabilité de production qui serait historiquement radicalement nouvelle en Amérique du Nord et en Europe, de même que dans le sud du Brésil et le nord de l'Argentine.
Évolutions de productivité
en
fonction d'hypothèses de changement climatique
à partir d'un
modèle de l'Institut Max-Planck
Source : « Nourrir la planète » - Michel Griffon
On voit ainsi se dessiner un premier résultat significatif : le changement climatique provoquera une recomposition de la géographie agricole mondiale dont seule l'ampleur est incertaine.
Un deuxième résultat semble acquis même si ces manifestations concrètes sont difficilement déterminables : du fait de l'amplification de la gamme des événements climatiques et d'un probable renforcement de l'instabilité du climat, le changement climatique conduirait à des crises sporadiques de contraction de l'offre qui accentuerait l'incertitude et l'instabilité des marchés agricoles et de l'alimentation.
La question des effets globaux et structurels du changement climatique sur le potentiel agricole est plus discutée. Les anticipations s'appuient en ce domaine sur des scénarios dont les résultats diffèrent selon trois variables principales : le régime pluviométrique associé aux modifications du climat ; l'impact du changement climatique sur le potentiel fertilisant du CO2 et l'adaptation des productions par acclimatation de nouvelles espèces. On présente ci-après les résultats des scénarios les plus couramment utilisés pour simuler les effets des changements climatiques sur la production agricole.
2. Des scénarios qui semblent incomplets
Trois observations s'imposent avant que de présenter les résultats des scénarisations disponibles.
La première tend à rappeler que l'ampleur des changements climatiques et de leurs implications, qui sont nécessairement hypothétiques, peuvent n'être pas complètement couverts par les scénarisations à partir desquelles ses effets sur les potentiels agricoles sont appréhendés. Il semble, en particulier, que la gamme des réchauffements envisagés ait été un peu « raccourcie » par rapport aux hypothèses éventuelles.
La scénarisation utilisée ne semble pas avoir entièrement exploré les situations les plus extrêmes au motif que leur probabilité serait faible ;
Surtout, ces scénarios apparaissent insuffisamment « bouclés ».
L'impact de l'instabilité des marchés agricoles que devraient accentuer les changements du climat ne paraît pas convenablement pris en compte dans la mesure où, en raison de la négligence d'un certain nombre d'effets socio-économiques, l'effet cumulatif des incidences qu'elle peut avoir sur les potentiels productifs n'est pas décrit.
On sait qu'une partie importante de la résolution de l'équation alimentaire réside dans l'investissement agricole qui est dépendant des financements mais aussi des risques perçus. Or, ces deux variables sont étroitement influencées par le niveau de stabilité des marchés agricoles et, plus largement, par l'existence d'un contexte caractérisé par la stabilité des perspectives des producteurs. Dans l'hypothèse où les changements climatiques affecteraient celle-ci, pour en apprécier correctement les effets sur les potentiels de production agricole, il faudrait que les scénarios proposés comportent la sommation des déficits d'investissement qu'on peut alors redouter, ainsi que leur impact multiplicateurs négatifs sur le potentiel productif.
Cette intégration d'effets économiques, qui pourraient d'ailleurs dépasser le strict champ de l'investissement pour affecter le capital humain engagé dans l'agriculture, manque dans les scénarios purement physiques ici présentés.
En conséquence, les résultats des scénarios d'impact du réchauffement climatique habituellement présentés minorent sans doute les pertes de potentiel agricole que provoqueraient les changements climatiques, voire, tout simplement leur perspective.
Par contraste toutefois, il faut relever sue les réponses technologiques aux changements climatiques ne sont probablement pas toutes modélisées faute peut-être d'informations sur ce qu'elles pourraient être.
Sur ce point, il existe cependant une certitude : à supposer qu'elles puissent être déployées de telles réponses devraient augmenter le coût des productions agricoles (sauf si elles incluaient un progrès technique permettant de réduire les coûts unitaires de production, ce qui est une hypothèse raisonnable mais peu pratique quand on raisonne en tendance).
Cette réserve conduit à accorder toute sa place à l'innovation comme un élément essentiel du développement durable, à côté de la prévention, et, plus spécifiquement, comme étant un enjeu central de la réponse à l'intensification du défi alimentaire que comportent les perspectives du changement climatique.
C'est sous ces réserves qu'il faut apprécier les résultats détaillés des simulations des changements climatiques.
B. LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS DES SCÉNARIOS
1. L'étude de la FAO
Les tableaux ci-après fournissent les principaux résultats pour le potentiel de production de blé et de maïs (cultivés en pluvial).
Les colonnes du tableau correspondent à des modes différents d'adaptation des cultures aux changements climatiques, selon leurs effets sur la fertilisation et l'acclimation, ou non, de nouvelles semences, soit deux variables essentielles pour apprécier les effets des changements climatiques (les deux premiers scénarios sans fertilisation supplémentaire liée au CO2 et avec deux types différents de semences - locales ou adaptées aux changements climatiques -, les deux derniers avec une fertilisation et un même jeu d'hypothèses portant sur le maintien ou l'adaptation des semences).
Effet du changement climatique sur le potentiel de « blé pluvial » selon plusieurs scénarios (déviation en % par rapport au scénario sans changement climatique)
Effets du changement climatique sur le potentiel de « maïs pluvial » selon plusieurs scénarios (variation en % par rapport au scénario sans changement climatique)
Source : FAO Gunther Fischer
Les principaux résultats suivants doivent être soulignés.
Les effets du changement climatique diffèrent selon la céréale considérée. Ils sont plutôt favorables pour le maïs et défavorables pour le blé, ce qui reflète notamment la sensibilité des rendements de chaque céréale aux conditions pluviales.
Les changements climatiques exercent des effets d'autant moins défavorables que les variétés cultivées pourraient être adaptées et que la fertilisation des sols ressortirait comme accrue par l'augmentation de la teneur de l'atmosphère en CO246(*).
Pour le blé, on va d'une réduction du potentiel du simple au double (à l'échelle mondiale) selon cet effet.
On peut, sous certaines réserves, en tirer la conclusion que les incidences des changements climatiques semblent pouvoir être contenues par le recours aux techniques agricoles de sélection et de fertilisation. Mais, évidemment, ces adaptations ont un coût.
L'impact des changements climatiques sur le potentiel de production de blé est globalement négatif mais très fortement différencié régionalement.
Le potentiel des pays en développement est nettement plus réduit que celui des pays développés. Les potentiels de l'Afrique subsaharienne ainsi que de l'Amérique centrale et de l'Asie seraient particulièrement affectés.
Ces régions ne profiteraient pas (ou très peu) des effets plus favorables des changements climatiques sur la production de maïs qui seraient concentrés dans les pays développés dits (« pays de maïs ») et sur les territoires de la Fédération de Russie.
Effets du changement climatique sur le potentiel de « céréales pluviales » selon plusieurs scénarios (déviation en % par rapport au scénario sans changement climatique)
Source : FAO Gunther Fischer
* *
*
Au total, quand on généralise la simulation des effets du changement climatique à l'ensemble des céréales et qu'on imagine la sélection de céréales les plus adaptées aux conditions locales après les changements du climat, les effets globaux sont modérés. De légèrement négatifs, ils deviennent même positifs lorsque l'hypothèse sur la fertilisation des plantes par l'augmentation de la teneur de l'atmosphère en CO2 est posée.
Néanmoins, des régions particulièrement sensibles déjà et susceptibles de voir l'augmentation de leur population renforcer leurs déficits alimentaires, subiraient des pertes de potentiel élevées.
Il en va ainsi particulièrement pour l'Afrique du Nord (notamment l'Égypte) et le sud de l'Afrique (avec une forte dégradation en Angola et en Namibie notamment).
Dans la plupart des scénarios, le recul serait important en Amérique centrale et en Amérique du Sud, allant jusqu'à toucher des pays considérés comme à très fort potentiel agricole, dont le Brésil.
2. L'étude de GAEZ sur les superficies cultivables
Ces impacts du changement climatique sont également décrits par l'étude GAEZ qui, portant spécifiquement sur la question des superficies agricoles disponibles, examine sept scénarios concernant le blé, le maïs-grain et le riz.
Trois de ces scénarios envisagent des augmentations uniformes des températures mensuelles - de 1, de 2 ou 3° C -, tandis que les quatre autres envisagent des augmentations combinées des températures et des précipitations mensuelles : plus 1° C de température et plus 5 % de précipitations ; plus 2° C et plus 5 % ; plus 2° C et plus 10% ; plus 3° C et plus 10 %47(*) (Fischer et al., 2002 ; Fischer, Shah, van Velthuizen, 2002).
Pour s'en tenir aux seuls effets sur les terres cultivables, on relève que, dans tous les cas, une extension, faible (de 1 % à 6 %), des superficies cultivables en céréales interviendrait à l'échelle du monde.
Toutefois, les effets seraient très inégaux selon les régions. Dans les pays en développement, la superficie cultivable diminuerait, de 1,3 % à 11 % tandis qu'elle augmenterait de 11 % à 25 %, dans les pays développés.
Pour tous les scénarios, les gains de superficie cultivable seraient particulièrement importants (toujours supérieurs à 20 %) au Moyen-Orient et en Russie, importants (autour de 20 %) en Amérique du Nord et en Asie de l'Est, et en Asie centrale (mais avec de fortes variations selon les scénarios).
Évolution des superficies convenables à la culture du blé, du maïs grain et du riz dans différentes régions du monde en fonction de 7 scénarios de changement climatique (en %)
Source : Mme Laurence Roudart, d'après GAEZ.
Des zones assez étendues, non cultivables avec le climat actuel du fait d'une insuffisance des températures, deviendraient cultivables : zones septentrionales de l'hémisphère nord (Nord du Canada, de l'Europe, de la Russie, de la Mongolie et de la Chine), zones australes de l'hémisphère sud (Sud du Chili et de l'Argentine, Tasmanie, Nouvelle-Zélande), et zones montagneuses situées dans les Andes et dans l'Himalaya.
En revanche, les régions tropicales perdraient des terres cultivables, en particulier dans les zones proches des zones arides de l'Afrique, au Nord de l'Amérique latine jusqu'au Mexique, et de l'Océanie.
* *
*
Au total, une certitude se dégage : les changements climatiques accentuent les déséquilibres entre l'offre et la demande agricole au plan local obligeant à recourir davantage aux échanges internationaux pour « boucler » l'offre et la demande alimentaire.
Autrement dit, le changement climatique est un obstacle de plus à des stratégies d'autosuffisance alimentaire qu'elles soient nationales ou régionales.
Mais les impacts du changement climatique sont entourées de grandes incertitudes, et leurs scénarisations, telles que réalisées à ce jour, semblent aller plutôt dans le sens d'une minoration de ses effets sur l'équilibre alimentaire.
II. LA MONTÉE DES STRESS HYDRIQUES
L'un des défis les plus inquiétants pour la planète, et pour l'agriculture, semble devoir être la disponibilité des ressources en eau qu'appellent le développement agricole.
Selon certaines estimations, les réserves mondiales d'eau douce qui s'élevait à 16 800 m3 par personne et par an en 1950 n'atteignent plus que 6 800 m3 et devraient tomber à 4 800 m3 en 2025, sous l'effet principalement, de la croissance démographique.
Celui-ci pourrait trouver dans la rareté de l'eau sa principale limite.
Sur ce point, les prospectivistes semblent partager une vision commune même si leurs façons de présenter le problème diffèrent : la ressource en eau mobilisée par l'agriculture, qui est attribuable aux procédés d'irrigation, devrait se heurter à des limites réduisant les possibilités d'extension de l'agriculture irriguée qui touchent plus particulièrement les pays en développement où cette agriculture est particulièrement nécessaire.
D'autres questions, pourtant importantes, sont moins systématiquement abordées dans les différentes prospectives.
Il en va ainsi de la possible montée des conflits d'usage qu'ils soient internes (entre les différents utilisateurs de l'eau dans un même pays) ou internationaux.
Déjà prépondérante, la consommation d'eau par l'agriculture représente une proportion de plus en plus importante de la consommation totale : d'environ la moitié au début du XXe siècle, elle s'élève aujourd'hui à 70 % de celle-ci.
Par ailleurs, la consommation mondiale augmente plus vite que la population : pendant le même XXe siècle, la consommation d'eau a décuplé, alors que la population mondiale triplait.
De même, la capacité des systèmes agricoles à limiter les nuisances qu'ils engendrent pour la ressource en eau n'est pas toujours traitée dans les grandes prospectives du défi alimentaire.
Enfin, l'optimisation des modalités de gestion du cycle de l'eau n'est que peu analysée, et notamment dans ses conséquences sur les besoins d'investissement ou dans ses enjeux pour que l'eau soit, demain moins qu'aujourd'hui, l'un des facteurs limitant du développement agricole là où celui-ci est plus nécessaire.
A. LES ESTIMATIONS RELATIVES À L'ACCESSIBILITÉ DE L'EAU VARIENT AVEC DES EFFETS SUR LE POTENTIEL ENVISAGEABLE
Selon la FAO, sur 1,4 milliards de km3 d'eau présents sur la planète, 45 000 km3 seulement sont consommables et l'accessibilité à cette ressource s'étagerait entre 9 000 et 14 000 km3, ce qui est une fourchette assez large.
Dans son ouvrage déjà cité, M. Michel Griffon suggère que, sur les 40 000 km3 d'eau de pluie, seuls 6 000 km3 sont actuellement réellement disponibles, soit 15 % du total. De ces 6 000 km3, seuls 2 500 km3 seraient prélevés, dont 1 750 réellement utilisés par l'agriculture. Les mégapoles prélèvent 350 km3 de leur côté, ce qui fait du secteur agricole de très loin le premier utilisateur de la ressource.
On peut juger que la mobilisation de l'eau est peu efficace mais cette faible efficacité s'explique, entre autres, par le fait que l'essentiel des eaux de pluie des zones tropicales et septentrionales n'est pas récupérable dans des bassins hydrographiques utiles, situation qui appelle des aménagements de grande ampleur dont la justification économique peut manquer compte tenu de la distribution de la ressource.
En effet, il doit être relevé que les disponibilités en pluie sont distribuées géographiquement de manière très inégale sur la planète. L'eau douce est très concentrée, une dizaine de pays bénéficient de 60 % des réserves.
Le Brésil reçoit à lui seul 14 % du total mondial puis viennent la Russie (la partie occidentale jusqu'à l'Oural et la Sibérie de l'Est), l'Asie du Sud-Est, la Chine (tout le pays sauf le Nord), le Canada et les États-Unis (l'Est). Au total, ces grandes zones de réception reçoivent 45 % des pluies continentales mondiales soit un peu plus que leur poids démographique relatif.
Cette dernière comparaison conduit à relever l'asymétrie entre la concentration de la population et la distribution des ressources en eau. Par exemple, si l'Asie regroupe 60 % de la population mondiale elle ne bénéfice que de 30 % des ressources en eau.
Sous des conditions un peu héroïques, on peut estimer que le maximum utilisable est de 40 000 km3. Ces conditions sont :
- la non-consommation du stock d'eau douce fossile (12 millions de km3 soit 300 fois plus) ;
- la préservation du stock immédiatement disponible dans les lacs et rivières (93 000 km3) ;
- mais aussi l'existence d'infrastructures qui, aujourd'hui font défaut.
Les disponibilités couvriraient ainsi les besoins d'une population de l'ordre de 8 milliards d'habitants en se référant à une disponibilité moyenne de 5 000 m3 par an48(*). À ce seuil, les besoins sont censés pouvoir être couverts sans trop de tensions.
Pourtant, la croissance démographique prévisible devrait porter la population à 9 milliards d'habitants et, dans certaines simulations, bien au-delà. Plus l'accroissement démographique sera élevé, plus les tensions sur les ressources seront fortes. Au seuil de 9 milliards, les disponibilités font baisser la disponibilité moyenne à 4 400 m3 ; au seuil de 11 milliards, elle n'est plus que de 3 636 m3 par habitant.
Malgré la chute de la disponibilité moyenne dans des contextes de forte croissance démographique, celle-ci resterait globalement à un niveau suffisant.
Mais le raisonnement en moyenne n'est pas satisfaisant.
D'ores et déjà nombreux sont les pays où la disponibilité effective est inférieure à la disponibilité moyenne.
B. LES DISPONIBILITÉS EN EAU RENOUVELABLE SONT TRÈS INÉGALEMENT RÉPARTIES
Le tableau ci-dessous donne la mesure de l'hétérogénéité des disponibilités annuelles par grande région.
Disponibilités annuelles en eau renouvelable en km3
Source : World Water Vision, World Water Council, 2000
Dans ces conditions, rares sont les pays dans lesquels la disponibilité dépasse la disponibilité moyenne, situation qui est un indicateur sûr de la très forte inégalité des dotations actuelles.
En revanche, de très nombreux pays sont en situation de stress hydrique définie par une disponibilité moyenne par habitant inférieure à 1 700 m3. Cette situation concernerait un tiers de la population mondiale (plus de 2 milliards de personnes) vivant dans une vingtaine de pays dont plus de la moitié (12) appartiennent à l'Afrique et 7 sont situés au Moyen-Orient.
Ces données doivent être pondérées par l'existence de disparités régionales, certains pays pouvant bénéficier localement de conditions favorables, et comprises en tenant compte des transferts internationaux ou intertemporels (quand, la quantité de précipitations variant dans le temps, des réserves peuvent être constituées).
Mais elles constituent un facteur limitant peu discutable pour la production agricole et les perspectives de son développement dans les régions concernées.
Si la disponibilité en ressources hydriques naturelles est inégale, la mobilisation effective ne l'est pas moins et conduit le PNUD à évoquer un « water gap » entre les pays développés et les pays en développement.
Ainsi, les quantités utilisées par personne sont elles aussi très différenciées ; de 1 870 litres par personne et par an aux États-Unis à 7 en Haïti, et 20 en moyenne en Afrique. Il en résulte des bilans locaux très contrastés.
La confrontation des disponibilités en eau et des besoins détermine une carte des stress hydriques par grand bassin hydrographique.
Les bassins versants qui sont déjà actuellement les plus en état de stress sont :
- l'Indus, le plateau du Dekkan et la partie occidentale du Gange ;
- la Chine du Nord qui reçoit peu de pluies, utilise beaucoup d'eau pour l'agriculture et utilise fortement les eaux fossiles au point que les nappes phréatiques connaîtraient une baisse déjà inquiétante ;
- toute la région Afrique du Nord et Moyen-Orient ;
- l'Afrique australe, en particulier l'Afrique du Sud ;
- certaines îles des Caraïbes et les côtes occidentales de l'Amérique centrale ;
- quelques régions du Cône sud américain.
La consommation d'eau agricole ne cessant de s'accroître, la simple continuation des tendances devait accentuer l'intensité du stress hydrique dans les mêmes régions. Les évolutions les plus préoccupantes interviendraient dans les régions suivantes :
- les États-Unis, particulièrement l'Ouest et le Centre ;
- la Pampa et le nord de l'Argentine ;
- la totalité de l'Afrique du Sud ;
- la totalité de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient ;
- le Kazakhstan et les pays d'Asie centrale ;
- la presque totalité de l'Inde ;
- la presque totalité de la Chine ;
- le Sud-Est australien.
À ces grandes tendances, il faut ajouter la perspective des risques liés à l'amplitude des conditions climatiques qui n'épargneraient pas les régions les plus tempérées.
D'ores et déjà, les années de sécheresse paraissent plus fréquentes dans de nombreux sites agricoles.
Face à ces situations, les perspectives offertes par les biotechnologies avec la disponibilité d'espères résistant mieux aux stress hydrique doivent être envisagées. Il en va de même pour la sélection des semences naturelles et même des espèces cultivées puisqu'aussi bien les besoins en eau diffèrent considérablement selon les produits (v. le tableau ci-dessous).
Quantités moyennes d'eau nécessaires
par denrées
(litre d'eau/kg produit)
|
Blé |
1 100 |
|
Riz pluvial |
1 400 |
|
Riz inondé |
5 000 |
|
Soja |
2 700 |
|
Coton |
5 200 |
|
Boeuf |
13 500 |
|
Porc |
4 600 |
|
Volaille |
4 1000 |
|
Lait |
3 000 |
|
Fromage |
5 000 |
|
OEufs |
2 700 |
|
Source FAO |
|
Mais, les besoins de régularisation des apports en eau devraient augmenter, ce qui suppose d'évaluer les potentialités d'un développement de l'irrigation.
C. QUELLES PERSPECTIVES POUR L'AGRICULTURE D'IRRIGATION ?
Une part importante de l'eau prélevée pour les besoins agricoles est attribuable à l'agriculture d'irrigation qui, pour n'occuper qu'une proportion minoritaire des surfaces (environ 287 millions d'hectares) est responsable de prélèvements dépassant souvent, en proportion, 90 % du total de l'eau prélevée dans les pays qui la pratiquent.
Pour le futur, l'une des questions principales est de savoir si la disponibilité en eau sera suffisante pour satisfaire les besoins combinés de l'agriculture et des autres usages de l'eau.
À cette interrogation, des études un peu « institutionnelles » apportent une réponse positive. Mais, cette conclusion n'a pas toute la portée qu'on pourrait lui attribuer puisqu'elle est tributaire d'une méthode largement tautologique dans laquelle les besoins en eau d'irrigation sont calculés à partir de projections des surfaces irriguées... elles-mêmes réalisées sous la condition d'une disponibilité présumée des ressources en eau nécessaires. La méthode est donc circulaire : il n'y aura pas de pénurie d'eau pour l'irrigation puisque les surfaces irriguées prendraient en compte les pénuries.
Ces études n'informent pas vraiment sur les besoins d'irrigation mais plutôt sur le potentiel d'irrigation à partir de critères qui ne sont pas complètement identifiables.
Dans ces conditions, tout juste peut-on relever que les estimations du potentiel posées dans lesdites études aboutissent à ce que l'expansion des surfaces irriguées serait assez modeste passant, au niveau mondial, de 287 à 318 millions d'hectares entre 2005 et 2050, soit une progression de l'ordre de 11 %.
Cette dynamique sera très inférieure à celle des besoins d'accroissement de la production agricole pour combler les besoins alimentaires (entre + 70 et + 100 %).
Par ailleurs, le potentiel serait inégalement mobilisé.
L'irrigation ne progresserait pas dans les pays développés (68 millions d'hectares constants, soit 24 % des surfaces concernées en 2005) tandis qu'elle gagnerait 14,6 % dans les pays en développement (de 219 à 251 millions d'hectares).
Hors Chine et Inde, où actuellement l'équipement d'irrigation absorbe plus de la moitié du potentiel installé dans les pays en développement (alors que seuls 2,6 % des équipements sont situés en Afrique subsaharienne), la progression serait un peu plus forte (+ 20 %).
La question des besoins d'investissement doit alors être posée. Apparemment, ils seraient limités puisque les surfaces irriguées augmenteraient peu. En réalité, même dans ce contexte, l'irrigation coûterait cher.
Les estimations sur la progression de l'irrigation concernent des progrès nets qui supposent que les gaspillages actuels soient corrigés, ce qui nécessitera des investissements considérables excédant de beaucoup ce qui serait nécessaire pour mettre en exploitation les 32 millions d'hectares supplémentaires de surfaces irriguées projetés pour les seuls pays en développement à l'horizon 2050.
Aux investissements nécessaires à cette fin s'ajoutent des investissements de réhabilitation qui conduisent à plus que les quadrupler de sorte que l'effort d'investissement (en équivalent surfaces) atteint un niveau de 173 millions d'hectares, nettement plus élevé que les besoins de financement ajustés aux seuls 32 millions d'hectares de mise en irrigation de surfaces nouvelles.
L'évaluation des besoins d'investissement pour l'irrigation suggère donc la nécessité de procéder à un effort important.
Mais la significativité de cette évaluation est toutefois limitée par une contrainte d'accessibilité à la ressource dont les termes ne sont pas complètement précisés si bien qu'on ne peut être tout à fait assuré qu'elle soit entière. Quoiqu'il en soit, cette contrainte posée en hypothèse a pour effet d'aboutir, tautologiquement, à la conclusion que l'eau ne manquera pas aux besoins d'irrigation.
Pourtant, la comparaison entre les ressources disponibles et les besoins de l'irrigation montre que les tensions s'intensifieront dans le futur (même avec la méthode utilisée pour les mesurer).
Ressources en eau renouvelables et consommation pour irrigation
Source : FAO Expert Meeting on How to Feed the
World in 2050
24-26 juin 2009
Globalement, la pression sur la ressource ne s'aggraverait que peu. Mais, alors que la pression est déjà très élevée dans certaines zones, elle se renforcerait encore pour y atteindre des niveaux encore moins soutenables que ceux déjà constatés.
Tel serait le cas en Afrique du Nord-Moyen-Orient et dans le Sud asiatique où les niveaux actuels sont déjà considérés comme excessifs notamment si d'autres usages devaient mobiliser davantage la ressource.
À l'horizon 2025, le nombre des pays africains au-dessus du seuil de stress hydrique (1 700 m3) serait de 22 contre les 12 actuellement recensés.
|
Les pénuries d'eau suscitent la recherche d'innovations Ainsi, le douzième plan quinquennal chinois (2011-2015), prévoit de multiplier par 5 ou 6 les pluies artificielles sur le nord-est de la Chine afin de favoriser les récoltes. Actuellement, 50 milliards de m3 de pluie et de neige seraient provoqués. Le plan prévoit d'étendre les programmes dans quatre régions du nord-est et d'élever le niveau des précipitations artificielles à 280 milliards de m3, ce qui correspondrait à environ 10 % du total des précipitations sur le pays Les pluies artificielles sont provoquées en « ensemençant » des nuages, c'est-à-dire en y intégrant, à l'aide fusées-roquettes, des produits tels que de la glace carbonique ou de l'iodure d'argent. Ces éléments créent des cristaux de glace qui forment les grosses gouttes à l'origine de la pluie. Une autre technique utilisant l'énergie solaire avait été expérimentée en 2005 par les israéliens. Elle consiste à étaler au sol une grande surface noire qui absorbe l'énergie solaire sur plusieurs kilomètres carrés puis la restitue, ce qui augmente la température de l'atmosphère. L'air chaud monte, se condense et finit par produire de la pluie. Ce programme est censé aider la Chine à parvenir à atteindre ses objectifs de production de céréales de 550 millions de tonnes par an, aujourd'hui compromis par les sécheresses. Ces procédés s'ajoutent aux procédés plus traditionnels de désalinisation de l'eau de mer qui représentent des coûts considérables mais sont dans certaines régions, le Proche-Orient notamment, l'une, sinon la seule, des solutions accessibles pour pallier le manque d'eau. Il va de soi que la soutenabilité de ces techniques n'est pas toujours garantie notamment quand elles concernent des milieux marins fortement contraints. |
III. LES PROBLÈMES DE SOUTENABILITÉ DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
A. LES EFFETS NON DÉSIRABLES DE LA « RÉVOLUTION VERTE » SUR LES RESSOURCES NATURELLES
L'idée se répand chez les prospectivistes que le rattrapage des pays en retard, sous l'angle de la productivité agricole, devrait se faire en sautant le stade de la « révolution verte » pour suivre les voies de la « révolution doublement verte » ou de « l'agriculture écologiquement intensive ».
Ces deux derniers modèles diffèrent entre eux mais se rejoignent sur l'essentiel : valoriser pleinement les biens environnementaux.
« L'agriculture écologiquement intensive » est plus ambitieuse que la « révolution doublement verte ». Celle-ci a pour objectif de concilier productivité et services écologiques quand la première vise à augmenter la productivité en recourant à des mécanismes écologiques.
Ces « modèles » doivent être appréciés à partir de la problématique du développement agricole qui, techniquement, suppose d'élever la productivité du secteur agricole.
La hausse de la productivité agricole est un objectif raisonnable. Mais sa contribution potentielle au rattrapage alimentaire ne peut être simplement déduite des écarts de productivité existant entre pays associés à des niveaux différents d'investissement agricole. En agriculture, les dotations naturelles comptent.
Par exemple, les rendements céréaliers diffèrent énormément entre la France (71,3 quintaux par hectare en moyenne) et l'Australie (16,5 quintaux), et cette différence de rendement ne saurait être attribuée à des systèmes de production inégalement efficaces. Elle provient essentiellement des conditions locales (notamment du rôle limitant de la pluviométrie pour l'agriculture australienne).
Ainsi, si les marges que réserve la productivité doivent être appréciées à raison de la distance entre les technologies mises en oeuvre et la « frontière technologique », qui recouvre les meilleures pratiques, ces marges doivent être appréciées compte tenu des contraintes locales.
Elles sont certainement importantes et votre rapporteur estime qu'il faut mettre en place les moyens d'un véritable « rattrapage agricole et alimentaire » des pays en retard de développement agricole. Pour autant, cette approche ne doit pas être aveugle.
Les « meilleures pratiques agricoles » doivent au surplus mieux tenir compte de la contrainte de mieux respecter à l'avenir les biens naturels, dans des modèles de développement agricole alternatifs à la « révolution verte » si nécessaires.
De fait, la soutenabilité de « l'agriculture de rendement » est de plus en plus mise en cause.
À titre d'exemple, on peut mentionner comment, dans leur récent ouvrage « 9 milliards d'hommes à nourrir », Mme Marion Guillou et M. Gérard Matheron exposent plusieurs des problèmes environnementaux posés par le processus d'intensification de la production agricole suivi jusqu'à présent.
L'agriculture intensive exerce des effets indésirables sur les différents milieux.
Pour l'eau, l'agriculture est responsable de différentes pollutions altérant la qualité de la ressource et imposant des coûts de dépollution. En outre, elle s'accompagne de conflits d'usage (dont l'intensité pourrait augmenter) puisque l'agriculture consomme globalement 70 % de la ressource et parfois, notamment dans les périodes de raréfaction et dans les zones d'irrigation, nettement plus.
Par ailleurs, l'agriculture intensive peut compliquer la gestion courante des eaux. Certaines formes d'aménagement agricole favorisent le ruissellement ou la pentification des sols avec des conséquences notables sur les crues ou inondations.
Pour les sols, qui représentent une ressource essentielle pour l'agriculture, qui plus est, très difficilement renouvelable (le temps caractéristique de la pédogénèse étant le millénaire), l'agriculture intensive telle qu'elle est parfois pratiquée comporte des destructions préoccupantes.
L'irrigation par utilisation intempestive d'eaux chargées en polluants ou en substances érosives (à cet égard la salinisation des sols par l'eau d'irrigation pose un problème très aigu) aboutirait à ce que près de la moitié des surfaces irriguées soient menacées (20 à 30 millions d'hectares sont d'ores et déjà très affectés).
L'éradication des couvertures permanentes des sols augmente l'intensité de leur érosion49(*). Or, la vitesse moyenne de l'érosion est plus rapide que celle de la formation des sols si bien que lorsque l'érosion atteint un seuil de rupture, le sol est perdu pour des années. On estime, par exemple, que 16 % des sols européens sont affectés par l'érosion hydrique.
La réduction de la teneur des sols en matières organiques associée à l'approfondissement des labours ou à la mise en culture de prairies est à considérer comme une menace particulièrement importante pour les sols agricoles européens.
Il en va de même de la diminution de la biodiversité à laquelle les sols fournissent un habitat de première importance puisque la nutrition minérale des plantes en dépend. Il existe 10 000 espèces vivantes dans un cm3 de sol et leur résistance à l'exploitation artificielle des sols n'est pas homogène.
B. INQUIÉTUDES POUR LA BIODIVERSITÉ
Cette réduction de la biodiversité des sols n'est au demeurant qu'une des modalités des effets plus globaux de l'agriculture sur la biodiversité.
L'agriculture substitue des agro-systèmes à des écosystèmes avec pour incidence une diminution de la variété des espèces. On ne peut pas mesurer précisément l'ampleur de ce phénomène non plus qu'en appréhender toutes les conséquences.
Certains évoquent une « sixième grande crise d'extinction » c'est-à-dire une crise aussi sérieuse que celle qui a vu la disparition des dinosaures et de la moitié des espèces, il y a 65 millions d'années.
|
La réduction de la biodiversité vue par l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques du Parlement français L'office parlementaire des choix scientifiques et technologiques a consacré en 2007 un rapport aux problèmes posés par l'évolution de la biodiversité intitulé : « La biodiversité : l'autre choc ? l'autre chance ? »50(*). La biodiversité des écosystèmes est présentée comme étant une voie de forte altération. Le rythme de disparition des espèces s'accélère avec la perspective à 2050 d'un rythme 100 à 1 000 fois supérieur au rythme naturel. Certains biotopes sont particulièrement menacés (les milieux humides et les eaux continentales notamment) atteints par la pollution et l'usage excessif de l'eau par l'agriculture qui excède les possibilités d'adaptation des espèces aux cycles biologiques. Le rapport indique qu'en trente ans, la Beauce a perdu plus de 30 % des composés organiques de son sol. Les pressions traditionnelles s'accroissent puisque, selon le rapport, depuis 1990, l'empreinte écologique de l'humanité dépasse les capacités de reconstitution de la planète. Le changement climatique devrait accentuer le processus, les hypothèses du GIEC estimant que 35 % des espèces mondiales pourraient disparaître de son fait. Le rapport affirme l'urgence des initiatives à prendre. Il faut en particulier réduire les pressions sur les forêts tropicales, les ressources marines et les espaces naturels. La protection des forêts tropicales passe par l'amplification de la conservation, mais aussi par la généralisation de l'exploitation rationalisée et par sa réinsertion dans l'économie mondialisée. La constitution de réserves forestières doit être entreprise. L'exploitation des forêts doit être rationalisée car lorsqu'une forêt tropicale n'est plus exploitée elle ne vaut rien et est donc détruite au profit d'installations d'élevage (Brésil), ou de plantations industrielles (Asie du Sud-Est ou Afrique). Il est donc nécessaire d'exploiter la forêt mais de façon beaucoup plus rationnelle qu'on ne le fait souvent. Enfin, une réinsertion réussie de l'économie forestière dans la mondialisation oblige à corriger les prix du marché pour tenir compte d'une rareté que les coûts structurels de son exploitation ne reflètent pas suffisamment. Pour les ressources marines, la FAO estime que la moitié des stocks halieutiques sont exploités au maximum et qu'un quart est surexploité ou épuisé. Pour sauver les stocks restants, il est nécessaire de mettre en oeuvre une gestion durable des ressources maritimes, ce qui implique : - d'amplifier la constitution de réserves maritimes ; - d'accorder une attention particulière à la gestion des milieux côtiers car en 2050, 80 % de la population mondiale vivra sur les côtes ; - de refondre la gouvernance de la pêche en la faisant reposer sur l'efficacité des contrôles et l'expérimentation d'attribution de quotas de pêches individuels et rétrocessibles. Quant aux espaces naturels, le rapport propose qu'une réforme de la loi de 1976 intervienne pour compenser toute destruction d'espaces naturels par une restauration d'autres surfaces, ainsi que la création d'un marché de la compensation des atteintes aux espaces naturels qui serait le pendant du marché des émissions de C02. Les menaces sur la biodiversité doivent être mieux anticipées. Ainsi, des effets du changement climatique par la mise en place des structures d'observation à long terme et la systématisation de la modélisation prédictive sur les réactions des écosystèmes. La conservation des semences s'impose, la France devant s'associer notamment au conservatoire mondial des semences culturales géré par la FAO. Il convient de mettre fin à l'anomalie que constitue l'interdiction de vente des semences culturales anciennes qui ne figurent pas au catalogue officiel. Un registre de ces semences devrait pouvoir être mis en place et géré par le Bureau des Ressources Génétiques (BRG). La vente par les associations de protection de la biodiversité ne devrait plus constituer un délit. Sur le problème des transgénèses et de l'adaptabilité génétique, le rapport estime que la généralisation des cultures d'organismes génétiquement modifiés n'est pas favorable au maintien de la biodiversité mais que le recours à des transgénèses permet de développer la résistance des espèces à la sécheresse et qu'ainsi le recours à une sélection génétique traditionnelle plus poussée devrait être exploré. Les concurrences futures d'occupation d'espaces doivent être réglées convenablement. L'extension actuelle des cultures dédiées aux biocarburants et dont l'impact écologique est négatif contribue fortement à la déforestation dans le sud-est asiatique et il serait souhaitable de proclamer en Europe un moratoire sur l'utilisation de ces biocarburants, en attendant la deuxième génération. Par ailleurs, il faut anticiper les effets des perturbations de l'hydrosphère qui s'annoncent. À cet égard, la mise en oeuvre progressive d'une agriculture de précision optimisant les processus naturels est indispensable, les techniques de forçage du sol et de lutte contre les ravageurs ayant atteint des zones de rendements décroissants. Les moyens d'étude de la FAO devraient être renforcés par des liens plus étroits avec les structures telles que l'INRA, le CEMAGREF, le CIRAD pour promouvoir cette agriculture de précision. Enfin, le rapport appelle à valoriser la biodiversité. Deux axes se profilent dans ce domaine : - la rémunération des services rendus par les écosystèmes ; - et l'exploration d'un réservoir de biens qui pourrait être une des boîtes à outils de la quatrième révolution industrielle. La rémunération des services écologiques est justifiée par l'importance des apports de la biodiversité aujourd'hui mal rémunérés. Ainsi, des services sanitaires qu'elle rend puisque la biodiversité est un facteur important d'inhibition de nombreuses maladies (leishmaniose, maladie de Chagas, maladie de Lyme, etc.) ; le changement de climat renforçant l'importance de cette inhibition, assurée par la biodiversité des écosystèmes. Quant aux services agronomiques, outre la pollinisation, la biodiversité rend des services agronomiques forts : - l'accroissement de la biomasse ; - des recherches menées en Europe et aux États-Unis sur les plantes herbacées révélant une corrélation positive entre le nombre d'espèces plantées et la récolte de biomasse à l'hectare. Des travaux identiques menés par l'INRA sur les céréales donnent des résultats similaires. - la résistance à la sécheresse dont des expériences de même ordre faites aux États-Unis et au Burkina Fasso montrent que l'accroissement de la biodiversité permet d'en élever le niveau ; - la résistance aux ravageurs au sujet de laquelle des études de l'INRA ont mis en évidence que l'insertion de feuillus dans des plantations industrielles de conifères faisait baisser l'impact des ravageurs. Enfin, les services hydrologiques rendus par les zones humides - dont la moitié ont disparu en France depuis cinquante ans -, les forêts, les talus jouent un rôle capital dans la distribution hydrologique - et principalement sur deux points, la filtration et le cycle de rétention-élimination lente de l'eau. Le chiffrage des biens et services fournis par la biodiversité a été estimé autour de 33 000 milliards de dollars en 1997, soit un chiffre analogue à celui du PIB mondial d'aujourd'hui (de l'ordre de 35 000 milliards de dollars). Mais la rémunération de ces biens publics est embryonnaire. Aussi le rapport recommande-t-il : - à l'échelle française, la création d'un marché de compensation des destructions d'espaces naturels fondé sur l'opposabilité d'« unités de biodiversité » négociables. Ce marché pourrait être complété par des actions spécifiques de rémunération des services hydrologiques rendus par les espaces naturels (zones humides, forêts, pays bocages) ; - à l'échelle européenne, le renforcement des mesures agro-environnementales du second pilier de la PAC (actuellement seulement 10 % du montant de la politique agricole commune) qui sera favorisé par la hausse du prix des matières premières agricoles. Ces actions sont d'autant plus justifiées que la biodiversité constitue l'une des boîtes à outils de la nouvelle révolution industrielle à travers : la biomimétique et la bioinspiration et l'usine du vivant qu'offre le monde bactérien. Par rapport à la chimie, les biotechnologies offrent plusieurs avantages : elles sont beaucoup plus économes en énergie puisqu'elles ne nécessitent pas de thermisation et utilisent des matériaux renouvelables et sont beaucoup plus précises. |
C. DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES DE PLUS EN PLUS CONTESTÉS
Pour une part très importante, l'augmentation des rendements agricoles a été déterminée par l'utilisation de produits phytopharmaceutiques (herbicides, fongicides, insecticides).
Or, l'utilisation de ces produits est, plus ou moins complètement, remise en cause, y compris par des acteurs informés, intervenant dans les différents champs de la connaissance scientifique concernés par le sujet.
Le débat n'est évidemment pas clos sur ces problèmes mais son existence témoigne en soi d'incertitudes sur certains modes de production et il représente comme tel une hypothèque pour la production agricole et ses perspectives.
Celle-ci est difficilement appréciable alors que la production agricole devra augmenter dans des proportions, qui peuvent varier selon les scénarios envisagés, mais qui restent toujours considérables.
À cela, il faut ajouter que les inquiétudes sur les produits phytopharmaceutiques tombent d'autant plus mal que les risques agricoles liés aux différents vecteurs pathogènes paraissent devoir se renforcer sous l'effet des facteurs divers et qui se combinent :
- l'intensification des échanges internationaux qui favorise le transport d'agents pathogènes ;
- le réchauffement climatique qui peut susciter des déséquilibres propices à leur multiplication ou à des invasions d'insectes aujourd'hui cantonnés dans les pays chauds ;
- la disparition des « réserves à virus » que représentent les forêts tropicales qui les libèrent, notamment quand les oiseaux qui y résident s'envolent par nécessité vers d'autres destinations ;
- la réduction de la biodiversité et l'hyper-sélection des espèces cultivées qui conduit à concentrer les risques en diminuant la résilience du système de production agricole...
1. Une utilisation très inégale des produits phytopharmaceutiques
La France tient une place importante dans la consommation et la production de ces produits.
Le chiffre d'affaires des industries installées sur le territoire (16 sites) s'élèverait à environ 2 milliards d'euros, la France étant le premier exportateur devant l'Allemagne.
À la fin de la décennie précédente, le pays était également le quatrième utilisateur de phytosanitaires dans le monde derrière les États-Unis, le Brésil et le Japon. Il est probablement devancé aujourd'hui par l'Inde et la Chine. En consommation par hectare, la France serait au troisième rang européen (5,4 kg/ha/an).
Le chiffre d'affaires mondial de l'industrie phytopharmaceutique à destination agricole s'élevait en 2010 à 38,3 milliards de dollars et était ainsi réparti.
Répartition du chiffre d'affaires par région du monde en 2010
On constate une forte disparité des consommations par région, constat qui s'étend à l'intérieur de l'Europe, première utilisatrice de ces produits :
Les marchés phytosanitaires en Europe en 2009
On observe que les agricultures les plus prolifiques sont aussi celles qui utilisent le plus de phytopharmacie mais la variabilité dans l'utilisation des pesticides n'est que partiellement corrélée avec l'ampleur des productions agricoles.
Les marges existant de ce point de vue peuvent tenir aux différences de spécialisation agricole. Certaines productions sont plus consommatrices que d'autres : l'arboriculture fruitière, la vigne, les cultures maraîchères, mais aussi les céréales et le colza du fait de l'étendue des surfaces concernées.
L'INRA et le Cemagref dans leur rapport « Pesticides, agriculture et environnement » (décembre 2005) relèvent qu'un « nombre restreint de cultures (céréales à paille, maïs, colza et vigne), qui occupent moins de 40 % de la SAU (Surface agricole utile) nationale, utilisent à elles seules près de 80 % des pesticides vendus en France chaque année.
Occupation du territoire et consommation de
pesticides
pour quelques cultures
(données 2000,
sources SCEES, UIPP)
|
Cultures |
Pourcentage de la SAU française |
Pourcentage |
Remarques |
|
Céréales à paille |
24 % |
40 % |
60 % fongicides 35 % herbicides |
|
Maïs |
7 % |
10 % |
75 % herbicides |
|
Colza |
4 % |
9 % |
|
|
Vigne |
3 % |
20 % |
80 % fongicides |
|
Ensemble |
38 % |
79 % |
En 1998, l'arboriculture fruitière (1 % de la SAU) représentait en valeur 4 % du marché national des fongicides, et 21 % du marché des insecticides. »
Mais la variabilité dans l'intensité d'utilisation des phytosanitaires est également attribuable aux pratiques agricoles qui sont elles-mêmes le résultat de facteurs diversifiés, économiques, sociaux, institutionnels, agronomiques...
Sous cet angle, il existe une summa divisio entre agricultures intensives et agricultures moins soumises à la logique d'intensification.
C'est du moins ce que suggère le rapport précité.
« Avant l'avènement des produits phytosanitaires, les systèmes de culture étaient conçus pour assurer le meilleur compromis entre risque phytosanitaire et potentiel de production de la culture. Progressivement, l'acquisition de connaissances sur les besoins d'une culture en éléments minéraux et la maîtrise de la fertilisation, le développement après la seconde guerre mondiale des herbicides qui permettaient de supprimer la concurrence des adventices, et des insecticides qui permettaient de s'affranchir de dégâts d'insectes puis, à partir de 1970, le développement des premiers fongicides de synthèse utilisés en végétation pour protéger les plantes contre les maladies ont profondément modifié les systèmes de culture.
Disposant de moyens d'intervention directe sur les principaux bio-agresseurs de ses cultures, l'agriculteur dissocie alors souvent dans son choix d'itinéraire technique ou de système de culture, les éléments qui contribuent à la recherche du potentiel de production le plus élevé et ceux qui préservent ce potentiel. Cette logique conduit à privilégier les pratiques en fonction d'un objectif de production, même si elles augmentent le risque phytosanitaire, puis à « traiter les symptômes » lorsqu'ils se manifestent.
2. Une utilisation contestée
Les pesticides, à la fois efficaces, d'un coût relativement faible et faciles d'emploi, ont contribué au développement de systèmes de production intensifs, qui bénéficiaient par ailleurs de marchés et de prix agricoles favorables, et de la sous-évaluation des conséquences environnementales de leur usage qu'il convient de gérer maintenant. »
Le propos est pour le moins nuancé mais il suggère d'une part l'existence d'un système d'incitations peu propice à une utilisation parcimonieuse des produits sous revue, du fait notamment de la sous-évaluation des conséquences environnementales, et, d'autre part, la nécessité de pondérer les progrès de production permis par ces produits par la considération de leurs nuisances auxquelles il convient désormais de porter remède.
En bref, la soutenabilité des produits phytopharmaceutiques est mise en cause. La montée des inquiétudes quant aux effets des produits en cause est tendancielle.
Celles-ci ont été décrites dans un récent rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST)51(*).
Elles sont d'abord associées au constat d'une exposition plurielle des populations aux substances actives52(*).
Ainsi, selon l'IFEN (Institut français de l'environnement), en 2006, les pesticides sont détectés au moins une fois dans 90 % des points de mesure du réseau de connaissance générale de la qualité des cours d'eau (1097 points) et dans 55 % des points dans le cas des eaux souterraines (1507 points).
Ces mesures traduisent une dispersion très importante des pesticides et une présence généralisée dans les milieux aquatiques.
La présence de certains pesticides dans les sols avec, par exemple, une rémanence forte d'organochlorés interdits depuis plus d'une décennie, est avérée mais reste très peu quantifiée, ce qui est source d'inquiétudes.
Aucune norme ne règlemente les teneurs en pesticides dans l'air et les données relatives aux niveaux de contamination sont beaucoup moins nombreuses que celles dont on dispose au niveau national pour les eaux.
Pourtant, l'Institut de veille sanitaire a considéré comme « non-négligeables » les contaminations aériennes aux abords des exploitations agricoles, en particulier près des vignes et des vergers.
Les pesticides sont également très présents dans l'air intérieur des bâtiments.
Les programmes de surveillance des denrées alimentaires, qui sont lancés au niveau européen et au niveau national se révèlent plutôt rassurants.
Pourtant, si le programme 2007 de la DGCCRF établit que 92,4 % des fruits et légumes analysés respectent la réglementation, la part de la production ne respectant pas les LMR peut être généralement interprétée comme étant la conséquence de mauvaises pratiques agricoles.
À ces constats croisés sur la diversité des modes d'exposition effective53(*) aux pesticides s'ajoute le poids des préoccupations qu'ils font naître pour la santé humaine notamment.
Seuls les effets aigus sont bien répertoriés.
En revanche, les effets retardés de l'accumulation sont mal connus. Or toute la réglementation repose sur le principe de Paracelse : « Rien n'est poison, tout est poison : seule la dose fait le poison », paradigme qui tend à être remis en cause sur des bases scientifiques. À cet égard des effets retardés non linéaires sont de plus en plus envisagés sans que des validations épidémiologiques qui supposent notamment un temps long, soient toujours possibles.
Les préoccupations pour la santé tournent plus particulièrement autour des effets des phytosanitaires comme perturbateurs endocriniens54(*) qui ont été étudiées dans un remarquable rapport de l'OPECST, comme facteur de troubles neurologiques (les agriculteurs exposés aux pesticides auraient un risque presque deux fois plus élevé de développer la maladie de Parkinson que ceux qui n'en utilisent pas) et dans l'étiologie du cancer.
Parmi les substances actives, les insecticides organochlorés (dont font partie le DDT et le lindane désormais sous des régimes d'interdiction plus ou moins complets) sont particulièrement en cause.
Ces préoccupations ont également eu pour effet de bouleverser les autorisations d'emploi des produits phytosanitaires et l'adoption d'un dispositif ambitieux de restriction des utilisations.
Il faudrait ajouter une considération supplémentaire dépassant la seule question du couple « rendement-nuisance » pour indiquer que la contribution des produits phytopharmaceutiques à « l'agriculture de rendement » permet aussi de concentrer la production agricole et, ainsi, d'éviter de mobiliser des surfaces supplémentaires dont l'intérêt environnemental peut être élevé.
L'arbitrage implicite que ceci suggère est celui entre un haut degré de préservation des surfaces terrestres qui suppose l'utilisation des produits chimiques pour élever les rendements et l'extensification de la production agricole qui nécessiterait le maintien d'une consommation réduite d'intrants.
Dans l'ensemble des prospectives, cet arbitrage est particulièrement présent, ce qui semble traduire l'existence d'un conflit d'objectifs, ou du moins de conceptions, sur la meilleure manière de concilier le nécessaire développement de la production agricole et la préservation de l'environnement.
Il apparaît assez difficile de trancher ce débat, sur un plan purement environnemental, d'autant qu'une troisième voie - celle de la promotion d'une « révolution doublement verte » - est assez systématiquement avancée pour le transcender.
3. Une tendance à la rationalisation ?
a) La législation européenne
La tendance, du moins en Europe, est peu équivoque : la réglementation des phytopharmaceutiques y connaît un durcissement progressif.
Ces produits font l'objet d'une réglementation européenne qui fixe des règles de commercialisation, et d'utilisation ainsi que des limites maximales des résidus dans les denrées alimentaires.
La directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 est longtemps restée le texte de référence jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 1107/2009 à partir du 14 juin 2011.
Elle instaure une procédure d'autorisation de mise sur le marché après évaluation préalable des risques de chaque substance active.
L'autorisation, accordée par l'État membre sur le territoire duquel le produit est mis sur le marché pour la première fois, valable 10 ans et renouvelable, peut être retirée si les conditions requises ne sont plus remplies, et modifiée si l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques le justifie.
Pour assurer la libre circulation des produits, un mécanisme de reconnaissance mutuelle a été prévu comportant néanmoins une clause de sauvegarde, permettant à un État membre de limiter ou d'interdire de manière provisoire la circulation d'un produit sur son territoire s'il présente certains risques pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement.
La directive harmonise également les règles concernant l'étiquetage et l'emballage des produits phytopharmaceutiques et les informations devant y figurer, notamment les instructions d'emploi et la dose à appliquer pour chaque usage autorisé ainsi que les indications concernant la phytotoxicité éventuelle du produit.
Le règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques modifie sensiblement les règles de mise sur le marché applicables par l'ensemble des États membres.
La principale novation est la substitution des critères d'exclusion fondés sur le danger aux critères de risque.
Désormais, pour être approuvée, et sauf exceptions particulières, une substance active ne doit pas être classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. Elle ne doit pas non plus être considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens.
Enfin, la substance active ne doit pas être identifiée comme un polluant organique persistant (POP), ni comme étant de type persistant, bioaccumulable et toxique (PBT), ni comme étant très persistant et très bioaccumulable (vPvB).
Le règlement prévoit de répertorier séparément les substances qui répondent à certains critères jugés préoccupants, et de limiter la durée de leur approbation.
Il planifie, par ailleurs, la réalisation d'évaluations comparatives pour les produits phytopharmaceutiques contenant de telles substances afin que les États membres puissent éventuellement les remplacer par des spécialités présentant des risques sensiblement moins élevés pour la santé animale ou l'environnement, ou par des méthodes non chimiques de prévention ou de lutte.
Une liste regroupant les substances déjà inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et considérées comme des substances dont on envisage la substitution sera établie au plus tard le 14 décembre 2013 par la Commission.
On relève que le règlement n'a pas d'effet rétroactif si bien que les autorisations en cours restent valables mais jusqu'à leur terme seulement.
De même, il vaut d'être noté qu'a été choisie une approche zonale. Le règlement définit trois zones d'autorisation des produits phytopharmaceutiques : Nord, Centre et Sud Europe, la France faisant partie de cette dernière. La demande d'évaluation d'un produit est réalisée par un État membre rapporteur pour l'ensemble, l'autorisation de mise sur le marché restant nationale.
Cette approche zonale de l'évaluation d'un produit est destinée à permettre d'harmoniser les procédures et d'éviter ainsi les distorsions de concurrence.
Le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 fixe les limites maximales applicables aux résidus de pesticides (LMR). Ces dispositions confient à l'Agence européenne de sécurité alimentaire l'évaluation de la sécurité des produits, sur la base des propriétés des pesticides, des limites maximales et des différents régimes alimentaires des consommateurs européens.
Enfin, la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaure un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, notamment en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à des méthodes ou techniques de substitution, telles que les moyens non chimiques alternatifs aux pesticides.
Les législations nationales viennent compléter le socle communautaire.
b) La législation française
Pour la France :
l'arrêté du 14 avril 1998, souvent modifié, établit en droit national la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques ;
le code rural fixe les règles relatives à la protection des végétaux, à la mise sur le marché, à la distribution et à l'application des produits phytosanitaires, aux matériels destinés à leur application, ainsi qu'aux compétences de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
l'article L. 1323-1 du code de la santé publique, confie à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments la charge de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du code rural.
L'État s'appuie en matière de conseil et de contrôle du bon usage des pesticides sur les SRPV (Services régionaux de protection des végétaux) et sur la DGCCRF (Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes).
Le durcissement de la réglementation n'est pas général, ni dans le monde, ni en Europe, ce qui pose d'importants problèmes de cohérence de l'action publique et, avant tout, d'application du principe de précaution qui fonde en France le processus.
Malgré tout, d'ores et déjà, un très grand nombre de substances ont été retirées du marché.
Dans les années 90, un millier de substances étaient disponibles. Depuis, les deux tiers d'entre elles ont été abandonnées tandis qu'un certain nombre de substances nouvelles faisaient leur apparition. À la suite du « Grenelle de l'environnement », une nouvelle cinquantaine de produits ont été éliminés si bien qu'au total, ne restent sur le marché que 40 % des produits accessibles en 1990.
Ces évolutions, qui peuvent résulter de décisions des industriels ou des autorités publiques, ne manquent pas d'interroger sur les systèmes d'autorisation de mise sur le marché, même si, dans la mesure où elles se trouveraient justifiées du point de vue sanitaire, cette interrogation ne doit pas en interrompre, ou en freiner, le flux55(*).
Mais, on peut observer que, moyennant peut-être une plus grande sélectivité des produits, ces retraits n'ont pas trouvé de traduction dans une baisse, à due proportion, des utilisations.
Par ailleurs, une inquiétude supplémentaire existe aujourd'hui avec le développement des trafics de substances aux origines et aux compositions douteuses, impliquant semble-t-il de plus en plus fréquemment des produits périmés ou contrefaits.
Ce phénomène est classique dans les processus de prohibition. Mais il appelle une vigilance sans faille, et les moyens de cette vigilance, d'autant que la libéralisation des échanges et l'ouverture de fait des frontières favorisent ces trafics.
Cet enjeu n'est nullement négligeable si l'on souhaite que les engagements pris pour réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques soient atteints sans par ailleurs créer de risques sanitaires nouveaux à travers des empoisonnements qui, pour être (plus) sporadiques, n'en seraient pas moins dramatiquement aigus.
4. Le plan « Ecophyto-2018 » : la question de la faisabilité d'une politique de réduction des phytopharmaceutiques
Engagé à la suite du Grenelle de l'environnement, le plan « Ecophyto-2018 » vise à réduire de 50 % l'usage des pesticides dans un délai de dix ans.
La réduction lente mais continue du nombre de doses unités (NODU) de pesticides (passées de 67 millions en 2009 à 60 en 2011, avec une prévision à 57 en 2012) est présentée comme offrant l'indicateur d'une progression du plan qui suppose des engagements de crédits croissants : 11,3 millions d'euros en 2009, 25,8 millions d'euros en 2010 et 36,5 millions d'euros en 2011, financés à partir d'un prélèvement sur la redevance pour pollution diffuses et très résiduellement par des crédits budgétaires.
Une précision décisive doit être apportée : l'objectif de réduction du plan est conditionné à sa possibilité de réalisation.
Cette condition paraît utile puisqu'une étude réalisée en amont par l'INRA avait conclu que, si une réduction des usages des pesticides comprises entre 20 et 30 %, dans le cadre d'une stratégie dite « de protection intégrée des cultures », permettrait, malgré la baisse des rendements (de 6 à 8 % pour les grandes cultures fruitières notamment), de maintenir à peu près le revenu agricole, d'autres scénarios plus ambitieux, de « production bio » altérerait franchement, et les rendements, et les revenus agricoles sans pour autant que leur bilan environnemental apparaisse clairement.
Il est intéressant de donner quelques indications sur les différentes stratégies productives envisagées dans cette étude dans la mesure où elles couvrent à peu près toute la gamme des possibles du plus « productiviste » à l'agriculture la plus « biologique ».
Cinq stratégies sont analysées : l'agriculture intensive, l'agriculture raisonnée, la protection intégrée des cultures, des conduites agricoles impliquant des modifications des systèmes de production, une agriculture biologique.
Ces cinq scénarios correspondent à des niveaux de pression sur l'environnement attribuable aux produits phytopharmaceutiques très différenciés. Ils sont récapitulés dans le tableau ci-dessous où le niveau NA correspond à la situation actuelle en moyenne, les cinq niveaux suivants correspondant aux cinq scénarios envisagés.
On observe que le scénario intensif (N0) est plus consommateur en produits phytosanitaires et que le scénario d'agriculture raisonnée (N1) est à peu près celui suivi par l'agriculteur français moyen.
Évolution de la pression des phytopharmaceutiques selon les niveaux de rupture
Le scénario N2 implique une baisse de l'utilisation des pesticides d'environ un tiers, le scénario N2c de 50 % et le scénario N3 de près de 80 % en moyenne.
À ces abattements dans l'utilisation des pesticides correspondraient des évolutions des rendements différenciées mais qui atteignent des niveaux significatifs de rupture autour d'une baisse de l'utilisation des pesticides au-delà de 30 %.
L'identité des résultats des scénarios N2a et N2c ne doit pas faire illusion. Elle vient de ce que le scénario N2c suppose l'introduction de rotation longues qui, égalisant les rendements des cultures pris individuellement, n'en ont pas moins des effets sur la production globale. En effet, les cultures introduites dans ce système de production ont des rendements plus faibles que les cultures dominantes dans le système actuel.
Les données ci-après traduisent ces effets.
Alors que la baisse de la production au niveau N2a (où l'utilisation des pesticides est réduite) atteint environ 6 %, elle dépasse 12 % pour une baisse de moitié avec des résultats beaucoup plus amples pour certaines cultures (blé dur, colza, pomme de terre...).
Il faut relever que l'ensemble de ces résultats est confirmé par des études, britanniques ou allemandes, qui ont chiffré la baisse des rendements pour le blé résultant de l'adoption de certains projets d'interdiction des pesticides, débattus au Parlement européen, à 50 %.
Ces différents scénarios de production exerceraient des impacts sur les revenus agricoles eux-mêmes différenciés.
En considérant les prix comme exogènes, c'est-à-dire sans qu'une réaction haussière pourtant probable, n'intervienne, les revenus agricoles par hectare peuvent reculer jusqu'à un tiers tandis que pour la « ferme France » le recul pourrait faire passer le produit agricole de 20,2 à 13,6 milliards d'euros.
Note : la colonne N3_2 correspond au modèle d'agriculture biologique avec des prix plus élevés que ceux où s'écoulent les produits « non-bio ».
L'évolution des marges serait à peu près parallèle, sous réserve que la structure des prix agricoles modifie assez sensiblement les écarts de performances de l'agriculture intensive et de l'agriculture raisonnée.
Quand les prix sont tendus l'agriculture intensive voit ses marges s'améliorer, le surplus de recettes faisant plus que compenser les charges d'exploitation plus lourdes qu'elle supporte.
Ces développements montrent qu'en l'état des techniques, il existe un arbitrage entre l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les rendements et la production agricoles et apportent quelques précisions sur les termes quantitatifs de cet arbitrage.
Dans tous les cas, l'agriculture intensive aboutit à des gains de rendement et de production. Mais, des systèmes alternatifs sont compatibles avec une optimisation du couple « risques-production ». Ces résultats valent pour la France. Mais, on ne peut manquer de s'interroger sur les effets que produirait l'adoption de systèmes de production différenciés du point de vue de l'équilibre entre les rendements et l'économie de produits phytopharmaceutiques dans le monde.
Les agricultures des pays en développement si elles ne sont pas nécessairement des agricultures biologiques utilisent en moyenne beaucoup moins ces produits que les agricultures du monde développé ou des pays émergents qui ont réalisé leur décollage agricole au moyen des pratiques de la « Révolution verte ». Et, il paraît évident qu'une utilisation plus répandue des produits phytopharmaceutiques serait, à technologie inchangée, favorable au développement agricole des pays en retard de développement.
On peut même affirmer que, sans elle, la production agricole ne pourra suivre les besoins alimentaires du monde et tout particulièrement des pays considérés.
Toutes choses égales par ailleurs, l'agriculture biologique ne semble pas permettre de nourrir le monde et son adoption dans les pays où elle représente un choix pourrait compliquer la solution du problème alimentaire, du moins sur un plan strictement quantitatif.
* *
*
Ce diagnostic demande certainement à être affiné. Il faudrait que ces questions soient systématiquement abordées dans la gouvernance du développement agricole à laquelle appelle le présent rapport. Sur ce point, celui-ci doit associer la préoccupation de mieux considérer les effets sanitaires et environnementaux des produits phytopharmaceutiques (et des autres produits pharmaceutiques utilisés dans l'agriculture avec la considération de leurs effets économiques de tous ordres).
Il semble également acquis que le développement agricole ne peut emprunter les voies du passé et que sa conception et sa conduite doivent et peuvent être renouvelés : des marges d'optimisation existent.
La France dispose d'atouts pour qu'elles soient efficacement explorées. Elle devrait porter ce sujet au plan international.
IV. VERS UNE NOUVELLE AGRICULTURE ?
Les limites de la Révolution verte paraissent de plus en plus entrer dans les débats sur l'agriculture de demain, ce qui conduit à proposer des solutions alternatives qui, à leur tour, posent chacune des problèmes.
Le surpompage de l'eau des nappes phréatiques ou fossiles, les pollutions de l'eau communiquées aux organismes (arsenic, pollutions chimiques, hydrocarbures...), les pollutions agricoles via les engrais, les épidémies animales (oiseaux, porcs) amplifiées par la concentration des productions, dans leur probabilité et dans leurs conséquences, la progression d'une agriculture destructrice des espaces forestiers entraînant des bouleversements des écosystèmes susceptibles de détruire les possibilités de l'agriculture locale (ex : changement du régime pluvial) mais aussi d'affecter l'environnement mondial, sont autant de problèmes attribués, peut-être avec quelque excès parfois, à la Révolution verte.
S'ajoutent des problèmes déjà évoqués :
- la destruction des sols et l'érosion liés à l'utilisation des techniques de travail du sol mis à nu pendant des périodes longues où il est vulnérable ;
- la contribution de l'agriculture à l'effet de serre (1/3 des émissions de gaz à effet de serre) causées par la déforestation par brûlis, le labour qui accélère la production de dioxyde de carbone par la faune du sol, l'irrigation des sols qui produit du méthane, l'utilisation d'engrais azotés et les émissions de méthane par les ruminants ;
- l'érosion de la biodiversité notamment du fait de la réduction à une centaine des espèces consommées par les sociétés humaines.
Face à ces limites, la « communauté » des spécialistes de l'agriculture (producteurs, fournisseurs, savants...) est loin d'être unanime :
- la détermination précise des questions de soutenabilité n'est nullement achevée ;
- les réponses aux problèmes évoqués sont diverses et contradictoires.
Cette situation n'a rien de choquant étant donné les difficultés posées par les questions abordées.
Mais, il est beaucoup plus regrettable que ces débats ne soient pas systématiquement organisés.
Aux niveaux nationaux, des pays disposent d'institutions à cet effet. Elles sont régulièrement contestées notamment au nom des conflits d'intérêts qui peuvent fragiliser leur crédibilité.
Mais, tous les pays ne disposent pas de telles institutions. C'est pourtant un problème mondial qui est ainsi posé même si ce problème se décline différemment dans le cadre de chaque espace national, en fonction des niveaux et des modalités du développement agricole. Il existe bien sûr des institutions plus ou moins mondiales qui prennent en charge les problèmes ici évoqués. Ainsi des grandes institutions du développement agricole avec, par exemple, le CODEX alimentarius.
Mais, outre les problèmes de crédibilité de ces instances, se pose celui de l'intégration des dimensions nécessairement plurielles des questions que posent les modalités du développement agricole.
Une institutionnalisation nationale et internationale plus aboutie devra être entreprise pour piloter un système alimentaire dont la complexité déjà très élevée se renforcera certainement dans le futur dans un contexte où les interdépendances iront grandissantes.
Si, selon une expression heureuse, « la mondialisation est déjà dans nos assiettes » nous avons tout intérêt à ce que la mondialisation agro-alimentaire soit nettement mieux organisée.
Sous le bénéfice de ces observations, qui devraient inciter notre haute assemblée à évaluer systématiquement les institutions existantes pour traiter ces problèmes, dans notre propre pays mais aussi dans le monde, il est généralement admis que les voies d'une élévation des rendements sont diversifiées.
Elles vont des plus « technologiques » aux plus « artisanales » en passant par l'extension des pratiques de la « Révolution verte ».
Votre rapporteur n'est pas agronome et l'objet du présent rapport n'est pas de rendre compte en détail des discussions techniques et encore moins d'évaluer les différentes options mises en débat. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui a déjà beaucoup apporté de ce point de vue sur des questions particulières pourrait très utilement reprendre globalement ces questions.
On se bornera ici à indiquer quelques unes des trajectoires envisagées et à formuler quelques observations à leur propos.
L'un des enseignements majeurs sur lequel il faut appeler l'attention est qu'il n'existe apparemment aucun modèle universel susceptible de s'imposer lorsqu'on se place sur un terrain normatif pour au moins deux raisons :
- chaque situation agricole paraît réclamer la poursuite d'une logique propre ;
- chaque « modèle » présente des défauts.
Ces observations devraient avoir des prolongements pratiques dans un « monde agro-alimentaire » idéal.
Pourtant, ce monde n'existant pas, sauf à le créer, ce que votre rapporteur appelle de ses voeux, il faut considérer la dynamique du système. Celle-ci pourrait bien se traduire par des solutions allant à rebours des évolutions souhaitables.
A. LES VOIES D'UNE AMÉLIORATION DES RENDEMENTS SONT PLURIELLES
1. Une « super-Révolution verte » est-elle réaliste ?
Une super-Révolution verte consisterait à accroître le potentiel génétique des plantes pour obtenir plus de rendement et à mettre en place des conditions de production permettant l'expression de ce potentiel.
Son horizon est encore assez indéterminé mais il comporte toute la gamme des progrès techniques, de l'ensemble des biotechnologies au recours à l'agriculture « high tech ».
Les biotechnologies incluent évidemment les organismes génétiquement modifiés qui n'en sont cependant qu'une des composantes.
Le développement des biotechnologies est un pari de plus en plus tenté dans le monde et les OGM sont largement diffusés.
Le soja transgénique est la culture la plus répandue avec 52 % des surfaces utilisées, représentant 75 % de la production mondiale. Il est suivi par le maïs, le maïs transgénique occupant un quart des 188 millions d'hectares consacrés dans le monde à cette céréale.
|
La formidable expansion des cultures génétiquement modifiées L'utilisation des cultures génétiquement modifiées a considérablement progressé depuis la fin des années 90. En 1996, 6 pays recouraient aux OGM, 18 en 2003 et 25 en 2009. Les pays où la surface concernée dépasse le million d'hectares sont : les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, l'Inde, le Canada, la Chine, le Paraguay et l'Afrique du Sud. Principaux pays de production de cultures
génétiquement modifiées en 2009
En Europe, la République tchèque, le Portugal, la Roumanie, la Pologne, la Slovaquie et l'Allemagne arrivent en tête. Les surfaces plantées en cultures transgéniques ont augmenté rapidement passant de 1,7 à 134 millions d'hectares entre 1996 et 2009. Aujourd'hui 9 % des terres cultivables sont vouées aux cultures OGM. |
Les OGM ne sont qu'une des techniques de la sphère en expansion des biotechnologies.
Ils correspondent à un processus consubstantiel à l'agriculture la sélection des semences, avec toutefois des particularités évidentes. D'autres méthodes traditionnelles, ou plus récentes, la mutagenèse, les hybrides FI ou la polyploïdisation, revendiquent parfois des effets analogues aux OGM comme la tolérance aux herbicides ou la résistance à des ravageurs. Ils ne font pas l'objet d'une surveillance sanitaire ou environnementale égale à celle prévue pour les OGM alors même qu'ils peuvent poser des problèmes similaires.
Cette différence de réglementation pourrait ne pas durer.
Sous l'angle du présent rapport, il n'est pas question de trancher les débats sur les risques sanitaires et environnementaux des biotechnologies.
Les questions qu'on souhaite aborder sont de savoir si la diffusion des biotechnologies peut contribuer à la résolution de l'équation alimentaire et, plus précisément, si elle peut favoriser la mise en oeuvre effective du droit à l'alimentation.
D'un point de vue économique, les biotechnologies représentent a priori une source de gains de productivité agricole. La productivité par hectare est censée augmenter du fait de leur usage tout comme elle augmente lorsqu'on emploie des semences adaptées ou des intrants classiques (engrais, phytopharmaceutiques...).
Mais cet effet de productivité est-il pour autant synonyme d'une augmentation de la production agricole ? Telle est la question. Plusieurs scénarios doivent être envisagés :
- un accroissement de segmentation de l'offre agricole, avec une distribution des progrès de productivité inégale, la diffusion du progrès technique pouvant évincer du marché des producteurs qui n'en bénéficient pas ; cette hypothèse correspond à des effets classiques des chocs technologiques ;
- les biotechnologies peuvent augmenter la productivité en volume mais sans pour autant que cela se répercute sur la productivité en valeur des exploitations si le coût d'accès aux biotechnologies augmentent plus que les prix agricoles, évolution d'autant plus probable que les fonctions de production seraient irréversibles ;
- enfin, un scénario de diffusion n'est pas à exclure, mais il est plus que probable qu'il s'accompagne de tous les effets usuels des chocs technologiques.
Selon divers points de vue, l'accroissement du potentiel génétique semble de plus en plus difficile avec le temps.
Obtenir les meilleures conditions possibles de rendement est encore plus délicat : une agriculture à hauts rendements exige un accès permanent aux parcelles pour apporter les corrections nécessaires, ce qui est techniquement problématique et très coûteux en personnel.
Comme on l'a indiqué précédemment, l'augmentation de la productivité naturelle a un coût technique qui peut être fortement croissant. Une augmentation des revenus des agriculteurs paraît constituer un préalable si elle passe par l'élévation du potentiel. Par ailleurs, certains dispositifs techniques56(*) sont plus envisageables pour les petites cultures que pour les grandes.
2. L'agriculture raisonnée ?
Les objectifs de l'agriculture raisonnée sont de limiter les excès de la Révolution verte. Ses moyens consistent à baisser le niveau d'intensité d'utilisation des intrants. Ce faisant, on perd de vue l'objectif de maximisation du rendement/hectare en lui substituant un objectif d'élévation du revenu/hectare à travers une baisse des charges d'exploitation.
L'agriculture raisonnée n'est pas destinée à augmenter les rendements ainsi que l'évaluation du plan « Eco-phyto 2018 » l'a montré. Son adoption suppose une extension des surfaces cultivables dont la faisabilité ne paraît pas condamnée par les disponibilités en erres arables mais peut poser d'autres problèmes environnementaux. D'un point de vue économique, et social des questions cruciales doivent être mentionnées :
- toutes celles qui entourent la mobilisation de nouvelles terres notamment la question foncière des droits de propriété ;
- la réalité d'une maximisation du revenu par hectare qui ne paraît pas acquise dans toutes les configurations d'agriculture raisonnée envisageables (v. à ce propos les analyses du plan « Eco-phyto 2018 »).
Son réalisme aussi dans la mesure où la mobilisation de nouvelles terres suppose d'exploiter des surfaces plus incertaines au regard de leurs rendements ce qui peut s'accompagner d'une élévation de la consommation d'intrants afin de trouver dans les processus d'artificialisation des assurances que la nature offre plus chichement.
3. La mise en oeuvre d'une Révolution doublement verte ?
M. Michel Griffon s'est fait le promoteur en France d'une Révolution doublement verte dans un scénario fondé sur l'écologie et l'équité consistant à développer l'agriculture des pays en développement.
Il s'agit d'un scénario alternatif à celui qui consiste à faire dépendre l'alimentation des agricultures les plus productives, en résolvant le problème de la pauvreté séparément.
Les efforts à entreprendre varient selon les régions du monde :
En Asie, alors que les rendements sont déjà élevés, l'effort productif devrait être très important et pèserait sur des petits exploitants familiaux dépendant des prix et des subventions.
En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, les possibilités varient entre la petite agriculture et les grandes exploitations ; alors que la production devrait être multipliée par 2,5 on ne peut compter sur des progrès de productivité qui seront trop faibles.
En Amérique latine, qui devra doubler sa production, il y a d'importantes réserves de terres mais le danger est de poursuivre le gaspillage des écosystèmes tropicaux forestiers.
Selon Michel Griffon, en simplifiant, il y a sept cas types où il faut trouver de nouvelles solutions technologiques à caractère générique :
- les zones d'irrigation marquées par la Révolution verte qui se situent dans les tropiques et les régions méditerranéennes,
- les zones périurbaines de maraîchage, de polyculture et d'élevage intensif dans les tropiques et la Méditerranée,
- les zones de culture et d'élevage tropical de type sahélien,
- les zones de culture et d'élevage tropical de savane,
- les zones de culture et d'élevage du tropique, d'altitude et de pentes,
- les grandes cultures des régions méditerranéennes,
- les zones de forêt tropicale humide évoluant vers l'agriculture ou l'élevage après déforestation.
Il faut évidemment croiser ces situations « physico-techniques » types avec les contextes sociaux et économiques : jardins et micro-exploitations, petites et moyennes exploitations, grandes cultures et c'est sur ces bases qu'il faut rechercher des solutions.
Le concept de « Révolution doublement verte » n'est pas fondé sur le refus des intrants chimiques, ni des OGM même s'il conduit à en limiter l'usage.
Il repose sur les séquences suivantes :
- l'accroissement des rendements (doublement en 20 ans) ;
- dans de nombreuses situations écologiques (et pas seulement comme pour la Révolution verte dans les zones du tropique humide) ;
- d'une façon non néfaste pour l'environnement ;
- auprès des populations en risque de sous-alimentation (populations pauvres) ce qui oblige à privilégier les techniques peu onéreuses ;
- en recherchant par priorité les potentialités des milieux, puis seulement ensuite le recours aux intrants artificiels.
Ses promoteurs sont principalement, en France, le CIRAD et le CGIAR (Consultative Group for International Research) au niveau international. Ses fondements théoriques sont constitués par la théorie de la viabilité développée par M. Jean-Pierre Aubin.
Gérer la viabilité des systèmes alimentaires, c'est gérer la relation entre les écosystèmes et les sociétés dans le but principal d'assurer la sécurité alimentaire et, à cet effet, d'abord conduire une trajectoire qui assure la réalisation de l'objectif souhaité (une alimentation suffisante et saine pour tous) et qui réduit les risques écologiques, économiques et sociaux.
Ce mode de gestion n'est donc plus caractérisé par la seule recherche d'un maximum, mais par la recherche d'un niveau de satisfaction de l'objectif sous contrainte d'assurer l'entretien permanent des flux du système. Il faut éviter d'outrepasser les frontières de viabilité, ce qui oblige à réfléchir dans le cadre des stratégies de résilience, notamment par la mise en place de procédures de protection, d'esquive, d'endurance, de réparation et de diversification dans les différents champs que sont le champ de l'écologie, celui de l'économie et des relations sociales.
Exemples de domaines de viabilité dans le
champ écologique, économique et social
à partir des
composantes du concept de viabilité
Source : « Nourrir la planète » Michel Griffon
La « Révolution doublement verte » implique un changement de paradigme vers lequel cependant on peut aller à petits pas.
Comparaison des principes fondateurs de la
révolution verte
et de la révolution doublement
verte
|
Principes de la Révolution verte |
Principes de la révolution |
|
Artificialisation la plus complète possible du milieu naturel |
Inscription des systèmes productifs dans le cadre des écosystèmes |
|
Utilisation des intrants en forçage du système de production |
Recherche d'un équilibre biogéochimique entre intrants et extrants |
|
Spécialisation des productions et standardisation des techniques |
Diversification des productions |
|
Protection absolue de la production et éradication des maladies et des ravageurs |
Gestion du pathosystème en vue de la contention des envahisseurs |
Source : « Nourrir la planète » Michel Griffon
À ces différences de principe correspondent des pratiques différentes dont le tableau ci-dessous donne des exemples dans divers domaines.
Comparaison des pratiques selon qu'elles
s'inscrivent
dans la tendance Révolution verte ou dans la tendance
révolution doublement verte
|
Fonctionnalité |
Tendance Révolution verte |
Tendance révolution doublement verte |
|
Compétition entre plants pour la lumière et l'espace |
Éradication de la végétation antérieure. Installation d'une sole cultivée monospécifique. Utilisation d'herbicides pour privilégier la plante cultivée. |
Conservation d'une partie de la végétation (agroforesterie) ou installation de cultures associées (ou en mélange). Valorisation de la complémentarité des espèces végétales. Utilisation de l'allélopathie. |
|
Structuration du sol : obtention d'une structure meuble pour l'installation racinaire |
Labour et préparation d'un lit de semence approprié (structure fine de surface). Apports d'amendements : calcaire, fumure de fond. |
La dégradation de la biomasse par la faune (vers en particulier), la microfaune et microflore du sol crée une structure meuble dans les horizons supérieurs. Utilisation de plantes ayant des propriétés structurantes. |
|
Fertilisation minérale : apport des minéraux nécessaire |
Apport de phosphates, de potasse, d'engrais azotés, de compléments en micronutriments. |
Recyclage de la plus grande partie des nutriments apportés par la biomasse végétale précédente et par la biomasse animale et microbienne. Utilisation des ressources de la roche mère. Utilisation des minéraux issus de symbioses microbiennes (azote, phosphore). |
|
Fertilisation organique : nutrition des plantes, structuration du sol |
Apports éventuels de fumiers. |
Recyclage le plus large de la biomasse. Apport de fumiers et litières. Apport de compost. |
|
Tolérance de l'agro-écosystème à la sécheresse |
Adaptation du milieu : irrigation. Amélioration variétale. |
Maintien de l'humidité par la couverture du sol : par des strates de végétation superposées (agroforesterie) ou des mulchs et plantes de couverture vivantes. Amélioration variétale. Irrigation d'appoint. |
|
Tolérance des plantes au sel |
Amélioration variétale. |
Plantes de bioremédiation. Amélioration variétale. |
|
Gestion de l'eau |
Irrigation de substitution : utilisation maximale pour garantir des rendements élevés. |
Stockages à différentes échelles, en particulier dans les sols (cf. couverture du sol). Irrigation d'appoint en cas de besoin (économie d'eau). |
|
Entretien du microclimat |
Dans cette conception, ce n'est pas un objectif. |
Aménagement du paysage pour conserver l'humidité et éviter des perturbations de flux atmosphériques non désirés. |
|
Pollinisation |
Risques d'atteintes aux pollinisateurs par les insecticides ; cas de pollinisation manuelle en arboriculture. |
Entretien et protection des pollinisateurs. |
|
Gestion des maladies et ravageurs : envahisseurs biologiques |
Insecticides, fongicides, bactéricides, nématicides. Résistances biologiques des plantes par sélection. |
Lutte biologique. Résistances biologiques par sélection. Lutte intégrée. |
|
Gestion de la diversité biologique pour les espèces et l'écosystème |
Ce n'est pas un objectif dans ce cadre. |
Aménagement du paysage pour maintenir les espèces et les fonctionnalités biologiques locales : haies, couloirs, zones humides, bandes enherbées... |
|
Alimentation des animaux d'élevage |
Apports calculés pour une croissance maximale. Hormones de croissance |
Pas de forçage sur la vitesse de croissance. |
|
Santé animale |
Protection a priori sur une base de vaccins et médicaments (antibiotiques entre autres). |
Approche écologique de la santé : bien-être animal, faible densité, alimentation équilibrée... Interventions médicales subsidiaires. |
|
Synergie agriculture élevage |
Non recherchée dans ce cadre : spécialisation agriculture ou élevage. |
Recherche des synergies : apport en travail, en fumure, en épargne sur pied, en diversification des moyens d'existence ; mais utilisation d'une partie de l'espace pour l'alimentation. |
|
Potentialités génétiques des plantes et animaux |
Recherche de potentialités élevées sur un petit nombre d'espèces, variétés et races de caractères nouveaux. |
Recherche de diversité d'espèces et races, et de rusticité (résistances) propre au milieu local. Intégration sur ces variétés et races de caractères de productivité. |
|
Gestion du temps |
Mécanisation pour raccourcir le temps de chaque intervention. Tendance Just in time. |
Détente du calendrier des interventions. |
|
Gestion des risques |
Maîtrise poussée du processus de production. Recours à des assurances (marchés financiers). |
Utilisation en priorité des capacités de résilience écologiques et économiques du système. |
Source : « Nourrir la planète » Michel Griffon
B. LA RÉVOLUTION DOUBLEMENT VERTE POURRA-T-ELLE NOURRIR LE MONDE ?
M. Michel Griffon rappelle que les besoins de production supplémentaire par région seraient les suivants dans le cadre de l'hypothèse centrale déjà mentionnée (hypothèse de Collomb).
Estimation du déficit mondial à combler à l'horizon 2050
|
Asie |
Amérique latine |
Afrique du Nord et Moyen-Orient |
Afrique subsaharienne |
Pays industriels |
|
|
Coefficient multiplicateur des besoins alimentaires 2050/2000 |
2,34 |
1,92 |
Estimé à 2,5* |
5,14 |
Fixé à 1 : On suppose que les pays industriels n'ont plus besoin d'accroître leur alimentation. |
|
Production 2000 (109t) |
1 700 |
272 |
154 |
260 |
/ |
|
Consommation 2000 |
1 770 |
260 |
220 |
262 |
/ |
|
Production nécessaire en 2050 (109t) arrondi |
4 140 |
370 |
550 |
1 340 |
Inchangée |
|
Différence 2050/2000 |
2 440 |
98 |
396 |
1 080 |
Inchangée |
|
* La catégorie ANMO (Afrique du Nord/Moyen-Orient) n'existe pas dans les travaux de P. Collomb. Le chiffre proposé est une estimation à partir des chiffres nationaux. |
|||||
Source : Nourrir la planète. Michel Griffon
On pose que les pays industriels équilibrent leur consommation et leur production (hypothèse qui peut être fragile soit en trop, soit en moins) et que les pays en développement s'efforcent de couvrir leurs besoins par un effort productif afin de limiter les importations alimentaires.
On peut tenter de mobiliser des surfaces nouvelles puis, si c'est insuffisant, d'augmenter les rendements.
Les surfaces agricoles théoriquement mobilisables sont les suivantes.
|
Monde |
Asie |
Am. Lat. |
ANMO |
Afr. SS |
Pays ind. |
Pays transit. |
||
|
Est |
Sud |
|||||||
|
Surface cultivée 200 |
1 600 |
232 |
207 |
203 |
86 |
228 |
387 |
265 |
|
Surface apte pour l'agriculture |
4 400 (source IIASA) |
366 |
220 |
1 066 |
99 |
1 031 |
874 |
497 |
|
Surface cultivée + surface apte |
39 % |
63 % |
95 % |
19 % |
87 % |
22 % |
44 % |
53 % |
|
Surface à protéger absolument en 2050 (109ha) |
/ |
100 |
S.A. |
200 |
S.A.* |
200 |
S.A. |
S.A. |
|
Surface supplémentaire possible pour l'agriculture |
/ |
34 |
13 |
663 |
13 |
603 |
/ |
/ |
|
* SA : surface actuelle / : donnée non disponible ou sans signification pour le tableau |
||||||||
Source : « Nourrir la planète » Michel Griffon
La composante « Révolution doublement verte » de la gestion des surfaces est identifiée à la préservation des 500 millions d'hectares de forêt tropicale. Cette contrainte sans être négligeable laisse disponibles pour l'agriculture 1 329 millions d'hectares essentiellement en Amérique latine et en Afrique subsaharienne.
Toutefois, la volonté de préserver des surfaces supplémentaires amène à évaluer ce que pourrait être un équilibre alimentaire mondial où les terres de l'Amérique latine ne seraient pas sollicitées significativement.
Une seconde catégorie de contraintes porte sur les rendements. Ceux-ci évoluent en tenant compte des possibilités techniques de la Révolution doublement verte.
Dans un tel scénario, qui limite le recours aux échanges internationaux, les déficits régionaux de l'Asie et de l'Afrique du Nord-Moyen Orient sont considérables.
Scénario Révolution doublement verte avec peu d'échanges entre grandes régions
|
Asie |
Amérique latine. |
ANMO |
Afrique SS |
Pays ind.et trans. |
|
|
Surface supplémentaires en pluvial 2050 (109 ha) |
23 |
0 |
4 |
603 |
0 |
|
Surface totale en pluvial 2050 |
462 |
203 |
90 |
831 |
inchangée |
|
Rendements R2V* pluvial |
+ 75 % (7t/ha) par rapport à 2000 (?4t/ha) |
+ 20 % (1,6t/ha) par rapport 1,35t/ha |
+ 40 % (2,5t/ha) par rapport 1,8t/ha |
+ 40 % (2,5t/ha) par rapport 1,15t/ha |
inchangés |
|
Production totale en pluvial |
3 234 |
325 |
225 |
1 304 |
inchangée |
|
Surface supplémentaire en irrigué 2050 en R2V* |
+ 27 à 78 soit 52± 25 sont possibles ; choix : 52 |
+ 3 à 12 soit 8± 4 sont possibles ; choix : 8 |
+ 2 à 9 choix : 9 |
+ 5 à 9 choix : 9 |
inchangée |
|
Accroissement de production en irrigué R2V* |
170 à 400 soit 285±115 choix : 285 |
+ 14 à 45 soit 30±15 choix : 45 |
+ 6 à 45 soit 25±20 choix : 45 |
+ 6 à 36 soit 21±14 choix : 36 |
inchangée |
|
Total production 2050 |
3 519 |
370 |
270 |
1 340 |
inchangée |
|
Rappel besoins 2050 |
4 140 |
370 |
550 |
1 340 |
inchangée |
|
Surplus ou déficit 2050 |
(-)621 |
0 |
(-)280 |
inchangé |
|
|
R2V : révolution doublement verte * soit 1,5 fois les surfaces en irrigation traditionnelle ** Les rendements moyens en irrigation par grande région n'étant pas connus, on ne peut calculer précisément l'accroissement de production que l'on peut attendre de la R2V dans les zones irriguées. On procède donc ici à une estimation, sachant que l'irrigation se fait en économie d'eau (appoint) et que cette économie d'eau peut permettre d'irriguer des surfaces plus importantes. L'accroissement est estimé à 1t/ha en tenant compte de la diminution correspondante des surfaces en pluvial. |
|||||
Source : « Nourrir la planète » Michel Griffon
Ils s'élèvent pour la première à 621 millions de tonnes, pour la seconde à 280 millions de tonnes, soit 15 % et 51 % des besoins respectivement.
La Révolution doublement verte n'est donc soutenable que moyennant l'augmentation du commerce agricole international.
Elle suppose de mobiliser davantage les potentiels de l'Amérique latine et des grandes plaines de l'est européen tout en augmentant le recours à l'irrigation.
Scénario Révolution doublement verte avec échanges internationaux
|
Asie |
Amérique latine. |
ANMO |
Afrique Sub-saharienne |
Plaines de la CEI |
|
|
Surface supplémentaires en pluvial 2050 |
23 |
93 à 212 |
4 |
603 |
100 |
|
Surface totale en pluvial 2050 |
462 |
322 à 415 |
90 |
831 |
215 |
|
Rendements R2V* pluvial |
+ 75 % |
+ 200 % (2,7t/ha) par rapport à 2000 1,35t/ha |
+ 40 % |
+ 40 % |
|
|
Production totale en pluvial |
3 234 |
871 à 1 121 |
225 |
1 304 |
516 |
|
Surface supplémentaire en irrigué R2V 2050 |
78 |
12 |
9 |
9 |
0 |
|
Accroissement de production en irriguée R2V 2050 |
400 |
45 |
45 |
36 |
0 |
|
Total production 2050 |
3 624 |
916 à 1 166 |
270 |
1 340 |
? 230 |
|
Rappel besoins 2050 |
4 140 |
370 |
550 |
1 340 |
? (+° 250 à 290 soit 250 |
|
Surplus ou déficit 2050 |
(-) 516 |
546 à (+) 796 |
(-) 280 |
0 |
|
|
Surfaces restantes (sauf réserves) |
0 |
525 à 408 |
0 |
0 |
? 200 (?) |
|
R2V : révolution doublement verte |
|||||
Source : « Nourrir la planète » Michel Griffon
Pour autant, le diagnostic de soutenabilité semble fragile à votre rapporteur.
En premier lieu, comme l'indique l'auteur, il est suspendu à deux conditions plus ou moins maîtrisables.
La première porte sur les rendements. Il va de soi que les effets de ces nouveaux process sur les rendements ne sont que partiellement évaluables. Pour illustrer le poids de cette indétermination il faut mentionner que l'accroissement de rendement simulé est important. « Il suffirait que l'Asie ne puisse augmenter ses rendements, par exemple que de 25 % au lieu de 75 %, pour qu'il manque 925 millions de tonnes, ce qui pourrait obliger l'Amérique latine à produire des aliments sur 250 millions d'hectares supplémentaires tout en augmentant les rendements de 20 %, ou bien à utiliser la totalité de l'espace (sauf 200 millions d'hectares de réserve) en n'augmentant les rendements que de 75 %, ce qui resterait une grande performance car la moyenne reste aujourd'hui assez basse (1,3 t/ha) ».
Par ailleurs, il faut mentionner une variable, peut-être davantage maîtrisable mais au prix d'une forte volonté politique, qui est celle d'un développement maîtrisé des biocarburants. M. Michel Griffon indique à ce propos que pour combler la totalité du déficit en biocarburants des pays industriels, il faudrait que l'Amérique latine et l'Afrique consacrent la quasi-totalité de leur territoire à la production énergétique avec des rendements élevés. Cette perspective est évidemment irréaliste. Mais, il est probable, sauf action très résolue, qu'une partie grandissante du potentiel agricole sera consacrée à des productions énergétiques.
Dans un tel contexte, peu favorable déjà à l'atteinte des objectifs de la « Révolution doublement verte » (et contradictoire avec les justifications environnementales des politiques de développement des biocarburants - v. le chapitre du présent rapport consacré à ces derniers -), il faudrait privilégier des process culturaux garantissant l'obtention de rendements maximums.
Enfin, votre rapporteur se demande si les progrès de productivité par hectare dessinés par la « Révolution doublement verte » et qui sont aléatoires, sont bien compatibles avec la nécessité d'élever la productivité agricole à un niveau suffisant, objectif qui paraît tout à fait décisif d'un point de vue quantitatif mais aussi économique.
En soi, les incertitudes sur ce point créent un contexte peu favorable à l'adoption d'une démarche qui pourtant peut se recommander de justifications essentielles.
CHAPITRE
III :
QUELLES PERSPECTIVES
POUR LES PRIX ALIMENTAIRES ?
Selon une annonce de l'organisation « Amis de la Terre », l'équilibre des marchés agricoles devrait se traduire dès l'horizon 2030 par une forte hausse des prix, notamment en raison des effets du réchauffement climatique sur l'offre de produits agricoles.
Les chiffres cités mentionnent des niveaux de prix spectaculairement élevés :
• 6,48 livres sterling pour 800 grammes de pain blanc contre 72 pence aujourd'hui et 1,44 livre sterling si ce produit devait s'aligner sur l'inflation globale ;
• 17,91 livres sterling pour 1 litre d'huile végétale (1,99 livre aujourd'hui ; 3,98 livres suivant le rythme d'inflation escompté) ;
• 15,21 livres sterling pour 1 kilo de riz basmati (1,69 livre ; 3,38 livres sterling) ;
• 7,20 livres sterling pour 500 grammes de « corn flakes » (78 pence ; 1,56 livre sterling) ;
• 16,02 livres sterling pour 24 biscuits de style Weetabix (1,78 livre ; 3,56 livres sterling) ;
• 18,45 livres sterling pour une pinte de bière (2,05 livres ; 4,05 livres sterling).
Ces évaluations ne sauraient être considérées comme des prévisions. Elles projettent les prix d'un certain scénario cumulant le déclenchement de risques à fortes incidences.
En tout état de cause, ces perspectives représentent une nette rupture par rapport au constat qu'on peut faire, sur longue période, d'une baisse spectaculaire des prix alimentaires.
Il faut se demander si, en dehors des aléas cumulés comme dans l'estimation précitée, la tendance posée sera réellement renversée ou si elle se poursuivrait.
Une précision préalable doit être formulée : les prix alimentaires et les prix agricoles ne désignent pas une et même chose alors que très souvent c'est ainsi qu'ils sont présentés.
Les prix alimentaires sont aux produits alimentaires qui par rapport aux produits agricoles ont fait l'objet d'une transformation, plus ou moins forte, et sont distribués. Les prix agricoles se rapportent à des produits qui peuvent être immédiatement alimentaires mais le son rarement. Il existe a priori des liens entre les deux catégories considérées mais ils peuvent être relativement distendus.
Par ailleurs, les « prix agricoles » eux-mêmes sont loin d'être homogènes, y compris quand on les appréhende dans un pays donné.
Entre les prix sur les marchés internationaux et les prix sur les marchés locaux des différences substantielles de régime existent, sans compter les problèmes particuliers d'évolution des biens échangés par troc.
Cette hétérogénéité des prix des produits agro-alimentaires est une caractéristique importante puisqu'aussi bien tous les producteurs n'ont pas accès aux mêmes compartiments d'un système de prix qui joue également de façon différenciée pour les consommateurs.
Ainsi, c'est en gardant à l'esprit la forte probabilité d'une grande hétérogénéité des évolutions des prix de l'agro-alimentaire qu'il faut considérer les différents scénarios envisageables, leurs effets sur les agriculteurs et leurs incidences sur les consommateurs.
Au-delà de la distribution des scénarios de prix selon leur probabilité - les prix baisseront-ils ? Augmenteront-ils ? - ce sont d'ailleurs leurs conséquences et ce qu'ils traduisent des équilibres alimentaires qui importent.
Aux yeux de votre rapporteur, parmi les scénarios envisageables, le plus probable est celui d'une inversion de l'allure des prix de l'agro-alimentaire et des prix agricoles en particulier.
On pourrait considérer qu'il s'agit d'une bonne nouvelle. Les prix sont classiquement appréciés comme des signaux de marché qui en cas d'orientation haussière favorisent l'essor de la production. Pourtant, outre que le secteur agricole réserve en soi des particularités qui conduisent à s'interroger sur la réactivité de la production aux prix, il faut envisager que la hausse des prix ne se traduise pas par un redressement effectif des incitations à produire.
Au demeurant, les effets d'une élévation des prix alimentaires sur les consommateurs et, par conséquent, sur l'accès des affamés à la nourriture doivent être considérés.
Une hausse des prix, même si elle ne résulte pas d'un épisode de flambée, a toute chance de désolvabiliser la demande, compliquant la résolution de l'équation alimentaire.
Ces considérations conduisent à préconiser un contrôle des prix qui pour ne pas pénaliser la nécessaire modernisation des agricultures du Sud devra être accompagné des transferts de revenus qui lui sont indispensables ainsi qu'à la défense du pouvoir d'achat des plus éloignés d'accéder à une alimentation décente.
Enfin, la financiarisation des actifs agricoles appelle une ferme régulation des marchés faute de quoi l'économie agricole réelle pourrait être sous la dépendance de marchés financiers à la stabilité particulièrement incertaine.
I. SUR UNE LONGUE PÉRIODE UNE CHUTE DES PRIX AGRICOLES RÉELS MAIS DEPUIS LE MILIEU DES ANNÉES 2000 UNE FORTE VOLATILITE
Le processus de baisse des prix agricoles semble avoir été structurel, avec pour conséquence une pression à la baisse du pouvoir d'achat des producteurs agricoles à laquelle seuls quelques uns d'entre eux ont pu échapper. Mais, depuis le milieu des années 2000 s'est ajoutée à cette tendance une forte instabilité des prix.
A. UNE BAISSE STRUCTURELLE MAIS DE FORTES TENSIONS À LA FIN DES ANNÉES 2000
Le constat d'une baisse structurelle des pris agricoles s'impose avec toutefois deux précisions à apporter.
En premier lieu, il faut distinguer les prix nominaux des « prix réels » appréhendés à partir des prix relatifs.
Si les prix nominaux ont un peu augmenté, les prix relatifs (les prix corrigés de l'indice de la valeur unitaire des produits manufacturés de la Banque mondiale) ont considérablement diminué à partir du pic de 1974 et par rapport à leur moyenne des années 60.
Si l'indice choisi pour apprécier l'évolution réelle des prix alimentaires comporte quelques biais, la tendance baissière est si nette qu'elle ne peut être sérieusement contestée.
En 2000, les indices FAO des prix alimentaires réels étaient à la moitié de leur niveau des années 60.
En décomposant ces évolutions, on observe qu'après une stabilité des prix (prix nominaux et prix relatifs) dans les années 60, un palier a été franchi au début des années 70 où l'indice FAO des prix des produits alimentaires a doublé.
Cette marche étant franchie, cet indice a connu une longue période de stabilité (de 1975 au début des années 2000). Couplée avec l'augmentation des prix des produits manufacturés cette stabilité s'est traduite par une réduction considérable du prix relatif des produits alimentaires dont l'indice est passé de 250 à 100 en une dizaine d'années (1974-1985) pour demeurer à ce niveau jusqu'en 2001.
|
La baisse des prix agricoles relatifs :
La baisse des prix relatifs des produits agricoles s'est traduite par une diminution su revenu réel associé à une production donnée. Dans un tel contexte, seuls les agriculteurs qui ont pu augmenter leur production ont pu « sauver » leur revenu, dans des proportions variables selon le niveau atteint par le supplément de leur production. Encore faut-il observer que l'augmentation des coûts d'exploitation a encore aggravé les effets de la réduction des prix agricoles réels en pesant sur les marges d'exploitation. Dans une telle équation, l'effort productif a entreprendre pour préserver le revenu net doit compenser à la fois la baisse du chiffre d'affaires et l'alourdissement des charges d'exploitation. Pour les agriculteurs contraints par la surface exploitée, il n'y a pas d'autre solution que d'augmenter les rendements. Pour ceux dont les rendements plafonnent, la solution est d'étendre leurs superficies. Mais, ces deux stratégies demandent des moyens financiers, en plus de réclamer que les conditions de leur faisabilité technique soient réunies. Or, si ces dernières ne le sont assurément pas systématiquement, force est d'observer que la baisse structurelle des prix agricoles n'est, de toute façon, pas propice à la réunion des moyens financiers nécessaires pour mieux exploiter le potentiel de production. Évidemment, sur ce point, les agriculteurs sont dans des situations différenciées. Certains peuvent compter sur un environnement qui les protège plus ou moins des effets de l'évolution défavorable des prix. C'est le cas pour les agriculteurs dont le revenu est soutenu par d'autres canaux que les prix. C'est aussi le cas des agriculteurs qui ont accès au système financier, sans pour autant que cet accès dispense les systèmes agricoles locaux des restructurations qu'appelle l'adaptation à la baisse des prix. En revanche, les petits agriculteurs sans soutien complémentaire, privés de l'accès aux financements nécessaires et des possibilités de redéploiement de leurs systèmes d'exploitation connaissent nécessairement de très grandes difficultés quand les prix relatifs agricoles baissent dans des proportions observées à long terme dans le passé. |
Autrement dit, si la baisse des prix agricoles réels est en soi une tendance peu favorable à la production agricole, elle exerce des effets particulièrement dramatiques pour une vaste majorité de paysans, déjà pauvres, ne bénéficiant pas des institutions, ou des conditions agronomiques, leur permettant d'y faire face.
Dans une telle conjoncture de prix, ces petits exploitants semblent n'avoir d'autre choix que de disparaître, ce qui pose la question des effets de l'abandon de leurs productions sur la production agricole globale, ou de s'enfoncer dans la pauvreté et la malnutrition.
Il est cruel d'observer que la flambée des prix aboutit à des résultats analogues tant pour les consommateurs des pays en développement que pour les petits exploitants agricoles comme l'a montré notamment l'épisode de la fin des années 2000.
Car c'est la seconde distinction, temporelle celle-là, au-delà de 2001-2002, une rupture s'est produite avec ces tendances. Les prix nominaux des produits alimentaires ont vivement progressé engendrant également une augmentation des prix relatifs.
L'indice global des prix des produits alimentaires est installé depuis 2001 sur une tendance nettement haussière. Entre 2001 et 2007, il avait presque triplé.
La crise globale a entraîné un fort repli des prix alimentaires (passés de l'indice 220 en 2008 à 140 en 2009). Mais, cette chute a été assez vite contenue et, alors même que la sortie de crise n'est pas assurée partout, les prix alimentaires ont repris leur ascension. Fin 2010, l'indice a dépassé le pic antérieur de 2008.
Produits alimentaires
Source : COE-REXECODE. Matières premières. Janvier 2011
B. LE CONSTAT DE MOUVEMENTS DE PRIX DIFFÉRENCIÉS PAR PRODUIT
Les produits alimentaires connaissent, un à un, des évolutions qui se reflètent dans l'indice global mais il existe des spécificités avec des volatilités particulièrement fortes pour certains d'entre eux.
Source : COE-REXECODE. Matières premières. Janvier 2011
Ces singularités peuvent se retrouver dans les sous-catégories de produits ou en fonction des marchés concernés.
Ainsi, pour les grains, les amplitudes des prix du maïs sont apparues plus fortes que pour le blé ou l'orge ces dernières années.
Céréales
Source : COE-REXECODE. Matières premières. Janvier 2011
C. DES DIFFÉRENCES PAR MARCHÉ
Il peut y avoir des écarts entre les cours mondiaux et les prix observés sur les marchés nationaux ou locaux, ce dont témoigne le graphique ci-dessous qui retrace les évolutions des prix du blé tendre, respectivement sur le marché mondial tenu à Chicago et sur le marché français.
Source : COE-REXECODE. Matières premières. Janvier 2011
Le constat d'un écart entre les cours mondiaux et les prix des marchés plus locaux n'est pas anodin. Les « pris de gros » ne se transmettent pas nécessairement aux productions primaires et vice versa.
La complexité du système de prix s'accroît concrètement quand le marché résulte de la rencontre d'agents appartenant à des espaces nationaux différents. Comme en témoigne le schéma sommaire ci-dessous (qui rend compte des mécanismes de détermination des prix mondiaux).
Tous les producteurs n'ont pas un égal accès aux marchés internationaux ni même aux marchés plus décentralisés, ce qui peut accroître l'amplitude des variations de prix sur ces marchés et a pour effet de réduire l'efficacité du « signal-prix » duquel on attend normalement qu'il active des adaptations de l'offre agricole. Enfin, les décalages entre les prix de gros et les prix perçus par les producteurs de base, en même temps qu'ils peuvent neutraliser l'impact sur leurs revenus d'une « bonne orientation » des prix agricoles, renforcent les inégalités de position des producteurs.
À cet écart entre prix mondiaux et prix locaux s'ajoute le problème des effets de la répartition de la valeur ajoutée de la filière agro-alimentaire qui paraît ne pas favoriser les producteurs de base. Ainsi qu'on l'indique dans le présent rapport, cette situation renforce les inégalités de position des producteurs de base tout en contribuant à l'instauration d'un système d'incitations peu favorable à l'essor de la production agricole et nettement handicapant pour la mise en oeuvre du droit de l'alimentation par ses effets d'ancrage dans la pauvreté.
II. LE CADRE D'ANALYSE DES PRIX AGRICOLES CONDUIT À ENVISAGER PLUSIEURS SCÉNARIOS AVEC UN SCÉNARIO PLUS PROBABLE DE HAUSSE DES PRIX
En dehors même des épisodes de flambée des prix, les prix agricoles sont structurellement marqués par l'instabilité. Cependant, sur longue période, c'est bien une baisse relative qui globalement s'est produite.
M. Marcel Mazoyer propose une analyse stimulante des prix agricoles sur longue période et des dynamiques existant généralement sur les marchés internationaux qu'il faut citer in extenso avant que de présenter les scénarios envisageables pour le futur, qu'elle éclaire.
S'agissant de la tendance longue des prix, son diagnostic appelle l'attention sur les effets de la modernisation agricole tant dans les pays développés que dans les pays en développement ayant connu la Révolution verte.
|
« Dans les pays où la révolution agricole contemporaine et la révolution verte ont le plus progressé, les gains de productivité agricole ont été si importants qu'ils ont souvent dépassé ceux des autres secteurs de l'économie, de sorte que les coûts de production et les prix agricoles réels (déduction faite de l'inflation) ont très fortement baissé. De plus, dans certains pays, la production agricole a augmenté plus vite que la consommation intérieure, et les excédents exportables ont fortement augmenté. Ainsi, dans les pays développés, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, les prix réels des matières premières agricoles de base (céréales, oléo-protéagineux, viandes, lait) ont été divisés par trois ou quatre. Dans le même temps, la production végétale ayant augmenté beaucoup plus vite que la population faiblement croissante, des quantités toujours plus importantes de produits végétaux ont été utilisées par les élevages (volailles, porcs, bovins), dont les produits ont à leur tour fortement baissé en coûts et en prix ». « Dans les pays en développement où la révolution verte a le plus progressé en Asie du Sud, du Sud-Est et de l'Est notamment, même sans grande motorisation, l'augmentation des rendements a entraîné une forte hausse de la productivité et une baisse importante des couts de production et des prix agricoles réels Certains de ces pays sont devenus eux aussi exportateurs (Thaïlande, Vietnam), alors même que la sous-alimentation y est très répandue. Enfin, dans les anciens pays coloniaux ou communistes où les grandes entreprises agricoles à salariés récemment modernisées atteignent aujourd'hui un niveau de productivité aussi élevé que celui des exploitations familiales les mieux équipées d'Amérique du Nord et d'Europe, les coûts de production sont encore plus bas et défient toute concurrence. Là en effet, les salaires ne dépassent pas quelques dizaines d'euros par mois, les prix des machines et des intrants fabriqués sur place sont beaucoup plus bas que dans les pays industrialisés, les charges fiscales sont souvent très faibles et les monnaies locales sont fréquemment sous-évaluées. |
Le rôle -clef de la productivité est souligné ainsi que la divergence entre les dynamiques de la production et la demande, la demande solvable pouvant ne pas suivre la production.
|
Ces évolutions ont des conséquences sur les équilibres sur les marchés internationaux. Du fait de la pauvreté et de la sous-alimentation dans les pays en cause, non réglées par les progrès d'efficacité du secteur agricole, les débouchés intérieurs sont limités. « Les marchés internationaux des produits agricoles et alimentaires de base sont donc approvisionnés par des pays exportateurs très divers : pays industrialisés, pays en développement, pays émergents ou en transition, c'est-à-dire un ensemble de pays très différenciés dans lesquels les conditions naturelles et les niveaux d'équipement et dé productivité sont très inégaux ; dans lesquels les prix des machines et des intrants varient du simple au double, le prix de la journée de travail varie de un à cinquante euros et dans lesquels le coût de revient de la tonne de céréale varie de cinquante à cinq cents euros. D'un autre côté, les pays importateurs de ces denrées sont également très divers : pays industrialisés dans lesquels l'étroitesse des terres facilement cultivables (Suisse, Norvège Autriche, Japon) ou le très faible nombre d'agriculteurs (Royaume-Uni Suède) n'a pas permis à la production de suivre l'augmentation et la diversification de la consommation; pays émergents dans lesquels, malgré la révolution verte, la production n'a pas pu suivre la consommation d'une population fortement croissante; mais aussi pays à faible revenu et forte dépendance vivrière, dans lesquels la révolution verte n'a que peu pénétré. Dans ces conditions, les prix internationaux sont très souvent inférieurs aux coûts de production. Les denrées agricoles et alimentaires de base ont ceci de particulier que la plus grande partie de la production est consommée à l'intérieur de chaque pays producteur et ne passe pas les frontières. Les marchés internationaux de ces denrées ne concernent donc qu'une petite partie de la production et de la consommation mondiales (de 10 à 30 % selon les catégories de produits). Ce sont des marchés restreints, où l'offre se trouve amplifiée par la pauvreté et la sous-consommation qui prévalent dans les pays en développement exportateurs, tandis que la demande se trouve réduite par la pauvreté et la sous-consommation qui prévalent dans les pays importateurs à faible revenu. Ce sont donc des marchés sur lesquels la sous-consommation des uns et des autres crée une insuffisance chronique de la demande par rapport à l'offre, et sur lesquels la demande équilibre l'offre lorsque le prix descend assez bas pour être supportable par l'importateur le plus pauvre et pour égaliser le coût de production, non pas de l'exportateur le plus compétitif, mais de l'exportateur encore assez compétitif pour répondre à cette demande-là, à ce prix là. |
Dans la phase historique du développement marquée par la révolution verte et le maintien de fortes contraintes sur la demande, les prix agricoles sur les marchés internationaux ont eu tendance à s'installer à un bas niveau, niveau inférieur aux coûts de production moyens.
|
Le prix international est inférieur au coût de production de 85 % des volumes produits dans le monde. Il est inférieur aux coûts de production de la très grande majorité des agriculteurs du monde : inférieur aux coûts de production des agriculteurs américains (130 euros la tonne environ), qui ne pourraient donc pas continuer d'exporter massivement, et très inférieur à celui des agriculteurs européens (150 à 200 euros la tonne), qui ne pourraient pas continuer d'approvisionner leur propre marché intérieur, s'ils ne recevaient pas les uns et les autres des aides publiques très importantes. Mais ce prix international est de toute façon très inférieur aux coûts de production des centaines de millions de paysans produisant moins de une tonne de céréales par an, coûts que l'on peut estimer à 400 euros la tonne si on veut qu'ils obtiennent un revenu de un euro par jour. |
Ces données décrivent les dynamiques passées des prix correspondant à un état bien particulier du développement agricole :
- l'offre, en expansion, n'y a pas créé sa propre demande dans les pays où cet essor est intervenu ;
- le marché international est submergé d'excédents qui rencontrent une demande structurellement inférieure ;
- les prix baissent sur tous les compartiments du marché ;
- dans ces conditions, les revenus agricoles n'augmentent que lorsque le volume de la production écoulée permet de compenser la baisse des prix ;
- mais, tendanciellement, ils sont très dépendants d'aides publiques qui peuvent prendre des formes différentes (soutien des prix, soutiens directs au revenu...).
Ces évolutions créent toutefois des déséquilibres.
|
« Dans les pays développés la forte baisse des prix agricoles réels a entraîné une diminution importante du revenu des petites et moyennes exploitations qui n'ont pas eu les moyens d'investir et de progresser suffisamment pour compenser les effets de cette baisse des prix. De très nombreuses exploitations se sont ainsi retrouvées incapables de dégager un revenu familial socialement acceptable. Devenues non rentables, elles n'ont pas été reprises lors de la retraite de l'exploitant. Leurs meilleures terres ont alors été partagées entre les exploitations voisines en développement, alors que les moins bonnes sont passées à la friche. C'est ainsi que plus des trois quarts des exploitations agricoles existant au début du XXe siècle dans les pays développés ont disparu. Dans les pays en développement, les paysans faiblement outillés, mal situés et peu productifs ont d'abord vu leur pouvoir d'achat baisser. La majorité d'entre eux s'est retrouvée dans l'incapacité d'acheter des outils plus performants, et même d'acheter les semences de la révolution verte. Leur développement a donc été bloqué. La baisse des prix se poursuivant, leur revenu monétaire est devenu insuffisant pour, à la fois, renouveler leur outillage et acheter quelques biens de consommation indispensables. La survie de l'exploitation paysanne dont le revenu tombe en dessous du seuil de renouvellement économique n'est possible qu'au prix d'une véritable décapitalisation (vente de cheptel vif, réduction et mauvais entretien de l'outillage et de la fertilité) et de la sous-alimentation. « Pressés par la baisse des prix des denrées vivrières, nombre de paysans des pays en développement ont cessé de produire ces denrées pour approvisionner leur propre pays et ils se sont orientés vers les productions destinées à l'exportation café, cacao, banane, coton, hévéa... Mais comme la révolution agricole et la révolution verte se sont également développées dans ces branches de production, la baisse des prix des produits tropicaux d'exportation a suivi de près celle des denrées vivrières, et elle a touché de la même manière les paysans le plus démunis. » |
Le niveau insuffisant des prix agricoles crée les conditions d'une éviction d'un assez grand nombre d'exploitations. Toutefois, ces effets diffèrent selon que des soutiens publics permettent ou non de compléter des revenus. Quand tel n'est pas le cas, le nombre d'exploitations concernées par la disparition s'élève. Il faut cependant ajouter une considération : celle des alternatives offertes par les économies locales. Si celles-ci n'existent pas en nombre suffisant des exploitations résiduelles se maintiennent en plus grand nombre. À l'inverse si elles sont diversifiées, l'octroi d'aides publiques aux agriculteurs peut ne pas suffire à les maintenir dans l'activité agricole.
Au total, le contexte de bas prix agricoles, qui peut résulter, ou accompagner les progrès de productivité, est un facteur indéterminé de variation de la production. Celle-ci varie selon l'ampleur comparée de la hausse de la productivité des exploitations qui se maintiennent et de la baisse de la production des exploitations qui disparaissent.
Si la production se contracte, les stocks ont également tendance à se réduire et un tel processus prépare les conditions des épisodes de flambée des prix.
|
« ... le déficit des pays importateurs s'accroît. Les excédents des pays exportateurs, bridés par la baisse des prix, n'augmentent pas dans les mêmes proportions. Les stocks internationaux de fin de campagne se réduisent. Et il arrive un moment où les acheteurs, craignant la rupture des stocks, précipitent leurs achats et provoquent une véritable explosion des prix... ... dans ces périodes de très hauts prix, l'aide alimentaire se faire rare, les pays pauvres manquant de devises doivent s'endetter et se surendetter pour s'approvisionner... » |
Leurs conséquences sur les consommateurs sont évidentes. La malnutrition progresse, parfois tragiquement.
A. PLUSIEURS SCÉNARIOS DE PRIX SONT ENVISAGEABLES
L'analyse des prix d'un produit est nécessairement complexe puisque le prix est au confluent d'un nombre élevé de variables se dissimulant derrière l'offre et la demande.
Pour les prix agricoles, la tâche est encore plus complexe du fait des singularités du marché agricole (aléas naturels, problèmes de stockage, interventions publiques, segmentations multiples du marché...).
Autant dire que l'incertitude sur les prix est élevée alors même que les prix agricoles jouent un rôle de plus en plus important dans l'économie du secteur et devraient, selon certaines recommandations, voir leur rôle renforcé.
Il existe au fond trois grands scénarios :
un scénario de tensions sur les prix qui prolongerait les évolutions les plus récentes ;
un scénario de poursuite du décrochage structurel entre les prix agricoles et les autres prix, observé sur longue période ;
un scénario où les prix agricoles joueraient sans excès leur rôle d'équilibrage du marché.
Votre rapporteur se risque à estimer que le scénario le plus probable, dans les conditions actuelles de la gouvernance agricole dans le monde, est celui d'une élévation mal maîtrisée du niveau des prix agricoles.
Une sorte de consensus fait valoir que dans le passé la baisse des prix alimentaires est venue d'une dynamique de l'offre plus forte que celle de la demande.
Les différents facteurs d'évolution de la production agricole - mobilisation des surfaces, augmentation des rendements - se seraient conjugués pour permettre d'augmenter les disponibilités globales davantage que les différences variables influençant la demande ne l'ont fait pour celle-ci.
Ces mécanismes de marché ont probablement été secondés par des transformations moins « naturelles » dont l'essor des soutiens publics à l'agriculture, du moins dans certaines régions du monde (les pays de l'OCDE notamment) et, sans doute aussi, la structuration des marchés où le pouvoir des « demandeurs » s'est vraisemblablement renforcé à mesure que la concentration des industries agro-alimentaires progressait. Évidemment les freins à la demande solvable ont également joué.
Toute la question pour l'avenir est de savoir si les éléments ayant pesé sur les prix alimentaires dans le passé continueront à jouer de la même manière.
1. Toutes choses égales par ailleurs, la hausse de la demande devrait exercer une tension sur les prix agricoles
|
L'OCDE et la question des prix agricoles Sans atteindre les sommes observés en 2007 et 2008, les prix agricoles devraient être généralement plus élevés qu'ils ne le furent en moyenne entre 1997 et 2006 au cours de la décennie à venir. Les prix réels au-dessus de la moyenne 1997-2006 Source : OCDE, Direction des Échanges et de l'Agriculture Les facteurs de variation des prix agricoles peuvent être regroupés en différentes catégories. L'OCDE privilégie une approche prudente où les marges d'incertitude - et donc d'action - sont assez larges.
Source : OCDE, Direction des Échanges et de l'Agriculture Dans la typologie que l'OCDE propose, les facteurs à long terme structurels vont dans le sens d'une hausse des prix telle qu'elle est retracée dans les perspectives décennales mentionnées plus haut. Les autres facteurs ne sont pas intégrés dans ces perspectives de prix et sont présentés comme des aléas. Hormis les éléments de nature technologique, ils vont plutôt dans le sens d'une tension sur les prix. Mais l'OCDE les analyse comme principalement exogènes, c'est-à-dire susceptibles d'être plus ou moins maîtrisés. En ce sens, l'organisation préconise de jouer sur plusieurs leviers. Les solutions envisagées sont les suivantes : - la réponse des producteurs aux conditions des marchés agricoles qui devrait en entraîner le rééquilibrage ; - l'amélioration du fonctionnement du système multilatéral et notamment la limitation du recours aux restrictions à l'exportation ; - l'innovation et le développement des technologies ; - l'amélioration de la gestion des risques ; - les changements de comportement des consommateurs - en lien avec la lutte contre l'obésité et le gaspillage - ; - le réexamen des politiques de soutien aux biocarburants ; - l'instauration de filets de sécurité, ou d'aides ciblées, pour les plus pauvres. |
Sous les réserves mentionnées au premier chapitre du présent rapport, la demande devrait progresser fortement dans l'avenir.
Dans une approche théorique, la croissance de la demande rencontre une offre qui ne s'ajuste que lentement. Dans l'intervalle, les prix augmentent mais l'accroissement de l'offre suscite une inflexion des prix, phénomène cyclique traditionnel dans le secteur agricole.
Toutefois, structurellement, l'augmentation de l'offre n'est elle-même pérenne que si l'augmentation des prix l'est également sauf à ce que les agriculteurs acceptent une baisse de leur revenu net à efficacité inchangée.
On pose en effet que les marchés sont efficients, c'est-à-dire qu'à tout moment les capacités productives mises en exploitation correspondent aux plus efficaces des ressources disponibles exploitées aux plus bas coûts.
Dans ces conditions, la production supplémentaire mobilise des terres marginales dont les coûts unitaires de production ont toutes chances d'être plus élevés que ceux des terres déjà exploitées.
Si les exploitants maintiennent leurs exigences de revenu, ces nouvelles terres ne sont exploitées qu'à la condition que les prix unitaires augmentent.
Si ceux-ci sont rigides, il n'y a qu'une issue pour concilier élévation de l'offre et stabilité des prix qui est le sacrifice des revenus des exploitants.
Mais cette condition de paupérisation absolue des paysans se heurte à la mobilité de la main d'oeuvre, particulièrement dans un contexte souhaitable de développement des pays émergents.
On peut voir la traduction concrète de cette limite l'origine des processus d'urbanisation par l'exode rural. La baisse des prix relatifs observée sur le long terme a provoqué une paupérisation des « masses paysannes » qui a favorisé cet exode.
Par ailleurs, toutes choses égales par ailleurs, le seuil de rentabilité des exploitations marginales n'est plus assuré si bien que la production se contracte. Il en résulte des tensions sur les prix.
Ces mécanismes ne font que traduire les enchaînements traditionnels par lesquels la demande agit sur les prix et les quantités.
Autrement dit, la hausse de la demande alimentaire n'est pas seulement annonciatrice d'une augmentation structurelle de la volatilité, à travers les ajustements intercalaires qu'elle suppose, elle promet aussi une hausse tendancielle des prix en en réunissant les conditions, à comportements de marges et à productivité inchangés.
Toutefois, l'effectivité de ces enchaînements semble remise en cause par les évolutions historiques qui ont vu coexister la baisse des prix relatifs agricoles et la hausse de la production dans un contexte d'augmentation de la demande.
Mais ce constat, à son tour, peut être expliqué par des considérations tenant à des circonstances historiques.
Il existait sans doute un potentiel inexploité mobilisable dans des conditions économiques favorables qui, aujourd'hui, peut être considéré comme moins élevé.
2. La hausse de la productivité comme variable d'équilibre ?
L'augmentation de la productivité agricole est présentée comme un facteur de contention des prix agricoles. Mais, ses effets peuvent être mis en doute.
L'augmentation de la productivité signifie que les facteurs de production engagés permettent de produire davantage que dans la situation initiale ou encore qu'on peut à production donnée « économiser » des facteurs de production. C'est en cela qu'elle est fréquemment associée à une maîtrise des prix se conciliant avec une croissance des revenus des producteurs57(*) et comme une solution pour concilier augmentation de la demande et stabilité des prix.
Mais, cette approche théorique peut être considérée comme inégalement prédictive.
a) En pratique, l'élévation du niveau des prix peut être une condition préalable à des progrès de productivité censés ... peser sur les prix surtout quand il n'existe pas d'aide publique ou d'accès au crédit
En premier lieu, il faut rappeler que des progrès de productivité peuvent nécessiter des configurations où les prix, loin d'être modérés, sont, au contraire, comparativement élevés par rapport à une situation idéale de marché. Tel est notamment le cas lorsque les ressources nécessaires au financement des facteurs de productivité dépendent uniquement des prix, n'étant pas abondées par des aides, ou lorsque l'accès au crédit est contraint obligeant les investisseurs à autofinancer leur développement.
On connaît les observations inspirées à Schumpeter par les monopoles et les situations de concurrence pure et parfaite. Ces dernières, au contraire des premiers, peuvent s'accompagner de prix rendant impossibles et, de toute façon, peu désirables, les efforts d'innovation nécessaires à l'augmentation de la productivité.
L'augmentation de la productivité appelle une réorganisation des exploitations agricoles qui passe par une élévation du capital par unité de production. Elle nécessite davantage d'investissement et (ou) davantage d'unités productives par unité de capital installée.
Relevons incidemment que ce dernier enchaînement passe classiquement par une extension des surfaces des exploitations (rendements d'échelle) mais peut également emprunter la voie, plus réaliste dans le secteur agricole, de la mutualisation des moyens de production de sorte que leur usage soit intensifié.
De son côté, l'augmentation du capital par unité productive réclame de l'investissement, matériel ou immatériel. Ce supplément d'investissement peut varier selon les modalités qu'il revêt (des investissements utilisés de façon peu intensive déplacent la contrainte d'investissement vers le haut) et selon son efficacité.
En bref, les progrès de productivité nécessitent des capitaux (même si le lien entre les deux variables n'est pas linéaire) et ses capitaux dépendent des revenus (quand le crédit n'est pas accessible).
À cet égard, dans la droite ligne des analyses schumpetériennes, les politiques de soutien au revenu agricole, qu'elles passent par les prix ou par des aides plus directes, peuvent être analysées comme des conditions préalables à l'innovation et aux gains de productivité.
Cependant, il faut souligner un point essentiel : les instruments de ces politiques diffèrent puisque la rente du producteur passe, dans un cas, par le « sacrifice » du consommateur et, dans l'autre, par celui du contribuable.
Ainsi, il peut exister un choix entre des prix élevés et des subventions, choix qu'il faut apprécier en fonction de ses effets globaux, sur les producteurs mais aussi sur les consommateurs.
b) Les progrès de productivité peuvent se heurter à des limites physiques
À ces conditions économiques, il faut ajouter la considération des contraintes physiques de la production agricole.
Le processus de gain d'efficacité est ordinairement décrit comme susceptible d'entrer dans une zone où le rendement décroît.
Le point d'entrée dans cette zone appelle des précisions si l'on veut estimer la contribution potentielle de l'investissement supplémentaire à la production alimentaire.
C'est une affaire à considérer au cas par cas en fonction des conditions concrètes d'exploitation.
Les études relatives aux perspectives de productivité physique des sols et aux marges d'extension des surfaces cultivables montrent en général l'existence d'un potentiel dans les régions en retard de développement. Elles soulignent, malgré tout, l'existence d'incertitudes sur son ampleur réelle d'autant qu'on tient compte d'une contrainte de durabilité environnementale.
Par ailleurs, il faut mettre en cohérence les perspectives physiques avec la dimension économique de la question et augmenter le raisonnement :
- en convertissant les gains de rendements physiques en valeur monétaire ;
- et en précisant les coûts de l'innovation.
c) Les progrès de productivité peuvent se faire à coûts croissants
La question des prix des intrants nécessaires à l'accroissement de la production peut être considérée comme essentielle. Il en va de même pour les coûts de l'innovation.
Sur le premier point, les structures de marché sont une variable trop souvent négligée.
On fait souvent valoir les effets de la domination subie par les agriculteurs en raison de leur position de marché par rapport aux industriels et aux distributeurs. Elle les expose à une compression de leurs marges du fait de l'écrasement des prix qu'elle entraîne.
La concentration des fournisseurs d'intrants - semences, engrais, phytopharmaceutiques - ainsi que certaines évolutions technico-juridiques en lien avec les innovations réalisées dans le secteur pourraient doubler cet effet en orientant les prix des fournitures à la hausse.
Les producteurs seraient soumis à un « effet d'enclume ». Celui-ci pourrait être d'autant plus fort que les prix énergétiques seraient tendus. Leur hausse est assimilable à celle d'un choc de productivité susceptible de réduire les revenus des agriculteurs.
Au total, l'élévation des coûts de l'innovation - et d'exploitation - dessine un contexte où les progrès de productivité pourraient intervenir à coûts croissants.
Dans une telle configuration, l'élévation du niveau des prix agricoles est une issue raisonnablement envisageable.
Encore faut-il que les acteurs de l'aval de la filière l'acceptent, ce qui ne va pas de soi. Dans l'hypothèse où les prix agricoles seraient contraints par ces acteurs, il n'y a pas d'autre voie que l'acceptation par les agriculteurs d'une baisse de leur revenu ou l'arrêt de leurs exploitations.
Ses effets sur les prix à long terme dépendent d'une comparaison entre les effets des gains de productivité sur l'offre des producteurs subsistant et la perte de production résultant de la disparition d'exploitants n'ayant pas accès à l'innovation et soumis à la hausse de leurs coûts de production.
La productivité est, on le voit, une variable importante pour réguler la hausse des coûts d'exploitation. Ceci conduit à s'interroger sur les coûts des progrès de productivité qui pourraient être croissants. La littérature oblige à distinguer sous cet angle deux régimes d'innovation. Le premier passe par un déplacement de la « frontière technologique ». Il implique des coûts élevés. Le second passe par un rattrapage au terme duquel les agricultures en retard se rapprocheraient de cette frontière. A priori, ses coûts seraient moins élevés.
Ce constat plaide pour une politique de développement agricole des pays en retard de développement comme axe à privilégier pour résoudre, de façon économe, l'équation alimentaire.
Elle appelle des moyens qui ne sont pas réunis aujourd'hui et ses succès réels dépendent d'une élucidation plus précise de la valeur nette du potentiel disponible.
Seule celle-ci permettrait d'apprécier précisément dans quelle mesure le potentiel agronomique peut être converti en des gains de productivité économique.
* *
*
Enfin, une dernière observation doit être formulée : si l'élévation de la productivité agricole comprise comme l'augmentation du rapport entre la valeur ajoutée et les capitaux qu'elle suppose n'est pas le tout. Seule une augmentation de la productivité par tête permet d'augmenter le revenu réel par tête.
L'histoire du développement agricole montre que les deux phénomènes marchent plutôt de conserve. Mais elle enseigne également que d'autres équilibres peuvent intervenir où les facteurs de production évoluent plus en phase les uns avec les autres. Dans un tel cas, le revenu par tête n'augmente pas. Cette situation pose un problème de soutenabilité. Celui-ci est étrangement négligé par certaines visions du développement agricole ainsi qu'on le montre dans la suite du présent rapport consacrée à l'investissement. Cette sous-estimation affecte la crédibilité des perspectives ainsi tracées.
3. Que peut-on attendre de la hausse des prix agricoles ?
À priori, une augmentation des prix agricoles compliquerait la mise en oeuvre du droit effectif à l'alimentation en raison de son incidence sur le pouvoir d'achat.
Toutefois, une trajectoire ascendante des prix agricoles crée les conditions d'une augmentation de la production. Des exploitations à la rentabilité marginale peuvent être mises en production ; des investissements agricoles non rentables ex ante peuvent le devenir. Cet enchaînement assigne à des prix agricoles plus élevés un rôle plus positif à travers leurs conséquences sur la quantité produite.
Malheureusement, ces mécanismes ne sont pas automatiques, loin de là.
Il faut d'abord s'entendre sur ce qu'on désigne par « prix agricoles ». Il existe en effet, au rebours d'une image simpliste évoquée par l'expression, une multitude de situations de marché dans le secteur agricole avec notamment une part importante de la population agricole dont la production ne s'écoule pas sur des marchés, ou alors sur des marchés très locaux sur lesquels la tendance ascendante des prix agricoles peut ne pas se diffuser58(*).
Il faut aussi considérer l'élasticité de la production aux prix. Or celle-ci a de bonnes chances d'être très différenciée selon les situations productives. Les producteurs qui ne disposent pas de marges de progression de leur production, certainement nombreux parmi les petits exploitants des pays en retard de développement, que ce soit pour des raisons techniques ou financières, ne sont pas en position de profiter d'un trend haussier des prix.
Dans ces conditions, une tendance ascendante des prix peut se traduire par une aggravation du défi alimentaire. Les prix à la consommation augmentent, y compris pour les consommateurs-paysans, sans que leur production (et leur revenu) ne suive. Le risque peut même exister que celle-ci ne rétrograde si les rentes perçues par les exploitants bénéficiant de la hausse des prix provoquent, par effet en retour, un arbitrage défavorable à l'augmentation voire au maintien de leurs efforts productifs.
En effet, des aspects structurels doivent être abordés. L'augmentation des prix agricoles peut se traduire par une élévation de la rentabilité du capital, sous certaines conditions d'évolution des consommations intermédiaires (dans les faits, leurs prix peuvent augmenter de conserve avec les prix agricoles ce qui neutralise les incidences de la variation des prix d'écoulement des produits sur les marges). Toute la question est de savoir si les différents acteurs sont placés dans une position identique face à un tel processus. Vraisemblablement, ce n'est pas le cas. Ainsi, les petits exploitants qui n'ont pas accès au « signal-prix » peuvent être dans l'incapacité de capter les bénéfices d'un tel « signal » quand d'autres intervenants sont en mesure de le faire. Dans un tel contexte, largement décrit dans la littérature mais peu abordée par la « littérature économique », des processus de restructuration plus ou plus radicaux, peuvent se produire. Les effets de ces processus sur la production sont a priori favorables puisque des producteurs plus efficaces se substituent à d'autres qui l'étaient moins. Encore faut-il pouvoir vérifier en pratique qu'il en va systématiquement ainsi et que les restructurations n'aboutissent pas purement et simplement à une extension des rentes sans effets favorables ou, même, avec des effets négatifs sur la production.
Les effets de ces restructurations sur le défi alimentaire entendu au sens du présent rapport sont donc très indéterminés. Si seule la rente augmente, le revenu agricole se concentre et les populations exclues peuvent subir une double-peine : la perte de leur revenu d'activité ; la hausse des prix de consommation.
En conclusion, il n'est pas du tout certain que des orientations haussières des prix favorisent spontanément le progrès vers un droit plus effectif à l'alimentation via leurs conséquences sur les quantités produites.
Au demeurant, cette indétermination a inspiré la conception des politiques de soutien aux prix conduites historiquement. Elle semble avoir pris en compte plusieurs des enchaînements décrits plus haut, sans pour autant que toutes leurs conséquences en aient été nécessairement tirées, mais cela était sans doute voulu.
Ainsi, si elles ont renforcé les rentes des producteurs les plus efficaces, les hausses de prix qui pouvaient être décidées étaient d'application générale et devaient toucher tous les producteurs au prix de la mise en oeuvre de structures permettant leur diffusion.
Cette condition qui appelle des mesures institutionnelles et d'organisation est une condition minimale pour que des prix haussiers produisent les effets attendus.
Elle n'est probablement ni suffisante, ni optimale, mais quand on considère la situation des paysanneries du Sud, elle implique, de la part des pays concernés, une véritable maîtrise politique des prix agricoles de sorte que la production réponde positivement, et durablement, aux prix.
Il reste que la hausse des prix agricoles comporte le risque d'une désolvabilisation de la demande, en particulier pour les personnes disposant de faibles revenus.
Il est possible de remédier à cet effet non-souhaitable en prévoyant des mesures ciblées de soutien de pouvoir d'achat de ceux qui seraient les plus handicapées par l'élévation des prix alimentaires.
La maîtrise politique des prix agricoles doit s'accompagner d'une maîtrise politique des revenus.
Autrement dit, un cadre favorisant des prix élevés appelle les systèmes de compensation des revenus.
Ceci demande une volonté publique mais aussi des disponibilités financières dont sont plus ou moins privés les pays concernés. Tout est affaire de cas d'espèce.
Toutefois, l'élévation des prix agricoles peut fournir une partie des solutions à ce problème particulier qu'elle pose. Par définition, elle engendre des rentes dont profitent les exploitants des plus efficaces. L'élévation des prix réduit le « surplus des consommateurs » - la différence entre les prix payés et ceux qu'ils seraient disposés à supporter - mais accroît le « surplus des producteurs » en augmentant les marges des producteurs supportant les coûts de production les plus faibles.
Dans ces conditions, il est justifié de redistribuer ce surplus aux consommateurs les plus touchés par la hausse des prix alimentaires.
B. LA CONFIRMATION PAR PLUSIEURS PROSPECTIVES
La prospective Foresight estime qu'il est probable qu'à l'avenir la tendance à la baisse des prix alimentaires s'inverse pour laisser place à une inversion de tendance vers une hausse significative des prix.
Évolution des prix alimentaires réels à l'horizon 2050 (en %)
Les prix réels - c'est-à-dire corrigés des prix des produits industriels - augmenteraient de 30 à 105 % selon les céréales et le scénario considéré parmi les scénarios optimiste, tendanciel ou pessimiste, développés dans le rapport.
Ceux-ci diffèrent par l'hypothèse de croissance démographique et de revenu, deux hypothèses étant communes à ces trois scénarios : l'absence d'effets du changement climatique - qui ont été toutefois modélisés en variantes - et une croissance de la productivité agricole toujours inférieure à ce qui serait nécessaire pour que l'offre équilibre la demande.
Ce sont les progrès de productivité qui varient dans le même sens que l'expansion du revenu qui contrastent les résultats du modèle.
Cette sensibilité à la productivité recoupe l'expérience du passé où les gains d'efficacité ont permis de développer la production de sorte que les élévations de prix anticipées ne se sont pas produites.
D'autres prospectives confirment ce résultat en suivant la même approche. Dans deux études d'Ivanic et Martin (2010) et van der Mensbrugghe et al. (2009), on prévoit des augmentations de prix du maïs, du riz et du blé de 127 %, 110 % et 68 % respectivement, mais l'absence de hausse significative des prix (même en termes nominaux) dans l'hypothèse d'un progrès de productivité de 1 % par an.
La sensibilité au changement climatique varie elle aussi en fonction des gains de productivité. Dans une étude de Parry (2004), alors que les prix augmenteraient de 30 à 80 % entre 1990 et 2050, le changement climatique ajouterait une hausse de 7 à 20 % en cas de progrès de productivité liés à la fertilisation et de 50 à 100 % sans ceux-ci.
III. LA VOLATILITÉ, UNE QUESTION UN PEU SECONDE, MAIS IMPORTANTE
A. APERÇUS THÉORIQUES
Le problème de la volatilité des prix alimentaires est de plus en plus posé. La volatilité s'apprécie en considérant l'ampleur et la fréquence des écarts à une moyenne.
Techniquement, les épisodes de « flambée de prix » sont constitués, quant à eux, dès lors que la variation des prix atteint un pourcentage supérieur à deux écarts-types calculés au cours des cinq dernières années précédant la période pour laquelle les prix sont observés.
Ces épisodes de flambée sont rares. Dans le temps long, on en identifie quatre : les années 1972-74, 1988, 1995 et la période récente. Vue à partir des seuls prix exprimés en termes réels, la rareté du phénomène est encore plus forte. Quatre années seulement le vérifient : 1973 et 1974, 2007 et 2008.
Mais si les flambées sont rares, la volatilité ne l'est pas. Or, si la volatilité des prix alimentaires pose des problèmes seconds par rapport à la question fondamentale de la tendance des prix, elle n'en est pas moins à considérer.
Ainsi, s'il faut regretter que l'agenda du G20 défini par notre pays lors de l'exercice de sa présidence ne se soit pas attaqué prioritairement au problème primordial des tendances des prix alimentaires et, fondamentalement, à la question essentielle de la sécurité alimentaire dans le monde, il n'est pas injustifié d'aborder les questions spécifiques que pose la volatilité des prix alimentaires. Celles-ci recouvrent d'ailleurs une partie des interrogations concernant la tendance des prix alimentaires dans le futur ainsi que les conclusions finalement adoptées par le G20 en témoignent.
Hormis les problèmes de fonctionnement des marchés associés aux messages confus adressés aux producteurs par des évolutions extrêmes des prix (qu'on résume plus bas), la volatilité des prix des matières premières alimentaires est susceptible de poser des problèmes économiques et sociopolitiques graves.
Les années qui viennent de s'écouler montrent assez que les prix alimentaires sont soumis à des variations importantes, phénomène connu de longue date par les économistes qui, dans le passé, ont pu en décrire le déroulement pour telle ou telle production agricole (le « cycle du porc » faisant ici référence).
Mais, les temps présents et les enseignements des travaux de prospective renouvellent complètement l'actualité de cette question.
Plusieurs phénomènes se conjuguent dans ce sens.
• Les perspectives d'augmentation de la demande alimentaire en lien avec le développement économique et les tendances démographiques, des pays émergents notamment, sont soutenues quand les variations de l'offre disponible sont, elles, plus hypothétiques.
Même si l'on suppose crédibles les diagnostics selon lesquels la production pourra structurellement satisfaire la demande, la probabilité que des désajustements entre demande et offre puissent se produire, sporadiquement en cas de problèmes naturels, ou plus structurellement si l'élasticité de ces deux grands déterminants de marché ne sont pas homogènes se renforce.
Dans ces conditions, on peut anticiper que les prix réagissent plus que les quantités et qu'une tendance au renforcement de la volatilité intervienne.
Mais un autre phénomène peut aggraver les inquiétudes relatives à la volatilité des prix alimentaires. Il s'agit de la « financiarisation » des produits agricoles et alimentaires.
Ce dernier phénomène est encore difficilement appréciable et l'une des propositions de la présidence française du G20 a du reste été d'améliorer l'information nécessaire à sa perception.
Mais, le processus semble en marche et il signifie que des actifs agricoles et alimentaires seront de plus en plus traités comme tout autre actif financier.
Dans ces conditions, les cours de ces produits n'obéiront plus seulement à des déterminants physiques. Ils seront aussi le résultat de mécanismes purement financiers. Or, les marchés financiers ont largement montré dans le passé leur instabilité, instabilité dont les ressorts ont été systématiquement étudiés au cours des dix dernières années.
Par ailleurs, l'histoire très ancienne montre que des produits de l'agriculture peuvent être le vecteur de positions spéculatives susceptibles d'entraîner la déstabilisation de toute une économie (voir en particulier l'explosion de la bulle financière sur les tulipes hollandaises en 1637 dite aussi « bulle du bulbe »).
Enfin, il ne faut pas négliger les effets potentiellement attachés à la volatilité macroéconomique générale ou à celle d'intrants indispensables à la production agricole et connexes à celle-ci la question des conflits d'usage.
À cet égard, les perspectives des marchés énergétiques, et, plus particulièrement, du marché du pétrole présentent un intérêt majeur. Or ce marché connaît des caractéristiques qui vont dans le sens d'une forte volatilité59(*).
Les risques attachés à la volatilité des prix alimentaires sont considérables, s'agissant de produits nécessaires à la satisfaction de besoins vitaux.
Évidemment le risque majeur est celui que les prix alimentaires atteignent à un moment donné des niveaux tels qu'ils remettent en cause la capacité de certaines populations à se nourrir. Le risque est alors vital ; il est aussi politique et le passé ancien, mais aussi plus récent, enseigne que des révolutions, ou des guerres peuvent résulter de situations de stress alimentaire.
La distribution primaire d'un tel risque pèse avant tout sur les populations des zones en déficit alimentaire et sur les franges les plus pauvres (mais se sont souvent les mêmes populations qui sont concernées). Il serait moralement intolérable et politiquement irresponsable de se réconforter en s'imaginant être à l'abri des effets des famines qui pourraient s'en suivre.
Par rapport à cette préoccupation fondamentale, les autres risques à envisager peuvent apparaître secondaires. Ils n'en sont pas moins importants.
En premier lieu, toute tension sur les prix alimentaires entraîne une hausse du niveau général des prix qui réduit d'autant le pouvoir d'achat des ménages, dans la mesure où elle n'est pas compensée par une hausse de leurs revenus.
Par ailleurs, étant donné la structure de demande des différents segments de la population, un tel choc de prix ampute tout particulièrement le pouvoir d'achat des ménages appartenant aux catégories sociales les plus fragiles. Leur bien être économique déjà faible est fragilisé et, globalement, par ses effets asymétriques, « l'inflation alimentaire » augmente les inégalités.
La question des impacts macroéconomiques d'épisodes de déviation par le haut par rapport à la tendance des prix doit être complétée par l'évocation de ses effets sur les équilibres économiques mondiaux. Sans doute n'existe-t-il pas actuellement, comme pour d'autres matières premières, une concentration des producteurs telle que des cartels pourraient gérer l'offre de sorte que se crée un mécanisme donnant naissance à des « agro-dollars » comme il y a des « pétrodollars ». Cependant, les exercices de prospective disponibles montrent que le creusement des déficits alimentaires locaux est une perspective tendancielle et que, si rien n'était entrepris pour l'éviter, les balances commerciales mondiales déjà déstabilisées par les volumes à échanger pour équilibrer la demande et l'offre locales pourraient se trouver dramatiquement déséquilibrées tant par la tendance haussière des prix alimentaires que par la volatilité des prix alimentaires. Ces déséquilibres risquent en outre d'affecter la parité des devises nationales des importations (accroissant leurs déséquilibres extérieurs si leurs exportations ne réagissent pas favorablement à la dépréciation de leurs monnaies).
Enfin, le choc négatif de croissance que les hausses élevées des prix alimentaires entraînent réduit la base fiscale des pays et complique l'équilibre de leurs budgets nationaux. Des déséquilibres jumeaux (déficits extérieurs et des finances publiques) peuvent apparaître nécessitant des ajustements de politique économique réduisant le bien-être de populations potentiellement déjà très affectées par la réduction de leurs revenus réels.
Des pénuries physiques peuvent apparaître et renforcer des crises qui peuvent devenir dramatiques. Des famines peuvent se produire ainsi que des migrations plus ou moins massives.
Évidement, ces enchaînements :
- dépendent de l'ampleur des mouvements de prix ;
- et sont asymétriques, les pays importateurs subissant ces hausses ainsi que les individus les plus pauvres.
Si les flambées de prix alimentaires sont des épisodes rares, la volatilité des prix est de règle sur les marchés de matières premières agricoles. Elle résulte de l'existence de fréquents désajustements entre offre et demande, les produits agricoles étant sujets à des aléas physiques plus ou moins prévisibles et, plus généralement, se caractérisant par une logique productive qui n'est qu'exceptionnellement compatible avec les fluctuations de la demande.
De fait, l'offre alimentaire est relativement inélastique. Dans de telles conditions, l'offre tend à réagir tardivement à la demande et, en même temps, paradoxalement à sur-réagir à celle-ci ou bien avec retard.
Ces déséquilibres successifs impliquent des hausses puis des baisses de prix alimentaires.
À ces facteurs physiques peuvent s'ajouter les effets des interventions sur le marché mises en oeuvre en réaction aux évolutions des prix, qu'elles viennent des pouvoirs publics ou des acteurs privés du marché.
Du côté des autorités publiques, la régulation des marchés peut exercer des effets déstabilisants. Par exemple, en situation de hausse subite des prix, il arrive assez souvent que, pour répondre aux pénuries qui les provoquent parfois, des dispositions soient prises pour accroître la production et réserver l'offre disponible à des usages nationaux. Les subventionnements accordés, les stockages (accompagnés dans certains cas de restrictions à l'exportation), peuvent accentuer la volatilité. Dans le premier cas, si la contraction de l'offre est due à des conditions momentanées, l'essor de la production résultant des subventions peut participer à la constitution d'un excès d'offre dans la période consécutive de retour à la normale.
Dans le second cas, les politiques de restriction à la mise sur le marché suscitées par un réflexe de précaution peuvent augmenter encore les prix des produits alimentaires.
Du côté des intervenants privés, il est à craindre que la volatilité n'alimente la volatilité. Les intervenants sur les marchés peuvent, pour certains d'entre eux, ne pas être hostiles à l'incertitude dont la volatilité des prix est une des manifestations. Car l'incertitude créée, avec la volatilité qu'elle engendre, des opportunités de spéculation. On peut même dire qu'elle les justifie dans la mesure où des opérations spéculatives mais à visée non spéculative, comme la couverture des risques, découlent, face aux situations d'incertitude, d'une volonté prudentielle.
B. L'ÉPISODE DE FIÈVRE DES PRIX AGRICOLES DES ANNÉES 2006-2008
Les prix des matières premières agricoles ont connu une forte hausse à partir de 2007. Les causes de ces tensions sont-elles à rechercher du côté des équilibres réels - la traditionnelle rencontre de l'offre et de la demande - ou du côté de l'effet des spéculations financières ? Autrement dit, la forte volatilité des prix agricoles alors constatée doit-elle être imputée à des phénomènes réels ou à des processus financiers créateurs de bulles, comme il en existe sur d'autres marchés ?
Selon une étude de la DGTPE du ministère de l'économie et des finances60(*), les données disponibles suggéreraient que l'effet des positions financières sur les marchés à terme de produits agricoles sur les prix au comptant aurait été faible au cours de cet épisode comparé à l'impact des facteurs traditionnels d'offre et de demande de produits agricoles. Ce constat s'il était exact n'équivaudrait pour autant pas à dénier un potentiel déstabilisant à la financiarisation des actifs agricoles.
Par ailleurs, il apparaît justifié de considérer la contribution des facteurs traditionnels d'équilibre sur les marchés agricoles à l'oeuvre dans l'épisode de fièvre des prix agricoles sous revue. Ils rappellent la fragilité de ces équilibres et comportent la confirmation de quelques inquiétudes nouvelles quant à leur avenir en lien avec l'intervention de nouvelles tendances
La hausse des prix des produits de base agricole qui s'est enclenchée fin 2006 s'est emballée jusqu'en 2008 particulièrement pour le riz blanc et les graines de soja.
Prix de matières premières agricoles
Source : DGTPE. Trésor-Eco n° 41. Juillet 2008
Pour le soja, qui est la matière première agricole dont le prix a le moins augmenté, l'accroissement du prix s'est élevé à 2,2 fois le prix d'origine entre l'année de base et le pic.
L'augmentation des prix agricoles a accéléré l'inflation mondiale. En 2007, elle en a représenté la moitié contre 25 % en 2006. Les prix à la consommation étant plus sensibles aux prix alimentaires dans les pays où l'alimentation constitue une part relativement importante de la consommation, ce sont les pays les moins avancés qui ont été les plus touchés : l'inflation des prix alimentaires s'est élevée aux 2/3 de l'inflation en Asie, à la moitié en Afrique contre seulement 20 % de l'inflation dans les pays avancés.
Pour la France, alors que la hausse des prix alimentaires était de 1,3 % en juin 2007, elle est passée à 3,1 % en décembre 2007 et à 5,5 % en juin 2008.
En bref, l'augmentation des prix des produits agricoles de base touche les plus modestes, que ce soit à l'échelle du monde ou des pays les plus avancés puisque l'alimentation représente une part de la consommation des ménages à bas revenus sensiblement plus importante que pour les autres ménages.
Les facteurs de marché traditionnels explicatifs des prix - la demande et l'offre - auraient joué un rôle essentiel dans les variations observées.
La demande de produits agricoles est en augmentation à mesure que se développent les pays émergents et les usages alternatifs à l'alimentation.
Le développement économique des pays émergents provoque une consommation accrue de produits agricoles d'autant qu'il s'accompagne de modifications des habitudes alimentaires passant par un recours plus important aux produits de base de l'agriculture. La Chine est devenue importatrice nette de produits agricoles en 2004.
Quant aux utilisations alternatives, l'extension de la production de biocarburants va dans le sens d'une plus grande sollicitation des capacités agricoles. À titre d'exemple, au plan mondial, environ 100 millions de tonnes de céréales ont été absorbées en 2007 par la production d'éthanol (dont 80 millions aux États-Unis), alors que le déficit total de céréales cumulé sur 2006 et 2007 a été d'à peu près 50 millions de tonnes selon le Conseil international des céréales (CIC). Ainsi, le développement massif de la consommation de bioéthanol a certainement contribué à la hausse du prix du maïs. Dans l'Union européenne, les deux tiers de la production de colza ont été absorbés par la production de biodiésel.
Cependant, la contribution des biocarburants à la hausse des prix agricoles est souvent relativisée dans la mesure où la part de la production de céréales destinée aux biocarburants est assez faible (environ 6 %), voire marginale pour certains produits comme le blé (moins de 1 %), d'après les données du CIC.
La hausse des prix agricoles n'a, en régime normal (il faut évidemment réserver l'hypothèse de ruptures dans la perspective de crises de l'alimentation), que peu d'impact sur la demande globale de produits alimentaires61(*)62(*).
De son côté, l'augmentation de la demande se heurte à une offre qui semble assez peu flexible et dont les coûts de production sont en augmentation.
S'agissant de la période sous revue, l'offre a été affectée par des sécheresses en Australie et Ukraine (pays exportateurs), mais aussi en Inde et au Maroc (importateurs nets) qui ont entraîné dans les régions concernées une forte baisse de la production de blé sur deux années consécutives (2006 et 2007).
Cependant, les autres productions (maïs, soja, par exemple) ont été peu touchées par les conditions climatiques alors que leurs prix ont également sensiblement augmenté.
En ce cas, on attribue cette augmentation à une certaine rigidité de l'offre. Celle-ci a d'ailleurs pu être renforcée par la substitution à ces cultures des cultures pour lesquelles les marges attendues ont monté en raison des accidents climatiques survenus dans le reste du monde.
En France, par exemple, il était attendu que les marges en 2008 pour la production de blé étant nettement supérieures à celles du colza, les surfaces cultivées en blé augmentent de près de 5 % en partie au détriment des surfaces cultivées en colza qui devaient baisser de plus de 8 %.
On relèvera qu'il existe dans la substituabilité des cultures, quand elle est possible, un élément de flexibilité de l'offre mais une flexibilité dont les effets globaux sur les prix sont mesurés puisque la restriction des surfaces consacrées à certaines cultures augmente, à court terme, le prix de ces cultures sauf vraie différenciation de la demande.
La raréfaction de l'offre a entraîné une diminution des stocks mondiaux de céréales.
Variation des stocks entre les campagnes 2005/06 et 2007/08
Source : DGTPE. Trésor-Eco n° 41. Juillet 2008
Par rapport à la fin des années 90, la chute des stocks aurait atteint 55 % et leur niveau aurait été un temps à l'étiage en ne représentant plus que 18 % de la consommation.
La saturation des capacités de production mises en oeuvre s'est accompagné d'une hausse des prix des matières premières non agricoles nécessaires à la production. Les prix des engrais auraient crû de 200 % en 2007.
Enfin, il faut souligner que les réactions des politiques ont pu aggraver les pressions à hausse des prix agricoles. Certains États (le Vietnam et l'Inde pour le riz notamment) ont pris des mesures de limitation voire d'interdiction des exportations agricoles. Ces mesures pénalisent l'approvisionnement des pays importateurs nets de produits agricoles puisque l'offre susceptible de satisfaire leur demande se raréfie. En outre, la limitation des volumes écoulables qu'elles impliquent désincite à investir ce qui contraint l'offre potentielle. Ces réactions valent d'être gardées en mémoire compte tenu de l'augmentation des probabilités de voir dans le futur se répéter des pics de prix que pourraient aggraver des politiques qu'on peut juger avoir plus d'effets pervers que de conséquences bénéfiques.
Face à ces modifications des équilibres de la demande et de l'offre de produits de base agricoles, les spéculations intervenues sur les marchés de gros n'auraient exercé que des effets limités sur les prix. En bref, leur responsabilité sur l'augmentation des prix agricoles ne serait pas avérée selon la DGTPE.
Cette étude semble s'inscrire dans la mouvance des études académiques qui estiment que les transactions sur les marchés à terme - n'importe quel marché à terme - n'accroissent pas la volatilité des marchés au comptant. Ces études parient sur l'efficience des marchés qui suppose que soient réunies de nombreuses conditions parmi lesquelles la rationalité des investisseurs figure au premier rang. Mais, cette rationalité, au terme de laquelle les prix à terme seraient le strict reflet d'anticipations correctes des conditions d'équilibre des marchés aux différentes échéances envisagées, fait fi de toute une littérature selon laquelle les marchés à terme, loin d'obéir à des comportements rationnels seraient des marchés de conventions, c'est-à-dire des marchés obéissant à une logique largement autonome et indépendante des conditions physiques et économiques de l'offre et de la demande réelles.
Le développement des opérations sur les marchés agricoles à terme a été important. En témoigne la progression spectaculaire des transactions sur ces marchés. Ainsi, le nombre de contrats futures agricoles échangés quotidiennement sur le Chicago Board of Trade (CBoT) a plus que triplé depuis 2000. Sur les marchés à terme de céréales, l'ensemble des positions à l'achat et à la vente tous intervenants confondus se sont nettement accrues, singulièrement à partir de 2004.
Évolution du total des positions sur les compartiments agricoles du CBoT
Source : DGTPE. Trésor-Eco n° 41. Juillet 2008
L'essor des marchés à termes a été favorisé par des innovations organisationnelles dont le développement de nouveaux supports d'investissement. Il s'agit principalement des ETF (Exchange-Traded Funds), ces véhicules d'investissement émettant des parts cotées en bourse et qui répliquent la performance d'un indice de cours de matières premières ont proliféré. Selon le régulateur des marchés à terme de matières premières américains, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), les émetteurs d'ETF sur matières premières représentent aujourd'hui 20 à 50 % des volumes des futures sur matières premières agricoles sur les marchés de Chicago, Kansas City ou New York.
Nombre d'etf (exchange-traded funds) de matières premières agricoles
Source : DGTPE. Trésor-Eco n° 41. Juillet 2008
Comme pour tout autre marché à terme, les intervenants sont de deux types :
- les opérateurs en couverture (hedgers ou « commercial traders »), qui cherchent à couvrir le risque de prix en prenant une position inverse que celle qu'ils ont prise sur le marché au comptant (producteurs, négociants, utilisateurs) ou sur le marché des contrats d'échange ou swaps (banques) ;
- les investisseurs financiers (« non commercial traders ») qui placent leurs avoirs en achetant des contrats à terme de matières premières agricoles dans le but de diversifier leur portefeuille afin d'en réduire le risque, de se prémunir contre le risque d'inflation ou pour réaliser un profit en spéculant sur l'évolution des cours à terme.
Compte tenu de l'augmentation des transactions sur ces marchés, beaucoup plus forte que celles des transactions au comptant, c'est moins le motif de couverture qui aurait joué que les motifs traditionnels des investisseurs financiers.
De fait, les opérations à court terme sur les matières primaires agricoles peuvent :
- répondre à un objectif d'augmenter les rendements des actifs détenus dans une optique de court terme selon un arbitrage classique risque/rendement dont les termes dépendent principalement de l'écart entre la hausse des prix anticipés et le coût de l'investissement (le taux d'intérêt) ;
- correspondre à une diversification des risques de portefeuilles constitués dans une optique de long terme (celle théorique des fonds de pension, par exemple). Ce motif serait lié aux propriétés des matières premières agricoles dont, comme semblent l'attester plusieurs études63(*), la valeur dépend de variables différentes dans leur nature ou leur évolution de celles qui influencent celles des autres actifs.
En tout cas, le rendement des actifs agricoles a été particulièrement fort sur la période concerné par la hausse des cours.
Ainsi, 100 $ investis à la fin de 2005 en contrats agricoles à terme (indice S&P GSCI agriculture) auraient rapporté en juin 2008 167 $ (voir graphique ci-dessous). C'est inférieur à ce qu'ils auraient rapporté en contrats pétroliers à terme (227 $ pour l'indice S&P GSCI pétrole). Mais supérieur à ce qu'aurait rapporté un investissement dans les obligations d'État américaines à 10 ans ou des actions internationales (indice MSCI AC World), dont la performance aurait été de 111 $ et 115 $ dollars respectivement.
Rendements comparés de différents placements financiers
Source : DGTPE. Trésor-Eco n° 41. Juillet 2008
Évidemment, ces rendements sont réversibles dans le cas d'une inversion des cours des marchés agricoles à terme.
La CFTC répartit les investisseurs à terme en deux catégories :
- les « commercial traders » sont réputés intervenir à des fins de couverture, c'est-à-dire que leurs positions à terme compensent des engagements d'autres sens (une vente, à terme un engagement d'achat, par exemple) ;
- les « non-commercial traders » n'interviennent pas dans le cadre de couvertures mais se comportent comme des investisseurs financiers classiques.
C'est sur la base de cette distinction que sont réalisées les analyses sur les mécanismes en jeu dans la dynamique des marchés à terme : les positions prises par les « non-commercial traders » sont distinguées des autres pour identifier la composante spéculative des transactions.
La CFTC fait observer que la part de ces positions dans le total des positions n'a pas augmenté (excepté pour le riz) et en tire la conclusion que la spéculation ne serait pas responsable de la hausse des prix agricoles à terme même si le nombre des positions longues (celles qui impliquent des achats à terme et donc des anticipations de hausse des prix) avait augmenté depuis 2006.
Positions nettes longues des investisseurs
sur
les marchés à terme agricoles du CBoT
Source : DGTPE. Trésor-Eco n° 41. Juillet 2008
Selon cette analyse, l'augmentation et le maintien de positions longues ne feraient que refléter un sentiment de marché ambiant et puisque leur part dans le total des positions n'aurait pas changé on ne saurait leur imputer une quelconque responsabilité dans les variations des prix.
Cet argumentaire est loin d'emporter la conviction.
D'emblée, on peut estimer qu'il serait surprenant que dans le contexte de financiarisation des marchés agricoles ceux-ci aient pu être un compartiment préservé des effets de bulle observés sur d'autres positions du marché financier. Les rendements théoriques rappelés plus haut semblent d'ailleurs témoigner pour, et du contraire.
Mais, par ailleurs, les conventions appliquées par la CFTC sont plus qu'incertaines.
La frontière entre opérateurs de couverture et investisseurs est particulièrement fragile. Ainsi, la catégorie des « commercial traders » identifiée par la CFTC ne regroupe pas que des participants des marchés physiques de produits agricoles. Par exemple, lorsqu'un établissement bancaire accepte de verser à un fonds de pension un flux de trésorerie fondé sur la hausse d'un indice de matières premières et couvre le risque encouru en prenant une position acheteuse sur des marchés à terme, l'opération est retracée comme une opération de couverture dans les déclarations auprès de la CFTC, alors qu'il s'agit en fait d'un pari de la part d'un fonds de pension sur l'évolution de l'indice, susceptible d'alimenter les anticipations de hausse des prix des matières premières. Si l'indice progresse, la banque versera au fonds de pension une somme équivalente à la hausse.
Selon toute vraisemblance, la spéculation a été un facteur de la hausse des prix des matières premières agricoles.
Toutefois, la corrélation entre prix à terme et prix au comptant s'est distendue au cours de l'épisode sous revue si bien que l'effet de la spéculation sur les prix au comptant aurait été plutôt faible.
Le graphique ci-dessous semble accréditer le constat que des écarts entre prix à terme et au comptant se sont produits, de façon d'ailleurs particulièrement instables en fin de période.
Écart entre le prix du contrat à
terme le plus proche
et le prix au comptant du blé, du maïs et
du soja
Source : DGTPE. Trésor-Eco n° 41. Juillet 2008
On en conclut que les prix à terme n'ont pas influencé les prix agricoles au comptant.
Cela serait en outre confirmé par le suivi des prix des matières premières pour lesquelles il n'existe pas de marchés à terme. On cite la faiblesse de l'écart de rendement entre les matières premières agricoles et d'autres matières premières pour lesquelles il n'existe pas de marchés à terme pour suggérer que ceux-ci n'ont eu que peu d'incidence sur les prix agricoles.
Écart de rendement annuel entre des produits de base agricoles liés à des contrats futures et des métaux non négociés sur des marchés à terme
Source : DGTPE. Trésor-Eco n° 41. Juillet 2008
La déconnexion entre prix au comptant et prix à terme est un phénomène qui est anormal puisque théoriquement ces prix à terme et au comptant s'équilibrent.
C. LES ORIENTATIONS DU G20 SOUS PRÉSIDENCE FRANÇAISE
Le G20 s'est penché sur la définition d'un « Plan d'action sur la volatilité des prix alimentaires et sur l'agriculture ».
En préambule de la déclaration du mois de juin figure un rappel des engagements pris au sommet de l'Aquila, au sommet mondial de l'alimentation de 2009 à Rome et dans les autres réunions du G20.
Il évoque le consensus sur la nécessité de politiques agricoles plus efficaces à l'échelle mondiale et nationale et sur le besoin d'une meilleure coordination internationale.
La perspective d'une croissance des besoins notamment dans les pays en développement où déjà se posent le plus les problèmes oblige à agir pour la sécurité alimentaire sur la base des « cinq principes de Rome » définis en novembre 2009.
La déclaration procède à la réaffirmation du droit de chaque être humain à avoir accès à une nourriture saine, suffisante et nutritive.
L'augmentation de la production et de la productivité agricoles est considérée comme une nécessité sous réserve qu'elle soit durable.
La volatilité des prix agricoles est vue comme un défi à l'augmentation de la production agricole.
On trouvera ci-après les principales conclusions du G20. Le plan d'action sur la volatilité des prix agricoles poursuit cinq objectifs principaux :
1. améliorer la production et la productivité en agriculture à court et à long terme pour répondre à une demande croissante de matières premières agricoles ;
2. renforcer l'information et la transparence du marché pour donner des bases plus solides aux anticipations des gouvernements et des opérateurs économiques ;
3. renforcer la coordination politique internationale pour améliorer la confiance dans les marchés internationaux et ainsi prévenir les crises des marchés alimentaires et y répondre de manière plus efficace ;
4. améliorer et développer les outils de gestion du risque pour les gouvernements, les entreprises et les agriculteurs afin de renforcer leur capacité à gérer et à limiter les risques liés à la volatilité des prix agricoles, notamment dans les pays les plus pauvres ;
5. améliorer le fonctionnement des marchés dérivés de matières premières, cet objectif étant poursuivi dans le cadre du travail des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales.
1. La nécessaire augmentation de la production et de la productivité agricoles
La production agricole devra augmenter de 70 % d'ici 2050 et de 100 % dans les pays en développement.
Conformément au plan d'action pluriannuel pour le développement, il faudra augmenter la résilience, la production, la productivité et l'utilisation efficace des ressources en particulier dans les pays les moins développés pour les petites exploitations familiales.
Il faut anticiper les effets des changements climatiques sur la production agricole.
La recherche doit être développée conformément à la « feuille de route de Montpellier » adoptée à l'issue de la première « Conférence mondiale sur la recherche agricole pour le développement de 2010 ». Les transferts de technologie devront être favorisés.
Une « initiative internationale de recherche pour l'amélioration du blé » est adoptée.
L'accent est mis sur la nécessité de créer un environnement propice à l'augmentation des investissements publics et privés dans l'agriculture.
La question de l'eau est considérée comme particulièrement cruciale.
L'importance des « Principes pour des investissements agricoles responsables » est rappelée.
La contribution de l'agriculture à la réduction des gaz à effet de serre est mentionnée comme l'un des trois défis lancés à l'agriculture (à côté de la sécurité alimentaire et de l'adaptation au changement climatique).
2. L'information et la transparence des marchés
Il est nécessaire d'améliorer la qualité des données sur les marchés agricoles. À cet effet, un « système d'information sur les marchés agricoles - AMIS » est lancé pour encourager les principaux acteurs des marchés à partager leurs données et à promouvoir le dialogue politique et la coopération.
Fondé sur la réunion des pays du G20, le système serait élargi pour accueillir les plus importants des acteurs du marché (producteurs, consommateurs et acteurs des échanges internationaux), y compris privés. L'AMIS sera « hébergé » par la FAO et le Conseil international des céréales (CIC) y collaborera.
L'AMIS devra bénéficier des informations des systèmes d'alerte précoce existant déjà (FAO-SMIAR ; USAID-FEWS-NET ; PAM-VAM).
À cela s'ajoute le lancement d'une « initiative de suivi satellitaire de l'agriculture mondiale » sous la forme d'un réseau volontaire.
3. Le renforcement de la coordination politique internationale
|
Les cinq principes de Rome Le sommet mondial sur la sécurité alimentaire réuni à Rome du 16 au 18 novembre 2009 sous l'égide de la FAO a adopté cinq principes destinés à atteindre les objectifs stratégiques alors définis. Ces objectifs sont les suivants. 1. Veiller à ce que des mesures urgentes soient prises aux niveaux national, régional et mondial pour assurer la concrétisation pleine et entière de l'Objectif du Millénaire pour le développement no 1 et de l'Objectif du Sommet mondial de l'alimentation de 1996, à savoir réduire de moitié respectivement le pourcentage et le nombre de personnes souffrant de faim et de malnutrition d'ici à 2015. 2. Unir les efforts pour oeuvrer au sein du Partenariat mondial pour l'agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition en s'appuyant sur les structures en place pour renforcer la gouvernance et la coopération, promouvoir une meilleure coordination aux échelles mondiale, régionale et nationale et faire en sorte que les intérêts nationaux et régionaux soient dûment exprimés et pris en compte et à cet effet mettre en oeuvre intégralement la réforme du Comité pour la sécurité alimentaire (CSA) principale plateforme internationale et intergouvernementale ouverte au sein de laquelle collaborent toutes sortes de parties prenantes. 3. Inverser la tendance à la diminution des financements nationaux et internationaux consacrés à l'agriculture, à la sécurité alimentaire et au développement rural des pays en développement et promouvoir de nouveaux investissements propres à susciter une augmentation de la production et de la productivité agricoles durables, à réduire la pauvreté et à contribuer à la sécurité alimentaire et à l'accès de tous à la nourriture. 4. Agir par anticipation pour faire face aux problèmes que pose le changement climatique en matière de sécurité alimentaire et pour répondre à la nécessité d'une adaptation et de mesures d'atténuation dans le domaine de l'agriculture et de renforcer la capacité d'adaptation des producteurs agricoles au changement climatique, en mettant l'accent sur les petits producteurs agricoles et les populations vulnérables. Afin d'atteindre ces objectifs, cinq principes ont été adoptés correspondant à des engagements sur des mesures à prendre. Principe 1 : Investir dans des plans pris en charge par les pays, visant à affecter les ressources à des programmes et à des partenariats bien conçus et axés sur les résultats. Il est admis que la responsabilité de la sécurité alimentaire incombe aux pays et que tout programme visant à relever les défis de la sécurité alimentaire doit être formulé, élaboré, pris en charge et conduit par les pays après une concertation avec toutes les principales parties prenantes. Mais, l'engagement d'intensifier le soutien international pour faire progresser des stratégies efficaces menées par les pays et les régions, est pris. Le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA) du nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), est considéré comme un bon exemple à cet égard, de même que les initiatives : « l'Amérique latine et les Caraïbes libérées de la faim en 2025 », le « Cadre intégré de la sécurité alimentaire de l'ANASE » et la « Déclaration de Riyad sur le renforcement de la coopération arabe pour faire face aux crises alimentaires mondiales ». Principe 2 : Stimuler une coordination stratégique aux niveaux national, régional et mondial pour améliorer la gouvernance, favoriser une meilleure allocation des ressources, éviter les chevauchements d'efforts et identifier les insuffisances des réponses. Le Partenariat mondial pour l'agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition doit être l'enceinte d'une coordination stratégique des efforts aux niveaux national, régional et mondial en tirant parti des structures existantes, en assurant une ouverture en ce qui concerne la participation et en favorisant une approche partant véritablement de la base, fondée sur les expériences menées et sur l'évolution de la situation constatée sur le terrain. Son organe, le CSA, offre une plateforme de débats et de coordination afin de renforcer la collaboration entre les gouvernements, les organisations régionales, les organisations et instances internationales, les ONG, les OSC, les organisations de producteurs vivriers, les organisations du secteur privé, les organisations philanthropiques et les autres parties prenantes concernées, en fonction du contexte et des besoins spécifiques de chaque pays. Son rôle doit être primordial dans les domaines de la coordination à l'échelle mondiale, de la convergence des politiques, de l'appui et des avis donnés aux pays et aux régions. Il devra élaborer un cadre stratégique mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Principe 3 : S'efforcer d'adopter une double approche globale de la sécurité alimentaire consistant en : 1) une action directe visant à remédier immédiatement à la faim dont souffrent les plus vulnérables et 2) des programmes à moyen et long termes dans les domaines de l'agriculture durable, de la sécurité alimentaire, de la nutrition et du développement rural visant à éliminer les causes profondes de la faim et de la pauvreté, en particulier grâce à la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate. Une attention particulière doit être accordée au développement rural, à la création d'emplois et la création et la répartition de revenus plus équitables en vue de surmonter la pauvreté et d'améliorer l'accès à la nourriture. Les conditions d'une augmentation de la production, y compris l'accès à des semences et à d'autres intrants améliorés et l'adaptation de l'agriculture au changement climatique, en reconnaissant le potentiel d'atténuation de l'agriculture durable devront être créées. L'investissement public et l'investissement privé dans les plans élaborés par les pays pour les infrastructures rurales et les services d'appui, ainsi que les infrastructures routières, l'entreposage, l'irrigation, la communication, l'éducation, l'appui technique et la santé seront encouragés. L'accent devra être mis sur les actions intégrées concernant les politiques, les institutions et les personnes touchant les petits agriculteurs et les agricultrices. L'importance pour les pays en développement, de renforcer leurs capacités institutionnelles en matière d'élaboration et de mise en oeuvre de politiques efficaces, fondées sur des données factuelles, qui assurent l'accès aux aliments, luttent contre la malnutrition et permettent aux petits agriculteurs d'avoir accès aux technologies, aux intrants, aux biens d'équipement, au crédit et aux marchés est soulignée. De même, les populations vulnérables sont particulièrement mentionnées et un appel au renforcement des mesures et programmes de protection sociale pour permettre aux communautés et aux ménages d'avoir accès aux avantages économiques et sociaux et contribuer à la stabilité sociale est lancé. En particulier, la mise en place de filets de sécurité visant à protéger la consommation alimentaire, comme la distribution d'espèces ou de bons d'approvisionnement, ainsi que la nutrition maternelle et infantile est préconisée. Les restrictions imposées aux exportations alimentaires ou les taxes extraordinaires sur les aliments achetés à des fins humanitaires non commerciales devront être éliminées. Le fonctionnement des marchés nationaux, régionaux et internationaux devra être amélioré notamment pour garantir l'accès équitable de tous, notamment des petits exploitants et des agricultrices des pays en développement à ces marchés. Tout en reconnaissant que les règles de l'OMC peuvent devoir être adaptées, elles sont considérées comme profitables à la sécurité alimentaire de même que la réussite des négociations de Doha. Un soutien est accordé à l'initiative « Aide pour le commerce », qui vise à permettre aux agriculteurs et aux producteurs des pays en développement de résoudre leurs problèmes relatifs à l'offre et à améliorer leur capacité de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. La mise en oeuvre intégrale de la décision de Marrakech est demandée. Les organisations internationales concernées devront examiner les éventuels liens entre la spéculation et la volatilité des cours des produits agricoles et évaluer l'intérêt de constituer des stocks pour faire face à des urgences humanitaires ou pour limiter l'instabilité des prix. L'engagement est pris, compte tenu des conditions propres à chaque pays, de soutenir un accroissement de la production et de la productivité agricoles et de réduire les pertes avant et après récolte, tout en appliquant des pratiques durables. L'accroissement de la productivité agricole est considéré comme le principal moyen dont on dispose pour répondre à la demande croissante d'aliments, compte tenu des contraintes qui pèsent sur une extension de l'utilisation des terres et des ressources en eau aux fins de la production vivrière. Le recours aux innovations et technologies nouvelles sûres, efficaces sans dommage pour l'environnement est mentionné comme prioritaire. L'exploitation de possibilités liées aux biocarburants doit tenir compte des besoins mondiaux en matière de sécurité alimentaire, d'énergie et de développement durable. Principe 4 : Veiller à ce que le système multilatéral joue un rôle important grâce à des améliorations continues au regard de l'efficience, de la réactivité, de la coordination et de l'efficacité des institutions multilatérales. L'ampleur mondiale du problème de la sécurité alimentaire exige une action rapide, décisive et coordonnée visant à s'attaquer à ses causes, à atténuer ses effets et à établir ou renforcer les mécanismes nécessaires pour éliminer la faim et la malnutrition de la planète. À cet égard, l'engagement en faveur du multilatéralisme et le renforcement de l'aptitude des institutions des Nations Unies, en particulier la FAO, le FIDA et le PAM et d'autres organisations multilatérales de portée mondiale, régionale et nationale, à s'acquitter de leur mission est pris. Le processus de réforme de la FAO doit être poursuivi ainsi que pour le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale et le Système mondial de recherche agricole par l'intermédiaire du Forum mondial sur la recherche agricole. Principe 5 : Garantir un engagement soutenu et substantiel, de la part de tous les partenaires, en faveur de l'investissement dans l'agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition, avec mise à disposition rapide et fiable des ressources nécessaires, dans le cadre de plans et de programmes pluriannuels. Les investissements nationaux et internationaux à court, moyen et long termes, dans l'agriculture des pays en développement doivent être accrus. L'engagement pris par les dirigeants africains, dans la Déclaration de Maputo, de consacrer à l'agriculture et au développement rural 10 % au moins de leurs dépenses budgétaires doit être encouragée et d'autres régions doivent adopter de semblables engagements quantitatifs et assortis d'un délai. Les engagements en matière d'aide publique au développement (APD), notamment ceux qu'ont pris de nombreux pays développés d'atteindre les objectifs de 0,7 % du produit intérieur brut (PIB) pour l'APD en faveur des pays en développement d'ici à 2015, et au minimum 0,5 % du PIB pour l'APD d'ici à 2010, ainsi qu'un objectif de 0,2 % du PIB pour l'APD en faveur des pays les moins avancés doivent être tenus. La part de l'APD consacrée à l'agriculture qui avait atteint 19 % en 1980, est tombée à 3,8 % en 2006. Il faut l'augmenter considérablement. Les engagements figurant dans la Déclaration commune de « L'Aquila » sur la sécurité alimentaire mondiale de juillet 2009, notamment ceux qui concernent l'objectif de mobilisation de 20 milliards d'USD sur trois ans doivent être honorés. |
Une gouvernance mondiale forte est indispensable.
Le système des Nations unies a un rôle crucial à jouer (à condition d'améliorer son efficacité, sa transparence et son efficience et de se concentrer sur le coeur de son mandat).
Les autres organisations internationales ont également un rôle important à jouer et doivent coordonner leurs actions (comme en est un exemple la UN-HLTF).
La coordination et la cohérence entre pays doivent être renforcées (dans le cadre du CSA).
Un forum de réaction rapide sera constitué dans le cadre d'AMIS.
Le commerce international peut jouer un rôle important pour améliorer la sécurité alimentaire et faire face à la volatilité des prix alimentaires. L'ouverture et le bon fonctionnement des marchés sont indispensables pour favoriser l'investissement dans l'agriculture. La gouvernance du commerce agricole doit être améliorée vis l'OMC et ses accords.
Le cycle de Doha pour le développement doit aboutir.
Les politiques qui faussent la production et les échanges de matières premières agricoles peuvent faire obstacle à l'objectif de sécurité alimentaire à long terme.
Les restrictions à l'exportation aux fins d'aide humanitaire doivent être abrogées même si chaque État a pour responsabilité première de nourrir sa population.
Les biocarburants continueront à être exploités compte tenu des besoins mondiaux de sécurité alimentaire, d'énergie et de développement durable.
Référence est fait aux travaux du Partenariat mondial sur les bioénergies (GPEP), au cadre d'analyse de la FAO et à l'Agence nationale pour les énergies renouvelables.
4. La réduction des effets de la volatilité des prix pour les plus vulnérables
La gestion du risque et l'atténuation de l'impact négatif de la volatilité excessive des prix alimentaires contribueraient fortement à la sécurité alimentaire mondiale.
Les filets de sécurité ciblés peuvent atténuer l'impact de la volatilité. Les assurances et les contrats entre producteurs, acheteurs et fournisseurs peuvent améliorer la gestion du risque de volatilité.
L'accès des agriculteurs aux marchés de gestion du risque, correctement régulés, doit être amélioré. L'initiative du groupe de la Banque mondiale pour concevoir des outils de gestion du risque innovants, le nouvel « Instrument de gestion des risques prix en agriculture » de la société financière internationale doit être saluée.
Une « boîte à outils de gestion des risques agricoles et de sécurité alimentaire » est mise en place.
L'assistance alimentaire restera un outil indispensable. Elle suppose la mise en place de réseaux pré-positionnés et l'intégration de la question du risque dans les achats internationaux d'assistance alimentaire.
Un système ciblé de réserves alimentaires humanitaires d'urgence complémentaires aux réserves alimentaires existantes devra être mis en place après une étude de faisabilité réalisée par le PAM.
5. La régulation financière
Des marchés financiers agricoles régulés sont essentiels au bon fonctionnement des marchés physiques en facilitant le processus de découverte des prix et en permettant aux opérateurs de se couvrir contre le risque de prix.
L'AMIS permettra d'améliorer la transparence sur les marchés physiques qui influence les marchés financiers.
Référence est faite aux travaux de l'organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).
Les marchés financiers agricoles doivent être mieux régulés. La supervision et la régulation peuvent passer par l'établissement de limites de positions.
QUATRIÈME
PARTIE :
QUEL INVESTISSEMENT ?
LE DÉFI ALIMENTAIRE : UN DÉFI DE L'INVESTISSEMENT
Il est tentant de promouvoir des politiques d'offre afin de réunir les conditions d'une augmentation de la production agricole dans la mesure où l'objectif d'un rapprochement du potentiel est considéré comme un instrument indispensable du développement agricole. Cependant, il ne faut pas négliger les enjeux d'une élévation de la demande solvable ce qui plaide pour un équilibre entre politiques d'offre et de demande d'autant que les premières peuvent passer par des voies susceptibles d'affecter négativement la demande.
En toute hypothèse, alors que l'agriculture est un secteur résiduel d'investissement dans les économies modernes, il faudra réaliser un effort d'investissement qui pourrait devoir être sensiblement plus élevé qu'on ne l'estime couramment.
L'estimation la plus répandue, celle de la FAO, situe à 83 milliards d'euros l'effort d'investissement à entreprendre chaque année. Ce chiffre est loin du compte aux yeux de votre rapporteur non seulement parce qu'il résulte d'un affichage qui ne doit pas tromper mais encore parce qu'il est associé à des hypothèses discutables qui minorent l'investissement à entreprendre et s'inscrit dans une stratégie de développement agricole aux ambitions sans doute trop limitées pour que le droit à l'alimentation soit mis en oeuvre.
I. COMBINER LES POLITIQUES D'OFFRE ET DE DEMANDE
On met généralement l'accent plutôt sur les « facteurs d'offre » que sur les « facteurs de demande ». Cette focalisation pour n'être pas arbitraire présente l'inconvénient de dissocier des variables qui interagissent entre elles.
Incontestablement, les facteurs d'offre comptent puisque les rendements sont corrélés de façon robuste aux facteurs de production mis en oeuvre, étant observé que les conditions naturelles (le capital « improduit ») jouent évidemment un rôle très important. De fait, la modélisation des rendements agricoles comporte schématiquement un terme d'investissement représentatif du capital technique mis en oeuvre et un terme de capital naturel dont il faut souligner la difficulté qu'il y a à le quantifier correctement (compte tenu de la grande diversité des éléments à considérer).
Quoiqu'il en soit tout objectif d'élévation des rendements oblige à évaluer, d'une part, la quantité de capital à mettre en oeuvre (qu'il s'agisse d'investissements stricto sensu ou de consommations intermédiaires) et, d'autre part, une contrainte naturelle particulièrement difficile à préciser.
Cette dernière caractéristique - l'incertitude sur les effets des conditions naturelles - constitue un défi aux enjeux élevés puisque tout le « capital produit » mis en oeuvre en dépend.
C'est pourquoi il importe, tout particulièrement dans un moment de l'histoire où l'intégrité du capital naturel est en cause, de réduire le plus possible cette incertitude. Cet impératif donne sa pleine justification à la préoccupation du développement durable au regard des incidences qu'il comporte, notamment pour le développement agricole. Toutefois, la complexité du développement durable doit être pleinement prise en compte pour concevoir les meilleures réponses possibles.
À cet égard, la « préférence pour la nature » mérite de déboucher sur des solutions non réductionnistes. En particulier, elle semble à votre rapporteur ne pas rimer avec un quelconque antihumanisme qui voit parfois dans l'humanité et la science des ennemis.
Autrement dit, sous réserve de ne pas céder à un scientisme toujours dangereux, ce qu'une application raisonnable du principe de précaution devrait permettre d'éviter, il est parfaitement légitime, et même hautement recommandable, de mobiliser les ressources de l'intelligence humaine pour contribuer à installer la trajectoire de production agricole dans les rails du nécessaire développement durable.
Mais, à côté des facteurs d'offre, les facteurs concernant la demande peuvent être considérés comme des déterminants des rendements agricoles.
Il existe au moins deux motifs pour ce préoccuper de la demande et de la considérer comme un volet à part entière des politiques de développement agricole : la demande est un déterminant de l'investissement agricole dont dépendent les gains de productivité et des rendements ; le cadre économique propice à ces gains de productivité peut altérer la demande adressée à l'agriculture ce qui rend nécessaires des actions correctrices.
Les progrès de la productivité sont tributaires des dynamiques des marchés de débouchés et il semble en aller ainsi pour l'agriculture.
Le différentiel des rendements observé dans le monde paraît offrir une illustration de cette dépendance.
Les zones abritant les grands émergents dans lesquels le rythme de la croissance économique et de la demande a été particulièrement élevé depuis les années 1990 sont aussi celles où la dynamique des rendements a été la plu forte.
À cet argument macroéconomique s'ajoutent des considérations micro-économiques. À cet égard, la forte demande de maïs ne serait pas un facteur mineur du développement relativement rapide de son rendement.
Au total, le lien entre les rendements agricoles et les dynamiques de la demande pour étroit qu'il soit, n'est pas univoque. Les rendements semblent également dépendre, dans des proportions sans doute variables, de la demande.
En conséquence, même si cela peut passer par des chemins différenciés, toute politique de développement agricole doit se préoccuper de stabiliser la demande et écarter l'illusion que les politiques d'offre peuvent suffire à elles seules à assurer le développement agricole.
Cette observation s'impose d'autant plus que le cadre macro-économique favorable à l'investissement peut comporter le risque d'altérer les conditions de la demande.
Un investissement élevé peut supposer une augmentation des prix susceptible d'exercer des effets défavorables sur le pouvoir d'achat ou bien d'engager des soutiens publics qu'il faut bien financer. Dans l'un et l'autre cas, l'attention doit être portée à la préservation de la demande ce qui suppose de formater le système de redistribution du revenu de sorte que les nécessaires incitations à l'investissement n'altèrent pas la demande, notamment des plus démunis.
II. L'INVESTISSEMENT : 83 MILLIARDS DE DOLLARS NE SUFFIRONT PAS
Les experts de la FAO ont réalisé une estimation des besoins d'investissement agricole sur longue période nécessaires pour remporter le défi alimentaire.
Telle est du moins la présentation qui est faite. Il faudrait être plus précis. L'exercice de la FAO consiste, en réalité, à évaluer les engagements financiers qui seraient nécessaires pour atteindre le niveau de production agricole que décrit la prospective de l'organisation, prospective qui n'est pas la seule possible.
L'estimation d'un besoin d'investissement annuel de 83 milliards de dollars a connu un retentissement certain et a été largement reprise par les médias et dans les débats d'experts pour résumer les exigences du défi alimentaire à l'horizon 2050.
Même s'il est souvent relativisé par la FAO, notamment au vu des investissements réalisés dans d'autres secteurs moins vitaux pour le développement humain (c'est le moins qu'on puisse dire quand il s'agit de l'armement), le chiffrage par la FAO des besoins d'investissement agricole peut apparaître formidable.
En gardant à l'esprit que les estimations sont imprécises (v. infra), il correspond à une nette augmentation de l'effort d'investissement, ce qui pose évidemment la question de savoir d'où pourrait venir une telle accélération de l'investissement.
Pour autant, aux yeux de votre rapporteur, cet effort supplémentaire doit plutôt être considéré comme insusceptible d'assurer la résolution de problème alimentaire, surtout si on l'envisage, comme dans le présent rapport, sous l'angle de la mise en oeuvre effective du droit à l'alimentation.
Pour atteindre cet objectif, il faudra investir sensiblement plus.
L'agriculture, considérée d'un point de mondial, est un secteur particulièrement paradoxal au regard de l'investissement agricole.
Certaines régions semblent être caractérisées par des surcapacités dont les excès de production récurrents ont témoigné éloquemment dans le passé. Désormais, les instruments des politiques agricoles ayant évolué, ce sont moins ces surproductions qui « signent » l'existence de ces surcapacités que les problèmes budgétaires ou ceux portant sur les revenus agricoles.
En revanche, de nombreuses régions relevant du monde en retard de développement souffrent d'une insuffisance d'investissement. Ces régions sont généralement des zones dépourvues des institutions nécessaires à l'investissement agricole.
Ces contrastes appellent l'attention sur l'importance des institutions comme variables déterminantes de l'investissement agricole mais aussi sur le défaut systématique d'attractivité du secteur agricole pour les capitaux. En bref, spontanément, l'agriculture n'est pas un secteur d'investissement. Cette situation paraît résulter d'au moins deux facteurs :
- le fonctionnement du marché des biens agricoles ne favorise pas une rentabilité économique du secteur attractive ;
- le fonctionnement des marchés de financement n'est pas spontanément adapté à l'investissement agricole.
D'autres variables comptent sans doute, dont, en particulier, les particularités du « capital humain » mobilisé par l'agriculture qui appelle une formation exigeante et nettement spécialisée.
Ces observations conduisent à analyser le développement agricole comme résultant pour une part importante d'un « héritage fatal », à savoir la nécessité historique de contribuer à sa propre alimentation pesant sur des hommes ancrés sur leurs terres.
Une grande partie de l'histoire agricole s'est inscrite comme un processus consistant à échapper à cette fatalité. Et l'un des problèmes a été de préserver les incitations à demeurer dans le secteur alors même que les autres secteurs permettaient des revenus supérieurs.
Que l'investissement agricole ait décru quand cette dernière préoccupation a décliné n'est donc pas une surprise.
Mais, on ne relèvera pas le défi alimentaire sans inverser ce processus.
A. UN RALENTISSEMENT DE L'INVESTISSEMENT AGRICOLE...
Au cours des années 1981 à 1996 l'investissement brut dans le secteur agricole primaire des pays en développement s'est élevé à 77 milliards de dollars (soit un investissement net de 26 milliards de dollars).
À ces investissements, il faut ajouter 34 milliards de dollars investis dans les activités post-récoltes et 29 milliards de dollars d'investissement public brut dans les infrastructures qui constituent le contexte de l'exploitation agricole.
La plupart de ces derniers investissements ont été effectués en Asie (60 %), l'Amérique latine concentrant 20 % du total. L'ANMO et l'Afrique subsaharienne n'ont bénéficié chacune que de 10 % desdits investissements.
En conséquence, le stock de capital agricole a évolué de façon très différenciée depuis 1975.
|
Des niveaux de l'investissement et du stock de capital agricole difficiles à évaluer L'identification du capital agricole et des investissements qui contribuent à sa constitution pose des problèmes de méthode et des problèmes pratiques. Pour ces derniers, hormis les informations de la base de données FAOSTAT, il n'existe pas de couverture géographique exhaustive. Les limites de cette base de données en réduisent toutefois la significativité puisqu'elle recense principalement des stocks physiques qui ne sont pas représentatifs de la totalité du capital engagé. Les autres données disponibles sont généralement issues des comptes nationaux. Elles sont plus complètes mais seuls quelques pays en disposent dans des conditions satisfaisantes. Sur le plan de la méthode, les problèmes auxquels on est confronté sont ceux de la définition du champ et de l'imputation à l'agriculture d'investissements qui peuvent avoir plusieurs usages (tel est le cas en particulier des infrastructures). Le champ du capital agricole dépasse de beaucoup l'investissement physique utilisé dans les exploitations. Les investissements dans le capital humain doivent être pris en compte de même que les investissements qui peuvent avoir un impact sur l'efficacité de l'exploitation tout en étant réalisés en dehors d'elle (infrastructures, industries d'amont, protection du capital naturel...). |
Taux de croissance annuel moyen de l'ACS1 avant et après 1990
1 Agricultural Capital Stock : Stock de capital dans l'agriculture Source : FAOSTAT
Après un rythme annuel d'investissement net de 1,11 % entre 1975 et 1990, on relève une nette décélération avec un progrès limité à 0,50 % entre 1991 et 2007.
Les pays développés ont été jusqu'à désinvestir de l'agriculture (- 0,34 % par an du capital agricole) à partir de 1991 mais le rythme d'essor du capital agricole dans les pays en développement a également ralenti. Il a été inférieur (+ 1,23 %) à partir de cette date à ce qu'il avait été entre 1975 et 1990 (+ 1,66 %).
Ces résultats peuvent être désagrégés par grande région.
Taux de croissance annuels moyens des ACS par région
Source : FAOSTAT
Pour les pays développés, on observe que la décrue du capital agricole devient significative en Europe plus tôt qu'en Amérique du Nord. La FAO tend à lier ce processus à l'adoption de la réforme de la PAC en 1992-1993 (réforme Mac Sharry).
Pour les pays en développement, le stock de capital a continûment progressé mais sur un rythme moins rapide au fil du temps, avec un freinage particulièrement marqué en Asie du Sud depuis la seconde moitié des années 90 et en Afrique subsaharienne à la fin des années 2000.
Ces évolutions combinées avec celles qui ont touché la population active agricole se sont soldées par des variations très disparates du stock de capital par tête dans les pays en développement.
Taux de croissance annuel moyen de l'ACS par
travailleur
dans l'agriculture, dans les pays en
développement
Source : FAOSTAT
La population active agricole n'a diminué qu'en Amérique latine mais sa progression a été très variable dans les autres régions avec une augmentation particulièrement marquée en Afrique subsaharienne.
En conséquence, le stock de capital par actif agricole a diminué dans deux régions : l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud mais il a augmenté de façon soutenue en Amérique latine.
Il est intéressant de décomposer le stock de capital agricole en ses différentes parties telles qu'inventoriées par la FAO. Celle-ci estime que les terres en représentent entre 52 et 55 %64(*), le bétail de 24 à 26 %, les machines de 16 à 17 % et les structures de l'exploitation autour de 5 %.
Entre 1975 et 2007, la progression la plus consistante a été celle des terres (+ 0,93 % par an) suivi des machines (+ 0,75 %), des structures (+ 0,66 %) et du bétail (+ 0,50 %).
Mais, en fin de période, l'investissement dans les terres ralentit.
Parmi les causes du ralentissement, il faut tout particulièrement évoquer la réduction des interventions publiques, internes ou internationales, dans l'agriculture.
C'est un constat partagé que les dépenses publiques et l'aide publique à l'agriculture ont baissé dans les années 90.
Il existe une corrélation positive entre les dépenses publiques consacrées à l'agriculture et la variation du capital/tête dans le secteur agricole.
Dépenses publiques pour l'agriculture par
travailleur et ACS
dans 44 pays en développement de 1980 à
2005
Source : FAOSTAT
De même, bien que la corrélation soit perturbée par des car particuliers (le Brésil d'un côté, le Soudan de l'autre) l'aide publique au développement agricole, qui peut favoriser un niveau élevé de dépenses publiques agricoles, exerce globalement des effets favorables sur le capital/tête dans le secteur agricole.
Aide publique au développement agricole de
1980 à 2005
et croissance de l'ACS dans 118 pays,
1995-2005
Source : FAOSTAT
B. DES BESOINS D'INVESTISSEMENT À RÉESTIMER
Si l'estimation par la FAO d'un besoin d'investissement s'élevant à 83 milliards de dollars par an pour remporter le défi alimentaire a été largement relayée, en réalité, ce chiffre peut être trompeur.
En effet, il correspond à un investissement net alors que les besoins d'investissement brut sont supérieurs à 200 milliards, ce qui est déjà sensiblement plus exigeant.
Mais là ne s'arrête pas la nécessaire correction des besoins d'investissement prévisibles.
Aux yeux de votre rapporteur les besoins d'investissement nécessaires à une mise en oeuvre effective du droit à l'alimentation seront probablement bien supérieurs.
1. L'estimation de la FAO
Les besoins en investissements agricoles dans les pays en développement ont été estimés par la FAO à 9 200 milliards de dollars pour la période 2005-2050.
Ce besoin d'investissement serait réparti entre des investissements agricoles « stricto sensu » (5 200 milliards de dollars et 56 % du total) et des investissements dans les infrastructures d'amont et d'aval (4 000 milliards et 44 % du total), dans le stockage ou pour les transports par exemple.
Les besoins d'investissement dans l'agriculture
des pays en développement
à l'horizon 2050 selon la
FAO
(93 pays, en milliards de dollars)
|
Investissements nets |
Amortissements |
Investissements bruts |
|
|
Investissements agricoles stricto sensu dont : |
2 378 |
2 809 |
5 187 |
|
Cultures |
864 |
2 641 |
3 505 |
|
Extension des terres, conservation des sols et aménagement des eaux |
139 |
22 |
161 |
|
Irrigation |
158 |
803 |
960 |
|
Mises en culture |
84 |
411 |
495 |
|
Mécanisation |
356 |
956 |
1 312 |
|
Énergie |
33 |
449 |
482 |
|
Formation |
94 |
0 |
94 |
|
Élevage dont : |
1 514 |
168 |
1 683 |
|
Extension des troupeaux |
413 |
0 |
413 |
|
Production de viande et lait |
1 101 |
168 |
1 269 |
|
Investissements dans les infrastructures |
1 257 |
2 729 |
3 986 |
|
Stockage |
277 |
520 |
797 |
|
Organisation des marchés |
410 |
548 |
959 |
|
Première transformation |
570 |
1 661 |
2 231 |
|
Total |
3 636 |
5 538 |
9 178 |
Source : FAO - Josef Schmidhuber, Jelle Bruinsma
and Gerold Boedeker
« Capital requirements for agriculture
in developing countries to 2050 »
La décomposition par région des évaluations de la FAO fait ressortir des besoins d'investissements qui seraient disparates.
Estimation régionale des besoins
d'investissement entre 2005 et 2050
(en milliards de dollars)
Source : FAO
La Chine et l'Inde exceptées, qui totalisent à elles seules 39 % des besoins d'investissement, c'est en Asie que ces besoins se concentreraient avec 57 % de l'ensemble.
Par contraste, les besoins d'investissement en Afrique subsaharienne ou en AN-MO seraient de l'ordre de 10 % du total mondial pour chacune de ces régions.
L'évaluation des besoins d'investissements proposée par la FAO peut sembler formidable mais cette impression doit être corrigée par la considération de quelques éléments qui viennent la relativiser.
Plusieurs considérations interviennent pour relativiser l'impression première d'un effort d'investissement gigantesque à réaliser pour développer l'agriculture dans les pays en développement.
Quelques ordres de grandeur doivent être rappelés.
L'investissement dont il s'agit doit être ramené à une estimation annuelle, soit une moyenne de 208 milliards de dollars par an65(*). Par ailleurs, il faut considérer que cette estimation concerne 93 pays en développement. Ainsi, même si cette moyenne n'a qu'une portée illustrative, par pays et par an, l'évaluation des besoins d'investissement agricole de la FAO peut être ramenée à 2,2 milliards de dollars. Cette somme représente à peine 0,50 dollars par habitant des zones rurales des pays en développement, soit à peu près la moitié d'une baguette de pain.
La FAO indique que les estimations des besoins d'investissement, en dépit de leur ampleur, traduisent une inflexion de leur rythme de croissance.
Par rapport à la croissance de la production agricole observée dans le passé, 3,5 % par an lors des 46 dernières années, les années à venir verraient s'infléchir le rythme de progression de la production qui n'excéderait pas 1,5 % par an.
Enfin, il faut souligner que l'estimation globale de la FAO porte sur des investissements bruts : 60 % de ces investissements seraient en réalité consacrés à amortir le capital, si bien que 40 % d'entre eux seulement serviraient à augmenter les capacités de production (5 500 milliards de dollars d'un côté, 3 600 milliards de l'autre).
Au total, les besoins d'investissements de capacité sont limités à 83 milliards de dollars par an.
Une partie significative des besoins d'investissement estimés par la FAO concerne la mécanisation (1 312 milliards de dollars dont 956 pour le remplacement des équipements et 356 pour l'augmentation des capacités) et l'irrigation (18,5 % des besoins d'investissement dans le secteur agricole proprement dit (à l'exclusion des infrastructures d'accompagnement).
Source : Josef Schmidhuber FAO 2009
Compte tenu du fait qu'au cours de la période sous revue la totalité du stock de capital aujourd'hui installée devra être amortie au moins une fois, les investissements nets, de capacité, reviennent à peu près à doubler le stock de capital par rapport à la situation existante.
Cette estimation est cohérente avec le scénario alimentaire de la FAO qui table sur une contrainte d'augmentation de la production comprise entre 70 et 100 % à l'horizon 2050. Elle ne représente pas une perspective héroïque en soi mais votre rapporteur veut souligner les incertitudes qui entourent cette évaluation.
2. Une estimation qui, au total, minore sans doute l'effort à entreprendre
Même si des facteurs pourraient alléger l'effort à entreprendre, il est plus probable que celui-ci devra être plus important.
Si l'estimation des besoins d'investissement agricole par la FAO est cohérente avec la contrainte de production, calculée par l'organisation, c'est plus globalement que cette estimation est assise sur le scénario agricole de l'organisation ce qui oblige à la considérer comme étroitement tributaire d'une forme particulière de développement agricole.
Quelques rappels s'imposent à ce sujet.
En premier lieu, le scénario agricole de FAO est fondé sur des objectifs de croissance de la production agricole très contrastés par région.
Projections de production agricole par
région
en pourcentage de croissance annuelle
|
2009 |
2030 |
2050 |
2050/2005 |
|
|
Pays en développement |
1 172 |
1 784 |
2 207 |
1,88 |
|
Afrique sub-saharienne |
98 |
182 |
263 |
2,69 |
|
Amérique latine-Caraïbes |
210 |
343 |
436 |
2,08 |
|
AN-MO |
95 |
155 |
200 |
2,11 |
|
Asie du Sud |
216 |
356 |
459 |
2,12 |
|
Asie de l'Est |
554 |
748 |
848 |
1,53 |
Source : FAO - Josef Schmidhuber, Jelle Bruinsma et Gerold Boedeker
La production agricole devrait s'accroître globalement de 88 % dans les pays en développement. C'est en Afrique sub-saharienne que la contrainte de l'élévation de la production serait la plus forte avec une tendance vers le triplement quand, en Asie de l'Est, elle n'augmenterait que de 50 %.
Ces résultats sont, en partie, « normés ». Notamment ils sont dépendants des perspectives régionales de la demande et, de ce fait, tributaires d'un objectif, nuancé, d'autosuffisance alimentaire.
Perspective des taux d'autosuffisance alimentaire
par région
|
2005 |
2050 |
|
|
Pays en développement (moyenne) |
99 |
99 |
|
Afrique sub-saharienne |
97 |
95 |
|
Amérique latine-Caraïbes |
118 |
130 |
|
AN-MO |
79 |
78 |
|
Asie du Sud |
99 |
98 |
|
Asie de l'Est |
91 |
91 |
Source : FAO - Josef Schmidhuber, Jelle Bruinsma et Gerold Boedeker
Cette particularité de l'estimation pourrait être considérée comme conduisant à exagérer les besoins d'investissement. Pour ceux qui estiment que le développement des échanges internationaux, comme clef de voûte de l'équilibre alimentaire du futur, permettra d'optimiser la production, la contrainte de raisonner en fonction d'une norme d'autosuffisance alimentaire régionale peut être considérée comme aboutissant à des situations sous-optimales. Dans un tel contexte, le capital requis pourrait être supérieur à celui que nécessiterait un système alimentaire reposant plus pleinement sur les avantages comparatifs et les échanges internationaux. Cette vision est cependant contestable comme on l'indique dans le présent rapport.
Par ailleurs, plus ponctuellement, les résultats du scénario peuvent poser des problèmes de cohérence.
On peut s'interroger sur le point de savoir pourquoi, dans un tel contexte, l'Amérique du Sud et d'autres régions (la Russie ou l'Ukraine) seraient en position d'exportateurs nets. Cette dernière interrogation conduit à se demander si les besoins d'investissement estimés pour cette dernière zone n'excèdent pas ce qu'il serait économiquement cohérent de prévoir.
Mais d'autres considérations conduisent à se demander si les besoins d'investissement estimés par la FAO ne sont pas, plus ou moins largement, minorés.
Pour votre rapporteur, c'est plutôt cette interrogation qu'il faut considérer.
En premier lieu, les taux d'autosuffisance alimentaire qui fondent l'analyse des besoins d'investissement agricole de l'étude peuvent apparaître contestables tant au regard de leurs valeurs de départ (indiquées dans le tableau ci-dessus) que, surtout, sous l'angle de leur signification. Particulièrement du fait des hypothèses de progression des rations alimentaires individuelles, on peut juger que les évaluations de la FAO minorent les besoins de production et, par conséquent, d'investissement. Des plafonds plus élevés obligeraient à des projets plus ambitieux.
Par ailleurs, seule l'Amérique du Sud se voit reconnaître, dans le scénario de la FAO, une vocation à exporter sa production agricole. Or, il ne serait pas inutile de se situer dans un contexte plus global de développement des pays en retard où celui-ci passerait par une affirmation de leur vocation agricole.
En pareille hypothèse, les besoins d'investissement seraient sensiblement plus élevés.
Mais il existe un autre motif important de s'interroger sur le niveau de l'estimation de la FAO.
À ce propos, on doit procéder à un rappel : le scénario agricole de la FAO aboutit à des niveaux de production par agriculteur très différenciés selon la région considérée avec un creusement des écarts de production par tête.
Projections de production par
agriculteur
en dollars
|
2005 |
2030 |
2050 |
2050/2005 |
|
|
Pays en développement (moyenne) |
882 |
1 319 |
1 844 |
2,09 |
|
Afrique sub-saharienne |
475 |
587 |
700 |
1,47 |
|
Amérique latine-Caraïbes |
4 993 |
10 405 |
18 173 |
3,64 |
|
AN-MO |
1 827 |
3 157 |
4 888 |
2,68 |
|
Asie du Sud |
575 |
836 |
1 230 |
2,14 |
|
Asie de l'Est |
845 |
1 398 |
2 221 |
2,63 |
Source : FAO - Josef Schmidhuber, Jelle Bruinsma et Gerold Boedeker
En 2005, la production par agriculteur s'élève aux deux extrémités de la hiérarchie, à 475 dollars en Afrique sub-saharienne et à 4 993 dollars en Amérique du Sud (soit un rapport de 1 à plus de 10) pour une moyenne de 882 dollars pour les agriculteurs des pays en développement (2,4 dollars par jour).
Le scénario de la FAO à 2050 table sur un doublement réel de la valeur de la production par tête.
Mais, cette projection verrait s'amplifier les écarts de production par tête, le rapport entre l'Amérique du Sud et l'Afrique sub-saharienne passant de 10 à plus de 25.
De fait, la production par agriculteur n'augmenterait que de 47 % dans cette dernière région contre, en moyenne, un doublement et un accroissement tangentant le quadruplement en Amérique du Sud.
Autrement dit, il n'y a pas d'homothétie entre les perspectives régionales d'évolution de la production agricole et les perspectives de production par tête par région66(*).
La question de la cohérence de ce résultat peut être posée. Les écarts de productivité pourraient entraîner des bouleversements des systèmes de production agricole dans un contexte où les concurrences internationales se renforceraient.
Dans un tel « monde agricole » un maintien des agriculteurs les moins efficaces est hasardeux et leur prospérité plus encore. Or, si l'on se fixe un objectif d'autosuffisance alimentaire, il faut se donner les moyens de ce maintien, ce qui suppose des investissements plus massifs, dès lors que ceux-ci sont une condition pour que les agriculteurs puissent vivre de leur activité.
Cette contrainte micro-économique peut être illustrée par des données plus macro-économiques.
On peut approcher, avec une grande imprécision toutefois, les flux de revenus annuels qui seraient nécessaires pour « sortir » les pauvres de leur situation. Pour les seuls ruraux, ils s'élèvent à environ 1 000 milliards de dollars.
|
Une évaluation grossière des revenus nécessaires pour sortir les pauvres de la pauvreté absolue Une évaluation grossière du supplément de revenu nécessaire pour que les ruraux sortent de la pauvreté peut être proposée. Précisions sur la méthode d'estimation suivie L'objectif est que chaque rural atteigne le seuil de revenu de 2,15 dollars par jour. On suppose que tous les ruraux dont le revenu est inférieur à 1,08 dollar n'ont pas de revenu, ce qui exagère la situation, et que ceux qui ont un revenu égal ou supérieur à 1,08 dollar mais inférieur à 2,15 dollars touchent 1,08 dollar. On multiplie le revenu annuel nécessaire pour atteindre le seuil de 2,15 dollars pour le nombre des ruraux appartenant à chacune des deux catégories identifiées. La méthode est évidemment grossière mais faute de connaître la distribution effective du revenu elle permet de chiffrer le surcroît de revenu qu'il faudrait pour que les ruraux des pays en développement sortent de la pauvreté. Quel supplément de revenu faudrait-il pour que les ruraux sortent de la pauvreté ? (estimée à 2,15 dollars par jour) (en milliards de dollars)
Au total, il faudrait accroître le revenu rural des pays considérés de 1 034,1 milliards de dollars pour disposer des moyens de surmonter la pauvreté rurale. L'effort le plus important (80 % du total) est requis pour les pays en mutation du fait du nombre de personnes concernées. C'est l'extrême pauvreté (quand les personnes touchent moins de 1,08 dollar par jour) qui absorbe l'effet théorique le plus élevé (près de 60 % du total dont plus des trois quarts dans les pays en mutation). Cette estimation peut être rapprochée de plusieurs grandeurs qui permettent d'approcher l'ampleur de l'effort nécessaire. Avec un taux de change de 1,3 dollar pour 1 euro, l'estimation revient à 795 milliards d'euros, soit un peu plus de 40 % du PIB de la France et 5,7 % du PIB européen. |
Il est douteux qu'un investissement net limité à 3 636 milliards de dollars engendre de tels revenus. Il faudrait que lui soit associé un rendement annuel exceptionnel.
Enfin, les estimations de la FAO, sont étroitement liées aux caractéristiques, très contrastées selon les régions, du développement agricole imaginé par elle.
L'évaluation des besoins d'investissement proposée par la FAO dessine des développements agricoles très différenciés avec, d'un côté, des pays à « agriculture productiviste » et, de l'autre, des régions où la production agricole reposerait principalement sur la main d'oeuvre. Cette vision n'est pas sans parenté avec celle développée par la Banque mondiale sur les conditions du développement agricole dans les pays en développement67(*)
Dans la situation d'aujourd'hui, le stock de capital par personne employée dans le secteur agricole varie nettement d'une région à l'autre.
Stock de capital par personne employé dans
le secteur agricole en 2009
(en millions de dollars)
|
Pays en développement (moyenne) |
4,28 |
|
Afrique sub-saharienne |
2,78 |
|
Amérique latine-Caraïbes |
25,24 |
|
AN-MO |
11,61 |
|
Asie du Sud |
3,88 |
|
Asie de l'Est |
3,06 |
Source : FAO
Le capital par tête varie de 1 à 9 entre l'Afrique sub-saharienne et l'Amérique du Sud. En dehors celle-ci, et de la zone Afrique du Nord-Moyen Orient, le paysan moyen dispose d'un capital estimé autour de 3 000 dollars.
Le scénario de la FAO implique qu'à l'horizon 2050 le capital par tête augmente à l'échelon des pays en développement de l'ordre de 80 %. Mais ce résultat moyen serait le produit d'évolutions très disparates.
Projection régionale de capital par
tête 2005-2050
(en millions de dollars)
|
2005 |
2030 |
2050 |
2050/2005 |
|
|
Pays en développement (moyenne) |
4,28 |
5,72 |
7,68 |
1,79 |
|
Afrique sub-saharienne |
2,78 |
2,62 |
2,77 |
1 |
|
Amérique latine-Caraïbes |
25,24 |
45,7 |
77,77 |
3,08 |
|
AN-MO |
11,61 |
17,33 |
25,41 |
2,19 |
|
Asie du Sud |
3,88 |
4,59 |
6,1 |
1,57 |
|
Asie de l'Est |
3,06 |
4,87 |
7,67 |
2,51 |
Source : FAO - Josef Schmidhuber, Jelle Bruinsma et Gerold Boedeker
Les projections de la FAO retiennent des augmentations du capital par tête par région qui amplifient les écarts initiaux.
La situation de l'Afrique sub-saharienne doit être relevée puisque l'équipement agricole par individu n'y ferait aucun progrès. En revanche, la région où il est déjà le plus développé - l'Amérique du Sud - connaîtrait aussi la plus forte progression avec un triplement de la valeur du capital par tête.
La fragilité d'un tel scénario doit être soulignée d'autant que des éléments pouvant être importants sont apparemment négligés.
La question essentielle est celle du savoir si sans une augmentation du capital par tête, le niveau du revenu par tête peut augmenter. Votre rapporteur en doute même en considérant les progrès de productivité non liés à l'investissement. Dans ces conditions, le maintien des agriculteurs qui n'auraient pas davantage de capital à leur disposition n'est pas acquis non plus que leur accès à un niveau de revenu compatible avec leur accès à la nourriture.
Par ailleurs, il faut prendre en compte des facteurs d'élévation du coût de l'investissement.
Les effets-prix pourraient être de plus de poids que dans le passé dans l'hypothèse d'une hausse des coûts de production des investissements d'autant plus envisageable que les fournisseurs seraient de plus en plus concentrés et exposés à l'augmentation du prix de l'énergie, dans un contexte où, par ailleurs, la flexion des prix due à la récente vague de mondialisation s'inverserait ;
Les effets des coûts d'amortissement des dommages environnementaux qui pourraient contraindre à des investissements supplémentaires, préventifs ou de réparation...
Dans ce contexte, il se pourrait que les besoins d'investissement pour relever le défi alimentaire, tout particulièrement s'il s'agit d'assurer le respect du droit individuel à l'alimentation, soient nettement plus élevés.
* *
*
Le cadrage général du développement agricole privilégié par la FAO et ses effets sur l'évaluation des besoins d'investissement sont ainsi discutables. Ils sont par ailleurs tributaires de la prospective globale des équilibres de l'alimentation de la FAO qui repose sur des hypothèses techniques qu'il faut détailler :
une faible substitution du capital au travail dans la mesure où nombre de pays suivraient un modèle d'agriculture intensif en travail (conformément à leurs avantages comparatifs supposés) ;
une augmentation de la productivité totale des facteurs qui permet d'économiser des facteurs de production, parmi lesquels le capital.
Globalement, la fonction de production du secteur agricole se modifierait avec un accroissement du capital de 71 %, une diminution du travail de 16 % et une extension des terres cultivées de 25 %.
La substitution du capital au travail ainsi décrite est présentée comme modérée par les experts de la FAO68(*).
C'est exact, mais ce n'en est pas moins problématique. En Afrique subsaharienne, le capital et le travail agricole évolueraient parallèlement (+ 48 % et + 59 %) avec une mobilisation supplémentaire des terres de seulement 28 %.
Les « hypothèses » sur la productivité totale des facteurs découlent de ces perspectives. Pour une croissance moyenne de 20 %, elle s'élèverait à 62 % en Amérique du Sud mais serait négative en Afrique subsaharienne (- 35 %).
Prises ensemble, ces variables posent un problème de cohérence.
La production agricole des pays en retard de développement peut-elle être développée dans un contexte où les incitations économiques ne s'amélioreraient pas significativement et où les concurrences s'accentueraient ?
Peut-on réellement envisager un supplément d'investissement, même modéré, dans des pays où les moyens de cet investissement devraient être trouvés à l'extérieur du secteur agricole lui-même ?
La production agricole mondiale peut-elle se passer d'un accroissement beaucoup plus conséquent de la production des pays les plus en retard ?
La mise en oeuvre effective du droit à l'alimentation ne nécessite-t-elle pas une élévation plus importante du niveau de revenus des agriculteurs les plus pauvres, qui implique un plus fort recours au capital ?
Telles sont autant de questions qui conduisent à estimer que les besoins d'investissement agricole pourraient être nettement plus élevés qu'envisagés.
Si l'effort d'investissement à entreprendre dans les pays en développement pourrait devoir être plus élevé que dans l'évaluation de la FAO, la question des moyens de cet investissement se poserait avec encore plus d'acuité.
D'ores et déjà celle-ci appelle la mise en oeuvre des moyens financiers gérés par des institutions adaptées au défi à relever tout en n'oubliant pas la mise en oeuvre d'un contexte facilitant69(*).
CINQUIÈME
PARTIE :
DEMAIN, QUELLE GEO-ALIMENTATION ?
On a naturellement tendance à considérer que la sécurité alimentaire passe par l'autosuffisance de chaque pays. Ce réflexe est du reste largement répandu puisqu'aussi bien l'autonomie alimentaire est perçue comme un devoir primordial des États un peu partout dans le monde même si peu d'entre eux ont mis en place des politiques agricoles comme la politique agricole commune (PAC) chargées d'atteindre cet objectif.
Pourtant, dans les débats des spécialistes, autosuffisance et sécurité alimentaire sont soigneusement différenciées. Le premier terme appartient plutôt à ceux qui prônent des politiques de développement agricole local, le second aux partisans d'un équilibre alimentaire mondial reposant sur le libre jeu des marchés et notamment sur les échanges commerciaux entre pays.
Il existe donc une opposition entre les deux termes, plutôt qu'une équivalence.
Cette opposition est largement (pas seulement) doctrinale et porte sur les mérites respectifs des marchés et des interventions publiques qu'illustre tout particulièrement le débat sur la libéralisation des échanges internationaux.
Mais, avant d'examiner cette discussion, il est justifié de mesurer si, concrètement, il existe un choix entre les interdépendances et le développement d'une production locale capable de nourrir, ici et maintenant, chaque personne où qu'elle réside.
I. AUTOSUFFISANCE OU SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ?
La nécessité de s'en rapporter aux échanges internationaux pour équilibrer l'offre et la demande alimentaire est un résultat plutôt consensuel des prospectives disponibles.
La combinaison de limites physiques locales au développement agricole et de dynamiques de population très différenciées rejaillissant sur la croissance des besoins alimentaires paraît impliquer de recourir de plus en plus à l'échange international pour équilibrer les besoins alimentaires de nombreux pays.
Dans un tel contexte, le système alimentaire mondial verrait se renforcer les interdépendances et la souveraineté alimentaire serait pour un vaste ensemble de pays un objectif inatteignable, du moins si on l'assimile à l'autosuffisance alimentaire.
Il n'en existe pas moins des marges de manoeuvre très larges pour développer davantage cette dernière et les estimations du poids des échanges internationaux dans le futur dépendent de leur mobilisation.
Autrement dit, s'il ne faut pas nécessairement confondre sécurité alimentaire et autosuffisance, le degré de dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur peut varier selon les actions entreprises pour « « tangenter » l'autosuffisance alimentaire.
Si l'ampleur des interdépendances dans le système alimentaire mondial peut varier, la question de leur nature est également essentielle.
Elle se décline en plusieurs interrogations :
- quels pays seront les pourvoyeurs du monde et seront des pays importateurs nets ?
- selon quels mécanismes le commerce international se déploiera-t-il ?
A. QUELLES TENDANCES POUR LA DIVISION AGRONOMIQUE DE LA PRODUCTION ?
Les échanges agricoles internationaux sont déjà une condition de l'équilibre du système alimentaire mondial. Au vrai, compte tenu du déséquilibre agricole du monde, ils devraient jouer un rôle beaucoup plus important si l'on voulait vaincre la faim.
Mais, cette remarque n'est qu'incidente puisqu'elle est tributaire d'un état de sous-développement agricole de nombreux pays qu'il faut surmonter.
À supposer que cet objectif soit atteint, il serait, malgré tout, nécessaire de recourir demain davantage qu'aujourd'hui aux échanges internationaux pour équilibrer le système alimentaire. Cependant, le niveau des interdépendances agricoles dépendra des progrès réalisés pour mettre à niveau les agricultures du Sud.
Même si ces perspectives sont tributaires du rattrapage des pays en retard de développement agricole, à cadre international des échanges inchangés (c'est-à-dire sans modification substantielle des conditions du commerce international), se dessine une nouvelle géo-alimentation mondiale..
1. Un scénario de renforcement modéré des interdépendances
a) L'existant : des interdépendances dont témoignent les bilans ressources-emplois
D'ores et déjà le monde est marqué par des déséquilibres régionaux entre les emplois et les ressources agricoles dont la mesure par l'INRA et le CIRAD (pour 2003) est résumée dans le tableau ci-dessous.
Synthèse du bilan ressources - emplois en 2003
Source : Agrimonde
Trois régions sont déficitaires (l'Afrique du Nord-Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne et l'Asie), l'Amérique latine et les pays de l'OCDE cumulant la quasi-totalité des excédents régionaux. Pour les animaux, seule la zone OCDE est excédentaire.
Les taux de couverture intra-régionaux (ratio de la production locale sur les emplois locaux) ressortent comme très disparates.
Pour les végétaux l'Afrique du Nord-Moyen-Orient ne couvre que 63,7 % de ses besoins, ce taux atteignant 88,4 % pour l'Afrique subsaharienne et 98,6 % pour l'Asie.
Mais ces déficits n'ont pas la même signification. En particulier, le taux de couverture de l'Afrique subsaharienne ne ressort comme particulièrement élevé que parce que la ration alimentaire individuelle y est singulièrement faible.
b) Le futur : vers un accroissement des déséquilibres régionaux et des échanges internationaux
Les prospectives agricoles convergent, pour la plupart, vers la prévision d'un renforcement des interdépendances internationales avec une montée en charge des échanges agricoles internationaux, même dans l'hypothèse où les pays en retard de développement agricole comblerait celui-ci.
À titre d'illustration, on peut présenter les travaux de M. Michel Griffon, dans la mesure où ils se situent dans une perspective de priorité donnée à une certaine forme de souveraineté alimentaire. Ils dessinent par ailleurs ce que pourrait être demain la géo-alimentation mondiale.
A l'avenir, l'Amérique du Sud serait la principale exportatrice (Brésil et Argentine surtout) et les capacités agricoles de ces pays suffiraient à satisfaire la plupart des besoins mondiaux. La contribution des grandes plaines de Russie, d'Ukraine et du Kazakhstan qui présentent quant à elles une nouvelle offre potentielle serait toutefois nécessaire à cet ajustement alors que les rendements y sont aujourd'hui très faibles et aléatoires et l'agriculture globalement encore mal organisée.
Pour les autres régions du monde, les perspectives à long terme sont plus incertaines.
Les États-Unis chercheraient à rester exportateurs mais devraient éprouver des difficultés compte tenu de la saturation des espaces agricoles et des contraintes exercées par les agro-carburants sur le potentiel agricole.
Les pays à grande agriculture extensive (Australie, Canada) seraient les premiers candidats sur les marchés d'Asie. Ils seraient les premiers gagnants de la libéralisation du commerce mondial en raison de leur compétitivité. Toutefois les capacités disponibles sont inégales et l'exposition aux sécheresses est parfois élevée (Australie) ce qui pose problème au regard du critère de résilience du système alimentaire.
L'Union européenne dispose d'une agriculture intensive et exportatrice de céréales notamment grâce à des politiques actives. L'Union européenne pourrait gagner en compétitivité du fait de l'agrandissement des exploitations. Mais, au total, il y a peu de perspectives de voir l'Europe en capacité de couvrir les besoins supplémentaires. Ce constat est clairement celui de la Commission européenne dont les projections agricoles à dix ans sont présentées en annexe.
Le tableau ci-dessous résume les conditions des équilibres des échanges mondiaux interrégionaux fondés sur ces perspectives.
Il ne s'agit pas d'une prévision mais d'une illustration d'un avenir possible de l'agriculture mondiale. On remarque qu'il se caractérise par un rattrapage assez net des retards de développement agricole des zones qu'ils handicapent aujourd'hui malgré l'esprit général du scénario qui repose sur un modèle alternatif à celui de la Révolution verte70(*).
L'AMÉRIQUE LATINE : PRINCIPAL COMPENSATEUR DES DÉFICITS RÉGIONAUX
|
Asie |
Amérique latine |
ANMO (*) |
Afrique subsaharienne |
Russie Ukraine Kazakhstan |
Pays industriels |
|
|
Surfaces supplémentaires en agriculture pluviale (109 ha) |
0 |
391 |
0 |
517 |
100 |
Dégel de terres UE USA et extension Europe centrale |
|
Rendement en pluvial |
+ 50 % |
+ 50 % (de 1,35 à 2 t/ha) |
Inchangé |
+ 50 % |
+ 15 % (de 2 à 2,3 t/ha) |
+ 10 à 20 % |
|
Production suppl. par extension des surfaces en pluvial (109 t) |
0 |
+ 782 |
0 |
+ 840 |
+ 230 |
+ 10 |
|
Production supplémentaire en pluvial obtenue par les rendements |
+ 850 |
+ 132 |
0 |
+ 130 |
+ 30 |
+ 34 |
|
Surface supplémentaire en irrigué |
+ 47 |
+ 8 |
+ 8 |
0 |
0 |
|
|
Rendement en irrigué |
8 t/ha soit + 33 % |
8 t/ha |
8 t/ha |
7 t/ha |
/ |
/ |
|
Production supplémentaire |
+ 698 |
+ 64 |
+ 114 |
+ 60 |
0 |
0 |
|
Production supplémentaire totale |
+ 1 548 |
+ 978 |
+ 114 |
+ 1080 |
+ 250 |
+ 44 |
|
Production totale |
3 248 |
1250 |
268 |
1 340 |
516 |
/ |
|
Excédent ou déficit |
- 892 |
+ 880 |
- 282 |
0 |
+ 250 |
+ 44 |
|
Surfaces restantes |
0 |
209 |
5 |
86 |
500 ? |
/ |
|
(*) Afrique du Nord, Moyen-Orient. |
||||||
Source : Nourrir la planète, Michel Griffon
Dans le scénario exposé par M. Michel Griffon, les besoins de l'Asie et de la zone Afrique du Nord - Moyen Orient sont couverts par l'Amérique du Sud et par la zone de l'ex-Union soviétique, les pays industriels et l'Afrique sub-saharienne couvrant leurs besoins.
Au total, les échanges internationaux permettraient de satisfaire les besoins alimentaires, du moins en théorie.
Ces perspectives conduisent aussi, on l'a indiqué, à anticiper une modification substantielle de la répartition géographique des échanges internationaux par rapport à la situation existante (voir les annexes relatives à la production et au commerce international agricole aujourd'hui et aux perspectives des marchés européens et des États-Unis à dix ans).
Les prospectives ne conduisent généralement pas à attribuer à l'Europe un rôle d'équilibrage de la demande mondiale, équilibrage auquel contribueraient de leur côté les États-Unis mais moyennant une contribution plus faible. À cet égard, la responsabilité principale est attribuable au développement des agro-carburants. Les projections du département agricole des États-Unis, et plus encore, celle de la Commission européenne expliquent l'atonie des exportations par l'absence de disponibilités (spécialement en Europe) à proposer sur le marché mondial.
Mais, si, globalement, les exportations européennes ne pourraient pas satisfaire une demande extérieure en expansion, du moins la production européenne permettrait de servir, à peu près, les besoins régionaux.
En outre, même si ce pourrait être de façon marginale, la production agricole réalisée en Europe pourrait excéder, plus ou moins sporadiquement, la consommation régionale et, ainsi, laisser quelques marges pour les exportations.
Ces constats ne conduisent pas à réserver à la promotion d'un objectif de production agricole élevée en Europe un rôle effacé.
Au contraire, le maintien d'une Europe agricole forte se recommande dans le contexte du défi alimentaire de sa vocation à contribuer à l'offre globale et à y contribuer dans des conditions de stabilité relative, enjeu particulièrement important alors que la volatilité de l'équilibre entre l'offre et la demande alimentaire pourraient devenir plus prégnante à l'avenir.
Sans doute est-il vrai qu'alors que les États-Unis et l'Europe dominent aujourd'hui la scène internationale, le commerce agricole décrit par les prospectives devrait faire beaucoup plus de place aux pays d'Amérique latine et de l'ex-URSS. Ces évolutions seront à peu près parallèles à celles prévisibles pour le commerce mondial pris globalement.
Cette perspective où, en particulier, le rôle de l'Europe deviendrait beaucoup plus marginal, est toutefois dépendante de variables qui ne peuvent être considérées comme intangibles.
Ainsi qu'on l'expose ci-après le contexte institutionnel du commerce international pourrait jouer un rôle accélérateur des nouvelles tendances de la division agricole du monde mais comptent aussi, les progrès techniques ou les effets des conditions naturelles (en particulier les changements climatiques) ainsi que les politiques environnementales.
Une annexe au présent rapport décrit l'état général de l'agriculture européenne et évoque, en les illustrant par quelques exemples empruntés aux problèmes rencontrés par les agriculteurs français, certaines des difficultés auxquelles cette agriculture est confrontée.
L'agriculture européenne est en cours d'homogénéisation mais sur un tempo inégal selon les régions. L'Europe abrite quelques uns des pauvres ruraux qui forment le gros du bataillon des personnes souffrant de la faim.
Par ailleurs, l'agriculture connaît en Europe comme ailleurs un phénomène de forte segmentation avec, à la clef, pour nombre d'entre eux, la disparition de petits exploitants.
Alors même qu'il existe un cadre de soutien aux agriculteurs, la « rationalisation » du secteur agricole se poursuit. Une crainte chronique existe en Europe : celle de la friche et de ses conséquences.
Or, il est de l'intérêt général du Monde que l'Europe reste une zone de production agricole.
À cet égard, il convient de répondre à certaines menaces.
Le développement des biocarburants de première génération n'apparaît pas viable au-delà d'un niveau raisonnable et l'Europe doit s'engager plus qu'elle ne le fait dans la recherche destinée à aboutir à l'exploitation d'agro-carburants de deuxième, voire de troisième génération, au besoin en réorientant en ce sens les dispositifs de soutien public aux biocarburants.
Une Europe de la concurrence déloyale n'est pas une Europe agricole viable. Ici, comme ailleurs, la « mauvaise monnaie chasse la bonne ». Même s'il ne faut pas exagérer la portée des protections sociales dont bénéficient les salariés agricoles dans certains pays, dont la France, le défaut de toute protection dans des pays de niveau de développement comparable (voire supérieur, comme l'Allemagne) ne devrait pas être toléré d'autant qu'il contrevient directement aux engagements pris pour promouvoir une Europe sociale et du commerce équitable.
L'avenir de la PAC est à l'évidence un motif d'inquiétude au vu des différences de préférence collective existant entre les pays européens. Les pays qui souhaitent banaliser l'agriculture européenne, en la livrant au jeu des marchés paraissent à votre rapporteur jeter la proie pour l'ombre. Ils devraient faire retour sur eux-mêmes et mesurer l'ampleur des revirements opérés par eux à l'occasion de la grande crise alimentaire de 2007-2008. La dépendance alimentaire n'est pas n'importe quelle forme de dépendance. Elle est vitale et difficilement réversible. En outre, le rôle agricole de l'Europe ne peut être celui d'une simple zone de consommation quand on la considère sous l'angle des responsabilités de notre continent à l'égard du Monde. Les consommateurs des pays pauvres n'auraient rien à gagner à la concurrence des consommateurs européens. Les équilibres environnementaux de notre planète seraient gravement endommagés par un déclin de l'agriculture européenne.
Ce n'est pas à dire qu'il ne faille pas adapter une politique agricole commune qui l'a déjà été maintes fois. Sans doute doit-on la repenser de sorte qu'elle prenne mieux en compte les objectifs d'élévation de la production et ceux de préservation et d'amélioration de l'environnement. Par ailleurs, la segmentation des productions agricoles doit être un critère de formatage de la PAC. La répartition des soutiens peut et doit certainement, être plus équitable tout en restant un élément de dynamisme de l'agriculture européenne.
Mais, à l'heure où les excès d'une dérégulation agricole systématique sont à juste titre dénoncés pour leurs effets sur la production agricole et sur la répartition des revenus engendrés par cette activité, quand le développement des agriculteurs du monde appelle l'instauration de politiques publiques de soutien, notamment à l'investissement agricole, ce serait une régression que d'abandonner les agriculteurs européens aux seules forces d'un marché dont les défaillances sont patentes dans le domaine qui nous occupe.
2. Conditionné à des hypothèses fragiles
Cependant, plus encore que les résultats de cet exercice de projection, ce sont les conditions des équilibres qu'il décrit qu'il faut considérer.
L'équilibre alimentaire mondial y est conditionné par plusieurs évolutions dont les rôles sont inégaux mais qui, comme dans toute prospective, sont discutables une à une, ainsi que l'auteur le souligne.
Ainsi, le scénario tient pour acquis un succès des politiques de développement agricole ce qui est évidemment optimiste.
L'extension des surfaces cultivées en pluvial apporte la majorité de la production supplémentaire. Elle concerne au premier chef l'Afrique sub-saharienne, l'Amérique du Sud et, à un moindre degré, la Russie, l'Ukraine et le Kazakhstan.
La progression des rendements (de 50 % en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique subsaharienne) permet de boucler le scénario.
Enfin, l'irrigation n'est que peu mobilisée excepté en Asie et en Afrique du Nord, au Moyen-Orient où le supplément de production en provenance des zones irriguées atteint, grâce à des gains d'efficacité, près de 20 % du total de la production supplémentaire.
Par ailleurs, ainsi que l'indique l'auteur, ce scénario repose sur un grand nombre d'hypothèses simplificatrices qui font l'impasse sur plusieurs problèmes importants.
Il convient d'en rappeler l'esprit qui consiste à ne pas faire reposer le développement de la production agricole sur l'intensification productive menée dans les conditions de la « Révolution verte », choix qui présente des exigences fortes comme il a été exposé dans la deuxième partie du présent rapport.
Toutefois, il n'exclut pas l'exigence d'une élévation des rendements régionaux dont l'ampleur pourrait exagérer les possibles, limités dans la réalité par l'hétérogénéité des conditions infrarégionales.
Plus discutable encore le scénario fait l'impasse sur des problèmes environnementaux aigus qui sont autant de limites à sa vraisemblance. Par exemple le rôle de pourvoyeur alimentaire de l'Amérique du Sud est suspendu à une mobilisation quasi-totale de l'Amazonie ce qui n'est guère réaliste.
Il suppose, en outre, d'importantes migrations et plus globalement des modifications sensibles de la géographie agricole mondiale qui ne vont pas de soi.
Enfin, au titre des conditions économiques, il repose notamment sur l'hypothèse d'une capacité des pays déficitaires en alimentation à financer les produits importés nécessaires à la couverture de leurs besoins.
En effet, l'hypothèse que le commerce international permettra de combler les déficits locaux de production suppose que les pays ayant ces besoins soient en mesure d'importer, autrement dit que la division internationale du travail les trouve excédentaires sur les autres postes de production.
Cette réserve ne s'applique pas particulièrement au scénario sous revue puisque celui-ci est construit sur des hypothèses de progrès vers l'autonomie alimentaire des régions et réserve, sous cet angle, aux échanges internationaux un rôle plus limité que d'autres scénarios. Elle doit être considérée comme une question majeure que pose la perspective du renforcement du rôle des échanges internationaux dans le bouclage de l'équation alimentaire mondiale.
Ce qu'il faut retenir de la prospective ici présentée c'est que, même en optimisant les capacités agronomiques des pays de sorte que ceux-ci rejoignent une situation proche de leur potentiel, il faudrait compter sur les échanges internationaux plus encore qu'aujourd'hui pour égaliser la demande et l'offre.
B. UN RÔLE DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX VARIABLE SELON LES SUCCÈS DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
En réalité, le rôle des échanges internationaux dépendra des stratégies agricoles qui seront suivies et de leur succès.
Les différences entre le bilan ressources-emplois des deux scénarios de la prospective Agrimonde illustrent cette donnée.
On rappelle que les deux prospectives diffèrent principalement sur deux points :
- le niveau de la ration alimentaire, qui est supérieure dans Agrimonde GO ;
- la progression des rendements, qui y est beaucoup plus forte, ce qui permet de moins solliciter les surfaces.
Ces deux prospectives aboutissent à des déséquilibres très différents entre les ressources et les emplois régionaux.
Résumé synthétique des variables principales de l'équation alimentaire dans les deux scénarios d'Agrimonde
Synthèse des hypothèses du scénario Agrimonde 1
Synthèse des hypothèses du scénario Agrimonde GO
Dans les deux cas, les déficits des uns sont couverts par les excédents des autres, solution qui peut bien être techniquement justifiable mais est suspendue, il faut le souligner, à des conditions économiques et financières qui n'ont rien d'évidentes.
Synthèse du bilan ressources-emplois pour le scénario Agrimonde 1 (*)
(*) Le solde nul pour les animaux est conventionnel.
Synthèse du bilan ressources-emplois pour le scénario Agrimonde GO (*)
(*) Le solde nul pour les animaux est conventionnel.
Source : Agrimonde
Le tableau ci-après présente les taux de déficit ou d'excédent de chaque région du monde exprimés en pourcentage de la consommation (pour les régions déficitaires) ou de la production (pour les régions en excédent).
Source : Académie des Sciences
Le scénario Agrimonde 1 marqué, pourtant par une progression contenue de la demande du fait de l'hypothèse posée quant à la ration alimentaire individuelle, aboutit à davantage de déséquilibres. Les déficits régionaux y sont supérieurs à ce qu'ils sont dans Agrimonde GO.
Pour l'Afrique du Nord - Moyen Orient le taux de dépendance doublerait (Agrimonde 1) par rapport à 2003. De même la dépendance de l'Asie pourrait atteindre 20 % de ses besoins dans ce dernier scénario.
Il est aisé d'en conclure que le rôle des échanges internationaux, qui dans Agrimonde 1 représenteraient 25 % de la production végétale (8,2 % seulement dans Agrimonde GO), dépendra largement des choix de rattrapage agricole qui seront effectués.
Les résultats d'Agrimonde proviennent en effet des modalités du rattrapage agricole propres à chaque scénario avec, dans Agrigmonde GO, une diffusion plus large des recettes de la Révolution verte. Au-delà de ses aspects techniques (extensification de l'agriculture contre intensification), c'est plus globalement qu'il faut considérer ce modèle.
Le choix de lui tourner le dos appelle l'acceptation d'une ambition agricole plus modérée mais surtout d'équilibres reposant davantage sur les échanges commerciaux internationaux que sur les excédents de quelques régions.
Mais, loin de retracer une progression vers l'autosuffisance alimentaire, des deux scénarios d'Agrimonde, quoique différents, ouvrent la perspective d'un renforcement de la dépendance alimentaire71(*).
* *
*
Les choix de rattrapage agricole peuvent être influencés au stade de leur définition par les appréciations portées sur les avantages économiques d'une inscription du développement agricole dans la logique de la division internationale du travail.
II. DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES AGRICOLES INTERNATIONAUX
Si la dynamique de la demande alimentaire confrontée aux potentiels agricoles semble exclure le projet d'en assurer la satisfaction à partir des productions locales, conférant à l'autosuffisance alimentaire les qualités d'une utopie, il existe des marges de manoeuvre dont l'exploitation peut rapprocher ou éloigner de cet objectif.
On peut envisager sous cet angle la question récurrente de la libéralisation des échanges agricoles internationaux.
Si la mondialisation est loin d'être totalement accomplie dans le domaine agricole, les logiques productives sont dès maintenant marquées par les facteurs de division internationale du travail, sans résultats vraiment probants.
Certains prétendent qu'un approfondissement de la liberté du commerce agricole international permettrait de dépasser cette situation, en éliminant les barrières au développement agricole des pays en développement. La libéralisation serait l'instrument miracle du développement agricole des pays du Sud tout en libérant les pays du Nord du « fardeau » que représentent leurs politiques de soutien aux agriculteurs coûteuses pour les contribuables et les consommateurs.
Pour sa part, votre rapporteur tend à s'interroger sur la compatibilité entre cette libéralisation et l'objectif d'assurer le droit à l'alimentation, au Nord comme au Sud.
La mondialisation a longtemps moins touché l'agriculture que d'autres activités.
Le poids relativement faible des échanges agricoles internationaux en témoigne, même si leur influence ne se résume pas aux quantités échangées. Le niveau des prix domestiques est de plus en plus sensible aux cours mondiaux, par exemple.
Des facteurs institutionnels comme les protections mises en place dans différentes régions du monde pour préserver les productions locales expliquent sans doute que les échanges internationaux de produits agricoles soient moins développés aujourd'hui que pour d'autres produits ou services. En outre, l'investissement international n'a pas pris dans le secteur agricole l'essor qu'il a connu dans d'autres domaines.
Il n'en reste pas moins que la satisfaction des besoins alimentaires mondiaux dépend déjà aujourd'hui assez largement d'une logique de division internationale du travail qui confère aux échanges internationaux un rôle important que d'aucuns souhaiteraient élargir.
Ce processus est assis sur une logique d'efficience. Elle suppose un renforcement des interdépendances.
Au coeur de ces questions on retrouve le problème du commerce international et de son régime.
Les vertus théoriques du commerce international sont immenses et s'offrent comme autant de justifications à un renoncement à tout objectif d'autosuffisance alimentaire.
Pour autant, cette approche théorique est contestée pour l'irréalisme de ces conditions de validité, ses conséquences pratiques étant, en outre, jugées si dangereuses qu'elles conduisent in fine à lui ôter toute crédibilité, aux yeux d'un nombre élevé de spécialistes, observateurs ou praticiens de l'économie agricole.
Votre rapporteur doit remarquer qu'il existe structurellement un gouffre entre les approches théoriques relatives à la contribution d'échanges commerciaux libéralisés à la résolution du problème alimentaire dans le monde et les pratiques réellement observées.
Ainsi, le statu quo dans les négociations de Doha est pleinement illustratif de blocages qui pourraient persister.
Ce décalage va jusqu'à empiéter dans le champ théorique lui-même puisque les zélateurs du libre-échange admettent qu'il faille lui apporter quelques nuances.
Aux yeux de votre rapporteur, une libéralisation du commerce international agricole mesurée pourrait sans doute apporter quelques progrès. Mais c'est plutôt dans un pilotage du système alimentaire mondial par une véritable politique agricole que se trouve la solution du problème.
En effet, l'affichage d'effets aussi favorables que ceux mis en évidence dans les approches théoriques de la libéralisation du commerce international lui semble être abusivement optimiste s'agissant d'un secteur marqué par de très grandes inégalités de compétitivité et de développement et dans lequel les inefficacités de marché sont quasi-systémiques.
A. UN PROCESSUS PROGRESSIF DE LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES AGRICOLES
La production agricole a été soumise à un processus de banalisation, dans la mouvance générale de la dérégulation associée à la globalisation.
1. Au niveau mondial, l'Uruguay Round et Doha
Au niveau international, l'accord sur l'agriculture du General agreement on tariffs and trade (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ((GATT)) a entériné une diminution des protections afin de réduire les distorsions de concurrence entre États et d'instaurer un contexte d'échanges « libres et non faussés ».
En Europe, la PAC a été adaptée pour que ses modalités interfèrent le moins possible avec la production.
L'accord sur l'agriculture du GATT a promu une baisse des protections. La distinction majeure entre les soutiens qui ont pour effet de stimuler directement la production et les mesures sans effet direct témoigne d'orientations visant à découpler l'intervention publique de la production agricole.
|
L'accord sur l'agriculture de « l'Uruguay Round » Le GATT originel s'appliquait au commerce des produits agricoles, mais il comportait des règles particulières permettant aux pays d'appliquer certaines mesures non tarifaires telles que des contingents d'importation et d'accorder des subventions. Le commerce des produits agricoles a été marqué par le recours à des subventions à l'exportation qui n'auraient pas été, en principe, autorisées pour les produits industriels. Le Cycle d'Uruguay a débouché sur un premier accord multilatéral consacré au secteur. Celui-ci va dans le sens de l'instauration d'un cadre plus concurrentiel. Cet accord vise à réformer le commerce dans ce secteur. Il contient des engagements portant sur les questions suivantes : - l'accès aux marchés - avec la question des différentes restrictions à l'importation - le soutien interne - subventions et autres programmes, y compris ceux qui visent à accroître ou à garantir les prix à la production et les revenus des agriculteurs; - les subventions à l'exportation et autres méthodes appliquées pour assurer artificiellement la compétitivité des exportations. L'accord permet aux gouvernements d'aider le secteur agricole, mais de préférence par des mesures qui affectent le moins les échanges. Il ménage aussi une certaine souplesse dans la mise en oeuvre des engagements : les pays en développement ne sont pas tenus de réduire autant que les pays développés leurs subventions ou leurs droits de douane et bénéficient d'un délai supplémentaire pour s'acquitter de leurs obligations ; les pays les moins avancés ne sont pas du tout tenus de le faire. Enfin, des dispositions spéciales portent sur les intérêts des pays qui doivent importer les produits alimentaires dont ils ont besoin et sur les préoccupations des pays les moins avancés. Les engagements de réduction des « protections » obéissent aux séquences récapitulées dans le tableau ci-après. Seuls les chiffres correspondant à la réduction des subventions à l'exportation figurant stricto sensu dans l'accord. L'accès aux marchés et les droits de douane La nouvelle règle en matière d'accès aux marchés des produits agricoles est « droits de douane uniquement ». Avant le Cycle d'Uruguay, les importations de certains produits agricoles étaient limitées par des contingents et d'autres mesures non tarifaires. Ceux-ci ont été remplacés par des droits de douane censés assurer un degré de protection à peu près équivalent. Les pays développés sont tenus d'abaisser leurs droits de douane de 36 % contre 24 % seulement pour les pays en développement. Il est aussi prévu que les quantités importées avant l'entrée en vigueur de l'accord peuvent continuer à l'être et il est garanti que, pour les quantités additionnelles jusqu'à concurrence d'un certain niveau, les taux de droits appliqués ne seront pas prohibitifs, grâce à un système de « contingents tarifaires » : des droits de douane moins élevés sont fixés pour des quantités spécifiées et des taux de droits plus élevés (parfois beaucoup plus élevés) pour les quantités en sus du contingent. S'agissant des produits pour lesquels les restrictions non tarifaires ont été converties en droits de douane, les gouvernements sont autorisés à prendre des mesures d'urgence spéciales (« sauvegardes spéciales ») afin de protéger leurs agriculteurs contre une baisse soudaine des prix ou un accroissement des importations. L'accord précise néanmoins dans quelles conditions ces mesures d'urgence peuvent être adoptées. Les formules de soutien interne Dans le prolongement des reproches adressés aux mesures visant à soutenir les prix intérieurs, ou à subventionner la production d'une autre manière, comme pouvant encourager la surproduction (laquelle élimine les produits importés du marché ou conduit à subventionner les exportations et à pratiquer le dumping sur les marchés mondiaux), l'Accord sur l'agriculture fait la distinction entre les programmes de soutien qui ont pour effet de stimuler directement la production, et ceux qui sont considérés comme n'ayant pas d'effets directs. Les mesures intérieures ayant une incidence directe sur la production et le commerce doivent être réduites. Les membres de l'OMC ont évalué le soutien de ce type qu'ils ont accordé chaque année à l'agriculture (en calculant la « mesure globale du soutien totale » ou « MGS totale ») pendant la période de base 1986-1988. Les pays développés ont accepté de réduire ces chiffres de 20 % en six ans à compter de 1995. Les pays en développement sont convenus de procéder à une réduction de 13 % sur dix ans. Les pays les moins avancés ne sont tenus de faire aucune réduction. (Ce type de soutien interne est parfois appelé la « catégorie orange », en référence au feu orange pour la circulation). Les mesures ayant une incidence minime sur le commerce peuvent être adoptées librement et sont classées dans la catégorie « verte ». Elles comprennent les services assurés par les pouvoirs publics tels que la recherche, la santé publique, les infrastructures et la sécurité alimentaire. Elles comprennent aussi les paiements versés directement aux agriculteurs qui n'ont pas pour effet de stimuler la production, comme certaines formes de soutien direct des revenus, l'aide à la restructuration des exploitations agricoles, et les paiements directs dans le cadre de programmes de protection de l'environnement et d'assistance aux régions. Les mesures suivantes sont aussi autorisées: certains paiements directs aux agriculteurs qui sont tenus de limiter la production (appelées parfois mesures de la « catégorie bleue »), certains programmes d'aide de l'État en faveur du développement agricole et rural dans les pays en développement, et d'autres mesures de soutien dont l'ampleur est modeste (« de minimis ») par rapport à la valeur totale du produit ou des produits bénéficiaires (5 % ou moins dans le cas des pays développés et 10 % ou moins pour les pays en développement). Les subventions à l'exportation : limitation des dépenses et des quantités L'Accord sur l'agriculture proscrit les subventions à l'exportation de produits agricoles, sauf lorsqu'elles sont spécifiées dans les listes d'engagements des membres, auquel cas ceux-ci sont tenus de réduire à la fois les montants des dépenses effectuées à ce titre et les quantités d'exportations subventionnées. En prenant les moyennes de 1986-1990 comme niveau de base, les pays développés ont accepté de réduire de 36 % la valeur des subventions à l'exportation pendant une période de six ans à compter de 1995 (24 % sur dix ans pour les pays en développement). Ils sont aussi convenus de réduire de 21 % en six ans les quantités d'exportations subventionnées (14 % sur dix ans pour les pays en développement). Les pays les moins avancés ne sont tenus de faire aucune réduction. Pendant les six années de la période de mise en oeuvre, les pays en développement sont autorisés, sous certaines conditions, à recourir au subventionnement pour réduire les coûts de commercialisation et de transport des produits exportés. L'Accord sur l'agriculture dispose que les membres de l'OMC doivent réduire leurs exportations subventionnées. Cependant, certains pays importateurs sont tributaires des produits alimentaires bon marché et subventionnés en provenance des principaux pays industrialisés. Parmi eux, figurent quelques-uns des pays les plus pauvres qui, malgré l'effet favorable que pourrait avoir sur leur secteur agricole une hausse des prix causée par la réduction des subventions à l'exportation, pourraient avoir besoin d'une assistance temporaire afin d'effectuer les ajustements nécessaires pour pouvoir financer des importations devenues plus coûteuses et éventuellement exporter. Une Décision ministérielle spéciale énonce les objectifs et certaines mesures concernant l'aide alimentaire et d'aide au développement agricole. Elle mentionne aussi la possibilité d'une assistance fournie par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale en vue de financer des importations commerciales de produits alimentaires. 1 Cependant, pour les autres points de l'accord, les chiffres sont repris dans les listes d'engagements pris par les États, qui sont juridiquement contraignants. 2 Si la mesure antérieure avait pour effet de majorer les prix intérieurs de 75 % par rapport aux prix mondiaux, le nouveau droit de douane pourrait être d'environ 75 % (cette manière de convertir en droits de douane les contingents et d'autres types de mesures est appelée « tarification »). |
Les négociations du cycle se poursuivent autour des trois piliers (soutiens internes, accès au marché et subventions aux exportations).
Les données générales d'un accord prévoient :
- l'élimination des subventions agricoles d'ici 2013 ;
- la réduction des taux de soutien de 40 % en Europe et aux États-Unis d'ici 2025 ;
- la réduction, par bande, des droits de douane graduées selon le niveau de la protection initiale et en fonction du niveau de développement des pays (de 50 à 70 % pour les pays développés à 33 à 47 % pour les pays en développement) mais avec la faculté de préserver davantage de protections pour certains produits (en échange de l'octroi de contingents douaniers multilatéraux).
2. À l'échelon européen, les réformes successives de la PAC
Avant 1992, la PAC était articulée autour d'un système administré. Elle fixait des prix rémunérateurs pour les agriculteurs et assurait une quasi-garantie de débouchés. En cas de surproduction, les surplus étaient absorbés par des mécanismes d'intervention (stockage, élimination des produits) ou favorisant leur écoulement (aides à l'exportation).
La réforme de 1992 a imposé une baisse des prix sur les principales productions (céréales et viande bovine) pour limiter l'intérêt à produire. La baisse des revenus qui en résultait a été compensée par des « paiements compensatoires », nommés « aides directes ». La maîtrise était renforcée par la jachère obligatoire.
La réforme de 1999 a amplifié la baisse des prix, partiellement compensée par des aides directes et introduit un nouveau pilier. La PAC compte désormais deux piliers : un premier pilier de marché est constitué des aides aux revenus et des interventions, intégralement financées par le budget communautaire ; un deuxième pilier, est consacré au développement rural pour lequel les aides européennes interviennent en cofinancement.
La réforme de 2003 a parachevé le tournant de 1992. L'aide directe aux revenus devient le coeur de la PAC et est découplée à des productions. La réforme ajoute un nouveau concept : la conditionnalité. L'octroi des aides est subordonné au respect de certaines règles, notamment environnementales. La priorité est donnée au deuxième pilier : une procédure dite de modulation est mise en place : elle consiste à faire glisser progressivement une part des financements du premier volet vers le second.
Le bilan de santé, du 20 novembre 2008, complète la réforme de 2003. L'accord prévoit principalement l'augmentation des quotas laitiers avant leur abandon définitif en 2015, la généralisation du découplage, la suppression des jachères obligatoires, la réorientation des aides en direction des productions herbagères, et réduit l'intervention sur les marchés à un filet de sécurité.
Les outils de régulation des marchés agricoles sont aujourd'hui réduits.
|
Inventaire des outils de régulation des marchés agricoles Le règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, dit règlement « OCM unique » arrête, pour chaque produit agricole, les outils de régulation pouvant être mis en oeuvre. La palette est a priori large, mais la mise en oeuvre varie selon les types de production. Certains outils, prévus par les textes, ne sont pas utilisés du fait des conditions qui pèsent sur leur déclenchement. L'intervention publique correspond au stockage public. L'Union achète une partie de la production pour soutenir les prix lorsque ceux-ci descendent en dessous des prix de référence. Mais ceux-ci sont fixés actuellement à un niveau très bas qui, souvent, ne couvre pas les coûts de revient (exemples de prix de référence : 101,31 euros/t pour les céréales, 404 euros/t pour le sucre blanc, 246 euros/100 kg de beurre). Les volumes achetés sont écoulés ultérieurement dans des conditions évitant autant que possible toute perturbation du marché. Toutes les productions agricoles n'y sont pas éligibles, notamment les fruits et légumes. L'OCM unique prévoit aussi des aides au stockage privé afin d'aider les producteurs à retenir une partie de leur production. Le montant de l'aide est fixé en tenant compte des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix de marché. La viande, l'huile d'olive, le sucre blanc et les produits laitiers sont les principales productions éligibles. Des mesures exceptionnelles de soutien au marché sont aussi prévues en cas de maladies animales, de perte de confiance des consommateurs. Les céréales ou le sucre peuvent aussi bénéficier de mesures complémentaires en cas de baisse des prix en dessous du prix d'intervention (retrait d'une partie de la production...). Des mesures d'adaptation non quantitative de l'offre aux exigences du marché peuvent aussi être mises en oeuvre par la Commission dans le secteur de la viande et des plantes vivantes. Deux secteurs sont encore soumis à un régime de quotas : le lait et le sucre. Les quotas de lait devraient être supprimés en 2015. Ce régime ne soutient pas directement les prix à la différence des précédents, mais prévoit des pénalités en cas de dépassement de certaines limites. Des aides au soutien de la demande sont parfois permises. Par exemple, une aide à la fourniture de produits laitiers aux élèves ou une aide à l'achat de crème, de beurre et de beurre concentré à prix réduit par les armées, les institutions et collectivités sans but lucratif... Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union peut recourir à des restitutions à l'exportation lorsque les prix mondiaux sont inférieurs aux prix européens. La différence est couverte pour permettre de s'aligner sur les prix mondiaux. À l'importation, des droits de douane variables selon les produits sont perçus. Des contingents existent également, notamment sur la viande bovine en provenance des États membres du Mercosur. Enfin, l'aide alimentaire peut être assimilée à une mesure de soutien aux marchés lorsqu'elle est massive comme aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas à un même degré en Europe. Source : Rapport d'information de MM. Jean Bizet, Jean-Paul Émorine, Mmes Bernadette Bourzai et Odette Hervieaux, fait au nom de la commission des affaires européennes et de la commission de l'économie n° 102 (2010-2011) 10 novembre 2010. |
Sur fond de découplage entre les aides agricoles et la production les outils de régulation comportent quelques dispositifs permettant la constitution de stocks (publics à travers les mécanismes d'intervention en cas de baisse des prix au-dessus du niveau de référence au privé). Leur portée paraît faible.
B. QUELS EFFETS DE LA LIBÉRALISATION DU COMMERCE AGRICOLE ?
La portée des arguments théoriques en faveur de la libéralisation du commerce agricole international a trouvé un renfort dans l'utilisation des outils de simulation que représentent les modèles.
Pourtant, les résultats des simulations ainsi réalisées doivent être soumis à la critique, ce qui ne disqualifie nullement leur emploi mais représente une démarche d'analyse naturelle, la modélisation ne pouvant « dire » plus que ce qu'elle peut.
La confrontation de plusieurs simulations, dont l'une réalisée par notre Haute assemblée a conduit à une ré-estimation des résultats de la libéralisation des échanges agricoles par les organisations mondiales en charge de ce dossier, en témoigne éloquemment.
Mais, il faut bien admettre qu'au-delà de différences portant sur les hypothèses et les données des simulations, c'est plus structurellement que les enseignements des modèles doivent être nuancés (voir encadré ci-dessous pour un exemple parmi d'autres).
UN EXEMPLE DES INSUFFISANCES DES MODÈLES DE SIMULATIONS
DE LA LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES AGRICOLES
Les modèles des simulations des politiques commerciales dans le secteur agricole sont généralement des modèles d'équilibre général (d'équilibre partiel parfois) dont les équations se réfèrent à un présupposé de fonctionnement efficient des marchés.
Or, leur fondement théorique semble particulièrement peu réaliste au vu des conditions particulières de l'économie agricole.
Il existe au moins deux problèmes de ce point de vue :
le fossé pouvant exister entre un modèles abstrait où les mécanismes de marché (l'équilibre de l'offre et de la demande à travers le système de prix) jouent avec efficacité et l'économie agricole comme elle fonctionne faite de rigidités et d'une segmentation des marchés ;
la négligence des imperfections de marché que représentent les externalités négatives et les problèmes d'information.
Les modèles de simulation de la libéralisation du commerce international agricole reposent sur une conception abstraite où les marchés fonctionnent de façon efficiente ce qui suppose quelques entorses par rapport au fonctionnement concret de l'économie agricole.
La libéralisation du commerce international peut aggraver, en les amplifiant, les effets des défaillances de marché.
Celles-ci sont généralement constituées d'externalités, ou de problèmes d'information (qu'il s'agisse d'informations asymétriques ou d'information imparfaite72(*).
Dans tous les cas, le marché n'intègre pas les phénomènes sous revue alors que, dans le secteur agricole, ils jouent un rôle particulièrement important.
Plus précisément deux préoccupations importantes semblent relever de ces défaillances de marché :
- les questions environnementales ;
- les problèmes de sécurité sanitaire.
Ces problèmes n'étant pas correctement traités dans le cadre des mécanismes de marché appellent des corrections à ces mécanismes.
La libéralisation du commerce international, en ce qu'elle peut être le vecteur de transmission de ces défaillances, peut quant à elle de son côté, être considérée comme devant être organisée.
C'est d'ailleurs souvent pour cette raison que des mesures non tarifaires réglementant le commerce agricole international sont mises en place par les États.
Or, il est permis de considérer qu'à l'avenir les débats relatifs à ces mesures, souvent présentées de façon exclusivement négatives comme constitutives d'instruments dissimulés de protection commerciale, devraient s'intensifier.
Si toutes les mesures non tarifaires ne peuvent être rangées sous la bannière des mesures destinées à remédier aux imperfections de marché il serait peu responsable de négliger que certaines d'entre elles vont dans ce sens.
À ce titre, elles sont justifiables et, d'ailleurs, peuvent être considérées comme favorables dans certaines hypothèses à l'expansion du commerce international. Tel est en particulier le cas pour les mesures visant à surmonter les asymétries d'information.
Mais, au-delà, le constat que le commerce international peut aggraver les imperfections de marché doit être au centre des réflexions sur la libéralisation des échanges internationaux.
Il conduit à nuancer des estimations théoriques des gains de la libéralisation des échanges internationaux, dans des proportions qui demandent à être précisées, mais peuvent être considérables.
Par exemple, si les simulations des avantages de libéralisation intègrent généralement les gains d'efficience qui pourraient être associés au supplément de production réalisé par un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, elles ne les corrigent pas des externalités négatives que pourraient engendrer la destruction, plus ou moins complète, de la forêt amazonienne.
Il serait par conséquent souhaitable de traiter tout autrement qu'aujourd'hui ces questions.
En l'état, les mesures non tarifaires sont essentiellement abordées sous l'angle de leurs effets restrictifs sur le commerce international.
Ainsi que le suggère une étude de Frank van Tongeren, John Beghin et Stéphane Marette pour l'OCDE, il serait justifié de faire prévaloir une autre approche basée sur le bilan de ces mesures en terme de bien-être. En effet, de nombreuses mesures non tarifaires peuvent bien restreindre le commerce mais, également, améliorer le bien-être, en présence d'externalités négatives ou de problèmes d'informations.
Dans une telle perspective, deux problèmes importants devraient être résolus :
- celui du choix des meilleurs instruments pour corriger les défaillances de marché (réglementations, taxes, subventions, certifications...) ;
- et celui des modalités d'institutionnalisation de la définition et de l'application des politiques de correction de ces défaillances.
À cet égard, d'ores et déjà, l'échelon strictement national n'a plus le monopole. Mais, la prédominance de l'OMC dans le paysage institutionnel, même tempérée par l'implication des Nations Unies avec la CNUCED, ne constitue pas une solution entièrement satisfaisante.
Il manque aujourd'hui une institution internationale en charge de coordonner la conception et l'application des politiques nécessaires pour corriger les défaillances des mécanismes de marché dans le secteur agricole.
1. Les enseignements des modèles
Le modèle d'équilibre alimentaire reposant sur les échanges internationaux peut se recommander d'une diversité d'arguments.
Le « consensus de Washington » a étroitement inspiré - et continue de le faire - la conception des politiques de développement, notamment agricole.
Sur le plan des relations commerciales internationales, ce modèle est celui du libre-échange.
Il est censé permettre d'optimiser la production agricole mondiale en instaurant un contexte de libre fonctionnement des marchés où, à la fois, la production est maximale et obtenue aux meilleurs coûts, permettant par là-même de satisfaire au mieux la demande en quantités et dans les meilleures conditions de prix.
Par ailleurs, en éliminant les distorsions apportées au marché agricole par l'intervention publique, la libéralisation du commerce international agricole favoriserait le bon emploi des ressources disponibles dans chaque pays et, à travers lui, le processus global du développement.
Ce modèle, qui est un modèle de division internationale du travail, peut être considéré comme conforme à la théorie des avantages comparatifs qui veut que chaque pays spécialise ses productions dans les secteurs où il dispose des avantages comparatifs les plus élevés.
Il inspire étroitement les projets de libéralisation du commerce agricole international que plusieurs exercices de simulation conduisent à préconiser.
Cependant des facteurs souvent négligés dans ces travaux obligent à douter de leur valeur normative.
À ce propos, on doit relever que les simulations portant sur la libéralisation du commerce agricole international donnent des résultats beaucoup plus contrastés quand on les diversifie que ceux généralement mis en avant par les partisans de la libéralisation.
La protection tarifaire du secteur agricole, qui est structurellement plus forte que celle des autres secteurs, est assez disparate.
a) Rappels sur le contexte
|
Note technique sur les droits de douane Chaque État notifie à l'OMC un « droit consolidé » par produit qu'il s'engage à ne pas dépasser. C'est sur ces droits que porte la négociation à l'OMC. Le « droit de douane appliqué » est le droit qui frappe effectivement le produit importé. Il peut être très différent du « droit consolidé » tout en devant rester inférieur. Pour les pays en développement la marge entre ces deux droits peut être en pratique assez élevée. Pour les pays développés, elle est généralement faible. Pour les produits agricoles elle représente environ 2,5 % pour l'Union européenne. Les « droits appliqués NPF (Nation la plus favorisée) » sont les droits appliqués par un pays à tous ses partenaires commerciaux, membres de l'OMC. Le système des préférences généralisées (SPG) constitue une dérogation à la clause de la NPF en proposant des dérogations non réciproques aux pays les moins avancés, pour certains produits. Il résulte, en pratique, de ce système une multiplicité de droits appliqués. |
La protection douanière de l'Union
européenne
et de quelques grands pays agricoles (en
2006-2007)
|
Moyenne droits consolidés |
Moyenne des droits NPF appliqués |
Moyenne pondérée par la Commission |
|
|
Union européenne |
15,1 |
15 |
11,8 |
|
États-Unis |
5 |
5,5 |
5,5 |
|
Chine |
15,8 |
15,8 |
16 |
|
Canada* |
14,5 |
17,9 |
10,8 |
|
Brésil* |
35,5 |
10,3 |
12,2 |
|
Argentine* |
32,6 |
10,2 |
10 |
|
Inde |
114,2 |
34,4 |
41,9 |
|
Australie* |
3,3 |
1,3 |
2,8 |
|
Nouvelle-Zélande* |
5,7 |
1,7 |
2,5 |
|
Afrique du Sud* |
40,8 |
9,2 |
9,3 |
|
Chili* |
26 |
6 |
6 |
|
Colombie* |
91,9 |
16,6 |
18,7 |
|
Russie |
nd |
14,6 |
24,2 |
|
Suisse |
54,3 |
43,6 |
17,3 |
Source : « Profils tarifaires dans le monde » OMC
NB : Les pays suivis d'un astérisque sont membres du « groupe de Cairns ».
Elle est généralement élevée dans les pays en développement, faible aux États-Unis et dans certains des pays du « groupe de Cairns » (l'Australie, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et, à un moindre degré, le Brésil ou le Chili) et intermédiaire dans l'Union européenne.
On doit cependant souligner que la protection de l'Union européenne est inférieure à la protection moyenne et que pour les pays les moins avancés, elle est globalement inférieure aux protections mises en place par les autres pays.
En outre, à dires d'experts, l'Union européenne opposerait moins de barrières environnementales, notamment dans l'agriculture, que les États-Unis ou le Japon par exemple où les produits affectés par les mesures de cette sorte seraient trois fois plus nombreux. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont en pointe dans la défense d'une libéralisation agricole par la baisse des tarifs de douane, recourraient systématiquement aux mesures environnementales puisque les trois quarts de la valeur des importations agricoles en seraient affectés.
La chose en soi n'est pas répréhensible puisque comme veut le montrer ce rapport, les mesures non tarifaires d'encadrement du commerce international sont justifiables et devraient même devenir un levier à part entière de la construction d'un système alimentaire mondial mieux équilibré. Il n'en reste pas moins que les écarts de pratiques doivent à ce stade être relevés pour progresser dans l'appréciation des degrés d'ouverture des différents marchés mais aussi comme le témoignage d'un problème, encore à résoudre, d'harmonisation des concepts de régulation des marchés.
Quoi qu'il en soit, ainsi que le relevait justement un rapport de la délégation à la planification du Sénat sur les principaux enseignements des simulations de la libéralisation des échanges commerciaux73(*), les calculs des droits de douane effectivement appliqués permettent de comprendre globalement les intérêts défendus par chaque partie dans les négociations commerciales.
« Au total, les calculs des droits de douane effectivement appliqués, tels qu'ils sont réalisés par le CEPII, permettent de comprendre globalement les intérêts défendus par chaque partie dans les négociations en cours :
- l'Union européenne a des intérêts défensifs sur l'agriculture, mais des intérêts offensifs sur les produits manufacturés ;
- les pays émergents ont des intérêts offensifs sur l'agriculture, et bien sûr vers l'Europe, mais des intérêts défensifs sur les produits manufacturés ;
- les intérêts américains paraissent plus dilués : moins défensifs que l'Europe sur les produits agricoles, mais plus défensifs sur les produits manufacturés, ce qui les rapproche sur ce point des pays émergents ;
- les PMA n'ont pas réellement d'intérêts communs avec les pays émergents, la solidarité entre les deux groupes qui se manifeste depuis le début de ce cycle obéissant à d'autres logiques. »
Le même rapport montrait que la protection tarifaire de l'Europe était en fait largement atténuée dans les faits par les nombreuses préférences commerciales qu'elle a accordées. Il concluait que le portrait d'une « Europe forteresse » dans le domaine agricole relevait davantage de la caricature que d'une représentation fidèle de la réalité.
L'observation des flux d'échanges confirme au moins partiellement, ce constat.
- l'Europe est le premier importateur mondial de produits agricoles ;
- l'Europe représente un marché pour les pays en développement plus important que les marchés américain et japonais cumulés ;
- quasiment 70 % des importations européennes proviennent des pays en développement, dont 16,4 % des pays les plus pauvres ; aux États-Unis la part des pays en développement n'atteint pas 45 % (3 % pour les plus pauvres) ; au Japon elle est de 32 % (2 % pour les plus pauvres). »
b) Des résultats contrastés quand on diversifie les techniques de simulation
Les simulations des effets de la libéralisation du commerce agricole international varient avec le temps et selon les propositions concernées.
Les résultats mentionnés comptent moins que les enchaînements à l'oeuvre et ne doivent être considérés que comme des ordres de grandeur.
Au tournant des années 2000, le montant des soutiens agricoles dans le monde était estimé à 248 milliards de dollars par l'OCDE.
En Europe, les transferts directs aux agriculteurs s'élevaient à quelque 40 milliards d'euros ; l'équivalent aux États-Unis était de l'ordre de 39 milliards de dollars (32,5 milliards d'euros). Ces sommes étaient susceptibles évidemment de modifier les conditions de concurrence et de handicaper les pays en développement sur le marché mondial réduisant leurs éventuels avantages.
(1) De la vision irénique de la Banque mondiale...
La Banque mondiale et, à des degrés divers, la plupart des travaux menés sur le sujet concluent généralement à un impact substantiel de la libéralisation agricole sur le « bien-être » mondial, et en particulier celui des pays en développement.
En 2004, la Banque mondiale évaluait à 369 milliards de dollars (au prix de 1997) l'impact positif de cette libéralisation dont plus des deux tiers (240 milliards de dollars) pour les pays en développement.
En outre, la libéralisation aurait un effet très favorable sur la pauvreté en raison de la baisse des prix des produits de première nécessité liée à la réduction des droits de douane et de la meilleure rémunération du travail agricole liée à l'augmentation de la production locale.
|
Les effets de la libéralisation du commerce
agricole : Les résultats des différentes simulations effectuées par les organisations internationales et par des universitaires suggèrent que plus la libéralisation des échanges est importante, plus les gains sont élevés au niveau mondial. Ce résultat traduit essentiellement une amélioration de l'efficacité de l'allocation des ressources. La baisse des droits de douane est l'aspect qui engendre les gains les plus élevés dans la plupart des cas, bien au-delà de la baisse des subventions à la production, et plus encore que l'élimination des subventions aux exportations. Les scénarios peuvent certes différer, mais les simulations réalisées avec des modèles d'équilibre partiel suggèrent que des gains mondiaux de richesse réelle situés entre 8 et 18 milliards de dollars résulteraient d'un accord modeste comme le sera probablement celui du cycle de Doha - Poonyth et Sharma (2003) ; Laird et alii (2004) ; Hoekman et alii (2002) -. Les modèles en équilibre général donnent des gains quelque peu supérieurs, compris selon les scénarios entre 15 et 80 milliards de dollars - Diao et alii (2001) ; Beghin et alii (2002) ; Achterbosh et alii (2004) -. Des scénarios plus ambitieux de libéralisation, comme la suppression totale des aides et droits de douane, donnent des gains plus élevés, généralement entre 80 et 130 milliards de dollars - Tokarick (2003) ; Francois et Alii (2003) ; Cline (2004) -. La Banque mondiale (2004) trouve des gains très élevés, par rapport aux autres études dans une optique dynamique (369 milliards de dollars pour une libéralisation très ambitieuse du commerce agricole) et, autre point de singularité, essentiellement au bénéfice des PED. Les effets sur les prix mondiaux agricoles varient également significativement, selon les modèles et les scénarios. Mais pour un accord envisageable au terme du cycle de Doha, ils se situent entre un accroissement de 4 % (Fapri, 2002) à 18 % (Diao et alii, 2001) pour le blé, de l'ordre de 0 à 10 % pour les oléagineux, 2 à 10 % pour le riz, et 2 à 5 % pour la viande bovine. Dans la plupart des cas, l'UE, et dans une moindre mesure les États-Unis, apparaissent comme les grands gagnants d'un accord, essentiellement grâce à la baisse des prix moindres payés par les consommateurs pour leur alimentation. Les pays du groupe de Cairns (qui comprennent des PED comme le Brésil ou l'Argentine) seraient également gagnants du fait de l'ouverture des marchés et de meilleurs termes de l'échange. Le débat reste vif en ce qui concerne les gains pour les autres PED. Si certaines études voient dans un accord agricole une source importante de gains pour ces pays (Banque Mondiale, 2004 ; Hertel et alii, 2003), d'autres, comme la Cnuced, trouvent des pertes significatives pour un grand nombre de pays, en particulier les pays insulaires et l'Afrique subsaharienne. 1 Revue française d'économie, n°1/Vol XX, de Jean-Christophe Bureau, Estelle Gozlan et Sébastien Jean : « La libéralisation des marchés agricoles, une chance pour les pays en développement ? ». |
Dans le rapport précité de la délégation à la planification où figuraient des simulations originales du CEPII la démonstration était apportée que les évaluations en question étaient trop optimistes.
Quatre explications en étaient avancées.
La protection commerciale n'y est pas mesurée avec précision : la Banque mondiale, comme la plupart des autres travaux, estiment les conséquences de l'abaissement des protections douanières en appliquant les formules de réduction tarifaire aux droits appliqués ; or, les pays négocient à l'OMC sur les droits consolidés, qui peuvent être très supérieurs aux droits appliqués et dont l'effet concret sur la baisse des droits effectivement appliqués peut être nul.
Ces simulations n'intègrent pas les régimes préférentiels de manière exhaustive et ne peuvent pas rendre compte de l'érosion de cet avantage de manière satisfaisante.
Les différents groupes de pays en développement ne sont pas distingués, alors que ce groupe n'a évidemment aucune homogénéité (le Brésil et un pays d'Afrique subsaharienne ont peu de caractéristiques communes en matière d'insertion dans le commerce agricole mondial) : il faudrait distinguer entre exportateurs nets et importateurs nets, PMA bénéficiant d'un accès à droit nul sur les marchés du Nord, PMA spécialisés sur un produit très protégé.
Enfin, les effets complexes des outils de soutien interne dans les pays du Nord ne sont pas pris en compte74(*).
(2) ... à l'approche plus réaliste de la délégation du Sénat à la planification75(*)
À partir des simulations du CEPII, on pouvait distinguer deux types d'effets de la libéralisation des marchés agricoles :
- la baisse des tarifs douaniers entraînait une augmentation des exportations agricoles mondiales, cependant très différenciée selon les pays ou les zones géographiques ;
- la baisse des soutiens internes à l'agriculture avait un impact sur les prix mondiaux agricoles, avec des effets différenciés sur le revenu réel des différentes zones ou pays.
Sur le premier point, la baisse des droits de douane étant plus forte sur les droits élevés, c'est la zone la plus protectionniste parmi les pays riches, l'Association européenne de libre échange (AELE), qui ouvraient le plus ses frontières. Au contraire, les États-Unis, où la protection agricole est relativement basse, mais aussi l'Afrique subsaharienne, du fait qu'elle est exonérée d'engagements de baisse des droits de douane, ne connaissaient qu'une faible réduction de leur droit de douane moyen.
L'accès des différentes zones exportatrices aux marchés agricoles étrangers était amélioré mais dans des proportions contrastées :
- cette amélioration était particulièrement forte pour les pays développés du groupe de Cairns et, dans une moindre mesure, l'Union européenne et les États-Unis ;
- au contraire, elle était faible pour les zones qui, avant la libéralisation, bénéficiaient largement d'accès préférentiels : l'AELE (sur le marché de l'UE) et l'Afrique subsaharienne.
Le commerce mondial agricole en volume augmentait de 6,1 % en moyenne à la suite de ce choc de libéralisation
La même simulation effectuée non pas, comme ici, sur les droits consolidés mais sur les droits appliqués, aurait donné une progression plus forte du commerce agricole de l'ordre de 15 %.
Globalement, dans un scénario de réduction des soutiens de l'ordre de la moitié, le volume d'exportations agricoles des pays riches progressait de 4,2 %, celui des pays en développement de 9,4 %.
Mais les bénéfices de la libéralisation et ses coûts étant inégalement répartis.
Parmi les grands exportateurs agricoles, qui sont aussi ceux dont l'accès aux marchés étrangers s'est le plus amélioré, ce sont les pays du groupe de Cairns (développés et en développement) qui bénéficiait le plus de la libéralisation.
En revanche, les exportations de l'Union européenne et surtout celles des États-Unis progressaient relativement peu car elles subissaient l'effet des réductions du soutien interne et des subventions à l'exportation.
Du côté de l'Association européenne du libre-échange (AELE) comme des pays d'Afrique subsaharienne, la faible progression des exportations s'expliquait par l'érosion de leurs marges préférentielles.
Ainsi, au Nord comme au Sud, l'augmentation des exportations est très différenciée selon les zones.
La prise en compte de la diversité des situations initiales dans les conditions d'accès aux marchés conduit donc à fortement nuancer les projections les plus optimistes.
L'idée selon laquelle les pays qui disposent initialement d'un avantage comparatif dans les productions agricoles vont être les principaux gagnants de la libéralisation est à reconsidérer : pour certains, cet avantage était en partie lié à une marge préférentielle nécessairement érodée dans les scénarios de libéralisation agricole.
L'érosion des préférences n'est pas le seul phénomène que certains pays en développement peuvent craindre.
La réduction des soutiens internes est susceptible d'exercer des effets sur les prix mondiaux de produits agricoles
Elle implique notamment pour les pays du Nord une diminution de l'incitation à produire, donc une diminution globale de l'offre de produits agricoles, et risque de provoquer ainsi une hausse des prix agricoles mondiaux.
Les résultats des simulations du CEPII suggéraient un impact sur les prix mondiaux avec une hausse de 2,8 % en moyenne.
La hausse des prix agricoles était variable suivant les produits et avantageait ou désavantageait les pays selon les produits sur lesquels ils sont exportateurs ou importateurs nets.
Dans un tel scénario, quatre zones en développement sur six subissaient une détérioration de leurs termes de l'échange. Il fallait anticiper que, pour les pays importateurs nets de produits agricoles, la valeur de leurs importations progresserait plus vite que celle de leurs exportations avec un appauvrissement subséquent de ces pays.
Au total, l'évolution des revenus réels consécutive à la libéralisation agricole se révélait pour le moins contrastée.
L'évolution du revenu réel combine l'impact de la modification des termes de l'échange (voir ci-dessus) et celui de la réallocation sectorielle des ressources induite par la réduction des distorsions créées par les tarifs ou les subventions (effet-volume).
L'impact global apparaît faiblement positif au niveau mondial. Compte tenu, dans ces zones, de l'importance relative des distorsions éliminées par la libéralisation, l'impact est également positif pour toutes les régions développées ainsi que pour l'Asie du Sud. En revanche, les autres zones en développement sont perdantes.
Le tableau ci-dessus montre que l'impact global - au niveau mondial - de la libéralisation en termes de revenu réel pourrait être limité, inférieur à celui simulé jusqu'à présent (+ 0,08 % pour l'ensemble du Monde) avec toutefois un impact non négligeable sur la production agricole au niveau mondial.
|
Une hausse du revenu réel en Europe ? On peut voir dans le tableau ci-dessus que l'impact en termes de revenu réel d'une libéralisation agricole serait globalement positif pour l'Union européenne. Ceci correspond à un résultat que l'on retrouve dans la quasi-totalité des simulations de cette nature. Les enchaînements « positifs » pour l'Union européenne décrits par ces exercices sont les suivants : - la diminution des soutiens internes permet une réallocation des facteurs sur les productions plus rentables (ce qui est conforme au cadre théorique des avantages comparatifs) ; - à l'inverse des pays pauvres, l'Union européenne, comme les autres pays riches, bénéficie d'une appréciation des termes de l'échange (elle est exportatrice nette des produits agricoles dont les prix montent) ; - si les prix de production agricole montent, les prix agricoles sur le marché intérieur baissent en raison de la baisse des tarifs douaniers : le pouvoir d'achat des consommateurs augmente. Par ailleurs, il est connu que l'impact d'une libéralisation agricole serait très différencié et inégal selon les produits et les pays : - les produits soumis à une forte concurrence (lait, viande bovine, riz...) seraient affectés par une libéralisation agricole ; - les zones ou pays (du Nord de l'Europe par exemple) spécialisés sur des productions très compétitives à l'exportation gagneraient à une libéralisation ; - d'autres travaux montrent qu'une libéralisation agricole entraînerait une baisse de la valeur ajoutée agricole dans l'Union européenne et une concentration de la production. Cependant, cet impact négatif pour les producteurs serait compensé par l'impact positif de la baisse des prix pour les consommateurs. On sait toute la fragilité des enchaînements ainsi décrits (v. infra). En particulier, la prise en compte des structures de marché conduit à douter que la baisse des prix agricoles se traduise de façon perceptible pour le consommateur par une inflexion des prix de consommation. |
2. « Considérations hors-modèles »
Globalement, la liberté du commerce est justifiée par l'élimination des distorsions qu'entraînent les entraves au libre fonctionnement des marchés. Le pivot de la théorie réside dans le concept d'allocation des ressources rares en fonction des avantages comparatifs des pays. Or le concept d'avantages comparatifs n'a pas la portée nominative qu'on lui prête trop souvent. En outre, il faut élargir le point de vue en tenant compte d'un principe de réalité qui oblige à considérer le fonctionnement d'autres marchés que celui concerné par les prospectives de libéralisation de secteur agricole et en tenant compte des défaillances systémiques du marché, particulièrement évidentes en agriculture.
a) Les avantages comparatifs ne sont pas figés et ne doivent pas être considérés comme tels
Une partie des avantages comparatifs peut être attribuée à des dotations naturelles qui sont a priori d'une importance stratégique particulière s'agissant d'une production qui dépend encore étroitement de telles dotations factorielles.
La géographie actuelle de la production agricole témoigne que celles-ci jouent un grand rôle et les prospectives ne manquent pas d'intégrer ce déterminant dans les scénarios pour le futur.
Cette dimension naturelle conduit souvent à assimiler avantages comparatifs en agriculture, dotations naturelles et intangibilité des avantages de chaque Nation.
Cette assimilation est une erreur et est source d'autres erreurs.
Les dotations factorielles ne se limitent pas, loin de là, aux ressources naturelles. L'ensemble des variables - de tous ordres - influençant les performances agricoles doivent être considérées comme contribuant à la formation des avantages comparatifs. La localisation des productions agro-alimentaires montre la sensibilité à cette large gamme d'avantages comparatifs. Les performances productives des agricultures qui varient du tout au tout dans le monde sous l'effet des révolutions qu'a connues ce secteur.
Comme le rappelle Marcel Mazoyer si « au début du XXe siècle, toutes les agricultures du monde s'inscrivaient dans un écart de productivité du travail de l'ordre de un à dix, une tonne par travailleur et par an pour la culture manuelle... ; dix tonnes par travailleur pour la culture à tradition mécanisée... au cours de la seconde moitié du XXe siècle... la superficie maximum cultivable pour un travailleurs (a) doublé tous les dix ans (et) dépasse aujourd'hui deux cents hectares par travailleur... ainsi, la productivité du travail dépasse souvent les mille tonnes par travailleur et par an, et peut même atteindre les deux mille tonnes... Ainsi, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, l'écart de productivité du travail entre les agricultures les moins performantes du monde et les plus performantes a été multiplié par plus de 100 : de 1 contre 10 qu'il était au début du siècle ; cet écart dépasse aujourd'hui 1 contre 1 000 ! ».
La très grande hétérogénéité des productivités agricoles, peut bien provenir en partie des conditions naturelles, elle résulte aussi des investissements réalisés dans le secteur, qui s'accompagnent de l'existence de capacités productives, physiques ou économiques, fortement disparates auxquelles l'approche économique des avantages comparatifs tend à conférer une portée naturelle normative qu'elle ne devrait pas avoir.
Passer ainsi de la description à la normativité représente un glissement abusif d'autant que le système alimentaire mondial ainsi décrit n'est pas soutenable.
Les avantages comparatifs ne sont pas intangibles. Dans l'agriculture, le poids des facteurs naturels est sans doute très élevé mais, outre que des régions disposant de ressources naturelles favorables n'ont pas effectué leur plein décollage agricole, d'autres, moins favorisées par la nature, pourraient améliorer leur production malgré ce handicap, s'il n'est point rédhibitoire.
Atteindre cet objectif est d'ailleurs indispensable si l'on veut remporter le défi alimentaire, c'est-à-dire produire des quantités suffisantes pour nourrir le monde et créer les conditions d'un accès réel à cette nourriture.
C'est la raison pour laquelle il faut considérer avec prudence la proposition de « forcer » le processus de division agronomique du monde en libéralisant le commerce agricole.
Outre que la revendication d'autonomie est une réaction usuelle aux dangers des interdépendances offertes par la mondialisation (la mondialisation si elle crée de nouvelles opportunités augmente également les risques), cette option est peu acceptable au nom même des impératifs du développement agricole puisqu'elle risque de se traduire en fait par la marginalisation d'une catégorie, la plus vaste, de paysans insusceptibles de résister au choc de la libéralisation (comme producteurs mais aussi comme consommateurs).
Alors que même la Banque mondiale paraît considérer que l'exploitation de leurs avantages agricoles par les pays les plus en retard de développement est une voie incontournable pour ceux-ci, une libéralisation agricole massive entraînerait pour ces pays comme l'ont montré les travaux du Sénat précités une perte de bien-être et un obstacle supplémentaire sur la voie de leur développement.
b) Ne pas négliger les risques d'une spécialisation tournée vars la demande étrangère
La libéralisation du commerce agricole international est parfois présentée comme une opportunité permettant à des pays subissant des barrières à l'entrée des marchés des plus développés d'y accéder.
La logique est de déployer une production agricole tournée vers l'exportation pourvoyeuse de revenus.
Cette stratégie ne doit pas être récusée d'emblée. Mais il faut en apprécier les limites.
En premier lieu, il ne faut pas négliger que la spécialisation des pays en développement sur des productions agricoles destinées à l'exportation est vulnérable à des conditions que ces pays ne maîtrisent pas :
la demande adressée par l'extérieur ;
les conditions du marché des changes ;
des éléments déterminants de la compétitivité de leur système productif.
En ce qui concerne la demande adressée, qui doit être décomposée pour tenir compte des productions du pays exportateur, elle est la résultante des dynamiques de la demande mondiale corrigées par la part du pays dans les exportations mondiales76(*).
Les prospectives disponibles tablent sur une croissance de la demande agricole plus ou moins forte (selon notamment la dynamique des agro-carburants) mais qui serait globalement soutenue.
Il existe toutefois d'importantes incertitudes sur la dynamique de la demande internationale de produits agricoles. En effet, la demande s'exprimant sur le marché international pourrait varier sensiblement en fonction des stratégies mises en oeuvre selon que les pays poursuivraient ou non des objectifs d'auto-suffisance alimentaire.
Par ailleurs, même si de tels objectifs n'étaient pas posés pays par pays, ils pourraient l'être au niveau régional, selon certaines recommandations, ce qui affecterait les perspectives de développement des échanges mondiaux. De telles stratégies pourraient entraîner des phénomènes de « détournement de trafic » au terme desquels les échanges internationaux, pour se développer, se structureraient régionalement. Dans ces conditions, c'est la demande dans la zone de la localisation du pays producteur qu'il faudrait anticiper et de laquelle dépendraient les exportations du pays.
Cette perspective modifierait les termes du problème.
L'insertion dans l'échange international des pays en développement se fait sous l'épée de Damoclès du taux de change. Il est exceptionnel que la monnaie des agriculteurs des pays en développement soit utilisée dans les marchés internationaux que ce soit pour libeller les transactions ou pour en opérer le règlement. La compétitivité des exportateurs qui se trouvent dans cette situation de dépendance varie selon les évolutions monétaires concernant les monnaies utilisées dans les échanges internationaux.
En réalité, cette vulnérabilité monétaire dépasse la question de la compétitivité-prix sur les marchés mondiaux qu'influencent les variations du change.
La dépendance des productions agricoles des pays qui subissent une situation de domination monétaire s'exerce sur les marchés internationaux mais aussi en amont (au stade de la production) et elle mobilise non seulement la composante des conditions monétaires liée au change mais aussi le canal des taux d'intérêt dans la mesure où les effets des politiques monétaires des pays dominants se diffusent également aux pays en développement par ce canal.
Une note du Mouvement pour une organisation mondiale de l'agriculture (MOMAGRI) propose une quantification des effets entre 2004 et 2009 des évolutions de la parité entre l'euro et le dollar et des écarts de taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Federal Reserve Board (FED) des États-Unis sur la compétitivité relative des agricultures des deux côtés de l'Atlantique.
Elle vise à illustrer l'amplification des impacts des conditions monétaires (taux de change et taux d'intérêt) sur la compétitivité agricole dans un contexte « d'économie agricole d'endettement », de libéralisation progressive des échanges agricoles et de financiarisation des marchés agricoles.
Les résultats présentés par MOMAGRI chiffrent à 20,7 milliards de dollars l'avantage compétitif tiré en 2008 par l'agriculture des États-Unis (14,5 milliards en 2009) des conditions monétaires plus favorables dont elle a bénéficié. La partie principale de cet avantage compétitif est attribuée à la sous-évaluation du dollar (17,8 milliards de dollars en 2008, 14,1 en 2009).
|
Résumé de l'étude MOMAGRI1 La sous-évaluation du dollar par rapport à l'euro se traduirait par deux principaux effets. Elle contraint les importations agricoles européennes et elle stimule les exportations agricoles américaines. « Si l'offre des exportateurs est inélastique en volume, les producteurs américains réalisent un gain égal à leurs moindres coûts de production exprimés en dollar. Cela se traduit par une marge sur les ventes à l'exportation augmentée d'autant ». Cet enchaînement ne paraît pas entièrement crédible. La détérioration des termes de l'échange résultant de la dépréciation du dollar risque plutôt d'augmenter les coûts de production agricole aux États-Unis à travers la hausse des prix des consommations intermédiaires ou des investissements importés ou consommés localement par effet de substitution. C'est alors plutôt à une réduction des marges que l'on doit s'attendre sauf si les producteurs sont en mesure de répercuter l'augmentation de leurs coûts dans leurs prix de vente ce qui est douteux compte tenu de leur pouvoir de négociation. En revanche, le second enchaînement, exposé ci-dessous, est plus crédible : « Si l'offre des exportateurs est sensible aux prix, ils pourront augmenter leurs ventes en baissant leurs prix ce qui leur permet de réaliser un gain plus important ». Dans ce second cas, l'érosion du dollar entraîne un avantage compétitif qui accroît les exportations agricoles des États-Unis en volume. Si l'effet-volume l'emporte sur l'effet-prix (ce qui suppose que la production soit flexible) la croissance de la production efface la perte relative de pouvoir d'achat des revenus. L'essentiel est bien que la production agricole aux États-Unis reçoit un stimulant susceptible de l'accroître et de permettre au pays de réaliser des gains de parts de marché, ses concurrents subissent inversement des pertes. Elle (la sous-évaluation du dollar par rapport à l'euro) ampute le pouvoir d'achat des consommateurs américains pour acheter des produits agricoles européens importés ce qui confère un avantage de prix relatifs aux biens produits localement. Le calcul de la sous-évaluation du dollar est réalisé dans l'étude à partir de l'écart entre le taux de change effectif euro-dollar et celui qui serait conforme à la parité des pouvoirs d'achat (PPA)2. Il est présenté ci-après avec les variations des exportations et des importations agricoles des États-Unis. La sous-évaluation du dollar par rapport à l'euro, de 6,5 % en 2004 passe à 16,7 % en 2008. Les exportations agricoles des États-Unis croissent de 87,8 % contre 49,3 % pour les importations. Ce différentiel qui peut s'expliquer par un écart de croissance entre la demande domestique et la demande adressée aurait également été sensible à la dégradation des termes de l'échange des États-Unis. C'est sur cette base que MOMAGRI chiffre les effets de la différence entre le taux de change effectif entre l'euro et le dollar et le taux de change en PPA en retenant un scénario dit « médian » parmi les trois scénarios envisagés : - Scénario 1 (estimation basse) : La sous-évaluation du dollar se traduit par une augmentation proportionnelle des exportations, et la hausse de prix sur les biens importés se traduit par des transferts à 50 % sur la production nationale ; - Scénario 2 (estimation haute) : La sous-évaluation du dollar se traduit par des transferts proportionnels des importations vers l'achat de la production nationale, et plus que proportionnels pour les exportateurs qui parviennent à accroître leurs parts de marché de 50 % ; - Scénario 3 (estimation médiane) : La sous-évaluation du dollar se traduit par une augmentation proportionnelle des exportations et par des transferts proportionnels des importations vers l'achat de la production nationale. Les estimations de l'avantage commercial retiré par l'agriculture des États-Unis dans les trois scénarios s'étagent entre 11,2 milliards de dollars pour le premier scénario et 18,4 milliards pour le troisième en passant par 14,4 milliards de dollars pour le scénario médian. Faute de connaître l'ensemble des hypothèses posées dans la modélisation et compte tenu des réserves que peut susciter la méthode d'estimation de la sous-évaluation du dollar, surtout quand on l'applique à un secteur (aussi) particulier (que l'agriculture), l'exercice a le mérite d'illustrer par un ordre de grandeur les effets d'une dépréciation du dollar sur le commerce agricole extérieur des États-Unis et, par conséquent, sur les recettes d'exportation de leurs concurrents. C'est également ainsi qu'il faut considérer les conclusions de l'étude sur les effets des politiques monétaires comparées aux États-Unis et en Europe. MOMAGRI estime qu'à l'exception de 2006 le caractère plus accommodant de la politique monétaire aux États-Unis a offert aux agriculteurs locaux un avantage comparatif. La méthode suivie consiste à appliquer l'écart de taux directeurs entre celui de la FED et celui de la BCE à l'endettement des exploitants agricoles des États-Unis auprès des banques. Les résultats, exprimés en termes de « soutiens additionnels » sont figurés dans la partie droite du graphique ci-dessous. Selon MOMAGRI la politique monétaire avantageuse pratiquée par les États-Unis par rapport à l'UE s'est traduite par un avantage compétitif estimé à 106 millions de dollars au titre de l'année 2009 pour l'agriculture américaine, après 2,9 milliards de dollars en 2008. 1 Assorti de quelques observations. 2 La parité des pouvoirs d'achat mesure les rapports des prix domestiques de deux espaces économiques et monétaires différents pour déterminer quel serait le taux de change d'équilibre entre leurs deux monnaies, celui-ci étant conçu comme la parité permettant d'égaliser les prix des deux pays. |
Outre que les pays en développement qui choisissent des stratégies d'exportation ne maîtrisent pas ipso facto des éléments déterminants de la compétitivité de leur système productif et ainsi de l'efficacité de cette stratégie, il faut mesurer que les revenus ainsi générés peuvent ne pas contribuer à résoudre le problème alimentaire.
Le commerce international peut même aggraver ce problème par plusieurs de ses effets :
en substituant des cultures d'exportation à des cultures vivrières accessibles à la demande domestique solvable ;
en renforçant les inégalités entre les producteurs présents sur le marché intérieur de sorte que les petits exploitants perdent de leur capacité à écouler leur production ;
en concentrant des revenus agricoles dont l'augmentation peut se révéler sans bénéfice pour le développement agricole local.
Ces effets non-désirables peuvent être régulés mais il faut pour cela mettre en oeuvre des politiques d'accompagnement de la libéralisation qui vont à rebours des tendances profondes auxquelles celle-ci correspond (politique de redistribution du revenu, constitution des stocks de sécurité...).
C. QUELQUES CONCLUSIONS AUTOUR DE CERTAINES CERTITUDES DANS UN CONTEXTE D'INCERTITUDES
Selon le département économique et social de la FAO, une libéralisation plus poussée profiterait surtout aux pays développés
« Selon la plupart des études, une libéralisation complète des échanges agricoles pourrait aboutir globalement à d'importants gains socioéconomiques, mais certains groupes y gagneraient et d'autres y perdraient. Les avantages iraient surtout aux consommateurs et aux contribuables des pays industrialisés où l'agriculture est particulièrement protégée, ainsi qu'aux exportateurs agricoles des pays en développement. Les consommateurs urbains et les paysans sans terre des pays en développement, par contre, risqueraient de devoir payer plus pour certains vivres, notamment les céréales, le lait, la viande et le sucre. Il faudrait donc prendre des mesures spéciales pour venir en aide à ces groupes perdants. »
1. La libéralisation du commerce agricole international peut compliquer l'équation alimentaire pour les pays en développement
Les subventions aux exportations favorisent la position de marché de ceux qui en bénéficient. Elles créent une distorsion de concurrence au détriment des producteurs des pays importateurs. Mais, en fonction de l'absorption des subventions par des intermédiaires, elle crée une rente pour le consommateur final qui, en théorie, bénéficie de prix moins élevés qu'en leur absence. Le coût des subventions est acquitté par les contribuables du pays exportateur. La suppression des subventions à l'exportation profite à ces contribuables et, normalement, aux producteurs locaux. Le consommateur du pays importateur n'a pas de bénéfice à en attendre sauf si les marges sur les produits alimentaires réalisées à partir de productions locales sont inférieures aux marges réalisées à partir des produits importés. Par ailleurs, il faut tenir compte de la suppression éventuelle, ou du moins de l'atténuation, de la protection tarifaire destinée à contrer les subventions des exportateurs. Dans cette hypothèse, ce sont les recettes douanières des pays importateurs qui sont affectées.
Le bilan a priori de la baisse des subventions à l'exportation est ainsi plus mitigé qu'on ne l'indique souvent.
Toutefois, les enchaînements décrits sont des enchaînements à court terme.
Dans une perspective dynamique, la substitution de la production des pays importateurs à celle des pays exportateurs que doit provoquer la suppression des subventions à l'exportation, sous réserve qu'il existe des capacités de production dans les pays importateurs, peut entretenir un cercle vertueux où ces capacités sont progressivement mieux exploitées. Les gains pour les producteurs locaux peuvent alors se doubler de gains pour les consommateurs des pays importateurs, voire pour ceux des pays exportateurs. Mais cet effet est suspendu à la démonstration que peut se mettre en place une structure de la production agricole mondiale plus efficiente.
C'est une partie de l'intérêt des travaux de prospective que de pouvoir apprécier si des mécanismes abstraits ont une chance de trouver des prolongements concrets.
Sur ce point, il existe beaucoup d'incertitudes mais aussi quelques acquis.
Les incertitudes sont si nombreuses qu'elles échappent au recensement. Plutôt donc que de les évaluer une à une, on peut retenir le sentiment qui imprègne le présent rapport ainsi que les autres études prospectives selon lequel la montée des risques auxquels est confronté le système alimentaire mondial, et qui sont distribués très inégalement dans le monde, doit être pleinement prise en compte. À cet égard, si le développement agricole des pays les plus en retard de développement est un impératif, celui-ci doit être vu de façon réaliste c'est-à-dire en pesant les limites de ce développement mais aussi le contexte d'élévation du niveau des risques qui peuvent en remettre en cause la logique formelle. Si les obstacles du développement agricole sont assez bien recensés ainsi que les solutions théoriques pour les surmonter (encore qu'à ces stades déjà il existe de nombreuses inconnues) les risques, notamment le risque climatique mais aussi les risques humains, qui pourraient se concrétiser relèvent davantage de l'incertain.
Une chose paraît certaine c'est que toutes les régions du monde ne sont pas à égalité devant ces limites et ces risques. Le développement agricole mondial doit tenir compte de ce fait. Cela suppose de dépasser l'idée que la restauration du libre fonctionnement des marchés, notamment par la suppression des subventions à l'exportation, aboutira à une agriculture mondiale plus satisfaisante puisqu'aussi bien les marchés paraissent très inégalement capables d'anticiper les risques.
Parmi les certitudes, il faut d'abord mentionner l'existence de limites physiques, indépendantes des limites engendrées par les distorsions de marché, à l'expansion de la production agricole, limites qui sont géographiquement plus ou moins étroites.
Contrairement à d'autres produits, la production agricole est tributaire de contraintes naturelles que les actifs produits peuvent desserrer mais sans les éliminer. Les travaux de prospective envisagés dans le présent rapport montrent que même si les conditions de maximisation des potentiels agricoles locaux étaient réunies, certains territoires, avec les techniques raisonnablement prévisibles, resteraient insusceptibles d'élever leur production, même s'il s'agissait simplement de nourrir leur population.
La redistribution de la production agricole ne bute pas sur les seules restrictions au libre échange (ou sur des obstacles socio-économiques).
Ainsi, il ne faut pas attendre du marché qu'il opère en soi une redistribution complète de la géographie agricole mondiale.
2. Les effets de la libéralisation seraient asymétriques
La simulation de la baisse des droits de douane telle qu'envisagée dans les négociations de Doha illustre l'asymétricité de ces effets. Lorsqu'un pays abaisse ses droits de douane le prix domestique diminue théoriquement (avec des effets sur les prix de consommation qui varient selon la captation de la réduction du prix de gros par les marges intermédiaires, situation généralement ignorée par les modèles utilisés pour estimer les effets d'une telle mesure mais qui, compte tenu des circuits du commerce agro-alimentaire doit être considérée comme une perspective crédible). Le prix étant plus faible, la production intérieure diminue tandis que la demande de produits importés augmente ce qui, à production donnée, fait monter les prix sur le marché mondial.
Les effets du désarmement douanier sur les pays passent donc par la modification des prix relatifs et par l'augmentation attendue du niveau des prix agricoles.
Au total, les protections douanières auraient un coût pour le bien-être des pays en développement77(*) estimé par le CEPII à 5 milliards de dollars ce qui représente une évaluation des gains de la libéralisation de 0,08 %. Ces estimations sont très inférieures à d'autres issues des grands organismes multilatéraux comme la Banque mondiale.
Les effets d'un désarmement douanier sont faibles au niveau agrégé mais sont très différenciés selon les pays.
Le Brésil bénéficierait de la moitié des gains suivi par l'Ukraine et plusieurs pays d'Amérique du sud (relevant du Mercosur). Mais, un tiers des 26 pays de l'échantillon perdraient au désarmement douanier. Il s'agit des des pays importateurs nets qui ne parviendraient pas à redresser suffisamment leurs positions commerciales.
Par ailleurs, si les gains de bien être sont globalement mitigés, ils résultent d'impacts de sens contraires, les uns favorables, concernant les exploitations agricoles, les autres, défavorables, les consommateurs.
Pour les agriculteurs des pays en développement, les exportations vers l'Europe et les États-Unis augmenteraient de 50 % ce qui est considérable (+ 49 milliards de dollars). Le Brésil bénéficierait d'environ du tiers de ce supplément d'exportation (les exportations du Brésil doubleraient). Globalement, les revenus des agriculteurs des pays en développement augmenteraient sous l'effet du surplus de volume et de la hausse des prix sur le marché mondial. Toutefois, l'augmentation de revenu serait différenciée : plus forte dans les pays à revenu intermédiaire (autour de 3 % en moyenne) que dans les pays à revenu faible (Inde, Vietnam...) avec seulement + 1 %. Mais les consommateurs de ces pays doivent supporter des prix plus élevés.
En Europe et aux États-Unis, la libéralisation douanière se traduirait par une amplification des importations mais qui serait concentrée sur quelques produits.
Les produits en cause (une trentaine) sont des produits qui font l'objet de protections tarifaires élevées et huit d'entre eux concentreraient plus de la moitié de la hausse des volumes importés.
Les produits les plus concernés seraient la viande, le sucre et les produits laitiers. C'est pour ces produits que la structure de la production mondiale serait modifiée avec des substitutions de revenu agricole entre l'Europe et les États-Unis (à leur détriment) et quelques pays émergents (le Brésil et plus globalement, ceux du groupe de Cairns). La plupart des agriculteurs du reste du monde ne bénéficieraient pas de cet assouplissement douanier et même beaucoup d'entre eux en pâtiraient. Ceux-là pourraient subir une double peine leur revenu faiblissant quand les prix agricoles mondiaux augmenteraient. Il est vrai que les produits concernés sont assez peu consommés par les pauvres du monde. Du côté de l'Europe et des États-Unis, les consommateurs profiteraient d'une baisse des prix puisque, pour eux, la baisse des droits de douane exercerait des effets supérieurs à la hausse des prix mondiaux. Mais ce bénéficie monétaire n'est probablement pas le seul effet dont il faille tenir compte pour évaluer les incidences de la libéralisation du commerce agricole international sur les consommateurs des pays développés.
À ce titre, les problèmes auxquels est confronté le système alimentaire mondial et que pourraient aggraver les échanges internationaux supplémentaires doivent être pesés dans l'évaluation de leurs effets sur les populations du Nord.
3. La libéralisation du commerce agricole pose de redoutables problèmes de transition
La libéralisation des échanges passe par l'élimination des dispositifs susceptibles de favoriser certains producteurs nationaux au détriment d''autres. Considérées structurellement, ses conséquences sont neutres sur la production, les producteurs désavantagés par les distorsions prenant le relais de ceux qu'elles avantageaient. Dans les faits, compte tenu du temps, elles seraient sans doute bien différentes. La suppression des incitations à la production risque d'avoir des effets immédiats sur le niveau de la production, qui baisserait, tandis que les producteurs dont le désavantage serait supprimé pourraient ne pas être en mesure de combler le déficit de production induit. Dans un tel contexte, la production mondiale diminuerait ce qui créerait des tensions sur les prix et peut aboutir à un choc de demande en retour si la demande solvable devait se réduire.
Autrement dit, la libéralisation des échanges agricoles appelle un accompagnement que les organisations multilatérales où elle est un credo ne peuvent garantir.
* *
*
L'instauration d'échanges internationaux totalement dérégulés compliquerait la résolution de l'équation alimentaire.
Ce constat peut être posé même quand on raisonne dans les termes ultra-simplificateurs des modèles économiques construits à partir des termes abstraits de l'économie la plus classique.
L'adoption d'hypothèses plus proches de la réalité comprenant des acteurs de force très inégale et la considération des défaillances du marché changent encore plus l'appréciation des effets de la libéralisation.
Celle-ci n'en doit pas pour autant être systématiquement récusée. Mais, elle ne doit pas être l'a priori qu'elle est trop souvent. Il faut l'évaluer plutôt qu'évaluer le monde à partir d'elle.
Le renforcement des interdépendances alimentaires est inscrit dans les forces qui structureront la géo-alimentation de demain. Il faut en tenir compte. Mais, poser qu'il est un bien en soi relève d'un dogmatisme dangereux. À cet égard, il est heureux que l'OMC ait pu reconnaître l'exigence d'appliquer un traitement spécial et différencié aux pays en développement. Mais, la question est bien de savoir si ce n'est pas plus globalement l'agriculture qui devrait relever d'une telle démarche plutôt que d'en faire une exception à un principe de libéralisation consacré, à tort aux yeux de votre rapporteur, comme la pierre angulaire du développement agricole.
Les questions abordées ci-après sur les positions des acteurs et sur les contradictions des paradigmes du développement agricole ajoutent au scepticisme qu'inspire une approche reposant avant tout sur la dérégulation des échanges.
III. QUELLE PLACE POUR LES HOMMES ?
Le secteur agroalimentaire fait intervenir plusieurs catégories d'acteurs parmi lesquels les producteurs (dont les situations sont extraordinairement contrastées) apparaissent comme particulièrement vulnérables à l'instar de l'autre catégorie placée en bout de chaînes, celle des consommateurs.
La dimension démographique est une composante du défi alimentaire pour ses effets sur la demande mais aussi une opportunité en raison des capacités de production qu'elle recèle.
On a indiqué que le développement agricole pouvait être pensé selon les modalités différentes de combinaison du travail et du capital impliquant des degrés inégaux de substitution entre l'un et l'autre facteur.
Mais une agriculture plus intensive en capital, si elle apparaît souhaitable (sous certaines réserves), ne signifie pas pour autant que les hommes, plus d'hommes, ne seront pas nécessaires pour produire la nourriture qu'il faudra. Il faut accorder du crédit aux versions qui accordent un rôle majeur aux hommes dans la résolution du défi alimentaire.
Mais, pour qu'ils exercent ce rôle, il faut créer les conditions d'un juste retour de développement agro-alimentaire au bénéficie des masses paysannes, conditions qui ne sont aujourd'hui pas réunies et pourraient, demain, être encore plus éloignées de l'être.
A. LA PLUPART DES PAYSANS SONT PAUVRES
La population occupée par l'agriculture représente 1,125 milliard78(*) d'individus (43 % de la population active mondiale) dont 450 millions sont des salariés agricoles, la grande majorité du reste regroupant de petits exploitants agricoles.
Selon d'autres données, pour 1,34 milliards d'actifs agricoles, il n'y aurait dans le monde que 28 millions de tracteurs (2 % du nombre des actifs agricoles) et 250 millions d'animaux de travail (19 % du nombre des actifs agricoles).
Ainsi 80 % des agriculteurs n'ont pour seul outillage que des outils à main, la Révolution verte ne les ayant pas touché sous cet angle.
De même, 500 millions d'agriculteurs n'auraient pas accès aux intrants de la Révolution verte : semences sélectionnées, engrais, pesticides.
Les écarts de productivité du travail dans le secteur agricole se sont élargis dans le cours du XXe siècle. De 1 contre 10 au début du siècle, l'écart entre les plus performants et les moins performants serait aujourd'hui de 1 à 1 000 avec une forte concentration au bas de l'échelle.
C'est parmi cette population qu'on trouve le plus de malnutris et de personnes souffrant de la faim.
Cette situation paradoxale pose un problème (grave) en soi et représente, en outre, un obstacle pour le développement de la production agricole. En même temps, elle peut être vue comme un indice des conditions futures du secteur ; si les emplois agricoles condamnent à la pauvreté, l'avenir appartiendra à une agriculture sans emplois, devant passer par des conditions de développement particuliers.
À cet égard, le rapport du rapporteur spécial de l'Assemblée générale des Nations-Unies sur le droit à l'alimentation, M. Olivier De Schutter, dessine un panorama préoccupant quant à la capacité d'une large fraction de la population active agricole à retirer de son activité un revenu minimal.
Par ailleurs, le rapport conduit à s'interroger sur les effets, qu'on estime généralement bénéfiques, d'un meilleur accès de ces agriculteurs aux marchés. Il met en évidence l'impact négatif des processus de renforcement de la domination de certains acteurs de la chaîne agro-alimentaire sur la situation des producteurs.
Ces constats rejoignent ceux posés ailleurs dans le présent rapport. On doit leur ajouter des interrogations sur les liens qui peuvent exister entre eux et la position, dominée, des agriculteurs dans les systèmes politico-sociaux où les agriculteurs sont les oubliés du développement.
Il faudrait commencer par la situation des femmes. Un très grand nombre de femmes dans le monde concourent à la production agricole. Leurs statuts sont souvent ceux d'êtres humains sans droits (il en va de même pour les enfants), sinon celui de travailler pour des rémunérations fréquemment en-deçà du minimum décent, donc vital (pour elles et plus encore pour les enfants qu'elles peuvent porter).
Mais cet état est partagé par de nombreux paysans hommes.
S'agissant des salariés du secteur agricole, à l'échelle mondiale, moins de 20 % d'entre eux disposent d'une protection sociale de base alors que 70 % des enfants, entre 5 et 14 ans travaillant dans le monde sont employés dans le secteur agricole (soit 132 millions d'enfants). Beaucoup de ces salariés ne bénéficient pas concrètement de la garantie d'un « salaire minimum vital » pourtant prévu par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Cet état de relégation ne saurait être compatible avec un développement agricole équilibré.
Il traduit un faible pouvoir de négociation des personnes qui le subissent.
Or, ce pouvoir de négociation (des petits exploitants ou des journaliers agricoles) pourrait encore s'affaiblir dans le futur.
L'émergence d'acteurs dominant le système agro-alimentaire - que ce soit par l'intégration verticale, des semences à la gondole de supermarché, ou par la concentration horizontale - pourrait y contribuer presqu'aussi bien un système agro-alimentaire dominé par quelques grandes firmes ne paraît pas être une hypothèse d'école.
B. LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS LA FILIÈRE AGRO-ALIMENTAIRE EST GLOBALEMENT DÉFAVORABLE AUX PRODUCTEURS DE BASE
La problématique au partage de la valeur ajoutée dans les filière agro-alimentaire illustre un des aspects de ces processus de domination qui mettent en péril la situation économique de nombre d'exploitants agricoles et au-delà même, la dynamique entière de la production agricole. Cette question est sans doute particulièrement sensible pour les agriculteurs des pays en développement. Mais, elle ne leur est pas réservée comme en témoignent les débats ayant cours en France à ce sujet.
Hormis les agriculteurs eux-mêmes, la filière agro-alimentaire réunit, en dehors des producteurs d'intrants nécessaires à la production, trois grandes catégories d'acteurs : les fournisseurs (les industriels de l'agro-alimentaire notamment), les distributeurs et les consommateurs.
Sauf le cas, plutôt rare, où le consommateur accède directement au fournisseur, le schéma de la filière suit la séquence suivante : la production des fournisseurs est vendue aux distributeurs qui vendent leurs services aux consommateurs.
Les deux premiers intervenants ont une activité de production d'où découle une valeur ajoutée. Le consommateur, avec ses achats, bénéficie quant à lui d'un surplus (ou fait bénéficier d'un surplus l'amont de la filière) selon que les prix qu'il paye évolue en-deçà (ou au-delà) du prix de production des fournisseurs de sorte que leur recette unitaire baisse ou monte.
En raisonnant dans le cadre usuel de maximisation des profits, l'objectif de chacun des maillons de la production (fournisseurs et distributeurs) est de maximiser son taux de marge, c'est-à-dire le rapport entre son excédent brut d'exploitation à sa valeur ajoutée.
Moyennant de nombreuses simplifications, cela suppose :
- pour le fournisseur, qu'il écoule ses produits en maximisant la quantité et le prix tout en minimisant ses coûts d'exploitation79(*) ;
- pour le distributeur, le même jeu.
Quant au consommateur, il gagne à ce que les taux de marge agrégés des producteurs (fournisseurs et distributeurs) soient les plus bas possibles (sous la réserve bien sûr que ces niveaux ne découragent pas la production pour ne pas subir de pénuries).
Si l'on tient compte du cadre théorique d'analyse des marchés, c'est le distributeur qui est en meilleure position.
En effet, dans la filière agro-alimentaire, les fournisseurs et les consommateurs sont atomisés (en dépit du processus de concentration des fournisseurs) alors que les distributeurs sont concentrés. Cette configuration confie à ceux-ci un pouvoir de négociation supérieur.
L'acteur qui est le moins économiquement dépendant, c'est-à-dire qui un « profit de réserve » (celui qu'il peut réaliser si un accord n'est pas trouvé) plus élevé, dispose à l'issue de la négociation d'une part du profit supérieure.
Face aux fournisseurs, les distributeurs sont en situation d'oligopsone (quelques acheteurs face à une multiplicité de vendeurs). Face aux consommateurs, ils sont proches d'une situation d'oligopole (quelques vendeurs face à une multiplicité d'acheteurs).
Ces situations sont renforcées par la constitution par les distributeurs de centrales d'achats qui augmentent globalement leur pouvoir de négociation.
De fait, la distribution est très fortement concentrée. Les six plus grands groupements d'enseignes détiennent, en 2007, 72 % de parts de marché parmi les grandes surfaces alimentaires.
Les effets de cette concentration sont démultipliés par le processus de différenciation de la distribution qui renforce le rôle des distributeurs sur chaque segment du marché :
- pour certains produits, il existe encore moins de diversité dans les circuits de distribution que celle observée en moyenne ;
- certaines techniques de fidélisation renforcent la dépendance du fournisseur envers un distributeur donné ;
- les « marques de distributeurs » augmentent leur « profit de réserve » face aux alternatives offertes par les marques nationales.
- dans certaines aires géographiques, le nombre des grands distributeurs est réduit par rapport à une situation normalement concurrentielle...
Des différentes données disponibles, il semble suivre que, si les industriels de l'agroalimentaire parviennent à dégager une rentabilité supérieure à ce qu'elle serait dans un contexte de concurrence pure et parfaite, c'est encore plus vrai pour les grands distributeurs.
Du côté de la rentabilité, les grands distributeurs semblent dégager des résultats supérieurs à ceux des producteurs agroalimentaires surtout quand ceux-ci sont de petite dimension.
De plus, pour les six grands distributeurs (qui réunissent 72 % des parts de marché des produits alimentaires), on relève une augmentation de leur rentabilité depuis le milieu des années 90, observation qui appelle pourtant quelques nuances.
Une étude de Natixis montre que la rentabilité opérationnelle (ratio du résultat d'exploitation sur le chiffre d'affaires) de ces grands groupes, a fortement augmenté dans la deuxième moitié des années 1990. Le taux moyen de rentabilité d'Auchan, Carrefour et Casino est passé de 2,7 % en 1996 à 5,4 % en 2004. Toutefois, une phase de baisse, considérée comme résultant des changements réglementaires subis par le secteur, est intervenue à partir de 2004. Mais, au total, entre 1996 et 2006, la rentabilité est en hausse (+ 1 point de marge pour Auchan ; +1,3 point pour Carrefour ; + 2,5 points pour Casino)80(*).
La distribution française, entre 1996 et 2004, a quasiment rattrapé les niveaux de ses grands concurrents internationaux (Wal-Mart, Target, Kroger et Tesco), avant de s'en éloigner entre 2004 et 2006.
Marge de rentabilité opérationnelle
comparée
des principaux distributeurs français et
anglo-saxons
Source : DGTPE. Trésor-Eco n° 53. Mars 2009
La hausse de la rentabilité des distributeurs s'est traduite par une forte hausse des cours de bourse des grandes entreprises cotées, avec un pic au tournant des années 2000 suivie d'une stabilisation jusqu'au déclenchement de la crise économique et financière.
Capitalisation boursière de deux
distributeurs
et trois industriels des IAA
Source : DGTPE. Trésor-Eco n° 53. Mars 2009
Les capitalisations boursières des trois grands fournisseurs ont été moins dynamiques excepté pour Pernod-Ricard, seul groupe à avoir connu une performance boursière comparable à celle des grands distributeurs.
Ces données ne sont pas entièrement significatives puisque les variations retracées ont été influencées par des opérations de réorganisation des entreprises.
En particulier, certains pics de capitalisation correspondent à des fusions : le pic de la capitalisation boursière de Carrefour en 2000 coïncide avec la fusion avec Promodès, le pic de la capitalisation boursière de Pernod-Ricard en 2005 coïncide avec le rachat d'Allied Domecq.
D'ailleurs, d'après l'étude de Natixis déjà citée, entre 1996 et 2006, la rentabilité opérationnelle des principaux industriels de l'agro-alimentaire a davantage augmenté que celle des distributeurs : + 6 points pour Danone, + 11,8 points pour Pernod-Ricard. En outre, les industriels n'ont pas connu la baisse de rentabilité ressentie entre 2004 et 2006 par les grands distributeurs.
L'évaluation boursière des principaux groupes n'a cependant pas complètement suivi. Sur la période 1991-2009, la capitalisation de Danone a augmenté à peine plus vite que le SBF 120, tandis que Bongrain connaissait une performance inférieure à cet indice. De leur côté, les grands groupes de distribution ont enregistré alors une performance boursière bien supérieure, sous les réserves mentionnées plus haut.
Il est plus parlant, et légitime, de se référer à des données plus spécifiques, celles issues de l'enquête « entreprise » de l'INSEE sur le secteur des industries agro-alimentaires (IAA), qui suit l'évolution du taux de marge (rapport de l'excédent brut à la valeur ajoutée) des entreprises du secteur.
Les entreprises y sont réparties en trois groupes : les micro-entreprises (de 0 à 9 salariés), les moyennes entreprises (de 10 à 249 salariés) et les grandes entreprises (au-delà).
Ratio EBE/VA dans les IAA (indice 100 en 1996)
Source : DGTPE. Trésor-Eco n° 53. Mars 2009
La situation des entreprises agro-alimentaires s'est globalement dégradée en dix ans mais surtout pour les micro-entreprises et les PME.
Les micro-entreprises ont connu une lente dégradation de 1996 à 2000, puis une dégradation plus marquée de 2001 à 2005. Les entreprises de plus de 250 salariés ont connu une évolution plus contrastée : période 1996-2000 stable ou en faible croissance, puis dégradation plus rapide que les PME pour 2001-2005.
Seules les évolutions sont ici fournies au motif que les valeurs absolues peuvent être trompeuses. Les taux de marge diffèrent pour de multiples raisons dont certaines sont purement conventionnelles, tandis que d'autres résultent du niveau du capital engagé : une entreprise qui suppose la réunion de plus de capital pour son exploitation doit normalement disposer d'un taux de marge plus élevé pour espérer rémunérer son capital de la même manière qu'une entreprise plus économe sous cet angle.
La comparaison des « markup » permet dans une certaine mesure de surmonter cette difficulté.
Le « markup », ou marge économique, est une mesure de l'intensité concurrentielle d'un secteur : plus le secteur est concurrentiel, plus le « markup » se rapproche de 1. Le « markup » correspond au ratio entre le prix de vente et le coût marginal de production : un « markup » de 1,2 signifie que l'entreprise fixe ses prix à 1,2 fois le coût marginal. Le « markup » intègre donc déjà la rémunération « normale » du capital, ce qui le distingue du taux de marge comptable défini par le rapport EBE/VA. Un « markup » élevé indique des profits « anormalement » élevés, tandis qu'un taux de marge (EBE/VA) élevé peut simplement refléter une forte intensité capitalistique du secteur.
« Markup » du
commerce et de l'industrie agro-alimentaire
dans 13 pays
(1993-2004)
Source : DGTPE. Trésor-Eco n° 53. Mars 2009
Au total, le secteur de la distribution présente, en France, une profitabilité nettement supérieure à celle constatée dans la plupart des autres pays développés. Les principales exceptions sont le Royaume-Uni (où la distribution est très concentrée) et les Pays-Bas (la situation ayant changé dans ce pays depuis le milieu des années 2000).
Cette différence s'expliquerait notamment par le cadre réglementaire français (absence de négociabilité tarifaire, restrictions fortes à l'urbanisme commercial), qui a longtemps limité la concurrence dans le secteur, mais d'autres facteurs peuvent, bien entendu, intervenir dans ces résultats.
En revanche, le secteur des IAA a une rentabilité proche de la moyenne des pays développés, malgré des situations différentes (les petites entreprises françaises n'ayant ni pouvoir de marché, ni possibilité de jouer sur la différenciation pour résister au fort pouvoir de marché d'une distribution concentrée).
Il reste que la rentabilité de ces deux secteurs apparaît très sensiblement supérieure à celle qui résulterait d'un équilibre de concurrence pure et parfaite (markup de 1), c'est-à-dire qu'il semble possible de baisser les prix. Bien sûr, la répartition de la valeur ajoutée dans la filière est différente selon le produit considéré et la période prise en compte.
Les données ici rassemblées ne portent que sur les IAA et les prix de la distribution.
*
* *
Elles invitent à conclure que, si les IAA pratiquent des prix excédant les profits normaux, c'est encore plus le cas des distributeurs. Autrement dit, il existe dans la filière un « sur-profit » global qui est plus particulièrement le fait des distributeurs mais auquel les industries agro-alimentaires ne sont pas étrangères.
Ce constat signifie que, compte tenu des coûts de production des uns et des autres, les prix devraient être inférieurs si la concurrence entre fournisseurs et distributeurs (et au sein de chaque groupe d'acteurs) fonctionnait mieux.
Même s'il suggère cette conclusion, il n'équivaut pas à établir que les producteurs de matières premières de base sont les victimes de cette situation. Pour s'en assurer, il faudrait examiner les « markup » des producteurs agricoles, entreprise extrêmement difficile compte tenu du rôle singulier des prix dans ce secteur de production.
Il faut, en outre, rappeler que si les prix de production des IAA et les prix à la consommation dépendent des coûts des matières premières agricoles, ils subissent aussi l'influence d'autres facteurs, en particulier les autres coûts des industriels (salaires, prix d'autres consommations intermédiaires comme l'énergie), les prestations de service et les comportements de marge des différents intermédiaires.
La part des produits agricoles de base dans les consommations intermédiaires des IAA est, par ailleurs, très variable d'une filière à l'autre, entraînant des transmissions différentes d'une hausse des prix des matières premières. Par exemple, en 2004, la part des produits agricoles dans les consommations intermédiaires est nettement plus élevée dans l'industrie des viandes (60 %) que dans l'industrie du lait (41 %) ou des céréales (33 %).
Toutefois, les constats effectués pour la France semblent pouvoir conduire à conforter le soupçon d'un fort rôle prescripteur des distributeurs et (plus faiblement) des industriels qui, selon toute vraisemblance, constituent deux phénomènes encore plus marqués quand on considère leurs effets sur les exploitants du monde en développement, dépourvus des protections dont bénéficient les agriculteurs européens.
Dans ces conditions, la montée en puissance des agricultures du Sud pourrait ne pas se traduire par les gains de revenus correspondants si bien que, globalement, au niveau mondial la croissance de la valeur ajoutée agricole pourrait s'accompagner d'une élévation des surprofits des acteurs de l'aval plutôt que par des gains de revenus, pourtant indispensables pour sortir les petits paysans de la pauvreté et, ainsi, de la faim.
Cette perspective préoccupante doit être doublée de celle associée à un renforcement de la domination des fournisseurs d'intrants dont le rôle devrait se renforcer à mesure de la modernisation agricole des pays en retard de développement.
« L'effet d'enclume » que subiraient alors les agriculteurs se renforcerait sur fond de précarisation, paradoxale dans une activité en développement, mais qui est un horizon crédible.
C. LES AGRICULTEURS DU MONDE CONNAISSENT DES SITUATIONS TRÈS DIFFÉRENCIÉES QUI POURRAIENT S'ACCENTUER
Les écarts de « productivité agricole » sont considérables et ont augmenté avec l'adoption par certains pays de la « Révolution verte ».
Un paysan du tiers monde produit entre dix et vingt quintaux de céréales par hectare quand les paysans européens en produisent environ quatre vingt. Les productivités céréalières varient dans une fourchette de 1 à 8 avec des écarts qui peuvent être beaucoup plus élevés81(*).
Les coûts de production varient eux aussi mais moins fortement. Ils s'étagent entre 18 et 36 dollars par quintal dans le tiers monde, atteignant 8 $ en Argentine et en Australie et de l'ordre de 15 $ en Europe contre 12 $ au Canada.
Ces écarts peuvent être beaucoup plus importants encore pour d'autres productions agricoles, comme le lait par exemple.
Il existe des centaines de milliers d'agriculteurs dans les pays en développement qui produisent moins d'une tonne de céréales par an. Avec un prix de cent euros la tonne, leur revenu est misérable et doit aussi supporter les charges d'exploitation.
Quant aux salariés agricoles, ils sont innombrables à ne percevoir que moins de deux euros par jour.
En outre, les producteurs agricoles peuvent bénéficier de soutiens qui desserrent leur contrainte de revenu. Ces soutiens sont nombreux et très disparates. Mais ils favorisent généralement une politique de prix concurrentielle en déliant en partie le revenu des agriculteurs des prix de vente de leur production.
Globalement, les soutiens publics sont plus développés dans les pays où l'agriculture est déjà le plus efficace.
Dans un tel environnement, le marché fonctionne au détriment des producteurs des pays les moins développés dont la solidité est pourtant cruciale pour répondre au défi alimentaire.
L'hypothèse d'une amplification de ces écarts est la plus tendancielle. Elle provoquait une précarisation plus forte des paysans les plus en retard.
IV. QUEL PARADIGME ?
On a exposé les oppositions de vues concernant les paradigmes techniques (terres contre rendements ; biotechnologies contre Révolution doublement verte...) ainsi que, sur le terrain économique de la libéralisation du commerce agricole international. Longtemps, c'est le consensus de Washington qui s'est imposé comme la norme des réflexions et des actions portant sur le développement agricole. Depuis la seconde moitié des années 2000, une évolution est en cours mais les grandes organisations en charge du développement agricole n'ont pas encore dégagé un cadre d'actions alternatif réellement cohérent.
C'est ce dont témoignent, tout à tour, deux documents représentatifs des conceptions dominantes du développement agricole dont on propose l'analyse.
A. UNE INITIATIVE POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE : L'EXEMPLE DE LA « DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE DANS LE NOUVEAU PARTENARIAT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE (NEPAD) »
Le NEPAD a adopté le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA) destiné à surmonter la crise structurelle de l'agriculture africaine. Ce programme a bénéficié au stade de sa conception du soutien de l'expertise de la FAO dont les traits saillants sont exposés ci-après.
Le Programme est fondé sur un principe de stimulation des avantages concurrentiels du secteur.
Il repose sur l'identification des productions agricoles bénéficiant d'un avantage concurrentiel pour les développer et les commercialiser. Il s'inscrit dans le cadre d'une contrainte budgétaire qui oblige à sélectionner les investissements « ... conditionnés par une forte probabilité de succès commercial, des prévisions de rendement positif et une bonne viabilité économique ».
Le PDDAA est conçu en fonction de l'importance croissante attribuée à un système économique et commercial intégré à l'échelle mondiale et régionale. Il fait le pari que les pays et sous-régions d'Afrique pourront « promouvoir ensemble les avantages comparatifs de chacune ».
Le raisonnement est conduit à partir de 5 sous-régions agro-écologiques en se fondant sur les notions d'avantages comparatifs et de compétitivité pour apprécier le potentiel d'exploitation et de création de revenus de chaque produit.
Le critère de sélection des produits a consisté à identifier les produits représentant un pourcentage significatif des productions nationales ou régionales dépassant un certain seuil du commerce international.
L'exercice a permis d'identifier des produits de spécialisation possible mais aussi d'observer des décalages parfois très importants entre les structures productives en place et cette spécialisation « idéale ».
Le tableau ci-après résume ces résultats.
Produits potentiellement compétitifs par
sous-région,
potentiel de production et de commerce
|
Critère d'adaptabilité naturelle |
Critère production/potentiel commercial |
Potentiel de production et de commerce*** |
||
|
Produits naturellement adaptés |
Superficie cultivée* (%) |
Culture prioritaire sous-régionale |
Superficie cultivée** (%) |
|
|
Afrique du Nord |
||||
|
Fruits |
28,4 |
Fruits |
20,5 |
Modéré |
|
Olives |
49,6 |
Olives |
12,9 |
Modéré |
|
Blé |
26,9 |
Blé |
6,0 |
Marginal |
|
Légumes |
4,6 |
Légumes |
43,8 |
Elevé |
|
Zone sahélienne de l'Afrique centrale (Tchad) |
||||
|
Fruits |
9,3 |
Fruits |
8,7 |
Marginal |
|
Arachides |
10,7 |
Arachides |
37,8 |
Élevé |
|
Millet |
22,1 |
Millet |
9,8 |
Marginal |
|
Sorgho |
21,2 |
Sorgho |
7,8 |
Marginal |
|
Riz |
2,8 |
Riz |
5,2 |
Marginal |
|
Légumes |
0,4 |
Légumes |
8,7 |
Marginal |
|
Coton-graine |
8,4 |
Coton-graine |
0,6 |
Négligeable |
|
Afrique centrale (à l'exclusion du Tchad) |
||||
|
Fruits |
28,5 |
Fruits |
35,1 |
Elevé |
|
Manioc |
11,6 |
Manioc |
24,5 |
Modéré |
|
Arachides |
5,9 |
Arachides |
6,2 |
Marginal |
|
Légumes |
2,4 |
Légumes |
11,0 |
Modéré |
|
Café |
17,8 |
Café |
4,6 |
Négligeable |
|
Cacao |
16,9 |
Cacao |
2,3 |
|
|
Noix de palme |
10,5 |
Noix de palme fruits |
3,6 |
|
|
Maïs |
9,6 |
Maïs |
3,5 |
|
|
Sorgho |
5,6 |
Sorgho |
0,7 |
|
|
Zone sahélienne de l'Afrique occidentale |
||||
|
Arachides |
10,7 |
Arachides |
11,1 |
Modéré |
|
Millet |
33,7 |
Millet |
27,0 |
Élevé |
|
Sorgho |
28,1 |
Sorgho |
5,0 |
Marginal |
|
Riz |
3,0 |
Riz |
6,8 |
Marginal |
|
Légumes |
0,9 |
Légumes |
26,9 |
Elevé |
|
Fruits |
39,5 |
Fruits |
4,9 |
Négligeable |
|
Pays côtiers de l'Afrique occidentale |
||||
|
Cacao |
52,6 |
Cacao |
7,3 |
Marginal |
|
Manioc |
10,8 |
Manioc |
10,1 |
Modéré |
|
Igname |
7,9 |
Igname |
50,0 |
Elevé |
|
Maïs |
15,9 |
Maïs |
0,3 |
Négligeable |
|
Fruits |
22,4 |
Fruits |
9,6 |
Marginal |
|
Légumes |
4,7 |
Légumes |
9,3 |
Marginal |
|
Millet |
14,7 |
Millet |
0,7 |
Négligeable |
|
Riz |
9,0 |
Riz |
0,8 |
|
|
Sorgho |
17,8 |
Sorgho |
0,3 |
|
|
Afrique orientale |
||||
|
Fruits |
26,5 |
Fruits |
46,8 |
Elevé |
|
Café |
12,5 |
Café |
6,1 |
Marginal |
|
Maïs |
12,9 |
Maïs |
5,4 |
Marginal |
|
Légumes |
0,9 |
Légumes |
13,3 |
Modéré |
|
Millet |
7,3 |
Millet |
1,8 |
Négligeable |
|
Légumineuses |
7,9 |
Légumineuses |
4,6 |
|
|
Sorgho |
18,9 |
Sorgho |
3,4 |
|
|
Afrique australe |
||||
|
Fruits |
29,4 |
Fruits |
22,5 |
Elevé |
|
Maïs |
25,5 |
Maïs |
13,8 |
Modéré |
|
Raisin |
9,6 |
Raisin |
12,0 |
Modéré |
|
Canne à sucre |
2,5 |
Canne à sucre |
17,5 |
Modéré |
|
Tabac |
1,0 |
Tabac |
6,6 |
Marginal |
|
Légumes |
1,5 |
Légumes |
13,7 |
Modéré |
|
Café |
12,0 |
Café |
0,2 |
Négligeable |
Estimations fondées sur les données de FAOSTAT (2002) ;
Note : `-' signifie: « chiffres inférieurs à cinq pour cent » ;
* pourcentage de superficie consacrée à une culture donnée par rapport à la surface des terres cultivées d'une sous-région, moyenne 1996-2000 ;
** pourcentage de la valeur commerciale de la production d'un produit par rapport à la valeur commerciale de la production totale d'une sous-région, moyenne 1996-2000 ;
*** On s'est servi de l'échelle suivante pour évaluer le potentiel de production et de commerce : < 5% négligeable; 5.0 % - 10 % marginal; 10.1 % -25 % modéré; > 25 % élevé.
Il en ressort que les produits d'exportation traditionnels propres à chaque sous-région ont un potentiel commercial élevé : café en Afrique orientale, cacao dans les pays côtiers d'Afrique occidentale, arachides en Afrique centrale et au Sahel occidental, fruits, légumes, olives et blé en Afrique du Nord, maïs, raisin, canne à sucre en Afrique australe...
Mais les couverts végétaux observés ne correspondent pas toujours à cette spécialisation « idéale » : en Afrique du Nord, les légumes représentent 44 % de la valeur commerciale de la production mais seulement 5 % de la superficie cultivée ; le café et le cacao ne dépassent pas 5 % de la valeur commerciale des produits de l'Afrique centrale alors qu'ils occupent 17,8 et 16,9 %, respectivement, de la superficie cultivée.
Il existerait donc des défauts de spécialisation auxquelles il conviendrait de remédier.
Mais ce n'est pas le seul problème envisagé par ces analyses de la FAO. Celle-ci conclut que la sous-compétitivité des produits agricoles africains est attribuable à des retards quasi systématiques de productivité qui renvoient à un déficit technologique de compétitivité.
Rendements annuels (tonnes à l'hectare) des
sous-régions et revenus bruts à l'hectare
(exprimés en
valeur unitaire du commerce mondial, moyenne 1996-2000)
par rapport aux
autres pays du monde et aux principaux pays dominant le marché
international
|
Produits prioritaires |
Sous-région |
T/ha |
Dollar E.U/ha |
Culture prioritaire |
Sous-région |
T/ha |
Dollar E.U./ha |
Cultures prioritaires |
Sous-région |
T/ha |
Dollar E.U./ha |
|
Manioc |
Afrique centrale* |
7,8 |
744 |
Maïs |
Afrique orientale |
1,5 |
188 |
Sorgho |
Tchad |
0,6 |
74 |
|
Pays côtiers de l'Afrique occidentale |
10,3 |
978 |
Afrique australe |
1,8 |
230 |
Zone sahélienne de l'Afrique occidentale |
0,5 |
116 |
|||
|
Brésil |
12,8 |
1 212 |
États-Unis |
8,3 |
1 075 |
Inde |
0,9 |
98 |
|||
|
Indonésie |
12,2 |
1 161 |
Monde |
4,3 |
557 |
Monde |
1,4 |
166 |
|||
|
Thaïlande |
15,2 |
1 447 |
Millet |
Tchad |
0,4 |
90 |
Canne à sucre |
Afrique australe |
69,0 |
4 414 |
|
|
Monde |
10,1 |
959 |
Zone sahélienne de l'Afrique occidentale |
0,5 |
219 |
Cuba |
33,0 |
2 109 |
|||
|
Cacao |
Pays côtiers de l'Afrique occidentale |
0,5 |
583 |
Inde |
0,8 |
176 |
Monde |
64,6 |
4 135 |
||
|
Indonésie |
1,1 |
1 346 |
Monde |
0,8 |
169 |
Tabac |
Afrique australe |
2,2 |
6 686 |
||
|
Malaisie |
0,8 |
1 010 |
Olives |
Afrique du Nord |
1,1 |
10 239 |
États-Unis |
2,4 |
7 255 |
||
|
Monde |
0,5 |
587 |
EU (15) |
2,3 |
6 263 |
Monde |
1,6 |
4 942 |
|||
|
Café |
Afrique orientale |
0,7 |
1 472 |
Grèce |
2,9 |
3 826 |
Légumes |
Afrique* centrale |
7,0 |
4 347 |
|
|
Colombie |
0,7 |
1 532 |
Italie |
2,7 |
2 035 |
Pays côtiers de l'Afrique occidentale |
5,5 |
3 402 |
|||
|
Brésil |
0,7 |
1 570 |
Monde |
1,9 |
4 904 |
Afrique orientale |
6,5 |
4 057 |
|||
|
Monde |
0,7 |
1 335 |
Riz |
Tchad |
1,4 |
318 |
Afrique du Nord |
19,2 |
12 000 |
||
|
Fruits |
Afrique centrale* |
6,4 |
3 459 |
Zone sahélienne de l'Afrique occidentale |
2,1 |
227 |
Tchad |
10,4 |
6 469 |
||
|
Pays côtiers de l'Afrique occidentale |
5,3 |
2 849 |
Italie |
6,0 |
1 367 |
Zone sahélienne de l'Afrique occidentale |
10,5 |
622 |
|||
|
Afrique orientale |
5,7 |
3 040 |
Thaïlande |
2,5 |
556 |
Afrique australe |
10,4 |
6 465 |
|||
|
Afrique du Nord |
9,5 |
5 128 |
États-Unis |
6,7 |
1 518 |
États-Unis |
26,8 |
16 647 |
|||
|
Tchad |
4,0 |
2 163 |
Viet-nam |
4,0 |
906 |
Monde |
16,1 |
10 005 |
|||
|
Afrique australe |
10,6 |
5 696 |
Monde |
3,9 |
873 |
Blé |
Afrique du Nord |
1,9 |
279 |
||
|
UE (15) |
10,3 |
5 544 |
Coton-graine |
Tchad |
0,7 |
150 |
Australie |
2,0 |
294 |
||
|
États-Unis |
23,6 |
12 686 |
Chine |
3,0 |
696 |
Canada |
2,4 |
353 |
|||
|
Raisin |
Monde |
9,4 |
5 039 |
Inde |
0,7 |
164 |
UE (15) |
5,8 |
862 |
||
|
Afrique australe |
9,7 |
9 349 |
États-Unis |
1,9 |
431 |
États-Unis |
2,7 |
408 |
|||
|
Chili |
12,6 |
12 182 |
Monde |
1,6 |
373 |
Monde |
2,7 |
402 |
|||
|
UE (15) |
7,5 |
7 254 |
Igname |
Pays côtiers de l'Afrique occidentale |
10,1 |
8217 |
|
||||
|
États-Unis |
16,8 |
16 234 |
Brésil |
9,2 |
5716 |
||||||
|
Arachides |
Monde |
8,1 |
7 840 |
Monde |
9,7 |
6 031 |
|||||
|
Afrique centrale* |
0,7 |
491 |
|||||||||
|
Tchad |
1,0 |
706 |
|||||||||
|
Zone sahélienne de l'Afrique occidentale |
0,8 |
720 |
|||||||||
|
Inde |
1,0 |
734 |
|||||||||
|
États-Unis |
2,9 |
2 093 |
|||||||||
|
Monde |
1,4 |
1 002 |
|||||||||
Estimations fondées sur les données de
FAOSTAT (2002) relatives aux rendements par hectare et aux valeurs commerciales
unitaires.
Note: * Afrique centrale, à l'exclusion du Tchad.
Même lorsque les rendements des pays africains se comparent à la moyenne mondiale, ce qui advient parfois, ils restent en-deçà des rendements des pays qui dominent le marché mondial, excepté pour le café, le cacao, la canne à sucre, le tabac et l'igname.
Ce diagnostic appelle selon la FAO un effort d'investissement respectueux des avantages comparatifs naturels des régions africaines.
Plus précisément, celle-ci estime que face « ... à un marché de plus en plus compétitif et mondialisé, la plupart des pays africains sont désavantagés par la faible productivité des terres et par le manque de technologies de pointe appliquée à la production et la transformation des produits alimentaires. La proportion de petites exploitations dans l'agriculture africaine - rarement plus de 5 hectares et souvent moins d'un hectare - limite, à long terme, la capacité des producteurs à accroître la production et le volume des exportations de manière compétitive ».
Cependant, des handicaps structurels, autres que la taille des exploitations, sont envisagés comme autant d'obstacles à surmonter par ailleurs.
Il en va d'abord ainsi des prix. De façon générale, alors même que les coûts de production y sont plus élevés du fait des retards de productivité, l'agriculture africaine bénéficie de prix à la production inférieurs aux prix internationaux.
Cette situation provient de divers facteurs parmi lesquels figurent les politiques publiques de détermination des prix. Mais les difficultés pratiques d'accès aux marchés semblent également compter beaucoup (difficultés de transport dues aux infrastructures mais aussi à l'atomisation de la production qui rend prohibitifs les coûts de transaction faute d'organisations communes adaptées...).
Dans ces conditions, les obstacles structurels au développement agricole en Afrique doivent être considérés plus globalement comme liés à la précarité des conditions économiques, sociales et politiques.
|
La précarité des conditions
économiques, sociales et politiques La FAO énumère ainsi les obstacles généraux à une croissance durable en Afrique : une forte dépendance du secteur agricole à l'égard des aléas du climat ; une proportion importante de petites exploitations dans l'agriculture africaine - rarement plus de cinq hectares et souvent moins d'un hectare. Cette contrainte structurelle supplémentaire entrave, à long terme, la capacité des producteurs à accroître la production et les volumes d'exportation tout en étant compétitifs ; une main d'oeuvre appauvrie et illettrée, sans accès aux services d'information, d'éducation et de santé qui, dans certains pays, supporte le fardeau de conflits intérieurs et de la maladie, notamment le VIH/SIDA ; des institutions publiques de gouvernance affaiblies par les réformes politiques (adoptées dans le cadre des programmes d'ajustement structurel et de stabilisation macro-économique qui n'ont pas tenu compte de graves carences institutionnelles), ce qui se traduit par des coûts de transaction élevés défavorables à l'émergence et au développement du secteur privé ; des problèmes persistants (liés aux pertes après-récolte résultant de technologies obsolètes, d'installations de stockage mal adaptées, de manque de produits d'emballage et d'infrastructures de transformation insuffisantes) qui limitent le gain de valeur ajoutée et la productivité des petits et des grands transformateurs. Ces derniers sont également handicapés par l'insuffisance et l'irrégularité des approvisionnements en matières premières due à l'instabilité de la production agricole ; l'état déplorable des infrastructures rurales qui empêche la majeure partie des ménages ruraux d'accéder aux marchés ou de boucler efficacement la chaîne production-commerce des marchandises. La situation est particulièrement critique pour les pays enclavés dont les systèmes de transport mal intégrés et inefficaces ont eu un effet dévastateur sur la compétitivité du commerce dans les pays africains. Pour plusieurs pays enclavés en Afrique, les coûts de transport et d'assurance représentent plus de 30 pour cent de la valeur totale des exportations (plus de 50 pour cent au Malawi, au Tchad et au Rwanda) ; une faible priorité accordée aux questions relatives à la production des connaissances et à leur diffusion aux utilisateurs finaux. De nombreux pays dans la région sont également pénalisés par un préjugé en faveur des cultures d'exportation. Cet à priori date de l'époque coloniale lorsque les ressources étaient allouées en priorité aux recherches portant sur les cultures d'exportation, et non sur les cultures locales. En conséquence, l'Afrique a pris du retard par rapport à la majeure partie des autres régions en développement dans la mise au point de variétés améliorées et de technologies adaptées aux conditions locales ; une dégradation accélérée des ressources naturelles induite par l'homme, y compris la désertification, notamment dans le Sahel, du fait de l'exploitation excessive des terres cultivées, du surpâturage des parcours, du déboisement et d'une mauvaise gestion des ressources hydriques ; un approvisionnement limité en eau douce utilisable dans de nombreuses zones de l'Afrique où les variations climatiques annuelles et/ou saisonnières sont extrêmes. Dans la mesure où l'agriculture irriguée est surtout alimentée par les eaux de surface et les nappes souterraines, priorité devrait être accordée à une gestion optimale des ressources hydriques pour tous les consommateurs (agricoles, industriels et privés) tout en veillant à maintenir l'intégrité et la productivité des écosystèmes naturels. La production agricole est en général limitée par le rôle modeste que joue l'agriculture irriguée. Les terres irriguées ne représentent qu'une très faible part de la superficie cultivée (7 % seulement en Afrique et 3,7 % en Afrique subsaharienne). Ces pourcentages sont les plus faibles des pays en développement. |
La FAO déduit de ces analyses un programme d'actions réparties entre des actions générales d'amélioration des conditions du secteur, des actions visant à une utilisation durable des ressources naturelles et des politiques d'infrastructures et d'accès au marché.
En ce qui concerne le contexte économique, la FAO met l'accent sur deux orientations :
la fourniture de biens publics (investissements dans les infrastructures, politiques macroéconomiques solides, bonne gouvernance) « favorable au développement de sociétés privés » ;
le renforcement du secteur privé dans les secteurs de l'agriculture et du commerce ce qui suppose de « créer un environnement économique fiable et rentable ». Il faut aussi « encourager les nouveaux arrivants du secteur prié et l'établissement de coopératives sur les marchés d'intrants et de produits ».
S'agissant de l'utilisation durable des ressources naturelles, la FAO préconise :
la sélectivité des actions et des investissements sur les produits dotés d'un avantage comparatif non exploité ;
l'élaboration d'un cadre stratégique pour l'expansion des surfaces cultivables puisque 25 % de la hausse de la production devrait provenir à l'horizon 2025 de l'exploitation de nouvelles terres jugées abondantes (233 millions d'hectares de disponibilité) mais très inégalement productives ;
l'adoption d'une gestion scientifique des ressources naturelles.
Enfin, les politiques d'amélioration des infrastructures et d'accès au marché doivent améliorer l'accès à l'eau, aux transports, au stockage et au traitement, à l'énergie et aux NTIC.
Mais la FAO préconise aussi la mise en oeuvre de politiques visant à promouvoir le commerce régional et à éliminer les obstacles aux marchés mondiaux.
Une série de recommandations pratiques découle de la suggestion de faire jouer au commerce un rôle-moteur « pour la croissance et l'éradication de la pauvreté ainsi que pour une réelle internationalisation des bénéfices de la mondialisation ».
B. UNE RÉHABILITATION DE L'AGRICULTURE ? LE RAPPORT DE LA BANQUE MONDIALE SUR LE DÉVELOPPEMENT 2008
Le rapport de la Banque mondiale de 2008 intitulé « L'agriculture pour le développement » est généralement présenté comme la manifestation d'un revirement de la doctrine de la Banque avec un regain de faveur accordée au rôle de l'agriculture dans le développement.
Le rapport aborde successivement trois grandes questions :
- celle de la contribution de l'agriculture au développement ;
- celle des instruments permettant de concrétiser cette contribution ;
- celle du cadre d'action le plus favorable pour atteindre les objectifs du développement.
La contribution de l'agriculture au développement est jugée « vitale » si l'on souhaite atteindre les « Objectifs du Millénaire » d'une réduction de moitié de la part des personnes souffrant d'extrême pauvreté et de la faim.
Pour autant, la diversité des situations est soulignée et elle conduit le rapport à suggérer des stratégies différenciées pour sortir les ménages ruraux de la pauvreté.
1. Les trois catégories de pays identifiées par la Banque mondiale
Le rapport part d'une analyse de la diversité des situations agricoles proposant une répartition en trois catégories de pays distingués selon le nombre d'agriculteurs et de pauvres :
les pays à vocation agricole,
les pays en mutation,
les pays urbanisés.
Les pays à vocation agricole sont ceux où l'agriculture représente une part importante de l'activité et de la croissance, mais aussi où le taux de pauvreté définie à partir d'un niveau du revenu inférieur à 2,15 dollars par jour est comparativement forte.
Dans les pays en mutation, l'agriculture est un plus faible contributeur à l'activité et à la croissance mais le nombre relatif des pauvres ruraux reste élevé.
Dans les pays urbanisés, la contribution de l'agriculture à la croissance est marginale et la pauvreté n'est plus un phénomène principalement rural même si le taux de pauvreté dans les campagnes est supérieur de 63 % au taux des pauvres urbains.
Le « monde du développement » vu à partir de la catégorisation proposée se présente comme suit.
La catégorie la plus nombreuse - 3 à 3,5 milliards d'habitants dont 63 % de ruraux - est celle des pays en mutation qui regroupent surtout des pays d'Afrique du Nord-Moyen Orient et d'Asie mais aussi quelques pays d'Europe. La part de l'agriculture dans l'activité économique y est de 13 %, soit un niveau relativement faible, alors que la population active agricole représente 57 % du total, ce qui est élevé. L'agriculture contribue pour moins de 7 % à la croissance annuelle et la valeur ajoutée agricole par habitant s'élève à 142 dollars contre un niveau moyen de PIB par habitant de 1 068 dollars82(*). La croissance du PIB agricole est relativement faible par rapport à la croissance globale (2,9 contre 7 % par an pour le PIB non agricole au cours de la période 1993-2005).
La pauvreté est concentrée dans le secteur agricole (80 % des pauvres). Il existe par ailleurs une tendance à l'élargissement des inégalités entre le monde urbain et le monde rural. Par exemple, la pauvreté en Chine a décliné, en pourcentage, deux fois plus vite dans les villes que dans les campagnes entre 1980 et 2001 (en Indonésie, 2,5 fois plus vite ; en Thaïlande, 3 fois plus vite). Pour autant, l'agriculture peut contribuer efficacement à la réduction du taux de pauvreté : entre 75 et 80 % de la baisse du taux de pauvreté en Chine entre 1980 et 2001 est attribuable à la baisse de la prévalence de la pauvreté dans le monde rural.
Les pays en mutation sont ainsi des pays dans lesquels, si la population agricole reste relativement importante, la prévalence de la pauvreté rurale pour être encore trop forte est inférieure à ce qu'elle est dans les pays à vocation agricole. L'agriculture n'y est plus le moteur principal de la croissance et l'essor de la production agricole est contenu. Mais, grâce à la diversification économique, la population rurale décline ce qui limite, à un haut niveau malgré tout, la pauvreté rurale.
Les pays urbanisés rassemblent 965 millions de personnes, dont 26 % vivent dans les campagnes. Les zones géographiques concernées sont principalement l'Amérique du Sud et l'Europe centrale et orientale.
Le poids de l'agriculture dans la production a été ramené à 18 % et la croissance y vient, plus encore que dans les pays en mutation, d'autres secteurs. Il y existe une forte inégalité entre le PIB par habitant et le PIB agricole. Le premier atteint 3 489 dollars, le second 215 dollars seulement.
La croissance du PIB agricole n'est que légèrement inférieure à la croissance annuelle du PIB. Mais, le taux de pauvreté rurale est plus élevé que le taux de pauvreté urbaine.
Enfin, les pays à vocation agricole (615 millions d'habitants dont 68 % de ruraux) sont particulièrement localisés en Afrique subsaharienne. L'agriculture représente 29 % de la production et apporte à ces pays un tiers de leur croissance. La dynamique de la valeur ajoutée agricole est relativement élevée : 4 % l'an entre 1993 et 2005 contre 2,9 % dans les pays en mutation (2,2 % dans les pays urbanisés).
La prévalence de la pauvreté dans les zones rurales est l'un des critères de différenciation des situations des différents pays.
Le taux de pauvreté général (défini comme la disposition d'un revenu inférieur à 2,15 dollars) est nettement plus élevé dans les pays à vocation agricole que dans les autres (80 % contre 60 % dans les pays en mutation et 26 % dans les pays urbanisés).
Les écarts concernant le taux de pauvreté rurale sont un peu moins élevés mais apparaissent substantiels : le taux de pauvreté rurale atteint 83 % dans les pays à vocation agricole ; 73 % dans les pays en mutation et 36 % dans les pays urbanisés.
La plupart des pauvres sont des ruraux dans les deux premières catégories (70 % dans les pays à vocation agricole et même 79 % dans les pays en mutation) mais dans les pays urbanisés, la pauvreté touche moins les ruraux que les urbains (39 % des pauvres vivent dans les campagnes contre 61 % dans les villes) même si le taux de pauvreté chez les ruraux est supérieur.
Apprécié à partir d'un plafond encore plus bas (1,08 dollar par jour) la situation des pays à vocation agricole ressort comme particulièrement dégradée avec près de la moitié des ruraux (49 %) qui perçoivent moins que ce revenu.
Dans les pays à vocation agricole, l'extrême pauvreté (celle attachée à un revenu inférieur à 1,08 dollars) touche 61,1 % des pauvres ; cette proportion atteint 38,1 % dans les pays en mutation et 35,2 % dans les pays urbanisés.
Dans le cadre de cette typologie, le rapport propose différentes stratégies de développement qu'il présente comme adaptées aux différentes situations en partant d'une ré-estimation des effets d'entraînement du secteur agricole sur l'activité économique.
2. Un appel à la réhabilitation de l'agriculture comme levier du développement
La contribution de l'agriculture au développement général est un problème débattu de longue date.
Sans remonter à Pisistrate (VIe siècle avant J.C.), à Sully ni même à Richelieu, on peut rappeler la discussion qui opposa les mercantilistes aux physiocrates et s'amplifia tout au long du XVIIIe siècle.
Dans ses versions plus modernes, cette querelle est axée autour de la question de l'accumulation du revenu. Elle est directement liée à la problématique de la productivité.
Dans l'analyse historique marxiste, l'agriculture est vue comme le socle de rentes qui sont « recyclées » dans d'autres activités économiques dont elles nourrissent le développement.
La perspective de gains de productivités supérieures et immédiatement accessibles dans des secteurs plus industriels et, grâce à des stratégies de développement fondées notamment sur l'attractivité du capital étranger a renouvelé la question.
On a imaginé pouvoir sauter les étapes initiales du développement et que l'agriculture loin d'être un moteur du développement pourrait être considérée comme l'un de ses freins. En fixant les facteurs de production dans des activités réputées faiblement productives mais aussi par les tendances à la constitution de rentes coûteuses pour le reste de l'économie à quoi obligerait le développement agricole, le secteur primaire représenterait une charge, en plus qu'un coût d'opportunité, pour le reste de l'économie.
Le rapport 2008 de la Banque mondiale sur le développement dans le monde qui est présenté comme une entreprise de réhabilitation de l'agriculture comme levier de développement présente un contre-argumentaire à cette vision qui a longtemps été présentée comme celle de cette institution83(*).
La forte croissance des secteurs non agricoles des pays en mutation s'impose comme un constat qui paraît confirmer les analyses classiques relatives à la dynamique différenciée des secteurs économiques.
Pourtant, la situation des pays appartenant aux autres catégories distinguées par le rapport (les pays à vocation agricole et les pays urbanisés) tranche avec ces constats : la croissance de la productivité du travail dans l'agriculture y aurait été plus élevée dans les années 1993 à 2005 que dans les secteurs non-agricoles.
Le rapport souligne par ailleurs que la croissance de la productivité totale des facteurs a été plus forte dans l'agriculture que dans l'industrie, de l'ordre de 0,5 à 1,5 point de pourcentage, dans une cinquantaine de pays à revenus faibles ou intermédiaires.
Quant aux explications des « sous-performances » du secteur agricole, quand elles doivent être constatées, elles sont attribuées à des politiques macro-économiques défectueuses et à des institutions défaillantes.
Du côté des facteurs macroéconomiques, les interventions destinées à plafonner les prix agricoles sont particulièrement en cause de même que les politiques de change inadaptées, les prélèvements fiscaux sur l'agriculture et l'encadrement des échanges internationaux.
Le rapport mentionne en particulier une étude séminale de Krueger, Schiff et Valdés (1991) qui, partant du constat que les interventions publiques menées dans 18 pays ont eu pour effet d'induire une baisse de 30 % du prix relatif du secteur, estiment qu'une réduction de 10 points de pourcentage de la taxation de l'agriculture pourrait augmenter la production annuelle du secteur de 0,43 point de pourcentage.
De même, plusieurs travaux sont évoqués comme ayant démontré les effets positifs d'une hausse des prix sur la production, ainsi, qu'à l'inverse, les incidences défavorables pour les prix des restrictions au commerce international des produits agricoles supposés avoir déprimé les prix des produits échangés sur les marchés internationaux de 5 %.
Enfin, la réduction de l'aide publique au développement agricole est pointée comme un élément déterminant des retards du développement dans un contexte où, par ailleurs, les interventions publiques internes aux pays ne favorisent pas particulièrement le monde rural et sont plutôt orientées au bénéfice des urbains.
Sur ce plan, le poids relatif des dépenses publiques à destination de l'agriculture a baissé dans les trois catégories de pays identifiés par la Banque mondiale.
Le tableau ci-dessus montre qu'il existe un autre paradoxe puisque la part des dépenses publiques consacrées à l'agriculture est plus faible dans les « pays à vocation agricole » que dans les pays en mutation et, même dans les pays urbanisés quand on l'estime à partir de la contribution des dépenses publiques au PIB agricole.
Quant à l'aide publique au développement (APD) dirigée vers l'agriculture, elle a considérablement baissé par rapport au pic atteint à la fin des années 70 et se trouvait en 2005 à un niveau inférieur à celui pourtant assez bas du milieu des années 70.
La chute de l'APD a touché sa part relative dans le total de l'APD (de 18 % en 1979 à 3,5 % en 2004) et son niveau absolu (de 8 à 3,4 milliards de dollars constants).
Elle a concerné à la fois l'aide multilatérale et l'aide bilatérale (qui n'a été que légèrement moins affectée).
Enfin, alors qu'elle a été durablement plate en Amérique latine, ce sont l'Asie et, avec une moindre ampleur, l'Afrique qui ont été les plus touchées par la réduction de l'aide.
La Banque mondiale estime que cette évolution s'est produite sous l'effet de plusieurs facteurs :
la baisse des prix agricoles aurait affecté la rentabilité de l'agriculture ;
la concurrence d'autres bénéficiaires ;
l'obligation de répondre à plusieurs crises dans d'autres secteurs ;
l'opposition des agriculteurs des pays donateurs à une aide pouvant favoriser leurs concurrents ;
celle des groupes de pression environnementaux défavorables à l'agriculture.
3. Des stratégies différenciées
Un « agro-scepticisme » se serait répandu devant les échecs de projets de développement agricole et la persistance d'un cadre général économique mais aussi institutionnel peu propice.
Les suggestions de la Banque mondiale pour favoriser le développement agricole dessinent des stratégies différenciées en fonction des trois situations décrites.
Pour les pays à vocation agricole, l'importance relative du secteur agricole confère au développement de l'agriculture une importance critique.
L'agriculture de ces pays est principalement vivrière et tournée vers le marché domestique même s'il existe aussi une agriculture non-vivrière qui concerne des matières premières généralement brutes et est essentiellement une agriculture d'exportation.
L'agriculture vivrière n'entre pas dans le courant des échanges internationaux du fait de la nature de ses produits et des problèmes d'infrastructures qu'elle rencontre.
Quant à l'agriculture qui entre dans le circuit des échanges internationaux, elle est souvent confrontée à des handicaps de compétitivité.
Pour ces pays, l'agriculture est un moteur de croissance irremplaçable du fait même de sa part dans l'activité économique globale mais aussi, selon le Rapport de la Banque, parce que ces pays sont astreints à produire leur propre nourriture et peuvent espérer conserver un certain temps leurs avantages comparatifs.
En effet, si le rapport rappelle que les échanges internationaux peuvent offrir une contribution efficace à la résolution des problèmes d'insécurité alimentaire, les limites d'accès de certains pays aux importations sont évoquées comme susceptibles de frapper d'ineffectivité le recours aux échanges internationaux pour combler des déficits alimentaires. Or, ceux-ci ont une forte probabilité de se produire dans l'état actuel du développement agricole de nombreux pays ce que démontre assez le niveau élevé de la variance de la production agricole.
Par exemple, au Soudan, tous les six ans une contraction de la production agricole de 25 % se produit.
Les obstacles que rencontrent ces pays dans leur accès au commerce international viennent des insuffisances de leurs ressources financières conjuguées à des infrastructures (de transport, de stockage...) qui les handicapent.
En moyenne, les pays à vocation agricole sont des importateurs nets de cultures vivrières, pour environ 14 % de leur consommation moyenne avec des pics (40 % en Guinée-Bissau, Haïti et pour le Yémen). Ces pays sont particulièrement exposés à la volatilité des prix agricoles dont le coefficient de variation s'élève à quelque 20 %.
En résumé, ils subissent une situation particulièrement préoccupante puisque, pour eux, à l'inverse du constat que l'on peut faire au niveau mondial, la production agricole est bien inférieure au niveau de leurs besoins, sans qu'ils puissent toujours espérer combler ce déficit par le recours aux importations.
De ces prémices, la Banque conclut à la nécessité de se donner pour objectif d'accroître la production agricole locale.
À cet effet, la variable névralgique réside, selon elle, dans la productivité avec l'objectif que celle-ci s'améliore au niveau le plus local des petites exploitations.
Cette recommandation s'inscrit dans le cadre de l'analyse des avantages comparatifs des pays concernés qui concernent à la fois l'agriculture et les autres secteurs économiques.
Globalement, ceux-ci ne disposeraient pas d'avantages comparatifs particuliers. Le rapport estime que les « pays à vocation agricole ont largement raté le développement des industries de main d'oeuvre qui ont fait décoller les pays d'Asie dans les années 80 ». Comme les nouveaux entrants subissent la concurrence des pays qui ont su précocement améliorer leur productivité en recourant à des économies d'échelle - qui est l'une des dimensions expliquant la productivité -, les pays à vocation agricole auraient intérêt à exploiter les avantages comparatifs qui leur restent à savoir leurs dotations en ressources naturelles et une population active nombreuse et peu coûteuse.
Cette recommandation plaide pour que l'agriculture occupe une place prioritaire dans leurs stratégies de développement et pour la mobilisation des moyens appropriés.
Pour les pays en mutation, la vision globale du développement qui sous-tend les analyses de la Banque mondiale est que le développement des secteurs non agricoles est le vecteur principal ce qui milite pour des solutions passant par des mobilités intersectorielles. Toutefois, une « nouvelle agriculture » et l'emploi rural non agricole peuvent jouer un rôle dans la réduction de la pauvreté rurale.
La « nouvelle agriculture » consiste en une agriculture plus productive et se diversifiant vers des productions à haute valeur ajoutée. Cette évolution est décrite comme correspondant à une tendance qui voit la part des aliments transformés dans le total de la valeur ajoutée agricole s'accroître avec le revenu.
Son essor suppose une « industrialisation » des process et son impact sur la pauvreté rurale dépend de l'intégration à ces process des petits exploitants qui peut passer par leur conversion au salariat.
En effet, le rapport de la Banque mondiale souligne les difficultés de la coexistence entre les petits exploitants et les chaînes de production verticalement intégrés.
Par ailleurs, le développement d'activités non agricoles dans les zones rurales, avec le déversement qu'il suppose d'emplois agricoles vers ces activités, est considéré comme un levier utile à la réduction de la pauvreté rurale.
Si ces productions peuvent être liées à l'agriculture, comme, par exemple, le commerce alimentaire ou le transport des productions agricoles, elles peuvent aussi en être indépendantes.
L'observation essentielle est que, pour la Banque mondiale, l'agriculture ne suffira pas à éradiquer la pauvreté rurale dans ces pays mais qu'elle peut y contribuer puissamment.
Le diagnostic s'appuie sur les succès remportés par la Chine où la réduction de la pauvreté en lien avec la croissance de la valeur ajoutée agricole aurait été quatre fois supérieure à ce que la croissance de l'industrie et des services aurait permis de réaliser. Une condition de cette performance est suggérée : une distribution plutôt égale des terres.
Enfin, pour les pays urbanisés, l'agriculture est considérée comme une activité commerciale comme les autres. Par ailleurs, d'un point de vue économique, les progrès de productivité agricole sont relativement élevés alors même que le niveau initial de la productivité est supérieur à ce qu'il est dans les autres pays.
Le développement agricole dépend du maintien des gains de productivité. Mais son impact sur la pauvreté peut varier en fonction de ses retombées sur l'emploi et les revenus des petits exploitants.
À cet égard, le rapport rappelle d'abord que l'accroissement de l'efficacité agricole n'a généralement pas d'effet sur les prix, qui sont fixés sur les marchés où opèrent les producteurs. Le surplus de productivité est ainsi principalement capté par les propriétaires des exploitations. Sa diffusion aux agriculteurs locaux dépend de leur degré de participation au développement agricole qui peut prendre la forme du salariat ou de l'inclusion dans des systèmes intégrés de production.
Deux cas « polaires » sont envisagés : celui du Chili où les gains de productivité n'ont pas empêché une augmentation de l'emploi agricole constitué assez largement par des pauvres ruraux et des femmes ; celui du Brésil où les gains de productivité ont été réalisés grâce à une combinaison productive axée autour d'un équilibre plus capitalistique et plus exigeant en main d'oeuvre qualifiée, qui a exclu de fait de nombreux agriculteurs pauvres du développement agricole.
La Banque relève que l'essor agricole du Brésil a succédé, dans les années 90, à une libéralisation du commerce international et à l'instauration de prix plus incitatifs qui ont favorisé l'adoption de productions tournées vers l'exportation et se prêtent à l'industrialisation des procédés.
Au total, la Banque mondiale envisage quatre grandes voies de sortie de la pauvreté agricole :
- l'augmentation de la productivité notamment dans la petite agriculture ;
- la valorisation au sein d'exploitations agricoles connectées aux marchés ;
- la diversification dans des secteurs d'activités non-agricoles ;
- l'émigration vers les villes.
L'accent est mis sur le rôle de la productivité dans les développements agricoles.
Entre 1980 et 2004, la production agricole a progressé de 2 % l'an en moyenne contre une croissance de la population de 1,6 %.
Les pays en développement, pris globalement, ont connu une croissance agricole particulièrement forte (2,6 % par an) de sorte que leur part de la production agricole a augmenté de 56 à 65 %.
C'est en Asie que les deux tiers de cette croissance sont intervenus.
Et c'est plus par la productivité que par l'extension des terres que ces performances ont été réalisées.
Les rendements céréaliers ont progressé de 2,8 % par an en Asie de l'Est contre 1,8 % dans les pays industrialisés sous l'effet de la diffusion de la « Révolution verte ».
Seule l'Afrique subsaharienne a connu une stagnation des rendements céréaliers.
Ces progrès sont attribués à l'amélioration des process agricoles et à des changements institutionnels.
Selon la FAO, l'amélioration des procédés dans le domaine de l'irrigation, de la sélection des céréales et des engrais a joué un rôle majeur.
De fait, une corrélation assez forte semble exister entre les progrès des rendements et la modernisation des procédés, excepté pour l'irrigation pour des raisons évidentes de différences dans les régimes pluviaux.
Le secteur de la viande a été l'un des plus dynamiques avec un doublement au cours des 15 dernières années. Il représente désormais le tiers de la production totale.
La croissance de la production a, au total, été entraînée par celle de la productivité totale des facteurs qui a atteint selon les régions entre 1 et 2 % par an. Elle explique la moitié de l'augmentation de la production en Chine et en Inde et de 30 à 40 % en Indonésie ou en Thaïlande. Elle a permis de limiter le recours à de nouvelles terres qui, localement, pouvaient, au demeurant, être déjà saturées.
Selon la Banque mondiale, ces gains de productivité sont attribuables aux investissements, particulièrement en recherche-développement, favorisés par l'instauration d'institutions adaptées.
Les investissements ont été un élément déterminant pour ces progrès.
La sélection d'espèces nouvelles a parfois été décisive comme ce fut le cas du riz hybride qui aurait contribué à la moitié de l'amélioration des rendements du riz en Chine entre 1975 et 1990.
La mise à niveau des infrastructures, en particulier des transports, a également été un facteur important (25 % de la croissance de la production agricole indienne dans les années 70). L'amélioration de la formation mais aussi de la santé a augmenté la productivité.
La Banque mondiale souligne enfin le rôle des réformes des institutions, reconnaissant néanmoins que les évaluations réalisées en ce domaine sont rares.
C. DES POINTS DE VUE QUI MANQUENT DE COHÉRENCE
Il existe plus que des nuances entre les deux projets envisagés. Mais, surtout, chacun d'entre eux comporte en soi sous cet angle des défauts et traite par prétérition des problèmes particulièrement aigus posés par le développement agricole.
Assez curieusement, la vision de la FAO ressort comme nettement plus conforme au modèle de développement d'inspiration libérale que celui de la Banque mondiale. Pour le dire d'un mot il s'inscrit étroitement dans le paradigme du « consensus de Washington ».
On doit y remarquer l'insistance mise sur les avantages comparatifs et la spécialisation agricole orientée par les marchés d'exportation.
De même, la « privatisation » de l'agriculture y apparaît comme un thème récurrent. C'est un peu étonnant compte tenu de l'état des agricultures en cause mais peut se comprendre dès lors qu'on imagine que sont visées par là les structures publiques (ou la trace de ces structures dans le système agricole, comme, par exemple, les droits fonciers) ou la nécessité d'attirer des investisseurs privés étrangers.
Enfin, l'État se voit reconnaître un rôle mais un rôle limité : financer les biens publics (les infrastructures, la recherche...) nécessaires à la rentabilité d'une agriculture par ailleurs régulé par les seuls marchés.
Si cette approche apparaît situer la FAO à front renversés par rapport aux logiques désormais défendues par la Banque mondiale, c'est sans doute parce que celles-ci ont évolué assez radicalement, le rapport de la Banque mondiale étant un peu postérieur aux « dires d'experts » de la FAO.
Par rapport aux approches traditionnelles de la Banque, l'agriculture se voit réhabilitée comme une source possible de développement, voire comme un secteur prioritaire pour les pays dits « à vocation agricole ». Mais, si la Banque mondiale juge souhaitable un renforcement des interventions publiques dans le secteur, on peut souligner que les prolongements pratiques qu'elle confère à son appel à des politiques publiques de développement agricole s'inscrivant dans une vision où les marchés, pourtant décrits comme ne fonctionnant pas bien dans toutes les situations, restent les grands ordonnateurs du développement.
Le modèle de référence paraît être le Brésil alors même qu'il est reconnu comme non-transposable à la situation des pays les plus en retard. À ce compte, on pourrait aussi évoquer la Corée du Sud pour la transition très rapide de ce pays d'une économie agricole traditionnelle à une économie « high-tech ».
Au total, hormis l'attention portée à l'agriculture, aux dépenses publiques dites « de modernisation » et aux institutions on a du mal à mesurer l'apport d'une analyse qui plaque les recettes mises en oeuvre dans les pays du groupe de Cairns sur l'agriculture subsaharienne et l'ensemble des agricultures en retard de développement.
Finalement, le paradigme du développement agricole est inchangé sur l'essentiel.
Sans doute, l'agriculture n'est plus considérée comme un secteur à délaisser mais les politiques de développement agricole restent les mêmes avec un cadre où, sur fond de financement public des infrastructures (d'où vient ce financement ?), les mécanismes du marché, qui n'ont pourtant pas démontré leur efficacité quand ils n'ont pas été couplés avec des régulations fortes qui abondent dans l'histoire du développement agricole des Nations, sont réputés suffire.
D. LES ÉTATS ACTEURS OU AGENTS DU SYSTÈME ALIMENTAIRE MONDIAL ?
La perspective existe du renforcement d'une agro-industrie qui structurerait le paysage agricole de demain ou après-demain.
« Les alliances, acquisitions et fusions en cours dans l'agribusiness pourraient aboutir à une très forte concentration du secteur en une poignée de complexes agro-industriels géants intégrant sous diverses formes la recherche, la production, la distribution et le marketing ».
Telle est la description d'un futur de l'agro-alimentation mondial proposée par une chercheuse de l'Unité d'économie et de sociologie rurales de l'INRA, dont l'auteur suggère qu'elle trouve déjà dans le présent des tendances à l'oeuvre rendant réaliste son extension.
Cette perspective a déjà été évoquée à plusieurs reprises dans le présent rapport pour ses effets sur les petits exploitants dont elle menacerait les revenus et finalement la viabilité et, avec elle, leur nécessaire contribution à la réalisation de l'équation de la faim.
On doit ajouter à ces interrogations la mention des inquiétudes que la concentration suscite sur les prix alimentaires, lesquels pourraient se tendre sous son effet.
Cette question est partagée par le département économique et social de la FAO qu'il faut citer.
« On accuse souvent la mondialisation de faire passer le pouvoir des gouvernements aux entreprises multinationales (EMN). On reproche à ces multinationales d'abuser de leur emprise sur le marché, d'exploiter les agriculteurs et les travailleurs agricoles du monde entier et d'exercer des pressions sur les gouvernements pour qu'ils assouplissent les normes en matière d'environnement et de travail.
Aujourd'hui, les EMN agroalimentaires mènent leurs activités sur une base internationale. Elles sont de plus en plus intégrées verticalement, et englobent l'ensemble des opérations depuis la production et la commercialisation des semences jusqu'à la transformation et la distribution des aliments en passant par l'achat des récoltes.
Quand elles contrôlent de grands segments de la filière d'approvisionnement, ces grandes entreprises profitent d'un pouvoir monopolistique sur la vente et l'achat, et peuvent par conséquent exercer des pressions sur les agriculteurs et les détaillants. Par le biais de contrats de production ou par des accords de copropriété des terres ou du bétail, elles peuvent obliger les agriculteurs à acheter leurs intrants à l'entreprise et à lui vendre exclusivement leurs produits. Les agriculteurs risquent aussi de perdre leur indépendance et de devenir plus ou moins des employés de l'entreprise dans leurs propres exploitations, Il est également vrai que les EMN peuvent, déplacer leurs activités de pays à pays à la recherche de coûts plus bas (salaires compris), et de normes moins strictes en matière d'environnement et de travail, ce qu'elles ne se privent pas de faire.
Les avantages de la mondialisation
Si, toutefois, les revendications souvent exprimées en faveur de la parité mondiale des salaires et des normes environnementales étaient satisfaites, un considérable avantage concurrentiel serait retiré aux pays les plus pauvres, et cela risquerait d'endiguer le flux des investissements qui y entrent et de compromettre gravement leur développement.
Les pays qui excluraient les EMN se priveraient des meilleurs circuits disponibles pour mettre leurs produits sur le marché mondial. Les EMN améliorent généralement les compétences, méthodes et normes locales à mesure qu'elles s'étendent dans un pays. A la fin des années 1980, par exemple, dans la province chinoise de Heilongjang, la société Nestlé a fait construire des routes rurales, organisé la collecte du lait et apporté aux exploitants des fermes laitières une formation en matière de santé et d'hygiène animales.
Des géants tentaculaires
Suite au mouvement de concentration des entreprises, quatre sociétés basées aux États-Unis d'Amérique et regroupées en deux alliances - Cargill/Monsanto et NovartisJAoM - contrôlent à elles seules plus de 80 % marché mondial des semences et 75 % du marché de l'agrochimie.
Un autre géant des États-Unis, ConAgra, est l'une des trois plus grandes sociétés minotières d'Amérique du Nord. Elle produit ses propres aliments pour le bétail. Elle occupe la troisième place du secteur de l'alimentation du bétail et la seconde de celui des abattoirs, la troisième pour la transformation du porc et la quatrième pour la production de volailles. Par l'intermédiaire d'United Agri Products, elle vend des produits agro-chimiques et des semences dans le monde entier. Elle possède la grande entreprise de courtage en grains, Peavey. Elle n'est dépassée que par Philip Morris pour la transformation des aliments et elle vend des produits alimentaires sous plusieurs marqués dont Armour, Swift et Hunt's.
Les EMN forcent également les entreprises locales à se moderniser pour rester concurrentielles. Des recherches récentes ont montré que plus une industrie nationale est ouverte à la compétition étrangère, plus elle est productive. En fait, la présence d'entreprises étrangères est peut-être le meilleur aiguillon de l'amélioration de la productivité dans beaucoup de pays en développement. »
Votre rapporteur souligne l'ambivalence de l'appréciation portée par la FAO sur le rôle des grandes multinationales de l'agroalimentaire.
Leur contribution à la modernisation des agricultures citée à leur bénéfice n'est sans doute pas contestable. Encore faut-il en évaluer strictement les effets sur les masses paysannes et, plus globalement sur l'économie agricole et celle du développement.
À cet égard, il convient de mettre en évidence les éventuels conflits d'objectifs pouvant exister entre un oligopole agro-industriel allant se renforçant et les États. Dans le contexte de la constitution d'un tel oligopole, la montée en puissance d'une agro-industrie mondialisée pourrait s'accompagner de la promotion d'une préoccupation prioritaire accordée à la maximisation de la rémunération du capital engagé plutôt qu'à la poursuite d'un objectif de maximisation de la production et de la consommation.
La maximisation d'un rendement peut passer par une substitution du capital au travail ou, selon la situation du marché du travail, par des exploitations plus extensives du type latifundiaire. La première des deux options est la plus probable dans la phase de transition où la concurrence joue entre les gros producteurs et implique de gagner en compétitivité. Quoiqu'il en soit, le processus conduisant à la constitution d'un oligopole peut s'avérer destructeur pour les petits exploitants, qu'ils disparaissent purement et simplement, qu'ils soient écartés de tout marché faute de satisfaire aux exigences des donneurs d'ordre ou soient contraints au salariat dans des contextes où celui-ci ne bénéficie d'aucune protection.
Si ce processus ne rime pas nécessairement avec une limitation de la production, le niveau de rentabilité exigé par les propriétaires peut être tel que l'augmentation de la production soit plus réduite que ce que peuvent souhaiter les États. Par ailleurs, ceux-ci ont affaire avec les problèmes de revenu que peuvent subir les petits paysans dans un contexte où le partage de la valeur ajoutée se déforme à leur détriment. Enfin, il ne faut pas écarter l'hypothèse d'une gestion des prix par les acteurs dominants pour augmenter leur rente.
À côté du rôle pilote de l'agro-industrie, il faut prendre la mesure des difficultés que les États, séparément, pourraient rencontrer dans la régulation de ces nouvelles puissances.
Il existe déjà dans le secteur des matières premières des exemples historiques de confrontation d'oligopoles commerciaux et d'États. Il suffit d'évoquer le secteur des hydrocarbures dans lequel la rente a finalement été partagée, mais après des épisodes historiques particulièrement « riches » en conflits. D'autres matières premières présentent l'exemple de tels conflits. Les ressources minières sont souvent exploitées par des firmes transnationales qui imposent leur prix aux pays de production dans le cadre d'échanges internationaux structurés de surcroît pour faire échapper cette exploitation à toute imposition.
Si jusqu'à présent, l'agriculture n'est pas allée au bout de ces logiques, on ne peut pas exclure qu'à la faveur des opportunités d'une meilleure rentabilité de l'investissement agricole, les processus déjà à l'oeuvre se généralisent.
Enfin, la course aux terres dans laquelle entrent de plus en plus d'investisseurs publics ou privés fait peser une menace sur les États les moins développés qui pourraient subir demain plus qu'aujourd'hui un affaiblissement de leur maîtrise sur leurs terres.
Il faut mesurer la force d'un système qui pourrait conduire vers l'horreur agro-alimentaire.
Sur le plan des process de production, la Révolution doublement verte, décrite plus en amont comme un horizon souhaitable, est loin d'être une option spontanée notamment parce que ses performances peuvent être incertaines (ce qui contribue à ne pas en faire une priorité tendancielle).
Par ailleurs, les process reposant sur une agriculture d'inspiration plus « biologique » posent la question de leur compatibilité avec la contrainte d'une augmentation de l'offre suffisante pour nourrir le monde. Leur potentiel productif est en cause ainsi que leurs effets économiques sur des exploitants qu'ils exposent, à davantage de risques et à des rendements économiques dont la gestion est plus complexe que dans les processus de l'agriculture plus « productiviste ».
Cette dernière paraît donc tendanciellement dynamique.
Certes, le progrès technique peut être de plus en plus coûteux et peut susciter de légitimes interrogations sur ses effets. Mais, il paraît correspondre à des logiques puissantes du système de production. La formidable extension des OGM en témoigne, qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore.
La question posée plus haut sur le « réalisme » d'une super révolution agricole à laquelle certains observateurs ne croient pas pourrait aussi bien être renversée. Y-t-il d'autres options plus réalistes ?
En posant cette dernière question, il ne s'agit pas d'assimiler « réalisme » et « souhaitable ». Il s'agit de définir les prolongements les plus probables compte tenu de l'état du monde.
Or, votre rapporteur voit dans celui-ci le ferment d'une évolution allant spontanément vers davantage d'agriculture industrielle, (ce que l'histoire a suffisamment démontré) avec sans doute quelques secteurs « high tech ».
Cette tendance, qui prolongerait les évolutions passées, même si elle n'est pas en soi condamnable, poserait d'évidents problèmes.
Compte tenu de ses caractéristiques, elle suppose que le capital engagé, qui sera plus coûteux, trouve sa rémunération. Or, il n'est pas acquis que les structures agricoles actuelles le permettent. Plutôt que d'imaginer que le progrès technique puisse buter sur cet obstacle, il faut raisonner comme si celui-ci devait être surmonté pour favoriser l'exploitation des potentiels techniques. Cela signifie que le processus de concentration agricole pourrait s'accélérer et que l'hypothèse de filières verticalement intégrées est des plus crédibles. D'ores et déjà, cette intégration est à l'oeuvre. À ce jour, elle est surtout conduite par le tempo imposé par les grands distributeurs84(*).
Par rapport à ces distributeurs, les industriels de l'agro-alimentaire, producteurs de produits à consommer ou d'intrants, paraissent aujourd'hui être des acteurs seconds.
Toutefois, l'influence de ces industriels pourrait s'affirmer plus nettement à mesure que les technologies qu'ils développement et dont ils tendent à faire consacrer de plus en plus efficacement la protection se diffuseraient. L'extension de la certification des obtentions végétales, les progrès de la brevetabilité dans le secteur agricole vont dans ce sens.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où des « sauts de productivité » interviendraient, il faut considérer les logiques économiques qu'ils recèlent sur la structuration de l'offre.
Elles vont dans le sens d'une diffusion du modèle dominant. Mais il n'est pas envisageable que cette diffusion soit accessible à tous. Ainsi, ici comme ailleurs, le progrès technique devrait s'accompagner d'une segmentation plus forte de l'offre agricole, l'ensemble des producteurs ne pouvant réagir de façon homogène à ce choc de productivité.
Cette perspective pose un problème de taille : la subsistance d'exploitations familiales plus marginalisée encore qu'aujourd'hui.
La constitution d'un oligopole alimentaire ne ferait pas que remettre en cause l'existence de ces petits exploitants.
À travers, elle mais aussi parce qu'un oligopole ne maximise généralement pas sa production mais plutôt ses marges, tout l'équilibre du système alimentaire mondial pourrait être atteint.
Dans un tel « monde agricole », la faim resterait pour longtemps un problème aigu.
Rares sont les perspectivistes qui aujourd'hui envisagent l'horreur agro-alimentaire. Il existe pourtant quelques « signaux (plus ou moins) faibles » pour témoigner que cette prospective retiendra, certainement plus que les opportunités d'une « Révolution doublement verte », l'attention dans les années qui sont devant nous.
Aux yeux de votre rapporteur cette inquiétude est légitime.
Elle n'est pas le résultat d'un refus systématique du « progrès ». Il est absolument légitime que celui-ci soit évalué mais le principe de précaution n'équivaut pas à s'abstenir de toute action, de tout progrès. Au contraire, il faudrait mieux prendre la mesure de ses prolongements en ne refusant pas, par principe, de considérer que le principe de précaution puisse dicter d'entreprendre, plutôt que de s'abstenir.
C'est d'une autre « entrée » que votre rapporteur s'inquiète des prolongements d'un système agro-alimentaire qui suivrait la plus grande pente soit celle où les progrès de productivité ne seraient pas maitrisés.
Il existe à cet égard une crainte « raisonnable » (c'est-à-dire dont l'expression est politiquement correcte). Elle part de la perspective de voire s'accentuer la segmentation des producteurs agricoles au point où nombre d'entre eux disparaîtraient. La production agricole pourrait en être plus ou moins affectée. Les petits exploitants perdraient la source de leur revenu sans certitude sur leur capacité à en trouver d'alternative dans des pays où les autres secteurs sont plus ou moins structurellement sous-dimensionnés.
De façon plus hardie, on peut évoquer la confiscation du progrès technique par un oligopole qui ne manquerait pas d'avoir des incidences encore plus défavorables sur ce système85(*).
Une telle perspective doit, en particulier, être prise en considération quand on envisage la course des techniques. Elle conduit à au moins deux conclusions :
- il n'est pas raisonnable de se retirer de cette course quand on prétend agir pour l'intérêt général ce qui revient à laisser ouvert son champ aux seuls intérêts privés ; à cet égard, il est de la responsabilité de chacun de défendre la recherche agricole publique dans notre pays ;
- mais, il faut aussi maîtriser cette course et ses effets ce qu'aucune institution n'apparaît vraiment capable de faire faute d'un point de vue partagé sur ce point, dans le monde et en Europe.
Plus globalement, le développement agricole doit rester, ou, plutôt, revenir, sous la maîtrise des acteurs qui, seuls, peuvent l'appréhender pour ce qu'il est, c'est-à-dire, sous de nombreuses facettes, un véritable bien public.
CONCLUSION
Le Monde a le potentiel agricole nécessaire pour nourrir la population qu'il accueillera dans les prochaines années. Mais, cet objectif ne sera atteint qu'au prix d'une augmentation considérable des moyens alloués à l'agriculture pour accroître la production mais aussi pour la rendre plus durable.
Cette contrainte s'imposera avec une force particulière aux pays les plus en retard de développement. Le Monde ne peut pas se passer de la contribution de leurs agricultures.
Surtout, on ne pourra remporter le défi alimentaire, qui est celui de la mise en oeuvre effective du droit à l'alimentation, sans leurs agriculteurs. Gagner le pari alimentaire, c'est gagner le pari du développement et c'est donc respecter la pluralité des modèles que celui-ci appelle.
Dans l'histoire, l'agriculture a globalement été une affaire d'État. Ses enjeux sont vitaux pour la population et ils sont vitaux pour les États par delà même les régimes politiques.
À part les hommes, il est probable que les premiers décomptes statistiques ont concerné les aliments, du moins les surfaces capables de les produire.
Depuis une vingtaine d'années, l'agriculture a de moins en moins été l'affaire d'État qu'elle fut historiquement. Elle a été davantage une affaire de marchés.
S'agissant du développement agricole, cette évolution qui concorde avec l'esprit du consensus de Washington a pu naître d'un certain découragement devant les résultats jugés mitigés de l'aide publique internationale et, localement, de l'absence de ressources, combinée avec une révision des priorités du développement plus ou moins imposée par les institutions internationales et avec des intérêts plus troubles. C'est dans tous les domaines que les acteurs de marché ont accru leur influence. Au stade de la production avec les fournisseurs des moyens de production de l'agriculture moderne, au stade de la distribution avec les grands industriels de l'agro-alimentaire et les chaînes de distribution. Mais, c'est aussi vrai des acteurs de la périphérie, tels que les opérateurs financiers pour lesquels les actifs agricoles sont plus ou moins souvent des positions vouées aux arbitrages. Cette privatisation de l'agriculture se vérifie même pour les « pilotes » du système alimentaire. L'extraordinaire puissance d'intervention de la fondation de Mme Melinda et de M. Bill Gates qui, selon la « Heinrich Böll Stiftung » aurait investi 1,4 milliard de dollars entre 2006 et 2009 pour promouvoir une « nouvelle révolution verte » quand le budget 2010-2011 de la FAO atteint à peine 1 milliard de dollars, en témoigne abondamment.
Dans ces conditions, on devrait s'incliner et considérer, plus que jamais, que l'agriculture est devenue un secteur comme un autre, un secteur devant être pleinement régulé par les mécanismes de marché.
Cette conclusion est d'autant plus tentante que le système alimentaire mondial est un système intrinsèquement complexe.
Pourtant, cette dernière caractéristique tentante aussi le motif qui conduit à récuser les solutions monolithiques que recouvre le recours aux seuls marchés ou aux seules interventions collectives.
Il peut y avoir un écart significatif entre le renforcement du rôle des mécanismes économiques ordinaires, les bénéfices qu'on en attend et ceux qu'on en retire effectivement.
Si, appliqués à l'agriculture, les mécanismes de marché permettaient de réunir les conditions de la sécurité alimentaire, il faudrait s'y rallier sans hésitation.
Malheureusement, il n'en va pas ainsi et il est à craindre que dans le futur les défaillances du marché persistent et que s'amplifient les distorsions qu'elles engendrent par rapport à une trajectoire permettant d'atteindre la sécurité alimentaire dans le monde.
Autrement dit, votre rapporteur, sans pour autant porter un jugement de condamnation de principe sur les marchés, et en reconnaissant même leur contribution à celle-ci, se rallie constant selon lequel la sécurité alimentaire est, par de nombreuses facettes, un bien public.
Bien public certainement du fait des enjeux vitaux d'un droit à l'alimentation s'exerçant réellement, mais bien public aussi parce que, spontanément, les agents économiques n'en garantissent pas l'instauration quand ils ne vont pas jusqu'à en éloigner le monde.
Cette façon de voir la sécurité alimentaire comme un bien public ne devrait pas beaucoup choquer sous nos latitudes puisque nous sommes, Européens ou citoyens des États-Unis, habitués à ce que s'en déroulent les conséquences, à savoir des interventions publiques destinées à créer ce que le marché n'aurait pas permis. Si les moyens diffèrent et évoluent, il reste que nous, pays occidentaux, attribuons aux agriculteurs des soutiens publics sans lesquels notre sécurité alimentaire ne serait plus aussi complètement maîtrisée qu'elle l'est aujourd'hui. Il faut ajouter que ces soutiens sont accordés alors même que nos économies sont assez développées pour que la productivité agricole y atteigne un haut niveau et assez diversifiées pour que les passages d'un secteur économique à un autre n'y butent pas systémiquement sur la rareté des opportunités de participation à la production nationale.
Pourtant, il faut reconnaître que cette idée a été un peu perdue de vue. Un certain « économisme » a prévalu pour la remettre en cause ou, du moins, sans l'afficher toujours clairement, opérer une critique systématique des moyens déployés pour parvenir à la sécurité alimentaire par le truchement des politiques publiques.
Il faut regretter que l'analyse économique puisse être dévoyée au point que des critiques ponctuelles, soient généralisées sans les précautions nécessaires et que les évaluations auxquelles elle contribue utilement quand elle est réaliste deviennent de simples instruments rhétoriques au prix de sa dénaturation.
Dans ce processus, la négligence ad hoc des conditions de validité des paradigmes économiques joue un rôle qu'on peut qualifier de gravement négatif.
Poser que les marchés agricoles, dont pourtant les singularités sont connues depuis toujours, sont des marchés comme tous les autres relève d'une telle négligence. De même, ignorer l'existence et les tendances très fortes à la segmentation des acteurs du système alimentaire mondial et donner de celui-ci la représentation d'un jeu entre des intervenants également atomisés c'est abuser de l'abstraction et c'est surtout commettre une erreur aux conséquences dévastatrices au regard du sujet même du présent rapport, le défi alimentaire.
En réalité, en agriculture plus encore que dans bien des domaines économiques, c'est au principe de subsidiarité (qui est aussi un principe de complémentarité) qu'il faut revenir. C'est lui qui doit ordonner le champ respectif des mécanismes du marché et des interventions collectives et, dans ce dernier domaine, c'est lui qui doit être le soubassement de l'architecture de l'institutionnalisation du droit à l'alimentation comme bien public mondial.
Car c'est bien à celle-ci qu'appelle le présent rapport.
Institutionnaliser le droit à l'alimentation c'est d'abord prendre au sérieux la déclaration universelle de ce droit.
Elle doit obliger et les obligations correspondantes doivent pouvoir être sanctionnées. En bref, la normativité du droit à l'alimentation doit être renforcée à tous les niveaux, international, régional, national.
Dans notre ordre juridique, notre droit civil comporte des obligations strictes de ce point de vue. Dans la sphère collective, les minima sociaux, les compétences sociales des collectivités territoriales, et leur action, se rattachent déjà à la préoccupation de votre rapporteur. De même, la fiscalité particulière des dons aux organismes caritatifs témoigne d'une intention. On peut même éprouver le sentiment d'un certain foisonnement. Sans doute serait-il utile de faire un peu de clarté sur cet ensemble.
Au plan européen, l'actualité est marquée par les débats autour de la renationalisation des actions d'aide alimentaire. Ils ne sont pas d'emblée illégitimes. Mais ils devraient être précédés par une réflexion sur les voies d'une sécurisation juridique du droit individuel à l'alimentation dans une Europe où la pauvreté déjà répandue est en voie d'extension.
Une telle réflexion doit aboutir également au niveau mondial.
Mais institutionnaliser le droit à l'alimentation, c'est aussi solidifier le gouvernement agricole du monde et lui donner les moyens des ambitions qu'on doit lui fixer.
Cette recommandation pourra apparaître quelque peu grandiloquente. D'une certaine manière son objet en est une excuse tandis que son contenu programmatique, votre rapporteur en fait le souhait, l'absout d'un travers que partagent trop systématiquement les grands messes qui, régulièrement, ponctuent les désastres alimentaires mais restent stériles et sans lendemain.
Institutionnaliser le droit à l'alimentation, c'est construire une organisation internationale à la hauteur du défi alimentaire.
L'architecture des institutions internationales dont l'activité touche plus ou moins directement l'agriculture est particulièrement complexe et, classiquement, contradictoire. Il en résulte que le droit à l'alimentation comme bien public mondial n'a pas encore d'institutions adaptées pour le promouvoir. Cette lacune doit être comblée. En outre, le financement du droit à l'alimentation doit être assuré.
Les institutions de Bretton Woods (FMI et Banque mondiale) accomplissent des missions qui ont un impact, plus ou moins direct mais très puissant, sur le développement agricole. Le FMI intervient plutôt dans les situations de crise des paiements tandis que la Banque mondiale, comme les autres banques multinationales de développement, est chargée de financer les actions de développement plus structurelles.
Dans l'un et l'autre cas, l'agriculture est souvent concernée. C'est évident s'agissant de la Banque mondiale compte tenu de la place qu'occupe l'agriculture dans les problématiques de développement. Mais c'est également vrai pour le FMI puisque ses interventions sont systématiquement conditionnées à des réformes qui, dans la plupart des pays où il intervient, impliquent l'agriculture.
Au prix d'une certaine simplification peut-être, on peut affirmer que le soutien public à l'agriculture n'a pas été une priorité de ces institutions.
Globalement, les interventions du FMI se traduisent par des exigences de réformes structurelles qui impliquent des reculs de l'intervention publique au nom de l'assainissement budgétaire et des réformes structurelles faisant plus de place aux mécanismes de marché.
Pour la Banque mondiale, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, le financement du développement agricole, qui a chuté, n'était pas considéré comme une priorité. Le rapport de la Banque pour 2008 abondamment cité dans le présent rapport constitue de ce point de vue un signal fort mais dont les effets concrets demandent un peu de recul pour les évaluer plus complètement.
|
Les activités de la Banque mondiale pour la sécurité alimentaire en 2008-2009 selon le rapport du Ministère de l'économie, des finances et de l'Industrie En matière de sécurité alimentaire, la Banque mondiale a été l'une des institutions les plus réactives face à la crise alimentaire de 2008, en créant un programme de réponse de 1,2 Md USD, dont 200 M USD provenant du revenu net de la Banque, le reste ayant été constitué par réallocation de ressources. La taille de ce programme a été portée à 2 Mds USD en avril 2009. Il doit permettre de renforcer les filets de protection sociale dans les pays pauvres, améliorer les infrastructures rurales et augmenter la productivité agricole. Elle est l'une des principales institutions représentées dans la Task Force de Haut Niveau des Nations Unies, dont l'un des objectifs est de contribuer à une meilleure coordination des institutions et des politiques concourant à la sécurité alimentaire, dans l'esprit du Partenariat Mondial appelé de ses voeux par le Président Nicolas Sarkozy le 3 juin 2008, lors du Sommet de la FAO à Rome. La Banque mondiale renforce en outre ses investissements agricoles à moyen et long terme : le Groupe Banque mondiale consacre 4,2 MdsUSD par an aux investissements en faveur du secteur agricole au travers de trois de ses principales institutions 1,1 MdUSD pour la BIRD, 1,8 MdUSD pour l'AID et 1,2 MdUSD au titre de la SF1. À ceci s'ajoute l'apport, modeste, de fonds fiduciaires (132 millions USD dont 70 % provenant du Fonds pour l'environnement mondial). Le plan d'action pour l'agriculture pour la période 2010-2012 prévoit un renforcement significatif du soutien à l'agriculture (dans une fourchette de 6,2 MdsUSD/an à 8,3 MdsUSD/an, en lien avec les orientations de la communauté internationale action complémentaire de celles du FIDA, de la FAO et du GCRAI (Groupe consultatif pour la recherche agronomique internationale), appui au CAADP (programme intégré pour le développement de l'agriculture en Afrique). |
Les institutions onusiennes comprennent au premier chef la FAO (Food and Agriculture Organisation) créée en 1904. Elle réunit des compétences techniques exceptionnelles et sa culture la conduit à être plus attentive aux questions de développement. Pourtant, cette logique ne trouve pas toujours tous les prolongements effectifs qu'on pourrait en attendre. Peut-être cette situation vient-elle l'existence de positions dominantes de doctrine un peu unilatérales que la structure exécutive de l'organisation favoriserait.
À cet égard, il faut se féliciter de l'ouverture des points de vue diversifiés du Comité de la sécurité alimentaire de la FAO. Mais ce sont également les moyens financiers qui font défaut à celle-ci. Avec un budget limité à quelque 1 milliard de dollars, les moyens opérationnels de l'organisation sont sans proportion avec ce qu'il faudrait.
Il serait peu utile de refonder les institutions existantes si une politique agricole mondiale n'était pas nécessaire.
Les attributions importantes, mais limitées des organisations multilatérales peuvent être assumées dans les cadres actuels de ces organisations, moyennant toutefois des processus de coordination plus efficaces entre elles.
Sur ce plan, les nouvelles formes de coordination internationale type G8, G20 exercent un rôle ambigu en assurant l'émergence d'initiatives consensuelles mais en créant également de nouveaux besoins de coordination entre ces initiatives que ces agoras n'ont pas les moyens de suivre et les activités des organismes permanents qu'elles peuvent bousculer.
Sur un autre plan, celui des relations bilatérales, l'éparpillement pose à l'évidence un problème.
Il aboutit à des concurrences mal maîtrisables entre bénéficiaires et États fournissant les soutiens, qui peuvent se traduire par des concentrations inéquitables et inutiles des aides.
Mais, c'est bien parce qu'une politique agricole mondiale intégrée doit voir le jour qu'il faut refonder les institutions internationales qui recevront la mission de la définir et d'en piloter la mise en oeuvre.
Ces institutions devraient coiffer un dispositif intégré dimensionné par référence au principe de subsidiarité.
Il serait vain d'imaginer qu'un gouvernement mondial de la sécurité alimentaire puisse à partir d'une capitale mondiale s'occuper des champs du monde.
Chaque échelon doit exercer les compétences qu'il est le mieux à même d'accomplir et assumer pleinement les responsabilités correspondantes.
Cela ne signifie pas que ces échelons soient disjoints les uns des autres. C'est au contraire en fonction des besoins manifestes d'intégration qu'il faudra prévoir un cadre cohérent de relations entre les divers niveaux.
De même, il ne faut pas imaginer une architecture uniforme déclinée spatialement.
À cet égard, l'idée de fonder la réponse au défi alimentaire sur l'instauration de politiques agricoles communes régionales est séduisante dans la mesure où elle transpose un cadre de politique agricole à laquelle la France est accoutumée et parce qu'elle manifeste une volonté d'intervention publique considérée comme une nécessité par la quasi-totalité des prospectives du défi alimentaire.
Pour autant, elle ne semble trouver, ni dans la réalité des relations internationales, ni dans les situations économiques et agricoles du monde la base solide qui permettrait de lui conférer une portée pratique et une justification analytique sans failles.
La fondation d'une politique agricole commune suppose que des politiques agricoles préexistent plus ou moins, mais surtout que des intérêts et des moyens puissent être échangés entre les membres qui forment la communauté. Régionalement, ces conditions peuvent être « introuvables ». En revanche, elles peuvent rassembler des échelons différents.
Si le droit à l'alimentation est promu à la dignité de bien public mondial, il va de soi que l'institution supérieure qui en sera en charge trouvera toujours matière à développer des relations avec d'autres échelons qui, de leur côté, pourraient ne pas trouver de points d'ancrage régionaux à des initiatives réciproques.
L'organisation mondiale en charge de la politique agricole devra être organisée sur un mode qui ne soit pas étroitement intergouvernemental. Une représentation diversifiée s'inspirant de celle qui devrait désormais être assurée dans le cadre du Comité de sécurité alimentaire de la FAO devra être garantie.
Par ailleurs, l'organisation devra disposer de moyens financiers nécessaires à sa mission. Les ressources de la Banque mondiale correspondant à ses interventions agricoles pourraient lui être affectées. Mais, ces ressources sont insuffisantes, même cumulées avec celles de la FAO, pour engager une politique agricole efficace. Celle-ci suppose que les investissements nécessaires soient financés mais aussi que la transition agricole soit accompagnée, en particulier par des filets de sécurité, et que des stocks soient garantis.
Compte tenu de l'ampleur des besoins d'investissement à quoi s'ajoutent les financements nécessaires aux actions complémentaires envisagées mais aussi à la R&d, les financements correspondant ne pourront vraisemblablement pas être dégagés sur les ressources courantes des États.
Un prélèvement mondial pour financer le droit à l'alimentation dans le monde devra être défini.
Par sa permanence, il rompra heureusement avec la série des engagements ponctuels des États, qui sont de façon systématique, imparfaitement suivis d'effets.
Il est urgent de réunir un comité international de préfiguration de l'institutionnalisation d'une volonté politique qui veuille vraiment abolir la faim dans le monde. Elle ne saurait, aux yeux de votre rapporteur, négliger la nécessaire dimension humaniste des solutions propres à cette ambition.
EXAMEN EN DÉLÉGATION
Au cours de sa séance du mercredi 18 avril 2012, la délégation sénatoriale à la prospective, réunie sous la présidence de M. Joël Bourdin, a examiné le présent rapport.
M. Joël Bourdin, président. - Notre délégation a confié à Yvon Collin le soin de réfléchir sur l'horizon alimentaire à l'horizon 2050. Je lui laisse la parole, le remerciant d'avance de sa contribution.
M. Yvon Collin, rapporteur. - Ce rapport est consacré à ce qu'on appelle couramment « le défi alimentaire », à l'horizon 2050. Il existe sur ce sujet de grandes prospectives dont je me suis inspiré en m'efforçant d'apporter quelque chose de nouveau. J'ai pris le parti de me situer dans la posture, la seule qui vaille, d'un abolitionniste de la faim dans le monde.
Généralement, les prospectives répondent à la question de savoir si le potentiel de production agricole de la planète suffira pour satisfaire une demande croissante. Il s'agit, en d'autres termes, de savoir si nous avons les moyens de produire dans les prochaines décennies autant que ce que l'agriculture mondiale a produit depuis l'an 1500.
Le rapport place la réflexion sur le terrain de la mise en oeuvre effective du droit individuel à l'alimentation, droit consacré par les Nations unies et pourtant négligé. La dimension socio-économique du problème ne doit donc pas être considérée comme une variable exogène.
Il y a quelques mois, j'avais insisté sur l'extrême complexité du système alimentaire, fait de multiples variables interdépendantes que l'on est assez loin de maîtriser. Ce n'est pas en intégrant les dimensions économiques et sociales que l'on va se simplifier la tâche ! Il faut pourtant bien le faire, si l'on ne veut pas tenir un propos vain.
Dans une première partie du rapport, je précise les perspectives d'augmentation des besoins alimentaires au regard des performances passées du système alimentaire. Il faudra progressivement doubler la production agro-alimentaire pour satisfaire les besoins alors que la faim a recommencé à progresser dans le monde. J'insiste sur les incertitudes touchant à l'ampleur de l'augmentation de la demande. Outre le facteur démographique, il faut prendre en compte des questions aussi importantes que les régimes alimentaires - comme disait Chamfort, il y a ceux qui ont plus de dîners que d'appétit et ceux qui ont plus d'appétit que de dîners - les pertes et gaspillages, ou encore les écarts entre la demande potentielle et la demande solvable.
La deuxième partie examine le potentiel agricole. Quid des terres disponibles ? Et des rendements ? Ma troisième partie est consacrée à la montée des tensions due à l'intensification de différents conflits d'usage et à la perspective d'une modification du régime des prix alimentaires. Enfin, après avoir examiné les besoins d'investissement, j'esquisse une géo-alimentation de demain.
Le premier message est que le potentiel agricole du monde est soumis à de grandes incertitudes qui vont encore s'accroître et qu'il connaît de profondes disparités régionales.
Au premier examen, les facteurs de production agricole paraissent suffire et certains prospectivistes suggèrent l'existence d'options entre des modèles extensifs ou intensifs de développement productif, avec plusieurs combinaisons d'hommes, de terres et de capital technique. Reste que le potentiel agricole est soumis à nombre d'incertitudes et d'aléas.
Les terres vont être soumises à de redoutables conflits d'usage. Je passe sur la nécessité de limiter des effets indésirables sur l'agriculture, comme la déforestation. J'insiste en revanche sur l'incidence de la production d'agro-carburants : celle-ci a beaucoup augmenté alors qu'elle n'est viable que grâce aux soutiens publics. Il est vraisemblable qu'à l'avenir les besoins énergétiques justifieront cet usage des sols ; on peut donc s'attendre à un effet d'éviction renforcé sur les terres agricoles à destination alimentaire. Il faut aussi prendre toute la mesure des conséquences du changement climatique ou de la raréfaction de l'eau. Ces événements auront des incidences localement catastrophiques.
On peut aussi craindre que les rendements agricoles ne plafonnent dans de nombreux pays, développés ou ayant engrangé les bénéfices de la révolution verte. Dans ces pays, le progrès technique devrait se faire à coûts croissants s'il se fait. Le coût serait moindre et les progrès moins aléatoires si les pays en retard de développement opéraient leur rattrapage.
Mon deuxième message est que l'équilibre du système alimentaire va passer par une modification de la géographie agricole mondiale. Dans les pays développés, les rendements pourraient s'élever grâce à des biotechnologies comme les OGM. Mais les marges de manoeuvre ne doivent pas être surestimées. Par contraste, de grandes nations agricoles s'éveillent en Amérique du Sud, dans les grandes plaines de l'est, en Ukraine ou en Russie.
Troisième message : pour mettre en oeuvre le droit à l'alimentation, il faudra que le potentiel agricole de tous les pays en retard de développement soit exploité. Il n'est ni souhaitable ni possible de se reposer sur les seuls grands pays émergents pour assurer l'équilibre alimentaire du monde, sachant toutefois qu'il est exclu qu'on puisse aboutir à l'autosuffisance alimentaire partout. Les interdépendances se renforceront et elles devront être régulées.
Il y a à cela une autre raison : pour autant, pour nombre d'hommes et de femmes dans le monde, le développement agricole est la seule manière de sortir de la pauvreté. La remarque peut paraître aller de soi, elle va pourtant à rebours du modèle de développement qui l'a emporté depuis le consensus de Washington adopté sous l'influence de Milton Friedman, le gourou de l'ère Thatcher-Reagan. Les politiques mises ainsi en oeuvre ont échoué et il est réconfortant de voir la Banque mondiale le reconnaître dans son rapport de 2008. J'y reviendrai car il faut toujours se méfier des conversions tardives.
Mon quatrième message est que l'exploitation de ce potentiel est suspendue à des conditions qui ne sont pas réunies, en particulier pour ce qui concerne l'investissement agricole. L'opinion mondiale a été sensibilisée par la FAO à la nécessité d'investir 83 milliards de dollars par an dans le secteur pour vaincre la faim. Encore ne s'agit-il que des besoins d'investissement net. Ceux d'investissement brut atteignent les 200 milliards, chiffre que je crois lui-même sous-estimé car le multiplicateur d'investissement retenu par la FAO est excessif. Il faudra bien plus pour atteindre les gains de productivité indispensables à la croissance du revenu des agriculteurs. J'ajoute que la vision du développement agricole que propage la FAO n'est pas assez ambitieuse pour l'Afrique. Les rations alimentaires sont trop basses et on a perdu de vue que, pour payer la main-d'oeuvre de son travail, il faut réaliser des gains de productivité par tête. Je me hasarderai à évaluer le besoin d'investissement agricole à plus de 110 milliards de dollars par an. C'est l'étiage !
Mon cinquième message est que notre modèle de développement agricole est sérieusement menacé. Historiquement l'agriculture est la chose de l'État or nous n'avons rien inventé de mieux que d'engager les États à se retirer de l'agriculture. On suit une ligne absolutiste de libéralisation du commerce agricole international alors que cela aura des effets incompatibles avec le développement agricole qu'il faudrait promouvoir. L'aide publique au développement agricole s'est effondrée. Les institutions internationales sont dispersées et suivent des logiques contradictoires et dénuées de cohérence.
Les mécanismes de marché renforcent leur emprise sur l'économie agricole et les initiatives privées ne manquent pas avec des résultats qui sont au mieux indéterminables. J'ai en tête l'engagement des donateurs privés au premier rang desquels la fondation Melinda et Bill Gates dispose d'un budget qui excède celui de la FAO et les engagements financiers habituels de la Banque mondiale dans le secteur agricole. Un tel engagement est sans doute appréciable mais il est fondé sur une conception qui peut ne pas concorder avec les priorités du développement que pourraient concevoir des États démocratiques.
Je pourrais parler de « marchéisation » pour décrire l'arrivée massive d'investisseurs financiers dans l'économie agricole. La concentration dans le secteur a progressé. Même si elle ne distribue pas seulement des produits alimentaires, pensez que Walmart est devenue la première entreprise mondiale ! La perspective de marchés en expansion, les chocs technologiques et l'anticipation de tensions sur l'offre et les prix sont propices à des phénomènes de rationalisation économique s'accompagnant d'une segmentation toujours plus poussée de l'agriculture. Dans cette situation, le sort des petits exploitants familiaux pourrait se détériorer alors même que c'est sur eux que l'on doit compter pour relever le défi alimentaire. Le renforcement du rôle des fournisseurs d'intrants et de semences aggraverait leurs perspectives en les soumettant à un effet d'enclume, entre distributeurs et fournisseurs. La concentration ne s'accompagne pas d'une maximisation de la production mais des marges ! Le risque existe que les seuls rendements exploités soient les rendements financiers alors que le monde a besoin de rendements agricoles. Et des États peuvent se montrer de plus en plus prédateurs. Je pense à la course aux terres et aux dispositions spéculatives avec limitation des exportations.
Pour éviter cette horreur alimentaire il faut résoudre notre équation alimentaire en lui attribuant la qualité d'authentique bien public. Cela passe par une réorganisation de la gouvernance mondiale et par l'affectation des moyens nécessaires. Il est dommage que la France n'ait pas mis cette question à l'agenda de sa présidence du G20. Il ne s'agit pas de renoncer aux mécanismes de marché mais de savoir remédier à leurs défaillances. Une mobilisation sans précédent est indispensable pour abolir la faim.
M. Joël Bourdin, président. - Je vous remercie de nous donner la primeur de cet excellent rapport.
M. Jean-Pierre Sueur. - Je regrette que le sujet n'ait pas toute sa place dans les débats actuels et je souhaite à ce rapport le retentissement qu'il mérite. Peut-on imaginer qu'il fasse l'objet d'un débat en séance publique ?
Nous avons un problème d'usage du sol. On sait qu'en France, tous les sept ans, disparaît l'équivalent d'un département en surface agricole, au profit des villes dont la population s'accroît de 200 000 personnes par jour dans le monde. À ce phénomène s'ajoute le développement de l'agro-carburant. Dans ces conditions, comment préserver la ressource en terre agricole dans le monde ? Vous parlez également de l'idéal de l'autosuffisance : il est vrai que l'agriculture pâtit d'un monde où la spéculation est déconnectée de l'économie réelle. Si l'on souhaite conserver une économie de marché, la puissance publique doit veiller à préserver les ressources agricoles. Vous avez évoqué un besoin de 110 milliards de dollars par an : il faut faire pression sur la communauté internationale pour qu'elle procède à des investissements.
M. Joël Bourdin, président. - Il est possible d'organiser un débat en séance publique dans une niche, comme cela a été fait sur l'obésité par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Je crois que c'est une bonne idée.
M. Jean-Pierre Sueur. - Un débat qui suscite la participation du plus grand nombre !
M. Yvon Collin, rapporteur. - Je ne peux que souhaiter le retentissement le plus large possible à ce rapport.
M. Jean-Pierre Sueur. - Cela pourrait se faire dans le cadre de notre semaine de contrôle.
M. Yvon Collin, rapporteur. - La politique pavillonnaire a joué un grand rôle dans la perte des surfaces agricoles. Ce mitage a commencé dans les années soixante et l'on n'a pas su le maîtriser. Dans un département à vocation agricole comme le mien, les maisons envahissent le paysage et, selon le règlement sanitaire départemental, une seule maison gèle trois hectares de terres. Le mitage est en grande partie responsable de la perte des surfaces agricoles.
Mme Fabienne Keller. - Ce rapport embrasse un sujet très large et très stratégique pour lequel la prospective me semble la bonne échéance.
N'y-a-t-il pas un sujet de modèle de consommation alimentaire à infléchir tout en gardant les traditions et les usages sur chaque continent ? La consommation de protéines animales est très coûteuse en termes de produits végétaux...
J'avoue être perdue entre l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Il me semblait que l'autosuffisance avait l'avantage d'immuniser les États contre la fluctuation des prix mondiaux, lesquels sont très variables, puisqu'il s'agit de prix d'excédents. Comment désensibiliser les populations les plus pauvres ? Les pays africains qui équilibrent leur panier par des importations ne sont-ils pas trop exposés ?
Je m'étonne que des études mentionnées dans votre rapport prévoient une forte progression de la production alimentaire de l'Afrique sub-saharienne, tant en termes de surfaces qu'en termes de productivité. J'avais cru comprendre que la région était particulièrement exposée aux aléas climatiques.
Vous dégagez quelques axes forts autour desquels le travail doit se poursuivre : la pertinence de la filière de production d'éthanol à partir de produits agricoles, la question des OGM ou de l'agriculture irriguée, l'urbanisation et ses conséquences sur le milieu rural.
M. Yvon Collin, rapporteur. - Les chiffres que vous évoquez au sujet de l'Afrique sont inspirés par la FAO. L'autosuffisance doit évidemment demeurer l'objectif mais les structures actuelles ne la rendent pas possible ; c'est un horizon pour l'action mais il faut anticiper les interdépendances pour mieux les maîtriser.
Il est vrai que les modèles de consommation évoluent : dès que le niveau de vie s'élève, la consommation de viande s'accroît ; or la production d'un kilo de viande nécessite plusieurs tonnes de fourrage, d'eau.
Je ne considère pas les OGM comme la panacée. En France, nous sommes un peu frileux : il faudrait trouver un équilibre entre recherche et immobilisme, en gardant à l'esprit la composante positive du principe de précaution.
Mme Fabienne Keller. - L'OGM ne serait-il pas plus acceptable s'il permettait de disposer d'un riz qui consommerait moins d'eau ?
M. Yvon Collin, rapporteur.- Un OGM qui résiste à tout stress hydrique n'est pas nécessairement envisageable, mais la France doit poursuivre la recherche et ne pas se laisser dépasser. C'est un sujet que nous devons aborder franchement. On doit aussi être réaliste sur la production bio, dont les rendements sont généralement inférieurs.
M. Joël Bourdin, président. - Le rapport donne-t-il des indications sur la course aux terres en Asie du Sud-Est et en Afrique ? Le coup d'État à Madagascar doit beaucoup à la vente de territoires à la Chine par l'ancien président.
Quid des effets du réchauffement climatique ? Il semble que le cacaoyer, qui pousse dans le Golfe de Guinée, souffre du réchauffement et que le cacao pourrait devenir aussi rare que la truffe... D'autres grandes denrées sont-elles touchées ?
On confronte l'évolution d'une demande alimentaire à une offre potentielle, elle-même fonction d'une technologie existante : entre la technologie et la demande n'y a-t-il pas autre chose qui interfère ? En Afrique, l'offre de terres est considérable en Angola, en Zambie, au Zimbabwe, avec à la fois le soleil et l'eau. Et pourtant c'est zéro. La carence est politique.
Quid du rôle des marchés financiers ? Les marchés à terme ont une très grande utilité mais des évolutions erratiques des prix peuvent gêner le système productif. A-t-on une évolution optimiste à espérer ?
La concurrence entre les biocarburants et l'alimentation va-t-elle perdurer à long terme ?
M. Yvon Collin, rapporteur. - Il faut souhaiter que les biocarburants de deuxième et troisième génération arrivent bientôt sur le marché car on peut s'inquiéter des effets de ceux de la première génération sur la production agricole à vocation alimentaire. Les biocarburants sont apparus comme un bon moyen de diversification des ressources énergétiques, mais au détriment de cultures vivrières, avec un effet dramatique sur le défi alimentaire.
C'est une litote de dire que la course aux terres a commencé. Des pays comme la Chine y sont déjà bien engagés. À ce sujet, je vous invite à consulter le rapport du centre d'analyse stratégique. Certains pays à fort potentiel comme le Brésil ou l'Argentine réagissent aux convoitises des spéculateurs.
Je comprends les angoisses du président Bourdin sur l'épuisement de la ressource cacao ! Il est vrai qu'il n'est pas seul concerné. Le réchauffement pourrait paradoxalement être favorable aux pays tempérés. Nous ne serons pas les plus pénalisés. Il faut prendre en compte ce facteur quand on réfléchit à la responsabilité agricole de l'Europe.
Le G20 a fait un important travail sur les orientations et la régulation des marchés. Il faut aller plus loin, avec le concours de notre commission des finances.
La délégation à la prospective a décidé, à l'unanimité, d'autoriser la publication du présent rapport.
ANNEXES
* 1 1 exacal=1018 calories.
* 2 On doit relever qu'ils excluent généralement la survenance d'événements dont la vraisemblance ne peut pas être discutée comme les grandes catastrophes ou les prodiges. Or, si le pire n'est jamais sûr, il peut advenir, de même que les « miracles ».
* 3 Une part seulement de ceux-ci sont attribuables aux conditions de consommation mais pour la commodité de l'exposé, on traitera ensemble avec celle-ci les déperditions observées au stade de la production.
* 4 L'augmentation de certaines formes d'inégalité dans la distribution des revenus des pays en développement, si elles se poursuivaient pourront singulièrement affecter la demande solvable. L'équation alimentaire ne serait simplifiée mais au prix d'une sous-alimentation persistante, qui est une hypothèse inacceptable mais, malheureusement pas irréaliste au vu des données actuelles du problème alimentaire.
* 5 L'arrimage des monnaies de nombre de pays en développement à des devises internationalement « consacrées » déjà enjeu crucial pour ces pays, pourrait demain représenter des enjeux encore plus importants dans un monde de plus en plus polycentrique du point de vue monétaire et où la « guerre des monnaies » ferait rage.
* 6 En outre, les prospectives de la demande alimentaire ne suffisent pas à estimer la « demande d'agriculture » qui doit prendre en compte les usages non alimentaires du secteur. À cet égard, une attention particulière doit être consacrée à la demande d'agro-carburants.
* 7 Dans cette hypothèse, 4 % de la population des pays en développement resterait en état de sous-nutrition en 2050.
* 8 Cependant, les produits carnés, qui posent d'autres problèmes nutritifs, répondent également à des besoins perçus comme tels par les consommateurs.
* 9 Toutefois, une partie des calories végétales ainsi absorbées peut ne pas entrer en concurrence avec l'alimentation humaine comme pouvant être impropre à celle-ci.
* 10 Des références plus élevées compliqueraient l'équation alimentaire.
* 11 Compte tenu des résultats de la projection des productions céréalières exposés par ailleurs, les importations nettes des pays en développement couvriraient une part de plus en plus importante de leurs besoins (de 9,7 à 14,7 % de ceux-ci) malgré le ralentissement de la croissance de la demande de céréales que comporte ce scénario.
* 12 Compte tenu de la connexité des phénomènes, on évoquera ici, ensemble avec le problème des gaspillages, celui des pertes.
* 13 Institut de Vienne.
* 14 « L'organisation de la recherche et ses perspectives en matière de prévention et de traitement de l'obésité » 8 décembre 2010, de Mme Brigitte Bout.
* 15 Ce qui justifie qu'ils soient abordés ici.
* 16 Cette question est abordée par ailleurs dans le présent rapport.
* 17 La même qui a efficacement promu le monétarisme, l'efficience des marchés et la critique systématique de l'intervention de l'État.
* 18 Mais sans pour autant qu'on doive systématiquement accorder à celle-ci un rôle de précurseur du développement économique global. La question du rôle de l'agriculture dans le décollage économique est particulièrement débattue.
* 19 Il faut ajouter que le Comité pose que « chaque État a l'obligation fondamentale d'adopter les mesures nécessaires pour lutter contre la faim, même en période de catastrophe naturelle ou autre ».
* 20 Assurances qui ont fait place au-delà, notamment à la suite de la crise globale en cours, à des attentes beaucoup moins encourageantes.
* 21 Les pertes et gaspillages ne sont déduits que partiellement dans la mesure de la nourriture disponible.
* 22 Du moins au vu de la consommation apparente moyenne.
* 23 Voir infra. Pour quelques précisions sur ce concept.
* 24 Pendant les années 90, la Chine a, elle seule, contribué aux deux tiers de la réduction de la faim dans le monde.
* 25 Les phénomènes observés dans les récentes crises montrent que la constitution de stocks spéculatifs peut se faire au détriment des consommateurs locaux du fait des concurrences des demandes lorsque les productions nationales ne suffisent plus à alimenter des consommateurs locaux à pouvoir d'achat relativement élevé.
* 26 Ou, du moins, moins intensif que les autres prospectives.
* 27 Les conflits d'usage entre la production agricole alimentaire et la production agricole énergétique sont traités dans un chapitre particulier.
* 28 Il existe certains témoignages selon lesquels des investisseurs du Golfe se seraient renseignés sur les conditions d'achat de la moitié de la Beauce...
* 29 49 000 hectares en 2007 pour une valeur de 4,9 milliards d'euros.
* 30 En exceptant l'extensification des surfaces cultivées.
* 31 En matière de progrès technique on navigue toujours entre optimisme et scepticisme. Votre rapporteur plaide pour une politique volontariste de recherche et développement. La France doit impérativement valoriser ses atouts qui sont considérables. Il ne s'agit pas seulement d'inventer mais aussi d'innover en développant notamment les transferts de technologies à destination des pays en développement.
* 32 Hors intraconsommations.
* 33 Les observateurs et acteurs avisés du sujet ont tendance à user d'une terminologie différente selon qu'ils soutiennent le développement de cette source d'énergie ou qu'ils y sont défavorables. Les premiers usent de l'euphémisme « biocarburants », les seconds du vocable, plus accusatoire, d'« agro-carburants ». Votre rapporteur souhaite échapper à cette querelle sémantique en utilisant indifféremment les deux termes.
* 34 Extrait de la note de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur les biocarburants.
* 35 Ou de pénalisation en cas de manquement aux obligations d'incorporation.
* 36 L'objectif de 20 % pour l'ensemble de l'énergie consommée peut techniquement être atteint à travers les biocarburants mais aussi par les autres formes d'énergies renouvelables tandis que pour les transports les biocarburants semblent être la seule ressource disponible.
* 37 Dans ce cadre, 29 unités de production de biodiesel (dont 11 à l'étranger), 20 d'éthanol et 4 d'ETBE ont été agréées, soit 53 unités de production dont 21 nouvelles construites pour un investissement supérieur à 1 200 M€.
* 38 Selon l'ADEME, sur 2 millions de tonnes de fioul consommés chaque année par les engins agricoles, 20 % pourraient être à terme remplacés par les HVP.
* 39 Le maïs américain n'en était alors éloigné que de cinq cents.
* 40 C'est malheureusement l'ETBE qui est aujourd'hui le plus utilisé pour les facilités d'incorporation qu'il offre. Cependant sa part se réduit depuis 2006.
* 41 Précaution de méthode nettement soulignée dans deux articles de la revue « Science » de 2008.
* 42 L'effet d'éviction dont il s'agit ne s résume pas à un simple abattement quantitatif portant sur les terres disponible pour produire des aliments. Il peut également se traduire par la mobilisation des terres dont les seuils d'exploitation à des fins alimentaires sont relativement faibles. Dans ce cas, l'effet d'éviction consiste dans un déplacement de la courbe de coûts des productions alimentaires vers le haut.
* 43 À cet effet d'éviction sur les surfaces il faut ajouter un effet d'éviction sur les emplois, sur la consommation intérieure mais aussi sur les exportations (v. l'annexe sur les prospectives agricoles à 10 ans)
* 44 Proposition réversible mais pas totalement symétrique puisque les rendements agricoles et les produits cultivables ne sont pas identiques dans les différents pays considérés.
* 45 Gtep : Giga (milliards) de tonnes - équivalent - pétrole.
* 46 Cette variable, ici vue sous l'angle naturel de la teneur atmosphérique en CO2, peut, dans une certaine mesure, être considérée comme illustration d'une réponse plus artificielle que les agriculteurs pourraient apporter au défi d'augmenter leurs rendements.
* 47 Pour ce faire, l'étude GAEZ utilise trois modèles de simulation climatique : ECHAM4, du German Climate Research Centre of the Max-Planck Institute for Meteorology (Hamburg) ; CGCM1, du Canadian Centre of Climate Modeling and Analysis ; HadCM2, du Hadley Centre for Climate Prediction and Research (Royaume-Uni).
* 48 Contre 16 800 m3 en 1950 rappelons-le.
* 49 L'érosion peut être provoquée aussi bien par des pratiques intensives que par des pratiques extensives.
* 50 Rapport n° 131 (2007-2008) de MM. Pierre Lafitte et Claude Saunier - 12 décembre 2007.
* 51 « Pesticides et santé » Rapport n° 2463 Assemblée nationale et n° 421 Sénat, 29 avril 2010 de MM. Claude Gatignol, Député et Jean-Claude Étienne, Sénateur.
* 52 Il faut distinguer les substances actives, qui sont les molécules produisant l'effet recherché et les préparations commerciales qui recouvrent les produits phytopharmaceutiques fabriqués à partir de ces substances qui comprennent les premières.
* 53 Constats qui ne vont pas jusqu'à permettre d'apprécier précisément l'exposition concrète des humains qui n'est que peu mesurée.
* 54 Voir à ce propos, l'excellent rapport de notre collègue Gilbert Barbier : « Les perturbateurs endocriniens. Le temps de la précaution » OPECST Sénat n° 765 du 12 juillet 2011.
* 55 Les retraits de substances actives sont des décisions difficiles en ce sens que la vertu dont ils témoignent peuvent renforcer le soupçon d'un vice originel.
* 56 On peut en mentionner plusieurs techniques : satellites ; caméras à réflectance qui captent les radiations des plantes et permettent d'analyser des besoins en nutriments...
* 57 Les constats de la Banque mondiale conduisent toutefois à remettre en cause la transmission des gains de productivité aux prix.
* 58 Il est même possible que les efforts de marge de certains producteurs en situations économiques relativement favorables ex ante coupent la diffusion de la hausse des prix dont pourraient bénéficier les petits producteurs dans des tactiques concurrentielles plus ou moins prédatrices. En effet comme les prix des intrants sont parfois (souvent) corrélés avec ceux des produits, les petits exploitants peuvent alors subir des pertes de marges fatales.
* 59 D'une forte volatilité mais aussi, comme à l'a vu, d'une tendance à la hausse des prix qu'il faut prendre pleinement en considération quand on fait la prospective des marchés agricoles et alimentaires, non seulement parce que l'énergie est un coût de production de cette filière mais encore, et surtout, peut-être, parce que les prix énergétiques pourront modifier l'allocation des terres agricoles.
* 60 « Le rôle des facteurs financiers dans la hausse des prix des matières premières agricoles ». Trésor-Eco n° 41, juillet 2008.
* 61 Il peut, en revanche, exister des substitutions entre certains produits (le riz et le blé, par exemple) qui ont pour effet de diffuser la hausse des prix.
* 62 L'élasticité-prix de la demande paraît plus forte pour les usages non alimentaires des produits agricoles.
* 63 Voir, par exemple, Gorton et Rouwenhorst (2005), « Facts and fantaisies about commodity futures », NBER Working Paper n° 10595, février 2008, qui montre que les actifs agricoles sont décorrelés des variables qui égaleraient le cours d'autres actifs, offrant ainsi une sorte d'assurance.
* 64 Il ne s'agit pas des seuls biens fonciers mais de « foncier viabilisé » qui comprend notamment l'irrigation.
* 65 Pour un investissement additionnel net, de capacité de 83 milliards de dollars.
* 66 Cette inégalité est rendue cohérente avec les objectifs d'autosuffisance alimentaire grâce à la variable des rations alimentaires.
* 67 Voir le présent rapport.
* 68 Mais elle serait nettement plus forte que la moyenne dans certaines régions. En Amérique du Sud, l'investissement augmenterait de 62 % avec une baisse de l'emploi agricole de 73 % et une extension importante des terres (+ 49 %).
* 69 À titre d'exemple, une annexe décrit les différentes voies envisageables pour gérer les risques économiques en agriculture.
* 70 Il ne faut pas exagérer la portée de ce parti pris sur le quantum de progression de la production agricole qui n'empêche pas de mobiliser beaucoup les terres et une augmentation assez nette des rendements. En réalité, les alternatives à la Révolution verte posent surtout un problème de faisabilité technico-économique qu'on pose ici comme résolu, ce qui représente une forte hypothèse.
* 71 Alors même que certaines hypothèses techniques (celles relatives à la nourriture animale notamment) peuvent sembler favorables à un desserrement des interdépendances.
* 72 Il y a information asymétrique quand un acteur du marché en sait plus que les autres et information imparfaite quand toutes les conséquences de la transaction commerciale ne peuvent être connues. Exemplairement, l'origine d'un produit agricole peut être citée comme problème d'asymétrie tandis que les effets de certaines modalités de production (les OGM par exemple) peuvent être vus comme relevant de problèmes d'information incomplète.
* 73 Rapport n° 120 du 7 décembre 2005 de MM. Jean-Pierre Plancade et Daniel Soulage « Libéraliser les échanges commerciaux : quels effets sur la croissance et le développement ? »
* 74 Cet aspect particulièrement important est développé un peu plus loin dans le présent chapitre.
* 75 La délégation à la planification a été la matrice de l'actuelle délégation sénatoriale à la prospective.
* 76 Le calcul de la demande adressée est rendu complexe par la nécessité qu'il y aurait, théoriquement, à l'ajuster en fonction des évolutions de la part des exportations du pays dans le total année par année.
* 77 Le coût pour le bien être de ces pays agrège ici les effets des protections douanières sur les producteurs et sur les consommateurs.
* 78 La population agricole totale (active et non active) s'élève à environ 2,7 milliards d'individus (41 % de la population mondiale).
* 79 Objectifs qui peuvent être contradictoires : l'augmentation de la quantité produite peut supposer une augmentation des coûts unitaires de production ; la hausse des prix peut réduire les quantités vendues...
* 80 Cette augmentation du taux de marge peut provenir de multiples facteurs parmi lesquels la baisse de la part des salaires ou celle des autres coûts de production au sens large.
* 81 Quelques millions de céréaliculteurs peuvent produire l'équivalent de 1 000 tonnes par actif et par an avec des rendements de 10 tonnes par hectare et un agriculteur pour 100 hectares.
* 82 Les données utilisées sont insuffisamment éclairantes. Il faudrait comparer le PIB non agricole par actif non agricole au PIB agricole par actif agricole.
* 83 Critique qu'elle semble assumer, pour partie du moins.
* 84 De façon parlante, on sait que Walmart est la première entreprise du monde.
* 85 L'existence d'un oligopole est d'ores et déjà fréquemment dénoncée dans les critiques du rôle des États développés sur le système alimentaire mondial. À supposer que cette critique soit fondée, il faut remarquer qu'elle vise des États dont le champ de préoccupation est a priori plus large que celui de l'oligopole privé dont l'émergence pourrait représenter une tendance lourde dans l'avenir avec la substitution d'intérêts purement marchands à des intérêts étatiques plus diversifiés.