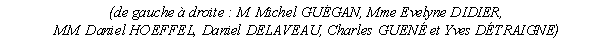Deuxième table ronde
Une
démarche législative présentée
par les membres
du Gouvernement qui ont élaboré
et défendu la loi du 6
février 1992 devant le Parlement
M. Jean-Michel Baylet , ancien secrétaire d'État chargé des collectivités locales, sénateur de Tarn-et-Garonne. - Nommé secrétaire d'Etat aux collectivités locales dans le deuxième gouvernement de Michel Rocard issu des élections législatives de juin 1988, placé sous l'autorité sourcilleuse du ministre Pierre Joxe, j'ai pu m'appuyer, d'une part, sur mon expérience d'élu local -maire, président de conseil général et président d'un district d'une vingtaine de communes- et, d'autre part, sur l'équipe constituée par mon prédécesseur du premier gouvernement Rocard.
Ces derniers, et notamment Pierre-René Lemas, m'ont rapidement parlé du projet de création de la fonction publique territoriale, la seule fonction publique existante étant alors celle de l'Etat. Les personnels des collectivités territoriales étaient recrutés selon des procédures et critères à la discrétion des responsables de l'exécutif et nombre d'entre eux se sont émus de notre volonté d'imposer le principe du concours. Mais vingt ans après, je me félicite du chemin parcouru, avec un regret toutefois concernant l'insuffisance des passerelles entre les deux fonctions publiques.
Puis nous avons abordé la question de l'intercommunalité, sur laquelle j'avais des convictions, notamment en tant que président de l'un des premiers districts de France, avec 20 communes regroupées dans une structure intercommunale alors relativement peu répandue. Ces convictions étaient fondées sur la réflexion personnelle que j'avais pu mener sur la nécessité, au-delà de l'échec de la loi Marcellin, de trouver une solution de regroupement respectant en même temps l'attachement des Français à leurs 36 000 communes.
Il m'était apparu que l'intercommunalité constituait une réponse permettant aux plus petites communes de disposer d'un minimum de moyens pour exister réellement, mais à la condition qu'il s'agisse d'une réforme démocratique partant du bas vers le haut et non l'inverse. Cette réforme fondée sur la concertation, mise en oeuvre par quatre ou cinq ministres illustrant ainsi la continuité de l'Etat, a permis à nos communes de franchir un cap.
La quasi totalité des communes ayant adhéré à des structures intercommunales, force est de constater que l'intercommunalité se porte bien.
Au vu du déroulement actuel de certaines commissions départementales de coopération intercommunales (CDCI), l'on peut toutefois regretter que la volonté d'accélérer n'ait conduit récemment à renforcer les pouvoirs du préfet, ce qui est une erreur. Nous avions la volonté de veiller, au contraire, à ce que cette réforme aille du bas en haut et avance ainsi au rythme du possible, en tenant compte des spécificités des différents territoires et des situations locales.
Le fait que, dans leur diversité, les communautés de communes aient prospéré, est une réalité heureuse qui contribue non seulement à mieux organiser le territoire, mais aussi à préserver l'avenir de nos communes.
Quelles sont les perspectives ? La loi de 1992 a été enclenchée, rappelons-le, six ou sept ans seulement après les premières lois de décentralisation. Des avancées sont intervenues, même modestes, quant au statut de l'élu. Il s'agit maintenant d'engager l'acte III de la décentralisation en donnant, comme nous l'avions fait, la préférence aux élus et non aux préfets, en prenant un nouveau tournant qui recentre l'Etat sur ses fonctions régaliennes et en transférant dans leur totalité des compétences aux régions, aux départements, aux communes et aux structures intercommunales. Alors que l'on a laissé à l'Etat un petit bout de DDE par ci ou de DDASS par là, un grand toilettage s'impose pour que la décentralisation soit digne de la France de notre siècle.
Les moments que nous évoquons ont représenté une période particulièrement agréable de ma vie, non seulement parce que je participais au gouvernement, ce qui en soi est gratifiant, mais aussi et surtout parce que nous avons pu faire avancer les choses pour les collectivités territoriales de notre pays.
M. Philippe Marchand, ancien ministre de l'intérieur . - J'ai le sentiment d'avoir été l'un des maillons d'une chaîne allant des lois de 1982 jusqu'à cet acte III de la décentralisation appelé de ses voeux par Jean-Michel Baylet, mais ce maillon fut assez faible car il s'en est fallu de peu qu'il se brisât devant l'Assemblée nationale.
Dès mon arrivée au gouvernement Rocard, en juillet 1990, mon ministre de tutelle Pierre Joxe me confia deux dossiers : celui de la sécurité civile, qui me donna l'occasion de constater cet été-là qu'il y avait alors le feu chez les pompiers, et le suivi, présenté comme risqué, de ce projet de loi. Aussi, à partir de septembre 1990, je travaillais sur la loi ATR chaque semaine, rue des Saussaies, avec les membres de mon cabinet et l'équipe de la DGCL, jusqu'à ce que, en janvier 1991, je sois convoqué à l'Elysée par le président de la République, François Mitterrand. J'apprends alors, après tout le monde, à la fois la démission de Jean-Pierre Chevènement en tant que ministre de la Défense -« belle lettre » dit le Président- et son remplacement par Pierre Joxe, ce qui eut pour conséquence de me faire nommer place Beauvau puisque, selon l'expression du Président, « j'étais déjà de la maison » et n'avait que la cour à traverser.
Ayant exercé de multiples responsabilités locales, dont celles de président d'un SIVOM et d'un conseil général, la Charente-Maritime, au moment du vote des lois de décentralisation, j'étais particulièrement intéressé par ce sujet, sur lequel le Premier ministre, Michel Rocard, me laissa d'ailleurs carte blanche. Avocat de profession, je me disais toutefois que cette affaire n'était pas gagnée d'avance, même si elle se présentait à front renversé par rapport à celle de 1981. En effet, si Gaston Defferre avait pu s'appuyer sur une large majorité, malgré une mauvaise ambiance au Parlement, je ne disposais pour ma part que d'une minorité à l'Assemblée, tout en bénéficiant d'une bonne ambiance liée au fait que la décentralisation était entrée dans les moeurs, et aux relations cordiales - ne suis-je pas du Sud-Ouest ? - que j'entretenais avec mes collègues, y compris de l'opposition. Si le dialogue était assuré, ce dont nous avions en revanche besoin, c'étaient de voix. Cet aspect de l'entreprise s'annonçait risqué, compte tenu de l'opposition résolue du groupe communiste au motif que ce texte portait atteinte à l'autonomie des communes.
Nous disposions toutefois d'un certain nombre d'atouts, dont les dix-huit mois de concertation et de travail de la commission spéciale, présidée par Gérard Gouzes et dont le rapporteur, compétent et précis, apprécié de tous, était Christian Pierret ; cette commission était parvenue à adopter 119 amendements à l'unanimité de ses membres. Un autre atout, au plan technique, fut de pouvoir m'appuyer sur l'équipe de collaborateurs conduite par Pierre-René Lemas.
Au niveau parlementaire, ma conviction était qu'il fallait prendre son temps. Les débat durèrent d'ailleurs 15 jours, soit deux fois plus que les prévisions de la Conférence des présidents de l'Assemblée, ponctués de nombreuses suspensions de séances au cours desquelles nous discutions les amendements émis par tous les groupes, dont certains étaient tout à fait bienvenus tels celui de Jean-Jacques Hyest, que j'avais accepté, et qui portait sur la départementalisation des services d'incendie et de secours. D'autres, en revanche, ne pouvaient être admis, tels celui défendu par MM. Barrot et Méhaignerie, en principe disposés à nous aider au vote du texte, et autorisant le financement public par les collectivités locales des établissements scolaires privés, amendement pour lequel ils se sont pourtant battus jusqu'au bout. Mais, ministre de l'Intérieur, pouvais-je accepter une disposition qui aurait mis des dizaines de milliers de manifestants dans la rue ?
Puis vint le moment du vote, un moment éprouvant puisque, comme la République, la loi ne fut adoptée en première lecture qu'à une voix de majorité, par 287 contre 286, score qui fut ensuite doublé par Jean-Pierre Sueur... Ce fut aussi un moment très fort, car, selon moi, on ne doit garder de son passage au gouvernement, comme de son service national, que les meilleurs souvenirs
Ma satisfaction fut ensuite très grande de voir comment cette loi fut rapidement mise en oeuvre, en particulier dans ma région, y compris par ceux qui ne l'avaient pas soutenue au Parlement. La première communauté, comptant 40 communes, y fut ainsi créée - je pris cela pour un coup de chapeau - par René Monory, alors président du Sénat, avec l'argument « pas un centime de fiscalité en plus ». De même, Claude Belot pris l'initiative de la communauté de communes du Haut-Saintonge, qui regroupe quasiment la moitié des communes de la Charente-Maritime. Ce n'est pas ce qui était prévu, mais cela fonctionne très bien, dès lors que le président est une forte personnalité et fait preuve d'esprit d'ouverture ; Claude Belot a notamment choisi son vice-président au sein de l'opposition.
Un autre de mes bons souvenirs du gouvernement restera le texte sur le statut de l'élu.
Pour le reste, j'ai continué à suivre l'ensemble de ces questions mais dans une position différente, au Conseil d'Etat notamment, à l'occasion de la préparation de la loi de 1999 et je suis persuadé que ces évolutions se poursuivront. (Applaudissements).
M. Jean-Pierre Sueur , président. - Ancien secrétaire d'Etat aux collectivités locales sous l'autorité de Philippe Marchand puis de Paul Quilès, j'ai participé à six des sept lectures sur ce texte, de jour comme de nuit, ce qui m'a d'ailleurs donné l'occasion de découvrir le Sénat et son immense courtoisie.
Même si la difficulté à convaincre était réelle, ceux qui combattaient la nouvelle loi pensaient qu'elle allait dans le bon sens. La relecture, toujours intéressante, de ces débats parlementaires démontre aussi que, comme en 1981 au sujet de la décentralisation, la loi de 1992 avait fait l'objet d'oppositions et de critiques qui ont fini par disparaître.
Le fait, sous le gouvernement d'Edith Cresson, de passer d'une à deux voix de majorité ne fut pas simple et il reviendra aux historiens de découvrir que tel ouvrage du côté de Lyon fut décisif pour l'obtention de cette majorité et que des discussions avec certains parlementaires du sud de la France eurent aussi quelque effet. Mais nous n'avons pas tout accepté pour autant et, par exemple, refusé l'amendement d'un député de Saint-Pierre-et-Miquelon demandant que la loi garantisse que la commune de Miquelon-Langlade perçoive un million de francs par an ...
Un premier élément essentiel de cette loi a été le respect des communes, en dépit des innombrables réquisitoires entendus contre nos 36 500 communes. Si nous avons réussi à créer les communautés de communes, c'est parce que nous avons respecté les communes. Si nous avions, à l'instar d'autres pays, décidé d'en supprimer, nous n'aurions abouti à rien. S'est ainsi instaurée une relation dialectique, entre les communes et les communautés, qui marche bien, même si j'estime toutefois qu'un problème démocratique se pose dans les grandes agglomérations urbaines, où 70 à 75 % des décisions sont prises par un conseil et un président non élus par la population, alors que, dans le même temps, on demande aux électeurs de voter dans le cadre de cantons dont ils ignorent même le périmètre. Je jette ce sujet sur le tapis pour que l'acte III de la décentralisation ne fasse pas l'économie de ce débat.
Un second facteur de succès a été le respect de la liberté locale. Alors qu'un rapport de la Cour des Comptes, dont j'avais pu m'entretenir avec Philippe Séguin, soulignait l'irrationalité de certains périmètres des communautés, sous-entendant que tel n'aurait pas été le cas, si les préfets les avaient définis, j'insiste sur le fait que nous n'aurions pas eu de majorité à l'Assemblée nationale, ni pu engager le dialogue avec le Sénat, si nous avions remis en question la liberté souveraine des communes de décider de créer une communauté et d'y adhérer. Certes, chacun connaît des découpages par exemple essentiellement inspirés par des motifs politiques, ou des communautés de communes autour d'une ville-centre, mais le mouvement de l'histoire fait que cela évolue.
En revanche, le choix effectué en 1992 a permis en seulement dix ans - il faut le souligner - à une grande majorité des communes d'appartenir à une communauté, la décennie suivante ayant simplement été consacrée à l'achèvement du processus.
La vertu de la décentralisation est la liberté locale et c'est en se fondant sur elle que nous avons réussi une réforme qui a changé aujourd'hui la donne puisque personne ne reviendra en arrière. Le mouvement ira au contraire plus loin en dotant nos intercommunalités de compétences supplémentaires tout en s'inscrivant dans le cadre d'une gestion plus rigoureuse exigée par le contexte économique actuel. L'on ne pourra notamment plus admettre les superpositions du passé et il faudra jouer davantage la carte de la solidarité.
Rappelons enfin que, même si cette loi a été défendue par plusieurs ministres et qu'elle a changé au cours du débat parlementaire, l'on sait que c'est Pierre Joxe, autant attaché à l'Etat républicain qu'à la décentralisation, qui en fut l'inspirateur. Je suis heureux de le saluer.
M. Pierre Joxe, ancien ministre de l'intérieur. - Vous m'avez présenté comme l'auteur de cette loi, titre qui revient surtout à la technocratie démocratique ici présente et dont plusieurs représentants se sont déjà exprimés. Je figure simplement parmi ceux qui ont eu à « porter », comme on dit, ce texte, il est vrai un peu lourd. Il est toujours compliqué de retracer une genèse, celle de la Bible ne donne-t-elle pas deux récits contradictoires de la création du monde ?
Mon histoire personnelle m'avait permis de voir évoluer cette question puisque, dés mon stage de l'Ecole nationale d'administration à la préfecture de l'Hérault, le préfet Yves Pérony, excellent maître de stage, me chargea, en juillet 1960, de mettre en oeuvre la loi sur les SIVOM en créant des municipalités de canton. Ces dernières devaient apporter une évolution historique à l'administration française, mettant fin à l'absurdité constituée par nos 36 000 communes héritées de la Troisième République et à l'irrationalité de la carte des syndicats intercommunaux, qui ressemblait à la carte administrative bariolée de l'Ancien régime. Cette tâche m'avait inspiré une terreur panique, car la note de stage, alors, était décisive et j'avoue avoir complètement échoué dans cette mission sous le regard affligé de mon préfet, même si ma note ne fut pas mauvaise. Mais j'en ai gardé le sens de la grande complexité de ces sujets, en particulier dans un département, entre mer et montagne, où les traditions locales étaient très différentes selon les territoires.
Puis, en 1967, je fus chargé au sein de la Cour des comptes d'une étude sur les finances locales. Je pus alors constater, à l'occasion de l'inventaire des dix-sept études réalisées sur le sujet depuis le début de la III e République, qu'elles avaient toutes plaidé en faveur d'une rationalisation de la gestion communale, sans qu'aucune n'ait abouti.
Plus tard, rapporteur-adjoint de la commission nationale d'aménagement du territoire du commissariat général au Plan, je fut chargé du groupe de travail sur l'administration locale qui devait mettre en oeuvre la décision de diviser par dix le nombre des communes françaises ; pareille démarche n'avait pas d'avenir ; ce fut encore un échec alors même qu'avec des taux de croissance économique compris entre 5 et 7%, l'Etat disposait de moyens d'incitation considérables sur les communes en matière d'investissements publics.
En 1971, fut votée la loi Marcellin, véritable catastrophe nationale, qui échoua à diviser drastiquement par cinq ou par dix le nombre de communes à l'instar des autres pays européens. Pourtant inspiré par un homme qui, indépendamment de ses conceptions très discutables en matière de police, était un praticien expérimenté de l'administration, cette loi fut appliquée dans des conditions terribles, notamment au regard des moyens de pression très importants conférés aux préfets. Elu député en 1973, je fus très rapidement sommé de prendre parti sur les fusions et les défusions de communes, qui se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui. Quand j'étais à l'Intérieur, en 1990, l'annonce régulière, en conseil des ministres, de nouvelles défusions de communes, ne manquait pas de susciter l'ironie du Président Mitterrand : « la rationalisation de l'administration française progresse », observait-il.
Nous avons eu au parti socialiste des discussions extrêmement intéressantes avec les radicaux de gauche, dont Maurice Faure, grand connaisseur de ces questions, sur les principes de l'organisation de l'administration locale. Nous avons conduit des missions en Angleterre, en Allemagne, aux Etats-Unis, en Suède, en Belgique. Nous posions trois questions : quel est le degré idéal d'administration locale ? Est-il nécessaire d'avoir des statuts homogènes ? Comment passe-t-on du modèle actuel, considéré comme désastreux, à un modèle idéal encore non identifié ? Chacune d'elle était traitée différemment, selon l'histoire de chaque démocratie. Ainsi les Etats-Unis sont nés d'une adjonction d'Etats, dotés chacun d'une Constitution et qui, pour la plupart, préexistaient à la fédération. Ce système non homogène diffère du modèle allemand, où l'Etat fédéral a été constitué à partir de la division imposée par les Alliés, ce que reflètent les noms des Etats qui n'ont, pour la plupart, à l'exception de la Bavière, pas de signification historique. Au sein même des Etats américains, il existe des constitutions locales. La ville de Chicago, dans l'Illinois, dispose d'un statut particulier. Cela est totalement contraire aux idéaux du droit public français tel qu'il s'est développé depuis la monarchie jusqu'au génie du Conseil d'Etat, à la fin du XIX e siècle.
Plutôt que de s'acharner à proposer un modèle unique, ne fallait-il pas laisser place à des constitutions locales, ou offrir le choix entre plusieurs modèles ? Une de nos propositions mettait en avant ces choix de statuts.
A l'époque, un débat très vif traversait la gauche : était-ce le moment de décentraliser, alors que nous espérions conquérir le pouvoir d'Etat pour transformer la France ? Etait-ce le moment de le désarmer pour donner plus de pouvoir à des villes et à des départements souvent dominés par la droite ? L'objectif stratégique de doter la France d'une forme de self-government était contradictoire avec celui de la transformer par les moyens, notamment économiques, de l'Etat. Nous avons eu des séminaires avec Olof Palme - Michel Rocard y était. La Suède social-démocrate ne faisait pas une réforme, sans qu'elle soit auparavant maquettée par le parti, puis proposée au peuple, soumise à discussion pendant deux à trois ans, ni sans qu'elle comporte une phase de transition et d'expérimentation dans une ou deux régions. L'idée me paraissait excellente, de soumettre notre projet à débat et à expérimentation. Je l'avais constaté, pendant mon stage de l'ENA : il y avait, dans les Cévennes, région à majorité protestante, une capacité d'auto-organisation et de discussion suffisante pour aboutir à une sorte de constitution locale. Il est vrai que la Réforme a facilité la pratique de la démocratie dans cette région de tradition quasi exclusivement protestante...comme l'Ariège est socialiste !
L'expérimentation rend possible une démonstration en vraie grandeur. La loi de 1966 sur les communautés urbaines avait entraîné la création une douzaine de communautés à travers la France, dont certaines étaient réellement urbaines, comme celle de Lyon et d'autres pas du tout, comme celle du Creusot-Montceau-les-Mines-Montchanin, où dominaient les paysages agrestes et forestiers, la seule ville de quelque importance étant le Creusot avec 30 000 habitants ! Cette non-communauté non-urbaine semblait très intéressante à l'élu du département que j'étais. Les discussions internes ont été vives. Les choix que je défendais ont été combattus et finalement écrasés par François Mitterrand, Gaston Defferre et Pierre Mauroy. Dans ce trio, que je qualifiais d'infernal, le premier gardait de sa fonction de président du conseil général de la Nièvre, une exécration, non pour la fonction de préfet, mais pour les préfets que la droite lui avait envoyés. Le deuxième avait conquis la mairie de Marseille les armes à la main et, malgré la ratification réitérée du suffrage universel libre et régulier, en avait gardé une certaine conception du pouvoir, régnant sur Marseille de façon autocratique. Le troisième avait tissé un consensus politico-social sur un réseau très serré. Ces trois hommes très expérimentés se rejoignaient, quant à leur conception de l'articulation entre pouvoir local et pouvoir d'Etat, sur la nécessité de définir un régime clair et net, ce qui excluait à leurs yeux toute expérimentation, transition ou variation. Je fus donc écrasé dans un vote au comité directeur du parti socialiste, qui n'intéressait pas la moitié de ses membres -à l'époque, nous avions très peu d'élus, ce n'est pas comme aujourd'hui ! Ce n'est pas un hasard si nos plus grands élus, qui avaient l'expérience de la gestion et de l'administration, furent les principaux dirigeants du parti, puis président de la République, Premier ministre, ministre de l'intérieur. Face à eux, je n'avais aucune chance ! Ces débats sur les formes de l'administration locale, l'homogénéité du système, sans mentionner les aspects financiers, ont été très importants...et assez décevants, par rapport aux objectifs poursuivis. La loi sur les SIVOM a cinquante ans. Son objectif était le même que celui de la loi sur les communautés de communes : rationaliser l'administration locale. Sans doute en prend-on le chemin, mais était-il inévitable qu'une telle réforme prenne cinquante ans ? Nous ne pouvons réécrire l'histoire, mais nous sommes d'accord, Jean-Pierre Sueur, cela participe du génie français, il fallait une expérimentation. Combien avons-nous eu de navettes ?
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Il y eut sept lectures !
M. Pierre Joxe . - Comme à Jéricho, les murailles se sont écroulées après qu'on en eût fait sept fois le tour...
La structure administrative de la France a été construite sur des bases ambiguës. Les maires ont été nommés, au long du XIX e siècle. Il y a eu la loi communale en 1884, mais il y avait eu la loi départementale, adoptée dans l'urgence de la Commune, établissant le département comme un service déconcentré de l'Etat, doté d'une assemblée consultative locale. J'ai connu le conseil général ancienne formule. C'était le même type d'assemblée que celles installées par la France coloniale en Algérie, avec des notables, des caïds. Il ne siégeait que quatre ou cinq demi-journées par an, face à un appareil d'Etat habitué à commander, à financer, à imposer des règles. Quand je siégeais au Parlement européen, alors composé de représentants des Parlements nationaux, nos collègues britanniques, allemands, ne nous croyaient pas lorsque nous leur racontions notre système. Ils attribuaient à notre passion politique la description que nous en faisions. A l'époque, il n'y avait que trois modèles pour construire un collège. Si un conseil général souhaitait faire construire un bâtiment à usage polyvalent, ce n'était pas possible, parce que n'était pas un des trois choix au catalogue du bureau de la rue de Grenelle. Les parlementaires allemands qui nous rendaient visite s'étonnaient de ce qu'ils voyaient de notre administration régionale. Ils invoquaient Napoléon, en ajoutant qu'il fallait être Français pour supporter cela ! En Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Suède, droite ou gauche au pouvoir, les modes d'administration locale étaient totalement différents.
La loi a ouvert un chemin français vers le souhaitable. Dans certain coin de France, où j'étais élu député, je connais des zones dépeuplées, où les communes ne reposent plus que sur la symbolique, les amitiés, les traditions, ce qui n'est pas rien, mais quelle est la réalité du pouvoir, lorsqu'elles sont administrées par un conseil municipal, ont cinquante habitants et que, dans un rayon de 30 kilomètres, on ne trouve pas une commune de mille habitants ? Pendant longtemps, la Saône-et-Loire a été le département champion des communautés de communes. Sur 55 cantons à l'époque, nous comptions une cinquantaine de communautés, qui ne coïncidaient pas toujours avec les cantons. Lorsqu'une commune demandait son rattachement au Jura ou à un autre département, le préfet réagissait comme si l'on enlevait l'Alsace à la France ! Aujourd'hui encore, un îlot du département de Vaucluse est enclavé dans la Drôme, et il n'est pas question d'y toucher !
M. Jean-Michel Baylet . - Il y a aussi deux enclaves des Hautes-Pyrénées dans les Pyrénées Atlantiques !
M. Pierre Joxe . - Dès que l'on s'approche des Pyrénées, on entre dans un autre monde ! Un jour, lorsque j'étais ministre de l'intérieur, on me communiqua le tract d'un collectif basque dénonçant « les honteuses spoliations de la nuit du 4 août ». J'ai interrogé l'un de mes collaborateurs, agrégé d'histoire : la nuit du 4 août 1789 a aboli les privilèges des nobles et du clergé, mais aussi ceux dont jouissaient trois vallées basques, entre la France et le pays basque espagnol, au titre des pacages, du foncier, et d'autres droits locaux, dont une assemblée d'élus, nommée bilzar , et que nous avons reconstituée, ce qui a donné lieu à un banquet mémorable ! Il y a là toute une tradition d'autonomie locale, qui n'a rien de folklorique et qui est très respectable.
La loi fut donc votée après sept lectures, au terme d'une longue démarche précautionneuse, toute sénatoriale. Sans doute a-t-elle atteint tardivement les résultats recherchés par des hommes politiques imprudents et de jeunes fonctionnaires, comme moi, ignorants. (Applaudissements)
M. Robert Coquidé, maire d'Echarcon . - Je suis maire d'une commune de 800 habitants dans le département de l'Essonne, membre de la communauté du Val-d'Essonne, que nous avons créée en 2003. Le raisonnement, que j'entends fréquemment, selon lequel il faudrait supprimer des communes parce que nous en avons 36 000, soit davantage que dans le reste de l'Europe, me paraît aussi critiquable que celui qui affirmerait : « il y a 600 fromages en France, plus que dans le reste de l'Europe, donc supprimons-en ! ». Parlons seulement des compétences : telle compétence exercée par tel type de commune, ne serait-elle pas plus efficace, exercée collectivement par plusieurs communes au sein d'une communauté ? Il serait judicieux de mener des expérimentations réversibles. Ainsi, on pourrait transférer une compétence à une communauté de communes pour trois ans, avant d'en dresser le bilan et de la transférer définitivement. Actuellement, une compétence transférée est impossible à rapatrier.
M. Alain Persillet, maire de Meusnes, président de la communauté de communes de Cher-Sologne. - Je suis maire et président d'une communauté de communes dans le Loir-et-Cher, suppléant de Jacqueline Gourault. La dernière réforme territoriale impose parfois des mariages contre nature entre communautés de communes, selon le souhait du préfet. Je regrette que cette réforme ne fasse pas référence aux SCOT, éléments essentiels de la cohérence de notre territoire.
M. Michel Le Scouarnec, sénateur du Morbihan . - Je suis maire d'une ville de 12 500 habitants dans le Morbihan. J'ai été chagriné que le préfet ait accepté des communautés de trois ou quatre communes. Le pays d'Auray compte cinq communautés de communes, quatre communes isolées, pour 28 communes en tout, ce qui pose des problèmes pour l'avenir. L'obligation de regroupement est rendue plus difficile aujourd'hui. Il aurait fallu dire non aux communautés de communes trop petites, certaines de trois communes seulement, qui ont été acceptées par l'Etat.
M. Michel Couroux, conseiller municipal de Quiers-sur-Bezonde, conseiller communautaire de la communauté de communes de Bellegardois . - A propos d'expérimentation, a-t-on demandé à la population ce qu'elle pense de nos 36 000 communes ? Je suis conseiller municipal d'une commune de 1 200 habitants et conseiller communautaire d'une communauté de 12 communes de 8 000 habitants. J'ai habité pendant 25 ans en Suisse, où je servais à l'ONU à Genève. Tous les maires se préoccupent de proximité. En Suisse aussi, où il y a beaucoup moins de communes que chez nous. Comme l'a souligné M. Joxe, des communes de 120 habitants ont un budget d'investissement de 15 000 euros. Cela équivaut à faire venir un expert-comptable dans une famille qui veut acheter une auto. Ici, on fait venir le maire ! Faut-il supprimer des communes ? Non, comme le montre l'expérience suisse, où le nom de stations de ski mondialement célèbres est conservé, bien qu'il appartienne à des communes inconnues. On peut garder les communes si l'on modifie le lieu où l'on met la compétence, comme cela a été dit. Le discours du président de la République aux maires, où il déclare, en substance, vouloir modifier la situation, mais en laissant la compétence générale aux communes, équivaut à ne pas faire de réforme...Parlons plutôt de compétences et du lieu où elles s'exercent !
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Monsieur Le Scouarnec, je comprends ce que vous dites des communautés de trois communes, mais le choix était le suivant : ou on laissait la liberté totale et la loi était votée, ouvrant ce formidable chemin au bout duquel nous sommes ; ou nous laissions le préfet intervenir pour dire que ce nombre n'était pas suffisant, et il n'y aurait pas eu de loi.
Le débat sur les communes est infini. Nous avons dit : prenons les choses comme elles sont. Les Français sont très attachés à leurs communes, quelle que soit leur taille. Il y a eu une tentative pour supprimer les syndicats scolaires. Renvoyer la mission scolaire à une communauté de 20 ou 30 communes, c'est faire fi de l'histoire et oublier que les Républicains ont planté dans chaque commune une mairie, puis une école. Si on la supprime, que restera-t-il ? L'état-civil ? Nos concitoyens sont très attachés au rôle des communes. Parce que nous sommes partis de cette réalité, nous avons pu aller plus loin et faire des communautés partout.
M. Jean-Michel Baylet . - Le débat sur les 36 000 communes n'est peut-être pas clos. Les textes que nous avons portés ont créé les conditions qui ont permis de les garder. La solution n'est pas mauvaise, même si nous ne l'avons pas encore menée au bout. Je suis d'accord avec Jean-Pierre Sueur : nous en avons la démonstration en ce moment, si nous avions donné aux préfets la compétence de décider du sort des demandes de créations de communautés, ils n'auraient pas tous décidé la même chose, et cela aurait eu des conséquences néfastes. Au nom de la démocratie, de la liberté, j'ai toujours défendu que les initiatives partent de la base vers le sommet. Les préfets ne partagent pas tous la même vision. Jeune député, j'ai connu un préfet ayant refusé la création d'une ACCA parce que son territoire était trop grand. Je me suis opposé à lui, les chasseurs sont descendus dans la rue, le préfet a perdu au tribunal administratif. Sur le fond, M. Le Scouarnec n'a pas tort : 5 communautés de communes pour 28 communes, ce n'est pas ce dont nous avons rêvé en préparant ces textes ! C'est aussi aux élus, conseillers généraux, sénateurs, députés, d'essayer d'accompagner ce mouvement. C'est le suffrage universel, la démocratie directe. Je ne suis pas pour la sous-traitance par le préfet.
Dans ma communauté de communes, j'ai pris la compétence scolaire et ni les citoyens, ni les maires ne s'en plaignent. Les maires sont tous conseillers communautaires : ce sont eux qui décident. Cela offre une vision globale de l'implantation des écoles sur le territoire, en mettant fin aux luttes entre communes, pour soustraire les effectifs de sa voisine, à la seule fin de toucher une meilleure dotation...
M. Jean-Pierre Sueur , président . - Vous l'avez décidé librement !
M. Jean-Michel Baylet . - Oui, nous avons délibéré.
M. Philippe Marchand . - Un souvenir m'a beaucoup touché : dans le débat en première lecture, le meilleur plaidoyer pour le maintien des communes a été prononcé, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, par Raymond Marcellin lui-même, expliquant pourquoi son système n'avait pas fonctionné et pourquoi il ne fallait pas s'engager dans cette voie. J'en ai retenu la leçon. Pierre Joxe a évoqué la compétence de Marcellin : il ne s'agit pas de maintien de l'ordre, mais d'honnêteté intellectuelle. Je vous invite à consulter le compte rendu de son intervention sur internet. Elle était très digne. Je n'ai pas souvent entendu un ministre reconnaître qu'il s'était trompé !
M. Pierre Joxe . - S'était-il trompé ? J'en ai parlé avec lui. Les lois allemande, belge, suédoise, ont été prises entre 1970 et 1972. La loi française est arrivée la dernière, juste avant la crise, après 25 ans de croissance ininterrompue et d'équipement dans tous les domaines, à un moment où l'idée de rationalisation de la gestion des collectivités territoriales n'était pas répandue, dans un contexte difficile pour M. Marcellin, qui était pourtant un homme expérimenté. Il a été président du conseil régional de Bretagne. J'ai été le voir, lorsque j'ai été élu président du conseil régional de Bourgogne, comme je suis allé voir MM. Savary et Defferre, parce que c'étaient les trois présidents de région qui oeuvraient le plus pour la recherche et la culture.
Un jour que j'étais interpellé par un adversaire politique de façon peu conforme à la courtoise suavité parlementaire, m'injuriant au motif que je ne réussissais qu'à procurer 20 000 gilets pare-balles aux 120 000 fonctionnaires de police, il avait pris la parole, en démontant cet argument et en montrant qu'il n'y avait jamais 120 000 policiers en service à la même heure. Il était, au fond, un homme de la III e République, celle qui a instauré, après la Commune, et maintenu la tutelle sur les collectivités. Certes, la République a construit partout des écoles. Mais son modèle n'était pas celui de la décentralisation. Elle a bâti une administration locale extrêmement centralisée. Le pouvoir des élus locaux n'était pas nul, mais ceux du jeune sous-préfet de Lodève que je fus pendant un mois, vis-à-vis des maires des petites communes rurales, étaient juridiquement hérités de l'époque coloniale ! C'était inimaginable pour un Allemand ou un Anglais. Cela est très long à changer. Le modèle de la loi de 1992 est un peu inspiré par la liberté de constitution, qui a présidé à l'édification des Etats-Unis d'Amérique, où le vrai pouvoir est local. Le modèle américain a ses inconvénients : le droit pénal fédéral, par exemple, est lacunaire. Notre modèle est tellement centralisé que nous avons du mal à nous en échapper. Les lois de décentralisation de 1982 n'ont pas encore fini de produire leurs effets, vos expériences sont contrastées : cela n'a pas très bien marché dans le pays d'Auray - peut-être les Bretons ont-ils la tête tellement dure que le préfet s'est cassé les dents !