ANNEXE 2 : LETTRE DE SAISINE DE LA COUR DES COMPTES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 58-1° DE LA LOLF
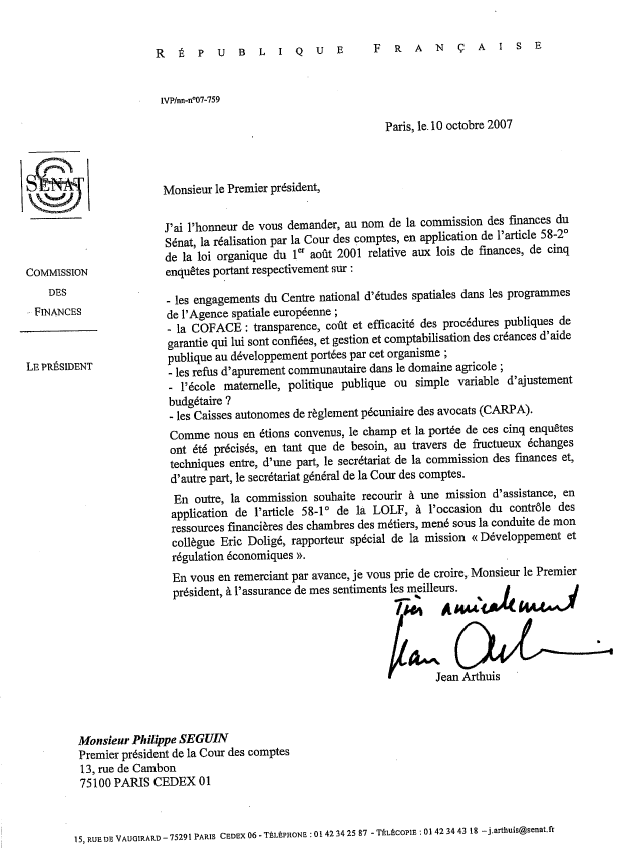
ANNEXE 3 : SYNTHÈSE DES RAPPORTS D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES RÉALISÉS EN 2007 ET 2008 PAR LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES (CRC) SUR LES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT (CMA)
Avertissement :
les informations
présentées dans cette note résultent
d'enquêtes
réalisées dans le cadre de la
procédure contradictoire propre aux chambres régionales des
comptes, consultable sur le site internet de la Cour des comptes
(www.ccomptes.fr).
Première partie : Les observations formulées en 2007
La présente synthèse a été réalisée à partir des 14 rapports d'observations définitives (« ROD II ») que cinq CRC ont rendus publics fin 2007 et qui étaient disponibles au 20/12/2007. Le tableau suivant identifie les CRC et les CMA concernées.
|
CRC |
CMA |
|
Aquitaine |
Landes, Gironde, Lot et Garonne, Pyrénées Orientales, Dordogne |
|
PACA |
Hautes-Alpes |
|
Réunion |
Réunion |
|
Bretagne |
Côtes Armor (Saint-Brieuc et Dinan), Finistère |
|
Lorraine |
Moselle, Meuse, Meurthe et Moselle, Vosges |
Les autres CRC, soit n'ont pas inscrit de CMA à leur programme de contrôle (pour quatre d'entre elles), soit publieront leurs ROD II en 2008 ou engageront des instructions cette même année.
Ces contrôles se sont inscrits dans le cadre d'une enquête conduite conjointement par la Cour des comptes et les Chambres régionales des comptes sur le thème de la formation professionnelle. Les CRC ont bénéficié, dans ce cadre, d'un guide commun d'enquête.
Cette synthèse se présente sous la forme de trois fiches : I) les financements, II) les procédures budgétaires et comptables, III) la gouvernance.
|
FICHE I : DES FINANCEMENTS MAL ADAPTES |
Les ressources des CMA sont réparties entre la vente de prestations diverses (formation, restauration...), les subventions publiques, la taxe d'apprentissage, la taxe pour frais de chambre de métiers (TFCM) et, enfin, les redevances pour prestations de service.
Les financements considérés comme « permanents » sont au moins de deux ordres : la TFCM et les redevances issues de la tenue du répertoire des Métiers.
Le tableau ci-dessous récapitule ces divers produits.
> Vente de produits finis : chapitre 70
> Subventions d'exploitation : chapitre 74
|
Subventions de l'Etat (741) |
Subv collectiv terr et org pub (744) |
Autres subv exploit° (748) |
|
Région / CFA - FPC Ss compte 7442 |
Département Ss compte 7443 |
Exon° taxe apprentissage(7481) |
F.A.F artisans / CMA Ss comptes 7482 et 4 |
> Autres produits de gestion courante : chapitre 75
|
Produits spécifiques (757) |
Produits divers de gestion courante (758) |
|
T.F.C.M Ss compte 7571 |
R.R.M. Ss compte 7572 |
> Produits financiers : chapitre 76
> Produits exceptionnels : chapitre 77
Abréviations :
- F.A.F. = Fonds d'assurance formation
- T.F.C.M. = Taxe pour frais de chambre de métiers
- R.R.M. = Redevance du répertoire de métiers
- F.P.C. = Formation Professionnelle Continue
1) une ressource fiscale (TFCM) qui couvre de moins en moins les charges de gestion
Rappel de la réglementation : Conformément aux dispositions de l'article 1601 du CGI, une taxe additionnelle à la taxe professionnelle est perçue au profit des chambres de métiers, des chambres régionales de métiers et de l'APCM. Cette taxe pour fonctionnement des CMA (TFCM) est destinée à couvrir les dépenses ordinaires. Elle est acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou de sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés.
Il appartient donc à la TFCM de couvrir principalement les missions régaliennes communes à toutes les CMA (CFE/Répertoire des Métiers, contrats d'apprentissage, ...).
La taxe est composée, d'une part, d'un droit fixe par ressortissant (impôt per capita ), arrêté par les CMA, dans la limite d'un montant maximum fixé, chaque année, dans la loi de finances, et d'autre part, d'un droit additionnel à la taxe professionnelle (TP) dont le produit est arrêté par chaque CMA. Le droit fixe est donc applicable à tous les artisans alors que le droit additionnel ne l'est qu'à ceux qui sont redevables de la TP.
Un droit fixe toujours au maximum
Au cours de la période sous revue, les droits fixes arrêtés par les lois de finances au profit des CMA départementales ont été successivement de 630 F (96 euros) en 2001, 101 euros en 2002, 105 euros en 2003, 93,5029 ( * ) euros en 2004 et 96,50 euros en 2005.
De nombreuses CMA contrôlées par les CRC (CMA 54, 55, 22, 64, 47, 24, 88) ont retenu, chaque année, les montants du droit fixe au maximum précité.
Un dépassement du droit additionnel qui tend à devenir une ressource permanente.
Rappel de la réglementation : Ce droit ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe, majoré d'un coefficient de 1,12, depuis la loi de finances 2004. Toutefois, depuis 1997, les CMA sont exceptionnellement autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85 % du produit du droit fixe, afin de mettre en oeuvre des actions (promotion ou communication au profit de l'artisanat) ou de réaliser des investissements en application de conventions conclues avec l'Etat (article 1601 du code général des impôts).
Constat : Les CRC ont noté que le dépassement du droit additionnel tend à devenir une ressource permanente des chambres, mouvement général également relevé par le rapport de l'IGIC. En effet, une grande majorité des CMA utilise le recours au conventionnement avec le préfet pour adopter un droit additionnel bien supérieur aux 50%.
Tel est le cas pour les CMA 55 et 22 (Saint-Brieuc), dont le dépassement est respectivement stabilisé à 70 % à partir de 2002 et à 75% en 2003 et 2004. La CMA de la Réunion a porté son droit additionnel à 75% du droit fixe et la CMA 40 à 80%. Seules la CMA 33, dont le taux n'est que de 55% sur toute la période, et la CMA 05, qui n'a pas sollicité ce droit à dépassement, échappent quelque peu à ce mouvement général.
La plupart des CMA sous contrôle (CMA 64, 47, 24, 22, 54, 29, 88) ont même opté pour un produit du droit additionnel porté à son maximum de 85 %. Ce sont, en général, les CMA gérant un CFA qui utilise cette possibilité.
Un dépassement du droit additionnel pas toujours conforme à la réglementation
Rappel de la réglementation : Le décret du 24 avril 2002 précise que le dépassement du droit additionnel reste subordonné à la signature d'une convention avec le représentant de l'Etat, qui autorise le dépassement après demande motivée. La convention doit mentionner les actions ou les investissements à réaliser et les engagements correspondants de la CMA.
Des dépassements pas toujours justifiés
Rappel de la réglementation : Selon les circulaires de la DECAS (Direction des Entreprises Commerciales Artisanales et des Services), le recours au droit à dépassement rend éligibles à ce type de financement les actions et les investissements pouvant relever des missions traditionnelles de la chambre (nouvelles technologies de l'information et de la communication, remise aux normes de sécurité, meilleure efficacité, redressement financier de la chambre).
Constat : Aux CMA 54, 88 et 22 (Saint-Brieuc et Dinan), le dépassement du droit additionnel, destiné à financer des investissements ou des actions au CFA, n'apparaît pas justifié par la réglementation rappelée ci-dessus puisque la DECAS ne semble pas considérer que les actions spécifiques aux CFA puissent justifier de l'ouverture d'un droit additionnel à la TFCM. Les CMA expliquent que le produit de la taxe d'apprentissage et les subventions de la région ne leur garantissent pas le financement de ces investissements. La réglementation devrait gagner en précision pour davantage de sécurité juridique.
En outre, les conventions passées par la CMA 22 au titre des années 2000 à 2005 ne précisent pas systématiquement la nature des investissements, ce qui ne permet pas d'en vérifier la conformité à la réglementation.
Il ressort de ces constats que le droit additionnel ne contribue pas uniquement à financer des opérations nouvelles mais qu'il sert désormais à la couverture des charges de structure.
Des conditions d'exécution non conformes à la réglementation
Rappel de la réglementation : L'article 321 bis de l'annexe 2 du CGI prévoit qu'aucun dépassement du droit additionnel ne peut être accordé si les engagements de la CMA au titre de la convention précédente n'ont pas été respectés.
Constat : A la CMA 55, le bilan d'exécution 2002 n'a pas été produit, celui de 2003 n'était pas chiffré et en 2004, l'investissement pour l'acquisition et l'aménagement du nouveau siège de la CMA a été reporté, même si ce report n'est pas du fait de la CMA 55. Dans ces conditions, l'obligation attachée aux engagements figurant à chaque convention annuelle n'a pu être vérifiée.
A la CMA de la Réunion, alors que les conventions passées visaient à rétablir le fonds de roulement, cette amélioration n'a pu être observée.
A la CMA 22 (Saint-Brieuc), le calendrier des opérations n'a pas été respecté et les conventions ont été renouvelées sans que la CMA ait eu à justifier de l'exécution des conventions précédentes.
Malgré des écarts constatés, à la CMA 54, entre les objectifs fixés par les conventions et les dépenses effectivement affectées aux opérations programmées, aucune réfaction sur le droit additionnel n'a été appliquée par la tutelle les années suivantes.
Une baisse tendancielle de la couverture des charges par la TCFM
Les CRC ont relevé que la TFCM, seule ressource stable et pérenne des CMA, a décru en part relative dans le budget des CMA.
Cela s'explique par les modalités mêmes de calcul du droit fixe, qui varie sous l'effet de deux variables : le nombre de ressortissants et le taux voté annuellement par le parlement. Lorsque ce taux est à son maximum, toute marge de progression liée à un « effet taux » est, par nature, exclue. De plus, si le nombre d'artisans tend à baisser dans le département, c'est le produit même issu du droit fixe qui diminue.
Conséquence de ce phénomène, le produit tiré du droit additionnel, dont la base taxable est différente, tend progressivement à rejoindre le niveau du produit procuré par le droit fixe (CMA 54, 55). A la CMA 22 (Saint-Brieuc), le nombre d'assujettis n'évoluant guère, les produits du droit fixe et du droit additionnel tendent donc à se stabiliser. A la CMA 55, la relative stabilité des immatriculations au registre des métiers, depuis plusieurs années, empêche que le produit de la TFCM constitue une véritable marge de manoeuvre.
A la CMA 22 (Dinan), le produit global de la TFCM ne couvre que la moitié des charges de personnel, qui apparaissent incompressibles, et que 37% des charges d'exploitation en 2003. La situation s'est dégradée à la CMA 22 (Saint-Brieuc), où il couvre 68% de la masse salariale en 2004 contre 77% en 2001, ainsi qu'à la CMA 88, où il n'en couvre que 77% en 2004 contre 83% en 2001. Cette même ressource ne couvre plus, en 2004, que 46% des charges d'exploitation et 70% des charges de personnel à la CMA 54, ces taux étant encore bien moindres à la CMA 55 (respectivement 27% et 45%). La couverture des charges du siège de la CMA 57 est passée, quant à elle, de 69% en 2001 à 77% à compter de 2003.
La TFCM arrive difficilement à couvrir 70% des charges d'exploitation de la CMA 05 et 62% de celles de la CMA 29.
Le rapport de l'IGIC préconisait, sur ce point, d'introduire une déconnexion du calcul du produit du droit additionnel de celui du droit fixe.
2) La montée en charge des subventions
Alors qu'elles sont, par nature, des ressources non pérennes, les organismes publics financeurs des CMA (Région, Etat, Union européenne) étant également sous contrainte budgétaire, les subventions deviennent, pourtant, la ressource majoritaire des CMA, compte tenu de l'insuffisance des ressources fiscales générées par la TFCM. Par ailleurs, ce mode de fonctionnement rend délicat le fonctionnement quotidien d'une CMA puisque les subventions ne sont, en principe, versées qu'après service fait.
Ainsi, la situation financière de la CMA 40 est tributaire à plus de 60% des versements de subventions.
Le budget d'exploitation de la CMA de la Réunion se caractérise aussi par une part prépondérante des subventions, qui représentent 74% de ses recettes totales, alors que la TFCM contribue pour seulement 8,5% aux produits de gestion en 2004.
Les subventions représentent 47% des ressources de la CMA 55, la baisse sensible des subventions de l'Etat ayant été, jusqu'alors, compensée par la région et le département. La CMA 55 est donc très largement dépendante des financeurs publics.
Inversement, la TFCM ne représente plus que 48% des produits d'exploitation de la CMA 57.
Les financements permanents des CMA, à savoir la TFCM et les redevances issues de la tenue du répertoire des Métiers, n'assurent plus le fonctionnement de la CMA 88 qu'à hauteur de 42 %.
Une telle situation ne semble pas satisfaisante, notamment au regard de l'obligation d'assurer des actions pérennes (article 23 du code de l'artisanat) avec des financements incertains et soumis à la politique économique et sociale d'autres acteurs économiques ou publics.
3) Le financement des centres de formation d'apprentis (CFA)
Rappel de la réglementation : Les ressources financières d'un CFA proviennent, en premier lieu, de la collecte directe de la taxe d'apprentissage auprès des redevables. Les CFA peuvent également bénéficier du reversement, par les fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle (article L. 4332-1 du CGCT), d'une partie de la fraction de la taxe d'apprentissage affectée à ces fonds. Il s'agit en quelque sorte d'un mécanisme de péréquation à la disposition de la région. Enfin, les CFA peuvent bénéficier de subventions d'équipement et de fonctionnement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. L'article L. 118-2-2 du Code du travail, modifié par la loi du 17 janvier 2002, prévoit que les ressources annuelles d'un CFA ne peuvent être supérieures à un maximum correspondant au produit du nombre des apprentis inscrits par leur coût de formation tel que rappelé ci-dessus.
Constat : En pratique, les principales ressources d'un CFA sont essentiellement constituées par la subvention régionale et par le produit de la collecte de la taxe d'apprentissage.
A la CMA 54, l'essentiel des produits d'exploitation du CFA a pour origine la subvention de la région Lorraine (79% en 2004). La taxe d'apprentissage constitue la seconde ressource (8% en 2004), mais celle-ci est en baisse régulière (-10%) depuis 2001.
L'essentiel des produits d'exploitation du CFA de la CMA 88 est constitué des subventions, pour plus de 90% sur la période 2000 à 2005. La plus grande part est constituée de la subvention régionale (environ 80% du total des subventions), suivie de la taxe d'apprentissage (entre 12% et 18% du total des subventions selon les années). Le financement du CFA par la CMA 88 demeure, pour sa part, marginal sur la période (de l'ordre de 3% mais avec une tendance à l'augmentation).
A la CMA 29, la part de la subvention régionale dans les recettes du CFA est de 61%, contre 20 % pour la taxe d'apprentissage, 9,5% pour la vente de produits et services, 2,5% pour la contribution de la CMA et 7% pour les contributions diverses. La part limitée de la taxe s'explique par la proportion importante de PME ressortissantes de la CMA.
Les subventions régionales
Rappel de la réglementation : La « création » 30 ( * ) d'un CFA fait l'objet d'une convention conclue avec la Région. La convention prévoit, notamment, la durée et les coûts de la formation dispensée, ces derniers pouvant être révisés chaque année par un avenant (article L. 118-2-2 du code du travail).
En application de l'article R. 116-16 dudit code, la convention quinquennale signée avec la Région doit déterminer, sur la base du nombre d'apprentis accueillis par le CFA, le mode de calcul de la subvention qui sera versée. Ce mode de calcul doit prendre en compte le coût de formation annuel des apprentis, ainsi qu'un coût forfaitaire d'hébergement et de restauration.
L'article L. 118-2-2 du code du travail prévoit, en outre, la fixation, dans la convention, des coûts de formation des apprentis par section.
Constat : A la CMA 33, les principales recettes du CFA sont constituées par la subvention attribuée par la région et le produit des sommes versées en exonération de la taxe d'apprentissage. Mais en contradiction avec les textes précités, les modalités de calcul de la subvention régionale n'ont pas été fixées par la convention signée le 11 février 2002 avec la région Aquitaine. Dans ces conditions, les modalités précises de financement du CFA, et par voie de conséquence, leurs engagements respectifs, n'ont jamais été réellement arrêtées par les signataires de la convention.
A la CMA 57, le montant versé au titre du fonctionnement des cours se calcule par rapport à un budget de référence voté chaque année par le conseil régional. Les coefficients de prise en charge sont de 53 % pour chacun des trois CFA. Outre cette participation, les CFA perçoivent un remboursement des transports des apprentis (formation de niveau IV et V) et une subvention forfaitaire pour l'hébergement et la restauration.
Principale financeur du CFA de la CMA 88, la Région Lorraine verse une contribution qui, rapportée au total des produits d'exploitation, s'est située, sur la période 2000 à 2005, dans une fourchette entre 71% (2003) et 77% (2000).
Selon les termes des conventions passées par la région Lorraine, si ce financement ne suffit pas à couvrir les charges du CFA, le complément doit être apporté, soit par le reliquat de taxe d'apprentissage des années antérieures, soit par l'organisme gestionnaire, soit, exceptionnellement, par la Région, au vu d'un rapport financier comportant des mesures de redressement.
la taxe d'apprentissage
Son taux est de 0,50 % des salaires bruts versés au cours de l'année d'imposition. En sont exonérées les entreprises dont la masse salariale n'excède pas six SMIC et qui embauchent au moins un apprenti. Les entreprises ont la faculté de s'exonérer de leurs versements auprès du Trésor public en affectant leur versement, soit à un ou plusieurs établissements de formation, soit à un organisme collecteur agréé qui effectue ensuite la répartition entre les CFA et les établissements d'enseignement technologique ou professionnel.
L'affectation de la taxe d'apprentissage est divisée en deux parts :
- une part appelée «quota», réservée obligatoirement aux CFA et sections d'apprentissage et qui représente 40 % de la taxe d'apprentissage. Sur ce quota, ¼ est versé à un fonds national de péréquation (FNPTA) destiné à rééquilibrer la distribution de la taxe au profit des régions les moins richement dotées en vue d'un financement plus équitable des CFA. Les ¾ restant sont affectés par l'entreprise au CFA de son choix.
- le surplus appelé «barème» (60 % de la taxe d'apprentissage) sert à financer, au-delà de l'apprentissage, l'ensemble des formations premières technologiques et professionnelles au niveau de l'enseignement secondaire et supérieur (lycées professionnels, IUT, écoles d'ingénieurs ou de commerce figurant sur une liste agréée).
Afin d'améliorer la lisibilité du système, la loi du 17 janvier 2002 a réduit le nombre de collecteurs et assuré une meilleure répartition des ressources entre CFA.
Les chambres consulaires régionales deviennent collectrices de droit et toute sous-traitance à un tiers des opérations de collecte et de répartition nécessite la conclusion d'une convention de délégation.
Constat : très souvent, les CMA départementales contrôlées collectent la taxe d'apprentissage par délégation de la chambre régionale. Elles doivent alors avoir une attitude offensive de collecte en démarchant les entreprises, afin de « flécher » ladite taxe au profit de leur CFA.
A la CMA 54, la baisse très importante du produit de la taxe d'apprentissage (moins 33,35 % entre 2001 et 2004) a largement contribué à la dégradation de la situation financière du CFA. Si la concurrence est, certes réelle, avec les autres établissements collecteurs de la taxe, la CMA 54 doit chercher à identifier les causes de ce phénomène.
La taxe d'apprentissage perçue par le CFA de la CMA 22 (Saint-Brieuc) a également baissé de près de 18%, passant de 1,39 à 0,95 million d'euros,
A contrario , le CFA de la CMA 22 (Dinan) a perçu des sommes en hausse de 0,26 à 0,41 millions d'euros (+58%) sur la période. De même, le versement, par la CMA 29, à son CFA est en hausse de 70% entre 2002 et 2006, passant de 0,250 à 0,427 millions d'euros.
A la CMA 88, les produits de la taxe d'apprentissage connaissent une évolution plutôt erratique (augmentation de 2000 à 2002, chute de 36% en 2003 puis reprise en 2004 pour retrouver un niveau proche de 2000).
Par ailleurs, dans les comptes respectifs des CFA de ces deux CMA des Côtes d'Armor apparaît un excédent de taxe d'apprentissage, alors que les conventions conclues avec la région Bretagne précisent que le compte financier du CFA ne peut être présenté avec un résultat excédentaire et que « dans le cas où les recettes recueillies sont supérieures aux besoins de l'activité de formation par apprentissage, l'excédent non mobilisé avec l'accord de la région, fait l'objet d'un versement au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue».
Dans le cadre des collectes 2002 et 2003, la CMA 29 a pratiqué, avec une CCI et le réseau des maisons familiales et rurales, un système d'échange de taxe opaque et rémunéré, 1 euro de barème étant échangé contre 1,2 euro de quota. Ce système, qui a permis à la CMA 29 de collecter 39 900 € supplémentaires au titre de la collecte 2002 et 38 692 € au titre de celle de 2003, est condamnable car, d'une part, la traçabilité comptable de ces opérations est difficile à établir, d'autre part, le manque de transparence est patent à l'égard des entreprises ayant versé leur taxe d'apprentissage à la CMA dans la mesure où elles n'ont pas eu connaissance de la mise en oeuvre de cette procédure, et enfin, le caractère lucratif de l'échange d'argent public relève de l'illégalité.
4) Un périmètre imprécis des redevances pour prestations de service
Une regrettable confusion entre prestations gratuites et payantes
Rappel de la réglementation : Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 19 juillet 1996, les CMA créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers.
En application de l'article 29 du décret du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, des redevances peuvent être perçues pour les services créés par les CMA, dans leur domaine de spécialité et dans l'intérêt particulier des artisans et des personnes désirant exercer une activité artisanale, lorsque l'usager de ce service en retire un intérêt personnel, direct et spécial et que ce service excède les services normaux dont le financement est couvert par le produit de la TFCM. Le montant de ces redevances est déterminé compte tenu de l'intérêt qu'en retire chaque usager et dans la limite des charges exposées au titre du service dont il a directement bénéficié. La CMA arrête le tarif de ces redevances figurant en annexe à son budget prévisionnel. Aucune autre redevance ne pourra être perçue par les CMA à compter de la date d'approbation de leurs budgets.
Constat : La difficulté vient du fait qu'aucune disposition réglementaire n'a jamais défini avec précision ce que sont les « services normaux » dont le financement est couvert par le produit de la TFCM et qui devraient donc être délivrés gratuitement par les CMA. Si l'on se reporte à leurs compétences telles que définies à l'article 23 du Code de l'artisanat, il est possible d'isoler deux catégories de services imparties aux CMA, le répertoire des métiers et le centre de formalités des entreprises, activité régalienne de la CMA, d'une part, le service des contrats d'apprentissage, d'autre part.
Dans nombre de CMA, la politique de tarification s'écarte du cadre de la gratuité minimale des prestations prévue par la circulaire du 30 mai 1997. Celle-ci indique que sont gratuites les formalités se rattachant à des prestations de base, tels que l'immatriculation au répertoire des métiers (réception des déclarations, délivrance du récépissé, transmission aux organismes concernés, information du déclarant que son dossier est incomplet), les changements d'adresse pour les seules personnes physiques et les radiations.
Or, certaines de ces prestations ont été facturées par la CMA 22 (Saint-Brieuc). De même, seules sont gratuites, dans les CMA 54 et 55, le changement d'adresse pour les personnes physiques et les radiations, toutes les autres prestations étant facturées. A la CMA 22 (Dinan), seules sont gratuites la mention du conjoint et la fourniture d'extraits d'inscription.
Seule la CMA 57, conformément aux instructions ministérielles, pratique la gratuité sur l'immatriculation du chef d'entreprise, les radiations et l'assistance aux formalités (CFE), service de base.
A la CMA 33, il a été irrégulièrement appliqué, à compter de 2004, un tarif unique englobant la redevance instituée par la loi de finances pour 1998 et le coût des prestations supplémentaires facultatives. Une telle pratique est contraire aux textes, qui distinguent la perception de droits pour la réalisation d'actes obligatoires, et la possibilité de percevoir des redevances en contrepartie de services facultatifs supplémentaires.
Un relatif manque de transparence
Le tarif des services facultatifs doit faire l'objet d'une information auprès des ressortissants : doivent figurer, en annexe du budget prévisionnel et des comptes, le montant de chaque redevance instituée par la CMA, les conditions de sa perception, ainsi que les recettes correspondantes. Le contrôle de la CMA 64 a montré que l'information des artisans sur les tarifs restait à améliorer.
Une progression soutenue du tarif des redevances
Il a été constaté (CMA 22 -Saint-Brieuc et Dinan, CMA 54, CMA 88) que la hausse des tarifs de redevances du répertoire des métiers est, sur la période 2000-2004, très supérieure à l'inflation observée durant les exercices concernés.
Par contre, la politique tarifaire de la CMA 54 apparaît moins soutenue pour le service « contrat d'apprentissage », l'explication probable étant que la CMA entre en concurrence avec d'autres organismes spécialisés et qu'elle doit, en conséquence, ajuster ses tarifs.
Des incidences fiscales parfois méconnues
La CMA 24 n'a pas assujetti les recettes de ses prestations (création/transmission/reprise, développement d'entreprise...) à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), alors qu'il s'agit d'activités pour lesquelles la concurrence doit être présumée, notamment à la lecture de l'article 26-II du code de l'artisanat, et qui sont susceptibles d'être fournies par des professionnels. La CMA 24 étudiera au cas par cas l'assujettissement de ses prestations de services aux impôts des entreprises.
5) Les ressources issues du stage préparatoire à l'installation (SPI)
Rappel de la réglementation : Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, le futur chef d'entreprise, avant son immatriculation au répertoire des métiers, suit un stage de préparation à l'installation (SPI) organisé par la CMA. Ce stage, ouvert au conjoint, assure une initiation à la comptabilité ainsi qu'une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale. L'article 4 du décret du 24 juin 1983 précise que les stages ont une durée minimale obligatoire de 31 heures et doivent se dérouler sur une période de deux mois au plus.
Le stage constitue donc une obligation et il est payant 31 ( * ) . L'article 97 de la loi de finances 1987 dispose que le participant acquitte un droit égal à 1,5 fois le montant du droit fixe de la TFCM.
Constat : L'instruction a révélé la perception de recettes pour des montants non conformes aux textes de référence, quand bien même certaines CMA justifient ce dépassement par une durée de stage de 48 heures au lieu des 31 heures minimales. Une CMA explique également que le SPI est financé en partie par les stagiaires qui bénéficient d'une prise en charge du conseil régional.
Il n'en demeure pas moins qu'en 2004, les tarifs du SPI ont été de 240 euros à la CMA 55, de 250 euros à la CMA 54, de 290 euros à la CMA 29, ou encore de 275 euros à la CMA 22 (St Brieuc), de 305 euros à la CMA 22 (Dinan) et de 378 euros à la CMA 88, au lieu des 140 euros réglementairement exigibles (1,5 fois le droit fixe de 93,50 euro).
|
Résumé des principaux constats : Le produit global de la TFCM (droit fixe + additionnel), taxe destinée à couvrir les « dépenses ordinaires » des CMA, couvre de moins en moins leurs charges de structure, souvent difficilement compressibles. Les marges de manoeuvre issues de cette ressource fiscale s'amenuisent donc. Le droit additionnel, ressource à l'origine exceptionnelle, tend à devenir une ressource permanente. Il ne contribue plus uniquement au financement d'opérations nouvelles car, d'une part, son produit est largement supérieur au montant de ces opérations qu'il est censé financer, d'autre part, il lui est demandé de financer certaines actions des CFA et non celles des CMA. Il s'en suit qu'il sert désormais à la couverture des charges de structure des CMA, le montant des opérations étant déconnecté du droit additionnel. Une réelle difficulté s'attache aux redevances pour prestations de service , due à l'absence de définition réglementaire de ce que sont les « services normaux », dont le financement est couvert par la TFCM et qui devraient, donc, être délivrés gratuitement par les CMA. Les CMA facturent, ainsi, indûment des prestations de service public aux artisans, qui paient déjà la TFCM. Les CMA voient leurs ressources propres stagner ou régresser, devenant de plus en plus dépendantes des financeurs publics à travers le versement de subventions. La part des subventions régionales tend, notamment, à s'accroître dans le financement des CMA servant de support à un CFA. Les modalités de calcul de ces subventions sont précisées dans les conventions quinquennales que chaque CMA passe avec la région. La part des ressources provenant des stages de préparation à l'installation progresse dans la mesure où les CMA facturent ces stages au-delà du seuil tarifaire réglementaire. Les CMA collectent très souvent la taxe d'apprentissage par délégation de la chambre régionale, les amenant à avoir une attitude offensive de collecte et de démarchage des entreprises. |
§§§§§§§§
|
FICHE II : DES PROCÉDURESBUDGÉTAIRES ET COMPTABLES MAL MAÎTRISÉES |
1) une information financière peu transparente
A la CMA 64, l'information des artisans sur les tarifs reste à améliorer, car le montant de chaque redevance instituée par la CMA, les conditions de sa perception, ainsi que les recettes correspondantes ne figuraient pas en annexe du budget prévisionnel et des comptes.
Les informations financières de la CMA 47 étaient incomplètes, faute d'élément sur le fonds de roulement et sa variation. La participation de la même CMA au capital d'une SEM n'a pas été retranscrite dans les comptes de l'établissement, en particulier à l'actif du bilan.
La CMA 40 n'a pas produit de balance définitive.
2) une obligation de certification budgétaire pas toujours satisfaite
Rappel de la réglementation : Le code du travail dispose, dans son article R. 116-15, que les comptes des CFA dont la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public doivent être certifiés par un commissaire aux comptes.
Constat : Cette obligation n'est pas parfaitement respectée par la CMA 33, les comptes du CFA ne faisant pas l'objet d'une certification distincte des comptes globaux de la compagnie.
De même, à la CMA 47, les comptes du CFA n'ayant été certifiés qu'à partir de l'exercice 2005, ceux de 2001 à 2004 ont donc été transmis à la préfecture, autorité de tutelle, et à la région Aquitaine, collectivité finançant la formation professionnelle, sans être certifiés.
3) Des budgets adoptés et rendus exécutoires tardivement
Rappel de la réglementation : Selon l'article 28 du code de l'artisanat, le budget est voté par l'assemblée générale dans le courant du mois d'octobre et n'est exécutoire qu'après approbation du préfet. Le décret du 2 novembre 2004 fixe la date limite d'adoption au 1 er décembre.
Constat : Ces dispositions sur les dates limites d'adoption ont été perdues de vue par les CMA 54 et 55, même si celles-ci tempèrent cette observation par le fait que certaines données financières, comme le montant du droit fixe de la taxe pour frais de chambre fixé par la loi de finances, leur sont transmises tardivement. Il s'ensuit que l'approbation préfectorale rendant exécutoire le budget a été extrêmement tardive. La CMA 54 a même fonctionné tout au long de l'année 2002 sans budget exécutoire.
Le même constat prévaut à la CMA 22, où tous les budgets avant 2004 ont été adoptés fin novembre ou mi-décembre, et rendus exécutoires en janvier ou mars de l'année d'exécution. Situation identique à la CMA 40, avec des budgets tardivement votés et non exécutoires en début d'année, et à la CMA 88, où tous les budgets ont été votés à la fin novembre entre 2001 et 2005.
4) des procédures budgétaires ou comptables déficientes
De nombreuses anomalies comptables ont été détectées.
L'examen des pièces comptables à la CMA 33 a révélé que les bons de commande étaient rarement émis et que l'engagement préalable des dépenses dans la comptabilité n'était pas obligatoirement réalisé. Cette défaillance dans la tenue de la comptabilité des dépenses engagées est de nature à compromettre la correcte surveillance des seuils de passation des marchés publics.
La CMA 22 ne dispose pas d'une comptabilité des dépenses engagées et n'opère aucun rapprochement entre les inventaires comptable et physique. Des factures ont pu être réglées en l'absence de certification du service fait.
Les administrateurs de la CMA de la Réunion, nouvellement élus en 2005, ont refusé de prendre à leur compte la gestion antérieure, amenant à ce que les comptes 2004, de par leur abstention, ne soient jamais approuvés par l'assemblée générale. La même CMA ne pratique pas le rattachement des charges à l'exercice, qui seule permet de garantir une image fidèle des comptes et de respecter l'indépendance des exercices.
La CMA 05 n'accompagne pas son compte de gestion, lors de son envoi au préfet, des pièces de comptabilité nécessaires.
La CMA 29 ne pratique pas l'amortissement réel de toutes ses immobilisations, l'absence de l'inscription comptable des dotations correspondantes améliorant fictivement le résultat de fonctionnement.
Les comptes du CFA de la CMA 40 ont confusément intégré ceux de la formation continue, pourtant distincte de l'apprentissage, la même CMA présentant des comptes 2004 assimilant, à tort, la capacité d'autofinancement au résultat net comptable.
A la CMA 22, des factures ont pu être réglées en l'absence de certification du service fait. Des bons d'achat de carburant pour les véhicules de service ne permettent pas toujours de savoir pour quel véhicule et à quel agent a été effectué l'achat. Des cessions d'ordinateurs au profit du personnel, relevées dans la comptabilité, n'ont pas été réalisées en toute transparence.
5) Des régies de recettes absentes ou mal gérées
En règle générale, l'absence de formalisation fragilise la sécurité des fonds au sein des CMA.
Ainsi, aucune régie n'existe à la CMA 29 alors que les sommes manipulées ne sont pas négligeables (près de 50 000 euros en 2005).
La CMA 47 a bien mis en place une régie générale de recettes mais compte tenu des différents lieux d'encaissement des produits, les recettes étaient, de fait, maniées par plusieurs agents.
A la CMA 64, les conditions minimales de formalisme n'ont pas été respectées car c'est une autorité incompétente, le bureau, qui a désigné les régisseurs. Il a été recommandé à la chambre de nommer les régisseurs par décision du président.
A la CMA 22, les régisseurs sont nommés sans l'agrément obligatoire du trésorier et les remises des fonds (chèques ou espèces) n'ont lieu que chaque fin de semaine, alors que les chèques doivent être remis à l'encaissement au plus tard lendemain de leur réception par le régisseur.
Le régisseur de la CMA 33 a exercé ces fonctions en l'absence d'acte officiel de nomination. Plusieurs agents de cette chambre de métiers et de la CMA 24 ont été amenés à encaisser des recettes et à manipuler des espèces sans qu'une habilitation expresse ne leur ait été délivrée.
6) Une séparation de l'ordonnateur et du comptable mal assurée
Faute d'élaboration d'un guide des procédures, il a été constaté l'immixtion dans l'encaissement des recettes de la CMA 05, qui relève de l'ordonnateur, de plusieurs membres du personnel.
§§§§§§§§
|
FICHE III : UNE GOUVERNANCE APPROXIMATIVE |
1) une organisation singulière
Le département des Côtes d'Armor voit irrégulièrement coexister sur son territoire deux CMA, l'une basée à Saint-Brieuc, l'autre à Dinan, en contradiction avec les dispositions du décret du 2 novembre 2004. Cette situation se rencontrerait dans quatre autres départements.
2) une faible représentativité du monde artisanal
Rappel de la réglementation : L'assemblée générale d'une CMA est composée de 36 membres, élus pour un mandat de 5 ans, dont 24 au titre du collège des activités (alimentation, bâtiment, fabrication, services) et 12 au titre du collège des organisations professionnelles.
Constat : Lors des dernières élections du 9 mars 2005, la plupart des CRC a constaté un taux de participation très faible. Ainsi, à la CMA 47, les suffrages exprimés représentaient un peu plus de 29% des inscrits dans le collège des activités et un peu plus de 28% des inscrits dans le collège des professionnels. Ces deux taux étaient de seulement 23% à la CMA de Dordogne. Le taux de participation à la CMA 29 était de 24,2%.
3) Un fonctionnement insatisfaisant des assemblées générales et des commissions
Rappel de la réglementation : Les CMA se réunissent en assemblée générale au moins deux fois par an. Les membres qui, pendant deux sessions successives, se sont abstenus d'y participer sans motif reconnu légitime, sont déclarés démissionnaires par le préfet, après délibération de l'assemblée générale de la chambre.
Constat : Les assemblée générales sont rarement saisies des absences successives non excusées afin d'engager la procédure de sanction de l'absentéisme (CMA 35, CMA 47, CMA 24, CMA 55, CMA 29, CMA 40).
A la CMA 05, les PV de l'AG sont formels et ne reflètent pas de débats de fond. La CMA 40 s'est exonérée de l'obligation de tenir un registre spécial des délibérations.
Dans de nombreuses CMA, les commissions ne fonctionnent pas à plein effectif.
4) une assemblée générale trop peu sollicitée
Nombre de CRC ont constaté que l'assemblée générale (AG) ne joue pas complètement son rôle d'instance décisionnelle.
Tel est le cas pour ce qui concerne l'approbation de la grille des rémunérations ainsi que celle des indemnités (CMA 35, CMA 55, CMA 22). De même, l'AG de la CMA 33 n'a jamais été appelée à approuver la grille indiciaire des emplois (situation corrigée en 2005).
De même, le versement d'indemnités de déplacement a pu être réalisé à partir d'un barème qui n'a jamais été décidé par l'AG, mais par le bureau (CMA 35).
Le versement des indemnités liées au mandat de membre du bureau de la CMA 33 était effectué jusqu'à octobre 2005 sur la base d'une décision du bureau, qui n'était pas compétent pour prendre une telle décision qui relevait de l'AG de la chambre de métiers.
La CMA 88 semble avoir perdu de vue que l'assemblée générale doit se prononcer, de façon spécifique, sur le principe et sur le montant des indemnités pour frais de mandat.
A la CMA de la Réunion, l'assemblée n'est pas toujours consultée pour certaines décisions entrant dans ses domaines de compétence (impact financier ou représentation extérieure de la CMA), et qui sont prises par le bureau.
L'assemblée plénière de la CMA 57 ne s'est jamais formellement prononcée sur l'attribution d'un véhicule de fonction au président et au secrétaire général.
A la CMA 29, l'AG n'a été informée des conditions d'un marché maîtrise d'oeuvre qu'après la signature de celui-ci.
5) un règlement intérieur rarement mis à jour
Il doit être approuvé par l'assemblée générale mais cette formalité n'est pas toujours remplie (CMA 35). Il mérite d'être actualisé, compte tenu d'importants retards de mise à jour (CMA 35, 33). Celui de la CMA de la Réunion est très imprécis et ne reflète pas la situation de l'organisme au moment du contrôle. Le règlement intérieur de la CMA 55 ne répertorie pas le nombre d'agents statutaires et la nature des emplois occupés, en méconnaissance de l'article 22 du code de l'artisanat.
6) Des membres associés défaillants
Rappel de la réglementation : Le règlement intérieur doit fixer un nombre de membres associés limité à la moitié au maximum du nombre des membres élus.
Constat : Suite aux élections de 2005, la liste des nouveaux membres associés n'était toujours pas arrêtée à la CMA 24.
7) Des délégations incertaines
A la CMA 47, certaines délégations de compétence ont été consenties à des agents dans des domaines d'intervention relevant de la compétence du trésorier.
Des délégations de signature à la CMA 64 sont obsolètes car datant de 1994. Ce domaine est également mal maîtrisé par la CMA 40, les délégations de compétence effectives de l'ordonnateur n'étant pas formalisées et les délégations de signature étant consenties directement par le bureau, et non par le président.
8) Des procédures irrégulières de subventionnement
Dans les CMA 24 et 47, l'attribution de subventions n'était décidée que par le bureau et non par l'assemblée générale.
9) Une gestion perfectible des ressources humaines
Une grille des emplois souvent formelle
Avant 2005, la grille indiciaire des emplois n'avait jamais été approuvée par l'assemblée générale de la CMA 33. Elle ne l'a pas été du tout dans les CMA 35, CMA 55 et CMA 22, ce qui constitue un manquement grave aux règles les plus élémentaires de transparence.
A la CMA de la Réunion, la grille des emplois qui doit être annexée au règlement intérieur ne comporte pas les mentions prévues par la réglementation.
Des points d'indice supplémentaires à ceux fixés par la grille ont pu être attribués à titre individuel par la CMA 29, dans des conditions peu transparentes.
La grille locale des emplois de la CMA 05 comporte des indices de base supérieurs à ceux fixés par la grille nationale statutaire. Si la CRC ne conteste pas la prise en compte par l'exécutif de l'évolution des métiers à la CMA, elle relève que ces écarts paraissent davantage fondés sur des critères de circonstances que sur des éléments objectifs. Par ailleurs, il existe des écarts entre ce que prévoit cette grille et les décisions du bureau, le personnel bénéficiant de bonifications de coefficients.
L'attribution de primes irrégulières
Rappel de la réglementation : L'article 25 du statut des personnels des chambres de métiers prévoit le versement aux agents d'une seule prime annuelle de fin d'année égale au douzième du traitement réel versé.
Constat : La CMA 47 a octroyé une prime exceptionnelle à deux agents (1 525 € en 2001), pour compenser une collaboration régulière pendant une période d'indisponibilité, et une prime annuelle de 7 318 € en 2001 et 2002, destinée à rémunérer une mission particulière.
A la CMA 24, une prime exceptionnelle est attribuée sous forme de points d'indice (20 000 € en 2004). Le règlement intérieur de la CMA 55 prévoit une prime exceptionnelle égale à un mois de salaire et une indemnité de départ à la retraite. A la CMA 57, ce sont 33 agents qui ont perçu, en 2004, plus de 13 000 euros de primes exceptionnelles irrégulières.
Les agents de la CMA 64 perçoivent une prime lors de leur départ à la retraite alors que n'étant pas prévue par le statut des personnels des CMA, elle n'a pas de fondement légal (8975 € pour la période 2000-2004). Le même constat a été dressé dans les CMA 29 et 05.
A la CMA 33, l'absence de délibération susceptible de servir valablement de base juridique au versement des indemnités de 2001 à fin 2005 constituait une importante anomalie. La même chambre des métiers a, de plus, versé irrégulièrement une prime de départ à la retraite puis une indemnité dégressive de fin de carrière.
Une prime mensuelle de 20% au titre de la vie chère est indûment incluse dans la rémunération de base versée par la CMA de la Réunion.
La CMA 22 (Dinan) a également procédé au versement de diverses primes, sans aucune habilitation de l'assemblée générale, comme à la CMA 05, où elles sont décidées par le bureau.
L'absence d'évaluation des agents
Une démarche d'évaluation a été initiée en 2002 par la CMA 64 mais elle a été arrêtée en 2003 au motif qu'il n'existait pas de modèle national en la matière. La situation n'a pas évolué depuis 2003.
A la CMA 05, les agents ne sont ni notés, ni évalués, contrairement à ce que prévoit le statut.
Une forfaitisation des frais de représentation et de déplacement
Les dispositions selon lesquelles le président et le cas échéant, certains membres du bureau de la CMA 33 peuvent bénéficier d'une évaluation forfaitaire mensuelle des frais de représentation ne sont pas conformes au code de l'artisanat. Alors qu'une décision du bureau avait fixé comme principe le remboursement des frais réellement engagés, un nombre limité de membres élus de la CMA 33 ont, en contradiction avec ces règles, bénéficié de versements mensuels de montants forfaitaires de frais.
A la CMA de la Réunion, outre que les frais de déplacement sont remboursés sur des bases supérieures à celles prévues pour les personnels civils de l'Etat, les indemnités de fonctions qui peuvent être versées aux membres de l'assemblée générale ont dépassé le montant prévu par les textes, soit le double du montant versé au président.
Les indemnités versées aux agents par la CMA 05 pour les repas pris et les nuitées passées à l'extérieur du département sont supérieures à celles retenues par la commission paritaire nationale.
Un recours abusif aux contractuels
Alors que le recrutement de contractuels doit constituer une exception et répondre à des conditions bien précises (besoins non permanents ou particuliers, remplacement d'agents titulaires), la CMA de la Réunion a multiplié le recours aux emplois précaires. La CMA 29 avait même envisagé, avant régularisation, que le poste de directeur général adjoint soit pourvu par un contractuel, alors qu'il s'agit d'un emploi permanent.
Une longévité particulière des secrétaires généraux
Le rapport de l'IGIC a mis en exergue l'inadaptation d'un statut relativement ancien aux principes d'un management moderne. Ainsi, au 31/12/2003, 42% des secrétaires généraux avaient une ancienneté dans le poste supérieur à 15 ans. A la CMA 54, le secrétaire général est, par exemple, en fonction depuis 1976.
Un mécanisme onéreux de GVT
Rappel de la réglementation : Le mécanisme de GVT (glissement-vieillesse-technicité), appliqué selon les statuts de personnel, conduit à une augmentation de 6% du traitement de base tous les quatre ans, avec un plafond de 40%.
Constat : Ce dispositif induit des conséquences financières importantes sur les CMA dont le personnel présente une forte ancienneté. Par exemple, à la CMA 55, sur les 15 agents permanents, six bénéficient d'une prime d'ancienneté entre 30 et 40% du traitement brut. A la CMA 54, sur les 59 agents permanents, la proportion était de 35 agents et à la CMA 57, elle était de 59 agents sur 155.
Les CMA 22 et 29 ont même prévu, par dérogation au statut, l'instauration de demi-échelons, soit un avancement à l'ancienneté de 3% tous les deux ans, ce qui est dérogatoire au statut et n'est pas sans effet financier important.
10) Des procédures de commande publique mal maîtrisées
Alors que les textes ne prévoient pas de déclaration d'intérêt des membres élus des CMA, à la différence des CCI, la CMA 22 a attribué des lots de marché de travaux à des artisans élus en son sein.
A la CMA 29, la prestation de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation du restaurant des apprentis n'a pas fait l'objet d'une mise en concurrence et aucun compte-rendu de la commission d'appel d'offres n'a pu être fourni pour le marché de travaux. La procédure d'attribution s'est révélée peu respectueuse de la réglementation.
La CMA 40 a indûment introduit, comme critère de sélection de ses fournisseurs de travaux, les montants de versement de taxe d'apprentissage.
La CMA de la Réunion ne procède pas à la publication de la liste des marchés publics passés l'année précédente. Par ailleurs, n'ayant pas défini ses propres règles d'appréciation quant à l'homogénéité de ses fournitures et services, il lui est difficile de contrôler le respect des seuils.
§§§§§§§§
Seconde partie : Les observations formulées en 2008
22 rapports d'observations définitives (ROD) sur des CMA ont été publiés en 2008 sur le site internet des juridictions financières (www.ccomptes.fr), à la suite d'examens de la gestion menés dans le cadre d'une enquête commune inter-CRC, à laquelle 10 d'entre elles ont participé en 2007/2008.
Le tableau ci-dessous identifie les 22 CMA contrôlées :
|
CRC |
CMA |
Date communication 2008 |
|
Poitou-Charentes |
CRMA |
27 novembre |
|
Charente |
20 novembre |
|
|
Deux-Sèvres |
15 avril |
|
|
Charente- Maritime |
29 janvier |
|
|
Bretagne |
CRMA |
21 février |
|
Midi-Pyrénées |
Tarn |
17 novembre |
|
PACA |
Alpes Maritimes |
25 août |
|
Rhônes-Alpes |
Loire |
29 mai |
|
Champagne-Ardennes |
Aube |
12 mars |
|
Haute-Marne |
14 janvier |
|
|
Basse-Normandie |
Calvados |
12 septembre |
|
Orne |
20 février |
|
|
Centre |
Eure-et-Loir |
11 septembre |
|
Indre-et-Loire |
11 septembre |
|
|
Loir-et-Cher |
31 juillet |
|
|
Limousin |
Haute-Vienne |
23 avril |
|
Pays de la Loire |
Maine-et-Loire |
12 septembre |
|
CRMA |
4 septembre |
|
|
Sarthe |
7 mai |
|
|
Mayenne |
21 août |
|
|
Loire-Atlantique |
21 août |
|
|
Vendée |
26 août |
Ces rapports font suite aux 14 ROD déjà publiés en 2007 par 5 CRC.
1) LES CONSTATS DES CRC DRESSES EN 2007 SONT RECONDUITS EN 2008
Les instructions menées en 2008 s'étant appuyé sur le même guide d'aide au contrôle, les constats dressés en 2007 perdurent et les principales problématiques demeurent :
- la taxe pour fonctionnement des CMA (TFCM), destinée à couvrir les dépenses ordinaires, est d'un montant insuffisant pour jouer ce rôle, ce qui explique la montée en charge des subventions ;
Ainsi, par exemple, à la CMA du Tarn , les subventions constituent la première source de financement (58% des recettes), loin devant la recette fiscale -la taxe pour frais de chambre de métiers- (près de 21 %), et la production vendue (17 %), ce qui traduit un degré de dépendance certain de la chambre vis-à-vis des collectivités qui la financent. « Cette situation est cependant assez classique dans les chambres de métiers gérant un CFA » précise la CRC.
De même, les subventions versées (Région, département, Etat, Union européenne) représentent 60% des produits à la CMA de la Haute-Vienne en 2006 et 65% à la CMA de la Mayenne.
En Haute-Vienne , les difficultés de trésorerie constatées en fin d'exercice à partir de 2004 seraient, entre autres, liées aux incertitudes relatives au versement des subventions par la Région qui, en principe, doit intervenir en février, mai et septembre, mais peut être irrégulier.
Le Président de la CMA de la Sarthe considère, également, que le caractère aléatoire des subventions et leur rythme de versement n'est pas sans incidence sur les évolutions budgétaires.
Celui de la CMA de la Loire insiste sur la variabilité des subventions au gré des années, la dépendance des CMA vis-à-vis de l'extérieur et l'absence de visibilité sur les ressources.
- le dépassement du droit additionnel tend à devenir une ressource permanente ;
Un dépassement du droit additionnel, lequel ne peut excéder 50 % du produit du droit fixe majoré d'un coefficient de 1,12, est cependant possible jusqu'à 85 % afin de mettre en oeuvre des actions spécifiques (promotion ou communication au profit de l'artisanat) ou de réaliser des investissements, dans le cadre de conventions conclues avec l'État.
Mais ce dépassement exceptionnel tend à devenir la règle. Ainsi, les taux de droit additionnel relevés lors des contrôles des CRC menés en 2007/2008 sont les suivants :
|
CMA |
Taux |
|
Charente |
85% |
|
Deux-Sèvres |
85% |
|
Charente- Maritime |
85% |
|
Tarn |
85% |
|
Alpes Maritimes |
85% jusqu'à 2005 |
|
Loire |
50% |
|
Aube |
73,5% |
|
Haute-Marne |
65% |
|
Calvados |
60% |
|
Orne |
- |
|
Eure-et-Loir |
85% |
|
Indre-et-Loire |
80% |
|
Loir-et-Cher |
- |
|
Haute-Vienne |
60% |
|
Maine-et-Loire |
50% |
|
Sarthe |
85% |
|
Mayenne |
75% |
|
Loire-Atlantique |
85% |
|
Vendée |
70% |
- le périmètre des redevances pour prestations de service est parfois imprécis ;
Ainsi, par exemple, la CMA de Loire-Atlantique perçoit un droit pour l'immatriculation au répertoire des métiers (150€) et un droit pour la création d'établissement (75€) qui sont supérieurs au plafond législatif (respectivement, 98€ et 49€). Si la CMA estime qu'aux prestations de base (donnant lieu au paiement du droit fixe) s'ajoutent des prestations complémentaires (élaboration des déclarations, conseil personnalisés lors des formalités) qui sont proposées systématiquement aux artisans mais qui ne rentrent pas dans le champ des prestations obligatoires, la CRC des Pays de la Loire observe, cependant, que les tarifs approuvés annuellement par le bureau ne permettent pas d'identifier la nature et le coût de ces prestations complémentaires qui peuvent donner lieu à une facturation distincte, aux côtés de la prestation de base financée par le droit fixe.
A la CMA d'Eure-et-Loir , des tarifs ont été fixés pour la délivrance d'extraits d'inscription au répertoire des métiers, pour les modifications apportées à ce dernier et pour les attestations de contrat d'apprentissage. La CRC du Centre constate que ces prestations, qui s'apparentent à des prestations de base, sont payantes alors même que, selon les termes de la circulaire du 30 mai 1997 relative au fonctionnement du centre de formalités des entreprises, seules les prestations d'assistance à la formalité peuvent donner lieu à paiement, les prestations de base devant pour leur part rester entièrement gratuites.
Quant à la CMA du Tarn , alors que l'immatriculation au répertoire des métiers devrait entrainer le paiement d'un droit égal au montant maximum du droit fixe en application des articles 1601 et suivants du code général des impôts, le montant demandé par la chambre à partir de l'exercice 2004 est supérieur au droit fixe et est intriqué avec d'autres prestations payantes.
- les tarifs du stage préparatoire à l'installation (SPI) sont parfois surévalués ;
Pour les stages de première installation des artisans, les prix demandés aux stagiaires par les CMA du Tarn, de la Loire et de Loire-Atlantique dépassent toujours le tarif légal (1,5 fois le montant du droit fixe). De même, le tarif de 203 € fixé par la CMA de la Sarthe excède le plafond maximal de 150 € en 2008.
2) DES CONSTATS CONFIRMENT LES ANALYSES ISSUES DES VISITES DE LA MISSION SENATORIALE
La lecture des ROD de 2008 permet, également, de confirmer certaines des préoccupations ou questionnements manifestés par les élus ou dirigeants de CMA lors des visites sur place de la mission sénatoriale.
- un rapprochement nécessaire avec la Direction des services fiscaux pour optimiser la perception de la TFCM ;
Dès lors que la CMA de la Charente n'opère pas de contrôle du niveau de ses recettes de TFCM, la CRC de Poitou-Charentes estime qu'un rapprochement des données du répertoire des métiers, tenu à la chambre, de celles des services fiscaux chargés de l'assiette de la TFCM pourrait receler un potentiel de ressources supplémentaires. Ces travaux de rapprochement, entamés puis abandonnés, il y a quelques années, mériteraient, selon elle, d'être repris.
A la CMA des Alpes-Maritimes , un rapprochement des fichiers avec les services fiscaux a permis d'effectuer, depuis 2003, un réajustement du nombre de ressortissants et d'améliorer ainsi le recouvrement des recettes à attendre.
A la CMA de la Haute-Vienne , le directeur des services fiscaux avait constaté que les écarts relevés étaient de nature à justifier un rapprochement du répertoire des métiers avec le fichier des assujettis à la TFCM tenu par ses services. Selon la réponse de la CMA, ce rapprochement devait avoir lieu en avril 2008.
- un transfert de charges non compensé ;
La CRC de PACA indique, dans son ROD sur la CMA des Alpes-Maritimes , que l'article 37 de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME a transféré la responsabilité juridique de l'enregistrement des contrats d'apprentissage aux chambres consulaires. Cette disposition, qui vise à simplifier la procédure d'embauche des apprentis par les entreprises, se traduira par une charge de travail supplémentaire sans contrepartie financière, puisqu'aucune redevance n'est perçue par la CMA pour les formalités relatives à l'apprentissage afin de ne pas alourdir les charges des entreprises. Pour éviter un affaiblissement financier, la CMA des Alpes-Maritimes indique avoir été amenée à diversifier ses activités de service public.
A l'occasion du contrôle de la CMA de la Loire , la CRC de Rhône-Alpes relève que le décret du 26 juillet 2006 sur l'enregistrement des contrats d'apprentissage a conféré aux CMA la mission de vérifier que le contrat satisfait aux obligations du code du travail, en terme de compétence du maître d'apprentissage et du plafond d'apprentis par entreprise. A ce titre, le CMA recueille le visa du directeur du CFA puis adresse le contrat au service en charge de la législation du travail. Ces formalités ne donnent lieu à aucun frais pour l'employeur ou pour l'apprenti. Pour la CMA de la Loire, l'évolution à la hausse du nombre de contrats ainsi que la modification de la réglementation ne sont pas sans conséquence sur la charge de travail qui pèse sur la chambre. Elle a ainsi accumulé en 2007 un retard dans le traitement des dossiers évalué à la mi-septembre à 300 contrats.
- une représentation affaiblie du monde artisanal ;
A la CMA de la Vendée , le taux de participation aux élections du 9 mars 2005 n'est que de 19,08 %. Ainsi les membres de la CMA ont-ils été élus seulement par 2 100 électeurs sur 11 000 inscrits. Ce taux est, en outre, en forte régression par rapport aux élections de 1999 où il avait atteint 30,45 % (moyenne nationale à 24,98 %) et il se situerait en dessous non seulement de la moyenne nationale (23,77 %), mais aussi de la participation dans les trois autres CMA de la région.
Au total, si la répartition des membres reflète bien le poids respectif de chaque secteur d'activités dans le département, le faible taux de participation atténue cependant la représentativité des élus.
Plusieurs facteurs peuvent, selon la CMA, expliquer la faible mobilisation des artisans pour cette élection, notamment le bon niveau d'activité des entreprises artisanales vendéennes, mais aussi un défaut de perception des enjeux de l'élection et du rôle exact de la chambre consulaire. Face à cette situation, l'objectif de la CMA de la Vendée pour les prochaines élections est de mieux la faire connaître, d'aller au devant des artisans par des réunions dans chaque canton, de repositionner les services de formation continue en adéquation avec les besoins des artisans qu'il convient de mieux connaître, et de sensibiliser les organisations professionnelles pour qu'elles conduisent une campagne plus active.
|
A la CMA de la Sarthe , le taux de participation à l'élection de mars 2005 s'établit seulement à 25,69%. Malgré l'adoption du vote par correspondance, ce taux n'a guère progressé par rapport à celui des élections de 1999, qui s'élevait à 25%. |
* 29 Cette baisse s'explique par le fait qu'en 2004, la part du droit fixe attribuée à l'APCM et aux CRMA leur a été attribuée directement
* 30 en pratique, le terme « création » doit s'entendre « fonctionnement »
* 31 A la différence des CCI, où il est facultatif et gratuit.







