Rapport d'information n° 233 (2003-2004) de M. Serge LEPELTIER , fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification, déposé le 3 mars 2004
Disponible au format Acrobat (1 Moctet)
- INTRODUCTION
-
PREMIÈRE PARTIE :
LA MONDIALISATION DE L'ÉCONOMIE :
MONTÉE DES INTERDÉPENDANCES ET ÉMERGENCE
DE PROBLÈMES GLOBAUX - I. LA MONTÉE DES INTERDÉPENDANCES
- A. LA CROISSANCE SPECTACULAIRE DES FLUX D'ÉCHANGES
- 1. L'expansion rapide du commerce international
- 2. La globalisation financière
- a) La croissance spectaculaire des flux financiers
- b) Globalisation financière et stratégies productives : le cas des investissements directs à l'étranger (IDE)
- 3. Les firmes multinationales jouent un rôle central dans la croissance de ces flux
- B. UNE INTÉGRATION CROISSANTE DE L'ÉCONOMIE MONDIALE
- C. LES « MOTEURS » DE LA MONDIALISATION
- 1. De puissantes logiques économiques
- a) Avantages comparatifs et spécialisation
- b) Les économies d'échelle et la recherche de la taille optimale pour les entreprises
- 2. Le rôle des facteurs technologiques
- 3. La mondialisation, un choix politique
- D. LA MONDIALISATION, UN PROCESSUS INACHEVÉ
- 1. La libéralisation n'est pas absolue
- a) Le niveau réel des protections douanières
- b) Des considérations politiques s'opposent à ce que le libre-échange soit généralisé à tous les domaines.
- 2. La volatilité des taux de change freine la croissance du commerce international
- 3. Une mondialisation géographiquement différenciée
- II. L'ÉMERGENCE DES BIENS PUBLICS MONDIAUX
-
DEUXIÈME PARTIE :
LES CONSÉQUENCES DE LA MONDIALISATION
DES ÉCHANGES SUR L'ENVIRONNEMENT - I. LA MONDIALISATION DONNE-T-ELLE UN AVANTAGE COMPÉTITIF AUX PAYS LES MOINS EXIGEANTS EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT ?
- A. LE RISQUE DU « DUMPING ENVIRONNEMENTAL »
- B. LES DONNÉES EMPIRIQUES DISPONIBLES CONDUISENT À RELATIVISER L'AMPLEUR DU PHÉNOMÈNE
- 1. Des exemples de délocalisation ou de recul des normes environnementales sont bien observés dans certains secteurs et dans certains pays du Sud
- 2. Les données macroéconomiques ne traduisent pas une spécialisation des pays en développement dans les activités polluantes
- 3. L'approfondissement de la mondialisation au cours des dernières décennies a été concomitant à un renforcement des normes environnementales dans les pays développés
- C. LES DIFFÉRENCES DE RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE NE SONT GÉNÉRALEMENT PAS UN FACTEUR DÉTERMINANT DES CHOIX D'IMPLANTATION DES ENTREPRISES
- 1. Les coûts de mise en oeuvre des normes environnementales semblent relativement modestes
- 2. Les facteurs classiques de l'avantage comparatif dominent les considérations relatives aux normes environnementales
- 3. Des facteurs techniques ou de réputation peuvent dissuader les entreprises ou les Etats d'exploiter les écarts de normes environnementales
- II. LA CROISSANCE FAIT ELLE PARTIE DU PROBLÈME OU DE LA SOLUTION ?
-
TROISIÈME PARTIE
AMÉLIORER LA GOUVERNANCE MONDIALE ENVIRONNEMENTALE - I. LA GOUVERNANCE INTERNATIONALE DE L'ENVIRONNEMENT AUJOURD'HUI : DES DISPOSITIFS ÉCLATÉS AUX MOYENS RÉDUITS
- A. L'ACTION INTERNATIONALE EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT : FAIBLESSE ET DISPERSION DES MOYENS
- 1. Le Programme des Nations-Unies pour l'Environnement
- 2. Les accords multilatéraux environnementaux (AME)
- 3. Le Fonds pour l'environnement mondial
- B. LA PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT PAR LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES : DES PROGRÈS À CONSOLIDER
- 1. Développement et environnement
- 2. Commerce et environnement
- a) L'exception environnementale dans les traités
- (1) L'article XX de l'accord GATT
- (2) L'Accord GATS (General agreement on Trade of services, ou Accord général sur le commerce des services) et l'Accord SPS (accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires)
- (3) L'Accord OTC (Obstacles techniques au commerce)
- b) L'interprétation jurisprudentielle : des conditions d'application strictes
- (1) De strictes conditions d'application de l'article XX du GATT
- (2) Interprétation de l'article 5 de l'Accord SPS : réaffirmation de l'exigence de preuve scientifique
- c) Incertitudes autour de l'articulation entre AME et accords de l'OMC
- II. RÉÉQUILIBRER LA GOUVERNANCE MONDIALE EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT
- A. POUR UNE ORGANISATION MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT
- B. POUR L'ÉLABORATION DE NOUVELLES CONVENTIONS ENVIRONNEMENTALES
- C. DÉFENDRE LE PROJET D'UNE ÉCOTAXE INTERNATIONALE
- D. POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT PAR L'OMC
- E. CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE À LA GOUVERNANCE DE LA MONDIALISATION
- F. CONTRIBUTION NATIONALE À LA MAÎTRISE DE LA MONDIALISATION
- 1. Améliorer le diagnostic par la création d'un Observatoire national des effets de la mondialisation
- 2. Faire de l'aide publique au développement un levier de la préservation de l'environnement dans les pays du Sud
- 3. Préciser les règles de transparence pour les grands groupes
- 4. Renforcer la prise de conscience des enjeux liés à l'environnement et à la mondialisation dans toutes les administrations
- CONCLUSION
- ANNEXES
- COMPTES RENDUS D'AUDITIONS
- Audition de M. Dominique Plihon, professeur à l'université Paris XIII, président du conseil scientifique d'ATTAC FRANCE, le 12 mars 2003
-
Audition de Mme Laurence Tubiana, directrice de
l'Institut du développement durable et des relations internationales
(IDDRI),
le 1er avril 2003 -
Audition de M. Tom Jones, chef de division
à l'Organisation de développement et de coopération
économiques (OCDE)
le 1er avril 2003 -
Audition de Mme Jacqueline Aloisi de Larderel,
directrice de la Division du Commerce, de l'Industrie, et de l'Economie du
Programme des Nations-Unies pour l'Environnement,
le 8 avril 2003 -
Audition de M. Patrick Messerlin, professeur
d'économie à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris,
et directeur du Groupe d'Economie Mondiale (GEM),
le 8 avril 2003 -
Audition de M. Antoine Jeancourt-Galignani,
président de Gécina et de M. Philippe Trainar, directeur des
affaires économiques, financières, et internationales à la
Fédération française des sociétés
d'assurance,
le 13 mai 2003 -
Audition de M. Denys Gauer, ambassadeur
délégué à l'environnement, et
de
M. Philippe Lacoste, sous-directeur de l'environnement au Ministère des Affaires étrangères,
le 27 mai 2003 -
Audition de M. Dominique Bureau, directeur des
études économiques et de l'évaluation environnementale, de
Mme Sylviane Gastaldo, sous-directeur de l'environnement, des
régulations économiques, et du développement durable, et
de M. François Nass, chef du bureau des régulations
internationales, au Ministère de l'Ecologie et du Développement
durable,
le 3 juin 2003 - Audition de M. Dominique Carreau, professeur de droit international économique à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, le 26 juin 2003
-
Audition de M. Jean Salmon, vice-président
de la Commission économique,
de M. Guillaume Baugin, chargé des affaires parlementaires, et de M. Guillaume Brulé, économiste, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, le 2 juillet 2003 -
Audition de M. Michel Mousel, ancien
président de la Mission interministérielle de l'effet de serre
(MIES),
le 2 octobre 2003 -
Audition de M. Francis Stephan, sous-directeur du
développement économique et de l'environnement au
Ministère des Affaires étrangères,
le 22 octobre 2003. -
Audition de MM. Jean-Pierre Bompard,
secrétaire confédéral en charge des questions
internationales,
et Pierre Bobe, secrétaire confédéral en charge de l'énergie, de l'environnement, et du développement durable, à la Confédération française démocratique du Travail (CFDT),
le 22 octobre 2003. -
Audition de M. Yannick Jadot,
directeur des campagnes de Greenpeace France,
le 17 décembre 2003 -
LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES AU COURS
DE LA MISSION À GENÈVE
DE M. SERGE LEPELTIER DU 4 JUIN 2003 -
LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES AU COURS
DE LA MISSION À BRUXELLES
DE M. SERGE LEPELTIER DU 8 OCTOBRE 2003
N°
233
____________
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mars 2004
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la délégation du Sénat pour la planification (1) sur la mondialisation et l' environnement ,
Par M.
Serge LEPELTIER,
Sénateur.
(1) Cette délégation est composée de : M. Joël Bourdin, président ; Mme Évelyne Didier, MM. Serge Lepeltier, Marcel Lesbros, Jean-Pierre Plancade, vice-présidents ; MM. Pierre André, Yvon Collin, secrétaires ; MM. Gérard Bailly, Joseph Kerguéris, Daniel Percheron, Roger Rinchet, Gérard Roujas, Bruno Sido
|
Mondialisation. |
INTRODUCTION
La
mondialisation est devenue, depuis une quinzaine d'années, un des
thèmes centraux du débat politique, économique et social.
Plusieurs rapports parlementaires ont déjà été
consacrés à ce sujet, mais peu se sont intéressés
à la question spécifique des liens entre mondialisation et
environnement. Le présent rapport sénatorial entend combler, pour
partie, cette lacune. Il entend également apporter sa contribution au
débat en cours sur la gouvernance de la mondialisation. La formation
d'un espace économique mondialisé appelle, en effet, de nouvelles
régulations. Les Etats peuvent, à leur échelle, traiter
certaines conséquences de la mondialisation, mais il paraît
difficile de faire l'économie de la création de nouvelles
instances internationales, ou d'actions coordonnées au niveau
multilatéral. Sur notre continent, l'Union européenne peut
toutefois représenter un échelon d'action intermédiaire
susceptible, dans une certaine mesure, de suppléer aux carences de
l'action internationale.
Il est d'autant plus important de relancer le débat sur la gouvernance
mondiale que le processus de création de nouvelles régulations
semble aujourd'hui traverser une crise. Les manifestations de cette crise sont
multiples. Il faut citer, en premier lieu, la réticence de
l'Administration américaine à accepter des cadres
multilatéraux contraignants. Dans le domaine de l'environnement, la
manifestation la plus spectaculaire de ce refus fut le retrait des Etats-Unis
du Protocole de Kyoto. En second lieu, on ne peut s'abstenir de mentionner les
difficultés - peut-être provisoires - que connaît
actuellement l'Organisation mondiale du commerce (OMC). L'échec de la
Conférence de Cancun en septembre dernier fait suite à
l'échec de la Conférence de Seattle en 1999, ce qui peut faire
craindre que le relatif succès de la Conférence de Doha il y a
trois ans ne représente, dorénavant, l'exception dans les
négociations commerciales internationales. Cette impasse dans les
négociations commerciales est particulièrement regrettable, dans
la mesure où l'Agenda de Doha prévoit, pour la première
fois, d'inclure de vrais éléments de régulation dans le
champ de la négociation. Des négociations sur les interactions
entre commerce et investissement, commerce et politique de la concurrence,
commerce et environnement, figurent, notamment, au programme de travail des
délégations
1
(
*
)
.
Un autre symptôme de la crise de la gouvernance internationale
réside certainement dans la vive contestation dont font l'objet
certaines organisations internationales de la part d'organisations
non-gouvernementales (ONG), ou de mouvements issus de la société
civile, qualifiés « d'anti- », ou
« d'alter-mondialistes ». Dans les années 1980 et au
début des années 1990, la critique s'est focalisée sur
l'action du Fonds Monétaire International (FMI) et de la Banque
Mondiale, et s'est cristallisée sur la question des Plans d'ajustement
structurel, imposés aux pays en développement en contrepartie de
l'aide financière qu'ils recevaient du FMI. Depuis l'accord de Marrakech
et la création de l'OMC en 1994, les critiques se sont
déplacées vers cette organisation, devenue le symbole de la
« mondialisation libérale ».
C'est faire justice au mouvement « altermondialiste » que
de rappeler la très grande diversité de points de vue qui s'y
expriment. On ne peut cependant occulter la contradiction qu'il y a à
vouloir empêcher le bon déroulement de grandes conférences
internationales, alors que ces réunions représentent
précisément le
modus operandi
par lequel une meilleure
régulation de la mondialisation pourra être obtenue.
Néanmoins, la vigueur de la contestation doit attirer l'attention du
politique sur certaines lacunes, réelles, de la gouvernance
internationale contemporaine.
L'angle choisi dans ce rapport pour aborder la question de la mondialisation
est celui de ses interactions avec l'environnement. Ce choix de l'environnement
répond à une préoccupation ancienne de votre rapporteur.
Il existe, par ailleurs, peu d'études systématiques sur les
relations entre mondialisation et environnement, alors que ces deux termes
recouvrent, à n'en pas douter, deux enjeux majeurs du siècle qui
s'ouvre. L'existence de problèmes environnementaux globaux, comme le
réchauffement climatique ou la disparition de la couche d'ozone,
problèmes qu'aucun Etat ne peut prétendre résoudre par une
action isolée, met en évidence la nécessité de
l'action multilatérale. La mondialisation des échanges favorise
l'industrialisation et le développement économique de certaines
régions, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'état de
l'environnement dans les zones concernées. En même temps, la
mondialisation érode, par certains aspects, la souveraineté des
Etats, et risque de réduire leur capacité à
réglementer des activités économiques dans un sens
protecteur de l'environnement. Toutes ces questions seront examinées
plus en détail dans le corps du rapport.
Le phénomène de mondialisation comporte deux dimensions. La
mondialisation désigne d'abord un processus de développement des
échanges et de montée des interdépendances. La
mondialisation de l'économie se traduit par la croissance des flux
commerciaux, des flux d'investissement et des flux financiers. Les firmes
multinationales (FMN) jouent une part active dans ces évolutions :
un tiers du commerce mondial est un commerce intra-firmes ; ce sont aussi
ces entreprises qui déterminent, pour une large part, la localisation
des principaux sites de production. Flux commerciaux, flux d'investissement et
flux financiers sont, bien entendu, liés : la décision d'une
entreprise de créer un site de production à l'étranger va
générer des flux d'investissement vers le pays d'accueil, puis
suscitera des flux commerciaux au départ de ce même pays.
La seconde dimension de la mondialisation réside dans l'émergence
de problèmes globaux. L'émergence de problèmes globaux
résulte elle-même de la prise de conscience de l'existence de
« biens publics mondiaux ». Le climat et la couche d'ozone
sont les deux biens publics mondiaux les plus fréquemment cités,
même si cette notion est aujourd'hui élargie à d'autres
biens, tels les fonds marins, les forêts humides, ou la
biodiversité. Ces biens profitent à tous, et leur
préservation requiert une coopération internationale
poussée.
Les termes de « mondialisation », ou de
« globalisation » - qui sont synonymes - sont
devenus d'usage courant au début des années 1990. Leur
succès correspond au besoin, ressenti alors, de trouver un nouveau
paradigme, un nouveau cadre conceptuel permettant de penser les relations
internationales dans le monde de l'après-guerre froide. La chute du
communisme en Europe de l'Est et les politiques d'ouverture menées par
les pays communistes d'Asie ont permis une extension à la
quasi-totalité de la planète du modèle d'économie
de marché et ont favorisé l'ouverture et l'insertion dans
l'économie mondiale de ces pays. Le trait dominant de
l'après-guerre froide serait donc la globalisation de l'économie
avec, pour corollaire, la multiplication des contacts et des
interdépendances entre les sociétés.
Si le mot de « mondialisation » s'est imposé depuis
peu dans le langage courant, les processus auxquels il renvoie sont en cours,
du moins dans la sphère occidentale, depuis bien plus longtemps.
L'ouverture graduelle et le développement des échanges entre
économies occidentales ont commencé dès l'après
seconde guerre mondiale, comme l'illustre la conclusion, en 1947, de l'accord
GATT (
General Agreement on Tariffs and Trade
). Le mouvement de
globalisation économique s'est amplifié, et a pris une nouvelle
extension géographique, après 1989, mais n'a pas
débuté à cette date.
La mondialisation que nous connaissons aujourd'hui n'est d'ailleurs pas sans
précédent. Les historiens de l'économie ont
souligné que l'économie mondiale avait déjà connu
une période de haute intégration, dans la seconde moitié
du XIX
e
siècle et au début du XX
e
(avec un
pic entre 1870 et 1914). Au cours de cette « première
mondialisation »
2
(
*
)
, l'internationalisation de l'économie
atteignit, dans les domaines du commerce et de la mobilité des capitaux,
un niveau qu'elle ne retrouverait qu'au milieu des années 1980. Le
commerce extérieur des principales puissances européennes prit
à l'époque un essor considérable : le commerce
extérieur français pesait 2,5 milliards de francs en 1847,
et 15 milliards, en francs constants, en 1913 ; celui de la
Grande-Bretagne est passé, entre 1870 et 1914 de 13 à
35 milliards, et celui de l'Allemagne, entre les mêmes dates, de 5
à 25 milliards. Le développement des flux financiers fut
également très spectaculaire : certaines années, la
Grande-Bretagne exporta jusqu'à 9 % de son PIB en capitaux ;
de 1887 à 1913, le volume net des investissements français
à l'étranger représentait environ 3,5 % du revenu
national, soit une proportion plus importante qu'aujourd'hui.
Plusieurs facteurs expliquent cette première internationalisation de
l'économie. Le désarmement tarifaire tout d'abord : entre
1850 et 1870, des traités de commerce bilatéraux furent conclus,
sous l'impulsion des Britanniques, entre tous les pays d'Europe. La formation
des Empires coloniaux conduisit à l'insertion dans les échanges
internationaux de vastes territoires. De plus, 90 % de la population de la
planète vivait dans des pays couverts par le régime de
l'étalon-or, c'est-à-dire dans un système de monnaies
convertibles et à valeur fixe par rapport à l'or. Le
système de l'étalon-or a garanti une exceptionnelle
stabilité des parités entre devises qui a, à son tour,
grandement favorisé le développement du commerce.
Des innovations technologiques soutinrent le développement des
échanges : généralisation du chemin de fer, du navire
à vapeur, de l'automobile, du télégraphe et du
téléphone. Avant l'installation du câble transatlantique
dans les années 1860, les informations mettaient trois semaines pour
arriver de New York à Londres. En 1914, le téléphone et le
télégraphe permettaient une communication entre ces deux villes
presque aussi rapide qu'aujourd'hui, ce qui favorisa, entre autres, la
convergence du prix des obligations entre ces deux grandes places
financières.
Cette première mondialisation se caractérisa aussi par de
très importants mouvements migratoires. De 1870 à 1914, quelque
55 millions d'Européens s'installèrent dans le Nouveau
Monde. Des pays comme l'Irlande et la Suède perdirent au moins 10 %
de leur population par décennie avant la Grande Guerre. Les deux
facteurs de production - le capital et le travail - étaient
donc également mobiles avant 1914, ce qui différencie cette
période de la mondialisation que nous vivons aujourd'hui.
La Grande-Bretagne fut le pays pivot de cette première mondialisation.
Elle fut le principal soutien du libre échange, et la livre sterling
était la monnaie d'échange et de réserve internationales
la plus couramment utilisée. Sa marine était le garant d'une
certaine stabilité géopolitique, et du maintien de routes
commerciales ouvertes. La Grande-Bretagne était la principale puissance
commerciale et le principal pourvoyeur de capitaux dans le monde.
Cette période de très grande ouverture économique prit fin
avec le déclenchement de la première guerre mondiale. La guerre a
interrompu les relations commerciales traditionnelles entre Etats
européens, et a conduit à un repli des nations sur
elles-mêmes. Elle a miné les fondements du système
économique de la Belle Epoque, notamment la stabilité des
monnaies et des prix. L'affaiblissement de la Grande-Bretagne et la
montée en puissance des Etats-Unis ont bouleversé les rapports de
force entre Etats. La crise de 1929 a balayé les minces espoirs de
retour à la situation d'avant 1914. Elle a renforcé les
tentations protectionnistes et abouti à un cloisonnement marqué
de l'économie mondiale. Dans le même temps, la jeune Union
soviétique faisait le choix d'un développement autarcique.
Ce rappel historique a pour but de montrer que l'actuelle mondialisation n'est
pas un phénomène inédit. Surtout, la comparaison entre la
phase de prospérité et d'ouverture économique
observée avant 1914, et la période postérieure,
marquée par la Grande Dépression, suggère que les
inconvénients de la fermeture l'emportent largement sur les
bénéfices escomptés, notamment pour un pays très
largement inséré dans les échanges internationaux comme la
France. Autrement dit, s'il est théoriquement possible d'inverser le
cours de la mondialisation, le coût économique d'une telle
orientation est élevé.
La première partie de ce rapport entend faire un état des lieux
de la mondialisation, c'est-à-dire en exposer les principales
manifestations, mais aussi les limites. L'intégration de
l'économie mondiale est en effet loin d'être absolue : des
secteurs, comme l'agriculture, sont peu libéralisés, et
d'importantes barrières aux échanges demeurent.
La question des répercussions de la mondialisation sur l'environnement
n'était guère posée avant 1914, dans la mesure où
les pressions exercées sur l'environnement étaient, à
l'époque, bien moindres que celles observées aujourd'hui. Il
n'est pas aisé d'évaluer l'impact global de la mondialisation sur
l'environnement. Une analyse théorique suggère que la
mondialisation aurait, à la fois, des effets positifs et négatifs
sur l'environnement, sans qu'il soit possible de déterminer quels effets
l'emportent. Les études empiriques suggèrent que certaines
craintes suscitées par la mondialisation en matière de
délocalisation sont peut-être exagérées. Mais
l'accélération de la croissance résultant, dans bien des
cas, de la libéralisation des échanges a des conséquences
dommageables sur l'environnement, même si des politiques publiques
appropriées peuvent réduire les dégradations subies par le
milieu naturel.
Le problème central est donc celui de la gouvernance de la
mondialisation, c'est-à-dire de la mise en oeuvre de politiques
publiques, qui permettent de l'accompagner et d'en maîtriser les effets.
Si les Etats occidentaux se sont dotés de législations
protectrices de l'environnement, des progrès restent à accomplir
pour atteindre l'objectif de développement durable. Cette remarque est
a fortiori
valable pour les pays en développement, où se
présentent, pour l'avenir, des risques importants de dégradation
de l'environnement. Maîtriser les effets de la mondialisation implique de
définir des règles et des politiques communes au niveau
international, dans la mesure où l'échelon global est le plus
pertinent pour traiter certains problèmes.
PREMIÈRE
PARTIE :
LA MONDIALISATION DE
L'ÉCONOMIE :
MONTÉE DES INTERDÉPENDANCES ET
ÉMERGENCE
DE PROBLÈMES GLOBAUX
La
manifestation la plus évidente de la mondialisation est la formidable
croissance des flux internationaux observée depuis 1945 : flux
commerciaux, flux d'investissement et flux financiers ont augmenté
à un rythme très supérieur à celui de la croissance
du PIB mondial. Les économies nationales sont ainsi devenues de plus en
plus interdépendantes : un événement survenu en
Extrême-Orient, comme la crise de changes de 1997, peut avoir des
répercussions en Occident, et inversement. Au niveau des entreprises,
les firmes multinationales ont de plus en plus tendance à
négliger les frontières nationales, pour considérer le
monde comme un espace économique unifié, dans lequel se
déploient leurs stratégies commerciales et de production. La
localisation des sites de production en des points éloignés des
lieux de consommation alimente en retour la croissance des flux commerciaux et
financiers.
La montée des interdépendances s'est accompagnée de
l'apparition - ou de la prise de conscience de l'existence - de
problèmes globaux, notamment liés à l'environnement. Par
exemple, la consommation excessive de gaz chlorofluorocarbones (CFC) a
dégradé la couche d'ozone, qui protège le globe du
rayonnement ultraviolet. Aucun pays ne peut se prémunir des
conséquences sanitaires de ce phénomène par une action
unilatérale, ni ne peut prétendre résoudre le
problème par une action isolée. En termes économiques, la
couche d'ozone s'analyse comme un bien public, qui, en raison de sa dimension,
peut être qualifié de « mondial ». Le climat
est un autre bien public mondial environnemental.
Toutefois, en dépit des progrès de la mondialisation, ce serait
une erreur de penser que l'économie mondiale est aussi
intégrée et unifiée que peut l'être une
économie nationale. Une analyse plus fine montre que des obstacles
significatifs aux échanges internationaux demeurent. La mise en
évidence de forts « effets-frontières » en
atteste. Des secteurs d'activité sont, de plus, restés jusqu'ici
largement à l'écart de la concurrence internationale.
I. LA MONTÉE DES INTERDÉPENDANCES
Cette
première partie se propose de revenir sur la croissance des flux
internationaux qui s'est produite depuis 1945, et qui est la manifestation la
plus évidente de la mondialisation de l'économie.
Trois sortes de flux doivent être distingués : les flux
commerciaux, c'est-à-dire les échanges de biens et services, les
flux d'investissements directs, et les flux financiers.
La théorie économique classique postule que le libre
fonctionnement du marché conduit à une allocation optimale des
facteurs de production. Si les mouvements de capitaux ont été
largement libéralisés, notamment parmi les pays
développés et émergents, il n'en est pas de même
pour le facteur travail. Depuis les années 1970, les pays
industrialisés ont sérieusement limité l'immigration
légale. Des considérations politiques et culturelles s'opposent
à ce qu'un principe de libre circulation des travailleurs soit
consacré à l'échelle internationale. Ce principe a
toutefois été reconnu dans le cadre, plus limité, de
l'Union européenne. L'intégration régionale est
allée sur ce point plus loin que l'intégration
multilatérale.
Un développement particulier sera consacré à la croissance
et au rôle des firmes multinationales (FMN), qui sont un acteur majeur de
la globalisation. Les stratégies de délocalisation qu'elles
mettent en oeuvre sont un important facteur d'accroissement des flux
d'échanges entre les pays.
A. LA CROISSANCE SPECTACULAIRE DES FLUX D'ÉCHANGES
1. L'expansion rapide du commerce international
Depuis la fin des années 1950, le commerce international a
augmenté à un rythme beaucoup plus soutenu que la production
mondiale.
Entre 1955 et 1975,
la valeur des exportations mondiales a été
multipliée par plus de 9
,
alors que la production mondiale a
« seulement » quadruplé
. Avec la fin des Trente
Glorieuses, la progression du commerce international devient un peu plus
heurtée, comme l'illustre le graphique ci-dessous, sans remettre en
cause toutefois la tendance de longue période à l'accroissement
de la part des échanges dans le PIB. On note même une tendance
à l'accélération de la croissance du commerce
international : celui-ci progresse, en moyenne, de 4 % par an sur la
période 1973-1980, puis de 5 % sur la période 1980-1992. Au
cours de la décennie écoulée, le commerce international a
crû de 6,5 % l'an.
Exportations
en pourcentage
PIB
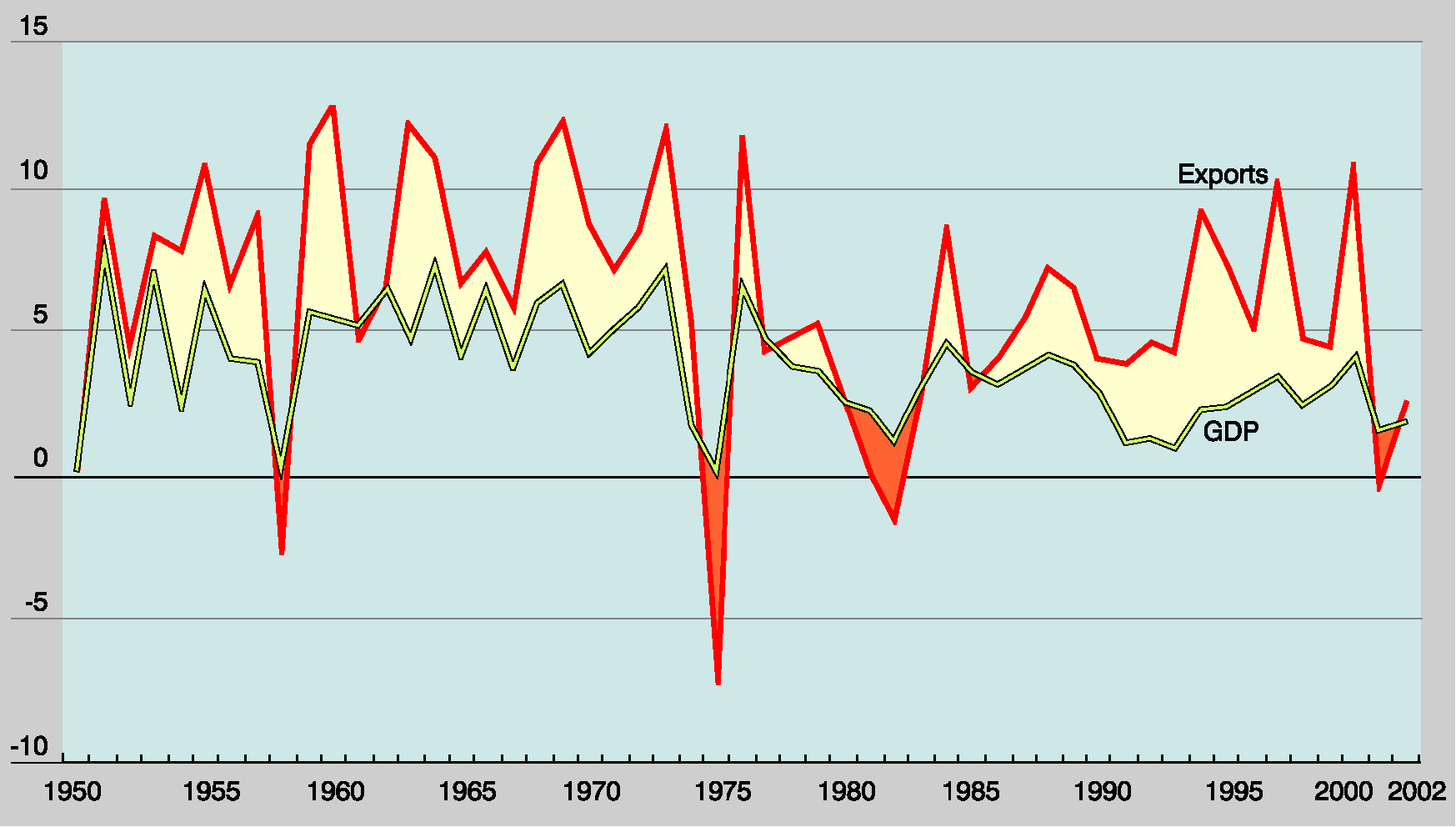
Variations en volume du commerce international et du PIB mondial
Source : CNUCED (2003)
Le commerce international est composé à 80 %
d'échanges de biens, et à 20 % d'échanges de
services
. Cette proportion a peu varié depuis vingt ans : les
chiffres correspondants au début des années 1980 étaient
respectivement de 83 % et 17 %. La part des services dans le commerce
international tend à augmenter depuis quelques années, mais ne
saurait remettre en question la prépondérance des échanges
de marchandises. Une bonne part des services produits dans les pays
développés ne sont en effet pas
« échangeables ».
Le commerce international est dominé par le commerce
intrabranche
, c'est-à-dire les échanges de biens qui
appartiennent à la même branche industrielle. Plus de la
moitié du commerce entre pays de l'OCDE porte sur des échanges
intrabranches. Au sein de l'Union européenne, première puissance
commerciale du monde, 60 % du commerce est intrabranche. On pourrait en
conclure que les pays fabriquent et échangent les mêmes biens, ce
qui contredirait la théorie classique du commerce international, qui
postule que les pays se spécialisent dans la production de biens pour
lesquels ils disposent d'un avantage comparatif. En réalité, les
producteurs, à l'intérieur d'une même branche (l'automobile
par exemple), cherchent à se distinguer de leurs concurrents en
singularisant le plus possible leurs produits (en se spécialisant, par
exemple, dans les véhicules bas de gamme ou haut de gamme), de sorte que
les produits échangés ne sont pas équivalents pour les
consommateurs.
La croissance des flux commerciaux a été suivie d'une forte
expansion des flux financiers, et notamment des flux d'investissement
direct.
2. La globalisation financière
a) La croissance spectaculaire des flux financiers
La
croissance des flux financiers a été encore plus spectaculaire
que celle des flux commerciaux. Les flux financiers ont atteint des niveaux
sans commune mesure avec ceux des flux commerciaux.
Le FMI s'est livré, en 1997, à une analyse de l'évolution
des transactions internationales sur titres entre 1975 et 1995. Les
transactions internationales sur titres désignent le total des achats et
des ventes d'actions et d'obligations entre résidents et
non-résidents. Ces transactions sont effectuées sur les
marchés boursiers. Le tableau suivant retrace une progression
considérable, en vingt ans, du montant de ces transactions.
|
Poids des transactions internationales sur titres (a) ( en pourcentage du PIB ) |
|||||
|
|
1975 |
1980 |
1985 |
1990 |
1995 |
|
États-Unis |
4,2 |
9,0 |
35 |
89 |
135 |
|
Japon |
1,5 |
7,7 |
63 |
120 |
65 |
|
Allemagne |
5,1 |
7,5 |
33 |
57 |
169 |
|
France |
3,3 |
8,4* |
21 |
54 |
180 |
|
Italie |
0,9 |
1,1 |
4 |
27 |
253 |
|
Royaume-Uni |
n.d. |
n.d. |
367 |
690 |
n.d. |
|
Canada |
3,3 |
9,6 |
27 |
64 |
195 |
|
*
Chiffre de 1982
|
|||||
Dans la
plupart des pays développés, les échanges d'actions et
d'obligations entre résidents et non-résidents
représentent chaque année un montant supérieur au produit
intérieur brut, alors qu'ils ne représentaient qu'une infime
fraction du PIB au milieu des années 1970. La progression des
échanges d'actions et d'obligations excède donc de très
loin ce que la seule progression du PIB aurait permis de prévoir.
Elle reflète une internationalisation croissante des marchés
boursiers.
Les travaux de la CNUCED (Commission des Nations-Unies pour le Commerce et de
Développement) attestent aussi d'une
forte augmentation des
transactions bancaires internationales
. La valeur des transactions
bancaires internationales est en effet passée de 6 % du PIB mondial
en 1972 à près de 40 % à la fin des années
1990. Les banques sont ainsi un important acteur de la globalisation
financière.
Mais c'est surtout la progression des transactions sur le marché des
changes
3
(
*
)
qui a
été la plus spectaculaire. Le montant des transactions
quotidiennes sur le marché des changes était évalué
à 200 milliards de dollars en 1986 ; il était de
600 milliards en 1989 ; selon la dernière enquête
disponible de la Banque des Règlements Internationaux (BRI), il
était de 1.400 milliards de dollars en 1998, soit un montant cent
fois supérieur aux sommes nécessaires pour financer les
transactions sur biens et services. Cette déconnexion entre flux
réels et flux financiers traduit l'existence
d'importants
mouvements spéculatifs
, cause d'instabilité sur les
marchés financiers.
b) Globalisation financière et stratégies productives : le cas des investissements directs à l'étranger (IDE)
Les investissements directs à l'étranger (IDE) se distinguent des autres flux financiers en ce qu'ils participent directement des stratégies de production et d'internationalisation des firmes. A la différence des placements financiers classiques (ou investissements de portefeuille), les IDE représentent l'achat d'avoirs à l'étranger en vue de créer, développer ou contrôler une entreprise située hors du territoire national. L'encadré suivant précise la distinction, sur le plan statistique, entre investissements directs et autres flux financiers.
LA
DISTINCTION ENTRE LES IDE ET LES AUTRES FLUX FINANCIERS
Les
investissements directs regroupent les opérations effectuées par
les investisseurs afin d'acquérir, d'accroître (ou de liquider) un
intérêt durable dans une entreprise, et d'avoir (ou de ne plus
avoir) une influence sur sa gestion.
Par convention, on considère qu'une relation d'investissement direct est
établie dès lors qu'une personne physique ou morale
(l'investisseur) détient au moins 10 % des droits de vote lors des
assemblées générales d'une entreprise (l'entreprise
investie), ou, à défaut, 10 % du capital social. Lorsque ce
seuil est atteint, l'ensemble des opérations financières entre
les deux entreprises est alors enregistré en investissements directs.
Les autres flux financiers sont classés en investissements de
portefeuille.
L'essor véritable des IDE date seulement de ces vingt dernières
années. Dans les années cinquante et soixante, le taux de
croissance des IDE était en effet inférieur à celui du
commerce international ; l'exportation demeurait la modalité
principale de la concurrence à l'échelle mondiale. Dans les
années 1970, le taux de croissance des IDE rejoint celui du commerce
mondial, mais dans un contexte de décélération du commerce
mondial. Une rupture apparaît en 1985 : les flux d'IDE
accélèrent sensiblement, passant d'un flux annuel de
50 milliards de dollars courants, à plus de 200 milliards en
1989-1990. La croissance des flux d'IDE s'est poursuivie dans les années
1990, pour culminer à 1.500 milliards de dollars en 2000. Le
montant des IDE s'est fortement contracté depuis :
735 milliards de dollars en 2001, et 534 milliards en 2002. Cette
contraction s'explique par la chute du nombre des fusions et acquisitions
transfrontalières
Conséquence de cette augmentation des flux,
le stock d'IDE s'est
lui aussi
fortement accru
: il a atteint
7.000 milliards de
dollars en 2002
, soit
14 fois plus qu'en 1980
. Il
équivaut à
près de 25 % du PIB mondial
,
après avoir plafonné autour de 5 % du PIB jusqu'au
début des années 1980.

Source :
Rapport sur l'investissement dans le monde 2002
,
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
(CNUCED), Genève.
Environ
48 % des flux d'IDE concernent le secteur des services
,
42 % le secteur manufacturier
, et
4 % le secteur minier
(y compris l'exploitation pétrolière). Au cours des années
1990, la progression la plus forte a été observée dans les
services, notamment la distribution de l'eau et de l'électricité,
les transports et les télécommunications.
3. Les firmes multinationales jouent un rôle central dans la croissance de ces flux
Les
firmes multinationales sont des acteurs majeurs de la mondialisation. Leur
activité contribue fortement à la croissance du commerce
international et des flux financiers.
Une firme multinationale est constituée d'une maison-mère et de
filiales implantées à l'étranger. La CNUCED retient une
définition large des firmes multinationales (FMN) : est
considérée comme multinationale une firme qui contrôle au
moins une filiale basée à l'étranger ; est
considérée comme une filiale une entreprise dont la
maison-mère détient au moins 10 % du capital. Sur la base de
cette définition,
la CNUCED dénombre, en 2002, environ 64.000
multinationales, disposant de 870.000 filiales, et qui emploient 54 millions de
salariés à travers le monde
. On ne recensait que 7.000 FMN
vingt ans plus tôt.
Le commerce international est très lié à
l'activité des FMN
. On estime en effet qu'
un
tiers du
commerce mondial de biens et services correspond à des échanges
« intra-firmes »
réalisés par des
entreprises dépendant d'une même firme. Un autre tiers correspond
aux ventes « extra-firmes » des FMN et de leurs filiales.
Au-delà, il importe de noter que le
montant des ventes locales
des filiales à l'étranger représente aujourd'hui le
double de la valeur totale des exportations mondiales
. Autrement dit, le
commerce international, qui est pourtant un indicateur majeur de la
mondialisation, est nettement moins important que la distribution locale de
biens et services par les multinationales. Pour M. Charles-Albert
Michalet, ce fait signifierait que nous serions passés d'une
« configuration internationale » de la mondialisation
à une « configuration multinationale »
4
(
*
)
. La « configuration
internationale » se caractérisait par « la
prédominance de la dimension des échanges de biens sur les autres
dimensions de la mondialisation ». Elle aurait pris fin vers le
milieu des années 1960, pour être remplacée par la
« configuration multinationale »,
caractérisée par la place dominante occupée par la
dimension des investissements directs à l'étranger
effectués par des firmes industrielles et financières.
Apprécier la place réelle d'une nation dans la mondialisation
implique donc de prendre en compte l'activité des FMN dont la
maison-mère est basée dans ce pays. Si le lourd déficit de
la balance des paiements américaine (près de 5 % du PIB)
peut faire penser que la puissance commerciale des États-Unis est
écornée, il ne saurait faire oublier que les ventes à
l'étranger des filiales américaines représentent deux fois
le montant des exportations américaines. Ces firmes multinationales,
soumises à la juridiction de l'Etat américain, participent
à l'influence des États-Unis dans le monde, et peuvent être
un levier de la puissance américaine.
|
LES DIX PREMIÈRES MULTINATIONALES EN 2002 |
||||||||
|
|
Rang |
Société |
Pays d'origine |
Activité |
Capitalisation boursière* |
Ventes* |
Salariés |
|
|
1 |
General Electric |
États-Unis |
Conglomérat |
372 089 |
130 685 |
315 000 |
||
|
2 |
Microsoft |
États-Unis |
Logiciels |
326 639 |
28 365 |
50 500 |
||
|
3 |
Exxon Mobil |
États-Unis |
Pétrole |
299 820 |
178 909 |
92 500 |
||
|
4 |
Wal-Mart Stores |
États-Unis |
Distribution |
273 219 |
|
|
||
|
5 |
Citigroup |
États-Unis |
Finances |
255 299 |
92 556 |
255 500 |
||
|
6 |
Pfizer |
États-Unis |
Pharmacie |
249 020 |
32 373 |
98 000 |
||
|
7 |
Intel |
États-Unis |
Microprocesseurs |
203 838 |
78 700 |
26 764 |
||
|
8 |
BP |
Royaume-Uni |
Pétrole |
200 794 |
178 721 |
110 150 |
||
|
9 |
Johnson et Johnson |
États-Unis |
Produits domestiques |
197 912 |
36 298 |
108 300 |
||
|
10 |
Royal Dutch Shell |
Pays-Bas/ Royaume-Uni |
Pétrole |
189 913 |
179 431 |
111 000 |
||
|
* en millions de dollars |
||||||||
B. UNE INTÉGRATION CROISSANTE DE L'ÉCONOMIE MONDIALE
La croissance des flux de biens, de services et de capitaux conduit à une intégration croissante de l'économie mondiale. La notion d'intégration de l'économie mondiale signifie que le marché mondial fonctionne de plus en plus comme un marché unique, indifférent aux frontières nationales. Quelques indicateurs permettent de tester le degré d'intégration de l'économie mondiale.
1. L'intégration des marchés de biens et services
Un
premier indicateur du degré d'intégration des marchés de
biens et services est le
ratio production échangée sur
production totale
.
Ce ratio indique un triplement du degré d'intégration des
marchés de biens et services depuis 1950.
Le commerce mondial
représentait 8 % du PIB mondial en 1950, contre 25 %
aujourd'hui
. Dans certains secteurs, comme l'électronique, le
rapport commerce mondial sur production mondiale dépasse
50 % ; en d'autres termes, plus de la moitié de la production
mondiale de biens électroniques fait l'objet d'un échange
international.
Ce ratio sous-estime pourtant le degré d'intégration effectif des
marchés, dans la mesure où, comme cela a été
indiqué précédemment, une bonne part de la production de
services porte sur des services non échangeables.
Il est donc utile de se référer à un autre indicateur
d'intégration économique :
la convergence, ou non, des
prix des biens et services échangeables
. Si le marché mondial
fonctionnait absolument sans entraves, le prix d'un même bien
échangeable devrait être le même en tout point de la
planète, aux différences de coûts de transport près,
conformément à la loi dite du « prix
unique ». Si les prix de vente d'un même bien
différaient en deux points du globe, il y aurait là une
opportunité de profit que les agents économiques ne manqueraient
pas d'exploiter jusqu'à ce que les prix s'égalisent.
Une étude très complète relative à la dispersion
des prix entre pays a été réalisée en 2001 par
David Parsley et Shang-Jin Wei
5
(
*
)
. Leur étude a porté sur les prix de 95
biens échangeables, examinés dans 83 villes, à travers le
monde, entre 1990 et 2000. Leur choix s'est porté sur des biens
très standardisés, et donc aisément comparables (produits
alimentaires, ampoule électrique, eau minérale...). Les
écarts de prix sont appréciés en comparant les villes deux
à deux.
Il ressort de cette étude que l'intégration du marché
des biens s'est
effectivement accrue au cours des années
1990
. Les écarts de prix pour un même bien ont, dans
l'ensemble, sensiblement diminué. Le graphique ci-dessous illustre ce
point, en montrant l'évolution de la dispersion des prix entre deux
paires de villes : Hong Kong et San José (capitale du Costa Rica),
d'une part, et Pékin et Hong Kong, d'autre part. Le graphique montre
clairement une tendance à la convergence des prix sur la période
étudiée.
Dispersion des prix par rapport à Hong
Kong
1
(en pourcentage)
Beijing,
Chine
San José,
Costa Rica
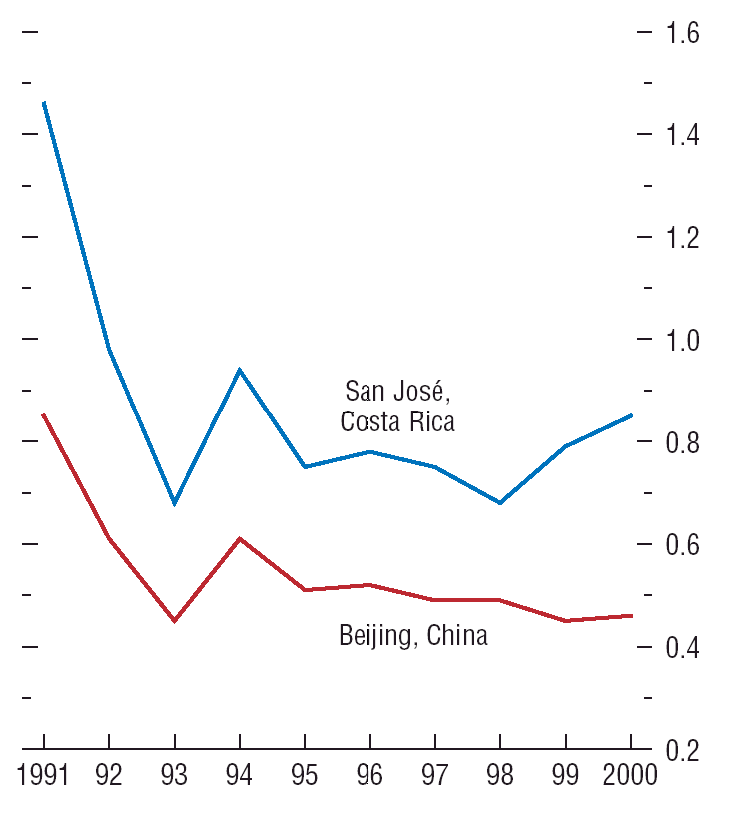
1.
Différence des prix moyenne (mesurée en logarithme) pour 95 biens
échangeables.
Source : Parsley and Wei (2001), cité dans
World Economic
Outlook
(septembre 2002)
Cette étude met en évidence l'impact de différents
paramètres sur l'intégration des marchés de biens :
Des coûts de transport plus élevés conduisent à une
moindre intégration des marchés de biens. Comme on pouvait s'y
attendre, la dispersion des prix est plus grande entre San José et Hong
Kong, qu'entre Hong Kong et Pékin.
Les accords monétaires, visant à garantir une plus grande
stabilité des parités entre devises, s'accompagnent, le plus
souvent, d'une meilleure intégration des marchés de biens.
L'intégration des marchés est plus poussée dans certaines
zones commerciales régionales, notamment l'Alena et la Communauté
européenne.
Toutefois, des « effets-frontières » significatifs
sont encore mesurés. La notion
« d'effet-frontière » sera précisée
ultérieurement. Ceci indique que le marché mondial demeure moins
intégré qu'un marché national.
2. L'intégration des marchés financiers
Un
élément de mesure du degré d'intégration des
marchés financiers mondiaux consiste à examiner si une nation
peut facilement être financée par les capitaux étrangers.
Il faut pour cela se pencher sur la relation entre épargne nationale et
investissement national. Dans un monde segmenté, le niveau de
l'investissement national est contraint par le montant de l'épargne
nationale. Dans un monde financièrement intégré,
l'investissement national peut être financé par l'épargne
internationale, et la corrélation entre épargne nationale et
investissement national est donc beaucoup plus lâche. On peut donc
déduire
d'une mesure du degré de corrélation entre
épargne et investissement nationaux une estimation du degré
d'intégration financière internationale
6
(
*
)
.
Le graphique suivant retrace l'évolution de cette corrélation au
cours du XX
e
siècle pour un ensemble de pays, qui recouvre la
quasi-totalité des pays membres de l'OCDE. Une corrélation
voisine de zéro indique une très forte intégration des
marchés financiers. Une corrélation proche de 1 est le signe
d'une très forte segmentation des marchés nationaux. La courbe
traduit de réels
progrès de l'intégration
financière internationale depuis les
années 1970
(sans
toutefois retrouver le niveau d'intégration observé avant 1914).
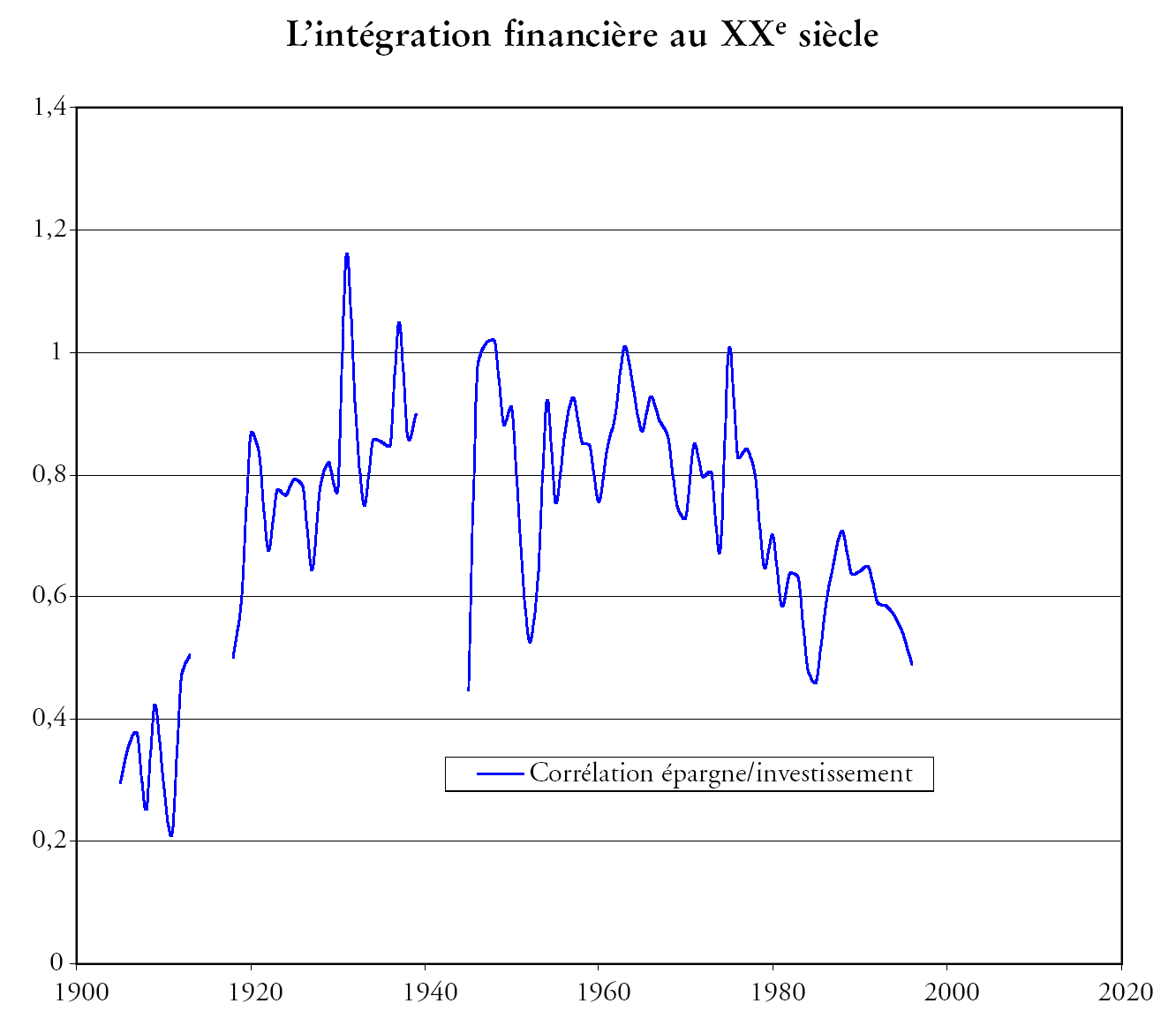
Source : Flandreau et Rivière, 1999.
C. LES « MOTEURS » DE LA MONDIALISATION
Quels sont, pour reprendre une expression de Jacques Le Cacheux 7 ( * ) , les « moteurs de la mondialisation » ? On peut apporter trois éléments de réponse à cette question. La mondialisation répond d'abord à une puissante logique économique ; il y a, dans le fonctionnement d'une économie de marché, de puissantes incitations au développement des échanges. Les gains mutuels retirés des échanges ont été analysés par David Ricardo dans sa théorie des avantages comparatifs, dès 1817. La mondialisation est ensuite favorisée par un certain environnement technique ; les échanges stagneraient si des coûts de transport et de communication rédhibitoires les empêchaient d'être rentables. Le progrès technique est donc un élément facilitateur de la mondialisation. Enfin, la mondialisation ne peut s'épanouir que si les Etats , convaincus des avantages économiques qu'elle procure, suppriment les obstacles tarifaires ou réglementaires susceptibles d'entraver les échanges. La mondialisation est donc le fruit de logiques économiques, de développements technologiques, et de choix politiques.
1. De puissantes logiques économiques
a) Avantages comparatifs et spécialisation
Dans la
théorie classique de l'échange international,
développée par David Ricardo au début du XIX
e
siècle, le développement des échanges s'explique par
l'existence de différences dans le prix relatif des biens, ou des
facteurs de production, entre économies fonctionnant de manière
autarcique. Ces différences de prix sont elles-mêmes attribuables
à la rareté relative des facteurs, ou à des écarts
en termes d'efficacité productive.
L'ouverture aux échanges permet aux pays participants de tirer parti de
ces écarts de prix : chaque participant se procure auprès de
ses partenaires commerciaux quelque chose qui lui aurait coûté
plus cher s'il avait dû le produire lui-même.
L'ouverture aux échanges conduit à une spécialisation des
pays dans les secteurs où ils disposent d'un avantage comparatif,
c'est-à-dire dans les secteurs où ils sont les plus efficaces (ou
les moins inefficaces).
Il n'est pas nécessaire qu'un pays dispose d'un avantage concurrentiel
absolu pour avoir intérêt à l'échange international.
Même si un pays affiche des coûts de production supérieurs
à ceux de ses partenaires pour tous les biens et services, il aura
malgré tout intérêt à s'ouvrir aux
échanges : il se spécialisera dans les productions pour
lesquelles il est le moins inefficace tandis que ses partenaires commerciaux
exploiteront leurs plus grands avantages comparatifs.
Traditionnellement, les avantages comparatifs des économies nationales
sont expliqués par des différences de dotations naturelles et
factorielles. Dans l'intuition initiale de Ricardo, c'est d'abord sur les
différences de ressources naturelles ou de climat, mais aussi de
méthodes de production, reflétées dans des
productivités relatives différentes, qu'est fondée
l'incitation à l'échange.
Les différences entre économies nationales qui fondent
l'existence d'avantages comparatifs ne se limitent, cependant, pas aux
dotations naturelles et factorielles ; celles qui sous-tendent l'existence
d'écarts dans les propensions à épargner ou la
productivité du capital sont aussi sources de gains dans les
échanges commerciaux ou les transactions financières
internationales.
Ainsi, des structures démographiques nationales
différenciées engendrent-elles, selon l'hypothèse du cycle
de vie de Franco Modigliani, des décalages temporels dans les variations
des taux d'épargne nationaux. Certains pays disposent donc d'une
épargne abondante, qu'ils peuvent prêter, tandis que d'autres
pays, où l'épargne est plus rare, ont besoin d'emprunter.
D'où l'intérêt, pour chacune des parties, de laisser les
transactions financières s'effectuer librement.
La spécialisation des économies nationales est, par
elle-même, facteur de gains de productivité. A plus long terme, la
spécialisation peut, par un phénomène d'apprentissage et
d'amélioration progressive des techniques de production, engendrer des
gains ultérieurs d'efficacité productive. C'est ce que l'on
appelle les gains dynamiques de l'échange international.
b) Les économies d'échelle et la recherche de la taille optimale pour les entreprises
Outre
les incitations à l'échange liées aux avantages
comparatifs des économies nationales, doivent être
mentionnés les phénomènes d'économie
d'échelle, qui encouragent les entreprises à rechercher des
débouchés sur les marchés extérieurs.
De nombreuses activités de production, mais également de
recherche et développement, se caractérisent en effet par
l'existence d'économies d'échelle : l'augmentation de la
production permet d'amortir plus facilement les coûts fixes
supportés par l'entreprise, ou les dépenses de R&D
engagées. Les entreprises sont donc à la recherche de la taille
optimale, qui leur permet de maximiser leur rentabilité. Or, le niveau
de production optimal excède souvent les capacités d'absorption
du marché national. Les entreprises sont donc portées à
rechercher des débouchés sur les marchés
extérieurs.
2. Le rôle des facteurs technologiques
Les
gains présentés ci-dessus ne peuvent se matérialiser que
si un certain état des techniques le permet. Si les coûts de
transport et de communication - autrement dit, en termes
économiques, les coûts de transaction - sont très
élevés, l'échange international ne sera pas rentable, et
ne se produira pas.
De fait, les périodes de fort développement des échanges
sont associées à des phases d'innovations technologiques dans les
domaines des transports et des communications : au XIX
e
siècle, peuvent être mentionnées l'apparition des bateaux
à vapeur et du chemin de fer, l'amélioration du réseau
routier et la diffusion du télégraphe ; aujourd'hui,
l'innovation certainement la plus emblématique de la mondialisation est
l'Internet.
Une étude
8
(
*
)
réalisée en 1995 révèle la forte diminution des
coûts du transport aérien et des communications
téléphoniques au cours du XX
e
siècle.
Coûts du transport aérien et d'un appel
téléphonique
(en dollars de 1990)
|
Année |
Coût moyen du transport aérien par passager et par mile* parcouru |
Coût d'un appel de trois minutes de New York à Londres |
|
1930 |
0.68 |
244.65 |
|
1940 |
0.46 |
188.51 |
|
1950 |
0.30 |
53.20 |
|
1960 |
0.24 |
45.86 |
|
1970 |
0.16 |
31.58 |
|
1980 |
0.10 |
4.80 |
|
1990 |
0.11 |
3.32 |
* 1
mile = 1 609,31 mètres
Source : Herring et Litan, cités dans
World Economic
Outlook
, FMI, 1997
Des travaux plus récents (
cf.
graphique) indiquent une baisse
importante des coûts de transport maritime et du transport aérien
depuis les années 1950.
Coût du transport
(en dollars constant
s
, 1950 : base 100)
Transport aérien
2
Transport maritime
1
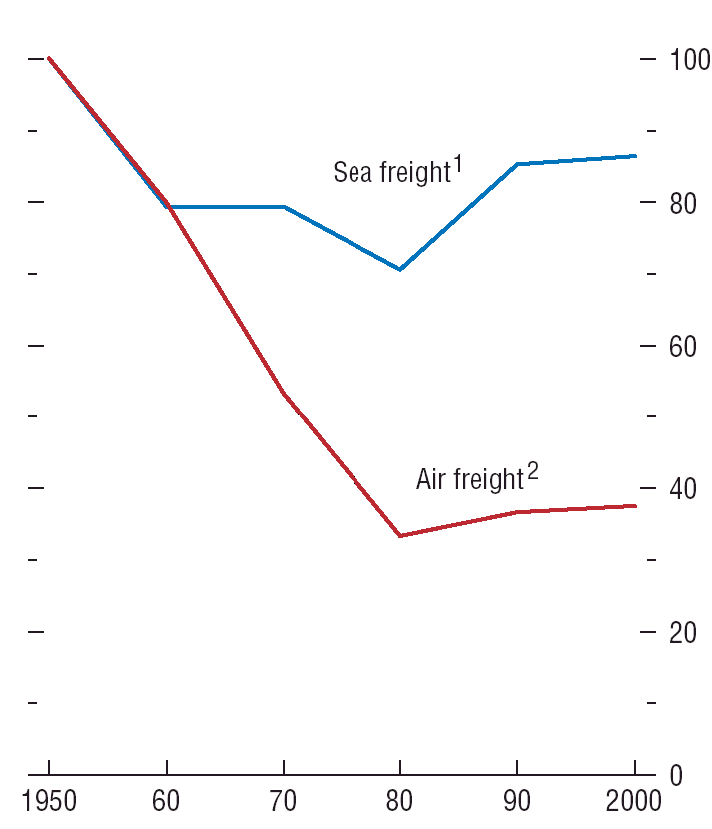
1.
Coût moyen par tonne de marchandise importée ou exportée
par cargo
(frais portuaires inclus).
2. Coût moyen du transport aérien par passager et par mile
parcouru.
Source : World Economic Outlook, FMI, septembre 2002.
L'apparente stabilisation des coûts de transport dans la période
récente s'explique, pour partie, par l'absence de grande innovation
technologique. Mais elle masque aussi un problème de
méthode : si les prix de transport ne baissent pas, la
qualité des prestations, elle, s'est améliorée, en termes
de rapidité, de fréquence ou de fiabilité. Ainsi,
l'utilisation de prix dits « hédoniques » (qui
intègrent les améliorations de qualité du bien ou service
considéré) aboutirait à une perception différente
de l'évolution des prix. Pour Hummels
9
(
*
)
, la diminution des temps de transport entre 1950 et
1998 a été telle qu'elle équivaudrait à une baisse
des tarifs douaniers sur les biens manufacturés de 23 % !
Les avancées en matière de traitement des données par
ordinateur, les progrès dans les domaines des fibres optiques
10
(
*
)
et des satellites ont rendu
possible une plus grande dispersion des activités économiques, y
compris à l'intérieur des entreprises, ce qui favorise la
constitution de firmes transnationales. Des activités qui ne faisaient
pas l'objet de commerce international peuvent maintenant être
délocalisées, comme le montrent les centres d'appels
téléphoniques par exemple.
3. La mondialisation, un choix politique
La fermeture des économies occidentales dans les années 1930 a montré que, si les Etats pouvaient bloquer les flux d'échange en imposant des droits de douane, ou en contrôlant les mouvements de capitaux, le coût économique d'une telle politique était prohibitif. Il est donc logique que les Etats développés aient poursuivi depuis 1945 un objectif de libéralisation des échanges, appuyé sur la conviction que l'ouverture serait porteuse de plus de progrès en terme de bien-être que le maintien de barrières protectionnistes. Le choix de l'ouverture a pu aussi se justifier, après-guerre, par l'idée selon laquelle la montée des interdépendances serait un facteur de paix entre les nations.
a) L'abaissement des droits de douane
Le GATT de 1947 a été l'instrument à partir duquel s'est opérée la libéralisation des échanges. Il a jeté les fondements de cycles de négociations successifs, qui ont permis de faire baisser, de 40 % en 1947 à moins de 5 % aujourd'hui, le niveau moyen des tarifs douaniers sur les biens manufacturés dans les pays développés.
LES
CYCLES DE NÉGOCIATION DEPUIS 1947
Depuis
la signature de l'Accord général en 1947, quatre grandes phases
de négociation (les
rounds
) se sont succédées pour
faire progresser le libre-échange :
Dillon Round
(1961-1962) : les négociations ont
porté sur un abaissement des droits de douane portant exclusivement sur
des produits manufacturés. Les réductions sont
négociées bilatéralement et produit par produit.
Kennedy Round
(1963-1967) : le champ de la négociation est
ouvert au domaine non tarifaire et aux produits agricoles. Les
négociations se font dans un cadre multilatéral et aboutissent
à une réduction de 35 % en moyenne des droits de douanes.
Tokyo Round
(1973-1979) : une nouvelle réduction des droits
de douanes est obtenue, d'environ 35 % en moyenne. Les domaines non
tarifaires ont été approfondis (normes et réglementations
techniques, protection des marchés publics, subventions à
l'exportation...).
Uruguay Round
(1966-1994) : cette négociation très
ambitieuse a abouti à la mise en place de l'OMC et inclus les services,
l'agriculture, la protection de la propriété industrielle et des
investissements étrangers.
Depuis 2001
est en cours un
Doha Round
, qui entend progresser
sur différents dossiers : ouverture des marchés agricoles et
de services ; propriété intellectuelle ; liens entre
commerce et investissement, commerce et politique de la concurrence, commerce
et environnement ; transparence des marchés publics ; commerce
électronique ; transferts de technologie et coopération
technique ; traitement particulier pour les pays les moins avancés
(PMA). L'Agenda de Doha ambitionne, au-delà d'une libéralisation
supplémentaire des échanges, de mettre en place des
éléments de régulation et d'encadrement du marché
au niveau international.
Depuis 1995, l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) offre un forum de
négociation à ses Etats membres. Surtout, elle se
caractérise par l'existence d'un Organe de règlement des
différends (ORD) qui fonctionne sur un mode quasi-juridictionnel. A la
différence du GATT, dont les arbitrages devaient, pour être
valables, être acceptés par toutes les parties, y compris la
partie accusée, le mécanisme de règlement des
différends de l'OMC n'admet pas le droit de veto. De surcroît, au
cas où une décision de l'ORD ne serait pas
exécutée, la partie plaignante sera autorisée à
exiger des compensations, et, le cas échéant, à imposer
des sanctions commerciales.
Après ce point sur la libéralisation commerciale, il convient
d'examiner les mesures qui ont rendu possible la globalisation
financière.
b) Les « trois D » de la globalisation financière
Henri
Bourguinat a identifié les « trois D » à
l'origine de la globalisation financière :
déréglementation, décloisonnement,
désintermédiation.
La déréglementation désigne le processus
d'assouplissement ou de suppression des réglementations nationales
régissant, et restreignant, la circulation des capitaux (contrôle
des changes, encadrement du crédit, etc.). Partie des États-Unis
et du Royaume-Uni, elle s'est progressivement étendue à tous les
pays industrialisés dans les années 1980.
Le décloisonnement désigne l'abolition des frontières
segmentant les marchés financiers : segmentation des divers
marchés nationaux, d'une part ; mais aussi segmentation, à
l'intérieur d'un même pays, entre divers types de marchés
financiers : marché monétaire, marché obligataire,
marché des changes, marché à terme, etc. Aujourd'hui, les
marchés financiers nationaux sont interconnectés, constituant un
vaste marché global. Et les différents compartiments du
marché financier ont été unifiés, pour créer
un marché plus large et profond, accessible à tous les
intervenants à la recherche d'instruments de financement, de placement,
ou de couverture.
La désintermédiation, enfin, désigne la
possibilité offerte aux opérateurs désireux de placer ou
d'emprunter des capitaux, d'intervenir directement sur les marchés
financiers, sans être obligés de passer par ces
intermédiaires financiers traditionnels que sont les banques. Dans des
pays comme l'Allemagne ou la France, le financement des entreprises a longtemps
été massivement intermédié, c'est-à-dire
assuré par les banques ; mais la part du crédit bancaire
dans le financement des entreprises a fortement diminué dans ces deux
pays, passant des deux tiers à la fin des années 1970 à
environ 50 % aujourd'hui.
c) La participation grandissante des pays en développement et en transition
Les
initiatives prises en matière de libéralisation commerciale ou
financière ont d'abord concerné les pays industrialisés.
Mais elles se sont depuis étendues à un nombre croissant de pays
en développement ou en transition.
La chute du bloc communiste a naturellement conduit à
l'intégration dans les réseaux commerciaux et financiers
internationaux des anciens pays de l'Est, qui, en faisant le choix de
l'ouverture, ont pris le contre pied de leurs pratiques antérieures.
Plusieurs grands pays émergents (Chine, Inde, Brésil...) ont
abandonné leurs stratégies de développement
autocentré pour participer à la mondialisation de
l'économie. Le succès, fondé sur les exportations, des
Nouveaux Pays Industrialisés d'Asie, explique, pour une part, ce
changement d'orientation stratégique. L'ouverture aux échanges a
également été promue, dans de nombreux pays en
développement, par le Fonds monétaire international, artisan de
ce qu'il a été convenu d'appeler le «
consensus de
Washington
» : la libéralisation économique et
financière a en effet été un élément
clé des politiques de réforme structurelle imposées aux
pays en développement, en contrepartie de l'octroi de prêts par le
FMI.
Un signe de la participation croissante des pays du Sud et de l'Est à la
globalisation peut être trouvé dans l'augmentation continue du
nombre de pays membres de l'OMC. 25 pays signèrent l'accord GATT en
1947 ; avec l'adhésion du Cambodge en septembre dernier,
l'Organisation compte dorénavant 148 Etats membres, rassemblant
90 % de la population mondiale. La participation aux échanges
internationaux n'est donc plus l'apanage des pays du Nord. Les pays du Sud ont
démontré, lors du sommet de Cancun, leur détermination
à peser dans cette enceinte multilatérale.
D. LA MONDIALISATION, UN PROCESSUS INACHEVÉ
L'intégration économique internationale est en
progrès, mais est loin d'être complète. Des obstacles aux
échanges demeurent. Des considérations politiques, liées
par exemple à la préservation d'un modèle agricole
original, ou d'une identité culturelle, s'opposent à ce que
l'ouverture à la concurrence internationale devienne une norme
s'imposant dans tous les domaines. D'autres obstacles aux échanges
pourraient, en revanche, être levés dans le cadre de l'actuel
cycle de négociations.
L'intégration ne concerne pas non plus de manière égale
toutes les régions de la planète. En dépit de
l'augmentation du nombre de pays membres de l'OMC, de nombreux pays, en Afrique
notamment, occupent une place tout à fait marginale dans les
échanges internationaux. En revanche, en d'autres endroits du globe
(Union européenne, Amérique du Nord), des expériences
d'intégration économique plus poussée ont
été menées, ce qui conduit à s'interroger sur
l'impact de ces politiques d'intégration régionales :
sont-elles un obstacle ou un facteur favorable à la mondialisation ?
LA
MONDIALISATION INACHEVÉE :
ILLUSTRATION PAR LA MISE EN
ÉVIDENCE DES « EFFETS-FRONTIÈRES »
Une
série de travaux se sont récemment attachés à
apprécier les effets économiques des frontières
géopolitiques. Tous confirment la persistance d'une importante
fragmentation économique.
S'agissant des échanges, Mc Callum (1995) a estimé qu'à
distance et poids économique identiques, les provinces canadiennes
échangaient vingt fois plus entre elles qu'avec les Etats
américains voisins. Pour l'Europe, Head et Mayer (2000) ont
récemment abouti à des résultats comparables (l'effet du
franchissement de la frontière était dans les années
soixante-dix de diviser l'intensité des échanges par un facteur
de l'ordre de 20, il est tombé à un peu plus de 12 après
l'achèvement du marché intérieur).
Un autre exemple concerne la composition des portefeuilles financiers. Les
travaux empiriques ont mis en évidence que, malgré la
levée des barrières à la mobilité du capital, les
actifs nationaux constituaient encore une part prépondérante des
portefeuilles d'actifs : comme l'avaient observé French et Poterba
(1991), plus de 90 % du portefeuille financier des ménages
américains ou japonais est constitué d'actifs
nationaux
1
. Même si la proportion est un peu plus faible pour
l'Europe (85 % pour l'Allemagne et 89 % pour la France), la structure
des portefeuilles reste très marquée par les biais nationaux.
1. D'après les chiffres du
World Economic Outlook
, FMI, octobre
2001. Les données portent sur les années
1996-1999.
Source : d'après
Gouvernance mondiale
, rapport
du Conseil d'Analyse Economique, 2002.
1. La libéralisation n'est pas absolue
L'audition de M. Patrick Messerlin 11 ( * ) a permis de mettre en lumière la persistance d'obstacles aux échanges non négligeables. Des pics tarifaires, ainsi que d'importantes barrières non tarifaires aux échanges demeurent.
a) Le niveau réel des protections douanières
Officiellement, le niveau moyen des droits de douane en Europe est
de seulement 4 %. Ce taux très bas ne devrait pas
représenter, en soi, un obstacle significatif aux échanges
internationaux. Une étude plus fine de la protection douanière en
Europe suggère cependant que le niveau effectif de protection aux
frontières de la Communauté est très supérieur
à ce que cette simple moyenne peut laisser supposer.
En effet, le taux moyen de 4 % couramment cité est quelque peu
trompeur. Ce taux est obtenu en faisant la moyenne des droits de douane
appliqués aux différents biens et services importés dans
la Communauté, pondérée par le niveau des importations
pour les biens et services considérés. Or, il est bien
évident que l'application d'un droit de douane élevé
réduit le niveau des importations pour le produit
considéré. La méthode de calcul employée conduit
donc à minorer le poids des produits sur lesquels pèsent les
droits de douane les plus élevés. Si l'on corrige ce biais
statistique, on constate que le droit de douane moyen en Europe est en
réalité
supérieur à 7 %, niveau d'ailleurs
comparable à celui observé aux États-Unis.
En outre, il faut tenir compte, pour apprécier le niveau de la
protection douanière en Europe, des barrières non tarifaires aux
échanges. Ces barrières non tarifaires prennent principalement la
forme de restrictions quantitatives (quotas) et de subventions.
Agrégées, elles représenteraient, en moyenne, un droit de
douane supplémentaire
d'un peu plus de 4 %.
Le taux de protection globale de la Communauté n'est donc pas de
4 %, comme pourrait le laisser penser la lecture des données les
plus immédiatement disponibles, mais
avoisinerait en fait les
12 %.
Ce taux était de 14 % jusqu'en 1997, mais a
diminué depuis en raison de la mise en oeuvre graduelle de
décisions prises dans le cadre de l'Uruguay Round
12
(
*
)
.
Ce taux de protection globale moyen dissimule d'importants pics tarifaires. P.
Messerlin a identifié 22 secteurs sur lesquels la protection est
concentrée (cinq dans l'agriculture, quatorze dans le secteur
manufacturier et trois dans les services). Pour illustration, ces secteurs sont
répertoriés dans le tableau suivant :
|
|
LES
VINGT-DEUX BIENS ET SERVICES PROTÉGÉS
|
|
||
|
Biens industriels |
Biens agricoles |
Services |
||
|
ciment |
céréales |
films français |
||
|
engrais |
viande bovine |
transport aérien |
||
|
polyéthylène de faible densité |
produits laitiers |
télécommunications de base |
||
|
polyvinyle chloride |
sucres |
|
||
|
panneaux de bois |
bananes |
|
||
|
papier journal |
|
|
||
|
fibres chimiques |
|
|
||
|
magnétophones |
|
|
||
|
circuits intégrés |
|
|
||
|
photocopieurs |
|
|
||
|
acier |
|
|
||
|
automobiles |
|
|
||
|
textile-habillement |
|
|
||
|
|
||||
Une
étude de Hufbauer et Eliott
13
(
*
)
sur la protection de l'économie
américaine montre que la liste des activités
protégées aux États-Unis est très proche de celle
observée en Europe. Autrement dit, ce sont les mêmes secteurs dans
les principaux pays de l'OCDE, qui ont réussi à se soustraire aux
précédentes étapes de la libéralisation. Ceci
représente une importante source de difficulté pour les
négociations en cours du Round de Doha : nombre de ces produits
fortement protégés sont, en effet, des biens
intermédiaires dans lesquels les pays en voie de développement
ont un avantage comparatif. Les pays occidentaux peuvent donc craindre les
conséquences, pour leurs producteurs, d'un désarmement tarifaire
dans ces secteurs.
Alors que le débat au sein de l'OMC tend à se focaliser sur la
question de la protection du secteur agricole, ces travaux montrent que le
secteur industriel n'est pas exempt de protections douanières
.
Ainsi, en 1999-2000, le taux de protection global était supérieur
à 10 % dans des secteurs industriels représentant plus du
quart de la valeur ajoutée industrielle de la Communauté
européenne, supérieure de 20 % pour près d'un
sixième de cette valeur ajoutée, et supérieur à
30 % pour le secteur textile, dont la valeur ajoutée est
supérieure à la somme des valeurs ajoutées dans la viande
et le sucre.
Enfin, les travaux de Messerlin proposent une évaluation du coût,
pour les consommateurs européens, du maintien de barrières
douanières. Ce coût serait de l'ordre de 7 % du PIB
communautaire, ce qui équivaut au PIB de l'Espagne. Un nouveau cycle de
libéralisation pourrait donc entraîner d'importants gains de
bien-être pour les consommateurs européens.
b) Des considérations politiques s'opposent à ce que le libre-échange soit généralisé à tous les domaines.
Evaluer à 7 % du PIB européen le coût des protections douanières aux frontières de l'UE, comme le fait P. Messerlin, constitue, a priori , un solide argument en faveur d'un démantèlement de l'ensemble des entraves au libre-échange. Un tel projet serait pourtant irréaliste. Les sociétés humaines poursuivent d'autres finalités que la maximisation du bien-être économique, mesuré en points supplémentaires d'accroissement du PIB. La préservation d'une identité culturelle, ou la défense d'un modèle agricole et rural original, justifient par exemple des aménagements aux principes du libre-échange.
(1) Les migrations internationales
Les
politiques de libéralisation commerciale et financière, qui sont,
on l'a vu, au fondement de la mondialisation, ont été
motivées par la conviction que le fonctionnement libre des
marchés conduirait à une allocation optimale des ressources, et
maximiserait ainsi la croissance. Dans ce schéma théorique, il
devrait être également optimal d'établir une totale
liberté de circulation pour les travailleurs à l'échelle
mondiale. Or, depuis les années 1970, on observe le
phénomène inverse : tous les pays développés
ont décidé de restreindre, voire de supprimer les
possibilités d'immigration légale, et de renforcer les moyens de
lutte contre l'immigration clandestine.
De ce fait, comme le notait le FMI en 1997
14
(
*
)
, «
il n'apparaît pas que les
marchés du travail soient devenus plus intégrés au cours
des dernières décennies
». Le FMI ajoutait :
«
bien que leur part dans la population totale ait augmenté
dans beaucoup de pays développés, le nombre de résidents
nés à l'étranger n'excède pas 5 % dans la
plupart de ces pays et dépasse 10 % dans seulement quatre d'entre
eux
». Si l'on se réfère au nombre de travailleurs
transfrontaliers, il apparaît que les marchés du travail
étaient beaucoup plus intégrés au début du
XX
e
siècle qu'aujourd'hui.
L'ouverture totale des frontières à la libre circulation des
personnes n'est pas une option réaliste. Mais il serait tout aussi
illusoire de nier la réalité du phénomène
migratoire. Environ 150 millions de personnes vivent aujourd'hui hors de
leur pays d'origine. Et ce chiffre ne prend pas en compte les immigrants
illégaux, difficiles, par définition, à dénombrer.
Si la lutte contre l'immigration illégale s'impose, il semble utile
d'ouvrir le débat sur un deuxième volet de la politique
d'immigration, celui
d'une immigration de travail choisie, en fonction des
besoins économiques,
à l'instar des expériences
tentées en Allemagne et au Portugal. Ce débat devrait permettre
de cibler les besoins économiques du pays, mais aussi de
réfléchir aux moyens de faire bénéficier les pays
d'origine de l'expérience acquise en France par leurs ressortissants.
(2) La préservation d'un modèle agricole
La
mondialisation a surtout concerné les biens industriels et, dans la
période récente, les services. Le secteur agricole est
resté relativement à l'écart de la croissance des
échanges : 10 % seulement de la production agricole mondiale
fait l'objet d'échanges internationaux.
Le choix de tenir l'agriculture à l'écart du mouvement de
libéralisation s'explique par les spécificités de ce
secteur d'activité :
- les activités agricoles sont soumises à d'importants
aléas climatiques ; l'évolution du revenu des agriculteurs
serait donc très erratique et imprévisible en l'absence de
mécanisme de soutien public ;
- le maintien d'un important secteur agricole sur notre territoire est
indispensable pour préserver la sécurité alimentaire du
pays ;
- l'agriculture est une activité qui présente des
bénéfices « multifonctionnels »
:
elle est un élément important d'aménagement du territoire,
et les agriculteurs contribuent à l'entretien des paysages et des
milieux naturels. La suppression de toute aide à l'agriculture
conduirait à la désertification de vastes territoires en Europe.
Ces considérations plaident pour un traitement spécifique de
l'agriculture dans le commerce international. Cela ne signifie cependant pas
que toutes les pratiques soient également recommandées en
matière de soutien public. Les négociateurs à l'OMC
classent les mesures de soutien à l'agriculture en trois
catégories :
- la « boîte orange » : elle rassemble les
mesures qui ont les effets distorsifs les plus importants en matière
commerciale ; il s'agit des aides directement couplées à la
production, ou des subventions à l'exportation ;
- la « boîte verte » rassemble les aides qui n'ont
pas d'effet distorsif en matière commerciale ; il s'agit, par
exemple, de subventions versées en contrepartie de bonnes pratiques
écologiques ou d'actions d'entretien du patrimoine naturel ;
- la « boîte bleue » rassemble les mesures de
portée intermédiaire, c'est-à-dire des aides qui ne sont
qu'indirectement liées au niveau de la production ; il peut s'agir,
par exemple, d'une aide versée par hectare cultivé.
Dans la mesure où les pays en développement souffrent souvent des
subventions agricoles versées par les pays du Nord, il est souhaitable
de faire passer une part plus importante des aides agricoles de la
« boîte orange » vers les « boîtes
bleues » et « vertes ». C'est l'orientation
retenue par la réforme de la Politique agricole commune
décidée en juin 2003. On reviendra sur ce point
ultérieurement.
(3) Commerce international et services publics
Le
commerce des services fait désormais, comme on l'a vu, partie
intégrante du processus de mondialisation. Le cycle de l'Uruguay a
abouti, en 1994, à la conclusion d'un Accord général sur
les services (ou
General
agreement on Trade of services
, GATS),
ce qui témoigne de l'importance prise par ce secteur dans les
échanges internationaux.
Il n'en reste pas moins qu'une part considérable des services produits
dans les pays développés sont assurés par la puissance
publique, et ne sont que très partiellement ouverts à la
concurrence. Il suffit de penser, pour s'en convaincre, à
l'organisation, en France, du système éducatif, et du
système de santé. La culture fait également l'objet de
dispositions particulières : la France a obtenu, à la toute
fin des négociations du cycle de l'Uruguay, en 1993, la reconnaissance
d'une clause « d'exception culturelle »,
c'est-à-dire l'idée que la culture puisse échapper
à l'application des règles régissant habituellement le
commerce international. Ceci a permis le maintien d'une protection
substantielle, notamment, du secteur cinématographique.
La décision, politique, de faire échapper aux règles du
marché certains secteurs d'activité vient naturellement apporter
des limitations aux possibilités d'expansion des échanges
internationaux. Il est cependant nécessaire de continuer à
exclure ces activités des règles du commerce international, dans
la mesure où elles sont au coeur de notre pacte social, et sont
indispensables à notre cohésion nationale.
Dans d'autres domaines, en revanche, tels les télécommunications
ou le transport aérien, la suppression des monopoles nationaux, et
l'ouverture à la concurrence, ouvrent de nouveaux espaces à la
négociation commerciale internationale.
2. La volatilité des taux de change freine la croissance du commerce international
Depuis la fin du système de changes fixes de Bretton Woods, en 1971, le système monétaire international se caractérise par la flexibilité des taux de changes. Au-delà de la flexibilité, on peut même parler de volatilité des taux de change . Les parités entre devises connaissent régulièrement d'amples variations, sans liens avec les modifications des données économiques fondamentales sous-jacentes. Le tableau suivant illustre ce point, en montrant les variations du change des principales devises par rapport au dollar américain dans la seconde moitié des années 1980 et dans les années 1990.
|
Taux de change nominaux en moyenne annuelle |
||||||
|
Valeur
|
1985 |
1987 |
1990 |
1995 |
1997 |
1999 |
|
Yen |
238 |
144 |
144 |
94 |
125 |
119 |
|
Deutschemark |
2,94 |
1,79 |
1,61 |
1,43 |
1,70 |
1,81 |
|
Livre sterling |
0,78 |
0,61 |
0,56 |
0,63 |
0,60 |
0,61 |
|
Francs français |
9,00 |
6,00 |
5,44 |
5,00 |
5,8 |
6,1 |
Source :
Economie politique contemporaine
, E. Barel
et alii
, 1999.
La
volatilité des taux de change
est
un frein au
développement du commerce
, dans la mesure où elle rend
très aléatoire les calculs économiques des entreprises
importatrices ou exportatrices. Une opération rentable dans des
conditions de change données ne le sera plus une ou deux années
plus tard, parce que les parités entre devises auront changé.
Au XIX
e
siècle, la stabilité des parités entre
devises était assurée dans le cadre du Gold Exchange Standard.
Cet environnement de stabilité monétaire a beaucoup
contribué à la croissance des échanges à
l'époque.
Il existe des techniques de couverture du risque de change qui permettent aux
firmes effectuant des opérations à l'étranger de s'assurer
contre une éventuelle variation du change. Mais ces techniques
assurancielles ont évidemment un coût pour les entreprises qui y
ont recours, et sont donc susceptibles, au même titre que les variations
de change elles-mêmes, de décourager des transactions
internationales.
3. Une mondialisation géographiquement différenciée
La mondialisation fonctionne aujourd'hui de manière profondément inégalitaire . L'intégration économique concerne les pays de la « Triade » (Amérique du Nord, Union européenne, Japon), et une quinzaine de pays émergents, mais des régions économiques entières, notamment en Afrique, sont marginalisées. Un autre fait marquant dans le monde contemporain est la formation de sous-ensembles économiques régionaux, dont l'exemple le plus abouti est, à ce jour, l'Union européenne. L'intégration dans un espace économique régional peut être, pour certains pays en développement, une étape vers une participation pleine et entière à la mondialisation.
a) Une participation inégale à la mondialisation
Les
indicateurs de participation au commerce international ou d'accueil des IDE
montrent que la mondialisation ne concerne en réalité qu'un
nombre limité de pays. Pour reprendre une expression de Pierre de
Senarclens, paradoxalement, «
l'espace de la mondialisation est
restreint
»
15
(
*
)
.
Au cours de son audition, M. Charles-Albert Michalet a recensé, outre
les pays développés, une quinzaine de pays émergents qui
participent pleinement au processus de mondialisation : il s'agit des
Nouveaux pays industrialisés (NPI) d'Asie (Corée du Sud, Taiwan,
Singapour et Hong Kong), des « Tigres » asiatiques
(Malaisie, Thaïlande, Indonésie), de la Chine et de l'Inde, de
trois pays latino-américains (Mexique, Chili et Brésil), et de
quelques pays d'Europe centrale (Pologne, Hongrie, Slovénie et
République tchèque).
Dix pays assurent plus de 55 % du commerce international, 22 pays en
assurent les trois quarts.
Les
dix premières puissances commerciales en 2002
|
|
|
Exportations + importations
|
En % du commerce mondial |
|
1. |
États-Unis |
1 896 293 |
14,63 |
|
2. |
Allemagne |
1 105 948 |
8,53 |
|
3. |
Japon |
753 920 |
5,82 |
|
4. |
Chine |
620 762 |
4,79 |
|
5. |
France |
615 320 |
4,75 |
|
6. |
Royaume-Uni |
611 737 |
4,72 |
|
7. |
Italie |
497 406 |
3,84 |
|
8. |
Canada |
487 149 |
3,91 |
|
9. |
Pays-Bas |
415 870 |
3,21 |
|
10. |
Hong Kong |
407 736 |
3,15 |
Source : FMI.
En dépit de son expansion démographique, la part de l'Afrique
dans le commerce international a baissé dans la dernière
période, passant de 2,7 % en 1990 à 2,1 % en 2000. En
vingt ans, les pays les moins avancés (PMA)
16
(
*
)
ont vu leur part dans les
exportations mondiales être divisée par deux, pour ne plus
représenter que 0,4 % du total.
Les investissements directs étrangers sont orientés pour les
deux tiers
vers les pays développés
. Et ces derniers
détiennent encore près de 90 % du stock mondial d'IDE, en
dépit de la montée en puissance des NPI d'Asie, qui
possèdent aujourd'hui 6 % du stock mondial d'IDE, contre seulement
2 % en 1985.
Les flux d'IDE à destination des pays en développement ont
cependant connu une progression spectaculaire dans la décennie 1990,
comme l'atteste le graphique suivant. Les flux d'IDE ont été
moins volatils que les autres flux financiers.
Flux nets d'investissements directs étrangers vers les pays en développement (en milliards de dollars américains)
Investissements étrangers de portefeuille
Investissements directs étrangers
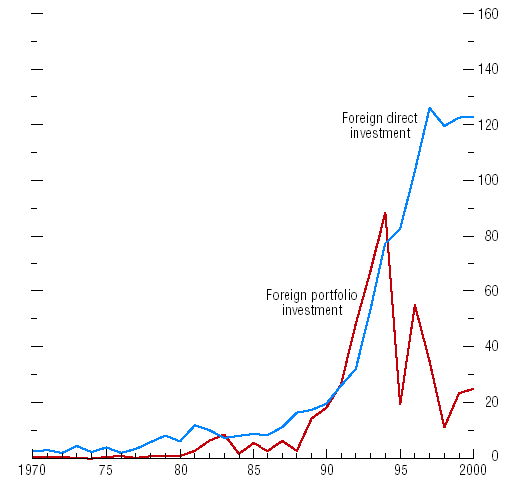
Source : FMI (2000)
Toutefois, au sein même de la catégorie des pays en
développement, les flux d'IDE sont très inégalement
répartis : dix pays reçoivent 80 % de ces flux. La
Chine arrive en tête, suivie de quelques grands pays d'Amérique
latine (Mexique, Brésil, Chili) et de pays en transition (Pologne,
République tchèque) ; parmi les pays africains, seule
l'Afrique du Sud figure parmi les dix premiers bénéficiaires
d'investissements étrangers.
Les pays les moins avancés ne reçoivent qu'une faible fraction
des IDE dirigés vers les pays en développement (moins de 2 %
à la fin des années 1990).
|
Investissements directs étrangers
|
|||
|
|
1986-1990 |
1991-1995 |
1996-1999 |
|
Ensemble des pays en développement |
27,9 |
79,3 |
182,2 |
|
Pays les moins avancés |
0,6 |
1,8 |
3,6 |
|
Aide publique au développement reçue par les PMA |
13,9 |
16,6 |
12,7 |
|
Source : FMI (2001). |
|||
Les investissements reçus par ces pays sont très inférieurs aux sommes perçues au titre de l'aide publique au développement. Ce point illustre leur dépendance par rapport aux bailleurs de fonds publics et leur faible attractivité pour les investisseurs privés.
b) Les regroupements régionaux, obstacle ou étape vers la mondialisation ?
Le
régionalisme s'est affirmé, depuis une dizaine d'années,
comme une tendance forte de l'organisation internationale, avec, bien
sûr, le renforcement de l'Union européenne, mais aussi
l'émergence de l'Alena en Amérique du Nord, ou la relance de
l'ASEAN en Asie. La création de zones de libre-échange a
été au coeur des projets défendus par ces rassemblements
régionaux. C'est en Europe que l'intégration économique
est la plus poussée, avec l'achèvement du Marché unique,
complété par une union douanière, et l'avènement de
l'euro. Le régionalisme est ainsi, le plus souvent, un facteur
d'approfondissement de l'intégration économique.
En ce sens, il participe de la même logique que le mouvement de
mondialisation. L'insertion dans une zone de libre-échange peut jouer le
rôle d'étape préparatoire avant une participation pleine et
entière au marché mondial. L'existence de solidarités, ou
d'affinités culturelles, au niveau régional, peut permettre
d'aller plus loin sur la voie de la libéralisation des échanges
que cela ne peut être obtenu au niveau multilatéral. Les bonnes
pratiques observées au niveau régional peuvent inspirer la
constitution d'autres zones de libre-échange, ou encourager leur
généralisation au niveau multilatéral.
Toutefois, le régionalisme peut, dans certains cas, être un
obstacle
aux progrès du multilatéralisme
s'il
conduit à la fragmentation de l'espace mondial en blocs rivaux
relativement fermés. Il peut aussi laisser à l'écart
certains Etats isolés. Seul un cadre multilatéral paraît,
en outre, propice à la conclusion d'accords commerciaux
équilibrés, respectueux de tous les intérêts en
présence : lorsqu'une grande puissance commerciale, comme les
États-Unis ou l'Union européenne, négocie, de
manière bilatérale, avec un pays en développement, le
déséquilibre des forces en présence rend difficile
l'obtention de concessions de la part des pays développés.
Pour que la régionalisation ne s'oppose pas à la mondialisation,
mais en soit le complément, plusieurs conditions doivent donc être
respectées. L'article XXIV du GATT (et l'article V du GATS,
General
Agreement on
Trade of Services
) encadre les unions douanières
en prévoyant que celles-ci doivent lever les obstacles au commerce pour
« l'essentiel des échanges », être mises en
place dans un « délai raisonnable », et ne pas
instaurer de barrières « plus
élevées » à l'égard des pays tiers. Un
mémorandum négocié lors de l'Uruguay Round a
précisé la notion de « délai
raisonnable » (dix ans maximum, sauf exception), les conditions de
recours à l'organe de règlement des différends de l'OMC,
et le calcul des compensations applicables en cas d'un relèvement d'un
droit de douane à l'égard des tiers. Les accords de
libre-échange conclus entre pays en développement ne sont
toutefois pas soumis à ces contraintes (la levée des
barrières aux échanges entre pays de l'ASEAN n'a, par exemple,
été que partielle).
Jusqu'à présent, la multiplication des accords de commerce
régionaux (l'OMC en dénombre plus de 200, qui ne sont pas tous de
très grande portée) n'a pas empêché
l'approfondissement des négociations multilatérales. On ne peut
cependant occulter une certaine tendance, dans les années 1990, à
la montée des contentieux entre puissances commerciales (notamment entre
l'Union européenne et les États-Unis : affaires de la
banane, du boeuf aux hormones, des OGM, de l'acier, etc.). Les
difficultés actuelles des négociations multilatérales
peuvent en outre faire craindre un repli des Etats sur leurs zones
économiques régionales.
Ce risque plaide pour un renforcement des règles visant à assurer
la compatibilité des accords régionaux avec le système
multilatéral. La Banque mondiale propose ainsi de préciser la
part des échanges devant être nécessairement couverte par
ces accords (elle suggère 95 % dans un délai de dix ans
après l'entrée en vigueur de l'accord), d'exiger la suppression
des procédures anti-dumping entre membres d'un accord régional,
et d'appliquer les règles de droit commun aux pays en
développement (par souci de réalisme, on pourrait envisager, sur
ce dernier point, de distinguer, parmi les pays en développement, les
pays émergents, qui ont atteint un certain niveau de
développement, et les autres). L'idée générale est
de s'assurer que les accords régionaux vont réellement beaucoup
plus loin sur la voie de la libéralisation que ce que prévoient
les règles de l'OMC, et ne puissent donc être perçus comme
un substitut à celles-ci.
Au-delà de cette question de la compatibilité entre accords
régionaux et système multilatéral, il faut souligner les
potentialités de l'espace régional comme lieu de
régulation des processus économiques et financiers. Du fait de
l'internationalisation des économies, l'espace national n'est plus
toujours adapté à la mise en oeuvre de politiques de
régulation. En revanche, des marges de manoeuvre plus importantes
peuvent exister à l'intérieur d'ensembles économiques
régionaux, telle l'Union européenne. Une coordination des
politiques budgétaires et fiscales donnerait aux Etats des
capacités d'actions supérieures à celles dont ils
disposent aujourd'hui. Mais elle supposerait, en contrepartie, un partage de la
souveraineté, souvent difficile à faire accepter. Lorsque la trop
grande divergence des intérêts en présence rend impossible
une action multilatérale, des initiatives régionales peuvent
constituer un premier élément de réponse aux excès
de la mondialisation. La conclusion d'accords régionaux pourrait ainsi
représenter une étape vers un multilatéralisme
généralisé. Ceci est particulièrement vrai pour les
pays du Sud, qui ont, plus que les autres, besoin de mutualiser leurs efforts,
et d'une étape intermédiaire avant de participer pleinement aux
échanges internationaux.
La mondialisation se définit couramment comme un processus
d'accroissement des flux entre les nations. Mais il y a une deuxième
dimension de la mondialisation qui ne doit pas être
négligée : la prise de conscience grandissante de
l'existence de biens publics mondiaux, dont la préservation ou la
production appellent une action coordonnée des Etats. La multiplication
des interdépendances entre les sociétés rend plus
évidents les solidarités et les enjeux à traiter. Les
problèmes globaux ignorent les frontières nationales, et rendent
plus nécessaire que jamais l'approfondissement de la gouvernance
mondiale.
II. L'ÉMERGENCE DES BIENS PUBLICS MONDIAUX
La mondialisation multiplie les problèmes et les intérêts communs à des ensembles de pays, voire à toutes les populations de la planète, qu'il s'agisse d'environnement, de santé, de stabilité financière, ou d'accès au savoir. Dans la période récente, le débat sur les problèmes globaux a été renouvelé par le recours au concept de « bien public », formulé par Paul Samuelson dans les années 1950 17 ( * ) . Initialement appliqué dans un cadre national, le concept de bien public a été élargi à l'échelle internationale, de sorte que l'on parle aujourd'hui couramment de « biens publics mondiaux ». Alors que la libéralisation des échanges a été inspirée par la perception des avantages retirés du fonctionnement libre des marchés, la promotion de la notion de bien public plaide pour un retour de l'action publique, à une échelle nouvelle.
A. UNE PROGRESSIVE PRISE DE CONSCIENCE
La liste
des problèmes considérés comme globaux s'allonge à
mesure que des problèmes traités jusque-là à
l'intérieur des frontières nationales débordent ce cadre
traditionnel de l'action politique.
Pour s'en tenir aux principaux problèmes globaux, on peut citer :
le changement climatique, la dégradation de la couche d'ozone, la
diminution des ressources naturelles, et notamment de la biodiversité,
les grands trafics, les risques de contamination sanitaire et de diffusion des
épidémies, l'instabilité financière, ou encore la
prolifération nucléaire. Cette liste pourrait bien sûr
être complétée. Ces problèmes, de nature très
hétérogène, renvoient, pour certains, à des
thématiques anciennes (sécurité, lutte contre les
épidémies), tandis que d'autres sont liés à des
questionnements plus récents, tel le changement climatique. Ils ont en
commun de poser de manière récurrente des problèmes
d'action collective.
L'émergence de nouveaux problèmes globaux dans les consciences
collectives doit beaucoup au travail de
réseaux d'experts
, qui
permettent de mieux apprécier l'étendue des risques. Un travail
scientifique préalable a, par exemple, été
nécessaire pour que la question de la dégradation de la couche
d'ozone fasse irruption dans le débat public. Aujourd'hui,
l'Administration Bush insiste sur les divergences entre scientifiques autour du
phénomène du changement climatique pour justifier son refus de
ratifier le protocole de Kyoto. Le discours de l'Administration
américaine vise à entretenir le doute sur l'origine humaine du
réchauffement climatique, et à minimiser la menace qu'il
représente. L'établissement d'un consensus parmi les
scientifiques, relayé par les médias et les ONG, apparaît
ainsi comme un facteur contribuant fortement à l'émergence d'un
problème global dans la conscience collective. Pour faciliter
l'apparition d'un consensus sur la question du climat, le Programme des
Nations-Unies pour l'Environnement (PNUE) et l'Organisation
météorologique internationale ont institué, en 1988, un
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).
L'organisation de grandes conférences internationales est le signe qu'un
problème global figure désormais sur l'agenda des Gouvernements.
Pour s'en tenir au secteur de l'environnement, le sommet de la Terre à
Rio, en 1992, a, de ce point de vue, représenté un tournant.
Cette conférence a voulu jeter les bases d'un nouveau compromis
international entre les préférences des pays du Nord et celles
des pays du Sud. La communauté internationale s'est attachée
à définir les problèmes pour lesquels pouvait être
établie une responsabilité commune, mais
différenciée, selon les pays et les niveaux de
développement. L'Agenda 21, adopté lors du sommet, a
défini un programme d'action pour un développement durable,
embrassant tous les aspects de la protection de l'environnement et du
développement des pays du Sud.
Une fois les problèmes globaux identifiés, se pose la question de
la mise en oeuvre d'une action collective pour les résoudre. C'est dans
ce contexte qu'il a été fait recours à la théorie
des biens publics. Cette théorie présente l'avantage de souligner
l'existence d'intérêts communs à l'ensemble des acteurs
étatiques, et de donner un
fondement rationnel à
l'intervention publique dans un univers de marchés libres et
concurrentiels, dont la légitimité n'est pas remise en
cause.
B. DE LA THÉORIE DES BIENS PUBLICS AUX BIENS PUBLICS MONDIAUX
1. Définition des biens publics
Pour
Samuelson, un bien public répond aux deux critères suivants :
- un critère de
non-rivalité
: cela signifie que la
consommation de ce bien par un usager n'entraîne aucune réduction
de la consommation des autres usagers ;
- un critère de
non-exclusion
: il est impossible d'exclure
quiconque de la consommation de ce bien ; il est, par conséquent,
impossible de faire payer l'usage de ce bien.
Les deux exemples de biens publics traditionnellement cités sont les
phares et l'éclairage public. L'usage d'un réverbère par
un individu ne se fait pas au détriment de l'usage des autres
consommateurs (non-rivalité) et il n'est pas possible de soumettre
à paiement le bénéfice de l'éclairage public
(non-exclusion).
Ces deux caractéristiques des biens publics ont une importante
conséquence pratique : le libre fonctionnement des marchés
ne permet généralement pas de les produire en quantité
satisfaisante. A l'évidence, la production de ces biens publics
présente un intérêt collectif, mais aucun agent
privé n'a intérêt à s'engager dans la production de
ces biens, dans la mesure où l'impossibilité d'en faire payer
l'usage interdit de rentabiliser l'investissement consenti. Chaque agent
privé a intérêt à adopter un comportement de
« passager clandestin » (ou de
free rider
dans la
terminologie de Mancur Olson), c'est-à-dire à attendre que
d'autres prennent l'initiative de la production du bien, pour pouvoir ensuite
en bénéficier, sans supporter aucun coût. Dans ces
conditions, il existe une forte probabilité que le bien ne soit pas
produit, ou le soit en quantité inadéquate.
Cette lacune pourrait être surmontée si tous les acteurs
privés se coordonnaient et produisaient le bien public en mutualisant
les coûts. Mais cette coordination des agents privés n'est pas
facile à obtenir, en raison des coûts de négociation, et
des difficultés qu'il peut y avoir à contrôler, et
sanctionner si nécessaire, l'application des règles communes.
C'est pourquoi la solution optimale réside, à l'intérieur
des frontières nationales, en la production de ces biens par la
puissance publique. Comme il est impossible de faire payer l'utilisation du
bien, sa production est financée par l'impôt.
Il est important de préciser que les contours de la catégorie
« biens publics » ne sont pas séparables d'un
certain état des techniques et du droit. Laurence Tubiana et Jean-Michel
Severino citent, à cet égard, deux exemples parlants :
«
le signal du phare, exemple type du bien public pur, peut
être remplacé par un système de signalisation
électronique accessible seulement à ceux qui paient pour son
accès ; les informations génétiques d'une plante
peuvent être réservées à ceux qui les
achètent au moins pour une période, ou au contraire,
laissées par décision dans le domaine
public
»
18
(
*
)
.
Les biens publics sont, au sens strict, ceux qui répondent au double
critère de non-rivalité et de non-exclusion. Mais on emploie
souvent l'expression de « biens publics impurs » pour
désigner des biens qui ne répondent qu'à un seul de ces
critères :
• les biens qui respectent le critère de non-exclusion, mais qui
sont des biens rivaux (exemple : les ressources halieutiques), sont
généralement qualifiés de « biens
communs » ; on ne peut restreindre aisément
l'accès à ces biens, mais ils s'épuisent quand ils sont
consommés ;
• les biens non-rivaux mais dont on peut interdire l'accès sont des
« biens clubs » ; des infrastructures comme le canal
de Suez ou le canal de Panama sont des exemples de biens clubs, puisque l'on
peut réserver l'accès à ces biens à ceux qui
paient.
L'expression « biens publics » est le plus souvent
employée pour désigner tant les biens publics purs que les biens
clubs ou les biens communs.
2. L'application du concept de bien public à l'échelle internationale
Le
concept de bien public a d'abord été développé dans
un cadre de réflexion national : pointant une défaillance du
marché, il offre un point d'appui théorique à une
intervention de la puissance publique. L'application de la notion à des
problématiques internationales est récente, puisque le terme de
« bien public mondial » n'est devenu d'usage courant dans
les milieux académiques que dans les années 1990. Il reste encore
peu connu du grand public, même s'il tend à se diffuser dans le
discours politique.
L'emploi du concept de bien public mondial s'est imposé pour plusieurs
raisons. Il est apparu logique de transposer à l'échelle
internationale un concept développé dans le cadre national, dans
la mesure où l'économie s'est elle-même
internationalisée. Surtout, le concept de bien public présente
l'avantage d'apporter une justification à la coopération
internationale, sans remettre en cause le bien-fondé de la
libéralisation des marchés. En ce sens, la prise de conscience
croissante de l'existence de biens publics mondiaux représente bien une
seconde dimension de la mondialisation, et non une volonté d'apporter
des restrictions à l'ouverture aux échanges.
La compatibilité de la notion de bien public mondial avec les canons de
la théorie économique classique lui confère une force
persuasive particulière auprès des États et des
organisations internationales (OMC, OCDE) les plus attachés à la
libéralisation des marchés.
Charles Kindleberger, l'un des auteurs pionniers en la matière,
définit les biens publics mondiaux comme « l'ensemble des
biens accessibles à tous les États qui n'ont pas
nécessairement un intérêt individuel à les
produire »
19
(
*
)
.
Cette définition souligne le caractère universel de ces biens.
Elle indique également que les biens publics mondiaux soulèvent
une difficulté supplémentaire par rapport aux biens publics
« nationaux », celle de la coordination entre États.
On ne peut, en effet, comme on l'a vu, compter sur les seules forces du
marché pour assurer un niveau de production suffisant de ces biens, mais
on ne peut pas non plus, en l'absence de gouvernement mondial, se tourner vers
une autorité politique unique pour combler les défaillances du
marché. Seule la coopération entre États peut permettre de
produire les biens publics mondiaux. Or la coopération entre
États est obérée par les mêmes
phénomènes de « passagers clandestins » qui
rendent difficile la production des biens publics par les acteurs
privés. Elle est encore compliquée par la grande
hétérogénéité des préférences
des États, qui résulte des écarts de niveaux de
développement et des différences culturelles entre
sociétés. Ces difficultés de la coopération
interétatique expliquent que la gouvernance mondiale soit encore si
lacunaire.
Kindleberger cite comme exemples de biens publics mondiaux l'existence d'un
système monétaire stable, un régime commercial ouvert, des
changes fixes, une monnaie d'échanges internationale, ou encore
l'existence d'un prêteur international en dernier ressort. On pourrait
ajouter, dans le domaine de l'environnement, la préservation de la
couche d'ozone, ou la réduction des gaz à effet de serre.
Ces quelques exemples montrent le glissement qui s'est opéré par
rapport aux biens publics traditionnels, type signalisation maritime ou
éclairage public.
Ces biens publics globaux correspondent à
des objectifs publics complexes et généraux, qui ne peuvent
être atteints qu'à la suite d'un long processus de
négociation.
De plus, dans un récent article
20
(
*
)
, Henri Bourguinat insiste avec raison sur le point
suivant : la gestion des biens publics mondiaux suppose bien souvent de
prendre en compte une importante dimension inter temporelle :
«
Qu'il soit question de l'effet de serre, des CFC
3
ou
des grandes campagnes d'éradication de maladies endémiques comme
la variole ou le sida, les dommages à combattre et les solutions
à apporter dépendent de stocks s'accumulant en longue
période. Pour le réchauffement climatique, par exemple, c'est
parce que les gaz à effet de serre se sont accumulés par le
passé que les flux nouveaux sont particulièrement dangereux. En
sens inverse interviennent les stocks de capital (technique ou humain), les
stocks biologiques ou génétiques, ou encore les réserves
de crédibilité pour les systèmes monétaires. Les
dommages ou les bénéfices se manifestant le plus souvent par
accumulation lente et parfois irréversible, la gestion de ces biens
publics est particulièrement délicate en raison de ces
décalages temporels importants. En matière biologique, par
exemple, la disparition actuelle d'une espèce peut très bien
avoir une incidence future sur l'équilibre du biotope sans commune
mesure avec son impact immédiat. La gestion de ces biens publics doit
donc prendre en compte non seulement l'intérêt de la
génération présente, mais aussi celui des
générations futures
. »
Pour tenter de mettre un peu d'ordre dans la nébuleuse des biens publics
mondiaux, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a
proposé de regrouper les biens publics mondiaux en trois grandes
catégories :
- la première regroupe les biens publics mondiaux naturels, tels la
stabilité climatique ou la biodiversité. Le problème
auquel est confrontée la communauté internationale est la
surutilisation de ces biens,
- la deuxième catégorie correspond aux biens publics mondiaux
d'origine humaine, tels que les connaissances scientifiques. Pour ce type de
biens, l'enjeu principal est leur sous-utilisation,
- la troisième catégorie, dénommée
« résultats politiques globaux », inclut la paix, la
santé, la stabilité du système financier international...
Le problème d'action collective est dans ce cas un problème de
sous-production. Les biens de cette catégorie se distinguent en ce
qu'ils correspondent à un processus continu de production, alors que les
biens des deux autres catégories sont des variables de stock, comme
l'avait déjà noté H. Bourguinat.
Le concept de bien public mondial permet de rationaliser l'approche des
problèmes globaux auxquels est confrontée la communauté
internationale. Il met en évidence des imperfections de marché,
et rappelle l'évidente nécessité de l'action publique pour
gérer les retombées de la mondialisation. Une fois cette analyse
faite, le problème se déplace vers la question des
modalités de production des biens publics mondiaux, qui se heurte aux
difficultés de la coopération internationale.
C. MODALITÉS DE PRODUCTION DES BIENS PUBLICS MONDIAUX
La production des biens publics mondiaux résulte le plus souvent d'une action coordonnée entre États. Mais ce n'est pas toujours le cas : sous certaines conditions, une grande puissance peut être le « fournisseur dominant » d'un bien public mondial.
1. Le modèle du fournisseur dominant et ses limites
Comme on
l'a vu, C. Kindleberger cite comme exemples de biens publics mondiaux, à
caractère économique, l'existence d'un système
monétaire international stable, d'un régime commercial ouvert, ou
d'un prêteur international en dernier ressort.
Kindleberger, et à sa suite le politologue Robert Gilpin, ont fait
remarquer que la fourniture de ces biens publics avait été
assurée pour l'essentiel, après 1945,
par une puissance
dominante, les États-Unis
d'Amérique
.
L'intégration commerciale a été facilitée par le
statut de monnaie d'échanges internationale du dollar, qui était,
jusqu'en 1971, le pivot du système de changes fixes. Les
Américains ont joué un rôle clé dans l'instauration
du GATT en 1947, et dans la reconstruction, sur le modèle
libéral, de l'Europe et du Japon après guerre. La Réserve
fédérale américaine a joué, à diverses
reprises, le rôle de prêteur international en dernier ressort
à l'occasion de crises financières internationales, y compris
lors de la crise asiatique de 1997-1998
21
(
*
)
.
Les États-Unis ont joué également un rôle
prépondérant pour assurer un certain degré de
stabilité politique et de sécurité internationale, qui
constituent le terrain indispensable au maintien d'un régime
économique ouvert.
La thèse de R. Gilpin est que la présence d'une puissance
hégémonique est indispensable au maintien d'un ordre
économique international libéral. La Grande-Bretagne aurait
été le pivot de l'ordre économique international au
XIX
e
siècle, et les États-Unis auraient assumé
cette fonction après 1945.
Il n'est pas nécessaire d'adhérer totalement à cette
thèse (on peut supposer en effet que la coopération entre grandes
puissances permette d'arriver au même résultat que l'action de la
puissance hégémonique) pour reconnaître que les
États-Unis ont joué un rôle important dans l'organisation
du système international depuis la fin de la Seconde guerre mondiale.
Il apparaît que ce modèle, qui consiste à s'en remettre
à un producteur dominant pour la fourniture de biens publics mondiaux,
est peu stable et présente de sérieuses limites. Les
États-Unis ont joué un rôle pivot après 1945 :
- parce qu'ils en avaient les moyens,
- et parce qu'ils étaient disposés à le faire,
c'est-à-dire qu'ils estimaient que les bénéfices
retirés par eux de l'existence de ces biens publics excédaient
les coûts supportés pour en assurer la production.
Ces deux conditions ne sont pas nécessairement toujours acquises.
Dès 1971, les États-Unis ont estimé ne plus être en
mesure d'assurer leurs obligations en matière de
convertibilité-or du dollar, ce qui a mis fin au régime de
changes fixes hérité de Bretton Woods. Et la puissance dominante
ne sera pas incitée à produire seule un bien public s'il
apparaît que les bénéfices qu'elle pourrait en retirer
seraient très inférieurs aux coûts qu'elle supporterait. Ce
peut être le cas pour la recherche du traitement d'une maladie
infectieuse qui frapperait principalement les pays du Sud, par exemple
22
(
*
)
.
Dans certains cas, le pays qui fournit le moins d'efforts pour produire un bien
public global détermine le niveau de production d'ensemble. L'exemple
typique est le contrôle des maladies infectieuses : le pays qui
déploie le moins de moyens pour lutter contre une maladie infectieuse
détermine, pour partie, le niveau de santé de ses voisins. Dans
ce type de configuration (modèle du « maillon
faible »), la puissance dominante ne peut, quels que soient ses
moyens, suppléer à une absence d'efforts coordonnés
éventuellement assortis d'une aide des pays riches vers les pays les
plus pauvres.
2. Les difficultés de la négociation collective
Lorsque
la production d'un bien public global dépend de la somme des actions de
chaque pays, l'enjeu est de coordonner le plus grand nombre d'États pour
maximiser la production de ce bien. Mais la coordination d'un grand nombre de
pays est difficile, comme l'ont rappelé récemment l'échec
du sommet de Cancun ou les ratés de la mise en oeuvre du protocole de
Kyoto.
Ces difficultés tiennent à certaines configurations
d'intérêts, du type « passager clandestin »,
déjà évoquées au sujet de la coordination des
acteurs privés. Laissé à lui-même, chaque pays peut
estimer qu'il a intérêt à ne pas contribuer à la
production du bien public : au mieux, il profitera des actions
éventuellement entreprises par les tiers ; au pire, il ne retirera
aucun bénéfice, mais ne supportera aucun coût au
bénéfice d'autrui.
Mener une action internationale coordonnée suppose également de
s'accorder sur les finalités à poursuivre, et, dans un univers
où les ressources sont limitées, de hiérarchiser les
priorités. Or,
la perception des enjeux et les
préférences collectives des nations sont loin d'être
homogènes
. Les négociations du Doha Round montrent un clivage
entre l'Union européenne, désireuse d'introduire des
éléments de régulation de la mondialisation dans le
domaine social et environnemental, et les pays en développement, qui
voient dans ces prétentions une possible menace sur leur croissance
économique.
Un accord peut être plus facilement obtenu entre sociétés
ayant des préférences divergentes si l'on admet le principe d'une
contribution différenciée de chacun des participants. Ainsi, les
pays qui ont les moyens les plus importants, ou qui sont les plus
déterminés à avancer sur un objectif, porteront une part
disproportionnée du fardeau commun.
Cette approche a été retenue dans le cadre de la
négociation sur le climat, qui assigne des objectifs très
différents aux États participants. Cette approche, pour
raisonnable qu'elle soit, n'en pose pas moins de redoutables problèmes
de répartition des efforts à fournir. L'administration Bush s'est
ainsi plainte de ce que le protocole de Kyoto imposait aux États-Unis
une charge trop lourde par rapport à celle de l'Europe et des pays
émergents pour justifier son refus de le ratifier.
3. Les instruments mobilisables
a) Une coopération plus ou moins institutionnalisée
L'instrument juridique auquel il est le plus souvent fait appel pour
organiser la production des biens publics mondiaux est la conclusion de
traités internationaux. Dans le seul domaine de l'environnement, on
compte quelques 200 conventions multilatérales. Une association
écologiste comme Greenpeace appelle de ses voeux l'élaboration
d'un « droit international de l'environnement » pour faire
contrepoids à la mondialisation économique et financière.
La multiplication des conventions n'est cependant pas, en soi, un gage de
progrès, dans la mesure où la question de l'effectivité
des traités est souvent posée. Comme on le verra, nombre
d'accords environnementaux ne sont pas ou sont mal appliqués.
La coopération entre États ne passe pas nécessairement par
la conclusion d'accords internationaux formalisés, comme le montrent par
exemple les initiatives prises par le G7/G8. En l'absence de formalisation
toutefois, les initiatives prises risquent de demeurer ponctuelles, et les
engagements difficiles à faire respecter dans la durée. Dans le
domaine monétaire, les décisions prises par le G7 dans les
années 1980 (accords du Plazza et du Louvre), visant à assurer
une plus grande stabilité du cours des devises, n'ont été
appliquées que très brièvement.
A l'inverse, une plus grande institutionnalisation peut être
recherchée par la création d'organisations internationales. Au
niveau politique, l'Organisation des Nations Unies, et plus
particulièrement le Conseil de Sécurité, sont
chargés de veiller au maintien de la paix. Dans le domaine
économique, le Fonds Monétaire International et l'Organisation
Mondiale du Commerce jouent un rôle éminent. L'Organisation
Mondiale de la Santé et l'Organisation Internationale du Travail sont
chargées de faire entendre des préoccupations sociales. La
création d'une organisation internationale peut être vue comme le
signe d'une volonté politique de la communauté internationale de
traiter un dossier. Une organisation internationale constitue un lieu de
concertation permanente qui facilite la conclusion d'accords. Elle est un lieu
où les États se surveillent en permanence, ce qui favorise le
respect des accords. Elle permet la formation d'une capacité d'expertise
reconnue et indépendante des États, et peut jouer un rôle
dans la sensibilisation de l'opinion publique à certaines
problématiques. La création d'une organisation internationale
n'est cependant pas décisive s'il n'y a pas une volonté politique
forte des États de lui donner les moyens juridiques et financiers
d'agir.
b) De la définition de normes à la création d'incitations
Traditionnellement, les traités internationaux
définissent des normes de comportement pour les États,
généralement énoncées sous la forme d'interdictions
de faire (interdiction de relever des droits de douane, interdiction de chasser
certaines espèces, etc.). L'efficacité de ces mesures
dépend de la volonté des États de respecter les
contraintes auxquelles ils ont souscrit. L'existence d'un mécanisme de
contrôle et de sanction est cruciale pour garantir l'effectivité
des accords. L'OMC dispose, avec l'organe de règlement des
différends (ORD), d'un instrument de contrôle et de sanction
efficace, mais ce cas de figure est assez exceptionnel en droit international.
Pour atteindre les objectifs de fourniture optimale des biens publics mondiaux
au moindre coût et sans mise en oeuvre d'un système de contraintes
et de sanctions, le recours à des instruments incitatifs peut parfois
être préférable. Ces instruments incitatifs peuvent prendre
la forme de taxes ou de création de marchés de droits.
Les biens publics se caractérisent par la présence
d'externalités
, c'est-à-dire que leur production a un
impact sur le bien-être d'agents qui n'y sont pas directement
impliqués et dont les avantages ou les coûts ne sont pas pris en
compte dans les calculs de l'agent qui les génère. Par exemple,
les émissions de gaz à effet de serre présentent un
coût pour la collectivité qui n'est pas reflété dans
le prix des énergies fossiles supporté par les consommateurs.
Cette « externalité négative » conduit
à une surconsommation d'énergie par rapport à ce qui
serait optimal du point de vue du bien-être collectif. Pour
« internaliser les externalités »,
c'est-à-dire amener les acteurs à intégrer dans leurs
calculs les coûts induits pour la collectivité de leurs
activités, l'instauration de taxes ou de redevances est l'instrument
économique le plus classique et le plus simple d'usage. La proposition
de James Tobin de créer une taxe sur les transactions internationales
s'inspire de ces réflexions ; cette taxe obligerait les agents sur
les marchés à internaliser les coûts supportés par
la collectivité du fait de la volatilité du cours des devises.
Pour rapprocher coût social et coût privé, Ronald Coase a
proposé une méthode différente de la taxation : il
s'agit de
la création de marchés de
droits
. Cela
suppose de créer d'abord des droits de propriété, puis de
définir leur répartition entre les différents acteurs
concernés. Pour l'application du protocole de Kyoto, des quotas de droit
d'émission de gaz à effet de serre ont été
négociés entre les parties, en vue d'être distribués
gratuitement selon des proportions définies par l'accord. Puis ces
droits devraient pouvoir être échangés sur un marché
international des droits d'émission. Ainsi, les pays désireux
d'émettre des gaz à effet de serre au-delà de leurs quotas
initiaux pourront le faire contre paiement. Le prix des droits
d'émission augmentant avec la demande représentera un signal
encourageant les États à modérer leurs émissions de
gaz à effet de serre.
*
* *
La mondialisation revêt donc, aux yeux de votre rapporteur, deux dimensions indissociables : l'accroissement des flux d'échange et de l'intégration économique, d'une part, et l'émergence dans le débat public d'enjeux globaux, commodément désignés par l'expression de « biens publics mondiaux », d'autre part. L'approche en termes de biens publics mondiaux présente l'avantage de fonder rationnellement l'action publique sur une analyse des défaillances de marché. Elle met en évidence le fait que la mondialisation, loin de rendre caduc le rôle du politique, appelle une action publique renouvelée. Des propositions en ce sens seront faites dans la troisième partie de ce rapport. Avant cela, il importe de présenter quelques éclairages sur une question souvent débattue, celle de l'impact de la mondialisation sur la qualité de l'environnement.
DEUXIÈME
PARTIE :
LES CONSÉQUENCES DE LA MONDIALISATION
DES
ÉCHANGES SUR L'ENVIRONNEMENT
La
mondialisation fait l'objet de vives critiques, fondées sur des
considérations sociales, politiques, culturelles ou environnementales.
Les critiques adressées à la mondialisation dans ses relations
avec l'environnement se résument, lorsqu'on les synthétise,
à deux assertions principales.
Premièrement, la mondialisation aurait pour effet de donner un avantage
compétitif aux pays les moins rigoureux en matière
d'environnement, ce qui aurait pour effet de conduire, soit à des
délocalisations d'entreprises industrielles, soit à un recul des
normes environnementales dans les pays développés.
Deuxièmement, l'ouverture économique, en stimulant la croissance,
conduirait à une aggravation insoutenable des émissions de
polluants et des pressions sur le milieu naturel.
Ces deux thèses sont parfois présentées par les opposants
à la mondialisation comme des évidences qui n'auraient même
pas besoin d'être discutées. En réalité, les
données disponibles, qui ne sont pas toujours simples à
interpréter ni univoques, amènent à un jugement beaucoup
plus nuancé sur l'impact de la mondialisation sur l'environnement. La
mondialisation exerce à la fois des effets positifs et négatifs
sur l'environnement, et c'est son effet net qu'il convient d'essayer de
dégager.
Depuis l'étude de Grossman et Krueger
23
(
*
)
relative à l'impact de l'ALENA sur
l'environnement, il est devenu habituel de distinguer trois effets de la
mondialisation sur l'environnement : un effet de composition, un effet
d'échelle et un effet technique.
L'effet de composition
est lié à la spécialisation
internationale induite par le commerce : des pays qui, auparavant,
produisaient un large éventail de marchandises pour répondre
à la demande locale se spécialisent dans une partie de ces
productions et importent les autres. La spécialisation internationale
conduit, en principe, à une utilisation optimale des facteurs de
production, y compris des ressources naturelles, ce qui devrait être
favorable à l'environnement. En pratique, toutefois, elle ne garantit
pas nécessairement un usage plus économe des ressources
naturelles, dans la mesure où le coût de ces ressources n'est pas
toujours internalisé dans les prix, comme l'a montré la
discussion sur les biens publics environnementaux. En d'autres termes, les
entreprises ne se soucient pas d'économiser des ressources dont l'usage
est gratuit.
Dans ces conditions, il est difficile de prévoir l'impact de la
spécialisation internationale sur l'environnement. Grossman et Krueger
nous invitent à distinguer deux scénarios. Dans le premier
scénario, on admet que la spécialisation est fondée sur
les dotations en facteurs de production traditionnels ; l'effet de
composition sera alors favorable à l'environnement si les
activités polluantes se localisent davantage dans les pays où les
normes environnementales sont strictes, et sera défavorable dans le cas
contraire. Dans le second scénario, on retient l'hypothèse
suivant laquelle la spécialisation est fondée sur les
différences de législation environnementale : dans ce cas,
les activités les plus polluantes se localiseront toujours dans les pays
les moins exigeants en matière d'environnement (qui
bénéficient d'un avantage comparatif) et le bilan pour
l'environnement global sera négatif.
Pour évaluer l'impact de la mondialisation sur l'environnement, il est
donc essentiel d'apprécier si les différences de
réglementations environnementales offrent effectivement un avantage
comparatif à certains Etats, et si la mondialisation s'accompagne de
délocalisations massives d'industries polluantes. C'est à ces
questions que le premier chapitre de cette deuxième s'efforcera de
répondre.
L'effet d'échelle
renvoie, quant à lui, à l'impact
de l'augmentation de la production sur l'environnement. Implicitement, Grossman
et Krueger considèrent que l'ouverture aux échanges favorise la
croissance. Pour un état des techniques donné, l'augmentation de
la production s'accompagne d'un accroissement des émissions de polluants
et des prélèvements sur le milieu naturel, ce qui est
défavorable à l'environnement.
Cela dit,
l'effet technique
vient contrebalancer l'effet
d'échelle : la libéralisation, en ouvrant les pays en
développement aux investissements, peut conduire à un transfert
de technologies plus modernes et plus propres vers ceux-ci ; et, surtout,
la libéralisation, entraînant une augmentation des revenus,
amène les citoyens à se montrer plus exigeants sur la
qualité de l'environnement et à exiger des normes plus strictes.
Apprécier l'impact de la croissance sur l'environnement suppose donc de
déterminer lequel de ces deux effets l'emporte. Votre rapporteur tentera
d'apporter une réponse à cette question dans un second
chapitre.
I. LA MONDIALISATION DONNE-T-ELLE UN AVANTAGE COMPÉTITIF AUX PAYS LES MOINS EXIGEANTS EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT ?
Certaines analyses théoriques font redouter que la mondialisation ne soit la cause d'importantes délocalisations industrielles, et n'entrave les politiques environnementales nationales. Les données empiriques disponibles, quoique souvent trop éparses, conduisent à relativiser quelque peu cette menace. De multiples éléments contredisent l'hypothèse selon laquelle les entreprises multinationales accorderaient une grande importance dans leurs choix de localisation aux différences de réglementations environnementales.
A. LE RISQUE DU « DUMPING ENVIRONNEMENTAL »
Depuis
une trentaine d'années, c'est-à-dire depuis que les pays
industrialisés ont commencé à adopter et à
appliquer des lois environnementales impliquant des coûts de mise en
conformité non négligeables, ces lois ont été
critiquées au motif qu'elles incitaient les industries les plus
polluantes à se délocaliser. On a employé l'expression de
« dumping environnemental » pour décrire ce
phénomène : les Etats rivaliseraient pour attirer des firmes
multinationales en adoptant des normes environnementales moins rigoureuses.
La thèse du dumping environnemental a été initialement
formulée à propos de la rivalité entre Etats ou provinces
de pays fédératifs dans lesquels les compétences
environnementales sont décentralisées. Le cas typique est celui
des Etats-Unis. Jusqu'en 1970, les différents Etats de l'Union
étaient libres de définir leurs propres normes. En principe, cela
aurait dû déboucher sur une différenciation souhaitable des
normes en fonction des conditions locales et du prix que la population de
chaque Etat était disposée à payer pour avoir un
environnement propre. Mais ce régime décentralisé a
été remis en question, pour deux raisons principales. D'une part,
il ne permettait pas de traiter de manière satisfaisante les
problèmes de pollution touchant plusieurs Etats. D'autre part, les Etats
fédérés s'exposaient au risque que les entreprises se
soustraient à leurs réglementations en déménageant.
Sous la pression d'une opinion publique de plus en plus sensible à
l'environnement, le Congrès des Etats-Unis a pris l'initiative,
surmontant les réticences des Etats et des collectivités locales,
et adopté plusieurs lois : loi sur la protection de l'environnement
(1969), loi sur la propreté de l'air (1970), loi sur la propreté
de l'eau (1972), loi sur les espèces menacées (1973). Ces textes
ont centralisé le pouvoir d'initiative et de réglementation.
Les mêmes raisonnements s'appliquent désormais à
l'échelon supranational.
La mobilité croissante des facteurs de production entre pays fait
craindre que la capacité d'action des Etats en matière
environnementale ne soit considérablement réduite. Dès
1988, les économistes Baumol et Oates
24
(
*
)
ont proposé une modélisation des
conséquences de la libéralisation des échanges entre deux
pays qui appliquent des normes environnementales différentes ; les
principaux résultats du modèle sont résumés dans
l'encadré suivant.
LES EFFETS DU LIBRE ÉCHANGE SUR
L'ENVIRONNEMENT
D'APRÈS LE MODÈLE DE BAUMOL ET OATES (1988)
Hypothèses du modèle : deux pays, un pays
développé et un pays en développement, sont producteurs
d'un même bien ; deux techniques de production de ce bien sont
disponibles : l'une est respectueuse de l'environnement, tandis que
l'autre est plus polluante ; le pays pauvre utilise le
procédé de production polluant, alors que le pays riche a recours
au procédé « propre » qui est aussi plus cher.
Résultats du modèle : l'instauration d'un régime de
libre-échange entre les deux pays conduit aux résultats
suivants :
(1)
l'utilisation du procédé de production polluant dans
le pays pauvre a pour effet de diminuer le prix du bien au niveau mondial, et
donc d'augmenter la demande pour ce bien ;
(2)
l'utilisation du procédé polluant assure au pays
pauvre un niveau de production nationale plus élevé ;
(3)
en conséquence de l'augmentation de la demande pour le bien
et de la part croissance de sa production dans le pays pauvre, les
émissions polluantes augmentent ;
(4)
à long terme, s'il continue d'utiliser le
procédé polluant, le pays pauvre va consolider son avantage
comparatif dans la production du bien considéré, et le pays riche
se spécialisera dans d'autres productions.
La démonstration de Baumol et Oates suggère que l'application de
normes environnementales dans les pays développés transformerait
les pays en développement en lieux d'accueil des activités
polluantes. Les pays en développement deviendraient ainsi, selon ce
modèle, des « havres de pollution » (traduction de
l'anglais «
pollution havens
»). Les politiques
environnementales nationales perdraient de leur portée, du fait des
délocalisations d'activité. L'effet du libre échange sur
la pollution serait géographiquement différencié :
les émissions polluantes se réduiraient au Nord, mais
augmenteraient au Sud. L'effet global serait cependant négatif pour
l'environnement, du fait de l'abandon des technologies propres, et de
l'augmentation de la demande pour les produits à bas coûts
fabriqués dans les pays du Sud.
Naturellement, les Etats développés victimes des
délocalisations seraient découragés de renforcer leurs
normes environnementales (« paralysie
réglementaire »), voire pourraient s'engager dans une
« course au moins-disant » environnemental (
race to the
bottom
) pour retrouver un avantage comparatif dans certaines productions
industrielles.
Dans l'un et dans l'autre cas toutefois (formation de « havres de
pollution », ou « course au moins-disant »
environnemental), l'environnement mondial pâtirait de la
libéralisation des échanges.
B. LES DONNÉES EMPIRIQUES DISPONIBLES CONDUISENT À RELATIVISER L'AMPLEUR DU PHÉNOMÈNE
Des études de cas révèlent que des délocalisations se sont bien produites dans certains pays et dans certains secteurs d'activité pour des raisons environnementales. Mais les cas relevés ne semblent pas être suffisamment nombreux pour qu'on estime que la dimension environnementale a un impact notable sur la structure des flux d'investissement et des flux commerciaux mondiaux.
1. Des exemples de délocalisation ou de recul des normes environnementales sont bien observés dans certains secteurs et dans certains pays du Sud
Des
études ont mis en évidence des phénomènes de
délocalisation pour des industries particulièrement polluantes,
qui supportent de ce fait des coûts de mise aux normes
particulièrement élevés.
Pour l'Europe, l'OCDE relève le cas du secteur de la tannerie, qui est
la source de rejets très polluants pour l'environnement. Cette
activité est aujourd'hui largement délocalisée dans les
pays du Sud.
D'autres travaux se sont intéressés au cas des
délocalisations des Etats-Unis vers les
maquiladoras
situées au nord du Mexique. Il semble que la disparité des
réglementations environnementales entre les Etats-Unis et le Mexique ait
bien favorisé certaines délocalisations. Mabey et Mc
Nally
25
(
*
)
estiment par
exemple que l'absence de réglementation relative à la
qualité de l'air a fortement encouragé la production de solvants
au Mexique. Léonard
26
(
*
)
a montré que la production de produits
chimiques dangereux, interdits ou fortement réglementés aux
Etats-Unis, tels les pesticides, s'était fortement accrue au Mexique. Le
même auteur indique que les travailleurs mexicains sont exposés
à certaines substances chimiques nocives, telles les fibres d'amiante,
auxquelles les travailleurs américains ne sont plus exposés.
L'OCDE s'est également penchée sur le cas du secteur minier.
L'exploitation minière peut entraîner de graves dommages pour
l'environnement, et les différences de législation entre pays
développés et pays en développement sont
considérables. Les entreprises minières, lorsqu'elles ont le
choix entre plusieurs localisations, tiennent compte de multiples
éléments, parmi lesquels la réglementation
environnementale peut jouer un rôle. Il apparaît que la
réduction des normes environnementales a pu être un instrument
utilisé par les pays en développement pour attirer les
investissements étrangers. Dans une étude de 1999, Jha
et
alii
27
(
*
)
notaient
qu'au Zimbabwe, le
Mines and Minerals Act
jouissait d'une force
juridique supérieure à celle des autres lois, y compris les
textes environnementaux, ce qui avait pour effet d'exempter le secteur minier
du respect des normes environnementales de droit commun. Ils observaient aussi
qu'en Indonésie ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'exploitation
minière n'était soumise à quasiment aucune
réglementation. L'exploitation minière en Indonésie
opérait sous le régime de contrats de concession, qui exemptaient
généralement les entreprises du respect des normes
environnementales existantes.
Ces études de cas montrent que les phénomènes de
« havre de pollution » ou de « course au
moins-disant » environnemental peuvent effectivement se produire.
Mais il reste à s'interroger sur leur signification au niveau
macroéconomique. Or il ne semble pas que les pays en
développement se spécialisent particulièrement dans les
activités polluantes.
2. Les données macroéconomiques ne traduisent pas une spécialisation des pays en développement dans les activités polluantes
En
dépit des exemples susmentionnés, on n'assiste pas à un
mouvement général de délocalisation des industries
polluantes vers les pays du Sud.
Une étude de la Banque mondiale de 1998
28
(
*
)
a examiné les exportations et les importations
de produits à forte intensité de pollution pour différents
groupes de pays. Il ressort de cette étude que
les pays à haut
revenu exportent davantage de produits à forte intensité de
pollution qu'ils n'en importent
(le ratio exportations/importations est
supérieur à 1), alors que la situation inverse prévaut
pour les pays en développement. Comme le montre le diagramme suivant,
cette tendance s'est plutôt accentuée entre 1986 et 1995 (sauf
pour les pays à bas revenu) : le ratio exportations/importations de
produits à forte intensité de pollution a augmenté dans
les pays à haut revenu, mais a décliné dans les pays
à revenu intermédiaire. Les pays développés
semblent donc avoir conservé un avantage comparatif dans la production
de produits polluants, malgré le renforcement de leurs normes
environnementales.
Ratio exportations/importations de produits à forte intensité de pollution
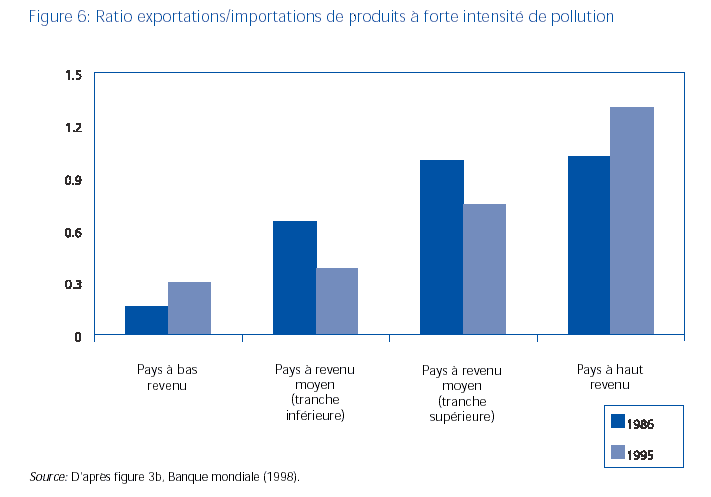
Cette
conclusion est partagée par P. Sorsa
29
(
*
)
, qui estime que la part des pays
développés dans les exportations de produits dont la fabrication
est polluante est restée stable entre 1970 et 1990 (81,1 % en 1990
contre 81,3 % en 1970). Des éléments d'explication de ces
résultats seront apportés dans la section suivante.
Les observations faites sur les chiffres du commerce international sont
corroborées par des études portant sur les flux d'investissement.
Repetto
30
(
*
)
a
analysé les investissements des Etats-Unis à l'étranger en
1992. Il a constaté que la part des pays en développement et en
transition dans ces flux était de 45 %, mais que leur part des
investissements dans des industries polluantes (pétrole et gaz, produits
chimiques et connexes, métallurgie) était bien
inférieure : seuls 5 % des investissements reçus par
les pays en développement concernaient ces secteurs, contre 24 %
des investissements destinés aux pays développés. Il
semble donc que
les pays développés exportent leurs industries
polluantes principalement vers d'autres pays développés.
Ce résultat a été confirmé en 1998 par J.
Albrecht
31
(
*
)
, qui a
examiné les IDE entrant et sortant des Etats-Unis. Il montre que la
croissance des IDE sortant est plus forte pour les industries
« propres » que pour les industries polluantes. Il obtient
le résultat inverse pour les IDE entrant aux Etats-Unis. En d'autres
termes, les Etats-Unis semblent « importer » davantage
d'industries polluantes qu'ils n'en exportent.
De même, Eskeland et Harrison
32
(
*
)
ont examiné si l'investissement
étranger direct dans les pays en développement était
concentré sur des industries polluantes, analysant la situation du
Mexique, du Venezuela, de la Côte-d'Ivoire et du Maroc durant les
années 1980. Les deux premiers de ces pays recoivent l'essentiel de
leurs investissements étrangers des Etats-Unis, et les deux autres de la
France. Ils n'ont trouvé aucun élément tendant à
montrer que ces investissements privilégiaient les secteurs polluants.
Ils ont vérifié leurs conclusions en estimant l'effet du
coût de la réduction de la pollution sur les investissements
directs des Etats-Unis à l'étranger de façon
générale et ont constaté que les entreprises
américaines, qui devaient engager les frais de lutte antipollution les
plus élevés aux Etats-Unis, n'investissaient pas plus à
l'étranger que la moyenne.
3. L'approfondissement de la mondialisation au cours des dernières décennies a été concomitant à un renforcement des normes environnementales dans les pays développés
Peut-on
expliquer le maintien d'un certain avantage comparatif des pays du Nord dans
les activités polluantes par un abandon de leurs exigences
environnementales ?
L'hypothèse d'une « course au moins-disant »
environnemental, destinée à prévenir les
délocalisations vers les pays du Sud, ne s'est jusqu'ici guère
vérifiée.
On peut certes trouver des exemples de recul des normes environnementales, mais
ceux-ci demeurent anecdotiques. Esty et Gerardin
33
(
*
)
citent le cas de la province
de l'Ontario au Canada qui a assoupli certains règlements
environnementaux ces dernières années pour répondre aux
intérêts commerciaux du secteur forestier, des industries
extractives, de la construction résidentielle et du secteur
agroalimentaire. Ils signalent aussi des modifications des lois allemandes sur
la protection de l'environnement intervenues dans les années 1990, qui
donneraient clairement la priorité à l'économie sur la
protection de l'environnement.
Certainement ces exemples montrent qu'il y a bien des cas de relâchement
de la réglementation environnementale motivés par des
considérations économiques. Mais on peut douter que le monde
développé soit entré dans une phase de
démantèlement progressif de ses normes environnementales.
Historiquement, les législations environnementales se sont
constituées depuis les années 1970, c'est-à-dire dans un
contexte d'internationalisation déjà avancée des
économies occidentales.
L'approfondissement de l'intégration
économique et le renforcement des normes environnementales ont donc
évolué en parallèle.
Si les cas de recul des normes environnementales sont rares, les exemples de
« paralysie réglementaire » semblent plus nombreux
et plus significatifs.
Par « paralysie réglementaire », il faut entendre le
refus des pouvoirs publics d'édicter des normes plus contraignantes, de
crainte de nuire à la compétitivité nationale.
Ainsi en 1992, la Commission européenne a présenté une
proposition de taxation du dioxyde de carbone. Cette proposition était
subordonnée à l'adoption de taxes similaires par les principaux
partenaires commerciaux de l'Union européenne. Toutefois, les
initiatives prises à cet effet, aux Etats-Unis, en Australie, ou au
Japon, ont été combattues, avec succès, par les
représentants des industriels qui ont soutenu que cette mesure nuirait
à leur compétitivité par rapport aux pays ne prenant pas
part à l'initiative (pays émergents notamment). En
définitive, la proposition a été retirée.
Autre exemple, en 1995, l'industrie britannique des peintures a obtenu
l'abandon d'une loi qui l'aurait forcée à réduire ses
émissions de composés organiques volatils, cause majeure du
smog
urbain et de problèmes respiratoires. Là encore,
l'argument était que cette loi pénaliserait l'industrie par
rapport à la concurrence internationale.
L'actualité récente offre un exemple supplémentaire des
craintes suscitées dans le secteur chimique par les propositions de
réglementation environnementale. En mai 2003, la Commission
européenne a déposé un premier projet visant à
réglementer l'industrie chimique ; l'objectif de la réforme
est de mettre en place un système complet d'enregistrement,
d'évaluation et d'autorisation pour les substances chimiques, avec
obligation pour les industriels de démontrer que leurs produits sont
sûrs pour la santé humaine et pour l'environnement. Suite aux
vives critiques des industriels allemands, français et britanniques, qui
ont évoqué des surcoûts excessifs pour leur
activité, et le risque de nombreuses suppressions d'emplois, le projet
de la Commission a été profondément remanié. La
Commission a également dû faire face à un lobbying intense
des Etats-Unis, qui craignaient pour leurs exportations vers l'Union
européenne. Un nouveau projet, présenté à la fin de
l'année 2003, a un champ d'application et des objectifs plus restreints.
La Commission estime que son coût pour l'industrie chimique
européenne serait de 2,8 à 5,2 milliards d'euros sur onze
ans, ce qui représente, annuellement, mois de 0,1 % du chiffre
d'affaires du secteur.
Qu'elles soient justifiées ou non,
les craintes de
délocalisation ont remis en question certains projets dans le domaine
environnemental ces dernières années, ce qui plaide pour un
effort accru de coopération internationale en vue de la
définition de normes communes.
Néanmoins, le tableau d'ensemble qui se dégage de cet
aperçu des données empiriques conduit à penser que les
grandes entreprises n'ont pas exploité de manière
systématique les différences de réglementation
environnementales pour se relocaliser, alors même que les normes
environnementales dans les pays développés se sont, sauf
exceptions, renforcées ou sont restées stables dans la
dernière période. Cet apparent paradoxe peut s'expliquer de la
manière suivante : le niveau des normes environnementales demeure,
pour la plupart des entreprises, un déterminant relativement secondaire
de leurs choix d'implantation ; de plus, d'autres facteurs s'opposent
à ce que les entreprises délocalisent aisément leurs
activités pour profiter de règles environnementales plus
laxistes.
C. LES DIFFÉRENCES DE RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE NE SONT GÉNÉRALEMENT PAS UN FACTEUR DÉTERMINANT DES CHOIX D'IMPLANTATION DES ENTREPRISES
Les coûts de mise en oeuvre des normes environnementales apparaissent, le plus souvent, comme un déterminant assez secondaire des choix d'implantation des entreprises.
1. Les coûts de mise en oeuvre des normes environnementales semblent relativement modestes
Les
données chiffrées relatives aux coûts de mise en oeuvre des
normes environnementales sont peu nombreuses et, de surcroît,
relativement anciennes. Elles doivent donc être
interprétées avec prudence, et comme rendant compte d'un ordre de
grandeur, plutôt que d'évaluations précises.
Seuls les Etats-Unis ont publié, jusqu'au milieu des années 1990,
des données relatives au coût du respect des normes
environnementales, sur la base d'une enquête annuelle auprès des
entreprises. Les derniers chiffres publiés portent sur l'année
1993. Il est difficile de proposer, à partir de ces chiffres, une
extrapolation des coûts aujourd'hui subis par l'industrie
américaine, mais il peut être utile de les rappeler pour se faire
une idée des coûts supportés à l'époque par
les différentes branches de l'économie américaine.
Comme le montre le tableau suivant, les entreprises américaines
consacraient, en moyenne, 0,6 % environ de leur chiffre d'affaires aux
mesures antipollution. Cette proportion montait jusqu'à 1,5 ou 2 %
pour les industries les plus polluantes - pétrole et charbonnage,
produits chimiques, métallurgie, et papier et produits connexes.
Coût d'exploitation des équipements
antipollution
selon la branche de production aux Etats-Unis (1993)
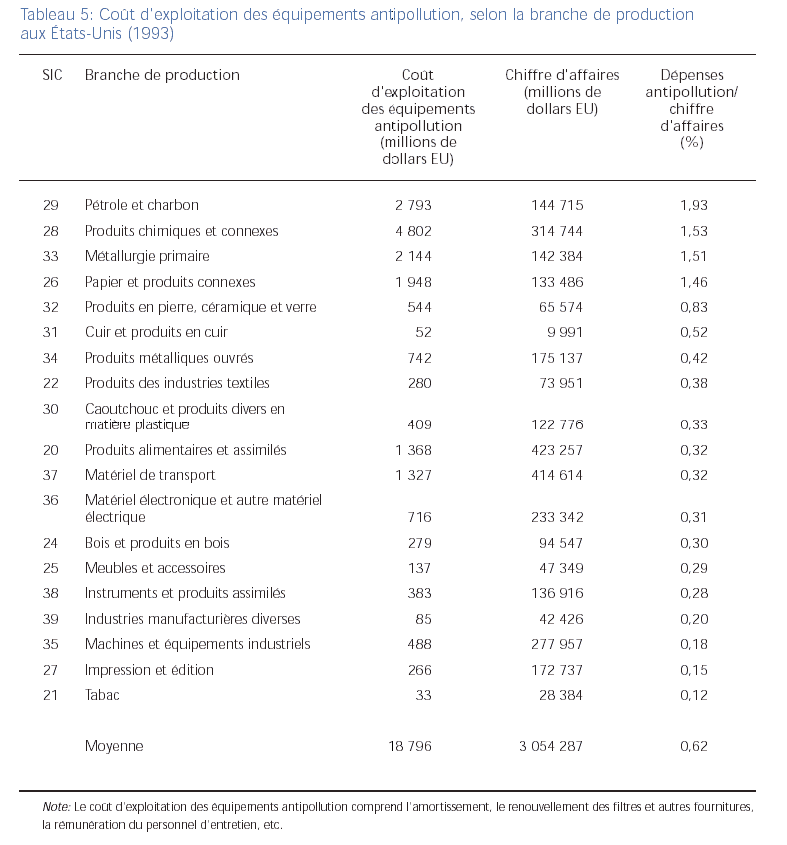
Source : Census Bureau (1996)
Une étude de l'OCDE, réalisée en 1997 et portant sur le
secteur de la sidérurgie
34
(
*
)
, a abouti à un éventail plus large,
puisque le coût direct de la protection de l'environnement est
estimé « entre 1 et 5 % du prix de
revient »
35
(
*
)
.
Ces données éparses suggèrent que, pour la majorité
des entreprises, le coût du respect des normes antipollution est assez
faible. Toutefois, pour des entreprises fortement exposées à la
concurrence internationale et produisant des biens standardisés, un
surcoût de 1 à 5 % peut n'être pas négligeable.
Cependant, si l'on retient l'argument énoncé par
l'économiste Michael Porter, le surcoût réellement
supporté par l'entreprise n'est peut-être pas si
élevé qu'il y paraît à première vue : pour
cet auteur, la pression due à la réglementation, comme toute
autre pression concurrentielle, encourage des innovations qui permettent de
mettre au point de nouveaux procédés de fabrication, ou de
nouveaux produits présentant un intérêt commercial, qui
viennent minorer les surcoûts supportés par les entreprises.
Un autre indice, qui laisse penser que les coûts de lutte antipollution
sont peu significatifs pour les entreprises, résulte de la comparaison
entre les performances financières des entreprises les plus en pointe
sur les questions environnementales, et les autres. En 1997, Cohen et
Fenn
36
(
*
)
se sont
penchés sur la rentabilité des 500 entreprises de l'indice
Standard and Poors
en fonction de la qualité de leurs
performances environnementales. Ils comparent les résultats de deux
portefeuilles, un portefeuille « vert », qui ne comporte
que les entreprises les moins polluantes de chaque branche de production
(celles dont les résultats environnementaux sont meilleurs que la
médiane de la branche) et un portefeuille « brun »
rassemblant les entreprises plus polluantes. Pour s'assurer que les
résultats ne sont pas trop biaisés par le choix des mesures de
comportement environnemental et de résultats financiers, ils font au
total 54 comparaisons de portefeuilles fondées sur différentes
combinaisons de neuf indices de comportement environnemental, trois indices de
résultats financiers et trois périodes. Dans 80 % des cas,
le portefeuille « vert » donnait de meilleurs
résultats que le portefeuille « brun », mais les
différences n'étaient statistiquement significatives que dans
20 % des cas. Un comportement plus écologique ne se traduit donc
pas par une baisse automatique de rentabilité. Ce résultat peut
être interprété comme une confirmation de
« l'hypothèse de Porter ». Il est vraisemblable
aussi que les entreprises qui ont les meilleurs résultats
environnementaux soient aussi les plus avancées sur le plan
technologique, organisationnel, en matière de gestion des ressources
humaines..., et que la performance environnementale ne soit qu'un aspect de la
performance globale de l'entreprise.
2. Les facteurs classiques de l'avantage comparatif dominent les considérations relatives aux normes environnementales
Comme on
l'a vu dans la première partie de ce rapport, l'explication classique de
l'avantage comparatif met l'accent sur deux facteurs de production : le
capital et le travail. Toutes choses égales par ailleurs, les pays dans
lesquels le ratio capital/main-d'oeuvre dépasse la moyenne mondiale ont
un avantage comparatif pour les industries capitalistiques, et inversement.
Les pays développés disposant de plus de capitaux que les pays en
développement jouissent d'un avantage comparatif pour les
activités capitalistiques, tandis que les pays en développement
sont avantagés pour les industries de main-d'oeuvre. Or, si l'on reprend
les données américaines relatives aux industries qui supportent
les coût de lutte antipollution les plus élevés (qui sont
aussi vraisemblablement les industries intrinsèquement les plus
polluantes) on observe qu'elles comprennent des industries comme celles des
métaux non-ferreux, de la chimie, du raffinage du pétrole, ou du
papier, qui font partie des secteurs les plus capitalistiques de
l'économie
37
(
*
)
.
Selon la théorie classique du commerce international,
ces secteurs
très capitalistiques auront donc tendance à se concentrer dans
les pays développés où le capital est abondant. Les
disparités de normes environnementales jouent certes en défaveur
des pays développés, mais il est douteux qu'un écart de
quelques points de pourcentage en termes de coût suffise à
renverser
l'avantage comparatif au profit des pays en
développement.
Cette intuition est confirmée par une étude de Tobey
38
(
*
)
: examinant si les
écarts de normes environnementales ont une influence notable sur la
structure du commerce international, il arrive à la conclusion que cette
structure reste déterminée par les facteurs classiques de
l'avantage comparatif (capital, main-d'oeuvre, et dotation en ressources
naturelles).
Ces raisonnements expliquent que des pays comme l'Allemagne ou les Etats-Unis
aient conservé un avantage comparatif dans le secteur chimique, par
exemple, secteur polluant et très réglementé, alors qu'ils
l'ont depuis longtemps perdu pour l'industrie textile, secteur moins polluant,
mais intensif en facteur travail.
L'idée selon laquelle les normes environnementales sont un
élément relativement secondaire dans les choix de localisation
des entreprises est confirmée par des enquêtes effectuées
auprès des chefs d'entreprises. Les principaux déterminants
cités pour les choix de localisation sont : le coût du
travail ; la fiscalité ; la qualité des
infrastructures ; la présence de ressources naturelles ; la
taille du marché intérieur du pays d'accueil, etc
39
(
*
)
. Les normes environnementales
ne sont que rarement citées.
Du point de vue des Etats, et des mesures qu'ils sont susceptibles de mettre en
oeuvre pour attirer des investissements étrangers, le recul des normes
environnementales n'est certainement pas l'instrument le plus pratique et le
plus efficace à mobiliser. Des mesures classiques de subventions ou
d'allégements d'impôts sont de nature à envoyer un signal
beaucoup plus lisible aux investisseurs étrangers, tout en suscitant
moins de réticences chez les consommateurs résidant dans les pays
développés.
Les firmes multinationales sont en effet soumises à des pressions
informelles croissantes de la part des consommateurs et des ONG.
3. Des facteurs techniques ou de réputation peuvent dissuader les entreprises ou les Etats d'exploiter les écarts de normes environnementales
Les
firmes multinationales ont souvent tendance à uniformiser leurs
procédés de production à l'échelle mondiale et
à exporter ainsi dans les pays en développement des technologies
modernes plus respectueuses de l'environnement.
Il est souvent rationnel pour une entreprise d'employer les mêmes
procédés au Sud et dans son pays d'origine : la production
sera de qualité identique ; l'entreprise n'aura pas à
supporter de coûts de développement supplémentaires ;
l'entreprise disposera d'un avantage technologique lui permettant de s'imposer
face aux producteurs locaux ; enfin, elle se mettra à l'abri
d'éventuelles critiques de la part des consommateurs et des ONG.
De ce fait, l'investissement étranger apporte souvent aux pays du Sud
des technologies plus modernes et respectueuses de l'environnement que celles
dont ils disposaient initialement. Des études ont mis en évidence
ce phénomène en Chine
40
(
*
)
, ou dans différents pays du Sud dans le
secteur de l'extraction minière
41
(
*
)
. Cet effet technologique est positif pour
l'environnement local, surtout s'il s'accompagne de transferts durables de
savoir-faire.
Au niveau étatique, l'ouverture internationale peut également
avoir pour effet d'inciter les gouvernements à relever leurs normes
environnementales pour avoir accès aux marchés des pays
développés. Vogel
42
(
*
)
fait ainsi remarquer que le Japon s'est aligné
sur les standards environnementaux développés aux Etats-Unis pour
l'industrie automobile dans les années 1970 pour préserver son
accès à ce marché. Et Lee
43
(
*
)
souligne que la Corée a relevé ses
normes d'émissions polluantes automobiles pour les placer au même
niveau que celles en vigueur au Japon, aux Etats-Unis ou dans l'Union
européenne. L'intégration économique peut donc conduire
parfois, non au « moins-disant réglementaire », mais
à l'exportation des normes les plus élevées.
Par ailleurs, les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux conditions
de fabrication des produits qu'ils achètent, que ce soit sur le plan
social ou environnemental. Ils exercent ainsi une « pression
informelle » sur les entreprises, qui peut dissuader celles-ci de
tirer parti des différences de normes environnementales. Les
médias et les ONG jouent bien sûr un rôle essentiel pour
faire parvenir l'information aux citoyens.
L'OCDE
44
(
*
)
cite l'exemple
de la campagne d'opinion menée avec succès par le collectif
Rainforest Action Network
contre la société
américaine
Home Depot
, spécialisée dans la vente de
meubles et de matériaux de construction. Après deux années
de campagne, la société a pris, en 1999, l'engagement de ne plus
vendre de produits fabriqués à partir de bois issu des
forêts primaires.
Un nombre croissant d'entreprises adoptent également, de manière
volontaire, les normes de gestion environnementale (ISO 14000) publiées
par l'Organisation internationale de normalisation. Ces normes donnent aux
entreprises un cadre commun pour apprécier et gérer l'impact
environnemental de leurs produits et procédés. L'adhésion
à ces normes est devenue bien souvent un véritable argument
commercial pour les entreprises.
*
* *
L'analyse qui précède a montré que les Etats
conservaient des marges de manoeuvre en matière de politique
environnementale. La mobilité des entreprises s'est certes accrue sous
l'effet de la mondialisation, mais les écarts de normes
environnementales ne semblent pas jouer un rôle décisif dans les
choix de localisation des sites de production. Ce constat n'implique cependant
pas qu'il en aille forcément toujours de même :
au-delà d'un certain seuil, les surcoût occasionnés par les
normes environnementales pourraient devenir suffisants pour motiver des
délocalisations massives.
Malheureusement, comme on l'a vu, les données chiffrées relatives
au coût des normes environnementales sont peu nombreuses et anciennes.
Dans ces conditions, il est bien difficile d'évaluer l'impact qu'aurait
le renforcement de telle ou telle norme en France ou en Europe.
Une
amélioration de notre appareil statistique sur ce point apparaît
donc hautement souhaitable.
La solution optimale résiderait toutefois dans un effort d'harmonisation
internationale des normes environnementales. Des standards minimaux pourraient,
dans un premier temps, être définis.
Avant d'envisager les conséquences de ces réflexions en termes de
gouvernance internationale, il importe de s'interroger sur la question du lien
entre commerce international, croissance et environnement.
II. LA CROISSANCE FAIT ELLE PARTIE DU PROBLÈME OU DE LA SOLUTION ?
Rappelons que l'analyse de Grossman et Krueger établit la
relation suivante entre commerce international, croissance et
environnement :
- d'une part, le commerce international stimulerait la croissance et cette
augmentation de la production serait nuisible à l'environnement (effet
d'échelle) ;
- d'autre part, l'enrichissement résultant de la croissance conduirait
à une aspiration à un environnement de meilleure qualité
de la part des populations (effet technique).
Cette analyse repose sur un postulat controversé : la
libéralisation des échanges stimule la croissance. Elle conduit
ensuite à s'interroger sur le point de savoir lequel de ces deux effets
- l'effet d'échelle ou l'effet technique - l'emporte, et si le bilan net
de la croissance sur l'environnement est ainsi positif ou
négatif.
A. PREMIER MAILLON DU RAISONNEMENT : LA LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES STIMULE LA CROISSANCE
De
nombreux éléments permettent de penser que la
libéralisation des échanges a un effet positif sur la croissance
du PIB, sans qu'il soit toutefois possible de clore totalement le débat
sur ce point.
Sur le plan théorique, l'argumentation en faveur du libre-échange
repose sur des analyses de type ricardien, déjà exposées
dans la première partie de ce rapport. Rappelons simplement ici que la
théorie ricardienne sous-tend la plupart des modélisations du
commerce international, celles utilisées par P. Messerlin pour
évaluer les conséquences d'une réduction des
barrières aux échanges en Europe, comme celles utilisées
pour évaluer les effets d'un nouveau cycle de négociations
multilatérales. Fort logiquement, ces modélisations concluent
à un impact positif de la libéralisation sur la croissance ;
ces résultats ne valent cependant pas démonstration, puisque ces
modèles sont, dès le départ, construits sur la base
d'hypothèses qui conduisent inéluctablement à ces
résultats.
Il est donc nécessaire de se tourner vers les études empiriques
pour établir l'existence d'un lien entre ouverture aux échanges
et croissance. La recension effectuée par l'OMC dans son Rapport annuel
de 1998 indique que la plupart de ces études concluent à une
corrélation positive entre degré d'ouverture et croissance du
PIB
. Lorsqu'elles aboutissent à une corrélation
négative, celle-ci est généralement non significative sur
le plan statistique.
Un tableau en annexe présente de manière synthétique les
résultats des principales études portant sur le sujet (annexe 1).
L'accumulation de données empiriques n'a cependant pas mis fin au
débat, comme l'a démontré en 2002 la réplique de
Rodrick et Rodriguez à l'étude de Sachs et Warner.
En 1995
45
(
*
)
, J. Sachs et
A. Warner ont analysé la corrélation entre croissance et
ouverture, sur la base d'un indice d'ouverture reposant sur plusieurs
critères : importance des obstacles non tarifaires, taux moyens de
droits de douane, écart entre le taux de change officiel et le taux de
change du marché noir, et importance des entreprises commerciales
d'Etat. Ils montrent que tous les pays ouverts ont connu, sur la période
1970-1995, une croissance supérieure à celle des pays
fermés. Dans la catégorie des pays émergents,
l'écart est même spectaculaire : les pays ouverts ont ainsi
connu une croissance de 4,5 % l'an, contre seulement 0,7 % en moyenne
pour les pays fermés. Parmi les pays industrialisés,
l'écart est plus réduit : 2,5 % l'an, contre
0,7 %. Ces chiffres suggèrent que l'ouverture non seulement
accélère la croissance, mais favorise aussi la convergence entre
pays riches et pauvres : les pays émergents ouverts ont une
croissance supérieure à celle des pays industrialisés,
signe qu'un rattrapage se produit ; en revanche, il n'y a pas
d'écart entre taux de croissance dans la catégorie des pays
fermés.
En 2002
46
(
*
)
, D. Rodrick
et J. Rodriguez ont contesté les conclusions de Sachs et Warner. Ils
mettent en doute le lien de causalité suggéré entre
ouverture et croissance. Ils soulignent que l'ouverture aux échanges
n'est qu'un aspect d'une organisation économique d'ensemble. Les pays
qui font le choix de l'ouverture sont généralement ceux qui sont
les mieux organisés sur le plan interne : stabilité
politique et macroéconomique, Etat de droit, bonne administration... Ce
serait la qualité de cette organisation interne qui serait la source de
la croissance des pays ouverts, et non l'ouverture
per se
. Le choix de
l'ouverture s'imposerait naturellement à des pays qui se savent en
situation d'en tirer parti. La libéralisation des échanges serait
davantage une conséquence de la prospérité qu'une de ses
causes.
La critique de Rodrick et Rodriguez révèle une difficulté
propre aux sciences sociales : on ne peut isoler totalement une variable
pour en analyser les effets de manière autonome. Il est
indéniable que l'ouverture commerciale est rarement un fait
isolé, et qu'elle est presque toujours conjointe à des facteurs
internes de croissance, ce qui rend problématique la
détermination des liens de causalité.
On peut toutefois faire valoir que l'argument peut être
renversé : l'ouverture internationale peut fournir de puissantes
incitations à la réforme interne. Les réformes mises en
oeuvre par les pays d'Europe centrale et orientale, pour préparer leur
adhésion à l'Union européenne, ou par la Chine, en vue de
son adhésion à l'OMC, en attestent.
L'intensification de la concurrence internationale conduit également les
agents privés à s'adapter, en recherchant les gains de
productivité, ou en investissant davantage dans la recherche et
développement, par exemple.
De plus, l'insertion dans l'économie internationale permet d'avoir
accès plus facilement aux éléments matériels
(technologies), ou intellectuels (méthodes de management, règles
juridiques...), qui sont indispensables à l'efficacité
économique sur le plan interne. Comme l'indiquait Rudiger Dornbusch dans
son commentaire de l'article de Sachs et Warner, « l
e commerce des
marchandises n'est peut-être que la moindre des choses dont
bénéficie une société ouverte. L'échange
direct des idées, des méthodes, l'émulation d'une
réussite ailleurs peuvent jouer un rôle tout aussi
capital
».
Et, comme l'a rappelé M. Patrick Messerlin au cours de son audition,
«
il n'y a pas, dans l'histoire, d'exemple de pays protectionniste
ayant connu le succès économique sur la longue
durée
». A long terme, l'ouverture apparaît donc
comme un ingrédient indispensable de la croissance économique.
Il est vraisemblable qu'existe en fait un cercle vertueux de
libéralisation et de croissance : les périodes de forte
croissance semblent encourager l'ouverture des marchés (probablement
parce que la croissance atténue les problèmes d'ajustement et
réduit la résistance aux changements) et l'ouverture des
marchés elle-même favorise la croissance
47
(
*
)
. L'ouverture commerciale et
financière serait ainsi une politique utile pour accélérer
la croissance dans les pays qui disposent déjà d'une bonne
gouvernance politique et économique interne. Son effet n'est pas neutre.
En revanche, une politique de libéralisation mal conduite (sans
politiques d'accompagnement macroéconomiques ou structurelles
adaptées à la situation concrète du pays) peut conduire
à des échecs, comme l'a illustré la crise asiatique de
1997 (la fragilité des systèmes bancaires nationaux ne leur a pas
permis de faire face aux conséquences de la libéralisation des
flux financiers).
Si l'on admet que l'ouverture stimule la croissance, quel effet la
libéralisation des échanges aura-t-elle, par ce biais, sur
l'environnement ?
B. RELATION ENTRE CROISSANCE ET ENVIRONNEMENT : DISCUSSION DE L'HYPOTHÈSE DE LA COURBE ENVIRONNEMENTALE DE KUZNETS
1. La courbe environnementale de Kuznets
L'expérience des pays développés a
montré que l'enrichissement des populations s'est accompagné de
la demande d'un environnement plus sain, ce qui a conduit à un
renforcement des normes et à une amélioration de la
qualité de l'environnement dans certains domaines (cas de la pollution
de l'air dans les villes, notamment).
Ce constat a conduit à formuler l'hypothèse suivante : la
croissance serait nocive pour l'environnement dans les premiers stades du
développement ; puis, au-delà d'un certain seuil de revenu
par habitant, la croissance entraînerait une amélioration de la
qualité de l'environnement. La relation entre croissance et
dégradation de l'environnement aurait dès lors la forme d'un U
inversé : dans un premier temps, l'augmentation de la production
dégraderait l'environnement (l'effet d'échelle domine, pour
reprendre la terminologie de Grossman et Krueger), puis, au-delà d'un
point d'inflexion, la croissance réduirait les dégradations
environnementales (l'effet technique l'emporte).
LA
COURBE ENVIRONNEMENTALE DE KUZNETS
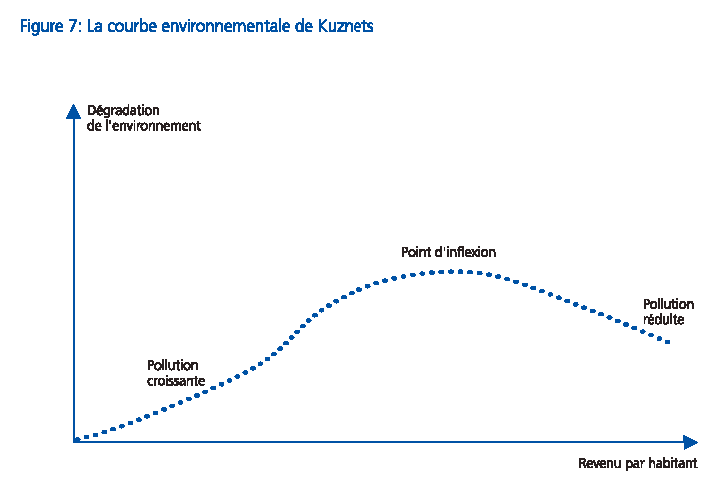
Source : OMC (1999).
Ce schéma a été rapproché de l'hypothèse
formulée par Simon Kuznets en 1955, qui avait envisagé une
corrélation entre la réduction des inégalités de
revenu et le niveau du PIB/habitant, selon une même forme de courbe en U
inversé. Cela explique l'emploi fréquent dans la
littérature économique de l'expression
« courbe
environnementale de Kuznets ».
2. Fondements théoriques
Le
modèle de la courbe environnementale de Kuznets repose sur l'idée
que l'environnement serait un « bien supérieur »,
c'est-à-dire
un bien
dont la demande augmente avec le revenu
(à l'instar de la santé ou des loisirs). Il s'agit là
d'une hypothèse très plausible : à l'évidence,
pour les individus les plus pauvres, la tâche de se nourrir, se loger, se
vêtir, ne laisse guère de place à d'autres
préoccupations. Ce qui est vrai au niveau individuel l'est aussi au
niveau national : toutes les personnalités auditionnées par
votre rapporteur ont confirmé que les pays du Sud étaient, dans
les enceintes internationales, moins sensibles aux questions environnementales
que les pays du Nord.
L'élévation du revenu s'accompagnerait donc d'exigences
« citoyennes » nouvelles. De plus,
la croissance du PIB
permet de dégager plus facilement des ressources pour financer les
politiques environnementales.
Pour les individus comme pour les nations, il
est sans doute plus facile de sacrifier une partie de sa consommation pour
protéger l'environnement lorsque les revenus sont élevés.
Si la dégradation de l'environnement entrave la production, la demande
de politique environnementale n'émanera plus seulement des citoyens,
mais aussi des entreprises. Ce point a été mis en avant par Mme
Laurence Tubiana au cours de son audition : ces dernières
années, les autorités chinoises se sont davantage
préoccupées d'environnement, d'une part parce que la pollution
urbaine menace la santé des habitants, mais aussi parce que la pollution
des eaux côtières empêche l'aquaculture, et parce que la
déforestation menace d'épuisement les ressources en
bois.
3. Données empiriques
Toutefois, les études menées à partir de
données empiriques montrent que
l'hypothèse de la courbe
environnementale de Kuznets n'est vérifiée que pour certains
polluants.
L'étude fondatrice de Grossman et Krueger en 1992 portait sur les
polluants atmosphériques. A partir de données sur la
concentration des polluants dans l'air de quartiers urbains de
différents pays, ils ont constaté que la teneur en SO
2
(dioxyde de soufre) et en particules avait tendance à augmenter
jusqu'à un niveau de revenu par habitant de 4.000 à 5.000
dollars, puis à diminuer progressivement. Cette première
étude est donc venue confirmer l'hypothèse de la courbe
environnementale de Kuznets.
D'autres données statistiques examinées depuis sont venues
nuancer ce premier constat. Shafik et Bandyopadhyay
48
(
*
)
ont étudié dix
indicateurs environnementaux et ont obtenu presque autant de profils de courbe
que d'indicateurs. Les indicateurs liés à l'eau propre et
à l'assainissement urbain s'améliorent uniformément avec
l'accroissement des revenus. En revanche, la production de déchets
urbains et les émissions de CO
2
semblent augmenter
uniformément avec le revenu. Seuls les indicateurs relatifs à la
qualité de l'air prennent la forme attendue d'un U renversé.
De manière générale, l'impression qui se dégage
des statistiques est que l'hypothèse de la courbe environnementale de
Kuznets n'est vérifiée que pour certaines pollutions
localisées, essentiellement urbaines, de l'air et de l'eau. Au
contraire, les pollutions transfrontières, notamment les
émissions de CO
2
, ne semblent pas connaître
d'inflexion.
Si l'on admet que l'effet technique dépend de la demande d'un
environnement plus sain de la part des habitants, il n'est guère
surprenant que les pollutions localisées dans les zones à forte
densité de population diminuent les premières. Jusqu'à une
date récente, les conséquences du changement climatique sont
apparues abstraites aux citoyens, ce qui n'incitait pas à une action
résolue contre les émissions de CO
2
. Il est probable,
et souhaitable, que les signes de plus en plus tangibles du
réchauffement planétaire, y compris la canicule en France
à l'été 2003, conduisent à un changement d'attitude.
La disponibilité et le coût des techniques antipollution sont
aussi un élément important pour expliquer les différences
de résultat. Une comparaison entre la lutte contre les émissions
de gaz CFC, responsables de la disparition de la couche d'ozone, et les
émissions de CO
2
est éclairante sur ce point. Un
accord international a pu être assez facilement obtenu pour
éliminer les gaz CFC (accord de Montréal, 1987), parce que des
produits de substitution étaient disponibles pour un coût modique.
En matière de lutte contre les émissions de CO
2
, les
stratégies à mettre en oeuvre apparaissent plus complexes et plus
coûteuses, d'où de plus grandes réticences à engager
les politiques adéquates.
4. La mise en oeuvre de politiques publique appropriées est la clé de la réduction de la pollution
Il est
important de préciser que l'hypothèse de la courbe
environnementale de Kuznets ne postule pas que l'augmentation du revenu
conduira
automatiquement
à une baisse de la pollution. Ce
résultat est conditionné à la mise en oeuvre de politiques
appropriées par les pouvoirs publics. Il faut donc que ces derniers
répondent aux changements des préférences exprimées
par les citoyens.
L'existence d'institutions démocratiques offre, en principe, la garantie
que les gouvernants suivront les préférences exprimées par
les citoyens. Dans les régimes autoritaires, les gouvernements,
n'étant pas comptables de leurs actes, risquent en revanche de ne pas
conduire les politiques environnementales nécessaires. De graves
dégradations écologiques se sont ainsi produites dans les pays de
l'ancien bloc de l'Est.
Dans certains cas, comme la lutte contre les émissions de
CO
2
, la notion de volontarisme politique retrouve également
tout son sens. En effet, si les citoyens ne sont pas encore sensibles à
un problème environnemental, alors que les données scientifiques
montrent qu'il est urgent d'agir, il appartient aux responsables politiques
d'imposer le sujet dans le débat public, et de défendre les
mesures nécessaires. Si le bien environnemental menacé
présente les caractéristiques d'un bien public mondial, une
action internationale coordonnée est en outre requise.
*
* *
Cette
seconde partie a montré qu'il n'y avait pas d'opposition
irréductible entre mondialisation et qualité de l'environnement.
Le phénomène de « dumping environnemental »
semble plus limité qu'il n'est parfois allégué, et il est
possible que la spécialisation internationale joue plutôt en
faveur de la lutte contre la pollution.
Par ailleurs, à long terme, seule l'élévation des niveaux
de vie, que favorise la mondialisation, permettra de dégager les
ressources suffisantes pour la protection de l'environnement, et permettra de
faire de cet objectif une priorité de nos politiques publiques.
Mais le bilan de la mondialisation en matière d'environnement
dépend,
in fine
, beaucoup de la mise en oeuvre de bonnes
politiques environnementales, au niveau national, pour les dégradations
localisées, et au niveau multilatéral, pour les problèmes
environnementaux globaux. Le manque d'action concertée donne prise aux
craintes de délocalisations industrielles, et décourage les
initiatives nationales ; c'est pourquoi l'amélioration de la
gouvernance mondiale environnementale est un enjeu central pour le
siècle qui s'ouvre. Ce thème fera l'objet de la troisième
et dernière partie de ce rapport.
TROISIÈME
PARTIE
AMÉLIORER LA GOUVERNANCE MONDIALE
ENVIRONNEMENTALE
La
deuxième partie de ce rapport a suggéré que l'impact de la
mondialisation sur l'environnement dépendait beaucoup de la mise en
oeuvre de politiques environnementales nationales adaptées et des
actions internationales engagées en la matière. C'est sur ce
second point que votre rapporteur souhaite s'attarder maintenant.
Depuis quelques années en effet, le thème de la gouvernance
mondiale a pris une place importante dans le débat public. La
mondialisation de l'économie appelle la création
d'éléments de régulation intervenant à
l'échelle adéquate. Le terme de
« gouvernance » est un néologisme utile, dans la
mesure où il reflète bien la principale difficulté qui se
présente à la communauté internationale : comment
gouverner la mondialisation en l'absence de gouvernement mondial ?
Divisé en Etats souverains, sans autorité centrale unique, le
monde contemporain n'est cependant pas dénué d'actions communes,
ni de normes collectives. C'est à cet ensemble d'actions et de normes
que renvoie la notion de gouvernance.
La gouvernance mondiale économique est relativement
développée, comme l'atteste l'existence du Fonds monétaire
international, de la Banque mondiale, de la Banque des règlements
internationaux, ou de l'OMC. La gouvernance mondiale environnementale est
demeurée jusqu'ici plus réduite, en dépit de la
création du Programme des Nations-Unies pour l'environnement (PNUE) il y
a une trentaine d'années, et de la multiplication d'accords
environnementaux dont la portée est souvent limitée. C'est
pourquoi votre rapporteur plaide pour un rééquilibrage de la
gouvernance mondiale en faveur de l'environnement. Les propositions faites en
la matière visent à engager le débat et s'inscrivent dans
une perspective de long terme. Leur mise en oeuvre requiert en effet un large
accord international, qui apparaît difficile à obtenir à
court terme.
I. LA GOUVERNANCE INTERNATIONALE DE L'ENVIRONNEMENT AUJOURD'HUI : DES DISPOSITIFS ÉCLATÉS AUX MOYENS RÉDUITS
Il existe deux dimensions de la gouvernance internationale de l'environnement : d'une part, des organisations ou des conventions internationales traitent spécifiquement de questions environnementales ; d'autre part, l'environnement est une préoccupation transversale, qui affecte les actions de diverses organisations internationales, à commencer par l'Organisation mondiale du commerce.
A. L'ACTION INTERNATIONALE EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT : FAIBLESSE ET DISPERSION DES MOYENS
Les deux
piliers de l'action internationale en faveur de l'environnement sont
actuellement :
- le Programme des Nations-Unies pour l'Environnement (PNUE) ;
- et les accords multilatéraux environnementaux (AME).
1. Le Programme des Nations-Unies pour l'Environnement
La
décision de créer le PNUE en 1972 a fait suite à
l'organisation de la Conférence des Nations-Unies sur
« L'Homme et l'Environnement » à Stockholm la
même année. Elle traduit un progrès dans la prise de
conscience de l'importance des enjeux environnementaux. Le PNUE est la plus
haute instance en charge de l'environnement au sein du système des
Nations-Unies.
On peut distinguer trois grandes missions du PNUE :
* surveiller l'état de l'environnement mondial, et en dresser
régulièrement un bilan ; le troisième rapport a
été publié en 20O2. On s'y réfère souvent
sous le titre « GEO 3 » (
Global Environment
Outlook
).
* servir de plate-forme pour discuter des actions et politiques à mettre
en oeuvre pour répondre aux problèmes identifiés, et pour
préparer les conventions et accords internationaux nécessaires.
C'est ainsi que le PNUE a été à l'origine de diverses
conventions internationales relatives à l'environnement ; peuvent
être citées, notamment, la Convention de Vienne et le protocole de
Montréal relatifs à la protection de la couche d'ozone, la
convention de Bâle sur les déchets, la convention sur la
biodiversité, ou encore la convention sur les produits chimiques et
organiques persistants. Le PNUE a été choisi pour assurer le
secrétariat de ces conventions. Le PNUE met aussi en oeuvre des
accords volontaires avec des représentants de grands secteurs de
l'industrie ou des services (banques et assurances,
télécommunications, tourisme...). Le PNUE organise
également des débats relatifs aux secteurs des transports, de la
grande distribution, ou de la publicité, ces deux derniers secteurs
ayant une grande influence sur les modes de consommation des
ménages ;
* enfin, le PNUE remplit des fonctions de formation, d'échange et de
diffusion d'informations et de bonnes pratiques.
Le PNUE est dirigé par un directeur-général, élu
par l'Assemblée générale des Nations-Unies
(actuellement : M. Klaus Töpfer, Allemagne). Tous les deux ans
le Conseil d'administration du PNUE se réunit pour approuver le
programme d'action de l'organisation.
Le Guide de l'environnement et du commerce
, édité
conjointement par le PNUE et l'Institut international du développement
durable, note, à juste titre, que «
le PNUE a
été chargé de catalyser l'action environnementale dans
tout le système des Nations-Unies, tout en se voyant attribuer des
moyens fort modestes pour une tâche de cette ampleur
».
Les moyens humains et financiers du PNUE sont en effet bien
limités : le budget annuel du programme est d'une soixantaine de
millions d'euros, largement consacrés aux frais de fonctionnement, et
notamment au versement des salaires de ses quelque 600 agents. De plus, ses
moyens sont géographiquement dispersés, puisque, outre son
siège à Nairobi, le PNUE dispose d'implantations à Paris,
Genève et Osaka. A Paris siège en particulier la Division du
Commerce, de l'Industrie et de l'Economie.
La modestie de ces moyens explique que le PNUE ne puisse financer sur ses fonds
propres de grands projets de protection de l'environnement, dans les pays du
Sud notamment, et doive se limiter à des tâches d'étude et
d'administration de grands accords internationaux
49
(
*
)
.
Outre la faiblesse de ses moyens, il faut souligner la précarité
des financements du PNUE : Le Programme est, en effet, abondé pour
l'essentiel, par des contributions volontaires des Etats. Cette
précarité des crédits du PNUE est un obstacle à une
programmation des actions à long terme, et conduit à
détourner une partie de l'énergie de ses agents de leur mission
première, pour la consacrer à la recherche de
financements.
2. Les accords multilatéraux environnementaux (AME)
Les AME
(définis ici comme des accords rassemblant plus de deux pays) se sont
multipliés ces vingt dernières années, de sorte qu'on en
compte aujourd'hui plus de 200.
Les AME se sont développés sans coordination, et sans
hiérarchisation, et s'appliquent à des espaces différents.
La plupart d'entre eux ne prévoient
pas de mécanisme de
sanction en cas d'inexécution
, ni ne comportent de véritable
système de surveillance. Une procédure d'arbitrage est parfois
prévue en cas de litiges ; mais le recours à une
procédure d'arbitrage requiert classiquement l'accord des deux parties
en conflit (y compris la partie fautive), et peut donc aisément
être évité. Ces caractéristiques des AME expliquent
que l'application par les Etats de leurs engagements internationaux ne soit pas
toujours irréprochable.
Devant l'impossibilité de présenter la totalité des AME en
vigueur, seuls les AME les plus significatifs seront ici brièvement
exposés. Ces AME comptent un grand nombre d'Etats parties, et abordent
les enjeux environnementaux les plus importants.
LES PRINCIPAUX AME
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de
flore sauvages menacées d'extinction (CITES).
- Premier en date
des principaux AME, la CITES a été élaborée en 1973
et est entrée en vigueur deux ans plus tard. Elle est conçue pour
réguler le commerce des espèces menacées d'extinction,
ainsi que des produits provenant de ces espèces. Elle comporte trois
annexes qui énumèrent les espèces dont la
Conférence des Parties a établi (d'après des avis
scientifiques) qu'elles étaient menacées d'extinction à
divers degrés. Elle institue des mécanismes de contrôle des
échanges qui vont de la prohibition complète à un
système de licences d'exportation. La CITES se caractérise par la
participation très active que prennent les organisations non
gouvernementales -- notamment scientifiques et militantes -- à ses
délibérations. (Elle compte 146 Parties.)
La Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer.
-
Dite
Convention de Montego Bay, elle a été signée en 1982 et
est entrée en vigueur en 1994. Certains de ses articles traitent de la
protection du milieu marin. Ainsi l'article 193 spécifie que
« les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs ressources
naturelles selon leur politique en matière d'environnement et
conformément à leur obligation de protéger le milieu
marin ». Et l'article 207 § 1 prévoit que
« les Etats adoptent des lois et règlements pour
prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu
marin » ; cette obligation doit conduire les Etats à
développer leur administration interne en matière d'environnement
(la Convention compte 145 parties).
Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent
la couche d'ozone.
-- Le Protocole de Montréal réglemente
plusieurs substances chimiques industrielles qui ont pour effet de
dégrader la couche d'ozone stratosphérique. Il interdit la
production et l'utilisation de plusieurs d'entre elles et applique aux autres
une stricte réglementation. Il prévoit la création d'un
fonds destiné à aider les pays en développement à
se libérer progressivement de leur dépendance à
l'égard des substances réglementées. Il réglemente
le commerce des substances qui favorisent la destruction de la couche d'ozone
et des produits contenant des substances réglementées. (La
Convention de Vienne compte 173 Parties, et le Protocole de Montréal
172.)
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination
-- Signée en 1989, la Convention de
Bâle trouve son origine dans la crainte des pays en développement,
notamment ceux d'Afrique, de devenir des lieux de stockage pour les
déchets dangereux qui ne seraient plus éliminés dans les
pays développés. Les organisations non gouvernementales ont
joué un rôle important dans l'élaboration de ce
traité. La Convention de Bâle définit la liste des
déchets dangereux. Elle proscrit l'exportation ou l'importation de
déchets dangereux vers ou en provenance d'un Etat non partie à la
convention. L'exportation de déchets dangereux doit être
autorisée par écrit par l'Etat importateur. La convention
prévoit les cas de réimportation des déchets dangereux,
notamment en cas de trafic illicite (Cette Convention compte 131 Parties et
trois signataires qui ne l'ont pas encore ratifiée.)
Convention de Nairobi sur la diversité biologique (1993).
-- Ouverte à la signature à la Conférence de Rio,
cette Convention a pour objectifs de protéger la diversité
biologique, d'encourager l'utilisation écologiquement viable de ses
éléments et de favoriser la répartition juste et
équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources
génétiques. La Convention sur la diversité biologique n'a
pas été facile à rendre opérationnelle. La
« diversité biologique » est elle-même un
concept élaboré par la recherche scientifique au cours des vingt
dernières années pour nous aider à mieux comprendre le
milieu naturel. La protection d'un tel concept, par opposition à quelque
chose de tangible comme une espèce ou un habitat
déterminé, ne va pas de soi. (La CDB compte 135 Parties et 12
signataires qui ne l'ont pas encore ratifiée.)
Convention-cadre sur les changements climatiques (1992) et Protocole de
Kyoto (1997).
-- Adoptée à la Conférence de Rio en
1992, la Convention-cadre des Nations-Unies sur le changement climatique
(CCNUCC) porte sur la plus complexe des questions environnementales et celle
qui présente les plus fortes incidences économiques. La
principale stratégie utilisée par la CCNUCC consiste à
diriger les investissements futurs vers des activités produisant moins
de gaz à effet de serre. Instrument de mise en oeuvre de la CCNUC, le
Protocole de Kyoto a été adopté en décembre 1997.
Il définit deux catégories de pays -- ceux qui s'engagent
à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre et les
autres -- et créée plusieurs mécanismes à cette
fin. (La CCNUCC compte 180 Parties ; le Protocole n'est pas encore
entré en vigueur.)
Convention de Paris sur la lutte contre la désertification
(1994).
- Entrée en vigueur en 1996, cette convention
prévoit que les parties élaborent des Programmes d'action
nationaux contre la désertification, harmonisés au niveau
régional par des conventions bilatérales ou
multilatérales. La convention insiste sur la nécessité
d'associer à ces programmes les communautés locales et les ONG.
Elle appelle à la mobilisation de ressources nationales ou
internationales, publiques ou privées, pour financer la lutte contre la
désertification (la Convention compte 178 parties).
Convention sur la procédure de consentement préalable en
connaissance de cause applicable dans les cas de certains produits chimiques et
pesticides dangereux qui font l'objet du commerce international (Convention de
Rotterdam).
-- De nombreux produits interdits, ou strictement
réglementés, sur le marché intérieur sont
échangés sur le marché international. On a débattu
pendant des années des procédures les mieux à même
de renseigner sans délai les autorités compétentes du pays
importateur sur la nature de ces produits. C'est ainsi qu'un groupe de travail
du GATT a consacré plusieurs années à négocier de
telles procédures sans parvenir à un résultat consensuel.
Le PNUE (compétent en matière de gestion des substances
potentiellement toxiques) et l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (qui surveille l'utilisation des pesticides)
avaient tout intérêt à élaborer un système
uniforme de notification, garantissant que les renseignements seraient
communiqués rapidement aux autorités compétentes. Il
fallait en outre créer un dispositif qui permettrait aux pays en
développement qui le jugent nécessaire de mettre fin à
l'importation de substances déterminées. Cet objectif a
été atteint grâce à la Convention de Rotterdam (qui
compte 55 parties).
Protocole de Carthagène sur la prévention des risques
biotechnologiques.
-- Ce Protocole à la Convention sur la
diversité biologique s'applique au commerce de la plupart des
catégories d'organismes vivants modifiés et aux risques qu'il
peut présenter pour la biodiversité. Il institue une
procédure de consentement préalable en connaissance de cause pour
les organismes vivants modifiés (OVM) destinés à
être libérés dans l'environnement (tels que les
micro-organismes et les semences). Pour ce qui est des OVM destinés
à l'alimentation humaine ou animale ou à être
transformés, il se contente d'instaurer un dispositif moins contraignant
de traçabilité. Il met aussi en place une procédure
permettant aux États de réglementer les importations d'organismes
vivants modifiés, en spécifiant par exemple les protocoles
d'évaluation des risques à respecter. Dans la mesure où il
autorise de prendre cette décision même en l'absence de risques
connus, le Protocole de Carthagène applique le principe de
précaution plus clairement peut-être que tout autre accord
international à ce jour. Ouvert à la signature en mai 2000, il
entrera en vigueur quand il aura été ratifié par 50 pays
Convention de Stockholm sur les polluants organiques
persistants.
- Ouverte à la signature depuis 2001, mais non
encore en vigueur, cette convention vise à réglementer les
polluants organiques persistants, c'est-à-dire des produits qui
persistent dans l'environnement et peuvent s'accumuler dans les organismes
vivants. La Convention prévoit l'élimination des produits les
plus dangereux, et restreint l'usage des substances jugées moins
nocives.
La portée réelle de ces conventions est variable. La Convention
de Montréal a été un véritable succès
puisqu'elle a permis de réduire considérablement les
émissions de gaz dégradant la couche d'ozone. Par contraste, on
ne peut s'empêcher de relever le caractère largement incantatoire
de certaines dispositions contenues dans la convention de lutte contre la
désertification, par exemple, ou dans la convention de Montego Bay. Il
est vrai que la faiblesse des contraintes imposées aux Etats est souvent
le gage d'une large adhésion au traité. A l'inverse, les
traités qui contiennent des objectifs précis suscitent plus de
réticences de la part des Etats au moment de la ratification, ce qui
explique que le Protocole de Kyoto, entre autres, ne soit pas encore
entré en vigueur.
3. Le Fonds pour l'environnement mondial
Le Fonds
pour l'environnement mondial (FEM) a été créé en
1990, à la suite d'une initiative franco-allemande. Il a pour vocation
de financer le surcoût occasionné dans les pays en
développement par l'application des accords environnementaux intervenus
dans les domaines suivants : diversité biologique, protection des
eaux internationales, changement climatique et protection de la couche
d'ozone
50
(
*
)
. Depuis 2000,
il peut aussi intervenir sur des projets liés à l'application de
la convention sur les polluants organiques persistants.
Le Fonds rassemble aujourd'hui 167 Etats. Son instance
décisionnelle est le Conseil du FEM, composé de 16 pays de
l'OCDE, de 2 pays en transition, et de 14 pays en développement. Le
Conseil s'appuie sur un Secrétariat, basé à Washington,
géré administrativement par la Banque mondiale. Le budget du FEM
est reconstitué tous les quatre ans par les pays donateurs : en
1994, le Fonds avait été doté de deux milliards de
dollars ; son financement est passé à 2,75 milliards de
dollars en 1998, puis à 2,9 milliards de dollars lors de la
dernière reconstitution en 2002. Le budget du Fonds est donc en
progression constante, mais demeure bien modeste compte tenu des enjeux qu'il
entend traiter, et de l'étendue de la zone géographique qu'il
couvre. La France contribue au financement du FEM à hauteur de 7 %
de son budget.
En pratique, le FEM accepte d'accorder son financement à des projets qui
lui sont présentés par trois agences de mise en oeuvre, qui sont
le PNUE, le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), et
la Banque mondiale. Depuis sa création, le FEM a contribué au
financement de plus de 1.000 projets dans 150 pays en voie de
développement ou en transition.
EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS PAR LE FEM
Protection de la biodiversité : préservation du littoral
au Belize.
Des recherches marines continuent à mettre en
évidence de nouvelles espèces dans la zone côtière
du Belize, site unique qui abrite des espèces en danger telles que les
lamentins, crocodiles, tortues de mer et de nombreuses espèces
d'oiseaux. Toutefois ces ressources biologiques sont menacées par une
montée rapide du tourisme, des pêcheries, du développement
du littoral et des activités agricoles. Exécuté par le
ministère bélizien de l'Agriculture et de la pêche, le
projet PNUD-FEM s'emploie, par le biais d'une gestion appropriée des
ressources côtières, à assurer la viabilité à
long terme des écosystèmes tout en ménageant des effets
positifs pour les communautés locales.
Ce projet s'articule autour de trois axes principaux :
1. Renforcer les institutions nationales chargées des ressources
côtières. Ceci inclut : la mise sur pied d'un comité
de pilotage qui supervise l'exécution, et consolide la coordination
interinstitutionnelle ; la préparation d'un projet de loi sur la
gestion du littoral qui fournira le cadre législatif de cette
politique de préservation; et la mise à disposition des
Béliziens de bourses d'études pour s'initier à la gestion
intégrée des zones côtières.
2. Actualiser et
améliorer les connaissances sur les ressources côtières
pour informer les décideurs. Ce volet comprend le lancement de plusieurs
programmes de recherche sur la gestion des ressources et de la faune sauvage,
un programme de suivi de la qualité de l'eau, et l'élaboration
d'un plan de zonage du littoral. Les informations ainsi rassemblées ont
permis la constitution d'un large réseau d'aires marines
protégées et le classement de sept réserves au Patrimoine
mondial.
3. Susciter chez les acteurs de tous les secteurs d'activité
une ferme volonté de développer les ressources
côtières en harmonie avec les impératifs environnementaux.
Le projet a orchestré une campagne de sensibilisation du public, a
appuyé un programme d'éducation aux ressources
côtières et introduit un manuel d'enseignant relatif à
l'environnement.
Lutte contre le changement climatique : récupération
du méthane des houillères en Chine.
Les
concentrations dans l'atmosphère de méthane, gaz à effet
de serre de 20 à 60 fois plus actif que le dioxyde de carbone, vont en
augmentant ; elles sont dues aux activités humaines. Mais,
capturé et utilisé, le méthane est une source
d'énergie efficiente et, dans certains cas, les systèmes de
récupération/utilisation peuvent s'autofinancer, voire
dégager un profit. L'exploitation du charbon contribue pour quelque
10 % aux émissions totales de méthane
générées par les activités humaines, un tiers de ce
pourcentage émanant de Chine.
En 1990, seules 40 des 600 houillères exploitées en Chine par
l'Etat disposaient d'un système de recyclage du méthane
récupéré. L'absence de mesures d'incitation, de capitaux,
de techniques et d'équipements dissuadait d'étendre ce
procédé. Le ministère chinois du Charbon, la Commission
nationale de la planification et un certain nombre d'administrations des mines
ont étudié et expérimenté de nouvelles technologies
de méthanisation du charbon. Toutefois, pour appliquer ces techniques
à une échelle suffisamment large pour asseoir leur
crédibilité, ces acteurs avaient besoin de ressources
financières additionnelles. Le projet PNUD-FEM a alors
élaboré une stratégie en trois volets : formulation
d'une stratégie nationale pour développer l'industrie de la
méthanisation ; introduction d'une large gamme de technologies et
techniques de contrôle et d'utilisation du méthane en apportant la
preuve de leur efficacité ; sensibilisation des décideurs,
tant au niveau central que régional, sur la portée
environnementale et économique de l'utilisation du méthane comme
source d'énergie. Un large éventail de techniques de
récupération et de conversion du méthane que les
sociétés minières chinoises seraient susceptibles
d'utiliser a été présenté en démonstration
sur trois sites d'exploitation. Le projet a également instauré un
climat politique et institutionnel favorable au développement d'une
industrie de la méthanisation et formé des membres du personnel
de divers instituts de recherche, du gouvernement central, de
sociétés charbonnières, d'administrations des mines, de
comités géologiques spécialisés dans le charbon et
de compagnies de gaz municipales.
Protection des eaux internationales : gestion environnementale et
protection de la mer Noire.
Les effluents urbains, industriels
et agricoles des pays riverains ont fait de la mer Noire la mer
intérieure la plus polluée au monde. Un projet PNUD-FEM,
associant l'ensemble des pays intéressés (Bulgarie,
Géorgie, Roumanie, Russie, Turquie, Ukraine), vise à
améliorer la qualité des eaux, préserver les aires
environnementales-clés, et intégrer les préoccupations
environnementales dans les politiques de développement.
Le projet appuie la réalisation d'un plan d'action centré sur
le littoral de la mer Noire, qui prend aussi en compte les bassins versants des
principaux fleuves y aboutissant. Il est étroitement coordonné
avec le projet du bassin du Danube et d'autres programmes financés par
la Communauté européenne, la BERD, la Banque mondiale,
etc
.
Une des toutes premières activités du projet est d'identifier les
principales sources de pollution (ponctuelle et diffuse) et de mesurer leur
impact. D'autres initiatives incluent la réalisation d'un plan de
gestion intégrée de la zone côtière qui prenne en
compte les activités agricoles, la gestion des pêcheries et des
déchets ménagers urbains, et la restructuration des
équipements industriels et portuaires. L'université de la mer
Noire à Constanta, en Roumanie, fait le lien avec le réseau
mondial FORMATION-MER-CÔTES et constitue le pôle de formation pour
la durée du projet. Tous les pays participants se mettent d'accord sur
des normes de qualité de l'eau, posent des limites à
l'émission de polluants, dressent la liste des investissements urgents
et préparent les procédures analytiques. Le programme favorisera
également la création de réseaux institutionnels et
scientifiques étoffés en vue de l'exécution des politiques
environnementales.
B. LA PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT PAR LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES : DES PROGRÈS À CONSOLIDER
Les organisations internationales en charge de l'économie et du commerce sont de plus en plus souvent amenées à se pencher sur les conséquences des interactions entre leur domaine de compétence et l'environnement. La question de l'articulation entre normes environnementales et règles de l'OMC est celle qui suscite le plus de controverses, et fera l'objet des plus longs développements.
1. Développement et environnement
Il est
indispensable que les institutions en charge du développement -
PNUD et Banque mondiale - intègrent pleinement l'environnement dans
leurs stratégies. L'environnement est, en effet, aux côtés
de l'économie et de la cohésion sociale, un des piliers du
développement durable.
Pour mémoire, il faut rappeler que le Fonds pour l'environnement mondial
participe au financement de projets du PNUD ou de la Banque mondiale, lorsque
ceux-ci ont une incidence sur la biodiversité, la protection des eaux
internationales, le changement climatique, ou la protection de la couche
d'ozone. Ces cofinancements et cette collaboration permettent d'intégrer
l'environnement à des projets portés par ces organisations, qui
ne sont pas spécifiquement en charge de l'environnement.
Il faut mentionner ensuite la
« réorientation
verte »
de la Banque mondiale. Principal acteur de l'aide
multilatérale, la Banque mondiale s'est progressivement engagée
sur le terrain du financement de projets environnementaux. Outre la lutte
contre les problèmes environnementaux internationaux, pour lesquels elle
est associée au FEM, la Banque mondiale intervient dans la protection de
l'environnement de la manière suivante :
• elle apporte son soutien à l'élaboration de politiques
environnementales ou de stratégies de développement durable
nationales, et renforce les institutions chargées du
développement durable ;
• elle veille à la complémentarité entre lutte contre
la pauvreté et préservation de l'environnement ;
• enfin, la protection de l'environnement fait partie des critères
pris en compte pour définir les modalités des prêts
accordés à des projets de développement.
EXEMPLES DE PROJETS ENVIRONNEMENTAUX
FINANCÉS PAR
LA BANQUE MONDIALE
Restauration des baies de Kartela et Trogir en Croatie
: ces
deux baies, situées sur la côte de la mer Adriatique, ont souffert
d'importants rejets industriels, qui ont décimé la vie marine et
dégradé la qualité des eaux. A la demande du gouvernement
croate, la Banque mondiale a accordé en 1998 un prêt de
36,6 millions de dollars destiné à financer un projet de
traitement des eaux usées. Le projet inclut également un
programme d'amélioration de la distribution et de la qualité de
l'eau potable.
Culture du café et protection de la biodiversité au
Salvador :
la Banque mondiale a financé un projet visant
à remplacer le mode traditionnel de culture du café, où
les plantes poussent en plein soleil, par un mode plus respectueux des
écosystèmes, dans lequel les plantes croissent à l'ombre
du couvert végétal. Le projet initial a nécessité
un modeste investissement de départ (750 000 dollars) mais a
été depuis reproduit à de multiples
reprises.
2. Commerce et environnement
La question de la compatibilité entre les règles de l'OMC et les normes environnementales est l'une des plus controversées. L'état du droit en la matière résulte tant des textes des accords de l'OMC que de la jurisprudence établie par les Groupes spéciaux ou par l'Organe d'appel 51 ( * ) .
a) L'exception environnementale dans les traités
Le principal accord dont le secrétariat est assuré par l'OMC est l'accord GATT ( General Agreement on Tariffs and Trade ). Il comporte une exception environnementale dans son article XX.
(1) L'article XX de l'accord GATT
L'exception environnementale du GATT est libellée de la
manière suivante :
«
Sous réserve que ces mesures ne soient appliquées
de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire
ou injustifiable, entre les pays où les mêmes conditions existent,
soit une restriction déguisée au commerce international, rien
dans le présent accord ne sera interprété comme
empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des
mesures : (...)
b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie
des personnes et des animaux ou à la préservation des
végétaux (...) ;
d) nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui
ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord
(...) ;
g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles
épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement
avec des restrictions à la production ou à la consommation
nationales ; (...)
».
L'article XX reconnaît que la protection des animaux et des
végétaux, comme des ressources naturelles, est un objectif
légitime des gouvernements, au même titre que la
libéralisation du commerce. Il institue une
exception
conditionnelle
aux règles du GATT.
(2) L'Accord GATS (General agreement on Trade of services, ou Accord général sur le commerce des services) et l'Accord SPS (accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires)
L'article XIV du GATS et le préambule de l'Accord SPS reprennent en substance l'article XX b) du GATT. Par ailleurs, l'article 5 de l'Accord SPS prévoit la nécessité d'établir un lien rationnel entre le niveau de protection adopté et l'évaluation des risques encourus (exigence de preuves scientifiques). L'accord SPS prévoit la possibilité d'adopter des mesures temporaires lorsque les données scientifiques dont on dispose ne suffisent pas à justifier l'adoption de mesures permanentes, ce qui en fait un des rares accords de l'OMC à appliquer le principe de précaution .
(3) L'Accord OTC (Obstacles techniques au commerce)
L'Accord
OTC vise les mesures susceptibles de constituer des obstacles non tarifaires
aux échanges. Il s'intéresse notamment aux normes de
qualité technique qu'un produit doit respecter pour pouvoir être
importé ou exporté. Il précise les conditions dans
lesquelles ces normes sont compatibles avec les règles relatives
à la liberté du commerce (notification, transparence dans
l'élaboration des règles, utilisation de normes internationales
le cas échéant).
L'article 2.2 de l'accord OTC reprend la problématique de
l'article XX du GATT puisqu'il énonce :
«
Les Membres feront en sorte que l'élaboration, l'adoption
ou l'application des règlements techniques n'aient ni pour objet ni pour
effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce
international. A cette fin, les règlements techniques ne seront pas plus
restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser
un objectif légitime, compte tenu des risques que la
non-réalisation entraînerait. Ces objectifs légitimes sont,
entre autres, la sécurité nationale, la prévention de
pratiques de nature à induire en erreur, la protection de la
santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la
santé des animaux, la préservation des végétaux ou
la protection de l'environnement. Pour évaluer ces risques, les
éléments pertinents à prendre en considération
sont, entre autres, les données scientifiques et techniques disponibles,
les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales
prévues pour les produits
».
b) L'interprétation jurisprudentielle : des conditions d'application strictes
(1) De strictes conditions d'application de l'article XX du GATT
L'Organe
de règlement des différends (ORD) de l'OMC a eu de multiples
occasions d'interpréter l'article XX du GATT ; un quart des
rapports de l'Organe d'appel ont en effet trait à des questions
environnementales.
Pour être admise au titre de l'article XX b), une mesure doit satisfaire
à plusieurs critères :
- elle doit tout d'abord répondre au
« test de
nécessité »
: la partie défenderesse
doit démontrer que la mesure prise était
« nécessaire » pour atteindre l'objectif
fixé, et qu'il n'était pas possible de prendre une mesure moins
pénalisante pour la liberté du commerce ;
- interprétant le préambule de l'article XX, l'ORD a
précisé que les mesures adoptées ne devaient pas, en
outre, instituer de
discriminations « arbitraires » ou
« injustifiables » entre les pays
, ni constituer une
« restriction déguisée au commerce
international »
; diverses décisions ont permis de
préciser quelles actions étaient interdites aux Etats ou quelles
règles de comportement ils devaient suivre :
Un Etat ne peut exiger d'un autre Etat qu'il adopte des techniques ou des
mesures environnementales déterminées : la
légitimité de techniques ou de mesures différentes ayant
le même effet final doit être reconnue.
L'Etat qui applique une mesure à d'autres pays doit tenir compte des
différences qui existent entre sa propre situation et celle des autres
pays.
Avant d'adopter des mesures commerciales, un Etat doit essayer de
négocier avec le ou les pays exportateurs.
L'Etat qui adopte des mesures commerciales doit laisser aux pays
touchés le temps de s'y adapter.
Les Etats ou les producteurs étrangers visés par les mesures
doivent disposer de voies de recours justes et équitables, de
procédures transparentes et de toutes les garanties d'une
procédure régulière.
Ces précisions visent à protéger les règles
commerciales multilatérales. Elles font de l'exception de l'article XX
une exception très qualifiée. Pour
M. Dominique Carreau, professeur de droit international
économique à l'Université Paris I, «
ces
conditions rigoureuses expliquent que, dans presque tous les conflits, l'OMC
ait fait prévaloir la liberté du commerce
».
Toutefois, il faut noter que les panels font une
interprétation
souple
de la notion de «
mesures destinées à
protéger la santé et la vie des personnes et des animaux, ou
à préserver les végétaux
». Il suffit
pour les Etats membres de démontrer que la politique dans laquelle
s'inscrivent les mesures entre dans la catégorie des politiques
destinées à protéger la santé et la vie des
personnes et des animaux ou à préserver les
végétaux. Il n'est pas nécessaire de démontrer un
lien plus précis entre telle mesure et ses effets, par exemple, sur la
santé humaine ou animale. Ainsi, dans le contentieux
Etats-Unis : Normes
concernant l'essence nouvelle et ancienne
formule
, le Groupe spécial a estimé qu'une mesure
destinée à réduire la pollution de l'air résultant
de la consommation d'essence était admissible au titre de l'article XX
b).
En 1998, l'Organe d'appel a également fait une interprétation
constructive de la notion de « ressources naturelles
épuisables », visée à l'alinéa g de
l'article XX, en estimant que les tortues marines entraient dans cette
catégorie. La notion de ressource épuisable renvoie donc à
un patrimoine minéral
ou biologique
. L'intérêt de
faire référence à l'alinéa g plutôt
qu'à l'alinéa b réside dans le fait que l'alinéa g
n'impose pas de « test de nécessité », mais
exige seulement que la mesure contestée vise principalement à la
conservation d'une ressource naturelle épuisable.
(2) Interprétation de l'article 5 de l'Accord SPS : réaffirmation de l'exigence de preuve scientifique
L'article 5 de l'accord SPS autorise les Etats à prendre des
mesures de protection dans les domaines sanitaire et phytosanitaire, afin
notamment de prévenir la dissémination de parasites ou la
diffusion d'épidémies.
L'Organe d'appel, dans une affaire
Australie : mesures visant les
importations de saumon
, a indiqué que les Etats pouvaient fixer
le niveau de
protection de leur choix
; rien ne s'oppose
à ce qu'un membre puisse «
déterminer que son niveau
de protection approprié correspond à un risque
nul
».
Cette affirmation n'implique cependant pas que les Etats puissent adopter
n'importe quelle mesure. La Communauté européenne a ainsi
été condamnée dans l'affaire du boeuf aux hormones, en
raison de son incapacité à apporter des
éléments
scientifiques suffisants
à l'appui de sa décision
d'interdiction. L'Organe d'appel a refusé d'admettre que cette
interdiction puisse être justifiée en vertu d'un principe
général de précaution.
Comme on l'a vu, un principe de précaution est prévu à
l'article 5-7 de l'accord SPS, mais de manière
très
encadrée
puisqu'il vise les cas d'incertitude scientifique et est
valable pour des mesures provisoires. La décision
Japon :
Mesures visant les produits agricoles
a précisé les
conditions de recours aux mesures provisoires :
- la mesure doit être imposée relativement à une situation
dans laquelle les informations scientifiques pertinentes sont
insuffisantes ;
- la mesure doit être adoptée sur la base des renseignements
pertinents disponibles ;
- la mesure ne peut être maintenue que si l'Etat membre s'efforce
d'obtenir des renseignements additionnels nécessaires pour
procéder à une évaluation plus objective du risque ;
- enfin, l'Etat membre doit, dans un délai raisonnable,
réexaminer la mesure en fonction de l'évolution des connaissances
scientifiques.
c) Incertitudes autour de l'articulation entre AME et accords de l'OMC
Sur les quelques deux cents accords environnementaux recensés, seuls une vingtaine contiennent des mesures à portée commerciale. Les cinq accords les plus significatifs de ce point de vue sont présentés dans l'encadré suivant.
MESURES COMMERCIALES ÉNONCÉES PAR CERTAINS
AME
Convention de Bâle.
-
Les Parties ne peuvent exporter
de déchets dangereux vers une autre Partie que si le pays d'importation
donne son autorisation par écrit. Les Parties ne peuvent importer
à partir de non-Parties ni exporter vers des non-Parties. Les Parties
sont également tenues d'empêcher l'importation ou l'exportation de
déchets dangereux lorsqu'elles ont des raisons de penser que ces
déchets ne feront pas l'objet d'un traitement écologiquement
rationnel sur leur lieu de destination.
Convention sur le commerce international des espèces de faune et
de flore sauvages menacées d'extinction.
-
La CITES
interdit le commerce international d'une liste agréée
d'espèces menacées d'extinction. De plus, elle règle et
surveille (par des systèmes de permis, de contingentements et d'autres
mesures restrictives) le commerce d'autres espèces susceptibles de se
trouver menacées d'extinction.
Protocole de Montréal.
-
Ce texte définit
certaines substances comme étant des facteurs d'appauvrissement de
l'ozone et prohibe tout commerce de ces substances entre Parties et
non-Parties. Des interdictions peuvent être prononcées à
l'égard de Parties dans le cadre de la procédure que
prévoit le Protocole en cas de non respect des règles
fixées. Le Protocole de Montréal prévoit aussi la
possibilité d'interdire l'importation de biens produits grâce
à des facteurs d'appauvrissement de l'ozone - prohibition fondée
sur les procédés et méthodes de production.
Convention de Rotterdam.
-
Les Parties déterminent
les pesticides et autres produits chimiques figurant sur une liste
agréée qu'elles ne peuvent gérer dans de bonnes conditions
de sécurité et dont elles interdisent, par conséquent,
l'importation. Lorsque des substances réglementées font l'objet
d'échanges internationaux, ils doivent observer des règles
strictes en matière d'étiquetage et d'information. Les
décisions des Parties à cet égard ne doivent pas avoir
d'effet sur les échanges : lorsqu'une Partie décide de ne
pas autoriser l'importation d'un produit chimique en provenance d'une autre
Partie, elle doit aussi en interdire la production nationale pour le
marché intérieur, ainsi que l'importation en provenance de toute
non-Partie.
Protocole de Carthagène sur la prévention des risques
biotechnologiques.
-
Les Parties peuvent appliquer des
restrictions à l'importation de certains organismes vivants
modifiés dans le cadre d'une procédure de gestion des risques
formulée avec la plus grande précision. Les organismes vivants
modifiés destinés à être libérés dans
l'environnement sont soumis à une procédure de consentement
préalable en connaissance de cause, et ceux qui sont destinés
à l'alimentation humaine ou animale ou à la transformation
doivent être accompagnés de documents descriptifs.
Certaines des mesures contenues dans ces accords contreviennent aux
règles de l'OMC : certaines instituent des restrictions
quantitatives (quotas), d'autres établissent des discriminations entre
Parties et non-Parties, autant d'entraves au commerce ou de mesures
discriminatoires que l'OMC cherche à éliminer.
Toutefois, si deux Etats parties à un AME appliquent entre eux les
mesures commerciales qu'il prévoit, aucun problème ne devrait
surgir, puisque ces Etats se conformant à des obligations librement
consenties, n'ont aucune raison de saisir l'Organe de règlement des
différends.
En revanche, une difficulté peut apparaître entre deux Etats
membres de l'OMC, si un seul d'entre eux est partie à un AME, et entend
appliquer des restrictions commerciales sur la base de cet AME à l'Etat
qui n'est pas lié par l'accord. Dans ce cas, il est probable que l'ORD
sera saisi du différend. Or, les accords de l'OMC ne prévoient
pas de règles particulières pour la résolution des
conflits pouvant surgir de la confrontation avec un AME. L'ORD n'ayant jamais,
à ce jour, été saisi d'un tel différend, il est
difficile de prévoir quelle pourrait être sa décision face
à un tel conflit de normes.
Face à cette incertitude juridique, le Comité du Commerce et de
l'Environnement à l'OMC a été chargé de
réfléchir à la compatibilité entre AME et accords
de l'OMC.
*
Au total, les moyens, tant financiers que juridiques, affectés, au niveau international, à la protection de l'environnement apparaissent bien modestes, et à tout le moins sous-dimensionnés par rapport aux enjeux à traiter. Un effort doit donc être mené pour renforcer le pilier environnemental des structures de la gouvernance mondiale.
II. RÉÉQUILIBRER LA GOUVERNANCE MONDIALE EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT
La
gouvernance mondiale actuelle apparaît
déséquilibrée : alors que des organisations
internationales puissantes gèrent les dossiers économiques (OMC,
FMI), et que les préoccupations sociales sont portées par l'OMS
et l'OIT, l'environnement semble être un secteur négligé,
puisque qu'aucune organisation internationale spécialisée n'en a
la charge. Un très grand nombre d'accords internationaux sont
juxtaposés à un Programme des Nations-Unies, sans
possibilité de mise en cohérence.
Une rationalisation et un renforcement des structures internationales en charge
de l'environnement devraient donc être des tâches prioritaires. La
question du financement de l'action internationale se trouve également
posée. En parallèle, il est indispensable d'améliorer la
prise en compte des questions environnementales au sein de l'OMC. Enfin, en
vertu du principe de subsidiarité, les échelons européen
et national doivent aussi être mobilisés pour mieux faire face aux
retombées environnementales de la mondialisation.
A. POUR UNE ORGANISATION MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT
La
création d'une Organisation mondiale de l'Environnement (OME)
complèterait de façon déterminante l'architecture
institutionnelle internationale.
Formulée pour la première fois il y a une dizaine
d'années, la proposition de créer une OME est aujourd'hui
défendue officiellement par la France, et par un certain nombre de nos
partenaires, dont l'Allemagne. Le Président de la République
Jacques Chirac soutient depuis plusieurs années cette idée, et
s'est déjà exprimé publiquement en sa faveur. Cette
proposition se heurte cependant encore à de fortes résistances de
la part de certains pays, ce qui impose d'exposer à nouveau
l'argumentation en faveur de ce projet.
Une éventuelle OME aurait pour première mission de centraliser le
secrétariat des différents accords environnementaux. Cette
rationalisation des structures serait source de gains d'efficacité. La
mutualisation des moyens donnerait davantage de poids aux secrétariats
des AME, qui pourraient développer des
outils communs de suivi de
l'application des accords
. Le regroupement des secrétariats
favoriserait également l'émergence d'une doctrine commune, autour
de grands principes actuellement énoncés de manière
dispersée dans les accords (principe pollueur-payeur, principe de
précaution, principe du consentement éclairé...).
L'OME pourrait reprendre les activités actuellement dévolues au
PNUE, mais dans des conditions de plus grande stabilité, dans la mesure
où le financement de cette organisation internationale serait
assuré par des contributions régulières et obligatoires
des Etats membres. Elle serait un lieu d'expertise reconnu, qui pourrait peser
dans le débat public international, et serait un interlocuteur
crédible pour les autres organisations multilatérales, notamment
l'OMC.
Outre les gains d'efficacité administrative, l'OME constituerait un
forum de négociation permanent, facilitant ainsi la conclusion de
nouveaux AME. Elle favoriserait la surveillance mutuelle entre Etats, et par
là, encouragerait le respect des engagements souscrits. La collecte et
la publication de données fiables et incontestables en matière
d'environnement permettrait de jouer sur les effets de
« réputation » et inciterait les Etats à
appliquer les accords environnementaux.
Pour être crédible, l'organisation devrait disposer d'un budget
suffisant. Il est difficile, à ce stade, de proposer un chiffre
précis tant les besoins en matière de protection de
l'environnement sont étendus. Toutefois, Mme Jacqueline Aloisi de
Larderel, ancienne directrice de la division du commerce, de l'industrie, et de
l'économie du PNUE, a indiqué au cours de son audition, que pour
faire face aux défis présents, un triplement des ressources du
PNUE lui paraissait nécessaire. Cela impliquerait de porter le budget
annuel de l'organisation à quelque 180 millions d'euros. En outre,
la gestion du Fonds pour l'environnement mondial pourrait être
rattachée à l'OME, ce qui ferait du FEM le « bras
financier » de l'organisation, lui permettant de mettre en oeuvre des
projets concrets de préservation de l'environnement.
La création d'une OME se heurte aux réticences des Etats-Unis,
qui doutent de l'intérêt de cette nouvelle organisation, et
craignent qu'elle ne vienne concurrencer l'OMC. Les Américains estiment
que les questions environnementales ayant une incidence sur les échanges
peuvent être traitées directement au sein de l'OMC. Ils
s'inquiètent également des contraintes qu'une OME pourrait faire
peser sur leur développement technologique. Les pays du Sud, quant
à eux, craignent qu'une OME ne vienne freiner leur développement
en imposant des normes environnementales trop sévères.
Pour surmonter les réticences des pays du Sud, les promoteurs du projet
d'OME devraient mettre en avant la notion de développement durable, qu
fait le lien entre croissance et protection de l'environnement, ainsi que le
principe pollueur-payeur, qui implique que l'effort principal en matière
de protection de l'environnement repose sur les pays du Nord. Pour
atténuer les craintes des Etats-Unis, une approche progressive pourrait
être retenue, passant d'abord par un renforcement du PNUE, avant de
formaliser sa transformation en Organisation mondiale de
l'Environnement.
B. POUR L'ÉLABORATION DE NOUVELLES CONVENTIONS ENVIRONNEMENTALES
Deux
problèmes environnementaux majeurs ne sont aujourd'hui couverts par
aucun accord multilatéral : il s'agit des phénomènes
de
déforestation
et
d'épuisement des ressources
halieutiques
.
• La déforestation, en effet, ne donne aucun signe de
ralentissement, malgré les avertissements lancés lors de la
Conférence de Rio. La disparition du couvert forestier menace la survie
de nombreuses espèces animales et végétales. Elle
complique aussi la lutte contre le réchauffement climatique : avec
presque 40 % du total du carbone stocké, les forêts sont en
effet le principal puit à carbone de la planète. Le timide
mouvement de reforestation observé dans les pays
développés ne compense pas la rapide déforestation
observée au Sud (
cf
. diagramme).
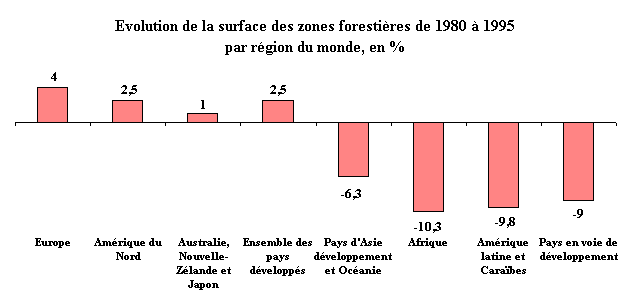 Source : Institut des ressources mondiales (WRI)
Source : Institut des ressources mondiales (WRI)
Une
convention internationale sur les forêts pourrait s'inspirer de la
Convention sur la désertification. Les Etats s'engageraient à
mettre en oeuvre des politiques nationales de préservation des
forêts, en fonction d'objectifs définis collectivement ; les
pays du Sud pourraient recevoir une assistance financière et technique
pour la réalisation de leurs programmes de préservation. Des
espaces pourraient être tenus à l'écart de toute
exploitation économique lorsque les impératifs de la
biodiversité l'exigent. Des filières d'exploitation
forestière « soutenable » devraient être mises
en place, ce qui implique que l'exploitation des ressources soit compatible
avec leur rythme de reconstitution.
• L'épuisement des ressources halieutiques est un autre sujet de
préoccupation. La surexploitation des réserves de poissons,
crustacés, et autres organismes marins est une réalité
dans toutes les parties du globe. En 1999, l'Organisation des Nations-Unies
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a publié une étude
indiquant que 28 % des réserves de poissons étaient
surexploitées ou épuisées. 47 % des réserves
sont pleinement exploitées, ce qui signifie que toute augmentation des
prélèvements ferait entrer ces stocks dans une phase de
décroissance.
Les ressources halieutiques présentant les caractéristiques d'un
bien commun, une gestion satisfaisante de ces ressources suppose la
définition d'un régime d'exploitation international. La
négociation d'une
Convention internationale pour une pêche
écologiquement responsable
apparaît donc nécessaire.
Cette convention pourrait s'inspirer des orientations retenues au niveau
communautaire pour une gestion durable des stocks. D'une analyse de
l'état des stocks devrait découler la définition de quotas
de pêche par zones géographiques. Cela supposerait, dans certains
cas, de recalibrer le tonnage des flottes de pêche nationales, et
d'améliorer les procédures administratives de contrôle.
Les difficultés rencontrées au niveau européen pour
parvenir à un accord sur la pêche laissent présager de la
complexité d'une négociation internationale sur le sujet. Il est
toutefois urgent, vu les menaces qui pèsent sur le renouvellement des
stocks de produits marins, d'engager le débat au niveau
international.
C. DÉFENDRE LE PROJET D'UNE ÉCOTAXE INTERNATIONALE
Depuis
quelques années, les propositions visant à créer une
fiscalité internationale rencontrent un plus large écho dans le
débat public. La proposition de créer une taxe sur les
transactions financières (taxe Tobin) est la plus connue, mais
l'idée de créer une taxation du commerce des armes a
également été discutée. Pour approfondir
l'étude de ces questions, un groupe de travail sur la fiscalité
internationale a d'ailleurs été récemment mis en place
à l'initiative du Chef de l'Etat.
Devant l'ampleur des défis écologiques à relever,
notamment en relation avec le problème du changement climatique, votre
rapporteur souhaiterait que soit privilégiée la création
d'une
écotaxe internationale
. L'assiette de cette taxe serait le
carbone contenu dans les énergies fossiles, dont la combustion est
génératrice de gaz à effet de serre. Le taux de la taxe
varierait selon les sources d'énergie considérées, en
fonction de leur intensité en carbone. Le contenu en carbone des
principaux combustibles est en effet très différent (
cf
.
tableau suivant) ; abandonner le charbon au profit du gaz pour la
production d'énergie suffirait pour réduire de 40 % les
émissions de carbone.
|
Contenu en carbone des divers combustibles |
|
|
|
Tonne de carbone/10 12 Joules |
|
Lignite |
27,6 |
|
Charbon |
25,8 |
|
Pétrole |
20,0 |
|
Essence |
18,9 |
|
Gaz naturel liquéfié |
17,2 |
|
Gaz naturel |
15,3 |
|
Source : GIEC (1996) |
|
Votre
rapporteur ne méconnaît pas les difficultés de mise en
oeuvre d'une telle proposition. Dans les négociations qui ont
précédé la conclusion du Protocole de Kyoto, l'Union
européenne avait déjà défendu, sans succès,
la création d'une écotaxe internationale. L'option quantitative
(création de quotas), défendue par les Etats-Unis, avait alors
prévalu. L'opposition politique des Etats-Unis à toute
idée de taxation internationale n'a pas disparu : les Etats-Unis
continuent de s'opposer, dans les enceintes onusiennes, à ce que des
réflexions soient menées autour des projets de taxe
internationale.
Depuis lors, les Etats-Unis sont même revenus sur leur adhésion au
Protocole de Kyoto. Cette réserve des Etats-Unis a des causes
culturelles profondes, comme l'a souligné M. Denys Gauer,
ambassadeur délégué à l'environnement, au cours de
son audition : outre une hostilité générale aux
progrès du multilatéralisme, l'administration américaine
exprime un attachement à un mode de vie fortement consommateur d'espace
et d'énergie, et une forme de foi dans les progrès de la science
et de la technique, sur lesquels il compte pour résoudre le
problème du changement climatique.
En plus de cet obstacle politique, l'application d'une écotaxe peut se
heurter à des problèmes pratiques dans certains pays en
développement qui, ne disposant pas d'une administration fiscale
performante, peuvent tout simplement avoir des difficultés à
lever la taxe.
Pourtant, la taxation est un instrument efficace, souvent utilisé dans
l'espace national, pour infléchir des comportements, et corriger des
défaillances de marché (ici, internaliser une externalité
négative). Elle présente l'avantage d'être un instrument
lisible, et facilement compréhensible, pour les agents
économiques. Elle est aussi un instrument souple, dont le taux peut
être modulé en fonction de l'évolution des connaissances
scientifiques et techniques et des objectifs politiques définis. Elle
apparaît enfin plus efficiente que la réglementation pour
atteindre un objectif de dépollution donné. En effet, la taxation
incite les agents qui supportent de faibles coûts de dépollution
à aller plus loin que ce qu'une norme pourrait imposer, et elle laisse
chaque agent réagir de la manière qui lui convient le mieux,
permettant ainsi une réduction des émissions au moindre
coût.
Par ailleurs, une taxation internationale peut être mise en oeuvre par
les administrations fiscales nationales, et semble donc plus simple à
gérer, d'un point de vue administratif, que le système retenu
d'échange de permis d'émission.
Quel devrait être le niveau approprié de la taxation ? Si
l'on se donne comme objectif de respecter les engagements du Protocole de Kyoto
(réduire de 5 % les émissions de gaz à effet de serre
par rapport à 1990 à l'horizon 2008-2012), il est possible de
calculer, sur la base d'hypothèses relatives à
l'élasticité de la demande d'énergie à son
coût, le taux d'une « taxe carbone fictive »
52
(
*
)
. Le taux de la taxe varie
selon les pays, en fonction notamment de la pente
« naturelle » de l'évolution de la consommation
d'énergie. Toutefois, les modèles donnent des résultats
assez divergents, en raison des différences entre les hypothèses
qui président à leur élaboration. Le rapport Guesnerie
indique que, pour les Etats-Unis, les estimations varient entre 50 et plus de
400 dollars par tonne de carbone, avec une concentration dans la zone
130-260 dollars. Le modèle GREEN de l'OCDE aboutit à une
estimation de 231 dollars par tonne. Pour l'Europe occidentale, les estimations
sont aussi très hétérogènes (de 72 à plus de
1 000 dollars par tonne), avec une concentration dans la zone
140-250 dollars. Le modèle GREEN de l'OCDE produit une estimation
de 189 dollars.
Comme les divers combustibles n'ont pas la même concentration en carbone,
l'instauration d'une taxe carbone aurait un impact différencié
sur les prix énergétiques. L'OCDE a proposé en 1999 une
évaluation de l'augmentation des prix de l'énergie en 2010
résultant de la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto (sans
échange de permis d'émission).
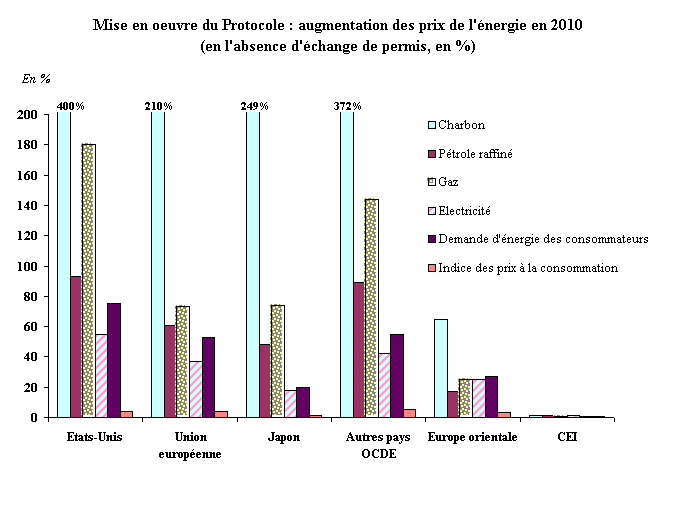 Source : OCDE, 1999.
Source : OCDE, 1999.
Logiquement, la hausse des prix serait particulièrement forte
pour le combustible qui présente la plus forte concentration en carbone,
à savoir le charbon. Globalement, le prix moyen à la consommation
de l'énergie s'élèverait de plus de 50 % en Europe ou
aux Etats-Unis.
Compte tenu des incertitudes autour du niveau de taxation optimal, il
paraît raisonnable d'envisager, dans un premier temps, un niveau de
taxation se situant plutôt dans le bas de la fourchette, pour
procéder ensuite à une évaluation régulière
de ses effets, débouchant éventuellement sur une modification du
taux de taxation.
Sous certaines conditions, l'impact du Protocole de Kyoto sur le PIB serait peu
élevé. Comme l'écrit l'OCDE, «
d'après
la plupart des modèles, les coûts économiques totaux
(exprimés en pourcentage du PIB ou du revenu réel total) se
situeraient aux alentours de 1 % ou en
deçà
»
53
(
*
)
.
Estimations du coût de la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto en 2010 sans recours aux mécanismes de flexibilité
|
|
Modèle |
Pourcentage de réduction de PIB en 2010 |
|
Etats-Unis |
RICE |
- 0,9 |
|
|
POLES |
- 0,2 |
|
|
EPPA |
- 1 |
|
|
GREEN |
- 0,3 |
|
Europe occidentale |
RICE |
- 0,5 |
|
|
POLES |
- 0,1 |
|
|
GREEN |
- 0,2 |
|
Japon |
RICE |
- 0,8 |
|
|
POLES |
- 0,3 |
|
|
GREEN |
0 |
|
Europe orientale |
GREEN |
- 0,3 |
|
CEI |
GREEN |
- 0,1 |
|
Source : d'après OCDE (1999) et Guesnerie (2001). |
||
Pour les
Etats-Unis, l'Europe ou le Japon, la perte de bien-être
résulterait de l'augmentation des prix de l'énergie. Pour la
Communauté des Etats Indépendants (CEI, qui englobe notamment la
Russie), c'est la moindre demande de pétrole qui explique la perte de
revenu.
Ces estimations globales des coûts peuvent sembler très modestes.
Mais il faut garder à l'esprit que les coûts indiqués par
les modèles économiques mondiaux correspondent non pas aux
coûts totaux de réduction des émissions (mesurés par
les recettes de la taxe sur le carbone nécessaire pour faire diminuer
les émissions), mais à la perte d'efficacité
économique associée à la réaffectation des
ressources résultant de la limitation des émissions de carbone.
Autrement dit, les recettes tirées de la taxe sont redistribuées
aux agents économiques, et le seul coût mesuré est le
coût d'adaptation de l'économie à ces nouvelles
dispositions fiscales. De plus, les modèles considèrent que les
mesures nationales sont mises en oeuvre de manière efficace,
c'est-à-dire sans créer de distorsions supplémentaires
dans l'économie.
Par ailleurs, il faut souligner que la plupart des modèles partent du
principe que le travail et le capital sont réaffectés sans
rigidité à la suite de la hausse des prix du carbone. Il s'agit
là d'une hypothèse forte, quand on connaît les
rigidités qui affectent les économies européennes, en
particulier sur les marchés du travail. Ceci conduit vraisemblablement
les modèles à sous-estimer les coûts d'ajustement des
économies, au moins à court et moyen terme.
Ces remarques doivent amener à considérer avec précaution
les résultats fournis par les modèles, et à s'attacher aux
ordres de grandeur plus qu'aux résultats précis. Il n'en reste
pas moins que les conséquences économiques de la création
d'une taxe internationale destinée à atteindre les objectifs de
Kyoto apparaissent gérables par les Etats.
La combinaison d'une taxe et d'un marché des droits d'émission
permet en outre d'atteindre les mêmes objectifs pour un coût
économique bien moindre (les coûts pourraient être
réduits par 1,5 ou 2 aux Etats-Unis, et par 2 ou 3 dans l'Union
européenne, selon le rapport Guesnerie). Dans ces conditions,
l'argumentation américaine selon laquelle l'application du Protocole de
Kyoto entraînerait des coûts insoutenables pour l'économie
apparaît peu crédible. L'introduction d'une taxe sur le carbone
devrait naturellement se faire de manière progressive, et selon un
échéancier connu à l'avance, afin que les agents
économiques puissent s'y adapter.
La taxe sur le carbone devrait avoir pour effet de faire diminuer la
consommation de carbone, sans toutefois la faire disparaître totalement.
La taxe générerait donc des recettes qui pourraient être
utilisées collectivement pour financer des biens publics mondiaux. En la
matière, comme on l'a vu, les priorités ne manquent pas. Un
chantier majeur qui pourrait être financé par le produit de la
taxe est celui de l'amélioration de l'accès à l'eau
potable dans les pays du Sud. Plus d'un milliard de personnes n'ont pas
accès aujourd'hui à l'eau potable, ce qui occasionnerait, selon
l'Unesco, 2,2 millions de décès chaque année. Une
amélioration du traitement et de la distribution de l'eau
représenterait donc, en plus de ses effets environnementaux, un
progrès sanitaire considérable.
Comment surmonter les oppositions au projet d'écotaxe
internationale ? Le meilleur moyen de faire adhérer les opinions
publiques à ce projet est sans doute d'affiner encore notre
compréhension du changement climatique, de manière à
rendre indiscutable l'origine humaine du phénomène. Il faut aussi
mettre en avant les coûts - économiques et
non-économiques - de l'inaction.
Pour surmonter les réticences des industriels, il est possible de
prévoir un système d'exemption, temporaire ou permanente, ou un
taux de taxation réduit. Les écotaxes mises en place dans divers
pays européens prévoient généralement des
règles différentes pour les professionnels et pour les
particuliers.
Les ressources prélevées grâce à la taxe pourraient
être utilisées, pour partie, pour financer des priorités de
l'action internationale, mais pourraient aussi servir à compenser la
réduction d'autres taxes, notamment celles qui pèsent sur le
travail. La substitution partielle d'une taxe écologique à une
taxation sociale pourrait stimuler l'emploi, et déboucher sur un
« double dividende » : dividende écologique
sous forme d'une réduction de la pollution, et dividende social sous
forme de créations d'emplois supplémentaires.
D. POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT PAR L'OMC
La
Déclaration de Doha, qui définit le cadre des négociations
en cours à l'OMC, prévoit, dans son paragraphe 31, que des
discussions soient engagées sur les liens entre commerce et
environnement.
Trois thèmes de réflexion sont plus particulièrement
visés par la Déclaration :
- préciser les
relations entre les règles de l'OMC et les
obligations commerciales énoncées dans les accords
multilatéraux environnementaux
(toutefois, la portée des
négociations est limitée à l'applicabilité des
règles de l'OMC
entre les parties
aux AME) ;
- réfléchir à d'éventuelles procédures
d'échanges de renseignements
réguliers entre l'OMC et les
secrétariats des AME ;
- avancer vers la réduction, ou l'élimination, des obstacles
tarifaires et non tarifaires visant les
biens et services
environnementaux
.
L'ouverture de négociations sur ces sujets traduit la volonté de
certains Etats, dont l'Union européenne, d'introduire des
éléments de régulation dans la libéralisation des
échanges. On doit toutefois constater que peu de progrès ont
été jusqu'ici enregistrés dans ces négociations. En
particulier, les discussions sur le commerce des biens et services
environnementaux achoppent sur un problème de définition de ces
biens et services.
Deux thèses en effet s'affrontent : pour les uns, les biens et
services environnementaux désignent simplement les biens et services qui
permettent de lutter contre la pollution (un système de traitement des
eaux usées par exemple) ; pour les autres, les biens et services
environnementaux doivent être entendus dans un sens beaucoup plus large,
comme recouvrant tous les biens fabriqués selon des méthodes qui
minimisent la pollution et qui favorisent une gestion durable des ressources
(du papier recyclé par exemple).
Votre rapporteur est favorable à ce qu'une définition large soit
retenue : réduire le coût d'accès aux biens
fabriqués selon des méthodes respectueuses de l'environnement ne
peut que stimuler la demande pour ces biens et contribuerait donc à une
meilleure préservation de l'environnement. On ne doit pas cependant
sous-estimer les difficultés soulevées par le choix d'une
définition extensive : dresser la liste des biens environnementaux
suppose un examen approfondi des procédés de production, et la
définition de règles de certification admises au niveau mondial.
Des discussions considérables et très complexes seraient
nécessaires pour atteindre cet objectif.
On mesure, incidemment, la contribution que pourrait apporter une Organisation
mondiale de l'Environnement à l'achèvement d'une telle
tâche. Il serait légitime, en effet, que les experts d'une OME
mènent à bien ces négociations, tandis que les experts
commerciaux à l'OMC se concentreraient sur la négociation
relative aux droits de douane et aux obstacles non tarifaires.
Outre ce problème de définition des biens et services
environnementaux, la réforme de l'OMC dans un sens plus
environnementaliste devrait s'organiser autour de deux axes : la
réforme des procédures d'une part, et la révision des
accords de l'OMC d'autre part.
Les procédures de l'OMC pour le règlement des différends
devraient garantir que les préoccupations environnementales sont prises
en compte à la hauteur de l'importance qui est la leur. Aujourd'hui, les
panels chargés d'examiner les différends sont composés de
fonctionnaires issus des ministères nationaux du Commerce, de
fonctionnaires issus de l'OMC, de professeurs de droit international...,
c'est-à-dire de personnes qui, de par leur culture et leur formation,
sont susceptibles d'être plus sensibles aux questions commerciales qu'aux
questions environnementales. D'où l'idée de rendre obligatoire la
présence «
d'experts environnementaux
» dans
les panels lorsque l'affaire à juger met en cause une
réglementation environnementale. Ces experts seraient issus des
ministères de l'Environnement nationaux, du PNUE ou des
secrétariats des AME, ou seraient des scientifiques, des juristes ou des
économistes spécialisés sur les questions d'environnement.
Cette diversification du profil des panélistes serait une manière
de prendre acte du fait que les décisions de l'OMC ont des
répercussions qui dépassent de loin le champ des politiques
commerciales.
Lorsque l'ORD est amené à connaître d'un conflit entre un
AME et un des accords de l'OMC, il serait également souhaitable de
prévoir une
procédure de consultation
du
secrétariat de l'AME concerné, afin que celui-ci fasse
connaître son point de vue sur la solution à apporter au litige.
Là encore, il s'agit de veiller à ce que les
préoccupations environnementales soient mises sur le même plan que
les questions commerciales. Il s'agit aussi d'organiser un dialogue
régulier entre les institutions, prélude à une
coopération plus poussée entre organisations internationales. Un
tel dialogue favoriserait l'émergence d'une doctrine et d'une approche
communes des questions touchant à la fois à l'environnement et au
commerce.
Ces réformes procédurales ne seraient cependant pas suffisantes
si elles ne s'accompagnaient pas d'une révision des textes applicables
par l'ORD.
En effet, comme on l'a vu, une grande incertitude existe quant à la
compatibilité entre les accords de l'OMC et les AME. L'article XX du
GATT (et les articles équivalents des autres accords) devraient
être complétés pour lever cette incertitude, et
réaffirmer la valeur juridique des AME. L'article XX devrait
reconnaître clairement
l'égalité de statut
entre les
AME et les règles de l'OMC (égalité fondée sur les
principes de non hiérarchisation ainsi que de soutien et de respect
mutuels), et la légitimité de principe des obligations
commerciales spécifiques contenues dans les AME.
En cas de conflit de normes, il devrait être précisé qu'un
Etat puisse opposer à une partie à l'OMC des dispositions
commerciales d'un AME auquel ce second Etat ne serait pas lui-même
partie. Pour éviter que la conclusion d'AME ne devienne un moyen
déguisé d'ériger des barrières aux échanges,
l'ORD veillerait, en cas de contentieux, à ce que les obligations
contractées n'instaurent des discriminations protectionnistes
arbitraires ou injustifiables. Autrement dit, l'ORD contrôlerait que les
obligations contractées poursuivent bien un objectif environnemental
(vérification du principe de bonne foi).
L'adoption de ces mesures serait de nature à renforcer la place de
l'environnement dans le processus décisionnel de l'OMC. En affichant une
plus grande sensibilité aux questions environnementales, l'OMC
améliorerait son image auprès des opinions publiques, ce qui est
susceptible, à terme, de favoriser les progrès du
multilatéralisme commercial.
E. CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE À LA GOUVERNANCE DE LA MONDIALISATION
En raison du rôle économique et politique qui est le sien, l'Union européenne peut peser sur le cours de la mondialisation. Sans prétendre passer en revue tous les aspects de la politique environnementale européenne, cette section se propose d'évoquer trois domaines pour lesquels l'action de l'Union européenne peut s'avérer décisive : il s'agit de la lutte contre le changement climatique, de l'agriculture et des transports.
1. La lutte contre le changement climatique
Compte
tenu du refus américain de le ratifier et des réticences de la
Russie, l'avenir du Protocole de Kyoto et de la lutte contre le changement
climatique repose largement sur la politique suivie par l'Union
européenne. L'Union a pris la décision d'appliquer Kyoto, quelle
que soit l'attitude de ses partenaires étrangers. Ce choix doit
être soutenu : la gravité du problème du changement
climatique rend en effet bienvenues toutes les initiatives qui visent à
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Même
si l'Europe ne pourra seule mettre un terme au phénomène du
réchauffement climatique; la valeur d'exemplarité de la politique
européenne est l'un des leviers dont nous disposons pour inciter nos
partenaires à se rallier à cette approche.
Deux directives communautaires ont été adoptées en 2003,
afin de donner aux Etats membres des outils leur permettant d'atteindre les
objectifs de Kyoto. La première, la directive n° 2003/87 du
13 octobre 2003, qui doit être effective au plus tard le
1
er
janvier 2005, prévoit la création de
quotas commercialisables d'émissions de gaz à effet de
serre
. Ces quotas seront alloués aux installations des secteurs de
l'énergie, des métaux ferreux, des minéraux et du papier,
qui émettent du dioxyde de carbone. La quantité totale de quotas
allouée sera déterminée par un plan national compatible
avec les engagements souscrits par chaque pays. Les exploitants dont les
émissions seront inférieures au quota dont ils disposent pourront
reporter les droits inutilisés sur l'année suivante, ou les
céder. Les exploitants qui prévoient que leurs émissions
excéderont leurs quotas pourront acquérir des droits
supplémentaires, ou devront sinon s'acquitter d'une amende.
La deuxième directive (directive n° 2003/96 du
27 octobre 2003) introduit une forme
d'écotaxe
européenne
, mais dans une version minimale. Dès 2004, les
droits d'accises perçus sur les produits énergétiques et
l'électricité devront excéder des minima fixés par
la directive. Le minimum prévu pour l'essence des véhicules
particuliers est inférieur aux niveaux de taxation pratiqués en
Europe, et sera donc sans incidence. Il n'en va pas de même pour les
autres produits énergétiques. Cependant, la portée de la
directive est affaiblie par de multiples dérogations, fondées sur
la qualité du produit ou sur l'intérêt public. Une
différenciation est aussi permise au profit de la consommation
professionnelle pour ne pas pénaliser l'activité
économique.
La mise en oeuvre de cet embryon de taxation écologique et des
marchés de droits d'émission devrait être
complétée par un renouveau de la politique d'économie
d'énergie pour porter pleinement ses fruits.
2. L'agriculture
L'Union
européenne doit promouvoir, au plan interne et au plan international, un
modèle agricole respectueux de l'environnement
. Il faut, pour
cela, préserver, et amplifier, l'orientation retenue pour la
dernière réforme de la PAC.
La réforme adoptée le 26 juin 2003 introduit en effet une forme
« d'éco-conditionnalité » dans la Politique
agricole commune. La plupart des aides sont désormais
découplées des volumes de production, ce qui devrait
décourager les phénomènes de surproduction,
préjudiciable à l'environnement, autrefois observés. Le
versement des subventions est en revanche
subordonné au respect de
normes en matière d'environnement, de sécurité
alimentaire
et de bien-être animal
. Le maintien de toutes les
terres agricoles dans des conditions agronomiques et environnementales
satisfaisantes doit être recherché. La réduction des
paiements directs aux grandes exploitations permettra de dégager
davantage de crédits pour les versements liés à
l'environnement.
Il est important que cette nouvelle orientation ne soit pas remise en cause par
les négociations en cours, et que l'OMC respecte la diversité des
modèles agricoles. Une complète libéralisation des
marchés agricoles ferait disparaître ces incitations à de
bonnes pratiques environnementales. La baisse des prix encouragerait les
exploitants agricoles à rechercher par priorité les gains de
productivité, au risque d'augmenter la pression sur les
écosystèmes.
3. Les transports
L'Union européenne peut contribuer à la maîtrise des conséquences environnementales de la croissance des transports internationaux.
a) L'Union européenne devrait parler d'une seule voix dans les instances internationales compétentes
Aujourd'hui, l'influence de la Communauté au sein de
l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ou de l'Organisation
maritime internationale (OMI) est réduite, du fait de l'absence de
représentation commune.
Pourtant, des exemples passés montrent qu'une coordination des pays
membres de l'Union peut avoir un impact réel sur ces organisations.
Ainsi, la décision de l'Union de bannir de ses ports les navires
à simple coque est à l'origine de la modification du calendrier
prévu par l'OMI pour l'élimination de ces navires. Et les efforts
de la Communauté pour avancer vers une réduction progressive du
bruit des avions ont contribué à accélérer les
discussions multilatérales pour réviser les standards sur le
bruit des avions définis par l'OACI.
Dans ces conditions, il apparaît à votre rapporteur qu'une
représentation unique de la Communauté
dans ces
organisations serait de nature à renforcer le poids des positions
européennes.
L'Union européenne devrait également demander que soit mise
à l'étude la possibilité de mettre fin à la
détaxation du kérosène utilisé pour le transport
aérien. En vertu d'accords internationaux, les compagnies
aériennes bénéficient en effet d'une exonération de
toutes les taxes sur le kérosène. Cette situation n'incite pas
les compagnies à faire appel aux avions les plus économes en
carburant, ni à diminuer les émissions de CO
2
,
auxquelles le transport aérien contribue à hauteur de
13 %.
b) Le défi de l'élargissement
L'adhésion de dix nouveaux Etats membres en 2004 devrait
logiquement s'accompagner d'une croissance des flux commerciaux entre l'est et
l'ouest de l'Europe. Or, il est à craindre que cette expansion des
échanges ne soit dommageable à l'environnement, dans la mesure
où les réseaux de transport en Europe centrale et orientale
souffrent d'une certaine vétusté.
L'enjeu principal réside sans doute dans
la modernisation des
réseaux
ferroviaires
. Le rail représente environ
40 % du transport de fret dans les pays d'Europe centrale et orientale,
contre seulement 8 % dans l'Union européenne. Il n'est pas
sûr toutefois que cette part de marché élevée puisse
se maintenir. En effet, le transport de fret pratiqué à l'est de
l'Europe consiste traditionnellement dans le transport de produits
pondéreux entre des zones d'extraction minière et des sites
industriels. Ce mode de transport ferroviaire a de moins en moins sa place dans
ces économies en mutation rapide.
Ce constat amène la Commission européenne à demander, dans
son Livre blanc sur les transports, que les futures perspectives
financières de la Communauté prévoient un
financement
public adéquat des infrastructures dans
les nouveaux Etats
membres
. Ces investissements auraient pour objectif de maintenir à
hauteur de 35 %, à l'horizon 2010, la part de marché du rail
dans le transport de marchandises. Le maintien d'une part de marché
élevée pour le transport ferroviaire à l'est de l'Europe
est susceptible de stimuler la demande pour le rail à l'ouest du
continent.
F. CONTRIBUTION NATIONALE À LA MAÎTRISE DE LA MONDIALISATION
Comme cela a été suggéré à plusieurs reprises dans ce rapport, des politiques environnementales nationales bien conduites sont le meilleur rempart face aux excès de la mondialisation. Devant l'impossibilité d'examiner ici tous les aspects de la politique française de l'environnement, votre rapporteur souhaiterait attirer l'attention de la Délégation sur quelques propositions.
1. Améliorer le diagnostic par la création d'un Observatoire national des effets de la mondialisation
Le
Premier ministre a chargé votre rapporteur, à la fin de 2003, de
faire des propositions en vue de la création d'un
Observatoire
national des effets de la mondialisation.
Ce projet d'Observatoire part du constat de l'inquiétude des
Français face à la mondialisation et du manque d'une expertise
reconnue et indépendante en la matière. Certes, les travaux
portant sur la mondialisation existent, mais ils sont souvent peu connus et peu
coordonnés. La création d'un Observatoire, associant acteurs
publics et privés, permettrait de remédier à cette lacune.
Cet organisme aurait plusieurs fonctions :
- il améliorerait notre compréhension du phénomène
de la mondialisation et de ses conséquences ;
- il produirait des études, structurerait un réseau d'experts, et
animerait le débat public ;
- il serait un outil d'aide à la décision, utile pour les
pouvoirs publics et pour les acteurs économiques et sociaux ; il
remettrait pour cela un rapport annuel au Premier ministre, assorti de
recommandations.
L'Observatoire serait dirigé par un directoire, agissant sous le
contrôle d'un conseil de surveillance. Il s'appuierait sur un conseil
scientifique, complété par des conseils sectoriels.
2. Faire de l'aide publique au développement un levier de la préservation de l'environnement dans les pays du Sud
Le
transfert de technologies et de savoir-faire et la promotion de la notion de
développement durable dans les pays du Sud sont les indispensables
compléments de la libéralisation des échanges
.
Important pourvoyeur d'aide au développement, et entretenant des liens
privilégiés avec de nombreux pays en développement,
notamment en Afrique, la France a un rôle à jouer en la
matière.
La dimension environnementale n'est pas absente de la politique
française d'aide au développement. Au sein de la direction de la
Coopération du ministère des Affaires étrangères,
le Bureau Gestion des ressources naturelles et environnement veille au respect
par la France de ses engagements dans le cadre des AME, et à
l'intégration de l'environnement dans le processus de
développement de nos pays partenaires.
Il convient donc simplement
d'amplifier et de systématiser les efforts fournis en la
matière.
Les principaux axes de travail du ministère rejoignent les
priorités identifiées dans ce rapport en matière de
protection de l'environnement. Sont en effet jugés prioritaires par le
ministère :
- la gestion durable des ressources halieutiques ;
- la préservation des forêts tropicales humides ;
- la gestion des ressources en eau ;
- et la protection de la biodiversité.
La stratégie du ministère privilégie à juste titre
le développement durable plutôt que la seule protection des
ressources : l'adhésion des populations à la protection de
l'environnement ne peut être acquise en l'absence de développement
économique. Ainsi, par exemple, dans le domaine forestier, l'Agence
Française de Développement passe avec les entreprises
exploitantes des contrats qui prévoient une gestion durable des
ressources, et une participation des populations locales aux
bénéfices de l'exploitation forestière. Dans le domaine de
la pêche, la politique française s'attache à apporter une
assistance pour l'évaluation du potentiel exploitable, et pour la mise
en oeuvre de plans de gestion et d'autres mesures de régulation de
l'effort de pêche, ainsi que pour la valorisation des produits de la
pêche qui doit permettre de compenser, pour partie, la stabilisation des
captures.
3. Préciser les règles de transparence pour les grands groupes
2003 a
été la première année d'application de la loi
Nouvelles Régulations économiques, votée en mai 2001.
Cette loi a mis à la charge des entreprises cotées de nouvelles
obligations de
publication d'informations
relatives à leurs
pratiques sociales et environnementales
. Renforcer les règles de
transparence en vigueur dans le monde de l'entreprise est une manière
indirecte de réguler la mondialisation. Dans la mesure où les
entreprises sont sensibles aux « effets de
réputation », et à la pression des consommateurs et des
ONG, accroître la transparence favorise le suivi des bonnes pratiques.
Il est sans doute trop tôt pour dresser un bilan de l'application de la
loi NRE. On peut toutefois observer que la précision et la
densité des données sociales et environnementales publiées
est très variable d'une entreprise à l'autre. Tous les groupes ne
traitent pas ces nouvelles obligations avec la même rigueur.
Comme la loi ne précise pas le périmètre du groupe
concerné par ses dispositions, certaines entreprises se sont
contentées de publier des informations relatives à leurs sites
localisés en France. D'autres publient des rapports environnementaux qui
ne comportent aucun indicateur chiffré.
Il est possible que la qualité des rapports sociaux et environnementaux
s'améliore dans les prochaines années, sous l'effet des pressions
des acteurs sociaux, et à mesure que les entreprises développent
leurs procédures internes de collecte de données. Quelques pistes
de réflexion peuvent néanmoins être évoquées
concernant les modifications à apporter à la loi NRE (ou à
ses décrets d'application) : préciser le
périmètre du groupe, en y incluant les activités des
filiales étrangères, notamment celles implantées dans les
pays du Sud ; étendre le champ d'application de la loi aux grandes
entreprises non cotées ; définir quelques
indicateurs-clés chiffrés. Par ailleurs, il pourrait être
utile de prévoir une possibilité de sanction en cas de non
respect de ces obligations.
4. Renforcer la prise de conscience des enjeux liés à l'environnement et à la mondialisation dans toutes les administrations
Les
ministères sont organisés selon un principe de
spécialisation, alors que les problématiques liées
à la mondialisation et à l'environnement sont éminemment
transversales. Trop souvent, l'environnement est considéré comme
une donnée exogène, alors qu'il devrait être
intégré à toutes les politiques nationales. De même,
la mondialisation n'intéresse pas les seuls ministères des
Affaires étrangères, ou du Commerce extérieur, mais
affecte un grand nombre de politiques internes.
Des progrès ont certes été réalisés.
Notamment, l'institution d'un ambassadeur délégué à
l'environnement a permis une meilleure implication du ministère des
Affaires étrangères dans ce domaine, et a amélioré
la coordination avec le ministère de l'Ecologie et du
Développement durable. Les échanges entre administrations
pourraient cependant encore être approfondis. Comme le notait en 2002 le
Commissariat général du Plan
54
(
*
)
, «
à la différence d'une
pratique constante de l'administration britannique, les informations
recueillies par les différents ministères ne sont pas, sauf
exception, répercutées sur les autres. Les renseignements obtenus
au sein des postes diplomatiques sur les positions de nos partenaires [...] ne
sont pas répercutés sur l'ensemble des administrations
parisiennes qui suivent ces dossiers. Il n'existe pas de réunion
stratégique des responsables de haut niveau des différentes
administrations pour examiner, dans leur ensemble, ces sujets (liés aux
problèmes globaux)
». Il semble donc possible de
progresser encore vers un décloisonnement des administrations, et
d'améliorer la transmission des informations entre ministères.
L'appréhension des dossiers globaux pourrait justifier des
réunions régulières des principaux directeurs
concernés (issus du ministère de l'Economie et des Finances, du
Quai d'Orsay, du ministère de l'Agriculture, de l'Environnement, etc.).
Il est également souhaitable de mieux associer en amont les
représentants de la société civile et des ONG à la
définition de la position internationale de la France. Des consultations
existent d'ores et déjà, mais celles-ci sont souvent trop
tardives pour permettre d'infléchir la position française.
Enfin, pour marquer la priorité nouvelle à accorder aux enjeux
globaux et à la solidarité internationale, la France pourrait se
doter d'un ministère du Développement mondial, sur le
modèle du
Department for International Development
britannique.
Ce ministère aurait la charge des politiques de coopération, de
solidarité internationale, d'action humanitaire et de défense des
droits de l'homme. Il devrait promouvoir une approche globale des questions de
mondialisation et de développement.
CONCLUSION
Ce
rapport se veut une contribution au débat très animé sur
la mondialisation. Il ne prétend pas clore la discussion : au
contraire, la proposition de créer un Observatoire national des effets
de la mondialisation montre que ces analyses et ces réflexions doivent
être prolongées et débattues.
Ce rapport a montré que la mondialisation comportait deux aspects :
elle se définit, d'une part, comme un processus d'intégration des
économies, qui se manifeste par l'accroissement des flux commerciaux et
financiers internationaux ; mais elle se traduit aussi par une prise de
conscience grandissante de l'existence de biens publics mondiaux, dont la
préservation requiert un effort soutenu de coopération entre les
nations.
En dépit des progrès de la globalisation, l'économie
mondiale demeure moins intégrée que peut l'être une
économie nationale. En effet, des obstacles tarifaires et non tarifaires
aux échanges demeurent. La volatilité des taux de change est un
autre frein à l'expansion du commerce international.
Par ailleurs, il est légitime de refuser que le libre-échange
soit étendu, sans restriction, à tous les secteurs
d'activité ; la préservation d'un modèle agricole et
rural original, la défense des politiques culturelles ou des services
publics, imposent des aménagements aux règles commerciales
ordinaires.
De plus, la mondialisation fonctionne aujourd'hui sur un mode
profondément inégalitaire. De nombreux pays en
développement ne participent que marginalement aux échanges
internationaux. Au contraire, certains Etats ont renforcé leur
intégration au sein de zones de libre-échange régionales.
Il serait souhaitable que les regroupements régionaux soient promus
parmi les pays du Sud, comme une étape préparatoire avant leur
participation pleine et entière à la mondialisation.
La spécialisation internationale résultant de l'ouverture aux
échanges ne semble pas particulièrement défavorable
à l'environnement. Si des cas de délocalisation pour raison
environnementale sont avérés, on n'observe pas de transferts
massifs d'activités polluantes vers les pays du Sud. Plusieurs facteurs
expliquent ce résultat : les secteurs d'activité les plus
polluants (chimie, papier, métallurgie, raffinage...) sont aussi des
secteurs très capitalistiques, pour lesquels les pays
développés conservent un avantage comparatif ; les firmes
multinationales ont, en outre, tendance à utiliser les mêmes
procédés de production dans les pays du Sud que dans leur pays
d'origine, et participent ainsi à la diffusion de technologies modernes
plus respectueuses de l'environnement ; enfin, les firmes opèrent
sous le regard de l'opinion publique et des ONG qui sont de plus en plus
sensibilisées aux questions environnementales.
En revanche, l'accélération de la croissance, stimulée par
la libéralisation des échanges, est source de dégradations
supplémentaires de l'environnement. Certes, dans les pays où le
revenu s'élève, de nouvelles exigences citoyennes se font jour,
qui peuvent conduire à un renforcement des normes environnementales,
puis à une amélioration de la qualité de l'environnement.
Dans les faits, toutefois, une telle amélioration n'a été
observée que pour certaines pollutions très localisées
touchant directement les populations.
On ne peut donc s'en remettre à la seule croissance économique
pour sauvegarder l'environnement.
Des politiques environnementales plus
ambitieuses sont nécessaires, en premier lieu dans les pays du
Nord
, qui sont les principaux responsables de la
détérioration de l'environnement. La concurrence internationale
ne constitue pas aujourd'hui une contrainte telle qu'elle empêche
d'avancer sur cette voie. Un renforcement de la réglementation
stimulerait la recherche de techniques respectueuses de l'environnement, qui
pourraient ensuite être diffusées dans les pays en
développement. De la même manière, il n'est pas
illégitime que des accords internationaux fassent porter l'effort
principal sur les pays du Nord, et permettent aux pays en développement
de s'y rallier plus tardivement.
Les politiques environnementales nationales doivent être
complétées par une action internationale plus résolue en
matière de protection de
l'environnement
. La création
d'une Organisation mondiale de l'Environnement enverrait le signal d'une
mobilisation de la communauté internationale. Un nombre croissant
d'Etats se rallient à cette proposition, défendue publiquement
par la France. Il faut également réfléchir à la
création, à moyen terme, d'une taxation écologique
internationale, qui créerait une incitation à diminuer les
émissions de gaz à effet de serre, tout en générant
des ressources, qui pourraient être affectées, au moins en partie,
à la gestion de biens publics mondiaux. De nouvelles conventions
internationales pourraient être négociées, notamment pour
contrer les phénomènes de déforestation et
d'épuisement des ressources halieutiques.
Les décisions de l'Organisation mondiale du Commerce sont susceptibles
d'avoir un impact sur l'environnement, et il est donc important que les
préoccupations environnementales soient défendues au sein de
cette organisation. De cette réflexion découle l'idée
d'imposer la présence « d'experts environnementaux »
au sein des panels de l'Organe de règlement des différends,
lorsque sont en jeu des questions environnementales. En cas de conflit entre
les règles commerciales et un accord multilatéral
environnemental, une procédure de consultation pourrait être
envisagée. Si aucune conciliation entre les règles en
présence n'est possible, l'OMC devrait admettre les restrictions au
commerce contenues dans les accords environnementaux contractés de bonne
foi.
Outre les initiatives à prendre à l'échelle
multilatérale, il faut souligner la contribution que peut apporter
l'Union européenne à une meilleure maîtrise des effets de
la mondialisation sur l'environnement. Il faut soutenir les efforts de l'Union
européenne pour mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto, et encourager la
nouvelle orientation « verte » de la Politique agricole
commune, qui subordonne le versement de certaines subventions au respect de
critères écologiques. La croissance du commerce entraînant
mécaniquement un développement des transports, un investissement
soutenu dans les infrastructures de transport est nécessaire, notamment
afin de moderniser les réseaux des nouveaux Etats membres. Les pays
européens pourraient également demander que soit
étudiée au sein de l'Organisation de l'aviation civile
internationale une éventuelle taxation du kérosène.
Au niveau national, votre rapporteur propose la création d'un
Observatoire national des effets de la mondialisation, qui produirait une
expertise utile aux décideurs et animerait le débat public. La
France dispose, en outre, de leviers pour peser sur le cours de la
mondialisation. Il convient ainsi d'amplifier les efforts menés pour
intégrer les considérations environnementales à notre
politique d'aide au développement. Les obligations des grandes
entreprises en matière d'information sur leurs pratiques
environnementales pourraient être précisées. Il faut enfin
renforcer la coordination entre ministère sur les dossiers transversaux
liés à la mondialisation, et mieux associer la
société civile et les ONG à la prise de décision.
ANNEXES
ANNEXE 1 : CORRÉLATION ENTRE COMMERCE
ET CROISSANCE SUR LA BASE DE COMPARAISONS ENTRE PAYS
|
Source et pays couverts |
Indice d'ouverture au commerce |
Résultats |
|
Michaely
(1977),
|
Taux de croissance de la part des exportations |
Corrélation positive entre les exportations et la croissance.
|
|
Feder
(1983),
|
Croissance des exportations pondérées par la part des exportations dans le PIB. |
Liens positifs entre la croissance du PIB et la croissance des exportations. |
|
Syrquin et Chenery (1989), pays divers |
Part des exportations dans le PIB après ajustement pour tenir compte de la taille du pays et de la spécialisation des exportations |
Le taux de
croissance est plus élevé pour les pays ouverts sur
l'extérieur dans tous les sous-groupes : petits exportateurs de
produits primaires, grands exportateurs de produits primaires, petits
exportateurs de produits manufacturés, grands exportateurs de produits
manufacturés.
|
|
Balassa
(1985),
|
Indice d'ouverture sur le commerce extérieur défini sur la base de la différence entre les exportations effectives et prédites. |
Les pays tournés vers l'extérieur croissent plus rapidement. |
|
Edwards
(1992),
|
Indice d'ouverture de Leamer (1988) fondé sur l'écart entre le commerce prédit et le commerce effectif. |
Les pays plus ouverts (moins interventionnistes) ont tendance à croître plus rapidement. |
|
Banque
mondiale (1987),
|
Les pays sont classés en quatre groupes : fortement tournés vers l'intérieur, modérément tournés vers l'intérieur, modérément tournés vers l'extérieur, fortement tournés vers l'extérieur. |
Les pays tournés vers l'extérieur ont tendance à croître plus rapidement. |
|
Sachs et Warner (1995), pays divers |
Indice d'ouverture établi sur la base de cinq critères. |
Les pays
ouverts croissent plus rapidement que les pays fermés, avec un
écart de 2 à 2,5 points de pourcentage.
|
|
Proudman,
Redding et Bianchi (1997),
|
Indice d'ouverture établi sur la base de plusieurs mesures de l'orientation de la politique de commerce extérieur |
Les pays
ouverts convergent vers un niveau de revenus plus élevé.
|
|
Barro
(1991),
|
Indice de distorsion des prix des biens d'équipement (écart à parité de pouvoir d'achat par rapport à la moyenne de l'échantillon pour les biens d'équipement). |
La distorsion des prix des biens d'équipement réduit la croissance. |
|
Dollar
(1992),
|
Distorsion du taux de change |
Le taux de
croissance par habitant moyen dans le quartile des pays (principalement
asiatiques) dans lesquels la distorsion était la plus faible
était de 2,9 % ; dans le deuxième quartile, le taux de
croissance était de 0,9 %, dans le troisième il était
de - 0,2 % et dans le quatrième de - 1,3 %.
|
|
Easterly
(1993),
|
Indice mesurant la distorsion entre les prix relatifs du marché mondial et les prix relatifs intérieurs. |
Plus la distorsion est grande, plus la croissance diminue. Lorsque la distorsion augmente d'un écart type, le taux de croissance diminue de 1,2 point de pourcentage. |
|
Lee
(1993),
|
Indice mesurant à quel degré le commerce est faussé par rapport au niveau qu'il atteindrait en régime de libre-échange du fait des distorsions introduites par le taux de change réel et les droits de douane. |
Le taux de
croissance augmente lorsque la distorsion diminue.
|
|
Harrison
(1995),
|
Sept indices : libéralisation du commerce extérieur (1960-1984), prime du marché noir, part du commerce dans le PIB, distorsion du taux de change réel, évolution vers les prix internationaux, distorsions au détriment de l'agriculture. |
Tous les
indices statistiquement signifiants font apparaître une
corrélation entre un régime de commerce extérieur
libéral et la croissance du PIB.
|
|
Edwards (1997), pays divers |
Neuf indices : indice d'ouverture de Sachs-Warner (1995), indice d'ouverture vers l'extérieur de la Banque mondiale (1987), indice d'ouverture de Leamer (1988), prime du marché noir, droit d'importation moyen sur les produits manufacturés, champ d'application des obstacles non tarifaires, indice des distorsions du commerce, ratio du produit des impôts sur le commerce, indice de Wolf (1993) de la distorsion des importations. |
Il y a une
corrélation positive entre les indices d'ouverture et la croissance de
la productivité totale des facteurs, et une corrélation
négative avec l'image symétrique des indices de distorsion du
commerce.
|
|
Matin
(1992),
|
Quatre indices : part du commerce extérieur, prime du marché noir, indice de libéralisation du commerce extérieur, distorsion du taux de change réel. |
.Tous les
indices qui sont statistiquement significatifs font apparaître une
relation positive entre un régime de commerce extérieur
libéral (faible distorsion) et la croissance.
|
|
Levine et
Renelt (1992),
|
Analyse de sensibilité pour des indices multiples avec régression interpays. |
Nette
corrélation positive entre la croissance et la part de l'investissement
dans le PIB.
|
|
Gallup et
Sachs (1998),
|
Indice de Sachs-Warner (1995). |
Il y a une
corrélation positive entre l'indice d'ouverture et la croissance,
après ajustement pour tenir compte des autres facteurs.
|
|
Balasubramanyam, Salisu et Sapsfort (1996),
|
Indicateur d'ouverture de la Banque mondiale. |
La réduction des obstacles au commerce renforce l'efficience de l'IED et, indirectement, la croissance. |
|
Source : Rapport annuel 1998 de l'OMC, chapitre IV |
||
COMPTES RENDUS D'AUDITIONS
Audition de M. Charles-Albert Michalet,
professeur
à l'Université Paris-IX-Dauphine, le 12 mars 2003
M.
Charles-Albert Michalet, professeur d'économie à
l'Université Paris IX Dauphine, consultant auprès d'organisations
internationales
, a débuté son exposé en proposant une
définition de la mondialisation. Selon
M. Charles-Albert
Michalet
, la mondialisation est un phénomène
multidimensionnel, qui recouvre trois éléments principaux :
le développement des flux d'échanges ; la
délocalisation de la production ; et les mouvements financiers. Ces
trois éléments sont interdépendants ; la constitution
d'une firme multinationale comme Vivendi par exemple a supposé des
mouvements de capitaux et génère des flux de marchandises et de
services.
Sur le plan politique, les avancées de la mondialisation s'accompagnent
d'un affaiblissement de l'idée d'Etat-Nation, que révèlent
notamment les mouvements d'intégration régionale. Les
références à la balance commerciale sont
dépassées, comme l'illustre le cas américain : les
entreprises américaines vendent énormément à
l'étranger
via
leurs filiales basées hors du territoire
américain. Ces transactions ne sont pas retracées dans les
statistiques de balance commerciale portant sur les exportations.
L'attractivité du territoire est devenue un nouvel objectif de politique
économique.
La globalisation met aussi en cause la gouvernance de l'économie
mondiale. Le modèle de Bretton-Woods, fondé sur la
coopération intergouvernementale apparaît dépassé.
Le « consensus de Washington » a, dans les années
1980, prôné la régulation par le marché, et la
diminution de l'interventionnisme étatique. Or, il apparaît que le
marché mondial, oligopolistique, est très éloigné
du modèle théorique de concurrence pure et parfaite, et est
intrinsèquement instable.
M. Charles-Albert Michalet
a ensuite souligné que la
mondialisation était encore loin d'être un phénomène
planétaire. Seuls certains pays sont concernés : outre les
pays de la Triade -- Union européenne, Amérique du Nord, et
Japon --, il s'agit d'une quinzaine d'économies
émergentes : Chine, Inde, Nouveaux Pays Industrialisés (NPI)
et Tigres d'Asie, Mexique, Chili, et Brésil en Amérique latine,
Pologne, Hongrie, Slovénie et République tchèque en Europe
centrale. Les pays restés à l'écart de la mondialisation
cherchent désespérément à attirer les
investissements étrangers car ils redoutent la marginalisation.
M. Charles-Albert Michalet
en est ensuite venu plus
précisément aux questions d'environnement. Il s'est d'abord
interrogé sur la notion de bien public mondial. Le concept de bien
public a été forgé dans les années cinquante par
les économistes Musgrave et Samuelson. Un pont, un phare, un
réverbère sont des biens publics. Leur fourniture est
assurée par l'Etat, et financée par les contribuables
résidant dans le pays. La transposition de la notion de bien public
à l'échelle mondiale pose la question du financement de la
production de tels biens. S'il est vrai que les problèmes
d'environnement ignorent les frontières, il n'y a pas d'Etat mondial
ayant naturellement vocation à assurer sa protection. Le rapport
« Gouvernance mondiale » du Conseil d'analyse
économique préconise de relancer l'Organisation des
Nations-Unies, et de créer une Organisation mondiale de l'environnement,
qui viendrait compléter ses autres agences spécialisées
(FMI et Banque mondiale, OMS, OIT, etc.). Il est cependant peu crédible
d'envisager la création d'une telle organisation à court terme.
Les initiatives des grands groupes privés ont un rôle à
jouer en matière de préservation de l'environnement. Nombreux
sont ceux qui élaborent des Chartes de bonne conduite en vue d'un
meilleur respect de l'environnement. Les mécanismes de marché
peuvent être utilisés à des fins de protection de
l'environnement, comme le montre le marché de droits à polluer
proposé dans le cadre du protocole de Kyoto.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a demandé à
M.
Charles-Albert Michalet
pourquoi il était sceptique sur la
possibilité de créer une Organisation mondiale de
l'Environnement.
M. Charles-Albert Michalet
a dit douter de l'efficacité d'une
telle institution. Il lui faudrait, pour être efficace, mobiliser
d'importantes ressources. Or, les phénomènes de passagers
clandestins (
free-riders
) risquent d'être massifs. Beaucoup
d'Etats ne voudront pas payer pour financer la lutte contre l'effet de serre,
ou la déforestation.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a alors évoqué la
question des taxes mondiales.
M. Charles-Albert Michalet
a indiqué que la taxe Tobin, sur les
mouvements de capitaux, n'était pas, selon lui, une option viable. Si
une écotaxe internationale était créée, se poserait
la question de savoir quelle institution serait chargée de la percevoir.
Il faudrait que les Etats reversent les prélèvements à une
organisation internationale, et un accord sur ce point paraît difficile
à atteindre. En ce qui concerne l'environnement, les firmes
multinationales peuvent prendre, de leur côté, des initiatives
concertées, comme l'illustre l'initiative du groupe des Sept, dont fait
partie Electricité de France, qui vise à promouvoir des
techniques de production énergétique moins polluantes. Ces
techniques nouvelles entraînent cependant un surcoût de production
de 15 à 20 % ; or, les pays pauvres tendent à
privilégier les prix les plus bas.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a ensuite demandé si la
mondialisation était de nature à creuser les écarts de
niveaux de vie, ou si elle allait au contraire favoriser le décollage
des pays les moins avancés.
M. Charles-Albert Michalet
s'est dit favorable à la
mondialisation. Il a souligné que les pays du Sud souhaitaient
s'industrialiser, exporter, et s'intégrer au mouvement de mondialisation
en cours. Il a cité l'exemple de l'Algérie, qui a adopté
en août 2001 une ordonnance sur les investissements d'inspiration
très libérale, et celui de l'Inde vers laquelle des banques
américaines délocalisent aujourd'hui une part de leurs
activités d'analyse financière. La croissance des pays du Sud est
souvent entravée par des problèmes de gouvernance à
l'échelle locale. L'Algérie a pâti d'un contexte
d'insécurité, et la Russie d'un climat d'incertitude
politique ; les chefs d'entreprise ont besoin d'un horizon de
stabilité politique à cinq ans pour investir. L'Afrique reste,
à ce jour, à l'écart de la mondialisation ; les
investissements étrangers y sont concentrés dans le secteur
minier et dans celui des plantations, soit les mêmes secteurs qu'au
XIX
e
siècle.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a alors souhaité savoir si
la constitution de grands ensembles économiques régionaux
était une réponse adaptée à la mondialisation.
Pour
M. Charles-Albert Michalet
, l'exemple de la Communauté
économique européenne suggère qu'une union
douanière produit de bons résultats lorsqu'elle intervient entre
pays ayant des niveaux de développement économique inégaux
- ce qui constitue une rupture par rapport à l'analyse théorique
traditionnelle présentée par J. Viner il y a 50 ans.
L'Accord de libre-échange nord-américain (Alena) rassemble des
pays de niveaux de développement inégaux, et a favorisé un
phénomène de division internationale du travail. Les firmes
multinationales recherchent, à la fois, un accès facile aux
marchés et des coûts de production bas. Des investissements au
sein de l'Alena permettent d'atteindre simultanément ces deux objectifs.
L'élargissement de l'Union européenne devrait favoriser des
évolutions similaires.
M. Charles-Albert Michalet
a cité
l'exemple de Peugeot qui peut embaucher des ingénieurs en Slovaquie pour
un coût de 770 euros par mois, contre 13 850 euros, charges
comprises, pour un ingénieur français. L'ASEAN (Association des
nations du sud-est asiatique) offre un autre exemple de division internationale
du travail ; l'intégration économique de la zone a
été assurée par les délocalisations des firmes
japonaises, et par l'action des communautés chinoises. Par ailleurs, les
créations d'emplois dans les pays du Sud présentent l'avantage de
réduire la pression des flux migratoires.
La création de grands ensembles régionaux ne permettra cependant
pas de résoudre certains problèmes environnementaux, qui sont,
par essence, de dimension planétaire. En l'absence d'organisation
satisfaisante à l'échelle de la planète, la fonction de
gouvernance mondiale est assurée, par défaut, par les Etats-Unis
d'Amérique, la puissance dominante.
Pour terminer,
M Serge Lepeltier, sénateur
, a demandé s'il
était plus facile d'améliorer la gouvernance mondiale dans le
domaine de l'environnement que dans celui de l'économie.
M. Charles-Albert Michalet
estime qu'il est vraisemblablement plus
facile de mobiliser les opinions publiques autour d'enjeux écologiques
qu'autour d'enjeux économiques. De ce point de vue, les Etats-Unis font
aujourd'hui figure d'accusés, en raison de leur refus de ratifier le
protocole de Kyoto.
Audition de M. Dominique Plihon, professeur à l'université Paris XIII, président du conseil scientifique d'ATTAC FRANCE, le 12 mars 2003
Après avoir été accueilli par
M. Serge
Lepeltier, sénateur, rapporteur
,
M. Dominique
Plihon, universitaire, et président du
conseil scientifique d'ATTAC France
, a débuté l'audition par
un exposé présentant les principales réflexions d'ATTAC
(Association pour la taxation des transactions financières pour l'aide
aux citoyens) sur le thème de la mondialisation.
M. Dominique Plihon a d'emblée souligné l'importance que les
notions de « mondialisation », de « biens publics
mondiaux », ou de « gouvernance » ont prise dans
le débat public contemporain. Les citoyens se sont appropriés ces
notions qu'il convient dès lors d'approfondir et de mieux
définir.
Certains historiens font remonter le début du processus de
mondialisation au XVI
e
siècle (Grandes découvertes). A
tout le moins, on peut affirmer qu'une phase longue de mondialisation est en
cours depuis le XIX
e
siècle, ce qui n'exclut pas des
périodes de régression.
La mondialisation est un phénomène complexe, qui comporte trois
dimensions principales :
* un processus d'internationalisation, c'est-à-dire de
développement des échanges entre les nations ;
* un processus de multinationalisation, caractérisé par la
croissance des firmes multinationales et des investissements directs à
l'étranger ;
* un processus de globalisation, qui conduit à ce que les
décisions des firmes échappent à toute
considération nationale.
La globalisation conduit à un affaiblissement de l'Etat-Nation, qui est
révélé tant par la dérégulation de
l'économie, que par l'érosion de la base fiscale résultant
de la grande mobilité de certains facteurs de production.
M.
Dominique Plihon
estime, à cet égard, que l'on est sans doute
allé trop loin dans le processus de dérégulation dans les
années 1970 et 1980.
La mondialisation pose, selon ATTAC, trois grands types de problèmes.
* L'économie mondiale devient plus instable au fil du temps : la
période 1945-1975 était plus stable que la période qui a
suivi. Crises de change, crises bancaires, et crises boursières se sont
multipliées au cours des vingt dernières années. Les deux
tiers des pays membres du Fonds monétaire international ont, par
exemple, connu une crise bancaire grave au cours de cette période.
* Les inégalités s'accentuent à l'échelle du globe.
Il n'y a pas de village global, mais plutôt un archipel, isolé,
composé des pays de la Triade (Amérique du Nord, Union
européenne, et Japon) et de quelques pays émergents (Asie du
Sud-Est, Chine et Inde, pays d'Europe centrale et orientale, quelques pays
d'Amérique latine). Cet archipel est environné d'environ 150
pays, en passe d'être distancés, ce qui dessine un monde de plus
en plus polarisé. De nombreux pays sont à l'écart des
mouvements de capitaux, ou de la diffusion des innovations.
* Enfin, notre modèle de développement actuel est insoutenable
à long terme. L'humanité ne pourra survivre si les tendances
actuelles se poursuivent, ce qui explique le succès de la notion de
développement durable. La planète est confrontée aux
défis, entre autres, de l'effet de serre, du manque d'eau potable, ou de
l'épuisement des ressources non-renouvelables. Si la Chine consommait
demain autant de pétrole, de papier, ou d'eau que les Occidentaux, les
ressources mondiales seraient vite épuisées.
La notion de développement durable renvoie à une idée de
préservation d'un capital social, culturel et environnemental. Elle
implique de respecter la diversité sociale et culturelle du monde, sans
chercher à exporter en toutes circonstances notre culture ou notre
modèle politique. ATTAC souhaite la mise en place d'un ordre
international fondé sur un objectif de développement durable, ce
qui suppose une nouvelle hiérarchie des normes internationales.
ATTAC reproche aux organisations internationales telles que le Fonds
Monétaire international (FMI), la Banque mondiale, ou l'Organisation
mondiale du Commerce (OMC) de ne pas être gérées de
manière démocratique, et d'obéir à une logique
libérale, qui tend à la marchandisation de toutes les
activités humaines. On peut craindre par exemple que les
négociations en cours relatives au commerce des services ne
débouchent sur une marchandisation accrue du secteur de
l'éducation.
Le marché est considéré comme la seule instance de
régulation, alors que des problèmes ne peuvent pas être
traités par les mécanismes de marché. Le marché
est, en particulier, incapable de prendre en compte les externalités
négatives, telles que la spéculation financière ou la
pollution. Ces coûts sociaux ne sont pas pris en compte
spontanément par les agents privés. Il faut donc obliger les
entreprises, par la réglementation ou la taxation, à internaliser
ces coûts externes.
M. Dominique Plihon
a ensuite insisté sur la
nécessité de gérer collectivement, et à
l'échelle mondiale, certains biens et services, tels que le patrimoine
naturel, la connaissance et l'éducation, ou la santé. Il a
plaidé en faveur d'un retour de la régulation à
l'échelle mondiale. Une nouvelle hiérarchie des normes devrait
être instaurée, qui placerait au premier rang le respect des
droits fondamentaux, puis la Charte des Nations-Unies, suivis des règles
édictées en matière sociale, culturelle, et
environnementale, par l'Organisation internationale du travail, l'UNESCO,
l'Organisation mondiale de la Santé, ou par une éventuelle
Organisation mondiale de l'Environnement, dont la création est
souhaitable. Les règles commerciales et financières viendraient
seulement ensuite. L'OMC devrait, par ailleurs, être rattachée au
système des Nations-Unies. L'OMC et le FMI seraient placés dans
une position subordonnée par rapport aux organisations à objet
social, sanitaire, ou environnemental. L'ordre juridique international devrait,
enfin, être organisé de manière telle qu'il permette aux
acteurs d'ester en justice pour faire respecter cette hiérarchie des
normes.
M. Serge Lepeltier, sénateur, rapporteur
, a alors demandé
si les ressources énergétiques devaient être
considérées comme un bien public mondial.
M. Dominique Plihon
a répondu que l'on pouvait admettre que
l'énergie soit gérée par le secteur privé, mais
avec une tutelle forte des pouvoirs publics, notamment pour tenir compte du
risque de raréfaction de certaines ressources non-renouvelables, comme
le pétrole.
M. Serge Lepeltier, sénateur, rapporteur
, s'est ensuite
demandé si le fait d'exclure le secteur de la santé des
mécanismes de marché ne risquait pas d'induire des gaspillages,
et ne poserait pas des problèmes de régulation.
M. Dominique Plihon
a estimé que le secteur de la santé
n'était, en réalité, pas exclu des mécanismes de
marché. Les entreprises pharmaceutiques, en particulier, sont toutes des
entreprises privées. Il convient dans ces conditions d'encadrer et de
réguler le marché. Cet impératif de régulation est
manifeste dans d'autre secteur que celui de la santé. Comment par
exemple garantir la diversité culturelle si une seule entreprise
contrôle l'édition ? Le même raisonnement vaut pour le
secteur du logiciel, avec la domination de l'entreprise Microsoft. L'Etat peut
intervenir en nationalisant, ou en mettant sous tutelle certains secteurs. Les
activités d'adduction d'eau dans les pays en développement
devraient, par exemple, être placées sous un contrôle
beaucoup plus étroit des pouvoirs publics.
M. Serge Lepeltier, sénateur, rapporteur
, s'est alors
interrogé sur la pertinence d'une écotaxe internationale, qui
serait assise sur les consommations d'énergies non-renouvelables.
M. Dominique Plihon
a rappelé que les taxes globales
poursuivaient deux objectifs : prélever des ressources, et lutter
contre des externalités négatives (ces deux objectifs peuvent
d'ailleurs être contradictoires). Il s'est dit d'accord avec
l'idée de créer une écotaxe dont les recettes
financeraient une future Organisation mondiale de l'Environnement. Elle
financerait la recherche dans le domaine des énergies alternatives
(énergie éolienne, hydrogène, fusion nucléaire...).
Mais l'institution d'une écotaxe mondiale ne doit pas nous dispenser de
réfléchir aussi à l'instauration d'une taxe mondiale sur
le capital.
M. Dominique Plihon
pense que la taxe Tobin n'est pas la
seule forme possible de contrôle des capitaux, comme le montre l'exemple
chilien. En attendant,
M. Dominique Plihon
a proposé la
création d'un « impôt de Bourse »,
prélèvement à très faible taux opéré
sur toutes les transactions boursières. Il a rappelé que cet
impôt existait au Royaume-Uni, sans que cela nuise à la
prospérité de la place financière de Londres. Cet
impôt alimenterait un Fonds mondial pour le développement, qui
investirait dans les biens publics des pays en développement
(santé, éducation...).
M. Dominique Plihon
a ajouté que certains régimes
risquaient de confisquer, ou de mal employer, ces ressources. Il ne faut
dès lors pas hésiter à confier ces ressources à des
ONG ou à des collectivités locales, surtout si les Etats qui
reçoivent ces ressources ne sont pas démocratiques.
M. Serge Lepeltier, sénateur, rapporteur
, a souligné le
caractère révolutionnaire de ces propositions. Elles supposent de
choisir les Etats auxquels on accepte de confier des capitaux, et ceux que l'on
préfère contourner.
M. Dominique Plihon
a indiqué qu'il percevait une certaine
maturation des opinions publiques, avec une prise de conscience plus forte des
problèmes soulevés par ATTAC, et une plus grande
réceptivité à des propositions audacieuses.
Puis
M. Serge Lepeltier, sénateur, rapporteur
, a abordé
les questions agricoles, et demandé si une diminution des subventions
versées aux agriculteurs du Nord pourrait avoir des effets positifs sur
les économies des pays du Sud.
M. Dominique Plihon
a répondu qu'il n'était pas contre les
subventions, mais qu'il défendait plutôt les propositions du
Commissaire européen Franz Fischler, c'est-à-dire une
déconnexion des subventions et de la production. L'agriculture remplit
de multiples fonctions : produire de la nourriture, préserver
l'environnement, aménager des territoires...Il est légitime de
subventionner certaines de ces fonctions, qui ne génèrent pas de
revenus pour les exploitants agricoles.
Lier les subventions à la production conduit à des
phénomènes de surproduction, et à une baisse des cours des
produits agricoles sur les marchés mondiaux, qui pénalise les
pays du Sud. Il faut donc avoir le courage politique de remettre en cause la
Politique agricole commune telle qu'elle existe actuellement.
M. Serge Lepeltier, sénateur, rapporteur
, a alors rappelé
que la France s'était engagée à discuter d'une
réforme de la PAC en 2006.
M. Dominique Plihon
s'est demandé pourquoi on ne discutait pas
dès maintenant de cette réforme.
M. Serge Lepeltier, sénateur, rapporteur
, a souhaité
quelques précisions sur les avantages que les pays du Sud retireraient
d'une baisse des subventions agricoles au Nord.
M. Dominique Plihon
a indiqué que les pays du Nord inondaient les
marchés du Sud avec des produits dont les prix sont maintenus
artificiellement bas par les subventions. Il faudrait au contraire
subventionner les agricultures du Sud pour les aider à se moderniser.
M.
Dominique Plihon
a achevé son intervention en
expliquant qu'une libéralisation généralisée de
tous les marchés n'était pas souhaitable, surtout pour les pays
les moins avancés, en s'appuyant sur la théorie du
protectionnisme éducateur. Aider les agriculteurs des pays du Sud
pourrait avoir des retombées positives pour l'environnement. Cela
éviterait par exemple que des paysans brésiliens très
pauvres ne pratiquent une culture sur brûlis, qui épuise les sols,
et conduit à la déforestation de vastes portions de territoires.
Audition de Mme Laurence Tubiana,
directrice de l'Institut du développement durable et des relations
internationales (IDDRI),
le 1er avril 2003
Mme
Laurence Tubiana, directrice de l'Institut du développement durable et
des relations
internationales (IDDRI)
, a commencé son
intervention en indiquant que l'Institut qu'elle dirigeait travaillait selon
deux axes de recherche prioritaires. Le premier a trait à la question
des biens publics mondiaux, et à celle de leur financement. Le second
touche au projet de création d'une Organisation mondiale de
l'Environnement (OME). Un débat oppose les partisans de la
création d'une telle organisation, à ceux qui la juge inefficace,
et qui préfèreraient que les préoccupations
environnementales soient intégrées directement dans les
règles du commerce international.
Mme Laurence Tubiana
a ensuite expliqué qu'il existait entre 150
et 200 accords internationaux relatifs à l'environnement, en comptant
les accords régionaux. Beaucoup d'accords ne sont toutefois pas
appliqués, tels les accords relatifs à la lutte contre la
désertification, ou la déforestation. L'accord relatif au climat
n'est toujours pas appliqué.
Puis
Mme Laurence Tubiana
a évoqué la question,
controversée, du lien entre ouverture aux échanges et croissance
économique. Les milieux académiques américains font preuve
aujourd'hui d'une grande prudence. L'idée d'une corrélation
positive entre ouverture aux échanges et croissance est remise en cause
par des économistes tels Dani Rodrick et Joseph Stiglitz.
Elle s'est ensuite interrogée sur la possibilité d'établir
une hiérarchie entre règles de l'Organisation mondiale du
Commerce (OMC) et accords multilatéraux environnementaux (AME). Il
serait possible, selon
Mme Laurence Tubiana
, d'envisager une
procédure d'avis, sollicités par les panels de l'Organe de
règlement des différends (ORD), auprès du
secrétariat de l'accord environnemental concerné.
Mme Laurence Tubiana
est revenue sur l'évolution de la politique
américaine dans le domaine de la gouvernance internationale. De 1995
à 2000, l'idée dominante était celle d'un progrès
continu vers la constitution d'un système complet de droit
international, avec des régimes couvrant à peu près tous
les domaines. L'Administration Clinton défendait des positions
très multilatéralistes, mais sans être soutenue par le
Congrès. Depuis 2000 et l'arrivée aux affaires de
l'Administration Bush, un recul très net est perceptible sur ces
dossiers. Mme Laurence Tubiana a regretté l'échec de la
Conférence de La Haye, en 2000, qui devait préciser les
conditions d'application du Protocole de Kyoto. Un bon compromis avait en effet
été trouvé sur la question de l'observance des accords.
Mme Laurence Tubiana
a proposé de mener une réflexion sur
la pluralité des modalités d'application des traités
environnementaux :
* leur application peut être laissée à l'initiative de
groupes pionniers de pays, qui souhaitent agir en commun;
* on peut concevoir que des accords comme le protocole de Kyoto soient
considérés comme des Chartes guidant la conduite des acteurs
économiques, même sans engagement juridiquement contraignant des
Etats ; ainsi des entreprises américaines ou européennes se
sont-elles volontairement engagées à respecter les objectifs de
Kyoto ( Shell, Lafarge, etc. ) ;
* il faudrait imaginer enfin des outils incitatifs au respect de ces
accords : création de procédures de vérification et
de suivi de l'application des traités, mise en cause publique des Etats
contrevenants, permettant de jouer sur les effets de
« réputation », voire mécanismes de sanctions
économiques. Les pratiques privées, des collectivités
locales,
etc.
devraient aussi faire l'objet d'un suivi.
Le système international actuel résulte d'accords conclus entre
Européens et Américains, auxquels des pays en
développement ont ensuite adhéré. Il est important
d'associer plus fortement, à l'avenir, les pays du Sud à la
définition des règles internationales.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, est alors intervenu pour demander
si les pays en développement étaient, dans l'ensemble, sensibles
aux questions environnementales.
Mme Laurence Tubiana
a répondu que les pays en
développement étaient de plus en plus sensibilisés
à ces questions. Elle a souligné que les autorités
chinoises, par exemple, étaient préoccupées par les
problèmes de pollution urbaine, de pollution des eaux
côtières, qui entrave l'aquaculture, ou par les problèmes
de déforestation. Il est vrai, cependant, que, dans les enceintes
internationales, les pays du Sud accusent fréquemment les pays
développés d'exploiter les questions environnementales à
des fins protectionnistes. Pour se prémunir contre cette critique, il
est important que de grands pays émergents (Chine, Inde,
Brésil...) soient coproducteurs des normes internationales.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a alors évoqué
l'idée de créer une taxe internationale.
Mme Laurence Tubiana
a indiqué que les Etats-Unis s'opposaient,
dans les enceintes onusiennes, à ce que des réflexions soient
menées autour de projets de taxe internationale. Ces projets ont donc
fort peu de chances d'aboutir dans un avenir proche.
L'encadrement des investissements internationaux peut être un autre moyen
de réguler la mondialisation, en tenant compte d'objectifs sociaux et
environnementaux. Des négociations sur l'investissement sont
prévues dans le cadre de l'actuel cycle de négociation de l'OMC.
Les réticences des Etats-Unis et la méfiance des pays en
développement obèrent cependant les chances de succès de
ces négociations.
Audition de M. Tom Jones, chef de
division à l'Organisation de développement et de
coopération économiques (OCDE)
le 1er avril
2003
Pour
introduire son exposé,
M. Tom Jones, chef de la division pour la
dimension globale et
structurelle à la Direction de
l'environnement de l'OCDE
, a rappelé la prise en compte croissante
des problèmes d'environnement dans les enceintes internationales. En
1994 a ainsi été créé au sein de l'Organisation
mondiale du Commerce (OMC) un comité « Commerce et
Environnement ». A la fin des années 1990, les
négociations autour de l'Accord multilatéral sur l'investissement
(AMI), menées au sein de l'OCDE, ont témoigné d'une
attention nouvelle portée à l'environnement, même si l'on a
reproché à ces négociations de ne pas aller assez loin sur
ce point. Enfin, l'environnement fait partie intégrante des
thèmes de négociation arrêtés à Doha, en
2001, en vue du nouveau cycle de négociation multilatérale de
l'OMC.
Depuis 1997, l'OCDE mène des recherches sur le thème de la
mondialisation et de l'environnement. La mondialisation s'analyse comme un
processus de libéralisation des échanges, des investissements
internationaux, de l'information (
via
internet), combiné à
une internationalisation des firmes. La mondialisation a un impact sur
l'environnement, révélé par l'existence de
problèmes globaux environnementaux, mais aussi par des problèmes
plus localisés, de pollution de l'eau ou de la terre par exemple.
M. Tom Jones
a ensuite distingué quatre effets de la
mondialisation sur l'environnement :
* un effet d'échelle : la mondialisation induit une croissance plus
rapide, ce qui a souvent un impact négatif sur l'environnement ;
* un effet structurel : la spécialisation internationale
améliore l'efficience des modes de production, ce qui permet une
meilleure utilisation des ressources environnementales ;
* un effet technologique : l'ouverture facilite la diffusion du
progrès technique ;
* un effet réglementaire : le développement
économique s'accompagne d'une plus grande attention portée
à l'environnement qui peut conduire les pouvoirs publics à
adopter des réglementations environnementales plus protectrices.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a souligné que ce qui
importait était l'impact net de ces différents effets. Dans le
secteur des transports par exemple, on observe des améliorations
techniques qui permettent de mieux préserver l'environnement. Mais
l'augmentation rapide des flux de transport fait plus que compenser cet effet
positif ; la pression exercée par le secteur des transports sur
l'environnement ne diminue donc pas.
Puis
M. Tom Jones
a abordé le problème du coût de
l'application, par les entreprises, des normes environnementales
édictées dans les pays développées. Dans la plupart
des cas, ce coût serait modeste, de l'ordre de 2 à 3 % du
coût total de production. Il ne pèserait donc pas
significativement sur la compétitivité de la majorité de
nos entreprises. L'OCDE n'observe pas de mouvements généraux de
délocalisation vers des « havres de pollution »
(
pollution havens
), c'est-à-dire vers les pays peu exigeants en
matière environnementale. Donc, des normes laxistes dans le domaine de
l'environnement ne constituent pas un atout décisif pour attirer des
investissements directs étrangers, en particulier parce que les firmes
multinationales sont soumises à la pression des consommateurs, des
organisations non-gouvernementales (ONG), et des médias, qui sont de
plus en plus attentifs aux questions d'environnement. On ne peut exclure
cependant un phénomène de « gel
réglementaire » (
regulatory chill
) dans les pays en
développement, qui pourraient hésiter à édicter des
réglementations plus contraignantes, de crainte de mécontenter
les multinationales installées sur leur sol.
M. Tom Jones
a ensuite discuté l'hypothèse dite de la
« courbe environnementale de Kuznets ». Selon cette
hypothèse, la croissance économique engendrerait, dans un premier
temps, une dégradation de l'environnement, en raison de l'augmentation
de la production. Puis le développement, s'accompagnant d'une meilleure
prise de conscience des problèmes environnementaux, conduirait à
un renforcement des normes environnementales, et ainsi à une
amélioration de la qualité de l'environnement. Néanmoins,
les études empiriques disponibles indiquent que l'hypothèse de la
courbe environnementale de Kuznets n'est pas vérifiée dans tous
les cas.
Deux types de politiques environnementales doivent, selon
M. Tom
Jones
, être distinguées : les politiques nationales d'une
part, et les politiques internationales d'autre part. Il n'existe que deux
problèmes environnementaux vraiment globaux : le réchauffement
climatique, et l'altération de la couche d'ozone. La résolution
de ces problèmes appelle une action internationale. En revanche, les
problèmes nationaux devraient être traités localement. La
préservation de la biodiversité s'analyse comme une addition de
problèmes locaux (protection d'espèces localisées sur un
territoire).
Interrogé sur la possibilité de créer une écotaxe
internationale,
M. Tom Jones
a répondu qu'une telle
proposition ne rencontrerait pas un accord unanime parmi les pays membres de
l'OCDE. Dans le cas spécifique de problème du changement
climatique, la négociation du protocole de Kyoto a montré que les
pays en développement étaient réticents à accepter
des objectifs quantifiés pour la lutte contre l'effet de serre. Il
serait donc difficile de leur faire accepter une écotaxe internationale.
Plusieurs initiatives ont déjà été prises au niveau
national, par exemple dans les pays scandinaves, qui ont instauré des
taxes sur le carbone. Mais ces taxes frappent essentiellement les
ménages détenteurs d'automobiles, et relativement peu les
entreprises exposées à la concurrence internationale.
L'effort de recherche de l'OCDE dans le domaine de la mondialisation et de
l'environnement porte aujourd'hui principalement sur les actions à
engager pour faire évoluer les processus de production. Cela suppose un
effort de transparence de la part des firmes, un engagement volontaire de leur
part, et un effort pour utiliser des technologies respectueuses de
l'environnement. La question de l'adaptation au changement climatique est
également un thème de recherche négligé.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a souhaité connaître
la position de l'OCDE par rapport à la proposition de créer une
Organisation mondiale de l'Environnement.
M. Tom Jones
a
indiqué qu'il n'y avait pas de position officielle de l'OCDE à ce
sujet, du fait de l'absence d'accord unanime entre les membres de
l'organisation. A titre personnel, il s'est dit réservé,
considérant qu'il serait préférable d'intégrer les
enjeux environnementaux à nos préoccupations économiques.
L'environnement est en effet, avec l'économique et le social, l'un des
trois piliers du développement durable. L'environnement est
également, dans la période récente, mieux pris en compte
politiquement à l'OMC.
Audition de Mme Jacqueline Aloisi
de Larderel, directrice de la Division du Commerce, de l'Industrie, et de
l'Economie du Programme des Nations-Unies pour l'Environnement,
le 8 avril
2003
Mme
Jacqueline Aloisi de Larderel, directrice de la Division du Commerce, de
l'Industrie, et de l'Economie du Programme des
Nations-Unies pour
l'Environnement (PNUE)
, a commencé son intervention par une
présentation du PNUE. Cet organisme a été
créé en 1972, suite à la réunion, à
Stockholm, de la Conférence des Nations-Unies sur « l'Homme et
l'Environnement ». C'est la première institution des Nations
Unies à avoir été implantée dans un pays en voie de
développement
Mme Jacqueline Aloisi de Larderel
a détaillé les trois
missions du PNUE :
* surveiller l'état de l'environnement mondial, et en dresser
régulièrement un bilan ; le troisième rapport a
été publié en 20O2 dans de nombreuses langues. On s'y
réfère souvent sous le titre « GEO 3 »
(Global Environment Outlook ).
* servir de plate-forme pour discuter des actions et politiques à mettre
en oeuvre pour répondre aux problèmes identifiés, et pour
préparer les conventions et accords internationaux nécessaires.
C'est ainsi que le PNUE a été à l'origine de diverses
conventions internationales relatives à l'environnement ; peuvent
être citées, notamment, la Convention de Vienne et le protocole de
Montréal relatifs à la protection de la couche d'ozone, la
convention de Bâle sur les déchets, la convention sur la
biodiversité, ou encore la convention sur les produits chimiques et
organiques persistants. Le PNUE a été choisi pour assurer le
secrétariat de ces conventions. Le PNUE met aussi en oeuvre des
accords volontaires avec des représentants de grands secteurs de
l'industrie ou des services (banques et assurances,
télécommunications, tourisme...). Le PNUE organise
également des débats relatifs aux secteurs des transports, de la
grande distribution, ou de la publicité, ces deux derniers secteurs
ayant une grande influence sur les modes de consommation des
ménages ;
* enfin, le PNUE remplit des fonctions de formation, échange et
diffusion d'information et de bonnes pratiques.
Le PNUE est actuellement dirigé par M. Klaus Töpfer, ancien
ministre allemand de l'Environnement. Le Directeur Executif du PNUE est
nommé par l'Assemblée générale des Nations-Unies
sur proposition du Secrétaire Général. Le Conseil
d'administration du PNUE se réunit tous les deux ans pour définir
le programme d'action de l'organisation et le budget correspondant. Des
sessions extraordinaires du Conseil ont lieu les autres années . A
l'occasion de ces Conseils se tient le Forum Global des Ministres de
l'Environnement, qui débat des grands enjeux environnementaux.
Le PNUE emploie environ 600 personnes à travers le monde. Son
siège est à Nairobi. Il est composé de 8 Divisions, et 6
Directions Régionales dans chaque partie du monde. La Division du
Commerce, de l'Industrie, et de l'Economie (DCIE) du PNUE est implantée
à Paris, Genève et Osaka, et emploie, au total, environ 125
personnes.
Le PNUE est financé pour l'essentiel, par des contributions volontaires.
Son budget annuel est d'une soixantaine de millions d'euros. A ce budget
ordinaire s'ajoutent des financements spécifiques, affectés
à des projets précis, qui proviennent, par exemple, du Fonds
Mondial pour l'Environnement, du Fonds multilatéral pour la couche
d'ozone, de la Fondation des Nations Unies ou de certains Etats. La France
finance ainsi la réalisation de certaines études conduites par le
PNUE.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a alors demandé quel budget
serait nécessaire pour permettre au PNUE de remplir plus
complètement ses missions.
Mme Jacqueline Aloisi de Larderel
a répondu que les ressources
actuelles du PNUE étaient très insuffisantes pour faire face aux
défis posés. Il faudrait dès les prochaines années
au moins tripler le budget global. Il faudrait de plus que ces ressources
soient stables et pérennes.
Puis
Mme Jacqueline Aloisi de Larderel
a détaillé les
activités de l'Unité « Production et
Consommation » de la DCIE. Cette unité cherche à
promouvoir des modes de production plus efficaces et plus propres. Elle
s'intéresse aussi aux conditions d'utilisation des produits : leur
mode de consommation ne doit pas nuire à l'environnement. D'où
des réflexions sur le cycle de vie des produits, ou sur les
critères devant être remplis par un produit pour
bénéficier d'un « label écologique ».
Plus généralement, elle a aussi décrit le travail
mené avec l'industrie . Elle a donné comme exemple le travail
avec le secteur financier, banques et assurances. Une initiative à
laquelle se sont associés 280 banques, et 80 compagnies d'assurance,
parmi lesquelles on trouve, pour citer quelques établissements
français, la Société générale, Dexia, ou la
Caisse des Dépôts et Consignations, a été
lancée. Trois groupes de travail ont été mis en
place : le premier porte sur les systèmes de gestion de
l'environnement dans les établissements financiers (par exemple, comment
un tel établissement doit-il présenter son rapport
d'environnement ?) ; le second traite de la gestion d'actifs, et
s'intéresse aux fonds d'investissement « écologiquement
responsables » ; il travaille avec des agences de notation,
telles Sustainability Asset Management, Core Ratings, Innovest ou
Vigéo ; le troisième groupe de travail examine les risques
pour l'économie du changement de climat, et concerne surtout les
compagnies d'assurance et de réassurance (Swiss Re, Munich Re). Un autre
exemple est le travail effectué, dans le cadre de la préparation
du Sommet sur le Développement Durable tenu à Johannesburg en
Septembre 2002, avec 22 secteurs économiques, représentés
par leurs associations internationales ; le PNUE a demandé aux
représentants de ces secteurs quelles actions ils avaient menées,
depuis 1992, en vue d'atteindre les objectifs définis lors du Sommet de
Rio, et quelles actions ils comptaient mettre en oeuvre à l'avenir. Ce
travail a permis au PNUE d'exercer une fonction pédagogique
auprès des industriels. Il ressort de ce travail que
« l'éco-efficacité » de la production des
entreprises a augmenté, mais que l'environnement est encore
considéré par les entreprises (comme d'ailleurs par les
Gouvernements) comme une donnée exogène, au lieu d'être
intégré dans leurs stratégies et leur politiques
générales, ce qui permettrait de prévenir les atteintes
à l'environnement, et les coûts qu'ils entraînent.
Par ailleurs, évaluer l'engagement des entreprises en faveur de
l'environnement suppose de disposer d'instruments de mesure, et d'indicateurs
précis. Il serait donc souhaitable que les entreprises présentent
un rapport annuel sur leurs performances sociales et environnementales suivant
un modèle standard, qui leur permet de mesurer leur progrès d'une
année sur l'autre, de se comparer entre elles, et d'assurer une
information fiable du public et de leurs employés. C'est dans cette
optique que le PNUE a établi l'Initiative du « Global
Reporting », qui a publié des recommandations sur les
critères à utiliser.
Après cette présentation du PNUE,
Mme Jacqueline Aloisi de
Larderel
a abordé quelques points particuliers
Mme Jacqueline Aloisi de
Larderel
a d'abord noté que les
mécanismes de marché ne fonctionnaient pas convenablement, car
les prix des produits n'incluent pas les coûts de leurs impacts sur
l'environnement. C'est donc la communauté locale, nationale, ou
internationale qui doit supporter ces coûts, et non celui qui les cause.
Une « internalisation » de ces
« déséconomies externes » permettrait donc
d'orienter la consommation vers des produits moins polluants et moins
consommateurs de ressources naturelles. Par ailleurs, beaucoup de subventions
ont des effets négatifs sur l'environnement ; les subventions
accordées au secteur de la pêche, par exemple, ont
encouragé une surexploitation des ressources halieutiques, ce qui a
conduit la Commission Européenne à proposer
l'établissement de quotas de pêche. Les subventions dans le
secteur de l'énergie, qui favorisent l'utilisation de sources
d'énergie fossiles, s'accompagnent des mêmes effets
négatifs sur l'environnement. C'est pourquoi il appartient aussi aux
ministères des Finances, de l'Agriculture, des Transports, pour ne
nommer que ceux là, d'intégrer la dimension environnementale dans
leurs politiques.
La libéralisation des échanges a aussi un impact sur
l'environnement. Le PNUE a d'ailleurs réalisé un certain nombre
d' études pour évaluer précisément l'impact
environnemental des mesures de libéralisation du commerce. Trop souvent,
les pays en développement accroissent leurs cultures avec pour seul
objectif l'exportation, et cela trop souvent au détriment de leur
environnement
.
Des productions agricoles, telles le coton dans certaines
parties du Sahel, les fleurs au Kenya sont grandes consommatrices d'eau, et ne
sont donc pas toujours adaptées aux conditions climatiques locales. Des
labels garantissant une bonne exploitation des ressources forestières
devraient être mis au point pour limiter les fraudes, très
importantes dans la filière bois. Il faut donc concevoir des mesures
commerciales et environnementales qui se renforcent mutuellement.
Mme Jacqueline Aloisi de Larderel
a indiqué que l'aide
versée aux pays en développement par les pays
industrialisés n'était pas toujours adaptée et parfois
intéressée, en ce sens qu'elle est utilisée pour
favoriser l'exportation vers les pays du Sud de produits industriels
fabriqués au Nord, sans que soit apportées en même temps la
formation et l'éducation nécessaire pour utiliser et entretenir
ces produits. Or, faute de maintenance, ces biens industriels sont rapidement
inutilisés. En fait, les politiques d'aide au développement
devraient être mieux évaluées sous l'angle de leurs effets
sur l'environnement. Enfin, les agences de crédit à
l'exportation, type COFACE, devraient réaliser des études
d'impact environnemental des projets qu'elles soutiennent.
Mme Jacqueline Aloisi de Larderel
a ensuite abordé le
thème de l'énergie, étroitement lié aux
problèmes de changement climatiques. Dans ces domaines, le PNUE
travaille avec l'Organisation Mondiale de la Météorologie, avec
qui il a établi le Groupe Intergouvernemental sur le Changement de
Climat (GIEC). Dans le domaine énergétique, Le PNUE souhaite
encourager une évolution des politiques axée sur
l'amélioration de l'efficacité énergétique, et la
promotion des énergies renouvelables. Les transferts de technologie sont
cruciaux à cet égard. Pour impliquer les responsables de tous les
pays, et favoriser échanges et réflexion commune, le PNUE a
lancé à l'occasion du Sommet de Johannesburg un réseau de
Centres d'excellence sur les énergies propres et renouvelables, le
Réseau Mondial sur l'Energie pour le Développement Durable
(GNESD). Ces centres travaillent sur des sujets d'intérêt communs,
tels l'accès à l'énergie, ou l'exploitation de la
biomasse.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a alors interrogé
Mme
Jacqueline Aloisi de Larderel
sur l'opportunité de créer une
éco-taxe internationale.
Mme Jacqueline Aloisi de Larderel
a estimé qu'il s'agissait d'une
excellente idée, mais politiquement difficile à mettre en oeuvre
à court terme. Différentes mesures allant dans cette direction
ont cependant été étudiées : taxation du
fioul consommé pour le transport aérien, fioul aujourd'hui
exonéré de toute taxe ; taxes sur les échanges de
matières premières. De telles eco-taxes permettraient
d'internaliser les déséconomies externes et d'assurer le
nécessaire financement de la protection de l'environnement.
Invitée à donner son avis sur l'intérêt de
créer une Organisation Mondiale de l'Environnement,
Mme Jacqueline
Aloisi de
Larderel
a indiqué qu'il s'agissait d'une
excellente idée, mais que l'efficacité d'une telle organisation
dépendrait beaucoup des moyens financiers qui lui seraient
alloués et de la volonté politique des pays d'en faire une
organisation ayant un réel pouvoir. Il faudra aussi répondre aux
préoccupations des pays en développement, qui redoutent que la
protection de l'environnement ne représente un frein à leur
développement économique. Les problèmes d'environnement
qui s'annoncent à moyen et long terme à l'échelle mondiale
nécessiteront de difficiles négociations et arbitrages, ainsi que
la mise en place d'institutions internationales appropriées. Cela ne
pourra se faire que progressivement, et le PNUE représente un outil
déjà en place sur lequel s'appuyer pour continuer
l'action.
Audition de M. Patrick Messerlin,
professeur d'économie à l'Institut d'Etudes Politiques de
Paris,
et directeur du Groupe d'Economie Mondiale (GEM),
le 8 avril
2003
M.
Patrick Messerlin, professeur d'économie à l'Institut d'Etudes
Politiques de Paris, et
directeur du Groupe d'Economie Mondiale
(GEM)
a débuté son exposé en indiquant que l'on avait
souvent tendance à surestimer le niveau actuel de mondialisation. Depuis
une quinzaine d'années, les pays se sont ouverts aux échanges,
non pas tant en raison de la baisse des barrières aux frontières,
mais plutôt du fait du progrès technique.
Le précédent cycle de négociations, l'Uruguay Round, a
certes permis d'enregistrer quelques avancées. De grands principes ont
notamment été posés :
* premier principe : l'agriculture fait partie des négociations
commerciales ; la libéralisation du secteur reste cependant
extrêmement modeste ;
* deuxième principe : le secteur du textile-habillement sera
libéralisé ; mais celle-ci ne deviendra effective
qu'à compter du 1
er
janvier 2005, et pour les seules
restrictions quantitatives (les droits de douane dans l'habillement resteront
élevés, sauf si le Cycle de Doha en décide
autrement) ;
* troisième principe : le commerce des services est
désormais régi par l'accord GATS (
General Agreement on Trade
of Services
).
Mais ce sont les innovations technologiques qui ont été le
principal moteur de la croissance des échanges. Ceci est tout
particulièrement vrai pour les services. Le développement du
courrier rapide, des télécommunications et, plus
récemment, du commerce électronique, a intensifié la
concurrence internationale. Une entreprise comme Amazon.com peut aujourd'hui
concurrencer les librairies françaises. L'arrivée d'une
technologie nouvelle comme la téléphonie mobile a aussi beaucoup
contribué à déstabiliser les anciens marchés
monopolistiques nationaux des télécommunications.
La dernière décennie a surtout été
caractérisée par le fort développement des investissements
directs étrangers (IDE), ainsi que par l'insertion, dans le commerce
international, de grands pays en développement et des pays de l'Est qui
n'y participaient pas jusqu'en 1990.
L'entrée de la Chine dans l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a
incité l'Inde à s'engager elle aussi sur la voie de la
libéralisation, et à défendre ses intérêts
dans le secteur agricole, ou celui des services. Les pays en
développement manifestent actuellement un certain agacement devant le
peu d'empressement des pays développés à accepter de
nouveaux progrès dans la libéralisation des échanges. La
position française sur l'agriculture est en particulier très
critiquée.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a alors souhaité savoir si
les IDE faisaient l'objet d'une régulation internationale.
M. Patrick Messerlin
a répondu qu'il n'y avait pas d'accord
global sur les investissements, et que celui-ci restait peu probable dans le
cadre de l'OMC. Le projet d'Accord Multilatéral sur l'Investissement
(AMI), négocié dans le cadre de l'OCDE a échoué,
mais il existe quelque 1500 accords bilatéraux relatifs aux
investissements dans le monde, dont 1400 conclus entre pays
développés et pays en développement. Pour les membres de
l'OCDE, les «
guidelines
» définis par cette
organisation servent de base de référence.
M. Patrick
Messerlin
a ajouté que les délocalisations étaient un
phénomène moins important qu'on ne l'a longtemps cru.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a souligné que de nombreuses
délocalisations étaient pourtant en cours vers l'Europe de l'Est.
M. Patrick Messerlin
a estimé que ces délocalisations
s'inscrivaient dans un mouvement logique de réorganisation industrielle
au sein de l'Europe, prélude à l `élargissement de
l'Union européenne. Il a relevé qu'une bonne part des
investissements à l'Est se faisaient dans le secteur des services,
avaient des débouchés locaux, et n'entraînaient pas des
problèmes d'emploi comparables à ceux qui pouvaient s'observer
parfois dans l'industrie.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a voulu connaître les
principaux enjeux des dix années à venir en matière de
commerce international.
M. Patrick Messerlin
a d'abord insisté sur la fin des
restrictions quantitatives prévue dans le secteur du
textile-habillement, à partir du 1
er
janvier 2005.
L'essentiel des quotas d'importations disparaîtra à cette date,
les mesures de libéralisation prises jusqu'à présent ayant
été de portée modeste. La production européenne et
américaine s'est déjà préparée à
cette libéralisation. Pourtant, on ne peut exclure que des pays
développés sollicitent de nouveaux quotas, plutôt que
d'accepter la complète élimination des quotas à la date
prévue.
Le deuxième enjeu majeur concerne le secteur agricole. L'agriculture
française est l'une des plus efficientes de la Communauté
européenne. Les producteurs français auraient donc, selon
M.
Patrick Messerlin
, intérêt à l'ouverture des
marchés. Les petits agriculteurs approvisionnent surtout des
marchés locaux, et sont peu impliqués dans le commerce
international. De plus, les règles de l'OMC n'interdisent pas les
soutiens directs au revenu des exploitants agricoles.
M. Patrick
Messerlin
a jugé que la Politique Agricole Commune (PAC)
était un instrument peu efficient pour soutenir le revenu des
agriculteurs. Quand un euro est dépensé au titre de la PAC, 25
centimes seulement restent à l'agriculteur ; les 75 centimes
restant sont reversés aux banques, aux équipementiers agricoles,
voire sont gaspillés en productions inappropriées. Dans le cadre
des actuelles négociations du Cycle de Doha, la question agricole est
cruciale pour les pays en développement. Elle revêt, à
leurs yeux, une importance bien plus grande que les négociations ayant
trait aux produits pharmaceutiques.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a alors demandé comment les
négociations pourraient évoluer au cas où la position
européenne sur l'agriculture ne changerait pas.
Pour
M. Patrick Messerlin
, la position européenne pourrait
être une cause de blocage des négociations. Les pays membres de
l'OMC ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un texte pouvant
être adopté lors du sommet de Cancun, en septembre 2003. Le sommet
du G8 à Evian pourrait être l'occasion de traiter certains points
faisant problème dans les négociations. L'acceptation de longues
périodes de transition faciliterait sans doute l'obtention d'un accord.
En tous les cas, il est probable que la date prévue pour la fin des
négociations de Doha (2005) ne sera pas tenue ; il faut s'attendre
à ce que les négociations se prolongent jusqu'en 2007 ou 2008.
Aux Etats-Unis, une nouvelle loi agricole a été votée en
2002. Il n'est pas sûr que cette loi soit plus protectionniste que la
précédente. Comme la durée de vie de ces lois agricoles
est de six ans, la prochaine loi sera discutée par le Congrès
entre 2006 et 2008. Comme l'Administration américaine a
déposé à l'OMC un projet très libéral dans
son volet agricole, tout le problème est donc de savoir si les
négociations de l'OMC pencheront suffisamment dans le sens de
l'Administration pour inciter le Congrès à adopter une loi plus
libérale en 2006-2008.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a noté que les exploitants
agricoles français tendaient à durcir leurs positions, pour
prévenir de futurs compromis au sein de la Communauté
européenne ou de l'OMC.
M. Patrick Messerlin
a regretté que les agriculteurs
français n'apprécient pas suffisamment les
bénéfices qu'ils pourraient retirer de la libéralisation,
et qu'ils ne mesurent pas suffisamment les opportunités d'exportations
que leur offrirait cette dernière. Aujourd'hui, 75 % de la valeur
ajoutée de l'agriculture européenne est constituée de
subventions ; ce chiffre est de 70 % aux Etats-Unis. Une
libéralisation du marché, même si elle conduisait à
une augmentation du soutien direct au revenu (ce qui revient à nier les
capacités exportatrices de nombre d'agriculteurs français, une
vue excessivement pessimiste), ne changerait donc pas fondamentalement la
donne : les agriculteurs sont déjà massivement
subventionnés, une situation devenue intenable sans la perspective de
réformes profondes.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a ensuite souhaité savoir
s'il demeurait, en Europe, d'importantes barrières douanières
aux échanges.
M. Patrick Messerlin
a déclaré que l'on pouvait
évaluer à 7 % le niveau moyen des droits de douane en
Europe. Officiellement, le droit de douane moyen en Europe est inférieur
à 4 %. Mais ce chiffre officiel est obtenu en faisant une moyenne
des droits de douane en vigueur, pondérée par le niveau des
importations pour les différentes catégories de biens et
services. Cette méthode conduit à sous-estimer de façon
systématique le droit de douane moyen. En effet, un droit de douane
élevé tend, logiquement, à diminuer les importations du
bien ou service considéré, qui est donc
sous-pondéré dans le calcul effectué. Il faut corriger cet
effet pour avoir une vision plus juste du niveau effectif de protection. Le
chiffre de 7 % obtenu est à peine supérieur au taux
américain. Il demeure, en Europe, d'importants pics tarifaires,
caractérisés par des droits de douane très
élevés, compris entre 30 et 40 %, voire bien plus pour
certains produits, tels le sucre (200 % si l'on tient compte de l'impact
protectionniste des aides) ou les produits pour animaux (plus de 1000 % en
1999).
Apprécier la protection du marché européen implique de
prendre également en compte les autres barrières aux
échanges : restrictions quantitatives, droits anti-dumping,
subventions à l'agriculture ou au secteur charbonnier... Au total, ces
barrières aux échanges équivaudraient à un droit de
douane supplémentaire de l'ordre de 4 à 5 %,
suggérant donc que l'économie européenne
bénéficierait, de nos jours, d'un taux global de protection (tous
instruments de protection confondus) de 11 à 12 %.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a demandé à
M.
Patrick Messerlin
s'il considérait que le libre échange avait
toujours des effets positifs en termes de croissance économique.
M. Patrick Messerlin
a répondu qu'il n'y avait pas, dans
l'Histoire, d'exemple de pays protectionniste ayant connu le succès
économique sur la longue durée. Toutefois, une politique de
libéralisation mal conduite (sans politiques d'accompagnement
macroéconomiques ou structurelles adaptées à la situation
concrète du pays) peut conduire à des échecs. La
libéralisation doit aussi être progressive et surtout uniforme,
c'est-à-dire s'appliquer à tous les secteurs, sans pics
tarifaires générateurs de graves et coûteuses distorsions
dans l'économie nationale.
Le Chili offre un exemple de politique de libéralisation réussie.
Ce pays a adopté un droit de douane uniforme (le même pour tous
les produits) élevé (35 %) en 1984. Mais le droit de douane
uniforme a des caractéristiques telles que le Chili a pu diminuer ce
droit de douane, de manière essentiellement unilatérale,
jusqu'à 6 % de nos jours. Cet exemple devrait aujourd'hui servir de
référence pour les pays africains.
Dans le même sens, il conviendrait que la Communauté
européenne diminue la protection forte appliquée aux secteurs
agricole et textile. Cela peut prend du temps : après tout, 40
années ont été nécessaires pour libéraliser
les échanges de biens industriels, qui représentent 20 % de
notre valeur ajoutée, et encore avec quelques exceptions
(sidérurgie, textile-habillement, agroalimentaire). Mais, comme
souligné plus haut, les pays en développement s'impatientent, et
il serait bon pour la survie du système commercial multilatéral,
donc pour les intérêts bien compris de la Communauté, que
cette dernière ne tarde pas à réformer en profondeur la
PAC.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a évoqué de possibles
arguments politiques pouvant venir à l'appui de mesures
protectionnistes, par exemple la volonté d'un Etat d'assurer l'autonomie
de son approvisionnement alimentaire.
M. Patrick Messerlin
a indiqué que l'on pouvait toujours trouver
des raisons politiques de s'opposer à la libéralisation. Mais les
droits de douane sont le plus mauvais instrument pour atteindre des objectifs
politiques. Des subventions ou des taxations (selon l'effet que l'on recherche)
à la production ou la consommation, voire des réglementations
appropriées des marchés, sont des instruments bien plus directs,
et donc bien plus efficaces, pour atteindre un objectif donné.
Par exemple, dans le domaine environnemental, une bonne réglementation
locale est souvent le meilleur moyen de traiter des problèmes qui
semblent de nature internationale. Il en est ainsi du problème des
marées noires. L'Europe devrait appliquer avec la même vigueur que
les Etats-Unis le principe du « pollueur-payeur ». La
compagnie Exxon a été condamnée à verser
9 milliards de dollars après le naufrage de l'Amoco Cadiz en
Alaska, et cette amende l'a bien évidemment incitée à
prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une nouvelle
marée noire. Des règles de responsabilité identiques
devraient être appliquées en Europe ; elles auraient un effet
dissuasif bien plus adapté que des dispositions techniques arbitraires
(comme la double coque) et bien plus fort qu'un système d'assurances
lent et limité (comme le système actuel) ; en d'autres
termes, elles assureraient à la fois moins de pollution et moins de
dépenses publiques et privées.
Audition de M. Antoine
Jeancourt-Galignani, président de Gécina et de M. Philippe
Trainar, directeur des affaires économiques, financières, et
internationales à la Fédération française des
sociétés d'assurance,
le 13 mai 2003
M.
Antoine Jeancourt-Galignani, président de Gécina, et
M. Philippe Trainar, directeur des
affaires économiques,
financières, et internationales à la Fédération
française des sociétés
d'assurance (FFSA)
ont
été, respectivement, président et rapporteur du groupe de
travail « Réussir la mondialisation »,
constitué au sein du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF). Les
instances du MEDEF ont approuvé, en juin 2002, le rapport
rédigé par le groupe de travail.
MM. Antoine Jeancourt-Galignani et Philippe Trainar
ont commencé
leur intervention en définissant la mondialisation comme un processus
d'ouverture progressive et d'interpénétration des
économies et des sociétés. Elle implique des
échanges commerciaux, des mouvements de capitaux, et des échanges
de technologie. La crise asiatique de 1997 a quelque peu ralenti le processus
de mondialisation.
MM. Antoine Jeancourt-Galignani et Philippe Trainar
ont dressé un
bilan positif de la mondialisation. Les pays qui connaissent la plus forte
croissance économique sont ceux qui ont fait le choix de l'ouverture.
Les principaux pays en voie de développement, tels la Chine, l'Inde, ou
le Brésil, ont ouvert leurs économies. Au total, les pays en
développement qui ont fait le choix de l'ouverture rassemblent trois
milliards d'habitants. A l'opposé, environ un milliard de personnes
vivent dans des pays, notamment africains, qui sont restés
fermés. L'ouverture économique s'accompagne d'une
amélioration des conditions sociales : augmentation des salaires,
hausse de l'espérance de vie, progrès de la scolarisation et de
la santé...
La mondialisation induit une spécialisation des pays dans les secteurs
qui sont pour eux les plus porteurs. Les investissements directs
étrangers jouent un rôle important dans cette évolution.
Les firmes multinationales apportent des capitaux, et introduisent dans les
pays d'accueil des standards sociaux supérieurs à ceux en vigueur
dans les entreprises locales. Les diasporas, notamment la diaspora chinoise,
ont également joué un important rôle de catalyseurs.
MM. Antoine Jeancourt-Galignani et Philippe Trainar
ont ensuite
affirmé que la mondialisation s'accompagnait d'une réduction de
la pauvreté et des inégalités au niveau mondial. Une
récente étude menée par le Programme des Nations-Unies
pour le Développement (PNUD)la Banque Mondiale a conclu à une
forte réduction des inégalités et de la pauvreté
dans le monde depuis vingt ans. L'Organisation des Nations-Unies (ONU) s'est
fixée comme objectif de ramener, d'ici 2015, à 15 % la
proportion de la population mondiale qui vit avec moins de 1dollar par jour. En
fait, il semblerait au vu des recherches récentes que cet objectif soit
déjà atteint, voire dépassé.
Concernant la France,
MM. Antoine Jeancourt-Galignani et Philippe Trainar
ont souligné qu'elle avait bénéficié de la
mondialisation, de même qu'elle a bénéficié de la
construction européenne.
Les consommateurs gagnent à la baisse des prix de certains biens, tels
le textile ou les jouets, qui pèsent lourd dans le budget des
ménages les plus modestes.
Les entreprises françaises font face avec succès aux
progrès de la mondialisation. S'il est vrai que la mondialisation fait
disparaître des activités et des emplois, la contribution nette du
commerce extérieur à l'emploi demeure positive.
La France doit toutefois relever deux défis connexes à la
mondialisation : la pression des flux migratoires, et le risque
d'uniformisation des cultures et des modes de vie. En outre, de nombreux pays
qui nous sont historiquement liés, en Afrique notamment, sont
restés à l'écart de la mondialisation, et la France ne
peut les délaisser.
Puis
MM. Antoine Jeancourt-Galignani et Philippe Trainar
ont
formulé quelques recommandations de politique générale,
pour à aider la France à mieux gérer la
mondialisation :
* en premier lieu, une meilleure anticipation des effets de la mondialisation
sur l'activité et l'emploi permettrait d'en atténuer les
conséquences ;
* le système de formation professionnelle devrait se donner pour
objectif d'améliorer « l'employabilité » des
personnes ;
* la politique économique devrait chercher à renforcer
l'attractivité du « site France » ;
* enfin, l'aide française au développement devrait être
davantage concentrée sur l'Afrique, et devrait encourager ces pays
à s'ouvrir à la mondialisation.
Alors que le leadership politique a été très fort, depuis
Jean Monnet, pour construire l'Union européenne,
MM. Antoine
Jeancourt-Galignani et Philippe Trainar
ont regretté que l'on
n'observe pas un leadership politique équivalent sur les questions
liées à la mondialisation.
Après ces considérations générales,
MM. Antoine
Jeancourt-Galignani et Philippe Trainar
ont abordé la question de
l'impact de la mondialisation sur l'environnement.
Ils ont indiqué que la mondialisation n'avait pas, par elle-même,
d'effet destructeur sur l'environnement alors que . Lles modèles de
développement fermés comme ceux expérimentés en
URSS ou en Chine ont été beaucoup plusen général
destructeurs de l'environnement.
L'hypothèse selon laquelle les entreprises quitteraient les pays
développés pour échapper à leurs normes
environnementales n'est pas vérifiée. Les exportations des pays
en développement portent sur des productions moins polluantes que leurs
importations. Les principaux produits polluants (chimie, papeterie, acier et
métaux) présentent souvent des coûts de transport
très élevés, et il ne serait donc pas rentable de
délocaliser ces productions vers les pays en développement. Il
est donc toujours possible de protéger l'environnement au niveau
national.
Les firmes multinationales installées dans les pays en
développement ont des pratiques environnementales plus exigeantes que
celles des entreprises locales. Les firmes multinationales ont, en effet,
tendance à appliquer dans l'ensemble de leurs implantations les
règles en vigueur dans les pays développés, et d'autant
qu'elles sont soumises au regard du public. La firme Total, critiquée
pour son exploitation de gaz naturel en Birmanie, a, par exemple, veillé
à ce qu'il n'y ait aucun cas de travail forcé sur ses sites, ou
chez ses sous-traitants, dans ce pays, et a amélioré les
conditions de vie des personnes résidant à proximité de
son pipeline. De même, la privatisation de la distribution d'eau en
Argentine, confiée au groupe Suez, s'est accompagnée d'une
diminution significative de la mortalité infantile parmi les
catégories sociales les plus défavorisées. Toutefois,
pour éviter d'éventuels abus, le MEDEF est favorable à
l'adoption de codes de bonne conduite par les grands groupes.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a alors souligné que, si
l'on admet que la mondialisation permet une plus forte croissance, elle devrait
s'accompagner aussi, logiquement, d'atteintes accrues à
l'environnement.
M. Philippe Trainar
a répondu que l'ouverture aux échanges
permettait aux pays en développement d'importer plus facilement, et
à moindre coût, des technologies plus propres. De ce fait,
certaines pollutions diminuent avec la croissance économique. Il a
été observé, par exemple, que 1 % de croissance
supplémentaire dans un pays en développement entraînait une
diminution de 1 % de la pollution au dioxyde de soufre (SO
2
).
De plus, l'ouverture économique a conduit à la fermeture de
grands combinats très polluants en Russie, en Europe de l'Est, ou en
Chine et dans de nombreux autres pays, au profit d'unités de production
plus modernes et moins polluantes.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a alors interrogé
MM.
Antoine Jeancourt-Galignani et Philippe
Trainar
sur la politique
qu'il conviendrait de mener à l'égard de l'Afrique, qui est
restée jusqu'ici à l'écart de la mondialisation.
M. Antoine Jeancourt-Galignani
a indiqué que les pays qui se
sont développés l'ont dû à leur propre dynamique
intérieure. L'aide extérieure devrait donc s'efforcer de
créer les conditions du décollage économique, en
améliorant, par exemple, l'approvisionnement énergétique,
ou l'accès à la santé. L'aide extérieure pourrait
aussi avoir pour objet de compenser les pertes de recette résultant de
la baisse des droits de douane, qui constituent une part importante des
ressources budgétaires des pays en développement avant leur
ouverture.
M. Philippe Trainar
a insisté sur la nécessité de
bâtir un système juridique performant, élément
central d'une bonne gouvernance. Les transferts de capitaux sont difficiles
dans certains pays du fait de l'absence de règles juridiques
adaptées.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a rappelé que la
libéralisation des échanges était loin d'être
complète, et a demandé quels devaient être les axes
d'action prioritaires en ce domaine.
M. Philippe Trainar
a évoqué deux dossiers
prioritaires : l'agriculture, et les droits de douane entre pays en
développement. Il a jugé que la politique agricole
européenne était un obstacle au développement des pays du
Sud. EtPar ailleurs, les droits de douane entre pays en développement
demeurent très élevés. Or, c'est; or, la croissance
est essentiellement soutenue par le développement des échanges
entre pays du Sud, plus que le développement des échanges avec
les pays du nord, qui est susceptible d'apporter le plus solide soutien
à la croissance des pays en développement. Les
négociations de Doha devraient permettre d'avancer sur ces dossiers.
Puis
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a voulu connaître la
position de
MM.
Antoine Jeancourt-Galignani et Philippe
Trainar
sur la proposition de créer une taxe internationale, qui
pourrait être une taxe écologique.
M. Antoine Jeancourt-Galignani
a estimé, d'une part, que les
grandes organisations internationales comme la Banque mondiale ou le Fonds
monétaire internationale ne manquaient pas de ressources
budgétaires, et, d'autre part, que la création d'une
écotaxe internationale n'était pas une perspective
réaliste.
M. Philippe Trainar
a indiqué qu'il était peu judicieux
d'assigner deux objectifs à un même impôt, à savoir
prélever des ressources financer le budget d'organisations
internationales, et réduire la pollution. D'autre part, la
création d'une écotaxe internationale poserait de nombreux
problèmes pratiques. L'assiette d'une telle taxe paraît difficile
à cerner, et la répartition de l'effort ne serait pas
nécessairement optimale. Il faut aussi s'interroger sur
l'autorité qui serait chargée de gérer cette
ressource ; il paraît difficile d'organiser une
responsabilité devant des représentants élus, si la
gestion de la taxe est confiée à une organisation internationale.
Enfin, une écotaxe créée seulement dans les pays
développés pourrait faire naître un risque de
délocalisation.
A la fin de l'entretien,
M. Serge Lepeltier, sénateur
, s'est
inquiété de la situation financière difficile des
compagnies de réassurance.
M. Philippe Trainar
a rappelé que la technique de la
réassurance permettait une mutualisation des risques à
l'échelle internationale, utile dans la mesure où beaucoup de
compagnies d'assurances ont encore une base essentiellement nationale.
Le secteur est confronté à une crise qui résulte d'une
succession de chocs : 11 septembre, épidémie de SRAS, chute
des Bourses, catastrophes naturelles, jurisprudence plus sévère
dans les affaires touchant à l'amiante (dommages et
intérêts plus élevés). Toutes les compagnies Swiss
Re ou Munich Rede réassurance sont confrontées à des
difficultés financières, mais il n'y a pas cependant de risque de
faillite majeure dans le monde.
M. Antoine Jeancourt-Galignani
a ajouté que la charge de
l'indemnisation retombait toujours, au final, sur les assurés, par
l'intermédiaire de leurs primes. Il faut donc préserver un
équilibre entre l'indemnisation des dommages, et le niveau de prime que
l'on est prêt à accepter.
Audition de M. Denys Gauer,
ambassadeur délégué à l'environnement, et
de
M. Philippe Lacoste, sous-directeur de l'environnement au
Ministère des Affaires étrangères,
le 27 mai
2003
M.
Denys Gauer, ambassadeur délégué à
l'environnement
, a débuté son intervention en
présentant les missions qui lui incombent. Il a rappelé que la
création, il y a deux ans et demi, d'un poste d'ambassadeur
délégué à l'environnement est apparue souhaitable,
en raison de la place croissante de l'environnement dans les
négociations internationales. L'ambassadeur délégué
contribue à la préparation des négociations
internationales. Il supplée, par sa présence, au manque de
disponibilité des ministres. Il dépend du Ministère des
Affaires étrangères, mais aussi du Ministère de l'Ecologie
et du Développement durable. M. Denys Gauer est le troisième
titulaire du poste.
Puis
M. Philippe Lacoste, sous-directeur de l'environnement au
Ministère des Affaires étrangères
, a souligné
que son service était le seul, au sein du Ministère, à
s'occuper exclusivement de questions d'environnement. Toutefois, d'autres
directions au Quai d'Orsay travaillent aussi sur les questions
environnementales, telles la direction des affaires juridiques, la direction
des Nations-Unies ou la direction de la coopération européenne.
La sous-direction de l'environnement s'efforce de mieux mobiliser les
ambassadeurs autour des grandes négociations environnementales,
notamment à travers le réseau des correspondants
« environement » des Ambassades, au nombre d'une
soixantaine environ.
M. Philippe Lacoste
a ensuite indiqué qu'il existait environ 500
accords internationaux traitant d'environnement, si l'on prend en compte les
traités multilatéraux et les traités régionaux. Ce
très grand nombre d'accords conduit à une certaine dispersion des
moyens, sans compter que l'effectivité de certains d'accords est faible.
D'où l'idée de créer une Organisation Mondiale de
l'Environnement (OME), qui permettrait de renforcer et de rationaliser les
efforts en la matière. L'actuel Programme des Nations-Unies pour
l'Environnement (PNUE) ne remplit pas à ce stade toutes les fonctions
que l'on pourrait attendre d'une OME, dans la mesure où les
contributions des Etats à son budget sont facultatives, et dans la
mesure où il ne rassemble qu'un nombre limité d'Etats. Ce
programme pourrait toutefois servir de base et être progressivement
transformé en une véritable organisation
spécialisée des Nations Unies. Aussi la France poursuit elle
comme objectif de court terme, un renforcement du PNUE ; cet objectif est
cohérent avec la stratégie d'ensemble de la politique
extérieure de la France, qui vise à renforcer l'Organisation des
Nations-Unies. La France oeuvre également à un rapprochement
progressif des conventions internationales qui traitent de sujets proches
(conventions relatives à différents produits chimiques par
exemple).
La proposition de créer une OME est défendue par la France et
l'Allemagne, mais elle suscite de sérieuses réticences chez
certains de nos partenaires. Les Etats-Unis s'interrogent sur la valeur
ajoutée de cette nouvelle structure et sont soucieux qu'elle ne vienne
pas concurrencer l'OMC. ils estiment en effet que certaines questions
environnementales, notamment celles liées aux échanges peuvent
être traitées directement au sein de l'OMC. Ils
s'inquiètent également des contraintes qu'une OME pourrait faire
peser sur leur développement technologique. Les pays du Sud craignent
que l'action d'une OME ne vienne freiner leur développement en imposant
des normes « vertes » trop sévères. La notion
de développement durable, qui fait le lien entre croissance
économique et protection de l'environnement, devrait permettre de
dissiper ces craintes. Le principe « pollueur-payeur »
pourrait également rassurer les pays du Sud, dans la mesure où il
implique que l'effort principal en matière de protection de
l'environnement repose sur les pays du Nord. Il sera également essentiel
de maintenir une implantation de cette future organisation à Nairobi,
où se trouve actuellement le siège du PNUE (qui dispose aussi de
bureaux à Genève et à Paris)
M. Denys Gauer
a insisté sur la nécessité d'assurer
une certaine cohérence entre les conventions internationales qui
touchent à des sujets différents, mais liés (commerce et
environnement, commerce et santé, par exemple). Il est prévu de
discuter, dans le cadre du round de négociations de Doha, des aspects
commerciaux des accords multilatéraux environnementaux (AME). Un
rapprochement du secrétariat de l'OMC et des secrétariats des AME
est proposé. Mais une telle évolution porte le risque que ce soit
l'OMC, organisation mieux structurée et plus influente, qui
définisse les règles environnementales.
Il faudrait également veiller à une meilleure application des
traités environnementaux en vigueur. Des mécanismes d'arbitrage
sont parfois prévus, dans les conventions, pour assurer leur bonne
application. Mais la mise en oeuvre de ces procédures d'arbitrage
suppose l'accord des deux parties, y compris la partie fautive, ce qui en
limite bien sûr considérablement la portée.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a indiqué que la
réforme de l'architecture institutionnelle internationale devait
être menée, selon lui, dans deux directions : il faut, d'une
part, créer une Organisation mondiale de l'Environnement, qui soit
spécifiquement dédiée à ces
problématiques ; mais il faut aussi développer une
sensibilité environnementale au sein de l'OMC, dans la mesure où
une future OME serait sans doute moins puissante que l'OMC. Puis M. Serge
Lepeltier, sénateur, a souhaité savoir quels nouveaux
mécanismes de contrôle et de sanction il était possible
d'envisager pour améliorer l'effectivité des AME.
M. Denys Gauer
a répondu que le premier problème à
résoudre était un problème de prise de conscience, par les
Etats, de l'importance des enjeux environnementaux. Se posent ensuite des
problèmes de capacité : certains pays en
développement n'ont pas la capacité de participer à toutes
les négociations internationales, ni de mettre en oeuvre tous les
accords environnementaux. Il faudrait inciter les Etats à ratifier les
accords dont ils sont signataires, et contrôler la mise en oeuvre des
accords. Il serait souhaitable d'harmoniser les procédures de suivi de
l'application des accords environnementaux.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a ensuite demandé quels
étaient, parmi les 500 accords environnementaux en vigueur, les
traités les plus significatifs.
M. Philippe Lacoste
a souligné l'importance des grandes
conventions cadre, issues du Sommet de Rio en 1992, relatives au climat et
à la biodiversité. Il a mentionné les programmes des mers
régionales du PNUE dont le plus avancé était celui portant
sur la Méditerranée. Dans le domaine du Climat, la question du
protocole de Kyoto était bien connue. Du fait du retrait des Etats-Unis,
seule la ratification russe permettrait son entrée en vigueur. D'ici la
l'Union européenne va l'appliquer en ce qui la concerne. S'agissant de
la protection de la biodiversité, le Protocole de Carthagène dit
aussi protocole Biosécurité, relatif à la circulation des
OGM, devrait entrer en vigueur prochainement (le 11 septembre 2003). Son
application sera intéressante à suivre au moment où les
Etats-Unis envisage de saisir l'OMC sur le moratoire européen portant
sur les OGM.
M. Denys Gauer
a distingué deux aspects dans les questions
liées à la biodiversité. La biodiversité implique
la protection de milieux naturels, par la création de parcs et de
réserves. C'est la démarche suivie en Europe par la directive
Natura 2000. Cette démarche présente l'inconvénient, si on
l'applique à l'échelle internationale, de réduire la
souveraineté des Etats sur certaines portions de leur territoire. Elle
rencontre, pour cette raison, des oppositions de principe de la part de
certains Etats. Mais la biodiversité peut signifier aussi la mise en
valeur du patrimoine naturel. Cette perspective devrait davantage
intéresser les pays du Sud, et pourrait les inciter à
protéger leurs espaces naturels.
Il a ajouté que les Etats-Unis n'étaient pas signataires de la
convention sur la biodiversité. Les Etats-Unis sont, en effet,
préoccupés par les conséquences que pourrait avoir la
convention en matière de droits de propriété
intellectuelle.
Les pays en développement, accaparés par les problèmes de
court terme, sont, de manière générale, peu sensibles aux
questions d'environnement. Ils sont pourtant touchés, au même
titre que les pays développés, par certains problèmes
environnementaux, tels le réchauffement climatique. Si un pays comme la
Chine s'ouvre peu à peu aux préoccupations environnementales,
d'autres Etats, comme l'Inde ou le Brésil, sont surtout soucieux de
préserver leur souveraineté, et sont, de ce fait,
réticents à accepter des accords multilatéraux trop
contraignants.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a souhaité avoir des
précisions sur le rôle du Fonds mondial pour l'environnement.
M. Denys Gauer
a indiqué que ce Fonds avait été
créé en 1990, dans le but de réparer les dommages
causés à l'environnement par des projets de développement.
Il était doté de 2,9 milliards d'euros en 2002. Il intervient
notamment dans le domaine de la biodiversité, pour la lutte contre le
changement climatique, pour la protection des eaux internationales, ou encore
pour diminuer, dans les pays en transition, les émissions de gaz
détruisant la couche d'ozone.
Il existe également un Fonds français pour l'environnement,
doté de 67 millions d'euros pour la période 2003 à
2006, qui finance des projets de développement bilatéraux,
surtout en Afrique.
M. Serge Lepeltier
, sénateur, a alors évoqué
l'idée de créer une éco-taxe internationale.
M. Denys Gauer
a rappelé que l'idée d'une éco-taxe
internationale avait germé au moment des négociations sur le
climat. Mais les Etats-Unis se sont opposés à ce projet, et ont
marqué leur préférence pour un mécanisme de permis
d'émissions. Il est vrai qu'une telle taxe serait très difficile
à mettre en pratique.
M. Philippe Lacoste
a souligné qu'il existait deux
manières de traiter les externalités : soit par les
quantités, via la création de quotas, ou soit par les prix, qui
peuvent être modifiés par une taxation appropriée.
Toutefois, le prix des ressources énergétiques, comme le
pétrole, connaît d'importantes variations qui peuvent neutraliser
les effets d'une taxe. Et seule une taxe fixée à un niveau
très élevée serait susceptible de faire changer les
comportements. L'idée d'une taxe sur le kérosène
utilisé par les avions (dont les émissions ne sont pas prises en
compte dans la convention sur les changements climatiques) est
régulièrement évoquée ; son produit
permettrait de financer un programme pour l'environnement.
M. Denys Gauer
a terminé son intervention en expliquant que la
politique étrangère actuelle des Etats-Unis ne favorisait pas les
avancées en matière de protection internationale de
l'environnement.
M. Denys Gauer
a identifié trois raisons
profondes au refus de l'Administration américaine de progresser sur ces
sujets : une hostilité générale aux progrès du
multilatéralisme ; un attachement à un mode de vie fortement
consommateur d'espace et d'énergie ; une forme de foi dans les
progrès de la science et de la technique. Les Américains
considèrent que la résolution des grands problèmes
environnementaux qui se posent aujourd'hui, tels le changement climatique,
découlera d'innovations technologiques. Cette confiance dans le
progrès technique conduit, aujourd'hui, à mener une politique
attentiste, alors qu'il serait possible de mieux protéger
l'environnement avec les technologies existantes.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a conclu la réunion en
rappelant que l'Union européenne était l'ensemble politique qui
défendait le plus fortement les sujets environnementaux dans les
enceintes internationales. L'Union européenne dispose d'une
capacité d'entraînement, et doit s'efforcer de faire partager ses
objectifs à des pays émergents. La politique
étrangère des Etats-Unis peut évoluer sous la pression de
l'opinion publique américaine, qui est sensibilisée aux questions
d'environnement, et sous la pression des industriels, qui peuvent souhaiter une
harmonisation des normes afin de pénétrer plus facilement les
marchés étrangers, et qui ne voudront pas être tenus
à l'écart des programmes de recherche menés en Europe pour
développer des technologies plus propres.
Audition de M. Dominique Bureau,
directeur des études économiques et de l'évaluation
environnementale, de Mme Sylviane Gastaldo, sous-directeur de l'environnement,
des régulations économiques, et du développement durable,
et de M. François Nass, chef du bureau des régulations
internationales, au Ministère de l'Ecologie et du Développement
durable,
le 3 juin 2003
Pour
introduire son exposé,
M. Dominique Bureau, directeur des
études économiques et de
l'évaluation
environnementale au Ministère de l'Ecologie et du développement
durable
, a indiqué que le service qu'il dirige a été
constitué il y a seulement trois ans, après une longue phase de
maturation et de réflexion. Ce service d'étude s'intéresse
principalement à l'évaluation économique et
environnementale, mais aussi à des thèmes transversaux, qui
touchent à l'économie nationale, à l'économie
internationale, et à la gestion des risques.
Pour
M. Dominique Bureau
, la question centrale est celle de la
conciliation entre développement des pays du Sud et protection de
l'environnement. Les pays du Sud s'opposent à ce qu'on leur impose des
contraintes qui entravent leur développement. Ils sont ouverts en
revanche à ce que les pays industrialisés les aident à
trouver les voies d'un développement « propre »,
c'est-à-dire respectueux de l'environnement. L'idée selon
laquelle le développement entraînerait automatiquement une
amélioration de la qualité de l'environnement est
naïve : l'amélioration de la qualité de l'environnement
nécessite la mise en oeuvre de politiques appropriées.
Puis
M. Dominique Bureau
a expliqué quelles étaient, selon
lui, les conséquences de la mondialisation sur l'environnement. Des
études - peu nombreuses - réalisées en Europe et aux
Etats-Unis suggèrent la relation suivante : la
libéralisation des échanges accélère le rythme de
la croissance économique, et entraîne, par là même,
une augmentation des atteintes à l'environnement, au moins à
court et moyen terme. En outre, la libéralisation rend les agents
économiques plus sensibles aux différences de
réglementation environnementale entre les pays.
M. Dominique
Bureau
a cité l'exemple du secteur de l'électricité en
Europe : la libéralisation du marché de
l'électricité dans l'Union européenne entraînera
vraisemblablement une restructuration du secteur ; les centrales
thermiques, qui consomment du charbon, sont fort polluantes, et il est probable
que les producteurs d'électricité chercheront à profiter
des différences de réglementation entre pays pour minimiser leurs
coûts. Il est donc essentiel de réfléchir à des
mesures d'accompagnement du processus de libéralisation. Il importe en
particulier de procurer une bonne visibilité des futures politiques
environnementales.
M. Serge Lepeltier, sénateur,
a alors rappelé que les
grandes entreprises avaient tendance à appliquer des règles de
conduite et des codes de gestion homogènes dans tous leurs sites de
production, ce qui devrait limiter l'impact des différences de
réglementation entre pays.
M. Dominique Bureau
s'est prononcé en faveur d'un
développement des études d'impact, afin de mieux apprécier
les conséquences environnementales des décisions
économiques.
En réponse à une question de
M. Serge Lepeltier,
sénateur, M. Dominique Bureau
a indiqué que
régionalisme et multilatéralisme pouvaient être
complémentaires à deux conditions : le régionalisme
ne doit pas être un obstacle aux progrès du
multilatéralisme ; et le régionalisme ne doit pas
détourner des flux d'échanges existants, mais
générer des flux d'échanges supplémentaires.
Au niveau multilatéral, le démantèlement des droits de
douane, qui était l'étape la plus aisée à franchir,
est aujourd'hui largement achevé. Les principales barrières aux
échanges qui demeurent sont non-tarifaires. Les réglementations
environnementales sont parfois vues comme des obstacles potentiels aux
échanges. Or, la montée des enjeux environnementaux conduit
à une multiplication des réglementations environnementales, ce
qui accroît les risques de conflit avec les règles commerciales.
Pour atténuer ces conflits potentiels, il importe de réduire le
déséquilibre actuel entre l'OMC, d'une part, organisation
très structurée, et les organisations en charge de
l'environnement, très éparpillées. L'OMC a besoin d'un
interlocuteur plus crédible et lisible.
Mme Sylviane Gastaldo, sous-directeur de l'environnement, des
régulations économiques, et
du développement
durable au Ministère de l'écologie et du développement
durable
, a alors souligné que très peu d'accords
environnementaux multilatéraux prévoyaient des mesures pour
sanctionner leur non-respect.
Puis
M. Dominique Bureau
a donné deux exemples de
difficultés de conciliation entre règles commerciales et
objectifs environnementaux. Dans une affaire portée devant l'organe de
règlement des différends (ORD) de l'OMC, les Etats-Unis se sont
opposés à l'importation de thon mexicain, car les méthodes
de pêche des marins-pêcheurs mexicains menaçaient la vie des
dauphins. L'OMC a rejeté les prétentions des Etats-Unis, en
indiquant qu'ils n'avaient pas ratifié la convention internationale de
protection des dauphins. Cet exemple pose la question de la prise en compte par
l'OMC de conventions internationales ratifiées par une partie seulement
de ses membres.
Dans un autre registre, l'application du protocole de Kyoto va entraîner
des surcoûts pour les industries productrices de CO
2
implantées en Europe, dans la mesure où seuls certains Etats
seront concernés par l'application du protocole. On pourrait imaginer
que l'Europe impose un droit de douane compensateur de cette distorsion de
concurrence. Mais une telle mesure n'est pas autorisée en l'état
actuel des règles de l'OMC.
M. Dominique Bureau
a suggéré que l'ORD s'inspire de la
théorie du « bilan », bien connue en droit
administratif français. L'ORD apprécierait d'abord si la mesure
controversée à des effets anti-commerciaux ; puis il
jugerait si la mesure mise en cause a des effets positifs suffisamment
importants pour contrebalancer l'atteinte portée au
libre-échange. Mais il a souligné la difficulté de mise en
pratique d'une telle proposition : les juges, de manière
générale, hésitent à faire un usage fréquent
de la théorie du bilan, dans la mesure où celle-ci se rapproche
d'un jugement en opportunité.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a évoqué
l'idée d'une écotaxe internationale.
M. Dominique Bureau
a indiqué qu'une telle suggestion se heurtait
à des problèmes de nature institutionnelle. Seule l'Union
européenne est parvenue, au prix de grands efforts, à quelques
avancées en matière d'harmonisation fiscale. Les Etats sont
réticents, pour des raisons de souveraineté, à abandonner
leur compétence en matière fiscale. De plus, certains Etats en
développement ne disposent pas d'une administration fiscale
effectivement capable de prélever des impôts.
Une taxe internationale peut, en outre, poursuivre deux objectifs, entre
lesquels il convient de choisir : veut-on modifier les comportements, ou
prélever des sommes pour faire de la redistribution ? Créer
une taxe à des fins de redistribution impose de réfléchir
à l'usage qui serait fait des sommes ainsi prélevées.
Mme Sylviane Gastaldo
a enfin évoqué la question de l'aide
au développement, en indiquant que les bailleurs de fonds pourraient
lier leur aide à de bonnes pratiques en matière environnementale
de la part des pays bénéficiaires.
Audition de M. Dominique Carreau, professeur de droit international économique à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, le 26 juin 2003
M.
Dominique Carreau, professeur de droit international économique à
l'Université Paris I
Panthéon-Sorbonne
, a
débuté son exposé en expliquant que la mondialisation
actuelle était moins avancée que celle observée au
XIX
e
siècle. La mondialisation implique la liberté du
commerce, la liberté des mouvements de capitaux, la liberté des
paiements, et la libre circulation des personnes. Sur ces deux derniers points,
le XIX
e
siècle était plus libéral que le monde
d'aujourd'hui.
Il a fallu reconstruire un ordre économique international après
la guerre. Les Etats ont alors rétabli, par le biais de conventions, un
ordre international qui existait sans conventions au XIX
e
siècle. Au XIX
e
siècle, la faiblesse des Etats
laissait le champ libre au règne du contrat. Aujourd'hui la
mondialisation résulte de la volonté politique des Etats, qui
l'ont fait advenir en adoptant de traités et en créant des
organisations internationales. Les Etats-Unis jouent un rôle majeur dans
ce processus, en exportant tant des produits, que des idées ou des
concepts juridiques.
La mondialisation pose en termes nouveaux la question des relations entre
réglementations internes d'intérêt général
(droit fiscal, droit du travail, droit de l'environnement...), et règles
du commerce international. Ces réglementations internes freinent les
échanges de biens et de services, ainsi que les investissements directs
étrangers (IDE).
La négociation d'un Accord multilatéral sur l'investissement
(AMI) a représenté une tentative pour concilier les
réglementations nationales et la liberté des investissements
directs étrangers. Une affaire récente intervenue au sein de
l'Alena (Accord de libre-échange nord-américain) fournit un
exemple de conciliation possible entre réglementation nationale et
liberté des IDE. Il s'agit de l'affaire
« Ethyl » : le Gouvernement canadien a introduit, pour
protéger l'environnement, une réglementation des produits entrant
dans la composition de l'essence. L'introduction de cette réglementation
a conduit une firme américaine à fermer l'une de ses usines
implantée au Canada. La firme a porté plainte devant les
instances de l'Alena, et a obtenu une compensation ; l'introduction de la
réglementation environnementale a été
considérée comme l'équivalent d'une mesure de
nationalisation. Le droit administratif français permet ce type de
réparations,
via
la notion d'inégalité devant les
charges publiques.
Puis
M. Dominique Carreau
a abordé, plus
précisément, la question de la conciliation entre environnement
et commerce. L'article XX du GATT prévoit des exceptions aux
règles commerciales afin de protéger l'environnement. Admettre
trop largement des exceptions au titre de l'article XX du GATT conduirait
à une restriction des échanges commerciaux. Les
réglementations nationales deviendraient des obstacles
unilatéraux aux échanges, et les pays les plus faibles seraient
pénalisés. Ce serait une manière pour les pays
développés d'exporter leurs normes de protection,
façonnant ainsi une nouvelle forme « d'impérialisme
juridique ».
Le commerce international porte sur des produits finis. S'intéresser
aux processus de fabrication conduit à s'immiscer très loin dans
la souveraineté des Etats. La délocalisation de services
(
outsourcing
) vers les pays du Sud se produit parce que les entreprises
peuvent tirer parti des législations sociales peu exigeantes des pays
d'accueil. Les pays du Sud pourraient appliquer des normes sociales plus
élevées s'ils bénéficiaient de technologies
modernes. Sans cela, leur imposer des normes sociales plus
élevées entraverait leur développement.
M. Dominique Carreau
en est ensuite venu au problème de la
« cohabitation entre traités ». Il existe plusieurs
centaines d'accords multilatéraux environnementaux (AME), d'une
très grande diversité. Certains traités apportent des
restrictions au commerce pour protéger des espèces animales et
végétales, ce qui est admis par le GATT. Il n'en demeure pas
moins des sources de conflit potentielles entre l'OMC et les AME.
Des conflits peuvent surgir autour des questions agricoles, comme l'ont
montré des litiges relatifs aux pesticides ou au boeuf aux hormones.
L'OMC admet des restrictions au commerce pour protéger l'environnement
ou la santé des consommateurs si les interdictions sont fondées
sur des preuves scientifiques.
Des conflits peuvent se nouer autour de l'Accord sur les droits de
propriété intellectuelle et le commerce (ADPIC), dans
l'hypothèse où le dépôt d'un brevet menacerait
l'environnement.
Des conflits peuvent apparaître dans le secteur des services. Les
services gouvernementaux sont aujourd'hui hors commerce. Il a été
suggéré de placer les services environnementaux dans la
même catégorie que les services gouvernementaux.
Des conflits peuvent enfin surgir entre des décisions rendues par
différentes instances de règlement des différends :
arbitres internationaux, Cour internationale de Justice, Organe de
règlement des différends de l'OMC,
etc
.
M. Serge Lepeltier, sénateur,
a alors demandé s'il
paraissait souhaitable de modifier l'article XX du GATT.
M. Dominique Carreau
a rappelé que l'exception de l'article XX
était très qualifiée. Les restrictions au commerce ne sont
admises que si la mesure envisagée est nécessaire, si elle
n'entraîne pas de discrimination arbitraire, et si elle ne constitue pas
une restriction déguisée au commerce. Ces conditions rigoureuses
expliquent que, dans presque tous les conflits, l'OMC ait fait prévaloir
la liberté du commerce.
Il a suggéré quelques pistes de réflexion : les normes
(relatives, par exemple, au climat, ou à la protection de la couche
d'ozone) qui visent à sauvegarder le patrimoine commun de
l'humanité, pourraient se voir reconnaître une autorité
supérieure à celle des règles commerciales. Il a cependant
admis que les autorités américaines actuelles s'opposeraient
à une telle évolution.
Une autre voie pourrait être explorée : la
négociation, sous l'auspice des Nations-Unies, d'une convention
internationale spécialisée sur l'environnement. Cette convention
définirait les grands principes à respecter. On pourrait placer
hors commerce international certains produits dangereux pour l'environnement,
ou les soumettre à une réglementation particulière, en
s'inspirant, par exemple, de la réglementation appliquée aux
armes ou aux matières nucléaires. Les Etats seraient libres de
définir leurs normes environnementales nationales, tant que celles-ci ne
mettraient pas en péril l'environnement global. Un Tribunal
international serait chargé d'arbitrer les conflits entre Etats.
On pourrait enfin s'inspirer de la notion de
jus cogens
, en l'appliquant
aux questions d'environnement. La Convention de Vienne sur le droit des
traités de 1969 définit le
jus cogens
comme un ensemble de
règles objectives et impératives à respecter. La France a
cependant toujours été réticente à
reconnaître la notion de
jus cogens
.
Pour terminer,
M. Serge Lepeltier, sénateur,
a soulevé le
problème du non-respect des conventions environnementales.
M. Dominique Carreau
a d'abord rappelé que le droit ne se
résumait pas à la seule question de sa sanction. Le droit dispose
d'un dynamisme et d'une force persuasive propres, qui peuvent lui assurer une
certaine effectivité, indépendamment de l'existence d'un
mécanisme de sanction.
Il s'est ensuite interrogé sur l'éventualité d'une
utilisation du Chapitre VII de la Charte des Nations-Unies pour protéger
l'environnement. Le Conseil de Sécurité a déjà
autorisé, sur la base du Chapitre VII, le recours à la force
à des fins humanitaires dans plusieurs instances. On ne peut donc
totalement exclure une nouvelle extension de l'usage qui est fait du Chapitre
VII, afin de protéger cette fois l'environnement. Pour
M. Dominique
Carreau
, les relations internationales sont en train de changer : le
droit international, qui a longtemps été jugé
quantité négligeable, vient aujourd'hui limiter la
souveraineté des Etats d'une manière inconnue dans le
passé.
Audition de M. Jean Salmon,
vice-président de la Commission économique,
de M. Guillaume
Baugin, chargé des affaires parlementaires, et de M. Guillaume
Brulé, économiste, de l'Assemblée permanente des chambres
d'agriculture, le 2 juillet 2003
M.
Jean Salmon, vice-président de la Commission économique,
M. Guillaume Baugin, chargé
des affaires parlementaires, et
M. Guillaume Brulé, économiste
, ont
présenté la position de l'Assemblée permanente des
chambres d'agriculture (APCA) sur la mondialisation.
L'APCA est favorable à une mondialisation régulée des
échanges agricoles. Elle estime qu'une totale libéralisation du
commerce agricole serait dangereuse pour les pays développés
comme pour les pays en développement. Les protections actuelles
évitent une invasion du marché européen par des produits
importés.
La production agricole n'est pas une production comme les autres. Des
considérations politiques doivent être prises en compte : la
production agricole locale assure la sécurité alimentaire du
pays. De plus, une complète libéralisation du secteur
entraînerait une baisse des prix, facteur d'exode rural et de
désertification de régions entières ; à la
production agricole sont donc associés des enjeux d'aménagement
du territoire.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a demandé quelles seraient,
en termes strictement économiques, les conséquences d'une
libéralisation complète des échanges agricoles.
M. Jean Salmon
a indiqué que, selon une étude du Fonds
monétaire international, la suppression des protections
douanières agricoles dans les pays développés ne
conduirait qu'à une hausse de 0,3 % du PIB mondial (soit 91
milliards de dollars). Cette suppression ferait des gagnants et des perdants.
Des pays comme la Suisse, la Norvège, le Japon, ou la Corée
bénéficieraient d'un tel changement, dans la mesure où les
coûts supportés par leurs consommateurs diminueraient. Les pays du
groupe de Cairns exporteraient plus de denrées agricoles. En Afrique,
seuls les pays jouissant d'une certaine stabilité politique et d'une
bonne gouvernance bénéficieraient de cette suppression. Il est
à noter que cette étude ne prend pas en compte les
« bénéfices multifonctionnels » de
l'agriculture (contribution à l'aménagement du territoire,
à la protection de l'environnement...) qui disparaîtraient, en
partie, du fait de la libéralisation totale des droits de douane.
M. Jean Salmon
a également estimé qu'il n'y avait pas de
risque de surproduction à l'échelle globale. Une étude de
la FAO montre que l'on s'achemine au contraire vers des tensions sur les
marchés agricoles mondiaux. Dans les pays développés, la
production tend à être réduite et contingentée. Les
évolutions démographiques en cours rendent indispensable le
maintien d'un secteur agricole très productif.
Puis
M. Jean Salmon
a abordé plus précisément les
questions liées à l'environnement. Il a distingué des
enjeux globaux (déforestation, effet de serre,
etc.
), et des
enjeux plus locaux. Il a évoqué le problème posé
par la difficile application de certains accords environnementaux, comme le
Protocole de Kyoto. Il a souligné que la pression à la baisse des
prix agricoles mondiaux favorise les atteintes à la biodiversité
dans les pays en développement ; dans un pays comme le Mali par
exemple, des écosystèmes fragiles sont surexploités par
des paysans appauvris par la baisse des cours des produits agricoles.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a alors voulu connaître la
position de l'APCA sur le cycle de négociations de Doha.
M. Guillaume Brulé
a indiqué que l'APCA souhaitait le
maintien d'une protection du secteur agricole dans l'espace communautaire.
Il a estimé, citant le cas de l'Australie, qu'une libéralisation
complète des échanges agricoles pourrait avoir des effets
négatifs sur l'environnement.
M. Jean Salmon
a ajouté qu'il fallait que les agriculteurs aient
des conditions de travail qui leur permettent de continuer à produire
des denrées commercialisables, tout en entretenant les espaces naturels
et le milieu agricole. L'idée que des agriculteurs soient
subventionnés pour se consacrer exclusivement à l'entretien des
espaces et des paysages lui paraît peu réaliste.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a demandé quelle
était l'analyse de l'APCA concernant la récente réforme de
la politique agricole commune (PAC).
M. Jean Salmon
a répondu que la réforme de la PAC
préservait la préférence communautaire, tout en organisant
la baisse des prix. L'appréciation que l'on peut porter sur la
réforme dépend du niveau auquel est fixé le prix des
différents produits agricoles. La baisse des prix doit rester
raisonnable pour ne pas menacer les producteurs.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a interrogé les
représentants de l'APCA sur leur vision des évolutions
souhaitables en matière de gouvernance mondiale.
M. Jean Salmon
a rappelé que la gouvernance mondiale dans le
domaine de l'environnement se caractérisait par la juxtaposition de
nombreux accords internationaux assez disparates. Il serait utile de
créer une instance mondiale dans le domaine de l'environnement, qui
suivrait les questions de traçabilité, ou d'OGM (organismes
génétiquement modifiés), sans oublier les finalités
non alimentaires de la production agricole : biomasse ou biocarburants,
par exemple.
M. Guillaume Brulé
a indiqué que le succès de l'OMC
reposait sur l'élaboration d'un corpus de règles contraignantes,
assorties d'un mécanisme de sanction. Les accords multilatéraux
sur l'environnement sont généralement peu contraignants, et les
Etats-Unis ne les ont pas tous ratifiés.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a souhaité connaître
la position de l'APCA sur les écotaxes.
M. Jean Salmon
a déclaré qu'il n'était pas hostile
à l'idée d'une fiscalité écologique, à
condition de savoir quelle était la finalité de la taxation, et
de définir des bases fiscales équitables. L'APCA est favorable
à une modulation de la fiscalité en fonction des pratiques
écologiques des agriculteurs. Toutefois, la mise en place d'un
dispositif satisfaisant risque de s'avérer complexe et très
bureaucratique.
Audition de M. Michel Mousel,
ancien président de la Mission interministérielle de l'effet de
serre (MIES),
le 2 octobre 2003
M.
Michel Mousel, ancien président de la Mission interministérielle
de l'effet de serre
(MIES)
, a expliqué que les rapports entre
mondialisation et environnement soulevaient trois questions :
* la première a trait aux stratégies des entreprises ;
* la seconde est liée au développement du secteur des
transports ;
* la troisième est relative aux biens publics et aux services publics.
Concernant les stratégies d'entreprises,
M. Michel Mousel
a
rappelé que les firmes multinationales avaient longtemps
considéré qu'elles pouvaient s'autoriser dans les pays du Sud des
comportements interdits au Nord. Cette situation évolue : les
dirigeants d'entreprises ont compris qu'ils avaient intérêt
à prendre des précautions pour protéger l'environnement,
ou, à tout le moins, à faire croire, qu'ils en prenaient. Compte
tenu de ces ambiguïtés, un processus contradictoire est
nécessaire pour se faire une juste opinion du comportement des
entreprises ; d'où l'importance du rôle des auditeurs
extérieurs pour la bonne information du public et des actionnaires.
Le développement des échanges internationaux est rendu possible
par la croissance des transports. La Commission européenne s'est peu
préoccupée des infrastructures de transport dans les pays
d'Europe centrale et orientale. On peut s'attendre, suite à
l'élargissement de l'Union européenne, à une
intensification des échanges à partir de réseaux de
transport très polluants.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a alors rappelé que la
croissance des transports était à peu près proportionnelle
à la croissance économique.
M. Michel Mousel
a ensuite abordé la question des biens publics,
dont font partie la santé et l'environnement, et des services publics.
Les altermondialistes sont très préoccupés par la question
de la privatisation des services publics, et de l'appropriation privée
des biens collectifs. A l'occasion de la préparation du Sommet de
Johannesburg, M. Michel Mousel a eu l'occasion de travailler sur une Charte des
grands services publics, qui réaffirme que la maîtrise des
services publics et de leurs infrastructures doit rester aux pouvoirs publics,
mais qui n'exclut pas des modes de gestion différenciés (public,
mixte, ou privé). Des responsables d'associations caritatives ou des
maires de grandes villes du Sud ont fait part, lors de ce sommet, de cas de
privatisations manquées, qui ont abouti, par exemple, à une
hausse du prix de l'eau ou à une raréfaction des ressources en
eau.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a demandé s'il était
possible, à court terme, d'avancer réellement sur la voie d'une
meilleure gouvernance mondiale, ou s'il fallait plutôt envisager une
action au niveau régional.
M. Michel Mousel
a répondu que le choix du niveau d'intervention
adéquat dépendait de la nature du sujet traité. Les
questions relatives à l'alimentation devraient par exemple être
organisées au niveau régional, afin de combiner autonomie dans
l'approvisionnement alimentaire et sécurité sanitaire,et
négociées entre ces sous-ensembles régionaux.
Il faut également s'interroger sur la nécessité de
créer, ou non, des organisations spécialisées. Il serait
utile de dépasser l'opposition apparente entre l'Organisation mondiale
du Commerce et les organisations spécialisées des Nations-Unies.
On pourrait imaginer, par exemple, qu'un Etat lésé par le
non-respect du Protocole de Kyoto par un autre Etat partie soit autorisé
à saisir l'Organe de règlement des différends de l'OMC, et
à prendre des mesures de rétorsion sur le terrain commercial.
Cela permettrait d'assortir le non-respect des accords multilatéraux
environnementaux d'une possibilité de sanction. Aujourd'hui, le point
faible de ces accords réside dans la faiblesse des mécanismes de
sanction. Il faudrait ainsi prévoir des possibilités de passage
de juridiction à juridiction.
M. Serge Lepeltier, sénateur
est ensuite revenu sur les causes de
l'échec du Sommet de La Haye, en 1998.
M. Michel Mousel
a indiqué qu'une cause importante de
l'échec de ce Sommet réside dans l'absence des pays du Sud de la
négociation. L'Union européenne et les Etats-Unis se sont
concentrés sur une négociation bilatérale sans marges de
compromis, faisant trop peu de cas des intérêts des pays en
développement.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a rappelé qu'un
phénomène similaire avait contribué à
l'échec du Sommet de Cancun, en septembre 2003. La conclusion d'un
accord Europe-Etats-Unis avant le sommet ne fut sans doute pas une bonne
stratégie internationale.
M. Michel Mousel
a ajouté que la culture, plutôt
conservatrice, de notre appareil diplomatique le prédisposait peu
à concevoir des dynamiques de réforme des institutions. Par
ailleurs, les questions environnementales sont encore trop peu abordées
lors des sommets internationaux.
Audition de M. Francis Stephan,
sous-directeur du développement économique et de l'environnement
au Ministère des Affaires étrangères,
le 22 octobre
2003.
M.
Francis Stephan, sous-directeur du développement économique et de
l'environnement à la direction du Développement et de la
Coopération technique du Ministère des
Affaires
étrangères
, a d'abord présenté le champ
d'activité de la direction qui l'emploie. La direction du
Développement et de la Coopération technique a été
créée au moment de la fusion du Ministère des Affaires
étrangères et du Ministère de la Coopération. Elle
gère de nombreux dossiers, ayant trait, notamment, à la bonne
gouvernance et à l'Etat de droit, à la santé, à
l'éducation, à l'agriculture, et à l'environnement. Elle
travaille surtout avec les pays faisant partie de la « zone de
solidarité prioritaire » de la France, c'est-à-dire les
pays africains, des pays de la zone Caraïbe, et trois pays d'Asie du
Sud-Est (Vietnam, Laos, Cambodge). La sous-direction du développement
économique et de l'environnement traite plus particulièrement des
questions liées à la gestion des ressources naturelles et de
l'environnement, aux services publics, à l'agriculture et à la
sécurité alimentaire, et au soutien aux petites et moyennes
entreprises (PME). La stratégie suivie privilégie le
développement durable plutôt que la protection des
ressources ; l'objectif est de définir les conditions d'une gestion
durable des ressources naturelles
Pour illustrer son propos,
M. Francis Stephan
s'est appuyé sur
l'exemple de la protection des massifs forestiers. Il est nécessaire,
pour protéger efficacement les forêts, d'obtenir l'adhésion
à ce projet de ceux qui y vivent, et en vivent. Une approche
fondée exclusivement sur les notions de protection et de
répression ne fonctionne pas. C'est pourquoi l'Agence française
de Développement passe avec les entreprises d'exploitation
forestière des contrats qui prévoient des obligations de gestion
durable des forêts, et une participation des populations locales aux
bénéfices retirés de cette exploitation. La politique de
la forêt mise en oeuvre par le Ministère s'inspire de
l'expérience française des parcs naturels régionaux :
des contrats sont passés entre l'administration et les habitants de ces
parcs pour les associer aux bénéfices de leur exploitation. Cette
approche contractuelle est aussi suivie pour la préservation des
espèces à usage pharmaceutique.
M. Francis Stephan
a rappelé que l'approche de la
biodiversité envisagée par la Convention de Rio fait du
patrimoine naturel un patrimoine national : la biodiversité n'est
pas considérée comme un élément du patrimoine
mondial, chaque nation est propriétaire de ses ressources naturelles.
La direction du Développement et de la Coopération technique
s'intéresse aussi à la gestion des ressources en eau. Elle
défend un modèle de Gestion intégrée de la
ressource en eau (GIRE). Il s'agit d'associer toutes les parties prenantes
(compagnies d'électricité, collectivités locales,
agriculteurs, habitants...) à la gestion durable de la ressource en eau.
La France a pris récemment une initiative relative au fleuve Niger. Le
Mali et le Niger souhaitent depuis longtemps une aide financière pour la
construction de barrages. La France a décidé de suspendre sa
réponse à cette demande à la condition que la dimension
régionale du projet soit prise en compte.
M. Francis Stephan
a ensuite abordé la question de la production
énergétique. Pour la Banque Mondiale, l'énergie est un
secteur économique comme les autres, qui doit être
géré par des entreprises privées. L'Union
européenne a fait sienne cette idée, ce qui explique que les
Accords de Cotonou ne prévoient pas de coopération dans le
domaine énergétique. L'Allemagne et la France souhaitent une
évolution en la matière ; elles considèrent que la
notion de politique énergétique reste pertinente, notamment parce
que les Etats doivent prendre en charge la construction des infrastructures,
qui, peu rentables à court terme, n'intéressent pas le secteur
privé. La France souhaite aussi que les politiques
énergétiques fassent une place aux énergies renouvelables,
et, en particulier, à l'énergie photovoltaïque. La promotion
des énergies renouvelables doit être complétée par
une politique d'économies d'énergie et d'amélioration de
l'efficacité énergétique. La marge de progression en la
matière est considérable : aux Etats-Unis, la production
d'un kilowatt heure d'électricité requiert une consommation de
mazout trois fois supérieure à celle observée en
Europe ; en Russie, une consommation sept fois supérieure est
nécessaire. A ce propos, le dernier accord de coopération
franco-russe inclut, pour la première fois, un volet consacré
à l'efficacité énergétique.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a alors demandé comment il
convenait de gérer les biens publics mondiaux, dont fait partie la
biodiversité. Il a aussi évoqué le thème de la
coopération décentralisée.
M. Francis Stephan
a indiqué que le Ministère était
très intéressé par la notion de bien public mondial. Il
veille de près à l'évolution des conventions sur le
changement climatique, la désertification et la biodiversité. En
principe, la gestion des biens publics devrait se faire au niveau local, tandis
que la gouvernance et le financement devraient être mondiaux. Mais la
pratique des organisations internationales n'est pas toujours conforme à
ce modèle. M. Francis Stephan a cité le cas de l'initiative prise
par la FAO pour la lutte contre les sauterelles en Afrique : l'action de
cette organisation internationale ne peut produire de résultats
satisfaisants sans la coopération des pays africains concernés.
Or, au lieu de s'appuyer sur des ressources locales, la FAO tend à
constituer une lourde structure logistique centralisée.
M. Francis Stephan
a souligné que le Ministère des
Affaires étrangères conduisait nombre d'actions en partenariat
avec les collectivités locales des pays en voie de développement.
Depuis dix ans, le Ministère soutient par exemple un programme de
Gestion locale sécurisée des ressources foncières. Ce
programme a pour objet de pallier l'absence de droits fonciers dans de nombreux
pays du Sud. La question de l'accès à l'eau relève aussi
clairement de la responsabilité des collectivités locales.
Les collectivités locales françaises mènent aussi des
actions de coopération. Mais elles ont eu trop souvent, selon
M.
Stephan
, une approche « humanitaire » de la
coopération. Cela signifie qu'elles ont mené des actions
ponctuelles, alors que l'apport majeur de la coopération
décentralisée pour le Ministère réside dans le
transfert de savoir-faire, qui suppose une intervention de longue durée.
Les ONG sont un autre acteur significatif dans le domaine de la
coopération internationale. Elles sont de plus en plus sensibles au
thème, développé par le Ministère, de la gestion
locale des ressources. La part de l'aide publique au développement qui
passe par les ONG demeure encore modeste en France. Mais elle constitue souvent
une part importante des ressources des ONG, de sorte que la situation
budgétaire tendue que connaît actuellement l'Etat se
répercute directement sur leur action.
Audition de MM. Jean-Pierre
Bompard, secrétaire confédéral en charge des questions
internationales,
et Pierre Bobe, secrétaire confédéral
en charge de l'énergie, de l'environnement, et du développement
durable, à la Confédération française
démocratique du Travail (CFDT),
le 22 octobre 2003.
Pour
ouvrir la discussion
, M. Serge Lepeltier, sénateur
, a fait part
de son impression selon laquelle les syndicats seraient moins présents
que les ONG dans les conférences internationales.
M. Jean-Pierre Bompard, secrétaire confédéral en charge
des questions internationales à la
CFDT
, a indiqué que
les syndicats étaient présents par l'intermédiaire de la
Confédération internationale des syndicats libres (CISL), ou de
la Confédération européenne des syndicats (CES). La CISL
intervient dans les sommets mondiaux, la CES dans les sommets européens.
Il a ensuite distingué l'action des ONG de celle des syndicats. Le
travail des ONG se situe dans une logique « de cause »,
souvent unique. Les syndicats s'inscrivent davantage dans une démarche
d'intérêt général, et sont prêts à
accepter des compromis. Leur image est de ce fait plus institutionnelle.
L'action syndicale à l'échelle internationale se manifeste par
des actions de lobbying auprès des Gouvernements, mais aussi par la
signature d'accords conclus entre les Fédérations internationales
et des firmes multinationales. 23 accords de ce type ont été
signés à ce jour.
Après ce préambule,
M. Jean-Pierre Bompard
a
développé la position de la CFDT sur la mondialisation.
La CFDT ne rejette pas la mondialisation. L'accroissement des échanges
est en effet un facteur de développement. Mais elle souhaite une
mondialisation régulée, qui ne saurait être obtenue par la
simple multiplication des accords bilatéraux. C'est pourquoi la CFDT ne
s'est pas réjouie de l'échec du sommet de Cancun.
La CISL a proposé que les normes sociales fondamentales soient au coeur
des négociations de Doha. Le mouvement syndical international
apparaît moins déterminé sur les questions
environnementales. Toutefois, les syndicats français sont plus
avancés sur les questions environnementales que leurs homologues
étrangers. Afin d'obtenir une meilleure prise en compte des questions
environnementales, la CFDT s'efforce de promouvoir la notion de
développement durable.
M. Pierre Bobe, secrétaire confédéral en charge de
l'énergie, de l'environnement, et du
développement durable
à la CFDT
a souligné que le concept de développement
durable permettait d'intégrer les trois dimensions de l'économie,
du social, et de l'environnement. En effet, le développement durable
vise à concilier efficacité économique,
équité sociale, et protection de l'environnement. Ces trois
dimensions doivent en permanence être associées : on ne peut,
par exemple, comme le suggèrent les Verts, proposer d'abandonner
l'énergie nucléaire en cinq ans, sans se préoccuper du
reclassement des 140 000 salariés de la filière
nucléaire.
M. Pierre Bobe
a insisté sur la nécessité de
convaincre les opinions publiques de l'importance du développement
durable. Aujourd'hui, on observe que des mesures telles que la hausse du prix
du carburant, ou l'instauration de péages pour les camions en Allemagne,
rencontrent des résistances dans l'opinion publique.
M. Jean-Pierre Bompard
a ensuite précisé que la CFDT
travaillait principalement sur trois dossiers au sein de la CES :
* l'agriculture et la sécurité sanitaire ;
* les risques chimiques et industriels ;
* l'énergie, le climat, les transports, et l'aménagement du
territoire.
Concrètement, la CFDT a, par exemple, pris l'initiative de rassembler et
de faire travailler ensemble les syndicats concernés par le naufrage du
« Prestige ». La CES a, par ailleurs, décidé
d'organiser une Conférence internationale sur le changement climatique
à l'approche de la Neuvième Conférence des Parties au
Protocole de Kyoto.
La CFDT est également présente au sein du TUAC (
Trade Union
Advisory Committee
, ou Commission syndicale consultative auprès de
l'OCDE). Le TUAC est régulièrement auditionné par l'OCDE
sur tous les dossiers que traite l'organisation.
M. Serge Lepeltier, sénateur,
a ensuite souhaité
être informé de la place des syndicats à l'OMC.
M. Jean-Pierre Bompard
a indiqué que des représentants
syndicaux étaient présents à tous les sommets de l'OMC. Il
a aussi souligné l'effort des autorités françaises pour
associer les syndicats à la préparation de ces conférences
internationales. Cette participation des syndicats aux travaux de l'OMC se
justifie pleinement, dans la mesure où le commerce international a un
impact direct sur la situation des salariés.
Puis
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a souhaité
connaître la position de la CFDT sur le projet de création d'une
Organisation Mondiale de l'Environnement (OME).
M. Pierre Bobe
a répondu que la création d'une OME serait
inutile si l'OMC intégrait pleinement les préoccupations sociales
et environnementales. Il existe un risque que l'OME soit une institution dont
l'action ait peu d'effets concrets. Il n'est pas sûr, en outre, que les
conditions politiques nécessaires à la création d'une OME
soient actuellement réunies : les syndicats des pays du Sud voient
dans la promotion des normes sociales et environnementales un frein au
développement.
Audition de M. Yannick
Jadot,
directeur des campagnes de Greenpeace France,
le 17
décembre 2003
M.
Yannick Jadot, directeur des campagnes de Greenpeace France
, a
débuté l'audition en présentant Greenpeace, association
présente dans de très nombreux pays, comme une organisation
mondialiste. Son but est de promouvoir la protection de l'environnement
à l'échelle mondiale, par l'élaboration d'un droit
international de l'environnement.
Greenpeace a contribué à l'élaboration de conventions
internationales sur l'environnement, telles que la Convention de Stockholm sur
les polluants organiques persistants, la Convention de Bâle sur les
exportations de déchets, le protocole sur la biodiversité, ou le
protocole de Kyoto. Les Etats ont une responsabilité dans le domaine de
l'environnement, et leur instrument d'action est le droit international.
Après la chute du mur de Berlin, la dimension économique et
financière de la mondialisation a pris le pas sur ses autres dimensions
(universalité des droits de l'homme, protection de l'environnement,
etc.). Les Etats tendent à se désengager, et à
étendre le champ des activités laissées au secteur
privé. Le Sommet de Johannesburg en a offert l'illustration : peu
d'initiatives intergouvernementales ont été
adoptées ; en revanche, les partenariats publics-privés ont
été fortement encouragés. Une initiative
franco-britannique sur l'eau a conclu à l'importance d'accorder aux
entreprises la possibilité de gérer la distribution d'eau. Une
initiative française sur la protection des forêts dans le bassin
du Congo envisage de donner aux entreprises la responsabilité d'assurer
la gestion durable des forêts, contre une rétribution
financée par l'aide publique au développement.
Cette tendance à confier aux entreprises des responsabilités de
protection de l'environnement peut inquiéter, dans la mesure où
c'est aux Etats qu'incombe normalement la responsabilité de
défendre l'intérêt général. Pour les
entreprises, l'environnement demeure une contrainte. De plus l'organisation des
systèmes judiciaires sur une base nationale rend souvent difficile la
mise en cause de la responsabilité des firmes multinationales pour les
activités de leurs filiales à l'étranger, comme l'a
montré en Inde l'affaire de Bhopal.
Puis
M. Yannick Jadot
a relevé les faiblesses de la gouvernance
mondiale, que ce soit en matière de sécurité collective,
de prévention des crises financières, ou de négociation
commerciale internationale. Il a souligné que l'Organisation Mondiale du
Commerce était devenue un lieu de négociation de nombreux sujets
politiques, et s'est demandé si cette enceinte était le lieu
adéquat de définition de nos préférences
collectives au niveau international.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a alors souhaité savoir
quels étaient les liens entre Greenpeace et la mouvance
altermondialiste.
M. Yannick Jadot
a répondu que Greenpeace se battait depuis
trente ans pour une mondialisation de la protection de l'environnement, et
qu'il se rangeait, en ce sens, parmi les altermondialistes. Mais il a
noté la grande hétérogénéité du
mouvement altermondialiste, qui est encore très peu structuré.
Greenpeace recherche ainsi des convergences avec les organisations qui
partagent ses objectifs.
Puis
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a demandé quelles
sections de l'opinion publique étaient les plus sensibles aux questions
environnementales.
M. Yannick Jadot
a indiqué qu'existait pour l'ensemble de la
mouvance écologiste le risque de ne s'adresser qu'à la
catégorie des « consommateurs globaux ». Il
désigne par là les personnes appartenant aux classes moyennes et
aisées, qui ont accès à une information globale et qui
bénéficient de la mondialisation. Ces catégories sociales
sont sensibilisées à la protection de l'environnement, mais
n'entendent pas de discours critique sur leurs modes de consommation, qui sont
pourtant une cause centrale des atteintes portées à
l'environnement. A l'opposé, 80 % des habitants de la
planète sont des personnes pauvres, largement déconnectées
du marché mondial. Il faut éviter que les populations des pays en
voie de développement, qui ont un droit légitime au
développement, ne reproduisent les modes de production et de
consommation propres aux pays occidentaux, sans quoi les pressions subies par
notre environnement naturel excéderont largement sa capacité
d'absorption.
L'opinion publique sera davantage incitée à protéger
l'environnement si elle a le sentiment de pouvoir agir concrètement en
ce sens. C'est pourquoi il est important de faire connaître les produits
écologiques aux consommateurs.
Dans la mesure où les lobbies économiques sont
généralement plus puissants que les lobbies écologiques,
il est indispensable de gagner les opinions publiques à la cause de la
protection de l'environnement pour infléchir les politiques publiques.
Convaincre les citoyens de l'enjeu que représente la protection de
l'environnement leur permet également de mieux s'approprier les
politiques environnementales.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a ensuite demandé quel
était pour Greenpeace le principal problème environnemental
aujourd'hui.
M. Yannick Jadot
a répondu que le réchauffement climatique
était le problème environnemental le plus préoccupant
actuellement. Il a souhaité que l'Union européenne applique le
protocole même si celui-ci ne devient pas juridiquement contraignant. Un
effort devrait être fait pour promouvoir les énergies
renouvelables, y compris dans les pays du Sud par le biais de l'aide au
développement et des agences de crédit à l'exportation.
M. Serge Lepeltier
,
sénateur
, a souhaité savoir si
le « dumping environnemental », c'est-à-dire la
délocalisation d'industries pour bénéficier de normes
environnementales moins strictes, représentait, selon Greenpeace, une
menace sérieuse pour l'environnement.
M. Yannick Jadot
a estimé que les situations étaient
contrastées. Beaucoup de firmes multinationales tendent à
s'implanter dans les pays du Sud en reproduisant les modes de production
développés dans leur pays d'origine, où les normes
environnementales sont strictes.
Toutefois, des phénomènes de « dumping
environnemental » sont bien observés dans certains secteurs,
tels le transport maritime. Les coûts du transport maritime demeurent
réduits, au prix d'un très faible niveau d'exigence dans le
domaine social, environnemental, et en matière de
sécurité.
Des délocalisations sont également observées dans le
secteur de l'industrie chimique. Le secteur de la tannerie est très
largement délocalisé dans les pays du Sud, en raison des
importants rejets polluants qu'il émet.
M. Yannick Jadot
a conclu sur ce point en indiquant qu'il pouvait
exister une contradiction entre l'évolution des
préférences collectives dans les pays du Nord, où les
populations sont plus sensibles à la protection de l'environnement, et
le choix de l'ouverture aux échanges commerciaux.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a ensuite évoqué la
question de la création d'une Organisation Mondiale de l'Environnement.
M. Yannick Jadot
a indiqué que Greenpeace était favorable
à la création d'une telle organisation et que celle-ci constitue
un objectif à moyen long terme. Il existe toutefois un risque que cette
organisation ait peu de pouvoirs, et se contente d'émettre des rapports
et des recommandations non suivis d'effets. Il ne faudrait pas non plus que le
débat sur l'OME détourne les Etats de leurs obligations les plus
immédiates, à savoir l'application des conventions
environnementales existantes. Il faut noter, enfin, que peu d'Etats sont
actuellement désireux de créer une telle organisation.
Greenpeace est également favorable à la création d'une
écotaxe internationale.
M. Serge Lepeltier, sénateur
, a précisé, sur ce
point, que le Groupe d'étude sur la fiscalité mondiale, mis en
place il y a quelques mois, réfléchissait à
l'hypothèse d'une taxation internationale du CO
2
.
LISTE DES PERSONNES
RENCONTRÉES AU COURS DE LA MISSION À GENÈVE
DE M. SERGE
LEPELTIER DU 4 JUIN 2003
-
M.
Roderick Abbott
, Directeur général adjoint OMC ;
-
M. Jorge Vigano
, Directeur Division Commerce et Environnement
OMC ;
-
S.E. Mme Yolande Biké
, Ambassadeur, Représentante
permanente du Gabon auprès de l'OMC ;
-
S.E. M. Alejandro Jara
, Ambassadeur, Représentant permanent du
Chili auprès de l'OMC ;
-
S.E. M. Pierre-Louis Girard
, Ambassadeur, Représentant
permanent de la Suisse auprès de l'OMC ;
-
M. Philippe Gros
, Délégué permanent de la France
auprès de l'OMC ;
-
M. Cédric Pène
, Conseiller agricole
Délégation de la France auprès de l'OMC ;
-
Dr Jansen
, Service des Etudes économiques OMC ;
-
S.E. M. Tim Groser
, Ambassadeur, Représentant permanent de
Nouvelle-Zélande auprès de l'OMC ;
-
S.E. M. Luiz Felipe de Seixas Correa
, Ambassadeur, Représentant
permanent du Brésil auprès de l'OMC.
LISTE DES PERSONNES
RENCONTRÉES AU COURS DE LA MISSION À BRUXELLES
DE M. SERGE
LEPELTIER DU 8 OCTOBRE 2003
-
MM.
Robin Miege
,
François Wakenhut
et
Mme Laurence Graff
,
Direction générale de l'environnement, Commission
européenne ;
-
Mme Catherine Day
, Directeur général de l'Environnement,
Commission européenne ;
-
M. François Lamoureux
, Directeur général de
l'Energie et des Transports, Commission européenne ;
-
M. Raphaël Bello
, Conseiller pour les questions OMC,
Représentation permanente de la France près de l'Union
européenne ;
-
Mme Lilas Bernheim
, Conseiller pour les questions environnement,
Représentation permanente de la France près de l'Union
européenne ;
-
M. Nicolas Théry,
Chef de Cabinet du Commissaire Pascal Lamy
(DG Commerce), Commission européenne ;
-
M. Robert Madelin
, Directeur à la DG Commerce, Commission
européenne.
* 1 Cf. Déclaration ministérielle de Doha, 14 novembre 2001, paragraphes 20 à 25 et 31 à 33.
* 2 D'après le titre de l'ouvrage de Suzanne Berger, Notre première mondialisation . Leçons d'un échec oublié , 2003, La République des idées, Paris Seuil.
* 3 Le marché des changes est celui où s'effectuent les opérations d'achat ou de vente de devises.
* 4 Cf. Charles-Albert Michalet, Qu'est-ce que la mondialisation ?, La Découverte, 2002 ; le compte rendu de l'audition de M. Michalet est publié en annexe.
* 5 Parsley David C. et Shang-Jin Wei, 2001 « Limiting currency volatibility to stimulate goods market integration : a price-based approach », NBER Working paper n° 8468 (Cambridge, Massachusetts, National Bureau of Economic Research).
* 6 Cette approche a été initiée par M. Feldstein et C. Horioka en 1980 ; cf. « The saving investment relation puzzle », Economic Journal, 1980.
* 7 Le Cacheux J. , « Mondialisation économique et financière : de quelques poncifs, idées fausses et vérités », Revue de l'OFCE, mars 2002.
* 8 Richard J., Herring et Robert E. Litan, Financial Regulation in the Global Economy, Washington, Brookings Institution, 1995, p. 14.
* 9 Hummels, David, «Time as a trade barrier », 2000, CIBER Working Paper n° 2000-007.
* 10 Les premiers câbles téléphoniques transatlantiques à la fin des années 1950 pouvaient transmettre une centaine de communications simultanément ; leur débit dépasse aujourd'hui 1,2 million de communications.
* 11 Le compte rendu de l'audition est publié en annexe.
* 12 Pour une présentation plus détaillée de ces travaux, le lecteur pourra se référer à P. Messerlin, Measuring the costs of protection in Europe, Institute for Internatinal Economics, Washington DC, 2001, ou à P. Messerlin, Niveau et coût du protectionnisme européen, Economie internationale, n°89-90, 1 er - 2 e trimestre 2002.
* 13 Hufbauer G. et Elliott K.A., Measuring the costs of protection in the United States, 1994, Institute for International Economics, Washington D.C.
* 14 Cf. World Economic Outlook, FMI, 1997, p.46. Traduction de l'auteur.
* 15 P. de Senarclens, La mondialisation. Théories, enjeux et débats, Armand Colin, 2002, p. 94.
* 16 Les PMA regroupent, selon la terminologie de la CNUCED, les 49 pays les plus pauvres de la planète.
* 17 P. Samuelson, « The Pure Theory of Public expenditure », Review of Economics and Statistics, vol. 56, 1954.
* 18 L. Tubiana et J.M. Severino, « Biens publics mondiaux, gouvernance mondiale et aide publique au développement », Gouvernance mondiale, Rapport du CAE, 2001, La Documentation française.
* 19 C. Kindleberger, « International public goods without international government », American Economic Review, n° 76, 1, 1986.
* 20 H. Bourguinat, « Quand les biens « publics » deviennent « globaux » », Sociétal, n° 39, 1 er trimestre 2003.
* 21 On peut consulter à ce sujet la contribution de Michel Aglietta et Christian de Boissieu, « Le prêteur international en dernier ressort », dans le rapport du CAE Architecture financière internationale, 1999.
* 22 Ces raisonnements, qui s'inscrivent dans la perspective d'États cherchant à maximiser leur utilité, n'interdisent cependant pas d'envisager des comportements altruistes.
* 23 G. Grossman et A. Krueger, « Environmental impacts of a North American Free trade Agreement », in P.Garber, The Mexico US Free Trade Agreement, 1993 (MIT Press, Cambridge, Massachusetts).
* 24 W.J. Baumol et W.E. Oates, The Theory of Environmental Policy, Cambridge University Press, 1988.
* 25 N. Mabey et R. Mc Nally, 1999, Foreign Direct Investment and the Environment : from Pollution Haven to Sustainable Development, WWF, UK.
* 26 H.J. Leonard, Pollution and the Struggle for the World Product, 1988, Cambridge University Press, Cambridge.
* 27 A. Jha, A. Markandya et R. Vossenaar, Reconciling trade and the Environment : Lessons from case studies in Developing Countries, 1999, Elgar : Cheltenham, UK.
* 28 Banque mondiale, Indicateurs du Développement mondial, 1998, Washington D.C.
* 29 P. Sorsa, « Competitiveness and Environmental Standards », Policy Research Working Paper n° 1249, Banque mondiale, Washington D.C.
* 30 R. Repetto, « Jobs, Competitiveness and Environmental Regulation : What are the Real issues ? », 1995, World Resources Institute, Washington D.C.
* 31 J. Albrecht, « Environmental Policy and Inward Investment Position of U.S. Dirty Industries », Intereconomics, juillet/août 1998.
* 32 G. Eskeland et A. Harrison, « Moving to greener pasture ? Multinationals and the pollution-haven hypothesis » Policy Research Working Paper n° 1744, Banque mondiale, Washington D.C.
* 33 D. Esty et D. Gerardin, « Environmental protection and international competitiveness : a conceptual framework », Journal of World Trade, vol. 32 (3), juin 1998.
* 34 OCDE, « Les conséquences des politiques de protection de l'environnement sur les coûts de compétitivité : la sidérurgie », DSTI/SI/SC (97) 46, 1997, Paris, France.
* 35 Il convient de noter que, dans l'étude de l'OCDE, les coûts de la lutte antipollution sont rapportés au prix de revient, tandis qu'ils sont rapportés au chiffre d'affaires dans les données américaines. Néanmoins, ces deux ratios sont étroitement liés puisqu'à long terme le prix du marché tend, du fait de la concurrence, à se rapprocher du prix de revient unitaire, majoré d'une marge correspondant au rendement du capital.
* 36 M. Cohen et S. Fenn « Environmental and Financial Performance : are they related ? », 1997, Department of Economics, Vanderbilt University, Nashville.
* 37 D'après Repetto (étude citée), le raffinage du pétrole, la fabrication de produits chimiques, la pâte et le papier, et le travail des métaux font partie des activités qui comptent le moins de salariés par millions de dollars de chiffres d'affaires.
* 38 J. Tobey, « The impact of domestic environmental policies on patterns of world trade : an empirical test », Kyklos, vol. 43, 1991.
* 39 Voir OCDE, « Environmental issues in policy-based competition for investment : a literature review », 2002, Paris, France.
* 40 Z.C. Guoming, Z. Yangui, G. Shungi et J.X. Zhan, « Cross border environmental management and transnational corporations : the case of China », 1999, CNUCED / Copenhagen Business School.
* 41 A. Warhust et G. Bridge, « Economic liberalisation, innovation and technology transfer opportunities for cleaner production in the minerals industry », 1997, Natural Resources Forum, 21.
* 42 D. Vogel, « Environmental regulation and economic integration », Journal of international economic Law », 3 : 2, 2000.
* 43 D. Lee, « The effects of environmental regulations on trade : cases of Korea's new environmental laws », Georgetown International Law Review, n° 5, 1993.
* 44 OCDE, « Environmental benefits of foreign direct investment : a literature review », 2002, p. 21, OCDE, Paris, France.
* 45 J. Sachs et A. Warner, « Economic reform and the process of global integration », Brookings paper on economic activity, 1, 1995.
* 46 D. Rodrick et J. Rodriguez, « Trade policy and economic growth : a skeptic guide to the cross national evidence », NBER Macroeconomics Annual, 2002.
* 47 Cf. A. Harrison, « Openness and Growth : a time-series, cross-country analysis for developing countries », NBER Working paper n° 5221, août 1995.
* 48 N. Shafik et S. Bandyopadhyay, « Economic growth and environmental quality : time-series and cross-section evidence », Policy research working paper n° WPS 904, 1992, Banque mondiale. Les dix indicateurs environnementaux retenus sont : l'absence d'eau propre, l'absence d'assainissement urbain, la teneur de l'air en particules et en oxyde de soufre, le rythme annuel de déforestation, l'oxygène dissous dans les cours d'eau, la teneur en coliformes fécaux, le volume de déchets municipaux par habitant et les émissions de CO 2 .
* 49 Des projets du PNUE sont toutefois financés par le Fonds pour l'environnement mondial (voir infra ).
* 50 Dans ce dernier domaine toutefois, le FEM n'intervient que dans les pays en transition. C'est le Fonds Multilatéral spécifique au Protocole de Montréal qui gère les ressources destinées aux pays en développement.
* 51 Groupes spéciaux et Organe d'appel sont des instances quasi-juridictionnelles mises en place par l'organe de règlement des différends pour arbitrer les litiges portés devant l'OMC.
* 52 Le lecteur se reportera avec profit aux analyses contenues dans le rapport Guesnerie, Kyoto et l'économie de l'effet de serre, CAE, 2003, notamment p. 23-31, ainsi qu'à un précédent rapport d'information de M. Serge Lepeltier, « Maîtriser les émissions de gaz à effet de serre : quels instruments économiques ? », n° 346 (1998-1999).
* 53 OCDE, Contre le changement climatique. Bilan et perspectives du Protocole de Kyoto, 1999, p. 38.
* 54 Rapport Lanxade, Organiser la politique européenne et internationale de la France, Commissariat général du Plan, La Documentation Française, Paris, 2002.







