C. DE NOUVEAUX ACTEURS DE TERRAIN À PROMOUVOIR
La France a derrière elle une longue tradition d'étatisme en matière de monuments historiques. Même Guizot, le libéral, se fait, dans ses « Mémoires pour servir l'histoire de mon temps », l'apôtre d'un despotisme éclairé dans lequel l'État indique « une direction éclairée au zèle des autorités locales » .
Mais, aujourd'hui, cela va dans le sens de notre histoire politique et administrative de proposer de recentrer progressivement l'État sur son coeur de métier, les fonctions régaliennes de contrôle ; celui-ci n'assurerait dans cette optique que la gestion des monuments ou des opérations qui, par leur importance, dépassent les capacités des autres collectivités publiques.
L'État doit donc envisager de passer sur le terrain le relais aux collectivités locales, d'ailleurs de plus en plus actives, tout en préservant ses prérogatives de régulateur et de garant de la protection du patrimoine.
1. Des collectivités territoriales de plus en plus présentes bien qu'inégalement motivées
Votre rapporteur spécial a pu, grâce à une enquête lancée par La Demeure historique et aux données rassemblées à sa demande par la direction du patrimoine et de l'architecture, se faire une idée de l'engagement inégal des collectivités territoriales en matière de patrimoine monumental.
a) L'effort variable des collectivités publiques induit une diversité des taux d'aide
La France n'a pas les mêmes traditions locales, le même « esprit de clocher », qui, à l'étranger, fait du patrimoine un élément constitutif de la conscience politique locale. Les républiques urbaines d'Italie, les villes libres d'Empire et les villes des Flandres possèdent un patrimoine qu'elles enrichissent depuis la fin du Moyen-age mais il faut attendre en France les années récentes pour voir apparaître la fierté , jusque là étouffée par le centralisme, des collectivités locales pour leur patrimoine.
Ce réveil patrimonial des collectivités territoriales s'est accompagné de la montée en puissance des interventions financières des départements, surtout ainsi que, accessoirement, des régions, aboutissant, compte tenu des aides de l'État et aujourd'hui de l'Europe, à des taux d'aides éminemment variables à travers le territoire national.
(1) Les aides européennes
Les aides en provenance des fonds structurels européens sont fixées pour une période qui va actuellement de 2000 à 2006. Pour en bénéficier, il faut appartenir aux zones dites de « catégorie 2 ».
L'aide communautaire présente un caractère complémentaire, en ce sens qu'elle vient s'ajouter au soutien public ou privé. Elle est distribuée sur la base des documents uniques de programmation, en l'occurrence les contrats de plan État -région, dont le volet culturel n'est qu'un aspect relativement limité.
Le taux d'intervention communautaire maximum est de 50 %, en application du règlement n° 1260/1999 du 21 juin 1999.
Le tableau ci-dessous montre que peu de régions profitent des Fonds structurels européens.

Il est impératif de profiter des facilités offertes à ce titre dans la mesure où, d'une part, les enveloppes pour la période d'après 2006 sont en cours de négociation mais pourraient bien baisser après l'élargissement, et où d'autre part à plus court terme, les aides non utilisées seront désormais caduques si elles ne sont pas utilisées dans les deux ans de l'engament des crédits, en application de la règle dite « du dégagement d'office ».
(2) La diversité des taux d'intervention de l'État
Les textes ne mentionnent aucun taux plafond pour les monuments classés, bien qu'une circulaire de 1991 recommande de ne pas dépasser 80 %. Pour les monuments inscrits, il résulte de la loi de 1913 que des subventions peuvent être attribuées dans la limite de 40 % du montant total des travaux.
En fonction des régions et des critères appliqués par le CRMH, le taux d'intervention varie de 10 à 60 % pour les monuments classés et de 10 à 40 % pour les monuments inscrits, pour lesquels la moyenne serait de 20 %.
(3) Des compléments des collectivités territoriales éminemment variables
Les interventions des collectivités territoriales ne reposent sur aucune base réglementaire définie. Certains conseils généraux rassemblent toutefois, dans un opuscule constituant un guide des aides, les règles applicables.
Ces modalités sont très variables selon les régions ou les départements ainsi que dans le temps.
L'étude lancée par La Demeure historique sur les cofinancements publics concernant les monuments historiques privés, protégés, classés ou inscrits, souligne la diversité des taux selon les régions.
Pour les monuments classés, un certain nombre de régions atteignent 50 % (Auvergne, Bretagne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charente, Provence-Côte d'Azur) avec un maximum de 60 % pour le Limousin et le Centre.
Pour les monuments inscrits, les niveaux d'intervention effectifs sont beaucoup plus faibles. Ils se situent entre 10 et 15 % pour l'Alsace, l'Aquitaine, la Bretagne, le Centre, le Nord-Pas-de-Calais et les Pays de la Loire. Seule la région Limousin atteint le taux de 40 % pour cette catégorie de monuments.
Les interventions des conseils régionaux sont relativement limitées et concernent, en règle générale, uniquement des monuments classés , sauf pour les régions de Bretagne, de Corse et des Pays de la Loire. Ainsi, les régions Alsace, Centre, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Basse-Normandie et Poitou-Charentes interviennent de façon, présentée dans l'étude la Demeure historique, comme limitée, voire exceptionnelle.
Au niveau départemental, le taux d'intervention des conseils généraux est souvent le même pour les monuments classés et inscrits. Il varie de 5 à 50 % dans l'Oise et dans le Nord, en passant par 40 % pour des départements comme la Mayenne ou la Sarthe.
L'étude souligne la diversité de l'attitude des conseils généraux vis-à-vis des monuments inscrits : soit le taux d'intervention est supérieur à celui des « classés » pour compenser la moindre participation de la DRAC, tel est le cas des départements de l'Ain, de l'Isère, de la Moselle, de l'Oise, de la Seine-Maritime et de la Somme ; soit, au contraire, certains conseils généraux n'aident pas les « inscrits » comme dans les départements de l'Allier, des Bouches-du-Rhône, du Cantal, des Deux-Sèvres, du Lot et des Pyrénées Orientales.
En définitive, il faut souligner qu'un bon tiers des conseils généraux n'apporte aucun soutien aux travaux entrepris sur des monuments privés : Hautes-Alpes, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Corrèze, Creuse, Dordogne, Doubs, Essonne, Gard, Gers, Haute-Garonne, Gironde, Marne, Haute-Marne, Landes, Loir-et-Cher, Haute-Loire, Loiret, Meuse, Nièvre, Orne, Pas-de-Calais, Hauts-de-Seine, Tarn-et-Garonne, Val-de-Marne, Vaucluse, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines.
A ces différences de taux d'intervention, s'ajoutent des différences d'assiette et de modalités de calcul. Tandis que la subvention de l'État est définie à partir du montant total TTC des travaux, les concours des conseils généraux sont calculés, dans certains cas, sur les montants hors taxes et se basent aussi bien sur l'ensemble du coût de l'opération que sur la seule part restant à la charge du propriétaire.
Peu de départements fixent des seuils minima -ils sont par exemple de 2.200 €, soit 80.000 francs pour la Côte d'Or- ; en revanche, l'État exige un montant minimum de travaux de l'ordre de 1.500 euros ou un montant minimum de subvention de l'ordre de la moitié de ce montant.
Enfin, nombreux sont les départements qui fixent des plafonds pour le montant des travaux qui vont, dans les cas les plus fréquents, jusqu'à 150.000 € (un million de francs) 13 ( * ) .
(4) Décentralisation et égalité des monuments devant les aides publiques
Ce rapide état des lieux, qui mériterait sans doute d'être confirmé de source ministérielle, démontre la grande variabilité des interventions publiques. Non seulement les taux globaux d'intervention sont très variables selon les lieux, mais encore les conséquences de la distinction entre monuments classés et monuments inscrits sont très différentes selon les départements.
La Demeure historique s'interroge sur ce qu'elle appelle « l'égalité des chances des monuments historiques privés en matière de cofinancement public ».
La décentralisation est perçue comme un enjeu important « car elle pourra renforcer des contrastes existants ou, au contraire, les rééquilibrer »par l'association, qui conclut à la nécessité de l'intervention de l'État : « de ce point de vue là, le rôle régulateur de l'État demeure important... ».
Votre rapporteur spécial estime, en effet, la question importante, mais il s'interroge sur la compatibilité entre la volonté de laisser une plus grande autonomie aux collectivités locales, et le maintien d'une stricte égalité face aux aides publiques.
Dans une logique de décentralisation, certaines collectivités pourront faire des efforts variables dans tel ou tel domaine, et il est donc évident que tous les citoyens ne seront pas sur le même pied du point de vue de ce qu'ils peuvent attendre de la puissance publique.
A cet égard, le rôle de l'État central est précisément, non pas tant de compenser les inégalités qui pourraient résulter des différents engagements des collectivités territoriales, que de s'assurer que la protection nécessaire et suffisante des monuments est bien mise en place sur l'ensemble du territoire.
b) Vers un nouveau partage des compétences entre l'État et les collectivités locales
Le secteur culturel se prête mal au découpage et à la répartition des compétences, « du fait de l'articulation nécessaire des différentes fonctions qui le régissent et du décloisonnement des domaines artistique et culturel » , comme l'a souligné le rapport de M. René Rizzardo sur la décentralisation culturelle de 1990.
Mais cela tient, aussi, aux réticences du ministère de la culture à transférer aux collectivités territoriales des compétences qu'il s'estimait seul capable d'exercer. Les termes de la loi du 7 janvier 1983, repris à l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, ont consacré ce non-partage des compétences culturelles en disposant que les communes, les départements et les régions concourent avec l'État, entre autres missions, au développement culturel.
Nombreux sont ceux qui sont en train de réfléchir à une nouvelle répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. A cet égard, deux approches sont concevables, une approche analytique détaillant, compétence, par compétence ce qui peut-être transféré et une approche plus globale, par bloc de compétences . Cette dernière est fondamentalement politique, et sur le contenu de ces compétences il n'y a guère de consensus et au contraire, beaucoup d'hésitations, alimentées par les expériences en cours.
Le partenariat culturel entre l'État et les collectivités territoriales connaît un début d'organisation dans le cadre de la politique contractuelle -à travers la mise au point du volet culturel des contrats de plan État-région ou l'expérience nouvelle des protocoles de décentralisation culturelle- et de l'élaboration du schéma collectif des services culturels.
En tout état de cause, il est vrai que l'on peut se poser certaines questions préalables que n'ont pas manqué d'évoquer nombre de fonctionnaires des conservations régionales, lorsqu'ils s'inquiètent de ces projets de décentralisation.
Est-il d'abord opportun de conduire une réflexion alors même que l'organisation de l'administration territoriale est susceptible d'évoluer ?
Existe-t-il une véritable demande de centralisation émanant de collectivités qui ont pu faire l'expérience ce que l'État leur transférait les compétences sans leur donner les moyens financiers de les exercer ?
(1) Un préalable : faire de la maîtrise d'ouvrage « État » l'exception et non la règle
Tout au long de l'enquête, on s'est trouvé face à un paradoxe : l'intérêt des collectivités locales pour le patrimoine , soucieuses d'animation sociale et touristique, est contredit par leur peu d'enthousiasme à assumer des responsabilités opérationnelles en matière de restauration .
Il est en tout état de cause important d'inciter les collectivités territoriales à assumer, chaque fois qu'elles sont propriétaires du monument, leur responsabilité de maître d'ouvrage .
Peut-être faut-il tout simplement donner de vraies responsabilités aux collectivités locales. Ce qui est sûr, c'est que la situation de surcharge des services des CRMH résulte, pour une large part, du fait qu'elles sont amenées à exercer la maîtrise d'ouvrage pour des monuments classés n'appartenant pas État , prestation actuellement gratuite , qui pourrait, si les habitudes n'étaient pas substantiellement infléchies, être à terme directement ou indirectement facturée .
(2) Les compétences régaliennes combinaison d'un noyau dur et de prérogatives diffuses
La plupart des professionnels de la filière du patrimoine souhaitent que le classement reste de la compétence de l'État.
Telle est la conclusion évidente qui ressort de l'examen des différents documents de travail exprimant les réflexions concertées de tout ou partie des milieux professionnels.
Pour certains d'entre eux, il faut envisager une certaine restructuration du parc d'immeubles protégés :
• Dans une hypothèse minimale, la décision d'inscription reste la compétence de l'État, le changement consistant simplement à offrir aux départements une possibilité d'initiative et d'instruction des mesures de protection, ainsi que la gestion des monuments protégés ;
• Dans d'autres schémas, la décision d'inscription à l'inventaire supplémentaire est décentralisée au niveau de la région pour les immeubles et des départements pour des objets, étant entendu que la définition de l'étendue spatiale de la protection et des abords peuvent être selon les cas relever, ou non, de l'État.
Dans une perspective plus analytique, la compagnie des architectes en chef, témoigne clairement de cette idée que les compétences forment un continuum difficile à scinder en sphères relevant de deux autorités différentes.
Ainsi, lorsqu'il évoque les possibles transferts de compétences, M. François Botton, le président de la compagnie, a tendance à raisonner par métier.
Feraient ainsi partie, de son point de vue, des « métiers de l'État » :
• l'expertise initiale, et notamment la conduite des études ;
• les décisions « opposables », et notamment les travaux d'office ;
• la gestion des immeubles appartenant à l'État ainsi que des monuments d'intérêt national majeur ;
• la péréquation entre les régions ;
• les questions de méthode pour assurer la cohérence des descriptions d'inventaire et de l'état sanitaire ;
• le contrôle de la qualification des opérateurs qu'ils s'agissent des maîtres d'oeuvre ou des entreprises ;
• enfin, le pilotage des opérations de référence ou destinées à repérer des champs nouveaux du patrimoine.
En revanche, relèveraient de la compétence des collectivités territoriales les activités suivantes :
• la surveillance de l'état sanitaire ;
• la couverture du terrain pour la définition des politiques de restauration et de programmation ;
• l'instruction des dossiers de protection ;
• la maîtrise d'ouvrage des opérations sur les édifices publics n'appartenant pas à l'État et ne constituant pas un monument d'intérêt national majeur ;
• la programmation et le financement des opérations de mise en valeur ;
• les actions tendant à la diffusion de l'information et à la communication à destination des publics.
Les ACMH soulignent l'intérêt qu'il y a à laisser le plus possible la maîtrise d'ouvrage aux propriétaires privés, sauf en ce qui concerne les études qui selon eux doivent continuer à relever de l'État , « en raison de leur caractère stratégique et de la nécessité de les abstraire d'un contexte de pure opportunité ».
Ils indiquent que ce rééquilibrage en faveur des propriétaires privés aurait un effet bénéfique en parvenant à maintenir hors du champ des marchés publics une certaine masse de travaux des monuments historiques, ce qui permettrait de conserver un vivier d'artisans spécialisés conservateurs d'un certain nombre de savoir-faire locaux dont la faiblesse administrative leur interdit de participer aux marchés publics.
(3) Les tentatives expérimentales pour définir des blocs et des niveaux de compétences
Des expériences ont d'abord été lancées au niveau réglementaire ; elles se trouvent relancées, dans des conditions non exemptes d'ambiguïtés, par l'adoption de l'article 111 de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité
Avant d'examiner le contenu de ces transferts de compétences, il faut évoquer la question essentielle du niveau auxquelles elles pourraient être exercées : région, département, structures intercommunales ad hoc. Tel est bien un des objets des expériences en cours qui ont pour but à la fois de déterminer la nature des compétences transférables mais aussi le niveau pertinent.
Le 29 mars 2002, ont été remis à Mme Catherine Tasca et à M. Michel Duffour, alors respectivement ministre de la culture et de la communication et secrétaire d'État au patrimoine et à la décentralisation culturelle, le rapport d'étape du groupe national de suivi et d'évaluation des protocoles de décentralisation culturelle , présidé par M. René Rizzardo. Ce rapport d'étape rédigé par M. Jean-Marie Pontier, a fait un premier point des expériences en cours.
Il s'agit d'une initiative novatrice dans la mesure où l'expérimentation n'a été que rarement pratiquée, l'exemple le plus récent étant, en 1997, le conventionnement ferroviaire.
Les protocoles, qui sont présentés comme « une mise en débat des rôles respectifs des collectivités publiques » , doivent ouvrir « le champ de nouvelles articulations possibles entre les interventions des personnes publiques ». En fait, au-delà d'un vocabulaire incantatoire, il y a la volonté de dire « qui fait quoi » ou plutôt « qui peut faire quoi et à quel niveau » dans un champ culturel où les rôles sont actuellement, sinon mal définis, du moins imbriqués de façon très étroite.
Le rapport de M. Jean-Marie Pontier rappelle que l'expérimentation a pour objet de donner des indications sur le contenu et le niveau des transferts de compétences de l'État vers les collectivités locales. Il souligne, à cet égard, que le Parlement a accéléré le mouvement en formalisant l'expérimentation en cours. Il note que le champ couvert par les protocoles est plus large que celui de l'article 111 de la loi du 27 février 2002. « L'expérimentation prévue par la loi pourra donc, selon lui, se rajouter à l'expérimentation des protocoles, ou se conjuguer avec elle, mais non la suppléer ». Il précise que « les protocoles signés en 2001 ne sont pas concernés par la nouvelle loi, sauf à inclure par des avenants au protocole les possibilités nouvelles ouvertes par la loi » .
Votre rapporteur spécial a eu connaissance de la circulaire du 20 février 2002 à la signature des directeurs de cabinet des deux membres du gouvernement sus-mentionnés. Cette note précise la façon dont devront être traités par l'administration les demandes d'expériences qui pourraient être faites en application de l'article 111.
Les projets de convention rédigés au niveau local, feront l'objet d'une validation par un comité de pilotage ministériel présidé par la directrice de l'architecture et du patrimoine et comprenant des représentants de la délégation au développement et à l'action territoriale et de la direction de l'administration générale, ainsi que des services déconcentrés du ministère de la culture. Ce comité de pilotage bénéficiera de l'appui du groupe national de suivi et d'évaluation.
|
Les protocoles de décentralisation Aux protocoles expérimentaux lancés dans un cadre administratif, à la suite notamment d'une déclaration à l'Assemblée nationale le 17 janvier 2001 de M. Lionel Jospin, s'ajoutent désormais les expériences découlant de l'article 111 de la loi du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité. Les sept premiers protocoles signés en 2001 ne portent pas que sur le patrimoine mais concernent également les enseignements artistiques et les arts plastiques. Ils ont été signés pour une durée de trois ans. Ils ont pour objectif : 1. de clarifier les rôles et d'identifier les nouvelles compétences culturelles pour les collectivités territoriales ; 2. de développer et d'améliorer le service public de la culture pour le patrimoine et les enseignements artistiques ; 3. de dégager les dispositions susceptibles d'inspirer les prochaines étapes de la décentralisation. On note que les partenaires de l'État peuvent être aussi bien les départements que les régions, étant rappelé que les compétences culturelles intercommunales sont du ressort de l'application d'autres textes législatifs et des dispositifs contractuels existants. Sur le plan des méthodes, les protocoles s'appuient sur un document cadre, d'orientation ainsi que sur un document de référence. Ce dernier document est éventuellement assorti d'un ou plusieurs contrats particuliers. Au-delà des moyens budgétaires déjà mobilisés, les parties prenantes, État et collectivités, apportent une contribution supplémentaire. Les expériences font l'objet d'une évaluation par un groupe national de suivi et d'évaluation, présidé par M. René Rizzardo, directeur de l'Observatoire des politiques culturelles installé à Grenoble. Les protocoles en cours en 2001 étaient les suivants : - numérisation des fonds patrimoniaux dans le cadre d'un protocole signé avec les conseils généraux et le conseil régional de la région Aquitaine ; - service patrimonial au sein de la collectivité dans le cadre d'un protocole expérimentation du transfert de la gestion des édifices et objets inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques dans le cadre d'un protocole signé avec le département de l'Isère ; - réalisation de l'inventaire dans le cadre d'un partenariat avec le conseil régional de Lorraine, ainsi que les conseils généraux de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges ; - mise en oeuvre du nouveau partage des tâches comportant, notamment, la structuration d'un véritable signé avec le département de la Lozère ; - développement des enseignements artistiques dans le cadre d'un protocole signé avec la région Nord-Pas-de-Calais ; - expérimentation d'une prise de responsabilité de la collectivité en matière de restauration et de mise en valeur du patrimoine inscrit dans le cadre d'un protocole passé avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. |
La note apporte « un certain nombre de précisions techniques », qui apparaissent comme tendant à restreindre le champ des initiatives. C'est ainsi qu'il est précisé tout d'abord que les édifices inscrits ou proposés à l'inscription appartenant à l'État, sont exclus de l'expérimentation . En outre, les conventions devront prévoir que l'État reste chargé de veiller à ce besoin de cohérence nationale, que ce soit au niveau de la doctrine ou des méthodes ou dans l'application, puisqu'un pouvoir de substitution de l'État doit être prévu en cas de défaillance grave.
Par ailleurs, il est demandé au rédacteur de conventions de veiller « à ce qui figurent des clauses adaptées préservant la plus-value scientifique qu'apportent les intervenants dans les procédures actuelles, notamment les architectes en chef des monuments historiques et l'inspection des monuments historiques ».
Enfin, il est précisé que les personnels exerceront leurs attributions dans les territoires d'expérimentation dans la limite de leurs compétences expérimentalement transférées, sans mise à disposition statutaire des personnels , sur la base d'un engagement de l'État de dégager le temps nécessaire.
Le jeu est un peu plus ouvert concernant le niveau de collectivité territoriale à retenir. En matière de monuments historiques, c'est à priori la région pour la protection et, pour les travaux, la région ou le département.
En matière de protection, il est indiqué que l'État devra conserver ses capacités d'initiative, et donner des instructions précise sur la procédure à suivre.
La procédure expérimentale d'instruction des demandes serait la suivante : l'instruction relèverait des cellules des DRAC, s'il s'agit d'édifices appartenant à l'État, mais non pour les autres monuments, pour lesquels la collectivité territoriale pourrait recourir à d'autres chargés d'études à condition qu'ils respectent la méthodologie des DRAC.
La procédure en commission régionale du patrimoine et des sites doit être adaptée en prévoyant, notamment, la co-présidence du préfet et du président du conseil régional , tant pour la commission elle-même que pour la délégation permanente.
Selon la circulaire, c'est le président du conseil régional qui signe la décision de refus de protection, ainsi que les arrêtés d'inscription définitive ou préalable à un classement ; en revanche, les décisions de classement continueront de relever de la compétence ministérielle sur proposition du préfet, ainsi que les instances de classement.
|
DÉCENTRALISATION : L'EXPÉRIENCE CORSE Lors d'un colloque qui s'est tenu le 17 septembre 2002 au Palais du Luxembourg, M. Jacques Moulin, architecte en chef des Monuments historiques, compétent pour la région corse, a fait le bilan du transfert à cette collectivité de la compétence en matière de patrimoine en application de la loi dite Joxe de 1990. M. Jacques Moulin a souligné que la collectivité territoriale de Corse a constitué un service de qualité et mis en place des financements importants. Il a rappelé qu'après avoir tenté de reproduire le fonctionnement de la DRAC pour s'efforcer d'assurer à la fois la maîtrise d'ouvrage et de montage financier des opérations, la Corse a renoncé à ce système notamment pour éviter de se trouver dans la position critiquable de pouvoir exercer une tutelle sur une autre collectivité territoriale. La Corse se contente de financer les études documentaires et de financer les travaux sur des bâtiments et objets en laissant la maîtrise d'ouvrage aux propriétaires. M. Moulin a mis l'accent sur l'intérêt porté par les communes à leurs propriétaires pour des raisons identitaires et signalé les attentes des intéressés : un interlocuteur unique responsable de l'entretien comme des restaurations et capable de vérifier ses propres travaux. L'architecte en chef des Monuments historiques de Corse a fait état de l'effacement progressif de la DRAC. Il a indiqué à cet égard qu'un certain nombre de chantiers, comme celui de la cathédrale d'Ajaccio ou du site d'Aléria, n'avaient guère connu de progrès ces dernières années. Cette situation trouve son origine dans ce que votre rapporteur spécial a perçu comme une perte de légitimité puisque la DRAC n'est plus en mesure d'approuver ou de désapprouver sans pouvoir prescrire quoi que ce soit au stade des projets. Les architectes des bâtiments de France de leur côté ont cessé toute intervention d'entretien sur les monuments historiques n'appartenant pas à l'État et ils se contentent désormais sur la réglementation des abords et le conseil architectural. L'architecte en chef des monuments historiques a perdu, faute de financement d'État, son monopole, et n'est plus qu'un architecte spécialisé dans la réfection des bâtiments anciens soumis à la concurrence. La nouvelle loi de décentralisation accentue les effets de la loi de 1990 en confiant à la collectivité territoriale de Corse la propriété des principaux édifices historiques appartenant à l'État. Ce changement obligera cette collectivité à créer un service de maîtrise d'ouvrage. |
En ce qui concerne la procédure de gestion des travaux sur les édifices inscrits, les déclarations préalables, qui resteront adressées aux services de l'État, seront simplement transmises au président de l'autorité d'expérimentation.
Trois autres protocoles du même type doivent être signés en 2002 sur des thèmes patrimoniaux :
- un avec le département de la Creuse, dans le cadre d'une collaboration avec la Région Limousin,
- deux avec les régions Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées.
Ces projets ont fait l'objet d'un travail préparatoire entre services déconcentrés de l'État et collectivités territoriales, mais aucun protocole n'a encore été signé.
Par ailleurs la Région Midi-Pyrénées et la région Lorraine ont été choisies par le ministre de la culture et de la communication comme les deux régions où il souhaite pousser et élargir l'expérimentation en matière de décentralisation culturelle. Le protocole mettant en place l'expérimentation avec la région Midi Pyrénées devrait donc être prochainement conclu ; le protocole signé par la région Lorraine avec l'État à la fin de 2001 devrait être renforcé et son champ d'expérimentation élargi.
Quant aux conventions fondées sur l'article 111 de la loi « Démocratie de proximité », aucune n'avait été mise en place à la fin septembre 2002 . Les demandes émanant de collectivités territoriales en vue de bénéficier de la mise en oeuvre de cet article n'ont d'ailleurs pas été très nombreuses à ce jour. Citons, sans que cette liste soit exhaustive, que :
- le président du conseil général du Loiret a demandé à être informé des modalités et conditions de cette expérimentation mais n'a pas confirmé à ce jour sa candidature ;
- le président du conseil régional de région Bretagne a manifesté son intérêt et demandé des renseignements, puis a retiré la candidature de sa région ;
- le département du Nord a fait savoir qu'il souhaitait engager les démarches pour que son département bénéficie de cette expérimentation ;
- la même demande a été exprimée par le président du conseil du Bas-Rhin, en association avec le président du conseil régional d'Alsace.
En revanche, le département de l'Isère a fait savoir qu'il souhaitait s'en tenir au protocole de décentralisation culturelle signé en 2001 et qu'il ne demandait pas d'élargir celui-ci aux dispositions de l'article 111.
(4) Régions ou départements ?
En conclusion de cet état des lieux, le rapporteur spécial a tendance à penser que, même s'il faut attendre de pouvoir tirer les conclusions des expériences en cours, un certain nombre de principe semblent s'imposer :
• la responsabilité des mesures de protection relève a priori plus naturellement du niveau régional , où avec les CRMH et les CRPS a déjà été acquise une expérience en la matière et où les services des collectivités se trouveraient naturellement en correspondance avec l'administration d'État, chargée de veiller au contrôle de légalité ;
• en revanche, toutes les questions comme celles de l'entretien et des travaux ou comme de l'inventaire, ont besoin d'être traitées à un niveau de terrain, c'est-à-dire au niveau du département, même si pour les grands chantiers de restauration des monuments, la maîtrise d'ouvrage déléguée ou la conduite d'opération doit être traitée de façon préférentielle au niveau régional .
Certes, on peut faire valoir qu'il s'agit, avec la protection, de prérogatives régaliennes que l'État ne peut pas abandonner aux autorités locales et, même, que beaucoup d'entre elles ne sont même pas demandeuses ; mais, globalement il semble que l'on a tout à gagner à associer les collectivités territoriales à la protection et à la mise en valeur de leur patrimoine : il faut déclencher un processus d'appropriation collective du patrimoine , qui fera perdre à la protection son caractère largement coercitif. Le risque de dérapage apparaît d'autant plus faible que l'État conserverait intégralement son pouvoir de contrôle.
Votre rapporteur spécial exprime ici des réflexions sur ce que pourrait être un partage des tâches et des responsabilités entre les collectivités territoriales.
Si la définition des règles du jeu et des grandes orientations relève naturellement de l'État, la mise en oeuvre de la politique culturelle peut incomber aux collectivités territoriales, sous réserve de la gestion de certains équipements ou opérations d'intérêt manifestement national.
S'agissant de la répartition des rôles au niveau local, votre rapporteur spécial a tendance à penser que, si l'échelon du département est celui de la proximité , l'échelon régional est le niveau où peut se faire jour la nécessaire cohérence de la politique culturelle .
Au niveau départemental, peut-être réalisé tout ce qui demande une présence constante sur le terrain : la gestion des autorisations, notamment en matière d'abords, la conduite de l'Inventaire ainsi que la surveillance et l'entretien du parc de monuments.
Mais le niveau régional apparaît, tout bien réfléchi, à votre rapporteur spécial, comme l'échelon de droit commun de la politique culturelle . D'abord, parce qu'il est actuellement le niveau auquel l'État intervient et a accumulé une expérience de l'action déconcentrée.
C'est là que se trouvent les services de la conservation régionale et que fonctionne la Commission régionale du patrimoine et des sites. Ensuite, parce qu'elle est le siège de l'administration des affaires culturelles d'État, la région est le bon niveau pour assurer la cohérence dans l'action ainsi qu'une certaine objectivité dans les aides.
Par sa dimension, et du fait qu'elle agira nécessairement en liaison avec des départements de tempérament et de sensibilité différents, la région est à même de garantir un traitement équitable des demandes.
Faire de la région l'échelon de droit commun de l'action culturelle en matière de patrimoine monumental ne signifie pas un dessaisissement du département qui devrait être en mesure de bénéficier de subdélégations de pouvoirs lui permettant d'assumer pleinement leurs responsabilités.
In fine , le cofinancement doit être maintenu, mais dans le cadre d'un véritable partenariat. A cet égard, il convient d'inscrire l'organisation à mettre en place dans la perspective de l'initiative prise par le Sénat dans le cadre de la loi d'orientation du 4 février 1995 tendant à créer la notion de chef de file.
L'article 65 de cette loi a en effet prévu qu'une loi de clarification des compétences entre l'État et les collectivités locales doit définir « les conditions dans lesquelles une collectivité pourra assumer le rôle de chef de file pour l'exercice d'une compétence ou d'un groupe de compétences relevant de plusieurs collectivités territoriales ».
En dépit de la censure par le conseil constitutionnel du II de cet article -au motif qu'il n'est pas possible de renvoyer à une convention le soin de désigner la collectivité chef de file susceptible d'exercer des compétences conférées aux autres collectivités par la loi -, il est question de relancer cette idée à l'occasion de la relance institutionnelle de la décentralisation. L'on peut interpréter la décision du conseil constitutionnel, non comme condamnant la notion, mais simplement comme censurant le fait de n'avoir pas défini les pouvoirs et les responsabilités afférents à cette fonction.
Comme cela avait été envisagé à l'occasion de l'examen de la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, -mais non retenu dans le texte définitif-, la désignation d'une collectivité chef de file pouvait s'accompagner de la définition d'un cadre juridique de nature conventionnelle précisant les obligations des uns et des autres.
On note que quatre protocoles sur sept utilisent la notion de chef de file, selon des modalités et avec des portées variables, explicité ainsi dans le protocole signé par la région Lorraine comme étant une « délégation consentie de responsabilités »
2. La globalisation des moyens, alternative à la répartition des compétences ?
L'imbrication des compétences dans le domaine du patrimoine monumental que l'on vient de souligner, a conduit à chercher des formules originales de mise en commun des moyens.
Sur le plan financier, il faut également s'intéresser aux perspectives de simplification des circuits de financement, à côté de transferts classiques de dotations globales.
a) Les réflexions autour de nouveaux modes de coopération
Un séminaire a eu lieu le 31 mai 2002 à Maisons-Laffitte dans le cadre du plan stratégique de la direction du Patrimoine et de l'Architecture en vue d'atteindre un des objectifs de ce plan consistant à « refondre, simplifier et développer des instruments de protection, de conservation et de restauration des monuments historiques et les outils de qualité architecturale, urbaine et paysagère dans les espaces protégés en redéfinissant le rôle de l'État et des autres collectivités publiques ».
Au cours de ce séminaire, qui associait l'encadrement de la direction, des représentants des services déconcentrés, ainsi que des représentants des ACMH, un certain nombre d'idées ont été lancées sur un nouveau partage des tâches, même s'il faut souligner qu'aucun consensus ne s'est dégagé en faveurs des différents scénarios évoqués.
Ces idées, qui, en leur qualité de réflexions exploratoires internes à la direction, n'ont pas à être reprises de façon systématique, ont paru toutefois ouvrir des voies intéressantes, qu'il fallait méditer dans la mesure où, pour surmonter les difficultés à définir pour les transférer des blocs de compétences, il a été envisagé d'utiliser un nouvel organe associant collectivités et État.
(1) Un nouvel instrument séduisant : l'établissement public de coopération culturelle
Jusqu'à présent, il manquait un outil de gestion des services culturels, qui permette à la fois d'institutionnaliser la coopération entre l'État et les collectivités territoriales et de doter d'un statut opérationnel les grandes institutions culturelles d'intérêt à la fois local et national.
C'est cette lacune qu'entendait combler, à la suite notamment du rapport de M. Jacques Rigaud, la proposition de créer un «établissement public culturel à vocation mixte», ou, selon la dénomination proposée par M. Michel Duffour, un «établissement public de coopération culturelle».
Le nouvel article L. 1431-1.- du code des collectivités territoriales, tel qu'il résulte d'une proposition de loi déposée au Sénat par M. Ivan Renar dispose que ces dernières et leurs groupements peuvent constituer avec l'État un établissement public de coopération culturelle chargé de la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture.
Il faut souligner que sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même. Effectivement, la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé précise que ne pourront être érigés en EPCC les services, qui par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par les collectivités territoriales elles-mêmes. Cette restriction, qui d'ailleurs serait appliquée par le juge administratif même si elle ne figurait pas dans le texte, vise les services culturels, et en particulier les archives, qui ont fait l'objet, dans le cadre des lois de décentralisation, de transferts de compétences obligatoires aux différents échelons de l'administration territoriale. Ces services ne peuvent dès lors être gérés par un établissement public associant l'État et les collectivités locales, ce qui reviendrait à « confondre « les niveaux de compétence que le législateur a entendu distinguer.
On note, également, que les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.
Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre, en application de l'article L. 1431-8 du même code :
1. Les subventions et autres concours financiers de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5 du même code, et de toute personne publique ;
2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
3. Les produits de son activité commerciale ;
4. La rémunération des services rendus ;
5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;
6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;
7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;
8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
L'outil est intéressant mais l'on voit qu'il est, dans l'esprit des ses auteurs, plutôt fait pour gérer des équipements en vue d'éviter le recours au cadre associatif qu'exercer un service public.
(2) L'idée d'une mutualisation des moyens dans une agence départementale généraliste
Toutefois, un des scénarios évoqués au cours du séminaire de Maisons-Laffitte, a consisté dans la mise en place d'une structure ad hoc au niveau départemental , mutualisant entre l'État et les collectivités les compétences actuellement dévolues à l'État central.
L'idée de créer des « agences du patrimoine et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère » (APQAUP) paraît prometteuse à tous ceux qui veulent éviter de scinder des procédures caractérisées par une continuité des différentes procédures et niveau de protection.
Dans une première hypothèse, il a été envisagé par certains participants au séminaire de confier à ces agences les missions suivantes :
• la conduite des opérations d'inventaire,
• l'initiative et l'instruction de certaines mesures de protection,
• l'étude de définition des espaces protégés,
• le conseil sur la qualité architecturale,
• les études sur les sites et patrimoine naturel,
• la gestion des abords des monuments historiques, y compris l'avis conforme des ABF qui exerceraient leurs pouvoirs propres au sein des agences,
• la maîtrise d'ouvrage délégués,
• les travaux d'entretien des monuments historiques,
• la conservation des objets et antiquités,
• la mise en valeur de sites patrimoniaux.
Les agences pourraient prendre la forme juridique des nouveaux établissements publics de coopération culturelle et suivre le régime des établissements publics administratifs.
Leurs seraient ainsi affectés les moyens humains existant dans les services de l'État, c'est à dire une partie des effectifs des services régionaux de l'inventaire et des conservations régionales des monuments historiques, quelques agents des directions régionales de l'environnement, ainsi que les agents des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.
S'y ajouteraient également les services existant au sein des conseils généraux, ainsi que ceux travaillant dans les conservations départementales des antiquités et objets d'art et des CAUE dont on connaît la situation précaire sur le plan financier et juridique.
Il a même été envisagé par certains participants d'inclure dans ce processus de mutualisation les agences d'urbanisme, même si celles-ci ont un champ de compétence de niveau infra-départemental.
La formule est séduisante. La mutualisation éviterait l'émiettement des missions et des moyens. D'un côté, les collectivités verraient leur poids devenir prépondérant, puisque l'État est minoritaire dans l'établissement public ; de l'autre, l'État ne serait pas dépossédé de ses prérogatives régaliennes qu'il tient de la loi, car ses agents exerceront leur activité au sein de l'établissement, mais en qualité d'agent de l'État.
Pour votre rapporteur spécial, la formule se heurte à une série d'obstacles juridiques et pratiques.
Le déplacement et la restructuration des services vont s'accompagner d'importants mouvements de personnels, tandis que les services absorbés, SDAP, ou CAUE, tout comme les ministères concernés peuvent exprimer des réserves. Il reste, en outre, à définir, ce qui incomberait dans cette optique à l'échelon national.
Votre rapporteur spécial ajoute que la formule de l'établissement public coopération culturelle n'est peut-être pas la bonne formule . Elle a été mise au point pour la gestion d'équipements culturels associant l'État et les collectivités territoriales et non pour gérer un service public comme cela est expressément précisé dans le texte de la loi, qui dispose, comme on l'a vu, que sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.
Une variante de ce schéma consisterait à laisser au niveau régional la conduite de l'inventaire, la protection des monuments inscrits, ainsi que la programmation des travaux sur les monuments n'appartenant pas à l'État, au moyen de la mise à disposition des personnels compétents de la conservation régionale des monuments historiques.
Ne resterait au niveau départemental dans le cadre d'une agence de moyens, que la décentralisation de la protection du patrimoine mobilier, la conduite de l'inventaire général avec l'assistance méthodologique de la conservation régionale, les propositions d'inscription à l'inventaire supplémentaire assorties éventuellement de l'instruction des dossiers, ainsi que toutes les compétences mentionnées dans la première formule.
(3) La piste des agences de maîtrise d'ouvrage régionales
Dans la ligne du point précédent, il faudrait étudier l'intérêt et la faisabilité d'organismes spécialisés dans la maîtrise d'ouvrage au niveau régional , de nature à exercer la conduite des opérations importantes pour le compte des collectivités publiques propriétaires.
Cela concernerait d'abord les communes, départements, régions, pour les éléments du patrimoine national qui leur serait confiés, et les opérations de restauration.
La formule des organismes d'assistance à maîtrise d'ouvrage -travaillant, soit par voie de convention comme maître d'ouvrage délégué, soit dans le cadre d'une prestation de conduite de travaux, les collectivités restant, alors, personne responsable du marché, PRM- serait à la fois un moyen de pallier les hésitations des collectivités à se lancer dans la maîtrise d'ouvrage et de permettre pour les opérations comportant des restructurations lourdes le recours à des professionnels de la programmation.
Autant la restauration stricto sensu ne nécessite que des compétences d'historien d'art et de gestionnaire notamment en matière de procédures financières, autant la mise en valeur de bâtiment en vue de la création de fonctions nouvelles, suppose un compétence de programmiste, c'est-à-dire, de spécialiste dans la mise au point de d'une « doctrine d'emploi » du monument.
La formule pourrait même s'appliquer à l'État, si l'on estimait que les CRMH, ne sont pas suffisamment armées pour réaliser des opérations complexes, notamment lorsque celles-ci portent sur des équipements culturels, ou s'accompagnent de la restructuration lourde d'un édifice en vue de son affectation à un équipement ou à un service public important.
Même dans cette hypothèse, il faut préciser que la CRMH garderait la maîtrise de la programmation financière et que les délais de réalisation devraient être arrêtés avec elle.
Ces organismes pourraient, par exemple, prendre la forme de syndicats mixtes auxquels adhéreraient les régions, départements et communes ou leurs groupements sur le territoire desquels seraient sis des monuments historiques, financés par des contributions de leurs membres, calculées sur des bases stables pour les départements et les régions et sur bases variant avec le potentiel fiscal pour la commune d'implantation du monument historique.
La raison majeure qui justifie la création, à un niveau régional voire interrégional, d'une telle structure est avant tout d'ordre technique : c'est la complexité croissante de la fonction de maître d'ouvrage tant en ce qui concerne la nature des opérations que la procédure financière par suite des contraintes liées aux marchés publics.
En fait seule une étude précise réalisée à l'issue d'un audit du fonctionnement des cellules « marchés-travaux » permettrait de déterminer si le coût supplémentaire qu'induirait une telle structure, même si elle était constituée par voie de redéploiements de personnel - en h'hésitant pas à prélever des fonctionnaires de rang en administration centrale-, est inférieur aux gains attendus : rapidité d'exécution, fiabilité des montages, renforcement de la position de négociation du maître d'ouvrage délégué par rapport aux maîtres d'oeuvre.
Mais, sur un plan plus général, on peut aussi voir des avantages au niveau du circuit de décision. Peut-être une structure de ce type serait-elle de nature à éviter les retards dus aux financements croisés ? Une solution de ce type pourrait effectivement s'accompagner d'une politique de globalisation des financements puisque, pour les départements et les régions, les fonds seraient transférés globalement et non pas opération par opération.
b) La simplification des circuits financiers
On ne pourra jamais simplifier la procédure administrative si l'on ne cherche pas à décroiser les financements.
Certes, il est souvent indispensable d'organiser des financements « croisés » pour réaliser des équipements dont le coût ne pourrait être assumé par une seule collectivité mais ce n'est pas le cas de la plupart des interventions culturelles ; il y a aussi une logique à ce que des participations locales régionales ou départementales, voire communales, viennent s'ajouter à l'effort de l'État qui joue ainsi le rôle de garant de l'intérêt public de l'opération .
Toutefois, la sécurité que donne le système est plus que compensée par les pertes de temps dues aux montages financiers à négocier au cas par cas.
Il y a là un frein à l'action, même si, bien souvent, les CRMH trouvent des astuces pour minimiser les conséquences de cette complexité.
La situation est très différente dans les autres secteurs de la politique culturelle comme le spectacle vivant où la pluralité du financement constitue un espace de liberté, permettant d'éviter le face-à-face entre le commanditaire et le porteur du projet, dans le domaine du patrimoine monumental. C'est ainsi que dans son rapport remis à Philippe Douste-Blazy en octobre 1996 pour la commission d'étude pour la politique culturelle, M. Jacques Rigaud pouvait déclarer : « quelle soit décrite en termes de cofinancement, pluri-financements, financements croisés ou d'enchevêtrement, la situation actuelle qui mêle les subsides des différents niveaux de pouvoirs pour financer les projets et les établissements culturels est plus souvent appréciée que regrettée ».
Certains acteurs du patrimoine monumental estiment qu'il y a là un complexité gérable, il n'en reste pas moins qu'une globalisation reste, selon votre rapporteur spécial, souhaitable.
(1) Prédéfinir le partage des charges entre collectivités territoriales
Le système actuel aboutit à transformer chaque opération de restauration en une fusée à plusieurs étages, chaque étage devant être négocié avec une collectivité différente. De surcroît les fenêtres de tir sont restreintes, puisqu'il s'agit de faire passer les dossiers aux dates des conférences administratives régionales, en ayant obtenu tous les accords des organes délibérants des différentes parties prenantes.
On peut s'en accommoder, utiliser la technique fragile des autorisations de programme provisionnelles ou convaincre le préfet de région de procéder à des CAR écrites, mais nul doute qu'un système forfaitaire et non négocié au coup par coup faciliterait grandement le montage administratif des opérations .
Des précédents dans d'autres domaines montrent que certaines actions peuvent être cofinancées par les différentes collectivités territoriales parties prenantes sur des bases relativement stables, sans exclure des variations importantes en fonction des cas d'espèce.
Ainsi, le financement des établissements publics en charge des services d'incendie et de secours est-il assuré à la fois par le département et les communes sur des bases prédéterminées.
Sans doute serait-ce difficile à négocier, mais il n'est pas interdit d'espérer que les différentes parties prenantes, départements, régions, ou communes, puissent se mettre d'accord a priori sur les modalités de participation des uns et des autres. On peut faire jouer la solidarité locale mais il devrait être envisageable de fixer les contributions à partir de critères objectifs liés au potentiel fiscal des différentes collectivités .
Il est difficile de préciser, à ce stade, sur quelles bases serait effectué le partage des charges. L'exemple des services départementaux d'incendie et de secours témoigne de ce qu'un même cadre législatif peut aboutir à des formules extrêmement variées.
Pour certains professionnels, la programmation pourrait-être décidée dans le cadre d'une instance de concertation, qui pourrait prendre le nom de « conférence régionale du patrimoine », au sein de laquelle se réuniraient périodiquement l'État, les collectivités territoriales et, pourrait-on ajouter, des représentants des propriétaires privés. Il reviendrait à cette instance de statuer sur les ordres de priorité et sur les clés globales de répartition financière ainsi que d'assurer le suivi et l'évaluation du programme.
Une telle formule, outre l'inconvénient de la lourdeur, puisqu'il s'agit de véritables « états généraux », fait néanmoins courir des risques aux collectivités de se voir imposer des charges nouvelles par l'État.
(2) Transférer ou contractualiser les apports de l'État ?
L'État se sert déjà des financements croisés pour accroître son influence. En dépit, d'une participation financière minoritaire, les services centraux peuvent s'octroyer la direction des projets culturels : à l'heure actuelle, les partenariats sont souvent déséquilibrés, impliquant des contributions financières des collectivités locales, tandis que l'État conserve la maîtrise de la politique culturelle .
Un transfert de compétences et de ressources aux collectivités locales permettrait une meilleure lisibilité et une plus grande proximité avec le terrain. Même si ce transfert s'effectue conformément aux lois de décentralisation, cela ne garantit pas aux collectivités, qu'il ne s'accompagnera pas de charges supplémentaires.
On rappelle que le code général des collectivités territoriales détermine les règles applicables en matière de compensation financière des transferts de compétences, et notamment que :
- « tout accroissement net des charges résultant des transferts de compétences (...) est accompagné du transfert concomitant par l'État aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences » (article L. 1614-1) ;
- « ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'État, au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées » (article L. 1614-1) ;
- « toute charge nouvelle incombant aux collectivités du fait de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées, est compensée » (article L. 1614-2).
Maintenant, même organisé conformément aux textes, c'est-à-dire en transférant le montant exact des crédits correspondant aux compétences transférées, le mode de calcul des compensations retenu par les lois de décentralisation repose sur un postulat hypocrite : l'hypothèse selon laquelle, à compter du transfert de compétences, le coût de leur exercice pour les collectivités locales n'augmentera pas plus vite que la dotation globale de fonctionnement.
Pour les gestionnaires locaux, il est surtout important que l'évolution réelle des recettes transférées soit en adéquation avec l'évolution du coût réel des compétences. Or, tel n'est pas le cas des compétences déjà transférées - qui croissent au moins deux fois plus vite que les recettes transférées et il n'est pas de raisons de penser qu'il en serait différemment pour le patrimoine monumental que pour les établissements scolaires qui ont vu les collectivités faire des efforts considérables.
Le risque est bien de voir en cas de transfert, soit des dotations calculées trop justes en regard des besoins, soit que l'État négocie des apports dans un cadre contractuel mais alors soumette les collectivités à sa politique propre dans le cadre d'un « partenariat imposé », comme c'est le cas avec les arts plastiques.
3. Mobiliser toutes les énergies locales au service du patrimoine
Les collectivités sont de plus en plus conscientes de la nécessité de préserver leur écosystème patrimonial.
A court terme et indépendamment des expériences en cours, des champs restent ouverts pour une prise de responsabilité plus franche des collectivités, qu'il s'agisse du patrimoine dit « non protégé » ou de l'inventaire, qui doivent s'appuyer sur des structures de nature à associer toutes les énergies locales, et, notamment, sur la Fondation du patrimoine.
a) Le patrimoine « non protégé », compétence naturelle des collectivités locales
La création d'un troisième niveau de protection est-elle une solution simple pour donner aux collectivités territoriales un supplément de compétences en matière de patrimoine monumental sans rien retirer à l'État central ?
Depuis le rapport de 1994 de M. Jean-Paul Hugot, parlementaire en mission, qui fut à l'origine de la création de la fondation du patrimoine, on a pris conscience de l'importance d'un patrimoine diffus, notamment dans les zones rurales, lavoirs, calvaires, chapelles, etc, qui font le caractère des paysages de la France.
Ce patrimoine, dit initialement patrimoine rural non protégé -PRNP-, ne mérite plus vraiment cette appellation. D'abord, par ce qu'il n'est plus seulement rural ; ensuite, parce que s'il n'est pas soumis aux réglementations de la loi de 1913 en matière de travaux ou d'abords, il bénéficie d'aides financières non négligeables et qu'il est souvent pris en compte dans les documents d'urbanisme.
La responsabilité particulière des collectivités territoriales en la matière est évidente, qu'il s'agisse des régions, des départements, ainsi que des communes dont les pouvoirs devraient être réaffirmés notamment au niveau du permis de construire.
Créer officiellement un troisième niveau de protection, ou plutôt un niveau de base, est une solution qui a le mérite de la simplicité, à cette réserve qu'elle aboutit à rendre plus complexe un édifice réglementaire, qui n'est déjà pas toujours cohérent.
Trois niveaux de protection n'est-ce pas trop ?
On serait tenté de souligner qu'au-delà de l'appellation officielle de patrimoine non protégé, le troisième niveau de protection existe déjà et qu'on peut à la fois l'officialiser et le confier aux collectivités locales .
La consécration fiscale de ce premier niveau, on la trouve dans l'article 156 du code général des impôts qui organise la procédure de l'agrément fiscal, et auquel donne droit sous certaines conditions le label de la Fondation du patrimoine, lui même accordé en liaison, contrairement à l'agrément direct, avec les collectivités locales et non les services de la DRAC.
Substituer des services dépendants des collectivités pour l'agrément de l'article 156 du code général des impôts et systématiser sa prise en compte dans les documents d'urbanisme achèverait le processus.
La solution d'un niveau de protection purement local, aux incidences fiscales près, peut se justifier mais seulement si elle s'accompagne d'une simplification de l'architecture d'ensemble de notre système juridique, telle qu'elle pourrait résulter sinon de l'alignement du moins l'articulation très étroite du régime des monuments inscrits sur celui des classés.
b) Faire de l'Inventaire général une affaire de proximité
L'inventaire général, créé à l'initiative d'André Malraux et porté par André Chastel, a subi les dérives d'une bureaucratisation. Alors qu'à l'origine il était question de s'appuyer sur des relais locaux et, notamment, sur des sociétés savantes, le projet a évolué vers une institutionnalisation croissante et le détournement des objectifs initiaux.
Écrasés par l'énormité de la tâche, la demi-douzaine et parfois moins de fonctionnaires affectés à cette tâche, ont largement renoncé à la couverture géographique, pourtant seule cohérente, pour se tourner vers des inventaires thématiques, plus gratifiants certes, mais qui laissent craindre un processus d'inventaire sans horizon défini.
Les services régionaux de l'Inventaire travaillent désormais en liaison étroite avec les collectivités locales, qu'il s'agisse des conseils régionaux, des conseils généraux, des villes, des pays, des SIVOM, etc. Cette collaboration démontre que la part des collectivités locales dans le financement des opérations d'inventaires est de plus en plus importante .
Il convient de prolonger le mouvement actuel en transférant la responsabilité des opérations d'inventaire au niveau départemental sur le modèle de l'Isère- qui a créé dès 1992 une conservation du patrimoine.
Les services d'État au niveau régional ne conserveraient que la responsabilité de la définition d'un vocabulaire commun.
Nombreux sont ceux qui reconnaissent, à commencer par les intéressés eux-mêmes, que les résultats de l'Inventaire doivent être désormais enregistrés de manière à répondre au maximum aux besoins spécifiques des gestionnaires du patrimoine urbain.
Il y a là un double intérêt dans cette démarche :
• politique : en faisant de la réalisation d'un inventaire sommaire, l'affaire des intéressés eux-mêmes, à commencer par les élus et les habitants du canton concerné, sans oublier les sociétés savantes, on permet aux intéressés de s'approprier leur patrimoine et donc à la fois de mieux en percevoir et l'intérêt et de mieux accepter les contraintes liées à sa conversation ;
• technique : on peut se donner les moyens d'aller vite et donc ne pas arriver « après la bataille », en signalant l'intérêt patrimonial d'immeubles ou d'objets. déjà disparus au moment même de la communication ;
L'idée d'un inventaire léger, rapide, sans cesse réitérée, doit être enfin inscrite dans les faits. Il faut fixer des objectifs précis en matière de couverture du territoire.
Votre rapporteur estime que le transfert des personnels aux départements dans un cadre plus polyvalent, gage de productivité sur le modèle des services patrimoniaux de l'Isère devrait insuffler un dynamisme nouveau à une fonction indispensable mais qui, faute de moyens et d'objectifs, a perdu son impulsion initiale .
Pour ceux des fonctionnaires qui refuserait une telle démarche, il ne resterait plus qu'à les maintenir au niveau régional pour veiller à la transférabilité des résultats entre les départements, voire à les transférer dans le cadre naturel d'une telle démarche, c'est-à-dire au CNRS, où il existe d'autres règles d'appréciation des performances mais aussi d'évaluation des chercheurs que dans l'administration active.
L'inventaire général doit être conduit de façon globale sur la base de programmes chiffrés pour retrouver l'élan initial de la planification à la française.
DÉPENSES RELATIVES AU PATRIMOINE RURAL NON PROTÉGÉ
(Autorisations de programme affectées)
|
CHAPITRE 6620/20 (en euros)) |
2000 |
2001 |
|
ALSACE |
114 992 |
114 127 |
|
AQUITAINE |
331 027 |
143 006 |
|
AUVERGNE |
182 449 |
347 599 |
|
BOURGOGNE |
352 147 |
291 277 |
|
BRETAGNE |
528 913 |
547 908 |
|
CENTRE |
450 129 |
504 748 |
|
CHAMPAGNE ARDENNE |
81 414 |
288 281 |
|
FRANCHE COMTE |
301 396 |
188 504 |
|
ILE DE FRANCE |
175 875 |
103 775 |
|
LANGUEDOC ROUSSILLON |
233 811 |
538 659 |
|
LIMOUSIN |
84 929 |
119 745 |
|
LORRAINE |
306 258 |
67 683 |
|
MIDI PYRENEES |
480 244 |
344 129 |
|
NORD PAS DE CALAIS |
171 273 |
108 056 |
|
BASSE NORMANDIE |
406 269 |
329 099 |
|
HAUTE NORMANDIE |
403 357 |
362 227 |
|
PAYS DE LOIRE |
269 796 |
357 548 |
|
PICARDIE |
253 561 |
145 414 |
|
POITOU CHARENTES |
681 018 |
330 944 |
|
PROV. ALPES COTE D'AZUR |
396 398 |
256 179 |
|
RHÔNE-ALPES |
357 012 |
428 564 |
|
GUADELOUPE |
105 640 |
125 556 |
|
GUYANE |
107 550 |
40 168 |
|
MARTINIQUE |
9 707 |
85 798 |
|
REUNION |
51 074 |
11 202 |
|
NOUVELLE CALEDONIE (1) |
22 867 |
22 867 |
|
TOTAL |
6 859 105 |
6 203 062 |
|
( 1) en l'absence de remontées d'information disponibles pour cette région, le montant indiqué correspond aux AP déléguées et non aux AP effectivement affectées |
||
c) Utiliser la Fondation du patrimoine comme un auxiliaire de terrain
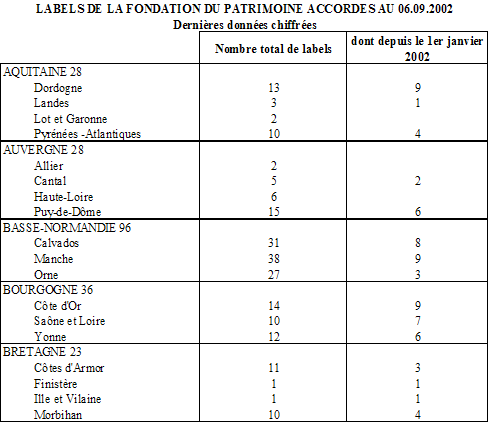
Créée par la loi du 2 juillet 1996, la fondation du patrimoine, organisme privé a but non lucratif, reconnue d'utilité publique par un décret du 18 avril 1997, a pour objet de promouvoir la sauvegarde, la connaissance et la mise en valeur du patrimoine non protégé par l'État.
Identifier des édifices et des sites menacés, participer par un soutien financier à la réalisation de programmes de restauration et contribuer, par l'attribution d'un label comportant des avantages fiscaux, à la sauvegarde du patrimoine menacé, tels sont les objectifs majeurs de la Fondation.
A ces tâches, s'ajoutent des missions plus générales consistant à favoriser le partenariat entre les associations et les pouvoirs publics ainsi que la création d'emplois et la transmission des métiers.
La Fondation du patrimoine a adopté une organisation décentralisée reposant sur un réseau de délégations régionales et départementales. Au sein du conseil d'administration, figurent des représentants d'institutions nationales et locales ainsi qu'un certain nombre de mécènes fondateurs 14 ( * ) .
L'État n'est plus le dépositaire unique de l'action publique. Un État qui entend agir seul se prive de relais qui accroissent l'efficacité de son action.
C'est dans le cadre de la réforme de l'État, qu'il convient de relancer la Fondation du patrimoine, qui par son organisation décentralisée, largement fondée sur le volontariat, constitue l'auxiliaire de proximité de l'action de l'État, de nature à constituer le lieu de rencontre entre tous les partenaires du patrimoine publics et privés.
Les ressources de la Fondation sont constituées par du mécénat en provenance des particuliers et des entreprises. Les dons faits à la Fondation sont déductibles de l'impôt sur le revenu à concurrence de 50 % de leur montant et dans la limite de 10 % du revenu imposable, en application de l'article 200 du Code général des impôts et, pour les entreprises, déductibles du bénéfice imposable des sociétés, dans la limite de 3,5 pour mille du chiffre d'affaires, en application de l'article 238 bis du même code.
La Fondation peut octroyer un label qui est susceptible de permettre l'octroi d'avantages fiscaux pour les propriétaires, lorsque l'opération a reçu l'accord de l'architecte des bâtiments de France.
Les projets, qui portent sur des bâtiments non protégés, doivent répondre à certains critères. Notamment, les travaux doivent présenter certaines caractéristiques de nature patrimoniale ou sociale. En effet, l'objectif de la Fondation n'est pas simplement de préserver un environnement de qualité, il est aussi de réintégrer le patrimoine dans les activités quotidiennes des Français.
Trois types d'immeubles sont concernés : les immeubles non habitables constituant le petit patrimoine de proximité, tels que pigeonniers, lavoirs, fours à pain ; les immeubles habitables caractéristiques de l'habitat rural, ainsi que les immeubles habitables ou non, situés dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
Les travaux doivent concerner les parties visibles de la voie publique, sauf pour les éléments de patrimoine non habitable . Il s'agit essentiellement de travaux concernant les toitures, les façades et les pignons.
La déduction fiscale, dont peut bénéficier le propriétaire, est de :
• 50 % du montant supporté par le propriétaire -après déduction des subventions perçues-, si les subventions recueillies sont inférieures à 20% du montant des travaux ;
• 100 % du montant supporté par le propriétaire -après déduction des subventions perçues-, si les subventions recueillies excèdent 20%.
Le label est accordé par le délégué régional de la Fondation après accord du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
Enfin, la Fondation du patrimoine lance aussi des opérations de mécénat de proximité. Lorsque, s'agissant de projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une commune ou une association, l'opération ne parvient pas à réunir les financements nécessaires, la Fondation se charge de lancer des souscriptions pour trouver des fonds complémentaires moyennant une commission de gestion de 3 %.
Votre rapporteur spécial s'est penché sur les intentions du législateur lorsqu'il a créé la Fondation du Patrimoine. A cette occasion, il a constaté que l'on avait cherché à prendre modèle sur le National Trust britannique et que, loin de se limiter à l'octroi d'un label fiscal, la Fondation avait initialement pour objectif de relayer l'action de ce qui était alors la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.
A la lecture du rapport de M. Jean-Paul Hugot, la Fondation aurait eu initialement pour vocation de jouer le rôle d'interface entre le secteur public et le secteur privé en reprenant notamment des actions pilotes jusqu'alors menées par la Caisse en matière de « routes historiques », de « villes d'art et d'histoire » et de « pays d'art et d'histoire ».
Sans doute le rapport allait-il trop loin, faisant relever de la Fondation une mission de promotion des éditions sur le patrimoine et en lui permettant de prendre en gestion certains monuments appartenant à des collectivités locales pour leur bâtir des projets de monuments.
Faut-il relancer cet aspect des compétences de la Fondation qu'elle n'a pas pu développer faute de moyens et de volonté politique ? La question mérite d'être posée.
Votre rapporteur spécial a considéré que la Fondation devait, en tout état de cause, avoir un rôle pilote dans la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine dit « non protégé ». C'est dans ce but qu'il souhaite lui en donner les moyens en proposant de lui a ffecter une ressource en harmonie avec sa vocation, en l'occurrence, le produit des successions vacantes .
LE PRODUIT DES SUCCESSIONS VACANTES
|
Années |
En francs |
En euros |
|
1990 |
88 460 804 |
(13 485 763) |
|
1991 |
86 717 171 |
(12 762 600) |
|
1992 |
75 622 920 |
(11 528 640) |
|
1993 |
71 068 646 |
(10 834 345) |
|
1994 |
74 048 745 |
(11 288 658) |
|
1995 |
100 368 219 |
15 301 036) |
|
1996 |
90 896 652 |
(13 857 105) |
|
1997 |
91 001 512 |
(13 873 091) |
|
1998 |
104 929 667 |
15 996 425 |
|
1999 |
88 668 159 |
13 517 374 |
|
2000 |
84 984 437 |
12 955 794 |
|
2001 |
62 630 327 |
9 547 932 |
Tout ou partie de ce produit, dont le montant, selon les années, est compris entre 10 et 15 millions d'euros, pourrait venir utilement encourager, en liaison avec les collectivités territoriales, la remise en état du petit patrimoine et favoriser, en liaison cette fois-ci avec les associations, la mise en valeur du patrimoine et des sites.
*
* *
Pour conclure ce rapport, il convient d'ajouter au relativisme, dont votre rapporteur spécial faisait état dans sa présentation, un paradoxe budgétaire .
On ne manquera pas, en effet, de remarquer qu'un certain nombre des propositions contenues dans ce rapport, pourrait se traduire par des dépenses accrues, à court terme, même s'il est possible d'agir par voie de redéploiement de crédits ou de personnels.
Certes, l'augmentation des moyens à consacrer aux opérations d'entretien devrait être aisément dégagée par une diminution des ouvertures de crédits au titre des dépenses d'investissement .
Mais, au niveau de la gestion de ces dépenses, il faut s'attendre à des coûts supplémentaires, soit que l'on opte pour le renforcement des services qui en ont la charge, services départementaux de l'architecture et du patrimoine ou services à créer dans les collectivités territoriales, soit que l'on confie un nombre plus important d'opérations à des architectes agréés qu'il faudra bien rémunérer.
De même, l'augmentation du nombre des architectes en chef des monuments historiques , tout comme celle des architectes habilités à travailler dans le secteur à l'issue d'une procédure d'agrément, pourrait déboucher sur des dépenses et des coûts supplémentaires. A ces facteurs de dépenses supplémentaires, s'ajouterait la nécessaire revalorisation des vacations perçues par ces fonctionnaires en leur qualité de « Conseils du ministère de la culture » et la création d'inspecteurs fonctionnaires .
Une troisième catégorie de mesures, consistant en la création d'agences de maîtrise d'ouvrage est, elle aussi, porteuse de dépenses, si l'on ne parvient pas à constituer ces nouveaux organes par réaffectation de personnels et de moyens.
A ceux qui y verraient une sorte de contradiction interne dans un rapport animé par un souci d'économie, votre rapporteur spécial fera valoir que l'on a sans doute , ces dernières années, trop investi sans avoir les moyens de maîtriser la dépense.
Trop de projets, pas assez de personnels pour les suivre, ont conduit à laisser les maîtres d'oeuvre prendre l'ascendant sur les maîtres d'ouvrage avec, pour conséquence, une dérive des dépenses résultant, non de coûts unitaires trop élevés, mais de projets inadaptés aux moyens disponibles , voire carrément surdimensionnés par rapport aux besoins.
Le même raisonnement vaut pour les perspectives de décentralisation dressées dans ce rapport. Transférer des compétences en matière patrimoniale aux collectivités territoriales devrait avoir également pour conséquence une augmentation des coûts de fonctionnement, ici non au niveau de l'État central mais des administrations publiques dans leur ensemble.
Cela ne suffit-il pour condamner une telle évolution ?
Votre rapporteur spécial ne le pense pas, à la fois parce qu'il y a sans doute-sous réserve des audits souhaités par votre rapporteur spécial- une sous-administration de la dépense d'investissement, et parce que la montée en puissance des collectivités territoriales est de nature à favoriser un dynamisme, gage d'augmentations de productivité.
Derrière la plupart des propositions de ce rapport -qui se présente plus comme une boite à idées que comme un mécano prêt à l'emploi- il y a un fil directeur essentiel : la conviction que s'il doit être mis face à ses responsabilités, le propriétaire doit aussi se voir donner les moyens de les exercer.
* 13 Ain (76.225 euros (500.000 francs) de travaux et 152.449 euros (1 million de francs) pour 3 ans), Allier (91.000 euros (600.000 francs) de travaux), Alpes-de-Haute-Provence (153.000 euros (1 MF de travaux), Charente (153.000 euros (1MF) de travaux), Côte d'Or (91.500 euros (600.000 F) de travaux pour les classés, 45.734 euros (300.000 F) pour les inscrits), Eure-et-Loir (152.400 euros (1 MF) de travaux), Finistère (pour les inscrits : travaux supérieurs à 7.600 euros (50.000 F), taux passe de 20 à 10 %), Indre (22.900 euros (150.000 F) de subvention), Maine-et-Loire (70.000 euros, 400.000 F de travaux), Mayenne (30.500 euros (200.000 F) de travaux pour les inscrits), Saône-et-Loire (45.700 euros, 300.000 F de travaux pour les inscrits), Seine-et-Marne (15.245 euros, 100.000 F de subvention lors d'un financement exclusif du CG), Tarn (38.112 euros, 250.000 F de travaux), Vienne (classés : 23.000/11.500 euros (150.870/75.435 F) de subvention selon le nombre de jours d'ouverture, inscrits : 18.300/9.200 euros (120.000/60350 F) de subvention selon le nombre de jours d'ouverture).
* 14 Axa, Bellon SA (Sodexho Alliance), Caisse nationale de Crédit Agricole, Danone, Devanlay, Fimalac SA, Fédération française du bâtiment, Fondation Électricité de France, Inderco, l'Oréal, Michelin, Shell, Par cet Jardins de France, Videndi.







