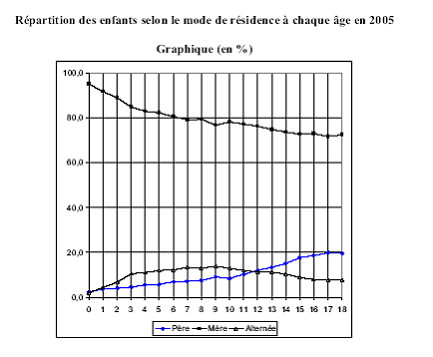Les quatrièmes et cinquièmes rencontres sénatoriales de la justice
Colloques organisés par M. Christian Poncelet, président du Sénat - Palais du Luxembourg - 20 juin 2006 et 5 juillet 2007
-
LES 4èmes RENCONTRES SÉNATORIALES DE LA JUSTICE
-
LES 5èmes RENCONTRES SÉNATORIALES DE LA JUSTICE
-
Intervention de M. Christian Poncelet, Président du Sénat
-
Stages en juridictions - Intervention de Jean-Pierre Michel
-
Indépendance de la justice et obligation de rendre des comptes - M Jean Arthuis, Président de la Commission des finances
-
L'Europe : un espace de liberté, de sécurité et de justice - M. Hubert Haenel, Président de la Délégation du Sénat pour l'Union européenne
-
La Commission des lois : évaluation et prospective - M. Jean-Jacques Hyest, Président de la Commission des lois
-
Le recrutement et la formation des magistrats -
M. Charles Gautier, Sénateur de la Loire-Atlantique
-
La résidence alternée - Jean-René Lecerf, Sénateur du Nord
-
Intervention de M. Christian Poncelet, Président du Sénat
-
ANNEXES
LES 4èmes RENCONTRES SÉNATORIALES DE LA JUSTICE
MARDI 20 JUIN 2006
Palais du Luxembourg
Compte rendu des débats
La séance est ouverte à 9 h 50.
M. Sylvain ATTAL .- Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces 4 ème Rencontres sénatoriales de la justice, qui seront en partie retransmises par Public Sénat .
Je vais passer la parole à M. le Président du Sénat, puis à M. le Garde des Sceaux, mais sachez que vous entendrez dans quelques instants les témoignages de sénateurs qui viennent de faire un stage dans certaines juridictions et qu'aux environs de 10 h 15, nous ouvrirons notre discussion sur le thème retenu aujourd'hui : la mise en oeuvre de la LOLF dans l'institution judiciaire.
Allocutions d'ouverture
M. Christian PONCELET, Président du Sénat .- M'adressant au ministre tout d'abord ainsi qu'à vous toutes et à vous tous, je tiens simplement à vous adresser mes souhaits de très cordiale bienvenue au nom de mes collègues sénatrices et sénateurs et vous dire que nous sommes heureux de vous accueillir ici, au Sénat pour un grand débat qui concerne la justice.
Vous savez que le Sénat, il y a quelques années, a pris l'initiative de solliciter les sénatrices et les sénateurs pour leur demander s'ils souhaitaient, avec l'accord du Garde des Sceaux, aller faire un petit stage dans les institutions judiciaires, de même qu'ils vont régulièrement en stage dans les entreprises, pour bien connaître la matière sur laquelle on va légiférer et pour mieux légiférer.
Je sais que ces stages se déroulent dans de très bonnes conditions, comme nous le verrons dans le cadre de ce débat, mais c'est à vous qu'il appartient maintenant de dire si c'est une bonne ou une mauvaise initiative et s'il faut changer, améliorer ou supprimer cette opération. Il est en effet inutile de refaire le discours à la sortie de la messe pour ceux qui y vont ou à la sortie du café du commerce pour ceux qui le fréquentent puisqu'ils ne seront pas là pour répondre. Je préfère donc que l'on se pose des questions ici et que nous les traitions ici plutôt qu'ailleurs.
Le Sénat a pris en tout cas cette initiative pour essayer d'améliorer notre législation et de bien connaître les différents secteurs sur lesquels nous avons à nous prononcer dans le cadre des décisions prises sous forme de projets par le gouvernement et sous forme de propositions par les parlementaires.
Encore une fois, bienvenue au Sénat. Si vous en conservez un bon souvenir, sachez que vous êtes d'ores et déjà invités, pour d'autres raisons peut-être, à y revenir. En tant que sénateur, j'ai mon compte !... (Rires.) Merci et bonne journée.
(Applaudissements.)
M. Pascal CLEMENT, Garde des Sceaux, Ministre de la justice .- Monsieur le Président du Sénat, monsieur le Vice-président Roland du Luart, mesdames et messieurs les Sénateurs et messieurs les Directeurs, je voudrais faire un salut extrêmement appuyé aux très nombreux participants présents dans cette salle, qui sont presque tous magistrats. Je tiens donc à saluer les premiers présidents, les procureurs généraux, les présidents, les procureurs et tous ceux qui sont ici, ainsi que les sénatrices et les sénateurs, bien entendu.
Je suis frappé de voir autant de magistrats au Sénat et c'est une joie pour moi de retrouver l'ensemble des stagiaires et de leurs tuteurs, puisqu'il s'agit de cela, si j'ai bien compris. J'en profite pour féliciter une fois de plus la Haute Assemblée de cette initiative tout à fait remarquable qui fait réfléchir. Je suis moi-même en pleine réflexion sur la manière dont on pourrait faire en sorte que des magistrats, au-delà de l'ENM, accèdent à une ouverture culturelle que certains corps possèdent en recevant des gens de la société civile.
En effet, s'il y a un sujet qui est peu connu par les Français, y compris ceux qui sont les plus cultivés, ce sont bien les questions judiciaires. Je suis frappé de voir combien les hauts fonctionnaires, quand on leur parle de questions de justice, sont parfois un peu courts. Il serait bon qu'il y ait, d'une certaine manière, à l'exemple de l'IHEDN, une double provenance de personnes qui font carrière et de personnes de la société civile. Je suis moi même en train de réfléchir à une chose qui irait dans ce sens et qui pourrait rejoindre votre idée, monsieur le Président : vous-même avez envoyé des sénateurs dans les juridictions et je n'en ai jamais vu qui n'en soient pas revenus conquis de ce qu'ils avaient découvert et de ce qu'ils avaient fait.
J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les chefs de juridiction et tous les magistrats qui ont pris des sénateurs en tutelle, ce qui est sûrement un plaisir et, comme nous le saurons tout à l'heure à travers leurs témoignages, un franc succès.
J'en viens à mon discours, monsieur le Président.
Tout d'abord, je tiens à vous remercier, ainsi que la Haute Assemblée, de nous accueillir une fois encore. En effet, c'est la quatrième fois que sont organisées ces rencontres qui permettent d'échanger sur la justice et la manière dont elle met en oeuvre les moyens que lui confie le Parlement chaque année en votant son budget.
Cette démarche est d'autant plus importante que certains sénateurs ont, cette année encore, suivi un stage d'immersion au sein des juridictions. Elle permet de prolonger ce dialogue de terrain avec les magistrats et les fonctionnaires de justice.
Echanger sur la justice ouvre d'immenses perspectives, tant sont grandes les attentes de nos concitoyens en ce domaine. Garante du respect du pacte social, l'institution judiciaire exerce sa mission sous le regard de tous, s'efforçant de rester sereine en dépit des impatiences et des inquiétudes.
Le Président Christian Poncelet nous a posé à tous une question provocante dans son invitation : « La logique budgétaire est-elle compatible avec l'oeuvre de justice ? » Je vous réponds sans détour que j'en suis profondément convaincu.
Depuis le 1 er janvier de cette année, les moyens de la justice sont mis en oeuvre dans le cadre de la loi organique sur les lois de finances, dite « LOLF ». Cette révolution budgétaire a exigé de nous des efforts importants et je crois qu'il est fait bon usage des crédits consentis par le Parlement, en particulier dans le domaine des frais de justice, qui sont un chantier stratégique majeur. Cette démarche est en outre approfondie par les audits de modernisation de l'Etat dans lesquels s'est engagée la justice.
La LOLF a bouleversé notre approche budgétaire traditionnelle. Le premier défi a consisté à être au rendez-vous de la loi de finances pour 2006 avec une nouvelle maquette budgétaire. Celle-ci est articulée en programmes et actions ainsi qu'en indicateurs d'activités et de performances illustrant l'obligation de rendre compte de cette expérience. Nous avons honoré ce rendez-vous. Ainsi, dans le cadre du programme « justice judiciaire », la mise en oeuvre de la LOLF s'est accompagnée de la fixation de sept objectifs tels que la réduction des délais de jugement ou l'amélioration de l'exécution des décisions pénales.
Parmi ces indicateurs de performances qui accompagnent ces objectifs, je citerai notamment le délai moyen de traitement des procédures civiles, l'ancienneté moyenne du stock civil ou le taux de réponse pénale.
D'autres indicateurs seront ultérieurement déclinés dans toutes les cours, mais ils nécessitent un temps d'adaptation. Il s'agit d'indicateurs plus complexes à établir tels que le nombre d'affaires civiles ou pénales traitées par magistrat. Le nombre d'affaires globalement traitées par juridiction est bien connu ; il est cependant plus difficile, au regard notamment de la polyvalence de l'activité juridictionnelle, de bien apprécier, pour chaque magistrat, la proportion de son temps consacré, par exemple, au civil ou au pénal.
J'insiste sur le fait que je n'entends en aucun cas concevoir cette démarche de performance comme un moyen de sanction des résultats. Il s'agit d'un système d'alerte permettant, en cas de difficulté d'une juridiction, de poser un diagnostic commun entre les responsables d'un budget opérationnel de programme et les responsables de programme. C'est ainsi que nous pourrons trouver les solutions les mieux adaptées à la résolution du problème constaté.
D'une façon générale, même si la plupart des chefs de cour et de juridiction suivaient déjà, bien entendu, l'actualité de leur ressort, la mise en place d'indicateurs de performances leur apporte la possibilité de se situer par rapport à des juridictions de taille similaire, ce qui était, semble-t-il, très attendu.
Nous avons également élaboré les outils de suivi précis des effectifs travaillant au ministère de la justice. Le fait que les administrations n'avaient jusqu'ici qu'une connaissance imparfaite de leurs effectifs n'est un secret pour personne. C'est ainsi qu'au mois d'avril 2006, le ministère de la justice disposait effectivement de 68 988 emplois à temps plein travaillés (ETPT). J'en tire la conclusion qu'il est temps aujourd'hui de se concentrer sur la capacité de recrutement des magistrats et fonctionnaires et non plus de se fonder sur des chiffres théoriques qui n'ont que peu de sens en pratique.
Enfin, les chefs de cour sont conjointement ordonnateurs de dépenses et responsables des marchés. Ils portent sur la gestion un regard nouveau, intéressé et responsable.
Je souligne que les ordonnateurs des dépenses des juridictions étaient jusqu'ici quand on y pense, on ne peut pas le croire les préfets. Les chefs de cour disposent désormais de la totalité de leurs responsabilités juridiques et financières ; ils sont devenus de véritables managers du service public de la justice.
La LOLF pose au ministère de la justice un deuxième défi plus redoutable : 20 % du budget du ministère est passé du statut de crédits évaluatifs à celui de crédits limitatifs. Ces crédits concernent l'attribution de l'aide juridictionnelle aux personnes sans ressources, le secteur associatif habilité par la protection judiciaire de la jeunesse, la prise en charge médicale de la santé des détenus et les frais de justice.
Dans chacun de ces cas, il convient à présent de rester dans l'enveloppe des crédits votés avec une consommation régulière et complète. Ce sujet est au coeur de nos préoccupations. Il mobilise toute l'énergie des chefs de cour et des juridictions, des magistrats et des fonctionnaires.
Il faut nous adapter à ces nouvelles règles, mais sans obérer les libertés d'initiative qui résultent non seulement du statut des magistrats mais aussi des exigences de leur mission de recherche de la vérité. La maîtrise des frais de justice a été la première action majeure que j'ai conduite afin de montrer qu'une justice équitable était aussi une justice bien gérée. Elle est au coeur de la mission que j'ai confiée au secrétaire général du ministère que j'ai créé en août 2005.
Un plan de maîtrise des frais de justice a été très rapidement mis en place par une mission qui mobilise l'ensemble des directions du ministère. Ce plan s'articule autour de quatre types de mesures.
J'ai tout d'abord mis en place des équipes affectées à la gestion des frais de justice à l'échelon central et aux échelons déconcentrés. Un magistrat référent est en particulier chargé d'en suivre l'évolution dans chaque cour d'appel. J'en remercie Mmes et MM. les Premiers Présidents et Mmes et MM. les Procureurs généraux.
La chaîne hiérarchique n'a cependant pas été la seule concernée. Au sein d'un forum Intranet, tous les individus confrontés à ces problèmes concrets communiquent en direct leurs informations ainsi que leurs méthodes de rationalisation et de mise en concurrence. Nous avons ainsi pu constater que l'approche des magistrats et des greffiers concernés avait profondément changé et que toute la justice s'inscrivait dans une démarche d'optimisation de ses moyens.
J'ai engagé également de nombreuses actions de formation et de sensibilisation de tous les acteurs : magistrats, fonctionnaires et officiers de police judiciaire. La maîtrise des frais de justice est ainsi un thème prioritairement abordé par le Secrétaire général lors de ses déplacements en juridiction. En quelques mois, plus de 1 500 magistrats et fonctionnaires de justice ont participé à ces réunions et ont compris cette volonté de modernisation.
Par ailleurs, j'ai voulu mettre en place des outils de suivi et d'analyse efficaces. Toutes les juridictions se sont vu ainsi doter du logiciel Fraijus, qui permet pour la première fois un suivi statistique des engagements de dépenses.
Enfin, j'ai imposé une négociation et une révision des tarifs, notamment en matière de coûts téléphoniques. Les négociations menées avec les opérateurs de téléphonie au titre des interceptions judiciaires ont permis de réduire de 40 % les tarifs actuellement pratiqués. L'économie prévisible sera en année pleine de 25 millions d'euros. De même, le coût des empreintes génétiques a été sensiblement réduit.
Les exemples pourraient être multipliés car chaque type de dépenses donne lieu désormais à une analyse et une approche pragmatique de réduction des coûts.
Les premiers résultats de ce plan d'action sont déjà au rendez-vous. En effet, on constate dès à présent une baisse sensible des engagements de dépenses pour l'année 2006. Rappelons simplement que, depuis 2000, l'augmentation des frais de justice était de 20 % par an. On mesure ainsi le chemin parcouru. C'est grâce à une mobilisation totale des acteurs de terrain, c'est-à-dire des magistrats et fonctionnaires de justice qui se sont appropriés cette nouvelle logique, et non pas grâce à une décision venue du sommet de l'administration, qu'elle peut être opérationnelle dès cette année.
Je voudrais ajouter qu'une bonne maîtrise des frais de justice signifie dépenser ce qui est nécessaire et non pas comprimer arbitrairement les coûts. Nous devons en effet veiller au respect de deux principes majeurs : le maintien de la qualité des prestations et la juste rémunération des experts.
Sur le premier point, j'ai d'ores et déjà demandé à mes services de travailler sur la revalorisation du tarif des expertises psychiatriques et psychologiques. Je souhaite également, en concertation avec le Ministère de la santé, revoir l'organisation et le financement de la médecine légale. Si la justice veut conserver des experts de qualité et s'entourer des meilleurs spécialistes dans les domaines requérant une grande technicité, elle doit pouvoir les rémunérer.
Sur le second point, des travaux débutent avec les compagnies d'experts et les laboratoires publics pour définir des normes et des protocoles d'analyse, notamment dans le domaine de la biologie. L'évolution des technologies utilisées aujourd'hui emporte des conséquences très importantes en matière de fiabilité des modes de preuves. Si une analyse ADN peut identifier un suspect, elle peut aussi mettre en cause un innocent au cas où les méthodes des procédures utilisées sont approximatives. C'est pourquoi nous devons saisir cette opportunité pour entrer dans une démarche de qualité, seule à même de garantir incontestablement la manifestation de la vérité.
Avec mon collègue Jean-François Copé, Ministre du budget et de la réforme de l'Etat, ainsi qu'avec les ministres de l'intérieur et de la défense, nous avons souhaité concrétiser cette démarche de modernisation. J'ai ainsi voulu que la justice joue un rôle moteur dans les audits de modernisation de l'Etat.
Le premier audit a porté sur les analyses d'empreintes génétiques, révélant qu'un même acte est facturé entre 28 et 360 euros selon le laboratoire et la manière dont la saisine s'effectue. Il n'est pas possible de tolérer une telle situation. Avant la fin de l'année, mon ministère lancera un appel d'offres en vue de la passation d'un marché dans ce domaine.
Le deuxième audit de modernisation a porté sur le fonctionnement des bureaux des exécutions de peine (BEX). J'ai souhaité qu'un BEX soit créé au sein de chaque juridiction afin de rendre effectives les décisions de justice et que les personnes condamnées puissent s'acquitter rapidement de leurs obligations. Cet audit a permis de définir les bonnes procédures à appliquer et les juridictions sont actuellement sensibilisées à ces résultats.
Le troisième audit de modernisation, dont je vous annonce aujourd'hui le démarrage, évaluera l'aménagement de la visioconférence. Les juridictions sont en train de s'équiper activement en ces nouveaux moyens de communication, mais les gains ne seront engrangés que si les services de police et de gendarmerie s'y adaptent également.
Prenons un exemple. Lorsqu'un détenu dangereux, tel un individu suspecté d'activités terroristes, doit être entendu par un juge, son transfert implique le déplacement de nombreuses forces de sécurité et la mobilisation de nombreux moyens matériels et humains. Pourtant, le risque d'une évasion existe toujours. Doit-on le faire courir au citoyen alors que la visioconférence permettrait, de surcroît à moindre coût, de le limiter ? Je souhaite que soit fait le choix de la visioconférence à chaque fois que l'acte à accomplir pourra se satisfaire de cette technique sans présentation physique de la personne devant le juge ou la juridiction.
Je prends également l'exemple des DOM-TOM pour illustrer ce qui précède. L'une des juridictions de la Réunion ou de Saint-Pierre et Miquelon ne dispose pas d'experts qualifiés dans tous les domaines d'expertise. Auparavant, les experts de la métropole se déplaçaient physiquement à l'audience pour seulement quelques dizaines de minutes. Depuis peu, la visioconférence a permis, par exemple à la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, de limiter ces frais de voyage en les faisant témoigner par cet intermédiaire. Je l'ai constaté aussi moi-même aux Antilles.
J'ai enfin proposé au Ministère du budget qu'un nouvel audit porte sur la circulation des procédures pénales. Elles se font actuellement par des courriers classiques avec de multiples enregistrements à chaque étape. La numérisation de ces procédures présenterait des avantages très importants en termes de délais de traitement au bénéfice des justiciables et en termes de coûts de délivrance des pièces.
Ces exemples illustrent l'engagement total du ministère de la justice dans la modernisation, la recherche de gains budgétaires et le dialogue avec tous les acteurs concernés, aux antipodes de la caricature d'une institution qui serait repliée sur elle-même.
Cette matinée d'échanges, Monsieur le Président, nous donne une nouvelle occasion d'enrichissement mutuel des participants. Je vous remercie de nous en offrir l'occasion dans le cadre prestigieux de cette salle Clemenceau, homme dont l'énergie proverbiale nous inspirera dans l'accomplissement d'une mission dont nos concitoyens attendent beaucoup et dont nos fonctions nous font obligation d'y répondre. Pour ma part, je m'y efforce et je vous remercie de l'aide que chacun d'entre vous apporte pour moderniser l'institution judiciaire et pour rendre une justice de qualité au service de tous les Français.
(Applaudissements.)
M. Sylvain ATTAL .- Merci, Monsieur le Ministre et Monsieur le Président du Sénat. Comme je l'ai annoncé, nous allons commencer par une série de témoignages, de rapports de stage, en quelque sorte, de quelques-uns des sénateurs et sénatrices qui viennent d'effectuer leur stage. Prendront la parole successivement Mmes et MM. de Broissia, Michel, Le Pensec et Dupont, mais, pour commencer, je donne la parole à Roland du Luart, qui va nous parler du stage qu'il a effectué à la Cour d'appel de Paris.
Témoignages de sénateurs
M. Roland du LUART, Sénateur de la Sarthe, Vice-président du Sénat .- En tant que rapporteur des crédits de la justice à la Commission des finances du Sénat, j'ai souhaité répondre à l'attente du Président Poncelet en effectuant un stage d'immersion. En effet, je n'ai pas de formation juridique et je pense qu'il faut s'immerger dans ce genre d'institutions, d'autant plus quand on veut comprendre une chose aussi complexe que l'ordre judiciaire.
J'ai eu cette chance de pouvoir faire un stage de trois jours à la Cour d'appel de Paris, et je tiens à en remercier son Premier Président, ici présent, ainsi que le Procureur général près la Cour d'appel et tous ceux qui m'ont consacré de leur temps pour essayer de me faire comprendre ce qui s'y passait.
Je dois dire que cela a été pour moi extrêmement enrichissant. Comme tout le monde savait ce que je faisais, nous avons, bien sûr, beaucoup parlé de la LOLF. Cherchant à savoir comment elle était perçue sur le terrain et si elle était ou non un facteur de modernisation pour les services publics de la justice, je me suis rendu dans le Service Administratif Régional (SAR) pour voir comment tout cela fonctionnait.
Si je puis me permettre de vous le dire, Monsieur le Garde des Sceaux, il y a quand même des paradoxes. En effet, je suis l'un de ceux qui ont eu l'outrecuidance de dire, lors du débat du mois de novembre dernier, que vous aviez peut-être une certaine insincérité budgétaire dans l'approche des frais de justice. Vous m'aviez alors donné vos arguments, mais je suis toujours convaincu que les crédits utilisés pour faire fonctionner la justice ne sont pas forcément suffisants. Certes, c'est le problème éternel des dépensiers, mais on assiste actuellement à un paradoxe à la Cour d'appel de Paris : il y a des sommes en retard, mais, au 15 mai, le moment où j'y étais, on n'arrivait pas à payer parce qu'on avait mis en place une machine extrêmement complexe qui imposait trois contrôles quand il n'y en avait qu'un auparavant, ce qui est un facteur d'alourdissement. Les fonctionnaires des SAR n'arrivent pas à faire fonctionner le système : le contrôleur financier ou la régie n'osent pas aller plus vite parce que, par principe de précaution, ils se demandent s'ils y sont habilités ou non.
Hier, j'ai eu au téléphone un personnage très important du ministère du budget qui assistera tout à l'heure à notre table ronde et qui m'a donné son accord - il pourra le dire lui-même - pour que nous essayions d'alléger les contrôles. En effet, vous avouerez qu'il serait paradoxal qu'après avoir dit qu'il n'y avait pas assez d'argent, nous nous retrouvions en fin d'année dans une situation dans laquelle nous sommes en sous-consommation de crédits en ce qui concerne les frais de justice.
Vous savez bien, Monsieur le Garde des Sceaux, qu'il y a, au moins pour les années 2004 et 2005, des sommes arriérées et non payées et il faut bien que nous en sortions. L'année 2006 est une année de transition extrêmement difficile, et je tenais à évoquer ce paradoxe.
Cela a constitué le centre de mon immersion auprès de la Cour d'appel.
Dans un deuxième temps, je me suis particulièrement intéressé aux conditions matérielles. Je dois vous avouer que j'ai été ahuri après avoir tout visité de fond en comble. Je ne pensais pas qu'il y avait 24 kilomètres de couloirs, 7 000 fenêtres, 3 500 portes et 7 entrées différentes, dont deux mal gardées... Tout cela m'a vraiment surpris. On m'a alors dit que le déménagement du Tribunal de grande instance devait se réaliser, mais que le lobby des avocats ne voulait pas bouger ! Nous sommes dans une France des corporatismes.
Comme vous êtes un ancien avocat, Monsieur le Ministre, je pense que vous allez nous aider pour cela, car il faut vraiment que le Tribunal de grande instance et la Cour d'appel bénéficient de conditions de travail décentes. En effet, aucun fonctionnaire territorial ne pourrait travailler dans ce qu'on appelle « la douche », c'est-à-dire un bureau de 1,5 mètre carré à la Cour d'appel de Paris. Je précise même que la moitié des magistrats n'ont pas de bureau ! Il ne faut pas s'étonner ensuite si la justice est lente.
Cela m'a particulièrement frappé et je me suis dit que cela ne pouvait pas durer. J'aimerais donc, Monsieur le Garde des Sceaux, que l'on sache quand va être remise en route la construction du nouveau Tribunal de grande instance pour Paris et la région parisienne. C'est un problème de fond. En tant que membre de la Commission des finances, je sais que cela coûte terriblement cher, qu'il faudra faire des choix et que vous ne pourrez pas faire la multiplication des petits pains, mais il y a quand même un problème de calendrier.
Maintenant, je voudrais vous délivrer mes sentiments à la suite de ce passage à la Cour d'appel. J'ai eu l'occasion, au cours de ces trois jours, d'assister à une séance en appel. J'ai entendu les réquisitions du procureur, le président de séance et les avocats ainsi que quelques remarques un peu bruyantes de certains appelés et j'ai eu l'impression que nous étions je le dis comme je le pense, même si cela va peut-être étonner certains à des années-lumière de compréhension entre ceux qui rendaient la justice et les justiciables. Il y avait là des gens du voyage qui disaient carrément : « Cause toujours, on n'en a rien à cirer ! Ce que tu racontes, on s'en fiche ! » J'ai été très choqué de cette ambiance qui montrait que tout cela passait véritablement au-dessus de la tête de ces gens.
Lorsque je m'en suis ému auprès du Procureur près la Cour d'appel (qui, en plus, a été procureur dans la Sarthe auparavant et que je connaissais bien), il m'a dit que cette situation était générale et que les jeunes, en particulier, étaient totalement indifférents à l'égard du droit, qu'il leur passait vraiment au-dessus des oreilles. C'est un vrai problème de société qui m'est apparu et que je n'avais pas perçu comme cela.
Par ailleurs, j'ai senti, de la part des magistrats et greffiers que j'ai rencontrés, un très profond sentiment de solitude et même de blessure du fait de certains excès médiatiques sur lesquels je ne m'étendrai pas car vous voyez bien ce que je veux dire.
M. Christian PONCELET .- Le Sénat y est étranger.
M. Roland du LUART .- Le Sénat s'honore, Monsieur le Président, d'y avoir été étranger, car il est trop facile d'avoir un acharnement médiatique, personne n'étant certain de ce qu'il fait. J'ai été très impressionné par cette dignité un peu blessée et ce repli sur soi d'un certain nombre de magistrats que j'ai pu rencontrer.
J'ai eu aussi une conviction qui va peut-être vous rassurer, Monsieur le Garde des Sceaux. Dans votre belle administration dans laquelle on compte 70 000 personnes, j'ai l'impression que l'on ne manque pas de magistrats mais qu'en revanche, on manque cruellement de greffiers en chef, de greffiers et d'auxiliaires de justice et qu'aujourd'hui, la corde est tellement tendue qu'à tout moment, nous pouvons avoir un gros problème. En effet, l'opinion publique se plaint des excès de délais d'instruction, mais la machine judiciaire est bloquée non par les magistrats mais par le fait qu'il faut revoir le problème des greffiers en chef et des greffiers.
A cette occasion, il faudra sans doute c'est l'objet de mon rapport de cette année après avoir rencontré l'ENM et l'ENG revoir le problème pour les greffiers, compte tenu du délai de formation, afin de ne pas nous retrouver dans une situation difficile encore aggravée par les départs en retraite.
J'en arrive à ma conclusion qui s'adresse à mes collègues parlementaires et au gouvernement. Je suis intimement convaincu, moi qui ai trente ans de Parlement, que nous légiférons trop, notamment dans le domaine de la justice, que nos législations deviennent illisibles par ceux qui sont chargés de les appliquer, c'est-à-dire les magistrats, et qu'à l'avenir, nous devons absolument essayer de tester en amont et en profondeur nos réformes avant de les voter au Parlement.
Voilà la conviction d'un « vieux jeune » ou d'un « jeune vieux » parlementaire passionné par la mission que m'a confiée la Commission des finances du Sénat et par cette immersion que j'ai eu l'occasion d'effectuer.
J'ai peut-être été un peu trop bavard, mais j'avais annoncé publiquement que je dirais ce que je pense tel que je le ressens car, avant tout, un parlementaire doit être un homme indépendant.
(Applaudissements.)
M. Sylvain ATTAL .- Merci de nous avoir fait entrer aussi vite dans le vif du débat. Naturellement, M. le Président Poncelet a envie de vous répondre.
M. Christian PONCELET .- Il ne faut pas hésiter non plus à faire des reproches aux parlementaires, c'est-à-dire à nous-mêmes. En effet, s'il ne faut pas légiférer d'une manière excessive, il faut aussi qu'à certains moments, nous sachions refuser la proposition ou le projet qui nous est présenté. Nous sommes dans une société de garantie. Dans cette société française, tout le monde veut la garantie de la naissance, de la formation, de l'activité, du loisir et même de la mort !... (Rires.) On cherche à tout moment une protection.
Quand une proposition est faite, nous faisons un peu de travail et nous lançons la proposition de loi, mais cela se calme ensuite. Si nous légiférons beaucoup, c'est aussi parce que cette législation excessive vient du peuple souverain. Nous devons donc, nous, élus, savoir refuser ce qui nous est proposé parfois par un vote souverain, même si cela nous rend impopulaires, car l'impopularité, c'est la noblesse de l'élu. En effet, bien qu'il travaille pour l'intérêt général, il n'est pas à la merci des intérêts particuliers des uns et des autres. Voilà la mission qui est la nôtre.
N'hésitez donc pas à nous interpeller quand on vous interpelle !...
(Applaudissements.)
M. Roland du LUART .- Monsieur le Président du Sénat, si vous voulez vraiment que le Sénat soit écouté, il faut que nous ayons le dernier mot sur les lois !... (Rires.) A ce moment-là, nous serons peut-être mieux entendus.
M. Pascal CLEMENT .- Monsieur le Vice-président, n'allez pas jusqu'aux dernières extrémités. En tout cas, je tiens à donner satisfaction au Président du Sénat : la garantie de la mort, c'est oui. Pour le reste, tout est relatif... (Rires.)
Je tiens à remercier Roland du Luart, avec lequel je me flatte d'avoir des liens d'amitié, ce qui me conduit à dire que mes remerciements ne sont pas du tout hypocrites mais évidemment sincères. Il y a huit ou neuf mois, j'ai été un peu surpris car, bien que je me pique de connaître un peu la Haute Assemblée, j'ignorais cette tradition du Sénat à l'égard de l'organisation de débats. Il se trouve qu'à cette occasion, le sujet portait sur les frais de justice et que je suis venu ici pour en prendre plein les oreilles. Nous nous sommes rencontrés de manière assez virile, comme on pourrait le dire en rugby, ce qui m'a rappelé quelques discours de Premiers Présidents dans certaines audiences solennelles, quelques semaines plus tôt.
Bref, pour vous le dire franchement et publiquement, j'ai démarré cette LOLF sous des auspices assez difficiles et je ne voyais plus beaucoup d'amis : quand je me retournais, il n'y avait pas grand monde.
Aujourd'hui, je ne vous donne pas les chiffres parce que j'aurais peur de me tromper, mais la tendance est excellente par rapport à l'objectif. Alors que personne n'y croyait, nous sommes en train d'arriver à l'objectif. Parmi vous, soit ceux qui n'y croyaient pas sans le dire, c'est-à-dire tout le monde, soit ceux qui ont dit publiquement qu'ils n'y croyaient pas, c'est-à-dire quelques-uns, vous pouvez avouer que vous êtes surpris. Je le suis aussi.
Voilà l'essentiel. Cela veut dire que, lorsque nous avons tous ensemble décidé de faire un peu attention, cela a porté ses fruits. Je vous ai parlé tout à l'heure des analyses ADN qui sont passées de 360 à 80 euros. Il en est de même pour le téléphone. Je ne citerai pas les compagnies, mais certaines ont vraiment été excessives. Pour le SMS, c'est la même chose : cela va de 1 à 100.
Nous avons examiné les choses de près et décidé de ne pas prendre fatalement celui qui proposait une sorte de monopole et, aujourd'hui c'est le rôle du Secrétaire général, qui le fait très bien , le fait de mettre en concurrence toutes ces entreprises a fait un énorme bien sans qu'aucune décision juridictionnelle, comme vous l'aurez constaté, mesdames et messieurs les Présidents, n'ait jamais été mise en cause. Autrement dit, nous avons en même temps respecté l'indépendance de la décision juridictionnelle et essayé de maîtriser les coûts.
Cela prouve c'était la question provocante du Président du Sénat que l'on peut faire une bonne justice avec une limite quantitative des coûts. La même question, volens nolens, se pose s'agissant de la santé : peut-on faire une santé publique de qualité sans enveloppe ? Evidemment, il est mieux qu'il n'y en ait pas, mais tout le monde sait qu'il en faut une.
Je répondrai aussi à la question de Roland du Luart sur la Cour d'appel de Paris. Vous savez tous qu'il y a dix ou quinze ans que les gouvernements successifs souhaitent créer un tribunal de grande instance à Paris. Je pensais arriver en fin de négociation, mais j'ai découvert que ce n'était pas le cas et qu'à la mairie de Paris, je n'avais pas toutes les oreilles que je souhaitais trouver.
On nous a proposé quelque chose d'inconvenant pour le TGI, à côté du périphérique, et nous souhaitons effectivement un autre emplacement. Aujourd'hui, le Préfet de Paris est en train d'user de son autorité juridique pour avancer, mais si nous n'avions pas de préfet, les choses resteraient en l'état, et je le dis avec délicatesse. Autrement dit, il faut s'en prendre à nous-mêmes, c'est-à-dire aux responsables de ce pays. Si nous n'avons pas plus avancé, c'est parce que nous ne savons pas faire avancer cette affaire, qui a démarré il y a quatre ans et demi et qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive. L'Etat va prendre sa décision sans l'accord du partenaire majeur, ce qui n'est pas la meilleure situation. Que de temps perdu ! Tout monde sait qu'avec la Cour d'appel et le TGI au palais de justice de Paris, on se fiche des justiciables français, comme au XIXe siècle !
La France est contrainte de demander à ses magistrats de s'excuser de leur réserver des conditions de travail aussi intimes, mais, sous ce rapport, les responsables ont de vraies responsabilités, et non pas depuis cinq ans : il y a une large vingtaine d'années qu'il fallait commencer à y réfléchir sérieusement, ce qui n'a pas été fait. En tout cas, j'affirme que, dans les semaines qui viennent, la décision sera prise irrévocablement et que l'on avancera. Malheureusement, c'est un peu tardif.
Il reste un point sur lequel je souhaite intervenir en demandant l'appui du Sénat, puisque plusieurs sénateurs sont allés dans les juridictions. J'ai cru comprendre que vous aurez la visite du directeur du budget, ce qui est une très bonne idée. Alors que nous vivons actuellement une période rare en France avec des départs à la retraite en très grand nombre, si la France veut se mettre au niveau européen en ce qui concerne le nombre de ses fonctionnaires (ce qui est un grand mot, parce que nous aurons toujours trois fois plus de fonctionnaires que les autres pays d'Europe) en se rapprochant d'un standard européen dont nous resterons de toute façon très loin, la seule opportunité est de ne pas remplacer les 70 000 départs à la retraite.
J'adhère complètement à ce discours et je considère que l'on pourrait même aller plus loin. Cependant (et vous me direz que je me contredis en tant que ministre de la justice), je voudrais expliquer pourquoi je n'arrive pas vous pourrez peut-être m'aider à expliquer au ministère du budget que, chez nous, les fonctionnaires ne sont pas des fonctionnaires. En effet, ce sont souvent des greffiers, mais il faut savoir qu'un greffier et un magistrat marchent en binôme. Il n'est donc pas possible de créer des magistrats sans avoir de greffiers à côté. Comme je n'arrive pas à faire passer ce message au Ministère du budget, je compte sur le Parlement pour être plus convaincant dans cette affaire afin que l'on ne mette pas les greffiers à la même sauce que ce que j'entends sur la fonction publique de niveau national. C'est tout à fait autre chose et chacun sait dans les juridictions que cela fonctionne ainsi.
Il serait donc souhaitable d'envoyer en stage nos fonctionnaires du budget car ils feraient des découvertes intéressantes... (Rires.) Ils verraient que le Ministère de la justice a un système un peu différent et qu'il faut le prendre en compte parce que nous sommes typiques et non pas assimilables à d'autres fonctions publiques. Voilà la difficulté.
Dans cette situation générale, Paris s'est toujours relativement bien porté (je reste prudent, bien sûr, car je ne veux pas me faire siffler par le Président qui est en face de moi) : ce n'est pas la juridiction où on manque le plus de magistrats et où le problème est le plus aigu. C'était le cas il y a six ou sept ans, mais c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Ici ou là, à chaque fois que je vais dans un tribunal ou une cour, nous prenons note des demandes et M. le Directeur des Services judiciaires, M. de la Gâtinais, se fait une joie d'y donner satisfaction, mais, globalement ce n'est pas vraiment le sujet.
En revanche, j'ai beaucoup de mal à obtenir des catégories C auprès du Ministère des finances, sachant qu'au Ministère de la justice, pour être franc, nous nous servons des catégories C comme de catégories B. On ne le dit pas trop au Ministère de la justice, mais c'est une réalité, et la responsable de toutes les catégories C de France qui est présente dans cette salle ne me contredira pas sur ce point. Nous y avons recours à un niveau supérieur en termes de compétences.
Par conséquent, je n'ai aucun conseil à donner au Parlement, mais votre rôle, Monsieur le Président, par rapport à nous, ministère réputé dépensier, est de rentrer dans la spécificité d'un ministère. Tous les ministères ne se ressemblent pas. C'est une lapalissade, mais, pour nous, c'est vraiment différent.
Certes, nous sommes un peu mieux traités que les autres puisque je vous rappelle que, cette année, le ministère le moins mal ou le mieux traité (vous choisirez la formule qui vous convient) est le Ministère de la justice. Je pourrais être flatté en me disant que je suis un très bon ministre selon la méthode ancienne, mais il faut savoir que, pour M. Copé, les meilleurs ministres sont ceux qui ont les plus petites augmentations de budget. Je suis donc le plus mauvais ministre puisque j'ai la plus grosse augmentation budgétaire, non pas par rapport à ce que je voulais, mais par rapport à nos besoins patentés et déclarés, sachant que, comme vous le savez mieux que moi, il reste, honnêtement, un écart malheureusement trop important.
Il serait donc souhaitable qu'au cours de cette session budgétaire, comme l'ancien président de la Commission des finances que vous êtes, Monsieur le Président, connaissez cela beaucoup mieux que moi, on fasse un effort très ciblé pour obtenir des éléments très précis en disant : « Nous voulons des greffiers et des catégories C ». Merci de votre attention.
(Applaudissements.)
M. Sylvain ATTAL .- Merci. Nous allons continuer les témoignages des sénateurs en écoutant celui de Mme Bernadette Dupont, sénateur des Yvelines, qui s'est rendue au tribunal de grande instance de Paris, 16ème.
Mme Bernadette DUPONT , Sénateur des Yvelines .- Auparavant, je suis allée dans celui de Nanterre, dont je salue le président. Je serai très brève parce que Roland du Luart a dit beaucoup de choses que j'aurais voulu dire, ce qui prouve que le contact et l'impression sont les mêmes.
Je ne parlerai pas vraiment de « stage » parce que, pour avoir l'habitude de recevoir des stagiaires en collectivité, je me rends compte qu'en trois jours, on ne peut pas faire grand-chose. Je voudrais surtout remercier les magistrats de l'accueil qui nous est fait. Nous sommes effectivement ravis de vous rencontrer et je me suis rendu compte à quel point le contact entre le politique et le judiciaire était une affaire vraiment récente. Je ne sais si cela s'explique par la séparation des pouvoirs, mais, l'année dernière, pour mon premier stage, j'ai été tout à fait étonnée de constater que j'étais l'un des premiers parlementaires qui entrait dans un tribunal.
J'insiste donc sur cet accueil. J'ai bien ressenti une méconnaissance entre nos deux institutions.
(Départ de M. Christian Poncelet et de M. Pascal Clément.)
J'ai fait un stage dans un secteur particulier : celui des tutelles, un sujet qui m'intéresse profondément. Pour m'être occupée, depuis 1989, des problèmes des personnes handicapées, je sais que les tutelles sont une vraie préoccupation non seulement pour les instances judiciaires, mais aussi pour tous les acteurs qui se penchent sur ce problème.
J'ai beaucoup appris. J'ai eu des entretiens individuels avec des juges, j'ai vu leurs conditions de travail et je rejoins mon collègue Roland du Luart, car ces conditions de travail sont aberrantes, dans des locaux à la fois inconvenants pour certains, en tout cas trop exigus, d'autant plus que, dans ce domaine des tutelles, on constate une inflation exponentielle des dossiers.
Je regrette que M. le Garde des Sceaux soit parti parce que je pense que nous ne serons jamais assez nombreux, les uns et les autres, pour insister sur l'urgence de cette réforme des tutelles. J'ai vu des juges, souvent très jeunes, travailler de façon absolument admirable et rendre des jugements d'une justesse et d'un discernement tout à fait étonnants pour des personnes aussi jeunes, ce qui prouve que ce n'est pas l'âge qui fait l'humanité. J'ajoute qu'il est urgent, pour le respect de la personne handicapée, quelle qu'elle soit, que nous arrivions à la conclusion de cette réforme, parce que, comme chacun le sait, les handicaps sont très divers, que certaines personnes ont besoin d'être sous tutelle ou sous curatelle, mais que tout le monde a besoin d'un accompagnement social d'une qualité exemplaire.
Les juges qui continuent d'avoir des tutelles ont besoin d'avoir un temps d'accompagnement. On a parlé du problème du tandem entre le greffier et le juge. Il est tout à fait évident dans mon esprit qu'il y a trop peu de juges de tutelle et trop peu de greffiers, que les dossiers s'entassent et qu'au bout du compte, la personne humaine n'est pas respectée alors que c'est elle qui est au coeur de cette problématique.
Je tiens à remercier tous les gens qui m'ont accueillie car j'ai ressenti vraiment la même réflexion, la même difficulté et la même amertume en constatant que le travail n'était pas forcément fait dans les conditions nécessaires au respect de la personne.
(Applaudissements.)
M. Sylvain ATTAL .- M. Louis Le Pensec était, lui, en stage au tribunal de grande instance de Versailles...
M. Louis LE PENSEC, Sénateur du Finistère, ancien ministre .- ...dont je salue le procureur et le président très sincèrement pour l'accueil et les conditions dans lesquelles s'est déroulé ce stage.
M. Sylvain ATTAL .- C'était un stage doublement intéressant, d'abord parce que vous êtes sénateur, mais aussi parce qu'on m'a dit que vous vous destiniez à devenir avocat...
M. Louis LE PENSEC . - Si tous mes secrets sont dévoilés, que vais-je devenir ? Il est en effet permis, à nos âges, d'embrasser d'autres carrières...(Sourires.)
Lorsque j'ai appris que l'on pouvait effectuer un stage, j'ai eu comme beaucoup, une moue un peu condescendante en me disant : « Un stage, à mon âge ? A la lumière de tout ce que nous avons fait, que pouvons-nous apprendre en trois jours ? » J'ai très vite réévalué mon appréciation qui rejoint, car nous avons un peu échangé entre nous, les sentiments de mes collègues. En effet, le choc est un peu rude lorsque, dès la première heure, on est confronté au fonctionnement de l'institution judiciaire, et je sais gré à l'institution de s'être montrée telle qu'elle est.
Pour une immersion, c'est un plongeon au coeur d'une institution en plein fonctionnement qui ne modifie en rien ses façons de faire à cause de la présence d'un sénateur : j'étais à côté du procureur adjoint qui a tout simplement demandé son avis au justiciable qui était présent en lui disant : « Acceptez-vous que M. un tel, stagiaire du Sénat, participe à cette audience ? »
J'ai parlé d'un choc. Il est lié à la fois aux chiffres et à la procédure.
Je commencerai par les chiffres. Ma collègue a parlé de croissance exponentielle. C'est une réalité dont nous avions conscience sans l'avoir vécue, mais lorsqu'on constate le nombre de dossiers présents dès le début de la journée et ceux qui restent à traiter au terme de la journée, cela fait peser un poids d'une densité qu'il convient de souligner. Autant de cas humains à traiter et d'audiences qui se succèdent avec la contrainte physique de garder l'esprit en éveil pendant de longues heures pour rendre sereinement la justice, ce qui est véritablement une gageure.
J'ai ressenti également un choc lié à la procédure, qu'il faut respecter à la lettre, faute de quoi l'affaire est à rejouer. Très sincèrement, lorsqu'on nous met sous le nez la complexité des lois que nous votons, mes chers collègues, à 3 heures du matin, dans le cadre d'un sous-amendement à l'article 231-quintiès, et que nous en voyons le résultat final dans l'application qui en est faite, on ne peut que se dire que la procédure est d'une rare complexité.
J'ai participé à faire adopter pendant dix ans au gouvernement un certain nombre de lois et, à chaque fois, je disais aux membres de mon cabinet que nous légiférions trop et que la voie réglementaire devait suffire. J'en suis encore plus convaincu, mais je pense que, sur ce terrain, il est permis tout de même d'avancer.
Dans ce contexte de contraintes pesant sur les chiffres et les procédures à respecter, l'exigence d'efficacité est incontournable. C'est ce travail qui a frappé, voire sidéré nombre de stagiaires. Je prends l'exemple du procureur adjoint : à la reprise en début de semaine, il doit non seulement traiter ce qui s'est passé le week-end, mais aussi établir un contact avec le terrain. Certains m'ont dit qu'il y avait jusqu'à 400 officiers de police judiciaire dans la juridiction de tel département et je n'ai plus le chiffre s'agissant de la juridiction dans laquelle je me trouvais, mais c'est une chose dont nous n'avions pas du tout conscience. Je pensais en effet que les procédures par lesquelles l'officier de police judiciaire faisait acheminer au procureur les faits du week-end et les mesures à prendre, étaient beaucoup plus bureaucratiques. En fait, il s'agit d'un traitement sur-le-champ avec, dans la file d'attente téléphonique, l'officier de police judiciaire qui écoute et qui répond aux questions du procureur adjoint, celui-ci prenant souvent ses décisions immédiatement.
Nous avons vraiment été très impressionnés par ce contact de terrain par téléphone et par la nécessité de bien évaluer l'interlocuteur qui est au bout du fil pour connaître la fiabilité à accorder à ce qui est dit. J'ai vraiment été frappé par la réactivité de la justice. Nous qui avions en tête la lenteur de la justice, nous avons dû réviser notre point de vue.
Cela dit, je fais mienne l'observation de Roland du Luart, rapporteur de la justice pour cette assemblée, sur le fait que la justice mais nous le savions est au coeur de toute la crise de la société. Cela a été, là aussi, un choc : 95 % des justiciables que j'ai vus appartenaient à ce qu'on appelle désormais les « minorités visibles » et tous ceux qui avaient à dire la justice n'y appartenaient pas. Cette situation diffère selon les départements où l'on se trouve, mais c'est néanmoins une réalité liée à la crise des banlieues et aux divers trafics que la justice doit résoudre, tout en lui demandant aussi de résoudre les problèmes de la société.
J'en viens à ma conclusion. J'ai été en contact avec des fonctions d'une rare exigence, qu'il s'agisse des juges, procureurs ou procureurs adjoints, qui sont assumées avec coeur et même, parfois, avec passion, ce qui nous a surpris, les intéressés convenant et ce n'est pas une clause de style qu'ils faisaient cela passionnément. Ils le font aussi avec beaucoup de mérite et cela vaut l'admiration de presque tous les sénateurs qui ont vu assumer ces fonctions.
On peut se sentir bien seul quand on est magistrat, mais, selon les juridictions, heureusement, il est permis de limiter sa solitude par une collégialité qui s'exerce de fait, notamment avec le doyen des juges d'instruction, et entre collègues. Sinon, la vie serait très difficile.
Enfin, si notre rapporteur prend l'initiative d'une manifestation à Paris avec des banderoles indiquant « Nous réclamons des greffiers ! », mon groupe s'y associera sans doute. En tout cas, je m'associerai à cette manifestation, car, très sincèrement, j'ai pu mesurer les conséquences de l'absence de greffiers et de greffières en ce qui concerne l'efficacité de la justice. Je suis injuste en ne citant qu'une seule catégorie, mais je le signale parce que c'est vraiment criant.
M. Roland du LUART .- Nous allons manifester ensemble, si je comprends bien.
M. Louis LE PENSEC .- Oui, camarade !...
(Applaudissements.)
Visiblement, le Garde des Sceaux en est convaincu, mais cela ne suffit pas pour obtenir la décision. En tout cas, c'est un problème qui est connu. Mon présent témoignage a été établi tout simplement pour servir le droit.
M. Sylvain ATTAL .- Merci. Jean-Pierre Michel, vous étiez vous-même au Tribunal de grande instance de Castres. Il semble que ce soit un retour aux sources.
M. Jean-Pierre MICHEL, Sénateur de la Haute-Saône .- J'étais à Castres vers le 20 mars et je me suis dit, comme Louis Le Pensec, qu'après vingt-cinq ans, je pouvais revenir devant un tribunal car cela avait dû beaucoup changer.
Tout d'abord, alors que je suis arrivé à Castres en pleine médiatisation de la commission d'enquête sur l'affaire Outreau, j'ai été surpris, même si j'ai été très réservé à l'égard de cette commission d'enquête, pour ne pas dire très hostile, par le traumatisme que j'ai constaté dans la juridiction chez tous les magistrats et tous les personnels de greffe. On ne m'a parlé que de cela au cours de ma première journée. Il s'agissait vraiment d'un traumatisme très profond des magistrats auxquels il vient d'être rendu hommage à l'instant et qui se demandaient comment ils pouvaient se trouver devant une sorte de tribunal parlementaire, popularisé et médiatisé par la télévision, dans lequel on met en cause leurs pratiques professionnelles, qui, à mon sens, sont exclues du champ disciplinaire. C'était bien de cela qu'il s'agissait.
Cela justifie d'autant plus la démarche du Sénat. J'ai eu l'impression que, dans cette modeste juridiction, la présence d'un sénateur qui était à l'écoute des magistrats présents était une très bonne chose. Cela justifie totalement ces stages au cours desquels nous disons simplement : « Nous venons écouter ce que vous avez à dire, constater vos difficultés de fonctionnement et non pas vous juger ».
Sur le fonctionnement, je voudrais simplement dire un mot de l'administration de ce tribunal qui, à mon avis, est admirablement géré. Je le dis d'autant plus que je ne vois pas dans la salle les chefs de juridiction, Jean-François Beynel et Danielle Drouy Ayral.
En ce qui concerne les décisions qui sont rendues sur le fond, je ne porterai aucun jugement, bien sûr, mais j'ai vraiment constaté que ce tribunal est très bien administré. J'ai assisté pendant la semaine à deux réunions qui se tiennent périodiquement, qui réunissent tous les acteurs de tribunal, les magistrats concernés, le barreau et le greffier en chef sur l'audiencement, c'est-à-dire le calendrier du tribunal, tant au civil qu'au pénal.
Il est fait état des affaires qui sont prêtes et du temps supposé qu'il faudra à l'audience ; le président et le greffier prennent leur agenda, ils se demandent à quelle date il sera possible d'audiencer les affaires qui restent et, s'il faut des audiences complètes pour des affaires pénales importantes, ils prévoient de fixer des audiences supplémentaires, ce qui ajoute des charges aux magistrats. C'est une très bonne administration. Le bâtonnier ou son représentant sont là et tout le monde y trouve son compte.
C'est un peu du cousu main parce que c'est une petite juridiction, mais je trouve que c'est une très bonne administration et l'avocat, le justiciable et le magistrat savent où ils vont. J'ai assisté à une audience correctionnelle normale et à une autre audience exceptionnelle et j'ai pu constater que le temps d'audiencement prévu par affaire était à peu près respecté, même s'il pouvait y avoir quelques débordements.
Je tenais à apporter un témoignage sur ce point parce que c'est à mon avis une très bonne administration de la justice.
Je pense que cela justifie l'existence de ce qu'on appelle les petites juridictions. Si je suis allé à Castres, dans le Tarn, c'est parce que je me suis dit que c'était l'équivalent de la Haute-Saône, dont j'ai été élu pendant vingt-cinq ans, même si c'était un peu plus peuplé. Le Tarn compte deux TGI (ceux d'Albi et de Castres), de même qu'en Haute-Saône (ceux de Vesoul et de Lure) et je me suis demandé si c'était justifié.
Pour la Haute-Saône, je n'en sais rien parce que je ne suis pas allé en stage, mais je peux vraiment dire que c'est le cas du Tarn. En effet, si on concentrait les audiences dans un seul tribunal, même en ayant recours à des audiences foraines ou à des antennes, je ne pense pas que ce serait administré de la même manière. Nous avons là une juridiction qui est très bien gérée et qui rend bien la mission que l'on attend de la justice.
Voilà très simplement ce que je voulais dire, en remerciant encore très sincèrement tous les magistrats et les greffiers, notamment le greffier en chef, qui m'ont accueilli dans ce tribunal et qui ont pris du temps de m'écouter et de me faire participer à l'audience, comme l'a dit à l'instant Louis Le Pensec, en prévenant les parties ou les avocats, leur demandant s'ils ne voyaient pas d'objection à la présence d'un stagiaire, notamment au cours d'une audience de la juge de la famille, qui était absolument débordée. Je pense d'ailleurs qu'il serait bon de faire un colloque à ce sujet, car il y a là un contentieux qui est exponentiel par rapport à ce que j'avais pu connaître et qui demande des moyens beaucoup plus importants que ceux qui lui sont accordés.
(Applaudissements.)
M. Sylvain ATTAL .- Nous écoutons notre dernier témoignage : celui de Louis de Broissia, sénateur de la Côte d'Or, qui est allé au Tribunal d'instance de Besançon.
M. Louis de BROISSIA .- J'ai été dépaysé dans la Cour d'appel de Besançon. C'était mon deuxième stage d'immersion en justice, le premier ayant eu lieu à Lyon, et il s'est déroulé dans ce climat que mes collègues ont rappelé et qui était particulièrement prégnant pour l'ensemble des magistrats, notamment le jour de février où j'y suis allé la première fois, puisqu'il y avait une assemblée générale spontanée ce jour-là. J'y suis retourné ensuite trois mois plus tard, le 23 mai, et j'ai pu voir une instruction, ce dont je tiens d'ailleurs à remercier le procureur général, le premier président, les procureurs adjoints et les substituts. A cette époque, la médiatisation de l'affaire Outreau était enfin tombée, mais il est vrai que le traumatisme de cette médiatisation il faut le dire par nos collègues de l'Assemblée nationale les avait particulièrement marqué.
Parmi d'autres points, le fait que des sénateurs viennent entendre, écouter et partager la vie d'une chaîne pénale pendant plusieurs jours était pour nous particulièrement intéressant, bien sûr, et je tiens à dire que les magistrats étaient particulièrement ouverts.
J'ai pu participer à la chaîne pénale dans son intégralité, notamment en comparution immédiate. J'ai eu la chance d'avoir les Bonnie and Clyde des hauts plateaux bisontins, j'ai pu suivre des « trafiquants » et j'ai même passé une journée à la maison d'arrêt pour voir la chaîne pénale, la commission de discipline et le débat contradictoire. J'ai pu également entrer dans une cellule pour rencontrer l'un de mes anciens compatriotes dijonnais.
J'ai donc vu la chaîne pénale dans son entier et j'ai été particulièrement frappé de voir des magistrats parfaitement républicains. En effet, même si ce que je dis n'est pas politiquement correct, la justice fait peur à ceux qui ne devraient pas la craindre et elle ne fait pas peur à de très nombreuses personnes. J'ai donc rencontré des magistrats parfaitement républicains qui appliquent sincèrement la loi en disant qu'il y a beaucoup trop de textes, qu'il faut du temps pour les appliquer et qui sont attachés au sens du débat contradictoire par rapport au parquet.
J'ai constaté une différenciation plus marquée et plus importante que je ne le pensais entre le parquet et le siège, et j'ai eu également le sentiment diffus que le parquet se considérait et était considéré comme supérieur à l'instruction. Je le dis très simplement au passage... (Réactions diverses.)
J'ai eu la chance de pouvoir passer aussi une journée avec le doyen des juges d'instruction et les juges d'instruction. L'avocat et la personne mise en examen étant d'accord, j'ai participé à l'audition d'un jeune trafiquant. A cette occasion, j'ai vu que le binôme entre le juge et le greffier ne fonctionnait pas bien. En effet, à la fin de l'audition, parfaitement menée par une juge très efficace et d'ailleurs très impressionnante (je n'aurais pas aimé être en face d'elle) qui déchirait tous les petits papiers sur lesquels elle avait écrit, tout avait disparu sur l'ordinateur de la greffière. Nous avons eu ainsi un petit moment d'émotion et j'ai pu mesurer la grande faiblesse du binôme obligatoire, sur lequel tout le monde insiste, entre le greffier et le juge.
Cela dit, je n'ai pas la même opinion que certains de mes collègues sur la LOLF et les frais de justice. J'ai en effet le sentiment que les frais d'expertise médicale sont payés à des tarifs ridicules. En tant que président de conseil général, il m'arrive de missionner des expertises médicales et je peux vraiment attester que les tarifs sont ridicules. Je le dis très simplement, et que la LOLF ne peut pas faire fi de la comparaison de certains experts médicaux. On m'a dit par exemple très précisément que tel médecin n'effectuait jamais de signalement parce qu'il n'avait pas du tout envie d'être lié à ces frais.
J'ai été très impressionné par l'explosion de l'aide juridictionnelle. La population pénale que j'ai eue en face de moi estimait que la justice faisait partie d'un parcours obligatoire, comme le fait de perdre quelques points sur son permis de conduire, en estimant que c'est provisoire et que l'on peut les récupérer.
J'ai été aussi impressionné par les bonnes notes qui étaient accordées à la loi « Perben II ». A cet égard, l'ensemble de la chaîne pénale nous demande simplement du temps pour que les bonnes pratiques se mettent en place, en précisant qu'il ne suffit pas de faire des lois pour aboutir à de bonnes pratiques, de la jurisprudence, des évaluations et des performances entre magistrats.
Ce deuxième stage m'a donc énormément appris et j'en suis très reconnaissant à ceux qui m'ont reçu sans difficultés et qui se sont mis en quatre sans changer leur mode de travail. Par exception, la Cour d'appel de Besançon est superbe, les bureaux sont magnifiques et le premier président est mieux logé que les sénateurs, ce qui est normal, de même que le procureur général et les juges... (Rires.) Les comparutions se font dans des salles prévues à cet effet et la sécurité est très précise. C'est un palais de justice extrêmement bien fait, très accueillant, avec une très belle architecture. Besançon n'est donc pas Paris.
C'est une justice dont j'ai eu le sentiment qu'elle était plus moderne du fait de l'arrivée des moyens qui manquaient. L'informatique fonctionne, même si la greffière avait perdu son texte. Sachez d'ailleurs que c'est la juge qui a sauvé la greffière, ce qui est très intéressant.
J'ai vu des magistrats jeunes, motivés et totalement à contre-courant de ce qu'on nous décrivait au même moment sur Outreau : des juges du siège ou des substituts qui n'avaient pas la grosse tête.
Je répète enfin que j'ai vu une population asociale de plus en plus nombreuse fréquentant la justice, population pour laquelle ce parcours est de plus en plus banalisé. A la maison d'arrêt de Besançon, il y avait un escroc ordinaire, mais il faisait figure d'homme étrange dans le monde qui défilait devant nous.
Cette justice a quand même une certaine raideur. J'ai vu le centre de semi-liberté de Besançon, qui est remarquable, et j'ai vu la maison d'arrêt. Alors que depuis trois ans, j'ai demandé au ministère de la justice d'ouvrir un centre de semi-liberté et que, en tant que responsable d'une collectivité locale ayant des moyens, y compris d'emprunt, j'ai dit que j'étais prêt à le construire, j'attends toujours que le ministère de la justice daigne me répondre. C'est la raideur de la justice. Je ne sais pas où cette demande est partie. Le ministre auquel j'ai écrit est parti et il faudra que je la relance.
C'est un peu la même raideur que j'ai vécue lorsque, triomphalement, les trois juges et le président du tribunal étaient venus me voir un jour au conseil général que je préside (nous partageons, Roland du Luart et moi, l'accompagnement de l'enfance en danger dans nos fonctions de président de conseil général) pour me dire : « Attention, cela ne va pas marcher parce qu'il faudra attendre un greffier ou une greffière pendant encore un an ». J'ai donc dit que j'allais mettre des moyens administratifs à leur disposition pour que cela puisse au moins avancer, cela a abouti à un grand colloque pendant trois mois sur l'impossibilité de créer des interférences avec la justice.
Il faut donc que cette justice que nous connaissons et qui me paraît extrêmement motivée, performante, républicaine et attachée à régler une société qui est à la dérive, comme nous le constatons de façon très claire, se donne les moyens de coopération, de partenariat et d'ouverture que ces stages indiquent à l'évidence.
(Applaudissements.)
Table ronde : La mise en oeuvre de la LOLF par l'institution judiciaire
M. Sylvain ATTAL .- Sans intermède, parce que nous avons pris déjà beaucoup de retard sur l'horaire prévu pour le démarrage de notre table ronde, j'appelle les participants à venir sur la tribune pour succéder aux témoins sénateurs :
M. Léonard Bernard de la Gâtinais, Directeur des Services judiciaires au Ministère de la justice ;
Mme Chantal Bussière, Présidente du Tribunal de grande instance de Valence ;
M. Pierre Delmas-Goyon, Premier Président de la Cour d'appel de Bastia
M. Frédéric Fèvre, Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Poitiers ;
M. Bernard Legras, Procureur général près la Cour d'appel de Colmar ;
M. Philippe Josse, Directeur du budget au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui est attendu vers 11 h 15.
M. Roland du LUART .- Philippe Josse m'a courtoisement téléphoné hier pour me dire qu'il aurait du retard. Il était au Conseil d'orientation de la fonction publique ce matin et il nous rejoindra vers 11 h 15 car c'est avec lui que les sujets qui nous tiennent à coeur vont être débattus.
M. Sylvain ATTAL .- En quelques mots, je vais resituer le sujet qui nous occupe, même s'il a déjà été abordé par Roland du Luart et plusieurs intervenants de la première partie. Nous parlons donc de la mise en oeuvre de la LOLF dans l'institution judiciaire.
La LOLF est une véritable révolution, comme cela a été suffisamment dit. Elle va permettre une meilleure utilisation de l'argent public, responsabiliser les acteurs et permettre un véritable contrôle par le Parlement, avec l'aide de la Cour des comptes, de l'exécution des lois de finance.
Cependant, sa mise en oeuvre, comme tout le monde en a conscience, va être difficile. C'est en effet un changement ou une révolution copernicienne. Le préalable sera certainement une meilleure maîtrise des frais de justice qui devient impérative, comme l'indique le titre du rapport du Sénateur du Luart, qui est disponible auprès des services du Sénat et qui est consacré justement à cette question.
Des craintes ont été évoquées tout à l'heure. On peut se demander si la mission de la justice, qui est de fournir à n'importe quel citoyen l'exercice serein, rapide et efficace de la justice, ne va pas être entravée par de nouvelles préoccupations qui seraient celles de la maîtrise comptable, comme on en a parlé pour les dépenses de santé, puisque le parallèle a été fait par le Garde des Sceaux entre ces deux domaines. Allons-nous nous retrouver dans une préoccupation voisine ?
Je commencerai par donner la parole à M. Bernard de la Gâtinais sur la question de l'augmentation exponentielle 20 % par an des frais de justice. Le Garde des Sceaux a parlé tout à l'heure au passé en disant que cette augmentation était de 20 %. Cela veut-il dire que nous avons déjà commencé à diminuer l'augmentation ?
M. Léonard BERNARD de la GÂTINAIS .- M. le Garde des Sceaux a eu raison de parler au passé. Cela dit, ce passé n'est pas si éloigné et je voudrais revenir sur la sensibilisation des juridictions et de l'administration centrale sur les frais de justice. Pourquoi une telle sensibilisation ?
Lorsque la LOLF est arrivée, que l'on nous a parlé de globalisation de crédits et que les crédits en question devenaient putatifs, tout le monde a mesuré l'impact qu'aurait, sur le fonctionnement de l'ensemble de l'administration de la justice, la poursuite des augmentations qui atteignaient, bon an mal an, environ 20 %. Les chiffres étaient des plus inquiétants.
Pendant très longtemps, les frais de justice n'étaient pas une véritable difficulté du fait de leur aspect évaluatif. En effet, personne n'avait réalisé que, malgré tout, le ministère de la justice payait et que les budgets en augmentation qui étaient accordés à la justice, notamment au service judiciaire, étaient pour une part largement consommés en administration centrale cela ne se voyait pas dans les juridictions pour les frais de justice.
Il a donc fallu évidemment revenir sur l'ensemble de nos comportements, mais aussi sur les comportements d'un certain nombre de nos prestataires qui, pendant des années, comme l'a très bien dit le Garde des Sceaux, ont trouvé quelque intérêt à notre perception un peu lointaine de la tarification des frais de justice.
La première réaction a consisté, au niveau à la fois de l'administration centrale et des juridictions, à sensibiliser chacun des acteurs, notamment les magistrats, en les rassurant sur le fait que la maîtrise des frais de justice ne signifiait en rien la limitation de leur pouvoir de prescription, le magistrat étant attaché à sa liberté de prescription. Certes, lorsqu'on est dans une recherche de la vérité, celle-ci n'a pas de prix, mais cette recherche doit quand même se mesurer et tout le monde doit être conscient du coût. Après quelques réticences, cette prise de conscience s'est faite très rapidement, chacun ayant bien compris l'enjeu majeur qui y était lié.
Je pense donc que nous avons quelques raisons d'être optimistes et que le Garde des Sceaux a eu raison d'indiquer que nous semblions rentrer dans un cercle vertueux, dans la mesure où la dépense de 2006 sera vraisemblablement en baisse assez significative, même s'il est absolument impossible de la chiffrer aujourd'hui.
Auparavant, nous n'avions pas de véritables outils de mesure sur l'engagement. Nous les avons maintenant. De cette façon, nous saurons et nous verrons sur quelles lignes se fait l'évolution des frais de justice.
En ce qui concerne les crédits de paiement, vous avez indiqué, Monsieur le Président, que vous aviez été frappé par la complexité de la chaîne, que vous aviez constatée à la Cour d'appel de Paris, entre la régie, le SAR, le contrôleur et la trésorerie. Il est certain que cette chaîne est complexe, même si on la comprend tout de suite dès lors qu'on en décrit le schéma, mais elle est alourdie encore par les masses de mémoires de frais de justice qu'il a fallu traiter et auxquelles sont confrontées les régies et les SAR. Ces masses sont arrivées pratiquement en même temps, puisque la mise en oeuvre de la LOLF a entraîné la validation des budgets opérationnels de programme et que ces validations sont intervenues un peu tardivement alors que ce sont elles qui permettaient la délégation des crédits.
Par conséquent, entre la complexité du système et le fait qu'un certain nombre de mémoires s'étaient accumulés, nous avons abouti à un engorgement qui a ralenti le rythme des paiements, contrairement à ce que chacun souhaitait. Le Secrétaire général et moi-même veillons particulièrement à suivre cette ligne de dépenses, sachant qu'il convient qu'à la fin de l'année, les crédits de paiement qui nous ont été alloués sur les frais de justice soient évidemment dépensés. C'est essentiel.
J'ai parlé de la prise de conscience des magistrats et le Garde des Sceaux a parlé tout à l'heure de la mise en place des référents en frais de justice, c'est-à-dire d'une organisation administrative propre aux frais de justice qui s'est mise en place sur l'ensemble de la chaîne, mais il est vrai aussi que le Secrétariat général et la Direction des Services judiciaires sont intervenus pour négocier avec un certain nombre de prestataires de services pour qu'ils revoient leurs tarifs à une mesure plus raisonnable. Les chiffres qui ont été indiqués par le Garde des Sceaux montrent bien cette évolution.
(Arrivée de M. Philippe Josse.)
Je voudrais revenir sur les empreintes génétiques afin qu'il n'y ait pas de confusion. En effet, il y a deux sortes de recherche autour des empreintes génétiques.
D'une part, désormais, le signalement est associé, par le biais des empreintes génétiques, à l'auteur de l'infraction, le prélèvement devant être fait au niveau du commissariat. Nous sommes là dans une procédure d'identification systématique. D'autre part, parallèlement, la recherche de trace ou la comparaison doit être faite dans une démarche de recherche de la vérité. Il est certain que l'on doit comparer ce qui est comparable. Les tarifs ont notablement baissé dans tout ce qui a un caractère systématique, à savoir l'identification des personnes suspectes au niveau de la police judiciaire qui est désormais faite par empreinte génétique.
Concernant la téléphonie, les baisses sont également significatives. Cependant, comme les outils évoluent très vite, il faut poursuivre en permanence cette négociation afin que notre négociation tarifaire s'adapte aussi à l'évolution des technologies. En effet, il est certain que toute technologie neuve nous sera facturée au prix fort. A nous de ne pas nous laisser embarquer sur ces terrains qui pourraient devenir assez vite mouvants.
Voilà ce que je voulais dire, très rapidement, sur la maîtrise des frais de justice, qui est évidemment un enjeu majeur mais qui, dans l'esprit de la LOLF, par rapport à ses enjeux et à ce qu'elle doit être, est peut-être un peu derrière nous. En effet, la LOLF pose aussi d'autres problèmes, notamment en termes de gestion, de localisation des effectifs, de performances et d'indicateurs. La LOLF, c'est aussi cela et j'aurai même envie de dire que c'est avant tout cela.
Cependant, pour pouvoir construire autre chose ensuite, il fallait absolument que nous maîtrisions cet énorme facteur de dépenses qui ont atteint à un moment 500 millions d'euros, ce qui est une somme considérable. Nous sommes arrivés à une baisse notable et je répète que ce problème devrait être derrière nous. Il convient d'accompagner le mouvement, de rester vigilant et de ne pas laisser dériver tout cela, sans quoi rien ne serait possible sur les autres enjeux, mais la LOLF n'est pas que cela.
M. Sylvain ATTAL .- Merci. Je souhaite la bienvenue à M. Philippe Josse, Directeur du budget au Ministère de l'économie et des finances, et je vais lui passer la parole en lui demandant, puisque nous avons commencé à parler de la LOLF et que nous avons posé la problématique de cette révolution, de prendre un exemple précis, à la fois pour tous ceux qui sont ici et aussi tous ceux qui nous écoutent, nos débats étant retransmis.
La LOLF signifie-t-elle, par exemple, qu'un président de tribunal pourra être amené à choisir entre le chauffage du tribunal et une expertise judiciaire dans un dossier d'instruction ? Les choix vont-ils être aussi violents que cela et pourra-t-on aller jusqu'à cette extrémité ?
M. Philippe JOSSE .- Tout dépend de l'intérêt de l'expertise... (Rires, réactions diverses.) De manière générale, dans un contexte où l'argent public n'est pas illimité, il y a toujours des choix à faire, mais je vais y venir en déroulant le fil de mon intervention.
Je pense qu'un certain nombre de choses ont déjà été dites, mais je commencerai par un bref rappel de ce que sont les trois grandes lignes de force de la LOLF. En synthétisant les choses à l'extrême, la LOLF se résume en effet à trois éléments.
Le premier est une plus grande liberté pour les gestionnaires, puisque l'on est passé d'une unité de limitativité des crédits sur plus de 800 chapitres à 130 programmes qui sont beaucoup plus vastes.
Le deuxième, en contrepartie de cette plus grande liberté, est une obligation de rendre des comptes, ce qui passe par deux canaux : d'une part, une profonde rénovation des comptabilités de l'Etat, qui n'étaient certainement pas à la hauteur des masses financières en cause ; d'autre part, la soumission de l'ensemble des ordonnateurs de la dépense à l'obligation de rendre des comptes sur la performance de leur action afin que tout le monde puisse mesurer l'efficacité de l'argent public.
La troisième ligne de force de la LOLF est un accroissement des pouvoirs du Parlement sur presque tous les segments des finances publiques.
En synthèse, nous avons donc des gestionnaires plus libres, mais astreints à un contrôle d'efficacité et d'efficience, le tout sous le regard du Parlement.
Cette réforme n'est pas seulement une série de pétitions de principe. Elle est réellement en marche, même si elle se fait avec plus ou moins de rapidité et de bonheur selon les secteurs : on rencontre toujours des problèmes quand on remet tout à plat.
Pour prendre le seul exemple du contrôle parlementaire sur l'affaire qui nous réunit aujourd'hui et qui est celle des frais de justice, sachez que nous avons eu d'ores et déjà deux rapports d'information de la commission des finances : l'un qui a été commandé à la Cour des comptes et l'autre étant une audition très détaillée et très scrupuleuse de la Commission des finances et de la Commission des lois. Bref, c'est une dépense qui est sous le contrôle et le regard du Parlement, ce qui modifie bien évidemment la perspective de l'ensemble des acteurs du système, et les oblige à rendre des comptes et à agir de manière beaucoup plus volontariste.
Pour aller un peu plus avant dans le sujet du jour et commencer à esquisser une réponse à la question difficile qui m'a été posée, je commencerai par rappeler quelques éléments du contexte budgétaire, puis je vous dirai et je ferai sans aucun doute écho à l'intervention qui vient d'avoir lieu la confiance qui est la mienne dans la capacité des différents acteurs du système judiciaire de faire face à la question des frais de justice et de la maîtriser sans dégrader la qualité de la justice. Enfin, je conclurai par quelques mots sur la question très difficile de la performance appliquée à un secteur comme la justice.
Je commence donc par le contexte budgétaire en vous donnant quelques chiffres.
La mission de justice, dans son périmètre d'aujourd'hui, en neutralisant tous les facteurs de variation qui peuvent être compliqués, a représenté environ 5 milliards d'euros en 2002 et elle en a représenté 6 milliards dans la loi de finances 2006. L'arbitrage du PLF 2007, qui vient d'être rendu par le Premier ministre (il est désormais public et figure dans les documents du débat d'orientation budgétaire), sera de 6,3 milliards d'euros.
Entre 2002 et 2007, cela représente une augmentation de plus d'un quart des moyens de la mission de justice dans un contexte dans lequel la hausse des prix est très faible. C'est donc quasiment une augmentation de pouvoir d'achat à due concurrence.
Cette affaire n'est absolument pas neutre. Dans le contexte de la dette publique que l'on connaît et dans lequel les déficits publics diminuent mais restent fragiles (certes, nous sommes du bon côté du fameux seuil des 3 %, mais seulement à 2,9 %), je tiens à vous dire en tant que technicien de la chose budgétaire que cet effort des pouvoirs publics en faveur de la justice est extrêmement important.
Il suffit de considérer, pour 2007, le taux d'évolution des moyens, qui est d'environ 5 %, là où le budget de l'Etat dans son ensemble augmente seulement de 0,8 %, cette augmentation très faible étant essentiellement destinée à couvrir des dépenses fatales, si je puis dire (évolution de la dette, évolution des pensions des fonctionnaires qui partent en retraite, etc.). Par conséquent, le budget de la justice, avec une augmentation de plus de 5 %, est un secteur qui va pouvoir renforcer ses moyens dans le cadre de dépenses que nous qualifions de discrétionnaires dans notre jargon, par opposition aux dépenses que nous subissons entièrement comme les charges de la dette ou les pensions, et ce point mérite vraiment d'être noté.
Je m'en tiendrai là sur le contexte budgétaire, même si ce rappel méritait d'être fait, pour en venir à la question plus spécifique des frais de justice qui ont trois grandes caractéristiques.
Premièrement, c'est une masse de dépenses d'environ 420 millions d'euros. Cette somme correspond à l'exécution que nous avons pu constater en 2004 et elle a été supérieure en 2005 puisqu'elle a presque atteint alors 500 millions d'euros, mais il s'agissait d'une année atypique, une année de transition d'un système à un autre.
Deuxièmement, c'est une dépense en évolution extrêmement rapide, mais depuis peu. En effet, jusqu'en 2002, la dépense était relativement stable, c'est-à-dire qu'elle n'évoluait que d'environ 2 % par an et ne se singularisait pas au sein de l'ensemble des autres dépenses du budget de l'Etat. C'est à partir de 2003 que nous avons constaté une véritable explosion qui est à mon avis en train de s'achever, essentiellement sous l'incidence de deux paramètres : le recours aux interceptions téléphoniques et les expertises médicales, notamment génétiques.
Troisièmement, c'est une dépense qui était soumise, jusqu'au 1er janvier 2006, au régime dit des crédits évaluatifs, qui consiste, pour le gestionnaire, à ne pas être limité par l'enveloppe de crédits que lui alloue le législateur quand il vote la loi de finances. Cela veut dire clairement qu'il peut dépenser au-delà des crédits prévus et qu'on le constate en loi de règlement. Par conséquent, il n'y a pas de contrainte du vote du législateur.
Voilà ce que je peux dire pour vous brosser à grands traits l'objet dont je parle d'un point de vue budgétaire, d'autres étant infiniment plus compétents que moi pour vous en parler d'un point de vue technique et juridique.
Face à l'objet que je viens de caractériser, nous avons trois questions à nous poser :
Est-il légitime d'avoir basculé d'un régime de crédits évaluatifs à un régime de crédits limitatifs ?
Est-il possible de maîtriser cette dépense ?
Les crédits sont-ils en adéquation avec la dépense ?
Première question : est-il légitime d'avoir basculé d'un régime de crédits évaluatifs à un régime de crédits limitatifs ? Vous imaginez bien que la réponse du Directeur du budget sera positive, mais je pense qu'au fond, cette affaire qui avait fait largement débat au sein de l'institution judiciaire il y a quelques années est maintenant très largement admise.
J'ajouterai simplement deux points pour vous montrer qu'il n'était pas possible, dès lors que nous rénovions notre constitution budgétaire, de conserver ce régime de crédits évaluatifs.
Le premier, c'est que la dépense de frais de justice n'est pas une dépense ordinaire. Les dépenses qui contribuent à la manifestation de la vérité judiciaire ne sont pas banales. Cela dit, d'autres dépenses qui, au sein du budget de l'Etat, sont tout sauf banales sont soumises de longue date au régime des crédits limitatifs. C'est le cas des crédits destinés à faire face aux crises sanitaires, avec tout ce que cela peut entraîner pour la population.
C'est également le cas des crédits des forces de sécurité, qui sont, en quelque sorte, en amont du système judiciaire et sans lesquels il n'est pas possible non plus d'avoir une manifestation de la vérité des libertés judiciaires.
C'est encore le cas des crédits d'investissement routiers. Il fut un temps mais on le voit encore actuellement de façon implicite où, pour le choix des investissements routiers, on faisait valoir ce qu'on appelait « le prix de la vie », c'est-à-dire que, parmi les critères pour choisir ces investissements, on intégrait leur incidence bénéfique en termes de sécurité routière. Par conséquent, dans un univers où les crédits ne sont pas illimités et dans un contexte de ressources rares qui est celui du monde dans lequel nous vivons, il y a un prix de la vie pour les investissements routiers, et ils sont néanmoins soumis au régime des crédits limitatifs.
Voilà quelques exemples qui vous montrent que beaucoup de dépenses sont extrêmement sensibles dans le budget de l'Etat. Les frais de justice en font partie et ils sont très emblématiques, mais il y en a d'autres.
J'en viens au deuxième argument qui me permet de justifier qu'il est tout à logique de transformer les frais de justice en crédits limitatifs dans le cadre de la réforme budgétaire : s'il n'y a pas de crédits limitatifs, l'autorisation parlementaire n'a pas de sens si elle ne contraint à rien et donc n'autorise rien.
Cela m'amène à répondre positivement et de façon certaine à la première question : oui, il est légitime de basculer en crédits limitatifs.
Dès lors que nous sommes en crédits limitatifs, encore faut-il, pour que cela ait un sens, que nous puissions maîtriser la dépense et lui appliquer la démarche de performance et d'efficience. C'est la deuxième question que je pose.
Le Directeur des Services judiciaires a commencé à y répondre et je suis beaucoup moins compétent que les autres orateurs de la tribune pour en parler techniquement, mais je tiens néanmoins à exprimer un message de confiance en rejoignant la conclusion de l'orateur précédent.
Premièrement, cette question a été prise à bras le corps par le Ministère de la justice, c'est-à-dire à la fois par le Secrétaire général, le responsable de programme et le Directeur des Services judiciaires. Un effort a véritablement été fait pour connaître la dépense et identifier les voies et moyens de sa maîtrise.
Deuxièmement, l'outil de mesure est profondément réformé : on ne contrôle bien que ce que l'on mesure exactement. C'est tout le sens de la comptabilité. Le ministère de la justice se dote ainsi d'un outil qui permet de connaître et de tracer la dépense afin de savoir qui l'a ordonnée, en quoi elle consiste et comment elle évolue. Il s'agit donc bien d'un outil de connaissance.
Troisièmement, il est apparu que, dans le domaine des frais de justice, il était possible de faire des économies sans dégrader la qualité du service public, c'est-à-dire, pour moins d'argent, d'avoir la même quantité de prestations fournies, en agissant à la fois sur les volumes et sur les coûts.
Sur les coûts, quatre possibilités d'action apparaissent : la massification, la mise en concurrence, la négociation et la réforme. Je vous en donne quelques exemples.
La massification et la mise en concurrence s'appliquent très bien aux analyses génétiques. On a constaté ainsi que, pour les prélèvements destinés à alimenter le fichier des empreintes génétiques, un prélèvement d'empreinte qui, au départ, coûtait 300 euros l'unité, était passé à moins de 80 euros, et nous avons conduit un audit de modernisation qui démontre que l'on peut arriver à 60 euros, tout simplement par la mise en concurrence des laboratoires et la globalisation des commandes qui leur sont faites.
Sur la négociation, le point a déjà été évoqué : c'est toute l'affaire des écoutes téléphoniques pour lesquelles des baisses de tarif de 40 % ont pu être obtenues de certains opérateurs. D'autres le contestent et les juridictions diront ce qu'il en est, mais c'est en tout cas une action qui apparaît possible aujourd'hui.
Il reste la possibilité d'action qui passe par la réforme. Par exemple, toujours en ce qui concerne les écoutes téléphoniques, jusqu'à présent, lorsqu'il y a prescription d'une interception téléphonique, il n'y a qu'une facture pour une écoute qui est adressée à chaque magistrat ordonnateur de l'écoute. Autant dire que cela coûte et que c'est facturé à l'institution judiciaire. Il semble possible de passer à la facturation détaillée qui consiste, à l'image de nos factures téléphoniques ordinaires, à avoir sur un seul relevé l'identification des différentes interceptions qui ont été effectuées. Je sais que le ministère de la justice y travaille et qu'un jour où l'autre, nous y arriverons. Voilà encore un exemple de facteur de minoration des dépenses.
Il est donc possible d'agir sur les coûts sans diminuer la qualité du service public.
On peut également agir sur les volumes. Les expériences qui ont été conduites en 2005 sur l'introduction de la LOLF ont montré ainsi qu'il y avait une diminution des volumes prescrits sans que les magistrats qui ont participé à ces expériences aient eu l'impression de dégrader la qualité du service public de la justice.
J'en viens à la dernière question concernant les frais de justice : les crédits sont-ils au rendez-vous ? En effet, il est bon de pouvoir agir sur la dépense, de la maîtriser et de la faire baisser, mais si l'adéquation est trop grande entre cette dépense, même maîtrisée, et les moyens qu'alloue la loi de finances, il y a un risque de déport sur d'autres aspects du financement du service public de la justice.
A ce point de vue, il y a eu ce que nous appelons, dans notre jargon, un effort de « rebasage » assez continuel : en 2006, nous en sommes à 370 millions d'euros inscrits au budget avec, en plus, l'assurance qu'a donnée le gouvernement de débloquer 50 millions d'euros supplémentaires si jamais cela ne suffisait pas, soit 420 millions d'euros en tout, et ces 50 millions d'assurance devraient être consolidés en 2007.
Après l'année atypique qu'a été 2005, pendant laquelle le changement de régime a conduit les gestionnaires, de manière tout à fait légitime, à apurer les factures, nous avons, dans le PLF 2007, un montant de crédits qui équilibrent la dépense de frais de justice lors de la dernière année normale d'exécution sous le régime des crédits évaluatifs, et ce avant la prise en compte de toutes les réformes dont je parlais et qui peuvent diminuer les coûts.
Je résumerai cette question des frais de justice en vous disant qu'à mon avis, comme cela a été dit, cette affaire est un peu derrière nous, même si cela s'est fait au prix des efforts de l'ensemble des acteurs du système.
Pour conclure, j'évoquerai en un mot la démarche de performance, plus globalement, au Ministère de la justice. J'espère avoir démontré qu'il était légitime d'appliquer cette démarche de performance à la question spécifique des frais de justice. Je vous rappelle que l'indicateur de performance retenu dans le projet annuel de performance de la justice est un indicateur qui rapporte la dépense de frais de justice au nombre total d'affaires et qu'il s'intitule donc « dépenses moyennes de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale », l'idée étant que cet indicateur n'a pas vocation à augmenter de manière illimitée et qu'au contraire, il peut même baisser s'il a une bonne maîtrise de cette dépense avec tous les leviers que j'ai indiqués tout à l'heure.
De manière plus générale, nous avons trois catégories d'indicateurs dans les budgets que vote actuellement le Parlement.
Les premiers sont des indicateurs d'efficience, qui répondent à la question de savoir si on gère avec une économie de moyens, ce qui est typiquement l'hypothèse de cet indicateur sur les frais de justice.
Les deuxièmes sont des indicateurs de qualité de service, qui servent à vérifier si nous apportons des prestations de bonne qualité aux citoyens.
Les troisièmes sont ceux que, dans notre jargon, nous appelons « indicateurs d'efficacité socio-économique », qui consistent à se demander si nos politiques publiques répondent aux objectifs que nous leur assignons.
Dans ces trois séries d'indicateurs, la justice est surtout concernée par les indicateurs d'efficience et par les indicateurs de qualité de service. Quand on examine les indicateurs du programme de justice judiciaire, on constate que beaucoup de choses tournent autour de l'idée de rendre une justice de qualité dans des délais raisonnables. C'est le principal objectif qui est assigné au service public de la justice.
Evidemment, les délais se mesurent de manière très scientifique, de même que les coûts, comme nous venons d'en parler abondamment, mais il est vrai que la qualité se mesure beaucoup plus difficilement. Cela dit, si la LOLF peut beaucoup (je pense très profondément que cet outil va nous permettre d'améliorer le service public que nous rendons aux Français), elle ne peut pas tout. Elle ne peut pas empêcher l'erreur judiciaire, par exemple. Il n'empêche que, lorsqu'on gère avec efficience, on a en fait, à même effort demandé au contribuable, plus de moyens et donc probablement la possibilité de rendre une justice plus sereine.
Pour terminer, je tiens à donner deux exemples de réformes possibles, sans savoir si elles sont opportunes. De toute façon, ce n'est pas à moi de le dire puisque ce sont des affaires dont la mise en oeuvre relève du Ministère de la justice et du législateur.
Le premier est la visioconférence. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, et ce n'est pas moi qui suis qualifié pour le dire, mais, si elle était développée, comme un audit nous le montre, cela permettrait d'économiser 2 000 emplois dans les forces de sécurité qui sont actuellement affectées à la surveillance des transfèrements. Voilà un exemple de réforme structurelle qui peut permettre, si cela apparaît opportun, de faire mieux avec moins de moyens.
Le deuxième a été observé à Singapour récemment et ce serait un moyen d'améliorer la qualité de service. Dans les instances judiciaires ordinaires, notamment les divorces, lorsqu'on est convoqué, on peut attendre toute la journée avant de passer. Je ne l'ai pas expérimenté car je n'ai pas eu la malchance de divorcer, mais j'ai lu qu'à Singapour, il existait un système de convocation par SMS, une demi-heure avant, des personnes intéressées par une affaire. Cela leur permet de ne pas perdre leur journée de travail et d'arriver seulement une demi-heure avant et non pas plusieurs heures à l'avance... (Réactions diverses.)
Ce sont deux exemples de gestion par la performance et la qualité de service qui peuvent être intéressants. Je souhaitais vous les livrer à titre anecdotique pour conclure mes propos.
M. Sylvain ATTAL .- Merci d'avoir été concret. Je donne la parole à Roland du Luart qui souhaite réagir à vos propos, et je la passerai ensuite aux magistrats qui sont à cette tribune.
M. Roland du LUART .- Je tiens à remercier Philippe Josse de son intervention et de la précision de ses propos, ainsi que M. de la Gâtinais qui est intervenu juste avant lui.
Vous m'excuserez d'être encore le vilain petit canard qui reste dubitatif. Il est vrai que les magistrats ont pris conscience d'une culture de gestion à 99 % et que nous allons vers une meilleure maîtrise des frais de justice, comme vous l'avez tous démontré, mais il ne faut quand même pas oublier les arriérés : nous traînons un passif très important dans le domaine des frais d'expertise.
L'année 2006 est une année charnière, mais je ne suis pas sûr que nous réussissions pour autant à gommer tous les arriérés. Je voudrais donc dire au Directeur du budget, qui a le mérite exceptionnel d'avoir été un ancien haut fonctionnaire du Sénat nous nous connaissons donc depuis longtemps , que je suis personnellement très gêné par un problème de blocage des paiements, notamment au niveau des SAR, entre les régies, le contrôleur, etc. Sur ce point, Monsieur le Directeur, je vous demande instamment de faire en sorte qu'entre le Ministère de la justice et vos services, nous puissions supprimer un contrôle pour simplifier les choses. Les fonctionnaires chargés des règlements disent qu'ils ne peuvent pas passer outre un contrôle car ils sont responsables, notamment pécuniairement. Nous sommes donc dans une situation de blocage et, aujourd'hui, nous sommes en sous-consommation des frais de justice.
Comme tout le monde l'a dit, la mise en concurrence des opérateurs téléphoniques et des laboratoires va dans le bon sens, mais il faut absolument arriver à gommer l'arriéré (comme cette donnée m'a été remontée à plusieurs reprises, je ne suis pas sûr que certaines juridictions connaissent la totalité de leurs arriérés) et, en même temps, faire tout ce qui est possible pour accélérer les paiements.
Enfin, en profitant de votre présence précieuse, monsieur Josse, je tiens à vous poser une question. Je vous rappelle que la LOLF a induit des transferts de compétences et que les juridictions ont aujourd'hui la compétence de l'ordonnancement secondaire de leurs dépenses alors que cela relevait autrefois des préfectures. Il m'est remonté de façon certaine que cela correspond à 200 équivalents temps plein. J'estime donc que ces 200 équivalents temps plein du Ministère de l'intérieur, pour un coût nul, pourraient être transférés au Ministère de la justice pour rendre les SAR plus opérationnels. Cela ne coûterait pas un sou de plus et, en tant que responsable de la Commission des finances, je veille au grain sur ce point.
Je pense que ce serait très important, car ces fonctionnaires très respectables que nous avons dans les départements je vous le dis en tant que président de conseil général n'ont plus grand-chose à faire et viennent donc faire des contrôles tatillons sur ce que font les présidents de conseils généraux... (Rires.) Vous trouverez peut-être cela positif, mais je pense que cela revient à perdre son temps. Lorsqu'on n'a plus les fonctions pour lesquelles on est affecté, on doit trouver quelque chose à faire. C'est ainsi que nous sommes contrôlés par la juridiction administrative alors que nous n'avons pas besoin d'un double contrôle en plus du contrôle tatillon des préfectures. C'est une demande qui remonte de l'ensemble des présidents de conseils généraux depuis que ces 200 équivalents temps plein ne sont pas utilisés comme il était prévu qu'ils le soient.
Je n'en dis pas plus, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire.
M. Léonard BERNARD de la GÂTINAIS .- Il est vrai que les services administratifs régionaux, sous l'autorité des chefs de cour, ont fait des efforts absolument considérables pour essayer de tenir dans l'élaboration des budgets opérationnels de programme et dans tout ce qui leur est demandé en matière de frais de justice et de traitement de ces mémoires. Par conséquent, si quelques signes pouvaient leur être donnés quant à la réalité de la transformation de l'Etat et s'ils pouvaient se dire que ce qui profite à l'un peut revenir à celui qui en a ensuite la charge, cela pourrait constituer un signe fort et avoir sans doute une audience un peu plus large.
M. Sylvain ATTAL .- Vous avez parlé des chefs de cour. Nous allons entendre tout de suite M. Delmas-Goyon qui, je le rappelle, est Premier Président de la Cour d'appel de Bastia.
M. Pierre DELMAS-GOYON .- Avant de vous faire part des réflexions que m'inspirent les riches débats de ce matin, je tiens à remercier le Sénat de prendre l'initiative de ces rencontres et de faire l'effort d'aller voir, sur le terrain même, la réalité de l'institution judiciaire. Cet effort, pour nous, n'a pas de prix (si vous me permettez d'utiliser cette formule dans un débat consacré pourtant à la maîtrise des coûts) alors que nous sommes touchés de plein fouet, précisément, par le fait que nous sommes entrés dans une société de l'émotion. En effet, on ne peut qu'être ému face à des événements qui se produisent et nous savons que l'émotion est contingente : elle peut aller dans un sens ou dans un autre.
Par conséquent, si certains des sénateurs ont pu exprimer le traumatisme qu'ils ont ressenti lorsqu'ils sont arrivés, dans une période troublée, dans les juridictions dans lesquelles ils se sont rendus, peut-être y a-t-il là, précisément, un signe important. En effet, mesurer notre efficacité, pour répondre aux attentes, quand on se situe sur le registre de l'émotion, est un séisme culturel majeur pour nous, car la justice se situe dans l'ordre du rationnel, et non pas dans celui de l'émotif, et elle s'est construite là-dessus.
Certes, tout peut évoluer et nous n'avons pas la prétention d'être les gardiens du temple dans ce domaine, mais il est certain que nous ne pouvons pas nous adapter à des attentes aussi contraires à nos constructions sans qu'il en résulte quelque désarroi pour les acteurs qui s'y trouvent.
Nous comprenons fort bien que, sur le long terme, nous sommes sommés de nous adapter aux efforts qui sont faits pour comprendre ce qui fait le noeud de notre action, mais si, en revanche, on évite de nous demander de sombrer dans une chose qui nous fait perdre des repères utiles à tous, c'est une initiative à laquelle nous sommes tous heureux de participer. Vous aurez d'ailleurs tous pu remarquer que l'institution judiciaire a répondu pleinement au désir de renseigner les gens qui viennent en son sein.
Il est vrai que l'on peut être optimiste et vous verrez que mon propos est dans la même ligne lorsque l'on constate la manière dont la LOLF s'est adaptée aux problèmes spécifiques des frais de justice. Certes, la maîtrise des coûts reste à faire, et je partage l'inquiétude du Président du Luart sur la capacité, avec le budget actuel, de faire face à la totalité des besoins en année pleine. Le problème que pose la possibilité de dépenser les crédits est une autre affaire, mais la capacité de répondre aux besoins en année pleine avec la dotation est évidemment un problème que nous n'avons pas résolu.
La réalité de la complexité vient du circuit de la dépense, qui n'est pas simple, et qui est non seulement induit par la LOLF proprement dite, mais aussi par les réformes successives du code des marchés publics qui imposent des modalités de contrôle de l'engagement de la dépense par les nouveaux ordonnateurs secondaires que nous sommes, sachant qu'en plus, nous serons étudiés dans notre capacité de faire face à nos nouvelles responsabilités. A cet égard, nous est-il possible, par souci d'efficacité, de simplifier le circuit de la dépense au point de courir après le risque de déléguer, dans des conditions qui ne seraient pas correctes, les signatures d'un ordonnateur secondaire ? Il ne me paraît pas inutile de poser la question.
Cela étant dit, je rejoins un problème sur lequel je souhaite revenir en dernier lieu : celui que nous pose la compatibilité de l'architecture de la LOLF, qui est fondée sur l'existence de responsables de budgets opérationnels de programme, avec une architecture judiciaire, qui est fondée sur un émiettement de juridictions, celles-ci étant fondées sur la réalité de l'institution judiciaire :
· juridictions du premier degré indépendantes dans leur fonctionnement et leurs prises de décisions ;
· échelon de la cour d'appel, celui de la juridiction d'appel, qui se doit maintenant, pour M. le Directeur du budget, être le seul organe qui compte dans la déconcentration, car on ne peut évidemment pas descendre en dessous de ce niveau qui est celui de l'ordonnateur.
Pour nous, c'est un problème majeur. En effet, comment concilier cette réalité avec la nécessité de promouvoir le dynamisme des juridictions du premier degré ? Il ne faut pas oublier que 80 % des affaires se règlent à ce niveau, qu'elles constituent la majeure partie du lien avec le justiciable, et que la prise en charge se fait à ce niveau. Il est très difficile, pour nous, de donner le sentiment d'approuver un système dans lequel la cour d'appel, échelon de gestion, devient le seul organe qui compte, sans quoi on risque d'avoir une démobilisation des juridictions du premier degré, ce qui posera un problème institutionnel majeur.
C'est un enjeu à long terme qui n'est pas du tout résolu, et qui va nous amener très probablement à travailler de manière progressive à un enjeu qui, pour nous, est extrêmement important dans ce domaine : celui de l'impossible réforme de la carte judiciaire. A cet égard, je ne partage pas l'enthousiasme dont nous a fait part tout à l'heure le sénateur Michel pour les petites juridictions. Je ne conteste pas que l'on puisse y rendre une justice de qualité parce qu'on est proche des décisions à prendre en matière de partenariat avec les partenaires les plus simples, mais on n'y arrive très souvent qu'au prix d'une surdotation de moyens de ces juridictions par rapport à d'autres qui, elles, ne peuvent pas se mettre au même niveau d'exigence.
Lorsque, dans des petits départements, les tribunaux de grande instance n'ont presque tous qu'une chambre, comment examine-t-on les réformes de la justice sur la collégialité de l'instruction ? Certes, on peut procéder à des délocalisations, mais n'est-ce pas aussi une réforme de la carte judiciaire qui ne dit pas son nom, au prix de contorsions qui ont leur coût en termes d'organisation ? Il ne sera pas très simple de demander à un avocat, au moment où on présente quelqu'un, de se déplacer dans un autre tribunal et de demander une escorte.
On parlait des forces de l'ordre : voilà ce qui va simplifier grandement les choses. On ne transportera tout de même pas la personne déférée par voie de visioconférence. Je crains que quelques véhicules soient encore nécessaires, de même que ceux qui les accompagnent, bien sûr.
Bref, j'ai le sentiment que nous sommes placés à long terme devant un défi majeur. Je ne dirai pas que c'est « de la faute de la LOLF ». Au contraire, je conçois fort bien que nous soyons amenés à nous engager dans cette démarche, mais je pense que nous aurons une réactivité de notre institution qui sera beaucoup moins favorable que celle que nous avons constatée dans la mise en oeuvre du dispositif sur les frais de justice.
On peut dire que la mise en oeuvre de la maîtrise des frais de justice n'est pas acquise mais que le dispositif, lui, est en place. On sait maintenant ce qu'il faut faire, l'architecture est là et l'institution est réactive. Je suis heureux que, pour une fois, l'institution judiciaire ait pu fournir la preuve de sa réactivité, parce que, je le sais, nous donnons toujours le sentiment que le juriste, et le magistrat en particulier, est le gardien d'une certaine manière de procéder et qu'il générerait une certaine pesanteur. Quelle erreur ! Au rythme où évoluent les lois, sachez que nous sommes d'une réactivité exceptionnelle !
Il suffit de penser à la procédure pénale, dont vous connaissez le rythme de réformes. Comment voulez-vous que nous ne soyons pas capables de nous adapter ? Il faut bien le dire : c'est la révolution permanente. Or nous pouvons le faire sur ce plan.
J'ajoute, pour dédouaner les parlementaires, que la procédure civile qui, comme nous le savons tous, est du domaine réglementaire, est en voie de suivre le même cheminement et que les réformes se succèdent à une vitesse accélérée, ce qui pose certainement des problèmes d'interprétation au moins égaux à ceux que nous pourrions trouver dans le cadre d'un débat parlementaire dans lequel la réflexion aurait pu ne pas être suffisante avant que le texte soit définitivement adopté.
Bref, notre réactivité existe, mais encore faut-il que nous soyons dans un contexte qui ne bouleverse pas notre efficacité. Nous avons effectivement des principes d'efficacité, de même que le Sénat, qui a nécessairement une manière de procéder. Les frais de justice ne nous ont pas pris à contre-pied et, à organisation constante, nous avons pu nous adapter.
Pour cela, il fallait un préalable : la garantie de la liberté de prescription du magistrat, pour employer un terme plus médical que juridique que nous comprenons tous et qui a été déjà employé ce matin. Autrement dit, il fallait s'abstenir de poser la question que vous avez posée : « Faut-il faire le choix entre le chauffage du tribunal et le financement d'une expertise ? » Si on fait cela, c'est terminé.
Or on a justement dit le contraire. Très vite, le Secrétariat général a rappelé, comme l'a dit M. le Directeur également, qu'il n'y avait pas d'ambiguïté : la liberté du magistrat prescripteur est entière. C'est au travers de cette garantie, qui a été précisée très rapidement, que nous avons pu éviter les interférences et le refus de certains d'entrer dans un système dont ils ont le sentiment qu'il va les priver de l'indépendance qui, indiscutablement, est une vertu cardinale de l'institution judiciaire. C'est ainsi que le processus a pu se mettre en route.
Les juges d'instruction ne sont jamais les derniers, loin de là, à signaler les difficultés qu'ils ont dans ce domaine, et à mettre leur pratique en commun, parce que tout cela est en ordre et que nous sommes en effet dans un dispositif dans lequel, loyalement, et peut-être efficacement, même s'il est trop tôt pour le dire, nous pouvons conserver l'espoir que l'institution se montre efficace dans ce registre.
Donnons-lui un peu de temps et ne soyons pas trop pressés de mesurer les résultats de 2006. En effet, si nous avons un taux de consommation des crédits qui est encore faible, nous savons que cela est dû à la difficulté de la mise en place de la dualité budgétaire dans ce domaine et à un retard de paiement qui fait que nous avons probablement, si nous ne voulons pas avoir une sous-consommation de crédits, du pain sur la planche.
Au titre des réflexions qui me venaient sur les enjeux, je vous ai dit qu'à court terme, nous avions le problème de la maîtrise des coûts et celui des frais de justice. A long terme, nous avons celui de l'architecture judiciaire, qui est à mon avis un problème majeur, et je pense que les chefs de juridiction du premier degré pourront nous dire, s'ils partagent mon souci, qu'ils se trouvent maintenant dans une situation parfois inconfortable dans cette mise en oeuvre.
Il reste le problème que je qualifierai de médian entre le court terme et le long terme, qui a été abordé par M. le Directeur du budget et qui a trait à la mesure de la performance et à la capacité, dans ce domaine, de nous doter des outils nécessaires.
Il serait caricatural de dire que la LOLF ne peut pas tenir compte de nos spécificités ou de la complexité de l'acte de juger. La LOLF n'a pas cet inconvénient majeur. Elle est simplement le reflet d'une approche gestionnaire. Dans une telle approche, on se préoccupe de ce que l'on mesure et ce que l'on ne mesure pas n'existe pas. Du moins, c'est ce que j'ai compris.
Si nous admettons qu'il faut mesurer pour que cela existe, il faudra, pour mesurer la performance, que nous mesurions deux choses que nous ne savons pas mesurer actuellement : la qualité du jugement prise au sens large (il s'agit ici de la décision judiciaire) et la charge de travail. Lorsque nous saurons mesurer la qualité de ces deux éléments, nous pourrons réellement nous engager dans un discours sur l'offre efficiente, puisque nous aurons vérifié quelle qualité nous obtenons.
Pour l'instant, nous ne savons pas mesurer la qualité du jugement. Peut-on considérer que la durée au terme de laquelle le jugement est obtenu est un indice de qualité ? On sait que le public trouve toujours que la justice est trop lente et souhaiterait qu'elle s'accélère. Je veux bien admettre que, pour le public, le fait de rendre un jugement plus vite serait le signe d'une meilleure qualité de la justice, mais, pour nous, la réduction des délais n'est pas un indicateur de qualité. En effet, il est facile de comprendre que, si nous avons mille affaires en stocks ou seulement cent, il suffit que le nombre diminue pour que le rythme du jugement s'accélère. Par conséquent, c'est beaucoup plus un indicateur quantitatif.
Je pourrai également citer les critères que l'on nous a donnés et que nous voyons apparaître à l'heure actuelle, notamment le taux de rectification des erreurs matérielles. Je vous citerai un exemple sans être du tout polémique : si un avocat vient au greffe de la juridiction pour dire que nous avons oublié, sur le chapeau du jugement, c'est-à-dire cette partie qui sort de manière informatique, de dire qu'il avait l'aide juridictionnelle (AJ) et que, de ce fait, il ne va pas pouvoir se faire payer ses frais d'AJ, la rectification va intervenir, bien entendu, mais par rapport à la construction que représente le jugement, la qualité d'écoute qui l'a précédé et le mûrissement de la décision, nous sommes dans un élément qui ne mesure pas grand-chose.
De même, le taux d'appel lui-même n'est pas un indicateur très pertinent. Certes, c'est un indicateur et il a ses vertus : si on constate une multiplication très importante du taux d'appels, ce sera naturellement un indicateur d'alerte, mais nous savons qu'en matière civile, l'appel est une loi d'achèvement en même temps qu'une loi de réformation, car les choses évoluent, et on voit donc apparaître des appels de jugement qui, en soi, ne méritent pas la critique. On constate aussi des jugements confirmés, alors qu'ils n'emportaient pas l'approbation totale et sans réserve des professionnels qui les ont examinés.
En matière pénale, nous savons tous que, lorsque quelqu'un fait appel, c'est parfois moins en fonction de l'idée qu'il a de la décision rendue que de l'appréciation que lui donne son avocat sur la jurisprudence de la chambre des appels correctionnels, ou de la chambre de l'instruction. Cela veut dire qu'en définitive, c'est le résultat escompté devant la cour qui risque de créer l'appel, plus que la décision de première instance elle-même.
Nous sommes donc dans des éléments, dont je ne dis pas qu'ils n'ont aucune valeur indicative ni qu'ils ne peuvent pas aider, mais qui ne sont pas en eux-mêmes des instruments de mesure. Nous ne connaissons pas encore cette qualité du jugement et nous ne savons pas encore vraiment la mesurer. Il faut admettre qu'il s'agit d'une chose très difficile et même redoutable. Je ne sais pas ce qu'en pense le Directeur des Services judiciaires, mais l'administration centrale doit éprouver une certaine prudence tout à fait légitime ce n'est pas une critique de ma part face à la décision de donner l'impulsion sur des critères de ce genre, sachant que tout peut être très polémique.
Le jugement lui-même procédant d'une recherche d'équilibre dans un débat contradictoire, il est extrêmement compliqué d'essayer de mesurer cet élément.
Nous payons peut-être je me permets de faire une critique de la LOLF dans ce domaine - le fait qu'elle procède d'une loi que les acteurs doivent maintenant s'approprier alors que, dans d'autres pays européens qui ont suivi la même voie, on a commencé par des expérimentations plus longues. On a travaillé à partir de réflexions de terrain sur ces indicateurs, puis les gens se les sont appropriés et y ont alors adhéré. Ensuite, il a été plus simple de parvenir à ce résultat. Je pense que nous n'arriverons pas à définir des indicateurs de la qualité du jugement s'il n'y a pas, sur le terrain, la possibilité de s'approprier ces éléments.
Il reste la charge de travail. Il est très difficile de mesurer la performance sans mesurer la charge de travail, mais mesurer la charge de travail n'est pas simple. Nous avons tous en mémoire un travail datant de quelques années qui avait été effectué par l'Ecole des Mines à ce sujet et qui consistait en une étude extrêmement fouillée, mais aussi très compliquée et très dévastatrice. En effet, j'ai tendance à penser que les évolutions du budget de la justice que vous nous avez retracées, Monsieur le Directeur du budget, étaient alors extrêmement modestes par rapport à ce qu'il aurait fallu pour entrer dans l'enveloppe. Peut-être fallait-il être plus pragmatique.
En ce sens, je me souviens d'avoir participé à un groupe de travail mené par l'Inspection générale des services judiciaires (les responsables de ce travail sont dans cette salle et je les salue volontiers au passage), qui avait pour but de vérifier si nous pouvions avoir une méthodologie de recherche très empirique, qui ne serait pas une construction intellectuelle abstraite, sur la mesure de la charge de travail. La démarche me paraissait assez bonne, puisqu'elle avait consisté à prendre une décision judiciaire et à essayer, sans se fonder sur une analyse intrinsèque de la décision, de voir ce que représentait la charge de travail des autres décisions judiciaires, selon l'appréciation des professionnels.
La norme peut être le jugement civil. On peut ainsi se demander ce que représente le jugement de droit de la famille ou le jugement pénal, par exemple, par rapport à un jugement civil. On peut ainsi décliner beaucoup de choses, et ce n'est pas une mesure abstraite. Ce serait simplement une sorte de consensus sur ce que représenteraient, par rapport au jugement civil auquel on attribuerait un coefficient 1, les autres actes de la vie judiciaire.
Cela ne nous mène peut-être pas très loin sur le plan des concepts, mais cela pourrait nous permettre d'avoir un outil de mesure à la fois pragmatique et utile, pour mesurer ce qui nous reste à mesurer.
Ainsi donc, je pense que, sur le problème de la maîtrise des coûts, nous n'aurons pas de difficultés d'adaptation de l'institution judiciaire, même s'il nous faudra du temps pour que l'efficacité soit réelle. Il a été dit que les premiers effets se faisaient déjà sentir et je pense que c'est exact.
Par ailleurs, il nous restera, dans un domaine qui n'est pas pour l'instant suffisamment mis en oeuvre, à mesurer les éléments de la performance.
Enfin, dans un troisième temps, sur le long terme, il faudra sans plus attendre s'assurer que l'architecture de la LOLF et celle de la justice soient davantage compatibles.
M. Sylvain ATTAL .- Merci. Je passe la parole à Bernard Legras, Procureur général près la Cour d'appel de Colmar, ce qui nous permettra de poursuivre sur l'aspect de la LOLF vue par un chef de cour.
M. Bernard LEGRAS .- Merci, Monsieur le Président, et merci au Sénat de donner la parole aujourd'hui aux magistrats de terrain. Je commencerai par un aveu en disant que je suis un fervent partisan, voire un militant, de la LOLF, ce qui provoque souvent, de la part de certains de mes collègues, des formes de prise à partie. En effet, je pense que la LOLF est d'abord un exceptionnel outil de transparence car elle permet de bien définir les responsabilités de chacun et de repositionner chacun sur son terrain de responsabilité.
Pour en revenir aux frais de justice, j'évoquerai les débuts de la réflexion. Lorsque nous avons ouvert ce dossier, il y a maintenant trois ans, j'ai participé à un certain nombre de groupes de travail au niveau national et nos interlocuteurs, en particulier ceux du budget, nous renvoyaient en permanence une idée reçue : les frais de justice, c'était la danseuse de la justice, l'irresponsabilité au pouvoir au Ministère de la justice, la gabegie !
J'ai lu avec beaucoup de plaisir l'analyse que M. le Sénateur du Luart a indiquée dans son rapport. Il cite en effet sans ambiguïté plusieurs causes à l'augmentation des frais de justice depuis un certain nombre d'années.
La principale est liée à une demande de plus en plus forte du corps social, relayée par les décideurs publics, et un besoin accru de justice. Parmi les objectifs que nous évoquions, il y a aujourd'hui, pour certains groupes, 80 % de taux de poursuite dans les parquets. Alors que, il y a quelques années encore, les procureurs utilisaient le classement sans suite, c'est-à-dire le pouvoir d'opportunité des poursuites, comme un moyen de gérer les contentieux, il faut aujourd'hui atteindre le taux de poursuite maximum et, naturellement, cela coûte cher.
Nous pouvons évoquer rapidement j'en parle parce que je suis confronté à ce problème actuellement , la montée en puissance sur le terrain judiciaire des victimes et de leurs associations, qui sont de plus en plus exigeantes avec cette nouvelle notion de procès exceptionnel. Désormais, pour des affaires sortant relativement de l'ordinaire, il faut l'admettre, il faut organiser des procès exceptionnels qui ont des coûts massifs là où, il y a encore quelques années, nous aurions jugé avec nos moyens. Mais ce qui est encore possible ou satisfaisant au quotidien pour les magistrats et les fonctionnaires, comme cela a été évoqué par les sénateurs revenant d'immersion, ne saurait être montré aux victimes et aux médias. D'où ces procès exceptionnels à répétition. Il faudra, à ce niveau également, définir une doctrine d'emploi : on ne peut pas continuer de cette manière car ces projets exceptionnels sont budgétivores.
J'évoquerai aussi avec prudence mais l'autocritique est intervenue dès ce matin la multiplication des lois budgétivores, sans étude d'impact réelle.
Enfin, M. le Sénateur, dans son rapport, évoque la cause qui était considérée à l'origine comme la seule : l'irresponsabilité des prescripteurs ou, plutôt, leur non-responsabilisation.
Dans le cadre des analyses que nous avons faites au cours de l'année d'expérimentation que nous avons connue dans la Cour d'appel de Colmar que j'ai l'honneur de codiriger avec le Premier Président ici présent, nous avons fait un gros travail en matière de responsabilisation des différents acteurs et prescripteurs, chacun oeuvrant dans le cadre de ses responsabilités : le Premier Président en direction des juges d'instruction et des magistrats du siège, le Procureur général en direction des services de police et de gendarmerie et des magistrats du parquet. Cette oeuvre était peut-être plus facile pour le ministère public que pour le siège, mais, globalement, la réponse a été excellente à Colmar.
Parmi ces causes sur fond d'irresponsabilité, nous avons dégagé principalement des tarifs aberrants de la part d'un certain nombre de fournisseurs. Comme les magistrats de terrain prescripteurs étaient en situation d'infériorité face à ces fournisseurs, il a fallu, dans le cadre de la bonne définition des responsabilités, que l'administration centrale monte au créneau sur cette question. C'est donc tout naturellement le ministère qui a engagé une action extrêmement volontariste sur ce terrain des frais de justice en matière de téléphonie et de génétique, et les résultats obtenus ont été très rapides. En effet, pour les analyses génétiques les plus simples, nous sommes passés dans notre cour de 160 à moins de 85 euros, ce qui veut dire que, sur une simple ouverture de dialogue, nous avons diminué de moitié le coût de chacune de ces expertises.
Il y avait aussi une vraie irresponsabilité, dans la mesure où nous étions sur crédits évaluatifs, les prescripteurs estimant qu'ils avaient, en quelque sorte, un droit de tirage et que cela ne leur coûtait rien. Les fonctionnaires de police et les gendarmes avaient tendance à faire tourner les écoutes téléphoniques pendant des mois et des mois (en se disant « on ne sait jamais, au cas où... »). On voyait également des modes se développer, en particulier en matière de génétique : on avait tendance à faire des prélèvements tous azimuts pour des affaires qui, objectivement, n'en valaient peut-être pas la peine.
On voyait aussi cela a été l'un des points essentiels sur lesquels nous avons travaillé un transfert sur frais de justice de charges de fonctionnement d'autres administrations. Les frais de justice étaient un peu la vache à lait, et les services de police et de gendarmerie avaient tendance à faire passer sur frais de justice, des frais de fonctionnement de leurs administrations. Je ne citerai pas ici un certain nombre de cas particulièrement éloquents, mais nous avons fait un énorme travail à ce niveau. Le message que nous avons fait passer, chacun à son niveau, le Premier Président et moi, a été très clair : on ne porte pas atteinte à la liberté de prescription du juge, car il faut en permanence se souvenir que le coeur de notre métier est le juridictionnel et la recherche de la vérité, mais indépendance ne doit pas rimer avec inconséquence, et liberté ne doit pas rimer avec responsabilité.
Ce message est très bien passé et nous avons obtenu, simplement sur cette nouvelle rigueur des prescripteurs, sur l'année d'expérimentation, c'est-à-dire sur l'exercice 2005, une baisse de l'augmentation des frais de justice. Alors que, comme ailleurs, nous étions sur une base de 20 % d'augmentation, nous somme passés au-dessous de 6 %, et je pense que les huit autres cours expérimentales ont obtenu sur ce point des résultats à peu près similaires.
J'en viens à la deuxième observation que je souhaite formuler. Hier, nous étions en réunion des procureurs généraux tout d'abord avec le Directeur des affaires criminelles, puis avec le Directeur des services judiciaires, et celui-ci aura pu noter comme moi que mes collègues ont exprimé un certain nombre de doutes face à la LOLF. En effet, cette année a commencé dans des conditions particulièrement difficiles. Quand on reprendra l'histoire de la LOLF, 2006 restera sans doute "l'année horrible" de la LOLF, l'année de démarrage.
Sur fond de sous-dotations budgétaires en matière de frais de justice et, surtout, en matière de masse salariale ou, peut-être, sur fond de doute sur la pertinence des dotations budgétaires, car le problème peut aussi se poser de cette manière, on constate en effet que chacun fonctionne sur la précaution : l'administration centrale constitue des réserves importantes de précaution non pas pour retenir le pouvoir, mais parce qu'elle n'a pas encore la certitude que les échelons inférieurs seront tout à fait capables de maîtriser les choses et, naturellement, les chefs de cour d'appel, eux-mêmes relativement inquiets, voire déresponsabilisés par ces sous-dotations, ont la tentation de constituer à leur tour des réserves de précaution. C'est un peu Kafka à la manoeuvre, et je ne vous parle pas des conséquences que cela peut avoir pour l'arrondissement judiciaire, c'est-à-dire le tribunal de grande instance.
Cela veut dire que, depuis le début de l'année, nous faisons en réalité de « l'anti LOLF », c'est-à-dire de la déresponsabilisation des gestionnaires de terrain qui, comme dans un passé déjà lointain, sont obligés de venir systématiquement, dans le cadre d'une forme de culture de dépendance, réclamer à l'administration centrale les budgets dont ils ont besoin.
Nous savons tous déjà que les dotations en matière de masse salariale seront insuffisantes pour nous permettre de terminer l'exercice. Bien évidemment, tous les magistrats et fonctionnaires seront payés jusqu'à la fin de l'année, mais cela passera par des dotations complémentaires et des abondements et je ne pense pas que nous soyons véritablement dans une logique LOLF.
Comme je veux être positif, je dirai que la LOLF existe et que nous l'avons rencontrée au cours de l'année d'expérimentation où nous avons été correctement dotés et où nous avons pu dégager des marges de manoeuvre, avec en particulier une fongibilité asymétrique positive qui nous a permis, en fin d'exercice, de rétribuer les magistrats et les fonctionnaires qui s'étaient lourdement investis dans l'expérimentation, rétribution non pas sous forme de primes, parce que n'était pas dans la culture de notre administration, mais sous forme d'amélioration des conditions matérielles de travail (amélioration des locaux, dotations en matériel, etc.). Je peux vous assurer que cette fongibilité est pour nous un levier essentiel de modernisation de l'institution judiciaire, et qu'en refusant aux chefs de cour toute marge de manoeuvre à ce niveau, on les prive de moyens importants de mobilisation de leur cour.
Je terminerai en disant quelques mots sur les autres sujets qui ont été abordés.
En ce qui concerne la performance, je suis d'accord avec ce qui a été dit par mon collègue Premier Président ainsi que par le Directeur des services judiciaires : aujourd'hui, il règne un consensus très clair chez les magistrats qui sont prêts bien évidemment à entrer dans cette logique de performance. Le problème est que notre activité, comme vous l'avez constaté, Messieurs les Sénateurs, est relativement spécifique. Je ne fais pas partie de ceux qui ont affirmé que le régalien n'est pas soluble dans la LOLF, car je pense que, pour une large part, le régalien aussi est soluble dans la LOLF. Nous avons donc un certain nombre de spécificités et nous constatons combien il est difficile de définir actuellement des indicateurs cohérents.
La plupart de nos collègues considèrent que les indicateurs qui nous sont proposés en matière de performances sont pour le moins artificiels et ne permettent pas d'aborder véritablement les problèmes de fond de la gestion. Nous sommes donc d'accord pour dire que, cette année, les indicateurs qui nous sont proposés ne seront pas suffisants, à l'évidence, pour alimenter le dialogue de gestion que nous devons avoir avec les arrondissements judiciaires et avec l'administration centrale.
Il nous faut des indicateurs. Cela passe d'abord par la mise à jour de nos outils informatiques en matière de statistiques, car un gros travail reste à faire à ce niveau, et par l'ouverture d'un dialogue plus ample avec les ressorts pour définir d'une manière consensuelle des indicateurs qui pourront alors être soumis et discutés avec les dispensateurs de crédits.
Parmi les orientations de modernisation qui ont été évoquées par M. le Directeur du budget, figurait le recours à la visioconférence. Celle-ci entre dans les moeurs et nous la pratiquons de plus en plus souvent ; la plupart des juridictions en seront équipées à la fin de l'année et nous travaillons beaucoup avec ce nouvel outil.
Il en est de même pour la dématérialisation. L'exemple de Singapour a beaucoup frappé un certain nombre de décideurs, y compris de ministres. Le secrétariat général a lancé sur ce point un chantier important avec la création de trois groupes de travail : l'un sur la dématérialisation des procédures civiles, l'autre sur la dématérialisation des procédures pénales et le troisième sur la dématérialisation de la gestion. Des chefs de cour ont été sollicités pour présider des groupes de travail et les expérimentations, en particulier pour le pénal, vont commencer dès le mois de septembre 2006 après élaboration d'une doctrine d'emploi.
Je ne pourrai pas terminer, Mme la Sénatrice étant présente, sans pousser un petit « cocorico » alsacien mosellan en ce qui concerne la fluidité des circuits de paiements et les difficultés qui ont été évoquées. L'Alsace Moselle, parmi ses spécificités, connaît l'absence des régies. Or nous avons constaté, en nous comparant aux autres, que cette absence de régie était plutôt un atout. Vous avez permis, en centralisant et en rationalisant la gestion au niveau des SAR, de faire sauter l'un des premiers verrous.
En même temps, cette absence de régie nous met, à travers le SAR, en dialogue direct et permanent avec le trésorier payeur général compétent. Cela nous a permis d'avoir avec lui des échanges "relativement virils". Dans le cadre de ce nouveau fonctionnement, le trésorier payeur général voulait en effet s'attribuer une forme de contrôle d'opportunité des frais de justice et, en particulier, il s'est immiscé pour évaluer la pertinence de certaines réquisitions. Grâce à l'aide de l'administration centrale, nous avons pu remettre les choses au clair et lui rappeler quelles étaient les limites de ce contrôle, mais il n'en reste pas moins et je serai également très prudent parce qu'il y a un gros débat interne au Ministère de la justice sur ce sujet qu'il nous manque un outil de contrôle. Dans la mesure où les ordonnances de taxes sont considérées comme des ordonnances juridictionnelles, les certifications faites par les greffiers sont assimilées à des ordonnances de taxes, si bien que, lorsqu'un magistrat taxe ou lorsqu'un greffier certifie, les ordonnateurs se trouvent devant une décision juridictionnelle et ne peuvent pas la contester en l'état. Le seul circuit de contestation passe par le trésorier payeur général et il faut donc que les ordonnateurs secondaires, inquiets face à une taxation, contactent le trésorier payeur général pour lui demander de saisir le procureur de la République territorialement compétent, de telle sorte que celui-ci saisisse la chambre de l'instruction qui pourra alors se prononcer sur la pertinence de cette taxe.
En tant qu'ordonnateurs secondaires, il nous apparaît qu'il faudrait effectivement réfléchir à la création d'un outil de contrôle à notre niveau. Il y avait deux hypothèses à cet égard : la première consistait à supprimer le caractère juridictionnel de l'ordonnance de taxe, mais nous sommes partis dans un débat théologique et je pense qu'il vaut mieux faire marche arrière sur ce point ; la deuxième solution consistait à donner aux ordonnateurs secondaires un droit de recours contre les ordonnances de taxes qui paraîtraient contestables à un niveau ou à un autre, auquel cas la chambre d'instruction pourrait statuer sur cette décision juridictionnelle.
Nous en sommes aux balbutiements et la réflexion est ouverte, mais je pense qu'il y a un vrai problème à ce niveau.
M. Sylvain ATTAL .- Comme la salle commence à s'impatienter car il y a des désirs de prises de parole, je vais demander à nos deux derniers intervenants, même si cela leur coûte un effort, d'intervenir de façon assez brève, de l'ordre de cinq minutes chacun, sachant que les questions qui seront posées leur permettront de répondre et d'intervenir à nouveau.
Je passe la parole à Mme Chantal Bussière, Présidente du Tribunal de grande instance de Valence, qui va nous dire ce que la LOLF a changé dans son expérience quotidienne de chef de juridiction.
Mme Chantal BUSSIERE .- Je vous remercie de me donner la parole, même si, pour un président de tribunal de grande instance, il n'est pas facile d'intervenir dans un débat sur la LOLF, notamment après le Directeur des services judiciaires, un procureur général et un premier président puisque, bien évidemment, la LOLF fait aujourd'hui des chefs de cour les acteurs centraux de la nouvelle architecture budgétaire au niveau central et de la cour d'appel l'échelon pertinent de cette très importante réforme.
Est-ce à dire pour autant que les tribunaux de grande instance ont perdu toute leur autonomie ? Bien évidemment, je ne le pense pas. Je crois tout au contraire que la LOLF est l'occasion de voir émerger une nouvelle forme d'animation budgétaire, ce que la circulaire budgétaire appelle un dialogue constructif à faire émerger au niveau local.
Bien sûr, c'est une réforme très importante qui a changé beaucoup de nos habitudes et notre culture et tout ne va pas être parfait du jour au lendemain, mais c'est à nous, acteurs de terrain, de faire vivre ces nouvelles formes d'animation budgétaire. Nous sommes en ce moment en pleine préparation de nos demandes budgétaires pour l'année 2007 et donc en pleine réunion de nos assemblées générales (commission permanente, commission restreinte, conférence budgétaire), et nous voyons déjà que nous n'abordons plus du tout les choses comme nous le faisions par le passé puisque, à l'évidence, le débat dans lequel nous étions enfermés autrefois s'est considérablement élargi, notamment en ce qui concerne tout ce volet de la performance. Nous devons maintenant nous engager sur des objectifs sous-tendus par des indicateurs qui, au final, sont extrêmement importants, puisque c'est de tout cela que dépendront les moyens qui nous seront alloués.
En réalité, nos collègues sont extrêmement sensibilisés à cette problématique et je vais évoquer deux indicateurs à ce sujet.
Le premier est celui de la charge de travail par magistrat, aussi bien en matière civile qu'en matière pénale. Pour l'instant, même si nous avons beaucoup évolué sur ce thème depuis un certain nombre d'années, nous sommes encore dans une approche assez approximative. Nous disposons d'outils extrêmement intéressants : la DSJ, notre structure de référence, nous donne beaucoup de données environnementales sur nos juridictions, la DACG diffuse elle-même un document très intéressant, nous avons aussi un outil statistique qui est d'ailleurs plus performant en matière civile qu'en matière pénale, et nous avons également pris l'habitude de voir des contrats d'objectifs se mettre en place dans nos juridictions.
Néanmoins, l'approche de la charge de travail par magistrat reste à améliorer considérablement puisque, en matière civile, par exemple, nous partons des affaires terminées que nous rapportons, certes, à un effectif de magistrats affectés en matière civile ou en matière pénale, mais nous ne faisons pas de distinguo entre un jugement de divorce, un jugement concernant un conducteur en état alcoolique ou un jugement d'affaire économique et financière.
Sur tous ces sujets, il va donc nous falloir trouver des coefficients de pondération. Ce sont des sujets sur lesquels nos collègues sont extrêmement attentifs et, même si, dans l'immédiat, en termes d'objectifs et de dossiers de performance, nous travaillons à partir de la circulaire qui émane de la Chancellerie et à laquelle nous essayons de répondre, la démarche de la performance, dans les années qui viendront, devra partir du bas vers le haut, parce que c'est par ce consensus, que nous arriverons à une véritable appropriation de toute cette démarche, et de cette révolution culturelle qui permettra d'en assurer l'efficience.
Le deuxième indicateur a trait à la qualité. Nous ne pourrons pas faire l'économie, à plus ou moins long terme, de la place de la collégialité dans tout le processus judiciaire. C'est un sujet que nous avons vu brutalement revenir à la surface en matière pénale, mais il faudra aussi le revoir en matière civile, même si nous n'allons pas passer brutalement et totalement de l'un à l'autre. Ce sont des sujets auxquels les collègues sont extrêmement attentifs et sensibles.
Cela étant dit, comment avons-nous vécu et comment vivons-nous sous l'ère de la LOLF depuis le 1er janvier dans une juridiction du premier degré ?
Au début de l'année, nous avons évidemment rencontré les difficultés qui ont été signalées et je ne vais pas y revenir. Il s'agit de toute une série de difficultés matérielles ou liées aux modalités pratiques de mise en oeuvre de la LOLF et à un certain retard dans l'actualisation du logiciel ou dans la notification de nos enveloppes. Ce sont des éléments sur lesquels nous allons pouvoir évoluer favorablement et qui ne remettent pas en cause la LOLF en elle-même.
En revanche, nous sommes plus inquiets sur certains sujets. Je citerai à cet égard deux aspects fondamentaux de la LOLF qui ont déjà été beaucoup abordés ce matin : les frais de justice et les ressources humaines.
En ce qui concerne les frais de justice, les choses ont beaucoup évolué depuis l'automne 2005. A cette époque, la crainte essentielle des collègues était de deux ordres : ils se demandaient, d'une part, si ce passage de crédits évaluatifs à des crédits limitatifs allait porter atteinte à l'indépendance du prescripteur et aux choix des experts, et, d'autre part, quelles seraient les conséquences d'une impossibilité de rester dans l'enveloppe qui a été allouée au regard des autres crédits.
En réalité, les choses ont évolué depuis parce que, comme cela a été dit avant moi, les collègues n'ont pas vécu au quotidien cette volonté de « couper la tête de l'indépendance ». Aucun chef de cour ni de juridiction n'aura donné des instructions à un juge des affaires familiales ou à un juge d'instruction en lui disant qu'il ne doit plus fonctionner comme précédemment. L'indépendance de prescription, qui est évidemment fondamentale, a donc été préservée.
En revanche, nos collègues ont été très réceptifs à la sensibilisation que nous avons essayé de leur communiquer en ce qui concerne la nécessité de parvenir à cette notion de juste rémunération de tous les opérateurs. Après tout, les collègues sont aussi des contribuables et, lorsqu'on leur a expliqué qu'à qualité égale, il était possible de dépenser 85 euros au lieu de 360, ils ont trouvé cela tout à fait normal et ils ont donc adhéré à cette démarche. De même, en matière d'écoutes téléphoniques, encouragés par des jurisprudences très rapidement intervenues de certaines chambres de l'instruction, ils ont pu pratiquer une politique de taxation qui se révélera certainement intéressante.
Malgré tous ces efforts, réussirons-nous à entrer dans l'enveloppe qui nous a été accordée au titre des frais de justice ? Il est encore un peu tôt pour le dire. Le montant des paiements reste élevé parce que nous continuons à apurer nos exercices antérieurs. Certes, le niveau des engagements dans l'outil Fraijus apparaît moins élevé, mais il faut le relativiser parce qu'on n'y rentre que des coûts moyens et il n'est pas entièrement fiable. Quant au problème de l'impact d'un éventuel dépassement sur les autres budgets, nous avons reçu des assurances soit de la DSJ, soit du Secrétaire général.
La crainte que nous avons aujourd'hui est d'un autre ordre. L'intérêt de la LOLF en matière de frais de justice et d'autres dépenses est le mécanisme de la fongibilité asymétrique. Je ne vais pas y revenir car chacun sait de quoi il s'agit. Je me contenterai d'indiquer l'intérêt de ce mécanisme : si on réussit à être économe, on peut utiliser l'économie à d'autres fins.
M. Sylvain ATTAL .- Merci d'avoir donné cette précision.
Mme Chantal BUSSIERE .- Cependant, les tribunaux de grande instance craignent qu'on leur demande de reverser l'économie qu'ils pourraient réaliser sur le terrain à un niveau régional, voire national. Certes, nous pouvons comprendre les précautions de prudence et de réserve, mais si nous ne parvenons pas à bénéficier sur le terrain des économies que nous aurons pu réaliser, ce sera quand même très démotivant en termes de gestion de nos coûts.
Je souhaitais évoquer cette problématique que nous voyons émerger en termes de frais de justice.
Pour terminer, je vais aborder une difficulté qui touche à ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon assez technocratique, les ressources humaines, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui rendent la justice au quotidien, les collègues magistrats et les fonctionnaires. Je ne parlerai pas des fonctionnaires parce que le temps est trop contraint. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, mais la salle pourra revenir sur ces questions.
Je tiens surtout, en termes de magistrat, à exprimer la crainte que nous avons aujourd'hui : celle que la LOLF et la nécessaire rationalisation des moyens qu'elle induit soit le moyen contourné d'éviter ce que nous considérons, nous, comme une indispensable réforme de la carte judiciaire.
Dans certains départements très étendus géographiquement, il y aura un tribunal de grande instance départemental avec des tribunaux d'instance un peu éparpillés, parfois très loin du siège du TGI. Ce sont des tribunaux à l'activité extrêmement réduite et, de surcroît, des juridictions dans lesquelles il y a parfois très peu de candidats. Evidemment, on peut se dire que, pour rationaliser les moyens, comme il y a deux tout petits tribunaux très éloignés, l'activité des deux réunis va faire un seul équivalent temps plein travaillé et que l'on peut localiser par conséquent cet équivalent temps plein travaillé au TGI départemental, le président étant libre d'utiliser la faculté, que lui donne le code de l'organisation judiciaire, de désigner un collègue pour aller tenir ces juridictions éloignées.
En termes de rationalisation de la gestion des ressources humaines, je peux être d'accord, mais, en termes de statut des magistrats du siège, cela me semble poser un problème au regard de l'inamovibilité d'un magistrat du siège. Si on peut, à court terme, envisager une délégation d'un collègue sur une fonction qu'il n'a pas choisie, je ne pense pas que l'on puisse le faire à long terme. Si on pense que deux juridictions ont une activité insuffisante pour justifier un magistrat à temps plein sur place, il faut aller, par cette réforme de la carte judiciaire, jusqu'à avoir le courage de supprimer cette juridiction. C'est une problématique fondamentale.
M. Sylvain ATTAL .- Merci beaucoup. Je passe la parole à Frédéric Fèvre, Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Poitiers, en lui demandant de faire encore un effort supplémentaire de brièveté.
M. Frédéric FEVRE .- Je suis un militant de la première heure de la LOLF parce que je suis convaincu que l'indépendance n'exclut pas la responsabilité. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit auparavant ; je me contenterai de vous expliquer comment, concrètement, nous avons mis en oeuvre la LOLF au tribunal de Poitiers.
Tout d'abord, nous avons organisé une journée de formation, en liaison avec le trésorier payeur régional, qui s'adressait à l'ensemble du personnel de la juridiction, c'est-à-dire que tous les magistrats, greffiers et fonctionnaires ont été dans les bureaux de la trésorerie générale et, pendant une journée, ont assisté à une présentation du budget de l'Etat dans sa problématique générale, avec les difficultés que cela représente actuellement, une présentation de la LOLF dans le cadre judiciaire, et une présentation de la problématique particulière des frais de justice, en donnant des exemples de mise en oeuvre de la LOLF dans d'autres services de l'Etat, lorsque cela avait bien fonctionné.
Notre deuxième initiative, à Poitiers, a été de créer un comité de pilotage avec la présidente, le procureur, le greffier en chef, des greffiers, des magistrats et des fonctionnaires. Ce comité de pilotage ne travaille que sur la LOLF, c'est un lieu d'échanges et de recueil de renseignements sur les bonnes pratiques. Cela nous permet de faire remonter les difficultés, quand il y en a, et de trouver les moyens de les résoudre. Par ailleurs, nous avons un groupe de discussion sur notre site Internet au sein de la juridiction qui nous permet d'échanger, entre les différents membres de ce groupe de travail, sur les difficultés de la LOLF.
Pour un procureur de la République, la question qui se pose est la suivante : la LOLF peut-elle avoir une incidence sur la politique pénale d'un parquet ? A plusieurs égards, je répondrai positivement, même si c'est un sujet assez délicat.
Poitiers se trouve à côté d'une autoroute. S'il arrive, comme cela s'est malheureusement déjà produit dans les années passées, un carambolage sur cette autoroute avec quarante voitures impliquées, cela aura évidemment des incidences sur la LOLF. On l'a vu au tribunal de Pontoise avec le crash du Concorde.
Un autre élément doit être pris en considération : un incendie de nature criminelle dans une maison d'habitation. Si les enquêteurs font vingt prélèvements de bocaux, dois-je choisir, pour des raisons d'économies, de ne faire analyser que cinq bocaux au risque de laisser passer une preuve dans les quinze bocaux restants ? C'est une question qu'un procureur de la République doit se poser.
M. Sylvain ATTAL .- Comment y répond-il ?
M. Frédéric FEVRE .- Il le fait en fonction des éléments qu'il a sur le terrain, si l'incendie apparaît criminel ou non. C'est bien souvent une question de bon sens.
Il en est de même en matière de stupéfiants. On fait souvent analyser les produits stupéfiants car il y a aussi un impératif de santé publique. Si on s'aperçoit que de l'héroïne a été coupée et qu'il y a un risque d'overdose, on fait analyser le produit et on le fait savoir. Si on refuse de faire cette analyse des stupéfiants, on n'aura pas ces éléments d'information qui permettraient peut-être de sauver des jeunes. C'est une vraie difficulté.
En termes de politique pénale, je citerai un exemple évident : lorsqu'un téléphone portable est volé, on sait que les réquisitions vont nous coûter beaucoup plus cher, au final, que le prix du téléphone portable, puisque cela peut aller jusqu'à 500, voire 700 euros à Poitiers, alors même qu'on n'est pas sûr de retrouver l'auteur. A Poitiers, j'ai dit aux enquêteurs, policiers et gendarmes que, sur un banal vol de téléphone portable, s'il n'y a pas d'éléments, il est inutile de faire des réquisitions parce que, après avoir fait le calcul, on se rend compte que cela ne vaut pas la peine, sauf circonstances particulières, bien évidemment.
D'autres problématiques nous ont permis d'avoir une vision plus claire de notre budget. Les chefs de cour, présidents et procureurs, sont des gestionnaires. Or aucun chef d'entreprise ne pourrait se satisfaire de ne pas connaître le budget de son entreprise. J'estime que, pour les chefs de juridiction et de cour, c'est la même chose : il faut de la transparence pour savoir sur quoi on peut compter. Malheureusement, un certain nombre de dépenses nous sont imputées.
Il en est de même dans les cas de mort naturelle ou de suicide avéré. On nous demande souvent de transporter le corps, ce qui coûte plusieurs centaines d'euros. J'ai donc dit aux policiers et aux gendarmes qu'il était hors de question de transporter le corps en cas de mort naturelle.
Dans le cas d'une épave sur la voie publique, la voiture étant abandonnée, si nous ne sommes pas dans le cadre d'une procédure judiciaire, ce n'est pas à l'autorité judiciaire de supporter les frais de transport ou de gardiennage du véhicule en fourrière.
Enfin, je ferai une petite observation : je constate que beaucoup de frais sont tarifés mais que les deux postes de dépenses les plus importants ne le sont pas, malheureusement, à savoir les expertises génétiques et les frais de téléphonie. C'est le principe de la libre concurrence qui s'applique en ce domaine.
Comme je ne veux pas abuser du temps qui m'a été accordé, je conclus rapidement. Les magistrats sont confrontés à cette réforme, ils ont fait une révolution culturelle et ils ont maintenant bien intégré cette réforme, mais il ne faut pas oublier que, comme le disait Yves Canac, pour être efficace, une administration doit toujours être juste.
M. Sylvain ATTAL .- Je vous remercie beaucoup de cet effort de concision. Il nous reste quelques minutes pour prendre quelques questions, en vous demandant de les formuler vraiment brièvement.
Mme THIRIEZ .- Je suis Secrétaire générale de la première organisation syndicale des fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires. Mon intervention sera très courte et elle s'adresse à toutes les personnes qui représentent l'Etat.
Pour que vous ayez une justice équitable et sereine, il faut respecter une proportion que M. le Ministre a bien soulignée : à chaque fois que vous créez un poste de magistrat, il faut obligatoirement un greffier de catégorie B et deux fonctionnaires de catégorie C. Si vous ne créez pas de fonctionnaires de catégorie C, le magistrat et le greffier ne pourront pas assumer pleinement leur mission parce qu'ils seront débordés.
Il faut savoir que les fonctionnaires de catégorie C font un travail que les magistrats et les greffiers ne peuvent pas faire. Je précise en passant que, la plupart du temps, les fonctionnaires de catégorie C font le travail de greffier, mais c'est autre chose. En tout cas, si vous ne créez pas des fonctionnaires de catégorie C, nous ne nous en sortirons pas.
C'est tout ce que je souhaitais dire.
Marie-Luce CAVROIS .- Je suis Présidente du Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne et je souhaite dire quelques mots pour insister sur l'échelon de l'arrondissement.
Comme plusieurs d'entre vous l'ont dit, la LOLF n'est pas simplement une affaire comptable ; elle doit être l'occasion de redonner au personnel de justice des marges de manoeuvre et du dynamisme. Or nous avons vu se mettre en place toute une économie de comptabilité qui a été assez désagréable dans la juridiction et qui a concerné les postes vacants. Lorsqu'on a des postes vacants dans une juridiction, les budgets repartent, si bien que les personnels qui souffrent de ces vacances de postes n'en voient pas les bénéfices. On pourrait imaginer que, du fait de la LOLF et de l'effet de la fongibilité asymétrique, on puisse utiliser ces vacances soit pour le fonctionnement, soit pour recruter des vacataires, mais on n'en est pas encore là pour le moment.
Il est bien dommage que nous n'arrivions pas, au niveau de l'arrondissement, à retirer une partie du bénéfice des difficultés et aussi des efforts qui sont faits. En matière de frais de justice, comme cela a été souligné par la Présidente de Valence, quand les magistrats font des efforts de gestion et de rationalisation de leurs dépenses, il faut qu'ils puissent en tirer un minimum de bénéfices. Sinon, ils ne feront plus cet effort à long terme, et il en est de même tant pour les frais de justice que pour les frais de fonctionnement.
M. Sylvain ATTAL .- M. Bernard de la Gâtinais veut-il dire un mot sur ces préoccupations qui émergent au niveau des juridictions ?
M. Léonard BERNARD de la GÂTINAIS .- Je commencerai par répondre à Mme Thiriez en lui disant mais elle le sait que je suis très attentif au travail des greffes et des fonctionnaires de greffe et à la situation extrêmement tendue qui est vécue dans les greffes et qui a été rappelée par le Garde des Sceaux.
Quant au positionnement des juridictions du premier degré et à leur sentiment d'avoir perdu un peu la main en matière de gestion, je répondrai cela fait partie de la réflexion menée actuellement sur le renouveau du dialogue social qu'il va falloir faire vivre d'une façon ou d'une autre l'arrondissement judiciaire. La cour d'appel a besoin d'avoir non seulement le retour de la juridiction en tant que telle, qu'il s'agisse du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance ou du CPH, mais aussi une vision plus globale de l'ensemble de l'arrondissement judiciaire. Il faudrait qu'au niveau de l'arrondissement judiciaire, il y ait une sorte de diagnostic partagé, ce qui permettrait mais je rêve sans doute d'envisager parfois de proposer le positionnement de tel ou tel fonctionnaire, des forces et des ressources humaines dans telle ou telle juridiction, ce qui faciliterait sans doute la tâche d'arbitrage des chefs de cour lorsqu'il s'agit de définir les effectifs cibles. Je ne parle pas d'une décision mais d'une proposition.
Cela pourrait être un dialogue intéressant. En tout cas, c'est une piste qui me semble pouvoir être suivie. Tout cela doit avancer, mûrir et être partagé par l'ensemble des acteurs, mais, comme vous l'avez dit, Madame le Président, je crois que la motivation est indispensable. Or, pour être motivé, il faut partager. Ce serait une forme de partage relativement intéressante.
En ma qualité de chef de cour je l'étais encore il n'y a pas très longtemps , je voyais revenir des demandes de certaines juridictions, ne serait-ce que pour les délégations d'un greffier ou d'un C placé. C'est ce qui me fait penser qu'un certain nombre de choses pourraient être résolues à l'échelon de l'arrondissement judiciaire. En effet, lorsqu'on dispose d'un peu de temps (il peut en effet exister des juridictions qui ont un peu plus de confort en matière de personnel que d'autres, même si je sais que la plupart souffrent), la mutualisation peut aussi avoir un intérêt. Pour cela, il faut que le diagnostic soit partagé à l'échelle de l'arrondissement judiciaire.
Mon propos a un côté légèrement provocateur dans la situation tendue que nous vivons, mais je parle ici de cas particuliers et ponctuels qui existent.
M. Sylvain ATTAL .- Merci. S'il n'y a plus d'autres interventions ni d'autres questions, je donne la parole à M. le Président Poncelet, qui va clôturer les travaux de ce matin.
Clôture par M. Christian Poncelet, président du Sénat
M. Christian PONCELET .- Mesdames et messieurs les Sénateurs, mes chers collègues, mesdames et messieurs les magistrats et fonctionnaires de justice, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les 4 èmes rencontres sénatoriales de la justice sont sur le point de s'achever et je souhaite vous dire combien je suis fier, au nom de toutes les sénatrices et de tous les sénateurs, de cette initiative prise en 2002.
Ces rencontres ont permis une fois encore à tous les sénateurs qui l'ont souhaité une vingtaine cette année de découvrir l'institution judiciaire dans son fonctionnement quotidien grâce à un stage de trois jours effectué au sein de tribunaux de grande instance ou de cours d'appel, où magistrats et fonctionnaires de justice se sont mobilisés pour leur réserver, comme mes collègues me l'ont dit et comme ils l'ont confirmé tout à l'heure, le meilleur accueil. Trois jours au cours desquels, grâce à une grande transparence et une réelle mobilisation institutionnelle, les sénateurs peuvent voir fonctionner des juridictions, s'entretenir avec leurs acteurs, constater les conditions parfois difficiles dans lesquelles ils travaillent, mais aussi la grandeur et la noblesse de leur mission.
Je souhaite en remercier ici l'ensemble des magistrats, des fonctionnaires et des auxiliaires de justice qui, comme chaque année, ont « joué le jeu » en nous ouvrant leur palais et en nous consacrant du temps.
Au moment où la justice n'a jamais autant été sous les feux de l'actualité, je souhaite vous dire combien je crois à l'utilité de ces rencontres qui permettent aux sénatrices et aux sénateurs de cultiver une connaissance réelle et profonde de l'institution judiciaire.
Sans vouloir présumer d'éventuelles réformes, je crois pouvoir affirmer que le Sénat demeurera vigilant, au-delà des aspects purement juridiques, à la pertinence et la cohérence des évolutions qui seront proposées, s'appuyant pour cela sur une bonne, voire une excellente connaissance de l'institution judiciaire acquise grâce à notre travail, d'abord séparé puis collectif à travers les Rencontres sénatoriales de la justice.
C'est une véritable révolution à laquelle cette institution a été, est et sera confrontée cette année et les années suivantes. Cette révolution, rares sont ceux qui en parlent. Aucune commission ne lui a été dédiée. Elle n'a pas fait les gros titres de la presse nationale et nous mesurons mal à quel point elle a nécessité, nécessite et nécessitera des efforts d'adaptation et des évolutions profondes. Je veux parler de la LOLF, la loi organique relative aux lois de finance qui, pour la première fois, a été mise en oeuvre cette année par l'Etat et l'ensemble des administrations. Au début, chacun se demandait comment s'appliqueraient ces nouvelles dispositions financières.
Je ne reviendrai pas sur les trois objectifs essentiels poursuivis qui ont pour but une meilleure lisibilité permettant la mise en oeuvre d'un contrôle parlementaire plus efficace devant conduire à une meilleure maîtrise des dépenses (ne perdons pas de vue la dette de la France).
Il ne s'agit en fait de rien d'autre que de redonner un peu de vigueur à l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Permettez-moi, devant un public constitué essentiellement de juristes, de le citer : « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ».
Comme la justice n'est pas une administration comme les autres, il m'a paru utile que nous échangions sur cette question cette année. Je sais que cette mise en oeuvre a été préparée avec le plus grand soin possible tant par l'administration centrale et le Directeur des services judiciaires, M. Bernard de Gâtinais, ici présent, auquel je présente mes respects et que je tiens à remercier, que par les cours et juridictions. A cet égard, les témoignages qu'ont bien voulu nous en donner MM. Delmas-Goyon et Legras, Mme Bussière et M. Fèvre nous ont été précieux. Chacun a apporté sa contribution et sa réflexion au travail collectif que nous voulions faire ce matin.
Je sais aussi qu'elle a suscité et suscite encore des interrogations et des inquiétudes. C'est parce que cette réforme a été faite par et pour le Parlement qu'il m'a paru normal que le Sénat s'inquiète de sa mise en oeuvre par l'institution judiciaire. En effet, la justice n'est pas une administration comme les autres je l'ai souligné et la LOLF a su, comme nos débats l'ont montré, en tenir compte dans une mesure importante.
Cette réforme est à la croisée de deux logiques, de deux cultures et de deux systèmes profondément différents : la logique budgétaire, d'une part, et l'institution judiciaire, d'autre part. Il a fallu que chacun fasse un effort pour reconnaître l'autre. Ainsi, le principe de la diarchie à la tête des juridictions, président et procureur, a-t-il été respecté, et j'en remercie Philippe Josse, Directeur du budget, qui fut, à l'inspection des finances du Sénat, un excellent collaborateur et qui a eu l'obligeance de se joindre à nous et de nous faire part de sa science qui ne se dément pas.
Cette notion n'était pas particulièrement familière aux budgétaires, mais ils ont pourtant fini par l'adopter. De même, c'est le niveau de la cour d'appel qui a été retenu comme étant le plus opératoire au plan budgétaire.
En contrepartie, les adaptations que la justice doit mettre en oeuvre sont nombreuses, profondes et parfois difficiles. Les premières sont des adaptations matérielles et d'organisation : le renseignement et la formation des services administratifs régionaux, et l'utilisation de nouveaux outils informatiques.
De nouvelles responsabilités pèsent désormais sur les épaules des chefs de cour en tant qu'ordonnateurs secondaires. De nouveaux concepts sont apparus avec leur horde de barbarismes : les BOP (budgets opérationnels de programme), les PAP (projets annuels de performance) et les RAP (rapports annuels de performance).
Il y a aussi, ce que vous n'avez pas manqué d'évoquer ce matin, les frais de justice, qui sont passés de crédits évaluatifs à crédits limitatifs, avec cette ardente obligation de prévoir l'imprévisible. Mon collègue du Luart, qui préside votre table ronde, en sait quelque chose : son rapport sur le sujet fait date et vous l'avez entendu vous donner ce matin le résumé de l'expérience qu'il a vécue auprès de vous. Je pense qu'il n'y avait pas meilleur avocat que lui pour votre cause ce matin en présence du ministre.
A l'heure où -mais faut-il y croire ?- on envisage, ô combien à juste titre, de donner à la justice d'importants moyens, je crois profondément que la LOLF constitue l'outil indispensable et adéquat pour qu'elle puisse l'utiliser de manière lisible et optimale. Je forme le souhait que la matinée que nous venons de passer ensemble y aura un peu contribué, tout au moins ai-je la faiblesse de le penser. Merci de m'avoir écouté.
(Applaudissements.)
La séance est levée à 12 h 55.
LES 5èmes RENCONTRES SÉNATORIALES DE LA JUSTICE
JEUDI 5 JUILLET 2007
Palais du Luxembourg
Compte rendu des débats
La séance est ouverte à 9 h 35.
M. Emmanuel KESSLER .- Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette salle pour assister aux 5 èmes Rencontres sénatoriales de la justice enregistrées sur la Chaîne parlementaire. J'aurai le plaisir de vous accompagner, pour Public Sénat, sur l'ensemble de la matinée. Au cours de cette matinée, nous allons accueillir un certain nombre de sénateurs, et vous-mêmes, en tant que professionnels de la justice, vous aurez l'occasion de vous exprimer sur toutes les questions de fond sur lesquelles travaille actuellement le Sénat.
Auparavant, pour ouvrir solennellement et officiellement ces Rencontres et vous donner le contexte dans lequel elles se déroulent, M. Christian Poncelet, Président du Sénat, va vous souhaiter la bienvenue au palais du Luxembourg.
Intervention de M. Christian Poncelet, Président du Sénat
M. Christian PONCELET .- Je vais tout d'abord solliciter votre indulgence et vous demander de m'excuser pour le retard avec lequel j'ouvre votre colloque. J'ai dû installer, pour sa première intervention au Sénat, Mme le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, qui intervient aujourd'hui dans un débat concernant la peine plancher. C'est la première fois qu'elle intervient dans notre assemblée et, par conséquent, surtout s'agissant d'une femme, l'élégance commande que le Président l'accueille. C'est ce que j'ai fait avec plaisir.
Mes chers collègues, monsieur le Premier Président, mesdames et messieurs les magistrats et fonctionnaires de justice, monsieur le Bâtonnier, mesdames et messieurs les avocats, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir une nouvelle fois cette année au Sénat. Ces rencontres sont en effet, pour moi et l'ensemble de mes collègues, une occasion de remercier les chefs de cour et chefs de juridiction, magistrats et fonctionnaires pour l'accueil qu'ils ont bien voulu réserver aux sénatrices et sénateurs au sein des juridictions. Ils auront l'occasion de vous le dire dans quelques instants.
Je vous demande de noter que le Sénat est la seule assemblée démocratique qui envoie ses élus en stage dans les entreprises, les institutions judiciaires et les forces armées. Bien sûr, ils y vont volontairement, puisque c'est une proposition qui leur est faite et que nombreux sont celles et ceux qui y souscrivent. Sur 331 sénatrices et sénateurs, presque 300 ont accompli ces stages et les ont même renouvelés. En la circonstance, je respecte les recommandations de mon ministre prédécesseur vosgien, Jules Ferry, qui disait : « Le Sénat est là pour veiller à ce que la loi soit bien faite ». Encore faut-il pour cela que ceux qui la construisent appréhendent bien la matière sur laquelle ils vont légiférer. Je me réjouis donc de cette démarche.
Je sais que les sénatrices et sénateurs ont toujours été bien accueillis dans les institutions judiciaires et qu'eux-mêmes ont été heureux de rencontrer les hommes et femmes de justice, et inversement.
Je tiens donc à vous dire combien je suis attaché à ces stages et combien j'en suis fier. J'ai souhaité, dès le début de mon mandat, que le Sénat s'ouvre davantage sur le monde professionnel. Les stages des sénatrices et sénateurs dans les juridictions, les entreprises et les forces armées ont contribué à ce que j'ai appelé la politique d'ouverture. Ils nous permettent de découvrir des secteurs d'activité essentiels à la vie de la nation.
C'est la cinquième année que ces stages se déroulent au sein des cours d'appel et des tribunaux de grande instance et plus de la moitié des sénatrices et sénateurs en ont effectué un, voire deux pour certains d'entre eux.
La justice change, se modernise et évolue dans des circonstances parfois difficiles avec des contraintes lourdes (pressions médiatiques, sécurité des tribunaux, réforme budgétaire et comptable, inflation législative), mais sans qu'il soit porté atteinte à son indépendance et à sa mission de gardienne des libertés individuelles. Cette impérieuse nécessité et cette haute mission, essence de la justice, sont au coeur de ce qu'on appelle communément le pacte républicain. Le Sénat, qui ne les méconnaît pas, saura les faire vivre dans le cadre des réformes à venir.
Ces changements et cette modernisation, mes collègues peuvent, à l'occasion des stages, les constater et en discuter avec tous les acteurs de la vie judiciaire : magistrats, avocats, fonctionnaires, travailleurs sociaux, policiers et gendarmes et, bien sûr, avec les justiciables eux-mêmes. Pour autant, je sais que ces stages nous sont précieux à tous ici lorsque nous faisons, nous, sénatrices et sénateurs, ce qui est notre vocation : la loi. L'expérience acquise, les relations nouées, les sites visités pendant ces stages nous permettent de légiférer avec, je veux le croire, un peu plus de clairvoyance et de sagesse, imprégnée du bon sens local.
Tout comme ces stages qui ne sont pas directement rattachés au processus législatif mais le nourrissent, l'activité des commissions et délégations du Sénat n'est pas systématiquement liée à l'actualité législative. Ce n'est ni le lieu, ni le moment de reprendre ici les débats qui, pour certains, se sont déroulés récemment dans l'hémicycle.
Evoquant l'hémicycle, permettez-moi de citer Mme la Ministre de la justice, Mme Rachida Dati, qui, dans quelques instants, va présenter son projet de lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs dans la salle des séances, ce qui explique qu'elle ne puisse être des nôtres en cet instant.
Ce travail de fond hors actualité législative que mène le Sénat est fait d'auditions, rapports et autres activités grâce auxquels il se construit un regard propre, solide et cohérent nous avons la faiblesse de le penser sur la société. Cela lui permet d'être parfois à l'origine de réformes importantes et d'être toujours à l'écoute de la société française.
Je parlais tout à l'heure du travail que nous recommandait Jules Ferry. J'ai noté dans mon prochain rapport que plus de 94 % des amendements présentés par le Sénat sont repris par le gouvernement et l'Assemblée nationale. C'est manifestement un compliment que nous pouvons nous adresser à nous-mêmes. Si d'autres ne le font pas, nous sommes bien obligés de le faire.
Ce sont ces travaux à propos desquels j'ai souhaité cette année, à l'occasion de ces cinquièmes rencontres, retenir votre attention. Ils illustrent, je crois, le souci de la Haute Assemblée, que j'ai l'honneur de présider, d'être toujours en prise avec l'institution judiciaire et ses missions.
Il s'agit également d'un juste retour des choses. Ils sont souvent nourris des auditions ou des contributions de certains d'entre vous : magistrats, responsables d'administration centrale, syndicalistes, représentants des mouvements associatifs, etc. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive.
Parce que les meilleurs d'entre nous devaient contribuer à ces rencontres, j'ai sollicité pour intervenir ici le Président de la Commission des finances, le Président de la Commission des lois et le Président de la Délégation pour l'Union européenne afin qu'ils présentent les travaux de leurs commissions et délégation. Mais, bien sûr, les sénateurs de toutes tendances pourront intervenir, faire part de leurs observations, de leurs sentiments et, éventuellement, de leurs ressentiments afin de nourrir ce débat.
J'ai également sollicité deux collègues membres de la Commission des lois sur des thèmes particuliers sur lesquels ils ont conduit d'importantes réflexions.
Le Président de la Commission des finances, Jean Arthuis, confrontera la valeur qui fonde la justice, son indépendance, à l'exigence de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 : rendre des comptes sur l'emploi des fonds publics. Ce sera sans doute également pour lui l'occasion d'évoquer les avancées constatées en matière de frais de justice. Elles démontrent la capacité de l'institution à concilier impératifs budgétaires, efficacité et indépendance.
Le Président de la Commission des lois, Jean-Jacques Hyest, évoquera le travail de sa commission, naturellement en charge des questions de justice. Je sais par ailleurs qu'il vous parlera d'un sujet qui lui tient particulièrement à coeur et à propos duquel il vient de rendre, avec nos collègues Portelli et Yung, un important rapport intitulé « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent ».
Le Président de la Délégation pour l'Union européenne, Hubert Haenel, nous apportera l'indispensable éclairage européen sur ces questions qu'il connaît parfaitement.
Le Sénateur Charles Gautier vous présentera pour sa part le résultat de la mission qu'il à menée avec le Sénateur Pierre Fauchon sur le recrutement et la formation des magistrats, démontrant ainsi que ce n'est pas parce qu'une loi vient d'être votée qu'un sujet perd de son actualité.
Enfin, le Sénateur Jean-René Lecerf vous présentera le résultat des auditions menées par la Commission des lois sur la question si importante pour les familles de la résidence alternée.
Mesdames et Messieurs, je souhaite que cette matinée vous permette ainsi de mieux comprendre et, je l'espère, d'apprécier la façon dont le Sénat travaille, de démontrer l'intérêt qu'il porte à la justice et de faire connaître les résultats de ses réflexions. Que celles-ci vous incitent à débattre et à prolonger le dialogue engagé, au cours de futures rencontres.
Je vous souhaite bon courage et un bon travail en vous remerciant d'avoir eu la gentillesse de m'écouter. Bonne journée à tous.
(Applaudissements.)
M. Emmanuel KESSLER .- Merci de votre intervention, Monsieur le Président, qui a rappelé le cadre dans lequel se déroulent ces 5 èmes Rencontres.
Le déroulement de notre matinée va être un peu perturbé du fait du débat, qui a lieu actuellement dans l'hémicycle, sur le projet de loi concernant la récidive, certains des sénateurs qui sont à mes côtés devant « naviguer » entre notre salle et l'hémicycle où ils doivent participer, voire intervenir dans une partie du débat. C'est notamment le cas du Président de la Commission des lois, Jean-Jacques Hyest, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Je vous propose donc que nous nous adaptions à la présence des uns et des autres en adoptant un ordre d'intervention différent de celui qui est indiqué sur votre programme compte tenu de ces impératifs.
Nous allons tout d'abord entendre les témoignages de ce que certains sénateurs ont vécu ces derniers mois à travers les stages qu'ils ont suivis dans des juridictions. Comme cela a été souligné par M. Poncelet, une quinzaine de stagiaires sénateurs se sont rendus dans différents tribunaux pour en voir le fonctionnement et en retirer des témoignages et je sais que c'est une chose à laquelle le monde de la justice est désormais très attaché.
Nous aborderons ensuite les différents thèmes évoqués tout à l'heure par M. Poncelet à travers un point liminaire de chacun des sénateurs qui ont travaillé sur ces questions.
Nous ménagerons également, après chaque intervention, un temps de débat avec vous, en nous fixant un maximum d'une demi-heure par thématique afin que cette rencontre soit la plus interactive possible et que s'instaure cet esprit d'échange avec le Sénat qui mène actuellement non seulement son travail législatif mais aussi, comme le disait M. Poncelet à l'instant, une réflexion de fond pour faire avancer la réflexion sur des questions qui, demain, feront peut-être l'objet de nouveaux projets de loi, en dehors de l'activité législative immédiate, tout en facilitant cet échange entre les sénateurs qui mènent ce travail et vous-mêmes qui travaillez au coeur du fonctionnement de la justice.
Le premier à intervenir sera Jean-Pierre Michel, qui a le privilège d'être Sénateur de Haute-Saône et magistrat d'origine et qui a lui-même effectué un stage au Tribunal de grande instance de Bobigny, une juridiction très sollicitée dont on parle beaucoup, d'autant qu'il a été au tribunal pour enfants entre le 11 et le 14 mars 2007.
Stages en juridictions - Intervention de Jean-Pierre Michel
M. Jean-Pierre MICHEL .- Depuis que je suis sénateur, c'est le deuxième stage que j'effectue et je constate que les deux se complètent. Le premier a eu lieu l'année dernière à Castres, petit département avec deux tribunaux de grande instance (TGI), et le second a eu pour cadre le tribunal pour enfant de Bobigny, un gros département qui n'a qu'un seul TGI.
J'ai tenu effectivement à faire ce stage au tribunal pour enfants à un moment où je le dis comme je le pense ce tribunal avait été injustement critiqué, comme les plus hautes autorités de la Cour de cassation l'avaient souligné.
Bien sûr, et ce n'est pas une formule de politesse, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont pris de leur temps pour m'accueillir : le chef de juridiction (je salue M. le Procureur de la République ici présent), ses substituts (ils sont sept au tribunal pour enfants de Bobigny), les juges des enfants, les personnels éducatifs et les greffiers.
J'en viens aux observations que je souhaite faire.
Premièrement, contrairement à ce que l'on peut penser ou dire quelquefois, j'ai trouvé, dans les diverses audiences auxquelles j'ai participé (audiences pénales à juge unique, audiences d'assistance éducative et permanences) que le respect et l'humanité n'excluent pas le rappel à la loi et la sévérité, que les deux choses sont associées de façon très nette et qu'il ne s'agit donc pas de parler d'un certain laxisme qui régnerait au sein de ce tribunal.
Deuxièmement, je tiens à souligner l'engagement de celles et ceux qui travaillent là dans des conditions difficiles. En effet, ce tribunal est déjà à mon avis sous-dimensionné et les locaux qu'occupe le tribunal pour enfants sont à l'extrême limite de la décence, notamment pour l'accueil des personnes, alors que ce tribunal gère ou traite une population très difficile.
Troisièmement, je suis dubitatif sur la politique pénale qui règne dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le parquet n'est peut-être pas le seul en cause et on pourra évoquer aussi les autorités de police, mais j'ai trouvé même si je dois le dire avec précaution, les trois jours qu'ont duré mon séjour étant sans doute insuffisants que le tribunal pour enfants est encombré de toutes petites affaires dans lesquelles il n'y a souvent pas de victimes. Ces affaires bloquent des magistrats du parquet et des jeunes substituts qui sont au téléphone toute la matinée pour s'entendre évoquer une litanie dont l'intérêt est vraiment limité. Lorsque les mineurs sont présentés, ils mobilisent les personnes du service éducatif qui doivent courir dans les couloirs pour voir les mineurs au petit écrou, avoir un rapport et faire en sorte que, lorsque le juge va les recevoir, il ait quelques indications. Nous verrons plus tard que, si la loi sur le point d'être votée est appliquée, il faudra bien que les juges soient en possession de dossiers de personnalité conséquents, ce qui n'est pas le cas partout aujourd'hui, pour prendre les décisions qui s'imposeront.
Tout cela peut aboutir à une audience de cabinet. Par exemple, j'ai vu une audience de cabinet tenue par une juge, d'ailleurs assez sévère, pour deux affaires sans aucune victime concernant quatre ou cinq inculpés de 15 ou 16 ans de milieu gitan et dont les parents étaient présents. Quand on nous dit qu'il faut faire des économies ailleurs, je vous laisse apprécier le temps passé et le prix de cette procédure pour rien. Il n'y avait pas de victime, tout était nié et il ne s'agissait que du vol de la bicyclette d'un copain.
Cela se fait au détriment d'affaires pénales plus graves qui méritent d'être traitées certainement plus rapidement, au fond et avec une certaine sévérité, mais aussi au détriment des audiences d'assistance éducative.
Dans un département comme celui de la Seine-Saint-Denis, j'avoue que ce qui m'a le plus « pris aux tripes », pour employer cette expression un peu vulgaire, ce sont les deux audiences d'assistance éducative auxquelles j'ai assisté et qui concernaient des enfants en danger moral qui vivaient au sein de familles totalement déstructurées et qui arrivaient devant le juge en étant souvent placés, lorsqu'on trouve des places, pour un point d'étape.
Je me souviens d'un môme de 14 ou 15 ans qui était placé et dont le père et la mère étaient séparés depuis quelques années, la séparation ne semblant pas s'être bien déroulée. A la première question du juge, le gosse a pris la main de son père d'un côté et la main de sa mère de l'autre, ce qui en disait long. Dans ces procédures, le juge n'a peut-être pas tous les moyens à sa disposition.
Les éducateurs présents font un gros travail et sont très attentifs devant un tribunal pour enfants, en particulier au pénal. J'ai eu l'exemple d'un enfant placé dont la mère avait eu cinq enfants de cinq pères différents ; quand le dernier arrivait, le précédent était totalement nié. Il s'agissait d'un petit antillais de 16 ans qui avait lancé je ne sais quoi pendant le mouvement contre le CPE. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait fait cela, il a répondu que c'était parce que tout le monde le faisait, et il a précisé qu'il voulait rester en placement car il était très bien, mais on lui a ensuite demandé si sa mère était venue le voir et celle-ci a répondu négativement en expliquant qu'elle ne pouvait pas le faire. Enfin, quand le juge a demandé à l'enfant s'il avait pu voir son petit frère, il a répondu qu'il ne l'avait jamais vu, avant de fondre en larmes parce qu'il avait été condamné à cause des quelques délits qu'il avait commis.
Les juges ont affaire à des populations de ce genre. Je considère donc qu'en matière d'assistance éducative, c'est le juge des enfants qui est le mieux placé et que c'est lui, et non pas une compétence administrative, qui doit être au centre de cette procédure. Même si le Conseil général, dans la loi, aura des compétences de centralisation, je pense que c'est le juge des enfants qui doit être au centre de ces dispositifs car il est le mieux placé.
Voilà les quelques réflexions que je souhaitais exprimer sur les trois jours que j'ai passés au tribunal pour enfants de Bobigny.
Si j'élargis, ces deux stages m'éclairent beaucoup avant tout sur les thèmes qui sont discutés par notre Assemblée et sur lesquels je ne ferai pas de commentaires ici puisque les sénateurs le feront, qu'ils soient de droite ou de gauche, et que, si j'ai bien compris, la Commission des lois a fortement édulcoré le texte qui l'avait déjà été à la suite des observations officieuses du Président du Conseil constitutionnel. Nous verrons ce qu'il en ressort, mais quand je considère la population de Seine-Saint-Denis, je pense que ce n'est pas par ce moyen que l'on traitera le problème de la délinquance des mineurs dans ce département.
Ces deux stages m'éclairent également sur la carte judiciaire. Franchement, le slogan « un TGI par département » n'a aucun sens. Quand je suis allé dans le Tarn, j'ai vu deux juridictions : celle de Castres et celle d'Albi, deux tribunaux qui fonctionnaient très bien avec des chefs de juridiction extraordinaires à chaque fois, et qui s'entendaient parfaitement. Tous les lundis matin, avait lieu une réunion d'audiencement pénal et civil avec le procureur, le président, le bâtonnier, les juges, etc.
La justice était rendue dans des délais rapides et courts, surtout en matière civile, notamment par le juge des affaires familiales, mais aussi en matière pénale. Lorsqu'on dit que la sanction ne doit pas être trop éloignée de la commission de l'infraction, tout le monde est d'accord et cela peut se constater dans ces juridictions. En revanche, lorsque je constate le gigantisme du tribunal de Bobigny, je me demande s'il ne faudrait pas créer un deuxième tribunal en Seine-Saint-Denis, par exemple à Saint-Denis. Certains sont contre, d'autres pour.
Je suppose qu'à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, le gigantisme fait également que les délais d'audiencement sont très longs et que les magistrats, les greffiers et tout le personnel de justice travaillent dans des conditions de rapidité et de stress peu favorables.
Que va-t-il sortir de tout cela ? Je ne suis pas de ceux qui disent, avec une espèce de lâche soulagement, comme le disait Léon Blum après Munich : « Il est bien qu'ils le fassent car cela nous permettra de ne pas avoir à le faire ». A mon avis, la refonte de la carte judiciaire mérite un examen attentif en termes d'aménagement du territoire, de justice rendue et de justice acceptée par les concitoyens. Or, je remarque que, dans un certain nombre de départements, dont le mien, les décisions civiles et mêmes pénales qui sont prises dans ces petites juridictions sont généralement acceptées, ce qui me paraît meilleur qu'une justice qui est contestée. Je ne dis pas que les décisions prises dans les grosses juridictions sont toujours contestées, mais qu'elles sont plus éloignées des gens, qu'elles interviennent plus tard et qu'elles manquent souvent de sens par rapport au procès pénal ou à la demande qui a été faite.
Vous constaterez, mes chers amis, que ces deux stages m'ont beaucoup appris et éclairé sur des sujets qui sont en plein dans l'actualité.
M. Emmanuel KESSLER .- Merci, Monsieur le Sénateur. Les thèmes que nous allons aborder seront un peu différents les uns des autres, même si des éléments concordants vont traverser le débat. Sur les points que vous avez abordés, si quelqu'un souhaite amorcer le débat, je lui donnerai volontiers la parole, car nous allons essayer d'être les plus directs possible dans notre dialogue et ce moment d'échange entre nous ce matin.
M. François MOLINS , Procureur de la République à Bobigny .- Pour faire écho à ce qu'a indiqué M. le Sénateur Jean-Pierre Michel, je tiens à vous faire part de quelques observations.
Nous avons été très heureux de recevoir la visite de deux sénateurs cette année. C'est effectivement l'occasion pour votre assemblée de percevoir l'application pratique des textes qui sont votés, et les effets qu'ils peuvent comporter.
Cependant, je souhaite réagir, après la discussion que nous avons eue avec M. le Sénateur, sur cette politique qui se traduit finalement par le fait que des magistrats peuvent s'occuper de choses qui peuvent apparaître relativement vénielles et qui, il y a quelques années, étaient traitées autrement, voire pas du tout.
Tout d'abord, vous avez vu la conséquence du traitement en temps réel qui fait que l'on traite par téléphone toutes les infractions signalées par les services de police. Les cas que vous évoquez ont effectivement tendance à exploser sous l'influence de deux facteurs :
- la création de très nombreuses infractions par la loi au cours des dix dernières années, ce qui a contribué à pénaliser des choses qui ne l'étaient pas dans le passé ;
- l'explosion des signalements due au partenariat avec l'Education nationale, qui contribue, au niveau des services de mineurs, au traitement d'un nombre très important d'infractions qui peuvent être très graves comme très vénielles.
Au-delà de la justesse de votre observation, il faut savoir garder raison. Nous sommes dans un concept de généralisation des réponses pénales et le travail du magistrat du parquet est justement de faire la part des choses au travers de ce qu'on lui signale. S'il est vrai que cela l'amène à traiter des choses qui peuvent paraître peu importantes, tout est important pour un mineur, l'essentiel étant de ne pas le revoir. Nous utilisons à cet égard des réponses très diversifiées. Les sujets que vous avez évoqués sont traités le plus souvent par des rappels à la loi en maison de justice ou par des mesures de réparation : nous en sommes à plus de 800 en six mois en Seine-Saint-Denis à l'heure actuelle.
Il faut donc avoir à l'esprit qu'au bout du compte, surtout au moment où l'on discute de la récidive, il n'est pas complètement inutile de penser que 80 % des jeunes que nous voyons sur des choses vénielles ne reviennent finalement pas devant le parquet des mineurs, et ne posent plus de souci.
M. Emmanuel KESSLER .- Merci de votre observation. Nous allons poursuivre les interventions sur les thèmes qui ont été retenus, en demandant à chacun de respecter une durée de trente minutes au maximum afin de laisser un temps d'échange et de débat avec chacun d'entre vous.
Nous allons commencer avec le Sénateur Jean Arthuis, ancien ministre, Sénateur de la Mayenne, Président de la Commission des finances du Sénat, qui va évoquer un élément sur lequel il s'est penché dans la Commission des finances, où on s'occupe aussi de justice : l'indépendance de la justice et l'obligation de rendre des comptes. Cette expression « rendre des comptes » peut choquer certains qui se disent que le pouvoir législatif va venir jeter un regard intrusif sur l'autorité judiciaire, et que cela pourrait constituer une entorse à la séparation des pouvoirs, alors que la justice doit fonctionner de façon autonome. Vous allez nous expliquer ce qu'il en est, Monsieur Arthuis.
Indépendance de la justice et obligation de rendre des comptes - M Jean Arthuis, Président de la Commission des finances
M. Jean ARTUIS .- Cet élément fait partie de la Constitution et de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : la société peut demander à tout agent public de rendre compte de son administration.
Naturellement, le point de vue du Président de la Commission des finances du Sénat est un peu particulier, mais je voudrais vous convaincre que ce point de vue ne s'abstrait jamais de cette réalité humaine, qui fait aussi la richesse de l'institution judiciaire.
Je n'ai pas effectué de stage dans l'une ou l'autre de vos juridictions, mais je garde fidèlement en mémoire les travaux que j'avais menés en 1990 avec Hubert Haenel dans le cadre d'une commission d'enquête sur la justice. Nous étions allés à la rencontre d'un certain nombre de juridictions et nous avions été frappés de constater qu'avec des moyens identiques, leurs performances n'étaient pas forcément les mêmes.
Lors d'un récent séminaire de travail de la Commission des finances du Sénat que nous avons tenu au printemps dernier dans la Sarthe, j'ai pu à nouveau toucher du doigt, comme tous les commissaires des finances présents, l'ampleur de votre tâche et les difficultés de la vie quotidienne du tribunal de grande instance du Mans. J'avais alors été frappé, me rendant dans le greffe de la chaîne pénale et pénétrant dans un bureau, de voir le nombre des dossiers répandus par terre, tout autour de la pièce, et le relatif accablement des personnes du greffe, qui avaient à transcrire les procès-verbaux et les comptes rendus des officiers de police judiciaire. Il fallait au moins deux mois pour les transcrire et permettre l'instruction. Lorsque j'ai demandé, très simplement, s'il y avait compatibilité entre les logiciels des officiers de police judiciaire et ceux du greffe, on m'a répondu négativement.
On peut faire toutes les lois que l'on veut sur l'accélération du traitement ; pouvons-nous plus longtemps tolérer de telles discordances entre les différents intervenants dans la chaîne judiciaire ? Très franchement, je ne le crois pas. On me dit que c'est très compliqué parce qu'il y a l'Intérieur d'un côté et la Justice de l'autre, mais je souhaite que l'on en parle très simplement, car il s'agit ici de l'autorité de l'Etat.
Je vais faire un bref retour en arrière sur la LOLF qui, je le sais, vous a donné matière à réflexion et, quelquefois, à souci. Il faut se souvenir des premiers pas de la loi organique sur les lois de finances dans la justice : une entrée sur la pointe des pieds, oserai-je dire, avec des manifestations d'inquiétude de la part des acteurs de l'institution judiciaire. Les propos tenus par les chefs de juridiction, lors de la rentrée solennelle de l'année 2006, témoignaient d'une certaine inquiétude et prenaient parfois une tonalité de protestation. Je souhaite donc que l'on y revienne.
La LOLF n'allait-elle pas remettre en cause le principe d'indépendance de la magistrature ? Les nouvelles dispositions budgétaires ne visaient-elles pas à mettre en adéquation (logique comptable, en quelque sorte) ce qui, par essence, ne peut pas être encadré, à savoir la liberté de jugement et de prescription des magistrats ? Soyons francs : les appréhensions étaient fortes et les critiques n'ont pas manqué.
Qu'en est-il aujourd'hui ? Le bilan d'ensemble, je le crois, mérite un vrai satisfecit. L'entrée en vigueur de la LOLF au 1er janvier 2006, n'a nullement remis en cause le principe d'indépendance de la magistrature auquel le Parlement est tout particulièrement attaché, comme vous le savez. Elle a, en revanche, permis une responsabilisation croissante des acteurs de l'institution, et une meilleure visibilité de la marche à suivre pour optimiser les moyens de la justice.
Le tableau n'est sans doute pas idyllique, et chacun doit convenir que les difficultés n'ont pas manqué, notamment au regard de l'outil informatique qui a parfois manqué au rendez-vous. C'est peu dire que le système d'information comptable et budgétaire au sein de l'Etat n'est pas adapté et que nous attendons la réforme, mais l'institution judiciaire a assumé cette LOLF et je voudrais vous en féliciter car les résultats sont déjà tangibles.
Le meilleur exemple est sans doute celui des frais de justice. Il y avait là à mener une vraie révolution, et les enjeux étaient lourds car la dynamique était préoccupante : une croissance de 22,8 % des frais de justice en 2004 et, la même année, une augmentation des crédits effectivement consommés pour le fonctionnement des juridictions, absorbée à 90 % par la seule majoration de ces frais de justice. Une prise de conscience était donc devenue nécessaire, et une action forte et résolue s'imposait car cela n'était pas tenable.
Dans ce contexte, l'année 2006 a marqué une étape importante dans la gestion des frais de justice et a donc constitué un moment clé pour l'institution judiciaire.
D'un point de vue budgétaire, tout d'abord, ces dépenses ont fait l'objet, dans le cadre de la mise en application de la LOLF, d'un encadrement plus contraignant. L'enveloppe de crédits était limitative alors que, jusque là, les crédits étaient évaluatifs, c'est-à-dire que l'on pouvait engager sans limitation.
D'un point de vue comptable ensuite, les chefs de cour d'appel se sont vu attribuer la qualité d'ordonnateurs secondaires, les préfets exerçant auparavant cette compétence.
Du point de vue de la dynamique de la dépense, enfin, la loi de finances initiale pour 2006 limitait les frais de justice dans une enveloppe de 370 millions d'euros (M€), soit une diminution de 24 % par rapport au montant des crédits consommés en 2005. C'est dire le défi que représentait cette inscription budgétaire. Je dois vous dire qu'au Sénat, lorsque les crédits de la justice sont venus en discussion, nous avons exprimé notre scepticisme au Garde des Sceaux, considérant que vous ne pourriez pas tenir dans cette enveloppe, tant la tendance ainsi imprimée à ces dépenses tranchait nettement avec leur augmentation massive des années précédentes.
Comme vient de nous l'apprendre le projet de loi de règlement pour 2006, vous savez que, désormais, nous passerons beaucoup plus de temps sur les lois de règlement que sur les lois de finances initiales. En effet, les lois de règlement sont les lois de vérité budgétaire, alors qu'il peut arriver que les lois de finances initiales, du fait de quelques effets d'annonce, aient un caractère particulièrement virtuel. Désormais, nous passerons donc beaucoup plus de temps à interroger les Ministres sur l'usage qu'ils ont fait des crédits votés dix-huit mois auparavant.
Cette loi de règlement nous apprend que la consommation des frais de justice a diminué de 22 % en 2006, pour atteindre un montant de 379 M€, contre 487 M€ en 2005. Le dépassement de 9,4 M€, au regard de l'autorisation accordée par la loi de finances initiale pour 2006, a été couvert par recours à la fongibilité asymétrique sur les crédits de fonctionnement. Le programme « Justice judiciaire » a même dégagé, hors dépenses de personnel, un solde de 8,8 M€ et a fait l'objet d'une demande de reports de crédits. Au-delà, il n'a donc pas été fait recours à la réserve prudente de 50 M€ qui avait été constituée. C'est dire la performance que vous avez accomplie.
L'année 2006 a ainsi permis au Ministère de la justice de reprendre la main sur les dépenses jusque là subies, en exerçant et en développant les compétences de gestionnaire qui lui avaient sans doute fait un peu défaut jusque là. J'évoquerai à ce titre quelques chiffres particulièrement parlants.
Si les frais de justice pénale demeurent la composante essentielle de ces frais, avec 262 M€, soit 70 % de l'enveloppe totale, ils enregistrent une baisse de 105 M€, soit 28,6 %. L'imputation de la dépense postale (15,4 M€) sur l'action de soutien du programme « Justice judiciaire » explique, certes, une part de cette diminution. Il reste toutefois, que cette baisse est bien aussi la conséquence de la politique volontariste engagée par la Chancellerie et d'une plus grande responsabilisation des magistrats prescripteurs de la dépense, soucieux, comme tous mes collègues sénateurs, de faire vivre cet article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que je rappelais en préambule à mon propos.
En particulier, les frais de réquisition des opérateurs de télécommunication ont été réduits de 44 %, passant de 69 à 38 M€ grâce à une révision des tarifs correspondants et à une plus juste rémunération des opérateurs de téléphonie. De même, l'année 2006 aura marqué une rupture dans l'évolution des frais de scellés. Après une hausse de 32 % en 2004, et de 35 % en 2005, cette dépense connaît une baisse de 32 % en 2006 : elle est ramenée à un montant de 18 M€.
Une telle diminution de la dépense trouve son origine dans vos efforts pour limiter la mise sous scellés aux seuls objets indispensables à la procédure, pour assurer un véritable suivi des scellés, pour statuer sur le sort des scellés devenus inutiles et pour exiger de la part des gardiens des demandes de paiement régulières.
Ces résultats, convenons-en, sont plus qu'encourageants. Ils doivent être cependant confirmés dans le temps. Disons que, jusqu'à maintenant, on avait peu négocié avec les laboratoires chargés d'identifier les empreintes génétiques et avec les compagnies de téléphonie. La seule négociation a permis un reflux considérable des tarifs qui accumulaient jusque là vos frais de justice.
Je souhaite également souligner la nécessité de résorber le stock de mémoires pouvant se trouver encore dans les régies ou les services administratifs régionaux. Ce stock reste très difficile à appréhender et, dans la mesure où ces travaux n'ont pas fait l'objet d'un mandatement, il induit une sorte d'incertitude préjudiciable sur le niveau exact de la baisse des frais de justice. Il m'est arrivé de penser que les experts judiciaires devaient émettre parfois leurs notes d'honoraires en fonction de la régulation de leurs revenus. J'attacherai un certain prix à ce que, désormais, il y ait un rattachement des dépenses à l'année où elles sont engagées, et qu'il y ait une plus grande célérité dans la production de ces mémoires.
La bonne justice est aussi celle qui rend ses décisions dans des délais acceptables. En la matière, le projet de loi de règlement pour 2006 témoigne de progrès très notables, mais qu'il me soit permis ici de dire que le chemin est encore long et que vous disposez c'est finalement un message optimiste de marges de progression.
A l'exception de la situation devant les conseils de prud'hommes, les délais moyens de traitement des procédures devant les juridictions ont enregistré en 2006 une réduction sensible : 6,58 mois devant les tribunaux de grande instance, contre 6,7 en 2005 ; 13,28 mois devant les cours d'appel, contre 14,2 en 2005 et 18,71 mois devant la Cour de cassation, contre 20,48 mois en 2005.
Pour autant, doit-on se satisfaire de délais que l'on peut encore considérer comme longs ? Si la tâche des magistrats et l'encombrement des greffes ne peuvent être sous-estimés, il faut aussi convenir que le justiciable pâtit gravement de ces lenteurs. Le temps de la justice doit se rapprocher du temps de notre société afin que, tout deux, dans la mesure du possible, marchent du même pas. La compatibilité des logiciels pourrait peut-être y contribuer. Il faut savoir à cet égard que, bien souvent, on fait porter les régulations budgétaires sur les équipements informatiques, moyennant quoi on ne va jamais jusqu'au bout des projets et on n'obtient jamais la pleine efficacité des mesures qui sont prises, mais je ferme cette parenthèse.
Cette ombre au tableau n'est pas sans lien avec la difficile concrétisation des créations d'emplois prévues par la Loi de programmation et d'orientation pour la justice (LOPJ) du 9 septembre 2002. Sur l'initiative de son rapporteur spécial, notre collègue le Président Roland du Luart, la Commission des finances du Sénat a, à plusieurs reprises, tiré la sonnette d'alarme sur les retards pris dans l'application de ce texte. Le projet de loi de règlement pour 2006 vient malheureusement de confirmer ses craintes sur la période 2003-2006. En effet, le taux de créations d'emplois prévues par la LOPJ n'aura atteint que 51,3 %, avec une réalisation prévisible fin 2007 de 63,8 %, soit 2 839 emplois de magistrats et de greffiers créés pour un objectif de 4 450.
Si les efforts réalisés ont permis d'accroître les effectifs de magistrats dans des proportions satisfaisantes, le déficit en créations d'emplois est alarmant concernant les greffiers. Le rapport était ainsi, fin 2006, de 2,73 greffiers pour un magistrat, soit un ratio encore trop faible, avec un rythme des départs à la retraite qui s'accélérera à partir de 2008, et une scolarité rallongée de six mois à l'Ecole nationale des greffes depuis 2003. Cette insuffisance de greffiers fait peser une hypothèque sérieuse sur le bon fonctionnement de l'ensemble du système judiciaire. Ne sous-estimons pas le rôle éminent des greffiers.
Si les moyens humains constituent une condition nécessaire à ce bon fonctionnement, ils n'épuisent pourtant pas la question car, souvent, en matière de réforme, le facteur essentiel de succès réside dans l'état d'esprit du « management » de la juridiction et la considération mutuelle entre les magistrats et les greffiers. La LOLF incite à la prise de responsabilité de la part des gestionnaires, et la révolution de l'institution judiciaire se joue bien au-delà, dans la capacité à produire, non seulement d'excellents techniciens du droit, mais aussi des « managers » performants. Déjà, l'expression choque moins que par le passé. J'oserai dire que c'est un signe de l'évolution des mentalités. Cette capacité à écouter, à mobiliser les équipes et à imaginer des projets de service, peut d'abord trouver à s'appliquer dans la surprenante triarchie qui préside à la destinée de vos juridictions.
Cette disposition de l'esprit doit aussi être mise à profit dans le cadre d'une réforme de la carte judiciaire attendue et désormais annoncée car, à n'en pas douter, les résistances au changement risquent de se manifester et semblent déjà se dessiner à l'horizon. Pourtant, la rationalisation de cette carte semble s'imposer comme une réalité. La France ne peut plus vivre avec des survivances d'une autre époque, et elle doit savoir réaliser les vraies réformes, trop longtemps retardées.
Sur cette question, le Parlement, notamment la Commission des finances du Sénat, a toute sa place. Dans un calendrier serré certains diront précipité , il aura à coeur de faire valoir son expertise, sa connaissance des territoires et ses liens étroits avec l'institution judiciaire, des liens que nous sommes ici même en train de conforter.
Pour conclure, je souhaite une fois encore saluer les efforts accomplis par l'institution judiciaire, et la véritable mue qu'elle entreprend sous nos yeux, et à laquelle peut contribuer la loi organique sur les lois de finances. Apprenez à la caresser, appropriez-vous la LOLF : ce n'est qu'un instrument.
Je tiens cependant à rappeler le législateur que nous sommes à ses propres responsabilités au regard du devenir de la justice. En matière judiciaire, l'inflation législative et, notamment, l'instabilité pénale sont un poison presque mortel, et je parle sous le contrôle du Président de la Commission des lois. Qui plus est, la multiplication effrénée des textes entrave une saine évolution et une saine évaluation préalable de leur impact budgétaire sur les finances publiques. C'est la faisabilité des textes qui est en cause.
Portalis avertissait qu'il ne faut toucher à la loi qu'avec une main tremblante. Assez paradoxalement, ce tremblement pourrait aujourd'hui être le meilleur gage de la justice sereine, humaine et modernisée, que nous appelons tous de nos voeux.
(Applaudissements.)
M. Emmanuel KESSLER .- Merci, Monsieur le Président. Je vois que nous avons quelques demandes d'intervention dans la salle.
Mme Dominique LOTTIN .- Je suis Adjointe du Secrétaire général du Ministère de la justice et responsable de la mission frais de justice.
Je vous remercie, Monsieur le Sénateur, d'avoir souligné les efforts importants réalisés par les juridictions et l'administration centrale dans le domaine des frais de justice. Comme vous le savez, nous avons eu à coeur de défendre le principe de l'indépendance des magistrats à la fois en matière de liberté de prescription et de choix de l'expert. Je crois que nous avons ainsi réussi à démontrer que nous étions capables, tout en préservant cette indépendance, d'avoir des gains en matière de gestion, comme vous l'avez souligné.
Il m'apparaît maintenant nécessaire de parler d'avenir et des années qui vont suivre et de souligner que les juridictions ne pourront évidemment pas poursuivre des proportions de baisses identiques. Il convient désormais de maintenir les crédits à la hauteur des besoins des juridictions en matière de frais de justice et de permettre une revalorisation indispensable de certains tarifs, si nous voulons maintenir la qualité des prestations attendues de nos experts et de nos prestataires. Ces demandes sont en cours devant le Ministère des finances. Je veux parler notamment, du maintien et de l'amélioration de la médecine légale, de l'augmentation des tarifs des psychiatres ou de l'augmentation des tarifs des interprètes.
Il est donc essentiel que, pour les années à venir, les crédits pour frais de justice soient maintenus encore une fois à la hauteur des besoins des juridictions, et nous comptons sur vous aussi pour défendre les besoins des juridictions en ce sens.
Dans une deuxième partie de votre intervention, vous avez parlé de la nécessaire amélioration de l'informatique dans nos juridictions. Vous savez que notre Garde des Sceaux a annoncé un vaste projet de développement et d'accélération de la dématérialisation et de la numérisation. Elle a notamment sollicité auprès des Ministères de l'intérieur et de la défense la création d'une mission interministérielle pour parvenir enfin à ce que nos trois chaînes métiers, celles des enquêteurs et celle du Ministère de la justice, se rejoignent pour être complémentaires, afin que nous obtenions des procédures pénales entièrement dématérialisées. Ce travail est déjà en cours, mais il devrait s'accélérer grâce à la création de cette mission interministérielle qui est demandée par notre Garde des Sceaux.
Par ailleurs, dès le 1er janvier 2008, toutes les juridictions de grande instance seront dotées de matériel nécessaire à la numérisation des procédures pénales ainsi qu'à la communication électronique en matière civile avec les auxiliaires de justice.
Enfin, toujours en matière pénale, je tiens à souligner le début des expérimentations de dématérialisation des procédures en ce qui concerne les procédures contre X et les comparutions immédiates.
Nous avançons dans cette voie. Comme vous l'avez souligné, nous avons besoin de budget. La Ministre a décidé d'en faire l'une de ses priorités pour l'année, et il faut donc qu'au PLF 2008, les budgets soient à la hauteur des besoins des juridictions, qui sont très grands en la matière en ce qui concerne non seulement le matériel, mais l'accompagnement nécessaire dans les domaines notamment de la formation et de l'organisation au sein des juridictions.
M. Emmanuel KESSLER .- Merci de votre témoignage et de votre appel à la vigilance qui a été entendu évidemment par Jean Arthuis.
M. Jean ARTHUIS .- Pour vous rassurer, Madame, je tiens à répéter que nous sommes vraiment admiratifs et qu'il n'est pas question de dire que, puisqu'il a été démontré que l'on pouvait faire baisser les frais de justice de 30 %, on pouvait remettre encore 30 % l'année suivante. L'objectif n'est pas celui-là ; il est d'enrayer une tendance qui finissait par manger toutes vos marges de manoeuvre. C'est précisément parce que vous maîtrisez maintenant vos frais de justice, et parce que vous avez négocié avec les prestataires, que vous allez pouvoir disposer de moyens pour faire face notamment à la numérisation et à la modernisation des moyens de traitement. Il y a à cet égard des gains de compétitivité considérables à trouver.
Sur l'expertise, il m'est arrivé de penser que certains experts judiciaires avaient tendance à traiter vos souhaits sans précipitation, ce qui crée des irritations difficilement supportables par les justiciables. Les niveaux de rémunération doivent donc être convenables, mais il faut aussi que les experts puissent travailler en temps réel, comme ils le font pour les entreprises. Il n'y a pas de raison que les mêmes professionnels, lorsqu'ils sont au service des entreprises, agissent en temps réel alors que, lorsqu'il s'agit de la justice, ils mettent six mois ou même un an avant de rendre un rapport d'expertise, non parce qu'il leur faut plus de temps pour l'expertise mais parce qu'ils vont traiter cela seulement lorsqu'ils n'auront pas autre chose à faire, ce qui est absolument insupportable. Je souhaite donc que vous ayez beaucoup plus d'autorité à l'égard de vos experts en les payant sans doute un peu mieux et en exigeant qu'ayant rendu le service, ils vous le facturent instantanément, et ne jouent pas sur un décalage dans le temps, ce que je trouve assez dérisoire.
M. Denis KNOLL .- Je suis Conseiller à la Cour d'appel de Metz et je souhaite vous entretenir d'une expérience concrète.
Premièrement, tant que l'on en restera au système Word Perfect, on n'en sortira pas parce que le système général utilisé est Word. Par exemple, on ne peut pas scanner de documents : dans certaines cours d'appel, on est obligé d'acheter son petit scanner personnel pour scanner des rapports.
Deuxièmement, l'article 25 de la loi de décembre 2006, qui réforme l'article L 376-1 du Code de la Sécurité sociale sur la nouvelle indemnité des victimes, devait conduire à faire des déductions poste par poste, et il s'avère qu'alors qu'à la Chancellerie j'ai demandé de disposer d'un tableur, on m'a répondu qu'il fallait pour cela Open Office et Word. J'ajoute qu'à chaque fois que la question est posée dans le cadre des discussions syndicales, on répond qu'il faut faire attention au budget et que cela coûte trop cher.
J'ai assisté récemment à une réunion sur le réseau judiciaire européen. De même que nous avons été rejoints en matière d'économie par la mondialisation, nous allons tous être rejoints en matière de justice par l'Europe, où chaque magistrat ne traite pas 430 dossiers par an mais envoie des commissions rogatoires longues parce qu'il prend plus de temps par dossier.
Mme Bernadette DUPONT , Sénateur des Yvelines .- J'ai fait moi aussi un stage en juridiction et j'ajouterai quelques mots à ce qu'a dit mon cher collègue Président de la Commission des finances.
Il a parlé de l'incompatibilité des logiciels et je souhaite évoquer, moi, le manque de coordination entre les administrations. Je retire de mon expérience au Tribunal de grande instance de Nanterre et d'un procès de grand banditisme, que la gendarmerie n'avait pas programmé le transfert des prévenus, ce qui a entraîné plus d'une matinée d'attente de trois magistrats, du greffe et des avocats, sans parler du sénateur, bien sûr, qui était invité. C'était absolument surréaliste ! Tous ces gens ont passé la matinée à attendre les prévenus qui sont arrivés à 14 heures.
M. Michel GAGET , Président du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne .- Je précise qu'avant d'être à Saint-Etienne, j'étais Président du Tribunal de grande instance de Meaux.
Je vous rejoins entièrement, Monsieur le Président, sur le fait qu'il faut absolument que nous ayons une informatique et des logiciels performants. Nous sommes équipés de logiciels trop lents et c'est épouvantable car c'est ce qui nous freine actuellement dans toutes les initiatives que nous pourrions prendre, pour améliorer le contrôle de la gestion. Nous avons donc besoin de ces outils performants au niveau des chaînes pénales et des chaînes ciblées.
Je vous donnerai un seul exemple : j'ai présidé une affaire impliquant 24 prévenus. Rien que pour faire l'en-tête du jugement, il a fallu quatre heures pour un fonctionnaire performant muni d'un logiciel qui reprenait les données ! Cela m'a épouvanté.
Voilà où nous en sommes. C'est cela qu'il faut absolument améliorer. Nous devons absolument avoir des logiciels compatibles avec toutes les autres administrations. En effet, la numérisation ne suffira pas puisqu'elle nécessite des fonctionnaires pour la saisie, alors que le transfert par e-mail et par l'électronique permet de gagner un temps considérable.
L'Etat est extrêmement centralisé pour la justice : c'est le ministère qui choisit les logiciels et les informaticiens qui les créent, et les responsables de juridiction n'y peuvent rien. J'ajoute que l'on va nous imposer un système de communication électronique avec les avocats qui est relativement lent, comme j'ai déjà pu le constater. Cela me fait peur en tant que gestionnaire, je le dis publiquement, alors que nous sommes à l'heure de l'Internet mondialisé et que, chez moi, sur un logiciel privé ou public, cela va beaucoup plus vite qu'au Palais. Je souhaiterais donc que le Sénat s'attaque à cette question fondamentale dans nos palais de justice, si nous voulons gagner la bataille de la gestion.
Mon deuxième point, qui sera très bref, concerne les experts. Il y a deux types d'expertises : l'expertise pénale et l'expertise civile. L'expertise pénale est en général assez bien maîtrisée, mais elle n'est pas toujours très bien payée. L'expertise civile est payée au coût réel, mais on constate que les plaideurs ralentissent les expertises. Pour les parties, c'est un jeu : l'expertise civile devient un vrai sport avec 24 participants, et une masse de papiers que nous n'arrivons pas à maîtriser. Là aussi, il y a quelque chose à faire.
M. Emmanuel KESSLER .- Un mot de conclusion, Monsieur Arthuis ?
M. Jean ARTHUIS .- Votre institution vous me pardonnerez de vous le dire alors que je suis si distant du travail de la justice , au nom de l'indépendance, a voulu assumer elle-même toutes les fonctions. Il fut un temps où la mission informatique était conduite par des magistrats il y avait certainement parmi vous des experts en informatique ; de même, vous vouliez être architectes et vous occuper vous-mêmes des travaux.
Si vous pouviez vous concentrer sur la justice et confier toutes ces tâches de logistique à des spécialistes et à des professionnels, je pense que votre autorité n'en souffrirait pas et que vous en seriez infiniment plus heureux. Ce n'est pas parce que vous demanderez à des administrateurs d'administrer que vous perdrez votre autorité et votre indépendance, bien au contraire. Vous serez d'autant plus exigeants que vous donnerez des instructions, et que vous pourrez blâmer ceux qui ne sont pas à la hauteur de vos souhaits alors que, lorsque vous le faites vous-mêmes, vous vous exposez à une performance relative et c'est toute votre autorité qui se trouve altérée. Par conséquent, de grâce, prenez les meilleurs pour faire de l'informatique.
J'espère que la Chancellerie a bien entendu vos souhaits sur ce point. Il faut faire sur ce point un vrai investissement. Ne le faisons pas à moitié et osons ce que je vais dire est presque sacrilège et cela risque de vous étonner dégrader un peu plus le déficit budgétaire si c'est pour faire un investissement qui portera ses fruits dans le temps. Nos économies budgétaires de demain nous obligent aujourd'hui à quelques investissements. Ne soyons donc pas trop tremblants.
En revanche, quand nous faisons des lois, demandons-nous quelle est leur faisabilité et quelles seront leurs conséquences. Dans ce chaînage administratif, nous pouvons être des sources de complication et de dysfonctionnement extraordinaires. Le Premier Président de la Cour de cassation ne doit donc pas hésiter à faire usage de son droit de remontrance. Que peut dire la Cour de cassation à l'endroit du politique ? Elle peut exprimer de temps en temps des souhaits pour que le politique coordonne un peu mieux son action et ses manoeuvres.
M. Emmanuel KESSLER .- Merci. Il y aurait beaucoup à dire sur ce thème, mais nous devons malheureusement nous arrêter là. Vous savez en tout cas maintenant que, lorsque vous dépensez un euro dans vos juridictions, il est observé de près par Jean Arthuis et les sénateurs de la Commission des finances du Sénat. C'est ce qui vous donne aussi le droit d'exprimer un certain nombre de demandes pour un meilleur fonctionnement de la justice.
Monsieur Haenel, vous êtes Président de la Délégation du Sénat pour l'Union européenne et, à ce titre, vous vous penchez depuis longtemps sur la manière dont l'Europe judiciaire se construit tant bien que mal. Nous allons comprendre avec vous ce qu'il en est depuis qu'un traité simplifié vient de voir le jour.
L'Europe : un espace de liberté, de sécurité et de justice - M. Hubert Haenel, Président de la Délégation du Sénat pour l'Union européenne
M. Hubert HAENEL .- Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, je vais vous parler d'un sujet qui doit répondre à une forte aspiration de nos concitoyens puisque, lorsque nous faisons des réunions publiques sur le traité constitutionnel, notamment, nous entendons continuellement que l'Europe fait insuffisamment ou mal, notamment dans le domaine de la justice, de la sécurité et de l'immigration. Le commun des mortels trouve qu'il n'est pas acceptable de voir aujourd'hui que l'on a supprimé un certain nombre de frontières, mais que celles qui restent ne sont que celles des policiers, des gendarmes et des magistrats.
La Délégation du Sénat pour l'Union européenne que j'ai l'honneur de présider a beaucoup travaillé sur ce sujet. Pour vous en parler, je commencerai par un état des lieux du cadre institutionnel.
La coopération en matière de justice et d'affaires intérieures est très récente. Pendant plus de quarante ans, cette dimension était totalement absente de la construction européenne, qui était d'abord conçue comme un projet de nature économique. Le traité de Maastricht, en 1993, a marqué une étape importante : l'introduction d'une nouvelle politique dite « Justice et affaires intérieures » (la JAI), mais, comme nous allons le voir, elle ne s'est pas faite par son insertion dans le cadre communautaire existant.
Vient ensuite le traité d'Amsterdam qui affirme l'objectif de la mise en place progressive d'un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Le traité d'Amsterdam a aussi profondément modifié le cadre institutionnel de ces matières.
Tout d'abord, les politiques d'asile et d'immigration et la coopération judiciaire en matière civile ont été transférées dans ce qu'on appelle dans notre jargon « le premier pilier ». Cela signifie qu'elles ont été communautarisées. Cette méthode communautaire se caractérise par :
- le monopole d'initiative de la Commission européenne ;
- le vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil en codécision avec le Parlement européen ;
- le contrôle plein et entier de la Cour de justice des communautés européennes, celle de Luxembourg.
Le « troisième pilier », qui regroupe aujourd'hui la coopération policière et la coopération judiciaire en matière pénale, se caractérise au contraire par une logique intergouvernementale.
L'action européenne dans ces matières présente donc plusieurs spécificités par rapport à la méthode communautaire.
Tout d'abord, en ce qui concerne les instruments juridiques, les décisions et les décisions cadres n'ont pas d'effet direct, contrairement aux directives et aux règlements communautaires. Les conventions doivent donc être ensuite ratifiées, et non pas transposées, par les différents pays.
Ensuite, au niveau de la prise de décision, le droit d'initiative est partagé entre la Commission européenne et les Etat membres. De plus, le Conseil statue en règle générale à l'unanimité et le Parlement européen est simplement consulté.
Enfin, au niveau du contrôle juridictionnel, la compétence de la Cour de justice de Luxembourg est limitée.
Dans ce cadre, quelles ont été les réalisations ? Je reprendrai les trois priorités qui ont été retenues lors de la réunion du Conseil européen de Tampere d'octobre 1999 pour la création de ce fameux « espace de liberté, de justice et de sécurité ».
La première priorité est l'harmonisation des législations nationales.
Pour ne prendre qu'un seul exemple, je mentionnerai la décision cadre relative à la lutte contre le terrorisme adoptée peu après les attentats du 11 septembre 2001. Ce texte contient une définition commune du terrorisme et prévoit une harmonisation des sanctions relatives à la direction ou à la participation à un groupe terroriste. Auparavant, je vous rappelle que seuls six Etats membres (les cinq grands et le Portugal) disposaient d'une législation spécifique.
La deuxième priorité est le principe de la reconnaissance mutuelle, qui a été consacré comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire par le Conseil européen de Tampere d'octobre 1999.
Le mandat d'arrêt européen institué par la discussion-cadre du 13 juin 2002 en a offert la traduction la plus concrète. Cet instrument que vous utilisez de façon tout à fait satisfaisante dans l'ensemble, on ne s'attendait pas à ce que les parquets ou les cabinets d'instruction en fassent usage aussi facilement a permis de remédier aux difficultés soulevées par la procédure d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne. Ce mandat d'arrêt européen se caractérise par plusieurs avancées :
- la procédure est entièrement judiciarisée sans intervention du pouvoir politique et donc du Ministère des affaires étrangères ;
- les motifs du refus d'exécution sont limités et le contrôle de la double incrimination est supprimé pour une liste de 32 infractions ;
- l'exception au profit des nationaux ne joue plus ;
- la décision doit intervenir dans des délais stricts, inférieurs à 90 jours.
En France, la transposition de cet instrument est due à la Commission des lois, en particulier au Sénateur Pierre Fauchon, car la Chancellerie, dans sa grande sagesse, n'avait pas imaginé que nous pouvions profiter d'un texte strictement national pour introduire ce mandat d'arrêt européen dans le dispositif dont nous allons maintenant disposer.
La troisième priorité relève des organes de coopération judiciaire.
Les magistrats de liaison, mais aussi le Réseau judiciaire européen facilitent grandement l'échange d'informations et l'entraide judiciaire. A cet égard, je regrette que la Chancellerie n'ait pas créé au moins un magistrat de liaison non seulement dans tous les pays membres de l'Union mais aussi en dehors de celle-ci : nous avons par exemple un magistrat de liaison à Washington. C'est donc un instrument remarquable.
Plus récemment, en 2004, une unité de coopération judiciaire, Eurojust, a été instituée. Cet organe, composé de 27 procureurs ou magistrats désignés par les Etats membres, n'est pas une sorte de parquet européen, mais un organe qui joue un rôle d'aiguillon pour faciliter la coopération judiciaire entre les Etats membres, pour les affaires de criminalité transfrontalière. Il ne fonctionne pas trop mal, mais on pourrait faire, dans ce domaine, des progrès considérables si une volonté politique commune se dégageait au niveau des pays de l'Union.
Je préciserai sur ce point que, comme par hasard, dans le traité simplifié qui a été évoqué à l'occasion du dernier Conseil européen de Bruxelles, nos amis anglais et irlandais se sont mis à l'écart parce qu'ils ne veulent pas entendre parler d'Eurojust ou, du moins, d'un parquet européen.
Cela dit, la France a demandé l'assistance d'Eurojust pour accélérer la transmission d'informations et faciliter l'entraide judiciaire, dans deux affaires qui ont défrayé la chronique : le naufrage de « l'Erika » et celui du « Prestige ».
En dépit de ces réalisations notables, force est de constater que le bilan demeure décevant : l'Union européenne est encore loin d'avoir une approche commune en matière d'immigration et d'asile ; la coopération judiciaire en matière civile demeure insuffisante ; après des débuts prometteurs, la coopération policière a peu progressé ; et la coopération judiciaire en matière pénale paraît désormais plus avancée, même s'il reste beaucoup à faire.
J'en viens aux limites. Je distinguerai trois carences institutionnelles.
La première est un manque de cohérence.
La construction en « piliers », qui doit être supprimée si le traité simplifié est adopté, est source de complexité et constitue un obstacle à une véritable prise en compte de la transversalité. Nous sommes dans un domaine byzantin.
L'indétermination du projet est également à souligner. Le Conseil européen de Tampere a fixé des grandes orientations, mais il n'a pas véritablement défini ce que devrait être le contenu de l'espace judiciaire européen. Faut-il un Code pénal européen pour tout ou pour certaines matières ? Que faut-il harmoniser au niveau européen et quels sont les domaines qui devraient rester de la compétence des Etats membres en vertu du principe de la subsidiarité ? Ce silence du traité n'est pas compensé par une approche politique claire et lisible.
La deuxième est une absence d'efficacité.
La mise en oeuvre des décisions adoptées au niveau européen est particulièrement laborieuse. Les textes européens sont souvent transposés avec retard, incomplètement, voire incorrectement.
L'unanimité aboutit souvent à des blocages ou à des compromis a minima. Ainsi, l'harmonisation des législations nationales en matière d'immigration comme de droit pénal se fait généralement sur le plus petit commun dénominateur. L'Union ayant maintenant 27 pays membres, elle compte 480 millions d'habitants. Il suffit qu'un Etat comme Malte (400 000 habitants) dise non pour qu'il ne se passe rien. Chacun des pays a une sorte de droit de veto et il faut donc vraiment faire de gros efforts dans ce domaine. Vous attendez vous-mêmes beaucoup sur ce point, que vous soyez du siège ou du parquet, de même que les policiers et les gendarmes, mais c'est surtout l'opinion publique qui espère que l'Union européenne ait enfin plus d'efficacité sur ces questions.
La troisième est un défaut de légitimité.
Les questions sensibles d'asile, d'immigration, de police et de justice concernent directement les droits des individus et sont au coeur des interrogations. Or le Parlement européen est simplement consulté, et les parlements nationaux ne sont pas véritablement associés au processus législatif dans ces matières, ni au contrôle d'Europol et d'Eurojust.
Europol est « haut le pied », comme on le dit dans une maison que je connais bien. Vous me direz qu'il y a un conseil d'administration et un conseil des ministres « JAI », mais personne ne contrôle véritablement Europol. Cet organisme vit sa vie, mais, dans un domaine qui touche aux libertés individuelles, il est anormal que le contrôle ne soit pas plus étroit. Il pourrait par exemple être effectué par des représentants des parlements nationaux et du Parlement européen, comme je l'ai personnellement proposé.
Il en est de même pour Eurojust. On n'a pas à contrôler Eurojust puisqu'il s'agit du domaine de la justice, mais on pourrait l'évaluer chaque année et avoir un dialogue avec cet organe, ce qui n'est pas le cas. J'ajoute que, par ailleurs, les compétences de la Cour de Luxembourg sont limitées.
Vous allez me dire que j'ai dressé un tableau bien noir de l'espace de justice et de sécurité. J'en viens donc aux perspectives qui nous sont offertes.
Je commencerai par les avancées prévues par le dernier traité constitutionnel. Ayant été membre des deux conventions chargées d'élaborer la charte des droits fondamentaux puis le traité constitutionnel, je peux vous dire que nous avons fait tout notre possible, dans les travaux précédant le traité constitutionnel, et dans les travaux récents précédant l'accord de Bruxelles, pour renforcer la coopération opérationnelle et créer un véritable parquet européen collégial.
Le traité constitutionnel contenait de nombreuses avancées sur ces aspects. On peut citer ainsi :
- l'octroi de nouvelles compétences à l'Union ;
- la suppression des « piliers » ;
- le renforcement d'Europol et d'Eurojust et la possibilité de créer un parquet européen à partir de ce dernier.
Ces avancées, qui n'ont pas été contestées lors de la campagne référendaire, ont été bloquées du fait des rejets français et néerlandais, mais nous les avons reprises et nous sommes même allés plus loin, si bien que le traité simplifié, que, je l'espère, nous aurons l'occasion d'adopter, est un progrès dans ce domaine.
J'en viens donc aux résultats du Conseil européen des 21 et 22 juin dernier.
Les Chefs d'Etat et de gouvernement sont parvenus à un accord sur les grandes lignes d'un nouveau traité modificatif qui devrait reprendre l'ensemble des avancées prévues par le traité constitutionnel, dans les domaines qui nous concernent aujourd'hui : la justice et la sécurité. Ainsi, la Charte des droits fondamentaux aura une valeur juridiquement contraignante et il sera possible désormais de surmonter le droit de veto d'un Etat dans le cadre de la coopération policière ou judiciaire en matière pénale.
Le Royaume-Uni, comme je l'ai dit, a obtenu des dérogations, mais ce n'est pas très grave : les Britanniques ont un autre système et ils ne sont pas tout à fait dans l'Europe... (Rires.)
Il y a même un aspect que le Conseil européen a amélioré par rapport au traité constitutionnel, celui des coopérations renforcées. A vingt-sept, on ne peut pas imaginer avancer tous en même temps et au même rythme pour toutes sortes de raisons : l'hétérogénéité du système et le fait que certains pays qui viennent de nous rejoindre, ne sont pas mûrs pour s'engager dans une coopération judiciaire et policière, parce qu'ils doivent encore faire des progrès à cet égard et nous apporter la démonstration que nous sommes capables d'avoir des échanges confiants avec leur police et leur justice.
La coopération renforcée, c'est la différenciation. Citons comme exemples les accords de Schengen, l'euro ou, plus récemment, le traité de Prüm que l'on a appelé « Schengen plus ». Cela signifie que quelques pays peuvent se mettre d'accord pour avancer sur un point sans que les autres puissent les ralentir et que, le moment venu, si ceux-ci veulent rejoindre les premiers après expérimentation, ils seront les bienvenus.
Dans le domaine judiciaire, la France et l'Allemagne, rejointes par l'Espagne et la Belgique, ont engagé un projet d'interconnexion de leurs casiers judiciaires respectifs. Le système est opérationnel depuis le mois de mars de l'année dernière, plusieurs pays, comme la Pologne, ont souhaité y participer et d'autres encore sont sur le point de nous rejoindre. Dans une Europe élargie, seul le recours à ce mécanisme pourrait permettre de réaliser de véritables avancées sur les questions de justice et de sécurité. Si vous récupérez un ressortissant de je ne sais quel pays européen, il n'aura pas de casier judiciaire en France puisqu'il n'y est jamais venu, mais il peut avoir commis chez lui un certain nombre d'infractions.
Voilà ce que je voulais vous dire sur les questions de justice, de police et de sécurité. Il faut retenir deux ou trois choses à cet égard.
Tout d'abord, les normes, en matière civile, relèvent pour l'instant de la communautarisation alors qu'au pénal, nous en sommes encore au système intergouvernemental, c'est-à-dire qu'il faut l'unanimité. Je regrette donc que nous ne soyons pas dans le domaine de l'opérationnel.
Ensuite, personne ne veut d'un procureur européen pour des raisons essentiellement françaises : la personnalisation de la justice inquiète beaucoup de gens et, quelles que soient les personnalités au pouvoir, ce n'est pas demain que la France acceptera un procureur européen. En revanche, on pourrait imaginer que l'on sorte de cette question par le haut et que l'on crée un parquet collégial en transformant Eurojust.
Imaginons, monsieur Olivier de Baynast, que vous soyez membre français d'Eurojust. Vous demanderez alors au Ministère de la justice ou aux différents procureurs généraux ou procureurs d'engager des poursuites selon les procédures françaises. Il n'y aurait donc pas une procédure pour tout le monde et je pense que c'est la meilleure façon d'avancer dans le sens d'un parquet collégial.
Enfin, je vous demande d'être attentifs à ces questions en cherchant à convaincre vos sénateurs et vos députés ainsi que les différents organismes professionnels dont vous faites partie pour faire en sorte que, dans ce domaine, on avance plus vite qu'on ne l'a fait jusqu'à présent.
(Applaudissements.)
M. Emmanuel KESSLER .- Merci, Monsieur Haenel. Nous pouvons maintenant consacrer une dizaine de minutes aux interventions dans la salle sur ce point.
M. Olivier de BAYNAST , Procureur général près la Cour d'appel d'Amiens .- J'étais le premier représentant français à Eurojust il y a quelques années.
Je tiens d'abord à dire à M. Haenel que les partisans de l'Europe judiciaire sont sensibles au travail qu'il a accompli avec M. Fauchon. Le Sénat a accompli une tâche qui est sans commune mesure avec quelque autre institution que ce soit dans ce domaine et qui a permis que l'on parle de la justice et de sa réforme d'une façon qui n'est pas uniquement « franchouillarde ». Je continue en effet à déplorer qu'en Europe, alors que la justice concerne tous les gens qui vivent sur un territoire, mais qui viennent parfois d'autres pays, dans ces questions de justice, nous sommes souvent confrontés à une approche de politique politicienne et non pas à une vue européenne.
On attend aussi des assemblées de la vigilance par rapport à l'acquis. L'Europe institutionnelle devrait pouvoir faire des progrès, mais il faudrait déjà que l'on applique les acquis. A cet égard, on constate de véritables scandales qui viennent du fait que la convention d'entraide judiciaire du 29 mai 2000, qui a été tellement souhaitée par les praticiens, n'est toujours pas ratifiée par la majorité des pays. C'est vraiment dommage, parce qu'elle permet notamment d'éviter les blocages liés aux spécificités des droits nationaux.
Toujours au sujet de l'acquis, il faudrait que puisse se créer une culture judiciaire européenne. Nous commençons à cet égard à avoir de véritables problèmes dans l'application du mandat d'arrêt européen car les gens ne se rendent pas compte qu'un tel mandat peut fonctionner. Je peux en témoigner avec ce qui se passe en Picardie : nous en avons plusieurs dizaines par an et cela fonctionne. Pour autant, il ne faut pas en lancer à tout bout de champ : nous passons notre temps à interpeller des gens qui ont volé des paquets de bonbons dans des supermarchés polonais, si je puis dire.
Le temps est donc venu d'avoir une culture judiciaire européenne et, peut-être, d'avoir une école de la magistrature européenne qui se chargerait non pas de la formation initiale des magistrats, mais de l'application de l'acquis communautaire et de tous ces textes européens et qui développerait une culture judiciaire commune, à laquelle pourraient participer aussi les avocats.
M. Emmanuel KESSLER .- Merci de votre suggestion. Plus d'autres remarques ou questions ?
M. Hubert HAENEL .- Si vous voulez en savoir plus sur toutes ces questions d'espace judiciaire européen, vous pouvez consulter le site du Sénat et celui de ma Délégation qui vous permettront de suivre ce que nous faisons, mais aussi de prendre connaissance des auditions auxquelles nous procédons. Nous avons ainsi auditionné Olivier de Baynast, lorsqu'il était à Eurojust, François Faletti qui est à Eurojust aujourd'hui, les différents Gardes des Sceaux et Ministres chargés de l'intérieur. Nous avons également entendu le Commissaire Frattini, qui est en charge des questions de justice au sein de la Commission, ainsi que son prédécesseur, Antonio Vittorino.
Il serait donc intéressant que vous soyez un peu plus « dans le coup » et que vous puissiez constater qu'une réflexion est menée. Je suis toujours étonné que l'on n'entende jamais parler de ces questions au sein des organisations professionnelles de magistrats. Le corporatisme judiciaire ne doit pas avoir seul voix au chapitre dans les débats que les magistrats ont entre eux. Chaque juridiction devrait s'en emparer. Je n'en entends que rarement parler à l'occasion des rentrées solennelles de cours d'appel ou de tribunaux de grande instance. Cela vous permettrait de dire aux parlementaires qui sont devant vous que vous souhaiteriez que les choses bougent. Il y a un courant à créer pour que les autorités politiques, les différents ministres, le Président de la République et le Premier Ministre se disent qu'il faut faire quelque chose.
Par conséquent, je vous en prie : emparez-vous de ces questions car c'est l'efficacité de la justice, de la police et de la gendarmerie en France qui est en jeu.
M. Emmanuel KESSLER .- Merci de cet appel. Nous voyons combien notre dialogue nourrit chacun de vos milieux politique et judiciaire.
Nous passons à l'intervention de M. Hyest, Président de la Commission des lois, qui va évoquer, de façon plus large que le travail législatif mené ce matin dans l'hémicycle, d'où il vient de revenir, les réflexions actuelles que mène la Commission des lois notamment dans le cadre d'un rapport lié à une mission d'information sur les questions de prescription. Cela ne fait pas partie d'un travail législatif immédiat, mais il s'agit d'une question de fond à moyen terme.
La Commission des lois : évaluation et prospective - M. Jean-Jacques Hyest, Président de la Commission des lois
M. Jean-Jacques HYEST .- Il est important de rappeler le travail des commissions, notamment celle des lois, qui consiste, bien sûr, à traiter tous les projets de loi mais de faire aussi des évaluations et de la prospective. Comme les autres commissions, elle a une double fonction :
- élaborer la loi en examinant les projets grâce aux travaux menés par les rapporteurs désignés en son sein, et en proposant le cas échéant, leur modification : le travail d'amendement est évidemment important pour notre commission ;
- assurer une fonction de contrôle de l'action du gouvernement en conduisant elle-même des travaux d'information, sans préjudice de sa participation à des travaux de même ordre communs à plusieurs commissions permanentes, ou dans le cadre de commissions d'enquête.
C'est dans l'exercice de cette fonction de contrôle que le rôle d'évaluation et de prospective de la Commission des lois prend toute son ampleur. Les travaux d'information lui permettent d'évaluer les secteurs de compétences qui sont les siens, au premier rang desquels figure l'administration judiciaire et, plus largement, la pertinence des normes juridiques en vigueur et leur application concrète.
La Commission des lois mène ce travail d'évaluation tout au long de l'année. A l'instar de ce qu'a exposé Jean Arthuis, ce travail prend la forme de déplacements conduits en particulier par les rapporteurs budgétaires désignés par la Commission des lois. A titre d'exemple, sachez que nos collègues Yves Détraigne et Simon Sutour, rapporteurs pour avis de la mission « Justice et accès au droit », ont l'habitude de visiter chaque année plusieurs juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Ils ont pu se rendre dans les Cours d'appel de Paris, Amiens et Lyon ainsi qu'au tribunal de Nîmes en 2006 et, cette année, au Tribunal de grande instance et à l'Ecole nationale des greffes de Dijon. Je précise que ceux qui n'ont pas été servis le seront dans les années suivantes.
Notre ancien collègue Philippe Goujon, alors rapporteur pour avis des crédits de la mission « Administration pénitentiaire », a pu récemment visiter les maisons d'arrêt de la Santé et de Rennes, le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin ainsi que le centre de détention de Casabianda, en Corse. Nul doute que Jean-René Lecerf, qui prend sa suite, aura à coeur de poursuivre ces déplacements.
Ces prises de contact sur le terrain sont essentielles pour évaluer l'application d'une législation dans l'élaboration de laquelle la Commission des lois est fortement impliquée. Elles constituent une base de réflexion pour la commission lors de l'examen des budgets concernés, mais surtout à l'occasion de la discussion de textes législatifs dont la commission aura à connaître. Il en a été ainsi par exemple de la discussion de la proposition de loi relative à l'assurance de protection juridique ou de celle relative à la récidive des majeurs et des mineurs qui débute aujourd'hui en séance publique.
Ce travail s'exerce également dans le cadre de séances d'auditions publiques organisées sur un thème déterminé permettant à la Commission des lois d'évaluer les effets liés à des réformes récentes. C'est ainsi qu'ont été entendues les parties concernées par la question de la résidence alternée des enfants, que Jean-René Lecerf abordera en détail dans quelques instants.
Ces auditions publiques permettent aussi de prendre le pouls des représentants de la société civile sur l'opportunité de réformes prochaines. La Commission a ainsi conduit en 2006 des auditions de représentants du monde judiciaire et juridique, des consommateurs et des entreprises, sur l'introduction en France d'une action de groupe. Elle a pu constater à cette occasion, l'absence de consensus, tant sur la pertinence d'une telle action de droit français, que sur la forme qu'elle pourrait revêtir, le cas échéant. Je pense que ce projet reviendra, compte tenu de l'actualité économique.
Ce travail d'évaluation et d'information, lorsqu'il concerne des sujets nécessitant un investissement particulier, prend la forme de missions d'information le plus souvent constituées par la Commission des lois en son sein. Depuis deux ans, le bureau de la Commission a souhaité que chacune de ces missions d'information soit dotée de deux rapporteurs, l'un émanant de la majorité et l'autre de l'opposition, garantissant un examen pluraliste et favorisant des propositions consensuelles au terme de ses travaux. Elle a ainsi devancé la politique d'ouverture désormais prônée par le Président de la République et le Gouvernement.
C'est dans un tel cadre que la Commission a réfléchi sur la question du recrutement et de la formation des magistrats dont notre collègue Charles Gautier va vous parler dans un instant, sachant que le rapport n'a pas encore été approuvé par la Commission, mais qu'il a été largement élaboré par les rapporteurs.
C'est également sous cette forme que la Commission des lois s'est intéressée de très près à la question des prescriptions, tant en matière civile que pénale. En cette matière, la Commission a considéré qu'il convenait d'évaluer la pertinence des règles de prescription actuelles, qui n'ont pas connu de changement substantiel depuis l'élaboration du code civil et du code d'instruction criminelle.
La prescription est connue de tous pour être désormais un nid à contentieux. Le Président Arthuis a dit tout à l'heure que la Cour de cassation avait son droit de remontrance. Ce n'est sans doute pas le bon terme, mais le fait d'alerter l'attention des pouvoirs publics sur des dysfonctionnements de la législation est une très bonne chose. C'est ce qui est d'ailleurs fait régulièrement dans le rapport de la Cour de cassation et nous nous servons souvent de ses observations pour faire évoluer la législation.
Des projets de réforme existent : un projet d'ordonnance a été rejeté par le Conseil Constitutionnel, à ma grande satisfaction, je dois le dire, car je pense que c'est purement du domaine du législateur. Cependant, il manquait un travail d'évaluation de la situation actuelle pour juger de la pertinence d'une évolution législative en ce domaine. Pour ce faire, la Commission a procédé à plus de trente auditions d'universitaires ainsi que de représentants de la Cour de cassation, des présidents de chambre concernées, des syndicats de magistrats, des avocats et des notaires, des administrations, des consommateurs et des milieux économiques. Ce travail d'évaluation mené pendant trois mois a permis à nos rapporteurs, Hugues Portelli et Richard Yung, ainsi qu'à moi-même en ma qualité de Président de la Commission, de faire deux constats.
Le premier est sans appel : le caractère foisonnant et le manque de cohérence des règles de prescription actuelles donnent un sentiment d'imprévisibilité et, parfois, d'arbitraire.
En matière pénale, la prescription d'action publique, qui obéit à la règle du « un, trois, dix » (un an pour les contraventions, trois ans pour les délits et dix ans pour les crimes) a vu se démultiplier les délais dérogatoires je dois dire que c'est le Parlement qui en est responsable sans que ces exceptions répondent à une vision cohérente. Ainsi, certains délits d'infraction sexuelle sont prescrits désormais par dix ans tandis que d'autres délits, notamment en matière de stupéfiants, se prescrivent par vingt ans. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, heureusement, mais certains crimes, tels que des viols sur mineurs, sont prescrits par vingt ans. D'autres, à l'instar des actes de terrorisme, connaissent une prescription de trente ans, et certains délits punis de peines lourdes connaissent une prescription plus courte que d'autres délits punis de peine moins sévères.
Le sentiment d'arbitraire que peuvent faire naître les règles de prescription en matière pénale résulte également des possibilités reconnues par la jurisprudence : le recours du point de départ du délai de prescription à l'égard des délais occultes ou dissimulés avec une liste totalement aléatoire, sans que la détermination des infractions puisse être dégagée avec une réelle certitude assurant la sécurité juridique.
Quant à la prescription civile, c'est un maquis impénétrable. La Cour de cassation a d'ailleurs relevé plus de 250 prescriptions différentes dont la durée varie de trente ans à un mois ! Certaines règles actuelles sont pour le moins paradoxales, à commencer par la différence de prescription entre l'action en responsabilité contractuelle et l'action en responsabilité délictuelle. Du fait de cette distinction, le passager d'un autobus blessé à la suite d'une collision entre cet autobus et un autre véhicule dispose de dix ans pour agir contre le conducteur de ce véhicule, mais comme il est passager, il a trente ans pour agir contre le transporteur et être indemnisé d'un même préjudice.
Le deuxième constat fait par la mission est également que les règles de prescription du droit français sont inadaptées à l'évolution de la société et à l'environnement juridique actuel. Dans une société où le devoir de mémoire et la vertu restauratrice du procès pénal sont de plus en plus mis en avant, le droit à l'oubli qui illustre la prescription est, dans son principe, fortement mis en question. L'allongement ponctuel du délai de prescription de l'action publique à l'égard de certaines infractions témoigne d'ailleurs de la volonté de poursuivre inexorablement leurs auteurs avec l'aide des progrès de la police scientifique. J'ajoute que nos concitoyens regardent les séries américaines et pensent que la justice fonctionne ainsi.
Or le droit français se caractérise par la brièveté des délais de prescription de l'action publique au regard de ceux retenus par les systèmes juridiques voisins, souvent fixés en fonction de la durée de la peine applicable.
En matière civile, par contre, le délai de droit commun de la prescription extinctive de trente ans se révèle inadapté à une société marquée par les modifications ultimes des relations juridiques intervenant à un rythme sans cesse plus soutenu. Au surplus, les règles de prescription actuelles présentent un décalage de plus en plus marqué avec celles prévues par nombre d'Etats européens, qui retiennent des durées de prescription de droit commun plus courtes. Monsieur le Président Haenel, nous sommes également attentifs à cette évolution, car il conviendrait de rendre un peu plus cohérentes les règles dans les différents pays européens.
Cette évolution a donc abouti à la présentation de recommandations en vue d'une réforme prochaine du droit de la prescription au moins en matière civile. En effet, l'objet des travaux d'information de la Commission est de servir de base et de réflexion sur les réformes à mener. Ils sont le fondement d'une mission de prospective que la Commission des lois a toujours cherché à développer.
Je ne vais pas vous détailler les dix-sept propositions.
M. Emmanuel KESSLER .- Elles ont été données avec les documents qui ont été distribués à chacun (cf. annexe I).
M. Jean-Jacques HYEST .- Il s'agit essentiellement de prévoir un allongement des délais de prescription en matière pénale et un raccourcissement de ces délais en matière civile, même si on peut évidemment discuter des seuils. Il nous paraît en outre que, pour les délais occultes ou dissimulés, il faudrait fixer un délai butoir qui serait le double de la prescription, c'est-à-dire dix ans pour les délits et trente ans pour les crimes.
Nous proposerions aussi d'étendre les délais pour les délits dissimulés. Je citerai à cet égard une affaire qui a fait grand bruit : des personnes âgées semblaient mortes de mort naturelle alors qu'en fait, elles avaient été étouffées. A ce titre, l'auteur avait été poursuivi pour les dernières affaires mais non pas pour la précédente du fait de cette prescription de dix ans. Il faudrait donc améliorer les choses dans ce domaine, parce qu'il n'est pas juste que l'on ne puisse pas poursuivre une personne pour des crimes antérieurs.
De même, dans l'affaire des disparus de l'Yonne, la Cour de cassation a dû augmenter le délai de prescription. Certains ont dit que l'on avait pensé uniquement à l'abus de biens sociaux, qui était tout à fait secondaire dans les travaux de notre mission. Je vous renvoie donc au rapport en question.
Les propositions de réformes sont formulées par la Commission dans le cadre de rapports et n'ont pas elles-mêmes de valeur normative, mais elles ont vocation bien sûr à être prises dans le cadre de procédures législatives. Cette prospective se traduit de manière quasi systématique par l'élaboration de propositions de loi déposées devant le Sénat par les membres de la Commission des lois ayant participé aux travaux d'information concernés. C'est ainsi que plusieurs recommandations issues des travaux de prospective de la Commission des lois ont été intégrées au droit positif.
J'évoquerai particulièrement la possibilité de recourir au placement de bracelets électroniques des condamnés. Cette possibilité a d'abord été évoquée par la mission d'information de la Commission qui s'était rendue en 1994 au Canada, pays précurseur en la matière. Notre ancien collègue Guy-Pierre Cabanel a alors repris cette suggestion dans le cadre d'un rapport remis au Garde des Sceaux en 1996, puis dans une proposition de loi déposée au Sénat la même année. Discuté dans les deux assemblées, ce texte a donné naissance à la loi du 19 décembre 1997, qui a introduit cette modalité d'exécution des peines en droit français. Cela a été très difficile et il y a eu beaucoup de résistance, mais tout le monde pense aujourd'hui que c'est une bonne alternative à la prison, sachant que cela se développe normalement dans un certain nombre de cas.
D'autres recommandations pourraient également se traduire par des dispositifs législatifs, du moins si le gouvernement, maître de l'ordre du jour parlementaire, consent à les inscrire à l'Assemblée nationale, et si cette dernière les accepte.
Tel sera le cas, je l'espère, des travaux menés par la Commission en matière de législation funéraire en mai 2006, dont les recommandations ont donné lieu au dépôt d'une proposition de loi adoptée à l'unanimité par le Sénat mais non encore discutée à l'Assemblée.
Tel est le cas plus sûrement des travaux de la commission d'enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France de juin 2000. Ces travaux ont débouché sur une proposition de loi tendant à créer notamment un contrôle général des prisons que j'avais déposée avec Guy-Pierre Cabanel et qui a été adoptée par le Sénat en 2001. Ce texte n'a jamais été inscrit à l'Assemblée nationale, mais je crois que Mme le Garde des Sceaux a l'intention de le présenter.
M. Emmanuel KESSLER .- Absolument. Cela a été annoncé il y a moins de 48 heures.
M. Jean-Jacques HYEST .- Cela devrait venir au Sénat avant la fin de la session extraordinaire. Le Sénat est satisfait de constater que ses propositions pertinentes sont reprises quelques années après. Ce projet de loi permettra à la Commission des lois de mettre à profit ses travaux passés lors de l'examen du dispositif proposé par le gouvernement.
Le travail prospectif de la Commission est ainsi mené à son terme. Vient alors le temps du travail législatif, le premier venant préparer et éclairer le second en permettant aux parlementaires de voter la loi en connaissance de cause et d'être à l'écoute c'est également très important pour nous de tous ceux qui ont quelque chose à dire sur le sujet. Avant de faire des propositions, nous avons entendu les meilleurs spécialistes des chambres civiles et criminelles de la Cour de cassation, un certain nombre de présidents de cour d'appel, des associations de magistrats et des organisations professionnelles, mais aussi des consommateurs, des entreprises et des assureurs, ainsi que beaucoup d'universitaires, dont les travaux très intéressants, ont permis d'éclairer la mission d'information.
(Applaudissements.)
M. Emmanuel KESSLER .- Merci. Je me tourne maintenant vers la salle. Si quelqu'un souhaite formuler une demande sur un sujet d'étude au Président de la Commission des lois, c'est le moment.
M. Régis de GOUTTES , Premier Avocat général à la Cour de cassation .- Je ferai un petit rectificatif : la Cour de cassation n'a pas de « droit de remontrance ». La Cour peut simplement faire un certain nombre de suggestions et de propositions dans son rapport annuel, parmi lesquelles a figuré à deux reprises, dans deux rapports annuels récents, le sujet des prescriptions en matière civile. Par ailleurs, le Président de la chambre criminelle a eu souvent l'occasion de dire à quel point il attendait une réforme pour la prescription en matière criminelle.
Par conséquent, la Cour de cassation peut faire passer des messages de deux manières : par ses rapports annuels, mais aussi par la jurisprudence de cassation, qu'il ne faut pas oublier et qui contient un certain nombre de messages que le législateur doit lire attentivement, et qui portent parfois sur des insuffisances de la loi ou des souhaits de la voir modifier. C'est donc un moyen d'indiquer ce qui devrait être amélioré.
M. Emmanuel KESSLER .- Quel exemple récent avez-vous en tête ?
M. Régis de GOUTTES .- J'ai en tête la question de la prescription des mineurs. Vous avez cité l'exemple des délits en matière économique. Sachant que ce qui détermine le délai de prescription est le moment de la découverte de l'infraction, il y a, à travers la jurisprudence de la chambre criminelle, un message évident.
M. Patrick BEAU , Procureur de la République à Amiens .- Je précise que je suis Vice-président de la Conférence nationale des procureurs.
Monsieur le Président, vous avez manifesté votre volonté d'être toujours à l'écoute de ceux qui font le travail judiciaire et de ceux qui réfléchissent sur leur pratique professionnelle. Je souhaite donc attirer votre attention sur l'évolution de la fonction de Procureur de la République ces dernières années. En effet, du fait de l'alourdissement et de l'enrichissement des tâches, ce métier a profondément changé tout en restant fondamentalement, comme nous le souhaitons très fortement, un métier de magistrats.
Nous sommes donc très attentifs à l'évolution éventuelle des règles régissant le fonctionnement des parquets et du statut des Procureurs de la République ainsi qu'aux évolutions culturelles. Vous évoquiez tout à l'heure la sensibilité de nos concitoyens aux feuilletons américains ; il n'est pas impossible que les parlementaires soient aussi parfois téléspectateurs. Nous souhaiterons donc avoir l'occasion d'être en dialogue avec votre commission à chaque fois qu'il s'agit de penser au statut des procureurs et à leur activité.
M. Jean-Jacques HYEST .- Soyez assuré, Monsieur le Procureur, que nous y sommes attentifs. Certes, les évolutions récentes font que nous avons alourdi, mais aussi enrichi, comme vous l'avez dit vous-même, la tâche des parquets. Pour autant, il n'est pas question, sauf dans l'esprit de quelques-uns, de songer sérieusement à faire en sorte que les procureurs et les substituts ne soient plus des magistrats. J'ajoute qu'il serait absurde de ne pas permettre à des magistrats d'aller au siège et au parquet.
Certains pensent même que, dans le cursus, surtout pour les jeunes magistrats, il devrait être obligatoire de faire un petit tour au parquet. En effet, c'est un lieu où il y a une équipe. Charles Gautier évoquera peut-être ces questions, mais j'avais eu déjà à les évoquer lorsque j'étais rapporteur du dernier texte sur la responsabilité et la formation des magistrats et il est évident que c'est aussi une bonne école parce qu'on appréhende les réalités au siège, bien sûr, mais on peut le faire également en première ligne.
Bien entendu, lorsque des réformes sont mises en oeuvre ou que l'on fait de la prospective, on entend les magistrats, qu'ils soient du siège ou du parquet. Il s'avère que certaines organisations professionnelles voudraient parler au nom de tout le monde, mais on s'aperçoit assez rapidement aussi c'est heureux que des associations de magistrats spécialisées pratiquent le domaine. Il est important, lorsqu'on fait des réponses de droit civil, d'entendre des magistrats de la famille, notamment des juges d'instruction. Au sein de la justice, il y a des métiers différents, qu'on le veuille ou non, et il est donc important d'entendre ceux qui les pratiquent quotidiennement et qui nous font part de leurs difficultés, comme Jean Arthuis l'a dit aussi ce matin.
J'ajouterai que l'intérêt, pour les parlementaires, notamment pour les sénateurs, de suivre des stages vous en avez des témoignages chaque année qui leur permettent de découvrir un monde qu'ils ne connaissent pas forcément, est de voir à la fois le sérieux avec lequel les magistrats oeuvrent quotidiennement, mais aussi leurs difficultés. Ils découvrent ainsi que l'oeuvre de justice est à la fois passionnante, compliquée et dangereuse, et je suis convaincu que les parlementaires qui sont maintenant nombreux à avoir suivi ces stages connaissent mieux la justice et savent mieux l'apprécier. Je pense donc que cette initiative prise par le président du Sénat en accord avec la Chancellerie est extrêmement profitable.
M. Emmanuel KESSLER .- Merci. Je retire de votre message que vous n'êtes pas favorable à une rupture définitive entre siège et parquet, ce qui est intéressant puisque le point vient souvent en débat.
Nous allons poursuivre notre programme en donnant la parole à Charles Gautier, Sénateur de la Loire-Atlantique, qui va nous donner en avant-première quelques éléments de la réflexion qui est menée actuellement et dont les conclusions seront présentées publiquement en commission le 11 juillet, dans le cadre d'une mission d'information de la Commission des lois, sur le recrutement et la formation des magistrats, qui a fait suite à un texte législatif adopté en fin de législature et dont la portée a donc été assez limitée, même s'il était guidé par l'actualité, du fait des conclusions de l'affaire d'Outreau. Il s'agissait de modifier des éléments dans le recrutement et la formation des magistrats, en essayant de faire quelque chose avant la fin de la législature, ce qui a laissé de nombreuses questions en suspens.
Comme la question va être reprise, l'idée est d'être un peu plus complet et je demanderai donc à M. Gautier de nous dire dans quelle direction travaille cette mission d'information.
Le recrutement et la formation des magistrats -
M. Charles Gautier, Sénateur de la Loire-Atlantique
M. Charles GAUTIER .- Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous saluer ce matin et de participer à ces travaux. Je le suis d'autant plus que j'ai l'impression d'être le prototype de ce que vient de décrire mon Président tout à l'heure : des sénateurs, y compris membres de la Commission des lois, qui ne sont ni de formation ni d'origine du monde juridique ou judiciaire. C'est pourquoi, je me suis porté volontaire lorsqu'il nous a été proposé de faire des stages en juridiction, et je remercie les représentants de ces juridictions de m'avoir agréablement accueilli, que ce soit à Brest ou à Rennes. Je constate d'ailleurs que, dans un cas comme dans l'autre, ils sont assidus à ce rendez-vous des Rencontres sénatoriales de justice.
Il est vraiment d'actualité aujourd'hui d'intervenir dans le domaine du recrutement et du système de formation des juges, en connexion avec le démarrage dans la carrière. C'est tellement vrai que les plus hautes autorités du monde judiciaire se sont exprimées dans l'année ou les mois qui viennent de s'écouler.
J'emprunterai au Procureur général de la Cour de cassation la formule suivante : il s'agit de « l'obligation de forger cette nécessaire humilité, cette capacité d'écoute, de compréhension et d'ouverture sans laquelle l'acte de juger risque de déboucher sur l'incompréhension. » Cela veut dire qu'au-delà de la formation technique ou juridique et de ces règles formelles, il convient évidemment d'aborder tout un contexte de relations humaines, dans lequel les futurs magistrats doivent baigner.
Il a été fait allusion tout à l'heure à cette catastrophe que fut l'affaire d'Outreau et à ses conséquences. Je ne m'étendrai pas sur ce point que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Cela a conduit à la création de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui a été extrêmement suivie et médiatisée, parfois beaucoup trop, qui n'a en tout cas pas permis, par ce moyen, de faciliter la réflexion sur le fond et qui a débouché sur des propositions qui ont déçu un certain nombre d'observateurs.
A cette occasion, le rôle de la formation et les modalités de recrutement ont été évoqués et il était normal que les travaux de réflexion se poursuivent. Depuis, comme cela a été dit, il y a eu une loi adaptant à la marge la procédure pénale, puis la loi organique du 5 mars sur le recrutement et la formation, qui est entrée en vigueur récemment, le 5 juin, et qui portait sur des éléments également assez ponctuels.
C'est ce qui a autorisé la Commission des lois et son Président à poursuivre les travaux de réflexion et c'est ainsi qu'a été créée cette commission d'information avec ses deux co-rapporteurs : mon collègue le Sénateur Fauchon, qui n'a pas pu être présent ce matin, et moi-même. En arrière-pensée, nous avions la volonté de ne pas limiter la formation à des professionnels brillants mais à tout ce qui va autour, c'est-à-dire en les dotant d'un solide bon sens et d'un minimum d'expérience des choses de la vie nécessaires au développement de la faculté de discernement, condition majeure dans l'art du juger. C'est en tout cas notre appréciation.
Une autre question plus ponctuelle a été abordée : le niveau de connaissance juridique compte tenu de la technicité croissante du droit. Vous avez d'ailleurs évoqué ce matin dans un certain nombre de domaines les évolutions qui font que, quel que soit l'apport que l'ont peut donner aux étudiants en la matière, on sera toujours un peu en retard compte tenu des évolutions fulgurantes auxquelles on assiste dans le monde économique, dans lequel la mondialisation vient tout perturber, le monde financier ou le monde médical, notamment dans le domaine de la bioéthique. Le besoin de technicité est donc croissant.
Nous nous sommes comparés à d'autres systèmes et il est vrai que le nôtre est original mais qu'en la matière, il emmène les étudiants vers des niveaux de technicité qui peuvent paraître insuffisants de temps en temps.
Pour faire ce travail dont le Président Hyest a décrit la méthodologie, nous avons procédé à un grand nombre d'auditions de magistrats de tous rangs impliqués dans des juridictions de tailles diverses. Nous avons également auditionné un certain nombre d'auditeurs de justice, notamment des étudiants de l'école de Bordeaux, ainsi que de tout jeunes magistrats issus depuis peu de cette école pour voir comment la greffe se fait dans le premier poste ou le début de la carrière.
Enfin, nous avons effectué trois déplacements : l'un à l'Ecole nationale de la magistrature, à Bordeaux, et les deux autres à l'étranger pour voir deux systèmes extrêmement différents du nôtre et qui ont entre eux une certaine analogie : ceux de l'Allemagne et de l'Espagne. Délibérément, nous avons laissé le Royaume-Uni de côté compte tenu du fait que son système était assez éloigné du nôtre, mais nous ferons plusieurs fois référence dans notre rapport au système britannique ainsi qu'au système italien. C'est donc un tour d'horizon européen qui est fait à cette occasion et je m'appuierai sur les deux grandes expériences allemande et espagnole pour vous indiquer nos champs d'observation, dans lesquels nous avons pu recueillir quelques avis.
Ma marge de manoeuvre est un peu étroite ce matin, comme vous pourrez le reconnaître, en ce sens que le rapport de la commission est en phase rédactionnelle terminale et qu'il sortira le 11 juillet. Aujourd'hui, je ne peux donc que vous en donner des pistes, ce qui représente un inconvénient, mais aussi un avantage : si des avis ou des réactions extrêmement pertinentes peuvent émerger, nous pourrons encore apporter quelques modifications. Je précise que le rapport sera rendu public la semaine suivante, puisque le rendez-vous est pris pour le 17 juillet.
L'Allemagne et l'Espagne constituent des cas extrêmement différents, mais avec un point commun pour les futurs juges : le niveau d'exigence d'une formation juridique extrêmement poussée, beaucoup plus qu'en France.
Tout à l'heure, le Président Haenel a fait allusion aux magistrats de liaison. Je tiens à cette occasion à les remercier parce que tout ce que nous avons pu faire, dire, voir ou entendre en Allemagne ou en Espagne, n'a été possible que grâce à leur collaboration extrêmement précieuse. J'avais déjà eu l'occasion d'user de leurs compétences sur une autre mission et je peux témoigner de leur excellent apport dans notre travail.
Je commencerai par le cas allemand. La première grande caractéristique de l'Allemagne, c'est que, dans cet Etat fédéral, le recrutement et la formation des juges relèvent de chaque Land. C'est pourquoi nous avons dû faire deux points de visite : l'un à Munich, pour le Land de Bavière, et l'autre à Berlin, capitale fédérale, pour mesurer ce qui relevait d'une nature plus globale.
La deuxième caractéristique, c'est que la formation généraliste est commune, en Allemagne, à tous les métiers du droit. La différenciation se fait donc très tardivement dans le cursus de formation. Quand j'évoque tous les métiers du droit, cela recouvre non seulement les magistrats du parquet ou du siège (je précise sur ce point que leur système est assez proche du nôtre, c'est-à-dire que les gens font plutôt carrière dans l'un ou dans l'autre, mais avec un passage possible, même s'il est plus rare que chez nous et si cette rareté peut nous interpeller eu égard à la question qui a été posée précédemment), mais aussi les avocats, les notaires et les huissiers. Tous suivent la même formation.
Cette formation est longue et le recrutement des juges n'intervient qu'à l'issue d'un cycle de formation très complet alors que, chez nous, leur recrutement est inséré entre une formation universitaire commune et une formation spécifique qui se fait à l'école de Bordeaux. C'est le concours de recrutement à cette école qui sert de concours de recrutement dans le corps judiciaire.
En Allemagne, la formation initiale des juges comprend deux périodes :
- une période exclusivement universitaire, qui dure au minimum quatre ans avec un flux d'environ 20 000 personnes par an ;
- une période centrée sur des pratiques professionnelles des métiers du droit, qui dure environ deux ans.
Cela veut dire que, si tout se passe bien, la formation dure six ans.
Après la première période, il y a ce que l'on appelle le premier examen d'Etat, qui n'a pas lieu obligatoirement tous les ans et qui est organisé par les Lander et non pas par l'université.
C'est ensuite que débute la deuxième période qui s'appelle le Referendariat. Cela veut dire que l'étudiant est référendaire. Il n'est pas fonctionnaire, mais il dispose déjà d'une bourse ou d'un présalaire qui est assez modeste mais qui lui permet de poursuivre ses études. Le flux est d'environ la moitié du nombre que je citais précédemment, c'est-à-dire environ neuf à dix mille personnes par an.
C'est pendant ces deux années que se déroule de façon prioritaire, une période de quatre stages pratiques, l'un pour le civil, le deuxième pour le pénal ou le parquet, le troisième pour l'administratif et le quatrième pour les avocats, d'une durée de trois à neuf mois. On ajoute à cela un cinquième stage optionnel qui relève de la personnalité, ou de l'ouverture vers le monde civil ou associatif, ou vers une expérience particulière, la gamme étant extrêmement large. Durant ces stages, il est dégagé du temps pour suivre des cours de procédure.
Ce sont les cours d'appel qui organisent ces deux années de stage, ce qui signifie que les personnes sont prises en charge par l'organisation juridique. C'est à l'issue de cette deuxième période que vient le deuxième examen d'Etat, sur lequel il y a, cette fois, assez peu d'échec : environ 10 %.
Comme le disait Sacha Guitry, quand on se regarde, on se désole, et quand on se compare, on se console. Il est vrai que, lorsqu'on se penche sur des exemples à l'étranger, on y trouve souvent toutes les vertus spontanément et sans y être allé, et c'est lorsqu'on approche ces systèmes, ou que l'on interroge les personnes concernées, qu'arrivent les critiques. Deux grands débats ont lieu là-bas.
Le premier concerne le protocole de Bologne qui a été signé par 45 pays européens ou en voie d'entrer dans l'Union. Il porte sur la convergence des cursus de formation. Il faut savoir que cette formation est extrêmement originale, puisqu'elle n'est ni française, ni anglaise.
Le deuxième débat porte sur l'opportunité d'avoir une filière commune et exclusive à toutes les procédures juridiques. En effet, alors qu'un effort considérable est déployé pour former des juges, ils se destinent à 80 % à exercer une autre fonction. Vous voyez quel problème cela peut poser.
Le recrutement des juges, qui relève du deuxième examen, est complété par des entretiens sur les compétences sociales. J'ajoute qu'à la différence de ce qui se passe chez nous, il n'y a qu'un recrutement en filière unique, et que l'originalité du système allemand se vérifie également dans le début de carrière : dans les premières années, le débutant est juge stagiaire pendant trois ans et il ne peut pas être juge aux affaires familiales pendant cette période. Il n'est alors pas inamovible, mais il doit passer obligatoirement un certain temps au parquet, il est régulièrement évalué par le Président et le Procureur de la juridiction auxquels il est confié, et il est révocable à tout moment.
J'en viens aux grandes caractéristiques du cas espagnol. Là aussi, on constate une forte décentralisation puisqu'on compte dix-sept communautés autonomes. La décentralisation va même jusqu'à la reconnaissance de lois locales, ce qui fait qu'il est assez compliqué de gérer les problèmes de mobilité des juges parce que les références catalanes ne sont pas forcément celles de Séville.
Par ailleurs, il y a là-bas une stricte séparation entre le parquet et le siège, au point qu'elle a même lieu avant la formation. En effet, il existe deux écoles distinctes et c'est pourquoi nous avons dû faire deux haltes en Espagne, l'une à Barcelone pour le siège et l'autre à Madrid pour le parquet.
Le recrutement se fait sur concours, mais après une formation extrêmement longue d'au moins cinq ans d'études supérieures. Ces années, contrairement au système français, ne sont pas sanctionnées année après année : le concours n'a lieu qu'à la fin du cursus, ce qui représente un risque considérable pour ceux qui le tentent et ce qui a fait l'objet de grandes discussions entre nous.
De même, le concours est unique pour le siège et le parquet, et la séparation se fait à l'entrée de l'école puisque, en fonction du rang de classement à ce concours, on choisit l'une ou l'autre carrière sans pouvoir jamais y revenir.
C'est un conseil général du pouvoir judiciaire qui organise le concours et qui gère la carrière des juges du siège, alors que, pour le parquet, c'est le pouvoir politique qui en a l'autorité.
Voilà ce que je voulais vous dire sur le système espagnol.
Quant à nous, nous débouchons sur trois niveaux de préconisations de différentes densités.
Sur le recrutement, nous recherchons des gens qui ont des compléments par rapport à la capacité juridique. A l'évidence, cela consiste à renforcer ce qui existe déjà puisque plusieurs filières permettent d'entrer dans la magistrature, sachant qu'il convient de regarder de près les unes et les autres, et que nous donnerons notre appréciation sur ce sujet.
En ce qui concerne la formation, nous avons entendu, non seulement chez nous, mais aussi à l'étranger, de nombreuses louanges concernant la qualité de l'école de Bordeaux, et nos propositions sont donc loin de bouleverser le système établi aujourd'hui.
Au demeurant, ce que nous proposerons aura tendance à remédier à l'isolement et au cloisonnement de l'école, à renforcer l'efficacité des stages et, peut-être, à nous interroger sur le caractère probatoire de la formation, puisqu'il faut bien se dire que, même si ce point est partagé avec beaucoup d'autres grandes écoles en France, lorsqu'on entre dans l'école, on en sort toujours par le haut et que seuls des accidents empêchent que ce soit le cas.
Enfin, notre troisième niveau de préconisation porte sur les débuts de carrière, en évoquant un certain nombre de systèmes permettant d'apporter un filet de sécurité aux jeunes magistrats. A l'évidence, c'est ce qui a dû manquer un certain nombre de fois. Nous avons parlé tout à l'heure de l'affaire Outreau, et je ne reviendrai pas sur la jeunesse du magistrat concerné parce que ce n'est pas cela qui en est la cause, mais c'est néanmoins le cas et, pour la petite histoire, je précise que ce poste est de nouveau vacant et qu'il sera pourvu par un magistrat sortant de l'école, même si je ne ferai pas de commentaires sur ce point.
Voilà ce que je voulais vous dire.
(Applaudissements.)
M. Emmanuel KESSLER .- Merci. Je vous précise qu'un document de travail du Sénat fait le point sur les législations comparées dans un certain nombre de pays européens, en ce qui concerne l'état du recrutement et de la formation des magistrats.
Mme Louisa AIT HAMOU , Substitut du procureur au TGI de Lille .- Vous venez de nous parler, Monsieur le Sénateur, des projets qui sont à l'étude concernant le mode de recrutement des magistrats.
Je souhaite surtout revenir sur l'aspect du recrutement. En effet, vous avez parlé de l'affaire Outreau et, comme vous avez terminé votre propos en disant que, finalement, la jeunesse du magistrat n'était peut-être pas le seul élément qui motivait les projets de modification du recrutement des magistrats, j'ai envie d'enfoncer les portes ouvertes en disant qu'à mon avis, la jeunesse n'est un gage ni de qualité, ni d'efficacité, mais que le fait d'avoir 50 ou 55 ans n'est pas non plus un gage d'efficacité ou de qualité. L'essentiel est l'état d'esprit. Sauf erreur de ma part, on peut être député à 28 ans et voter des lois que nous sommes chargés d'appliquer. Le fait de voter des lois est quelque chose de grave et je répète que les députés peuvent être élus à 28 ans.
M. Emmanuel KESSLER .- Ils ne sont pas seuls à apprécier, quand même.
Mme Louisa AIT HAMOU .- C'est vrai, mais les magistrats ne sont pas tous jeunes non plus.
J'ajoute que, sur la liste des recrutements, il faudrait évoquer la question du profil de l'auditeur de justice, une question qui dépasse l'école de la magistrature et qui est commune à toutes les grandes écoles de notre pays. Le profil de l'auditeur de justice est une personne qui a 26 ans vous le dites dans votre rapport , ce qui signifie qu'il sort de l'école à environ 29 ans. Je ne pense pas que cela soit un si jeune âge pour commencer à travailler.
De même, il faudrait peut-être réfléchir à un élargissement du recrutement au départ, afin qu'il corresponde davantage à la sociologie de notre pays. C'est une voie à explorer car cela me semble important.
Véronique MALBEC , Directrice adjointe de l'Ecole de la magistrature .- J'ai été évidemment particulièrement intéressée, Monsieur le Sénateur, par votre rapport qui va sortir le 11 juillet.
Je reviendrai en quelques mots sur la loi organique du 5 mars 2007 que vous avez évoquée assez rapidement alors qu'elle contient déjà des avancées conséquentes, puisqu'elle a rendu la formation continue obligatoire, ce qu'il convient de noter : jusqu'à présent, nous avions un droit à la formation continue de cinq jours par an alors qu'à partir du 1er janvier 2008, l'ensemble du corps, c'est-à-dire 8 100 magistrats, si on inclut à la fois les détachés et les mis à disposition, devra venir à l'Ecole de la magistrature, dans le cadre de la formation continue déconcentrée, pour suivre cette formation continue obligatoire. Je pense que c'est une avancée importante eu égard à ce que vous disiez sur la technicité des lois qui exigent du magistrat une adaptation au quotidien.
Je précise, par ailleurs, que ce texte a également modifié la scolarité initiale à Bordeaux, en augmentant de façon conséquente le stage avocat, qui est passé de deux à six mois minimum, l'Ecole ayant choisi de le limiter à six mois. Cela représente un cinquième de la scolarité des futurs magistrats et va nous obliger à revoir de A à Z le séquençage, en diminuant les parties importantes de la scolarité de l'auditeur de justice, c'est-à-dire la formation bordelaise et le stage en juridiction.
Enfin, j'évoquerai un dernier point lié à ce nouveau texte : celui qui concerne le recrutement. La loi organique a en effet modifié le recrutement en rendant possibles des recrutements beaucoup plus importants, non pas par les voies du concours étudiant, mais par des voies externes, c'est-à-dire à la fois les concours administratifs et les recrutements de l'article 18. Je pense donc déjà que cette loi organique, même si elle n'est pas uniquement liée à la formation des magistrats, a modifié considérablement la formation initiale et la formation continue.
Pour terminer, je vous remercie de vos propos sur la scolarité à l'Ecole. Il est vrai qu'elle est connue dans le monde entier, puisque nous recevons de nombreuses délégations étrangères et qu'on nous demande énormément de magistrats à l'étranger. Je crois cependant que nous sommes perfectibles, et c'est la raison pour laquelle nous attendons avec beaucoup d'intérêt, Monsieur le Sénateur, la sortie de votre rapport, votre visite à Bordeaux ayant été extrêmement bénéfique.
M. Franck NATALI , Président de la Conférence des bâtonniers .- En écho à ce que vient de dire la Directrice adjointe de l'Ecole nationale de la magistrature, je souhaite apporter deux ou trois observations en me permettant d'intervenir dans ce débat auquel j'ai eu le plaisir d'être invité à partager les réflexions du Sénat qui sont toujours très enrichissantes, sachant que, généralement, il n'y a pas beaucoup d'avocats.
Ma première observation concerne la formation continue, dont les avocats font l'expérience depuis trois ans à raison de vingt heures par an. Cela n'a l'air de rien, mais sachez à titre d'expérience, que cela bouleverse beaucoup de choses dans la profession d'avocat et nous oblige à créer des synergies au sein de la profession, à remettre en cause des pratiques professionnelles et à permettre aux uns et aux autres de se retrouver dans ces cycles de formation. Cette formation continue est en train de bouleverser beaucoup de choses dans l'exercice de la profession d'avocat, notamment sur les notions de compétences et d'échanges.
Comme la formation continue fait partie de la loi organique du 5 mars 2007, peut-être aurons-nous un échange à faire dans ce cadre.
Ma deuxième observation sera consacrée au stage qui devra désormais être suivi pendant six mois dans un cabinet d'avocats. Nous n'avons pas tous encore bien mesuré l'importance de ce stage qui va être initié à partir d'octobre 2008, si j'ai bien compris, mais il semble que plus de 200 stagiaires vont arriver dans un premier temps dans les cabinets d'avocat. Soyez en tout cas assurés à cet égard qu'en liaison avec l'Ecole, nous cherchons des stages de qualité.
Il est donc un fait que, pour éviter les cloisonnements et les regards en chiens de faïence que nous avons trop souvent déplorés, il va s'instaurer une nouvelle synergie commune entre avocats et magistrats, qui permettra un meilleur fonctionnement et qui amènera les futurs magistrats à être placés en immersion dans les cabinets puisque, si je l'ai bien compris, il s'agit de véritables stages d'immersion.
Je tiens simplement à vous assurer qu'en ce qui concerne notre Conférence et les différents ordres, nous allons nous mettre au travail pour que les stages offerts aux futurs magistrats soient de qualité afin qu'ils ne se résument pas simplement à la formule : « Venez passer quinze jours dans mon cabinet pour quitter vos audiences », et qu'une véritable relation de synergie puisse s'instaurer. Je pense que, sur ce point, quelque chose se passe au sein du monde judiciaire et cela me paraît vraiment tout à fait essentiel.
Une intervenante .- Je suis auditrice de la promotion 2005, c'est-à-dire que je suis actuellement en stage de pré-affectation et que je vais prendre mes fonctions dans quelques mois. Je tiens à faire quelques remarques.
Vous avez dit, Monsieur le Sénateur, que lorsqu'on entre à l'école, on est quasiment sûr de devenir magistrat. Sachez que, dans ma promotion, nous étions 286, tous auditeurs confondus, c'est-à-dire ceux qui ont passé les premier, deuxième et troisième concours ainsi que les recrutés au titre de l'article 18-1, et que nous sommes 275 à sortir.
M. Emmanuel KESSLER .- On me dit que c'est la première fois dans l'histoire de l'Ecole.
L'intervenante .- C'est faux : chaque année, il y a des redoublements et des exclusions.
M. GAUTIER .- A ce nombre-là, les échecs ne représentent que quelques unités sur environ trois cents, quand même.
L'intervenante .- Cela signifie cependant que nous n'avons pas la garantie de devenir magistrats. J'ajoute que certains auditeurs, bien qu'ayant le concours, vu la difficulté du métier et l'intensité du travail qu'on nous demande, renoncent d'eux-mêmes à exercer la profession.
Par ailleurs, s'agissant du poste de juge d'instruction à Boulogne-sur-Mer, je précise qu'il a été choisi par le major de la promotion qui n'est pas elle-même issue du premier concours (le concours étudiant, qui fait visiblement le plus débat) mais qui a été recrutée au titre de l'article 18-1.
M. Emmanuel KESSLER .- Elle avait donc déjà une expérience professionnelle antérieure.
L'intervenante .- Exactement.
De même, je dirai à Mme la Substitut de Lille que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas juger avec humanité, et que l'on n'a pas les capacités pour faire notre travail.
Enfin, en ce qui concerne le stage avocats, je préciserai que j'ai suivi avec mes collègues un stage avocats de seulement deux mois, que je l'ai effectué en décembre et qu'il est tombé pendant l'examen de classement, ce qui fait que nous n'étions absolument pas concentrés sur notre stage du fait de la nécessité de penser à notre relogement à Bordeaux, sachant que, selon le résultat de l'examen de classement, nous obtenons ou non la fonction qui nous plaît ou la préservation de nos vies familiales. Nous n'étions pas toujours très investis dans ce stage et les avocats, qui nous connaissaient souvent en tant qu'auditeurs et qui nous avaient entendus requérir au parquet, par exemple, n'étaient pas toujours enclins à nous laisser regarder tous les dossiers, puisque nous faisions nos stages dans les barreaux de nos juridictions.
Je suis ravie de constater aujourd'hui que, du côté des avocats, on va prendre la mesure du stage avocats pour les auditeurs, et je tiens à préciser que si le stage total est prévu pour une durée de six mois, c'est souvent un stage plus long que celui que nous aurons pour notre premier poste. La formation d'avocats prend donc une ampleur toute particulière avec cette réforme.
M. Emmanuel KESSLER .- Ce que vous dites est important et nous permet de constater combien les rencontres comme celle-ci sont importantes, dans la mesure où elles permettent la rencontre de professions qui appartiennent au même monde, mais qui sont parfois cloisonnées.
Mme Claire ESTEVENET , V ice-présidente du TGI de Senlis .- En ce qui concerne le bon sens du magistrat, je tiens à dire que l'intérêt de la formation initiale à l'Ecole nationale de la magistrature était non seulement de permettre les stages extérieurs (je suis partie deux mois à Madrid pour faire un devoir comparé sur la justice espagnole), mais aussi de faire des stages avec les huissiers, la police et la gendarmerie. Je crains donc que l'allongement de la procédure du stage avocats à six mois ne se fasse au détriment d'autres stages à l'extérieur.
Dans le cadre de l'ouverture d'esprit, il faut, certes, avoir à l'esprit le droit de la défense, mais il faut aussi connaître le fonctionnement de tous nos partenaires et auxiliaires de justice par la suite. Je m'inquiète donc de constater cette réduction de l'ouverture d'esprit uniquement à un stage sur la défense et ses droits.
M. Emmanuel KESSLER .- Monsieur Gautier, vous voyez à quel point vos propositions et votre réflexion sont attendues, tant ces éléments soulèvent d'intérêt face à ce que vous vivez tous ici en tant que professionnels ou futurs professionnels de la magistrature. J'y ajouterai la question de savoir si vous êtes favorable à ce que des personnes qui ont eu une longue carrière professionnelle puissent devenir magistrats, comme cela se fait dans certains pays, notamment au Royaume-Uni, avec les difficultés liées à la rémunération que cela implique. En effet, quand on a travaillé dans une entreprise, il peut être intéressant d'avoir une expérience que l'on met au service de la justice, mais on ne peut pas pour autant obtenir le salaire d'un magistrat.
Vous nous donnerez votre position sur cette question et je vous demanderai ensuite de conclure rapidement avant de laisser M. Lecerf procéder à la dernière intervention de la matinée.
M. Charles GAUTIER .- Je ne conclurai pas car je partage tous les questionnements qui ont été exprimés et que nous nous posons à nous-mêmes. En effet, nous n'avons pas une vision interne qui s'impose et des échos externes qui viennent nous percuter. Tout cela se percute chez chacun d'entre nous. Le problème n'est pas là, bien évidemment : il s'agit surtout d'un problème d'expérience. Quand on constate que les postes à risques sont majoritairement proposés à des personnes dont l'expérience n'est pas démontrée, je trouve que c'est la société qui prend un risque.
Mme Claire ESTEVENET .- Qu'est-ce qu'un poste à risque ?
M. Charles GAUTIER .- Je vous donne un exemple : en Allemagne, le jeune magistrat sera en fonction, mais il sera en co-pilotage, pour le dire ainsi, et un poste lui est interdit pendant un certain temps : celui des affaires familiales. Pourquoi ? Tout simplement parce que, dans ce pays, on a sans doute considéré que c'était un poste à risque, et qu'il valait mieux avoir plus d'entraînement avant de se lancer dans ces affaires.
Jérôme BOURRIER , Substitut au parquet de Bordeaux .- Se pose-t-on la question pour un directeur de cabinet d'un préfet qui a en charge l'ordre public sur toute une circonscription et qui a 28 ans ?
M. Charles GAUTIER .- J'espère que certains se la posent... (Rires.)
M. Emmanuel KESSLER .- Il est vrai que vous avez le pouvoir de cet acte terrible de la mise en détention d'un individu...
(Réactions diverses dans la salle.)
Je vous propose d'organiser un prochain colloque sur ce thème à la suite de la discussion sur le rapport de M. Gautier, tellement ce sujet semble passionnel.
Nous allons terminer avec une autre affaire passionnelle ou parfois difficile, celle du divorce ou de la séparation dans les familles, à travers le travail qu'a effectué la Commission des lois sur la résidence alternée et l'éventualité de retoucher un certain nombre de dispositifs. C'est sur ce point que nous conclurons notre matinée, sachant que nous sommes là dans une matière concrète, dans l'observation de ce qui se passe et dans la nécessité d'ajuster les dispositifs existants et non pas forcément dans la recherche d'une loi nouvelle.
Je rappelle à tous que, parmi les documents préparés à votre intention pour ce colloque, il vous a été remis le compte rendu d'une journée d'auditions de la Commission des lois sur le sujet de la résidence alternée (cf. Annexe II), et que M. Jean-René Lecerf, sénateur du Nord et membre de la Commission des lois, était rapporteur de ce dossier.
La résidence alternée - Jean-René Lecerf, Sénateur du Nord
M. Jean-René LECERF .- Je vous prie tout d'abord de m'excuser de n'avoir pas pu participer à l'ensemble de vos travaux, sachant que, comme bien des collègues, nous avons dû nous partager entre l'hémicycle et ces Rencontres sénatoriales de la justice.
On m'a demandé de faire un rapide bilan de ce problème de la résidence alternée et d'en dresser les perspectives, ce dont je vais tenter de m'acquitter avec beaucoup de plaisir.
Comme vous le savez, c'est la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale qui a jeté les bases légales de l'organisation d'une résidence alternée des enfants au domicile de leurs parents en cas de divorce ou de séparation.
Le législateur avait deux objectifs essentiels : permettre des relations suivies avec les deux parents et permettre d'assurer la parité homme/femme ou père/mère dans l'exercice de l'autorité parentale.
En 2002, le législateur était parfaitement conscient des contraintes pratiques importantes imposées aux parents en matière de résidence alternée, de la nécessité d'une collaboration constante du père et de la mère et des avis, parfois partagés des spécialistes de l'enfance, sur les conséquences, pour l'enfant, de la résidence alternée. C'est la raison pour laquelle le législateur a laissé de larges pouvoirs d'appréciation au juge aux affaires familiales, qui peut imposer la résidence alternée ou s'y opposer au nom de l'intérêt de l'enfant.
La loi de finances rectificative pour 2002 a autorisé le partage des avantages fiscaux liés à la présence des enfants en alternance au domicile de l'un ou l'autre parent et, comme vous le savez, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, prévoit le partage des allocations familiales à l'exclusion de toute autre prestation.
Pour commencer, je m'efforcerai de dresser un bilan de ces mesures. Vous constaterez que, d'une part, la portée pratique de ces mesures est encore limitée et que, d'autre part, elle est contestée.
La proportion des enfants faisant l'objet, par décision judiciaire, d'une résidence en alternance n'était que de 11 % en 2005. La résidence est fixée chez la mère dans 78 % des cas, pourcentage qui diminue au fur et à mesure que l'âge augmente, et elle est fixée chez le père dans 10,3 % des cas, pourcentage qui augmente avec l'évolution de l'âge. La résidence en alternance est marginale dans les toutes premières années de l'enfant, puisqu'elle est inférieure à 2 % jusqu'à 1 an, qu'elle atteint 10 % à 3 ans et qu'elle culmine à 13,8 % à 9 ans. J'ajoute que les trois quarts des enfants en résidence alternée ont moins de 10 ans, l'âge moyen étant de 7 ans.
On note également un faible recours à l'aide juridictionnelle (une procédure sur cinq seulement), ce qui semble signifier que les parents qui demandent ce mode de résidence ont une situation financière relativement aisée, du fait de contraintes matérielles importantes, ne serait-ce qu'en matière de logement.
Dans 80 % des cas, les demandes de résidence alternée sont formées conjointement par les deux parents et, dans ce cas, 95 % de ces demandes sont acceptées par les juges.
En cas de désaccord parental, la résidence alternée est retenue dans un quart des cas et, dans cette hypothèse, le magistrat s'entoure d'un maximum d'investigations, notamment le recours à des mesures d'investigations, parmi lesquelles l'enquête sociale est la plus pratiquée.
Les décisions de rejet des juges sont fondées sur les mauvaises relations entre parents, sur l'éloignement des domiciles, sur l'âge des enfants ou sur les conditions matérielles de résidence.
Dans la mesure où le juge aux affaires familiales n'est saisi qu'en cas de divorce ou de litige, il est vraisemblable que la proportion des enfants qui sont concrètement en situation de résidence alternée soit plutôt de l'ordre de 15 à 20 % que les 11 % que je citais tout à l'heure.
Cette pratique est aujourd'hui encore contestée. En effet, on note une absence d'études fiables sur les conséquences de la résidence alternée pour l'enfant. Certains nous disent, notamment les représentants des professions médicales, les psychiatres et les psychologues, qu'il convient que les parents entretiennent des contacts fréquents et que l'enfant ne soit pas trop jeune, en ajoutant que, lorsqu'elle n'est pas adaptée à la situation familiale, la résidence alternée entraîne chez l'enfant des troubles fréquents, intenses et durables.
Les représentants des professions de santé ont parfois émis quelques critiques sur les magistrats. Je vous les cite :
- la loi est trop souvent détournée de son sens par certains magistrats ;
- il est des cas de résidence alternée prononcés alors que l'un des parents vit à l'étranger ;
- dans certains cas, on voit des magistrats exiger l'inscription de l'enfant dans deux écoles différentes, ce qui paraît effectivement difficile à comprendre ;
- les besoins de l'enfant sont trop rarement pris en compte alors que quatre critères devraient être prépondérants : l'âge de l'enfant, la proximité géographique de l'école et du domicile des parents, l'entente des parents sur les principes éducatifs et la possibilité d'une bonne organisation pratique.
D'autres, notamment les universitaires, nous disent au contraire que la résidence alternée est bénéfique à la fois aux parents et aux enfants et que les troubles psychologiques chez les enfants ne sont pas liés à leurs conditions de résidence, mais davantage à la persistance du conflit parental.
Les associations sont extrêmement divisées sur leurs sentiments à l'égard de la résidence alternée. J'en citerai quelques-unes.
La Confédération syndicale des familles considère la résidence alternée comme une évolution nécessaire pour améliorer la co-parentalité, en cas de divorce ou de séparation. Si elle n'est pas la panacée, elle constitue, pour cette association, la « moins mauvaise » des solutions.
La Fédération des mouvements de la condition paternelle considère la résidence alternée comme l'aboutissement d'une évolution sociale reconnaissant le droit pour l'enfant d'être élevé par ses deux parents, et un moyen de préserver la co-parentalité au-delà de la séparation.
L'association « SOS Papa » fait observer que l'alternance est inhérente à tous les modes de résidence des enfants de parents séparés, qu'il s'agisse de la résidence alternée ou de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent.
L'association « L'enfant d'abord » insiste sur les risques qui menacent les enfants en bas âge lorsqu'ils sont régulièrement séparés de leur mère. Pour cette association, la résidence alternée doit observer des conditions précises : absence de conflit parental, prise en compte de la maturité et des souhaits de l'enfant, respect de ses rituels et de ses habitudes.
L'Association pour la médiation familiale estime que l'alternance, inhérente à toute séparation des parents, est vitale pour l'enfant.
L'Union nationale des associations familiales (UNAF) soutient le principe de la résidence alternée comme un moyen d'égalité entre les parents et de préservation des liens de l'enfant avec son père et sa mère.
Enfin, pour la Confédération nationale des associations familiales catholiques, il est important pour l'enfant de pouvoir se référer à un lieu de vie unique. A son sens, il serait donc déraisonnable de faire de la résidence alternée une règle générale et absolue. L'audition de l'enfant est non seulement souhaitable, mais elle suppose que les juges y consacrent suffisamment de temps.
Deux mots maintenant sur le regard des avocats et des magistrats. Les avocats nous ont fait observer que les demandes des parents ne sont pas toujours guidées par le seul intérêt de l'enfant, mais également par deux autres types de considération : le regard des autres et l'argent. Pour le père, cela apparaît trop souvent comme un succès et, pour la mère, comme un échec.
L'intervention du juge aux affaires familiales, nous disent les avocats, est l'occasion de replacer l'enfant au centre du débat entre les parents. Elle se fait toujours discrète en cas d'accord entre ces derniers. La majorité des juges apprécie au cas par cas l'opportunité de la mesure. Les avocats constatent une acceptation sociale progressive de la loi du 4 mars 2002, et une plus grande sensibilité des parents à l'intérêt de leur enfant. Aujourd'hui, les pères ne se résignent plus à abandonner à la mère la garde de l'enfant, mais à l'avenir, on peut craindre le cas inverse où aucun des deux parents ne souhaiterait accueillir ses enfants chez lui en permanence, pour des raisons professionnelles.
Les représentants des magistrats indiquent que les demandes de résidence alternée formulées conjointement par les deux parents sont systématiquement homologuées, sauf lorsqu'elles s'avèrent aberrantes.
Les situations de désaccord étant délicates à apprécier, les juges, pour étayer leur décision, recourent à des enquêtes sociales ou médico-psychologiques, ou orientent les parents vers la médiation familiale.
Quant à la prise en compte de la parole de l'enfant, les magistrats nous disent qu'elle appelle la plus grande prudence et qu'elle risque notamment de placer l'enfant au coeur d'un conflit qui n'est pas le sien.
J'en viens à la deuxième partie de mon intervention qui porte sur les perspectives.
La législation étant récente, appelle-t-elle des modifications ? Cela ne me paraît pas évident. En effet, même si les propositions de réforme législatives sont extrêmement nombreuses, elles sont peu consensuelles. Quelles sont-elles ?
En ce qui concerne tout d'abord la révision de la place de l'alternance parmi les modes de résidence de l'enfant, certains nous disent que la résidence alternée doit devenir la règle ; d'autres, au contraire, demandent de rétablir la notion de résidence habituelle et de réserver la résidence alternée à des situations spécifiques. Il est difficile de faire la part des choses entre ces deux revendications contraires.
Quant à l'interdiction de la résidence alternée pour les enfants en bas âge, que proposent certains, nous n'y sommes pas globalement favorables car cela nous paraît introduire une grande rigidité, alors que le seul critère pertinent est l'intérêt de l'enfant. Cela risque aussi d'induire des débats sans fin sur l'âge en deçà duquel la résidence alternée serait impossible. En outre, la proportion des enfants de moins de 3 ans en résidence alternée est extrêmement faible et, dans ce cas, la décision est presque toujours prise avec l'accord des deux parents.
Autre proposition : la remise en cause des pouvoirs d'appréciation du juge aux affaires familiales. Faut-il lui retirer la possibilité d'ordonner une résidence alternée en cas de désaccord des parents ? Il nous semble qu'il convient au contraire d'éviter de donner un droit de veto aux parents qui s'estiment en position de force pour obtenir la résidence de l'enfant, et nous constatons qu'il arrive que la résidence alternée soit en définitive bien vécue par les parents, même après avoir été imposée.
Faut-il retirer au juge aux affaires familiales la possibilité de s'opposer à la mise en place d'une résidence partagée souhaitée par les deux parents ? La réponse est également négative puisque, parfois, les deux parents font une demande qui paraît effectivement contradictoire avec l'intérêt de l'enfant, alors que celui-ci doit primer.
Faut-il partager davantage les prestations familiales ? J'ai rappelé il y a un instant que la loi pour le financement de la sécurité sociale de 2007 avait prévu le partage des seules allocations familiales. Ne serait-il donc pas légitime de verser à chacun des parents la moitié des prestations familiales dues pour leurs enfants en résidence alternée ? Cela a fait l'objet d'une proposition de loi déposée par nos collègues socialistes et présentée par Michel Dreyfus-Schmidt.
Cette solution n'a pas été retenue, non pas pour des raisons de fond, mais parce qu'elle s'avère extrêmement délicate à mettre en oeuvre du fait de la nature très différente des prestations. Certaines sont effectivement soumises à des conditions de ressources alors qu'elles ne sont pas nécessairement les mêmes ; d'autres sont plafonnées ; d'autres encore varient selon le nombre d'enfants à charge.
Enfin, il a été proposé des modifications de la procédure judiciaire et du Code pénal. Deux questions ont ainsi été posées sans qu'on ait pu y apporter de réponse :
- faut-il rendre obligatoire la présence des avocats lors des enquêtes sociales ?
- faut-il instaurer un référé permettant une révision plus facile de la résidence alternée, lorsqu'il est soupçonné qu'elle est néfaste à l'enfant ?
Je terminerai par le souhait d'un renforcement des aides à la décision. Trois propositions ont été faites, la troisième étant plus consensuelle.
La première est la définition d'un calendrier prévoyant la mise en place progressive de la résidence alternée. L'objectif serait de mettre en place un hébergement progressif chez le père, et de créer un dispositif d'accompagnement avec des visites régulières d'un pédopsychiatre ou d'un psychologue. L'objectif est également d'accélérer le rythme de l'alternance quand l'enfant est plus jeune. En effet, le rapport au temps n'est pas le même entre le très jeune enfant et l'enfant un peu plus âgé.
La deuxième est l'élaboration d'un guide des bonnes pratiques, qui permettrait de garder sa souplesse au système et de réduire le sentiment d'arbitraire éprouvé par certains parents à l'annonce de la décision judiciaire. La Chancellerie n'y est pas favorable car elle considère qu'en raison des spécificités de chaque situation et des précautions prises par les juges aux affaires familiales, il n'est pas nécessaire d'élaborer un tel guide.
La troisième est une proposition plus consensuelle : le développement de la médiation familiale, avec le souhait que le juge puisse l'imposer aux parents, et qu'elle soit dotée des moyens nécessaires. Sur ce point, la Chancellerie nous a rappelé que, d'une part, les crédits destinés à financer les associations de médiation familiale avaient évolué ces dernières années et que, d'autre part, les mentalités n'étaient pas encore totalement prêtes en France pour ce mode de résolution des conflits, si l'on en juge par le faible nombre des justiciables ayant accepté d'y avoir recours après avoir suivi une séance d'information ordonnée par le juge aux affaires familiales.
En conclusion, alors qu'on nous dit souvent que nous légiférons beaucoup trop, même lorsque l'encre du Journal officiel n'est pas encore sèche, nous estimons que, pour légiférer à nouveau sur ce point, il est pour le moins urgent d'attendre.
(Applaudissements.)
M. Emmanuel KESSLER .- Vous avez fait preuve d'un grand esprit de synthèse et d'une grande efficacité dans votre présentation. Il est vraiment intéressant de voir tous ces cas. Cette évaluation montre que, pour l'instant, il vaut mieux ne pas légiférer.
Si quelqu'un souhaite apporter un élément ou une observation sur ce sujet qui reste ouvert, c'est encore possible, mais il est intéressant, Jean-René Lecerf, de voir que, dans cette matinée, nous avons pu prendre conscience du travail en continu de la Commission des lois que vous avez fait partager à ceux qui sont ici, avec un grand esprit d'ouverture et de concertation, et en étant demandeur des avis et des observations du monde professionnel. Je souhaite que l'on vous applaudisse pour cela et, à travers vous, l'ensemble de votre Assemblée.
(Applaudissements.)
Dans un instant, vous pourrez poursuivre plus directement votre dialogue dans la salle René Coty, et je vous remercie tous d'avoir participé à ces 5èmes Rencontres sénatoriales de la justice, qui devraient avoir lieu dans leur sixième édition à la même période l'année prochaine.
La séance est levée à 12 h 35.
ANNEXES
ANNEXE I
|
Pour un droit de la prescription moderne et cohérent LES 17 RECOMMANDATIONS DE LA MISSION D'INFORMATION 1. MAINTENIR LE PRINCIPE DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE PÉNALE EN RESTAURANT LA COHÉRENCE DU DISPOSITIF Recommandation n° 1 : Conserver le caractère exceptionnel de l'imprescriptibilité en droit français, réservée aux crimes contre l'humanité. Recommandation n° 2 : Veiller à la cohérence du droit de la prescription, en évitant des réformes partielles. Recommandation n° 3 : Préserver le lien entre la gravité de l'infraction et la durée du délai de la prescription de l'action publique afin de garantir la lisibilité de la hiérarchie des valeurs protégées par le code pénal, en évitant de créer de nouveaux régimes dérogatoires. Recommandation n° 4 : Allonger les délais de prescription de l'action publique applicables aux délits et aux crimes, en fixant ces délais à cinq ans en matière délictuelle et à quinze ans en matière criminelle. Recommandation n° 5 : Consacrer dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation tendant, pour les infractions occultes ou dissimulées, à repousser le point de départ du délai de prescription au jour où l'infraction est révélée, et étendre cette solution à d'autres infractions occultes ou dissimulées dans d'autres domaines du droit pénal et, en particulier, la matière criminelle. Recommandation n° 6 : Établir, pour les infractions occultes ou dissimulées, à compter de la commission de l'infraction, un délai butoir de dix ans en matière délictuelle et de trente ans en matière criminelle, soumis aux mêmes conditions d'interruption et de suspension que les délais de prescription. Recommandation n° 7 : Fixer l'acquisition de la prescription au 31 décembre de l'année au cours de laquelle expirent les délais de prescription. 2. RÉDUIRE LES DÉLAIS ET SIMPLIFIER LE RÉGIME DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE CIVILE Recommandation n° 8 : Abaisser de trente ans à cinq ans le délai de droit commun de la prescription extinctive. Recommandation n° 9 : Maintenir en principe les délais de prescription extinctive actuellement inférieurs à cinq ans, sous réserve d'un examen au cas par cas de leur pertinence. Recommandation n° 10 : Etendre le délai de cinq ans aux prescriptions extinctives d'une durée plus longue, notamment aux obligations entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, sous réserve d'un examen au cas par cas de leur pertinence. Recommandation n° 11 : Maintenir à trente ans le délai de droit commun de la prescription acquisitive en matière immobilière et fixer une durée abrégée unique de dix ans en cas de bonne foi et de juste titre du possesseur, quel que soit le lieu de résidence du propriétaire. Recommandation n° 12 : Faire de la négociation de bonne foi entre les parties une cause de suspension de la prescription extinctive, y compris en cas de recours à la médiation. Recommandation n° 13 : Transformer la citation en justice en une cause de suspension de la prescription et conférer également un effet suspensif à la désignation d'un expert en référé. Recommandation n° 14 : Supprimer les interversions de prescription. Recommandation n° 15 : Prévoir que la durée de la prescription extinctive peut être abrégée ou allongée par voie contractuelle, dans la limite d'un plancher d'un an et d'un plafond de dix ans, sauf en droit des assurances et en droit de la consommation. Recommandation n° 16 : Poser le principe de la soumission des délais dits de forclusion ou préfix au même régime que les délais dits de prescription, tout en conservant au cas par cas des règles spécifiques. Recommandation n° 17 : Consacrer les solutions jurisprudentielles en matière de droit transitoire. |
ANNEXE II
La résidence alternée : une journée d'auditions publiques pour évaluer la loi du 4 mars 2002
N° 349
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 juin 2007
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) et de la commission des Affaires sociales (2) sur la résidence alternée ,
Par MM. Jean-Jacques HYEST et Nicolas ABOUT,
Sénateurs.
(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Jacques Gautier, Mme Jacqueline Gourault, M. Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Hugues Portelli, Marcel Rainaud, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, MM. Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.
(2) Cette commission est composée de : M. Nicolas About, président ; MM. Alain Gournac, Louis Souvet, Gérard Dériot, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Claire-Lise Campion, Valérie Létard, MM. Roland Muzeau, Bernard Seillier, vice-présidents ; MM. François Autain, Paul Blanc, Jean-Marc Juilhard, Mmes Anne-Marie Payet, Gisèle Printz, secrétaires ; Mme Jacqueline Alquier, MM. Jean-Paul Amoudry, Gilbert Barbier, Pierre Bernard-Reymond, Daniel Bernardet, Mme Brigitte Bout, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Mmes Isabelle Debré, Christiane Demontès, Sylvie Desmarescaux, M. Claude Domeizel, Mme Bernadette Dupont, MM. Michel Esneu, Jean-Claude Etienne, Guy Fischer, Jacques Gillot, Francis Giraud, Mmes Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange, Gélita Hoarau, Annie Jarraud-Vergnolle, Christiane Kammermann, MM. Serge Larcher, André Lardeux, Dominique Leclerc, Mme Raymonde Le Texier, MM. Roger Madec, Jean-Pierre Michel, Alain Milon, Georges Mouly, Mme Catherine Procaccia, M. Thierry Repentin, Mmes Janine Rozier, Michèle San Vicente-Baudrin, Patricia Schillinger, Esther Sittler, MM. Jean-Marie Vanlerenberghe, Alain Vasselle, François Vendasi.
Divorce .
|
AVANT-PROPOS Mesdames, Messieurs, Voici cinq ans, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, adoptée en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, donnait une base légale à l'organisation d'une résidence alternée des enfants au domicile de leurs parents, en cas de divorce ou de séparation. L'objectif recherché était de permettre aux enfants d'entretenir des relations suivies avec leurs deux parents et de consacrer la parité de l'homme et de la femme dans l'exercice de l'autorité parentale. Le législateur n'en était pas moins conscient, comme l'écrivait notre collègue M. Laurent Béteille, rapporteur de ce texte au nom de votre commission des lois, « des contraintes pratiques importantes de ce mode d'organisation pour les parents, de la collaboration constante qu'il implique entre eux ainsi que des avis partagés des spécialistes de l'enfance sur ses conséquences sur le développement de l'enfant1( * ). » Aussi a-t-il laissé un large pouvoir d'appréciation au juge aux affaires familiales, qui peut imposer la résidence alternée, le cas échéant après une période d'essai et le recours à des experts, ou s'y opposer au nom de l'intérêt de l'enfant. La loi de finances rectificative pour 2002 a ensuite autorisé le partage des avantages fiscaux liés à la présence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs deux parents. En revanche, jusqu'à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 et à son décret d'application du 13 avril dernier, le partage des prestations familiales n'était pas possible. Depuis lors, seul le partage des allocations familiales, à l'exclusion des autres prestations, est prévu2( * ). Auparavant, le 17 octobre 2006, le Sénat avait examiné une proposition de loi présentée par notre collègue M. Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, prévoyant un partage à parts égales de toutes les prestations familiales, à défaut d'accord des parents ou de décision contraire du juge3( * ). Cette solution n'avait pu être retenue, comme l'avait expliqué notre collègue M. André Lardeux, rapporteur de la proposition de loi au nom de votre commission des affaires sociales, en raison de la nécessité de prendre en compte les différentes conditions d'attribution de ces prestations4( * ). A la suite des débats suscités par ces deux textes, votre commission des lois et votre commission des affaires sociales ont décidé d'organiser conjointement une journée d'auditions publiques pour dresser un bilan d'ensemble de la mise en oeuvre de la résidence alternée. Sociologues, psychiatres, psychologues, avocats, magistrats, professeurs de droit, représentants des associations et des administrations concernées ont ainsi été conviés à faire part de leur expérience et de leurs souhaits d'évolution de la législation. Ce bilan complète utilement ceux déjà dressés, en 2006, par la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la famille et les droits des enfants5( * ) et par la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes6 ( * ), dont les champs d'investigations étaient toutefois plus larges. Il montre que la pratique de la résidence alternée reste limitée et contestée mais qu'il n'est pas indispensable de modifier une législation récente et finalement équilibrée. I. UNE PRATIQUE ENCORE LIMITÉE ET CONTESTÉE Cinq ans après sa consécration législative, la résidence alternée reste peu pratiquée. Les débats qu'elle suscite portent désormais moins sur son principe même, qui semble désormais accepté, que sur ses modalités de mise en oeuvre. M. Marc Guillaume, alors directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, a fait valoir les efforts accomplis par le ministère de la justice pour acquérir une meilleure connaissance statistique du recours à la résidence alternée : réalisation d'une enquête sur un échantillon représentatif de décisions judiciaires en 2003 ; mention au répertoire général civil du mode de résidence des enfants faisant l'objet d'une décision judiciaire depuis 2004. Ces données ne reflètent toutefois qu'imparfaitement la pratique de la résidence alternée. 1. Une faible proportion des décisions judiciaires Les premiers résultats de l'exploitation de ce répertoire montrent que la proportion des enfants faisant l'objet, par décision judiciaire, d'une résidence en alternance était d'environ 11 % en 2005, à peine supérieure à celle observée dans l'enquête réalisée en 2003 (10 %). Tous âges des enfants confondus, la résidence est fixée chez la mère dans 78 % des cas en moyenne, par le juge aux affaires familiales ou d'un commun accord entre les parents. Cette proportion diminue régulièrement à mesure que l'âge de l'enfant augmente : elle passe de 95,1 % pour les enfants âgés de moins d'un an à 72 % pour les adolescents de quinze ans et plus. La résidence des enfants est fixée chez le père dans 10,3 % des cas, tous âges confondus ; cette proportion augmente avec leur âge, passant de moins de 6 % dans les cinq premières années de l'enfant à environ 19 % pour les adolescents âgés de seize ans et plus. Enfin, la résidence en alternance reste marginale dans les toutes premières années de l'enfant (2 % pour les moins de un an, 4,2 % à un an, 6,7 % à deux ans), cesse de l'être à trois ans en passant la barre des 10 %, augmente légèrement jusqu'à neuf ans, pour atteindre un maximum de 13,8 %, puis décroît, surtout à partir de onze ans. Les trois quarts des enfants en résidence alternée ont moins de dix ans, l'âge moyen étant de sept ans.
Tableau (en %), source ministère de la justice Le faible recours à l'aide juridictionnelle -une procédure sur cinq seulement- donne à penser que les parents qui demandent ce mode de résidence ont une situation financière relativement aisée, ce qui s'explique par les contraintes matérielles importantes qu'il comporte, notamment en matière de logement. * 1 Rapport n° 71 (Sénat, 2001-2002), page 18. * 2 Les parents sont d'abord invités à se mettre d'accord sur le choix d'un allocataire unique ou, à défaut, sur un partage de la charge des enfants pour le calcul des droits aux allocations familiales. Si aucun accord n'est trouvé, la charge des enfants est répartie à parts égales entre les deux parents. * 3 Proposition de loi n° 483 (Sénat, 2005-2006). * 4 Rapport n° 18 (Sénat, 2006-2007), page 9. * 5 Rapport n° 2832 (Assemblée nationale, douzième législature) de Mme Valérie Pecresse au nom de la mission d'information sur la famille et les droits de l'enfant présidée par M. Patrick Bloche. * 6 Rapport d'activité n° 388 (Sénat, 2005-2006) de Mme Gisèle Gautier, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. |
2. Un mode de résidence généralement décidé conjointement par les deux parents
Dans 80 % des cas, les demandes de résidence en alternance sont formées conjointement par les deux parents et 95 % d'entre elles sont acceptées par les juges .
En cas de désaccord parental, la résidence en alternance est retenue dans un quart des cas. Les magistrats ne l'imposent qu'après s'être entourés d'un maximum de précautions : en 2005, ils ont eu recours dans 61 % des cas à une mesure d'investigation, le plus souvent une enquête sociale.
Dans les trois quarts des cas restants, la résidence habituelle de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le plus souvent chez la mère.
Les décisions de rejet sont fondées sur plusieurs critères : les mauvaises relations entre les parents, l'éloignement de leurs domiciles respectifs, l'âge des enfants ou encore les conditions matérielles de leur résidence.
3. Un mode de résidence sans doute plus pratiqué que ce qu'indiquent les données du ministère de la justice
Dans la mesure où le juge aux affaires familiales n'est saisi qu'en cas de divorce ou de litige , la proportion des enfants qui vivent effectivement en résidence alternée est sans doute plus importante que ce qu'indiquent les données du ministère de la justice .
M. Gérard Neyrand, professeur de sociologie à l'université de Toulouse 3, directeur du Centre interdisciplinaire méditerranéen d'études et de recherches en sciences sociales , l'a ainsi estimée comprise entre 15 % et 20 %.
Il a observé que, même dans les pays où elle est juridiquement reconnue depuis longtemps, la résidence alternée ne dépasse jamais la moitié du total des modes de garde. Ce taux est ainsi au maximum de 40 % en Californie, dans d'autres États américains, ou dans des pays du nord de l'Europe.
Les auditions ont mis en lumière l'absence d'étude fiable sur les conséquences de la résidence alternée pour l'enfant, des divisions encore marquées entre les associations et, à travers le regard des acteurs de la pratique judiciaire, des situations parfois difficiles.
1. L'absence d'étude fiable sur les conséquences de la résidence alternée pour l'enfant
Selon M. Maurice Berger, psychiatre, psychanalyste, chef du service « psychiatrie de l'enfant » au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne , des précautions doivent être prises pour qu'une résidence alternée soit mise en place avec succès. Il convient notamment que les parents entretiennent des contacts fréquents et que l'enfant ne soit pas trop jeune . Or, la législation actuelle ne subordonne son instauration ni à une condition d'âge, ni à la qualité du lien entre les deux parents et entre les parents et les enfants. Par ailleurs, la loi serait trop souvent détournée de son sens par certains magistrats pour des raisons idéologiques : il est des cas de résidence alternée prononcée alors que l'un des parents vit à l'étranger ou d'autres obligeant l'enfant à être inscrit dans deux écoles différentes.
Or, a-t-il fait valoir, la résidence alternée, lorsqu'elle n'est pas adaptée à la situation familiale, entraîne chez l'enfant des troubles fréquents, intenses, impressionnants, durables et impossibles à traiter , comme des dépressions ou des problèmes d'agressivité et de sommeil liés à un sentiment d'abandon, troubles qui n'étaient pas observés chez ce même enfant avant la mise en place de la résidence alternée. Lorsque les parents ne sont pas en conflit, certains enfants, compte tenu de leur sensibilité personnelle, supportent mal soit l'instabilité de leur cadre de vie, soit l'éloignement prolongé et répété de la figure d'attachement maternel. Lorsque les parents impliquent leur enfant dans un conflit important, l'enfant n'a pas d'autre choix pour se construire que de s'adapter en surface à deux mondes opposés en se coupant de ses sentiments : aller chez un parent, c'est perdre l'autre.
Mme Mireille Lasbats, psychologue clinicienne, expert près la cour administrative d'appel de Douai , a déploré que les besoins de l'enfant soient trop rarement pris en compte . Ces besoins évoluent avec l'âge, a-t-elle souligné. Aussi bien les décisions de résidence alternée doivent-elles être prises au cas par cas, en fonction de la situation de l'enfant et du contexte familial, étant entendu que le lien affectif avec les deux parents est indispensable à l'équilibre de l'enfant. Le calme et le respect des rythmes de vie, ainsi que la qualité de la relation entre les parents, constituent également des facteurs d'équilibre et de sécurisation indéniables. En fait, pour qu'une résidence alternée réussisse, chaque parent doit accepter l'altérité et la suppléance de l'autre.
Mme Mireille Lasbats a proposé quatre critères dont le respect devrait être vérifié par le juge avant de décider la mise en place d'une résidence alternée : l' âge de l'enfant , puisque la faible capacité de mémorisation des figures et des lieux d'attachement rend difficile le changement fréquent de résidence avant l'âge de trois ans, la proximité géographique de l'école et des domiciles des parents , l' entente de ces derniers sur les principes éducatifs et une bonne organisation pratique .
A l'inverse, selon M. Gérard Neyrand , la résidence alternée peut être bénéfique, tant pour les parents que pour les enfants , dans la mesure où elle permet de maintenir un lien concret et régulier entre l'enfant et chacun de ses deux parents. Elle est facteur d'enrichissement de la vie sociale des enfants et conduit chaque parent à être plus disponible pour l'enfant pendant la période où il en assume la garde. Ces résultats, a-t-il précisé, ont été confirmés par des études nord-américaines, qui ont montré que les enfants en résidence alternée ne souffrent pas de problèmes particuliers. Il en a conclu que les troubles psychologiques éventuellement observés chez ces enfants n'étaient pas liés à leurs conditions de résidence, mais plutôt à la persistance du conflit parental .
Les réticences suscitées par la résidence alternée, a-t-il observé, concernent le plus souvent les très jeunes enfants, sachant que dans les trois quarts des cas, les demandes de résidence alternée portent sur des enfants de moins de dix ans et, dans un tiers des cas, de moins de quatre ans. Certains pédopsychiatres estiment que seule la mère est apte à s'occuper d'un très jeune enfant. Aucune étude ne démontre pourtant, a-t-il fait valoir, qu'une résidence permanente chez la mère soit absolument indispensable dans ce cas : s'il est vrai que certains pères ne souhaitent pas assumer les mêmes tâches que la mère, d'autres, en revanche, s'occupent de leur enfant dès sa naissance et établissent avec lui un lien d'attachement très fort. Il est alors important de préserver les relations nouées avec les deux parents. Les témoignages recueillis montrent que la résidence alternée peut être bien vécue à tout âge quand des liens psychologiques forts sont établis avec les deux parents .
M. Jean-Laurent Clochard, représentant de la Confédération syndicale des familles , a considéré que la résidence alternée était sans doute une évolution nécessaire pour améliorer la coparentalité en cas de divorce ou de séparation. Si elle n'est pas la panacée , elle constitue parfois la moins mauvaise des solutions car elle évite de donner la priorité à l'un des deux parents et permet de préserver au quotidien les liens tissés par l'enfant avec son père et sa mère. Elle constitue également un moyen d'encourager les deux parents à assumer véritablement leurs responsabilités.
M. Stéphane Ditchev, secrétaire général de la Fédération des mouvements de la condition paternelle , a insisté sur le fait que la résidence alternée constituait l' aboutissement d'une évolution sociale reconnaissant le droit pour l'enfant d'être élevé par ses deux parents et un moyen de préserver la coparentalité au-delà de la séparation . Les pères ont pris une place importante auprès de leur enfant et sont impliqués dès avant la naissance. Certes, un enfant a besoin de figures d'attachement pour son développement affectif mais les deux figures, paternelle et maternelle, lui sont indispensables.
M. Alain Cazenave, président de l'association « SOS Papa » , a souligné l'importance de préserver la coparentalité au-delà de la séparation. La rupture entre les parents constitue nécessairement un traumatisme pour l'enfant, mais c'est la persistance du conflit parental qui est destructrice pour lui, bien plus que le choix d'un quelconque mode de résidence. On reproche souvent à la résidence alternée de faire peser des contraintes excessives sur les enfants qui sont obligés de déménager toutes les semaines. Or l'alternance est inhérente à tous les modes de résidence des enfants de parents séparés , qu'il s'agisse de la résidence alternée ou de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent. En l'absence de résidence alternée, il est très difficile de faire respecter l'autorité parentale conjointe .
Mme Jacqueline Phélip, présidente de l'association « L'enfant d'abord » , a estimé que les nouveaux développements de la pédopsychiatrie permettaient de montrer les risques qui menacent les enfants en bas âge lorsqu'ils sont régulièrement séparés de leur mère car, même lorsque celle-ci travaille, elle reste leur principale figure d'attachement. Ces enfants, a-t-elle observé, peuvent présenter des troubles graves qui devraient inquiéter le législateur et le conduire à introduire dans la loi des garde-fous pour le recours à la résidence alternée. Elle a particulièrement dénoncé la possibilité donnée aux juges d'imposer une résidence alternée à des parents en situation de conflit ouvert. La résidence alternée ne peut , selon elle, fonctionner qu'en respectant des conditions précises : absence de conflit parental , prise en compte de la maturité et du souhait de l'enfant , respect de ses rituels et habitudes afin d'assurer une continuité psychique.
Mme Isabelle Juès, présidente de l'Association pour la médiation familiale , a constaté que l'alternance est inhérente à toute séparation des parents , quel que soit le régime juridique adopté pour la résidence des enfants. Même si elle est source de difficultés, elle est vitale pour l'enfant , car elle lui permet de rester au contact de ses deux parents et donc de construire son identité. Le rôle des médiateurs familiaux est d'aider les parents à prendre acte de cette alternance, à distinguer ce qui relève de leur conflit de couple et de leur responsabilité de parents et à faire preuve de créativité dans leur organisation, en rappelant que l'équilibre de l'enfant ne réside pas nécessairement dans un partage de son temps à part égale entre ses parents.
M. François Fondard, président de l'Union nationale des associations familiales , a soutenu le principe de la résidence alternée, comme moyen d'égalité entre les parents et de préservation des liens de l'enfant avec son père et sa mère . Il est important de recueillir l'avis de l'enfant capable discernement sur son mode de résidence. Toutes les séparations reflètent nécessairement des situations conflictuelles et la difficulté pour les enfants réside moins dans la gestion du temps que dans la gestion du conflit. La résidence alternée ne doit pas être nécessairement égalitaire.
Mme Clotilde Brunetti, responsable de la commission juridique de la Confédération nationale des associations familiales catholiques , a insisté sur la nécessité de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de rappeler la complémentarité de l'homme et de la femme face aux discours parfois égalitaristes des tenants de la résidence alternée. Il est important pour l'enfant de pouvoir se référer à un lieu de vie unique et il est dommage, à ce titre, que la notion de résidence habituelle ait disparu dans le code civil. A son sens, il serait dangereux et déraisonnable de faire de la résidence alternée une règle générale et absolue , au risque de faire de l'enfant un « sans domicile fixe ». L' audition de l'enfant est souhaitable , en fonction de sa maturité, et suppose que les juges y consacrent suffisamment de temps. L'intérêt que présente une enquête sociale préalable à la décision de résidence alternée mérite également d'être relevé.
3. Le regard des avocats et des magistrats
Mme Hélène Poivey-Leclercq, avocat, représentant le Conseil national des barreaux, l'Ordre des avocats au barreau de Paris et la Conférence des bâtonniers , a relevé que les couples qui s'engagent dans des procédures de divorce connaissent en général l'existence de ce mode de résidence : les hommes ont tendance à considérer qu'il devrait constituer le principe, et non l'exception, et les femmes à y voir une menace au motif que leur conjoint n'a pas eu, dans l'éducation quotidienne des enfants, une implication aussi importante que la leur.
Les demandes des parents ne sont pas toujours guidées par le seul intérêt de leur enfant, mais par deux autres types de considération : le regard des autres et l'argent . Bien souvent, la résidence alternée est socialement perçue comme une victoire pour le père et un échec pour la mère, celle-ci étant considérée comme devant avoir à temps plein la résidence de ses enfants. S'agissant des considérations pécuniaires, certains pères attendent de la résidence alternée une diminution des sommes à verser à la mère, moins par souci de réaliser des économies que de subvenir directement aux besoins de leur enfant et de lui marquer ainsi leur affection ; certaines mères redoutent à l'inverse une réduction des sommes reçues du père, par crainte que celui-ci n'utilise son pouvoir d'achat plus élevé pour essayer de s'attacher les faveurs de leur enfant.
L' intervention du juge aux affaires familiales est l'occasion de replacer l'enfant, si besoin en est, au centre du débat entre les parents. Elle se fait toujours discrète en cas d'accord entre ces derniers. L'attitude du juge face au principe même de la résidence alternée est variable : certains magistrats y sont systématiquement favorables ou, à l'inverse, opposés, mais la majorité d'entre eux apprécie au cas par cas l'opportunité de la mesure , le plus souvent après une enquête sociale ou une expertise médico-psychologique ainsi qu'une audition de l'enfant.
Mme Hélène Poivey-Leclercq a constaté une acceptation sociale progressive de la loi du 4 mars 2002 et une plus grande sensibilité des parents à l'intérêt de leur enfant , d'autant que la procédure de divorce a été récemment dédramatisée. Aujourd'hui, les pères ne se résignent plus à abandonner à la mère la garde de l'enfant . A l'avenir, on peut craindre le cas inverse où aucun des deux parents ne souhaiterait accueillir ses enfants chez lui en permanence , en raison notamment de ses obligations professionnelles.
Mme Valérie Goudet, vice-présidente du tribunal de grande instance de Bobigny chargée des affaires familiales , a souligné la bonne coordination des neuf juges aux affaires familiales du tribunal et indiqué que les demandes de résidence alternée formulées conjointement par les deux parents étaient systématiquement homologuées , sauf lorsqu'elles s'avéraient aberrantes : dès lors que les parents exercent conjointement l'autorité parentale, il n'y a pas de raison, a priori , de rejeter leur demande si l'intérêt de l'enfant n'est pas manifestement négligé .
Si le divorce est demandé huit fois sur dix par la femme, la résidence alternée est réclamée, à l'inverse, huit fois sur dix par le père, celui-ci y voyant souvent un moyen d'atténuer le choc de la séparation et de maintenir un lien avec la mère. Il arrive également que l'un des parents demande l'interruption d'une résidence alternée décidée au moment de la séparation.
Les situations de désaccord étant très délicates à apprécier, les juges, pour étayer leur décision, recourent à des enquêtes, sociales ou médico-psychologiques, ou orientent les parents vers la médiation familiale .
En revanche, la prise en compte de la parole de l'enfant appelle la plus grande prudence , voire de franches réserves, car l'obligation légale faite au juge de s'assurer que l'enfant a bien eu connaissance de son droit à donner son avis risque de placer l'enfant au coeur d'un conflit qui n'est en réalité pas le sien.
Mme Valérie Goudet a indiqué avoir déjà ordonné une résidence alternée contre l'avis de l'un des parents lorsque l'enquête sociale avait établi l'absence d'obstacles dirimants. A l'inverse, les principaux motifs de rejet d'une demande de résidence alternée sont l'inadéquation ou l'éloignement des domiciles, l'âge de l'enfant ou des divergences de vues trop importantes sur son éducation. Enfin, elle a marqué l'attachement des juges du tribunal de grande instance de Bobigny à la médiation familiale , celle-ci devant être à son sens une étape obligée du parcours judiciaire .
II. UNE LÉGISLATION RÉCENTE QUI N'APPELLE PAS DE MODIFICATION ÉVIDENTE
Plusieurs propositions de réforme législative ont été formulées au cours de ces auditions, sans toutefois recueillir un consensus minimal. Peut-être convient-il simplement, comme cela a été également évoqué, de développer les instruments d'aide à la décision.
A. DES PROPOSITIONS DE RÉFORME LÉGISLATIVE PEU CONSENSUELLES
Si la révision de la place de l'alternance parmi les modes de résidence de l'enfant a été proposée, les principales interrogations portent sur l'opportunité, d'une part, de supprimer le pouvoir reconnu au juge aux affaires familiales de l'imposer en cas de désaccord des parents, d'autre part, de l'interdire pour les enfants en bas âge. Le partage des prestations familiales est jugé nécessaire mais ses modalités de mise en oeuvre s'avèrent délicates. Enfin, quelques propositions de modifications de la procédure judiciaire et du code pénal ont été avancées.
1. La révision de la place de l'alternance parmi les modes de résidence de l'enfant
La résidence alternée ne constitue actuellement qu'un mode de résidence parmi d'autres, une simple possibilité offerte aux parents et au juge aux affaires familiales.
Quelques intervenants ont souhaité que cette place soit redéfinie. Toutefois, leurs positions sont contradictoires.
Ainsi, MM. Stéphane Ditchev et François Fondard ont estimé que la résidence alternée devrait devenir la règle en cas de séparation des parents.
A l'inverse, Mme Clotilde Brunetti a souhaité le rétablissement de la notion de « résidence habituelle » et que la résidence alternée soit réservée à des situations spécifiques, en fonction de l'âge de l'enfant.
2. L'interdiction de la résidence alternée pour les enfants en bas âge
M. Maurice Berger, Mmes Mireille Lasbats, Jacqueline Phélip et Clotilde Brunetti ont suggéré d'interdire la résidence alternée pour les jeunes enfants.
M. Hugues Fulchiron, professeur de droit, doyen de l'université de Lyon 3, directeur du Centre du droit de la famille , s'y est opposé, en relevant l'absence de consensus entre les spécialistes de l'enfance sur les effets de la résidence alternée. Autant laisser au juge , comme aujourd'hui, le soin d'apprécier au cas par cas chaque situation , en recourant le cas échéant à des expertises ou à la médiation familiale.
Une telle interdiction présenterait selon lui plusieurs inconvénients : introduire une grande rigidité , alors que le seul critère de la décision doit être l'intérêt de l'enfant ; susciter un débat sans fin sur l'âge en deçà duquel la résidence partagée devrait être prohibée ; porter atteinte au principe de coparentalité ; entretenir le sentiment d'instabilité législative .
Mme Hélène Poivey-Leclercq a, elle aussi, estimé qu'il ne serait pas opportun d'interdire le recours à la résidence alternée en dessous d'un âge déterminé.
Mme Valérie Goudet a indiqué que les juges aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, lorsqu'ils étaient saisis d'une demande de résidence alternée concernant un enfant de moins de trois ans à laquelle sa mère était hostile, décidaient toujours de fixer la résidence de l'enfant chez elle. Pour les enfants âgés de trois à six ans, les décisions judiciaires sont variables.
M. Marc Guillaume a souligné que la proportion des enfants de moins de trois ans en résidence alternée était extrêmement faible et que la décision était, dans ce cas, pratiquement toujours prise avec l'accord des deux parents. Les résultats des études statistiques sur le recours à la résidence alternée ne fournissent ainsi aucune raison objective de modifier la législation, même si certaines décisions peuvent parfois engendrer, comme dans bien d'autres domaines, des situations individuelles difficiles.
3. La remise en cause du pouvoir d'appréciation du juge aux affaires familiales
M. Maurice Berger et Mme Jacqueline Phélip se sont élevés contre la possibilité donnée au juge aux affaires familiales d'ordonner une résidence alternée en cas de désaccord entre les deux parents.
A l'inverse, M. Hugues Fulchiron a jugé légitime que le juge puisse imposer un partage de la résidence de l'enfant, à titre provisoire ou définitif, en raison de la nécessité d'éviter de donner un droit de veto au parent qui s'estime en position de force pour obtenir la résidence de l'enfant .
En dépit de quelques arrêts erratiques, les juges ne font d'ailleurs pas un usage immodéré de leur pouvoir, a-t-il observé, et il arrive que la résidence partagée soit en définitive bien vécue par les parents après leur avoir été imposée dans un premier temps.
Enfin, il est également nécessaire, selon lui, de conserver la règle permettant au juge aux affaires familiales de s'opposer, dans l'intérêt de l'enfant, à la mise en place d'une résidence partagée, même souhaitée par les deux parents .
Mme Hélène Poivey-Leclercq a estimé, elle aussi, qu'il convenait de conserver la possibilité donnée au juge d'imposer aux parents une résidence alternée, au moins à titre provisoire.
4. Le partage des prestations familiales
Si la plupart des représentants d'associations ont exprimé le souhait que le partage des prestations familiales, notamment des aides au logement, soit rendu possible, d'aucuns ont également souligné les risques d'effets pervers, qu'il s'agisse de la diminution du montant global des prestations versées aux deux parents ou de la précarisation de la situation de la mère.
M. Aymeric de Chalup, responsable du pôle « prestations familiales » à la direction des prestations familiales de la Caisse nationale des allocations familiales , a observé que la législation et la réglementation, en prévoyant l'attribution de ces prestations à la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant, sans considération du lien de parenté, avaient permis de s'adapter aux évolutions des configurations familiales, notamment au développement des familles recomposées.
Il a toutefois reconnu que, jusqu'à récemment, le code de la sécurité sociale ne reconnaissait pas à chaque parent un droit aux prestations familiales, ce qui ne permettait pas de résoudre les situations de conflit sur le choix de l'allocataire en cas de résidence alternée des enfants. Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a autorisé le partage des allocations familiales, les autres prestations ne peuvent toujours être versées qu'à un allocataire unique .
En l'absence de règles spécifiques à la résidence alternée, les caisses d'allocations familiales se réfèrent à une éventuelle décision du juge aux affaires familiales, proposent aux parents d'alterner chaque année le choix de l'allocataire ou de recourir à la médiation familiale et, à défaut, s'en remettent à la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale .
Dès lors que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a prévu le partage des seules allocations familiales, il serait logique de verser à chacun des parents la moitié de toutes les prestations familiales dues pour leurs enfants en résidence alternée, puisque la charge effective est partagée entre les deux ex-conjoints. Toutefois, une solution globale s'avère délicate à élaborer du fait de la nature très différente de ces prestations : certaines sont soumises à des conditions de ressources, d'autres sont plafonnées, d'autres encore varient selon le nombre d'enfants à charge. Il est de surcroît nécessaire de retenir des modalités de calcul garantissant une équité entre les parents, mais aussi entre les familles séparées et les familles non séparées, et conservant l'esprit initial de chaque prestation .
5. Des modifications de la procédure judiciaire et du code pénal
Mme Hélène Poivey-Leclercq a suggéré de rendre obligatoire la présence des avocats lors des enquêtes sociales , dès lors que ces enquêtes peuvent ne pas se dérouler de manière identique, au détriment du père ou de la mère, et d' instituer une sanction pénale à l'encontre du parent qui n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement , cette sanction faisant le pendant de celle déjà prévue en cas d'entrave par l'autre parent à l'exercice de ce droit.
Mme Clotilde Brunetti a estimé qu'il conviendrait d'instaurer un référé permettant une révision plus facile de la résidence alternée lorsqu'il est soupçonné qu'elle est néfaste à l'enfant.
B. LE SOUHAIT D'UN RENFORCEMENT DES AIDES À LA DÉCISION
Pour aider les parents et les magistrats dans leur décision, il a été suggéré de définir un calendrier prévoyant la mise en place progressive de la résidence alternée, d'élaborer un guide des bonnes pratiques et de développer le recours à la médiation familiale.
1. La définition d'un calendrier prévoyant la mise en place progressive de la résidence alternée
MM. Maurice Berger, Gérard Neyrand, Alain Cazenave et Mme Jacqueline Phélip , dont les prises de position semblent a priori opposées, ont évoqué l'idée d'une mise en place progressive de la résidence alternée . Peut-être n'ont-ils pas la même conception de ce calendrier.
M. Maurice Berger a ainsi indiqué que plusieurs pédopsychiatres avaient proposé un calendrier incitatif qui pourrait servir de support aux décisions des magistrats. L'objectif est de mettre en place un hébergement progressif chez le père et de créer un dispositif d'accompagnement avec des visites régulières d'un pédopsychiatre ou d'un psychologue tous les six mois pendant deux ans.
De son côté, M. Gérard Neyrand a déclaré qu'il pourrait être utile d' accélérer le rythme de l'alternance de la résidence quand l'enfant est plus jeune , dans la mesure où les enfants en bas âge n'ont pas le même rapport au temps que les enfants plus âgés.
2. L'élaboration d'un guide des bonnes pratiques
Pour M. Hugues Fulchiron, la solution aux difficultés que peut poser la résidence alternée doit être recherchée non pas dans la modification d'une loi encore récente, mais dans l' élaboration d'un guide des bonnes pratiques permettant de conserver au système sa souplesse et de réduire le sentiment d'arbitraire éprouvé par certains parents à l'annonce de la décision judiciaire.
Mettant en avant les spécificités de chaque situation et les précautions prises par les juges aux affaires familiales avant de prendre leur décision, M. Marc Guillaume n'a pas jugé indispensable l'élaboration d'un tel guide .
3. Le développement de la médiation familiale
La nécessité de développer la médiation familiale a été soulignée par Mmes Mireille Lasbats, Isabelle Juès, Valérie Goudet et par M. François Fondard , ce dernier souhaitant que le juge puisse l'imposer aux parents et qu'elle soit dotée des moyens nécessaires.
M. Marc Guillaume a souligné que les crédits destinés à financer les associations de médiation familiale avaient doublé entre 2002 et 2004. Toutefois, a-t-il déclaré, une étude établissant un ratio entre le nombre des affaires résolues au moyen de la médiation et son coût conduirait peut-être à remettre en cause sa rationalité économique. Surtout, les mentalités ne sont, à son avis, pas encore prêtes, en France, pour ce mode de résolution des conflits, si on en juge par le faible nombre de justiciables ayant accepté d'y avoir recours après avoir suivi une séance d'information ordonnée par le juge aux affaires familiales. Une directive européenne devrait être prochainement adoptée pour développer le recours à la médiation.
AUDITIONS PUBLIQUES DE LA COMMISSION DES LOIS ET DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES - MERCREDI 23 MAI 2007
La séance est ouverte à neuf heures trente, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, et de M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales .
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale . -
Mesdames, messieurs, mes chers collègues, je vous souhaite la bienvenue. Voilà cinq ans, l'Assemblée nationale et le Sénat s'accordaient pour consacrer, dans le cadre de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, la possibilité d'une résidence alternée des enfants au domicile de leurs parents en cas de séparation ou de divorce.
L'objectif était de permettre aux enfants d'entretenir des relations suivies avec leurs deux parents et de consacrer la parité de l'homme et de la femme dans l'exercice de l'autorité parentale.
Le législateur n'en était pas moins conscient des contraintes pratiques importantes de ce mode d'organisation pour les parents, de la collaboration constante qu'il implique entre eux, ainsi que des avis partagés des spécialistes de l'enfance sur ses conséquences pour le développement de l'enfant.
Aussi a-t-il laissé au juge aux affaires familiales un large pouvoir d'appréciation et a rapidement autorisé le partage des avantages fiscaux liés à la présence des enfants en alternance au domicile de leurs deux parents.
En revanche, jusqu'à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 et son décret d'application du 13 avril dernier, le partage des prestations familiales n'était pas possible. Depuis lors, le partage des seules allocations familiales, à l'exclusion des autres prestations, est prévu.
Auparavant, au mois d'octobre 2006, nous avions débattu d'une proposition de loi présentée par notre collègue Michel Dreyfus-Schmidt et les membres du groupe socialiste, prévoyant un partage à parts égales de toutes les prestations familiales à défaut d'accord des parents ou de décision contraire du juge.
Une telle solution n'a pu être retenue, comme l'a expliqué notre collègue André Lardeux, rapporteur de la proposition de loi, au nom de la commission des affaires sociales, en raison de la nécessité de prendre en compte les différentes conditions d'attribution de ces prestations.
À la suite de ces débats, la commission des lois et la commission des affaires sociales ont décidé d'organiser conjointement une journée d'auditions publiques et filmées pour dresser un bilan d'ensemble de la mise en oeuvre de la résidence alternée.
Sociologues, psychiatres, psychologues, avocats, magistrats, professeurs de droit, représentants des associations et des administrations concernées sont donc conviés à nous faire part de leur expérience et de leurs souhaits d'évolution de la législation.
Ce bilan complètera utilement ceux qui ont été dressés en 2006 par la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la famille et les droits des enfants et par la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.-
Monsieur le président, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je suis très heureux que, sur l'initiative de notre collègue André Lardeux, nous ayons pu organiser cette journée d'auditions sur la question de la résidence alternée.
La résidence alternée ne représente que 8 % des décisions en matière de divorce ou de séparation, et non, comme le disait ce matin M. Gérard Neyrand sur une radio périphérique, 15 à 20 %.
Cinq ans après son adoption, nous devons faire le point sur l'application de la loi du 4 mars 2002. Nous avons le devoir de mesurer l'intérêt que cette solution représente pour l'enfant, pour le lien entre les parents et l'enfant, plus particulièrement pour le lien entre le père et l'enfant. Nous devons aussi mesurer son effet sur le développement psychologique de l'enfant.
Je remercie le président de la commission des lois d'avoir accepté de co-organiser cette série d'auditions qui nous permettront d'être mieux éclairés et, peut-être, de faire évoluer les textes.
M. Gérard Neyrand, professeur de sociologie à l'université de Toulouse 3, directeur du Centre interdisciplinaire méditerranéen d'études et de recherches en sciences sociales
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.-
La parole est à M. Gérard Neyrand, professeur de sociologie à l'université de Toulouse 3, directeur du Centre interdisciplinaire méditerranéen d'études et de recherches en sciences sociales.
M. Gérard Neyrand, professeur de sociologie à l'université de Toulouse 3, directeur du Centre interdisciplinaire méditerranéen d'études et de recherches en sciences sociales . -
Je rappellerai brièvement mon implication en tant que sociologue dans l'histoire de la garde alternée qui, en 1987, est devenue la résidence alternée dès lors que la notion d'autorité parentale a été distinguée de la question de la résidence de l'enfant.
J'ai réalisé mon enquête au début des années quatre-vingt-dix, à une époque où la résidence alternée n'était pas encore reconnue juridiquement.
Si la résidence alternée concerne 8 à 10 % des décisions judiciaires, les 15 à 20 % que j'ai évoqués ce matin correspondent à la pratique de celle-ci. En effet, la résidence alternée peut être décidée par les parents en dehors de toute décision judiciaire. Lorsque j'ai effectué mon enquête, 8 à 10 % des personnes interrogées y avaient recours de façon quasi clandestine puisqu'elle n'était pas reconnue.
L'enquête portait sur soixante-dix couples, dont la moitié pratiquait la résidence alternée. Au terme de ma recherche - qui ne consistait pas en de simples témoignages individuels -, j'ai pu constater que la résidence alternée pouvait être bénéfique pour les enfants et pour les parents. Au-delà des difficultés rencontrées par certains et du mal-être manifesté par quelques enfants, les résultats de l'enquête donnaient une image éminemment plus positive de la pratique que celle qui était diffusée jusqu'alors par des cliniciens confrontés à des dysfonctionnements pathologiques dans un nombre limité de cas.
En effet, tout d'abord, en préservant la double relation parentale, une telle pratique est sans doute conforme au mode de vie antérieur des parents, un mode de vie égalitariste. Ensuite, il faut signaler l'intérêt manifesté par les enfants pour cette solution et les bénéfices éducatifs qu'ils peuvent en retirer, l'essentiel étant de maintenir un lien concret et régulier avec les deux parents. Enfin, cette pratique a des effets positifs sur la vie sociale et relationnelle des enfants : si les parents ont chacun leur enfant à mi-temps, ils sont plus disponibles dans la mesure où ils peuvent faire face à leurs contraintes professionnelles ou personnelles quand leur enfant n'est pas avec eux.
Contrairement aux craintes qui se sont manifestées, cet ensemble de facteurs concourt à l'équilibre psychologique des enfants.
D'autres enquêtes, surtout nord-américaines, ont confirmé ces résultats en montrant que les enfants en situation d'alternance ne présentaient généralement pas de troubles particuliers et que les perturbations qui avaient été constatées chez une minorité d'entre eux semblaient être liées davantage à la persistance du conflit parental qu'à la pratique de la résidence alternée.
Il est vrai qu'en cas de conflit parental, de surcroît lorsque l'enfant est au centre de celui-ci, l'alternance peut être préjudiciable à l'enfant. D'où l'intérêt des mesures de médiation familiale ou de pacification avant la mise en place de la résidence alternée.
Si les représentations de la résidence alternée ont évolué, si sa pratique est beaucoup mieux acceptée, aussi bien chez les cliniciens que chez les juristes, les résistances qu'elle suscite se sont focalisées sur la situation particulière des jeunes enfants.
La résidence alternée est très rare pour les bébés mais, compte tenu de la multiplication des séparations ayant lieu lorsque les enfants sont en bas âge, le nombre de jeunes enfants concernés n'est pas négligeable. Dans les trois quarts des demandes de résidence alternée, l'enfant unique ou le plus jeune des enfants a moins de dix ans. Surtout, dans un tiers des cas, il a moins de quatre ans.
C'est la raison pour laquelle cette solution peut créer un malaise chez une minorité d'enfants, comme je l'ai constaté, et entraîner parfois chez ceux-ci des troubles psychiques. Bien que l'origine de ces troubles soit complexe, leur existence, à laquelle sont d'abord confrontés les pédopsychiatres, a poussé certains d'entre eux à adopter une position hostile à la résidence alternée, peut-être avec l'idée que la seule personne capable de s'occuper d'un bébé ou d'un jeune enfant serait la mère. Même si l'on considère que les jeunes enfants ont toujours besoin d'amour, l'on peut se demander si la mère est la seule personne capable de le leur apporter. Est-ce que la prépondérance maternelle en la matière, qui a été théorisée il y a plus d'une cinquantaine d'années par de nombreux auteurs - je vous renvoie aux travaux de René Spitz et de John Bowlby, notamment, sur l'attachement -, doit véritablement être considérée comme exclusive d'autres attachements utiles au bien-être et à l'équilibre de l'enfant ?
Qu'est-ce qui permet d'affirmer qu'une résidence alternée serait a priori plus préjudiciable à l'enfant qu'une résidence unique chez la mère ? À ma connaissance, rien n'a jamais été véritablement démontré. Personne ne conteste que, sous l'influence de déterminations bioculturelles, les mères sont prédisposées à s'investir davantage dans la relation avec le bébé. D'ailleurs, bien des pères ne seraient pas capables de prendre la place que tient leur conjointe sur le plan des soins et de l'éducation jusqu'à un âge relativement avancé de l'enfant. Sauf exception, ces pères ne demandent pas une résidence alternée de leur enfant, surtout si ce dernier est très jeune.
En même temps, un certain nombre de pères sont très investis dès la naissance dans le soin apporté à leur bébé et se constituent donc en figure d'attachement pour celui-ci, autant que la mère, voire davantage, compte tenu du fait que la double activité est devenue la norme aujourd'hui et que, dans un certain nombre de cas, les pères peuvent être au chômage alors que les mamans travaillent.
En cas de séparation, la demande de résidence alternée apparaît logique. Elle s'inscrit dans ce que les parents perçoivent comme la préservation de l'intérêt de leur enfant, même si cela ne concerne qu'un nombre limité de cas.
Pourquoi, dès lors, ces situations devraient-elles être appréhendées selon un modèle qui ne les concerne pas ? En fait, pour la plupart des cliniciens, la présence de deux figures principales d'attachement pour un bébé doit être préservée. Le refus de l'alternance, qui prive l'enfant de l'une d'entre elles, semble alors participer plus d'une position idéologique que d'une analyse strictement scientifique.
L'absence plus ou moins prolongée d'un père impliqué - je vous renvoie aux travaux de Jean Le Camus - n'engendrerait-elle pas aussi des souffrances pour l'enfant et des carences préjudiciables à son bien-être ? Pour autant, cela ne revient pas à dire que le père et la mère sont interchangeables : ils ont bien sûr chacun une spécificité liée à leur position sexuée.
De fait, de nombreux témoignages de parents et d'enfants ayant vécu l'alternance de la résidence montrent que, lorsque les liens psychiques sont établis, celle-ci peut être bien vécue à tout âge, quitte à ce qu'elle soit aménagée en fonction des enfants, par exemple en augmentant le rythme d'alternance pour les plus jeunes. Le rapport au temps des jeunes enfants n'est pas le même que celui des enfants plus âgés et des adolescents. Pour les premiers, il est donc nécessaire que le rythme de l'alternance soit inférieur à la semaine. Dans ces cas-là, la stabilité des liens est plus importante à préserver que l'unicité du lieu de vie pour l'enfant.
L'hostilité de principe de certains pédopsychiatres à ce mode de gestion de l'après-séparation ne découle pas seulement du constat du mal-être de certains bébés qui, parfois, en résulte. Il faut reconnaître que des bébés ou de jeunes enfants peuvent manifester des troubles dans des situations d'alternance. Néanmoins, on peut se demander si ces troubles sont liés à l'alternance ou à des problèmes relationnels avec les parents, qui ont pour conséquence de placer l'enfant au centre d'un conflit qu'il ne peut pas gérer, surtout s'il est très jeune.
Aujourd'hui, les possibilités de réorganisation du lien familial sont multiples. Aussi, il est nécessaire de préserver la possibilité que celui-ci puisse être maintenu lorsque les parents le demandent et lorsqu'ils sont prêts à s'investir l'un et l'autre dans une double pratique de résidence de l'enfant.
Il convient d'insister sur la complémentarité des bénéfices que peuvent retirer les parents et les enfants de cette pratique. Contrairement à ce que laissent entendre certains de ses détracteurs, qui sont trop centrés sur les dysfonctionnements possibles, ce n'est pas leur seul intérêt que les parents défendent lorsqu'ils évoquent les bienfaits de la résidence alternée. En interrogeant un certain nombre d'enfants concernés, j'ai constaté que ceux-ci, en tout cas ceux qui étaient en résidence alternée depuis un temps relativement long, n'avaient pas envie de changer de système et trouvaient cette solution tout à fait convenable.
Je ne prétends pas que c'est la panacée puisque, même dans les pays où elle est juridiquement reconnue depuis longtemps, la résidence alternée ne dépasse jamais la moitié du total des modes de garde. Là où la pratique est la plus fréquente, que ce soit en Californie, dans d'autres États américains, ou dans des pays du nord de l'Europe, ce taux est au maximum de 40 %.
Un certain nombre de conditions contraignantes, parfois impossibles à réaliser, sont en effet requises pour la mise en place d'une résidence alternée. Il faut en outre que les deux parents veuillent la réaliser. Mais, pour un certain nombre de familles, celle-ci constitue sans doute la moins mauvaise des solutions pour organiser au mieux leur après-séparation.
Devant la diversité des situations familiales, notre système social a pour défi de soutenir les compétences des parents pour préserver la coparentalité et déterminer eux-mêmes les solutions qui conviennent le mieux à leur situation et à celle de leurs enfants.
M. André Lardeux.-
Monsieur Neyrand, vous avez présenté la défense du système de résidence alternée. Je vous poserai plusieurs questions.
Votre enquête avait porté sur soixante-dix couples, dont trente-cinq avaient adopté la résidence alternée. Je ne doute pas de la qualité de votre travail, mais estimez-vous que le nombre de cas que vous avez étudiés est suffisant pour valider scientifiquement l'ensemble des réflexions que vous venez de nous soumettre ?
Ensuite, vous avez parlé des troubles psychiques. Il en existe certes d'autres, mais ces troubles sont les plus graves qui puissent affecter les enfants. J'ai reçu quelques témoignages individuels, dont il ne faut, bien sûr, tirer aucune conclusion générale. Par exemple, une personne m'écrit qu'elle a « subi » - pour reprendre son propre terme - ce mode de garde bien avant que la loi ne l'ait institué. Elle se plaint de huit ans de changements d'environnement, de règles, d'autorité, de lit et de jouets, de transports de valises et de livres. Le rythme hebdomadaire de l'alternance, solution la plus fréquemment retenue, est-il le bon ? D'autres solutions ne pourraient-elles pas être envisagées tendant à allonger les délais de l'alternance et à diminuer le rythme des transferts des enfants ?
Ne devrait-on pas avoir recours à la résidence alternée en fonction de l'âge des enfants et de l'évolution des familles recomposées ? Au sein des familles recomposées, certains des enfants sont concernés par la résidence alternée, tandis que les autres ne fréquentent qu'un seul domicile. Cela ne va pas sans poser des problèmes pour les premiers. Que pouvez-vous nous dire en l'espèce ?
M. Gérard Neyrand.-
Mon enquête était qualitative. Il aurait d'ailleurs été très difficile de réaliser une enquête qui puisse prétendre à une quelconque représentativité. En effet, la résidence alternée n'étant pas reconnue à l'époque, il n'était guère possible de savoir à l'avance qui, parmi les personnes interrogées, était en situation d'alternance et qui était en situation de résidence unique.
À la suite d'une première étude que j'avais réalisée sur la situation de parents après leur séparation, j'avais rencontré un certain nombre d'entre eux qui pratiquaient cette garde alternée, préalablement à sa reconnaissance par la loi. Était-elle, ainsi que le prétendait le discours dominant de l'époque, véritablement impossible à pratiquer au motif qu'elle eût été déstabilisante et trop pénible pour les enfants, ou bien fallait-il donner raison aux parents que j'avais rencontrés au cours de ma première enquête et qui m'avaient parlé des bienfaits qu'ils avaient retirés de la résidence alternée et de leur souffrance qu'elle ne fût pas reconnue par le système social ?
Ce second terme de l'alternative fut, en quelque sorte, mon hypothèse de départ. L'enquête a effectivement démontré que la résidence alternée est, dans certains cas, non seulement possible, mais encore bénéfique pour les personnes qui y ont recours. Mais elle ne prétendait pas donner une représentation statistiquement exacte de la population concernée. On pouvait trouver des témoignages allant dans les deux sens : certains ont vécu la résidence alternée de façon très positive, et d'autres beaucoup moins. Même les enquêtes menées aux États-Unis ne sont pas statistiquement représentatives de la population. Il serait très difficile de parvenir à une représentativité exacte.
Le rythme hebdomadaire de l'alternance est-il le bon ? Il est en tout cas le plus pratiqué. Cela ne signifie pas qu'il convienne dans tous les cas. Ce rythme a tendance à s'allonger avec l'âge de l'enfant. D'ailleurs, un certain nombre des enfants que j'ai interrogés sont passés, à l'adolescence, d'un rythme hebdomadaire à un rythme bimensuel, et ce à leur propre demande. Dans le cas d'enfants très jeunes, le rythme d'alternance est inférieur à la semaine, justement parce que le rapport au temps diffère selon les enfants.
Ce rythme évolue en fonction de l'âge de l'enfant, des circonstances et des professions exercées par chacun des parents. L'alternance n'est pas toujours définie et peut légèrement varier selon les contraintes professionnelles du père ou de la mère.
L'évolution des situations de garde et de résidence de l'enfant après la séparation peut être liée à de multiples facteurs, y compris à des recompositions familiales. J'ai rencontré des enfants qui, dans un premier temps en résidence alternée, y ont finalement renoncé. Je me souviens du cas d'une jeune fille qui, adolescente, ne s'entendant pas avec sa belle-mère, a préféré rester vivre chez sa mère, après avoir pratiqué pendant douze ans la résidence alternée à sa plus grande satisfaction. Rien n'est jamais définitif et chaque situation peut être adaptée.
À l'heure actuelle, les situations familiales sont très évolutives. Les situations monoparentales sont souvent des séquences dans la vie d'un individu et durent plus ou moins longtemps.
Mme Catherine Troendle.-
Monsieur Neyrand, vous avez évoqué tout à l'heure une problématique qui me semble primordiale dans l'approche de ce sujet, à savoir le conflit entre les parents. Il est très difficile d'évaluer le degré de conflit qu'il peut y avoir entre des parents. Dès lors qu'il en existe un, confirmez-vous que, selon vous, la résidence alternée n'est pas la solution la plus adaptée pour l'enfant ?
En outre, j'ai l'impression que vous vous intéressez beaucoup à la situation et aux sentiments des parents. Quid de l'enfant ? On ne peut pas interroger les enfants en bas âge et on n'a peut-être pas suffisamment de recul pour interroger des enfants plus âgés. Néanmoins, il aurait été opportun - mais peut-être n'aviez-vous pas non plus suffisamment de recul - d'auditionner également les enseignants, dont les nombreux témoignages attestent qu'ils sont parfaitement à même de repérer dans leurs classes les enfants vivant mal la résidence alternée. La problématique semble s'aggraver au fur et à mesure que l'enfant grandit, notamment au collège, en classes de sixième et de cinquième.
M. Gérard Neyrand.-
Tout d'abord, un conflit conjugal non résolu ne me paraît pas constituer un obstacle définitif à la pratique de la résidence alternée, à condition que les parents parviennent à le dissocier de leur rapport avec leur enfant. Certains parents ont fait la part des choses et ont décidé, dans l'intérêt de l'enfant, de pratiquer une résidence alternée, en limitant la communication entre eux aux questions relatives à l'éducation de leur enfant.
Ce travail de dissociation est une nécessité absolue. Lorsque les parents n'y parviennent pas, il faut mettre en place une médiation, pour éviter que l'enfant pris entre les deux feux ne se trouve très perturbé.
De toute façon, il faudrait davantage prendre en compte les avis des éducateurs et des enseignants.
La pratique de la résidence alternée est née dès les années soixante-dix, principalement dans les couches sociales moyennes cultivées. Nous disposons maintenant d'un certain recul, avec le témoignage de personnes aujourd'hui âgées de trente ans ayant vécu une bonne partie de leur enfance en résidence alternée.
Mme Marie-Thérèse Hermange.-
Nous en convenons tous, la situation familiale des parents - mariés, non mariés, divorcés, en union libre - a une interaction sur la vie et le développement ultérieur de l'enfant, comme le souligne Serge Lebovici.
Dans votre exposé, monsieur Neyrand, vous avez cité les études de John Bowlby, René Spitz, Donald Winnicott. Nous, législateurs, représentons, en fin de compte, l'opinion publique, soit, selon Gaston Bachelard, ceux qui pensent mal.
Pour ma part, j'ai toujours eu le sentiment que ces théories relatives à l'interaction et à l'attachement tendaient à démontrer la nécessité de « défusionner » la relation entre la mère et l'enfant pendant la période de vulnérabilité de ce dernier, notamment pour que le père puisse jouer son rôle de limite et d'autorité. Or vous semblez affirmer qu'aux yeux de ces experts les rôles du père et de la mère sont similaires.
Peut-être ai-je mal compris ! Il va sans dire que la perception que nous avons de ces différentes théories n'est pas sans influence sur nos travaux législatifs.
Même Jean Le Camus a insisté sur le rôle précis de la paternité. C'est aujourd'hui un point fondamental. Poser la question de l'autorité, c'est-à-dire de la limite, c'est poser celle de la paternité. Qui « fait le père » aujourd'hui ? Le législateur ? Le père ? L'instituteur ? Le juge ?
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.-
C'est l'enfant-roi !
Mme Marie-Thérèse Hermange.-
Tout à fait !
M. Gérard Neyrand.-
C'est l'enfant qui « fait le père » !
Mme Marie-Thérèse Hermange.-
Peut-on parler de prédisposition bioculturelle de la mère ? S'il participe aux soins de ses enfants au même titre que la mère, le père doit-il pour autant négliger la question de la limite ?
M. Gérard Neyrand.-
Je partage l'avis que vous venez d'exprimer, même si je n'ai pas pu le développer au cours de mon intervention, mon temps de parole étant limité.
Spitz et Bowlby ont théorisé le fonctionnement du modèle familial dans les années cinquante, alors que les rôles paternel et maternel étaient très différenciés et qu'il revenait à la mère de s'occuper des enfants, notamment en bas âge.
Une évolution importante s'est produite depuis dans les comportements, mais aussi dans les positionnements théoriques. Les travaux de ces experts ont été non pas contredits, mais relativisés par les études ultérieures, notamment celles de Jean Le Camus.
À l'évidence, un enfant élevé avec un seul parent court un risque « fusionnel » en se renfermant sur la relation unique avec le parent gardien. À cet égard, la notion de tiers séparateur, de tiers tout court, qui permet à l'enfant d'avoir une bipolarité de relations, m'apparaît très importante.
Précisément, la résidence alternée donne à l'enfant la possibilité de maintenir un double système relationnel, sans s'enfermer dans une relation unique.
Nous touchons à la problématique que vous évoquiez concernant la paternité et la place du père aujourd'hui, sachant que son rôle ancien a été délégitimé, alors que la préservation de la coparentalité se révèle nécessaire, notamment sur le plan psychique.
M. Jean-René Lecerf.-
Permettez-moi de vous livrer un modeste témoignage. Je participe depuis plusieurs années au jury d'un concours qui est organisé conjointement par le Sénat et un quotidien d'information pour enfants.
Actualité oblige, la question posée cette année avait pour thème : « Si j'étais président... ». Dans les différents projets présentés par des élèves de l'enseignement primaire et du début du secondaire, à notre grande surprise, de nombreuses remarques ont eu trait au problème des familles séparées. La résidence alternée a été très critiquée, non pas sur le principe, mais sur ses modalités.
Ainsi, les enfants ont revendiqué de disposer chez chacun des deux parents d'une chambre, d'un bureau, de leurs manuels scolaires pour pouvoir faire leurs devoirs. Ils se sont insurgés contre la durée de transport, parfois supérieure à une heure, entre le domicile du père et celui de la mère. Enfin, ils ont considéré que les réformes ne pouvaient se faire sans leur accord puisqu'ils étaient les premiers concernés.
M. Gérard Neyrand.-
J'ai également constaté, au cours de mon enquête sur la résidence alternée, que les inconvénients soulignés par les enfants étaient d'ordre pratique, tandis que les avantages qu'ils relevaient étaient relationnels et psychologiques. Les discours tenus par les enfants montrent bien une différence à cet égard.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.-
Je vous remercie.
M. Maurice Berger, psychiatre, psychanalyste, chef du service « Psychiatrie de l'enfant » au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne ; Mme Mireille Lasbats, psychologue clinicienne, expert près la cour administrative d'appel de Douai
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.-
La parole est au Dr Maurice Berger, psychiatre, psychanalyste, chef du service « psychiatrie de l'enfant » au CHU de Saint-Étienne.
M. Maurice Berger, psychiatre, psychanalyste, chef du service « psychiatrie de l'enfant » au centre hospitalier universitaire de Saint-Étienne.-
Je vous livre le point de vue médical d'un pédopsychiatre ayant une pratique clinique quotidienne avec des enfants réels, non pas ceux de la loi ou de la sociologie.
Alors que la loi de mars 2002 a été élaborée sans que soit sollicité l'avis d'un seul pédopsychiatre, il est maintenant demandé à cette profession de réparer les dégâts. Ainsi, mes collègues et les psychologues sont consultés sur des centaines de cas ; il m'arrive d'être sollicité jusqu'à trois fois par semaine.
Il est donc faux d'affirmer qu'il y a peu de situations difficiles, même si les choses se passent bien dans certains cas.
En fait, les enfants en question présentent des troubles liés à la mise en place d'une résidence alternée sans précautions. Mais aucune étude statistique ne porte sur le devenir des enfants qui supportent mal ce mode d'hébergement.
En général, mes propos sont tellement déformés que je tiens à préciser tout de suite que je n'ai aucune position de principe contre la résidence alternée. Je considère qu'elle a été très bénéfique pour certains adolescents, alors que pour d'autres elle a constitué la pire des choses. Cela montre la difficulté de la généralisation.
Au demeurant, j'ai toujours pensé qu'il était souhaitable, pour son développement affectif, que l'enfant bénéficie très précocement, dès les premiers mois de sa vie, de contacts suffisamment fréquents avec ses deux parents pour être significatifs.
Cela dit, le dispositif de la résidence alternée tel qu'il est appliqué en France, reposant sur le partage par moitié, soulève de sérieux problèmes pour les enfants âgés de moins de six ans. Ce sont ces cas que j'évoquerai.
En effet, la question des tout petits n'a été que très insuffisamment pensée dans la loi. Mon député a d'ailleurs reconnu, lorsque je l'ai interrogé, que le cas des bébés n'avait pas été envisagé.
Construite sans garde-fou, la loi a été détournée de son sens : dans de nombreux cas, il s'agit non plus de la qualité du lien proposé à l'enfant, mais de la part d'enfant que chaque parent aura.
Dès lors, si certains magistrats font preuve de prudence, nombre de décisions judiciaires sont inadéquates, prises non pas par méconnaissance, mais par idéologie. On sait par avance, sur le plan géographique, quelle décision sera prise, indépendamment du contexte familial.
On peut voir ainsi la mise en place d'un dispositif de résidence alternée pour un bébé de six ou sept mois, d'un système engendrant sept changements de résidence en dix jours pour des enfants de quinze mois, de décisions de résidence alternée dans des situations extrêmement conflictuelles, de prescriptions par certains magistrats de dates de fin d'allaitement pour permettre l'application de la résidence alternée.
On peut voir également des décisions ne tenant aucun compte de l'éloignement des domiciles des parents. Il en est ainsi de la décision d'un tribunal français, citée par Claire Brisset, à l'époque défenseure des enfants, contraignant un bébé de six mois à passer six semaines chez son père aux États-Unis et six semaines chez sa mère en France ; dans certains cas, les enfants doivent fréquenter deux écoles.
Même Gérard Poussin, favorable à la résidence alternée, considère qu'un tel dispositif ne peut être mis en place que moyennant un certain nombre de précautions.
Il faut noter que les décisions de résidence alternée ordonnées à titre provisoire pour évaluer leur faisabilité ne sont presque jamais modifiées par la suite, quels que soient les troubles présentés par l'enfant au cours de cette période d'essai.
Contrairement aux affirmations des non-cliniciens, des conséquences sont visibles : troubles fréquents, intenses, impressionnants, durables et impossibles à traiter, troubles du sommeil, agressivité, traduisant l'angoisse de l'abandon, un sentiment permanent d'insécurité, une perte de confiance dans les adultes, un état dépressif. Certains enfants de moins d'un an peuvent avoir le regard vide durant plusieurs heures.
Nous commençons à avoir le recul suffisant pour constater que ces troubles persistent souvent à l'adolescence. Des témoignages figurent sur le site de l'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre, que je vous invite à consulter.
Je peux affirmer qu'une telle pathologie est directement liée à la mise en place de la résidence alternée puisque je ne la constatais pas auparavant, alors que j'exerce la pédopsychiatrie depuis 1975, époque à laquelle des divorces impliquaient déjà des enfants en bas âge.
Les causes de ces troubles sont clairement repérées. Lorsque les parents ne sont pas en conflit, certains enfants, compte tenu de leur sensibilité personnelle, supportent mal soit l'instabilité de leur cadre de vie, soit l'éloignement prolongé et répété de la figure d'attachement maternel. Ces symptômes disparaissent si les parents acceptent d'aménager différemment l'alternance.
Lorsque les parents impliquent leur enfant dans un conflit important, l'enfant n'a pas d'autre choix pour se construire que de s'adapter en surface à deux mondes opposés en se coupant de ses sentiments. Lorsqu'il est chez un parent, il perd tout contact avec l'autre. Dans les situations de conflit, aller chez un parent, c'est perdre l'autre.
De mon point de vue, la question est donc non pas de déterminer le droit des pères ou celui des mères, mais uniquement de savoir comment protéger le développement affectif d'un enfant.
Comment les sénateurs et les députés en sont-ils venus à voter une loi qui risque de créer des troubles affectifs ?
Tout d'abord, lors de la préparation du projet de loi, le discours sociologique prééminent a prévalu sur la question de la vie psychique et affective de l'enfant.
Or ce n'est pas parce que des pères ont décidé d'exercer différemment leur rôle parental dans une société en évolution que les besoins relationnels des bébés ont changé. Leurs besoins de stabilité demeurent les mêmes.
Je suis convaincu que le père a une place spécifique à prendre auprès de son bébé, qui n'est pas équivalente à celle de la mère. Elle est complémentaire, ainsi que l'ont montré notamment les travaux de Jean Le Camus et Michael Lamb. Désolé, le père n'est pas une mère comme les autres !
Il existe à l'heure actuelle une confusion entre l'égalité de droits sur le plan de l'autorité parentale et l'égalité de rôles quant au développement précoce de l'enfant. En fait, la figure maternelle est plus sécurisante. La figure paternelle permet plus d'ouverture sur le monde extérieur.
Selon le discours sociologique, celui du rapport d'Irène Théry, la famille est un système d'échanges où chacun a des droits - les enfants, mais aussi les parents -, où chacun a des devoirs - les parents, mais aussi les enfants. Je m'interroge : quels sont les devoirs d'un enfant de six ans ou d'un bébé de douze mois ? Un sociologue connaît-il parfaitement la santé mentale du tout petit ?
Permettez-moi de citer la réponse d'un sociologue à une mère dont l'enfant va mal depuis l'âge de sept mois, qui, lorsqu'il revient de chez son père, pleure silencieusement pendant son sommeil, se réveille fréquemment la nuit, présente un visage sans expression dans la journée et connaît des instants de panique : « Le fait que votre bébé en arrive à pleurer la nuit ne me semble pas anormal : il a à faire le deuil de l'amour que ses parents avaient l'un pour l'autre quand il a été conçu. »
Telle n'est pas l'interprétation que, pour ma part, je donnerais à ces faits !
Ensuite, la préparation du projet de loi a été marquée par les méthodes utilisées par les associations de pères qui se présentent comme des victimes.
Je reconnais que les pères ont souvent eu une place insuffisante auprès de leur enfant. Mais il est devenu coutumier que les professionnels qui, comme moi, ne font que souligner les risques de la résidence alternée pour les enfants en bas âge, se trouvent calomniés, diffamés, traités de vichystes, de nazis sur les sites Internet de ces associations, qui les accusent de prétendre qu'une mère a une valeur supérieure à un père et d'opérer ainsi une discrimination raciale, sans voir que leurs propos concernent uniquement la protection du développement affectif de l'enfant.
J'ai apporté un extrait du bulletin d'actualité de l'association Les Papas = Les Mamans, paru sur le site Internet de cette dernière, où je suis traité de nazi. Les mêmes propos sont publiés dans un numéro du magazine SOS-Papa. Je suggère à ces associations de faire preuve d'une plus grande courtoisie.
À cela s'ajoutent des menaces à peine voilées d'un certain nombre de pères, à tel point qu'un pédiatre a renoncé à publier dans une revue scientifique un article montrant comment certains troubles psychosomatiques importants peuvent être mis en lien avec la résidence alternée !
Tel est l'état des lieux réel ; ce n'est pas un tableau à l'eau de rose ! Va-t-on continuer à se voiler la face ?
Certes, tout n'est pas à rejeter dans le dispositif de la résidence alternée, car il convient réellement à certains enfants. Toutefois, il importe d'y apporter des modifications, qui dépendront du courage ou de l'absence de courage des responsables politiques.
Une réflexion a été menée récemment sur ce sujet par le précédent ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, dans le cadre d'un séminaire dirigé par le professeur Jeammet, considéré comme un pédopsychiatre très expérimenté et très modéré dans notre profession.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.-
La parole est à Mme Mireille Lasbats, psychologue clinicienne, expert près la cour administrative d'appel de Douai.
Mme Mireille Lasbats, psychologue clinicienne, expert près la cour administrative d'appel de Douai . -
J'ai une expérience de terrain et je suis psychologue clinicienne. Je donne des consultations sur des tout petits, des enfants scolarisés et des adolescents. Je possède une grande expérience en qualité d'expert. J'ai beaucoup travaillé avec les magistrats, étant très souvent requise par des juges aux affaires familiales dans des affaires de divorces conflictuels.
Dans mon activité, j'ai évidemment recours aux concepts, me référant notamment à John Bowlby et à tous les auteurs qui ont déjà été cités. Toutefois, mon expérience est également pratique. Or je constate que, depuis la loi de 2002, les besoins différents des enfants n'ont pas été suffisamment pris en compte dans le dispositif de résidence alternée. Les besoins d'un nourrisson sont bien spécifiques, tout comme le sont ceux d'un enfant scolarisé dans l'enseignement primaire ou ceux de l'adolescent.
En tout premier lieu, il importe donc de déterminer le stade d'évolution de l'enfant, de considérer son contexte familial et de définir la demande des parents. Je suis favorable à une approche modulée au cas par cas. À cet égard, ma position est plus nuancée que celle de M. Neyrand. Sachant qu'un enfant a sa fragilité, son propre rythme, sa spécificité, une étude individualisée me paraît nécessaire avant toute décision.
Qu'en est-il actuellement de la place du père et de la mère selon les concepts de nos théoriciens et suivant notre pratique sur le terrain ? Nous sommes tous d'accord pour dire que le père et la mère sont absolument indispensables pour l'évolution et l'équilibre de l'enfant. Il n'y a aucun doute à cet égard, les deux sont essentiels.
Au-delà, il importe de définir le domaine d'intervention de chacun. Les apports de l'un et de l'autre parent étant complémentaires, ils ne devraient pas se superposer. Un manque de différenciation entre le rôle du père et celui de la mère - le père voulant jouer le rôle maternant et la mère adoptant une attitude trop autoritaire, paternelle ou masculine - conduit à une confusion des genres et à une perte de repères.
Bien différencier les rôles dans leur complémentarité et dans leur entente est une base d'évolution psychoaffective nécessaire.
En outre, si chacun éprouve le besoin de paix, de calme, le nourrisson se construit selon des rythmes bien définis et inchangeables. Il faut impérativement veiller à ce que n'interviennent pas trop de bouleversements dans sa vie. Le nourrisson ne repère pas immédiatement un individu comme étant son père ou sa mère. Il est beaucoup plus sensible aux lumières, au calme, à la chaleur, à l'ambiance. C'est aussi tout cela qui constitue sa base de sécurité primaire.
Où sont les facteurs d'équilibre ? Cette complémentarité et cette ouverture dans la triangulation résident également dans la parole de la mère, dans la place qu'elle accordera au père. Si elle tient des propos disqualifiants à l'égard du père ou, à l'inverse, si le père tient de tels propos sur la mère, il se produira automatiquement chez l'enfant une espèce de rejet de l'autre parent.
Donc, cette ouverture est faite non seulement par la perception, la vision régulière de l'un ou de l'autre, mais par la parole, par l'acceptation de l'autre.
Mon temps d'intervention étant limité, je vous invite à consulter l'article plus complet que j'ai écrit à ce sujet dans la revue Dalloz et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions.
Quelles sont les conditions pour que soient réussies la résidence alternée et la séparation conjugale ?
Avant même qu'interviennent la décision judiciaire ou la décision librement consentie par les conjoints, il importe que chacun accepte de laisser la place à l'autre, d'autoriser le lien avec l'autre. En d'autres termes, il doit y avoir une acceptation de l'altérité et de la suppléance.
Il faut se garder de concevoir la résidence alternée comme un partage mathématique. Il est souhaitable d'établir une grille des besoins de l'enfant, en fonction de son âge, de son niveau de scolarisation, de sa fragilité, parfois de ses retards ou de ses handicaps : les situations sont multiples. En règle générale, plus l'enfant est sécurisé, plus il aura de facilité pour aller vers l'extérieur.
Quatre critères sont à retenir.
Le premier concerne l'âge de l'enfant. Au-dessous de trois ans, il est très difficile pour un enfant de changer de lieu et surtout d'hébergement nocturne. Le fait de passer une ou deux nuits à l'extérieur de son milieu le perturbe considérablement.
Des recherches ont montré que, chez les enfants de moins de trois ans, l'hébergement, non seulement en résidence alternée mais aussi en week-ends répétés, provoque des troubles fonctionnels, des réveils nocturnes, des cauchemars ou des symptômes d'angoisse de séparation, d'agrippement, des difficultés d'adaptation, une grande anxiété et un fort sentiment d'insécurité.
Au-delà de trois ans, l'enfant acquiert de la résistance, une faculté plus grande d'adaptation et peut plus facilement passer une ou deux nuits, voire plus, à l'extérieur de chez lui.
N'oublions pas le phénomène de la mémorisation. Avant trois ans, un enfant ne peut pas se souvenir très longtemps des visages, que ce soient ceux de sa mère, de son père, des figures d'attachement. C'est ainsi qu'après une séparation supérieure à deux nuits, l'enfant perd très rapidement la mémoire de ses figures d'attachement. Une journée équivaut pour lui à plusieurs mois pour un adulte.
Les capacités de mémorisation sont aussi importantes que celles de la cognition, de la compréhension et du jugement. Il importe donc de prendre en compte la maturité psychique et physiologique de l'enfant.
Le deuxième critère concerne la proximité géographique. Il est indispensable que l'école se situe près de la résidence du père et de celle de la mère, que l'enfant garde auprès de lui ses attaches culturelles et ses amis. Il faut éviter les grandes distances, sources de fatigue.
Le troisième critère, c'est l'entente des parents sur les modalités éducatives maternelles et paternelles. Une bonne organisation pratique est nécessaire sur de nombreux aspects matériels, notamment le choix des vêtements.
Il ne faut pas oublier que des décisions de résidence alternée prises trop à la hâte, sans étude psychologique approfondie des souhaits et de la personnalité de chacun des parents, ont pu entraîner non seulement des troubles chez l'enfant, mais aussi des rapts. Il arrive que des parents profitent du temps qui leur est imparti pour manipuler, voire enrôler l'enfant dont ils ont la charge. Les statistiques le démontrent : près de 50 % des syndromes d'aliénation parentale ont été constatés dans le cadre des décisions de résidence alternée. Quelle que soit la position de chacun en la matière, il faut donc agir avec prudence.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.-
Si vous me le permettez, monsieur le président de la commission des lois, je souhaiterais réagir aux propos de mon confrère le Dr Berger et lui dire que je n'ai pas très bien compris son attaque dirigée contre le législateur. Je sais qu'il est psychiatre et psychanalyste, et je me demande s'il ne nourrirait pas un vieux rêve refoulé : être lui-même législateur ! (Sourires. )
Nous n'avons jamais élaboré une loi qui ait pour effet d'entraîner des troubles chez l'enfant. La loi n'a créé d'obligations pour personne : nous n'avons jamais demandé aux Français de divorcer ou d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.
Mme Gisèle Printz.-
Bien sûr !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales . -
De même, nous n'avons jamais demandé aux Français de mettre en place des résidences alternées. Nous avons offert aux magistrats, aidés par des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes et tous les experts qu'ils souhaitent, la possibilité de choisir la meilleure solution dans l'intérêt de l'enfant.
Le constat des troubles que vous dressez résulte non pas de la loi, mais éventuellement de la mauvaise application de celle-ci par les magistrats, aidés par les psychologues, les psychiatres et les psychanalystes. Cela pose un vrai problème. Il y a lieu soit de modifier l'intervention des experts, soit de reformer la magistrature française. En aucun cas le législateur ne saurait être mis en cause dans cette affaire. Pardonnez-moi de le dire avec force, mais on ne peut pas laisser penser que l'objectif, avoué ou inavoué, du législateur aurait été de créer un texte engendrant des troubles chez l'enfant.
M. Maurice Berger.-
Je n'ai pas dit cela puisque je ne le pense pas !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.-
Vous avez dit qu'il était scandaleux que le législateur ait mis en place une loi ayant entraîné des troubles chez l'enfant.
M. Maurice Berger.-
Absolument pas !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.-
Si l'on veut dresser la liste des lois qui ont engendré des troubles chez tous les Français, commençons par la première, la loi fiscale ! (Rires .)
M. Maurice Berger.-
J'ai demandé comment nous avions pu en arriver à ce qu'une telle loi soit votée. Si l'avis de pédopsychiatres avait été sollicité lors de son élaboration,...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.-
Cela a été fait !
M. Maurice Berger.-
Vous auriez peut-être pu bénéficier de conseils en matière de précautions, lesquels auraient eu une influence sur la rédaction du texte. Mais je n'ai jamais prétendu que l'intention du législateur était celle que vous avez dite. D'ailleurs, je ne le pense pas. Veuillez m'excusez si je ne me suis pas bien fait comprendre.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.-
J'espère que le gouvernement d'alors - je crois me souvenir que je ne le soutenais pas particulièrement... - a pris soin, dans son rôle d'exécutif, de s'entourer des avis concernés et que les parlementaires ont fait de même.
M. Maurice Berger.-
Non !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.-
La mise en oeuvre de la loi est du ressort non pas du législateur, mais des magistrats.
Les propos que vous avez tenus sur l'application géographique des textes sont très intéressants ; ils montrent bien que c'est le magistrat qui décide d'interpréter la loi dans un sens ou dans l'autre. Vous en avez fait immédiatement la démonstration.
M. Maurice Berger.-
La loi doit prévoir des garde-fous.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.-
C'est tout le débat.
M. Maurice Berger.-
La loi doit être modifiée.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.-
On peut considérer que chaque cas est particulier et que le rôle du magistrat, entouré par les experts, est de mettre en oeuvre la meilleure solution pour l'enfant et sa famille. Dès lors, la loi doit être relativement ouverte pour s'adapter à toutes les situations. Il est évident qu'il ne faut pas retirer l'enfant du sein de sa mère ; le droit du travail pourrait d'ailleurs en tenir compte : il serait possible, par exemple, d'indemniser les femmes qui ont décidé de poursuivre l'allaitement et de ne pas les forcer à l'interrompre pour reprendre leur activité professionnelle, comme c'est malheureusement toujours la règle.
Même si je partage nombre de vos propos, monsieur Berger, j'estime qu'il ne faut pas aller trop loin.
M. Maurice Berger.-
Vous le savez, lors d'une réunion organisée par le Conseil national des barreaux, le vice-président de la chambre chargée des affaires familiales d'une cour d'appel a estimé que certains de ses collègues prenaient des décisions délirantes en matière de résidence alternée.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.-
Des sanctions s'imposent.
M. Maurice Berger.-
L'espèce humaine est ce qu'elle est. Puisque la loi structure notre pensée - nous sommes bien d'accord -,...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.-
Elle donne un cadre.
M. Maurice Berger.-
Son rôle est d'instaurer au moins des garde-fous pour éviter les grosses erreurs.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.-
Dans un certain sens, oui !
M. Maurice Berger.-
Or ils n'existent pas dans cette loi.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.-
C'est ce que nous allons voir.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.-
Généralement, la loi vise à dire le droit. Ensuite, elle est appliquée aux situations individuelles. Surtout dans ce domaine, on attend des magistrats de la prudence.
Il y eut un temps où prévalait une certaine idéologie, où la garde des enfants était systématiquement confiée à la mère. On a estimé pendant très longtemps que les pères devaient disparaître ; c'était en ce sens que décidaient les juges dans leur majorité.
Il faut donc être prudent dans la nomination des juges aux affaires familiales.
Madame Lasbats, font-ils souvent appel à vous dans de tels cas ?
Mme Mireille Lasbats.-
Oui. J'ai constaté que les magistrats étaient désireux d'obtenir des informations, et l'on peut reprocher aux psychiatres ou aux psychologues de ne pas assez s'approcher de la justice pour communiquer leur constat - je rejoins les propos de M. Berger - dans un climat de confiance et de collaboration. Les magistrats sont très isolés dans leur travail.
Je participe à des congrès à l'étranger et j'ai remarqué que la collaboration, la communication étaient bien meilleures dans d'autres pays que chez nous. En France, il existe de nombreux clivages entre les domaines judiciaire, médical et psychanalytique. Nous faisons des colloques entre nous, mais il nous manque cette ouverture les uns vers les autres. Pourtant, nombreux sont les juges aux affaires familiales ou les avocats qui désirent obtenir des éléments d'information pour prendre les décisions les plus justes possibles.
Mme Marie-Thérèse Hermange.-
Je souhaiterais formuler deux observations sur le fait que presque tout se joue avant l'âge de trois ans. Sur ce point, un consensus pourrait peut-être se dégager entre les observations de M. About et celles de M. Berger, puisqu'il est vrai, me semble-t-il, que depuis peu, l'âge du tout petit enfant est pris en compte dans ses implications ultérieures, y compris en ce qui concerne les phénomènes de violence et de délinquance.
Par ailleurs, il me semble exister une concordance entre vos propos, monsieur Berger, et ceux de M. Neyrand. Ce dernier nous a dit qu'une forte proportion des enfants concernés par son enquête avait moins de dix ans. Et vous, monsieur Berger, vous nous dites que vous voyez essentiellement des enfants de moins de six ans. Puisqu'il existe une convergence entre les données statistiques et la psychanalyse, on peut en déduire que ce qui se passe dans les premières années de la vie est très important.
Permettez-moi de formuler une seconde observation. On parle de résidence alternée pour les enfants de moins de trois ans. Mais il ne faut pas oublier que ces enfants vont en crèche et qu'ils sont donc soumis à une troisième garde : outre leur père et leur mère, ils sont confiés au personnel de la crèche où, en raison des 35 heures, la stabilité est encore compromise !
Je souhaiterais connaître la situation des familles qui se situent dans un contexte européen et dont les parents décident de divorcer. Le règlement de Bruxelles II a certes fait avancer la problématique, mais êtes-vous confrontés à des situations particulièrement difficiles ? Et que se passe-t-il pour les familles immigrées qui connaissent ce type de problèmes ?
M. Maurice Berger.-
Je n'ai pas rencontré de famille qui se situe dans un contexte européen. En revanche, j'ai eu à connaître des difficultés auxquelles doivent faire face des familles immigrées. Il est souvent arrivé que des mères acceptent la résidence alternée, et parfois même que leur enfant réside habituellement chez son père, uniquement en raison de la situation de dépendance économique dans laquelle elles se trouvaient. Elles en souffraient beaucoup et l'état psychologique de leur enfant en était affecté.
M. André Lardeux.-
Monsieur Berger, vous avez évoqué les troubles psychologiques que peuvent subir les enfants et vous avez dit que vous donniez de plus en plus de consultations. Avez-vous réalisé une étude statistique sur l'augmentation dans votre service des consultations résultant de la résidence alternée et sur ses conséquences éventuellement négatives pour les très jeunes enfants ? Il serait intéressant que nous disposions d'une indication concernant l'accroissement du nombre des troubles constatés.
J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas très favorable à la résidence alternée et je me pose la question suivante : faut-il encourager ce mode de résidence ou est-il préférable de s'engager dans une autre direction ?
Par ailleurs, la pratique la plus générale, qui est l'alternance hebdomadaire, est-elle la mieux adaptée pour les enfants ? Ne vaudrait-il pas mieux envisager un changement tous les quinze jours ou tous les mois ?
S'il faut procéder autrement, quels autres modes d'intervention peut-on envisager pour que le père ait sa place dans le développement de l'enfant ? Mme Lasbats a énuméré un certain nombre de conditions pour que, selon elle, les choses se passent mieux. Je souhaiterais connaître l'opinion du Dr Berger sur ces propositions.
M. Maurice Berger.-
Nous aurons du mal à trouver une réponse à cette question tant que nous ne mettrons pas en place un dispositif de recherche sérieux pour connaître la situation et l'état psychologique des enfants en fonction de leur âge et du mode de résidence retenu.
Voilà trois ans, j'ai sollicité la direction générale de l'action sociale, mais le simple fait - cela témoigne de l'atmosphère idéologique dans laquelle nous nous trouvons - de demander une étude en double aveugle, c'est-à-dire sans que l'on sache si les enfants observés vivaient ou non en résidence alternée, pourtant avec un dispositif méthodologiquement très valable, a été considéré comme tendancieux.
Les responsables politiques pourraient peut-être s'emparer du problème et réclamer la mise en oeuvre d'une telle recherche, qui n'est pas si onéreuse. Sinon, nous resterons confrontés aux mêmes difficultés pendant des dizaines d'années.
Mme Mireille Lasbats.-
Monsieur Lardeux, il existe d'autres modalités de résidence que l'alternance hebdomadaire ou mensuelle. L'idéal, pour les plus jeunes, c'est que le père puisse se rendre régulièrement, tous les jours ou toutes les semaines, dans le lieu où réside l'enfant pour l'habituer progressivement à sa présence et pour maintenir un contact avec lui, avant d'envisager une résidence alternée. Les modalités d'application de l'alternance peuvent être très souples.
M. Maurice Berger.-
J'ajouterai que plusieurs pédopsychiatres français proposent la création d'un calendrier incitatif qui serait mis à la disposition des magistrats. Il s'agit d'un calendrier d'hébergement progressif chez le père, bien entendu si la mère ne présente pas de trouble l'empêchant d'exercer son droit de garde. Une très large place serait ainsi faite au père. Au départ, l'enfant pourrait lui être confié trois demi-journées par semaine, et ce dès la première année, ce qui est supérieur à ce qui était bien souvent accordé auparavant.
En outre, ce calendrier serait applicable en fonction de l'investissement préalable du père. C'est la règle américaine du « temps approximatif » ou approximation rule : combien de temps le père consacrait-il à son enfant avant le divorce ? Certains pères disparaissent et ne réapparaissent qu'au bout de six ou sept mois pour demander la mise en place de la résidence alternée. Ce calendrier incitatif pourrait donc être adapté.
La création d'un dispositif d'accompagnement nous semblerait également importante. En France, lorsque des problèmes se posent au départ, il est très difficile de rattraper la situation. Je propose donc de créer un diplôme interuniversitaire pour les spécialistes, psychiatres et psychologues, qui accompagneraient pendant deux ans - avec une évaluation tous les six mois - les familles qui auraient retenu le principe de la résidence alternée. À ceux qui m'objectent que ce dispositif est très onéreux à mettre en oeuvre, je réponds qu'il coûtera de toute façon moins cher que toutes les procédures engagées devant les tribunaux, voire les cours d'appel ! Mais, pour que le système fonctionne, il doit être expérimenté au sein du service public. Sinon, les professionnels concernés seront accusés d'être tendancieux.
Reste la question importante de la modification éventuelle de la loi. Peut-on faire en sorte, par exemple, qu'aucune résidence alternée ne puisse être imposée sans l'accord des parents, ce qui apaiserait le conflit ? L'intimité et la vie privée des familles sont-elles respectées ? Un âge limite - trois ou six ans par exemple - peut-il être prévu par la loi ? Il faut entamer ce débat avec les professionnels concernés, mais je ne pense pas que ce soit le lieu ici.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.-
Monsieur Berger, les auditions ont précisément pour objectif de nous éclairer. Et la loi n'est jamais définitive !
Mme Mireille Lasbats.-
Aucune recherche précise n'a été effectuée en France, mais des études ont été menées aux États-Unis - les Américains sont peut-être un peu plus performants que nous en la matière - et nous disposons de données chiffrées sur l'augmentation des troubles fonctionnels, des cauchemars chez les jeunes enfants de moins de deux ans qui passent d'un lieu à l'autre.
Mme Gisèle Gautier . -
La délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, dont certains membres sont présents aujourd'hui, a publié un rapport voilà quelque temps sur ce sujet. Permettez-moi d'en rappeler l'une des recommandations, qui me paraît tout à fait fondamentale.
Nous nous sommes aperçus, après les différentes auditions de personnalités compétentes, qu'il n'existait aucune étude statistique fiable sur l'évolution des familles monoparentales ou recomposées. Or c'est le b-a-ba pour examiner et essayer de résoudre le problème de la résidence alternée.
À notre grand regret, le représentant de la Chancellerie que nous avons reçu nous a déclaré que celle-ci ne disposait pas non plus de données statistiques exhaustives sur la mise en oeuvre de la résidence alternée. Les seuls éléments d'évaluation quantitative disponibles proviennent d'une enquête effectuée par le ministère de la justice à la fin de l'année 2003, portant sur un échantillon de 7 716 décisions prononcées du 13 au 24 octobre.
Il serait bon, avant tout, de mettre les choses à plat et de les actualiser. Il est un fait que le nombre de familles monoparentales ou recomposées a littéralement explosé ces dernières années. Mais, sans connaître les chiffres, nous ne pourrons pas prendre les mesures qui s'imposent.
La délégation a également souhaité évoquer l'âge de l'enfant. Les différentes auditions auxquelles nous avons procédé nous ont conduits à proposer que la résidence alternée ne soit retenue que pour des enfants en âge de scolarisation, c'est-à-dire ayant environ six ans. L'alternance ne nous a pas paru souhaitable lorsque l'enfant a moins de six ans, a fortiori si la distance séparant les domiciles des deux parents est grande. Est-ce une bonne recommandation ? Il faudra que nous puissions trancher cette question ; elle est d'autant plus importante que les spécialistes nous ont expliqué que l'enfant se formait dans les cinq ou six premières années de sa vie.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.-
Je vous rappelle que nous aurons l'occasion d'entendre cet après-midi le directeur des affaires civiles et du sceau.
Mme Gisèle Gautier.-
Il nous dira la même chose.
Mme Gisèle Printz.-
Nous parlons beaucoup de la résidence alternée, et je conçois qu'elle puisse susciter de nombreux problèmes. Mais a-t-on pensé aux milieux défavorisés, qui connaissent les mêmes difficultés, avec des ennuis financiers supplémentaires ? Pour les parents, disposer chacun d'un appartement à peu près similaire, d'une chambre et d'un lit identiques s'avère pratiquement impossible !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.-
D'où l'importance des prestations familiales, comme l'aide au logement.
Mme Gisèle Printz. -
Tout à fait !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.-
Outre les allocations familiales, ces familles doivent être aidées grâce aux autres prestations sociales. L'exigence d'un double domicile peut être remplie grâce à l'aide au logement. Toutefois, il est vrai que les conditions matérielles de la résidence alternée posent des problèmes financiers quasiment insurmontables aux familles défavorisées disposant de revenus modestes. Nous aurons l'occasion d'y revenir, mais vous avez raison, madame Printz, d'y insister. D'ailleurs, ces parents souhaitent-ils avoir recours à la résidence alternée ?
Mme Mireille Lasbats. -
Il existe des demandes émanant de familles défavorisées.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.-
Il me semble que M. Neyrand nous a dit tout à l'heure que cette pratique était surtout le fait des classes moyennes et supérieures.
Mme Mireille Lasbats.-
Absolument !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales . -
J'approuve tout à fait l'idée de développer les recherches, non pas seulement sur la résidence alternée, mais sur l'ensemble des différents modes de garde, dont il faut préciser très exactement, à mon avis, les risques à court, à moyen et à long terme.
Si l'enfant fait peut-être plus de cauchemars lorsqu'il vit en résidence alternée, les troubles du comportement à l'adolescence ou à l'âge adulte sont sans doute plus importants chez ceux qui n'ont jamais vécu avec leur père.
Les propos que Mme Lasbats a tenus tout à l'heure me laissent perplexe. Si j'ai bien compris, l'enfant de moins de trois ans qui dormirait une nuit ou deux hors du domicile familial perdrait ses repères...
Mme Mireille Lasbats.-
Il ne perd pas forcément ses repères, il perd son vécu de sécurité.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.-
Cela signifie que, si l'enfant de moins de trois ans passe une nuit chez son père, il perd son « vécu de sécurité » ?
Mme. Mireille Lasbats.-
Ce sont les changements qui importent.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.-
Il faudrait donc interdire à tout enfant de moins de trois ans d'aller chez son père, puisqu'il perd son « vécu de sécurité » s'il dort une nuit ou deux hors du domicile où il réside habituellement ? Comment peut-on imaginer un droit de visite et d'hébergement qui ne permettrait pas à l'enfant de dormir une nuit chez son père ? Or il n'est pas question que nous, législateur, placions les enfants en situation de risquer de perdre leur « vécu de sécurité ». Vous voyez les limites de l'exercice... Pour ma part, j'ai eu six enfants, et ils sont parfois allés dormir chez le voisin, même lorsqu'ils étaient en bas âge. Je ne me rendais pas compte alors du risque que je leur faisais prendre ! (Rires .)
Mme Mireille Lasbats.-
Ce sont les changements trop fréquents qui sont néfastes.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.-
Je fais un peu de provocation pour aller au terme du raisonnement. Mais comment peut-on imposer un droit de visite et d'hébergement et maintenir un lien entre le père et l'enfant s'il n'est pas envisageable d'assurer ce lien avant que l'enfant ait trois ans ?
Mme Mireille Lasbats.-
Je reçois beaucoup de très jeunes enfants en consultation et je constate, comme mes collègues - je fais partie d'une équipe pluridisciplinaire, je m'exprime donc au nom de plusieurs pédopsychiatres et psychologues -, qu'il existe un vécu d'insécurité, une anxiété chez ceux qui dorment régulièrement dans des endroits différents. Je n'ai pas parlé forcément de la visite au père. Mais, je le répète, les changements très fréquents d'hébergement bouleversent l'enfant.
Mme Gisèle Gautier . -
Même pour une nuit ? Il ne faut pas mélanger les choses : le droit de visite pour une nuit est une chose, la résidence alternée en est une autre. Nous sommes bien d'accord. Lorsque l'enfant est séparé de l'un de ses parents, il est nécessaire, me semble-t-il, qu'il lui soit confié au moins une fois par semaine. Il n'est pas question de couper le contact entre l'enfant et chacun de ses deux parents.
Mme Mireille Lasbats.-
Là encore, madame, soyons précis. Il existe une différence de résistance entre un nourrisson de quelques mois et un enfant de deux ans. Même si le comportement de ceux-ci ne peut pas être généralisé et qu'une solution toute faite est exclue, nous suggérons aux parents d'agir de la façon suivante. Pour les tout petits enfants de quelques mois à un an, voire dix-huit mois, qui ont particulièrement besoin de stabilité, il serait préférable que la personne qui s'est éloignée - certains pères ont la garde de leurs enfants et remplissent ce rôle admirablement à la place de la mère très démunie -,...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.-
Bien sûr !
Mme Mireille Lasbats.-
Père ou mère, se rende régulièrement au domicile du parent qui a la garde de l'enfant. Elle pourrait ainsi maintenir le contact avec son enfant et le voir évoluer dans son lieu de vie habituel.
Mme Gisèle Gautier.-
Cela vaut-il uniquement pour la première année ?
Mme Mireille Lasbats.-
Oui, après deux ou trois ans, la mémorisation et la résistance physique s'accentuent. Encore une fois, il ne faut pas généraliser : certains enfants de trois ou quatre ans s'adaptent très bien à des résidences alternées ; d'autres n'y parviennent pas, parce qu'ils sont extrêmement fragilisés, qu'ils n'ont pas résolu complètement la « séparation-individuation » et ont des problèmes affectifs. Cette question ne peut donc être réglée qu'au cas par cas.
M. Maurice Berger.-
D'où l'importance d'un suivi de l'enfant et d'une adaptation éventuelle de la loi. Monsieur About, permettez-moi de préciser que vous n'étiez sans doute pas en conflit avec votre voisin lorsque vous lui avez confié vos enfants !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.-
Il s'agit bien de conflit, vous avez raison !
Je ne suis pas favorable à un mode de garde plutôt qu'à un autre. Ce que je crois, c'est que l'intérêt de l'enfant doit primer. Mais il faut être très vigilant, lorsque l'on défend une éventualité parmi d'autres, de ne pas commettre l'erreur de lui attribuer toutes les qualités. Pour chaque enfant, parmi les différentes solutions possibles, la meilleure doit être retenue. De toute façon, les troubles sont inévitables, car le monde des adultes n'est malheureusement pas toujours idéal pour les enfants...
Mme Mireille Lasbats.-
Nous ne devons pas rester dans le cadre de nos consultations, où nous sommes confrontés à des échecs et à des troubles chez l'enfant. Dans la vie quotidienne, en dehors de notre travail, nous rencontrons des personnes qui ont choisi la résidence alternée pour leur enfant de plus de trois ans et qui s'en félicitent.
Mme Patricia Schillinger.-
Existe-t-il une donnée statistique des enfants soignés ? Qui pousse les parents à emmener leur enfant chez un pédopsychiatre quand il présente des troubles du comportement ?
Adjointe au maire d'une commune de 3 000 habitants, je suis chargée des affaires sociales et, dans le cadre de mes activités, je reçois de plus en plus de parents qui sont déboussolés. Je joue alors le rôle d'assistante sociale et je téléphone au médecin généraliste pour attirer son attention sur l'enfant qui va mal. Or, après un ou deux ans - je suis élue depuis six ans -, je m'aperçois souvent que rien n'a été fait, ni à l'école ni par le médecin, et que les dégâts sont énormes.
Mme Mireille Lasbats.-
Souvent, ce sont les instituteurs ou les enseignants qui conseillent aux parents de nous consulter lorsqu'ils perçoivent des signes d'instabilité ou des troubles du comportement chez l'enfant. C'est souvent à l'occasion d'une alerte comme celle-là que les parents se tournent vers nous.
M. Maurice Berger.-
En ce qui concerne la résidence alternée, nous manquons de pédopsychiatres et de psychologues. Ce sont souvent les mères qui consultent lorsque leur enfant va mal. À ce moment-là, nous nous heurtons à un problème juridique : pouvons-nous soigner un enfant sans l'accord de son père ? Nous contactons systématiquement ce dernier pour qu'il vienne nous donner son point de vue. Malheureusement, beaucoup de pères rejettent notre demande. Nous pataugeons, avec le risque de subir un procès ou un rappel du Conseil de l'Ordre : certains de nos collègues ont été interdits de pratique pour des vétilles alors qu'ils cherchaient essentiellement à essayer de soigner l'enfant. La situation n'est pas claire. Nous n'avons pas les mains libres pour aider ces enfants.
Mme Janine Rozier.-
A-t-il été suggéré d'écouter les enfants quand ils commencent à grandir et qu'ils peuvent émettre un avis ? Cela pourrait être utile avant le prononcé du jugement. On peut très bien décider du mode de garde des enfants sans eux, mais à partir du moment où ils ont l'habitude de vivre chez leur père, chez leur mère, ou un peu chez les deux, ils sont souvent à même de porter un jugement sur ce qui leur conviendrait le mieux.
Je voudrais souligner un autre point. Il arrive que des avocats conseillent aux parents de consulter un pédopsychiatre pour leur enfant. Certains d'entre eux n'ont pas les ressources financières leur permettant de le faire, car ces consultations ne sont pas intégralement remboursées. Or le spécialiste aurait pu écouter l'enfant et le rasséréner un peu.
J'ai été confrontée de très près à ce problème. Le pédopsychiatre en question a expliqué aux enfants qu'ils devaient aller chez leur père. Ces consultations ont coûté très cher et n'ont abouti à rien, puisqu'il n'en a pas été fait mention dans le jugement.
Mme Mireille Lasbats.-
À chaque fois qu'un couple se sépare, la présence d'un médiateur ou d'un psychologue serait souhaitable pour recueillir la parole de l'enfant et pour rassurer les parents.
Mais lorsqu'un enfant s'exprime, le fait-il en son nom propre ou répète-t-il des propos qu'il a entendus ? L'avis d'un psychologue est donc nécessaire pour savoir si sa parole est authentique.
M. Maurice Berger.-
Pour ce qui me concerne, je prends essentiellement en compte le cas des jeunes enfants ; mais, même au-delà de six ans, la résidence alternée ne devrait à mon avis pas être retenue sans que l'enfant ait été entendu, le médiateur n'étant pas forcément la personne la mieux à même pour se prononcer.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.-
Des dispositions légales existent et s'appliquent à la résidence alternée. Ainsi, aux termes de l'article 388-1 du code civil, « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
« Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. [...] Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. [...]
« Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »
M. Maurice Berger.-
Mais les juges manquent de temps. Ils ne disposent parfois que de dix minutes pour examiner un dossier.
Mme Janine Rozier.-
Monsieur Hyest, de quelle façon un mineur peut-il formuler sa demande ?
Mme Mireille Lasbats.-
Les affaires que doivent traiter les juges sont tellement nombreuses que ces professionnels n'ont pas le temps d'appliquer les dispositions susvisées.
Mme Marie-Thérèse Hermange.-
Bien souvent, les troubles se manifestent immédiatement, mais ne sont pris en charge que deux ou trois ans plus tard.
Pour ma part, je ne comprends pas la situation actuelle.
Lorsque des médecins hospitaliers ont des difficultés pour dépister un cancer ou pour rédiger une ordonnance après l'établissement d'un diagnostic, par exemple, ils organisent une réunion avec l'équipe de l'hôpital, d'un autre établissement, voire d'un établissement étranger afin de proposer une solution pour éviter que ne se développent les troubles.
Pourquoi, dans les lieux fréquentés par les enfants, n'instaure-t-on pas une sorte de « staff de parentalité » - notamment à la maternité avec les gynécologues, à la crèche avec la directrice - chargé d'examiner, par exemple, le cas de l'enfant présentant un certain dysfonctionnement depuis quelques jours ? La mise en oeuvre d'une telle proposition serait de l'intérêt de tous : des enfants, des parents, comme des professionnels ayant la charge des enfants. Cette solution permettrait parfois un meilleur dialogue entre les parents et l'institution prenant en charge leur enfant. En effet, il existe souvent une rupture, voire des conflits, entre cette dernière et les parents eux-mêmes. Organiser un dialogue au moment adéquat est donc de l'intérêt des enfants.
Mme Janine Rozier.-
La consultation d'un pédopsychiatre a été évoquée précédemment. Dans un tel cas de figure, l'enfant est fréquemment conduit par sa mère. Le professionnel, après avoir écouté cette dernière, souhaite souvent connaître le point de vue du père. Or ce dernier, ne s'estimant pas fou, peut refuser d'aller consulter un pédopsychiatre. Par conséquent, il serait peut-être utile de faire figurer dans la loi l'obligation, lorsqu'un enfant a besoin de consulter un pédopsychiatre, que soient entendus le père et la mère.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.-
Cela paraît difficile !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.-
Ma chère collègue, je ne suis pas sûr qu'une telle contrainte soit productive.
Mme Janine Rozier.-
Il serait cependant souhaitable d'entendre les deux parents, dans l'intérêt de l'enfant.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.-
Faut-il conduire le père chez le pédopsychiatre manu militari ?
Mme Janine Rozier.-
Non, monsieur le président, mais, si l'obligation figurait dans la loi, le refus du père de s'y soumettre serait pris en considération lors du jugement.
M. Maurice Berger.-
Je partage le point de vue de Mme Hermange, mais notre profession est déjà tellement surchargée de travail que sa proposition nécessiterait le recrutement de personnels supplémentaires, ce qui aggraverait la dette publique ; c'est inadéquat.
Mme Marie-Thérèse Hermange.-
Certes, mais les commissions de synthèse ont lieu lorsqu'un drame est intervenu, et elles coûtent plus cher à la collectivité.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.-
Je vous remercie.