L'année Victor Hugo au Sénat
Palais du Luxembourg, 15 et 16 novembre 2002
Disponible au format Acrobat (13 Moctets)
-
L'HOMMAGE SOLENNEL DU SÉNAT À VICTOR HUGO À L'OCCASION DU BICENTENAIRE DE SA NAISSANCE 1802-2002
-
L'ANNIVERSAIRE 26 février 1802 ce siècle avait deux ans... 26 février 2002 - LE BUREAU DU SÉNAT À JERSEY et GUERNESEY
-
LES EXPOSITIONS
-
CE QUE C'EST QUE L'EXIL : TEMOIGNAGES POUR AUJOURD'HUI - ACTES DU COLLOQUE DU 15 NOVEMBRE 2002
-
L'EXIL AU XIXE SIECLE OU L'ESPOIR DU LENDEMAIN
-
L'EXIL DU XXE SIECLE OU
LA TRAGIQUE EXPERIENCE D'UN DEPART SANS RETOUR
-
LES FIGURES DE L'EXIL :
-
Quatrième table ronde sur L'EXIL, RENAISSANCE ET CONSTRUCTION DE SOI - Vendredi 15 novembre 2002
-
JOURNÉE DE LA TOLÉRANCE organisée par le Sénat avec le patronage de l'UNESCO - Débats, lectures et témoignages dans l'hémicycle du Sénat le samedi 16 novembre 2002

L'HOMMAGE SOLENNEL DU SÉNAT À VICTOR HUGO À L'OCCASION DU BICENTENAIRE DE SA NAISSANCE 1802-2002
PRÉSIDENCE DE M. CHRISTIAN PONCELET
(La séance exceptionnelle est ouverte à quinze heures.)
M. le président. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, j'ouvre solennellement la séance exceptionnelle pour le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo, sénateur de la III e République.
J'ai le très grand plaisir de saluer la présence, dans notre tribune officielle, de M. Bertrand Poirot-Delpech, de l'Académie française, président du Comité national de commémoration, ainsi que des membres de ce comité. (Applaudissements.)
Je présente également mes respectueux hommages à Mme Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire perpétuel de l'Académie française, qui occupe quai Conti le siège de Victor Hugo. (Applaudissements.)
Des élèves des lycées de Besançon, ville de naissance de Victor Hugo, et de Sceaux nous font également le plaisir d'assister avec nous à cette séance solennelle, qui se déroulera de la manière suivante : après mon allocution, un orateur représentant chaque groupe de notre assemblée prendra la parole pour évoquer un aspect de l'action de Victor Hugo en tant qu'homme politique ; ensuite, Mlle Rachida Brakni, pensionnaire de la Comédie-Française, donnera lecture de quelques textes de Victor Hugo. (Applaudissements.)
VICTOR HUGO ET NOUS
M. le président. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, mesdames, messieurs, à l'orée de cette séance exceptionnelle consacrée à Victor Hugo, « cet esprit conducteur des êtres », au verbe « frémissant », je voudrais me féliciter de cet hommage républicain qui nous rassemble aujourd'hui par-delà nos clivages politiques.
Comme la République, dont nul n'a le monopole, Victor Hugo n'appartient à personne tant il incarne l'humanité tout entière dans sa lutte contre la fatalité et son combat pour le progrès, ce « mode de l'homme », se plaisait-il à dire.
Le 26 février 1802, ce siècle - le XIX e - avait deux ans lorsque Victor Hugo, d'ascendance vosgienne (Exclamations amusées sur de nombreuses travées), naquit à Besançon, « vieille ville espagnole », par le hasard de la vie de garnison de son père.
Le 20 février 2002, ce siècle, le nôtre - le XXI e - entre dans sa deuxième année, après une première année marquée par la tragédie.
Deux siècles séparent ces deux dates, et, pourtant, Victor Hugo, cette légende des siècles, cet « homme océan », ce génie protéiforme demeure notre contemporain : il continue de nous parler, de nous intriguer et de nous enthousiasmer.
Victor Hugo et nous : pourquoi lui, pourquoi nous ? Deux raisons principales expliquent la pérennité de sa présence et le caractère indissoluble du lien qui nous unit à ce chantre de l'humanité, à ce héraut de la fraternité : d'une part, la proximité de l'homme Hugo, « Ego Hugo », et, d'autre part, l'actualité des combats politiques menés par ce perpétuel insurgé.
Humain, ai-je dit, et donc proche de nous : cette affirmation peut surprendre lorsque l'on songe au Victor Hugo bardé d'honneurs et figé dans sa posture de poète officiel.
Certes, le père Hugo, c'est ce personnage animé par une conception altière de sa prédestination de poète qui le place au-dessus des hommes dont il se veut le guide, le phare et la conscience. Certes, le père Hugo, c'est en quelque sorte cet égocentrique soucieux de sa trace dans l'Histoire, cet artisan de son propre mythe, ce bâtisseur de sa légende qui érige, de son vivant, sa « grande pyramide ».
Le père Hugo, c'est parfois cela, cette démesure dans l'orgueil, cette outrance dans la vanité.
Mais l'homme Hugo, c'est aussi et surtout, quand l'ombre de la complexité humaine fait reculer la lumière officielle, un ami chaleureux, un amant généreux, un père admirable et un grand-père émouvant.
Humain, et donc notre prochain, Victor Hugo a beaucoup aimé, Victor Hugo a beaucoup souffert.
Cet homme qui consigne dans ses carnets intimes le montant de ses menues dépenses
comme le détail de ses bonnes fortunes ne mesurera pas sa douleur lors de la mort de sa fille Léopoldine à Villequier.
Cet homme qui s'apparente à un monument saura pratiquer, avec simplicité et bonheur, l'art quotidien d'être grand-père et se fondra dans l'amour de la petite Jeanne.
Victor Hugo, dans son épaisseur charnelle, sa complexité et ses contradictions, c'est notre prochain, c'est notre frère et notre semblable.
Ici, dans cet hémicycle, cette proximité de Victor Hugo confine, pour nous sénateurs, à la promiscuité : il siégea, en effet, en ces lieux, d'abord comme pair de France, sous la monarchie de Juillet, de 1845 à 1848, puis comme sénateur de la III e République, de 1876 à sa mort, en 1885.
Comme nous, femmes et hommes politiques, le poète saisi par la politique a subi l'épreuve du suffrage universel - à six reprises - et connu l'amère expérience de la défaite électorale, en 1872.
C'est de cette tribune qu'il prononcera des discours immortels, comme celui du 22 mai 1876 en faveur de l'amnistie des Communards.
À la Chambre des pairs, à la Chambre des députés, au Sénat, Victor Hugo ne fit pas que des grands discours. Il s'intéressa à la question de l'école, aux ateliers nationaux, à la lutte contre la misère, et même à l'ensablement du port de Courseulles...
Pair de France - et ce fut sans doute l'un de ses premiers engagements politiques - Victor Hugo s'investit, avec une émouvante clairvoyance pour l'époque, dans la mise en place, au grand dam des manufacturiers lillois, d'un « code de protection sociale, de patronage, d'éducation et de prévoyance », exigeant l'intervention de l'État dans la question sociale. C'est ainsi qu'il participa, sur le terrain, à une investigation sur le logement ouvrier dans le Nord, qui fut peut-être l'une des premières commissions d'enquête parlementaires.
Dans sa vie de représentant de la nation, cet homme révolté fera preuve d'un immense courage, celui que confère la foi dans la providence.
Lui qui ne sait pas même charger un fusil passera sans hésiter de la tribune à la barricade.
Le poète, l'orateur incomparable, fut l'un des seuls parlementaires à être présent sur les barricades pendant les journées de juin 1848 pour y faire connaître les délibérations de la Chambre et essayer d'éviter l'effusion de sang ; l'un des seuls à animer, dans les rues de Paris, la résistance au coup d'État du 2 décembre 1851 ; le seul à demeurer, « vieillard désarmé », « présent mais non pas combattant », dans un Paris assiégé et affamé, auprès du peuple en armes, lors du terrible hiver 1870-1871.
Son opposition irréductible et infatigable au coup d'État de 1851 et à l'absolutisme qui en résulte lui valut un exil de dix-huit années ; mais la voix de Guernesey continue de tonner, avec une vigueur redoublée, contre Napoléon le Petit, l'usurpateur.
Du haut de son rocher, le proscrit, l'exilé de l'intérieur, le poète qui « marche devant les peuples comme une lumière », incarne la République en face de l'Empire, le citoyen poète en face de Napoléon III, ce « muet de la providence ». Victor Hugo est entré dans l'histoire.
Enfin, Victor Hugo, parlementaire accompli et chevronné, était, comme nous, mes chers collègues, un fervent partisan du bicamérisme conçu, tout à la fois, comme un point d'ancrage de la République et comme la forme la plus achevée de la démocratie.
À cet égard, je ne résiste jamais au plaisir de citer cette phrase datée du 4 novembre 1848 et extraite de Choses vues : « La France gouvernée par une assemblée unique, c'est-à-dire l'océan gouverné par l'ouragan ».
Victor Hugo et nous, c'est cette proximité de l'homme et cette promiscuité du parlementaire.
Victor Hugo et nous, c'est aussi la proximité dans le temps de ce géant intemporel qui demeure notre contemporain.
Moderne, Victor Hugo l'est assurément, tant nombre des combats qu'il a menés conservent une brûlante actualité.
Pour lui, « ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front ».
Pour lui, qui s'identifie à une conscience, « le genre humain est une bouche dont il est le cri ».
Ses armes sont sa plume étincelante, la puissance de son verbe, son art du plaidoyer et le souffle de sa voix.
Que de combats livrés, « un combat de cinquante ans », avec, pour fil d'Ariane, l'élévation de l'Homme avec un grand H.
Combat contre la peine de mort, ce « meurtre légal », combat qui sera parachevé, en 1982, par notre collègue Robert Badinter - oui, toujours le Sénat ! (Sourires.)
Combat pour l'émancipation de la femme et l'égalité des sexes, combat livré avec d'autant plus d'ardeur qu'il considère, en 1872, que « dans la civilisation actuelle, il y a une esclave... la femme ». De même, il lui semblait « difficile de composer le bonheur de l'homme avec la souffrance de la femme ».
Certes, le chemin parcouru depuis la fin du XIX e siècle est considérable. Désormais, il y a des citoyens et des citoyennes.
En outre, la parité dans l'accès aux mandats électifs est devenue une réalité, au moins pour les mandats municipaux. Mais nous savons tous que le combat pour l'égalité professionnelle demeure une lutte de tous les instants.
Combat pour la femme, mais aussi combat pour l'enfant, dont il épouse le parti, celui de l'innocence. Pour Victor Hugo, « l'enfant s'appelle l'avenir ».
Pour lui, il invente le concept de « droit de l'enfant », qu'il décline notamment en un droit à la subsistance et un droit à l'instruction.
De ce droit de l'enfant découle un devoir d'État, celui d'organiser l'école publique, laïque et gratuite.
En nos temps troubles, troublés et incertains, où l'enfant fait l'objet de convoitises qui peuvent briser son développement et piétiner sa personnalité, ce combat demeure - hélas ! - d'une cruelle actualité.
À ce combat, il me semble que le Parlement pourrait prendre une part active par la création, au sein de chacune des deux assemblées, d'une délégation aux droits de l'enfant.
Enfin, dernier combat qui conserve toute sa pertinence, le combat pour l'État de droit, le combat pour la République à laquelle ce jeune royaliste ultra, puis libéral, et enfin démocrate se convertira en 1848.
La République, Victor Hugo en a une conception exigeante et une vision globalisante.
Plus qu'une forme de gouvernement, la République est pour Victor Hugo une religion.
La République c'est, tout à la fois, le prolongement du Siècle des lumières, la souveraineté populaire, le suffrage universel, le Gouvernement de tous par tous, l'État de droit, la condition de la liberté dans toutes ses dimensions et la justice sociale. La République, « forme de Gouvernement la plus logique et la plus parfaite », a vocation à l'universalité et c'est l'avènement de la République universelle qui sera l'instrument de l'instauration de la paix perpétuelle.
Ces utopies peuvent faire sourire, tant la paix nous semble un état précaire. Mais ces idéaux ne sont-ils pas l'objet même du droit international et des organisations internationales mises en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ?
La paix n'est-elle pas devenue, depuis plus d'un demi-siècle, une donnée immédiate de la conscience européenne ?
L'Europe justement, l'Europe, c'est Victor Hugo, le visionnaire qui le premier formulera, dès 1849, le concept des États-Unis d'Europe.
Cette Europe république, inspirée par la France, et dont le siège est à Paris, Victor
Hugo la voit comme une Europe fédérale, mais sans fusion des nations, une Europe politique, une Europe pacifique, une union économique et commerciale, un espace de libre échange et une union monétaire.
Au moment où l'euro devient enfin une réalité concrète pour 300 millions d'Européens, n'oublions pas que, dès 1855, Victor Hugo avait dessiné les contours de cette « monnaie continentale », de cette « monnaie une » qui, je le cite encore, « remplacerait et résorberait toutes les absurdes variétés monétaires d'aujourd'hui, effigies de princes, figures des misères ».
Proximité, actualité, modernité : à cette trilogie qui tente de cerner l'oeuvre foisonnante de Victor Hugo, il faudrait adjoindre un quatrième terme : universalité.
Victor Hugo, ce héros romantique, cet homme chimérique, ce rêveur sacré appartient sans conteste au patrimoine de l'humanité.
Et s'il n'en reste qu'un au fronton de nos références, au Panthéon de nos valeurs, au firmament de nos idéaux, ce sera lui, Victor Hugo. (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
VICTOR HUGO, PAIR DE FRANCE ET SÉNATEUR
M. le président. La parole est à M. Fauchon.
M. Pierre Fauchon. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, un homme a traversé le siècle des révolutions la tête haute. Il n'en a pas seulement été le plus grand poète, il en a été aussi la conscience politique, conscience hésitante à ses débuts, très vite la plus lucide et la plus courageuse.
Pair de France pour deux ans en 1845, député de 1848 à 1851 et de nouveau quelques mois en 1870, finalement sénateur de 1875 à sa mort, en 1885, Victor Hugo n'a ambitionné que le mandat parlementaire, mais il l'a élevé à son plus haut niveau de dignité.
Rappelons les faits. En 1848, le vicomte Hugo a quarante-six ans. C'est un auteur d'avant-garde très en vogue. Il est monarchiste, chevalier de la Légion d'honneur, académicien, reçu aux Tuileries. Louis-Philippe l'a nommé pair du Royaume en 1845. De ce passage à la Chambre des pairs ne subsistent que quelques discours en faveur de la Pologne, du littoral et de la famille Bonaparte.
Il n'a pas fait de faux pas politique majeur, si ce n'est d'avoir engagé, depuis plus de quinze ans déjà, un combat personnel contre la peine de mort. IL est le chef de file de sa génération. Il en a l'élégance, l'audace et l'impertinence. Une impertinence qui n'épargne d'ailleurs pas le Sénat, le Sénat romain, bien sûr. Évoquant les temps héroïques, il rappelle que celui-ci avait refusé de verser la rançon de certains prisonniers et il ajoute : « Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le Sénat n'avait pas d'argent. » Déjà, le règne des questeurs ! (Rires.)
Le vicomte Hugo est un homme arrivé.
En réalité, il est sur son chemin de Damas que sera pour lui la Révolution de février 1848. Très vite, cet homme « arrivé » va larguer une à une toutes ses amarres et prendre le départ pour la haute mer du siècle et des siècles à venir. Député à la Constituante, il trouve sa voie ou, plutôt, il la construit : étroite et difficile. Défenseur de la République, du suffrage universel, de la liberté de la presse, de l'enseignement populaire laïc, il inscrit encore l'Union de l'Europe et la République universelle à l'horizon de l'histoire. IL se passionne enfin pour la question sociale dont il mesure le caractère crucial en accompagnant Adolphe Blanqui, son ami, dans son « enquête sur les classes ouvrières en 1848 ».
En cette même année cependant où Marx publie le Manifeste du parti communiste, Hugo rejette le matérialisme comme le collectivisme au nom d'un socialisme de compassion et de fraternité. Il dénonce la gabegie des Ateliers nationaux et s'oppose physiquement, au risque de sa vie, aux barricades de la révolte sociale de juin 1848, parce qu'il préfère la République à la révolution perpétuelle.
Dès lors, il ne sera compris ni par les conservateurs qui l'ont élu et avec qui, cependant, il tombera dans l'illusion de faire confiance au prince Napoléon, ni par les républicains de gauche qui ne l'applaudissent que pour le compromettre.
Le coup d'État de 1851 le libère définitivement. Après avoir tenté, à grand risque, une résistance physique, il échappe à la police et choisit, avec l'exil, la seule démarche parfaitement claire : un exil qu'il prolongera volontairement jusqu'en 1870. Vingt ans !
Son retour est un triomphe populaire, mais il se prête moins que jamais au politiquement correct. Élu à l'Assemblée nationale, il rejette l'armistice, vécu comme un affront aux combattants du siège de Paris et surtout pressenti comme la consécration d'une lutte inexpiable entre la France et l'Allemagne. « C'en est fait, écrit-il, du repos de l'Europe. L'immense insomnie du monde va commencer. » C'était en 1870 !
Cet extraordinaire pressentiment de la cascade des guerres mondiales le conduit à démissionner immédiatement, avec le regret de renoncer à un programme qui comprenait, outre l'abolition de la peine de mort - bien sûr - celle des peines afflictives et infamantes, la réforme de la magistrature - éternel sujet - la préparation des États-Unis d'Europe, l'instruction gratuite et obligatoire et les droits de la femme : un programme pour un siècle, et davantage !
Les portes du Sénat s'ouvrent enfin pour lui en 1876. Au côté de Gambetta, il prend immédiatement la tête du combat pour l'établissement de la République. Il poursuit sans relâche la lutte pour l'amnistie des Communards.
En dépit d'une congestion cérébrale en 1878, il poursuivra sa prodigieuse activité. Il reste au Sénat jusqu'en 1885, comme la statue vivante de la liberté, de l'égalité sociale et de la fraternité.
Deux réflexions prolongeront cette trop sommaire chronologie.
La première me conduit à relever que le parcours politique de Victor Hugo, à la différence de beaucoup d'autres, ne va pas de l'idéalisme au réalisme. S'il commence par les chemins battus du « politiquement correct », il se poursuit par des actions de franc-tireur et de partisan par lesquelles il s'émancipe de toute voie tracée et balisée. Ses balises à lui sont la liberté, la démocratie, la compassion pour toutes les misères et, sur leurs exigences, il ne transigera jamais. Sa vie publique ne va pas, selon la formule de Charles Péguy, de la mystique à la politique, mais l'inverse : elle n'est pas une carrière, elle est une ascension.
Ma seconde réflexion est une invitation, l'invitation faite à chacune des familles qui composent notre assemblée à se retrouver en Victor Hugo. À la veille de l'élection présidentielle, il est même permis d'imaginer chacun des candidats enrôlant sous sa bannière un message de notre héros.
Du côté de l'Assemblée où l'on s'honore d'occuper le lieu même où le sénateur Hugo a choisi de siéger, on ne manque certainement pas de légitimité à invoquer l'homme qui a écrit : « À côté de la liberté, qui implique la propriété, il y a l'égalité, qui implique le droit au travail, formule superbe de 1848 ! Et il y a la fraternité, qui implique la solidarité. Donc, République et socialisme, c'est un. Moi qui vous parle, citoyens, je suis un socialiste de l'avant-veille. Mon socialisme date de 1828. J'ai donc le droit d'en parler. »
Mais les libéraux pourront, de leur côté, invoquer Victor Hugo s'opposant à toutes les formes de collectivisme, à commencer par les Ateliers nationaux, s'indignant de « cette aumône qui flétrit le coeur au lieu du travail qui le satisfait », et proclamant son attachement à une République fondée sur « une liberté sans usurpation et sans violences, une égalité qui admettra la croissance naturelle de chacun, une fraternité, non de moines dans un couvent, mais d'hommes libres », une République qui « partira de ce principe qu'il faut que tout homme commence par le travail et finisse par la propriété et qui respectera l'héritage, qui n'est autre chose que la main du père tendue aux enfants à travers le mur du tombeau ».
Mes amis politiques personnels, de leur côté, auront le bonheur de s'inscrire dans la perspective de l'Union européenne, annoncée dès le 17 juillet 1851 avec la monnaie unique. Ils se retrouveront, avec peut-être un mélange de fierté et de mélancolie, dans le précepte selon lequel il vaut mieux obéir à la conscience qu'à la consigne. (Très bien ! sur les travées socialistes.)
Enfin, je m'adresse à ceux qui ont la fierté de se réclamer du plus grand Français de notre temps, dont l'héritage est si vaste qu'ils accepteront bien de le partager avec nous tous en cette minute : je veux parler, bien sûr, de l'homme du 18 Juin.
Comment ne verraient-ils pas, comment ne verrions-nous pas avec eux qu'il y eut une première résistance avant la Résistance, que l'exil de Jersey préfigure celui de Londres, que le premier comité de résistance fut créé sous ce nom même par Victor Hugo le 2 décembre 1851, à Paris ? Il écrit alors :
J'accepte l'âpre exil, n'eût-il ni fin ni terme.
Sans chercher à savoir et sans considérer
Si quelqu'un a plié qu'on aurait vu plus ferme.
Comment ne pas identifier le même combat dans des formules telles que : « S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là », ou : « Quand la liberté rentrera en France, je rentrerai » ? Plus tard, lors de l'invasion de 1870, ce n'est pas Malraux, c'est Hugo qui écrit : « O francs-tireurs, allez, traversez les halliers, passez les torrents, profitez de l'ombre et du crépuscule. Faisons la guerre de jour et de nuit. » Comment ne pas reconnaître, déjà, Le Chant des partisans et la même fierté d'être Français, le même amour de la liberté et de la République ?
Sans doute l'Histoire ne se répète-t-elle pas, mais elle se continue, et le recul du temps permet de mieux discerner, dans le mélange d'ombres et de clartés dont toute vie est faite, le fil d'or qui relie entre eux les destins héroïques.
Ainsi fut le sénateur le plus courageux, le plus lucide, le plus fraternel de nos collègues.
S'il nous paraît incohérent, contradictoire, c'est qu'il voit plus large et plus loin que nous.
S'il nous paraît un poète égaré en politique, c'est que nous sommes aveuglés par le quotidien, qui nous empêche de voir les étoiles. Cependant, elles brillent pour tous, et pas seulement pour les poètes.
S'il nous paraît dépassé, c'est que nous avons perdu de vue notre propre horizon et le sens de l'infini.
En réalité, mes chers collègues, nous faisons non pas l'éloge d'un mort, mais l'éloge du plus vivant d'entre nous. (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
VICTOR HUGO, CHANTRE DES LIBERTÉS
M. le président. La parole est à M. Del Picchia.
M. Robert Del Picchia. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, « il n'y a de liberté pour personne s'il n'y en' a pas pour celui qui pense autrement ».
Cette phrase de Rosa Luxemburg, qui définit si bien le principe de liberté d'opinion situé au fondement de notre démocratie, Victor Hugo aurait pu la prononcer.
Ce principe, il l'a en effet illustré toute sa vie, dans son oeuvre, dans ses combats politiques et à cette tribune.
Souvent, il a appartenu à la minorité.
En 1849, auditionné par le Conseil d'État lors de la préparation de la loi sur les théâtres, Victor Hugo affirme : « J'ai dans le coeur une certaine indifférence pour les formes politiques et une inexprimable passion pour la liberté. Je viens de vous le dire, la liberté est mon principe, et partout où elle m'apparaît, je plaide ou je lutte pour elle. »
La liberté, donc, est dans son oeuvre.
Hugo garde de son éducation un sens profond du caractère humain de la liberté.
Fils du XVIII e siècle, il incarne au XIX e la marche des Lumières, une marche de la liberté qui, pour n'avoir pas suivi un chemin rectiligne - il fut tour à tour royaliste, libéral, puis républicain, on le sait -, ne connut cependant jamais de retraite.
Pour lui, parler « des » libertés n'a pas de sens. En 1866, il écrit à Clément Duvernois :
« Égalité, liberté, aspiration et respiration du genre humain. Cela posé, il est étrange d'entendre raisonner sur les libertés accessoires et sur les libertés nécessaires.
« L'un dit : Vous respirerez quand on pourra.
« L'autre dit : Vous respirerez comme on voudra.
« La liberté est. Elle a cela de commun avec Dieu qu'elle exclut le pluriel. »
Il défend d'abord la liberté dans l'art, dans la création. Cette liberté, il l'affirme en 1827 dans Cromwell, dont la préface apparaît comme le manifeste du nouveau théâtre romantique :
« Il serait étrange qu'à cette époque, la liberté, comme la lumière, pénétrât partout, excepté dans ce qu'il y a de plus nativement libre au monde, les choses de la pensée.
Mettons le marteau dans les théories, les poétiques et les systèmes. Jetons bas ce vieux plâtrage qui masque la façade de l'art ! »
Deux ans après cette préface, en 1829, sa pièce Marion de Lorme, qui contient quelques allusions déplaisantes pour la royauté, est frappée par la censure, comme le sera Le roi s'amuse en 1832.
Le 25 février 1830, les cris d'indignation et les ovations ponctuent la première d'Hernani. La pièce porte à son paroxysme l'affrontement des romantiques et des classiques. Elle est traînée dans la boue par la critique, mais le public est conquis : la bataille d'Hernani est gagnée.
Une fois entré en politique, celui qui disait avant son élection vouloir défendre à l'Assemblée « les ouvriers de l'intelligence » ne manque pas à sa promesse. Le 3 avril 1849, quand la question est soulevée par Jules Favre au cours de la discussion budgétaire, il distingue deux censures : la bonne, respectable, efficace, exercée au nom de la décence et de l'honnêteté, est celle qu'exercent « les moeurs publiques », autrement dit la conscience d'auteurs et de spectateurs responsables ; la mauvaise censure, celle contre laquelle il se bat, c'est celle qu'exerce le pouvoir et qui est oppression. Elle ne peut qu'être méprisée et bravée.
Du théâtre - littérature en action -, Hugo choisit de faire le lieu par excellence du combat pour la liberté dans l'art.
Chez lui, la poésie est politique ; on ne peut distinguer les deux.
Dans sa pièce intitulée L 'Épée, parue après sa mort dans le recueil du Théâtre en liberté, l'un de ses personnages dit au peuple :
Ah ! Vous autres,
Vous êtes contents ! Ah ! Vous êtes heureux, vous !
Gais à la chaîne ! Alors ils ont raison, les loups,
D'être maigres, sans feu ni lieu, nus sous la bise,
Mourant de soif sitôt que la rivière est prise,
Las, affamés, errant l'hiver, errant l'été,
Et d'avoir la misère, ayant la liberté !
Désireux de participer à la vie publique, suivant l'exemple du grand Chateaubriand, Victor Hugo voit son souhait satisfait en 1845, lorsqu'il est nommé à la Chambre des pairs.
En février 1848, il regarde l'histoire se faire autour de lui et comprend qu'une nouvelle ère commence.
La République lui apparaîtra peu à peu comme le régime susceptible de permettre au citoyen de se réaliser en tant qu'homme libre.
Plus tard, Victor Hugo deviendra républicain de coeur et adoptera l'idéal de la République de 1848, à laquelle il reconnaît le mérite d'avoir inauguré une conjugaison de la souveraineté du peuple et de la liberté des citoyens.
Si Victor Hugo ne prend pas parti pour les insurgés de Juin, après la fermeture des Ateliers nationaux, il s'oppose aux mesures répressives du général Cavaignac, qui fait interdire onze journaux.
Il s'élève alors en faveur de la liberté de la presse, regrettant en octobre 1848 que l'élaboration de la Constitution n'ait pu bénéficier d'une presse libre. Pour lui, « la liberté de la presse importe à la liberté même de l'Assemblée, elle est même la garantie de sa liberté ».
Hugo s'oppose donc à la censure qui accompagne l'état de siège, à son caractère arbitraire et imprévisible. IL prend la défense d'Émile de Girardin, directeur du journal La Presse, suspendu pendant un mois.
Mais Victor Hugo n'est pas favorable pour autant à l'absence de règles. La censure doit laisser place non pas au vide, mais à la loi, qui seule fixe des règles identiques pour tout le monde et connues de tous : « Les lois doivent être les tutrices et non les geôlières de la liberté. »
Quand le pouvoir souhaite rétablir, par la loi, le cautionnement et le droit de timbre pour les journaux, il affirme dans son grand discours du 9 juillet 1850 que « la souveraineté est l'âme du pays. Elle se manifeste sous deux formes : d'une main, elle écrit, c'est la liberté de la presse ; de l'autre, elle vote, c'est le suffrage universel ». Pour Hugo, la presse est « une formidable locomotive de la pensée universelle ». En comprimer la liberté, c'est aller vers l'explosion.
On comprend aisément qu'il n'y ait pas de droit plus essentiel, pour un homme qui combat l'injustice, l'oppression et l'intolérance avec sa plume, à l'exemple de Voltaire, que celui d'écrire et de publier librement.
Pour Victor Hugo, la laïcité est au fondement de la liberté de l'enseignement. Dans son grand discours du 15 janvier 1850, il déclare que « l'État ne peut être autre chose que laïque ». C'est cette laïcité qui permet aussi «une liberté d'enseignement pour les congrégations religieuses ».
Le discours de Victor Hugo est un discours fondateur pour la libre-pensée en matière d'instruction.
Anticlérical, mais déiste et spiritualiste, Hugo est un libre-penseur à l'époque où cela signifie d'abord un profond attachement à la République.
La portée de son action pour la liberté dans l'enseignement et sa proximité avec les mouvements de libre-pensée sont confirmées à sa mort : soixante et une associations de libre-pensée et cent vingt et une sociétés d'instruction suivent le convoi lors de ses funérailles.
Au fil de ses discours, Hugo devient donc le chantre de la République et des libertés.
Il est personnellement touché quand les mesures autoritaires qui annoncent la fin de la République frappent ses deux fils, incarcérés pour délit de presse.
Le 11 décembre 1851, après avoir tenté d'organiser la résistance au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, menacé d'arrestation, il prend le chemin de la liberté, qui le conduit en exil à Bruxelles, puis à Jersey en 1852 et Guernesey en 1855.
Homme des exils successifs, Victor Hugo devient, pendant près de vingt ans, un Français de l'étranger. (Sourires.)
Gardant une plume libre, il dévoile pendant son exil des talents de pamphlétaire. Son Napoléon le Petit suit les voies de la contrebande de la Belgique à la France.
En 1859, il pourrait revenir en France. L'amnistie impériale lui est offerte. Il la refuse, n'oubliant pas le péché originel de l'Empire. « Fidèle à l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de ma conscience, je partagerai jusqu'au bout l'exil de la liberté. Quand la liberté rentrera, je rentrerai. »
Pendant ses années d'exil, son oeuvre - Les Contemplations, La Légende des siècles, Les Misérables - touche une audience à la fois populaire et lettrée. Il combat sur tous les fronts - entreprises coloniales, tentations nationalistes - et met l'idéal de liberté au coeur de chacune de ses luttes.
Quand il rentre à Paris, le 5 septembre 1870, Hugo est devenu le poète national, la conscience républicaine, le héraut de la liberté. La foule l'accueille à la gare du Nord en chantant La Marseillaise et Le Chant du départ.
Élu député de Paris en février 1871, il démissionne un mois plus tard lorsque ses collègues l'empêchent de s'exprimer pour prendre la défense de Garibaldi au moment où l'Assemblée discute de l'invalidation de ce député étranger qui s'est battu pour la France : « Vous avez refusé d'entendre Garibaldi, je constate que vous refusez à mon tour de m'entendre ; et je donne ma démission. »
Après l'avoir défendue en parole, c'est donc par ses actes qu'il revendique la « liberté de la tribune ».
À Bruxelles, pour des raisons familiales, Hugo prêche la voie sacrée de l'asile politique et se dit prêt à accueillir les Communards exilés.
Expulsé de Belgique, il passe au Luxembourg avant de regagner Paris, où il s'emploie à obtenir l'amnistie des Communards.
Élu sénateur de la Seine en janvier 1876, il défend, le 22 mai, la proposition d'amnistie au Sénat, se retrouvant à nouveau en position minoritaire : « Ce que l'amnistie a d'admirable et d'efficace, c'est qu'on y retrouve la solidarité humaine.
C'est plus qu'un acte de souveraineté, c'est un acte de fraternité. »
Le 30 mai 1878, devant des sénateurs et des députés réunis au théâtre de la Gaîté, il rend hommage à la liberté de Voltaire, son modèle, Voltaire qui, comme lui, ne concevait de véritable civilisation que celle qui obéit à l'idéal et non à la force.
Comme il le disait lui-même de Rousseau, Diderot et Voltaire, Victor Hugo a été « un ouvrier du progrès qui a utilement travaillé ».
La République et l'État de liberté dans lesquels nous vivons aujourd'hui lui doivent beaucoup.
N'oublions pas, comme il l'a lui-même montré tout au long de sa vie, que la liberté n'est jamais définitivement acquise, qu'elle est toujours à faire, qu'il faut continuer à avancer.
Pour terminer, permettez-moi de citer une dernière fois Victor Hugo évoquant la démocratie et la liberté dans le chapitre « Les esprits et les masses » de son ouvrage sur William Shakespeare : « La servitude, c'est l'âme aveuglée... Qui n'est pas libre n'est pas homme... La liberté est une prunelle. La liberté est l'organe visuel du progrès. » (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
VICTOR HUGO, L'HOMME DU PROGRÈS SOCIAL ET HUMAIN
M. le président. La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, j'avais six ans quand mes parents m'emmenèrent avec mes deux soeurs pour la première fois au cinéma voir Les Misérables. J'ai été bouleversé au point que les noms des personnages s'imprimèrent dans ma mémoire pour toujours. Je me déroule encore avec précision les images de ce film-livre. À un moment de la projection, Fauchelevent, joué par Carette, risque la mort par écrasement. Je me suis mis à crier. C'étaient mes premières « choses vues ». On dut quitter la salle. J'avais 40° de fièvre. Hugo et ses personnages fissurés, fracturés, bousillés même, m'avaient transpercé. Ils sont toujours là, même si la situation a beaucoup changé. Nombre de nos concitoyens ont des rallonges à leur vie. Eux n'ont pas de place pour leurs vies en friche. Ils pensent même qu'ils sont de trop dans la société, d'autant qu'ils sont frustrés du rayon de leur marche.
Ce dévoilement de la misère et les mots-cris, les mots-alertes pour la dire, au lieu de s'éloigner avec le calendrier, fonctionnent comme un zoom permettant de mieux les mettre à feu. Le choc reçu m'a conduit au devoir-désir d'autre chose. Fièvre, friche, feu, ne cherchez pas pourquoi je suis devenu un mutin.
Oui le vieil Hugo, comme on dit si vite avec condescendance, en vérité le jeune Hugo après vieux comme Faust a mis d'innombrables humains en marche vers la lumière à travers la conscience. Le présent est un trou dont les deux bords sont le « passé luisant » et « l'avenir incolore, » disait Apollinaire. Hugo a ôté du luisant au passé et coloré l'avenir, sans pratiquer la célébration, cette friperie idéale où viennent se costumer les identités vacantes.
Mes mots sur Hugo, qui siégea ici de 1876 à 1885, ont une tendresse reconnaissante à son égard, qui s'est renforcée à l'école publique où j'ai eu deux maîtres d'école hugoliens et en 1952 quand le cent cinquantième anniversaire de sa naissance fut méprisé par les pouvoirs publics.
Mes deux maîtres avaient dans leur « faire » intégré le sens que Hugo formula pour l'école dans son William Shakespeare :
« Qu'est-ce que le genre humain depuis l'origine des siècles ? C'est un liseur. Il a longtemps épelé, il épelle encore ; bientôt il lira.
«Cet enfant de six mille ans a d'abord été à l'école. Où? Dans la nature. Au commencement, n'ayant pas d'autre livre, il a épelé l'univers... Puis sont venus les premiers livres ; sublime progrès. Le livre est plus vaste encore que ce spectacle, le monde, car au fait il ajoute l'idée...
« La lecture, c'est la nourriture. De là l'importance de l'école, partout adéquate à la civilisation. Le genre humain va enfin ouvrir le livre tout grand. L'immense bible humaine, composée de tous les prophètes, de tous les poètes, de tous les philosophes, va resplendir et flamboyer...
« L'humanité lisant c'est l'humanité sachant. »
Victor Hugo mêlait ainsi dans son approche de l'école « le coeur qui pense » et sa distance de « l'utile » dont Bataille dira plus tard que sa mise en avant systématique permet d'éluder les questions fondamentales.
L'année 1952 maintenant. Aragon, qui avec Breton avait défendu Hugo chez les surréalistes en le lisant à haute voix, ne supporta pas le silence organisé. Il souhaitait aussi faire réfléchir sur la lecture sectaire de Hugo par Guesde et Lafargue et par les radicaux. Le 24 mars 1952, à la salle des sociétés savantes à Paris, il interrogea un auditoire passionné: «Avez-vous lu Victor Hugo?» J'y étais. J'avais Les Misérables dans ma besace et cette apostrophe aux sénateurs de l'époque : « Je ne suis pas de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde... mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire... Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse ; car, en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli. »
J'ai dévoré ensuite le reste de son oeuvre qui n'est pas une marmelade - comme on le dit parfois - pour les enfants des écoles, mais un immense poème que Hugo identifie à l'homme, un sillage écumant et triomphant de l'énorme XIX e siècle. Ce génie légendaire du siècle fit oeuvre forêt, oeuvre lumière, oeuvre d'un solitaire solidaire, oeuvre de combat, oeuvre en cours - « la vie est une poésie interrompue », écrivait-il - oeuvre prophète, oeuvre d'éternelle aurore, oeuvre de cime, oeuvre de l'essentiel, oeuvre d'utopie, oeuvre sur l'infini, oeuvre de conscience.
Dans cette véritable armoire démentielle, à l'opposé de la littérature « mot d'ordre » - Hugo voulait « l'influence et pas le pouvoir » - il milita pour la condamnation absolue de la peine de mort - pour Victor Hugo, l'affaire John Brown fut l'affaire Calas pour Voltaire - pour le suffrage universel, le droit d'auteur, l'Europe des peuples, la paix, l'école laïque obligatoire, les droits de la femme - écoutez et voyez Esméralda - et de l'enfant, l'amélioration de la condition pénitentiaire, l'amnistie des Communards. Il milita contre Napoléon le Petit ; les plus beaux vers de Hugo sont contre l'oppression. Il milita contre l'esclavage et il travailla, notamment par la « question d'Orient », sur le dialogue heurté des peuples et des cultures, sur l'identité et l'altérité, sur l'option d'autrui, sur l'hospitalité pour le différent dans le pluralisme.
Si l'on voulait condenser Hugo politique, on dirait qu'il s'est compromis toute sa vie, courageusement et lucidement, avec la personne humaine et a assumé lucidement et courageusement sa vie de proscrit volontaire durant dix-neuf ans à quarante-huit kilomètres des côtes normandes avec cette morale : « Quand la liberté rentrera je rentrerai. »
En témoigne le récent beau livre Écrits politiques où Franck Laurent cite en vrac : « La politique est strictement l'affaire de tous : en aucun cas elle ne saurait être réservée à un individu ou à un groupe, ni limitée aux lieux et aux modes "officiels". L"'homme politique" qui ne reconnaît d'autre légitimité que la sienne et celle de ses pairs, comme le citoyen qui se décharge sur lui du soin des affaires publiques pour mieux s'occuper des siennes, font le lit de toutes les tyrannies, les violentes et les douces. »
« La vraie fidélité à l'idéal consiste moins à multiplier, au nom d'une conception sectaire et puritaine de la pureté, les lignes de fracture et les procès en trahison qu'à rassembler les énergies de tous les amoureux du progrès, voire de tous les hommes de bonne volonté autour d'un commun désir. »
Le temps court. L'océan Hugo a du mal à être contenu. Encore quelques mots cependant.
Hugo dont la pensée en quatre-vingt-trois ans de vie - « une durée », comme dirait Goethe - a obéi d'une surprenante manière à l'histoire et s'est aussi formée en s'écrivant, Hugo a tenté de faire partager à tous tout ce que la terre compte d'ardents et d'insatisfaits. Aussi, le vertige des transgressions et la visite des ombres.
Il en est de taille et je reviens aux Misérables.
Avant eux, j'évoquerai RuyBlas, écrit en 1838, présenté actuellement par Brigitte Jacques au Théâtre-Français. Ruy Blas est né dans le peuple. Il ne ménage pas ses mots, mais il est laquais, valet, et n'a donc pas de présent. Il échoue.
Après eux, je retiens L'homme qui rit, roman publié en 1869. Le héros Gwynplaine à la Chambre des lords parle : « Vous augmentez la pauvreté du pauvre pour augmenter la richesse du riche. C'est le contraire qu'il faudrait faire. » Et il conclut : « Je suis le peuple. »
Que s'était-il passé entre Ruy Blas et L'homme qui rit ? La Révolution de 1848 et ses barricades, Les Misérables et Gavroche.
Une quantité de vie, une quantité d'imagination et, comme dit Hugo, « la quantité de civilisation se mesure à la quantité d'imagination ». Quantité d'imagination qui lui fit aborder le socialisme au congrès de la paix en 1869 : « Le socialisme est vaste et non étroit. Il s'adresse à tout le problème humain. Il embrasse la conception sociale tout, entière. En même temps qu'il pose l'importante question du travail et du salaire, il proclame l'inviolabilité de la vie humaine. Le socialisme affirme la vie, la République affirme le droit. L'un élève l'individu à la dignité d'homme, l'autre élève l'homme à la dignité de citoyen. Est-il un plus profond accord ? Je défends le socialisme calomnié. »
C'est ce même Hugo qui se battit avec acharnement pour l'amnistie des Communards. Le 22 mai 1876, il intervenait ici : « À vingt ans d'intervalle pour deux révoltes, pour le 18 mars et pour le 2 décembre, les deux conduites tenues dans les régions du haut desquelles on gouverne sont : contre une fièvre du peuple, toutes les rigueurs ; devant les infamies de l'Empereur, l'agenouillement. Il est temps de faire cesser l'étonnement de la conscience humaine. Il est temps de renoncer à cette honte de deux poids et deux mesures, je demande pour les faits du 18 mars l'amnistie pleine et entière. »
Et ce travail inouï, cette écoute avec anxiété des voix inconnues, Victor Hugo l'a fait sans linéarité et dans certaines douleurs de son intimité.
Le monde est d'une extraordinaire complexité. Hugo n'en a pas tiré prétexte pour se distancer de l'action et ne l'a pas trahi. Il fut homme du malaise critique. On prête à Hugo des certitudes qu'il n'avait pas. Ses convictions inquiètes ne l'empêchèrent pas de se jeter dans la mer et de n'esquiver rien. Dans cette mer, il y avait son intimité où l'amour fut central, mais qui fut douloureuse quand il vit disparaître ses enfants et d'abord, en 1843, Léopoldine, noyée avec son mari.
Je verrai cet instant jusqu'à ce que je meure,
L'instant, pleurs superflus !
Où je criai : l'enfant que j'avais tout à l'heure,
Quoi donc ! je ne l'ai plus !
Allons, je revendique le droit d'aimer cet homme qui m'a permis, selon la belle expression d'Aragon, d'« avoir tous les oiseaux du monde dans ma volière », un homme qui a voulu, avec une certitude morale, à tout prix comprendre le perpétuel mouvement de l'histoire, un homme qui, dans son poème A l'Arc de Triomphe, monument qu'il aimait, osait écrire ces vers :
Quand le temps dans la frise antique Ôte une pierre et met un nid !
Ôter une pierre et mettre un nid, c'est un travail politique incontournable auquel nous nous devons de participer. Hugo, cet homme qui se souvient de l'avenir, me pousse à le faire, à faire plus, à faire mieux avec, notamment, le transfert en politique de la langue du poète. L'acte de création est un accumulateur d'énergie. Le désespoir n'est pas un mot politique ! (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
VICTOR HUGO ET L'ABOLITION
M. le président. La parole est à M. Badinter.
M. Robert Badinter. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je préfère commencer par un aveu : je suis hugolâtre ! (Sourires.) Et quand on a, comme moi, une telle passion, il est difficile de s'en tenir aux dix minutes imparties.
Nous parlons de l'homme public, pas de l'homme Hugo, pourtant si attachant, pas de l'écrivain, non, de l'homme public. Je suis parti à la recherche de ce qui donne à une si étonnante destinée son unité profonde. Comme l'a rappelé Pierre Fauchon, cette unité est difficile à trouver au départ, dans son parcours politique.
J'ai retrouvé cette formule, non destinée à la publication, dans laquelle Hugo, cet ancien royaliste - nous sommes en 1849 - s'interroge et se définit : « Je suis libéral, socialiste, démocrate, républicain. » Reconnaissons qu'il faut être un poète pour écrire ces choses ! (Rires.) Mais il n'en deviendra pas moins, comme l'a si bien dit Jack Ralite, le symbole même de la République, dans ce qu'elle a de meilleur et de plus pur.
Alors, à la recherche de l'unité de cette destinée tumultueuse, je crois avoir trouvé la clef. La clef, chez Victor Hugo, c'est la passion de la justice. Plus qu'aucun homme public, à ma connaissance et certainement dans son siècle, Hugo a été le champion d'une autre justice, d'une justice plus humaine, d'une justice plus fraternelle.
Ces passions-là, il faut tenter d'en trouver la source cachée, généralement profondément enracinée dans l'enfance ou dans l'adolescence. Hugo nous livre, çà et là, des indications sur sa vie. Il avait dix ans lorsque, traversant Burgos, renvoyé à Paris par son père, le général Hugo, avec Mme Hugo et son frère Eugène, Hugo assiste aux préparatifs d'une exécution capitale et voit un homme que l'on emmène vers l'échafaud pour y être garrotté entre des capucins masqués en inquisiteurs.
Il avait à peine seize ans, et c'est lui-même qui le narre, lorsqu'il passe sur la place du palais de justice, à Paris. Et là, il voit, comme cela se faisait à cette époque de la Restauration, une servante, une malheureuse, qui avait volé deux mouchoirs à sa patronne, marquée au fer rouge par le bourreau. « J'ai encore dans l'oreille », écrit-il quelque cinquante ans plus tard, « et j'aurai toujours dans l'âme, l'épouvantable cri de la suppliciée. C'était une voleuse. Pour moi, ce fut une martyre. Je sortis de là déterminé à combattre à jamais les mauvaises actions de la loi. »
De cette violence injuste de la justice, Hugo s'attaquera d'abord à l'expression la plus sanglante, la plus insupportable aussi : la peine de mort. Il n'est pas d'écrivain qui ait dénoncé la peine de mort avec autant de passion, parfois même autant de génie que Victor Hugo. « Cette loi du sang pour le sang, je l'ai combattue toute ma vie », écrivait-il, en 1862, au pasteur Bost, de Genève. C'est vrai, et c'est pourquoi je parlais d'unité.
Il l'a combattue tout au long de son oeuvre, depuis Le Dernier Jour d'un condamné, en 1829, sous la Restauration, jusqu'à Quatre-vingt-treize en 1874, sous la Troisième République, roman dont la guillotine est une sorte de héros fatal.
Il l'a combattue à la tribune, en 1848, à l'Assemblée constituante, dans une intervention passionnée - écrite, mais improvisée, si vite allait-il dans le cours du débat constitutionnel - qu'il conclut ainsi : « Je vote pour l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort. », paroles qui n'ont jamais cessé de m'habiter et auxquels je me permettrai simplement d'ajouter le mot « universelle ».
Il l'a combattue, mais cela se sait moins, devant la cour d'assises où il défendait, comme on pouvait le faire à l'époque, son fils Charles, accusé d'avoir manqué au respect dû aux lois en stigmatisant, dans un article, la guillotine. Il n'a pas été trop bon avocat, puisque son fils fut condamné à six mois de prison.
Il l'a combattue inlassablement, en tout lieu et en toute occasion, en intervenant auprès de tous les pouvoirs pour demander la grâce des condamnés, qu'ils fussent parmi les plus célèbres politiques ou, au contraire, d'obscurs anonymes.
En 1839, prévenu de l'exécution imminente de Barbes, il fait porter une supplique en vers au roi Louis-Philippe. Barbes sera gracié.
En 1854, en exil, il écrit, dans des termes plus que vifs qui compromettaient sa sûreté, eu égard au ministre de l'intérieur de l'Angleterre de l'époque, lord Palmerston, pour obtenir la grâce de Tapner.
En 1859, il demande aux États-Unis celle de John Brown.
En 1862, il supplie avec succès, en Belgique, pour les sept condamnés de Charleroi ; en 1867, il intercède pour les Fenians irlandais. Il intervient auprès du tsar de Russie, et sa correspondance en fait foi, auprès de l'empereur d'Autriche, auprès de la reine d'Angleterre, auprès du président Juarez du Mexique pour que Maximilien, vaincu, et qui, tant s'en faut, n'appartenait pas à sa famille politique, soit épargné.
En un mot, partout où l'échafaud est dressé, Victor Hugo est présent pour le combattre, mais rarement avec succès, je dois le dire. Comme il le constatait avec mélancolie, évoquant cette inlassable lutte : «J'ai quelquefois réussi. Souvent échoué. »
À cet égard, il se leurrait. Certes, le voeu superbe qu'il exprimait, lorsqu'il déposait son ultime proposition de loi au Sénat en faveur de l'abolition de la peine de mort et qui se concluait par cette espèce de rêve : « Heureux si l'on peut dire de lui : en s'en allant, il emporta la peine de mort. », ne s'est pas accompli. Mais je suis convaincu que, pendant un siècle et demi, à l'instant décisif où les jurés devaient engager leur conscience en décidant du sort de l'accusé dont était demandée la tête, bien des hommes ont échappé à la peine de mort parce que ces jurés, à cet instant-là, se souvenant du Dernier Jour d'un condamné, n'ont pas voulu voter la mort.
Hugo a-t-il mieux réussi s'agissant de cet autre outrage à la conscience humaine qu'est le bagne ?
Dès 1824, Hugo avait demandé à un ami de le documenter sur le bagne de Toulon. Il s'y rendra lui-même en 1839, et il visitera de même le bagne de Brest. Et, surtout, en 1827, il assiste, en compagnie du grand David d'Angers, au ferrement des forçats à Bicêtre, quand, rassemblés dans la cour de la prison, ils voyaient leurs chaînes scellées pour un long transport qui les emmenait vers le Sud à travers la France. Cela durait vingt-sept jours. Cela s'appelait la cadène. C'était l'effroyable chaîne des galériens.
Vingt-cinq ans plus tard, la vision hantait encore Hugo. On en trouve les traces quand Cosette, rencontrant la cadène à côté du Luxembourg, s'adresse ainsi à Jean Valjean : « Père, est-ce que ce sont encore des hommes ? », « Quelquefois, dit le misérable ». Étaient-ils encore des hommes, ceux que la société traitait ainsi et dont Hugo disait qu'ils étaient les « damnés de la loi humaine » ?
Pour dénoncer le scandale du bagne, Hugo, en mai 1848, élu à l'Assemblée constituante, lance cette provocation sublime, qui fera ricaner tous les bien-pensants : « J'aurais voulu que l'on eût fait voter les bagnes et être le candidat choisi par les galériens. »
Il combat avec la même force, en 1850, la déportation des condamnés politiques, qu'il appelait « cette guillotine sèche ». Après 1871, comme l'a rappelé notre collègue Jack Ralite, il dénoncera la transportation des Communards, ce qui lui valut, on l'ignore trop souvent, des attaques furieuses et jusqu'à des assauts contre sa demeure - à Bruxelles, où il s'était rendu après la mort de son fils Charles - parce qu'il avait offert l'asile politique aux Communards proscrits.
Et toujours, tout au long de son oeuvre, il dénonce l'inhumanité de nos prisons. Il visite la Conciergerie et la Roquette, accumule des notes et rédige, pour la Chambre des pairs, un discours sur la réforme pénale. Il refuse les peines perpétuelles, parce que, écrit-il, « il est un droit qu'aucune loi ne peut entamer, qu'aucune sentence ne peut retrancher : le droit de devenir meilleur ».
Il condamne ainsi le régime pénitentiaire : « Messieurs, tirez le peuple de ces affreuses vieilles prisons, écoles de vice, ateliers de crime, dans lesquelles le froid et la faim sont employés comme moyen de répression et comme auxiliaire du geôlier, dans lesquelles la mortalité, grâce à de hideux abus, est de un sur onze, quelquefois de un sur sept ».
Les liens profonds qui, toujours, ont uni dans l'histoire de nos sociétés la misère, l'ignorance et le crime, Hugo les a dénoncés, dès 1834, dans Claude Gueux. Ne l'oubliez pas, c'était un homme comblé par la gloire, la fortune, le bonheur et le génie. Eh bien, pour lui, il n'existait pas de classe dangereuse.
Ce pair de France, cet académicien choisira de déclarer à la Haute Assemblée d'aristocrates et de nantis dans laquelle il siège, entre le comte de Montalembert et le maréchal Soult : « Messieurs, je le dis avec douleur, le peuple, dans l'état social tel qu'il est, porte aussi, plus que toutes les autres classes, le poids de la pénalité. Ce n'est pas sa faute. Pourquoi ? Parce que les lumières lui manquent d'un côté, parce que le travail lui manque de l'autre. D'un côté, les besoins le poussent, de l'autre, aucun flambeau ne l'éclaire. De là les chutes... ! ».
Certains souriront de cette simplicité. Moi pas.
Que c'est beau un écrivain de génie découvrant la question sociale par la question pénale et se dressant contre la misère comme il s'est élevé contre la guillotine et contre la prison ! Dans la démarche de Hugo, cet élargissement progressif de la réflexion - de la réforme des peines à la réforme de la société - me paraît comme une ascension. Le refus de l'injustice individuelle le conduit naturellement à refuser l'injustice collective.
On comprend, dès lors, pourquoi le monarchiste qui siégeait à droite, à la Chambre des pairs, s'est retrouvé, vingt-cinq ans plus tard, assis à ce qui était déjà l'extrême gauche du Sénat, sous la III e République.
Le chemin politique qu'a parcouru Victor Hugo est assurément rare. Il est, dans son cas, d'autant plus admirable. Celui qui écrivait, en 1847, que la loi en discussion sur les prisons serait « une grande loi, parce qu'elle est une loi pour le peuple » pouvait avec fierté dire, en demandant pour la troisième fois, en 1880, l'amnistie pour les Communards : « Il y a trente-quatre ans, je débutais à la tribune française... à cette tribune. Dieu permettait que mes premières paroles fussent pour la marche en avant et pour la vérité, il permet aujourd'hui que celles-ci, les dernières peut-être, si je songe à mon âge, que je prononcerai parmi vous, soient pour la clémence et pour la justice... ! »
Merci, Victor Hugo ! (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
VICTOR HUGO ET L'ENFANT
M. le président. La parole est à M. About.
M. Nicolas About. « Laissez. Tous ces enfants sont bien là... »
Monsieur le président, ce propos ne s'adresse pas aux collégiens que vous avez invités : c'est par ce poème qu'en mai 1830 Victor Hugo ante pour la première fois l'innocence et le pouvoir des petits êtres.
Le génie de Hugo n'est pas d'avoir écrit sur les enfants, mais d'avoir aussi chanté le chaos, le ciel, Jupiter, Dieu, Homère. Il est sûrement l'un de nos seuls poètes à pouvoir aussi aisément passer du plus magnifique lyrisme et de l'épopée la plus pathétique au ton simple, proche et touchant qui est le sien quand il parle des enfants.
Hugo parle des enfants, il parle aussi des siens : Charles, François-Victor, Adèle, ses petits-enfants Jeanne et Georges. Mais c'est surtout la grâce et l'innocence de Léopoldine qui nous restent en mémoire : Hugo a écrit beaucoup de vers pour elle, il en a écrit plus encore sur elle.
Les lieux communs de la littérature et du monde depuis des siècles faisaient de l'enfant un être inachevé et tendaient, par l'éducation et l'instruction, à l'amener à une plénitude adulte.
L'enfant, selon Hugo, loin de ce schéma réducteur, porte en lui, pour le temps de son existence terrestre, l'avenir de l'humanité.
L'enfant, c'est cet être dont l'horizon est encore ouvert, celui dont on peut dire : « Un jour il sera grand ». Un avenir glorieux l'attend : il sera sculpteur, nouveau Michel-Ange, il sera grand stratège militaire, « comme Bonaparte ou François 1 er », il découvrira des astres ou des mondes, comme Christophe Colomb, ou bien, mieux encore, il sera poète.
La petite enfance est image de bonheur. Cosette a trois ans quand sa mère, Fantine, la confie aux Thénardier. Elle est joufflue, heureuse, elle rit. Les enfants sont des êtres de lumière.
Avec leurs beaux grands yeux d'enfants, sans peur, sans fiel,
Qui semblent toujours bleus, tant on y voit le ciel !
Tel est le mystère de l'enfance, nous dit Hugo : ces petits êtres sont grands, ils contiennent Dieu.
Les enfants sont partout dans la poésie de Hugo : en se promenant dans un vallon
« charmant ;
Serein, abandonné, seul sous le firmament,
Plein de ronces en fleurs... »,
on rencontre une jeune chevrière, aux yeux bleus, aux pieds nus.
Hugo a bien noté les gestes des enfants, leurs mots, leurs façons de s'amuser, leurs petits chagrins ; il s'y attarde complaisamment, il est leur peintre, leur peintre le plus optimiste, leur peintre le plus flatteur.
Les poèmes de Hugo sur les enfants sont d'une poésie ténue, brillante, indéfinissable, mais si vivace et si forte que, à côté, les plus beaux vers éloquents perdent de leur charme et ne nous paraissent plus que de la prose rythmée et rimée.
Enfant, vous êtes l'aube et mon âme est la plaine
Qui des plus douces fleurs embaume son haleine
Quand vous la respirez...
Au milieu de la tempête politique - on est en 1831 -, Hugo chante l'enfant par des vers intimes, empreints d'une douce mélancolie.
Il nous dit sa pitié pour les enfants, pour « les mille objets de la création qui souffrent et languissent autour de nous » ; il nous confie ses joies de père. Quand il parle de l'enfant, dans Les Voix intérieures en particulier, on entend la voix de l'homme, qui parle au coeur.
Mais Hugo aborde souvent la mort des enfants.
La mort de Léopoldine, ne l'oublions pas, fait douter Hugo de sa mission ; elle lui fait connaître la tentation de la révolte et du blasphème. La douleur du père est immense, toutes ses certitudes s'effondrent. Pour la première fois, il ne trouve plus ses mots, ne peut plus jeter sur le papier que des bribes de vers, aucune strophe complète, aucun poème, aucune méditation suivie.
Le malheur s'est jeté sur moi, brusque et terrible,
Ainsi que l'ennemi par la brèche d'un mur...
O Dieu ! Je vous accuse !
Il ne peut rien écrire sur son deuil, lui qui s'était défini, en tant qu'artiste, comme un « écho sonore », une « âme de cristal » que tout souffle, tout rayon faisait luire et vibrer. La mort de son enfant l'a rendu muet, même pour ce qui lui était le plus cher, ou plutôt parce que cette enfant lui était le plus cher.
Les années 1844 et 1845 sont absentes des Contemplations. Le souvenir de sa fille n'est évoqué que trois ans après le deuil et à cause de la mort d'une autre enfant, Claire Pradier, la fille unique de Juliette Drouet, décédée le 21 juin 1846. Belle comme Léopoldine, comme elle, elle n'avait pas fait le mal, n'avait nui à quiconque ; comme Léopoldine, elle a été frappée par Dieu en pleine jeunesse.
Qu'est-ce donc que la vie, hélas ! pour mettre ainsi
Les êtres les plus purs et les meilleurs en fuite ?
Essayant de consoler Juliette Drouet, Hugo retrouve toutes ses questions, toute sa détresse. Le premier poème qui suit le sinistre page blanche marquée « 4 septembre 1843 » est intitulé Trois Ans après. Il exprime la même révolte qu'au premier jour. Simplement, cette fois, Hugo peut achever le poème.
À ses yeux, la mort des enfants pose la question du triomphe de l'injustice : pourquoi la mort des innocents, pourquoi la misère et le chagrin ? Qui oserait dire que l'enfant pauvre, l'enfant esclave, l'enfant mort étaient coupables ?
Dieu n'est pas seulement incompréhensible à Hugo s'il fait ou laisse souffrir et mourir les enfants, les innocents, les êtres purs ; il est incompréhensible également s'il ne punit pas comme ils le méritent les coupables, les tyrans, les criminels et les lâches.
L'enfant, chez Hugo, porte souvent une dénonciation politique.
Dans les yeux bleus - chez Hugo, à une exception près, les enfants ont tous les yeux bleus -, on ne lit pas seulement la gaieté et l'innocence, on lit aussi une critique féroce de l'injustice sociale et de l'exploitation politique.
Hugo retire du massacre perpétré par les Turcs dans l'île de Chio la vision d'un enfant grec aux yeux bleus, assis « seul près des murs noircis ».
La Grèce réduite en esclavage par les Turcs, c'est un enfant à la « tête humiliée », un enfant aux pieds nus sur le roc anguleux, un enfant aux yeux orageux de larmes, aux chagrins nébuleux.
L'expression de la paix, du bonheur et de l'innocence de l'enfance fait ressortir les images de la guerre et de la destruction.
Dans Les Châtiments, Hugo dénonce :
L'enfant avait reçu deux balles dans la tête......
...Sa bouche,
Pâle, s'ouvrait ; la mort noyait son oeil farouche
L'oeil farouche, est-ce celui de l'enfant ? Non, c'est celui de l'opposant à un régime qui a exilé et étouffé la République. Dans ce pamphlet, la dénonciation est d'une force fulgurante.
« Est-ce qu'on va se mettre à tuer les enfants maintenant ? », crie la vieille grand- mère. Le poète lui répond que Napoléon « aime les palais », veut « des chevaux, des valets... »
C'est pour cela qu'il faut que les vieilles grand'mères,
De leurs pauvres doigts gris que fait trembler le temps,
Cousent dans le linceul des enfants de sept ans.
L'enfant est transformé en symbole et en mythe porteur de valeurs morales exemplaires.
Par l'association de la tonalité familière, dans la réalité présentée, et de la tonalité épique, dans la dramatisation, Hugo touche au sublime. Son ton se fait vigoureux, réaliste, compréhensif quand il parle du malheur des enfants, notamment ceux qui parcourent tant de chapitres des Misérables.
Dans cette oeuvre, la dénonciation de l'atrophie de l'enfant par la nuit n'est pas moins flamboyante que la condamnation de l'homme par le prolétariat ou de la déchéance de la femme par la faim. L'enfant est la principale victime d'une société injuste et égoïste, le bonheur de la petite enfance dure peu et la misère en ternit vite la gaieté et l'insouciance.
Hugo n'est peut-être pas l'inventeur en littérature du mot « gamin », mais cela correspond à une réalité effectivement nouvelle et perçue comme telle par ses contemporains. Avant Gavroche, on peut penser aux petits Savoyards, évoqués par Voltaire ou Mercier.
Gavroche fait l'objet d'une longue présentation, trempée dans la même veine que les chapitres sur Waterloo ou sur les égouts de Paris, présentation dont le rôle est d'inscrire l'histoire dans l'Histoire, de faire des Misérables le roman de l'Histoire.
Gavroche n'est presque plus un enfant, à peine encore un adolescent : il a à peu près douze ans quand il meurt sur la barricade.
Gavroche a fait de la rue sa maison, son école, c'est l'incarnation du gamin de Paris décrit par Balzac et peint par Delacroix dans La Liberté guidant le peuple.
Débrouillard, inventif, pas toujours très honnête, il collabore à l'évasion d'un prisonnier, vole une bourse... à un voleur. Mauvaise tête et grand coeur, il déteste la bourgeoisie qu'il critique pour son égoïsme. C'est un révolté qui casse les réverbères et se bat sur la barricade en héros.
Sa meilleure arme est pourtant le langage : il a le goût des jeux de mots et le sens de la répartie.
Gai, impertinent, ses plaisanteries démystifient et démythifient l'autorité : « Son rire est une bouche de volcan qui éclabousse toute la terre. »
L'enfant dans sa petitesse devient l'incarnation de Paris, Paris la capitale, Paris la géante. Gavroche reste pourtant humain ; tour à tour tendre et brutal, il touche le lecteur qui voit s'envoler à regret « cette petite grande âme ».
On se souvient de la mort de Gavroche, sur les barricades : le voilà « tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l'oeil fixé sur les gardes nationaux qui tiraient ». Les balles le manquent. Une, deux, trois, quatre, il continue à chanter : « Je ne suis pas Voltaire, je ne suis pas notaire, je suis petit oiseau. » Le spectacle est à la fois épouvantable et charmant.
Gavroche, fusillé, taquine la fusillade. Il a l'air de s'amuser beaucoup. À chaque décharge, il répond par un couplet. La barricade tremble, lui, il chante. Gavroche n'est plus un enfant. C'est un gamin fée, un enfant feu follet. La mort de Gavroche, c'est le peuple qu'on assassine. Pour Hugo, l'enfant victime, c'est aussi l'enfant exploité.
Dans Mélancholia, il dénonce le travail des enfants.
Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?
Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ?
Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules ?
Ils s'en vont travailler quinze heures sous des meules ;
...
O servitude infâme imposée à l'enfant !
L'enfant apparaît à nouveau comme un personnage à dimension symbolique, dans une poésie qui n'est pas un ornement, qui n'est pas un divertissement : c'est une arme au service d'un combat.
Dans L'Année terrible, il dénonce la répression de la Commune, qui l'atterre. Un des plus beaux récits du livre reproduit une histoire poignante, qui bouleverse le poète.
L'enfant est superbe et vaillant qui préfère
À la fuite, à la vie, à l'aube, aux jeux permis,
Au printemps, le mur sombre où sont morts ses amis.
La gloire au front te baise, ô toi si jeune encore !
Voilà qui montre la vraie mission du poète : il est le seul à pouvoir donner aux actes sublimes qui, sans lui, seraient vite oubliés, leur récompense impérissable.
Mes chers collègues, guider les hommes, leur apporter un message d'amour et d'attention aux enfants : telle est la fonction que Hugo assigne au poète dans Les Rayons et les Ombres. Le poète est celui qui nomme, qui donne une voix à ce qui n'en a pas. La certitude du pouvoir des mots préside ainsi aux écrits polémiques et politiques de Hugo. Les mots peuvent tout, ce sont les « clairons de la pensée », devant lesquels tombent les murailles de l'ignorance, du mal et de la tyrannie.
C'est à Hugo que l'on doit l'entrée de l'enfant dans la littérature ; l'enfant ne devait plus en sortir : Cosette et Gavroche sont vite rejoints par Rémi, le héros de Sans famille, d'Hector Malot, ou encore par Jacques, L'Enfant de Jules Vallès. Les enfants le lui ont bien rendu, puisqu'il est l'un des auteurs les mieux connus des enfants, l'un des poètes les plus lus à l'école. Cosette des Misérables et le Petit Paul de La Légende des siècles vivront longtemps dans les mémoires et donneront pour longtemps raison à leur génial créateur, qui nous lance une nouvelle fois cet appel : « Peuples ! Écoutez le poète ! » (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
VICTOR HUGO, L'EUROPE ET LA PAIX
M. le président. La parole est à M. François-Poncet.
M. Jean François-Poncet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, Victor Hugo n'est ni le seul ni le premier qui, au XIXe siècle, appelle l'Europe à s'unir. L'idée est dans l'air. Le romantisme politique l'a faite sienne, notamment après les révolutions de 1848, qui, de capitale en capitale, ébranlent l'ordre imposé au continent par le Congrès de Vienne. Chateaubriand, Saint-Simon, Michelet, Lamartine, Guizot, Auguste Comte s'y réfèrent. Hegel et Heine en Allemagne, Mazzini et d'autres en Italie leur font écho.
Mais nul n'annonce avec autant de constance et de conviction, autant de passion et d'éloquence que Victor Hugo l'avènement des « États-Unis d'Europe ». M. le président du Sénat l'a rappelé, c'est Victor Hugo qui lance cette expression un siècle et demi avant l'heure. Il ne s'agit pas chez lui, comme chez d'autres, d'une intuition passagère, d'une improvisation vite oubliée, mais d'une authentique prophétie, d'une anticipation politique d'autant plus géniale qu'elle s'inscrit à contre-courant d'une époque marquée par l'ascension et le choc des nationalismes.
Le 21 août 1849, Victor Hugo préside à Paris le Congrès de la paix, organisé par une association née en Grande-Bretagne, qui rassemble d'éminentes personnalités venues de toute l'Europe et de l'Amérique et qui propage le principe de la paix universelle. Aux congressistes enthousiastes et médusés, il déclare, dans une envolée restée célèbre : « Un jour viendra où vous France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne et vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure. (...) Et, ce jour-là, il ne faudra pas quatre cents ans pour l'amener. (...) À l'époque où nous sommes, une année fait parfois l'ouvrage d'un siècle. »
Deux ans plus tard, le 17 juillet 1851, à l'Assemblée législative, où il a été élu, il s'écrie : « La France a posé au milieu du vieux continent monarchique la première assise de cet immense édifice de l'avenir, qui s'appellera un jour les États-Unis d'Europe. » Montalembert, qui l'a écouté, s'écrie : « Les États-Unis d'Europe ! C'est trop ! Hugo est fou. »
Victor Hugo n'a rien d'un dément. Mais il est probable qu'on ne verrait en lui qu'un rêveur inspiré si l'histoire, celle du XX e siècle, n'avait, après deux guerres mondiales et des dizaines de millions de morts, inscrit sa prophétie dans des traités, des institutions et une monnaie dont la naissance constitue l'un des grands événements politiques de notre temps.
L'Europe, dont Victor Hugo s'est fait, tout au long de sa vie, le chantre passionné, ressemble-t-elle à la Communauté d'aujourd'hui, celle de Jean Monnet et de Charles de Gaulle ? Oui, elle en a, dans une assez large mesure, les caractéristiques.
L'Europe hugolienne est démocratique et républicaine, comme la nôtre. Du moins est-ce la conception que Victor Hugo en a après 1849. Dans l'oeuvre d'avant son exil, parlant de l'Europe, il se réfère à l'empire, celui dont Napoléon a forgé le modèle, parce que, à ses yeux, l'empire permet de transformer le chaos européen en un espace organisé et harmonieux. Mais après 1848, le ton change. Il se rallie à la République et en devient, après le coup d'État du 2 décembre, un fervent militant. Dès lors, l'union et l'avenir de l'Europe passent pour lui par la déchéance des rois. Il s'en explique dans la lettre qu'il adresse en 1869 au congrès de la paix qui se réunissait périodiquement : « Les rois divisent pour régner ; il faut aux rois des armées et aux armées la guerre. (...) Mais comment supprimer l'armée? Par la suppression des despotismes », qui ouvrira la porte, dit-il, à la « grande République continentale ». Le fait est que l'union de l'Europe n'a pris corps qu'avec la disparition, après 1945, des régimes totalitaires d'Allemagne et d'Italie et que la démocratie et les droits de l'homme sont, comme Victor Hugo l'avait prédit, les fondements de la communauté qui se construit.
L'Europe de Victor Hugo présente une autre caractéristique qui la rapproche de celle du traité de Rome : elle est rhénane, c'est-à-dire franco-allemande ; elle n'inclut pas l'Angleterre. C'est une ligne de force à laquelle Hugo se tiendra, mais qui comportera, après la guerre de 1870, un préalable : le retour de l'Alsace-Lorraine à la France.
Dans la conclusion de son ouvrage sur le Rhin paru en 1842, Victor Hugo affirme que la France et l'Allemagne sont essentielles à l'Europe. « Il faut, dit-il, pour que l'univers soit en équilibre, qu'il y ait en Europe, comme une double clef de voûte, deux grands États. L'un septentrional et oriental, l'Allemagne, s'appuyant à la Baltique, à l'Adriatique et à la mer Noire, avec la Suède, le Danemark, la Grèce et les principautés du Danube pour arcs-boutants, l'autre méridional et occidental, la France, s'appuyant à la Méditerranée et à l'océan avec l'Italie et l'Espagne en contrefort. L'union de l'Allemagne et de la France serait le salut de l'Europe, la paix du monde. » C'est une vision qu'on ne rejetterait aujourd'hui ni à l'Élysée ni à Matignon.
Viennent la guerre et la défaite. Le paysage européen est bouleversé et, le 1 er mars 1871, à l'Assemblée nationale réunie à Bordeaux pendant le siège de Paris, Victor Hugo s'écrie : « Dès demain la France n'aura qu'une pensée : reprendre des forces, forger des armes, former des citoyens, créer une armée qui soit un peuple. (...) Puis, tout à coup, un jour, elle se redressera. Oh, elle sera formidable, on la verra d'un bond ressaisir la Lorraine, ressaisir l'Alsace. Est-ce tout? Non, non, saisir- écoutez-moi - saisir Trêves, Mayence, Cologne, Coblence, toute la rive gauche du Rhin. » Victor Hugo atténue ensuite son propos : « on entendra la France crier, Allemagne me voilà ; suis-je ton ennemie, non, je suis ta soeur. Je t'ai tout repris et je te rends tout à une condition : c'est que nous ne ferons plus qu'un peuple, qu'une seule famille, qu'une seule république. Soyons les États-Unis d'Europe, soyons la fédération continentale ». Malgré la guerre, l'entente franco-allemande reste pour Victor Hugo le socle sur lequel l'union de l'Europe s'édifiera.
Mais cette Europe unie, il ne l'a jamais imaginée autrement que façonnée par la France, ce qui confère à sa foi européenne une redoutable ambiguïté. « La France, dit Victor Hugo, est destinée à mourir comme les dieux, par la transfiguration. La France deviendra l'Europe. » Emporté par son rêve, il poursuit : « À un moment donné un peuple entre en constellation, les autres peuples, astres de deuxième grandeur, se regroupent autour de lui et c'est ainsi qu'Athènes, Rome et Paris sont pléiades. » Pourquoi la France ? Par ce que, répond-il sans sourciller, « la France le mérite, parce qu'elle manque d'égoïsme, parce qu'elle est créatrice de valeurs universelles, (...) parce que toutes les batailles de la pensée et du progrès ont été livrées et gagnées par elle, (...) parce que la France est "d'utilité publique" ». « Les autres nations, ajoute-t-il, sont seulement soeurs, elle est mère. Cette nation aura pour capitale Paris et ne s'appellera plus la France, elle s'appellera l'Europe. »
Mes chers collègues, il est difficile de concevoir franco-centrisme plus échevelé, ni d'imaginer qu'on puisse rassembler sur cette base le reste de l'Europe et surtout l'Allemagne, à laquelle on arracherait, en outre, la rive gauche du Rhin ! On touche ici du doigt l'inconscience du poète, la naïveté du visionnaire, en même temps qu'un travers caractéristique de l'intelligentsia française, portée depuis toujours à donner des leçons à la planète. (Sourires.)
Encore faut-il, dans le cas de Victor Hugo, tenir compte des circonstances du moment, de l'émotion et de l'humiliation qui accompagnent la défaite et de l'exaltation patriotique qu'elles appellent très naturellement. Ajoutons que Victor Hugo ne se lasse pas, pour autant, de tendre la main à l'Allemagne. « Les malentendus s'évanouiront », écrit-il en 1871. « Nous aimons cette Germanie dont le nom signifie fraternité. Les questions de frontière disparaîtront. La solution de tous les problèmes, aujourd'hui, est dans ce mot immense, les États-Unis d'Europe. »
Un mot qui en appelle immanquablement, dès cette époque, un autre : les États-Unis d'Amérique. « Ces deux groupes immenses, écrit Victor Hugo, placés face l'un à l'autre, se tiendront la main par-dessus les mers combinant ensemble la fraternité des hommes et la puissance de Dieu. » Au-delà de l'Union européenne, c'est l'Alliance atlantique que Victor Hugo entrevoit.
Les choix politiques de Victor Hugo - cela a été rappelé à plusieurs reprises à cette tribune - ont évolué au cours de sa vie. Le jeune royaliste devient admirateur de Napoléon, avant de militer, corps et âme, pour la République. Mais jamais il ne renonce à l'espérance européenne, véritable point fixe de sa pensée politique. Personne ni alors ni aujourd'hui, n'a défendu l'idéal européen avec autant de force, de talent et d'éloquence que lui. Oui, Victor Hugo est bien le père spirituel de l'Union européenne ! (Applaudissements sur l'ensemble des travées.)
LECTURE D'UN TEXTE DE VICTOR HUGO
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant écouter Mlle Rachida Brakni, pensionnaire de la Comédie-Française, qui va nous lire un texte de Victor Hugo.
Mlle Rachida Brakni. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de m'avoir invitée à participer à cet hommage solennel rendu à Victor Hugo.
Je vais vous lire un extrait d'un chapitre tiré des Misérables, intitulé « Les morts ont raison et les vivants n'ont pas tort » :
« Qu'est-ce donc que le Progrès ? Nous venons de le dire. La vie permanente des peuples.
« Or, il arrive quelquefois que la vie momentanée des individus fait résistance à la vie éternelle du genre humain.
« Avouons-le sans amertume, l'individu a son intérêt distinct, et peut sans forfaiture stipuler pour cet intérêt et le défendre ; le présent a sa quantité excusable d'égoïsme ; la vie momentanée a son droit, et n'est pas tenue de se sacrifier sans cesse à l'avenir. La génération qui a actuellement son tour du passage sur la terre n'est pas forcée de l'abréger pour les générations, ses égales après tout, qui auront leur tour plus tard. - J'existe, murmure ce quelqu'un qui se nomme Tous. Je suis jeune et je suis amoureux, je suis vieux et je veux me reposer, je suis père de famille, je travaille, je prospère, je fais de bonnes affaires, j'ai des maisons à louer, j'ai de l'argent sur l'état, je suis heureux, j'ai femme et enfants, j'aime tout cela, je désire vivre, laissez-moi tranquille. - De là, à de certaines heures, un froid profond sur les magnanimes avant- gardes du genre humain.
« L'utopie d'ailleurs, convenons-en, sort de sa sphère radieuse en faisant la guerre. Elle, la vérité de demain, elle emprunte son procédé, la bataille, au mensonge d'hier. Elle, l'avenir, elle agit comme le passé. Elle, l'idée pure, elle devient voie de fait. Elle complique son héroïsme d'une violence dont il est juste qu'elle réponde ; violence d'occasion et d'expédient, contraire aux principes, et dont elle est fatalement punie. L'utopie insurrection combat, le vieux code militaire au poing ; elle fusille les espions, elle exécute les traîtres, elle supprime des êtres vivants et les jette dans les ténèbres inconnues. Elle se sert de la mort, chose grave. Il semble que l'utopie n'ait plus foi dans le rayonnement, sa force irrésistible et incorruptible. Elle frappe avec le glaive. Or aucun glaive n'est simple. Toute épée a deux tranchants ; qui blesse avec l'un se blesse à l'autre.
« Cette réserve faite, et faite en toute sévérité, il nous est impossible de ne pas admirer, qu'ils réussissent ou non, les glorieux combattants de l'avenir, les confesseurs de l'utopie. Même quand ils avortent, ils sont vénérables, et c'est peut- être dans l'insuccès qu'ils ont plus de majesté. La victoire, quand elle est selon le progrès, mérite l'applaudissement des peuples ; mais une défaite héroïque mérite leur attendrissement. L'une est magnifique, l'autre est sublime. Pour nous, qui préférons le martyre au succès, John Brown est plus grand que Washington, et Pisacane est plus grand que Garibaldi.
« Il faut bien que quelqu'un soit pour les vaincus.
« On est injuste pour ces grands essayeurs de l'avenir quand ils avortent.
« On accuse les révolutionnaires de semer l'effroi. Toute barricade semble attentat. On incrimine leurs théories, on suspecte leur but, on redoute leur arrière-pensée, on dénonce leur conscience. On leur reproche d'élever, d'échafauder et d'entasser contre le fait social régnant un monceau de misères, de douleurs, d'iniquités, de griefs, de désespoirs, et d'arracher des bas-fonds des blocs de ténèbres pour s'y créneler et y combattre. On leur crie : Vous dépavez l'enfer ! Ils pourraient répondre : C'est pour cela que notre barricade est faite de bonnes intentions.
« Le mieux, certes, c'est la solution pacifique. En somme, convenons-en, lorsqu'on voit le pavé, on songe à l'ours, et c'est une bonne volonté dont la société s'inquiète. Mais il dépend de la société de se sauver elle-même ; c'est à sa propre bonne volonté que nous faisons appel. Aucun remède violent n'est nécessaire. Étudier le mal à l'amiable, le constater, puis le guérir. C'est à cela que nous la convions.
« Quoi qu'il en soit, même tombés, surtout tombés, ils sont augustes, ces hommes qui, sur tous les points de l'univers, l'oeil fixé sur la France, luttent pour la grande oeuvre avec la logique inflexible de l'idéal ; ils donnent leur vie en pur don pour le progrès ; ils accomplissent la volonté de la providence ; ils font un acte religieux. À l'heure dite, avec autant de désintéressement qu'un acteur qui arrive à sa réplique, obéissant au scénario divin, ils entrent dans le tombeau. Et ce combat sans espérance, et cette disparition stoïque, ils l'acceptent pour amener à ses splendides et suprêmes conséquences universelles le magnifique mouvement humain irrésistiblement commencé le 14 juillet 1789. Ces soldats sont des prêtres. La révolution française est un geste de Dieu.
« Du reste il y a (...) les insurrections acceptées qui s'appellent révolutions ; il y a les révolutions refusées qui s'appellent émeutes. Une insurrection qui éclate, c'est une idée qui passe son examen devant le peuple. Si le peuple laisse tomber sa boule noire, l'idée est fruit sec, l'insurrection est échauffourée.
« L'entrée en guerre à toute sommation et chaque fois que l'utopie le désire n'est pas le fait des peuples. Les nations n'ont pas toujours et à toute heure le tempérament des héros et des martyres.
« Elles sont positives. A priori, l'insurrection leur répugne ; premièrement, parce qu'elle a souvent pour résultat une catastrophe, deuxièmement, parce qu'elle a toujours pour point de départ une abstraction.
«Car, et ceci est beau, c'est toujours pour l'idéal, et pour l'idéal seul, que se dévouent ceux qui se dévouent. Une insurrection est un enthousiasme. L'enthousiasme peut se mettre en colère ; de là les prises d'armes. Mais toute insurrection qui couche enjoué un Gouvernement ou un régime vise plus haut. Ainsi, par exemple, insistons-y, ce que combattaient le chefs de l'insurrection de 1832, et en particulier les jeunes enthousiastes de la rue de la Chanvrerie, ce n'était pas précisément Louis-Philippe. La plupart, causant à coeur ouvert, rendaient justice aux qualités de ce roi mitoyen à la monarchie et à la révolution ; aucun ne le haïssait. Mais ils attaquaient la branche cadette du droit divin dans Louis-Philippe comme ils en avaient attaqué la branche aînée dans Charles X ; et ce qu'ils voulaient renverser en renversant la royauté en France, nous l'avons expliqué, c'était l'usurpation de l'homme sur l'homme et du privilège sur le droit dans l'univers entier. Paris sans roi a pour contrecoup le monde sans despotes. Ils raisonnaient de la sorte. Leur but était lointain sans doute, vague peut-être, et reculant devant l'effort ; mais grand.
« Cela est ainsi. Et l'on se sacrifie pour ces visions, qui, pour les sacrifiés, sont des illusions presque toujours, mais des illusions auxquelles, en somme, toute la certitude humaine est mêlée. L'insurgé poétise et dore l'insurrection. On se jette dans ces choses tragiques en se grisant de ce qu'on va faire. Qui sait ? on réussira peut-être. On est le petit nombre ; on a contre soi toute une armée ; mais on défend le droit, la loi naturelle, la souveraineté de chacun sur soi-même qui n'a pas d'abdication possible, la justice, la vérité, et au besoin on mourra comme les trois cents Spartiates. On ne songe pas à Don Quichotte, mais à Léonidas. Et l'on va devant soi, et, une fois engagé, on ne recule plus, et l'on se précipite tête baissée, ayant pour espérance une victoire inouïe, la révolution complétée, le progrès remis en liberté, l'agrandissement du genre humain, la délivrance universelle ; et pour pis aller les Thermopyles.
« Ces passes d'armes pour le progrès échouent souvent, et nous venons de dire pourquoi. La foule est rétive à l'entraînement des paladins. Ces lourdes masses, les multitudes, fragiles à cause de leur pesanteur même, craignent les aventures ; et il y a de l'aventure dans l'idéal.
« D'ailleurs, qu'on ne l'oublie pas, les intérêts sont là, peu amis de l'idéal et du sentimental. Quelquefois l'estomac paralyse le coeur.
« La grandeur et la beauté de la France, c'est qu'elle prend moins de ventre que les autres peuples ; elle se noue plus aisément la corde aux reins. Elle est la première éveillée, la dernière endormie. Elle va en avant. Elle est chercheuse.
« Cela tient à ce qu'elle est artiste.
« L'idéal n'est autre chose que le point culminant de la logique, de même que le beau n'est autre chose que la cime du vrai. Les peuples artistes sont aussi les peuples conséquents. Aimer la beauté, c'est vouloir la lumière. C'est ce qui fait que le flambeau de l'Europe, c'est-à-dire de la civilisation, a été porté d'abord par la Grèce, qui l'a passé à l'Italie, qui l'a passé à la France. Divins peuples éclaireurs ! Vitai lampada tradunt.
« Chose admirable, la poésie d'un peuple est l'élément de son progrès. La quantité de civilisation se mesure à la quantité d'imagination. (...) Il ne faut être ni dilettante ni virtuose ; mais il faut être artiste. En matière de civilisation, il ne faut pas raffiner, mais il faut sublimer. À cette condition, on donne au genre humain le patron de l'idéal. » (Applaudissements prolongés.)
(M. le président du Sénat dépose une gerbe de fleurs à la place où siégea Victor Hugo. - Mmes et MM. les sénateurs ainsi que M. le secrétaire d'État se lèvent et applaudissent.)
M. le président. Mes chers collègues, avant de lever cette séance exceptionnelle, je vous invite à gagner tous ensemble la salle des conférences où je vais inaugurer l'exposition « Victor Hugo, témoin de son siècle ».
À travers cette exposition qui a été réalisée par le service de la bibliothèque et des archives du Sénat, notre assemblée poursuivra pendant plusieurs mois son hommage à celui qui fut l'un de ses membres les plus illustres.
Par ailleurs, le 26 février prochain, jour anniversaire de la naissance de Victor Hugo, une délégation du bureau du Sénat se rendra à Jersey et Guernesey pour saluer la mémoire du poète exilé.
Les journées du patrimoine du mois de septembre 2002 mettront l'accent sur les liens de Victor Hugo avec le Sénat et le quartier du Luxembourg.
Enfin, un concours sera ouvert aux élèves des collèges et lycées portant le nom de Victor Hugo. Les lauréats seront invités à participer à la séance solennelle qui se tiendra dans notre hémicycle le 16 novembre 2002. (Applaudissements.)
(La séance exceptionnelle est levée à dix-sept heures.)

En lisant l'extrait des Misérables qu'elle a choisi, Mlle Rachida Brakni met un point d'orgue à la manifestation du Sénat. Pour la première fois une comédienne s'exprime de la tribune de l'orateur du Palais du Luxembourg.
L'ANNIVERSAIRE 26 février 1802 ce siècle avait deux ans... 26 février 2002 - LE BUREAU DU SÉNAT À JERSEY et GUERNESEY
Composition de la délégation :
M. Christian Poncelet (RPR - Vosges), président du Sénat
Vice-présidents :
M. Jean-Claude Gaudin (RI - Bouches-du-Rhône) M. Serge Vinçon (RPR - Cher) M. Adrien Gouteyron (RPR - Haute-Loire) M. Guy Fischer (CRC - Rhône)
Secrétaires :
Mme Annick Bocandé (UC - Seine-Maritime) M. Jean-Claude Carie (RI - Haute-Savoie) M. Bernard Joly (RDSE - Haute-Saône) Mme Nelly Olin (RPR - Val-d'Oise) Mme Gisèle Printz (Soc - Moselle) M. Philippe Richert (UC - Bas-Rhin)
Représentants des groupes politiques :
M. Henri de Raincourt (Yonne), président du groupe des Républicains et
Indépendants
M. Jacques Pelletier (Aisne), président du groupe du Rassemblement démocratique
et social européen
M. Pierre Fauchon (Loir-et-Cher), représentant le groupe de l'Union centriste
M. Robert del Picchia (Français établis hors de France), représentant le groupe du
Rassemblement pour la République
M. Philippe Adnot (Aube), délégué de la Réunion administrative des sénateurs ne
figurant sur la liste d'aucun groupe
Ainsi que :
M. Bertrand Poirot-Delpech, membre de l'Académie française, président du comité
national pour le bicentenaire de Victor Hugo
Mme Sandrine Mazetier, adjoint au maire de Paris, chargée du patrimoine
Mme Josseline de Clausade, directrice des affaires culturelles à la Ville de Paris
M. Gérard Pouchain, agrégé de l'université, spécialiste de Victor Hugo
VISITE À JERSEY
J
ersey constitua la première étape du déplacement de la délégation du Sénat car Victor Hugo, exilé au lendemain du coup d'État du 2 décembre 1851, y résida du 5 août 1852 au 31 octobre 1855. C'est là qu'il écrivit « Les Châtiments » et les « Contemplations ».
Départ du Bourget
Arrivée à Jersey à 9h45 (heure locale), la délégation est accueillie à l'aéroport par M. Robin Pallot, Consul honoraire de France, M. John Rothwell, Président du Comité pour le bicentenaire, ainsi que par le Lieutenant-colonel Charles Woodrow, OBC, Mc, QGM, ADC auprès de son Excellence M. le Lieutenant Gouverneur.


Installation à bord des deux appareils « Beechcraft King Air » de 19 places chacun.
Accueil solennel à la chambre des États :
La délégation est ensuite conduite à la Chambre des États, où elle est accueillie par le Bailiff et Son Excellence le Lieutenant Gouverneur. M le Bailiff prononce alors un discours de bienvenue, auquel M. le Président Poncelet répond.


Accueil par Sir Philip Bailhache, Bailiff de Jersey et
réception aux États
10 h 20 :
Le Bailiff et Son Excellence le Lieutenant Gouverneur retournent siéger dans la Chambre des États. La délégation est conduite dans les tribunes de l'Assemblée qui lui sont réservées.
Salut en séance de la délégation par le Bailiff.
Allocution de M. Christian Poncelet,
Président du Sénat,
En réponse à l'accueil de Monsieur le Bailiff de Jersey
Monsieur le Lieutenant Gouverneur,
Monsieur le Bailiff,
Permettez-moi de vous dire tout d'abord le plaisir que j'éprouve à me trouver dans cette île qui s'est honorée en accueillant Victor Hugo. Le poète d'ailleurs, même si ses convictions ont pu l'amener à enfreindre les règles de l'hospitalité, n'a jamais oublié cet accueil : « Qui a vu l'archipel normand, l'aime » nous dit-il ; « qui l'a habité, l'estime ».
Le message de Jersey, pour Victor Hugo, c'est bien sûr tout d'abord celui du déchirement de l'exil. C'est aussi l'histoire d'une reconnaissance et d'une affirmation de soi qui ont servi d'écrin aux Contemplations.
Si, aujourd'hui, Jersey n'a peut-être pas ses « airs de Sicile et ce beau ciel pur » que Victor Hugo décrivait, on devine qu'elle peut être ce « bouquet trempé par l'océan qui a le parfum de la rose et l'amertume de la vague ».
Terre d'histoire d'où l'on aperçoit la France.
Terre métisse si je puis dire, entre deux pays dont les contacts renforcent l'estime. Vous êtes à la fois un coin de France, si je puis me permettre, et un coin de Grande-Bretagne. Vous unissez ainsi des vertus complémentaires de deux pays qui furent les plus grands du monde et qui ont encore un rôle à jouer à cette échelle à condition de le jouer ensemble au sein de l'Europe.
C'est avec plaisir aussi que je rencontre des collègues parlementaires que je tiens à saluer et à remercier du fond du coeur de la manière digne et chaleureuse avec laquelle ils nous accueillent.
Je sais que le 26 février n'est pas seulement pour vous le jour anniversaire de la naissance de Victor Hugo. C'est une date historique, mais à un autre titre, puisque vous débattez aujourd'hui d'une réforme du statut constitutionnel de votre île.
Comme vous le savez, le Sénat de la République française est particulièrement proche des territoires qu'il représente et attentif à leur diversité. Il s'est aussi beaucoup ouvert sur le monde et il m'arrive très souvent d'accueillir des délégations et de les saluer en séance publique. C'est donc un plaisir rare mais que nous savons apprécier, que vous nous réservez en nous accueillant en votre Parlement.
Il ne m'a pas échappé non plus que les membres des États comptent parmi eux des sénateurs. C'eût été dommage que nos deux institutions ne se rencontrent pas. C'est donc très directement et sans réserve que je vous dis aujourd'hui « chers collègues », et que je m'incline en la personne de Monsieur le Lieutenant Gouverneur, devant votre Majesté la Reine.
Pour nous Français, votre souveraine demeure celle qui sut accompagner, après la guerre héroïque de son peuple et de sa famille, l'adaptation de l'Angleterre à une nouvelle période de son histoire. Cet empire, sur lequel le soleil ne se couchait jamais, a laissé place aujourd'hui à une mosaïque qui perpétue les meilleures traditions démocratiques. C'est une situation que nous comprenons puisque nous l'avons vécue nous aussi.
Les hasards de l'histoire font que nous sommes aujourd'hui les uns et les autres confrontés à un autre défi : celui de maintenir notre identité. Je sais que, pour votre part, vous y êtes très attachés non seulement en tant que sujets de sa très gracieuse Majesté mais en tant que Jersiais. Représentants de la diversité territoriale française, influencés par Victor Hugo qui qualifia vos îles de « Républiques », les membres du Sénat de la République française peuvent comprendre mieux que quiconque votre attachement à votre petite mais singulière patrie.
Permettez-moi déformer le voeu que Français et Anglais défendent ensemble cette identité si nécessaire à travers l'Europe dont la construction s'accélère, conformément aux voeux et à la vision de Victor Hugo. Vive Jersey, vive l'Angleterre et vive l'amitié franco-britannique !
Visite au Rocher et au cimetière des proscrits
10 h 30. Media
La délégation reprend le car pour se rendre jusqu'au Dicq où se trouve le Rocher des Proscrits, lieu de promenade près de Saint Hélier très fréquenté par les exilés, où Victor Hugo s'est fait photographier par ses fils, seul face à la mer.

La délégation reprend la route pour se rendre au cimetière de Zion qui a accueilli de nombreux exilés, français mais aussi polonais, italiens, hongrois, qui avaient trouvé refuge à Jersey après le reflux des mouvements révolutionnaires de 1848. Le guide, M. Pouchain, évoque l'histoire de Louise Julien de Paris, décédée en 1853, exilée pour avoir chanté une chanson de Victor Hugo à une terrasse du café de Paris, à l'époque de Napoléon III.
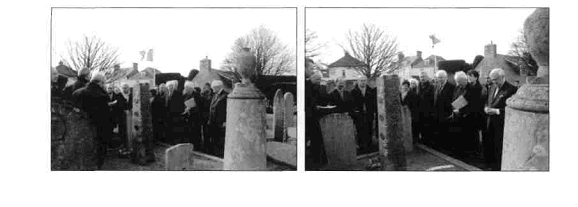
· 11 h 30
Départ vers Guemesey
Top-level French delegation visit
Island to pay tribute to Victor Hugo
By Jane Delmer
FRANCE'S third most important man arrived in Jersey this morning with 20 French Senators to pay tribute to Victor Hugo on the bicentenary of the great author's birth.
President of the French Senate, Christian Poncelet, and his high-powered delegation were met at the Airport by French honorary consul, Robin Pallot, Bicentenary Committee president, John Rothwell and Lieut-Col Charles Woudrow, ADC to the Lieut-Governor. The party were then taken to a reception at the States Chamber attended by the Lieut-Governor, Air Chief Marshal Sir John Cheshire. Afterwards they took seats in the Gallery for an official welcome from the Bailiff, Sir Philip Bailhache, at the opening of today's sitting. Ten minutes later the delegation were taken by bus to the Rock of the Banished near Victor Hugo's home at Le Dicq a favourite place of contemplation of the author.
The party were due to depart for Guernsey this afternoon before returning to Paris at 5 pm.
« Jersey Evening Post » 26/02/2002
VISITE À GUERNESEY
L
a seconde étape du déplacement amène la délégation sur l'île de Guernesey où Victor Hugo trouva refuge du 31 octobre 1855 au 15 août 1870. C'est là qu'il écrivit notamment « La légendes des siècles », « les travailleurs de la mer » et acheva son oeuvre majeure : « Les Misérables ».
Accueil
· 12 h l5
Arrivée à Guernesey.
Le Président du Sénat, Monsieur Christian Poncelet, et sa délégation sont accueillis par son Excellence le Lieutenant Gouverneur et Commandant en Chef sir John Foley, par le Bailiff de Guernesey, sir de Vic Carey, Mme Véronique Bascoul, administrateur-régisseur de Hauteville House et Consul honoraire de France.
Sont également présents le Colonel R.H. Graham, Secrétaire de son Excellence le Lieutenant Gouverneur et Commandant en Chef et Monsieur A.E. Richings, Secrétaire du Bailiff de Guernesey.
· 12 h 30
Le Président et sa délégation, le Bailiff, le Consul honoraire de France et le Secrétaire du Bailiff prennent place dans le car, qui est escorté par le véhicule conduisant le Lieutenant Gouverneur jusqu'au parc de l'hôtel.

Déjeuner au restaurant Victor Hugo
à l'hôtel Saint-Pierre Park
A la fin du déjeuner Monsieur le Président du Sénat porte un toast à la Reine (cf. annexe I) et son Excellence le Lieutenant Gouverneur porte un toast au Président de la République française. Monsieur le Bailiff prononce ensuite quelques mots de bienvenue auxquels Monsieur le Président du Sénat répond (cf. annexe II).

Remise par M. Poncelet d'un cadeau au Lieutenant-Gouverneur, Sr John Foley

Discours de Sir de Vic Carey, Baillif de Guernesey
Allocution de M. Christian Poncelet, Président du Sénat,
« TOAST » en l'honneur de Sa Majesté la Reine d'Angleterre
Monsieur le Lieutenant Gouverneur,
Le Sénat de la République française est un de ces lieux et l'une de ces institutions dont l'ambition est de concilier la tradition et la modernité. C'est sans doute pour cela que mes collègues et moi-même nous nous sommes sentis tout de suite à l'aise en ces lieux.
Au moment où nous foulons pour la première fois la terre de Guernesey, je voudrais rendre un hommage solennel, respectueux, admiratif et amical à votre souveraine, à ce duc de Normandie à qui vos ancêtres ont choisi de rester fidèles et qui fait qu'aujourd'hui, vous possédez une situation singulière.
Nous qui avons connu les mêmes épreuves ne pouvons, en cette année jubilaire, oublier ce sourire et cette ténacité mêlés qui accompagnèrent la résistance du peuple anglais.
Nous qui représentons la diversité des territoires français, nous pouvons comprendre aussi le souci de votre souveraine d'accompagner chacun de ses territoires vers une plus grande autonomie dans le respect de la « richesse commune ».
Nous souhaitons longue vie à votre souveraine et formons des voeux pour que le Royaume-Uni, Guernesey et la France restent côte à côte au service de la liberté et du progrès du monde.
Allocution de M. Christian Poncelet,
Président du Sénat,
À l'issue du déjeuner offert par le Bailiff de Guernesey
Monsieur le Bailiff, Monsieur les Élus, Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Si je ne craignais de vous blesser, je serais tenté de dire a l'issue de ce déjeuner, tout à la fois plantureux, délicieux et sympathique, que mes collègues et moi-même avons eu l'impression de nous sentir en France.
De nous sentir en France mais aussi d'être très proches de vous, car nous sommes, nous les sénateurs, comme vous, des représentants du terrain et, en tant que tels, très insérés dans la vie locale.
Des manifestations comme celle d'aujourd'hui, évoquent pour nous ces réunions de travail qui se concluent toujours par un déjeuner. La convivialité est, en effet, pour nous, comme pour vous je crois, une dimension essentielle de la politique.
Si Guernesey est proche de la France, sachez que le Sénat est, de son côté, un peu anglais...
Aux grandes proclamations, nous préférons la réalité, le pragmatisme et le travail.
Notre Assemblée elle-même, beaucoup plus que l'Assemblée Nationale, fait une large place, à côté de son règlement, à la coutume et aux usages. C'est un lieu où les hommes et les femmes se respectent et où la tolérance, « ce commencement de fraternité », selon Victor Hugo, est notre première valeur commune.
Notre délégation, qui représente tous les groupes politiques, en est le témoignage.
Notre Assemblée est aussi parfois, il faut le dire, dans cette atmosphère prestigieuse mais feutrée du Palais du Luxembourg, un lieu de non-dit. Les sénateurs pratiquent ainsi «I'understatement »...
Je voudrais surtout, Monsieur le Bailiff, vous dire combien nous avons été séduits par votre île.
Nous qui sommes attachés à l'agriculture, nous sentons la richesse de cette terre « si hospitalière aux fleurs » et nous imaginons volontiers la profusion de sa nature au printemps.
Victor Hugo a chanté Guernesey, il lui a dit sa reconnaissance ; c 'est en elle qu' 'il a puisé la force et l'inspiration pour écrire ou achever ses oeuvres les plus marquantes. Comme il le disait « les vers sortent en quelque sorte d'eux-mêmes de cette splendide nature ».
C'est dans cet écrin que la légende du siècle a forgé sa philosophie politique et sociale.
Plus tôt qu'un autre, Victor Hugo a fait que français et anglais, ces deux peuples qui ont fait l'histoire, se connaissent mieux. C'est grâce à lui que nous sommes ici et que nous avons eu l'honneur et l'immense plaisir défaire votre connaissance.
Ne serait-ce que pour cette raison, Victor Hugo mérite d'être remercié. Mais c'est vous, vous qui avez su l'accueillir, qui méritez ces remerciements. Vous avez montré une fois de plus la générosité des habitants des îles. « Tous les archipels sont des pays libres.
Mystérieux travail de la mer et du vent ». Merci d'avoir atténué l'exil de Victor Hugo, de lui avoir offert un cadre propice à l'expression de son génie littéraire et à la conception de sa philosophie politique.
Je n'oublie pas non plus qu'il a planté sur votre île, le 14 juillet 1870, le chêne des États-Unis d'Europe, image de l'avenir et, j'en suis sûr, de notre destin commun.
C'est donc au nom de cette patrie commune, l'Europe, que je lève à nouveau mon verre et souhaite à Guernesey de trouver dans le cadre des institutions britanniques et européennes la place qui concilie son désir du développement et le respect de son identité et de son originalité.
Visite à Candie Gardens
Arrivée à Candie Gardens et accueil de la délégation par le Député, Madame C.H. Le Pelley. Cette dernière s'avance jusqu'au pied de l'impressionnante statue de Victor Hugo. Il s'agit d'un don de la France, réalisé en 1914 par Jean Boucher.
Dépôt de gerbe par le Bailiff, le Président du Sénat, Mme Sandrine Mazetier, Adjoint au Maire de Paris, Mme Véronique Bascoul, administrateur-régisseur de Hauteville House et Consul honoraire de France, ainsi que par le Consul honoraire de France et Monsieur M.E.W. Burdbridge, Député, Président du Comité Victor Hugo.

Visite de la maison Victor Hugo
· 15 h 30 :
Arrivée à Hauteville House où Victor Hugo a résidé de 1856 à 1870 dans un cadre enchanteur. Sa terrasse surplombe la mer.
Accueil par Mme Sandrine Mazetier, adjoint au maire de Paris, chargée du patrimoine, puis visite de la maison-musée.

Monsieur le Président Christian Poncelet devant le port de Guernesey,
depuis Hauteville House, maison de Victor Hugo.
A droite, le « Lock-out » où il aimait venir pour écrire.
· 16 h 30 :
Accueil et cérémonie de la remise de la plaque commémorative représentant l'hémicycle du Sénat et rappelant l'appartenance de Victor Hugo à la Chambre des pairs et au Sénat de la III e République.

«la République gouvernée par une assemblée unique, c'est-à-dire l'océan gouverné par l'ouragan ».
M. Christian Poncelet et Mme Sandrine Mazetier,
adjoint au maire de Paris
Allocution de M. Christian Poncelet, Président du Sénat,
Lors de la remise de la plaque commémorative
du sénateur Victor Hugo
(Hauteville House)
Monsieur le Lieutenant Gouverneur,
Monsieur le Bailiff,
Madame la Représentante de Monsieur le Maire de Paris,
Mes chers collègues, chers amis,
C'est avec une émotion toute particulière que je me trouve aujourd'hui à la tête d'une délégation du Bureau du Sénat, composée de représentants de tous les groupes politiques, dans cette maison de Hauteville House qui fait désormais partie de la littérature française mais aussi de notre histoire et de notre patrimoine.
Victor Hugo l'a habitée quatorze ans. Il ne l'a pas construite mais il l'a façonnée, transformée, imprégnée au point que son fils Charles pouvait écrire qu'elle était en soi un « autographe ».
Elle est d'ailleurs, avec ses extravagances et ses fulgurances, à l'image du génie de Victor Hugo, dont elle a provoqué des manifestations inattendues. Écrivain, certes, et sous toutes les formes possibles : théâtre, poésie, roman, lettres. Dessinateur, dont l'oeuvre immense reste encore à découvrir. Penseur, philosophe et visionnaire, c'est une dimension supplémentaire que peu d'écrivains ont eu à ce point. Homme politique et parlementaire qui a su traduire concrètement son engagement, fort bien.
Nous le découvrons ici, grâce à vous mesdames, architecte, décorateur, menuisier... attentif au moindre détail. Cela montre s'il était besoin l'universalité de son génie : il n 'y avait pas pour lui de grandes choses et des petites.
Une chose est grande dès lors qu'elle est portée par une âme. Cette âme peut être trouvée dans toutes les circonstances de la vie, tous les métiers, tous les âges. Tel est le message politique fondamental de Victor Hugo, ce pourquoi il a opté très vite et définitivement pour la République en 1848. C'est l'illustration concrète de la fraternité, le mot qui s'accorde le mieux avec l'auteur des Misérables. C'est pour « faire comprendre l'égalité et la fraternité » qu'il donna ainsi à dîner ici même tous les mardis à « quinze petits enfants pauvres choisis parmi les plus indigents de l'île ».
Cette maison aussi a construit Victor Hugo. Elle a servi de cadre à la rédaction de nombre de ses plus belles oeuvres et des plus marquantes, : La légende des siècles, Les Misérables, L'homme qui rit, William Shakespeare, Les chansons des rues et des bois...Il a mis aussi dans celles-ci, et souvent, des témoignages et des images de son séjour à Guernesey au point de consacrer un roman entier les « Travailleurs de la mer » à cette île « d'hospitalité et de liberté », à ses hommes et à ses femmes.
Ses femmes... Déjà accompagné de sa femme et de sa maîtresse fidèle, il a trouvé ici des servantes et des compagnes qui ajoutent à sa légende de démesure et de vitalité, confirmant ainsi peut-être une réputation que tous les Français ne méritent sans doute pas... « Je resterai jusqu' 'à la mort », écrivait Victor Hugo le 23 décembre 1860 à Guernesey, « le protestant de la liberté d'aimer. La liberté est le même droit que la liberté de penser, l'une répond au coeur, l'autre à l'esprit ; ce sont les deux faces de la liberté de conscience ; elles sont au plus profond sanctuaire de l'âme humaine. »
Je crois surtout que cette île à travers ses paysages, a accentué chez Victor Hugo le sens de la grandeur et de l'infini : « J'aime les petits pays entourés de grands spectacles » disait-il... « Il y a ici tant de mer et tant de ciel que c'est à peine si l'on a besoin d'un peu de terre ». C'est ce ciel et cette mer qui lui tinrent lieu de vrais compagnons tout au long de ces journées passées dans son belvédère « cette serre sur le toit » où il aimait écrire debout, face à la mer.
C'est sans doute cette paix du silence et de la solitude qui l'ont aussi transformé. Lui qui sut rompre radicalement et tenir, seul, face à ce qu'il considérait comme un déni de justice politique et à une imposture a construit en fait dans l'exil et dans cette maison sa capacité de rassemblement ultérieur. C'est ici qu'il a constaté en lui-même « ce magnifique mélange de l'indignation qui s'accroît et de l'apaisement qui augmente ».
« Combattre avec l'espoir de pouvoir pardonner, c'est là le grand effort et le grand rêve de l'exil ».
Le Palais du Luxembourg qui abrite le Sénat à Paris a eu l'avantage d'accueillir Victor Hugo dans son hémicycle par deux fois, avant et après l'exil : entre 1845 et 1848, comme Pair de France nommé par la Monarchie de Juillet ; de 1876 à sa mort en 1885 comme sénateur de la République élu de la Seine. Il siégeait à droite avant 1848 dans une assemblée qui n'était pas particulièrement progressiste. C'est à l'extrême gauche qu'est fixée la plaque qui commémore sa présence aujourd'hui. Ce déplacement dans l'espace de l'hémicycle résume son parcours politique.
Beaucoup ont vu dans cette évolution un revirement coupable. Je crois qu'ils méconnaissent les motivations de l'homme.
Certes Victor Hugo a changé au cours de sa carrière. Jeune bourgeois chanceux, c'est en écrivain talentueux qu'il entre à l'Académie française puis à la chambre des Pairs pour suivre Chateaubriand, son modèle. « Être Chateaubriand ou rien ».
La révolution de 1848 sert pour lui de révélateur et le projette dans une toute autre « carrière ».
Il trouve dans la République sociale de la deuxième République la chance qu'il attendait de réaliser l'unité sociale de la France.
Le coup d'État de Napoléon l'amène ensuite à choisir la voie la plus difficile pour défendre la liberté. Projeté « hors de toutes les séries » comme le sera plus tard un autre grand Français qui choisit l'exil en Angleterre, il acquiert une valeur de référence pour les républicains. Il mûrit par ses interventions une doctrine politique et sociale bâtie sur l'engagement personnel contre l'injustice et qui n'a pas besoin de partis.
Il reste ainsi un intellectuel, au meilleur sens du terme, mais qui ne sera prisonnier d'aucune chapelle ni d'aucune mode.
Aucun domaine d'action humaine ne lui est étranger : abolition de la peine de mort, réforme sociale, éducation pour tous laïque et obligatoire, droit des enfants, égalité des sexes, indépendance des peuples, États-Unis d'Europe... Ce qui le caractérise, autant que la diversité de ses combats, c'est son opiniâtreté à les mener. Dès lors qu'il se saisit d'une cause, plus de limites, plus de frontières. Il combat la peine de mort en France mais aussi aux États-Unis, et ici même, au risque de choquer ses bienfaiteurs. Le Sénat est le théâtre de ses combats pour l'amnistie des Communards. Trois fois il dépose une proposition de loi en ce sens jusqu' 'à la loi du 11 Juillet 1880, aboutissement de ses efforts, dix ans après les événements.
Cette ténacité, cette continuité, cette liberté ce sont celles dont s'inspire le Sénat. Sa stabilité, son mode d'élection, la durée de son mandat lui donnent le recul et la liberté de jugement indispensables au combat politique.
C'est ce qui fait le caractère indispensable de la seconde Chambre dans une République démocratique, sa vertu d'équilibre, de contrepoids et de tempérance.
Victor Hugo l'avait bien perçu, avant même de devenir sénateur : c'est dès 1848 qu'il s'élève contre le principe de la chambre unique adoptée par l'assemblée Constituante : « la France gouvernée par une assemblée unique, c 'est à dire l'océan gouverné par l'ouragan ». Nous avons pensé que cette citation, métaphore maritime prémonitoire de l'homme océan, serait à sa place dans cette maison marine. C'est la raison pour laquelle elle est inscrite sur cette plaque symbolique que je vous remets madame, vous qui représentez la Ville de Paris légataire ici de Victor Hugo, sénateur de la Seine.
Vous y retrouverez l'hémicycle, dans lequel siégeait il y a peu notre collègue Bertrand Delanoë, le maire de Paris dont nous avons conservé un souvenir fidèle et avec qui je demeure en contact amical.
Il était normal que le Sénat de la République française que Victor Hugo a illustré et dans lequel il est présent - un salon porte son nom - vienne ici rappeler, en ce jour anniversaire, la dimension politique et parlementaire de son action.
« On voit à l'horizon la France comme un nuage et l'avenir comme un rêve » écrivait Victor Hugo pour qui la vie était un exil.
Nous voulons aujourd'hui rappeler par ce geste le lien entre ce lieu et la France.
Au moment où, en France comme au Royaume-Uni, l'action politique n'est plus aussi considérée qu'au temps de Victor Hugo, nous voulons surtout, sénatrices et sénateurs de la République, collègues parlementaires de Victor Hugo, dire solennellement que nous n'imaginons toujours pas un monde où « l'action ne serait pas la soeur du rêve ».
EUROPE 1 JOURNAL Le 26/02/2002 à 18 H 52 - EXTRAIT
GUILLAUME DURAND
Figurez-vous qu'une délégation de sénateurs était cet après-midi à Guernesey dans la maison de Victor Hugo, la célèbre maison de l'exil du grand écrivain dont on fêtait hier le bicentenaire, mais entre Les Misérables et choses vues, entre la haine de Napoléon 3 et les amours avec Juliette DROUELLE (ph), on avait un petit peu oublié que Victor fut un sénateur de notre auguste république, du coup les vénérables actuels ont rendu hommage à leur illustre prédécesseur. Au téléphone avec nous, Jean-Claude GAUDIN, sénateur maire de Marseille, monsieur GAUDIN méridional est de bonne humeur, il adore « toto » le romancier, l'homme politique, l'exilé, quand la Cannebière rend hommage à Guernesey, ça donne ça.
JEAN-CLAUDE GAUDIN
Ma foi les grands romans qui nous ont tous impressionné et que l'on a vu sous la forme et que l'on a vu sous la forme de films même ce qui rend encore plus vivant et puis le personnage politique, ce personnage politique qui a quand même un peu varié parce qu'il a quand même adopté plusieurs attitudes au Sénat de la République, il y a la Place de Victor Hugo d'abord dans l'hémicycle, et puis ensuite il y a cette influence de Victor Hugo que nous ressentons tous et ça a été l'occasion d'une superbe séance publique la semaine dernière et là je suis à « Hauteville House », c'est-à-dire à la maison d'exil de Victor Hugo de 1856 à 1870 à Guernesey et nous sommes en train avec le président PONCELET, avec le bureau du Sénat, de visiter cette maison en étant impressionnés par l'influence que Victor Hugo a donnée à Jersey, à Guernesey.
GUILLAUME DURAND
Alors Jean-Claude GAUDIN, vous avez une grande expérience politique, Victor Hugo a commencé comme un fringant jeune monarchiste et puis il est devenu un républicain résistant, impitoyable... Presque quinze ans sur cette île, vous rencontrez en votre terre politique des gens de cette trempe ? Ça n'existe plus des gens qui sont prêts à mettre leur vie entre parenthèses, pendant quinze.
JEAN-CLAUDE GAUDIN
Bien entendu c'est une autre époque mais je vous rappellerais ce qu'on disait de quelques hommes politiques comme Edgar FAURE qui lui aussi avait su à un moment donné évoluer. Non ce que je retiendrais c'est pas tant l'oeuvre politique de Victor Hugo, mais c'est plutôt cette oeuvre qui nous enchante et qui marque la littérature française et la littérature internationale et aujourd'hui le Sénat se déplaçant, vient rendre hommage à Victor Hugo parce que bien entendu, eh bien c'est à la fois et un homme politique et un littéraire extraordinaire, vous entendez il y a des camions qui passent sur le parvis de la maison de Victor Hugo où je m'entretiens avec vous à l'instant même et c'est surtout son oeuvre littéraire et puis ses années d'exil. Vous savez, les gens croient toujours que la politique c'est facile, mais quand un homme a défendu avec les convictions qui ont été les siennes, qui souhaitait cette abolition de la peine de mort, qui a lutté contre toutes les injustices, allez, c'est quand même quelque chose de remarquable pour notre histoire politique française mais aussi pour la France tout court.
GUILLAUME DURAND
Dites-moi Jean-Claude GAUDIN, si Victor Hugo était parmi nous, il voterait pour qui aux présidentielles ?
JEAN-CLAUDE GAUDIN
Oh, écoutez je ne sais pas, je ne sais pas mais je vous citerai simplement pour garder l'humour méditerranéen que Victor Hugo disait «... demain sur nos tombeaux, les blés seront plus beaux... » . Allez ceux qui sont ici avec le bureau du Sénat n'ont pas envie de mourir. Ni électoralement, ni tout court.
GUILLAUME DURAND
En direct avec nous, merci Jean-Claude GAUDIN.FIN"
Sénat-Hugo PREV
Le Sénat sur les traces de Victor Hugo en exil par Claude Lévy
SAINT-PIERRE-PORT (Guernesey), 26 fév. (AFP) - Une délégation du Sénat avec à sa tête son président Christian Poncelet, s'est rendu mardi, jour anniversaire de la naissance de Victor Hugo sur les traces de l'écrivain en exil à Jersey et à Guernesey où il séjourna de 1855 à 1870.
Première étape : Jersey où Victor Hugo, exilé au lendemain du coup d'État du 2 décembre 1852, habita pendant trois ans. C'est là qu'il se livra à des expériences de spiritisme et écrivit notamment "Les Châtiments" et "Les Contemplations".
Il séjourna à son arrivée à l'Hôtel de la Pomme d'Or, au toit vert, en face du port de Saint-Hélier avant de venir à l'Hôtel "Marine Terrace" - aujourd'hui disparu.
Au rocher des Proscrits, où les proscrits français, italiens ou polonais se retrouvaient face à la mer, à trente kilomètres de la côte française, une simple plaque rappelle le passage de Victor Hugo.
A quelques kilomètres de Saint-Hélier dans la campagne, un petit cimetière regroupe les proscrits décédés à l'époque de Victor Hugo. Une tombe collective surmontée d'une colonne en grès avec des plaques comportant les noms d'une dizaine de Français est située au milieu du cimetière sobre et sans fleur, émouvant.
Le guide évoque notamment l'histoire de Louise Julien, de Paris, décédée en 1853, exilée pour avoir chanté une chanson de Victor Hugo à une terrasse de café à Paris, à l'époque de Napoléon III.
Victor Hugo dira sur sa tombe : "Une femme de nos jours, digne de devenir une citoyenne".
Au Parlement, reçu par le Bailli et le Lieutenant-gouverneur, M. Poncelet a déclaré que Victor Hugo "n'a jamais oublié l'accueil de Jersey et que ce 26 février est une journée historique, non seulement du fait de la naissance de Victor Hugo mais également du débat entamé à Jersey autour de la réforme du statut constitutionnel de l'île".
Deuxième étape : Guernesey (1855-1870). Dépôt de gerbes sous la pluie et dans le vent à Saint-Pierre Port, devant la statue de Victor Hugo, qui avance résolument vers la mer, cheveux au vent, s'appuyant sur un bâton et tenant son chapeau à la main. Il s'agit d'un don de la France, réalisé en 1914 par Jean Boucher.
"Hauteville House" où Victor Hugo a habité de 1856 à 1870 est impressionnant. Sa terrasse domine la mer. C'est là qu'il a écrit "Les Misérables" et "La Légende des siècles".
La villa transformée en musée est aujourd'hui propriété de la Ville de Paris à la suite d'un don de Jeanne Hugo et des enfants de Georges Hugo.
"Nous voulons rendre hommage à son engagement politique, à sa passion pour la défense du peuple", a déclaré en accueillant les visiteurs, Mme Sandrine Mazotier, adjointe au Maire de Paris.
CL/dmk/gw/dlm
FP 261759 FEV 02
AFP 261759 FEV 02


LES EXPOSITIONS
Le 20 février 2002, Monsieur Christian Poncelet, Président du Sénat et Monsieur Bertrand Poirot-Delpech, de l'Académie-Française, inauguraient l'exposition réalisée par le service de la Bibliothèque du Sénat à partir de son fond d'archives.
« Incrustée » dans la Salle des Conférences, l'exposition « Victor Hugo, témoin de son siècle» accompagna la vie du Sénat jusqu'au 15 novembre 2002 et accueillit plusieurs milliers de visiteurs, jeunes pour la plupart.
Son catalogue, réalisé en collaboration avec le Centre National de Documentation Pédagogique du Ministère de l'Éducation nationale fût tiré à 100 000 exemplaires et diffusé dans toutes les écoles de France.
Les huit panneaux résumant les combats de Victor Hugo furent placés de part et d'autre de la façade du 15 rue de Vaugirard, consacrant pour un temps l'identité entre le Palais et un homme qui y fit retentir sa voix par deux fois : comme Pair de France de 1845 à 1848, comme sénateur élu (de la Seine) de 1876 à 1885.


L'enseignement primaire obligatoire c'est le droit de l'enfant...
et le creuset de la République

Le 24 septembre 2002, M. Jean-Claude Gaudin (R.I. Bouches-du-Rhône), Vice- président du Sénat, inaugure l'exposition « Victor Hugo, promeneur du Luxembourg » présentée par le Sénat et réalisée par la Bibliothèque nationale de France avec le soutien du Ministère de la Culture sur les grilles du jardin, le long de la rue de Médicis, du 21 septembre au 6 décembre 2002. Cette série de panneaux reprend, sur une scénographie originale de Michal Batory, des éléments graphiques et manuscrits révélant au grand public la diversité des talents de Victor Hugo. Au premier plan : M. Jean-Claude Gaudin (R.I. Bouches-du-Rhône), Vice-président du Sénat et M. Bertrand Poirot-Delpech, Président du Comité national pour le Bicentenaire de Victor Hugo. Au centre, M. Jean-Noël Jeanneney, Président de la Bibliothèque nationale de France... et petit-fils de Jules Jeanneney, Président du Sénat du 3 juin 1932 au 10 juillet 1942.

A l'occasion des journées Victor Hugo organisées par le Sénat, Anne Saulay et Bruno Lehnisch, administrateurs du Service de la Communication, accueillent les jeunes invités de Gérard Klein et son équipe pour le tournage de l'émission « Va Savoir » devant l'exposition « Victor Hugo, le Promeneur du Luxembourg ». L'émission a été diffusée sur France 5 le 17 novembre 2002. Depuis sa création « Va Savoir » est un magazine de découverte dans lequel un groupe d'enfants sillonne les routes de France et d'Europe à bord d'un autobus jaune, conduit par Gérard Klein. Désormais, leurs étapes les mènent à la rencontre du monde de la culture.
CE QUE C'EST QUE L'EXIL : TEMOIGNAGES POUR AUJOURD'HUI - ACTES DU COLLOQUE DU 15 NOVEMBRE 2002

Une affluence exceptionnelle pour des tables rondes exceptionnelles
ACTUALITÉ DE L'EXPÉRIENCE HUGOLIENNE DE L'EXIL
M. ROBERT DEL PICCHIA , SÉNATEUR, représentant Monsieur Christian Poncelet, Président du Sénat
Mesdames, Messieurs,
C'est un grand honneur pour moi d'être appelé à prononcer devant vous le discours d'ouverture de ce colloque préparé par M. le Président Poncelet qui est retenu ce matin par des obligations impératives auxquelles il n'a pu se soustraire. Il m'a demandé de l'excuser auprès de vous. Le remplacer est un honneur mais c'est aussi une émotion particulière dans la mesure où, sans être nullement exilé moi-même, je fais partie de ce million et demi de Français dits « expatriés » qui vivent la France d'une façon particulière, même s'ils ont conscience dans leur vie de tous les jours de la représenter.
Je crois en effet que Danton s'est trompé le jour où il a dit que « l'on n'emporte pas sa patrie à la semelle de ses souliers ». Si, justement, on l'emporte car malgré tous nos efforts, tous nos oublis parfois, notre volonté de rupture aussi, il demeure une part de nous-mêmes que l'on ne peut renier. Elle ne s'apaise vraiment, me semble t-il, que si on l'intègre après l'avoir reconnue et, d'une certaine manière, admise.
A l'inverse, la France que transporte celui qui est loin d'elle est souvent plus belle, plus proche des idéaux qu'elle véhicule que la France réelle. Faut-il s'en plaindre ? « Il existe, " écrivait Giraudoux, qui s'est tant moqué du chauvinisme et qui était lui- même un peu chauvin, " un pacte éternel entre la France et la liberté du monde ». Sans doute faut-il voir dans ce jugement une trace de cette arrogance qui, pour nos voisins, est le premier de nos défauts. C'est aussi cependant, notre modestie dut-elle être prise en défaut, une de ces idées dont la France est porteuse grâce à son histoire et qui ne lui appartient plus tout à fait. C'est cette part d'universel qu'avec un certain nombre d'autres pays, elle a la chance d'incarner, au moins partiellement.
C'est au nom de cette liberté que le Sénat, sur la proposition de M. Christian Poncelet, a décidé d'organiser ces journées hugoliennes sur l'exil et la tolérance. Permettez-moi de vous donner lecture du discours de M. le Président.
« Le Sénat s'est associé naturellement avec l'UNESCO qui incarne cette mission mondiale en faveur de la paix à travers la diversité des cultures. L'UNESCO, il y a cinq ans, a fait du 16 novembre la journée mondiale de la tolérance. C'est une valeur qui s'est affirmée progressivement au moment des conflits religieux qui ont divisé l'Europe et qui est aujourd'hui toujours d'actualité, même si le contexte a changé... mais en pire...
La société contemporaine pose la question de la coexistence des États mais plus encore des différents groupes en quête d'identité. C'est une question internationale mais aussi nationale. Le Sénat y est particulièrement attentif. C'est la raison pour laquelle sous l'impulsion de ses Présidents successifs, il a développé une politique d'ouverture, j'allais dire « tous azimuts ».
Le Sénat est d'abord une assemblée parlementaire à part entière et, à ce titre, avec le Président de la République et l'Assemblée Nationale l'une des expressions de la souveraineté nationale. De ce fait, il est aussi comptable de l'unité de la nation. Dans cette tâche, son mode de scrutin, qui a l'avantage de le tenir quelque peu en retrait de l'actualité immédiate, est un atout. Ses membres peuvent y puiser le recul nécessaire pour essayer de comprendre la diversité des opinions.
Ils y puisent l'atmosphère qui fait le charme de cette maison où l'esprit de modération est une qualité partagée par tous ses membres. Pragmatiques, les Sénateurs s'efforcent d'écouter avant d'agir. Cette attitude ne signifie pas qu'ils n'aient pas eux-mêmes des opinions - ils les expriment quand il le faut selon la règle majoritaire -, mais ils s'efforcent de le faire en privilégiant, aussi souvent que possible, l'approche concrète des problèmes.
Ils ont pour cela un deuxième atout naturel, celui de connaître le terrain. La plupart n'arrivent au Sénat qu'après une expérience de gestion locale et c'est dans cette gestion, naturellement plus consensuelle et marquée par le souci de l'unité de la collectivité des habitants, que s'élabore leur culture politique. Si je pouvais me permettre une image, les Sénateurs sont les « palpeurs » naturels et permanents des courants visibles et invisibles qui traversent la société. Ce qui caractérise en effet aujourd'hui la société française, c'est la profonde recomposition des idées. Celles-ci s'expriment de plus en plus difficilement à travers les canaux traditionnels ou idéologiques. Elles cherchent l'ouverture dans des zones qui Jusqu'ici, n'étaient pas considérées comme appartenant stricto sensu à la sphère politique. Ce que les citoyens ne trouvent plus - et on ne peut que le déplorer - dans la participation électorale, ils le recherchent à travers l'engagement individuel, et souvent pour des causes généreuses. La « culture » au sens large : information, ouverture vers le monde, spectacle devient, sous des formes diverses et parfois balbutiantes la compagne de leur vie quotidienne. La multiplicité des rencontres provoque certes des affrontements mais révèle aussi des clivages inattendus. Ces évolutions imposent la modestie et proscrivent les idées toutes faites.
Notre souhait est que dans un tel contexte, ces rencontres nous aident à délivrer un message d'espoir : celui que la tolérance, à l'intérieur et à l'extérieur, est possible ; qu'elle est, en tout cas, le chemin de l'avenir commun, même si elle exige des efforts de chacun.
Nous avons pensé que la meilleure manière d'aider la société française à se reconnaître était, justement, de rappeler que la France était par essence un lieu d'accueil et de rencontre, d'où le choix du caractère international de ces manifestations.
Nous avons été aidés dans cette démarche par Victor Hugo, notre prestigieux collègue que l'un de mes prédécesseurs Président du Sénat accueillit par ces mots après son élection par les électeurs de la Seine : « Mes Chers Collègues, le génie a pris séance. Le Sénat a applaudi et il reprend le cours de sa délibération ».
Quel chemin parcouru depuis le 20 février 2002 depuis cette séance solennelle au cours de laquelle des Sénateurs de tous les groupes se sont exprimés, chacun à leur manière en l'honneur de Victor Hugo ! Nous avons voulu à cette occasion, pour la première fois, permettre à une sociétaire de la Comédie Française qui nous accompagne en cette année du bicentenaire d'accéder à la tribune du Sénat pour nous lire l'un des plus beaux textes de Victor Hugo. Rachida Brakni dont nous avons apprécié la jeunesse et le courage, avait choisi un extrait des Misérables qui nous a redonné ce bien le plus précieux : des raisons de croire en nous-mêmes. « La grandeur et la beauté de la France, c'est qu'elle prend moins de ventre que les autres peuples... Elle est la première éveillée, la dernière endormie. Elle va en avant. Elle est chercheuse. Cela tient à ce qu'elle est artiste ».
Quelques jours après, nous étions à Jersey et Guernesey, sur les pas des proscrits et de Victor Hugo exilé. Ce fut un pèlerinage simple et digne, le jour même du bicentenaire.
Soucieux de faire le lien entre le passé et le présent, nous avons également exploité les richesses de nos propres archives pour en faire une exposition. Plutôt qu'un catalogue réservé à quelques-uns, nous avons choisi d'en faire une publication en collaboration avec le Ministère de l'Éducation nationale pour que les archives du Sénat sur Victor Hugo, et elles étaient riches, soient diffusées comme il l'aurait souhaité dans toutes les écoles de France : « Mettre le coeur du peuple en communication avec le cerveau de la France ».
Cette plaquette a servi de référence à un concours qui rassemblera demain dans notre hémicycle 280 élèves de collèges et lycées. Ils pourront voir aussi, comme des milliers d'autres, les documents disposés sur les grilles de notre jardin par la Bibliothèque Nationale de France ainsi que la remarquable exposition sur notre mémoire douloureuse que constitue l'exposition de Madame Virginie Buisson que vous avez pu voir à l'entrée de cette salle. J'ai souhaité qu'elle quitte notre prestigieuse Salle des Conférences où nous l'avons inaugurée pour qu'elle soit plus accessible à vous tous qui avez pris le chemin du Palais du Luxembourg.
Consacrée aux déportés de la Commune, elle rassemble quelques-unes des images les plus émouvantes que l'on puisse connaître, celles des exilés dans leur pays lui- même, celui de l'incompréhension et de l'injustice.
Nous n'avons pas voulu en effet esquiver le regard nécessaire que chacun doit porter aujourd'hui sur la souffrance du monde. Cela ne sert à rien de se dissimuler les réalités. Nous le faisons d'autant plus volontiers que, précisément, l'exil de Victor Hugo à travers sa souffrance est aussi un espoir : « Soit d'autant plus sévère aujourd'hui que tu seras plus compatissant demain ».
Victor Hugo nous apprend que tous les exils, un jour ou l'autre, ont une fin et que la fin est d'autant plus grande que la résistance aura été plus absolue.
Certes tous les exils qui sont ici rassemblés à travers des personnalités du monde politique mais surtout de la culture, de la création et des arts ne sont pas des exils contraints, au moins en apparence. Ils ont tous cependant un point en commun, celui de l'arrachement à sa culture, à sa famille, parfois à ses repères.
Tout exil est un grand départ vers l'inconnu.
Tout exil est aussi rencontre. Rencontre d'un autre peuple, d'une autre culture.
Tout exil est une interrogation. Dois-je abandonner ma culture ? Dois-je disparaître dans une autre ? Est-il possible de fondre les deux dans une synthèse supérieure ?
L'exil, par nécessité, est toujours création.
Je n'ai ni le talent, ni le désir de répondre aux questions à votre place. Je voudrais dire seulement au début de cette journée, combien le Sénat vous est reconnaissant d'avoir répondu présent à son invitation et d'avoir ainsi compris l'esprit dans lequel il vous avait invité. Nul doute qu'à travers ce travail collectif, vous aiderez notre société à grandir et, peut-être, à se trouver un peu mieux.
Après avoir étudié et observé vos différents parcours, si divers et si multiples, je suis persuadé que ce sera le cas. Je crois comprendre en effet que, pour vous comme pour Victor Hugo, l'exil, finalement, c'était aussi la découverte de soi-même. La vie est exil ou l'exil c'est la vie...
Lorsque, comme vous, l'on y ajoute le talent, cette découverte de soi a toute chance de devenir une référence pour tous. »
HUGO, L'EXIL ET LE XIXE SIECLE
JACQUES SEEBACHER
Professeur honoraire à l'Université Paris VII et fondateur du Groupe Hugo
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Je souhaite commencer par exprimer la reconnaissance du grand nombre des spécialistes de Victor Hugo de l'Université et d'ailleurs. Nous avons tous été particulièrement émus et nous sommes reconnaissants aux membres de cette assemblée et au personnel de cette maison des magnifiques réalisations qui viennent de se compléter par l'exposition bouleversante et extraordinairement pédagogique sur les déportés de la Commune. Je vous demande aussi la permission d'adopter un ton plus familier que celui qui convient à l'éloquence parlementaire. Je souhaite ainsi soulever quelques points paradoxaux concernant les questions politiques qui intéressent ici les orateurs. Je souhaite donc faire sentir, sinon montrer comment, chez Victor Hugo, il y a des vécus tout à fait inattendus sur ces questions.
La conscience dans l'oeuvre de Victor Hugo
Il y a quelques jours, la chaîne de télévision franco-allemande Arte anticipait sur ce colloque en présentant un reportage fort remarquable sur les exilés de notre temps. Ce reportage nous faisait entendre des témoignages d'exilés ainsi que des reportages sur la vie et l'oeuvre de Victor Hugo. Cependant, il y a toujours un malin génie, si bien qu'un lapsus s'est glissé dans la présentation des avantages de l'exil, exil qui a permis à Victor Hugo de livrer, sans doute, la partie majeure de son oeuvre poétique. En effet, il a été dit que, pendant son exil, Victor Hugo avait écrit Les Châtiments, Les Contemplations, La Légende des siècles et Les Odes et Ballades. Or ce dernier recueil a été publié en 1822, c'est-à-dire lorsque Hugo était encore loin de son exil. Comme la plupart des lapsus, celui-ci a une signification importante parce qu'il décèle peut-être la clé même de la conduite politique de Victor Hugo. En 1822, la préface des Odes affirme que ce livre correspond à deux intentions : l'intention politique et l'intention littéraire. Or l'intention politique est présentée comme la conséquence et non pas la cause de l'intention littéraire car " l'histoire des hommes ne présente de poésie que jugée du haut des idées monarchiques et des croyances religieuses ". C'est ici le jeune ultra qui parle. Le jeune ultra soumet en effet l'action politique à l'intensité de la recherche poétique. Il assigne pour objet à la poésie la poésie de l'histoire des hommes. C'est tout un humanisme systématique qui se met en place en une seule phrase de la préface de cet ouvrage. Si vous remplacez la formule de l'ultra " les idées monarchiques " par ce qu'elles représentent à cette époque, à savoir la notion de souveraineté, et si vous remplacez " les croyances religieuses " par ce qu'elles représentent pour Victor Hugo, à savoir un système de conscience et de responsabilité, alors vous verrez que le jeune ami de Lamennais se prépare déjà méthodiquement à une évolution qui n'a rien de contradictoire et qui est tout entière contenue dans l'intensité de ce premier mouvement.
La poésie est donc une religion de la conscience. Cette conscience continuera tout au long de sa vie à animer son oeuvre. Elle apparaît surtout à la fin de sa vie, en particulier en 1878. C'est cette année-là qu'il prononce le discours pour le centenaire de la mort de Voltaire lequel discours constitue une contribution extraordinairement provocatrice dans les luttes religieuses, politiques mais aussi sociales de l'époque. En effet, c'est le 30 mai 1878 que ce discours est prononcé dans un théâtre afin de ne pas trop provoquer d'émeutes. À cette époque, le maréchal de Mac Mahon est obligé de se soumettre avant de se démettre. C'est aussi le plein moment pour savoir si la République va tenir ou si l'on risque au contraire une restauration monarchique. Victor Hugo fabrique son texte autour de la notion de responsabilité de la conscience humaine « ouverte et rectifiée ». Il veut apporter au XVIII e siècle le témoignage du XIX e . Avec les débats à venir, nous pourrons, quant à nous, nous demander si nous pouvons apporter le témoignage de notre siècle au XIX e siècle et à l'oeuvre de Victor Hugo.
Il est aussi important de savoir quelles étaient les positions religieuses de Victor Hugo pour comprendre sa poésie, son oeuvre, ses romans, son action politique et en quoi il peut encore servir de référence à tous ces débats sociaux et politiques auxquels vous allez vous livrer. Pour l'essentiel, son Dieu est un Dieu absolument transcendant qu'aucune recherche ne peut identifier ni trouver et qu'aucune religion ne peut prétendre représenter. C'est un Dieu innommable et inaccessible, dont la religion récuse toutes les religions établies.
Pour Victor Hugo, Jésus-Christ est un apôtre sanglant du progrès. Jésus-Christ, incarnation, Dieu fait homme pour la plupart des Chrétiens, apparaît pour Victor Hugo comme un être historique, probablement décisif dans le développement de l'humanité au travers de l'Empire romain. Du coup, Voltaire est récupéré dans cette phase quasiment terminale de l'oeuvre de Victor Hugo car si ce discours a été prononcé le 30 mai, dans les conditions que je viens de vous décrire, c'est dans la nuit du 27 au 28 juin que Victor Hugo a été frappé par l'hémorragie cérébrale qui l'a tenu à l'écart des affaires publiques pendant quelques semaines. Or cette attaque cérébrale est, dit-on, survenue après une grande discussion avec Louis Blanc sur Voltaire et Rousseau. Hugo avait commencé sa carrière par les Odes. Il l'a finie par Voltaire et Rousseau. Il avait aussi commencé sa carrière par Voltaire en publiant en 1824 un recueil de ses lettres. Il avait alors 22 ans. Il y a chez Victor Hugo une connaissance considérable de l'oeuvre de Voltaire. Il connaît sur le bout du doigt Le Siècle de Louis XIV. Il connaît sur le bout du doigt l' Histoire de Charles XII. Et, bien entendu, il connaît Candide. Voltaire à Ferney ou Hugo à Jersey puis à Guernesey, ce ne sont pas simplement des rimes mais des histoires de face-à-face et de gens soit contraints à l'exil, soit ayant choisi la liberté " dans ces trous où se loger contre la persécution ", comme le dit Voltaire. Il y a là un dialogue tout à fait intéressant. Voltaire qui sait parfaitement parler de l'exil dit dans le chapitre 26 de Candide des rois exilés, des rois chassés, des rois déposés qu'ils "passent le carnaval à Venise ". Les systèmes d'opposition et d'accointance, les fils invisibles qui traversent l'identité de chacun de ces rois et chacun de ces pays sont inimaginables. Il faut donc avoir un très bon dictionnaire à côté de soi pour arriver à s'y retrouver. On découvre ici des arrière-fonds, non seulement ironiques, non seulement plaisants, mais aussi des arrière-fonds de type métaphysique et de type social. Qu'est-ce que la misère ?
Qu'est-ce que la prison pour dette ? Je vous laisse donc lire du Voltaire car sa lecture est toujours extraordinairement tonique. Si nous nous dépouillons de ce que nous croyons savoir, elle reste toujours surprenante. Ces rois plus ou moins relâchés de leur prison, plus ou moins évacués de leur pays, pas encore assassinés par leur tsarine sont à Venise pour "passer le carnaval", c'est-à-dire pour faire tout ce que la bonne société faisait au XVIII e siècle : se rencontrer à Venise dans des fêtes à n'en plus finir et se rencontrer avec des masques. Voltaire n'en dit pas un mot. Le lecteur doit savoir et comprendre tout seul. Ces rois à Venise non seulement dépensent leur faible temps de liberté mais outrepassent aussi le caractère carnavalesque de leur situation, les problèmes du pouvoir, les problèmes des luttes entre Turcs et Russes ou entre Anglais et Français. La vie de Victor Hugo s'encadre ainsi dans la vie et l'oeuvre de Voltaire. La réflexion sur l'exil passe donc facilement de l'un à l'autre comme moyen d'accès, non seulement aux réalités historiques, guerrières, politiques de l'exil et des déportations, mais encore comme quelque chose qui passe à l'intérieur de chaque homme et qui interroge son statut.
Ce que c'est que l'exil
Comme M. le Président nous en a dit un mot tout à l'heure, le grand texte, c'est le texte publié comme préface au deuxième volume des Actes et Paroles en 1875, Ce que c'est que l'exil. " Il n'y a pas de bel exil, il n'y a pas de beau pays pour l'exil (...) ". L'exil produit une dissociation entre les différents éléments de la personnalité. L'exilé - Victor Hugo à Jersey - est en effet espionné. On lui envoie des provocateurs, si bien que contre cette attaque se produit exactement le contraire de ce qui devrait se produire : une transformation du pour ou contre, un système newtonien d'action/réaction. C'est la clémence pour le tyran. L'exil est un jugement pour le proscripteur. Ce retournement est tout à fait au coeur de Ce que c'est que l'exil. L'exil est le système qui inverse ce que l'on pourrait attendre ou croire d'un système d'oppression, d'un système d'opposition, d'un système de clans, d'un système de partis. Que peut faire le penseur ? Il doit ne pas penser à ce qu'on lui fait. Les choses ne sont plus à l'extérieur de nous. Elles ne sont plus séparées, elles ne sont plus distinctes. Il faut penser, songer, penser à autre chose. L'exilé devient un autre capable de reconnaître les autres comme autres et les choses comme autre chose que ce à quoi on est habitué de vivre, de penser, de vouloir, d'aimer. L'exil est comme la pierre d'achoppement de la Bible et de l'Évangile. La pierre d'achoppement, c'est la liturgie de la régénération. C'est la pierre d'achoppement qui doit devenir la pierre d'angle de l'édifice. Ce qui vous fait broncher est aussi ce qui vous rendra capable de construire et de faire tenir une politique qui ressemble à quelque chose.
Voilà le travail qui est proposé par ce texte. Ce texte ressemble très curieusement, dans sa structure profonde, dans son ressort intime, au fameux texte Philosophie, commencement d'un livre qui constitue le grand texte métaphysique de Victor Hugo. Ce texte a d'ailleurs été pensé, à un moment donné, comme pouvant servir de préface aux Misérables. C'est le texte de cette religion, c'est-à-dire de la responsabilité qui est fondée essentiellement sur l'idée que nous avons une évidence de sensation, de sentiment et de sens : notre existence. Nous sommes persuadés d'exister et nous ne pouvons pas comprendre et connaître que cette existence a pu commencer un jour ni qu'elle doit finir un autre jour. C'est une évidence existentielle de base. C'est sur ce principe qu'il construit ce Dieu transcendant et inaccessible qu'aucune religion ne peut circonscrire ni même désigner. Il dit de ce Dieu qu'il est le moi de l'infini. Il illustre cette tension poétique, religieuse, politique et psychologique de deux exemples.
Dans le discours pour Voltaire, Victor Hugo rappelle son voyage de Guernesey à Southampton dans le vaisseau du capitaine Harvey, voyage effectué en 1867. Comme la Reine d'Angleterre devait recevoir Napoléon III, tous les matelots de la flotte étaient au garde à vous. Or, comme une dame avait demandé au capitaine Harvey de voir la scène et que le capitaine s'était laissé prier par Victor Hugo, il avait accepté de détourner le navire pour passer devant la grande flotte de la Grande- Bretagne. Les officiers britanniques imaginant que ce navire faisait partie du cortège royal s'étaient alors mis à pousser des hourrahs. Le capitaine avait déclaré que ces hourrahs n'étaient pas pour la Reine mais pour le " Proscrit ". Trois ans plus tard, le capitaine Harvey mourait lors du naufrage de son bateau dans la Manche, exemple d'abnégation, victime du devoir.
Dans Philosophie, commencement d'un livre, nous trouvons l'histoire d'un ancien prêtre devenu athée. Celui-ci va même jusqu'à dire qu'il n'y a aucun intérêt de mourir pour autrui. Pourtant, quelques années plus tard, ce prêtre meurt dans un naufrage dont il s'était échappé après avoir sauvé deux femmes mais sans avoir pu en sauver une autre. Le sacrifice des personnes dans leurs fonctions, dans leur honneur, dans leur conscience, voilà ce qui illustre toute cette action sociologique, religieuse et politique.
De même qu'il faut relire le chapitre 26 de Candide, il n'est pas mauvais de revoir le fameux poème de La Conscience. En règle générale, ce poème est perçu comme un texte psychologique et bien pensant. Cependant, ce Caïn avait été prévu pour Châtiments. Le Caïn visé ici est bien entendu Louis Napoléon Bonaparte. L'ami et associé de Victor Hugo pendant la Seconde République, Émile de Girardin, avait un projet très bien articulé de réforme générale contre la misère. Ayant été enfermé plusieurs jours au secret après les journées de juin 1848, ce dernier avait connu la réalité des prisons. Il avait donc compris qu'il fallait purement et simplement supprimer la prison comme peine. La prison servait de sûreté pour déférer les coupables à la justice. Girardin, dans sa réforme du système pénitentiaire, explique que Caïn - premier meurtrier - n'a pas été tué ni n'a été condamné ni n'a été enfermé par Dieu. Au contraire, il a été voué à se promener éternellement, c'est-à-dire à aller enseigner dans le monde que le meurtre était interdit. Autrement dit, l'exil, c'est ce qui caractérise Caïn : la limite problématique de toute pénalité. Dans La Légende des Siècles, il y a un Caïn sorti des Châtiments qui devient un Caïn de l'aventure humaine, de l'aventure de la faute, de l'aventure du crime et en même temps de l'aventure du néolithique, du bronze et de la musique. C'est de Caïn que sort la race des musiciens. Les coupables et les bandits pourront donc bien un beau jour, si l'on s'occupe d'eux, produire des beautés, des vertus, des consciences car " l'oeil est dans la tombe " et n'est pas prêt d'en sortir.
L'attention à la misère et aux misérables est aussi, en grande partie, l'attention à des misérables tels qu'on ne les connaît pas nous-mêmes : des bandits réels, des fous graves et des gens dépossédés de ce qui devrait être leur raison d'être et leur dignité.
C'est le cas, par exemple, de la moitié de l'humanité - les femmes -. Ainsi, l'exilé se porte sur les problèmes du féminisme et de la féminité lesquels sont extrêmement vivaces à cette époque. Il s'y porte même d'une manière très curieuse dans Les Contemplations (livre VI, poème 15). Voilà ce que dit Victor Hugo dans un quatrain, quatrain que je vous laisse interpréter tant ces quelques phrases restent difficiles à comprendre. Il s'adresse dans ce poème à une sorte de fantôme voilé et voici comment il lui parle :
Toi, n'es-tu pas comme moi-même,
Flambeau dans ce monde âpre et vil,
Âme, c'est-à-dire problème Et femme,
c'est-à-dire exil.
Nous pouvons parfaitement comprendre que la femme vive en exil à cette époque. Nous pouvons comprendre que Victor Hugo se prenne pour un flambeau. Nous pouvons aussi comprendre que chaque âme, c'est-à-dire chaque moi et chaque sentiment, ne puisse être que problématique à moins de sombrer dans la folie ou dans l'absence. Mais comment pourrait-on imaginer que Victor Hugo se sent femme ? Cette question reste irrésolue. La syntaxe de cette strophe n'est pas problématique pour rien.
Le Sénat a voulu consacrer cette journée à l'exil politique. Faut-il penser à l'exil pénal ? En effet, les condamnés quand ils essaient de se sauver deviennent des exilés dans d'autres pays. Faut-il penser à cet exil intérieur auquel je viens de faire référence ? Faut-il penser aux exils historiques ? A-t-on le droit de penser aux exils économiques ? N'est-ce pas une condamnation que de ne pas avoir de travail ? N'est- ce pas une condamnation que de ne pas avoir à manger ? N'est-ce pas être exilé que d'arriver dans un pays où l'on pense trouver de l'emploi ? Ces questions sont des questions d'aujourd'hui et sans doute de toujours. Ce sont des exilés qui ont fait, non seulement distinguer le droit et la loi comme Victor Hugo, ce sont aussi des exilés qui ont construit et réalisé leur programme d'enseignement, de divorce, d'égalité de la femme. Quant à la misère, ce qui pouvait être proposé à cette époque très audacieusement n'est pas encore totalement réalisé maintenant. Malgré les efforts de nos représentants, nous en sommes loin. Il y a eu un bon effet de l'exil. Si les Quakers en Angleterre n'avaient pas été poussés à gagner l'Amérique, alors l'Amérique ne serait pas apparue comme le phare, le bout de la ligne de la liberté telle qu'elle est apparue au XIX e siècle à la suite d'immigrations successives et telle qu'elle nous sert encore de référence comme République de la liberté avec notamment la statue de la liberté qu'un grand hugolien a fondue pour l'ériger dans le port de New York. Hugo se demandait dans la préface de Cromwell, si l'Amérique était vraiment l'avenir. La question posée dans Les Misérables est la suivante : "Faut-il trouver bon Waterloo ?". Nous pourrions dire aujourd'hui, "Faut-il trouver bon l'exil ?". Tous les propos qu'il a tenus dans les dernières années de sa vie sont contre la guerre et contre les guerres.
Nous sommes maintenant au moment où il convient d'apporter notre témoignage au XIX e siècle. Il y a eu au cours du XX e siècle tant de guerres, tant de déportations, tant de massacres. Quel témoignage les héritiers de ces fléaux peuvent-ils porter aujourd'hui ? Vont-ils pouvoir suspendre les conflits dans lesquels nous sommes présents ou arrêter les conflits qui menacent de se déclencher ? Vont-ils pouvoir rendre aux hommes leur pétrole et leurs universités là où ils n'en sont plus maîtres ? Hugo nous laisse en suspens, dans cette urgence.
Première table ronde sur
L'EXIL AU XIXE SIECLE OU L'ESPOIR DU LENDEMAIN
Vendredi 15 novembre 2002
Participent à cette table ronde :
Karine RANCE, Agrégée d'histoire en service détaché à l'Université Paris I
Sylvie APRILE, Maître de conférences à l'Université de Tours, membre du Groupe Hugo
Virginie BUISSON, Chercheuse en sciences sociales
Robert TOMBS, Professeur à l'Université de Cambridge
Franck LAURENT, Maître de conférences à l'Université du Mans
La table ronde est animée par Michel WINOCK, Professeur émérite à l'Institut d'Études Politiques de Paris, conseiller littéraire aux éditions du Seuil et conseiller de la direction de la revue l'Histoire .
Michel WINOCK
Cette matinée sera divisée en deux temps. La première table ronde sera consacrée à l'exil au XIX e siècle. Elle sera suivie par une autre table ronde, sur l'exil au XX e et XXI e siècles.
Il y a deux sortes d'exil, celui qu'on a souhaité et celui qu'on s'est vu infliger. Il y a le départ pour un autre pays de celui qui a rompu avec le sien, trop ingrat ou trop hostile : on arrache alors ses racines pour les replanter dans une terre plus accueillante. Il y a, à l'opposé, la proscription, la punition, l'ostracisme : il faut partir pour échapper à la prison ou à la potence. Cet exil-là est chargé d'un autre espoir que le premier : revenir.
« L'exil n'est pas une chose matérielle, écrit Hugo, c'est une chose morale. » Tout de même, être exilé c'est d'abord, chronologiquement, et parfois durablement, affronter le besoin, la pauvreté, voire la misère. Les caisses de secours ne sont que des palliatifs, il faut survivre : être manutentionnaire ou répétiteur, faire de la copie ou faire la manche. L'inégalité règne dans l'exil comme ailleurs. Certains disposent de rentes, la plupart n'ont que leurs yeux pour pleurer et leurs mains à enchaîner.
Il est d'autres souffrances que matérielles, l'espérance étant la plus violente d'entre elles. Car la proscription, sine die en général, précipite dans l'espoir du retour, toujours à vif, toujours déçu. C'est la douleur du vaincu. Injurié et spolié dans son pays natal, surveillé sans relâche dans le pays d'accueil, où l'espion prend tous les masques possibles, l'exilé de surcroît est accablé par l'éloignement et la solitude. Sont-ils perdus à jamais ses paysages familiers, la rue et la maison où il a grandi, les lieux de promenade mille fois parcourus, les chers visages restés là-bas ? L'exil est une mort à petit feu.
Cependant Hugo, qui parle en connaissance de cause des malheurs de l'exilé, a su montrer aussi la grandeur de l'exil. « En vous retirant de tout, écrit-il, on vous a tout donné ; tout est permis à qui tout est défendu ; vous n'êtes plus contraint d'être académique et parlementaire ; vous avez la redoutable aisance du vrai, sauvagement superbe. »
Vécu comme une catharsis, l'exil transforme et libère. La mondanité, sur laquelle les moralistes ont tant ironisé, et qui contraint à des politesses inhibitrices, la mondanité n'a plus court ; la liberté de pensée n'est plus aliénée par l'ambition ou la vanité ; le recul permet de se concentrer, comme dirait le cardinal de Retz, sur la substance au mépris du frivole.
Certes, les pièges abondent. Lucide, Hugo peur ainsi écrire en 1875 : « Le proscrit est un homme chimérique. Soit. C'est un voyant aveugle ; voyant du côté de l'absolu, aveugle du côté du relatif. Il fait de bonne philosophie et de mauvaise politique.» Mais l'auteur des Châtiments défend néanmoins la voix de « l'homme chimérique » : le seul relativisme mène à l'abîme.
Car l'exilé républicain rappelle le droit, la vérité, la justice. En ce sens, il est un danger permanent pour le prescripteur ; il fait peur à l'usurpateur ; il est l'oeil qui ne perd jamais de vue Caïn.
Au demeurant, tous les exilés ne partagent pas l'idéalisme de Victor Hugo. Leurs motivations ne sont pas nécessairement celles du droit et de la justice. Les émigrés de Coblence avaient quitté une France qui ne reconnaissait plus leurs privilèges. Les proscrits qui, avec Blanqui, avaient voulu imposer par le coup de force la raison révolutionnaire aux représentants du peuple souverain. La figure d'Hugo, son symbole, ne sauraient épuiser le modèle de l'exil. Le proscrit n'est pas obligatoirement une sainte victime, un soldat de la vérité, un prophète désintéressé, et c'est pourquoi l'exilé ne doit pas être seulement un objet d'admiration et de compassion -- mais un objet d'histoire.
*
* *
Le XIX e siècle, si l'on veut bien y inclure la période de la Révolution, aura été en France le siècle même de l'exil. Un grand précédent datait du XVII e siècle, lorsque l'abolition de l'Édit de Nantes, en 1685, déclencha une diaspora huguenote aux effets durables et désastreux pour la France. Un peu plus de cent ans plus tard, les épisodes successifs de la Révolution jettent environ 150 000 Français hors des frontières. « 100 000 Français chassés à la fin du XVII e siècle, écrit Michelet, 120 000 Français chassés à la fin du XVIII e siècle, voilà comment la démocratie intolérante achève l'oeuvre de la monarchie intolérante. »
L'Émigration des temps révolutionnaires n'a pas bonne réputation dans la tradition républicaine, qui a l'assimilée à cette « armée de Coblence », armée des princes retournant leur épée contre la nation française. De fait, la première émigration, volontaire, fut bien celle des aristocrates suivant, dès les lendemains du 14 juillet 1789, le comte d'Artois puis le comte de Provence, les frères du roi, dans l'espoir contre-révolutionnaire de restaurer l'absolutisme royal avec l'appui des régiments étrangers. Mais ce premier exil a été suivi de plusieurs vagues successives, provenant de toutes les classes sociales et de tous les partis vaincus, jusqu'à la chute de Robespierre. L'émigration n'a donc pas été homogène. Si la première phase est le fait de personnes hostiles à la Révolution, la deuxième phase, notamment au moment de la Terreur, est dominée par des partisans de cette Révolution en butte au jacobinisme montagnard. En 1793, le « crime d'émigration en temps de guerre » est défini par la loi. Les biens des exilés sont confisqués. Eux-mêmes, dont les noms sont inscrits sur une liste, sont condamnés à mort. La politique de réconciliation nationale, décidée par Bonaparte et le Consulat, prononcera le 26 avril 1802 l'amnistie générale des émigrés. Beaucoup alors rentreront en France. Certains attendront la chute de celui qui pour eux reste un usurpateur, en 1814.
Si désireux du consensus, le pouvoir napoléonien renforcé par l'instauration de l'Empire n'en provoque pas moins les départs de France, de la part des esprits les plus libéraux. Émigration qualitative plus que quantitative, illustrée au premier chef par les exils de Mme de Staël et de Benjamin Constant, pourtant ralliés au coup d'État de Brumaire par lequel Bonaparte avait accédé au pouvoir. Par son opportunisme, Benjamin, lui, sera condamné à un double exil : rallié de nouveau à Napoléon au moment des Cent Jours, il doit quitter la France après Waterloo. Il restera en Angleterre jusqu'en décembre 1816, date à laquelle, gracié par Louis XVIII, il peut revenir à Paris.
C'est de cette première grande vague d'exil que va nous parler Karine Rance, chercheuse associée à l'Institut d'histoire de la Révolution française (université Paris I).
Les émigrés de la Révolution : de l'émigration politique à l'exil politique
Karine RANCE
Évoquer l'émigration des nobles contre-révolutionnaires dans le cadre d'une manifestation consacrée à Victor Hugo peut surprendre car tout semble opposer l'émigré de l'époque révolutionnaire et l'écrivain défenseur de la République. Face à Victor Hugo se trouve un groupe d'environ 17 000 individus 1 ( * ) , une population extrêmement mobile, dispersée dans toute l'Europe et aux États-Unis, et favorable au rétablissement de la monarchie. Pourtant, comme Victor Hugo, les émigrés nobles contre-révolutionnaires pourraient être regardés comme des exilés politiques.
Émigration, exil, refuge, autant de termes dont la signification a évolué. À l'époque révolutionnaire, quand on évoquait les réfugiés, on pensait aux huguenots. Le terme d'émigré, légalement, désignait toute personne ayant quitté la France (en étaient exclus les négociants et les étudiants). Cependant, dans les débats publics, dans la presse et pour les acteurs eux-mêmes, l'émigré était défini plus précisément, à savoir par sa noblesse et par ses opinions contre-révolutionnaires. Le terme d'exilé, en revanche, renvoyait à une catégorie très floue.
Ces termes n'ont plus le même sens de nos jours. Le réfugié est aujourd'hui défini par un statut juridique ; l'émigré est celui qui se trouve à l'étranger : la définition est désormais très générale ; l'exilé, en revanche, est défini d'une manière plus précise qu'autrefois, à savoir par son engagement politique : selon Yossi Shain, les exilés sont ceux qui sont engagés « dans une activité politique dirigée contre la politique du régime du pays d'origine, [...] de manière à créer des circonstances favorables à leur retour. » 2 ( * )
Faut-il distinguer l'émigration politique de l'exil politique ? Cette distinction permettrait de caractériser deux époques très différentes de l'émigration contre- révolutionnaire qui, dans son ensemble, a duré une dizaine d'années. La première période va jusqu'à la défaite militaire de 1792, la seconde jusqu'au retour en France vers 1800-1802. Une troisième période s'ouvre avec le retour en France, qui ne signe pas toujours la fin de l'exil. 3 ( * )
Coblence : une émigration politique ?
L'émigration nobiliaire n'était pas politique à l'origine. Les nobles émigrés, dans leurs mémoires, écrivirent souvent que le départ du comte d'Artois (frère de Louis XVI et futur Charles X) et du prince de Condé, au lendemain de la prise de la Bastille, avait sonné le « signal de l'émigration ». En réalité, les premiers départs eurent lieu avant la prise de la Bastille : en Franche-Comté par exemple, les premiers nobles passèrent la frontière dès mars-avril 1789. 4 ( * ) Ces individus partirent pour se mettre à l'abri des troubles. Ils se rendirent à Bruxelles ou à Londres, allèrent prendre les bains à Spa, à Bath ou à Wilhelmsbad. Ils s'y enivrèrent d'une vie de société trépidante. Les émigrés étaient alors de simples de voyageurs.
Les départs se multiplièrent après chaque événement marquant, comme l'abolition de la noblesse héréditaire en juin 1790 5 ( * ) . Mais le groupe des nobles émigrés n'était ni structuré, ni véritablement politisé. Le comte d'Artois et le prince de Condé, qui s'étaient établis à Turin, avaient appelé les gentilshommes à les rejoindre pour former une armée. Cependant, rares étaient ceux qui avaient répondu à l'appel.
Au printemps 1791, les choses changèrent. Le prince de Condé et le comte d'Artois furent chassés de Turin. Le prince de Condé s'établit à Worms en mars, et le comte d'Artois à Coblence en juin. Il y fut rapidement rejoint par le comte de Provence, futur Louis XVIII. Ces trois princes renouvelèrent leur appel à la noblesse de France. Or la situation générale avait beaucoup changé : la tentative de fuite de Louis XVI fut considérée comme la confirmation de sa captivité, et l'obligation imposée aux officiers de prêter serment à la constitution en juin 1791 provoqua de nombreuses démissions 6 ( * ) . Les nobles déjà émigrés et d'autres qui se trouvaient en France se précipitèrent à Coblence et à Worms, car ils aspiraient, désormais, à lutter contre la Révolution. L'objectif était de restaurer la monarchie par une intervention militaire soutenue par les puissances étrangères.
C'est donc à partir de juin 1791 que l'émigration nobiliaire devint une émigration politique, au sens où les acteurs menaient une activité dont le but était de renverser le régime mis en place dans leur pays d'origine. En attendant un conflit militaire, les émigrés de Coblence se livrèrent à une intense activité de propagande et dotèrent le groupe d'institutions. Les princes et leurs « ministres » se réunissaient quotidiennement en un « conseil des princes », dont le premier ministre était Calonne. Ce conseil des princes tenait lieu de Gouvernement en exil et prétendait détenir la légitimité du pouvoir monarchique. Il disposait d'envoyés auprès des cours étrangères. Les princes établirent un cérémonial curial et reconstituèrent chacun leur maison. Une police, dont les membres étaient des émigrés, fut créée pour surveiller les Français résidant dans la ville. En cas de délit, la justice était rendue par des gentilshommes émigrés 7 ( * ) . Ceci soulevait des conflits de compétence avec les autorités locales. En effet, il ne s'agissait pas seulement d'un groupe d'immigrants faisant leur propre police afin d'éviter les conflits avec la population d'accueil : les émigrés s'arrogeaient le droit de juger tous les Français de passage à Coblence, et contrôlaient leurs opinions politiques. Deux sociétés se superposaient de ce fait : celle des habitants autochtones de Coblence et celle des émigrés, qui fonctionnait comme si elle se trouvait en extra-territorialité par rapport à la société urbaine dans laquelle elle était implantée. Ceci était inscrit dans la topographie de la ville puisque les émigrés, en arrivant à Coblence, devaient passer le seuil du bureau des émigrés où ils étaient inscrits sur une liste, après avoir été contrôlés. Les émigrés acceptés étaient, en outre, reconnaissables à des marqueurs identitaires : la cocarde blanche, la fleur de lys et le plumeau blanc, qui furent rendus obligatoires par le règlement militaire d'août 1791.
Cet espace était aussi délimité par des rites visant à exclure deux catégories indésirables : le tiers état parce qu'il était jugé indigne du combat, et les individus nobles jugés avoir été souillés par la Révolution, à savoir les partisans d'une monarchie constitutionnelle (les monarchiens) et tous ceux qui ont été en contact avec la Révolution. Ces personnes jugées impures étaient chassées de Coblence, parfois avec violence.
Pourquoi un tel exclusivisme ? Chaque adhésion et chaque rejet étaient l'occasion de réaffirmer l'identité du groupe et de le rendre visible. Il s'agissait de rompre le continuum politique qui liait le révolutionnaire au contre-révolutionnaire en distinguant clairement l'ami de l'ennemi 8 ( * ) . L'objectif était de faire valoir une vision du monde et d'exprimer le refus des valeurs et des institutions que la société française révolutionnaire semblait imposer. La neutralité n'était pas de mise : les puissances étrangères se virent sommées de prendre position. L'exclusivisme français fut ainsi exporté et, joint aux enjeux politiques intérieurs, déboucha sur un conflit européen.
Cette première phase de l'émigration nobiliaire peut être décrite comme une émigration politique : politique, puisque les acteurs partirent à l'étranger pour lutter contre le nouveau régime ; émigration, car les acteurs étaient libres d'entrer et de sortir de leurs pays. Pourquoi avaient-ils quitté la France alors qu'ils y courraient peu de danger et que la lutte eût sans doute été plus efficace de l'intérieur, comme ils le reconnurent volontiers, a posteriori, dans leurs mémoires ? Pourquoi répondirent-ils à cet appel des frères du roi et du prince de Condé en 1791 ? En partie parce que Coblence était alors le seul pôle d'opposition visible à la Révolution, en partie parce que la situation de cette ville, à l'étranger, permettait de rassembler les forces contre- révolutionnaires et de les structurer, mais aussi parce le Rhin traçait symboliquement une frontière nette entre la Révolution et la Contre-Révolution, une frontière qu'il était d'autant plus nécessaire de marquer qu'elle était beaucoup plus floue dans le domaine politique.
Après 1792, un exil politique ?
La campagne de 1792 représenta un triple échec pour les émigrés nobles et un véritable traumatisme : c'était d'abord une défaite militaire, c'était ensuite une défaite politique puisqu'ils n'avaient pas pu sauver le roi, c'était enfin l'effondrement de tous les rêves élaborés à Coblence concernant une régénération monarchique et nobiliaire.
La conséquence immédiate de la défaite fut la dissolution du rassemblement de Coblence et la dispersion des émigrés, jusqu'en Russie ou aux États-Unis. Menacés de la peine de mort s'ils tentaient de rentrer en France et appauvris par la confiscation de leurs biens, les émigrés subirent désormais un exil involontaire. La politique anti-émigrés mise en place par les gouvernements du Saint-Empire aggrava leur situation : les héros destinés à une croisade contre-révolutionnaire se trouvaient réduits à errer en terre étrangère, contraints à quémander un asile et voués à l'instabilité. Ils reconstituèrent de multiples colonies là où ils étaient tolérés et où ils pouvaient trouver un emploi. Les noblesses étrangères, en effet, soutinrent quelques familles, mais, dans l'ensemble, les nobles français furent abandonnés à leur sort et contraints de subvenir à leurs besoins.
L'armée des princes ayant été licenciée à l'issue de la campagne de 1792, et Condé n'étant pas en mesure d'augmenter les effectifs de son corps, des militaires cherchèrent à entrer dans les armées étrangères. D'autres émigrés nobles passèrent au service d'un souverain étranger. Mais la plupart durent innover. Certains se livrèrent à des activités manuelles (jardiniers, restaurateurs, fabrication et commercialisation d'objets à partir de fleurs artificielles...), d'autres se lancèrent dans le commerce (vin, articles de mode, etc.). D'autres encore enseignèrent le français, la musique, la danse ou le dessin. Les femmes et les enfants étaient associés à ces activités. Pourtant, l'engagement professionnel, qu'il soit militaire ou civil, fut toujours conçu comme étant temporaire. Les émigrés n'envisageaient de réaliser leurs projets à long terme qu'en France. Guidés par l'espoir du retour, ils refusaient de s'intégrer dans les sociétés d'accueil. Rares furent ceux qui apprirent la langue locale ou qui entretinrent des relations étroites avec les populations autochtones 9 ( * ) . Les nobles émigrés continuaient à se définir sous le regard français, et non sous le regard étranger. Le but restait de rentrer en France : cette attitude définit une migration de maintien 1 ( * )0 .
Que devint l'engagement politique des émigrés dans ce naufrage ? Ils prétendaient être fidèles à leur projet d'origine et s'identifiaient toujours à l'idéal coblençais. Mais la réalité était tout autre. Hormis les volontaires qui s'engagèrent dans l'expédition malheureuse de Quiberon, et malgré l'admiration des émigrés à l'égard des Vendéens, peu nombreux furent ceux qui rejoignirent la Contre-Révolution intérieure pour poursuivre le combat. À l'étranger, les émigrés avaient, pour la plupart, abandonné leur cause. Les frères du roi, « chefs légitimes » de la Contre- Révolution 1 ( * )1 , se révélèrent, en effet, incapables de remobiliser les troupes après 1792 et de restructurer le groupe des émigrés après l'expérience de Coblence. L'abandon de la cause se manifesta par deux attitudes qui se généralisèrent à partir de 1796 : certains émigrés commencèrent à rentrer en France, tandis que d'autres envisageaient de s'établir définitivement dans le pays d'accueil. Ainsi, au moment où certains parlaient de revenir en France, en 1796, un émigré pensait au contraire à s'implanter à Hambourg : « J'aime mieux gagner ma vie dans un pays étranger riche et plein de ressources ». Pour faciliter ce revirement, il renonçait à ses titres de noblesse : « Ayez donc la bonté de m'écrire sous mon seul nom [...]. Ce que nous avons été n'est plus qu'un rêve, il n'en doit rester que les principes et les sentiments honorables ». Son objectif était de se « créer une petite existence indépendante des événements ». Fatigué d'être ballotté par la contingence révolutionnaire et internationale, il prit donc sa destinée en main 1 ( * )2 . Comme l'écrit Gérard Noiriel, « le paradoxe de l'immigré n'est-il pas que plus il l'est, moins il l'est ? » 1 ( * )3 .
Quel sens donner alors aux protestations de fidélité à la cause monarchique qui fleurirent après 1796? Celles-ci relevaient de la magie incantatoire. Les émigrés protestaient de leur loyauté, tout en sachant que l'émigration était un échec. De plus, la figure de l'émigré était concurrencée en France par les Vendéens, et à l'étranger par la présence d'autres Français de toutes origines (révolutionnaires ayant fui après un revirement politique intérieur, jeunes fuyant la conscription...). L'émigré noble contre-révolutionnaire, appauvri et dépourvu de tout signe susceptible de l'identifier comme tel, n'avait plus que ses protestations de fidélité pour se distinguer. Or la distinction, par l'affirmation d'une fidélité à la cause monarchique, était essentielle pour justifier sa présence à l'étranger.
Il semble possible, à partir de 1793, de regarder l'émigration nobiliaire comme un véritable exil politique ou plutôt comme une exopolitie comme la définit Stéphane Dufoix : un espace de « fluidité politique » transfrontalier caractérisé par son opposition au régime du pays d'origine 1 ( * )4 . L'émigration contre-révolutionnaire ne constitue plus un champ politique clairement délimité comme à Coblence. Elle ne se définit plus, après 1792, que par les relations entre les acteurs et par leur opposition commune à d'autres Français, en particulier à ceux qui avaient également fui la France, mais dont les opinions politiques différaient.
Le retour
L'abandon général de la cause explique le retour massif des émigrés vers 1800-1802, au moment où Napoléon autorisa les Français à revenir dans leur pays. En rentrant, ils étaient doublement parjures : d'une part, parce qu'au début de leur émigration, ils avaient prêté serment de ne rentrer qu'avec les Bourbons ; d'autre part, parce qu'ils devaient, pour rentrer dans la France napoléonienne, jurer de n'avoir pas porté les armes contre leur patrie au cours de leur séjour à l'étranger. Ce nouveau serment signait leur soumission à Napoléon : ils rentraient en vaincus.
La réintégration dans la société française napoléonienne se fit sans heurt. La population semblait éprouver un réel désir de réconciliation et accueillit bien les anciens seigneurs. Les émigrés, pour leur part, se soucièrent d'abord de récupérer leurs biens et de marier les jeunes gens. Après 4 ou 5 ans, ils cherchèrent à se faire une place dans la nouvelle France. Le service militaire était la solution qui s'offrait d'évidence. Les anciens émigrés se retrouvaient ainsi dans les rangs de l'armée napoléonienne, luttant contre leurs anciens alliés. D'autres intégrèrent l'administration impériale. Le comte de Contades, par exemple, fut nommé, après son retour, membre du conseil général de Maine-et-Loire en 1804, et chambellan de l'Empereur en 1809. Il reçut le titre de comte d'Empire la même année et obtint la conversion de sa terre de Montjeoffroy en majorat. Ses trois fils furent placés dans l'armée ou dans l'administration napoléoniennes 1 ( * )5 . Quelques nobles retournèrent dans les pays où ils avaient émigré avec un mandant impérial. Le comte de Serre étudia ainsi le droit pendant six ans en France après son émigration, devint avocat général à Metz avant d'être nommé premier président de la cour impériale établie à Hambourg en 1811 1 ( * )6 . Les émigrés issus des grandes familles, enfin, n'hésitèrent pas longtemps à accepter les faveurs de Napoléon et se laissent attirer à sa cour. La noblesse émigrée semblait, dans son ensemble, prête à se dissoudre dans la nouvelle France et dans la noblesse d'Empire.
En 1814, la Restauration suscita un véritable désenchantement. Puisque la monarchie était restaurée, les émigrés nobles espéraient recouvrer leur ancien statut, leurs biens et les honneurs qui leur semblaient dus pour les « sacrifices » faits à la cause. De fait, certains réussirent une réadaptation exemplaire : Serre, décoré sous la première Restauration de la légion d'honneur et de la croix de Saint-Louis, est nommé premier président de la cour de Colmar en 1815, puis président du collège électoral du Haut- Rhin avant d'être élu député du même département en 1816. Président de la chambre des députés en 1816 et 1817, il fut appelé aux fonctions de garde des sceaux puis à l'ambassade de Naples, avant de s'éteindre en 1824. La situation des émigrés nobles sans fortune ni appui, cependant, fut plus rude, à cause de la réduction drastique des effectifs militaires 1 ( * )7 . Mais, avant tout, ce fut l'attitude des Bourbons qui déçut profondément leurs anciens compagnons d'émigration. Le mot d'ordre de Louis XVIII, « union et oubli », était une injonction que seul Napoléon, homme nouveau doté d'une poigne de fer, avait pu implicitement imposer. L'amnistie prononcée par Louis XVIII 1 ( * )8 et la garantie, accordée aux acquéreurs, de conserver les biens achetés pendant la Révolution eurent l'effet opposé à celui escompté : quand l'article 11 de la Charte proclamait que «toutes les recherches des opinions et des votes émis jusqu'à la restauration [étaient] interdites [et que ] le même oubli [était] commandé aux tribunaux et aux citoyens », les émigrés s'indignaient de voir un roi vieillissant refuser de condamner la Révolution, et l'accusaient d'ingratitude à leur égard.
Les anciens exilés se restructurèrent, créant une association pour la défense des intérêts des émigrés en 1821. L'objectif était d'obtenir une indemnité et une condamnation de la Révolution 1 ( * )9 . Le débat qui les opposa aux adversaires de l'émigration traduisait l'impossibilité d'oublier le traumatisme de l'émigration et de la Révolution. Chaque camp stylisa de nouveau l'émigré : dans les caricatures, il était présenté sous les traits de Monsieur Argentcourt ou de Monsieur de la Jobardière 2 ( * )0 . Pour les partisans de l'émigration, il redevint le preux se sacrifiant à la cause, tel qu'il avait été imaginé à Coblence. La monarchie restaurée, qui avait essayé d'éviter, par une amnistie, la revanche des vainqueurs, se trouvait impuissante à réduire chaque parti au silence. Elle avait même réveillé le conflit que l'octroi d'une indemnité, le fameux « Milliard des émigrés », ne parvint pas à étouffer.
Le drame des émigrés, fondamentalement, tenait à leur incapacité à réintégrer la société post-révolutionnaire. Ceci apparaît clairement dans les mémoires rédigés après le retour en France et publiés de manière posthume. Dans ces ouvrages, les mémorialistes évoquaient un exil définitif, celui de la terre de leur enfance. La Restauration ne signa pas le rétablissement du monde de leur enfance ou de leur jeunesse, elle n'en fut qu'une imitation de mauvais goût, « cet écueil des âmes faibles » 2 ( * )1 : « Maintenant, un traînard dans ce monde a non-seulement vu mourir les hommes, mais il a vu mourir les idées : principes, moeurs, goûts, plaisirs, peines, sentiments, rien ne ressemble à ce qu'il a connu. Il est d'une race différente de l'espèce humaine au milieu de laquelle il achève ses jours. Et pourtant, France du dix-neuvième siècle, apprenez à estimer cette vieille France qui vous valait. » 2 ( * )2
Chateaubriand est l'un de ceux qui manièrent avec le plus de talent la thématique de l'exil, déployée du berceau à la tombe : « En sortant du sein de ma mère, je subis mon premier exil ; on me relégua à Plancouët » 2 ( * )3 . Lorsque la famille quitta sa ville natale pour rejoindre le père au château de Combourg, il effectua les « premiers pas d'un Juif errant qui ne se devait plus arrêter.» 2 ( * )4 En 1812, il reçut l'ordre de s'éloigner de Paris et se rendit à Dieppe : « c'était me réfugier auprès de ma jeunesse [...] ; de la table où j'étais assis, je contemplais cette mer qui m'a vu naître, et qui baigne les côtes de la Grande-Bretagne, où j'ai subi un si long exil : mes regards parcouraient les vagues qui me portèrent en Amérique, me rejetèrent en Europe et me reportèrent aux rivages de l'Afrique et de l'Asie. Salut, ô mer, mon berceau et mon image ! » 2 ( * )5 . Exil, donc, le voyage en Amérique, l'émigration en Allemagne et en Angleterre, les ambassades de Londres, de Rome et de Berlin, dans un « redoublement de l'histoire individuelle et de l'histoire collective » 2 ( * )6 , mais aussi dans un redoublement de l'écriture de l'exil et de l'écriture en exil. Le souvenir des exils antérieurs se voyait revivifié par l'exil intérieur, constitutif de l'acte scriptural.
L'émigration noble contre-révolutionnaire illustre ainsi un double phénomène : celui d'une émigration politique dans un premier temps, qui correspond à un départ volontaire dont le but est de lutter contre le régime mis en place dans le pays d'origine; celui d'un exil politique après 1792, lorsque les émigrés se trouvent bannis de leur pays et naviguent entre l'affirmation d'une fidélité au projet d'origine et l'abandon de leur cause. Enfin, l'exemple de l'émigration montre que le retour dans le pays d'origine ne signifie pas toujours réintégration dans la société d'origine.
Cette expérience, qui est probablement la première manifestation collective d'un exil politique, révèle que l'émigration est un processus, un phénomène qui ne se stabilise jamais, fait de conflits, d'adaptation à la contingence, de réévaluation des catégories et de redéfinition de soi-même.
Michel WINOCK
Le deuxième grand moment de l'exil se déroule au coeur du XIX e siècle, à partir de la Révolution de février 1848.
La monarchie constitutionnelle, restaurée en 1814-1815, acquise plus ou moins au régime des libertés, n'a pas été une grande période d'exil. Le principal exilé fut le roi Charles X, chassé de France par la révolution de 1830. Ses partisans eurent la ressource de l'exil intérieur, préférant souvent quitter Paris pour n'avoir pas de complicité avec la monarchie de Juillet. Comme le dit un personnage de Balzac, dans Le Cabinet des Antiques : « Les Gaulois triomphent ! » Les Gaulois, c'est-à-dire le peuple, la démocratie.
C'est la révolution de février 1848, suivie, comme la Grande révolution, d'une série de conflits opposant socialistes et républicains modérés, républicains et monarchistes, finalement républicains et bonapartistes, qui entame un nouveau cycle dans l'histoire de l'exil. La journée du 15 mai 1848, l'insurrection ouvrière de Juin, l'émeute du 13 juin 1849, voient le déchirement de la révolution en elle-même, suivi de répression. La République naissante ne serait pas socialiste, certains comme Auguste Blanqui ou Armand Barbes durent le payer de la prison, des centaines d'autres, comme Louis Blanc ou Ledru-Rollin, de l'exil, avec des centaines de leurs partisans, ceux qui avaient échappé aux tribunaux.
Plus de trois ans plus tard, le coup d'État réussi par le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte entraînait à son tour une nouvelle vague de réfractaires hors de France. Victor Hugo en a été le symbole mémorable, refusant l'amnistie de 1859, et ne rentrant en France qu'à la nouvelle de la chute de Napoléon III, au début de septembre 1870. Comme l'émigration des contre-révolutionnaires, l'exil d'Hugo et des républicains devient un combat. Par ses discours, ses poèmes et ses livres, Hugo portera jusqu'au bout le drapeau du refus. Il n'était pas le seul proscrit, 70 députés républicains l'étaient en même temps que lui, dont Schoelcher, Raspail, Martin Nadaud, Agricol Perdiguier, Pierre Leroux, Edgar Quinet, dont les noms s'ajoutaient aux exilés de 1848.
1848 avait été pour les réfugiés politiques de tous les pays une grande espérance : n'allaient-ils pas pouvoir rentrer dans leur pays ? C'est ce dont va nous parler Mme Sylvie Aprile, maître de conférences en histoire à l'Université de Tours.
Exil et Printemps des peuples
Sylvie APRILE
Les mouvements révolutionnaires qui embrasent l'Europe entre 1848-1849 ont été un échec, mais cet ébranlement avant de conduire en exil Hongrois, Allemands, Italiens et Polonais a nourri un immense espoir qui s'est traduit pour le retour de nombreux exilés vers leur patrie.
Pour ces bannis, il faut revenir en arrière car cet exil s'inscrit dans une période longue, des années 1830 aux années 1860 : la dernière insurrection polonaise qui a lieu en 1863-64 fait arriver en Suisse de façon plus ou moins durable plus de 2000 fugitifs polonais.
Ces exilés sont alors des étudiants, des intellectuels, des militaires poursuivis pour leurs idées, appartenant aussi pour l'Europe centrale et l'Allemagne à une moyenne bourgeoisie intellectuelle sans perspectives d'avenir, de plus dans un climat de crise économique à la fin des années 40. Paris est alors la capitale des exilés et comme le dit le journaliste révolutionnaire russe Alexandre Herzen, « l'émigration est le premier indice d'une révolution qui se prépare » .
Les grands intellectuels français ont tous à coeur de défendre les « soeurs de la France » qui n'ont pas encore d'existence : l'Italie morcelée, la Pologne démantelée. Le premier grand discours de Victor Hugo à la Chambre des pairs, le 19 mars 1846 est en l'honneur du 23 e anniversaire de la révolution polonaise.
Parmi les grandes figures de l'exil d'alors, il faut citer le poète Adam Mickiewicz qui passe la plus grande partie de sa vie en dehors de la Pologne. À l'âge de vingt-cinq ans, il est d'abord mis en prison par les autorités tsaristes et ensuite mis en résidence surveillée en Russie Centrale pour cinq ans. IL fait la connaissance et se lie d'amitié avec des écrivains russes, Pouchkine en tête. En 1829 il suit les cours de Hegel à Berlin, rend visite à Goethe à Weimar, enfin en 1832 s'établit à Paris où il occupe de 1840 à 1844 la chaire de littératures slaves. Il y enseigne aux côtés de Quinet et Michelet. Ce nomadisme forcé nourrit un cosmopolitisme qui enrichit la réflexion des intellectuels tant sur l'idée de nation que sur celle de l'Europe. Lors du printemps des Peuples, il organise une légion polonaise et rentre dans son pays. Les espoirs nationalistes et libéraux sont de courte durée. Mickiewicz, le polonais, Kossuth le Hongrois, Mazzini l'italien et tant d'autres célèbres et anonymes prennent le chemin de l'exil. Leur nombre est difficile à établir : pour l'Allemagne, on compte sur les 728 300 émigrants de l'après 48, près de 15 000 intellectuels exilés dont 5 000 se réfugient aux États-Unis.
Paris n'est plus alors la capitale de l'exil, la France impériale n'est guère accueillante, elle a elle-même banni les anciens représentants du peuple, et contraint à l'exil volontaire tous ceux qui ne veulent pas prêter serment à l'Empereur. Les exilés choisissent surtout Londres, l'Angleterre a une politique très libérale à l'égard des étrangers, qu'elle ne surveille guère et n'expulse pas... Sa seule pression est de les inviter à bénéficier d'un passeport gratuit pour l'Amérique. Ailleurs la situation reste souvent précaire, les exilés n'ont aucun statut juridique, ils bénéficient de l'hospitalité plus ou moins grande des États qui les reçoivent.
Le sort de tous ces proscrits est fort divers et il est difficile d'esquisser une typologie d'autant que l'exil a des durées contrastées. Si l'exil de Victor Hugo couvre une longue période de sa vie, Kossuth meurt en exil à Turin en 1894, après 45 années d'exil. On peut cependant esquisser une palette des engagements marquée par une grande diversité et une intensité variable. Au degré inférieur, il faut faire la part du désengagement. Bon nombre de militants se confondent avec les migrants économiques, pour d'autres le désengagement est synonyme de désenchantement. Le nombre de suicides, déguisés ou non, traduit le traumatisme de l'échec et l'absence d'espoir. Le carré des proscrits au cimetière de Jersey en est un poignant témoignage. Beaucoup refont leur vie : c'est le cas notamment des quarante-huitards allemands qui deviennent fermiers ou qui exercent des professions libérales ou commerçantes aux États-Unis. Ils participent à la construction de l'esprit civique américain et militent dans les rangs anti-esclavagistes. Ils jouent notamment un rôle important dans la guerre de Sécession au plan politique et militaire.. On trouve aussi parmi eux des femmes qui après l'échec des combats en Europe poursuivent leur action dans le féminisme naissant.
Ceux qui restent en Europe méditent l'échec de 1848 de diverses manières. Les infatigables conspirateurs et comploteurs ne renoncent pas à l'action clandestine plus ou moins violente. C'est d'Angleterre qu'est organisé l'attentat contre Napoléon III, dont le principal ordonnateur Orsini est un militant de la cause de l'unité italienne. Mazzini et Garibaldi préparent de nombreuses séditions dont l'expédition des Mille en 1860. Si Victor Hugo condamne tous les projets de tyrannicide, il soutient de sa plume les soulèvements italiens, polonais et irlandais. Il a participé à cette fraternité de la proscription à Jersey, où se sont trouvés réunis des exilés de tous les pays d'Europe, publiant leurs ouvrages à l'imprimerie universelle, méditant sur leur passé et prophétisant leur avenir dans les colonnes du journal L'homme, dont le sous titre était journal de la démocratie universelle. Les anniversaires de la révolution de février 1848 en France et celui de la révolution polonaise sont chaque année dans toutes les villes qui accueillent des proscrits, l'occasion de banquets et de déclarations fraternelles.
D'autres quarante-huitards ne croient plus à la révolution du moins à la façon dont elle a pu être pensée et menée jusqu'à l'échec du Printemps des peuples et s'exaspèrent des divisions politiques qu'il a engendré. Karl Marx s'enferme à la British Library pour écrire le Capital, et ne sort de son isolement que pour prôner une nouvelle forme d'action sociale et politique, non plus nationale mais internationale concrétisée en 1864 à Saint Martin's hall par la création de l'Association Internationale des Travailleurs. Alexandre Herzen lui aussi déçu par la révolution européenne de 1848, prône dans son journal L'étoile polaire, une nouvelle organisation de la société basée sur la communauté villageoise et qui prend ses racines dans la tradition russe. Reste la question essentielle mais complexe : celle de l'impact de ces exilés dans la construction nationale et démocratique, qui constitue une marche souvent lente et heurtée vers la mise en oeuvre d'un idéal. Leur souvenir parle déjà en leur faveur.
Michel WINOCK
La troisième grande vague de l'exil, après celle de la Révolution et celle du coup d'État, fut lancée par la défaite de la Commune de Paris en 1871. Outre les 20 000 morts au combat, le plus souvent fusillés par l'armée versaillaise, outre les milliers de déportés ou transportés en Nouvelle-Calédonie (environ 4 700), ce furent plus de 3 000 communards, échappant à leurs vainqueurs, qui purent trouver un abri en Suisse, en Angleterre, principalement. Là, jusqu'à l'amnistie de 1880, ils ont survécu de leur mieux, ils se sont combattus, n'ayant pas les mêmes idées sur la République ou le socialisme, jusqu'au moment où ils ont pu redevenir les citoyens actifs de la III e République.
Je laisse Mme Virginie Buisson, écrivain, le soin d'évoquer pour nous l'exil des déportés de la Commune.
La Commune ou l'expérience de la déportation
Virginie BUISSON
Pendant la Semaine sanglante, il y a eu à Paris 400 000 lettres de dénonciation. Cette attitude présage de ce qu'il allait arriver au moment de la Seconde guerre mondiale. Cette dénonciation est considérable car un tiers des habitants de Paris étaient en train de dénoncer leurs compatriotes. L'exil commence par la dénonciation. Cette dénonciation signifie que les Communards n'appartiennent plus au corps social. Ils sont proscrits.
46 000 personnes ont été raflées. Or, en étant raflé, l'individu perd son identité et devient sans feu ni lieu. « Sommés de s'agenouiller devant les église, piqués par les soldats, ils ont parfois été attachés à la queue d'un cheval. Parfois fusillés sur place. » Les prisons de Versailles deviennent un véritable cloaque. La population des environs ne supporte pas cette situation et demande l'élargissement des prisonniers. On décide alors d'évacuer les prisonniers sur les forts et les pontons de la rade atlantique, de la Gironde jusqu'à Brest. Ces prisonniers seront évacués en wagons cellulaires. Lors de ces transports de masse, il y eut des morts et comme l'écrit Lissagaray " la folie s'empara de plusieurs d'entre nous ".
L'histoire commence le 31 mai 1871. Les premiers wagons cellulaires arrivent en gare de Brest par wagon de 1 200 personnes. Jour après jour, les prisonniers sont acheminés sur les forts et sur les pontons. Les pontons sont des bateaux que l'on désarmait et mouillait en rade. Les personnes incarcérées vont attendre de revenir à Paris, de nouveau reconduites en wagon cellulaire, pour être jugées.
25 000 personnes sont raflées. Parmi elles, on ne compte pas uniquement des Communards car, dans les rafles, on ne fait pas de distinctions. On prend souvent ceux qui ont les cheveux gris parce que l'on pense que ces derniers ont participé à la révolution de 1848. On rafle aussi les femmes. On rafle également les petits Savoyards qui, pleins de suie, sont accusés d'avoir participé à l'incendie de l'Hôtel de Ville. Lors de ces rafles, les identités des individus arrêtés ne sont pas vérifiées.
À l'issue des jugements, 5 600 personnes seront condamnées à la déportation en Nouvelle-Calédonie. La France souhaite créer une colonie de peuplement, le climat guyanais n'est pas très sain, les prisonniers sont donc envoyés en Nouvelle- Calédonie. De plus, la France pense que le sous-sol calédonien recèle des richesses minières. Cette colonie apparaît donc comme une terre propice au peuplement. Une émigration de droit commun de 40 000 bagnards vient s'ajouter à ce mouvement, ces derniers étant transportés en Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1897. Des bateaux vont être aménagés pour assurer le transport de ces condamnés. Des cages vont être construites dans lesquelles seront entassées 80 personnes. Les bateaux transporteront ainsi entre 400 et 600 prisonniers par voyage. La route maritime suivie par ces bateaux ira de Brest à Saint-Martin-de-Ré, de Saint-Martin-de-Ré à Gorée, de Gorée à Sainte-Catherine au Brésil, du Brésil à l'Afrique du Sud en passant par la Tasmanie, le détroit de Basse et à Nouméa.
Tous les prisonniers ne sont pas condamnés aux mêmes peines. Il y a des déportés simples, des déportés en enceinte fortifiée et ceux qui seront internés au bagne avec les prisonniers de droit commun. Les déportés simples sont les plus nombreux. Ils sont au nombre de 3 000, ils seront déportés sur l'Île des Pins. Les Japonais qui se rendent aujourd'hui à l'Île des Pins pour célébrer leur voyage de noces disent que c'est l'île la plus proche du paradis. Il est vrai que cette île est de toute beauté. Cependant, pour les déportés qui arrivent, c'est surtout l'île de l'exil infini. C'est « l'île de la mort lente. C'est l'île de l'assassinat en détail ». Rien n'est préparé pour l'arrivée des déportés. Ils doivent construire eux-mêmes leurs cases ou leurs paillotes. Ils n'ont pas d'outils.
Peu à peu ils vont réussir à s'organiser. La privation la plus violente qu'ils vont subir est celle de la confiscation de leur correspondance. Cette privation va être ressentie des deux côtés du monde. C'est le cas en Nouvelle-Calédonie, où les prisonniers sont relégués en attente d'un retour et d'une amnistie. C'est le cas pour les familles en métropole qui restent sans nouvelles des leurs.
Aux archives d'Outre-mer, j'ai trouvé quelques lettres disant ceci "S'il y a une personne à qui il faut demander, c'est à Victor Hugo". D'autres ne savent pas à qui s'adresser. Sur les 3 000 personnes déportées, 300 vont mourir sur l'île des Pins, mourir de désespoir, mourir du sentiment d'abandon. Il y aura de nombreux suicides. Ils écrivent "La maladie de se pendre se répand sur l'île des Pins ".
Les prisonniers condamnés en enceinte fortifiée sont envoyés au nord de Nouméa, à Ducos. Il ne faut pas imaginer que l'enceinte fortifiée est un château féodal avec des douves. Les fortifications, ce sont le lagon et les requins. Ce sont eux qui empêchent les évasions. Évidemment, il y a des sentinelles mais les surveillants ne sont pas choisis parmi les personnes les plus honorables. L'alcool est largement consommé et les surveillants tirent sans discernement ni raison.
Parallèlement, une émigration économique a lieu. Le ministère de la Marine et des Colonies engage des Bretons, en particulier, à émigrer en Nouvelle-Calédonie. Les femmes et les orphelines sont particulièrement encouragées à suivre ce mouvement. On sort les femmes des maisons centrales pour leur proposer de se rendre en Nouvelle-Calédonie et d'épouser des bagnards libérés.
La condition des proscrits de droit commun est un déni du droit, les traitements y sont impitoyables. Ceux qui ont été condamnés à la relégation en Nouvelle- Calédonie ne sont pas tous de grands criminels. On y envoyait des vagabonds, des libres-penseurs, des personnes en rupture de ban.
Le premier bateau des proscrits de la Commune, s'appelle la Danaé, il rejoint Nouméa en septembre 1872. Les déportés ignorent la durée de leur peine. Ils attendent et ils espèrent. Les premiers retours se feront en 1876. Leur amnistie sera due à Victor Hugo grâce à la loi de juillet 1880.
L'exil a été durement ressenti, en particulier lorsque les familles restées en France n'ont aucune nouvelle. On peut retrouver de nombreuses lettres disant en substance ceci "Pouvez-vous me dire, Monsieur le Gouverneur, si mon fils est mort ou existant ?". Nous pouvons trouver des centaines de lettres de ce type. De Nouvelle- Calédonie, partent aussi des lettres qui n'arrivent pas forcément à destination. "Dites-moi si ma femme est toujours domestique là-bas", "Dites-moi si mon fils est encore existant, peut-il venir ?". Toujours dans cette volonté de peuplement, l'État va autoriser les familles à rejoindre les proscrits. Ces familles seront au nombre de 284. Ce sont des femmes et des enfants à qui l'on donne un trousseau et à qui l'on promet 6 hectares de terre comme on va le promettre aux immigrants libres.
Or ce ne sont pas des terres qui les attendent à l'issue d'un si long voyage. Ce sera quelque chose de l'ordre de l'abattement et de la désespérance. Certains vont accepter de travailler dans les mines. Ces derniers vont se rendre de mine en mine à l'instar de la ruée vers l'or du Far West. Cependant, ce ne sont pas ici des mines d'or mais des mines de nickel et de cobalt. 300 Communards vont alors rejoindre la Grande-Terre de Nouvelle-Calédonie pour travailler dans les mines. Certains d'entre eux vont avoir droit à des concessions. Ils vont épouser des émigrantes et vont faire souche. Sur les 3 800, seuls 24Communards vont rester.
22 convois maritimes ont transporté les Communards en Nouvelle-Calédonie. Autant de bateaux les rapatrieront. Les retours se feront lentement. Avant que ne soit prononcée l'amnistie, il y aura des commutations de peines. Cependant, certains ne veulent pas des commutations car la commutation signifie la prison. Or, être en prison en métropole, c'est ne plus être libre de circuler. Dans l'île des Pins, les prisonniers pouvaient éditer des journaux, travailler dans les familles. Parmi les Communards déportés, il y avait des imprimeurs, des ouvriers du bois, des tapissiers, des écrivains. Certains sont devenus alors des « garçons de famille ». Ils sont devenus écrivains publics dans les familles ou dans les administrations. Cependant, l'arbitraire demeurait au gré du changement des gouverneurs. Par ailleurs, ces jugements arbitraires se sont multipliés au moment de l'évasion de Rochefort. À ce moment-là, la répression est devenue plus féroce. Le retour n'a pas signifié la fin de l'exil. L'exil avait commencé au moment de la l'exclusion de son lieu de vie, au moment de la séparation.
Les lettres des familles mettaient entre trois et six mois avant d'arriver. Les voyages duraient 155 jours. On ne sait en définitive jamais si les lettres vont réellement arriver. Au moment du retour, si le déporté a eu la chance que l'amour ait résisté à 1' éloignement, les proches attendent dans les gares. Pour les plus nombreux, ce qui les attend, c'est la soupe populaire et l'entraide dans le meilleur des cas. Pour certains, le retour n'est qu'un autre exil dans son pays : un exil intérieur. Pour d'autres, c'est le suicide. Cette histoire sera transmise à la génération suivante. Il sera dit et raconté dans les familles que ce retour au pays est dû à Victor Hugo. Ce dernier deviendra alors une figure tutélaire sacrée.
Michel WINOCK
Victor Hugo a appris la défaite de Sedan, la défaite de Napoléon III, à Bruxelles, et il s'est alors empressé de regagner Paris. Il rentre donc en France dans les premiers jours de septembre et il restera dans la capitale pendant toute la durée du Siège, à la fin du mois de janvier 1871. Ce n'est que quelques semaines plus tard, le 18 mars 1871, qu'éclate l'insurrection de la Commune de Paris. Robert Tombs, professeur à Cambridge, va nous parler de Victor Hugo au cours de ces semaines dramatiques.
Les déchirures de la société française à la fin du XIX e siècle
Robert TOMBS
Le XIX e siècle, le siècle de Victor Hugo, était profondément marqué par l'exil politique. Politique dans le sens classique, et non pas exil religieux, comme au XVIII e siècle, ou exil ethnique, comme au XX e . En commençant par les émigrés qui fuyaient la Révolution française, en passant par les nationalistes polonais, hongrois, allemands et italiens de la période romantique, les démocrates russes, les socialistes prussiens et français, pour terminer avec les anarchistes français, italiens et espagnols, et aussi (à l'autre extrémité de l'échiquier politique) les religieux français de l'époque de Combes, le XIX e siècle est peuplé par des dizaines de milliers de femmes et d'hommes qui refusaient, ou qui ne pouvaient, pour des raisons politiques, vivre librement dans leur pays d'origine. L'héritage - ou les héritages - de la Révolution française, c'est-à-dire la démocratie et le nationalisme, engendraient un siècle de luttes politiques qui n'étaient plus l'occupation exclusive des élites frondeuses, mais des masses. Par conséquent, les exilés n'étaient plus seulement des princes et des philosophes, mais aussi des institutrices, des employés de commerce, des journalistes, des cordonniers, des médecins et des blanchisseuses.
La France de Victor Hugo occupait une position unique au milieu de ce tourbillon d'exilés : elle était à la fois créatrice et protectrice d'exilés ; une terre que certains fuyaient et où d'autres cherchaient asile. Ce n'est pas une contradiction ; ou si l'on préfère, c'est une contradiction facile à élucider. Car la France après la Révolution essayait de créer une nouvelle société, soit démocratique, soit monarchique, mais de toute façon unie. Pour le faire, il fallait, si nécessaire, se débarrasser de ceux qui rechignaient, qu'on les appelle émigrés, exilés, déportés, relégués, ou même fusillés. Mais en même temps, cette vision révolutionnaire d'une société nouvelle attirait les assoiffés de progrès, qui voyaient la France comme phare, laboratoire, protecteur et champion des faibles ; et la France, qui allait demeurer pour une grande part du siècle, parmi les quelques pays libéraux de l'Europe, les accueillait, et même les honorait.
Victor Hugo était non seulement l'un des porte-parole les plus éloquents de cette vision révolutionnaire et patriotique de la société nouvelle, mais aussi l'un des plus célèbres parmi le petit nombre de ceux qui, comme Mickiewicz, Marx ou Mazzini, incarnaient, dans leur propre vie, le geste de l'exil politique qui n'était pas seulement une fuite, mais aussi une protestation politique et morale : « Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là ! »
Hugo croyait, d'une façon mi-mystique et mi-scientifique, que l'univers entier cheminait vers un avenir meilleur: l'obscurité céderait finalement la place à la lumière, l'ignorance, à la science, l'oppression à la démocratie, la haine à l'amour. Et la France, et surtout Paris (sans oublier ses poètes, ces guides du peuple) montraient ce chemin à l'humanité entière. Même les déchirements politiques, même les égarements, ne pouvaient qu'aider ce qui étaient inévitable : « Tout travaille à tout » 2 ( * )7 . Même les plus « abjects » pouvaient servir au progrès : « Les révolutions ont le bras terrible et la main heureuse. » 2 ( * )8
Cela ne veut pas dire qu'Hugo approuvait tout acte de révolte. Il craignait, et il était même dégoûté, par la violence populaire de juin 1848, liée pour lui à l'ignorance et à l'immoralité, et qui représentait la nuit contre la lumière, la barbarie contre la civilisation, à laquelle il fallait résister même en employant des moyens aussi barbares. Mais en même temps, l'ignorance servait d'excuse pour cet égarement populaire. La férocité du pouvoir, au contraire, ne pouvait bénéficier de cette circonstance atténuante. Comme dans le cas de Jean Valjean, ce symbole de l'homme du peuple brutalisé et puis sauvé, un acte de clémence pouvait guérir ce que la répression perpétuelle ne ferait que gangrener. Il fallait tendre la main au vaincu.
Donc Hugo, exilé lui-même après le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, et plus tard protecteur des exilés, tendait la main à ceux dont il condamnait les actes. Car à l'époque de la Commune de 1871, aussi bien qu'en juin 1848, il désapprouvait la révolte et les actes des insurgés. Les Communards, à l'instar des insurgés de juin (et il s'agissait parfois des mêmes individus) menaçaient la France, la République, la démocratie et la civilisation - toutes les valeurs les plus chères à Hugo. Il croyait même qu'il fallait les vaincre. Mais du jour au lendemain, il est devenu leur défenseur le plus illustre, et, peut-être, le plus intrépide.
Une raison certainement fut la férocité de la répression. Pour la plupart des conservateurs et même des centristes en France, l'attitude qu'il fallait adopter vis-à-vis des Jean Valjean, était celle de Javert : il fallait traquer et détruire les ennemis de la société. Dans plusieurs grands pays, le XIX e siècle a été un siècle d'élimination, par l'exil, par l'émigration, par la déportation, et même par les massacres. C'était l'aspect sinistre des sociétés qui cherchaient l'harmonie et l'équilibre ; et dont l'aspect positif, si l'on veut, a été l'éducation de masse et l'inclusion démocratique. Ceux qu'on ne pouvait pas inclure, il fallait, par un moyen ou un autre, les exclure.
Pour beaucoup de Français - même, pour une courte période, peut-être la majorité - la Commune de 1871 a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ; le moment où il fallait en finir avec l'esprit de révolte. La Commune pour eux a été un crime contre la patrie, contre la volonté nationale, et contre la civilisation dont Paris était le centre. Les coupables - qui avaient enclenché la guerre civile en présence de l'ennemi, brûlé Paris et fusillé des otages - méritaient les châtiments les plus sévères : la mort, la déportation, au moins l'exil. Ainsi, la France retrouverait l'équilibre, et, comme l'avait espéré Jules de Goncourt, la prochaine révolution serait retardée au moins d'une génération.
Tous les Français d'aujourd'hui connaissent grosso modo les terribles conséquences de cette attitude. Des milliers de Parisiens ont été tués dans les combats ou fusillés dans les quelques jours de la Semaine sanglante. Des dizaines de milliers ont été faits prisonniers sur le coup ou arrêtés par la police pendant une répression légale qui a duré pendant des années. Plusieurs milliers ont été condamnés à la déportation en Nouvelle Calédonie, et des milliers encore ont dû se réfugier en Angleterre, en Suisse et ailleurs, pour vivre comme ils pouvaient. Des dizaines de milliers de familles ont été ainsi détruites, une foule d'enfants abandonnés. Tout cela n'a pas été fait au hasard. L'armée et la police ciblaient ceux qu'elles considéraient les plus coupables : les hommes politiques, les chefs militaires, les journalistes, les étrangers, les combattants, les criminels, les buveurs, les prostituées. Tous ceux que les conservateurs de l'époque considéraient comme les éléments les plus actifs de la classe dangereuse qui faisaient les révolutions, qu'ils considéraient comme des orgies de pillage, d'ivresse et de sexualité déchaînée.
Hugo aussi - comme la plupart des Français - a trouvé la Commune déplorable. IL était dans cette attitude assez typique des républicains modérés (mais non modérément républicains) qui allaient bientôt créer la Troisième République. Et il l'a dit sans ménagement dans cette série de poèmes écrits sur le vif, L 'Année Terrible, où il parle, par exemple, de la « torche misérable, abjecte, aveugle, ingrate ! » qui a incendié Paris. Cependant, du jour au lendemain il a demandé la clémence pour les Communards, et il proposait presque immédiatement l'amnistie. Pour ce fait, il s'est fait expulser de Belgique (après que la maison qu'il occupait fut lapidée par une foule). Pourquoi cette action en faveur de ceux dont il déplorait les actes ? Il y a plusieurs raisons. Il connaissait certains Communards prisonniers (parmi eux Louise 2 ( * )9 Michel, avec qui il semble avoir eu une brève aventure, et le célèbre journaliste Henri Rochefort), et il est intervenu en leur faveur auprès du gouvernement. Cependant, il faisait des efforts non seulement pour quelques Communards, mais pour tous les Communards. Comme dans le passé, il croyait que le peuple, même quand il était coupable d'actes atroces, était moins condamnable à cause de ses souffrances et son ignorance, et parce qu'il portait le poids d'une longue oppression :
« La bête fauve sort de la bête de somme »
« J'accuse la Misère ; et je traîne à la barre
Cet aveugle, ce sourd, ce bandit, ce barbare
Le Passé [...]
Dans les lois, dans les moeurs, dans les haines, dans
tout. » 3 ( * )0
Il s'expliquait l'affreuse guerre civile non pas par la sauvagerie innée de la classe dangereuse, mais par la corruption, l'égoïsme et la lâcheté des gouvernements et des généraux de l'Empire, qui avait perdu ou même vendu la France ; ainsi, la révolte de la Commune, même illicite, était compréhensible comme une explosion de colère. Et finalement, il a été horrifié par les excès de la réaction versaillaise. Il l'a considérée à la fois comme injuste, car les insurgés n'étaient pas les plus coupables des Français (« C'est Monsieur Bazaine qui a livré Metz et on va fusiller Rossel » 3 ( * )1 ), et aussi comme un débordement de la violence pire que les crimes des Communards - « Férocité des deux côtés ». 3 ( * )2
Cette férocité réciproque est devenue pour lui un seul crime partagé, qu'il dénonce dans les vers puissants du poème Talion :
« Quoi ! parce que Ferré, parce que Galliffet
Versent le sang, je dois, moi, commettre un forfait !
On brûle un pont, je brûle une bibliothèque.
On tue un colonel, je tue un archevêque ;
On tue un archevêque, eh bien, moi, je tuerai
N'importe qui, le plus de gens que je pourrai. » 3 ( * )3
La seule façon de terminer cette violence pour Hugo, c'était le pardon et l'oubli, et Hugo a été probablement le premier qui l'ait dit à haute voix, quand les ruines de Paris fumaient encore. IL le répétait sans cesse de son propre exil temporaire et volontaire en Belgique, au Luxembourg et en Angleterre, et pendant toute la décennie de la campagne pour l'amnistie, dont il était un des plus grands inspirateurs. Il a écrit: « Je défends les vaincus. J'ai défendu la Commune vaincue contre l'Assemblée Nationale. Si la chance avait été pour l'Hôtel de Ville de Paris...J'eusse défendu l'Assemblée contre la Commune. » Pour Hugo, aucun être humain n'était tout à fait perdu. Le pardon et la rédemption n'étaient jamais exclus.
Quelles conclusions pouvons-nous tirer en lisant Hugo sur l'exil ? D'abord, la constatation qu'il sortait d'une culture plus innocente que la nôtre. Il pouvait croire que l'univers marchait inévitablement vers la lumière ; que les révoltes étaient toujours l'acte des peuples contre les princes ; que les révolutions étaient toujours, en fin de compte, globalement positives ; que tous les crimes pouvaient être pardonnés ; qu'on pouvait trouver la réconciliation des luttes intestines en déclarant une sorte d'équivalence morale entre les deux cités.
Nous pouvons lui envier ces certitudes ; il est impossible, après l'expérience du siècle européen qui a suivi sa mort, de les partager. Pour nous, il y a des crimes impardonnables, légalement et moralement. Quelle voix humanitaire de nos jours, en faisant écho à Hugo en 1871, dirait avec la même certitude tranquille : « J'ai défendu la Gauche contre Pinochet ; maintenant je défends Pinochet contre la Gauche » ? Est- ce que cela signifie que la générosité d'esprit d'Hugo n'est qu'illusion, et même fatuité ? Pas tout à fait, il me semble. Hugo nous offre au moins deux défis. D'abord, qu'il ne faut pas simplement défendre les droits de ceux que l'on aime, mais aussi de ceux que l'on déteste : les droits de l'Homme n'ont pas de côté politique. Après, que l'on ne doit pas choisir entre les maux : si les deux côtés d'une lutte politique sont coupables de crimes, il faut dénoncer les deux. Au coeur de l'attitude d'Hugo est un sentiment humain qui transcende les principes et les idées : je termine en le citant : 3 ( * )4
Quoi ! cet homme n'est pas aux vengeances fougueux !
Il n'a point de colère et de haine, ce gueux !
Oui, l'accusation, je le confesse, est vraie.
Je voudrais dans le blé ne sarcler que l'ivraie ;
Je préfère à la foudre un rayon dans le ciel ;
Pour moi la plaie est mal guérie avec du fiel ; [...]
Pour moi la charité vaut toutes les vertus ;
Ceux que puissants on blesse, on les panse abattus ; [...]
Je tâche de comprendre afin de pardonner ;
Je veux qu'on examine avant d'exterminer.
Michel WINOCK
Nous allons achever ce tour d'horizon par une dernière intervention. On sait que Victor Hugo a été un des grands champions de l'idée européenne, ce qu'il appelait les États-Unis d'Europe. Dès lors, on peut se poser la question des rapports entre l'exil et l'élaboration d'une conscience européenne. Je donne la parole à Frank Laurent, maître de conférences à l'Université du Mans.
L'exil comme épreuve fondatrice d'une conscience européenne
Franck LAURENT
Qu'a fait cet homme pendant ces longues années ? Il a essayé de ne pas être inutile. La seule belle chose de cette absence, c'est que lui, misérable, les misères sont venues le trouver ; les naufrages ont demandé secours à ce naufragé. Non seulement les individus, mais les peuples...
(Victor Hugo, « Ce que c'est que l'exil »,
préface
d'Actes et paroles - II ; pendant l'exil)
L' « européanisme » de Victor Hugo ne date pas de l'exil. Pour s'en tenir à quelques repères, on peut rappeler qu'en 1842 il avait dans la conclusion d'un récit de voyage au Rhin exposé un programme géopolitique qui en appelait à l'union libérale de l'Europe, autour d'une France et d'une Allemagne alliées, enfin réconciliées après les déchirements hérités des guerres napoléoniennes et des traités de 1815 3 ( * )5 . En 1843, il pouvait présenter ses oeuvres complètes sous la forme d'un tableau à deux entrées : d'un côté la série des siècles du XIII e au XIX e , de l'autre la série des pays européens, France, Italie, Angleterre, etc., - tant sa production romanesque et surtout dramatique avait montré l'intérêt au moins littéraire qu'il portait à l'histoire des différentes nations de l'Europe 3 ( * )6 . Pendant la Seconde République, il avait suivi comme tout le monde certains développements du mouvement révolutionnaire en Europe, notamment les avatars de la révolution hongroise et des diverses révolutions italiennes, surtout à Rome 3 ( * )7 . En 1849, il avait présidé à Paris le Congrès de la paix, qui rassemblait des personnalités venues du monde entier pour inciter les gouvernements au rapprochement et au désarmement général 3 ( * )8 . Enfin, lors de son dernier discours à l'Assemblée législative, le 17 juillet 1851, de toutes ses interventions parlementaires la plus violemment disputée et interrompue, il ne lança pas seulement, pour la première fois, la fameuse formule « Napoléon-le Petit » 3 ( * )9 , mais aussi celle, non moins fameuse, des « États-Unis d'Europe » 4 ( * )0 .
Pourtant c'est avec l'exil que Hugo se constitue en « conscience universelle », en référence active pour tout ce mouvement d'internationalisme démocratique et républicain, hérité du Printemps des Peuples de 1848, et qui s'enflamme pour les luttes des nationalités opprimées, travaille à la constitution d'une opinion publique internationale, rêve d'élargir à l'Europe et au monde le combat pour la justice et pour la liberté. Certes, depuis 1830 au moins, la notoriété européenne de Hugo ne fait pas de doute, - mais elle est littéraire et non pas politique. Même sous la Seconde République, il n'est encore que peu sollicité par les démocrates étrangers. Avant son engagement dans la résistance armée au coup d'État de Louis Bonaparte, avant la proscription qui résulte de cet engagement, avant les magistrales oeuvres de combat qui marquent au début de cet exil à la fois la renaissance de l'écrivain et la ténacité radicale de l'opposant (Napoléon-le-petit en 1852, Châtiments en 1853), on n'imagine guère, par exemple, Mazzini écrivant à Hugo ces lettres de 1856 dans lesquelles l'exilé italien demande à l'exilé français d'intervenir pour la République italienne : « Une page dans laquelle vous diriez à l'Italie aujourd'hui très agitée mais égarée, tiraillée par des intrigants, que l'étoile de ses destinées luit en elle-même, en son coeur, en son peuple, en ses traditions, en ses souvenirs de 1848 et 49, non au dehors, aux cours et aux conférences, nous rendrait un grand service » 4 ( * )1 . Si l'on s'en tient aux interventions publiques reprises dans Actes et paroles, et sans parler des proclamations aux hôtes successifs de l'exilé (Bruxellois, Jersiais ou Guernesiais) on relève entre 1852 et 1870 trois textes adressés ou consacrés à la Pologne (et à la Russie), cinq à l'Italie, quatre à la Grèce, deux à la Belgique, un à la Suisse, trois à l'Irlande ou à l'Angleterre, un au Portugal, deux à l'Espagne. 4 ( * )2 Dans la plupart des cas, ces interventions de Hugo sont sollicitées par des correspondants étrangers, et sont liées à un événement dramatique, insurrection nationale et/ou condamnation à mort, principalement. Que l'efficacité immédiate d'actes politiques de ce genre soit par nature douteuse, Hugo le sait, et il appelle d'ailleurs à une meilleure organisation de cette solidarité internationale, à une meilleure articulation des luttes et, dirions- nous aujourd'hui, de leur accompagnement médiatique:
« Quant à moi », déplore-t-il en 1866, « c'est la quatrième fois qu'un appel de ce genre m'arrive trop tard depuis deux ans. Les insurgés de Haïti, de Roumanie et de Sicile se sont adressés à moi, et toujours trop tard [alors que l'insurrection était déjà étouffée]. Dieu sait si je les eusse servis avec zèle ! Mais ne pourrait-on mieux s'entendre? Pourquoi les hommes de mouvement ne préviennent-ils pas les hommes de progrès? Pourquoi les combattants de l'épée ne se concertent-ils pas avec les combattants de l'idée? C'est avant et non après qu'il faudrait réclamer notre concours. Averti à temps, j'écrirais à propos, et tous s'entraideraient pour le succès général de la révolution, et pour la délivrance universelle. » 4 ( * )3
De fait, c'est sans doute en exil que Victor Hugo élabore l'essentiel sinon d'une doctrine constituée et détaillée, du moins des quelques principes qui président à sa conception de l'Europe à venir.
Penser l'avenir de l'Europe dans ces années 1850-1860 oblige d'abord à poser la question des « nationalités ». Loin d'être stabilisée par la Réaction, l'Europe d'après 1848 est toujours en travail. Ce qui fermente dans le continent semble alors se cristalliser autour de l'idée de Nation. Hugo, contre les vieux Empires (turc et russe, autrichien et britannique) défend les nationalités en lutte pour leur indépendance : Hongrie, Pologne, Irlande, Serbie... De même il soutient les aspirations à l'unité nationale qui lèvent en Allemagne et en Italie. Mais il redoute plus que jamais l'autonomisation de ces revendications nationales. Car à ses yeux, la Nation ne saurait constituer une fin en soi : elle n'a de valeur et de sens que si elle est le vecteur de la démocratie républicaine, et si elle s'intègre immédiatement à un ensemble plus vaste qu'elle, une fédération continentale de peuples libres. Or, après les échecs de 1848, il semble que, un peu partout, la Nation risque de passer avant la République.
C'est le cas notamment en Italie, où les républicains perdent du terrain au profit de ceux qui souhaitent réaliser l'unité de la péninsule derrière la monarchie piémontaise du roi Victor-Emmanuel et de son ministre Cavour, et espèrent le soutien Napoléon III. Pour Hugo et les républicains internationalistes, cette unité nationale monarchiste, analogue à celle qui se profilait en Allemagne autour de Guillaume I er et de Bismarck, n'avait guère de chance de faire avancer la cause de la République universelle. Elle éviterait peut-être les révolutions, mais préparerait sans doute les futures guerres européennes. Alerté par Mazzini, Hugo s'était élevé contre cette tendance, rappelant aux Italiens que l'union devait venir des peuples, non des rois et de leur diplomatie :
« Italiens, c'est un frère obscur, mais dévoué qui vous parle. Défiez-vous de ce que les congrès, les cabinets et les diplomaties semblent préparer pour vous en ce moment. L'Italie s'agite : elle donne des signes de réveil ; elle trouble et préoccupe les rois ; il leur paraît urgent de la rendormir. Prenez garde ; ce n'est pas votre apaisement qu'on veut ; l'apaisement n'est que dans la satisfaction du droit ; ce qu'on veut, c'est votre léthargie, c'est votre mort. De là un piège. Défiez-vous. Quelle que soit l'apparence, ne perdez pas de vue la réalité. Diplomatie, c'est nuit. Ce qui se fait pour vous, se fait contre vous.
Quoi ! des réformes, des améliorations administratives, des amnisties, le pardon à votre héroïsme, un peu de sécularisation, un peu de libéralisme [...] ! Voilà ce que vous offrent les princes ! et vous prêteriez l'oreille ! et vous vous diriez : contentons-nous de cela ! et vous accepteriez, et vous désarmeriez ! Et cette sombre et splendide Révolution latente qui couve dans vos coeurs, qui flamboie dans vos yeux, vous l'ajourneriez ! Est-ce que c'est possible ?
Mais vous n'auriez donc nulle foi dans l'avenir ! vous ne sentiriez donc pas que l'empire va tomber demain, que l'empire tombé, c'est la France debout, que la France debout, c'est l'Europe libre ! [...]
Oui, le premier des deux peuples qui se lèvera fera lever l'autre. Disons mieux : nous sommes le même peuple, nous sommes la même humanité. [...]
Il y a entre vous et nous cette profonde solidarité humaine d'où naîtra l'ensemble pendant la lutte et l'harmonie après la victoire. Italiens, la fédération des nations continentales soeurs et reines, et chacune couronnée de la liberté de toutes, la fraternité des patries dans la suprême unité républicaine, les Peuples-Unis d'Europe, voilà l'avenir. » 4 ( * )4
Plus tard, quand la guerre menacera à nouveau l'Europe, conséquence de la politique menée par Bismarck en Allemagne, c'est à nouveau cette division à la fois nationaliste et monarchiste du continent que dénoncera le poète. Ainsi, au congrès de la paix de 1869, réuni à Lausanne, et qu'il présidait, Victor Hugo prévient :
« Les rois s'entendent sur un seul point : éterniser la guerre. On croit qu'ils se querellent ; pas du tout, ils s'entraident. [...] Les rois épuisent leur malade, le peuple, par le sang versé. Il y a une farouche fraternité des glaives d'où résulte l'asservissement des hommes. » 4 ( * )5
Et plus tard encore, en 1876, alors qu'il prend à parti les gouvernements européens coupables de laisser l'armée turque massacrer la Serbie, il rappelle une fois encore que l'indépendance de cette jeune nation n'a véritablement de sens que si elle précipite la formation des États-Unis d'Europe :
« Ce qui se passe en Serbie démontre la nécessité des États-Unis d'Europe. Qu'aux gouvernements désunis succèdent les peuples unis. Finissons-en avec les empires meurtriers. Muselons les fanatismes et les despotismes. Brisons les glaives valets des superstitions et les dogmes qui ont le sabre au poing. Plus de guerres, plus de massacres, plus de carnage ; libre pensée, libre échange ; fraternité. Est-ce donc si difficile, la paix ? La République d'Europe, la Fédération continentale, il n'y a pas d'autre réalité politique que celle-là.» 4 ( * )6
Parmi d'autres, ces quelques textes permettent d'apercevoir les principales justifications de cet idéal des États-Unis d'Europe.
D'abord la paix, bien sûr. Établir enfin la paix sur ce continent qui, déjà au XIX e siècle, semblait fait par la guerre et pour la guerre, - guerres de plus en plus meurtrières, du fait du développement technique des armements.
La paix, donc, mais pas seulement. L'autre justification, c'est la République démocratique. Les États-Unis d'Europe ne peuvent être que République, et inversement, la République ne peut être pleinement assurée que si elle est européenne, - puis universelle.
La République, qu'est-ce à dire, selon Hugo ?
La Liberté, toutes les libertés, individuelles et publiques, - liberté de penser, d'écrire, de croire ; liberté d'association, de réunion, d'expression, de circulation ; liberté syndicale et liberté de la presse, etc.
La souveraineté du peuple, garantie par le suffrage universel libre (y compris féminin), à tous les niveaux, du plus bas (la commune) au plus haut (l'instance fédérale), et très largement appliqué à tous les domaines concernant la collectivité.
L'abolition de la misère 4 ( * )7 par le développement économique et par une authentique justice sociale, fondée sur une solidarité sans failles de tous, et sur la reconnaissance absolue de l'égale dignité de chacun.
Insistons sur ce point : l'Europe n'est pas une question particulière, plus ou moins marginale, de la pensée politique de Victor Hugo. À ses yeux, la Fédération continentale, préfiguration de la République universelle, constitue le seul cadre où pourront enfin s'articuler libéralisme, démocratie et socialisme, - articulation que le XIX e siècle a tant de mal à réaliser et qui est au fond et à la pointe du désir politique hugolien.
On peut le dire autrement : la République dans un seul pays a peu de chance de durer, ou, si elle dure, elle court tous les risques d'oublier bientôt l'idéal républicain et de dégénérer en simple forme de Gouvernement parmi d'autres. Telle est l'une des principales leçons que Hugo (avec d'autres) tire de l'échec de la Seconde République. Et c'est pourquoi, dès le début de l'exil, il imagine la « Révolution future », qu'il salue à maintes reprises, comme une révolution européenne et non pas seulement française. C'est pourquoi le Représentant du peuple, proscrit par le Président félon mais non pas déchu de son mandat, imagine que lorsqu'il retrouvera son banc de député, ce sera au sein d'une Assemblée non pas nationale, mais à la fois européenne et authentiquement républicaine. Espoir qu'il confie, peu après son arrivée à Jersey, au colonel Charras, républicain, député et proscrit, ancien compagnon de l'exil bruxellois :
« Ayons foi, cher ami. J'ai l'idée que nous siégerons vous et moi, coude à coude, au Parlement des États-Unis d'Europe. Nous nous retrouverons l'un à côté de l'autre, et nous n'aurons plus les Thiers, les Montalembert et les Dupin en face de nous. » 4 ( * )8
Espoir qu'il exprime encore à un républicain allemand qui lui demandait une préface, en précisant cette fois les différents aspects du travail politique à venir, leur solidarité intime et leur « calendrier » :
« Je le pense comme vous, Monsieur, l'inévitable avenir de l'homme, c'est la liberté ; l'inévitable avenir des peuples, c'est la République ; l'inévitable avenir de l'Europe, c'est la fédération. Suffrage universel, République universelle, voilà ce que fondera le dix-neuvième siècle, voilà ce que recueillera le vingtième.
Avant peu, la royauté sera abolie en Europe [...]
En attendant, comme tous les hommes sérieux et convaincus, vous méditez sur la révolution future. Dans des écrits et dans des discours antérieurs à décembre 1851, j'avais comme vous indiqué aux penseurs les deux premières phases nécessaires de cette révolution : premièrement, affranchissement de l'Europe, libération des nationalités, République continentale, unité ; deuxièmement, organisation de chaque état démocratique confédéré, selon son progrès relatif et selon le droit de sa souveraineté locale, souveraineté subordonnée à l'unité continentale pour toutes les questions de civilisation générale. Voilà l'avenir, entrevu par vous comme par moi. Ceci du reste n'est que la formule politique ; ensuite viendra la grande et épineuse élaboration de la formule sociale. [...] Le moment est arrivé où la révolution française doit perdre son nom et s'appeler la révolution européenne. » 4 ( * )9
Resterait à établir en quoi l'expérience de l'exil a pu précipiter ou approfondir cette conscience européenne, à en marquer les spécificités et les limites. IL faut d'abord se replacer dans le contexte des années 1852-1856, où tout n'est encore que provisoire, et, pour comprendre les aléas et les formes prises par l'exil hugolien, se garder de tout finalisme : parce qu'on ne peut aujourd'hui nommer Victor Hugo sans faire surgir immédiatement l'image d'un homme seul sur son rocher et l'océan autour, cet exil-là n'était pas pour autant prévu d'avance, et n'était pas le seul possible : il a résulté d'un bizarre mélange de hasards, d'opportunités et de choix, qu'il faut restituer autant que faire se peut si l'on veut apprécier à sa juste mesure la spécificité de l'exil hugolien.
Il ne fait pas de doute que l'exil a considérablement élargi l'espace de référence, la géographie personnelle de Hugo. D'abord, et essentiellement dans ses dimensions les plus concrètes : ce Parisien invétéré, dont les voyages n'avaient jamais duré plus de deux ou trois mois, se vit soudain lancé dans cette existence flottante où l'on ne sait trop de quoi le lendemain sera fait, ni quelle sera son adresse le mois suivant. À lire sa correspondance des premières années de l'exil, disons jusqu'à l'achat de Hauteville House à Guernesey en 1856, ce qui frappe d'abord c'est ce sentiment d'instabilité, et la diversité un peu arbitraire des lieux d'asile envisagés. Le premier, Bruxelles, où Hugo réside d'abord (jusqu'en août 1852) est un passage obligé, tout simplement parce que la frontière belge est la plus proche de Paris (vingt ans plus tard, pour la même raison, la Belgique verra affluer les réfugiés de la Semaine sanglante). Mais la Belgique, petit pays, n'est pas sûre : on craint alors une invasion française, en tout cas des pressions du nouveau Gouvernement sur les autorités belges pour obtenir l'extradition des exilés ou les réduire au silence (fin 1852, le vote de la loi Faider aura pour but d'obtenir ce silence). Aussi l'asile bruxellois est-il presque d'emblée considéré comme provisoire. Hugo songe alors à Londres, l'autre grand pôle de l'émigration politique. Mais d'autres destinations sont possibles, et plus ou moins sérieusement envisagées. On évoque la Suisse, elle aussi bien pourvue en exilés de toutes origines. Un correspondant sarde offre à plusieurs reprises l'hospitalité à Turin, ou dans une villa au bord du lac Majeur 5 ( * )0 . Napoléon-le-petit achevé, Hugo opte finalement pour Jersey. Mais là encore, rien de définitif. En 1854, Hugo apprend, d'abord par les journaux, que la Junte libérale qui vient de prendre le pouvoir en Espagne l'invite à s'installer dans la péninsule, et, au milieu de « l'été parjure » de l'archipel de la Manche, pluvieux et venteux, il caresse l'idée de retrouver le soleil de « [ses] Espagnes » 515 ( * )1 . Puis, brutalement, vient l'expulsion de Jersey. À Marine-Terrace, on parle alors d'Amérique. Guernesey est plus proche, et sera l'ultime refuge. Mais qui pourrait alors le jurer ? l'expérience récente de la famille Hugo ne l'a pas habituée à considérer l'avenir comme sûr. Si Hugo s'empresse d'acheter Hauteville House avec les droits des Contemplations, de devenir ainsi un landlord comme il l'écrit plaisamment à Noël Parfait 5 ( * )2 , lui qui jusqu'alors avait toujours été locataire, c'est bien pour conjurer cette instabilité de l'exil, sachant que la bourgeoise Angleterre y regarde à deux fois avant d'expulser un propriétaire. C'est là néanmoins un pari un peu risqué : sa femme Adèle s'en plaint, parce que la perspective de s'enterrer durablement sur cet îlot - et d'y condamner sa fille - ne la réjouit guère ; mais aussi parce que, non sans raison, elle s'inquiète du capital ainsi immobilisé alors que les vicissitudes de la politique peuvent du jour au lendemain contraindre les Hugo à s'en aller ailleurs, plus loin. L'exil, c'est donc d'abord cela : la conscience forcée que, pour être né à Besançon et avoir presque toujours vécu à Paris, on n'en pourrait pas moins être demain, ou après-demain, bruxellois, londonien, jersiais, madrilène, genevois, guernesiais, turinois, - ou new- yorkais... L'Europe, la terre est vaste, - plus ou moins accueillante, mais vaste.
À cette ouverture géographique des lieux où vivre s'ajoute celle des réseaux mobilisés pour exercer son activité d'écrivain. Le premier réflexe de l'exilé Hugo consiste à se remettre à écrire, et, parallèlement, à chercher les moyens de publier ses écrits. Les réseaux d'édition et de diffusion habituels étant désormais fermés, il faut trouver de nouveaux partenaires éditoriaux hors des frontières françaises : à Bruxelles, à Londres, en Suisse, voire en Hollande. Même ouverture, plus grande encore, des supports de médiatisation : les journaux français sont toujours sollicités mais, soumis comme ils le sont à la censure impériale, ils doivent être complétés par des organes belges, anglais, italiens, - voire grecs, espagnols, américains, etc., qui sont souvent les seuls susceptibles d'accueillir telle ou telle déclaration. L'audience européenne de l'écrivain Victor Hugo a précédé son exil, - mais dans l'ensemble, elle était subie (et parfois non sans déplaisir : quand par exemple tel éditeur belge imprimait et vendait sans négocier de contrat ni payer de droits d'auteurs tel livre paru en France). Désormais, cette audience, indispensable, est directement sollicitée et entretenue par l'exilé. Quand bien même le public privilégié resterait le public français (ce qui est souvent le cas), l'atteindre suppose de passer par l'Europe : de gré ou de force, l'univers culturel des exilés est européen.
Enfin, avec l'exil, le cercle des correspondants, et, dans une moindre mesure, des intimes, s'internationalise. Hugo n'oublie pas ses amis et ses relations restées en France, qui constitueront toujours l'essentiel de ses correspondants et de ses visiteurs (ces derniers assez peu nombreux). Mais s'y ajoutent désormais massivement les relations étrangères imposées par sa nouvelle situation éditoriale et politique, ainsi que des représentants des diverses communautés d'exilés. Car, conséquence de la dimension européenne du mouvement de 1848, l'exil est alors une réalité européenne, et Hugo entre en contact, au moins en correspondance, avec nombre d'exilés étrangers. Citons entre autres les Italiens Brofferio, Mazzini, Garibaldi, le Hongrois Teleki (un temps familier de Marine Terrace, à Jersey), ou le Russe Herzen, à qui il s'adresse toujours comme à un compatriote de cette nouvelle communauté supranationale qu'est l'exil (ainsi dans les premiers mots de sa réponse du 25 juillet 1855 : « Cher concitoyen - car il n'y a qu'une cité, et en attendant la République universelle, l'exil est une patrie commune. » 5 ( * )3 )
Néanmoins, la connaissance concrète et détaillée de la situation européenne, même accrue par l'expérience de l'exil, reste chez Hugo limitée. Le poète ne relève pas de cette catégorie d'exilés cosmopolites, véritables vagabonds européens, représentée par les Herzen, les Marx, les Mazzini... Signe de cette limite: la compétence linguistique. Malgré ses dix-neuf ans passés sur le territoire de Sa Majesté Britannique, Hugo n'apprit jamais vraiment l'anglais. L'espagnol, seule langue vivante qu'il pratiquât, intervient davantage dans sa création littéraire que dans sa pratique sociale ou politique. Hugo n'écrit donc qu'en français, et ce à une époque où le monopole international de cette langue est déjà bien écorné : il est donc tributaire des traductions. Même si certains éditeurs londoniens, comme Jeffs, publiaient alors des ouvrages de français en français, mieux valait cependant traiter avec des francophones, dont les débouchés éditoriaux étaient d'abord et principalement français. Le choix des lieux d'asile fut également en grande partie déterminé par la langue qu'on y parlait : après Bruxelles, l'archipel de la Manche, ces îles anglo-normandes où l'on parlait encore français à l'époque, - certes un français un peu étrange, mais qui ne déplaisait pas à l'auteur des Travailleurs de la mer.
L'exil de Hugo n'est donc pas un exil cosmopolite. Mais il n'est pas non plus celui, devenu vite étouffant et déprimant, des petites communautés politiques, chapelles essentiellement regroupées par origine nationale malgré plusieurs tentatives d'organisation plus vastes, et livrées bientôt au démon du ressassement et de la division. Communautés regroupées en Suisse, en Belgique et surtout à Londres et que Herzen, qui les connut de près, décrit d'une plume acerbe dans ses souvenirs :
« Il fut un temps où, dans un paroxysme d'irritation et d'ironie amère, je m'apprêtais à rédiger un pamphlet à la manière de Grandville : Les réfugiés peints par eux-mêmes. Je suis content de ne pas l'avoir fait. À présent je vois les choses avec plus de sérénité, je me moque moins souvent et ne m'indigne pas autant qu'autrefois. Au surplus, l'exil se prolonge trop longtemps et pèse trop lourd sur les uns et les autres...
Je n'en affirme pas moins, même maintenant, qu'un exil dont la décision a été prise non dans un but défini mais sous la pression du parti opposé freine toute évolution et, enlevant les hommes à leurs activité réelles, les pousse vers des occupations fantomatiques. Partis de leur patrie la rage au coeur, obsédés par la pensée d'y retourner demain, ils ne vont pas de l'avant et, au contraire, reviennent constamment au passé. L'espérance empêche qu'ils se fixent, qu'ils entreprennent un travail continu. L'irritation, les querelles vaines mais acharnées, ne leur permettent point de se dégager d'un certain nombre de questions, d'idées, de réminiscences, qui aboutissent à une tradition contraignante et accablante. Les hommes en général, et particulièrement ceux qui se trouvent dans une situation exceptionnelle, ont un tel penchant pour le formalisme, pour l'esprit corporatif, pour l'aspect professionnel, qu'ils assument immédiatement l'apparence typique de leur métier ou de leur doctrine.
Tous les immigrés, coupés du milieu vivant auquel ils appartenaient, ferment les yeux pour ne pas voir les amères vérités et se cantonnent de plus en plus dans un cercle clos et irréel, formé de souvenirs stagnants et d'espoirs irréalisables. Si nous y ajoutons leur éloignement de ceux qui ne sont pas des émigrés, et une tendance à la méchanceté, à la suspicion, à l'exclusivité et à la jalousie, le nouvel Israël au cou raide deviendra parfaitement compréhensible. » 5 ( * )4
On pourrait presque reprendre terme à terme les travers des exilés fustigés ici par Herzen et constater que Hugo a construit son exil de manière à éviter d'y sombrer. De ce point de vue, l'essentiel de son attitude relève de ce qu'on pourrait nommer une stratégie de la solitude, à tout le moins du retrait. À Bruxelles, il est nécessairement plongé dans la communauté des proscrits du Deux-Décembre. L'expérience lui vaut plusieurs amitiés solides, fruit du combat, des douleurs et des espoirs partagés. Il semble cependant que cette présence (pour ne pas dire cette pression) constante de ses compagnons d'exil lui ait vite pesé - d'abord et avant tout parce qu'elle empiétait sur son temps de travail ! Or, dès Bruxelles, l'exilé Hugo montre qu'il n'a pas l'intention de faire de l'exil un lieu qui l'enlèverait à ses « activités réelles », pour reprendre l'expression de Herzen. Tout au contraire, comme on le sait, l'exil sera pour lui l'occasion de se replonger dans la plus réelle de ses activités : l'écriture, - y compris et d'abord celle qui pouvait servir son idéal politique. L'insistance avec laquelle, Napoléon-le-petit achevé et sous presse, il soutient contre ses compagnons d'exil sa volonté de quitter Bruxelles, se pare de considérations tactiques certes non dénuées de pertinence et de sincérité. Le pamphlet antibonapartiste va déchaîner les foudres du pouvoir français, la loi Faider va être votée, l'expulsion est à peu près inévitable : autant prendre les devants, ne serait-ce que pour épargner aux autres proscrits une expulsion collective. Il n'en reste pas moins qu'elle révèle aussi chez Hugo le désir impérieux de prendre du champ, et de décliner poliment le rôle de chef de chapelle qu'on lui offrait. Les proscrits bruxellois le déléguèrent comme représentant de leur groupe auprès des chefs londoniens, du fameux Comité révolutionnaire européen, formé par Ledru-Rollin, Mazzini et Kossuth. Reconnaissant et flatté, il s'acquitte de sa mission, mais en quelque sorte a minima : n'ayant pas l'intention de s'attarder à Londres, il ne saurait compter remplir auprès des émigrés londoniens un rôle majeur 5 ( * )5 . Sur la petite île de Jersey, il y a certes des proscrits, et surtout des Français. Mais, à l'exception de Pierre Leroux, ce ne sont pas des « ténors », les chefs sont à Londres ou à Bruxelles. En outre, pour la plupart, il s'agit non pas d'exilés du Coup d'État, mais de Républicains au drapeau rouge, proscrits dès 1849 par la République conservatrice : Hugo choisit donc une communauté d'exilés qui n'est pas exactement la sienne, ni en terme de doctrine politique, ni quant à l'expérience concrète de la proscription. Les risques de friction sont réels, acceptés, mais bien moindres en revanche les tentations de part et d'autre d'instituer Victor Hugo en chef de groupe.
Qu'on ne s'y méprenne pas, cette tendance au retrait n'est pas dédain des compagnons de lutte, moins encore volonté d'abandonner le combat. À Bruxelles, à Londres, à Jersey, Hugo ne ménage ni son engagement ni sa solidarité. D'emblée, l'écrivain affirme qu'il doit reprendre le combat littéraire d'abord sur le mode politique : à ce moment de l'exil, toute oeuvre de « poésie pure » apparaîtrait comme un « désarmement ». Les Contemplations ne seront possibles qu'après Napoléon-le- petit et Châtiments. Il prête sa plume aux proclamations collectives, et assume pleinement les positions définies en commun, par exemple celle des exilés jersiais prônant l'abstention au plébiscite de 1852 5 ( * )6 . Même quand il désapprouve, ce qui n'est pas rare, le radicalisme hautain des socialistes de Jersey, il s'abstient de toute prise de distance publique, se contentant du silence. Enfin son nom apparaît toujours en bonne place dans les souscriptions destinées à venir en aide aux exilés démunis (de loin les plus nombreux), - à la mesure de ses revenus, restreints et peu assurés avant les grands succès éditoriaux qui viendront plus tard.
Pour autant, on est en droit de penser que l'isolement auxquels les événements vont bientôt le réduire n'est pas pour lui déplaire. L'expulsion collective de 1855 qui disperse les exilés de Jersey (lesquels ne prennent pas tous le chemin de Guernesey), puis surtout l'amnistie de 1859 (qui permet aux proscrits de rentrer en France sans avoir à solliciter leur grâce, et que la grande majorité d'entre eux accepte), font enfin à Hugo l'exil qu'il avait sans doute plus ou moins secrètement désiré depuis 1852 : celui d'un fantôme hantant un rocher, d'un homme libre et seul, attentif à la rumeur du monde, disponible pour tous les appels au secours, l'exil d'un absent dont la voix était sans arrêt portée par l'océan et amplifiée par ses échos.
Quel effet d'approfondissement un tel exil a-t-il pu avoir sur la conscience européenne de Victor Hugo ? Se tenant à l'écart des grands centres de la politique, exilée ou pas, progressivement détaché de toute fréquentation régulière des communautés de proscrits politiquement organisées, son information et son action tendent à se limiter aux voies médiatiques du livre, de la presse et de la lettre, ouverte ou non. Sa connaissance des diverses situations nationales reste donc limitée, il le sait et ne s'en cache pas. Quand des correspondants étrangers, de plus en plus souvent au fil des années, sollicitent de lui une intervention dans telle ou telle question nationale, il évite le plus souvent d'entrer dans les détails de la tactique ; ainsi dans sa lettre à l'allemand Gloss, citée plus haut : « Vous connaissez naturellement mieux que moi, Monsieur, l'état actuel de la question intérieure allemande ; je ne puis donc qu'approuver de confiance la formation du comité allemand tel que vous l'entendez. » 5 ( * )7 . En revanche, il met sans difficulté sa plume au service de l'enthousiasme et de l'indignation, du rappel exaltant des principes généraux et généreux, et il sait très bien formuler et répéter les grandes lignes de la stratégie d'ensemble qui lui semble légitime et nécessaire. Les détails et détours de la tactique, il ne les évoque et ne les emprunte guère que lorsqu'il s'agit de la France.
Au demeurant, il n'est pas certain qu'un exil davantage mêlé aux vicissitudes de la politique pratique et de la communauté internationale des proscrits aurait conféré une plus grande vigueur et une plus grande efficacité à son engagement européen. Les témoignages des exilés de l'après 48, les travaux qui portent sur leur existence et leur action, tendent à montrer combien, malgré l'internationalisme proclamé, les regroupements se faisaient d'abord sur des bases nationales, bien difficiles à articuler. Même à Londres, la plupart des proscrits fréquentaient essentiellement leurs compatriotes. Et ceux qui, parmi eux, peuvent vraiment être qualifiés de cosmopolites, tel Alexandre Herzen, montrent que leur expérience les conduisit plus souvent à accentuer leur perception des différences nationales, à grand renfort de généralisations hâtives et de clichés autorisés, plutôt qu'à dégager les formes et les mots de la solidarité européenne. Sur son rocher, le vieillard solitaire et tonitruant s'attacha sans cesse, lui, à mettre en avant et à glorifier ce qui réunissait l'Europe de ses voeux, les principes partagés, les souffrances communes, l'avenir rêvé par tous, - plutôt que les divisions héritées de l'histoire et d'une hypothétique psychologie des peuples. Et tandis que, servi et porté par les prestiges du Verbe, par une gloire littéraire renouvelée et décuplée, par sa ténacité exemplaire, Hugo forgeait les symboles de la communauté européenne qu'il croyait en gestation, tandis qu'il chantait ses martyrs et ses héros (Garibaldi, la Pologne, les anonymes des barricades écrasées...), lui-même devenait un drapeau, un symbole vivant et parlant de cette Fédération continentale à venir, de cette République universelle de l'idéal. Le nombre croissant des appels qui lui parvenaient des quatre coins du continent et du monde prouvait que, « chose publique » 5 ( * )8 , Hugo ne l'était pas seulement pour la France. Or qui n'admettra l'efficacité, ou pour mieux dire la nécessité de symboles communs, dans l'émergence d'une communauté nouvelle ? Et n'est-ce pas là, entre autres choses, ce qui fait cruellement défaut à l'Europe d'aujourd'hui ?
Mais revenons, pour conclure, à l'exil, et disons que Hugo a construit le sien en fidélité exacte à cette trinité qui fait le fond de sa conception et de sa pratique de la politique : indépendance, solidarité, conscience. Ces trois termes dessinent en quelque sorte la subjectivité politique hugolienne, la figure même du sujet humain en tant qu'il est sujet politique. Les deux premiers de ces termes se comprennent aisément ; le troisième est plus énigmatique, plus essentiel, et davantage susceptible de contresens. Conscience chez Hugo ne désigne pas une vague déontologie, une éthique de la politique comme on dirait aujourd'hui. Elle est le nom du moteur même, du désir inextinguible de politique, - sa source, alors que les deux autres termes de cette trinité définissent ses modes d'application. La conscience est ce qui dit à l'homme qu'il vaut mieux et plus que l'existence qu'il se fait et qu'on lui fait, qui dit au sujet politique que le genre humain est appelé à de plus hauts et plus heureux destins que ceux ménagés et aménagés par l'état présent de la collectivité. C'est en cela que la conscience est à la source de la seule politique qui vaille, celle qui tend à réduire le hiatus, celle qui pense, sent et agit en accord avec cette voix intérieure, celle qui oeuvre à ce que Hugo, parmi d'autres, appelle le Progrès. Et l'on comprend alors que le grand exilé ait si souvent parlé de la proscription en termes de conscience, qu'il l'ait comprise comme une expérience intimement et intensément adéquate à la conscience : c'est que tant que l'Histoire n'est pas achevée, tant que l'Homme n'est pas vraiment l'Homme, tant que la politique est nécessaire, la conscience parle toujours d'ailleurs, pour autre chose. La conscience est toujours en exil.
Michel WINOCK
Il est notable que cette histoire de l'exil ait pu être illustrée, en chacun de ses chapitres, par des écrivains de haute lignée : Chateaubriand, Germaine de Staël et Benjamin Constant, Victor Hugo, Jules Vallès. Chacun d'eux, à sa manière, a décrit les souffrances et les espoirs du proscrit, les yeux tournés vers son pays interdit, redoutant de mourir sans l'avoir revu. L'exil a été pour beaucoup, illustres ou non, une école de formation politique, où les grandes idées du siècle, le libéralisme, la République, le socialisme, ont mûri. C'est aussi cette fécondité de l'exil qu'il faudra vérifier.
Enfin, si la France a été, au XIX e siècle, une terre d'exil, il ne faudrait pas oublier -- même si ce n'est pas exactement notre sujet -- qu'elle fut aussi une terre d'asile : qu'il suffise de dire les noms de l'allemand Heine, du russe Herzen, du polonais Mickiewicz, derrière lesquels furent des milliers de compatriotes, pour signaler que le phénomène d'exil ne fut pas unilatéral et que, pour beaucoup d'Européens, la France, terre de la révolution, est restée -- au moins à certaines périodes de son histoire -- terre de liberté.
Je vous propose maintenant de poser vos questions.
Débat
De la salle
Dans la partie consacrée aux exilés de la révolution, Michel Winock a cité le chiffre de 150 000 exilés. Mme Rance, quant à elle, a parlé de 100 à 150 000 exilés dont 17 000 nobles. Au-delà de ces nobles, quels ont les autres exilés ? Qu'ont-ils fait ? Sont-ils revenus en France après l'amnistie ?
Karine RANCE
Je commencerai par répondre à votre dernière question. Quasiment toutes les personnes ayant quitté la France au moment de la Révolution sont rentrées. Les autres émigrés sont des membres du clergé réfractaire, c'est-à-dire ceux refusant de prêter serment à la constitution civile du Clergé. Ce sont aussi des membres du Tiers- état en particulier des paysans d'Alsace et des régions frontalières où avaient lieu les conflits militaires. Ces personnes se sont réfugiées de l'autre côté de la frontière de peur des représailles au moment où les armées françaises revenaient dans la région. Le profil du Français en exil à l'étranger se complexifie et se diversifie. En effet, à chaque changement de régime en France pendant la période révolutionnaire, une nouvelle vague d'émigration se produit. Nous trouvons alors dans une ville comme Hambourg à la fois des émigrés que nous pourrions qualifier d'ultraroyalistes avant l'heure, des partisans de la monarchie constitutionnelle mais aussi des gens comme Talleyrand qui passe à Hambourg en revenant des États-Unis.
Michel WINOCK
Nous pouvons aussi citer les Girondins qui ont également fait partie des exilés. En effet, une partie des révolutionnaires a fait partie de cette émigration. Au moment de la Terreur, quelques centaines de personnes quittent la France. Un historien américain, Donald Greer, donne les statistiques suivantes : " l'émigration est composée de 25,2 % de prêtres, 16,8 % de nobles, 11 % de grands bourgeois, un peu plus de 6 % de petits bourgeois mais aussi 14,5 % d'ouvriers et près de 20 % de paysans ". IL reste donc 7 % d'exilés non identifiés.
De la salle
Franck Laurent, à propos de l'Europe, dit que la pensée politique de Hugo s'articule autour du libéralisme, du socialisme et de la démocratie. Qu'entend-il par libéralisme à cette époque ?
Franck LAURENT
Le libéralisme fait référence aux principes de 89, c'est-à-dire liberté publique, égalité civile, etc. C'est aussi le refus d'un système représentatif. Néanmoins la dimension économique du libéralisme commence à immerger y compris en France. Le libéralisme est certes avant tout une invention anglaise. Hugo globalement est partisan d'une forme de libéralisme économique. Il n'y a aucun doute sur cette question. Même s'il entend le libéralisme économique avec des correctifs pour les peuples entre autres des correctifs de redistribution voire de planification incitative dans certains cas, l'État pouvant être en mesure de donner certaines impulsions à l'économie. C'est au cours des années 1868-1870 que cette idée est développée. Il défend aussi comme tous les républicains de son bord, c'est-à-dire les républicains radicaux, l'impôt sur le revenu contre l'impôt sur la consommation. L'impôt sur le revenu est une mesure d'un rouge écarlate pour l'époque. D'ailleurs, cet impôt ne sera voté qu'en 1911 ou 1912 c'est-à-dire qu'après bien des péripéties et des campagnes de presse très importantes.
Michel WINOCK
L'impôt sur le revenu est voté en 1914 et sera mis en oeuvre après la guerre. Hugo est un social libéral. Le mot libéralisme est aujourd'hui devenu plus ou moins un terme péjoratif mais le libéralisme représente le progrès. C'est la liberté politique, c'est la liberté de la presse. C'est la liberté individuelle. C'est la liberté de se déplacer. Le libéralisme politique s'accompagne d'un libéralisme économique plus ou moins encadré par l'intervention de l'État. C'est ici que les différentes écoles s'expriment.
De la salle
Pour quelles raisons précises Herzen est-il parti en exil ?
Sylvie APRILE
Herzen est un opposant au régime tsariste dans les années 1840. Il est donc contraint de quitter la Russie. Il bénéficie, de par ses origines, d'une fortune personnelle qui va lui permettre de vivre en exil. Bien qu'ayant vécu en France, il a à la fois une vision très cosmopolite et en même temps il se replie sur une conscience nationaliste. Il exprime donc un pessimisme par rapport aux événements ayant lieu en Europe à cette époque. Il faut lire les mémoires d'Herzen pour comprendre pleinement le milieu dans lequel il évolue et le foisonnement intellectuel. Je vous invite à faire cette lecture.
Franck LAURENT
Avant d'inviter les lecteurs à lire Herzen, il serait bon d'inviter les éditeurs à publier ses mémoires. Il est fort dommage que les magnifiques mémoires d'Herzen ne soient pas disponibles dans l'édition française.
Sylvie APRILE
Herzen était également publié largement dans les colonnes d'un journal que nous nous devons d'évoquer, L'Homme, journal de la proscription publié à Jersey. Ce journal avait pour sous-titre Journal de la démocratie universelle, journal qui ouvre ses colonnes très largement à toutes les tendances de la proscription. Herzen a été un collaborateur important de ce journal et y a publié des textes qu'il ne pouvait publier nulle part ailleurs.
Michel WINOCK
Je vous propose d'entendre quelques questions écrites posées par le public se trouvant dans la salle adjacente et qui suit nos débats par écran interposé. La première question écrite s'adresse à Franck Laurent. Combien de temps Victor Hugo est-il resté en exil ?
Franck LAURENT
L'exil principal dure 19 ans et 9 mois. Il part le 10 décembre et rentre un 5 septembre. Il existe cependant d'autres périodes d'exil de Hugo.
Michel WINOCK
La deuxième question vous est également adressée : à propos de la pensée de Victor Hugo sur l'Europe, je souhaite savoir s'il s'est posé la question d'une langue unique et celle de la défense des cultures nationales face à la mondialisation ou à l'européanisation.
Franck LAURENT
Victor Hugo s'est effectivement interrogé sur la perspective d'une langue unique. Dans les années 1840, c'est le français comme langue véhiculaire. Il s'aperçoit assez rapidement qu'une langue véhiculaire n'est pas suffisante et par ailleurs que le français n'est peut-être pas la langue la mieux placée. Victor Hugo reste particulièrement discret sur la question. Il imagine certainement une langue nouvelle qui serait certainement construite à partir du français mais qui deviendrait la langue de l'Europe future. Ce serait en quelque sorte un français métissé.
Jacques SEEBACHER
Quand Hugo parle d'une union continentale, je ne pense pas qu'il y inclut l'Angleterre. Sur la question de la langue, "il faut que nous nous trouvions avec les allemands en face de l'Allemagne pour que toute l'Europe parle français et non allemand", dit-il.
Michel WINOCK
Voici une autre question : « Comment peut-on faire un parallèle entre l'histoire des peuples et l'histoire individuelle? » C'est un grand sujet. Nos vies dépendent nécessairement des conditions historiques générales de l'époque où nous vivons. Que l'on songe seulement aux guerres, aux crises économiques, aux révolutions... Ou tout simplement au prix du pain. Cependant, les destinées de chacun ne dépendent pas étroitement des événements, parce qu'elles sont soumises à d'autres contingences, personnelles, familiales, locales. Quand on lit des mémoires ou des correspondances, on découvre parfois que la vie particulière de tel ou tel individu présente des périodes fastes et heureuses au moment même où la conjoncture est mauvaise. Le parallèle entre vie personnelle et vie publique devient beaucoup plus net dans le cas des personnes qui sont très engagées dans l'histoire de leur pays, dans l'histoire politique notamment. C'est bien le cas de Victor Hugo : on peut lire sa vie, sa carrière, suivre son évolution, comme un livre d'histoire, depuis ses premiers poèmes d'ultra-royaliste, sous la Restauration, jusqu'à son apothéose républicaine au début de la III e République.
Deuxième table ronde sur
L'EXIL DU XXE SIECLE OU
LA TRAGIQUE EXPERIENCE D'UN DEPART SANS RETOUR
Vendredi 15 novembre 2002
Participent à cette table ronde :
Ioana POPA, Attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Poitiers
François FEJTÖ, Journaliste, historien et écrivain
La table ronde est animée par Bruno GROPPO, Sociologue .
Bruno GROPPO
Notre table ronde se fera dans un cercle plus restreint que la précédente puisqu'il manque la présence de l'un de nos interlocuteurs, Alexandre Adler. Permettez-moi de vous donner quelques considérations initiales afin de situer le problème de l'exil au XX e siècle.
Les exils européens au XX e siècle
Introduction
L'objectif de ce texte est de présenter un tableau général des exils européens au XX e siècle et de proposer quelques réflexions sur certains aspects de la problématique de l'exil. Par exils européens j'entends ceux qui ont leur origine en Europe, même s'ils se sont dirigés aussi vers d'autres continents. L'Europe nous intéresse donc surtout en tant que «productrice » d'exilés, même si dans les dernières décennies du XX e siècle elle est devenue, de plus en plus, un pôle d'attraction pour de nombreux exilés venus d'autres continents. On montrera comment le phénomène de l'exil a évolué historiquement et quelle a été sa spécificité au cours de ce siècle. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité du sujet, le tableau présenté ici est inévitablement sommaire. L'accent est mis sur les tendances de fond et sur quelques points essentiels, notamment sur le problème des notions (« exilé », « réfugié », « émigré ») utilisées. L'exil politique est analysé en tant que composante d'un phénomène beaucoup plus large, celui des réfugiés, qui, après avoir été dans la première moitié du XX e siècle un problème essentiellement européen, est devenu ensuite, et reste aujourd'hui encore, un problème mondial. Dans ce cadre, je consacre une attention particulière à la construction historique d'un statut international du réfugié, codifié par la convention de Genève de 1951, toujours en vigueur. Je montrerai enfin comment le problème de l'exil, en tant que composante du phénomène migratoire, est étroitement lié à l'évolution des politiques d'immigration et des conjonctures économiques et politiques. Une réflexion sur les typologies possibles et sur l'évolution de l'historiographie clôt cette présentation. La France, en tant que pays d'accueil, fera l'objet d'une analyse spécifique.
L'exil - que l' Encyclopaedia Britannica de 1997 définit comme « absence prolongée de son propre pays, imposée comme mesure punitive par l'autorité constituée » 5 ( * )9 - est un phénomène ancien, présent déjà dans l'antiquité classique. À Rome, l' exilium - qui veut dire « bannissement » - signifia d'abord l'éloignement volontaire de la cité, possibilité offerte aux citoyens romains d'échapper à la peine de mort avant que la sentence fût prononcée, et ensuite toute forme d'expulsion, temporaire ou permanente. La Grèce antique l'utilisait comme peine, notamment dans les cas d'homicide, et Athènes en particulier pratiquait l'ostracisme, c'est-à-dire l'exclusion temporaire de la cité, pour des raisons politiques, à l'encontre de citoyens jugés dangereux pour l'ordre publique. La Bible est pour beaucoup d'aspects un récit sur l'exil, que ce soit celui du peuple juif, exilé à Babylone ou en Égypte, ou, de manière plus métaphorique, celui d'Adam et Ève, chassés du Paradis terrestre, ou de l'être humain qui, dans son exil terrestre, aspire à retrouver sa véritable patrie, la cité céleste. Ces récits mythiques laissent entendre que l'expérience de l'exil est constitutive de la nature humaine. Le Moyen Age connut également le phénomène de l'exil, qui a laissé sa marque, par exemple, dans la Divina Commedia de Dante Alighieri, exilé de sa Florence. Pour l'époque moderne, il suffit de mentionner l'exil des protestants français après la révocation de l'édit de Nantes ou les innombrables exils du XIX e siècle. Quant au XX e siècle, comme le souligne l'historien italien Maurizio Degl'Innocenti, l'exil - défini comme « éloignement de la patrie pour des raisons politiques, raciales, religieuses, civiles, de manière imposée légalement ou arbitrairement par le pouvoir dominant, ou de manière volontaire pour échapper à des persécutions ou à des violences physiques ou psychologiques » - « constitue, de par ses dimensions et son importance sociale, un élément caractérisant de l'histoire contemporaine » 6 ( * )0 . Il faut donc se demander quels ont été, dans l'Europe du XX e siècle, les traits spécifiques d'un phénomène si ancien.
L'exil est une forme de migration, qui se distingue des migrations dites économiques par son caractère forcé : l'exilé est un migrant involontaire, qui aurait souhaité rester dans son pays, mais qui en a été chassé ou qui a dû le quitter pour échapper à des persécutions ou à des menaces graves. L'objectif de cette migration forcée et de sauvegarder la vie et la liberté. Quand on étudie les parcours des exilés on constate que, de la même manière qu'il existe une géographie des migrations économiques, on peut dessiner aussi une géographie de l'exil et des migrations politiques et essayer d'établir une typologie des pays de départ et des pays d'accueil. En effet, comme le souligne Pierre Milza, « il existe des permanences qui font que - à l'épreuve du temps long - tel pays appartient plutôt à la constellation des pays-refuges, tel autre se range de manière continue dans la famille des pays de départ. Les Pays-Bas, la Belgique, les pays Scandinaves, la Suisse, la France également, appartiennent sans conteste à la première catégorie. L'empire des tsars devenu Union soviétique, (...) l'Espagne et la Grèce jusqu'à une date récente relèvent plutôt de la seconde. L'Allemagne et l'Italie se trouvant dans une situation intermédiaire» 6 ( * )1 . La France « fonde largement son identité sur sa réputation de terre d'accueil des exilés » 6 ( * )2 , même si elle a eu elle aussi, à différentes époques, ses propres émigrés politiques (royalistes, républicains, communards, collaborationnistes, pour citer quelques exemples). Dans cette géographie de l'exil il y a des pôles d'attraction, des centres où la présence d'exilés est particulièrement importante : ainsi, Paris, Londres, Bruxelles, Genève, Zurich, ont été au cours des deux derniers siècles les capitales de l'exil européen. Selon le type d'exil, il y a souvent une capitale et d'autres centres qui, par rapport à elle, font figure de provinces. Dans les années 20 et 30, par exemple, Paris a été la capitale mondiale de l'exil antifasciste italien, qui avait des ramifications dans toutes les colonies d'émigrés italiens dans le monde. Mais l'exil n'est pas resté limité à l'aire européen. Dès le XIX e siècle des exilés européens ont cherché refuge dans d'autres continents, en particulier dans les Amériques, et ce mouvement s'est poursuivi au siècle suivant, parallèlement à celui des migrations économiques. Avec les hommes ont voyagé aussi les idées. La géographie de l'exil est aussi une géographie de la diffusion des idées politiques et sociales, dont les exilés ont été des vecteurs particulièrement importants. Le rôle des exilés européens dans la diffusion des idées socialistes et anarchistes aux États-Unis et en Amérique latine (surtout en Argentine et au Brésil) au XIX e siècle est bien connu. Au XX e siècle l'exil allemand et l'exil espagnol ont été de fascinants exemples de transfert culturel d'Europe vers les Amériques.
Au cours du XX e siècle la notion d'exilé a eu tendance à se confondre avec celle, plus générale, de réfugié 6 ( * )3 . L'exil, considéré en tant que phénomène spécifiquement politique 6 ( * )4 , est devenu une composante d'un phénomène beaucoup plus large, celui des réfugiés, qui constitue un aspect fondamental de l'histoire européenne et mondiale du XX e siècle : en effet, 1' « âge des extrêmes » 6 ( * )5 a été aussi le siècle des réfugiés. Le nombre de ces derniers a atteint de telles proportions, surtout depuis la première guerre mondiale et davantage encore au lendemain de la seconde, que le phénomène est devenu un problème international et a obligé la communauté internationale (la Société des Nations d'abord, et ensuite l'ONU) à chercher des solutions et à élaborer un statut spécifique du réfugié, codifié dans la résolution de Genève de 1951 6 ( * )6 .
Mots et concepts
Toute réflexion sur les exils européens au XX e siècle implique une interrogation préliminaire sur les mots et les concepts utilisés. « Exilé », « émigré politique », « réfugié », sont employés souvent comme équivalents. Cet usage n'est pas entièrement satisfaisant, et il convient de faire quelques distinctions. On peut remarquer, tout d'abord, que les mots « réfugié » et « émigré » sont nés tous les deux dans le contexte linguistique français pour désigner, à l'origine, une réalité spécifiquement française. Le premier servit à indiquer les protestants chassés de France après la révocation de l'édit de Nantes en 1685 6 ( * )7 et qui s'installèrent dans d'autres pays européens, comme la Suisse, la Prusse, l'Angleterre ou les Pays-Bas. L' Encyclopaedia Britannica de 1796 notait que le terme « réfugié » avait été « étendu depuis à tout individu contraint de quitter son pays en période de troubles » 6 ( * )8 , mais selon l'historien Michael Marrus « rien n'indique que cet usage, relevé en 1796, soit très répandu » 6 ( * )9 . Pour lui, « l'absence jusqu'au XIX e siècle (...) d'un terme général pour désigner les réfugiés, est le signe que la conscience européenne ne les intègre pas comme une catégorie ». Jusqu'aux années 80, « le XIX e siècle se préoccupe essentiellement des exilés, individus expatriés pour raisons politiques » 7 ( * )0 . C'est l'exode de presque deux millions et demi de Juifs fuyant l'empire tsariste et d'autres pays d'Europe orientale entre les années 80 et 1914 qui, d'après cet historien, aurait contribué à familiariser les Européens avec le phénomène des réfugiés et amorcé ainsi une prise de conscience. Ce mouvement migratoire en direction de l'Europe occidentale et centrale et des Amériques présentait en effet la spécificité d'être à la fois une migration « économique », de personnes fuyant la misère à la recherche d'un travail et d'une vie meilleure, et un exode provoqué aussi par des raisons religieuses ou politiques, notamment par la volonté de fuir les pogromes et les discriminations dont les Juifs étaient victimes dans l'empire tsariste, surtout depuis le début des années 80. Cet exode de masse ne peut être assimilé que partiellement aux autres mouvements migratoires de la même époque, notamment en direction des États-Unis, qui étaient essentiellement de nature économique 7 ( * )1 . Les Juifs qui partent de l'empire tsariste « représentent un cas intermédiaire (...): ni complètement des réfugiés ni entièrement des émigrés volontaires, ils se rattachent partiellement à l'un et l'autre groupe » 7 ( * )2 .
Aux XIX e siècle le terme « réfugié », dans la mesure où il cessa de désigner exclusivement les protestants français, s'appliquait essentiellement aux réfugiés politiques, qui avaient dû abandonner leur pays à cause de leurs opinions ou activités politiques (qu'elles fussent d'orientation libérale, démocratique-républicaine ou socialiste). Chaque défaite des mouvements libéraux et révolutionnaires, chaque insurrection écrasée, obligèrent de nombreux militants de ces causes à prendre le chemin de l'exil. Paris, Londres, Genève et Bruxelles devinrent les capitales de cette émigration politique, qui comptait dans ses rangs des personnalités comme Giuseppe Mazzini, Karl Marx, Alexandre Herzen, Giuseppe Garibaldi, Adam Mickievitz, Michel Bakounine, Heinrich Heine, pour n'en citer que quelques unes 7 ( * )3 . Ces groupes d'exilés étaient formés surtout d'intellectuels, mais comprenaient également un certain nombre d'artisans et d'ouvriers devenus des militants politiques. Ils constituaient, en tout cas, une élite politique, de dimensions relativement modestes. Yves Lequin note par exemple qu'au total, dans la France de la seconde moitié du XIX e siècle, « les réfugiés politiques ne sont jamais plus de quelques milliers, qui repartent chez eux dès qu'ils le peuvent, les autres se perdant dans l'ensemble de la population française » 7 ( * )4 . La dimension quantitative limitée explique le fait qu'à aucun moment le problème des réfugiés politiques ne se posa alors comme problème international (sauf sous la forme d'une coopération entre les polices de différents pays), exigeant une action coordonnée de la communauté internationale : chaque État qui accueillait des exilés (par ex. la France qui donna asile aux vaincus de l'insurrection polonaise de 1831) était en mesure de faire face à ce problème par ses propres moyens.
C'est à partir de la première guerre mondiale que la notion de réfugié s'imposa définitivement pour désigner un phénomène qui était devenu, de par ses dimensions, un problème international, puisque désormais toute solution au niveau national, comme au XIX e siècle, apparaissait impossible 7 ( * )5 . Cette notion ne s'applique plus seulement aux réfugiés politiques proprement dits, mais aussi à différentes formes de migration forcée que le siècle précédent n'avait pas connues. En effet, si l'exilé est généralement un réfugié (et plus particulièrement un réfugié politique) - c'est d'ailleurs en tant que réfugié qu'il peut prétendre à l'attribution d'un statut juridiquement reconnu 7 ( * )6 -, tous les réfugiés ne sont pas des exilés politiques. C'est en tout cas la question des réfugiés, pas celle des exilés politiques en tant que tels, que la communauté internationale s'est efforcée de régler : il existe, ainsi, un statut juridiquement reconnu du réfugié, mais pas un statut de l'exilé politique.
Le mot « émigré » désignait, à l'origine, les Français, partisans de l'Ancien Régime, qui quittèrent le pays et cherchèrent asile à l'étranger pendant la Révolution française : 7 ( * )7 un exil politique composé surtout d'aristocrates et de membres du clergé, dont le dénominateur commun était l'hostilité à la Révolution. Le mot « réfugié » étant associé en France à l'exil protestant, les exilés contre- révolutionnaires, qui se situaient dans la tradition catholique, s'appelèrent, et furent appelés, « émigrés ». Ce mot fut ensuite utilisé au XIX e siècle par d'autres groupes d'exilés et acquit progressivement une signification plus large, finissant par perdre la connotation exclusivement politique qu'il avait eue initialement et par désigner, comme le précise le Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, toute « personne qui a quitté son pays pour des raisons économiques, politiques, etc., et qui est allée s'installer dans un autre ». Ainsi, par exemple, les Polonais appellent « Grande Émigration » celle du XIX e siècle, qui fut essentiellement politique, « Vieille Émigration » celle de l'entre-deux-guerres, qui fut de nature essentiellement économique, et « Nouvelle Émigration » celle qui va de 1939 aux années 1980 7 ( * )8 . La langue allemande désigne par les mots d'origine française Emigration et Emigranten l'émigration politique, et par Auswanderung et Auswanderer l'émigration économique 7 ( * )9 .
Le mot « immigré » - et il ne faut pas oublier que l'exilé, pour le pays qui l'accueille, est un immigré - est plus récent : comme l'écrit Patrick Weil, « c'est historiquement au moment où la révolution industrielle provoque une immigration de masse que les mots d' « immigration » et d' « immigré » apparaissent » 8 ( * )0 . Le XIX e siècle marqua le début des migrations internationales de masse, en particulier transocéaniques 8 ( * )1 . Dans plusieurs pays d'accueil, une émigration politique, de dimensions restreintes, commença alors à coexister avec une immigration « économique », qui prenait, elle, une dimension de masse. De ce point de vue, le dernier quart du XIX e siècle, qui voit se développer la migration de masse en même temps que la seconde révolution industrielle, la migration de masse, marque, selon Pierre Milza, « un tournant majeur » 8 ( * )2 . Le caractère de masse des mouvements migratoires s'est maintenu, à travers de multiples vicissitudes, tout au long du XX e siècle : la principale nouveauté, par rapport au siècle précédent, a été l'accroissement extraordinaire des migrations forcées, qu'il s'agisse de réfugiés politiques proprement dits ou de réfugiés en général. Le phénomène de l'exil au XX e siècle est donc indissociable du phénomène migratoire. Dans beaucoup de cas l'attitude à l'égard des exilés politiques a été étroitement dépendante de la politique d'immigration mise en oeuvre par tel ou tel pays. Nous reviendrons sur ce point.
Ces précisions à propos des termes employés ne relèvent pas d'un simple souci philologique. Les mots, comme les concepts auxquels ils renvoient, correspondent à des réalités différentes, qu'il faut toujours situer dans leur contexte historique. Ainsi par exemple, s'il est vrai que « émigration » et « immigration » ne sont, au fond, que deux manières différentes de définir le même phénomène - la migration -, vu dans la perspective du pays de départ ou dans celle du pays de réception, on doit toutefois reconnaître que le premier terme conserve une connotation particulière, qui implique non seulement une provenance géographique, mais aussi l'existence et le maintien de certains liens, plus ou moins forts, avec le pays d'origine. Ainsi, dans le cas des réfugiés politiques, on préfère généralement parler, même dans les pays d'accueil, d' « émigration » plutôt que d' «immigration », afin de prendre en compte la spécificité du phénomène. À un niveau plus subjectif, l'étranger vivant dans un pays qui n'est pas ou qui n'est pas encore devenu le sien se considère souvent un « émigré » plutôt qu'un « immigré » 8 ( * )3 . Dans le cas des exilés politiques, à plus forte raison, il est indispensable de prendre en compte cette dimension subjective. L'exil n'est pas seulement une situation objective, mais aussi une expérience que chaque exilé vit de manière individuelle, en fonction de sa subjectivité.
Les réfugiés au XX e siècle : un phénomène de masse et un problème international
Le phénomène des réfugiés acquit en Europe un caractère de masse surtout à partir de la première guerre mondiale, comme conséquence directe des bouleversements politiques et territoriaux qu'elle provoqua. La révolution bolchevique et la guerre civile en Russie, par exemple, causèrent l'exode d'environ deux millions de personnes 8 ( * )4 , auquel aucun pays ne pouvait faire face seul. Le problème des réfugiés changeait ainsi de nature : il ne concernait plus exclusivement ou principalement des groupes restreints d'exilés politiques, comme au siècle précédent, mais désormais des populations entières. Les guerres 8 ( * )5 (mondiales, locales, civiles) et l'instauration de régimes totalitaires ou d'autres types de dictature, ont été les causes principales du flux des réfugiés. Soulignons une fois de plus une évidence : ce sont les régimes autoritaires et dictatoriaux qui « produisent » des réfugiés et des exilés politiques, alors que le régimes démocratiques servent plutôt de lieux d'accueil. De ce point de vue, l'histoire des exils en Europe est étroitement liée à celle de la construction, des transformations et des crises de la démocratie depuis la Révolution française. Le problème de la démocratie est aussi étroitement associé à celui de l'espace politique dont peuvent bénéficier dans le pays d'accueil les exilés qui entendent poursuivre une activité militante. N'importe quel régime politique exerce un contrôle sur l'activité des exilés qu'il accueille sur son territoire, mais les marges de liberté dont ces derniers disposent peuvent varier considérablement ; d'une manière générale, c'est dans les régimes démocratiques qu'elles sont les plus larges. Mais il faut souligner avec force que le phénomène des réfugiés au XX e siècle est aussi et surtout la conséquence du triomphe et de la généralisation de l'État-nation comme modèle dominant de l'organisation politique 8 ( * )6 . La première guerre mondiale et ses conséquences, en particulier la désintégration des empires (austro-hongrois, ottoman, tsariste 8 ( * )7 ), donnèrent une forte impulsion à ce processus. Au lendemain du conflit les frontières 8 ( * )8 européennes furent largement redessinées et plusieurs États nouveaux (la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, les États baltes) apparurent. Ces États incluaient tous des minorités ethniques, qui furent souvent désignées comme ennemies ou considérées comme indésirables par les représentants de l'ethnie majoritaire. Les réfugiés sont donc, en large mesure, les « laissés-pour-compte » du nouvel ordre international issu de la guerre de 1914-1918 et de la fin des empires 8 ( * )9 . La dimension de masse du phénomène apparaît clairement dans les statistiques. Bien que les données puissent varier selon les sources et les critères utilisés, l'ordre de grandeur est de plusieurs millions de personnes. « On estime à au moins 9,5 millions, en 1926, le nombre des exilés européen, dont 1,5 millions échangés de force entre la Grèce et la Turquie, 280.000 échangés de la même manière entre la Grèce et la Bulgarie, 2 millions de Polonais rapatriés, plus deux millions de réfugiés russes et ukrainiens, 250.000 Hongrois et un million d'Allemands venus de divers points d'Europe » 9 ( * )0 . Il faut y ajouter environ 600.000 Arméniens, rescapés du génocide turc. Plus tard, l'Allemagne nazie «produit» à son tour, entre 1933 et 1939, plus d'un demi-million de réfugiés (environ 330.000 en provenance de l'Allemagne proprement dite, 150.000 en provenance d'Autriche, annexée en 1938, et 25.000 des Sudètes) 9 ( * )1 . En 1939 la victoire de Franco dans la guerre civile espagnole provoqua l'exode vers la France d'environ 450.000 républicains espagnols 9 ( * )2 . Au lendemain de la seconde guerre mondiale le phénomène des réfugiés atteint des dimensions encore plus élevées, de l'ordre de dizaines de millions de personnes 9 ( * )3 . Confiné jusque-là pour l'essentiel à l'Europe, il s'étendit ensuite à d'autres continents et devint ainsi un problème mondial.
Par rapport au XIX e siècle, le saut quantitatif est impressionnant. Là où on comptait auparavant par milliers, ou par dizaines de milliers, on compte désormais par centaines de milliers et par millions (et dans certains cas, comme au lendemain de la deuxième guerre mondiale, par dizaines de millions). La notion même de réfugié doit être redéfinie. Avant la première guerre mondiale, « tant que l'Amérique accueill(ait) tout le monde, les Européens n'(eurent) que rarement à se soucier de trouver une nouvelle définition, à se poser la question de leurs responsabilités ou de savoir qui d(evait) être ou non secouru » 9 ( * )4 . Mais les restrictions apportées par les États-Unis à leur politique d'immigration après la guerre et en particulier l'introduction d'un système de quotas, modifièrent radicalement la situation et obligèrent à chercher d'abord en Europe des solutions à un problème qui à ce moment-là était encore un problème essentiellement européen. La question des réfugiés et des exilés politiques apparaît donc indissociable de celle des politiques d'immigration mises en oeuvre par différents pays. En 1944 deux chercheurs pouvaient écrire que « l'histoire des migrations internationales des trente dernières années correspond, pour une large part, à celle de réfugiés » 9 ( * )5 . Ce qui rendit dramatique le problème des réfugiés dans l'Europe de l'entre-deux-guerres fut la conjonction de trois éléments : l'arrivée au pouvoir du nazisme, dont la politique antisémite, imitée par plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, avait pour objectif principal, jusqu'à 1939, de pousser les Juifs allemands à quitter le pays ; l'isolationnisme et la nouvelle politique restrictive des États-Unis en matière d'immigration 9 ( * )6 ; la crise économique mondiale des années 30, qui incita tous les pays à prendre des mesures de protection du marché du travail national et à fermer leurs frontières à l'immigration 9 ( * )7 .
Le problème des réfugiés présentait aussi des formes nouvelles, qui n'existaient pas ou qui n'avaient pas d'importance pratique au siècle précédent, par exemple l'apatridie. Au moment où l'État-nation s'imposait comme le modèle normal de l'organisation politique, bénéficier de la protection d'un État devenait presque une condition de survie. Avoir un passeport - autrement dit, être citoyen d'un État et pouvoir se réclamer de sa protection - devenait infiniment plus important qu'au siècle précédent. Un homme sans passeport, sans papiers d'identité, se trouvait ipso facto dans une situation dramatique 9 ( * )8 . Désormais indispensables pour passer d'un pays à l'autre, les passeports et les visas devinrent l'expression la plus évidente du renforcement des nationalismes. Dans une étude sur le problème des passeports publiée en 1930, Egidio Reale notait que « le régime des passeports et des visas, rétablis pendant la guerre, est devenu d'une sévérité qu'aucune époque n'a connue. Aucune possibilité de passer d'un pays à l'autre sans être pourvu d'un passeport valable délivré par les autorités de son pays, visé par celles du pays où l'on veut se rendre ou par où on est obligé de passer, après une série infinie d'enquêtes et de démarches » 9 ( * )9 . Or, le nombre des personnes ne pouvant se réclamer de la protection d'un État ne fit qu'augmenter, l'une des nouveautés du XX e siècle étant la pratique, appliquée d'abord par les États totalitaires et imitée par d'autres, de priver de la nationalité, pour des raisons politiques, une partie de leurs ressortissants. Inaugurée en octobre 1921 par la Russie soviétique comme mesure punitive à l'égard des émigrés qui refusaient de reconnaître le régime communiste, cette pratique fut reprise ensuite par l'Italie fasciste et, à beaucoup plus grande échelle, par l'Allemagne nazie. En termes quantitatifs, ce sont les mesures de « dénationalisation » prises par le régime bolchevique qui eurent les conséquences les plus graves, puisqu'elles laissèrent sans protection presque un million d'émigrés. C'est d'ailleurs le problème des réfugiés russes qui poussa la Société des Nations (SdN) à intervenir et à instituer à leur intention le fameux « passeport Nansen », un document ensuite attribué aussi à d'autres groupes (par exemple les Arméniens) auxquels la SdN avait décidé d'accorder sa protection. Aux « dénationalisations directes » pratiquées par la Russie communiste, l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie s'ajoutèrent les conséquences de la politique nazie d'expansion et d'annexion. En 1938, à la suite de l' Anschluss, l'Autriche cessa d'exister comme État indépendant, et l'année suivante la Tchécoslovaquie et la Pologne connurent le même sort. Des millions de personnes se trouvèrent ainsi, presque du jour au lendemain, dans la situation de ressortissants d'États qui n'existaient plus. Leurs documents d'identité n'avaient plus aucune valeur. Le problème des réfugiés atteint son point culminant en 1938-1939, au moment même où les « murs de papiers » - pour reprendre l'expression de l'historien américain David Wyman 1 ( * )00 - qui barraient l'entrée des États-Unis et d'autres pays aux réfugiés européens devenaient presque infranchissables.
Dans l'Europe du XX e siècle, le simple fait d'appartenir à un certain groupe ethnique, à une minorité, à une communauté discriminée et persécutée, pouvait désormais suffire pour transformer en réfugié même une personne parfaitement étrangère à la politique, alors qu'aux siècles précédents les réfugiés étaient généralement des personnes impliquées activement dans la politique. Par rapport à l'ensemble des réfugiés, les réfugiés politiques proprement dits constituent désormais une minorité, bien que leur nombre se soit aussi fortement accru. Sur le demi million de réfugiés du Troisième Reich, par exemple, seulement quelques dizaines de milliers étaient des opposants politiques déclarés ; la grande majorité, en revanche, était composée de Juifs, persécutés en tant que Juifs, c'est-à-dire pour ce qu'ils étaient, non pour ce qu'ils pensaient ou qu'ils avaient fait sur le plan politique. 1 ( * )01 Cet exemple oblige à s'interroger sur la notion de réfugié politique et sur son contenu exact. Faut-il considérer comme des réfugiés politiques les émigrés juifs qui ont quitté l'Allemagne hitlérienne ou l'Autriche annexée? La réponse dépend, de toute évidence, de ce qu'on considère comme relevant du politique. Au sens large, il s'agit incontestablement de réfugiés politiques, puisque ce sont des causes politiques - notamment la persécution organisée par le régime nazi - qui les ont poussés à partir. D'un autre côté, vu que la plupart d'entre eux n'avaient eu aucune activité politique antérieure et n'aspiraient pas à s'engager politiquement, on ne peut pas les assimiler à des réfugiés politiques au sens étroit, comme les militants sociaux-démocrates ou communistes, dont la politique avait été l'activité principale et qui durent s'exiler précisément pour cette raison. La notion de réfugié politique peut donc être définie de manière plus ou moins large ou plus ou moins étroite, en fonction de ce qu'on considère comme étant spécifiquement politique. La distinction entre les réfugiés politiques au sens étroit et les autres est importante parce que, le plus souvent, le comportement de ces deux groupes diffère considérablement. Les militants politiques exilés se caractérisent en général par un attachement très fort au pays d'origine, vers lequel leur regard reste tourné, et par la volonté de continuer à lutter contre le régime responsable de leur exil : émigrés involontaires, ils aspirent au retour, et, s'ils continuent la lutte dans le pays d'accueil, c'est précisément dans le but de changer la situation politique dans le pays d'origine afin de pouvoir y retourner. Cette attitude ne favorise pas une intégration définitive dans le pays d'accueil. Dans le cas de l'Allemagne, les émigrés politiques des années 30 retournèrent, en général, dans leur pays après la fin de la seconde guerre mondiale. Au contraire, la plupart des réfugiés juifs s'établirent définitivement dans les pays d'accueil : pour eux, « l'émigration devint un acte de séparation » 1 ( * )02 , une rupture définitive avec la patrie d'origine. De manière analogue, seule une minorité des artistes, écrivains et universitaires allemands émigrés pendant le Troisième Reich rentra au pays après 1945.
Déjà avant 1914 l'émigration de masse de Juifs de Russie et d'Europe orientale ne pouvait pas être considérée une simple migration économique, compte tenu de l'importance des facteurs politiques ou religieux comme cause de départ 1 ( * )03 . Dans l'entre-deux-guerres, le problème des réfugiés européens concerna surtout les Juifs, contraints ou incités à partir non seulement d'Allemagne et d'Autriche, mais aussi de Pologne, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Italie. Cette position centrale des Juifs dans les exils européens ne se maintint, après la seconde guerre mondiale, que dans le cas de l'URSS, où les personnes autorisées à quitter le pays à partir des années 70 furent essentiellement des Juifs (et dans une moindre mesure des citoyens soviétiques d'origine allemande).
L'élaboration d'un statut international du réfugié
La distinction, déjà évoquée, entre les réfugiés statutaires et les autres, qui s'imposa à partir des années 20, est importante, car elle avait des conséquences pratiques considérables. Seulement les premiers, en effet, c'est-à-dire les réfugiés qui étaient reconnus comme tels, avaient droit à une certaine protection de la part de la communauté internationale. L'élaboration d'un statut international du réfugié, dont l'aboutissement a été la convention de Genève de 1951, commença après la première guerre mondiale et se fit en différentes étapes. Lorsque la SdN, à peine créée, se trouva confrontée au problème des réfugiés, elle l'envisagea en un premier temps comme un problème conjoncturel pouvant être résolu assez rapidement par le rapatriement des personnes concernées, comme on l'avait déjà fait avec les prisonniers de guerre. C'est pourquoi elle en confia la responsabilité à l'explorateur norvégien Fridtiof Nansen, qui s'était occupé avec succès du rapatriement des prisonniers de guerre entre la Russie bolchevique (qui n'était alors reconnue par aucun autre État) et les autres pays concernés. Mais le retour des réfugiés, notamment russes et arméniens, s'avéra impossible, alors même que de nouveaux groupes venaient s'ajouter sans cesse aux premiers. Les dimensions prises par le phénomène incitaient à « rechercher une réglementation juridico-diplomatique et à créer en même temps des organismes internationaux de tutelle » 1 ( * )04 , mettant ainsi le problème du statut du réfugié au centre du droit international. Le chemin choisi par la SdN fut celui d'une politique au coup par coup : on élabora des conventions internationales et des mesures spécifiques destinées à tel ou tel groupe particulier de réfugiés, en provenance d'un certain pays (les Russes, les Arméniens, etc.), sans affronter le problème dans son ensemble. La protection fut donc accordée à certains groupes seulement, pas à tous ceux qui auraient pu y prétendre. Ainsi, par exemple, les exilés antifascistes italiens ne furent jamais reconnus comme réfugiés statutaires et ne bénéficièrent à aucun moment d'une protection particulière : ils étaient, et restèrent, des réfugiés de facto. Tout au long de l'entre-deux-guerres le critère essentiel et pratiquement unique pour être reconnu comme réfugié fut donc celui de l'appartenance à un certain groupe ethnique ou provenant d'une certaine aire géographique, auquel la SdN avait décidé de s'intéresser : Russes, Arméniens, Assyro-Chaldéens, Syriens, Kurdes, Turcs, réfugiés « en provenance d'Allemagne », Espagnols. Un premier pas vers une définition plus générale fut réalisé par la convention internationale approuvée en 1933, qui définissait le réfugié comme une personne « qui ne jouit pas ou ne jouit plus de la protection de son pays », mais cela n'entraîna aucune conséquence pratique, parce que le texte ne faisait qu'énumérer, ensuite, les groupes reconnus comme réfugiés. Celui qui ne faisait pas partie de l'un de ces groupes, même s'il ne bénéficiait pas ou plus de la protection de son pays, n'était pas reconnu comme réfugié.
Seule la Convention de Genève de 1951 mit fin à la pratique qui consistait à définir les réfugiés d'après une liste de pays de provenance, et aboutit à une définition générale et universelle du réfugié. D'après cette définition, doit être considérée comme réfugiée toute personne « qui par suite d'événements survenus avant le 1 er janvier 1951 et craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». L'universalité de la définition était en réalité réduite par la limite chronologique choisie, ainsi que par le fait qu'elle laissait aux États la faculté de la circonscrire géographiquement à la seule Europe. L'article précisait en effet que les mots « événements survenus avant le 1 er janvier 1951 » pouvaient être compris soit dans le sens de « survenus en Europe », soit dans le sens de « survenus en Europe ou ailleurs ». Bien que ces limites géographiques et temporelles aient été ensuite supprimées, la Convention de Genève avait été conçue dans une optique essentiellement européenne 1 ( * )05 et pour répondre à un problème qui était encore, pour l'essentiel, un problème européen. Malgré ces limites, elle marqua une étape décisive dans la définition d'un statut international du réfugié. Encore faut-il qu'elle se traduise dans les faits. Une convention internationale ne devient opérationnelle, en effet, que si elle est ratifiée par les États et que si ces derniers promulguent ensuite une réglementation appropriée. De ce point de vue, la question des réfugiés est étroitement liée à celle du droit d'asile, qu'on peut définir comme le « droit pour un État d'ouvrir ses frontières aux réfugiés politiques et de refuser leur extradition à l'État poursuivant » 1 ( * )06 . C'est un domaine où chaque État reste entièrement souverain, puisque la décision d'accorder ou de refuser l'asile dépend entièrement et exclusivement de lui. IL n'existe donc pas, en réalité, un droit d'asile, dans le sens d'un droit du réfugié à se voir accorder l'asile, mais simplement un droit à demander l'asile 1 ( * )07 .
La France comme pays refuge
La France occupe une place importante en tant que pays d'accueil, dans la géographie des exils européens du XX e siècle, pour différentes raisons : la continuité du régime démocratique - interrompue seulement de 1940 à 1944 -, alors même que ce dernier connaissait une éclipse prolongée dans beaucoup d'autres pays européens ; la proximité géographique avec certains pays de dictature ; l'existence de liens culturels ou politiques privilégiés avec certains pays (européens, comme la Pologne ou l'Italie, ou extra-européens, comme ses anciennes colonies) ; la nécessité de main- d'oeuvre (qui, dans certaines périodes comme les années 20 ou les années 60, permit à de nombreux réfugiés politiques de s'insérer sans trop de difficulté dans le marché du travail) ; l'attraction exercée par le mythe de la France comme patrie des droits de l'homme et de la Révolution de 1789. Des émigrations politiques très différentes, venant d'Europe et d'ailleurs, s'établirent sur le sol français au cours du siècle : Arméniens rescapés du génocide turc, Russes fuyant la guerre civile et le régime soviétique, antifascistes italiens et allemands, républicains espagnols, réfugiés chiliens et d'autres dictatures militaires latino-américaines 1 ( * )08 , réfugiés des dictatures communistes d'Europe et d'Asie, etc. Une partie de ces exilés y est restée définitivement. Pour d'autres, la France a été simplement une étape dans un itinéraire d'exil qui les a conduits vers d'autres pays 1 ( * )09 . Certains se sont réfugiés en France après avoir dû quitter un autre lieu d'exil, comme les mencheviks russes qui s'étaient d'abord établis en Allemagne 1 ( * )10 , ou les sociaux-démocrates allemands et autrichiens qui avaient été accueillis en Tchécoslovaquie jusqu'à 1938. Lorsque la seconde guerre mondiale éclata, la France était devenue le principal pays d'accueil des réfugiés politiques en Europe 1 ( * )11 : un accueil parfois contraint et forcé, qu'elle aurait préféré éviter et qui fut parfois absolument déplorable, comme dans le cas des républicains espagnols en 1939 1 ( * )12 ; mais accueil tout de même, au moment où les frontières se fermaient partout et où le nombre des pays démocratiques pouvant offrir asile aux persécutés politiques ne faisait que diminuer.
L'analyse du cas français suggère quelques observations de portée plus générale. On constate tout d'abord que le phénomène de l'exil politique est resté pendant la plupart du XX e siècle une question essentiellement intra-européenne, puisque la plupart des réfugiés établis en France venaient d'autres pays européens. À partir des années 70, par contre, le nombre des exilés et réfugiés extra-européens augmenta fortement et constamment, alors même que celui des exilés européens établis dans l'Hexagone diminuait grâce à la disparition des dernières dictatures fascistes et plus tard des régimes communistes d'Europe centrale et orientale.
Avant 1945, l'afflux de réfugiés politiques en France avait été provoqué surtout par l'instauration de régimes fascistes ou autoritaires dans plusieurs pays européens, tandis que celui provenant de la Russie communiste, très important pendant les premières années de la révolution, s'était arrêté avec le verrouillage des frontières par le régime bolchevique dans les années 20 1 ( * )13 . La plupart de ces réfugiés cherchèrent d'abord à rester en Europe, s'établissant de préférence dans un pays proche de celui qu'ils avaient dû quitter. Seulement en un deuxième temps une partie se décida à tenter d'émigrer plus loin, en particulier au-delà de l'Atlantique, quand la possibilité se présenta. La défaite de la France en 1940, l'occupation allemande (et italienne) et l'installation d'un régime collaborationniste à Vichy transformèrent l'Hexagone en un immense piège, d'où les réfugiés politiques antifascistes qui y avaient cherché asile avaient intérêt à s'échapper s'ils voulaient sauver leur vie. Une partie réussit à le faire et trouva refuge aux États-Unis, au Mexique ou ailleurs ; d'autres, au contraire, tombèrent aux mains de la Gestapo, de la police italienne ou de celle de Vichy et connurent souvent un destin tragique ; d'autres encore plongèrent dans la clandestinité et participèrent à la Résistance 1 ( * )14 .
Après 1945, les deux régimes de type fasciste qui avaient survécu, le franquisme et le salazarisme, continuèrent à pousser vers l'exil les opposants, dont beaucoup s'établirent en France, où il y avait déjà une forte présence d'exilés espagnols arrivés en 1939 1 ( * )15 . Des dictatures militaires, notamment en Grèce et en Turquie, provoquèrent également leur lot d'exilés, qui s'installèrent en partie en France. Mais la quantité la plus importante d'exilés politiques européens après 1945 fut produite par les régimes communistes d'Europe centrale et orientale. La prise du pouvoir par les communistes en Tchécoslovaquie en 1948, l'écrasement de la révolution hongroise de 1956 par les chars soviétiques, l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie en 1968 1 ( * )16 , et les crises politiques à répétition ( 1956, 1970, 1976, 1981 ) en Pologne, donnèrent lieu à autant d'exodes, qui se dirigèrent en partie vers l'Europe occidentale et en partie vers l'Amérique du Nord ou d'autres continents. Entre temps, l'Allemagne communiste continua à se vider régulièrement d'une partie de sa population au bénéfice de la RFA jusqu'à la construction du Mur de Berlin en 1961 1 ( * )17 . Après 1989, la disparition des régimes communistes en Europe centrale et orientale et leur remplacement par des régimes démocratiques (quels que soient leurs limites ou insuffisances) a interrompu le flux de réfugiés politiques en provenance de ces pays. Le seul pays communiste européen à avoir produit des réfugiés après 1989 a été l'ex-Yougoslavie, où l'ultranationalisme serbe a été à l'origine de guerres meurtrières.
L'accueil et l'insertion des réfugiés politiques provenant des pays communistes ne posèrent pas de gros problèmes, que ce soit en France ou dans d'autres pays d'Europe occidentale, d'un côté parce que la plupart d'entre eux arrivèrent pendant une période de croissance économique (les « trente années glorieuses » qui vont du lendemain de la guerre à la moitié des années 70), de l'autre parce que, dans la situation de la guerre froide, leur insertion constituait une priorité politique. Inversement, les pays communistes est-européens et l'URSS accueillirent un certain nombre d'exilés politiques communistes fuyant des dictatures de droite (d'Europe ou d'ailleurs).
L'Union soviétique constitue un cas à part dans la problématique de l'exil. En tant que pays d'accueil, elle a joué un rôle à la fois limité et important : limité, parce que, globalement, elle n'a admis sur son territoire qu'une quantité assez limitée de réfugiés politiques, généralement communistes ; 1 ( * )18 important, parce que, parmi les communistes étrangers exilés à Moscou, beaucoup occupèrent ensuite des fonctions importantes dans les gouvernements et l'appareil d'État des « démocraties populaires » ou dans les partis communistes occidentaux. En tant que pays de départ, la fermeture quasi hermétique des frontières soviétiques empêcha pendant des décennies toute émigration. À partir des années 70 une possibilité de départ s'ouvrit, avec beaucoup de difficultés, pour un secteur de la population, les Juifs. Depuis, l'émigration juive en direction d'Israël ne s'est plus interrompue. Les Juifs d'origine soviétique constituent désormais un pourcentage non négligeable de la population israélienne et sont devenus un enjeu politique important. Par ailleurs, beaucoup de Juifs soviétiques ont émigré aussi vers d'autres pays, en particulier vers les États- Unis. C'est une émigration à la fois politique, qui exprime un rejet du système politique soviétique ou post-soviétique, et économique, qui correspond, surtout depuis la perestroïka et la disparition de l'URSS, à la volonté d'échapper à des conditions de vie très difficiles. Parallèlement, depuis les années 70 l'URSS expulsa ou laissa partir un certain nombre de dissidents (Alexandre Soljénitsyne, Andreï Siniavski, Leonid Plioutch, Vladimir Boukovsky, Andreï Amalrik, Iouri Orlov, etc.). Bien que peu nombreux, ils ont exercé une influence considérable sur l'opinion publique occidentale et ont contribué largement à façonner l'image de l'URSS en Occident. À l'heure actuelle, le problème des réfugiés en Russie et dans la CEI (Communauté des États Indépendants) concerne essentiellement les minorités russes de 1' « étranger proche » (comme on appelle en Russie les pays limitrophes qui faisaient autrefois partie de l'URSS ou qui sont encore inclus dans l'actuelle CEI) et les populations de républiques (surtout du Caucase et d'Asie centrale) impliquées dans des heurts ethniques ou dans des guerres de type colonial. Il s'agit de réfugiés au sens large, plutôt que de réfugiés spécifiquement politiques.
Au cours des trente dernières années l'Europe, ou plus exactement l'Europe occidentale, est devenue un pôle d'attraction pour un nombre croissant de réfugiés et d'exilés extra-européens. Les demandeurs d'asile, autrefois en grande majorité européens, viennent de plus en plus d'autres continents. L'Amérique latine a été fort représentée, parmi les demandeurs d'asile, à l'époque des dictatures militaires, entre les années 60 et les années 80, et d'une manière générale les exilés latino-américains ont été accueillis assez libéralement. Les portes se sont ouvertes facilement aussi pour certains réfugiés asiatiques en provenance de pays communistes, comme par exemple les Vietnamiens dans les années 70. Toutefois, au fur et à mesure que le problème se mondialisait, les politiques d'accueil des États européens - qui ont cessé, eux, de produire des réfugiés - sont devenues progressivement plus restrictives. Obtenir l'asile dans l'Union européenne, par exemple, est devenu beaucoup plus difficile que dans le passé. Les dispositions de la convention de Genève de 1951, élaborées à partir de l'expérience européenne, n'apparaissent pas toujours adaptées aux nouvelles réalités des exils extra-européens qui se dirigent vers l'Europe 1 ( * )19 . D'autre part, dans un contexte de mondialisation économique il est devenu de plus en plus difficile de distinguer le réfugié politique de l'immigré économique. La mise en oeuvre par de nombreux pays européens de politiques restrictives en matière d'immigration depuis les années 70 a incité en effet de nombreux candidats à l'immigration à se présenter plutôt comme demandeurs d'asile, parce qu'ils estiment avoir ainsi de meilleures chances d'être acceptés. Plusieurs États, à commencer par la République fédérale allemande, ont répondu à cette arrivée d'immigrés/réfugiés en modifiant dans un sens restrictif leur législation et en adoptant des procédures administratives qui permettent d'exclure de l'asile la plupart des demandeurs.
L'exil comme composante du phénomène migratoire
L'exil, en tant que migration forcée pour des raisons politiques, est un aspect du phénomène migratoire plus en général. Les liens et les points de contact entre migrations politiques et migrations économiques sont nombreux 1 ( * )20 . Les unes et les autres s'effectuent par vagues, et empruntent souvent les mêmes chemins 1 ( * )21 . Parfois, les deux phénomènes sont étroitement parallèles et se développent en même temps. Ainsi, par exemple, la France des années 20, qui avait un fort besoin de main-d'oeuvre, a accueilli en même temps plusieurs centaines de milliers de travailleurs italiens et des dizaines de milliers d'exilés politiques antifascistes, qui étaient d'ailleurs, pour la plupart, des travailleurs manuels 122 . Les émigrés politiques ont cherché le plus souvent à s'établir dans des pays où étaient déjà installées des communautés de compatriotes, parce qu'ils y rencontraient des conditions plus favorables tant pour la recherche d'un travail que pour la poursuite d'une activité militante. L'émigration économique, d'autre part, a été dans beaucoup de cas un réservoir de militants et de futurs cadres pour les organisations politiques exilées. La géographie de l'exil politique se superpose en partie à celle des diasporas économiques. En partie seulement, toutefois, parce que les logiques qui président aux deux types de migration ne sont pas exactement les mêmes. Les émigrés politiques cherchent, en général, à ne pas trop s'éloigner géographiquement du pays d'origine, parce que la proximité permet de maintenir plus facilement les contacts avec ce dernier et peut rendre plus aisée l'action politique en direction de la patrie. Ainsi, les exilés antifascistes italiens se sont concentrés surtout en France et en partie en Suisse, et les exilés politiques allemands ont cherché à poursuivre la lutte contre le nazisme à partir des pays limitrophes, comme la Tchécoslovaquie, la France, la Belgique ou le Danemark. L'éloignement géographique devient souvent un éloignement politique. Mais surtout, les exilés cherchent à maintenir et à faire vivre un espace politique à l'étranger, et cela dépend de la politique (intérieure, extérieure, d'immigration) du pays d'accueil. C'est en effet le pays d'accueil qui fixe les limites de l'activité politique que peuvent développer les réfugiés. Ainsi, quand ils ont la possibilité de choisir, les exilés s'orientent vers certains pays plutôt que vers d'autres.
Très souvent les motivations qui poussent au départ sont à la fois économiques et politiques, sans qu'on puisse faire la distinction entre les deux. IL est impossible, en réalité, de tracer une ligne de séparation nette entre migration économique et migration politique, même si cette distinction est utile du point de vue analytique. De toute manière, pour les pouvoirs publics (et la population) du pays d'accueil l'exilé politique est d'abord un étranger et un immigré, et la manière dont il est traité dépend du traitement que le pays réserve à ces deux catégories. La législation de certains pays ne fait pas de différence entre les immigrés du travail et les réfugiés politiques, qui relèvent donc de la politique générale d'immigration 1 ( * )23 .
Les conditions de l'accueil des réfugiés politiques dépendent largement de la conjoncture économique et en particulier de la situation du marché du travail : elles sont plus favorables dans les périodes d'expansion économique et de pénurie de main-d'oeuvre, et plus difficiles, par contre, dans les périodes de crise économique et de chômage 1 ( * )24 . Cette règle générale connaît naturellement des exceptions, dans le sens que des considérations d'ordre politique peuvent l'emporter sur celles de nature exclusivement économique. Chaque État, en effet, tend à privilégier, pour des raisons politiques qui lui sont propres, certaines catégories de réfugiés. Avant la chute du Mur de Berlin, les réfugiés en provenance des pays communistes (d'Europe orientale ou d'ailleurs) obtenaient facilement l'asile politique en Europe occidentale. Il y avait sans doute parmi eux un certain pourcentage, impossible à déterminer avec exactitude, de personnes ayant choisi d'émigrer pour des raisons économiques plutôt que politiques, mais tous avaient intérêt à se présenter comme demandeurs d'asile, puisqu'ils étaient pratiquement sûrs qu'on leur accorderait le statut de réfugiés politique et donc le permis de travail. Dans la seconde moitié des années 70, alors même qu'elle venait de mettre fin officiellement à l'immigration, la France a accueilli, pour des raisons politiques, un grand nombre de réfugiés indochinois (les boat people).
L'Europe est restée un lieu d'émigration vers d'autres continents et en particulier vers les Amériques jusqu'au milieu du XX e siècle. Les courants migratoires ont commencé ensuite à s'inverser, et elle est devenue à son tour un pôle d'attraction tant pour des immigrés économiques que pour des réfugiés politiques d'autres continents. Ce renversement de situation est lié avant tout à l'expansion économique prolongée d'après-guerre, qui a transformé l'Europe occidentale en une zone globalement prospère et bénéficiant d'un niveau de vie élevé. Il est lié aussi à la stabilisation démocratique de cette région, où le modèle de la démocratie parlementaire, basée sur le pluralisme politique, s'est imposé comme la forme « normale » d'organisation de la vie publique. Les dernières dictatures de la région, que ce soit de type fasciste ou fascisant comme en Espagne et au Portugal ou militaire comme dans la Grèce des colonels, ont cédé la place dans les années 70 à des régimes démocratiques. L'Europe occidentale, qui n'a plus connu de guerres depuis 1945 1 ( * )25 , a cessé de produire et d'exporter des exilés. Quant à l'Europe de l'Est, la disparition des dictatures communistes, remplacées à leur tour par des démocraties parlementaires, a mis fin à l'émigration politique en provenance de cette région 1 ( * )26 , où certains pays, comme la Pologne ou la République tchèque, deviennent à leur tour un pôle d'attraction pour une immigration économique et aussi, en partie, de réfugiés politiques ou qui se présentent comme tels. La principale exception, dans ce tableau, est représentée Yougoslavie, avec son cortège de réfugiés à la suite des guerres et du « nettoyage ethnique » déclenchés par le dictateur serbe. Il faut toutefois noter que le régime national-communiste a été essentiellement un prolongement, en version ultra- nationaliste, du régime communiste antérieur, par rapport auquel il n'y a pas eu d'authentique rupture.
Au XX e siècle le phénomène de l'exil s'est amplifié et mondialisé, perdant ainsi le caractère principalement européen qu'il avait encore au siècle précédent 1 ( * )27 . Il s'est aussi « démocratisé » et « prolétarisé », dans le sens qu'il a concerné non seulement une élite politique et intellectuelle issue surtout des couches supérieures ou moyennes de la société, mais aussi, et massivement, les couches populaires 1 ( * )28 . Les exilés ont continué à être, comme déjà au siècle précédent 1 ( * )29 , des vecteurs privilégiés d'influences politiques et culturelles, que ce soit en direction des pays d'accueil ou bien des pays de départ. Il suffit de penser, par exemple, à l'influence exercée par l'émigration intellectuelle allemande pendant le Troisième Reich sur les sciences sociales américaines 1 ( * )30 , ou à la diffusion de la musique et de la culture chiliennes en Europe par les exilés chiliens dans les années 70 et 80, ou encore à l'influence de la culture espagnole en Amérique latine, et au Mexique en particulier 1 ( * )31 , grâce aux réfugiés républicains espagnols accueillis dans ce continent. Sur le plan politique, on peut rappeler également l'influence des exilés politiques au sein des Internationales ouvrières 1 ( * )32, et plus spécifiquement, pour l'entre-deux-guerres, de l'Internationale Ouvrière Socialiste (IOS) et du Komintern 1 ( * )33 . Grâce à l'exil se sont tissés des réseaux de contacts et de solidarité politique non seulement d'un pays européen à un autre, mais aussi d'un continent à l'autre 1 ( * )34 . C'est l'existence de ces réseaux, par exemple, qui en 1940-1941 a permis à des centaines de réfugiés politiques de différentes nationalités d'obtenir les visas et les moyens nécessaires pour quitter la France et échapper ainsi à la Gestapo grâce à l'intervention d'organisations américaines comme le Jewish Labor Committee ou l' Emergency Rescue Committee 1 ( * )35 .
Esquisse de typologies
Du point de vue politique, les exils européens du XXe siècle présentent un panorama très varié, qui inclut pratiquement toutes les familles politiques, de l'extrême-droite à l'extrême-gauche. On peut tenter, avec beaucoup de précaution, de les regrouper sous quelques grandes catégories. L'une de ces catégories est celle de l'exil antifasciste, qui inclurait l'émigration politique italienne depuis le début des années 20, l'émigration allemande à partir de 1933, l'émigration sarroise de 1935, l'émigration autrichienne a partir de 1934, l'émigration espagnole à partir de 1939 (ou déjà de la guerre civile), l'émigration portugaise sous la dictature de Salazar. Le dénominateur commun de toutes ces émigrations, qui se situent pour l'essentiel avant 1945 (avec l'exception des émigrations ibériques), est d'avoir été provoquées par l'installation au pouvoir de régimes fascistes ou fascisants. Mais il ne faut pas oublier, naturellement, qu'il y a de grandes différences entre elles, en particulier d'orientation politique (puisqu'on y trouve des socialistes, des communistes, des anarchistes, des libéraux, des républicains, des catholiques). Après 1945, cette catégorie devient résiduelle et n'inclut plus que les émigrations politiques ibériques et, d'une certaine manière, l'émigration politique grecque 1 ( * )36 . Une autre catégorie est celle de l'émigration issue du mouvement ouvrier, qui coïncide en partie avec l'émigration antifasciste et dans laquelle on classerait notamment l'émigration communiste, socialiste/social-démocrate et anarchiste. Bien que le groupement soit plus homogène que dans le cas de l'exil antifasciste, il présente aussi des différences internes considérables. L'émigration juive est une catégorie générale, qui permet de regrouper le cas de pays aussi différents que l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, mais aussi la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, bref l'ensemble des pays qui ont adopté dans l'entre-deux-guerres des politiques antisémites et provoqué ainsi le départ d'une partie de la population juive. Après la seconde guerre mondiale cette catégorie concerne, en Europe, presque exclusivement les Juifs soviétiques/russes. Une autre catégorie, qui se superpose en partie à la précédente, est celle des émigrations politiques venant des pays communistes : elles présentent aussi, au-delà du dénominateur commun constitué par l'anticommunisme, une grande diversité. Une autre catégorie, qui a été peu étudiée jusqu'à présent, est celle de l'exil d'extrême-droite, en particulier fasciste et nazi. On ne connaît pas les dimensions exactes du phénomène, mais on sait qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale un nombre considérable de nazis et de fascistes, parmi lesquels beaucoup de criminels de guerre, a trouvé refuge en dehors de l'Europe, en particulier en Amérique latine, mais aussi, pour certains d'entre eux, en Espagne. Dans cette catégorie on inclurait également les terroristes de l'OAS qui se sont réfugiés en Espagne ou au Portugal après la fin de la guerre d'Algérie. Ce type d'exil est assez différent de tous ceux que nous avons passés en revue jusqu'ici dans la mesure où les personnes concernées fuyaient même des régimes démocratiques et où beaucoup d'entre elles étaient responsables de crimes atroces : il s'agit donc d'une émigration politique à forte connotation criminelle. Quant aux exilés provenant d'autres continents et qui se sont installés en Europe, on peut distinguer plusieurs groupes, ayant chacun un certain nombre de caractéristiques communes : le groupe latino- américain, celui en provenance des ex-colonies, celui issu des pays communistes extra-européens (principalement asiatiques).
Il existe donc toute une série de catégories possibles pour tenter de classifier les exils européens, mais ont voit immédiatement qu'elles n'ont qu'une valeur relative et qu'elles doivent être maniées avec infiniment de précautions, car un même exil peut figurer dans plusieurs catégories à la fois. Une distinction intéressante est celle qui concerne la durée des exils. La durée, en effet, modifie inévitablement la perspective de l'exilé 1 ( * )37 . Nous avons déjà noté que l'aspiration au retour, typique des exilés politiques, constitue un frein à l'intégration dans le pays d'accueil. Mais lorsque l'exil se prolonge indéfiniment, pendant des décennies, et que la perspective du retour devient de plus en plus incertaine et improbable, l'exilé se voit contraint d'organiser durablement sa vie dans le nouveau pays. Il se transforme ainsi, dans beaucoup de cas, en un immigré comme les autres, et peut pousser la volonté d'intégration jusqu'à prendre la nationalité du pays d'accueil. On doit donc se demander, quand on étudie les phénomènes d'exil, jusqu'à quand l'exilé continue de se considérer comme tel et à partir de quel moment il devient autre chose. Ce problème est lié, bien évidemment, au problème des générations, tant biologiques que politiques. L'âge compte : une chose est de s'exiler à vingt ou trente ans, quand on a encore toute la vie devant soi, et autre chose de le faire à l'âge mûr, quand il est beaucoup plus difficile de se reconstruire une autre existence. L'appartenance à telle ou telle génération politique joue aussi son rôle. Et influe sur la manière de vivre l'expérience de l'exil et d'en tirer des enseignements. Dans le cas de responsables politiques, l'exil, s'il est bref, peut représenter simplement une étape dans une carrière qui se poursuivra après le retour. Un exil prolongé, en revanche, signifie souvent l'impossibilité de retrouver un rôle politique dans le pays d'origine, avec lequel le contact a été interrompu pendant trop longtemps. On peut donc distinguer les exils de courte durée et ceux qui, comme l'exil des républicains espagnols ou les exils des années 40 et 50 en provenance des pays communistes, se sont éternisés pendant des générations. En tout cas, l'exil doit être considéré comme un itinéraire non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, qui peut aboutir à toute une série de transformations. Un exilé peut se transformer en un immigré, et inversement un immigré «économique» peut se politiser à l'étranger, au contact des exilés, et finir par devenir lui-même un exilé 1 ( * )38 .
Conclusions
Les exils politiques représentent un aspect important de l'histoire européenne au XX e siècle. Par rapport à ceux du siècle précédent, ils se distinguent quantitativement, parce qu'ils concernent un nombre de personnes beaucoup plus élevé, et socialement, par leur composition moins élitaire et beaucoup plus populaire et prolétarienne. Mais surtout, ils s'inscrivent dans un phénomène beaucoup plus vaste, caractéristique du XXe siècle, celui des réfugiés, qui a pris des proportions de masse, surtout depuis la première guerre mondiale. À l'origine de ce phénomène il y a plusieurs causes : la généralisation de l'État-nation comme modèle d'organisation politique, et donc la montées des nationalismes, intolérants vis-à-vis des minorités ethniques ; les guerres, en particulier les deux guerres mondiales, mais aussi les guerres civiles (Russie, Espagne, Grèce) et locales (Yougoslavie) ; l'instauration de dictatures, que ce soit de type fasciste/autoritaire (Italie, Allemagne, Espagne, Portugal, etc.) ou communiste (Russie/URSS et Europe orientale) ; les processus de décolonisation. Les dimensions du phénomène en ont fait un problème véritablement international, d'abord à l'échelle européenne et ensuite à l'échelle mondiale, et ont obligé la communauté internationale à chercher des solutions et à définir, en différentes étapes, un statut international du réfugié. Dans les années 30 la grande majorité des réfugiés est composée de Juifs, qu'aucun pays n'est prêt à accueillir.
Dans la première moitié du siècle les exils européens sont la conséquence surtout de la révolution bolchevique en Russie et des régimes fascistes et autoritaires, en particulier du régime nazi. Dans la seconde moitié, par contre, la majorité des exilés européens provient des pays communistes d'Europe centrale et orientale. Au cours de cette période l'Europe occidentale se transforme en une zone de prospérité économique et de stabilité politique, où les dernières dictatures (Espagne, Portugal, Grèce) laissent la place dans les années 70 à des régimes démocratiques. L'Europe occidentale cesse ainsi de produire des réfugiés et des exilés politiques et devient, au contraire, un pôle d'attraction pour des réfugiés et exilés non seulement de l'Europe communiste, mais aussi d'autres continents. Par ailleurs, dans les années 50 les courants migratoires « économiques » commencent à s'inverser. À l'émigration européenne vers les Amériques succèdent désormais une immigration de main- d'oeuvre provenant d'autres continents vers l'Europe ou des migrations intra- européennes. Avec la disparition des dictatures communistes est-européennes, remplacées par des régimes démocratiques, cesse également l'afflux de réfugiés et exilés politiques provenant de ces pays.
La géographie de l'exil tend souvent à recouper celle des migrations économiques, et il est d'ailleurs impossible de distinguer de manière nette les deux types de migration, politique et économique. La conjoncture économique, quant à elle, influe directement sur l'accueil réservé aux exilés, plus favorable en période de croissance économique qu'en période de crise et de chômage.
« Exilé », « réfugié », « émigré » restent des notions problématiques, difficiles à définir d'une manière entièrement satisfaisante. Celle de réfugié a beaucoup évolué depuis le XIX e siècle, lorsqu'elle désignait essentiellement les exilés politiques. Elle est devenue plus large mais aussi moins précise, à l'image du phénomène qu'elle désigne, dont les réfugiés et exilés politiques ne sont qu'une partie. L'exil s'est mondialisé. Il est possible de construire une typologie des exils européens, en les regroupant sous différentes catégories, mais cette opération n'a qu'une valeur limitée, compte tenu de l'extrême complexité du phénomène.
Dans cette esquisse, inévitablement sommaire, des exils européens au XX e siècle j'ai dû laisser de côté un certain nombre de problèmes importants. J'en cite simplement quelques uns. Celui du retour des exilés mériterait une attention toute particulière du point de vue de l'histoire politique européenne, compte tenu du rôle que beaucoup d'entre eux ont ensuite joué dans leur pays, en devenant présidents de la République, chefs de gouvernement, ministres. L'exil a été un laboratoire d'idées et d'expériences qui ont modifié l'univers intellectuel des exilés et orienté leur action politique après leur retour. Un autre problème intéressant est celui des rapports entre exil politique et émigration économique dans les cas où les deux coexistaient dans un même pays d'accueil : l'exemple des Italiens et des Espagnols en France mérite, à cet égard, d'être analysé de près. Les rapports entre exil et mouvement ouvrier constituent également un terrain de réflexion particulièrement stimulant et complexe, qui se prête particulièrement à une étude sur la longue durée et à une comparaison avec le XIX e siècle. Pour le XX e , il faudrait s'interroger sur la spécificité, par exemple, des exils communistes, d'un côté, et socialistes, de l'autre. Un thème central dans toute la problématique des exils et qui mériterai d'être approfondi est celui du droit d'asile et de son évolution au cours du XX e siècle 1 ( * )39 Dans les recherches sur l'exil, l'attention s'est focalisée généralement sur les grandes personnalités politiques ou littéraires et elle a souvent négligé ceux qui, moins connus, sont restés dans l'ombre même s'ils constituaient la grande majorité des exilés. Les recherches plus récentes se sont tournées vers cette autre réalité - les militants de base, les « petites gens », les femmes, les enfants 1 ( * )40 -, mais on peut estimer que dans ce domaine l'exploration ne fait que commencer. IL reste à construire des biographies collectives qui ne soient pas simplement celles des états- majors de l'exil 1 ( * )41 . Restent également à approfondir le thème de la vie quotidienne des exilés 1 ( * )42 et celui de l'exil vécu au féminin.
Nous allons aborder cette question dans un ordre chronologique en prenant comme point de départ la période qui précède la seconde guerre mondiale. Le phénomène d'exil est lié très directement aux phénomènes des migrations économiques. La situation difficile de l'Europe au cours des années 30 est due d'une part au fait que, sous l'impulsion de la crise économique et sous l'impulsion de l'arrivée au pouvoir du nazisme, le nombre des exilés et des réfugiés politiques se multiplie au moment même où la quasi totalité des pays ferment leurs portes aux étrangers pour des raisons tenant essentiellement à la crise économique. Les frontières se ferment à partir des années 20 et la possibilité d'accéder aux États-Unis est considérablement réduite. À cette époque, les exilés voient leurs possibilités d'être accueillis dans d'autres pays considérablement diminuées. Pendant l'entre-deux-guerres et en particulier pendant les années 30, l'exil juif devient de plus en plus important à l'intérieur du phénomène plus général de l'exil. Je le rappelais à propos de l'émigration allemande mais ce phénomène s'applique aussi à d'autres pays. L'exemple allemand d'une politique qui tend à expulser la population juive est suivi par de nombreux autres pays d'Europe qui essaient de cette manière de conduire les Juifs à quitter leur sol. À partir de 1938, c'est le cas de l'Italie lorsque le fascisme italien se lance à son tour dans une politique de discrimination et de persécution de la population juive.
Je vais passer la parole à François Fejtö qui, je crois, n'a pas besoin d'être présenté. C'est un exilé qui a été un pont entre la culture de son pays d'origine et plus largement la culture d'Europe centrale et orientale et la culture française et d'Europe occidentale.
Les exilés de l'Europe en ruine du Traité de Versailles
François FEJTÖ
Je ne suis pas venu en France en tant qu'exilé. Après une première visite en France en 1937, j'ai eu le projet de venir passer quelques années dans ce pays comme correspondant du journal social-démocrate budapestois. La réalisation de ce projet a été accélérée par l'évolution de la situation dans mon pays.
Je rappelle : nous sommes au début de 1938, un de mes meilleurs amis, le poète Attila Jozsef avec qui j'ai co-dirigé une revue littéraire et politique à la fois antifasciste et anticommuniste - ce qui, à cette époque, était une entreprise aléatoire - s'est suicidé à la suite d'une dépression profonde que les médecins déclaraient incurable. J'ai travaillé d'arrache-pied pour finir une monographie de l'empereur Joseph II, frère de Marie-Antoinette. Après une conférence organisée dans la vile de Mako, grande agglomération de la pusztà connue pour sa production d'oignons, à la mémoire de Jozsef qui y avait beaucoup d'admirateurs, et lors de laquelle j'ai eu l'occasion de discuter longuement avec les paysans de la situation internationale, j'ai écrit un compte rendu pour le journal que j'ai terminé par cette phrase : « Si je pouvais rencontrer dans notre classe dirigeante seulement le centième du bon sens, de la lucidité et du patriotisme des paysans de Mako, alors je n'aurais aucune raison de m'angoisser pour le destin de mon pays ». Cette petite phrase m'a valu de la part du tribunal de Budapest une condamnation à six mois d'emprisonnement pour « incitation à la haine de classe ».
En même temps, une campagne a été menée contre moi dans la presse nationaliste, suite à une série de conférences que j'ai faite en compagnie de quelques collaborateurs de ma revue, à l'invitation de l'Union des écrivains tchécoslovaques, sur la littérature hongroise contemporaine, à Komarom, Bratislava et Prague. C'est moins ce que j'ai dit de la littérature magyare que le fait d'être allé dans un pays « ennemi », parler de la nécessité d'une conférence danubienne, qui a irrité mes accusateurs.
L'atmosphère en Hongrie après l'Anschluss de l'Autriche devenait de plus en plus pesante. J'ai fait appel de la condamnation mais j'ai appris par un ami qui travaillait au ministère de l'Intérieur que je pourrais bien être interné après ma sortie de prison. C'est alors que j'ai pris la décision de profiter des jours de liberté dont je bénéficiais encore, et de la possession d'un passeport, pour précipiter mon départ pour Paris. Je ne savais pas combien de temps durerait mon séjour à l'étranger, j'espérais encore obtenir un jugement plus juste en appel. Je n'avais nullement imaginé que mon exil durerait. Ce n'était pas en exil que j'imaginais aller.
Je suis arrivé à Paris avec un passeport régulier, avec un visa pour un séjour indéterminé, comme correspondant accrédité par le Quai d'Orsay. Et je ne suis pas arrivé comme un inconnu. Au cours de mon premier voyage touristique, j'avais pris contact avec un certain nombre d'écrivains et journalistes, entre autres avec Emmanuel Mounier, qui avait commencé récemment la publication de sa revue Esprit dont j'ai été, sauf erreur, le premier à signaler l'importance hors de France. J'avais même eu l'honneur d'être invité à la table de Geneviève Tabouis, éditorialiste du journal L 'OEuvre, une des journalistes les plus connues et discutées de Paris, en compagnie de deux grands exilés, le comte Michel Kàrolyi, ancien président de la République hongroise de 1918, et le comte Sforza, antifasciste italien, mais aussi en présence de personnalités françaises comme Paul Reynaud et Georges Mandel. J'ai eu le privilège d'entendre parler la première fois à ce déjeuner par Paul Reynaud du récent livre paru de la plume d'un « officier supérieur de grand talent », le colonel Charles de Gaulle, livre dont il a chaleureusement recommandé la lecture à Mme Tabouis.
Donc, il faut dire que je ne suis pas un exilé typique. Aussi me suis-je senti gêné par l'invitation du Président du Sénat à prendre part à cette conférence. Je n'avais pas l'intention de m'exiler, je le suis devenu à la fois à la suite de l'attraction de Paris qui, pour moi comme pour une grande partie des intellectuels hongrois, représentait le symbole de la liberté et, d'autre part, en raison de la situation en Hongrie, de plus en plus menaçante pour des hommes de gauche dont j'étais. Je suis donc devenu exilé, et même deux fois - la deuxième fois après la guerre, quand j'avais d'abord pensé rentrer en Hongrie « pour y construire la démocratie », projet auquel j'ai renoncé après deux visites de reconnaissance faites en 1946 et 1947, persuadé qu'avec la présence prolongée de l'occupation soviétique, les chances d'une démocratie pour ce pays étaient bien problématiques.
Les années de guerre et d'occupation dont j'ai passé la plus grande partie dans la zone « pas encore occupée » - comme me le disait en août 1940 un officier allemand commandant de la gare de Nantes auprès duquel je me suis informé des modalités pour aller dans le Lot - pas encore mais bientôt occupée, ont confirmé dans mon esprit la vérité d'un mot de Proudhon : « Où il y a la justice, là est ma patrie ». Revenu de Cahors à Paris, fin octobre 1944, j'ai rencontré Albert Camus, à la rédaction de Combat où il travaillait alors, et je lui ai parlé de l'accueil plus qu'amical dont j'ai bénéficié durant ces années difficiles grâce à des amis français que j'avais eus ou que je m'étais fait. « C'est un conte de fées que vous me racontez, me dit Camus, vous avez eu vraiment beaucoup de chance, je n'imaginais pas que mes compatriotes fussent capables d'ouverture et de générosité ». Il m'a demandé de faire pour la revue dont il venait de prendre la direction, et dont le premier numéro a paru le 1 er janvier 1945 - elle s'appelait Variétés -, un papier sur mon « exil doré ». Il l'a publié sous le titre « Hommage à la France », en tête de revue, après un article de Paul Valéry. Ce qui lui a plu dans ce papier, c'était la phrase de fin : « J'aime la générosité française composée de 45 millions d'égocentrismes ». En 1958, j'ai retrouvé Camus pour publier aux éditions Pion un livre de documentation sur L'affaire Imre Nagy dont il a écrit la préface et moi la postface.
Je ne m'étendrai pas plus longtemps sur mon sort d'exilé dont j'ai parlé plus en détail dans mes Mémoires, publiés en 1988 sous le titre De Budapest à Paris. Nous avons eu, ma femme et moi, beaucoup de chance car il faut bien dire que la France, à l'époque, n'a pas été très accueillante pour les émigrés venus des pays du centre de l'Europe occupés par les Allemands.
Ce qui nous a sauvés des désagréments de l'exil, c'est d'avoir eu la chance d'être accueillis par des milieux intellectuels qui savaient apprécier l'amour que nous portions à la France et notamment à sa littérature, à sa culture. Même pendant les années de guerre pendant lesquelles j'ai pu avoir encore des contacts avec ma famille et mon éditeur en Hongrie, j'ai traduit en hongrois des livres de Jules Romains, de Joseph Peyré, de Maxence Vandermeersch, qui ont pu paraître sous un pseudonyme à Budapest. J'ai écrit encore en langue hongroise des essais, espérant les publier en Hongrie après la guerre, puis, avec timidité au début, j'ai commencé à m'exercer dans la langue française. « La langue, c'est la patrie » a dit un linguiste, grand artisan de la modernisation du hongrois à la fin du XVIII e siècle, Jozsef Révai. Il fallait beaucoup d'efforts pour passer d'une langue à l'autre, pour faire de la langue française ma seconde patrie, la première restant le hongrois dont je n'ai cessé d'admirer la richesse. Mais je ne me suis jamais senti vraiment apatride en France.
Quoi qu'en disent de plus savants que moi, on peut avoir plusieurs identités qui cohabitent sans difficulté dans l'âme. Nous avons passé, ma femme et moi, nos premières vacances, en août 1939, en Bretagne. Un jour, alors que nous étions à la plage, des gendarmes sont venus interroger les pêcheurs chez lesquels nous logions, pour demander qui étaient ses étrangers. La femme du pêcheur leur a dit : « Ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Français de Hongrie ! ». Cette phrase nous a donné le leitmotiv pour tout notre séjour en France. Il a été la démonstration qu'on peut être exilé heureux dans ce pays, peut-être plus que partout ailleurs dans le monde. N'a-t-on pas dit que l'exception confirme la règle ?
Bruno GROPPO
Nous pourrions vous écouter avec passion pendant des heures. Malheureusement, notre temps est compté. Voici un exil entre le politique et le littéraire.
Je souhaite rappeler que nous allons maintenant entendre une présentation sur l'exil essentiellement littéraire. L'une des nouveautés du XX e siècle est aussi l'importance de l'exil scientifique. Ce thème ne sera pas évoqué directement au cours de notre journée. Cependant, nous devons penser à la fuite de capital intellectuel et scientifique principalement vers les États-Unis à la suite de l'avènement du III e Reich. La France, à l'époque, n'a pas été très accueillante pour ces émigrés. Très peu ont trouvé la possibilité de s'établir en France. Ce sont peut-être les voies de la Providence qui l'ont voulu ainsi car ces derniers auraient alors passé de mauvais moments lors de la débâcle. Il était préférable qu'ils mettent l'océan entre eux et l'Allemagne nazie. Nous devons néanmoins ne pas oublier qu'il existe un important transfert de capital scientifique. Le Mexique, en accueillant l'exil républicain espagnol, a été exemplaire par rapport au malthusianisme étroit de la quasi-totalité des autres pays. Le Mexique a profité de l'apport de ces émigrés espagnols. Plus tard, ce pays a aussi profité de l'apport des exilés des dictatures militaires sud-américaines qu'il a accueillis sur son sol à partir des années 60 et 70. C'est un élément important que nous n'avons pas le temps d'évoquer aujourd'hui. Il serait cependant dommage d'oublier cette question.
Je donne maintenant la parole à Ioana Popa qui est attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Poitiers et qui prépare une thèse de sociologie sur les transferts culturels est-ouest.
À la recherche de la liberté politique : les exilés de la démocratie
Ioana POPA
L'instauration des régimes communistes et la mise en place des circuits de publication parallèles
La mise en place des régimes politiques totalitaires dans les pays de l'Est après la deuxième Guerre Mondiale marque le début d'une situation de politisation exceptionnelle des univers littéraires de ces pays. IL s'agit d'une transformation radicale des conditions de production et des mécanismes de consécration littéraires, qui procède de l'étatisation de l'ensemble des circuits de publication nationaux, de la stricte réglementation de la circulation interne et internationale des textes, de la refonte des institutions existantes et la création de nouvelles instances sur des bases politiques, du contrôle idéologique. Ces changements s'accompagnent de l'interdiction et de la répression des écrivains opposés aux nouveaux régimes, qui entraînent l'exil d'une partie d'entre eux. Dans un tel contexte, consentir à publier sous la contrainte ou refuser de le faire devient un vrai enjeu politique.
L'organisation des formes de résistance ou d'opposition internes s'avère, dans un premier temps, impossible ou illusoire. Un clivage principal - à la fois politique et géographique - traverse, au début des années 50, ces univers littéraires nationaux : d'une part, à l'intérieur du pays, est désormais pratiquée une littérature officielle et qui obéit strictement aux principes idéologiques de la méthode réaliste socialiste de création, adoptée par des écrivains qui consentent à servir le régime. D'autre part, à l'extérieur du pays, se met progressivement en place un espace de production et de diffusion culturelle non contrôlé et délocalisé par l'exil. Certains écrivains et intellectuels qui décident (ou qui peuvent) partir en exil tentent ainsi d'y poursuivre et promouvoir la littérature nationale dans des conditions de liberté politique, voire même de reconstituer symboliquement une partie des anciennes structures littéraires, désormais interdites dans leur pays d'origine : des associations, des fondations, des journaux et revues, des maisons d'édition voient ainsi le jour. Ces instances - plus ou moins rudimentaires et éphémères - sont parfois récrées sous leurs anciens noms, pour suggérer, justement, cette volonté de continuité. Pour les intellectuels exilés, un des premiers enjeux est donc de se poser, à travers ces activités, en gardiens uniques et en dépositaires légitimes de la tradition littéraire nationale, en opposition avec la littérature pratiquée dans le pays d'origine, désormais réduite à exprimer l'idéologie officielle. Ces activités et initiatives visent également à faire le lien entre les intellectuels exilés et à empêcher leur assimilation complète dans la société d'accueil. Si tous ces objectifs ont un sens, c'est surtout parce que l'exil est généralement vécu, à ses débuts, comme une expérience provisoire.
Progressivement, après la mort de Staline en 1953, des formes d'opposition deviendront possibles à l'intérieur même des régimes communistes : elles conduiront plus tard, notamment dans les années 70, à l'apparition des circuits de publication parallèles, clandestins, alternatifs aux circuits officiels (il s'agit de la littérature de samizdat). En disant cela, nous ne nous éloignons qu'apparemment de notre problématique, l'exil, puisque ces deux voies d'expression libre - à l'intérieur et à l'extérieur du pays - ne manquent pas de se rapprocher. Leur articulation se fait, par exemple, grâce à la circulation clandestine de revues et de documents entre l'exil et le pays d'origine, ou à des émissions radiophoniques faites en exil à destination des pays communistes, ou encore, à la publication des écrivains qui y sont interdits par les revues de l'exil ou, enfin, grâce aux reprises, fréquentes, d'un samizdat par une édition exilée, et réciproquement. La complémentarité de ces deux circuits parallèles de publication (interne et externe) contribue ainsi à la progression du discours politique et littéraire non-autorisé, en lui donnant à la fois un poids encore plus important dans les pays d'origine et une visibilité accrue en Occident.
L'objectif des instances culturelles de l'exil devient donc celui d'encourager et de maintenir le contact avec les oppositions naissantes à l'intérieur des pays communistes, puisqu'elles sont susceptibles de diffuser ou d'amplifier des idées démocratiques qui pourront, à terme, y entraîner des changements politiques. Ce déplacement de stratégie suppose, de la part des exilés, non seulement des moyens matériels nécessaires pour apporter ce soutien, mais aussi la compréhension du fait que rester dans le pays (y compris faute d'avoir les moyens de partir) ne signifie pas automatiquement soutenir sans réserve le nouveau régime. En effet, cette appréciation ne va pas de soi : pour une partie des instances culturelles et politiques de l'exil, tout contact avec ceux restés dans le pays (même avec les réformistes) est considéré comme une compromission avec le régime, puisque même passivement, ils acceptent de cautionner le pouvoir. Selon cette logique, le fait, par exemple, d'avoir accepté de publier officiellement dans le pays d'origine est un geste de "collaboration" : l'écrivain qui l'a commis, même s'il a pris ensuite des positions critiques à l'égard du pouvoir - devenant par exemple, lors de la déstalinisation du milieu des années 50, un réformiste ou un "révisionniste" - ne peut pas être accueilli dans les pages d'une revue exilée. Ce problème va d'ailleurs se poser - nous allons le voir plus loin - à l'égard de nouveaux exilés, qui ont décidé de rompre avec le régime après y avoir vécu. Car, évidemment, à cause de la répression qu'elles entraînent, les activités internes d'opposition et de dissidence vont contraindre souvent leurs auteurs à s'exiler à leur tour et donc à rejoindre ainsi l'exil constitué à la première heure.
L'exil des écrivains
La décision de s'exiler - qui fait intervenir des mobiles politiques et moraux mais aussi affectifs et psychologiques, et qui dépend de facteurs très divers, dont la capacité matérielle de quitter son pays - est encore plus problématique pour les écrivains, dont l'activité est indissolublement liée à leur langue. Alors qu'ils ont le courage d'affronter le régime, certains d'entre eux ne peuvent pas franchir le pas de l'exil. Comptant sur le fait que cette expérience peut facilement devenir pour eux l'équivalent d'un suicide littéraire, le régime en fait souvent un moyen de pression et de chantage : lorsque la notoriété interne et internationale des écrivains protestataires devient trop gênante, il tente de s'en débarrasser en les bannissant.
Un des cas les plus dramatiques est, de ce point de vue, celui de Pasternak, le premier écrivain de l'Est qui ait osé envoyer clandestinement un de ses manuscrits ( Le Docteur Jivago) en Occident, pour y être publié. Couronné par le prix Nobel en 1958, Pasternak fait l'objet d'une immense affaire politico-littéraire internationale et subit les pressions du régime soviétique, dans un premier temps, pour empêcher la parution libre de son roman, ensuite, pour qu'il refuse la haute distinction. Éliminé de l'Union des Écrivains, ce n'est que la menace d'être déchu de sa nationalité et donc contraint à l'exil qui le fait infléchir : s'il estime qu'il peut continuer à rester écrivain en dépit de l'exclusion de la corporation officielle, Pasternak ne se sent pas, en revanche, à même de l'être ailleurs que dans son pays et dans sa langue d'origine. À la suite de cette escalade, il est ainsi amené à refuser son prix Nobel. "L'affaire" Pasternak met en place un modèle de gestion de ce type de crise qui aura désormais un usage récurrent : mieux vaut se débarrasser d'un opposant, en le contraignant à l'exil et en misant ainsi sur la "dévalorisation " de ses actions, de ses oeuvres, et de son nom à l'étranger, que de continuer à le persécuter à l'intérieur du pays, en alimentant une publicité négative du régime en Occident (faite entre autres, par des exilés). Appliquant ce principe, des écrivains comme Kundera, Kohout, Goma ou Soljenitsyne seront déchus de leur nationalité et contraints à l'exil.
La destination des écrivains mis ainsi devant la nécessité de s'exiler peut relever d'un choix réel ou, au contraire, du hasard; dans la mesure du possible, les proximités linguistiques et culturelles préalables jouent dans cette décision. Cependant, l'accueil dont les écrivains exilés bénéficient, en France ou ailleurs, est toujours plus complexe : il dépend non seulement de leur proximité ou de leur éloignement culturels, mais aussi de leur notoriété littéraire et / ou politique, des traductions préalables de leurs romans, des relations doit ils disposent déjà dans le pays de leur exil. On remarque ainsi aisément le contraste entre, d'une part, l'arrivée en exil de l'écrivain tchèque Milan Kundera (à ce moment-là, déjà lauréat d'un prix Médicis étranger et plusieurs fois traduit chez Gallimard) ou celle du dissident roumain Paul Goma (auteur de la même maison d'édition et en faveur de qui une campagne internationale a été préalablement orchestrée pour qu'il soit mis en liberté en Roumanie), et d'autre part, un départ "anonyme" et silencieux d'un écrivain que personne ne connaît, et qui connaît personne. L'accueil des écrivains exilés dépend enfin, et surtout, de la conjoncture politique de leur arrivée : là encore, le contraste est saisissant, entre, par exemple, l'arrivée controversée de l'écrivain polonais Czeslaw Milosz, au début des années 50, et une fois de plus, celle de Paul Goma, étiqueté d'emblée, cette fois à la fin des années 70, de "Soljénitsyne roumain". En effet, l'accueil des premières générations d'exilés des pays de l'Est est, souvent, problématique. Dans l'atmosphère qui règne à la Libération, compte tenu du "sentiment de dette" que l'Europe des Alliés éprouve à l'égard de l'Union soviétique et du peuple qui a héroïquement résisté à Stalingrad, le fait de fuir les nouveaux régimes de démocratie populaire, en train de s'installer à l'Est grâce à l'Armée rouge, semble non seulement incompréhensible, mais aussi disqualifiant, au même titre que la collaboration. De ce point de vue, le climat manichéen de la Guerre Froide ne facilite pas, au contraire, l'accueil des intellectuels exilés de l'Est, souvent pris pour cible des attaques venues de la part des représentants ou des sympathisants du Parti Communiste Français, qui occupe à ce moment-là une position dominante.
Un roman-témoignage comme Le Zéro et l'infini, signé par Arthur Koestler - écrivain d'origine hongroise qui a définitivement quitté son pays en 1926 et le Parti Communiste en 1938 - représente, de ce point de vue, une date-clé. Traduit en français en 1945, il est le premier roman de l'après-guerre sur les purges et les procès politiques qui ont eu lieu en Union Soviétique dans les années 30. À la fois par son impact (il est vendu à 500 000 exemplaires) et par les clivages politiques et intellectuels qu'il révèle, ce roman peut être considéré comme un des événements intellectuels qui marquent symboliquement, en France, le début de la Guerre Froide. Le devoir de témoigner éprouvé par certains des écrivains exilés se heurte donc, pendant cette première configuration de réception des littératures de l'Est, à des réticences et suscite des polémiques.
Le cas de Milosz, évoqué tout à l'heure, est encore plus complexe : d'une part, sa décision de s'exiler et son essai-témoignage sur les intellectuels des démocraties populaires, paru chez Gallimard en 1953 ( La Pensée captive), restent encore "en avance" par rapport aux revirements politiques et intellectuels des milieux de gauche et progressistes français, qui ne se produiront qu'à partir de 1956 (l'année du rapport Khrouchtchev et des révolutions hongroise et polonaise). D'autre part, et pour des raisons opposées, Milosz est reçu avec une méfiance extrême par une grande partie de l'exil polonais lui-même, qui le juge violemment pour sa "collaboration" avec le régime de Varsovie et le considère un "agent communiste". En effet, non seulement Milosz n'est pas un exilé de la toute première heure, mais, homme de gauche, il devient à la Libération attaché culturel de la nouvelle Pologne populaire aux États- Unis et en France : c'est en 1951, alors qu'il est en poste à Paris, qu'il demande l'exil politique. Milosz bénéficie cependant d'un soutien singulier à l'intérieur de l'exil polonais: celui de sa plus importante revue culturelle, Kultura, et de la maison d'édition l'Institut littéraire, fondées en Italie, et actives à Paris dès 1946. Jusqu'au début des années 80 - lorsque, à la faveur de son prix Nobel, Milosz commencera à être abondamment traduit - c'est Kultura qui assure à cet écrivain (comme à beaucoup d'autres) la survie littéraire en langue polonaise (évidemment, hors la Pologne), puisqu'elle publie pratiquement toutes les éditions originales de son oeuvre.
Écrire en exil
Le problème central de l'écrivain exilé reste, en effet, comment continuer à écrire et à publier en exil ? Différents cas de figure sont ainsi possibles, à commencer par le fait de s'arrêter tout simplement d'écrire et / ou de publier, à cause du déracinement, du dépaysement, du déclassement vécu en exil. L'interdiction des oeuvres dans le pays d'origine d'une part, l'incapacité à franchir la barrière linguistique du pays d'accueil d'autre part, privent l'écrivain d'un destinataire potentiel et peuvent, en effet, le conduire à cesser complètement d'écrire. Si la possibilité matérielle existe, l'écrivain peut toutefois publier, dans sa langue d'origine, dans le réseau des revues de l'exil, sachant que, dans la durée, un curieux combat s'installe avec sa propre langue maternelle. Après plus de quarante ans d'exil, l'écrivain polonais Pankowski avoue lire quotidiennement le dictionnaire pour exercer son polonais et pour ne pas perdre le contact avec l'évolution de la langue.
Avec ou sans le préalable de cette publication, l'écrivain exilé peut ensuite passer le cap de la traduction, bénéficiant ainsi d'une diffusion de ses oeuvres dans la société d'accueil. Une prépublication par des revues ou des maisons d'édition de l'exil peut, en effet, faciliter ce passage, si ces instances parviennent à être, notamment grâce d'une conjoncture de réception favorable, un chaînon actif dans le processus de transfert littéraire. C'est par exemple le cas de la revue des exilés tchèques Témoignage (éditée à Paris), après l'écrasement du Printemps de Prague de 1968. Témoignage est un lieu par où transite toute la littérature tchèque non-officielle (samizdats ou publications des maisons d'édition en exil). Grâce à l'intérêt et à la sympathie suscités en France par l'écrasement du Printemps de Prague, la revue devient une véritable rampe de lancement de textes dans la traduction, et c'est l'une de ses très proches collaboratrices, elle-même exilée, qui devient la traductrice en français de la plupart des romans tchèques interdits après 1968.
La traduction en français peut ainsi constituer l'aboutissement de la diffusion parallèle des oeuvres littéraires interdites dans leur pays et publiées d'abord par les instances de l'exil: elle acquiert ainsi, implicitement du moins, une signification, sinon une visée politiques. Enfin, la traduction reflète à son tour la progression du discours littéraire non-autorisé : le nombre d'écrivains exilés traduits en français s'accroît continûment entre le début des années 50 et la fin des années 80. Leur réception est corrélée aux grandes crises qui rythment l'évolution des pays d'origine : ainsi par exemple, après 1956, ce sont les écrivains exilés hongrois qui sont le plus traduits, tandis que les Tchèques le sont notamment, on vient de le voir, après 1968 et les Polonais, pendant la décennie 80.
Le défi auquel l'écrivain "exilé" traduit reste toutefois confronté est d'éviter que sa situation équivoque de "double présence" - symbolique, par la fidélité à sa langue d'écriture et réelle, par la circulation effective de l'oeuvre - ne se transforme dans une "double absence", à défaut d'une réception réelle à la fois dans les pays d'origine et d'accueil. Une solution possible est celle qu'ont adoptée les "transfuges" linguistiques, c'est-à-dire les écrivains qui changent de langue d'écriture en rédigeant leur oeuvre (soit entièrement, soit à partir d'un moment de l'exil), le plus souvent, dans la langue du pays d'adoption. Faire cela, suppose non seulement le fait d'avoir des ressources linguistiques conséquentes, mais reflète aussi l'aspiration de l'écrivain exilé à se construire une nouvelle position littéraire, en cessant de se référer à son univers littéraire d'origine. Dans des situations assez exceptionnelles, l'écrivain exilé, via le changement de la langue, arrive à se reconvertir véritablement dans l'espace littéraire d'accueil, comme l'illustre le cas de Cioran ou de Kundera, désormais reconnus non plus simplement comme des auteurs étrangers traduits, mais comme des écrivains français à part entière.
Enfin, l'écrivain exilé peut jouer un dernier rôle, plus rare, mais complémentaire aux précédents: il peut devenir lui-même un médiateur, c'est-à-dire un intermédiaire et un relais entre l'espace littéraire « de départ » et « d'arrivée ». En tant que traducteur (comme l'écrivain roumain Virgil Tanase ou tchèque Petr Kral), directeur d'une revue de littérature internationale et publiée cette fois en français (comme l'écrivain roumain Dumitru Tepeneag ou le journaliste-écrivain Antonin Liehm), directeur de collection dans une maison d'édition française (comme c'est temporairement le cas de Paul Goma), voire même en tant que membre de son comité de lecture (comme Milan Kundera, chez Gallimard), l'écrivain exilé peut faciliter ainsi, directement ou indirectement, la connaissance et la diffusion de la littérature de son pays d'origine dans le pays d'accueil.
Pendant plus de quarante ans, les écrivains exilés des pays de l'Est ont, naturellement, témoigné des conceptions variées à la fois de la littérature et de leur propre rôle. Cette diversité va de l'engagement direct de leurs écrits à la pratique de l'art pour l'art, en passant par la séparation complémentaire entre leurs oeuvres et leurs activités militantes. C'est cette diversité qui a rendu possible à la fois le combat politique et la création d'une véritable littérature.
Bruno GROPPO
Le fait de perdre sa nationalité est aussi l'une des grandes nouveautés de ce XX e siècle même si cette pratique rappelle aussi l'ostracisme d'Athènes. Cette pratique prend son sens dans un siècle où le fait de posséder un passeport devient fondamental. Tel n'était pas le cas auparavant. Le XX e siècle est en quelque sorte le siècle au cours duquel triomphent les nationalismes. L'État nation devient le cadre normal de l'organisation de la vie politique. Ce sont très souvent des nationalismes qui se posent de manière assez différente de ceux qui avaient été imaginés par Victor Hugo ou par Mazzini. Ce sont très souvent des nationalismes d'exclusion qui se concrétisent par des visas et des passeports. C'est l'histoire du XX e lue au travers de l'histoire des papiers d'identité, des visas et des passeports. Ici, nous verrons difficilement une humanité qui se dirige vers toujours plus de liberté. Le XX e siècle nous a aussi appris à renoncer à ce type d'illusion. Priver quelqu'un de sa nationalité est une pratique inaugurée par le régime bolchevique en Russie. Cette pratique est ensuite reprise par le fascisme italien et plus largement encore par le régime nazi. On crée ainsi la figure de l'apatride. Cette figure a son sens au XX e siècle alors que cette figure ne revêtait pas le même sens au siècle précédent. Le contexte général de l'exil change donc considérablement au XX e siècle.
Je ne résiste pas à la tentation de vous rappeler que très près de Paris, la bibliothèque universitaire de Nanterre possède des collections remarquables sur les exils européens du XX e siècle et lui consacre aussi dans la revue Matériaux pour l'histoire de notre temps une attention particulière. Victor Hugo nous a rappelé que la France a été une terre d'accueil. Cette caractéristique fait partie de son identité politique. Toutefois, la France a aussi été, tout au long de son histoire, une terre d'expulsion. Il suffit de citer le cas des Protestants. La France a donc un double visage. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient approfondir ces questions, la BDIC du campus de Nanterre est un outil formidable. Il s'agit probablement d'une source unique d'informations en Europe. Je laisse maintenant la parole à la salle.
Débat
De la salle
M. Fejtö, parliez-vous français lorsque vous êtes arrivé en France ? Dans quelle langue, rédigiez-vous vos écrits publiés dans les revues ? Pouvez-vous préciser quel était le problème de la langue pour les exilés et en particulier pour les écrivains ?
François FEJTÖ
J'ai dit que mon cas était atypique, puisque j'ai déjà parlé le français, sinon l'argot parisien, dès mon arrivée. Je lisais sans difficulté Montaigne, Racine et Proust, sans pour autant réussir à comprendre les chauffeurs de taxi, dans les premiers temps. Ma femme savait aussi par coeur des poèmes de Baudelaire et de Verlaine. Mais j'ai mis dix ans à rédiger assez correctement dans cette langue sans avoir besoin de relecture par un Français. Je dois dire cependant que jamais ma maîtrise de cette dernière langue n'a atteint celle que j'avais de la langue maternelle. Si j'étais resté ou revenu en Hongrie, j'aurais été sans doute un écrivain beaucoup plus littéraire car mon vocabulaire était bien plus riche. En France, je me suis orienté - parce que c'était plus facile - vers l'histoire, l'essai et le journalisme. Quand, à partir de 1989, après une interruption de plus de quarante ans, on a recommencé à me publier en Hongrie, je me suis fait traduire par d'autres, surtout faute de temps. Et c'était cela la grande épreuve pour moi, car malgré la grande qualité de mes traducteurs, j'ai dû passer presque autant de temps réécrire que j'en aurais mis à écrire directement. Ce qui m'a appris que, pour traduire sans trahir, il faut un art spécial que je ne possédais pas. Lisez le livre de l'écrivain franco-chinois François Cheng Le dialogue. Il y analyse merveilleusement bien la difficulté à exprimer la même pensée dans une langue puis dans l'autre. « Ici... L'exilé se rend compte combien le langage confère la légitimité d'être » . La difficulté que j'ai rencontrée m'a ramené à la discipline qui a eu ma préférence à l'époque de mes études universitaires : l'étymologie comparée.
De salle
Vous avez affirmé qu'il n'existait pas de statut international du réfugié politique.
Bruno GROPPO
Non, j'ai affirmé qu'il n'existait pas de statut international de l'exilé politique. En revanche, il existe un statut international du réfugié lequel statut couvre aussi le cas des exilés. Cependant, ce statut porte essentiellement sur la figure du réfugié et pas sur la figure de l'exilé en tant que telle. L'exilé en tant que tel n'existe pas pour la convention de Genève.
De la salle
L'accord de Schengen restreint également le droit des réfugiés.
Bruno GROPPO
Oui.
De la salle
Quel est le titre du roman que Pasternak fait passer en Occident ?
Ioana POPA
Il s'agit du Docteur Jivago.
De la salle
J'ai l'impression que certains exilés partant pour des raisons politiques, une fois installés dans le pays d'accueil sont obligés, du fait de la position qu'ils occupent et du risque de se faire expulser, de renoncer à leur lutte politique. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation ? J'affirme cela en pensant à Kundera. Peut-être également que Pasternak s'est rendu compte qu'il allait non seulement ne pas pouvoir écrire mais qu'il allait aussi perdre ce qui constituait sa personnalité.
Ioana POPA
En effet, la manière d'envisager l'engagement politique est variable suivant les personnes. Kundera peut être considéré comme un cas à part. Il devient non seulement un écrivain étranger traduit mais il réussit aussi à se convertir complètement dans l'espace littéraire d'accueil puisqu'il est désormais considéré comme un écrivain français à part entière. Son évolution est relativement complexe. Kundera est un écrivain qui peut publier normalement en Tchécoslovaquie. Son roman La plaisanterie peut être publié dans son pays. Cependant, suite à l'écrasement du Printemps de Prague et du mouvement réformiste tchécoslovaque et suite à ses prises de position très courageuses dans l'Union des écrivains tchécoslovaques, il est alors interdit. Au même moment, chez l'éditeur Gallimard, la traduction de son roman va paraître. Ce sera une traduction non autorisée sachant que le roman a été interdit dans le pays d'origine de Kundera. Il s'en suivra alors une période assez grise pour l'écrivain. Kundera restera en Tchécoslovaquie où il pourra continuer à publier clandestinement grâce aux initiatives de Claude Gallimard en France. C'est de cette manière qu'il va recevoir le prix Médicis Étranger. Ses ressources symboliques et matérielles proviennent donc de l'extérieur. Son départ en France est toujours atypique au sens où il s'agit d'un départ autorisé. Il est en effet invité à Rennes en tant que professeur. Or, c'est lors de son voyage en France qu'il est déchu de sa nationalité. Il est alors obligé de rester en France.
Bruno GROPPO
À propos des exilés intellectuels bulgares, l'écrivain Gorki Markov tué à Londres par le parapluie bulgare constitue-t-il un cas unique ? En France, compte-t-on aussi de tels cas d'intellectuels bulgares assassinés ?
Ioana POPA
Je connais très peu le cas des écrivains bulgares. Je sais néanmoins qu'il existe d'autres attentats au parapluie empoisonné visant d'autres écrivains. Ces événements ont eu lieu dans les années 70 et 80. D'autres dissidents exilés ont donc également été victimes de ce type d'attentats.
Bruno GROPPO
Je vais vous lire une question écrite qui s'adresse aux organisateurs de ce colloque. Quand la décision a-t-elle été prise d'organiser le présent colloque ? Qui se trouve à l'origine de cette initiative ? Je ne vais pas répondre à cette question. Les organisateurs de ce colloque vont certainement répondre à cette interrogation dans un instant.
De la salle
Je suis frappé par l'ampleur des mouvements de population qui ont eu lieu au XX e siècle, mouvements liés aux changements de frontières ou aux questions de nationalité. Je suis allé récemment en République Tchèque. J'ai donc eu des informations complémentaires sur le départ des 2,5 millions d'Allemands qui ont été chassés en 1945 essentiellement vers la Bavière. Je crois que Staline a ordonné des mouvements très importants quand les frontières de la Pologne et de l'URSS ont été fixées. Il aurait été intéressant de dire quelques mots de ces mouvements de masse.
Bruno GROPPO
M. Fejtö peut peut-être répondre à cette question. Vous vous êtes certes intéressé à la dissolution de l'Empire austro-hongrois et à la naissance d'une série de nouveaux États conduisant à un nouveau découpage des frontières au coeur de l'Europe.
François FEJTÖ
En effet, vous avez raison, la dissolution de l'Empire austro-hongrois, la naissance, les péripéties voire la mort des nouveaux États qui se retrouvent à présent au sein de l'Europe, c'était un des sujets qui m'ont le plus passionné dans toute ma vie. Ce qui fait que j'ai eu peut-être tort en parlant de mes deux identités hongroise et française. Je n'ai pas dit toute la vérité, car étant né d'une famille dispersée sur le territoire de toute la monarchie, j'ai eu une expérience existentielle des problèmes qui se sont posés aux habitants de ces pays qui étaient tous multinationaux. Ils ont essayé, sans y réussir, de se transformer en États nationaux. Le découpage, les démembrements de l'empire ont rendu plus aigus, plus difficiles à résoudre, les problèmes posés par cette multi-nationalité qu'ils ne l'avaient été sous la monarchie dont j'ai vécu, personnellement, familialement et bien douloureusement, la fin. Être minoritaires dans des pays où autrefois ils étaient maîtres constituait un changement de situation que des millions de Hongrois ont difficilement vécu en Roumanie, en Tchécoslovaquie et en Yougoslavie. J'espère qu'en entrant dans l'Union européenne, ces pays trouveront une solution satisfaisante pour le problème de la cohabitation sans frictions de gens parlant des langues et attachés à des traditions culturelles différentes les unes des autres. Beaucoup de Français font semblant de ne pas comprendre la difficulté de respecter le principe de l'égalité des citoyens qui veulent conserver leur langue et leur culture différentes dans un pays centralisé. Or l'Europe du Centre et de l'Est et les Balkans ne sont pas les seuls à connaître ces problèmes : ils existent et perturbent la stabilité des pays démocratiques de l'Ouest comme la Belgique, la Grande-Bretagne et l'Espagne, et pourquoi pas nommer aussi la France ? La Suisse est peut-être le seul pays qui n'en souffre pas, malgré la conservation de ses structures anciennes et de leur autonomie. Avoir gardé ma sensibilité à l'égard de ces problèmes fait que je continue à m'affirmer comme « centre-européen » et que je sois en même temps un partisan fervent de l'unité européenne, en tant qu'étape vers une citoyenneté du monde qui se dessine en perspective.
Bruno GROPPO
Telle sera la conclusion de notre table ronde. Cette dernière phrase exprime certainement l'espoir que nous partageons tous.
M. Alain DELCAMP, directeur général de la Communication et du Développement technologique
Pour répondre à la question portant sur l'organisation de cette journée, je souhaite préciser que c'est le Président du Sénat ainsi que le Bureau du Sénat qui ont pris la décision au mois de novembre 2001 d'organiser cet événement au moment où le Sénat a décidé de s'associer aux manifestations du Bicentenaire de la naissance de Victor Hugo. Vous savez tous que le poète a été par deux fois membre d'une deuxième chambre siégeant au Luxembourg, de 1845 à 1848 et de 1876 à 1885. L'idée du colloque néanmoins ne s'est affirmée qu'après les premiers contacts que cette initiative nous a permis d'avoir, notamment avec deux personnes qui se sont exprimées ou qui vont s'exprimer ce matin. Je veux parler de M. Jacques Seebacher et de M. Guy Rosa. Ces deux intervenants se répondent en tant que fondateur et animateur du groupe Hugo de l'Université de Paris VII qui se trouve au coeur de la recherche hugolienne. Ce sont eux aussi qui nous ont mis sur le chemin de l'exil. Ils nous ont permis de comprendre que si l'exil est un ébranlement de la personne, c'est aussi la première pierre sur laquelle cette personne peut se reconstruire. C'est la raison pour laquelle nos célébrations s'articulent autour de deux journées, la journée de vendredi étant consacrée à l'exil et à la souffrance et la journée de samedi étant consacrée à la tolérance puisque l'exil est une manière pour chacun de se trouver voire de se dépasser. Or c'est en se dépassant qu'il est possible de devenir une référence. C'est la raison pour laquelle vous entendrez cet après-midi des témoignages de personnalités qui ont vécu la même expérience que Victor Hugo et qui ont peut-être suivi le même itinéraire. Je vais laisser maintenant la parole à M. Rosa lequel va axer son intervention sur Victor Hugo. Nous avons certes abandonné quelque peu les références au grand homme au cours de notre matinée. Cependant, notre but n'était nullement de céder au vertige habituel de la commémoration. Notre but, au contraire, était de voir ce qui pouvait être utile dans le passé pour éclairer notre présent.
HUGO EN EXIL : TEMOIGNAGES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
GUY ROSA
Professeur à l'université Paris VII, animateur du Groupe Hugo
Pour beaucoup d'hommes, la défaite des révolutions de 1848 dans toute l'Europe ouvre le temps de l'exil comme la sanction d'un échec personnel et national : temps de souffrance et d'épreuves. Pour Hugo, l'exil fut un accroissement. On s'explique sans peine le contentement intérieur des premiers jours qui lui fait signer l'une de ses toutes premières lettres d'exilé « le proscrit satisfait » 1 ( * )43 : soulagement de qui, l'épreuve du feu passée, se sait courageux ; satisfaction du devoir accompli ; approbation de la conscience ; justification publique aussi pour un militant de fraîche date, souvent accusé d'opportunisme et dont on mettait le ralliement républicain au compte de l'ambition parce qu'il datait à peu près du moment, juin 1849, où la gauche ayant perdu ses chefs, emprisonnés ou proscrits 1 ( * )44 , elle aurait offert un avenir plus brillant que la droite encombrée de leaders. Ajoutons la fièvre de l'indignation, l'exaltation du combat à poursuivre par des armes qui sont maintenant les siennes - la parole et l'écriture -, l'empressement des Belges flattés d'accueillir le plus grand poète du temps et sincèrement choqués de l'infortune de la France dont la révolution avait donné naissance à leur propre nation, le mouvement vers lui des autres proscrits comme vers une protection et un guide.
La proscription de Victor Hugo
Au reste, l'exil serait de courte durée, tous en étaient persuadés tant la base politique du régime était étroite - même Thiers ! - et universelle une réprobation souvent teintée d'appréhension au souvenir de l'oncle 1 ( * )45 . En janvier 52, Hugo peut écrire : « Ce n'est pas moi, monsieur, qui suis proscrit, c'est la liberté; ce n'est pas moi qui suis exilé, c'est la France. 1 ( * )46 » À quoi fait écho, le disculpant de toute mégalomanie, tel journal belge : « ...la France n'est plus à Paris, elle est à Bruxelles avec V. Hugo [...] à qui Dieu et la France semblent avoir remis le soin de venger un grand peuple 1 ( * )47 ».
Moins d'un an après, il ne reste plus grand chose de cette effervescence pleine d'espoir. Il y eut encore banquets, toasts et discours lorsque Hugo dut quitter Bruxelles pour Jersey 1 ( * )48 , rien lorsqu'il en est expulsé trois ans après 1 ( * )49 et l'histoire de son exil fut celle d'un continuel assombrissement.
À la pauvreté près 1 ( * )50 , ses souffrances furent celles des autres exilés. Isolement d'abord. À Bruxelles, la proscription forme encore une société ; à Jersey, les Français sont une centaine 1 ( * )51 ; 75 à Guernesey toutes nationalités confondues ; après l'amnistie de 59, pas plus d'une dizaine et il y a quelque chose poignant dans la dignité courtoise avec laquelle Hugo quémande une visite à des amis parfois très proches. C'était tomber de très haut et devoir presque changer d'être. Car l'image du solitaire de Guernesey fait oublier que du Cénacle à l'Assemblée nationale et des généraux de l'Empire aux marchands de vin républicains du VIII e arrondissement, le cours de son existence avait si bien élargi et multiplié autour de Hugo les cercles de socialité qu'à la veille de l'exil, aucun homme de son temps sans doute n'avait une vie si mêlée à celle de ses concitoyens. Ce trait de caractère aura sa revanche dès le retour, en 70.
Sentiment aussi de la vacuité d'une existence sans utilité. À François-Victor, qui se plaint dès le printemps 1852 d'un « avenir muré », son père ne peut guère opposer que les certitudes froides d'un messianisme abstrait : « Ne parle pas d'avenir muré ; pour que l'avenir vous fût muré, mes enfants, il faudrait qu'il fût muré au progrès, à la démocratie, à la liberté 1 ( * )52 ». Mais lui-même avoue, trois ans après : « Je ne suis [...] pas pressé, je suis triste; je souffre d'attendre, mais j'attends et je trouve que l'attente est bonne » 1 ( * )53 .
Famille, surtout, asphyxiée et bientôt brisée par l'assèchement de son terreau mondain. Hugo avait vu dans l'exil l'occasion de la garder complète auprès de lui : « Quand nous serons réunis, écrit-il de Bruxelles, je ferai des vers, je publierai un gros volume de poésie, je m'y dilaterai le coeur, et il me semble que nous aurons des heures charmantes. Que ne suis-je à ce temps-là! » 1 ( * )54 . Hélas ! dès les premières années, l'aigreur ou l'agressivité animent les discussions familiales. Tous préféreraient Londres, n'importe quelle grande ville. L'épouse n'attend pas l'amnistie pour des escapades progressivement prolongées, bruxelloises ou parisiennes; les fils en profitent pour déserter à sa suite et l'on sait la fuite affolée d'Adèle H. Dans un agenda, à la date du 3 octobre 1858, Hugo note, sans commentaire mais entre guillemets : « ta maison est à toi, on t'y laissera seul » 1 ( * )55 .
La communauté des proscrits elle aussi, famille et société de substitution, s'effrite sous l'effet des autorisations de retour, s'aigrit sous celui de la misère, se décompose dans l'envie ou le soupçon - on y estime le nombre des mouchards au quart de l'effectif 1 ( * )56 -, se détruit dans les dissentiments politiques avivés en querelles suicidaires par l'irréalité de ces débats en l'absence de leur destinataire et de leur arbitre, le peuple. À Hugo qui s'étonne auprès d'un partant de son intention de s'installer à Bilbao plutôt qu'à Barcelone où il retrouverait beaucoup de français, ce dernier répond : « C'est justement pour cela que je vais à Bilbao » 1 ( * )57 .
Ne comptons pas pour rien la contrainte morale de cette société insulaire, accueillante mais intolérante et revêche 1 ( * )58 , ni non plus l'oppression d'une surveillance policière ouverte, constante, parfois agressive 1 ( * )59 . Elle pèse sur Hugo plus que sur d'autres et s'aggrave pour lui, assidûment censuré, dénigré et discrédité, du brouillage de la communication avec son public 1 ( * )60 .
Hugo se plaint peu, autant par caractère que par politique; sa mission le lui défend et ses succès lui auraient donné mauvaise grâce à le faire. Mais l'oeuvre alors, aussi optimiste soit-elle, multiplie les traces d'une disposition dépressive sans exemple auparavant, se troue d'« effondrements intérieurs ».
Qu'est-ce que l'exil ?
À la dernière année de l'exil - Hugo ne savait pas que c'était la dernière -, le portrait de l'exilé Lord Clancharlie et l'aventure de Gwynplaine ressassent l'histoire d'un désastre : « engloutissement », « écroulement », « ruine », « résidu ». On sous-estime aujourd'hui la profondeur de ces blessures et l'on met au compte de l'exagération romantique l'amertume de la plainte des exilés de 48. Bien à tort : aucun droit international n'affaiblissait le sérieux des frontières, aucune conscience mondiale leur bien fondé ; ceux qui étaient loin étaient très loin, sans que la séparation soit réparée par aucune des communications modernes; surtout, le sentiment d'appartenance à la communauté - aussi vif qu'aujourd'hui mais différent - désignait à chacun moins l'origine de son identité que le bénéficiaire dernier de son existence (cela se mesure, par exemple, à la passion de l'héritage, passion alors, moins d'hériter que de transmettre). Être exilé, c'était vivre une vie réduite à elle-même, autant dire n'être rien.
Il existe encore à Jersey une sorte de tombeau des proscrits inconnus 1 ( * )61 ; on y lit dix noms d'exilés, morts entre avril 1853 et janvier 1856, liste déplorable qui contraste avec une autre, glorieuse : Napoléon le Petit, Les Châtiments, Les Contemplations, La Légende des siècles, Les Misérables, William Shakespeare... Les souffrances partagées, là destructrices, se retournent ici en valeur et en sens. Le sacrifice consenti n'y suffisait pas - la preuve -, ni non plus la magie de je ne sais quelle transfiguration poétique - au nombre des exilés, Hugo n'était pas le seul écrivain. IL fallait pour que la proscription fît de lui ce qu'il y devint, que l'exil fût pour Hugo le lieu d'un ancrage personnel plus profond, d'une position politique plus juste, d'un accomplissement littéraire.
La première fois qu'il dut songer à quitter son île, Victor Hugo en fut « assez contrarié » : « [...] voici que les médecins veulent que je voyage. Comprenez-vous ce guignon? Ce serait une absence de six semaines ou deux mois. Mais où aller? Qui est banni trouve le monde fermé. Peu importe après tout; -alors j'aurai la tombe. Me serais-je prédit mon avenir dans cette scène-là ? 1 ( * )62 ». Voici la scène ; don Carlos, futur empereur d'Allemagne menace Hernani de le mettre au ban de l'empire :
HERNANI
À ton gré, J'ai le reste du monde où je te braverai. Il est plus d'un asile où ta puissance tombe.
DON CARLOS
Et quand j'aurais le monde ?
HERNANI
Alors j'aurai la tombe 1 ( * )63 .
Rien de surprenant à cette assimilation de l'exil et de la mort : l'exclusion de la société s'achève dans celle du cercle des vivants et la mort offre refuge à la liberté ; pour dire cela, Hugo avait à sa disposition cinquante autre citations de son oeuvre antérieure tant elle est imprégnée d'une méditation sur l'exil. Mais il s'empare, en isolant ces vers, de l'idée, différente, que celui qui « a » le monde n'a rien de plus que celui qui « a » la tombe et même beaucoup moins, que l'exil ouvre un autre univers, plus habitable, plus vrai, que celui des vivants, même tout-puissants. Idée neuve ou plutôt constatation résultant de l'expérience même de l'exil.
Elle s'exprime largement dans l'oeuvre, mais souvent aussi dans de simples lettres, au plus près du vécu. 1855, à sa cousine, Marie Hugo, qui entre au Carmel : « Chère enfant, tu vas bientôt faire ce grand acte de sortir du monde. Tu vas t'exiler, toi aussi; tu le feras pour la foi comme je l'ai fait pour le devoir 1 ( * )64 . » 1856, à Edmond About : « Un proscrit est une espèce de mort. Il peut donner presque des conseils d'outre- tombe 1 ( * )65 »; et, à Villemain : « L'exil ne m'a pas seulement détaché de la France, il m'a presque détaché de la terre et il y a des moments où je me sens comme mort et où il me semble que je vis déjà de la grande et sublime vie ultérieure 1 ( * )66 . » Le sentiment d'être mort ne donne donc pas son contenu à la méditation de l'exilé ; il n'est que l'accès à une évasion mystique quotidienne. Dieu est son objet dernier - « J'habite dans cet immense rêve de l'océan, je deviens quelque peu un somnambule de la mer... je finis par ne plus être qu'une espèce de témoin de Dieu 1 ( * )67 » -, mais sa substance et sa tonalité dépendent des conditions effectives de l'exil : transparence de la conscience garantie par le sacrifice, liberté d'une autonomie absolue - puisque le hors la loi ne trouve de loi qu'en lui 1 ( * )68 -, fusion dans la nature permise à qui est rejeté du monde des hommes, mais aussi communication immédiate avec l'humanité maintenant que sont dissoutes toutes les médiations sociales. Telle est l'extase de l'exil. Les oeuvres la disent souvent, mais telle note l'atteste avec la nudité du plaisir : « Je suis là, j'ai deux chaises dans ma chambre, un lit de bois, un tas de papiers sur ma table, l'éternel frisson du vent dans ma vitre, et quatre fleurs dans mon jardin que vient becqueter la poule de Catherine pendant que Chougna, ma chienne, fouille l'herbe et cherche des taupes. Je vis, je suis, je contemple. Dieu à un pôle, la nature à l'autre, l'humanité au milieu. Chaque jour m'apporte un nouveau firmament d'idées. L'infini du rêve se déroule devant mon esprit, et je passe en revue les constellations de ma pensée 1 ( * )69 . »
On comprend que Hugo puisse conclure : « Je trouve de plus en plus l'exil bon.[...] Depuis trois ans - en dehors de ce qui est l'art - je me sens sur le vrai sommet de la vie [...]. Ne fût-ce qu'à ce point de vue, j'aurais à remercier M. Bonaparte qui m'a proscrit, et Dieu qui m'a élu. Je mourrai peut-être dans l'exil, mais je mourrai accru 1 ( * )70 . »
Bien plus tard, Ce que c'est que l'exil, préface du second volume d'Actes et Paroles - Pendant l'exil, transpose en affirmation générale cette expérience personnelle. Première page : « Un homme [...] tellement dépouillé qu'il n'a plus que sa conscience, tellement isolé qu'il n'a plus près de lui que l'équité, tellement renié qu'il n'a plus avec lui que la vérité, tellement jeté aux ténèbres qu'il ne lui reste plus que le soleil, voilà ce que c'est qu'un proscrit 1 ( * )71 . » Antithèses éloquentes, mais rigoureuses : l'exclusion des liens sociaux, des propriétés et des droits - la mort symbolique du proscrit - le rejette du côté de l'impersonnel sous ses trois formes : impersonnalité du nombre - où il rejoint le peuple et, au-delà, l'humanité ; impersonnalité par essence - où il rentre dans la proximité de la nature et de l'idéal ; impersonnalité dans le temps : il est l'homme du progrès parce que, dans la forclusion du présent, il est celui de la mémoire et de l'avenir. Conclusion : « [...] lui, misérable, les misères sont venues le trouver ; les naufragés ont demandé secours à ce naufragé. Non seulement les individus, mais les peuples; non seulement les peuples, mais les consciences; non seulement les consciences, mais les vérités 1 ( * )72 . »
Ce ne fut pas en vain, on le sait. Car - corollaire de l'inversion hyperbolique des valeurs au passage à l'infini - la plus grande liberté résulte de la sujétion maximale et la toute puissance du comble de la faiblesse : « ... votre pouvoir et votre richesse sont souvent votre obstacle : quand cela vous quitte, vous êtes débarrassé, et vous vous sentez libre et maître; rien ne vous gène désormais; en vous retirant tout, on vous a tout donné; tout est permis à qui tout est défendu; vous n'êtes plus contraint d'être académique et parlementaire; vous avez la redoutable aisance du vrai, sauvagement superbe. [...] La plus inexpugnable des positions résulte du plus profond des écroulements; il suffit que l'homme écroulé soit un homme juste; [...] il est bon qu'il soit accablé, ruiné, spolié, expatrié, bafoué, insulté, renié, calomnié, et qu'il résume en lui toutes les formes de la défaite et de la faiblesse, alors il est tout puissant. [...] Quelle force que ceci : n'être rien ! 1 ( * )73 »
Cette force, on s'explique que Hugo revient symboliquement la puiser dans l'exil, à Bruxelles et Vianden d'abord, puis Quatrevingt-Treize lorsque la Commune et sa répression rouvrent devant l'histoire en marche le trou profond où Louis-Napoléon Bonaparte l'avait déjà fait tomber.
L'accroissement constaté « en dehors de ce qui est l'art » rejoint donc l'oeuvre, la relance et en récupère l'énergie en une spectaculaire surenchère. Car tout se passe comme si l'oeuvre antérieure de Hugo avait eu le pressentiment et le souhait d'un exil dont la réalité vint remplir l'attente, et la dépasser. Beaucoup de ses personnages, hommes sans racines ou déplacés, étaient des exilés, mais d'un exil fortuit et inintelligible, vécu comme une fatalité. Entre Hernani ou Ruy Blas et Gwynplaine la différence ne tient pas à la sévérité de la catastrophe - elle est plus complète dans L'Homme qui rit - mais à sa nature : les drames montraient dans l'entreprise du héros, usurpation légitime ou légitimation usurpée, une contradiction sans issue; Gwynplaine va au devant d'un échec nécessaire et salutaire : « Il faut passer par les abîmes ». Jean Valjean et Gilliatt sont « hors de tout » comme Quasimodo, mais pourvoyeurs d'avenir. En 1851, Léopoldine était morte depuis longtemps, beaucoup des pièces des Contemplations étaient écrites et le titre du recueil trouvé; mais il fallut l'exil pour que la superposition des dates de la mort de Léopoldine et de la mort civile de son père, divisant ensemble ces « Mémoires d'une âme », donne au recueil son architecture et son sens. Bref, la proscription ratifie l'oeuvre et la dépasse avant que l'oeuvre, enregistrant à son tour ce dépassement, figure en ce progrès la vie de son auteur comme un trajet porteur de sens - non pas comme un destin mais comme une Histoire. Dans cette étonnante circularité progressive, l'exil fait de Hugo son plus éclatant personnage.
Troisième table ronde sur
LES FIGURES DE L'EXIL :
SOUFFRANCE ET CONFRONTATION
Vendredi 15 novembre 2002
Participent à la table ronde :
Bachir BOUMAZA, ancien Président de la deuxième chambre algérienne
Slimane BENAÏSSA, dramaturge
Reza DANESHVAR, écrivain
Marek HALTER, écrivain
Jordan PLEVNES, dramaturge, ambassadeur de Macédoine à Paris
Reza, photographe
Sabine YI, journaliste
Paula JACQUES, romancière et productrice d'émissions radiophoniques
La table ronde est animée par Philippe GARBIT, producteur à France Culture.
" Tous les coins de terre se valent ", Victor Hugo, écrivain, Pair de France puis Sénateur.
Philippe GARBIT
Je vous remercie d'avoir répondu si nombreux à l'invitation du Sénat qui, dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la naissance de Victor Hugo, a souhaité organiser un colloque international qui a pour titre : "Ce que c'est que l'exil, témoignages pour aujourd'hui." IL eût été intéressant d'évoquer Victor Hugo et ce qu'a représenté l'exil dans son oeuvre et dans sa vie, mais cela a déjà été fait ce matin.
Victor Hugo sera la figure tutélaire, de référence et |de réconciliation, de notre colloque. Je vous propose d'entendre des paroles d'exilés. Deux tables rondes seront organisées au cours de cette après-midi. La première portera sur le thème "souffrance et confrontation".
Faire parler de l'exil - sujet douloureux - peut présenter un côté voyeur. Nous savons que l'exil n'a pas la même valeur selon que l'on est parti du pays enfant, adolescent ou adulte, ni selon que l'on a été accueilli ou accompagné. Une différence intervient également selon que l'on est parti pauvre ou riche et selon que l'on a, ou non, un art à exercer. Je vous propose de nous parler de vos histoires d'exil. Pour nous, les Français, descendants d'exilés ou pas, ce sont souvent des histoires de vie. Vous allez nous raconter comment s'est déroulé ce roman familial. Ce roman pourrait commencer par ces questions : Pourquoi êtes-vous partis ? Comment êtes- vous partis ? Êtes-vous partis libres ? Vous verrez ensuite ensemble les similitudes et les différences de vos exils.
Reza, vous êtes iranien. Vous avez quitté votre pays en 1981. Toutes les histoires d'exil sont marquées par une date. Il y a un avant 1981 et un après 1981. Que s'est-il passé avant 1981 ?
REZA
J'ai en fait quitté l'Iran le 25 mars 1981 à 7 heures 25 du matin. Vingt ans après, je reste ému en pensant à cette date, l'émotion du dernier regard vers un pays, une culture, et ceux que nous avons laissés derrière nous. Je suis parti pour délit de pensée et pour délit d'image. Je suis photographe. Je travaillais pour l'agence France-Presse, pour l'agence SIPA presse et pour Newsweek. Les années 1979 et 1980 ont marqué l'Iran. Ces années ont vu la révolution, le début de la guerre avec l'Irak et la prise d'otages à l'ambassade américaine. Je couvrais tous ces événements pour la presse internationale jusqu'au moment où la République islamique a commencé à attaquer son propre peuple. Les premiers à être attaqués ont été les Kurdes. Un Gouvernement qui venait de prendre le pouvoir par la révolution était en train de massacrer son propre peuple. En tant que journaliste photographe, il était de mon devoir de couvrir ces événements. Comme nombre de mes confrères, j'ai réussi à me rendre sur les lieux malgré l'interdiction. Mes reportages ont été publiés dans le monde entier. Ils constituaient le seul témoignage sur cette guerre que le Gouvernement menait contre son peuple. Mon arrêt de mort était signé. C'est pourquoi j'ai conservé mon seul prénom, Reza, qui est très commun en Iran. Cela m'a permis de continuer à travailler pendant deux ans, avant qu'ils ne me retrouvent.
Philippe GARBIT
Vous avez aussi passé quelques années en prison sous le régime du shah.
REZA
J'ai été prisonnier politique pendant trois ans sous ce régime, pour le même délit : j'étais photographe et je dénonçais des injustices, grâce à mes photos. J'étais étudiant, et je ne pouvais accepter l'injustice. La seule solution du Gouvernement était d'arrêter un jeune étudiant de 22 ans. J'ai été torturé pendant cinq mois puis emprisonné pendant trois ans car j'avais envie de m'exprimer. Le Gouvernement révolutionnaire est allé plus loin : il m'a condamné à mort.
Philippe GARBIT
Vous souvenez-vous de votre dernière photographie prise en Iran ?
REZA
Ma dernière photo a été prise à l'aéroport. Un obus est tombé à quelques mètres de nous. Certaines personnes ont été grièvement blessées, et j'ai reçu quelques éclats dans la main. Avec une main blessée, je suis retourné à Téhéran et j'ai obtenu une autorisation de quitter le territoire, en me faisant passer pour un blessé de guerre. La blessure de ma main a sauvé ma tête.
Philippe GARBIT
Slimane Benaïssa, vous êtes né à Guelma, en Algérie. Contrairement à Reza, vous ne vous êtes pas dit que vous alliez quitter votre pays, mais que plutôt vous n'alliez pas y retourner.
Slimane BENAÏSSA
L'histoire a fait que je me suis trouvé dans une situation inverse. Je suis venu en France pour honorer un contrat avec un atelier d'écriture. C'est pendant ce voyage que trois de mes amis ont été assassinés. Ma fille m'a appelé en me demandant de ne pas rentrer. Ils ont été les premiers intellectuels tués. Je suis venu en France pour un mois et demi, et j'y suis depuis maintenant dix ans. Le thème de la pièce était le retour. Je venais rencontrer de jeunes beurs et un "grand frère" afin d'expliciter la problématique du retour. Au bout d'un mois, ils me demandaient quand j'allais repartir.
Philippe GARBIT
Vous avez travaillé avec Kateb Yacine. L'arabe dialectal est arrivé au théâtre grâce à vous.
Slimane BENAÏSSA
Nous voulions communiquer directement avec le peuple algérien. En 1962, tout était à faire. Il fallait inventer le théâtre, le jeu et la langue. Il était nécessaire de communiquer. Le théâtre est le lieu dans lequel on résout les conflits d'une société, mais aussi où l'on apprend à dialoguer. Le théâtre est le dialogue. Nous cherchions à réinventer une langue de dialogue et à la laïciser. L'arabe classique est investi de terminologies religieuses, puisqu'il est né de la religion. L'arabe dialectal est également très religieux. Il n'est pas possible de présenter ses condoléances sans utiliser une formule religieuse. Il fallait laïciser notre langue, la rendre humaine afin que nous puissions résoudre nos problèmes.
Je finis d'écrire un roman, La dernière nuit d'un damné. Il raconte les trois ans qui ont précédé un attentat terroriste, la préparation des trois kamikazes musulmans. Je souhaite lire l'avant-propos de ce livre, que j'ai commencé il y a six mois. Victor Hugo écrivait en 1832 Le dernier jour d'un condamné. La continuité naturelle de la Révolution française et des droits de l'homme était l'abolition de la peine de mort, il en était l'initiateur. En 1962, Soljénitsyne écrivait La journée d'Ivan Denissovitch, plaidoyer contre la mort lente dans les goulags des révolutions populaires, un plaidoyer contre les murs de toutes sortes, qui a mené à la chute du Mur. Si je me sens lié à ces deux génies de la littérature mondiale, c'est d'abord par la pensée, mais surtout par ma situation historique. En effet, comme ce fut le cas pour eux, l'histoire me met en face de la responsabilité de dire combien certaines morts sont injustes, inconcevables, inadmissibles. Mon histoire face à l'intégrisme et en tant que musulman me dicte de placer la troisième pierre du Petit Poucet sur la route des ogres afin de repérer le chemin qui mène à l'humain en écrivant La dernière nuit d'un damné qui, j'espère, sera un plaidoyer contre toutes les idéologies de la mort.
« Victor Hugo a fait de la Belgique une base de repli pour son combat et la Belgique n'était pas le symbole des valeurs de son combat.
Victor Hugo ne risquait pas sa vie en France parce qu'il défendait en France des valeurs belges.
Ce que je dis paraît tout à fait évident et pourtant, si je suis en exil en France, c'est parce que je défendais en Algérie les valeurs fondées par la révolution française.
Face à l'intégrisme, j'ai risqué ma vie pour défendre l'Algérie et face à l'Algérie, je risque ma vie pour défendre les valeurs françaises.
J'aime le peuple algérien qui m'a vu naître et j'en suis fier.
J'aime le peuple français parce qu'il a donné son sang pour construire et offrir au monde une idée de la république, de la démocratie, de la laïcité dans leur forme la plus moderne. J'y adhère et j'en suis fier. En mon âme et conscience, je suis autant Algérien que Français. Je suis Algérien de naissance et l'Algérie est le berceau de mon enfance. Je suis Français de conscience et la France est le berceau de ma renaissance d'adulte. Je ne sortirai de l'exil que lorsque l'adulte que je suis pourra jouir en toute liberté de l'espace de son enfance et lorsque l'enfant que j'étais se reconnaîtra pleinement dans l'adulte que je suis devenu.
C'est pour cela que je ne peux dire que je suis un Algérien exilé en France, et que je ne peux affirmer que la France est un exil pour moi. Parce qu'en réalité, je suis exilé d'un pays utopique. Je suis l'exilé d'une utopie qui serait la fusion de l'Algérie et de la France. Car la raison réelle de mon exil est l'échec d'une colonisation doublée de l'échec d'une indépendance.
Pour ma part, je me définis comme tri-culturel, de culture berbère, française et arabe. Ma langue est pluralité, mon lieu culturel est mon métissage. Ma parole en est la synthèse. Ainsi, je suis le fils de l'histoire et non de mes parents. Ils ont été mes géniteurs biologiques et mon existence culturelle allait se faire ailleurs que dans l'espace d'origine. L'histoire est devenue une sorte de lieu psychanalytique dans lequel je forge ma pluralité. Elle est la justification et la raison de mon outil : la langue. Elle est mon alibi identitaire. Celle du métis qui sait plusieurs langues et que chaque langue ignore. C'est dans ces gouffres que j'ai rencontré la tragédie à dire et à écrire. Et le théâtre s'est imposé à moi comme lieu d'écriture. Née du tragique et pour le tragique, la poétique devenait mon pain quotidien et le sérum d'un peuple anémique sur le plan culturel. Au théâtre, lieu de socialisation réel de tous les conflits d'une société, je donnais l'écrit et il me rendait la parole. Je lui donnais la solitude, il me rendait le dialogue. Je lui donnais mes malheurs, il me rendait la joie. Je lui donnais mes larmes, il me rendait mon rire. Le théâtre, par sa capacité à convertir le malheur en fête a fait ma vie d'homme et a garanti ma survie d'être. Il n'est pas pour moi un lieu que j'ai choisi, il est un lieu que ma nécessité a choisi. Mais mes malheurs s'entassent avec autant de spécificité, de densité et de poids. Je me suis retrouvé comparable à un bulldozer caché de la vue de tous par le volume de ce qu'il pousse devant lui. Il me fallait éclaircir tout cela, déblayer le terrain et je ne pouvais le faire qu'avec les miens pour pouvoir aller vers les autres. Forger une parole comprise, parlée et entendue par les miens était la seule garantie d'établir un dialogue avec le monde. C'est ce qui m'a fait choisir l'Algérie comme lieu géographique à mes écrits et à mon existence d'auteur. Jusqu'au jour où ma vie fut menacée. Face à la mort, j'ai quitté mon pays. Le chemin de l'exil s'imposa comme un nouveau lieu d'écriture. Les rôles se sont alors inversés : ce lieu est devenu le bulldozer et moi les problèmes. Pour ne pas risquer d'être écrasé, il me fallait pousser mes problèmes avec autant de force et de rapidité que le bulldozer. Face au danger de me perdre dans les méandres d'une vie fragilisée à tous les niveaux, j'ai compris que je devais intégrer l'exil comme une dimension intérieure à moi et non comme une situation extérieure qui risquerait de m'enfermer de plus en plus dans la solitude jusqu'à la solitude absolue. C'est en apprivoisant l'exil que l'on reconquiert sa liberté. Je refuse qu'il soit mon lieu d'écriture. Il faut qu'il reste un voyage. C'est dans cette confrontation à l'exil que je compris que sa forme la plus simple était la séparation d'un pays, des siens. Quant à sa forme la plus complexe, celle qui consiste à toujours vouloir dépasser ses limites et à encourager les autres à dépasser les leurs, elle était en moi depuis longtemps. L'exil me fit comprendre que j'étais un ancien exilé nouvellement déplacé. Au bout de tous ces chemins initiatiques ou mon désir fut mon guide, la poésie mon refuge, et le silence mon ennemi, je n'ai voyagé que vers moi-même à la recherche des autres. L'autre est l'aboutissement de mon écriture. Il est le lieu humain de mon écriture. L'écriture a humanisé mon « moi », au point qu'il ne pense qu'à l'autre. Elle est un voyage dont le lieu n'est pas le train mais le compagnon. Elle échappe à tous les lieux. Elle en est la négation pour la résistance, pour l'invention, pour l'existence. Écrire, c'est s'échapper pour vivre, c'est mentir pour raconter, c'est se souvenir pour oublier, c'est inventer pour nier et permettre au malheur d'être sous la lumière dans sa vérité aux yeux de tous, c'est remonter le malheur jusqu'à la source et en rire, avec le désir d'être toujours dans la beauté et la générosité et l'espoir d'atteindre les consciences avec une ou deux métaphores mensongères qui font la vérité des poètes.
En fin de compte, l'écriture est le seul lieu qui me permet d'échapper à tous les autres car il casse chaque jour un lieu de mon aliénation et reconstruit un lieu de ma liberté. Elle est mon seul recours dans ma négociation avec l'autre, avec le malheur, avec l'exil, avec la vie et avec la mort, elle est le bunker dans lequel j'implose et au- delà duquel j'explose.
Mais si je lutte pour dépasser mes limites, ai-je fait dépasser aux autres leurs limites ? En faisant exploser à l'intérieur de moi toute frontière impossible, ai-je pour autant gommé de mon espace les frontières ? L'exil est une école du dépassement de soi, et plus nous résolvons nos contradictions internes plus les contradictions externes nous apparaissent de plus en plus aberrantes, absurdes, insupportables. Ainsi né un nouvel exil et j'ai la nette impression que l'exil nous féconde pour nous faire accoucher encore et encore d'autres formes d'exils, beaucoup plus intimes beaucoup plus profondes beaucoup plus sereines
Et on sort petit à petit de l'exil patriotique, national, terrien pour entrer dans une sorte d'exil aérien où on plane, et à ce stade de mon exil je plains les autochtones.
Toujours est-il que Le 10 février 2003 à 11 h 55, cela fera dix ans que je n'ai pas vu le sol algérien. J'ai fait de mon billet de retour périmé une oeuvre d'art sous verre dans mon bureau. Le 10 février 2003, j'irai à Orly à la cafétéria de l'aéroport et je demanderai un café serré (car à chaque fois que j'arrivais à Orly, avant de passer aux bagages, je prenais un café fort pour réaliser que j'étais bien arrivé à Paris). Et je me dirai : il y a dix ans, c'était hier. Peut-être qu'à ce moment-là, le temps d'un café, je me sentirais réellement en exil parce que simplement j'ai pris le temps d'y penser. Ce qui sauve un vrai exilé, c'est qu'il développe en lui une énergie extraordinaire et s'il a du talent, il sera exceptionnel. Il s'investit dans le travail pour ne pas avoir à réfléchir à sa situation. Car au fond, on devient libre. Plus de plan de carrière, plus d'ambition sociale, absence de regard de notre société sur nous. On devient subitement exposé à la planète entière sauf aux nôtres. Renié par eux, on est contraints de se faire entendre par le monde pour être entendus par les nôtres. Nos peuples n'ayant pas les moyens d'être dans l'universalité, ils nous livrent à l'enfer de l'exil pour que nous le soyons. Nos peuples ne sont pas barbares, nos peuples ont compris que pour devenir civilisés, leur histoire leur impose de dépasser la barbarie.
Mis sur le banc de deux sociétés, celle du départ et celle de l'arrivée, on devient un regard libre sur les autres, sur nous-mêmes et la lucidité nous dit que dorénavant, nous n'existerons que par ce que nous ferons. Le travail devient non pas la raison de vivre mais de survivre. C'est pour cela que les enfants du pays sortent dans la rue pour réclamer la diminution du temps de travail et l'augmentation des salaires alors que les exilés sortent pour réclamer du travail quel que soit le salaire. Tout cela pour dire, moi qui suis contre toute forme de guerre et toute solution de violence, et qui lutte partout où il m'est possible pour construire la paix, que l'exil m'empêche d'être en paix avec moi-même. C'est ma seule et unique douleur. Douleur qui est heureusement la source de toute ma créativité et que l'exercice de l'art transforme en bonheur. Je troque ainsi mes douleurs d'homme contre des joies d'artiste. Nul n'est exempt du malheur, et rare sont les artistes heureux. Si mon pays n'a pas pu m'éviter certains malheurs, je remercie l'exil de faire de moi un artiste heureux pour le bonheur d'un public qui, je l'espère, m'a aimé et adopté.
Pour finir, tous les étrangers se plaignent, à tort ou à raison, de la dureté des lois à leur égard. Personnellement, j'ajouterais à cette dureté une restriction supplémentaire en matière de demande de nationalité. Je préférerais qu'elle se passe dans une cérémonie de cooptation. Parce que personnellement, je suis sûr d'aimer la France, j'ai risqué ma vie pour ses valeurs. Je voudrais être sûr que la France m'aimera le jour où je deviendrai Français. Parce que je n'ai jamais pensé qu'un jour, en devenant Algérien le 5 juillet 1962, l'Algérie ne m'aimerait plus. »
Philippe GARBIT
Merci, nous vous avons écouté avec émotion. Vos propos vont rester dans nos pensées toute cette après-midi. Sabine Yi, vous êtes coréenne.
Sabine YI
Je suis conférencière sur l'histoire du thé, la cuisine et l'histoire de la Corée. Ce sont des prétextes qui m'évitent de dire mon histoire. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais parlé de la raison pour laquelle je suis ici. Je suis arrivée en 1964. Je pensais suivre quelques années d'étude comme toute personne qui admire la France, puis rentrer chez moi. Ma situation provisoire a perduré plus de trente ans. Dans les années 1968, j'ai participé au mouvement de prise de conscience pour contrebalancer le penchant trop autoritaire d'un régime militaire. Je suis sud-coréenne. Depuis trente-huit ans, j'ai organisé de nombreuses manifestations afin de faire connaître la Corée.
Philippe GARBIT
Vous êtes correspondante pour des journaux de Séoul.
Sabine YI
J'ai organisé une sorte de résistance à distance, en publiant des pamphlets et en organisant des colloques. J'ai collecté des signatures pour arrêter des condamnations à mort injustes. Je voulais absolument faire revenir la démocratie dans mon pays. La Corée a cinq mille ans d'histoire et je suis issue d'une famille qui remonte à 1296. Mon grand-père a vécu de 1890 à 1946, juste après la libération de l'occupation japonaise. Il a vécu toute la période de l'occupation. Les sévices subis à cette époque ont été terribles. Mon grand-père était un propriétaire terrien. Il a eu l'intelligence de partager sa terre juste avant que les Japonais n'imposent des mesures foncières qui obligeaient à la déclarer. Cette mesure avait pour objet de prendre la terre coréenne.
Par ailleurs, le grenier de mon grand-père était toujours vide, parce que les Japonais envoyaient toutes les récoltes au Japon. Les jeunes hommes étaient enrôlés de force afin de partir mourir au front à la place des Japonais. Les jeunes filles de douze ou quatorze ans étaient capturées en plein village pour devenir des femmes de réconfort au front. Je n'ose pas décrire les difficultés qu'ont connues ces jeunes filles. Elles ont erré pendant cinquante ans après la guerre parce qu'elles n'osaient pas rentrer en Corée. Elles ont erré aux Philippines, en Asie du Sud-Est ou dans des îles éloignées.
Un journaliste japonais a trouvé une photographie prise pendant la guerre. Il s'est demandé qui étaient ces jeunes femmes. Il a fait des recherches dans les archives, malgré les barrages qui lui ont été opposés. Avec la collaboration de journalistes coréens et un appel radio, 139 000 femmes de réconfort ont pu être recensées. Les survivantes sont âgées de 70 ans. Un procès pour crime de guerre a été organisé.
La Corée, pays entouré de trois puissances, a une superficie équivalente à la moitié de celle de la France. Sa petite taille a favorisé les invasions. Cependant, nous sommes riches de cinq mille ans d'histoire, nous sommes indépendants, nous possédons notre langue. Nous en sommes fiers.
Malgré une histoire souvent faite de misère, les Coréens ne sont pas tristes. Il est quoi qu'il en soit un mot coréen, han, que je souhaiterais porter sur l'autel de Victor Hugo. Il a 22 sens : un ; le commencement ; la clarté ; la luminosité ; l'unité ; la réunification ; la population ; l'acceptation ; l'ensemble ; l'est ; la même race ; la couleur blanche; la droiture; la justesse; l'auteur; la même matière; une très grande quantité ; le ciel et le dieu ; l'infini ; le sommet ; l'aura ; sa majesté le roi et le parfait État ; la tolérance. Le sens d'acceptation concerne directement la souffrance d'exil. Celui de "tolérance" se rapporte également au thème de ce jour.
Mon grand-père a demandé pardon à nos ancêtres pour ne pas avoir su garder notre indépendance. Selon lui, la Corée avait souffert par la faute des coréens. Il est parti. Il a connu la souffrance, la révolte et la colère. Il se battait clandestinement lorsque les Japonais venaient chercher les jeunes filles. Il s'est mêlé à un combat et y a perdu un oeil. Lorsque je lui demandais "Pourquoi vous manque-t-il un oeil ?", il me répondait "Je suis tombé de cheval". Quelques années après, il m'a donné une autre réponse à cette question, et j'en ai déduit qu'il ne disait pas la vérité. À sa mort, j'ai appris de mon père qu'il avait perdu son oeil dans un combat. En mourant, il disait qu'il n'était pas triste et qu'il avait fait tout ce qu'il avait pu faire. Il nous a dit qu'il nous transmettait son han et que nous ne serions jamais seuls. Nous avons compté trois millions d'exilés et quatre millions de morts sous l'occupation japonaise. Mon grand-père nous a dit que tous ces morts seraient avec nous parce qu'ils nous transmettaient leur han, leur souffrance devenue espérance.
Mon ouvrage est centré sur la recherche de l'espérance. D'après Gabriel Marcel, l'espérance est une attitude d'attente, une attente qui apparaît là où nous n'avons plus à espérer. L'attente est plus qu'une acceptation, c'est une sublimation de toute la souffrance qui devient la force. Il n'est donc pas possible de tomber dans le désespoir. Victor Hugo explique que tout ce qui a eu lieu pendant 38 ans était minime face aux sacrifices véritables que certaines personnes ont offerts. Dans Les Contemplations, Hugo écrit :
« La source tombait du rocher
Goutte à goutte dans la mer affreuse.
L'océan, fatal au nocher,
Lui dit : - Que me veut-tu, pleureuse ?
Je suis la tempête et l'effroi,
Je finis où le ciel commence.
Est-ce que j'ai besoin de toi,
Petite, moi qui suis immense ? -
La source dit au gouffre amer :
- Je te donne sans bruit ni gloire
Ce qui te manque, ô vaste mer !
Une goutte d'eau que l'on peut boire. »
La souffrance d'exil de chacun d'entre nous représente une goutte d'eau, mais une goutte d'eau à boire.
Philippe GARBIT
Je vous remercie. Marek: Halter, avec vous, le mot exil ne peut pas s'employer au singulier. IL s'agit d'exils et d'errances. Vos prédécesseurs à cette table auraient pu dire à quel jour et à quelle heure ils ont quitté leur pays. Ce n'est pas votre cas.
Marek HALTER
Je ne sais pas si mes prédécesseurs sont des exilés. Je ne suis pas sûr non plus que Victor Hugo ait été exilé. Il a dit qu'il était exilé en France, mais il a dit ensuite qu'il était réfugié. Aujourd'hui, nous parlons de réfugiés politiques, comme les républicains espagnols dans les années 1930 ou les dissidents soviétiques dans les années 1960. Un réfugié est ailleurs et regarde vers la source. Un réfugié est en France, il continue à parler russe, coréen, arabe ou berbère. IL continue de vivre la réalité d'autrefois. Il cherche dans l'environnement un soutien pour son combat, mais l'environnement ne l'intéresse pas vraiment. Il n'écrit pas dans la langue de son environnement. L'Angleterre n'intéressait pas Victor Hugo. Il n'avait que de l'ironie pour la Belgique. Il s'intéressait à la France. L'exilé est celui qui vient d'ailleurs et qui s'habitue à vivre dans son nouveau milieu. Il prend la langue. Il introduit dans cette langue un accent. Je parle et j'écris avec un accent. Je pense être le seul écrivain français à avoir écrit ainsi. Je parle d'ailleurs avec le même accent dans toutes les langues, même le russe. L'exilé promène son accent dans des cultures différentes qui deviennent ses cultures. Mon cas est particulier puisque je suis né étranger. J'appartiens à une minorité en Pologne : 11 % des Polonais étaient juifs. Nous étions déjà ailleurs. Il existait en Pologne des villages totalement peuplés de Juifs, nous parlions yiddish, nous lisions la presse yiddish etc. Au sein d'un pays, il y avait des gens qui étaient déjà ailleurs. Les hommes politiques polonais apprenaient le yiddish pour séduire les électeurs. J'étais donc en exil au sein même du pays dans lequel j'étais né. Au fur et à mesure, il ne s'est plus agi d'une perte, mais d'une conquête constante de cultures et d'horizons.
Descartes a su que pour comprendre son propre pays, il faut partir. Montesquieu a compris que, pour voir la France, il fallait faire venir des Perses. Quand nous nous trouvons dans un pays, nous sommes dans un environnement et nous ne le voyons plus. Il faut être en exil de l'intérieur, pour comprendre pour qui nous parlons et au nom de qui et de quoi nous parlons.
J'ai grandi en Ouzbékistan, en Asie Centrale. Curieusement, je parle ouzbek. Curieusement, l'un des deux Perses que Montesquieu a fait venir en France pour renvoyer aux français comme dans un miroir leur propre image s'appelait Usbek. C'est cet Usbek qui permet à Montesquieu de dire aux français ce qu'ils sont. En tant que petit Ouzbek juif de Pologne, je vous permets peut-être de comprendre ce que vous êtes.
Philippe GARBIT
Vous étiez un petit Ouzbek considéré. Vous êtes allé à Moscou très jeune pour offrir des fleurs à Staline.
Marek HALTER
J'ai grandi dans la rue et je n'ai jamais pu aller à l'école. Je n'ai pas la nostalgie d'un pays mais d'une école. J'ai la nostalgie de l'école, de l'université, de la méthode que l'on reçoit, et non de la connaissance. Il est possible d'acquérir la connaissance dans la rue. J'étais un petit voleur, pas très bon. Je me faisais toujours tabasser, mais j'avais cette chance inouïe d'avoir lu beaucoup de livres. J'ai su les raconter aux vrais voleurs. Je dois tout à Alexandre Dumas, un grand ami de Victor Hugo. J'ai pu raconter Les trois mousquetaires. J'inventais les aventures de d'Artagnan à Jérusalem. Cela m'a sauvé la vie. Ma petite soeur est morte de faim, mais j'ai pu sauver la vie de mes parents en racontant des histoires à de vrais voleurs qui me donnaient de quoi survivre. A la fin de la guerre, la police secrète a raflé les petits voleurs. On nous a donné des foulards rouges, et nous sommes devenus des pionniers. Pour la fête de la victoire, on m'a envoyé à Moscou pour donner des fleurs à Staline.
Philippe GARBIT
Paula Jacques, vous souhaitez réagir.
Paula JACQUES
Nous avons tous des points de convergence. Nous sommes tous en exil, et ici en tant qu'écrivains placés sous la grande aile protectrice et écrasante de Victor Hugo. Nous avons énormément de points communs, mais aussi de spécificités. Ce sont peut-être les spécificités des écrivains. Reza a été chassé de son pays pour délit d'opinion politique. Le point de vue de Slimane Benaïssa est le même.
Comme Marek Halter peut-être, mon seul délit était celui de l'appartenance à une confession précise qu'est le judaïsme. Il existe toutes sortes d'exil : l'exil historique, économique ou politique. Il est aussi des exils historiques contre lesquels vous ne pouvez pas agir. J'appartiens à un peuple dont l'exil est sans retour. Lorsque Reza ou Slimane Benaïssa parlent de leur situation en France, ils parlent d'un exil placé sous le signe d'un retour possible. Je viens d'une terre vers laquelle aucun retour n'est possible. Je suis née en Égypte, et l'histoire de la communauté juive d'Égypte s'est arrêtée en 1956, au moment de l'affaire de Suez. Je me considère dans une sorte d'exil définitive, dépourvue d'idée de retour. Cet arrachement à mon pays a été ma catastrophe, mais aussi l'événement le plus heureux de toute mon existence. Cet exil qui m'arrachait à mon pays était déjà un peu inscrit dans les faits. La communauté juive d'Égypte parlait arabe jusqu'au début du XX e siècle. Tout d'un coup, cette communauté s'est tournée vers la France et les valeurs françaises. Il existait une sorte de rapport de patrie de coeur envers la France, alors même que la communauté vivait sur la terre d'Égypte.
J'étais une petite fille élevée au lycée français du Caire, qui adorait la lecture et qui avait une vénération pour les écrivains français, surtout pour Hugo. Victor Hugo incarne la grandeur de la France. J'ai dans ma famille des femmes peu lettrées qui sont capables de réciter par coeur La légende des siècles. Ainsi, durant cette période, les Juifs d'Égypte se trouvent en Égypte sans plus y être. Ils sont tournés vers l'Occident. Ils parlent français. Ils se sont exilés à l'intérieur. Chassée à l'âge de 9 ans, je ne vais rejoindre la France que trois ans plus tard. Je vais donc être en exil de la France. Lorsque j'arrive dans ce pays, j'ai l'impression d'être dans la patrie de mes livres. Je rejoins ainsi le but premier, celui de se trouver dans la patrie de la langue. Les écrivains veulent écrire car ils aiment lire. Pour passer à l'écriture, nous disposons de la langue mais non de la même configuration psychologique ou organisation sociale que nos lectures. La littérature française que je vénère me paraît le comble de l'exotisme. Je comprends chaque mot, mais certains comportements ou certaines situations me semblent tellement éloignées de mon entourage que je souffre d'une sorte d'interdiction du passage à l'écriture. Certains livres donnent la permission d'écrire, en réconciliant la patrie physique retrouvée avec celle des livres. À l'âge de 12 ou 13 ans, lorsque j'arrive en France, je lis Les misérables et je découvre ces quelques pages sur l'argot des étudiants. Il s'agit d'une langue à l'intérieur d'une langue ; il y a deux langues françaises, ce qui signifie qu'une autre spécificité de la langue peut se faire entendre. À l'instar des livres d'Albert Cohen par exemple, ce livre démontre que le français offre la possibilité d'exprimer le déplacement, l'exil, le métissage, une autre culture. Nous avons chacun en même temps énormément de points communs et une expérience qui nous est particulière.
Philippe GARBIT
Slimane Benaïssa est parti mais j'ai noté l'une de ses phrases : "Le véritable exilé est celui qui ne sait pas pourquoi il se trouve là où il est." J'aimerais savoir, Bachir Boumaza, si, dans le contexte singulier de votre histoire, vous savez pourquoi vous êtes là. Votre histoire présente certainement des points communs avec d'autres histoires particulières : vous êtes né en Algérie française, vous êtes kabyle, autodidacte, écrivain et ancien Président du Conseil de la Nation en Algérie. Quel genre d'exilé êtes-vous, Bachir Boumaza ?
Bachir BOUMAZA
Cette rencontre est la seconde à laquelle je participe au Sénat. La première, qui s'est déroulée en janvier, était consacrée à Victor Hugo. J'ai eu l'occasion de rencontrer de grands connaisseurs de l'illustre écrivain, tous représentants de la Civilisation ; j'étais le seul Barbare. En effet, selon Victor Hugo, "la Méditerranée est composée de deux rives : au Nord, la Civilisation, au Sud la Barbarie." Malgré tout, je lui voue depuis mon adolescence une grande admiration et une grande sympathie, non seulement en tant qu'écrivain, mais également en tant qu'homme politique et homme de luttes. J'ai donc essayé de comprendre ce qu'il entendait par Barbarie. Mais il ne s'agit pas d'en parler ici.
"L'année Victor Hugo" s'achève et, comme vous le savez, il est mort sénateur. Sa dimension particulière d'homme politique m'intéresse chez lui. Vous l'avez précisé, je suis autodidacte et M. Poirot-Delpech, de l'Académie française, m'a un jour demandé pourquoi je connaissais aussi bien Victor Hugo. Cette question était légitime venant de sa part. J'ai répondu ceci : "Afin de ne pas sembler ingrat, je tiens à remercier les autorités françaises de m'avoir emprisonné à plusieurs reprises. Cela m'a donné l'occasion de lire Victor Hugo et de le connaître." Voilà au moins un aspect positif, bien que de manière indirecte, de la colonisation.
Je suis venu ici aujourd'hui avec l'idée de parler en respectant deux très importantes contraintes. La première est le temps. Je dois certainement préciser qu'en ce mois de novembre, je fête mon anniversaire. J'ai soixante-quinze ans et je suis dans l'action politique depuis soixante ans ; j'ai débuté à l'âge de quinze ans. Victor Hugo l'écrivain m'a amené à la culture mais c'est Victor Hugo l'homme politique qui m'a amené à la lecture. En cette année d'hommage à Victor Hugo, j'ai participé à toute une série de conférences, y compris en Suisse chez les autonomistes jurassiens, lors des semaines de la Francophonie. J'ai appris que deux Français sur cinq ne savaient pas qui il est, alors qu'il est l'écrivain le plus lu en Afrique et dans le tiers-monde. Pourquoi ? Je ne vais pas, comme M. Benaïssa, lire un texte que j'ai préparé car il faudrait une demi-heure, ce qui serait trop ennuyeux. Je précise simplement que je prépare un livre qui, j'espère, paraîtra l'année prochaine, qui s'intitulera Victor Hugo vu de l'autre bord de la Méditerranée. Sans être un " hugolâtre " comme le pensent certains, je suis un " hugolien " car Hugo est un homme universel dont la pensée est enrichissante pour tous. Mon ami, le regretté Claude Roy, a comparé, avec un fort esprit patriotique, Hugo au Mont-Blanc. D'autres l'ont comparé à l'Everest. Je préfère cette métaphore à la première qui me semble par trop nationaliste et trop chauvine. Victor Hugo appartient à l'ensemble de l'Humanité.
La seconde contrainte provient du fait que parmi tous les intervenants, qui sont des hommes de lettres, des écrivains, je suis le seul à pouvoir être qualifié "d'animal politique". La politique m'a permis de rencontrer Victor Hugo, pas l'inverse. Je parle donc essentiellement en homme politique. Pour reprendre l'expression de Marc Terk, je considère aussi qu'il convient d'arrêter une définition de l'exil. Vous connaissez tous la fameuse interrogation de Monsieur Jourdain, dans Le Bourgeois Gentilhomme, lorsqu'il se rend compte à l'âge de quarante ans qu'il parle en prose. Vu de la rive sud de la Méditerranée, je n'ai pas à lire Ce que c'est que l'exil, texte admirable et mémorable que Victor Hugo écrivit en novembre 1875.
J'ai écrit un livre il y a vingt-cinq ans pour condamner dès le départ l'intégrisme. Son titre est significatif : Ni Émir ni Ayatollah. Je ne pense toujours pas que l'Émirat ou les Ayatollahs puissent favoriser le développement et la modernité du monde arabo- musulman. Concernant Victor Hugo et ces messieurs de quarante ans qui ignoraient qu'ils faisaient de la prose, j'ai rencontré au bout de dix ans d'exil deux Algériens haut placés, de culture essentiellement arabo-musulmane. Nous avons discuté toute la nuit. Avant de prendre leur avion le lendemain matin, ils ont regretté qu'un homme comme moi perde un temps précieux alors qu'il aurait pu servir en Algérie. Je me suis aperçu qu'ils reproduisaient le modèle de Monsieur Jourdain. Ils ignoraient qu'ils vivaient sous un calendrier hégirien - l'Hégire, c'est l'Exil.
Je n'ai pas honte de dire que je suis musulman et que j'ai découvert l'exil par la lecture de l'un des meilleurs poèmes sur le sujet, à savoir le portrait de Mahomet par Victor Hugo. Les Occidentaux, les Français, l'ont lu pour la beauté du style. Je l'ai lu pour sa signification, dont la définition réside entièrement dans " l'an neuf de l'exil ". Sous couvert de parler de Mahomet, Victor Hugo parle en réalité de lui. Mahomet meurt sous sa plume au bout de neuf ans d'exil, alors qu'il est mort en réalité après onze ans d'exil. Toute la signification de l'Exil est dans ce poème. L'exil est un combat. Dès lors que Mahomet a terminé son exil, il n'intéresse plus Victor Hugo.
La définition de l'exil est importante, surtout dans la langue arabe, voire en kabyle, car il existe une confusion entre émigré et exilé. L'exil est un combat, une position de révolte, de rejet à l'encontre les pouvoirs tyranniques ou despotiques. C'est un acte de résistance. C'est pour cela que j'ai de l'admiration pour Victor Hugo, homme universel. Dans mon prochain ouvrage, je fais une comparaison entre Les Châtiments et certains poètes kabyles et arabes d'Algérie. Ces poètes sont des contemporains de Victor Hugo. Ils ne connaissaient pas son existence mais s'exprimaient avec le même sentiment de révolte concernant l'exil. Les années 1870-71 marquent la fin de l'exil de Victor Hugo du fait de la chute de Napoléon III suite à la bataille de Sedan. C'est également à cette époque que le "Verlaine kabyle algérien" écrit : "J'ai juré que de Tizi-Ouzou jusqu'au Lac Fadou, ils ne me commanderont pas. Nous nous briserons, mais nous ne plierons pas. Plutôt être maudit. Quand les chefs sont des maquereaux, je préfère quitter le pays que d'être humilié parmi les pourceaux." Un tel sentiment préside à l'exil.
Personnellement je suis parti amer, trahi par Boumediene à l'image de Victor Hugo trahi par Napoléon III. Ben Bella avait été déposé du pouvoir, accusé de "pouvoir personnel". Malheureusement, un an après avoir placé ma confiance en Boumediene, je me suis rendu compte que ce type de pouvoir avait été renforcé sous couvert de direction collégiale et de démocratie.
Philippe GARBIT
Vous en avez fait des allées et venues dans l'Histoire, Bachir Boumaza.
Bachir BOUMAZA
J'ai fait deux exils comme Victor Hugo et je totalise comme lui dix-neuf ans d'exil. J'ai de plus à mon actif six an de prison, dont trois à Fresnes.
Je suis parti en 1966 pour rentrer en 1980. J'ai entamé un second exil, comme Victor Hugo, qui a duré cinq ans et demi environ. Je me permets une remarque : au regard de mon expérience, l'exil est plus difficile que la prison.
Dans son texte magistral sur l'exil, Victor Hugo nous dit - on n'est pas obligé d'être toujours d'accord - au sujet des grands exilés, qu'il se réfère parfois à l'histoire vécue par certains grands hommes et qu'il en conclut qu'il n'est pas le seul. Tel est mon cas, mais dans certaines péripéties, je me sens plus proche de Jules Vallès et de Louise Michel. L'exil de Victor Hugo est relativement plus proche de celui - doré - de Sénèque que de la misère d'un Jules Vallès. Preuve en est la correspondance entre ce dernier, Hector Malot et Émile Zola. Jules Vallès y expliquait ses problèmes quotidiens pour se nourrir. Je retiens en premier lieu de l'exil la difficulté de trouver un pays d'accueil.
Philippe GARBIT
Il y en eut pourtant plusieurs : la Suisse, l'Allemagne...
Bachir BOUMAZA
En premier lieu, j'ai été expulsé de France dans des conditions très différentes de celles vécues par Victor Hugo. Il reçut à Jersey ses connétables anglais qui lui indiquèrent qu'il avait une semaine pour plier bagage avec ses enfants. Personnellement, j'ai disposé de moins d'une heure. Je peux l'affirmer, les témoins du stratagème sont encore vivants. On a appelé certains de mes amis pour leur signaler que l'on souhaitait entrer en communication avec moi. En conséquence, mes amis m'ont appelé pour me signaler que la police était à ma recherche ; c'était le réflexe attendu par les autorités, puisque au préalable leurs téléphones avaient été placés sur écoute de façon à localiser mon domicile. La police m'a interpellé et j'ai passé la journée au commissariat du Panthéon. J'ai tenté de faire intervenir un ami journaliste, qui était à l'époque directeur du Cabinet du ministre de l'Intérieur, mais sans succès.
La première réflexion sur l'exil a trait à la désillusion. J'ai pensé : "Moi, Boumaza, j'ai été le premier homme politique algérien à avoir été reçu par le Général De Gaulle. J'ai négocié les accords Giscard/Boumaza sur le vin et les hydrocarbures, je connais M. Debré, M. Michelet...." Sachez que lorsque vous êtes exilé, vous n'existez plus. Non pas que ces hommes n'aient pas de la sympathie pour moi, mais ils sont soumis à des pressions. Victor Hugo nous en parle, au sujet de la Belgique et des Anglais. Alger a astucieusement refusé que je vive le même sort que Ben Barka ; mieux valait que je parte mourir ailleurs. J'ai pu uniquement téléphoner à mon épouse afin qu'elle m'apporte mes effets personnels. Je devais en outre choisir un pays d'exil. Je n'ai pas choisi la Belgique comme l'avait fait Victor Hugo. J'ai choisi la Suisse pour rejoindre d'autres exilés.
La seconde difficulté a trait aux papiers : il faut avoir des papiers. Je suis sorti avec un passeport de ministre alors que je n'étais plus en exercice, ce qui rend facile sa confiscation.
Philippe GARBIT
Vous avez été ministre des Affaires sociales, de l'Économie...
Bachir BOUMAZA
J'ai été ministre de l'Économie, et au préalable de l'information et de la culture. J'ai été trois fois ministre.
Dans mon livre à paraître sur Victor Hugo, je mentionne ma rencontre avec un célèbre exilé, assassiné par la suite. Il s'agit du signataire des accords d'Évian, Krim Belkacem. Lors d'une discussion, je lui avais confié qu'il est nécessaire de savoir falsifier un passeport si l'on veut partir en exil ; dans le cas contraire, il ne faut pas sortir. J'y suis parvenu malgré la difficulté que représentait la célébrité de mon nom. Je devais conserver mon identité, mais avec des passeports marocains, algériens, tunisiens...
La troisième difficulté est la censure. Lorsque je suis arrivé en Suisse, j'ai été informé qu'il ne me serait pas remis de permis. Je suis libre de mes allées et venues, mais je dois signer un papier indiquant que je serai expulsé si je fais une déclaration déplaisante à l'égard des autorités d'Alger. Victor Hugo a vécu la même situation puisqu'il a été expulsé de Jersey suite à une déclaration. Si je veux exprimer mon opinion, je suis contraint de le faire en dehors de la Suisse.
De plus, sans lieu de résidence, sans papiers, comment trouver un travail ? Les difficultés s'accumulent. La différence est très nette entre un réfugié et un exilé. L'un de mes amis français, actuellement Médiateur de la République, m'a mis en contact avec le Conseil d'État afin d'être un réfugié avec des papiers d'identité en règle. J'ai refusé ce statut, car il limitait ma liberté de mouvement et d'expression. J'ai également refusé l'aide d'organismes charitables, comme la Cimade, qui pouvaient subvenir à mes besoins. Je vous parle de tout cela afin de vous faire comprendre la difficulté que représente l'exil, qui ne s'assimile pas à l'immigration mais est bien un acte de lutte : on quitte le pays car le rapport de forces est tellement défavorable qu'il devient impossible de lutter utilement de l'intérieur pour faire évoluer la situation. Le combat continue de l'extérieur.
J'aurais pu parler pendant une heure de trente ans d'exil et de prison, parler de soixante ans de vie politique. Parler de tout cela en quelques minutes seulement est frustrant. Je ne peux pas vous lire mon prochain livre, je cherche actuellement un éditeur et suis en train de le traduire en arabe. Mon immense admiration à l'égard de Victor Hugo découle de l'exil. IL aurait pu mener une existence paisible, mais il a préféré s'exiler, souffrir plutôt que de soumettre au diktat de Napoléon III. Merci.
Philippe GARBIT
Merci Bachir Boumaza. Jordan Plevnes, vous êtes aussi un homme politique, dramaturge et ambassadeur depuis deux ans.
Jordan PLEVNES
Oui. Je cherchais la phrase qui me permettrait de me libérer de ma culpabilité d'être un homme politique. M. Boumaza m'a inspiré en évoquant la Suisse. James Joyce a écrit une nuit : "Un exilé se considère comme vrai. Il considère son pays comme faux." Aujourd'hui, je dois peut-être me considérer comme faux puisque mon pays est vrai, du point de vue de la perspective historique. Est-ce une consolation ?
Philippe GARBIT
Vos papiers sont vrais...
Jordan PLEVNES
Selon un "classique" russe, "les vrais hommes sont rares comme la fausse monnaie." Si, comme le pense Albert Camus, la tyrannie de l'argent va se poursuivre, alors je préfère être de la fausse monnaie. Voilà ma réponse.
Philippe GARBIT
On parle d'exil, Jordan Plevnes. Vous êtes simplement un Macédonien à Paris. On ne peut pas parler d'exil, vous vivez à l'étranger. Vous êtes parti un jour ? À quel âge ?
Jordan PLEVNES
Je vais lire un petit poème en trois mouvements, qui va nous mettre dans l'ambiance de la globalisation. C'est un texte extraordinaire que j'ai lu il y a longtemps. Il est devenu un apocryphe de mes lectures. Il date du Moyen Age, parle des Bogomiles, des Cathares, de la Macédoine et des pays balkaniques. Nous sommes tous des exilés, un seul être vous manque et vous êtes en exil. En ce sens, il s'agit d'une consolation universaliste. Que représente Hugo pour la Macédoine ? Cette question peut aussi se poser ainsi : que représente-il pour la République universelle ? Avant cette dernière, il y avait des individus, puis des peuples. N'oublions pas que tout a commencé par un individu et finira pas un individu.
Premier mouvement : un exilé, Euripide, quitta Athènes pour la Macédoine - son Jersey - afin de terminer sa vie et d'écrire sa dernière tragédie, Archélaos, qui signifie "le commencement et le peuple" ou tout simplement "le commencement du peuple". La maison où il écrivit cette pièce possédait un grand dépôt dans lequel étaient rangées, par ordre chronologique, les tablettes de pierre noire sur lesquelles étaient inscrites les scènes de la tragédie. La dernière nuit, lorsqu'il acheva cette oeuvre unique et qu'il alla dormir, trente chariots conduits par cent vingt chevaux chargèrent les tablettes. Elles furent ensuite embarquées sur un navire, qui quitta le port de Salonique un jour de printemps de l'an -406, vers une direction inconnue. Le Président des Immortels, Makaron Pritanis, qui vivait dans sa petite maison - 169 e vers du Prométhée enchaîné d'Eschyle, condamné par Zeus pour crime d'amour envers de l'Humanité - fut averti une heure après. Depuis vingt-quatre siècles, il cherche ce navire et sa cargaison dans toutes les villes portuaires de la Méditerranée.
Deuxième mouvement : n'ayant rien trouvé, il change de direction. Depuis les grands chambardements de l'Histoire moderne survenus à partir du XVII e siècle, le monde capitaliste s'organise autour de la mer du Nord. D'une guerre à l'autre, quelques pays se disputent les atouts de la puissance et de la richesse - comme dirait un chroniqueur moderne - et donnent l'impression de chercher à ouvrir la porte de Makaron Pritanis. L'ère de la Méditerranée s'achève avec l'émergence d'une nouvelle époque dans le Nord. C'est une consolation, M. Boumaza, en ce qui concerne la Barbarie et la Civilisation. Makaron Pritanis arrive à Paris - à la recherche du commencement des peuples - le 1 er juin 1885 et assiste incognito aux funérailles de Victor Hugo. Ce jour-là, dans cette capitale universelle de l'Esprit, où la terre a submergé la mer, "dans cette foule immense, ceux qui l'ont vu ne le verront plus, ceux qui ne l'ont pas vu ne le verront jamais." 0 ! Combien d'étrangers sont venus le voir ? Hugo rêvait des États-Unis d'Europe devenant le coeur d'une République universelle. La liaison entre Hugo et la Macédoine s'établit exactement ici.
Comme l'écrivait le regretté Nicolas Bouvier dans L'usage du monde, "le coeur de l'Europe se trouve dans les Balkans et son cerveau est à Paris." Imaginons le propriétaire anonyme d'un coeur anonyme, venu de Macédoine pour assister à ces funérailles, comme apprenti tragédien chargé d'accompagner le Président des Immortels dans le grand large de l'Histoire. Celui-ci retourne de nouveau en Macédoine pour enseigner le français, cette langue universelle, dans des lycées ouverts dans plusieurs villes macédoniennes. C'est lui qui permet à Gotsé Delchev, le Garibaldi macédonien de lire, pour la première fois, La légende des siècles. Avant de mourir à l'âge de 33 ans, il écrit à un ami anonyme "Je comprends le monde, la République universelle, comme champ de dialogue culturel entre les peuples." Trois mois après sa mort, en 1903, la première République des Balkans est proclamée, pour dix jours seulement, hélas.
Notre "hugolien" Damé Gruev après la chute du rêve de l'indépendance de la Macédoine, dira en 1905 à un journaliste anglais : "Si la République universelle n'existe pas sur la Terre, nous allons la chercher plus loin et elle va s'appeler Underground Republic. " Soixante-dix ans plus tard, Victor Hugo est présent dans l'horizon national macédonien. Une vieille dame, d'une beauté et d'une élégance incomparables, Lika Chopova, nièce de Gotsé Delchev, vient en République de Macédoine, proclamée en 1944 dans le cadre de la Fédération Yougoslave de Tito, issue de la guerre antifasciste. Elle y vient pour y mourir car elle n'aurait pas su mourir ailleurs. Elle m'a révélé son secret familial. Plusieurs générations de cette famille mythique connaissaient par coeur les vers d'Hugo :
" Ô République universelle Tu n'es encore que l'étincelle Demain tu seras le soleil ! "
Le troisième mouvement répond à votre question. Hugo revient dans mon exil volontaire. Je quitte mon pays en octobre 1988, entouré de l'amour de ma femme - ici présente - et de nos deux enfants, devenus parfaitement bilingues. Après avoir prononcé au dernier congrès des écrivains yougoslaves vingt-huit lignes lyriques, vingt-huit éditoriaux dans la presse de la nomenklatura communiste soutinrent que je devais disparaître au plus vite. Dans ma confrontation avec la réalité politique j'ai dit "votre révolution n'est plus la mienne. J'ai droit à une révolution privée, je rejette l'adjectif 'notre' si le 'nous' va de nouveau faire couler le sang." J'ignorais à cette époque le mot "hugolien" : "La vraie définition de la République, la voici : moi, souverain de moi " Lorsque Victor Hugo mourut, tous les pays balkaniques étaient sous l'emprise de l'empire ottoman ou venaient de s'en libérer. Une anecdote tragi- comique à propos des récents événements fait s'interroger les habitants des Balkans sur la façon dont les Turcs ont pu les supporter pendant cinq siècles. Lors de la décomposition de la Yougoslavie, sans les Turcs, les peuples balkaniques sont devenus maîtres dans l'art de s'entretuer. Ils ont réussi à produire durant la dernière décennie du XX e siècle et en plein coeur de l'Europe, quatre cent vingt-six charniers dévolus à l'épuration ethnique. Que va-t-il se passer avec la Macédoine ? Cette question m'a hanté durant toute cette période de carnages.
L'écriture est l'art de la disparition. Je commençai à disparaître dans une mansarde de la place de la Contrescarpe, quartier de miséreux. Cette mansarde devint mon Jersey. "Pour les Hommes, comme pour les Nations, écrivait Mircea Eliade, l'épreuve suprême est leur capacité de contemplation dans la souffrance." Dans cette mansarde parisienne, j'ai constaté que ma situation ne formait qu'un zéro : ma langue, mon pays, mes idéaux, ma tragédie d'écriture, mes pensées, mes répliques, mes remarques, tout cela dessine un grand zéro. J'entre dans ce zéro, j'arrache ma peau, je me couche et je me vois en rêve comme un faucon aux ailes coupées. Le faucon est le seul oiseau dont les ailes se régénèrent. Je vais voler avec mes ailes régénérées... C'est dans cette mansarde que fut édité, avec l'aide de mes amis macédoniens, français et européens, le premier quotidien indépendant de la République de Macédoine, Republika, qui exista pendant cent soixante-trois jours. "Les peurs intérieures et les menaces extérieures", comme disait l'apôtre Paul, étaient une véritable épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes à cette époque. À la veille du référendum sur l'indépendance de la République de Macédoine, le 8 septembre 1991, le titre principal de Republika fut: "Bienvenue chez vous." Deux ans plus tard, la République de Macédoine devint le 188 e État membre des Nations Unies. C'est ainsi qu'elle a rejoint la République universelle et que je suis devenu son ambassadeur à Paris. Voilà pour la réponse.
Avant de retrouver Paris en tant que représentant officiel de mon pays, je sortirai à nouveau Hugo du dictionnaire encyclopédique de mon coeur. Il nous explique que l'histoire de l'existence tragique du passé ne pouvait nous aveugler et masquer les ténèbres des crimes à venir. Je crois que même aujourd'hui - le 15 novembre 2002 - le Président des Immortels est venu célébrer avec nous le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo. Après tant d'années passées à la recherche de la tragédie perdue d'Euripide, il ne connaît toujours pas la question qui le tourmente lorsqu'il contemple le miroir du Monde : où commence le peuple et où finit l'Histoire? Merci.
Philippe GARBIT
Merci Jordan Plevnes. Nous avons commencé cette première table ronde avec Reza Deghati, reporter-photographe. Reza Daneshvar vous êtes également iranien. Avez- vous trouvé votre Jersey à Paris ? Pensez-vous également que l'écriture est aussi un art de la disparition ? Comment s'est passé votre exil ?
Reza DANESHVAR
Avant de répondre à votre question, je souhaiterais évoquer quelques réflexions concernant ce que je viens d'entendre. Hugo est l'un des écrivains français les plus lus en Iran. Il y a une vingtaine de traductions pour les seuls Misérables. Si l'on en croit une statistique, il était à mon époque l'écrivain étranger le plus lu dans mon pays. Aujourd'hui, je ne saurais dire.
Le second point concerne Paula Jacques lorsqu'elle évoque certains exilés qui ont un espoir de retour. Je pense que le problème se pose de manière plus subtile. Pour les écrivains iraniens, je ne pense pas qu'il soit facile d'imaginer retrouver le passé perdu. Tout est changé dans notre perception du pays et même parfois de la langue. Lorsque je lis les textes politiques des journalistes iraniens, je suis face à une langue déformée. On ne peut jamais retrouver le passé que l'on a perdu.
Philippe GARBIT
Vous pourriez craindre d'être exilé dans votre pays d'origine si vous y retourniez.
Reza DANESHVAR
Je voulais aborder ce point. Les écrivains qui vivaient dans des pays comme l'Iran étaient déjà marginalisés. Par rapport au système qui gouvernait le pays, avant ou après la Révolution, nous étions toujours exilés. Notre exil n'en est pas facilité par notre exil antérieur, mais nous sommes habitués à être différents et rejetés, le cas échéant, par le pouvoir de notre pays. Je pense que cela reste la même chose lorsqu'on revient car la résistance de la tradition dans des sociétés comme la nôtre est beaucoup plus forte que l'on veut bien l'imaginer. Cette habitude de l'exil ne le facilite pas pour autant, comme je vous l'ai dit. Je voudrais vous raconter à ce propos des petites souffrances et des petites difficultés que je connais ici en tant qu'exilé. Il faut savoir en outre que chacun vit son exil d'une manière qui lui est propre. Mes problèmes sont plutôt de l'ordre du temps et de la langue. J'ai essayé de résumer ces deux point dans un petit texte.
« On me demande souvent pourquoi j'ai choisi de vivre en France. Parce que Paris est en France. Pour moi cette ville a le même sens qu'Athènes dans le monde antique. Je l'ai aimée dès mon jeune âge, peut-être parce que je l'ai connue à travers les textes et les belles images. Des événements comme la Révolution française, la Commune de Paris, la Résistance, Mai 68, l'existentialisme, le théâtre de l'absurde, la nouvelle vague, etc. étaient des références pour notre culture moderne. La plupart des écrivains que nous aimions vivaient à Paris. Lorsque le problème de l'exil se posa, je n'ai pensé à aucun autre lieu que Paris. J'étais un écrivain, et la place d'un écrivain exilé était à Paris. Mais je n'avais jamais envisagé que, pour quelqu'un de ma condition, Paris était l'endroit le plus pénible pour écrire, alors que je ne m'y suis jamais senti étranger.
Je n'avais ni prétention au pouvoir, ni appartenance militante, mais j'avais toujours défendu la liberté et espéré la démocratie. Mon exil était la conséquence de mon statut d'écrivain, que je n'avais pas choisi. Je suis persuadé que cela me vient de caractères qui sont innés. Être écrivain n'est pas facile dans un pays comme le mien. Lorsque le fait d'écrire s'est présenté à ma conscience comme une raison de vivre et que je l'ai accepté, je ne connaissais pas les ennuis qui m'attendaient. Lors de mon départ précipité d'Iran, j'ai tout abandonné sans tristesse. L'espoir d'être délivré de conditions inhumaines avait occulté les difficultés que je devrais surmonter. Le conflit central de notre génération nous opposait aux institutions tenaces de notre culture traditionnelle. J'acceptais en tant qu'écrivain et dans ma vie personnelle, cette vision mystique du monde comme lieu de l'exil où l'Homme est un hôte d'une nuit dans une auberge. Je pense qu'écrire est un acte universel qui libère les rapports ente les Hommes de toutes les contraintes conventionnelles. À la lecture d'une belle oeuvre, nous avons tous vécu - ne serait-ce que quelques heures - dans la patrie de l'écrivain qui se situe au-delà de toute frontière. Ayant vécu la majeure partie de mes 33 ans dans la lecture et l'écriture, l'exil ne représentait pas à mes yeux une perspective effrayante, mais bien un voyage au-delà des frontières vers une ville cosmopolite, avec des promesses de délivrances. Le sens de cette délivrance ne pouvait signifier uniquement une vie quotidienne sauve.
La vie de chacun est faite d'attachements. Mon attachement fondamental, celui qui m'a sauvé du non-sens du monde, est l'acte d'écriture. Seule la moitié de cette promesse de délivrance s'est réalisée : bien que la dictature religieuse aux mains sanglantes ait réussi à assassiner plusieurs de mes amis à Paris et ailleurs, j'ai pu poursuivre ma vie quotidienne loin des murs de la violence, du mensonge et de la vilenie. Ce quotidien était en harmonie avec le rythme qui préserve les droits fondamentaux de l'être humain. Mais ce rythme était différent de celui vécu et décrit autrefois par les exilés.
Le combat contre le temps avait commencé. Le temps qui m'environnait n'était ni mon temps, ni celui d'écrire. Le temps dans lequel j'avais grandi était beaucoup plus lent, mieux accordé aux pulsations et aux va-et-vient entre raison et imagination. Ici, il se transforme en courses dans les couloirs du métro et en luttes administratives. Le temps n'avait pas un instant pour s'arrêter. Je n'avais aucun moyen de me mettre à l'écart de ce tourbillon. Ce rythme rapide amplifiait l'angoisse de vieillir et de mourir. Le Paris d'autrefois, capitale mondiale de la culture, offrait toujours la même profusion de souvenirs, mais je devais être en mesure de les acheter. La vie quotidienne, qui était avant le dernier de mes soucis, était devenue le premier. J'étais obligé de dépenser cette liberté indispensable pour écrire afin de survivre. La délivrance était demeurée inachevée. Elle était mêlée de souffrances. Petit à petit, un exil surgissait au coeur de l'exil.
Je n'ai jamais eu assez de temps pour apprendre le français et m'entraîner à le parler. Un écrivain qui n'écrit pas dans la langue de la société dans laquelle il séjourne vit un exil redoublé. Dès que je pose le pied hors de la vie quotidienne, j'éprouve la lourde étrangeté de cet exil. En français, je ne peux jamais montrer autre chose que des morceaux brisés et déformés de moi-même. Mon interlocuteur voit mon visage dans un miroir brisé. Dans la langue française, je ne suis que cet homme cassé que lui montre le miroir. En tant qu'écrivain, je suis extérieur à cette langue. Le manque de temps pour écrire dans ma propre langue aggrave la frustration de cette exclusion. L'écrivain à qui la vie quotidienne ne laisse pas assez de temps pour écrire est peu à peu exilé de l'écriture. J'ai passé vingt ans à combattre pour ne pas être exilé de la patrie de l'écrivain. Ainsi, exclu de ma langue et prisonnier du temps, je perds ma liberté existentielle et je continue à vivre avec l'angoisse de la montre. Avec obstination, j'essaie d'écrire en marge de mes longues heures quotidiennes de travail alimentaire. J'ai assez de projets, de frustrations et de désirs pour remplir la vie de deux hommes. L'absence de toute nostalgie du passé, qui est pourtant l'une des souffrances des exilés, me fait comprendre à quel point ma soif de temps pour écrire est puissante. C'est déjà quelque chose. »
Philippe GARBIT
Merci Reza Daneshvar. Reza, puisque vous avez commencé la table ronde, vous avez le droit de parler en fin de table ronde.
REZA
Il y une histoire concernant Victor Hugo...
Philippe GARBIT
Encore Victor Hugo ! Tout le monde parle Victor Hugo, pour ne pas parler de sa propre histoire.
REZA
Après mes cinq premiers mois en prison, en cellule individuelle, j'ai été transféré dans une cellule collective. Pendant ces cinq mois, je n'avais rien lu ni vu. J'avais soif de lire et, dans ma cellule, j'ai trouvé un livre, Comment apprendre le français. Je ne connaissais pas un mot de cette langue, et je me suis laissé guider par l'amour qui existe en Iran à l'égard de la culture française pour décider de l'apprendre. Mais comment faire ? J'ai mis une semaine à déchiffrer "Qu'est-ce que c'est ? C'est un crayon" Un mois après je terminais ce livre et j'en demandais un autre. Le deuxième s'intitulait Mauger. Ensuite j'ai demandé à ma famille de m'apporter des livres en français. La censure de la prison refusait de me délivrer de nombreux ouvrages. Parmi les livres autorisés, il y avait Le petit prince. Les autorités devaient espérer que je devienne royaliste... Le deuxième était Les misérables. Il s'agissait selon le pouvoir de dédramatiser l'injustice du régime iranien en montrant que, même en France, il y a des misérables. Pour terminer je voudrais aussi lire un texte, à l'instar de tous nos amis ici présents.
Philippe GARBIT
Combien de lignes ?
REZA
En tant que photographe, j'avais souhaité projeter des photos. Cela n'a pas été possible, je vais donc lire un petit texte.
Philippe GARBIT
Vous ne voulez pas plutôt décrire une photo ? La première photo que vous avez prise en France... Non, il ne veut pas.
REZA
Ce texte porte sur l'exposition du Carrousel du Louvre auquel j'ai participé il y a deux ans. Elle s'intitulait Les mémoires d'exil. Ce texte accompagnait mes photos. Il portait le titre suivant : Nos mémoires d'exilés.
« Au commencement était l'atteinte à la liberté de l'Homme. Oppression, répression, torture, guerre, massacre, pour des questions de couleurs, de pensées, de positions politiques, de convictions religieuses. Tout est prétexte à vouloir asservir l'autre. Au commencement, l'État ne veut ou ne peut garantir la liberté aux citoyens. Parfois, même sa passivité en fait un complice silencieux. L'exode est alors la seule route pour continuer à vivre et à développer sa pensée. Après un départ difficile, parfois au péril de sa vie, l'exil reste le refuge dans lequel chacun s'efforce de survivre. Chacun s'efforce aussi de reconstruire en soi le souvenir du pays perdu et de surmonter la déception de ne pas trouver la terre promise. Au-delà de la joie d'être libre, la fracture physique et intellectuelle marque l'arrachement à sa terre natale. Les souvenirs, une odeur, un goût, un paysage, un visage, la mélodie de sa langue, le rythme de son pays, marquent constamment les joies présentes des exilés. »
Voilà ce que je voulais vous dire. Merci.
Philippe GARBIT
Merci à tous. Nous commencerons la seconde table ronde dans quelques minutes.

Quatrième table ronde sur L'EXIL, RENAISSANCE ET CONSTRUCTION DE SOI - Vendredi 15 novembre 2002
Participent à la table ronde :
Henri LOPES, écrivain, ambassadeur du Congo (Brazzaville)
Nedim GURSEL, écrivain
Masao HAIJIMA, peintre
Françoise MORECHAND, essayiste et productrice d'émissions de télévision
Nicolas PETROVITCHNJEGOSHde MONTÉNÉGRO
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA, Premier ministre de Bulgarie.
La table ronde était animée par Philippe GARBIT.
Philippe GARBIT
La première table ronde nous a fait prendre conscience à quel point les itinéraires personnels, psychologiques, géographiques étaient variés et aussi que le fait de parler de quelqu'un d'autre était une manière de parler de soi, comme avec Victor Hugo par exemple. Ces manières de se raconter ne sont pas frontales mais sont tout aussi émouvantes.
Nous avons été confrontés à des exils subis, il y en a d'autres qui sont choisis et qui marquent le début d'une renaissance de soi. De quelle culture se nourrit-on pour se reconstruire après l'exil ? Faut-il privilégier à tout prix la fidélité aux racines familiales, ancestrales ? Comment tous ces allers-retours, ou parfois allers simples, se manifestent-ils dans l'Histoire ? Nedim Gürsel, vous êtes né en Turquie et vous y avez publié une vingtaine d'ouvrages. Vous êtes traduit dans le monde entier, vous écrivez en turc et aussi en français. Vous habitez en France et vous vous rendez fréquemment en Turquie. Est-ce qu'un écrivain est partout chez lui parce qu'il écrit, comme nous le suggèrent les premiers témoignages ? Cessez-vous d'être un exilé ?
Nedim GÜRSEL
L'exil fut au début une contrainte pour moi et non un choix. En 1971, après le coup d'État du 12 mars - nommé curieusement le "mémorandum des généraux" - j'ai été dans l'obligation de quitter Istanbul, ma ville bien-aimée dont je parle beaucoup dans mes livres. J'ai été en effet poursuivi pour avoir écrit un article sur Gorky dans une revue titrée Ami du peuple. Le titre n'était pas innocent mais mon article n'était qu'un essai sur un écrivain russe.
J'ai ma propre histoire par rapport à l'exil - comme tous - et je profite de l'occasion pour réfléchir sur l'exil des écrivains. Vous avez précisé que j'habite Paris et aussi un peu Istanbul. J'écris dans les deux langues : j'écris mes nouvelles et romans relevant de la fiction en turc ; mes essais sont écrits dans les deux langues. Ma maison familiale se trouve sur les berges du Bosphore, sur la rive asiatique. Il y a beaucoup de bateaux qui passent et, de temps en temps, l'un d'entre eux heurte les vieilles maisons. Un second pont reliant les deux continents a été construit par les Japonais juste à côté de notre vieille demeure familiale. Il gâche le paysage mais je m'identifie à lui. Ce pont relie aussi les cultures et les hommes entre eux. Bien que j'habite Paris depuis longtemps, je porte mon pays en moi. Et s'il est un pays pour un écrivain, c'est bien sa langue. Des écrivains ont changé de langue, par exemple Cioran, Ionesco... Comme eux je me sens à cheval entre deux cultures, deux langues.
Dans la tradition populaire turque, la condition sine qua non pour devenir poète est de partir en exil. Les poètes ambulants de l'Anatolie appellent cela le gourbet. Il faut quitter son village natal et chanter la nostalgie de son foyer. Dans la tradition populaire turque, l'exil est une lamentation. Pour moi, l'exil peut être une forme extraordinaire d'enrichissement. J'ai bien sûr connu des souffrances réelles. Suite au second coup d'État militaire du 12 septembre 1980, deux de mes livres ont été saisis pour offense à l'armée et à la morale publique. Tout cela vous prive de votre pays et de vos proches, mais cela vous offre aussi la possibilité de rencontrer d'autres personnes, d'aller dans un autre pays et d'y être bien accueilli. Maintenant je peux rentrer en Turquie, mes livres sont publiés. Cela est possible grâce à l'évolution de ce pays, qui est officiellement candidat à l'Union européenne. L'exil peut être vécu comme une expérience enrichissante et non pas uniquement comme une lamentation.
Philippe GARBIT
Vous connaissez d'autres exilés turcs, iraniens ou indiens... ?
Nedim GÜRSEL
Oui, Paris est une ville cosmopolite. L'Exil est un mot pluriel pour moi. Je pense notamment aux écrivains américains de la génération perdue, qu'il s'agisse d'Hemingway, d'Henry Miller... Ils ont quitté leur pays non pas par contrainte politique, mais bien parce qu'ils ne supportaient pas le puritanisme de la société américaine. Selon moi, le vrai exil est celui de l'écrivain marginalisé dans son propre pays ou qui a simplement envie de partir. Le véritable rapport de l'écrivain à l'exil est pour moi langagier. J'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler une prochaine fois, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole.
Philippe GARBIT
Vous ne monopolisez absolument pas la parole. Je suis persuadé qu'Henri Lopes sera d'accord avec vous. M. Lopes est né à Léopoldville, ex-Congo belge, et assume aujourd'hui les fonctions d'ambassadeur du Congo Brazzaville. Vous avez dû vivre beaucoup de péripéties liées à l'exil au préalable à votre ascension.
Henri LOPES
L'un des adages de notre peuple est le suivant : "Quand tu prends la parole, aie pitié de ceux qui t'écoutent". Je vais tâcher d'être charitable. J'ai beaucoup de réticences à me raconter. Je suis ambassadeur et écrivain ; je me considère en outre comme un exilé. Non seulement les contradictions de ma double appartenance m'habitent, mais à cela s'ajoute mon apparence. Lorsque je suis présenté à quelqu'un - Henri Lopes, congolais - cette personne regarde ma couleur de peau ainsi que la sonorité de mon nom et conclue que je suis un usurpateur. Je pense qu'ici se trouve la source de mon premier exil. Mes grands-parents ne suivaient pas les règles de leur communauté et j'en suis le résultat. Ma mère est issue d'une mère congolaise et d'un père corse. Au lieu de rechercher ses racines africaines, elle se marie avec un homme issu d'un père inconnu - certainement belge.
Je ne sais pas comment le nom Lopes s'est imposé, mais dès le départ, je ne ressemblais pas à mon pays. Je reprends à mon compte la formule d'Aragon - par ailleurs grand admirateur de Hugo : "J'étais en étrange pays dans mon pays lui- même". Le métissage est mon premier exil. Le second intervient après la guerre, au Congo français. Je suis envoyé à l'âge de onze ans en France pour être éduqué. C'est commun aujourd'hui, mais à l'époque le Congo était très différent de ce que nous connaissons. Il n'y avait pas de télévision, très peu de cinémas et surtout, la ségrégation - des quartiers pour les Blancs, d'autres pour les Noirs - était une réalité. Il y avait des cinémas pour les Blancs et les Noirs pouvaient regarder le film en plein air, assis sur les murs ou dans les arbres. Les Blancs jouaient au football avec des chaussures et les Noirs étaient pieds nus.
On m'a dit que cet exil vers la France était pour mon bien. Je débarque dans un pays où les Blancs font aussi des travaux manuels. Métis, donc Blanc pour les uns mais Noir pour les autres, je craignais pour ma sécurité. Or, je me fais des amis, je joue au football, je flirte à 16 ans avec une blonde... Il s'agit de la nouvelle image de l'exil. Parfois l'histoire des décolonisations en Afrique noire est enjolivée. En fait, la conscience "patriotique" n'était pas développée dans ces pays. L'on souhaitait avant tout devenir Français, alors que nous ne l'étions pas. Or, en France nous sommes traités comme des citoyens français. Lorsque nous revenons en vacances, nous nous transformons en agitateurs, afin de faire évoluer le pays.
Je n'ai pas préparé de texte pour cette rencontre. Un personnage de l'un de mes romans a décidé de vous parler à ma place. Il est présent dans la salle et souhaite prendre la parole. Je ne la lui donnerai pas à moins que le débat nous en donne l'occasion. Merci.
Philippe GARBIT
Merci Henri Lopes. J'avais noté que vous avez été Premier ministre de la République Populaire du Congo, ancien directeur au sein de l'Unesco, membre du Haut Conseil de la Francophonie et du Conseil Supérieur de la Langue française, lauréat du grand prix de la Francophonie de l'Académie française décernée pour l'ensemble de vote oeuvre. Tout cela est-il exact ? Vous disiez que vous alliez inventer légèrement votre biographie.
Henri LOPES
Il y a un mélange de la réalité et de mes fantasmes.
Philippe GARBIT
En ce cas, alors nous choisirons ce qui nous plaira.
Henri LOPES
Vous voulez que mon personnage vous lise deux pages.
Philippe GARBIT
Tout à l'heure. Masao Haijima, vous êtes artiste peintre. Vous êtes ancien élève de l'école des Beaux-arts de Tokyo. Vous êtes venu un jour à Paris pour ne jamais en repartir. Votre histoire est originale par rapport à celles que nous avons entendues au cours de cette table ronde. Ceci me donne l'impression que l'intérêt de votre expérience réside dans ce non-retour, plutôt que dans les raisons de votre venue.
Masao HAIJIMA
Après dix-sept ans de vie en France, je suis rentré une fois au Japon pour raison familiale, en 1990.
Philippe GARBIT
Vous êtes venu étudier la peinture française et européenne et vous êtes devenu un peintre français et européen ?
Masao HAIJIMA
Oui, c'est vrai. C'est difficile à exprimer. Je suis peintre et ne m'exprime pas par les mots, donc je vais lire le papier que j'ai préparé.
Philippe GARBIT
Vous n'allez pas sortir un tableau...
Masao HAIJIMA
Non, non. Je vais lire les raisons pour lesquelles je suis venu en France. Je suis arrivé à Paris en 1973, à l'âge de 24 ans. Je venais de terminer mes études sur la peinture occidentale à l'école de Sokei à Tokyo. C'est pourquoi j'ai naturellement eu l'idée de me rendre en Occident, berceau de cette technique. Pourquoi en France précisément alors que durant mes études, je me suis concentré sur l'art des primitifs flamands ? J'aurais donc pu aller en Belgique et, en amateur de Léonard de Vinci, j'aurais pu me rendre en Italie. En réfléchissant à l'histoire de la culture occidentale, j'ai eu l'impression que Paris était au centre de l'Europe, ne serait-ce que par l'importance de ses musées et le nombre de ses galeries d'art. J'ai donc décidé de venir à Paris et d'intégrer l'école des Beaux-Arts de Paris, qui baigne dans cet environnement culturel unique.
Mon départ volontaire résultait d'un choix conscient et personnel. Lorsque je suis parti, je n'imaginais pas rester aussi longtemps à Paris. Mes études à l'école des Beaux-Arts m'ont beaucoup aidé à m'intégrer dans la société française. J'y ai rencontré des professeurs et des étudiants avec lesquels j'ai tissé des liens très forts. Mon expérience m'a également aidé à comprendre la culture française et m'a persuadé de rester en France.
Ma venue en France a profondément marqué ma peinture. J'ai eu une révélation grâce aux impressionnistes. Au Japon, ma peinture était influencée par les peintres classiques. Après avoir visité le Louvre, je suis allé au musée des Impressionnistes où j'ai été frappé par la beauté et la légèreté des oeuvres. J'ai perçu l'importance du traitement de la lumière et du travail d'après nature. Trente ans après, mes oeuvres continuent à être marquées par cette révélation. Le goût artistique est probablement conditionné par l'environnement, l'ambiance de mon atelier, les couleurs des immeubles, du ciel et la lumière de Paris. Tous ces éléments influencent ma peinture.
On me pose souvent la question de l'influence respective de l'art japonais et l'art occidental dans ma peinture. Personnellement, je ne me pose plus la question de savoir si je suis un peintre français ou japonais. Je peins. Je renvoie cette question aux spectateurs en leur demandant s'ils ressentent la culture japonaise à travers mes tableaux.
Pour conclure cette brève présentation, je m'avoue incapable d'analyser les raisons pour lesquelles je suis resté en France et je n'ai pas éprouvé le besoin de retourner au Japon. Le débat qui va suivre me permettra peut-être d'éclairer ces raisons.
Philippe GARBIT
Merci Masao Haijima. Françoise Morechand, vous avez fait le trajet inverse. Vous êtes née à Paris rive Gauche et à 18 ans vous avez décidé de quitter la France, pour le Japon. Vous vous êtes exilée, expatriée ?
Françoise MORECHAND
Non, cela ne s'est pas déroulé exactement comme cela. Je vais également parler de mes racines car elles ont certainement eu une grande influence. Je ne suis pas exilée au Japon, j'habite dans ce pays. J'y suis venu pour la première fois il y a 42 ans et je l'ai quitté pendant 10 ans. J'ai passé presque 33 ans au Japon et ai pu voir l'évolution de ce pays, bien que cela ne soit pas notre propos.
Mon arrière-grand-père, Gaétan Domanski, était polonais. Il a quitté la Pologne pour s'exiler. En 1861 ou 1863, il y a eu, comme d'habitude, un soulèvement contre les Russes. Il y a participé et, comme d'habitude, les Polonais ont perdu. Il était à Cracovie et avait le choix entre la pendaison ou la Sibérie - j'y suis passée l'année dernière avec une télévision et j'ai vu les photos, les boulets... Il s'est enfui en passant par les Carpates. Je suis heureuse à ce propos d'avoir entendu ici que le coeur de l'Europe est dans les Balkans, les Carpates, et que le cerveau est à Paris. C'est formidable, je suis européenne... Et je suis européenne au Japon.
Il est arrivé à Paris, célibataire, et a épousé une Française. Cette branche de la famille est dès lors devenue française. Ma grand-mère était donc franco-polonaise. Elle s'appelait Gabriella Domanska - jusqu'au jour de son mariage où elle a pris le prénom de Marie. Elle s'est mariée avec un Normand qui travaillait dans le drap et le boeuf. Lors de ma petite enfance, elle m'a raconté sa vie à Zakopan, à Cracovie... Elle pouvait y retourner à une époque, lorsque la Pologne était libre et en paix avec la Russie. Elle me racontait ses souvenirs des traîneaux, des petits chevaux, des grandes maisons en bois qui ont vu passer les Russes et les Allemands et qui ont conservé leurs vitres intactes.
Ma mère vient des Pyrénées, elle est née dans une ferme très pauvre et ses parents ne savaient ni lire ni écrire. À l'âge de deux ans, elle est transportée à Paris et donc exilée dans son propre pays. Lorsqu'elle était petite, elle continuait à "barrer les oies" alors qu'elle vivait dans un appartement parisien. Avec beaucoup de travail et en gagnant des concours, elle est devenue peintre et professeur aux Beaux-Arts. Elle est morte aujourd'hui et je lui dois beaucoup car elle ne m'a jamais empêchée de partir à l'étranger, bien que je sois fille unique.
Après la guerre, j'ai fait mes études au collège Sévigné, où les juifs, les catholiques et les non-croyants coexistaient déjà à cette époque J'ai été élevée dans l'idée que l'on pouvait aller ailleurs pour ses idées. Je suis partie, mais je n'ai pas choisi le Japon. Je voulais être interprète internationale, je voulais aller loin. Dès mes 2 ans, dans le jardin du Luxembourg, je partais seule, ma mère me cherchait, les gardes me retrouvaient et, à force, finissaient par me reconnaître. Ma mère me reprenait et me demandait : "Mais Françoise, pourquoi es-tu partie sans le dire à maman ?" Et je lui répondais : "Parce que je veux aller loin." J'avais 2 ans, donc évidemment lorsque, âgée de 18 ou 20 ans, je lui ai dit que je voulais partir au Japon, elle n'a pas été étonnée.
J'ai aujourd'hui 66 ans ; j'avais entre 5 et 8 ans durant la guerre. Mes parents ont fait de la résistance, donc nous étions des exilés à Paris, puisque nous étions entourés de collaborateurs. Il fallait être très vigilant. Dès l'âge de 6 ans, j'ai appris à me taire et à ne pas répondre exactement aux questions que l'on pouvait me poser. Par ailleurs, mes grands-parents ne parlaient que le patois ; lorsque je revenais dans les Pyrénées, j'étais confrontée à des grands-parents que je ne comprenais pas, mais que j'aimais. Cela m'a appris à ne pas comprendre obligatoirement les gens et à les aimer malgré tout. À 5 ans et demi j'entendais des réflexions sur le manque de savoir-vivre des Allemands qui mangeaient des pommes de terre à la place du pain. J'étais très étonnée de ces commentaires, malgré mon jeune âge. Je sais que la nourriture a de l'influence sur les cellules du corps, mais tout de même ! En parallèle, j'entendais les critiques des Allemands à l'égard des Français. La maison de ma grand-mère était occupée et lorsque les officiers rentraient le soir, c'était réellement Le silence de la mer. Qui connaît encore Le silence de la mer ?
Philippe GARBIT
Tout le monde.
Françoise MORECHAND
Cela me fait plaisir. Les officiers allemands tentaient de discuter avec ma grand- mère, qui ne leur répondait pas. Elle tricotait, pour nous nourrir. Ils lui disaient : "Vous savez, on aime bien les Français. Vous êtes tellement légers, vous avez de l'humour, du Champagne... Mais vous n'êtes pas sérieux !" J'étais sidérée par une telle incompréhension. J'étais très petite et ne comprenais pas les vraies raisons économiques ou autres.
Toujours est-il que cette incompréhension renforçait dès cette époque mon désir d'aller loin quand je serai plus grande. Qu'est-ce que cela signifiait-il ? Cela voulait dire aller dans un pays qui a une autre culture. À cet égard, la Belgique - pays doté de grandes qualités - ne m'intéressait pas. J'aurais pu aller en Afrique, en Chine... Talleyrand disait que l'Asie commence après Vienne, donc il fallait au moins que j'aille au-delà de cette ville. Je voulais, dans le pays où j'irais, montrer avec mon coeur - je ne suis pas restée assez longtemps à Paris pour penser avec mon cerveau - que l'on pouvait s'aimer même si l'on est différent.
Après mes études en langues orientales, je suis partie à 22 ans et depuis je fais énormément de travaux. On m'a demandé de le dire moi-même, ce qui est extrêmement gênant.
Philippe GARBIT
Non, non, je vais le lire pour vous.
Françoise MORECHAND
Oh, s'il vous plaît...
Philippe GARBIT
Vous êtes déléguée pour l'Asie du Nord du Conseil Supérieur des Français de l'Étranger. Vous faites également de la télévision...
Françoise MORECHAND
Nous sommes au Sénat, parlons du Conseil Supérieur des Français de l'Étranger...
Philippe GARBIT
Vous êtes devenue une petite Française exotique au Japon ?
Françoise MORECHAND
Au début, c'était cela. J'enseigne les cultures comparées à l'Université. Il est préférable que je lise ma carte de visite. Je suis conseiller du Commerce extérieur et membre du Conseil d'Administration de l'Unesco, organisation dans laquelle je m'occupe de l'héritage culturel. Je fais également beaucoup d'émissions de télévision et j'ai écrit 26 livres en japonais. J'aurais souhaité avoir le temps de vous parler de la différence du sens des mots : par exemple, le mot "amour" a une signification différente pour Confucius et pour les judéo-chrétiens. Cela nécessite donc énormément d'adaptation, d'affection et d'amour, ainsi que des nerfs solides. Il y a quinze ans de cela, j'ai eu une dépression nerveuse en essayant de mettre en relation les judéo-chrétiens avec les gens d'Asie, généralement des confucéens, des zens. Ce n'était pas évident.
Depuis, je suis guérie de cette dépression nerveuse, aidée par quelques conseils et remarques. Ainsi, j'ai une charmante amie japonaise âgée de 75 ans, Mme Mishima, qui a été élevée en France. Elle est secrétaire et écrit le français mieux que moi. À ce propos, lorsque j'ai des lettres de château à écrire, chaque jour en fait, je lui demande de les rédiger pour moi. Un jour elle m'a dit : "Oh, écoutez Mme Morechand ! On vous aime beaucoup, vous les Français. Mais vous êtes fatigants..." Je m'en doutais un peu et je lui ai posé la question de savoir pourquoi. Elle m'a répondu : "Vous comprenez, vous voulez tout comprendre. Vous êtes incapables de laisser le psychisme et les actions des gens se dérouler comme passe la rivière. "La rivière ne remonte jamais son cours- ce qui serait d'ailleurs inquiétant." Ne pouvez-vous pas laisser les choses se faire ?", me demanda-t-elle. Depuis, je me suis remariée à un Japonais, Tatsuji Nagataki, ce qui signifie Cascades Éternelles - je m'appelle Madame Cascades Éternelles, je vous prie de le retenir, s'il vous plaît. C'est pour le nom que je me suis remariée avec ce monsieur...
Philippe GARBIT
Ce n'est pas votre voisin...
Françoise MORECHAND
Non, non, mais j'aime aussi beaucoup M. Haijima. Il est japonais, il comprend que je fais de l'humour, comme tout le monde d'ailleurs...
Mon mari m'a aussi dit un jour d'arrêter de lire les journaux à 8 heures du matin, et de m'énerver contre les communistes et autres aussi tôt dans la journée. Il m'a conseillé d'attendre 14 h 30 pour cela. Maintenant, je me sens bien avec eux et avec les autres car j'accepte les choses telles qu'elles sont. Par exemple, dans les grandes lignes, pourquoi les Japonais ne sont-ils "pas encore..." ? Mais que cela signifie-t- il ? Et bien, ils ne sont pas encore modernes. Pourquoi cela ? Parce qu'ils ne sont pas encore comme nous. Nous pourrions en débattre longuement. Il s'agit d'une question très importante, car nous questionnons la source du racisme. Mes parents n'ont pas été résistants durant la guerre pour que j'oublie cette idée-là.
Pour conclure, je dirai que je voudrais que l'on s'entende même si l'on ne se comprend pas, même si l'on ne parle pas le même langage. Mes activités ont pour objectif que l'on s'entende même si l'on est différent.
Philippe GARBIT
Merci Françoise Morechand. Nous accueillons son Excellence Siméon de Saxe- Cobourg Gotha, Premier ministre de Bulgarie, nommé aussi Siméon Borisov, Siméon Rilsky. Autant de noms pour un seul homme, car lorsqu'on a été exilé, il faut se reconstruire le plus vite possible. 1996 a été l'année de votre retour au premier plan. Vous aviez alors déclaré : "L'exil m'a appris l'humilité, à ne jamais ruminer le passé. J'ai conquis l'anonymat, l'indépendance et cela n'a pas de prix." Il y a eu ensuite un voyage historique et des élections, mais nous pourrions remonter jusqu'en 1946...
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
L'anonymat reste tout aussi important aujourd'hui pour moi. Ce n'est peut-être pas le sujet, mais lorsqu'on a vécu cinquante ans moins trois mois en exil, c'est quelque chose malgré tout. On apprend beaucoup, mais ma vie n'a rien d'extraordinaire, comparée à celle d'autres personnes qui ont vécu de façon plus difficile ou dramatique que moi. Il faut accepter de regarder les choses telles qu'elles sont, accepter la réalité et faire de son mieux.
Philippe GARBIT
Malgré tout, vous appartenez à l'Histoire. Tous les exils peuvent être tragiques et certains anonymes doivent affronter d'énormes problèmes, parfois durant leur vie entière. Vous appartenez à un "roman familial" qui s'inscrit dans l'Histoire et à un royaume. Vous êtes roi très jeune, durant trois ans.
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
De six à neuf ans.
Philippe GARBIT
C'est une expérience impossible à oublier. Vous avez appris à vos enfants ce qu'est la Bulgarie...
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Oui, par respect pour l'Histoire, mais sans plus. J'ai voulu les élever comme des citoyens normaux et ils ont réussi en partie grâce à cela.
Philippe GARBIT
Vous souvenez-vous, Excellence, des derniers sons, des derniers parfums de la Bulgarie, des conditions de votre départ ?
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Oui, je m'en suis souvenu durant les cinquante ans de mon exil. Il est difficile d'évoquer cela aussi subitement. On pourrait croire que je cherche à faire de la littérature ou à improviser. Être obligé de quitter subitement son pays alors que l'on est un enfant, que l'on y a toujours vécu et que l'on y est attaché à quelque chose d'impressionnant. Des questions sur l'injustice de l'exil se posent alors dans la tête de cet enfant, même élevé plus sévèrement que les autres.
Philippe GARBIT
Mais qui vous a dit que vous deviez partir ?
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Il s'agit de la personne chargée par le ministre des Affaires étrangères d'annoncer le résultat du référendum concernant le maintien ou non de la monarchie. Si l'on intègre les cinq siècles sous domination ottomane, le pays a connu treize siècles de monarchie. Les résultats ont été de 94 % pour son abolition. Dès lors, ma mère, ma soeur et moi nous avons quitté le pays. Nous sommes allés en Égypte rejoindre mes grands-parents.
Philippe GARBIT
C'était la première étape. Même s'il n'y a pas de ressentiment, une certaine psychologie se forme pour un enfant de neuf ans qui vit une telle situation. Comment accepte-t-on de quitter ce que l'on vous a peut-être présenté comme un paradis ?
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
L'enfant voit les choses d'une manière plus pratique. Il ne faut pas dramatiser.
Philippe GARBIT
Lors de votre retour en 1996 en Bulgarie, vous craigniez vos larmes et vous appréhendiez de décevoir vos compatriotes. J'imagine que votre retour a été très émouvant pour vous, mais n'avez-vous pas craint d'être déçu par vos compatriotes ?
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Je craignais de les décevoir, oui, mais certainement pas d'être moi-même déçu par mes compatriotes.
Philippe GARBIT
Pouvez-vous nous expliquer brièvement comment s'est passé votre retour en 1996 ? Comment cela s'est-il passé dans votre coeur ?
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Dans mon coeur il se passe des choses curieuses. Pour satisfaire votre désir de détails, je dirai que ce qui m'a pris véritablement au coeur, ce n'est pas tellement l'énorme foule qui couvrait la route de l'aéroport à Sofia, ni revoir les monuments. Le véritable moment indescriptible s'est produit avant, lorsque l'avion a atterri. C'est peut-être stupide au regard des moments beaucoup plus extraordinaires que j'ai connus par la suite, mais ce détail m'a énormément frappé.
Philippe GARBIT
La terre patrie...
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Oui, j'ai senti qu'après cinquante d'exil, j'atterrissais dans ce pays.
Philippe GARBIT
Était-ce une forme de fin d'exil ?
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Tout à fait.
Philippe GARBIT
Il existe un mot pour qualifier la fin de l'exil : le "retour". Mais le terme est moins fort.
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Le retour est tout à la fois un retour aux racines, à une certaine justice, à la satisfaction. C'est une grande joie.
Philippe GARBIT
Ayant vécu votre exil en Égypte puis en Espagne, vous avez décidé de servir votre pays, de reprendre l'Histoire là où elle s'était arrêtée.
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Toutes ces années d'exil, je me posais la question de savoir comment être utile pour le pays. Nous l'étions modestement, mais malgré tout nous l'étions. Le sort me permet de contribuer au développement de ce pays.
Philippe GARBIT
Vous avez précisé que vous n'aviez pas éduqué vos enfants dans l'idée qu'ils étaient des exilés.
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Non, car cela crée des complexes.
Philippe GARBIT
Ils sont donc espagnols.
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Ce sont de braves citoyens.
Philippe GARBIT
Mais de quelle nationalité sont-ils ?
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Ils sont espagnols. Leur mère est espagnole et ils sont nés en Espagne. Nous étions déchus de notre nationalité.
Philippe GARBIT
Vous êtes apatride.
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Je suis resté apatride avant de découvrir en 1991 - soit cinq avant mon retour - que l'on ne m'avait pas retiré la nationalité bulgare et de récupérer immédiatement mon passeport. Je dois avouer qu'il s'est agi d'une très grande satisfaction.
Philippe GARBIT
Il n'y a jamais eu d'abdication non plus ?
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Non. Mais c'est un détail technique.
Philippe GARBIT
C'est important malgré tout. J'ai appris que vous étiez l'arrière arrière-petit-fils d'un roi des Français, Louis-Philippe, qui est lui aussi un exilé.
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Oui. Il y a de nouveau une similitude.
Philippe GARBIT
Avant de devenir roi des Français, il avait changé de nom. Il prenait un nom d'emprunt pour donner des cours de langue et de mathématiques en Suisse.
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Je suis allé au Cap Nord pour voir son buste. Il avait été maître d'anglais là-bas.
Philippe GARBIT
Il travaillait sous le nom de Chabaud-Latour.
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
À l'image des alias que j'ai utilisé.
Philippe GARBIT
Ces noms d'emprunt étaient-ils indiqués quelque part ? C'était pour les affaires, pour passer incognito ?
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Oui. Mon passeport était de convenance car je me suis bien gardé d'adopter une autre nationalité. Mes collègues de cette table ronde trouveront aussi que le passeport devient terriblement important. C'est l'unique source d'identification sans laquelle nous ne pouvons pas nous déplacer. Nous dépendons d'un bout de papier car sans lui nous n'existons pas. Ceci est curieux aussi.
Philippe GARBIT
Ayant été roi, puis exilé et maintenant Premier ministre de Bulgarie, vous devez certainement comprendre les problèmes des sans papiers.
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
On comprend certainement beaucoup de choses, on comprend certains drames, et l'on devient plus indulgent.
Philippe GARBIT
À une époque, vous disiez que vous n'aviez pas de baguette magique pour réduire le malheur de vos compatriotes. Je sais bien que vous êtes en visite de travail en France et que vous n'avez peut-être pas envie d'en parler, mais...
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Nous avons la chance d'avoir un peuple très doué et une équipe formidable. Après, il s'agit d'une question de travail qui remplace la baguette magique. Le résultat est sans doute moins rapide, mais peut néanmoins se matérialiser.
Philippe GARBIT
Nous parlions de l'Europe. Nedim Gürsel précisait que la Turquie était candidate à l'intégration. Il en va de même pour la Bulgarie. Cela peut-il faire plaisir aux exilés qui sont en France ou ailleurs ? Ou cela peut-il empêcher des exils ? Vous n'avez sans doute pas envie que vos compatriotes quittent le pays.
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Le Bulgare n'est pas un exilé ou un émigrant volontaire. Il quitte son pays si les conditions de vie sont mauvaises. Notre objectif est de rendre le pays suffisamment attrayant pour que les migrants puissent rentrer et gagner leur vie convenablement. Nous voudrions aussi qu'ils contribuent à la reprise du pays avec leur know-how et leur épargne.
Philippe GARBIT
Merci. Siméon de Saxe-Cobourg Gotha, je ne vous présente pas Nicolas Petrovitch Njegosh de Monténégro, vous vous connaissez.
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Nous sommes cousins.
Philippe GARBIT
Le destin de Nicolas Petrovitch Njegosh de Monténégro est aussi une histoire singulière. Vous êtes né en France.
Nicolas PETROVITCH NJEGOSH de MONTÉNÉGRO
Tout à fait. Je suis né à Saint-Nicolas du Pélem dans les Côtes d'Armor.
Philippe GARBIT
Vous êtes breton, votre mère est bretonne et vous travaillez en France.
Nicolas PETROVITCH NJEGOSH de MONTÉNÉGRO
Oui, et mon père, qui est décédé, était le dernier roi de Monténégro. Il a régné pendant quelques mois, lors de l'exil du roi Nicolas en France. À l'âge de dix ans, il a été officiellement roi de Monténégro en exil pendant six mois. Je ne souhaite pas parler à titre personnel de l'exil. Je ne peux que parler de l'exil de ma famille. Le Monténégro est un petit pays qui a joué un rôle en Europe pendant des siècles. C'était un bastion de résistance à l'occupation ottomane - cher occupant ottoman...
Philippe GARBIT
Vous dites cela en regardant Nedim Gürsel...
Nicolas PETROVITCH NJEGOSH de MONTÉNÉGRO
On se respecte entre ennemis. J'ai découvert très tard que j'étais porteur d'un exil que je ne soupçonnais pas, puisque j'ai passé ma jeunesse dans l'euphorie de cette génération parisienne de l'après-guerre. Cette génération a certainement bénéficié des meilleures conditions de vie du XX e siècle. J'étais donc quelque peu insouciant. Mais lors de l'hiver 1989, un appel téléphonique de l'ambassadeur de Yougoslavie a totalement modifié le regard que je portais sur mon environnement. Il sollicitait un rendez-vous avec le ministre de la Culture de la République de la République Socialiste Fédérative de Monténégro. Je m'y suis rendu. Il me demanda l'autorisation de rapatrier le corps du roi Nicolas - mon arrière-grand-père - de la reine Milena et de deux princesses du Monténégro enterrées à l'église russe de San Remo. Le ministre voulait faire un retour et un enterrement officiels au Monténégro. À l'époque, je ne soupçonnais pas les menaces et les nuages qui s'accumulaient sur l'ex-Yougoslavie et je trouvais l'idée honorable. Il me semblait donc de bon augure de donner mon accord, en tant que chef de famille apte à autoriser la levée du corps par les autorités italiennes. Grâce à cela, j'ai redécouvert mon pays. Alors étudiant, je m'y étais rendu en auto-stop en 1967.
Philippe GARBIT
Vous étiez alors incognito.
Nicolas PETROVITCH NJEGOSH de MONTÉNÉGRO
Oui, j'étais totalement incognito. J'avais un sac à dos...
Philippe GARBIT
Il s'agit là d'un vrai roman ! Le fils du roi qui revient incognito...
Nicolas PETROVITCH NJEGOSH de MONTÉNÉGRO
Vous savez, j'étais étudiant. Je connaissais l'histoire de ma famille, mais c'était comme une légende pour moi. Si vous découvriez que vous êtes le descendant de Clovis, cela ne bouleverserait pas votre vie.
Philippe GARBIT
Merci de me l'apprendre, néanmoins...
Nicolas PETROVITCH NJEGOSH de MONTÉNÉGRO
C'était pour moi une histoire légendaire : le petit Monténégro, qui avait toujours lutté contre les Ottomans, était relayé de nos jours par une Yougoslavie dont le socialisme - vu de Paris - apparaissait éclairé, autogestionnaire, porteur de la stratégie tiers-mondiste. Ce pays était incontestable et incontesté et l'histoire du Monténégro était ancienne pour moi.
J'ai évidemment participé au retour des corps et j'ai été surpris par l'importance que les Italiens accordaient à ce rapatriement. Le protocole de l'enterrement d'un chef d'État a été respecté, de San Remo à Bari, où les cercueils ont été embarqués sur un bateau de guerre italien. L'armée et la fanfare étaient présentes, les populations de San Remo et de Gênes - où nous sommes passés - étaient dans la rue. Il y eut une magnifique cérémonie religieuse, oecuménique, orthodoxe, catholique, à Bari. Les bateaux de guerre ont tiré au canon pour saluer le départ du roi Nicolas. Toute cette démonstration a été très impressionnante. Le plus surprenant fut l'arrivée au Monténégro le lendemain matin. J'étais déjà venu en tant qu'étudiant, mais les circonstances étaient évidemment très différentes. J'étais paré de mon titre et je tenais absolument à être accompagné par mes enfants et par ma mère. Elle était atteinte du cancer et décéda un mois plus tard. Le trajet entre le port de Bar et la petite ville de Cettigné, l'ancienne capitale, fut un moment incroyable. Tout au long de la route montagneuse - le " serpentino " -, normalement désertique, se trouvaient des milliers de personnes qui acclamaient le convoi. À Cettigné, ville de 15 000 habitants, nous étions attendus par 200 000 personnes. Les gens étaient sur les toits, dans les arbres... Cela m'a profondément bouleversé.
L'exil est la souffrance de celui qui part et de ceux qui restent, dans ce cas précis. Le Monténégro était en voie d'oubli. À l'école, tout le monde pensait que cela se situait en Amérique latine. Personne ne connaissait la dynastie qui a régné pendant deux cent cinquante ans. Le problème, qui se rapporte à la renaissance d'une seconde moitié de moi-même, était difficile : comment répondre à cette ferveur ? Quelques semaines après, le mur de Berlin tombait. En tant qu'architecte, je suis étroitement lié à différents courants culturels. Dès lors, j'ai compris que, par la culture, je pouvais contribuer à aider la Yougoslavie, à faire connaître la petite ville de Cettigné et à la revitaliser, afin de répondre à l'amitié des Monténégrins. Tout cela a commencé comme un conte de fées et a fini comme un cauchemar.
J'ai passé une grande partie de mon temps durant ces dix années à tenter, à travers la culture et la défense des droits de l'Homme, de comprendre, d'aider et d'assister, l'ex-Yougoslavie. J'ai monté un projet de biennale d'arts contemporains en 1991, qui s'est ouverte le 7juin. Trois semaines plus tard, la Yougoslavie implosait et la guerre civile éclatait, marquant le début d'une terrible décennie. Cette biennale a été durant toute cette période d'embargo la seule fenêtre vers l'extérieur pour le Monténégro, permettant brièvement aux gens d'échanger et d'appartenir aux mouvements culturels européens ou universels. J'ai aussi monté une structure juridique de défense des victimes de discrimination ethnique afin d'apporter un soutien aux militants des droits de l'Homme dans les différentes Républiques de l'ex-Yougoslavie. J'ai redécouvert mon pays, mes racines, à travers des événements tragiques. J'ai redécouvert mes concitoyens de l'ensemble de la Yougoslavie dans des contextes dramatiques. Quatre millions de personnes ont été déplacées ; elles sont donc en exil.
Ma conclusion n'est pas liée à la question de l'exil. La culture peut jouer un rôle important ; preuve en est le panel réuni autour de cette table pour parler de l'exil. La culture permet de rétablir le dialogue entre les peuples. Je suis très déçu de constater que dans les grandes opérations internationales et dans la diplomatie internationale, l'on ne s'appuie pas plus sur la culture afin de prévenir et régler les conflits. Les gens de culture sont les plus aptes à avoir ce langage commun, à l'instar de notre ami peintre, qui n'est ni japonais, ni français, mais peintre. Avec des moyens modestes, la culture peut aider. Malheureusement, le pacte de stabilité des Balkans ne comporte pas de volet culturel, ce qui est scandaleux.
Philippe GARBIT
Merci Nicolas Petrovitch Njegosh de Monténégro. Nedim Gürsel, l'écrivain est bien sûr d'accord.
Nedim GURSEL
J'ai été le premier à prendre la parole et en conséquence j'ai très peu parlé et je me sens un peu frustré. Moi aussi, j'ai envie de parler de mes parents, comme la plupart des intervenants.
Philippe GARBIT
Étendez-vous sur le divan.
Nedim GÜRSEL
Cela concerne les Balkans. Mais avant, je voudrais raconter une petite anecdote. En 1989, la Yougoslavie existait encore, avec ses six Républiques et ses deux Régions autonomes. J'étais invité à Belgrade pour participer à une rencontre internationale d'écrivains. Milosevic avait fait son fameux discours dans le "Champ des Merles" où il évoquait la Grande Serbie. Nous étions réunis, à l'occasion du 600 e anniversaire de la bataille du Kosovo, pour parler de la mémoire collective dans nos pays respectifs. L'animateur du débat m'a présenté au public en tant que vainqueur de cette bataille.
Philippe GARBIT
Vous faites beaucoup plus jeune.
Nedim GÜRSEL
J'ai répondu que je n'étais pas le vainqueur de la bataille du Kosovo, mais plus prosaïquement écrivain d'un pays qui existait depuis 1923. Je suis citoyen turc, écrivain turc. Il a fallu une guerre sanglante, en Croatie puis en Bosnie, pour comprendre à quel point la mémoire collective était présente dans nos esprits. Nous avons assisté à cette guerre par écrans de télévision interposés et en ce qui me concerne de manière plus directe, puisque je suis allé à Sarajevo lorsque la ville était assiégée.
Je voudrais profiter de la présence de son Excellence pour rappeler que dans ma famille il y a aussi beaucoup d'histoires d'exils et d'exodes. J'ai évoqué rapidement mon expérience d'exilé à Paris. J'ai connu l'exil et je n'étais pas le seul. Je suis en grande partie des Balkans. Ma grand-mère maternelle était originaire de Bulgarie, ma grand-mère paternelle de Macédoine, etc. Lorsque Valéry Giscard d'Estaing dit que notre capitale ne se trouve pas en Europe, il a peut-être raison, mais notre histoire - et mon histoire familiale - se trouve en Europe, dans les Balkans. Ma grand-mère, qui m'a élevé, était une "rapatriée des Balkans". Elle a toujours dit beaucoup de bien de son pays d'origine et de ses voisins. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé aux littératures balkaniques. J'en ai beaucoup parlé dans mon pays car nous avons tendance à oublier nos voisins au profit de l'Europe. Il y a peut-être des raisons à cela, mais je suis heureux que l'on ait évoqué les Balkans ici. Il aurait fallu aussi parler des tragédies que cette région a connues pour que cela ne se reproduise plus.
J'ai écrit un ouvrage en 1993, intitulé Retour dans les Balkans. Il y a un chapitre sur Sofia où se trouve la phrase suivante : "Les têtes couronnées sont de retour dans les Balkans." En Bulgarie, cela sera peut-être un jour la réalité. Chaque écrivain a peut- être une part de prémonitions. Ma prémonition s'est réalisée, ce qui est positif, mais sans référence à la Monarchie.
Philippe GARBIT
Merci Nedim Gürsel. Comment réagit le Premier ministre de Bulgarie à la dernière petite phrase de Nedim Gürsel ?
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Je pense qu'il faut mettre l'accent sur le bon voisinage et sur le fait que c'était une prémonition qui s'est avérée exacte.
Philippe GARBIT
Êtes-vous d'accord avec l'idée de votre cousin selon laquelle la culture doit être plus présente dans les négociations internationales, afin de servir la paix ?
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Je pense que qu'il s'agit d'une excellente idée. La culture est un vecteur qui peut réellement apaiser, enseigner et unir les gens.
Philippe GARBIT
Concrètement, cela passe par des échanges d'écrivains...
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Oui, et cela nécessite une traduction des littératures respectives. Il faut aussi encourager des écrivains et ceux qui appartiennent au monde littéraire à se positionner de manière plus active dans les négociations politiques.
Philippe GARBIT
Avez-vous nommé des écrivains, des gens de culture, dans votre Gouvernement ?
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Il y a des gens de culture autour du gouvernement, mais ils n'ont pas été choisis spécifiquement pour cette raison car cela risquerait d'être de la discrimination à l'envers.
Philippe GARBIT
Henri Lopes, vous êtes ambassadeur et écrivain. Êtes-vous un homme politique ?
Henri LOPES
Je vous ai dit que j'avais plusieurs vies. Pour en revenir au thème, j'ai oublié de préciser que l'histoire que j'ai racontée illustre ceci : lorsque ma génération est venue en France, nous avons fait le voyage prométhéen. Il s'agissait d'un exil d'enfants placés en pension où l'on découvre le feu. Nous le prenons et allons semer les brandons dans les esprits de nos populations. Je pense que cela rejoint l'une de mes théories, si vous me pardonnez ce petit péché d'orgueil.
Je dis toujours que j'ai trois identités. La première est mon identité originelle, celle qui me rattache à mes ancêtres les Bantous. Pour ne pas rester uniquement à la culture de village, je dois affirmer ma deuxième identité par un acte volontaire. Il s'agit de mon identité internationale, que j'ai commencé à trouver ici, en jouant au football au lycée. On me disait que j'étais différent des autres Africains, ce qui me déplaisait. J'avais perdu mon accent, mais il se retrouve dans mon écriture. Mon identité internationale me rattache, notez-le, à mes ancêtres les Gaulois, bien que je sois descendant de Belges et de Corses. C'est par le biais de cette identité internationale que nous avons été conduits à faire émerger au sein de nos populations la volonté d'indépendance, afin de permettre la naissance d'une identité nationale encore plus forte, capable de s'imposer sur la scène internationale. La troisième identité est personnelle : nous sommes tous pareils et tous différents. Il s'agit de trois cordes de guitare. Il ne faut peut-être pas les jouer simultanément, mais si l'une d'entre elles se brise, le résultat n'est plus harmonieux et produit des grandes tragédies personnelles ou internationales.
Philippe GARBIT
Merci Henri Lopes. Françoise Morechand, vous allez repartir très vite au Japon, je crois.
Françoise MORECHAND
Oui, ce soir.
Philippe GARBIT
Vous n'allez pas convaincre votre voisin de repartir au Japon, et vous n'avez pas à le faire...
Françoise MORECHAND
Je trouve cela étrange qu'il ne rentre pas plus souvent au Japon. Personnellement, je rentre très souvent en France.
Philippe GARBIT
Au moins en touriste...
Françoise MORECHAND
Nous ne sommes pas des exilés dans le sens négatif. Nous avons choisi. J'ai un petit pécule et mon banquier m'a demandé ce que je comptais faire à la fin de ma vie. Il souhaite savoir où je compte vivre mes derniers jours. Je ne sais pas. Je suis incapable de choisir. Un joli tombeau m'attend au Japon car mon mari est fils de bonze, de Kyoto, l'un des plus beaux temples. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis remariée avec lui, pour le temple, le tombeau. Je peux rester là-bas. J'ai aussi un tombeau à Paris. Pourtant, j'ai besoin des deux pays et le choix sera pour moi une amputation.
Nous parlons d'identité. Mon arrière-grand-père était un exilé politique. Selon ma grand-mère, il en a beaucoup souffert à la fin de sa vie. Zakopan, la neige, la Pologne lui manquaient. Dans ma vie, j'ai voulu aller vers les gens, je suis née pour cela. C'est sans doute la raison pour laquelle je travaille dans la communication. J'ai essayé de m'identifier totalement à eux dans les années 1970. Ce fut un échec complet. Ils ont refusé mon attitude, car ils n'attendaient pas cela de moi. Vous avez dit que j'avais peut-être été un jouet ou plus exactement vous n'avez pas dit cela exactement.
Philippe GARBIT
Non, je ne vous ai jamais traitée de jouet...
Françoise MORECHAND
J'ai dû l'être. Lorsque l'on fait de la télévision, on est souvent manipulé. Le Japon ne fait pas exception, d'autant plus que j'étais une jeune étrangère. Je suis assez pragmatique, je l'ai utilisé tant que cela était possible, jusqu'à trente ans environ. Ensuite, ceux qui vous appréciaient parce que vous êtes un jouet commencent à vous mépriser pour la même raison. Il faut savoir changer tous les dix ans...
Philippe GARBIT
J'avais dit exotique...
Françoise MORECHAND
Oui. Je le suis forcément. En France nous avons l'habitude de côtoyer des étrangers. Mon mari - Cascades Éternelles - était à Paris depuis cinq jours. À Saint-Germain-des-Prés, quelqu'un l'arrête pour lui demander l'heure. En tant que Japonais, sa surprise fut immense - si bien qu'il a raconté cette anecdote trois ans après, lors de son retour au Japon. Je lui ai précisé que de très nombreuses nationalités coexistent à Paris, alors que les Japonais vivent sur une île...
Pour survivre, un exilé doit normalement essayer de se fondre dans l'identité du pays qui l'accueille. Au Japon, c'est l'inverse. Il ne faut pas "passer la ligne" selon l'expression que Boris Vian utilise dans J'irai cracher sur vos tombes. Je voulais passer la ligne alors que je ne suis pas japonaise et que je ne suis pas née là-bas. Je suis judéo-chrétienne et non pas confucéenne. Il faut assumer sa propre personnalité et, dès lors, les Asiatiques vous respectent. Entre-temps se produisent des souffrances épouvantables, mais la reconstruction de soi-même passe généralement par la souffrance. La situation est terrible lorsque l'on essaie d'aller vers eux et qu'ils nous rejettent, dès lors nous sommes trop repliés sur nous-mêmes. Le Japon est à cet égard certainement plus ardu que la Chine. Le Japon est une île. Pendant deux cent cinquante ans ils se sont retirés chez eux - le sakoku. Si un Japonais tentait de sortir et si un étranger essayait de rentrer au Japon, les deux avaient la tête coupée. Ils sont donc restés entre eux durant tout ce temps. Cela s'est fortement ressenti dans l'art. L'art japonais, d'un extraordinaire raffinement, n'a pas été inspiré par des apports extérieurs artistiques. Les Japonais ont parfait à l'extrême leurs techniques héritées du XVII e siècle. L'art japonais est l'une des raisons pour lesquelles je suis restée. On peut tomber amoureux de l'art japonais avant de tomber amoureux des Japonais, qui sont généralement rudes.
Philippe GARBIT
Ce n'est pas très gentil de dire cela.
Françoise MORECHAND
Je suis mariée à un Japonais et je vis là-bas ; j'ai le droit de le dire.
Philippe GARBIT
Mais Masao Haijima n'a peut-être pas de tombeau à vous offrir...
Henri LOPES
Si vous permettez... Pour apaiser les tourments de Monsieur Cascades Éternelles, je voulais vous signifier que si on lui a demandé l'heure c'est parce qu'actuellement les meilleures montres sont japonaises.
Françoise MORECHAND
S'il n'y avait que les montres qui étaient les meilleures !
Philippe GARBIT
Vous travaillez pour...
Françoise MORECHAND
Je suis conseillère pour Nissan. Il y a une équipe de Français extraordinaire autour du Président.
Nous vivons au XXI e siècle. L'exil ou le fait de vivre à l'étranger doit servir à soi- même et aussi à son pays. On retient beaucoup la Culture, mais n'oublions pas les styles de vie. J'aimerais que l'on se rende compte que si l'on veut vendre des produits français au Japon ou en Chine, il faut au préalable exporter la culture, les styles de vie. Concrètement, pour qu'un étranger monte dans un avion Air France, il faut qu'il s'y sente en France. Sur le plan technologique, les caractéristiques sont proches d'un appareil à l'autre. Les moteurs sont identiques - de marque Rolls- Royce je crois.
Philippe GARBIT
Qui vous paie ? Nissan, Rolls-Royce ?
Françoise MORECHAND
Personne, donc je peux parler de tout le monde. Il faut vendre notre style de vie pour pouvoir faire du commerce extérieur. C'est peut-être trivial, mais c'est le nerf de la guerre.
Philippe GARBIT
Merci Françoise Morechand. Henri Lopes, vous avez la parole.
Henri LOPES
Madame, vous avez eu raison de souligner le drame qui peut survenir au moment de la mort. Dans l'exil, qu'il soit géographique ou intérieur, on arrive à croire que l'on est devenu multiculturel, équilibré, mais au moment de la naissance, du mariage et de la mort, la question du choix se pose. Faut-il circoncire son fils ? Selon quels rites le mariage va-t-il être célébré ? Où se faire enterrer ? La culture la plus ouverte n'a pas trouvé de réponse à ces souffrances.
Françoise MORECHAND
Merci Monsieur. Il a raison.
Philippe GARBIT
Une dernière parole, Françoise Morechand ?
Françoise MORECHAND
J'ai les larmes aux yeux, ce qui prouve que j'ai été touchée. Ces questions sont graves et rejoignent un questionnement intérieur.
Philippe GARBIT
Nous n'allons pas rester sur cette idée de mort, même si elle est d'importance. Avez- vous des conclusions à apporter à ces tables rondes ? Vous avez raconté des histoires individuelles, ce qui ne couvre pas tous les exils possibles. Souhaitez-vous ajouter un dernier élément ?
Nicolas PETROVITCH NJEGOSH de MONTÉNÉGRO
Je pense qu'il faudrait insister sur l'apport que l'exil procure à un pays. Paris est considéré comme une capitale culturelle parce que tous les étrangers y sont allés. Les étrangers sont très précieux pour les pays d'accueil.
Philippe GARBIT
Pas uniquement les gens de culture, d'ailleurs...
Nicolas PETROVITCH NJEGOSH de MONTÉNÉGRO
Non. Que l'on pense aux restaurants ! C'est un enrichissement pour l'urbanisme, pour notre mode de vie. L'exil n'est pas uniquement négatif.
Philippe GARBIT
Cette constatation était en filigrane. Nous recevons des exilés et c'est une chance pour la France. Nedim Gürsel, souhaitez-vous ajouter un dernier mot ?
Nedim GÜRSEL
Je dois beaucoup à la France. Elle m'a accueilli lorsque dans mon pays, pour reprendre l'expression d'un grand poète turc, "les loups entraient dans les villes sur des tanks." J'ai beaucoup rêvé de Paris lorsque j'étais interne au lycée francophone d'Istanbul. J'y ai découvert la littérature française. Je rêvais des filles et de Paris. Mais j'y suis sous contrainte. La France est un pays d'accueil et j'espère qu'il ne se transformera pas, par fantasme sécuritaire, en un pays hostile à l'immigration et aux exilés qui souffrent beaucoup.
Philippe GARBIT
Merci Nedim Gürsel. Excellence, qu'avez-vous à ajouter ?
Siméon de SAXE-COBOURG GOTHA
Ce que viens de dire M. Gürsel est tellement juste qu'il n'y a pas beaucoup à ajouter. Je disais hier en entretien que la France avait toujours accueilli nos compatriotes, à la différence d'autres pays. Nous devons un grand merci à la France.
Philippe GARBIT
Merci Excellence. Merci à tous.
INTERVENTION
DE SON EXCELLENCE SIMÉON DE SAXE-COBOURG GOTHA, PREMIER MINISTRE DE BULGARIE
Je tiens tout d'abord à rendre un vibrant hommage à la mémoire d'un des plus illustres et des plus grands humanistes du XIX e siècle. C'est bien son humanisme qui est la raison pour laquelle Victor Hugo appartient, et ceci depuis longtemps, à la France et au patrimoine français. Par son oeuvre, il est merveilleusement présent dans la littérature universelle. C'est pourquoi son bicentenaire s'est transformé en un événement culturel pour le monde civilisé.
Monsieur le Président,
Je m'empresse de vous exprimer mes remerciements pour l'invitation que vous m'avez adressée, de prendre part au colloque organisé par cette auguste institution, d'autant plus que le thème « Exil et tolérance » est d'actualité à un moment où les fondements de notre civilisation sont menacés par les formes drastiques que prend le terrorisme. D'une part, une radicalisation odieuse, souvent au nom de la foi mal interprétée, et d'une autre, les conséquences qui se traduisent souvent en réfugiés, par centaines de milliers. L'exil ce n'est pas seulement la misère physique, c'est aussi la tristesse, la nostalgie et une révolte lancinante contre l'injustice et très souvent l'indifférence.
Mon destin, tant personnel que politique, m'a plus d'une fois placé devant « l'exil et la tolérance », comme l'on peut s'imaginer. C'est pourquoi je serais vraiment heureux si le XXI e siècle, prometteur mais aussi plein de contradictions inquiétantes, nous permettait de délaisser à jamais toute forme d'exil par l'intolérance politique aussi bien que religieuse.
Je suis persuadé que le langage de la tolérance est celui de l'avenir. Être tolérant signifie avant tout connaître l'autre, le différent de soi. Nous connaître mutuellement est une condition nécessaire, surtout dans une société de plus en plus massifiée.
C'est pourquoi, du haut de cette tribune, j'éprouve une satisfaction toute particulière d'appartenir à un peuple qui au cours de son histoire a laissé des traces irréfutables de tolérance ethnique et religieuse.
Le peuple bulgare n'aime pas se faire remarquer et encore moins, imposer aux autres ses valeurs. Cependant je tiens à souligner que la tolérance est assise dans l'acte fondateur de l'État bulgare. Lorsqu'en cette lointaine année 681, les tribus proto- bulgares du khan Asparouh, réputées pour leur puissance militaire, déferlent sur les Balkans pour se rallier aux tribus slaves autochtones, ils créent une communauté solide et vitale, fondée non pas sur la peur de l'adversaire commun, mais sur le respect et la sauvegarde de l'autre, de sa langue, des traditions, voire même des diverses divinités, des différents cultes.
La propagation du christianisme en Bulgarie et dans les terres slaves fut, comme vous le savez, la mission de toute une vie des saints frères Cyrille et Méthode - ces ecclésiastiques si instruits, qui prêchaient une doctrine révolutionnaire pour son temps, fondée, elle aussi, sur la tolérance. Ce sont eux qui réfutent le dogme obscurantiste des trois langues, selon lequel la messe ne pouvait être célébrée que dans les trois langues inscrites sur la croix du Christ - l'hébreu, le latin et le grec. C'est ainsi que pour la première fois dans l'histoire du christianisme ils introduisent le principe démocratique, que la spiritualité et la culture se penchent vers l'homme ordinaire. Ils défendent leur grande idée de façon simple et compréhensible. Je cite : « Le soleil ne brille-t-il pas de la même façon pour tous ? Et le Seigneur n'envoie-t-il pas de la même façon à tous les peuples de la pluie et sa grâce divine ? » Lors de sa visite en Bulgarie en 1984, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Javier Pérez de Cuellar, avait déclaré que le principe de l'égalité et de l'autodétermination des peuples, énoncé dans la Charte de l'ONU, fut proclamé pour la première fois par les apôtres slaves Cyrille et Méthode.
Et plus tard, lorsque au XIV e siècle les Bulgares se trouvent sous le joug ottoman, et ceci pour une période de cinq siècles, ils font preuve de tolérance ethnique. Au cours d'une centaine d'insurrections, les Bulgares ne manifestent pas leur juste colère contre la population turque. Ceci peut paraître invraisemblable, mais c'est un fait. Même lors du grand soulèvement d'avril 1876, il n'y a pas de massacres de Turcs. Ainsi donc notre héros national, Vassil Levski, prône que « l'adversaire ce n'est point le Turc ordinaire mais les zaptiés » - c'est-à-dire la police ottomane. Ce qui explique qu'à la libération en 1878, un grand nombre de Turcs restent en Bulgarie. Et l'homme dont nous commémorons aujourd'hui le bicentenaire avec tant d'admiration comme étant la conscience de son temps, va prononcer, ici, à Paris, à la Chambre des députés, des paroles élogieuses pour mon peuple.
Aujourd'hui encore, lorsque les Balkans sont de nouveau censés être la « poudrière » de l'Europe, la Bulgarie reste pratiquement le seul État dans cette région non seulement épargné de tout conflit militaire ou civil, mais elle est citée, et pour cause, comme un « îlot de stabilité ». Aujourd'hui encore, sur nos terres, Bulgares et Turcs cohabitent en paix et avec un respect mutuel édifiant, et lors de la fête musulmane, la bayram (l'Aïd pour d'autres), chrétiens et musulmans se mettent à table ensemble. Il en est souvent de même lors des fêtes chrétiennes.
Pour nous Bulgares, la tolérance est un état d'esprit naturel et un élément de notre conception de la vie. C'est Hitler lui-même qui en fit l'expérience, lorsque la Bulgarie fut, avec le Danemark, le seul État qui prit la protection de ses Juifs, interdisant qu'ils soient extradés vers les camps d'extermination. Ce furent l'Église, des députés, le souverain, les Bulgares ordinaires qui prirent leur défense.
Chers amis,
Toute promenade dans l'histoire, pour brève qu'elle soit, et tout réconfort que l'on cherche en elle, ont leur sens s'ils servent le présent et l'avenir. Je veux bien croire que nous tous trouverons la force et les moyens, au nom de la mémoire de personnalités comme Hugo, et au nom de l'avenir d'un monde plus humain, de défendre les principes de l'égalité et de la tolérance. Ce sera là un signe sûr que les leçons de l'histoire sont devenues celles de l'avenir.
JOURNÉE DE LA TOLÉRANCE organisée par le Sénat avec le patronage de l'UNESCO - Débats, lectures et témoignages dans l'hémicycle du Sénat le samedi 16 novembre 2002

Lors de la séance solennelle, animée par J. P. Elkabbach, le Sénat organise dans son hémicycle une rencontre associant les lauréats du concours, les Sénateurs élus de leur département, des personnalités emblématiques de la politique, de la littérature, des arts, que le destin aura conduites, à partir de situations extrêmement différentes, à accomplir un chemin parallèle à celui de Victor Hugo, et des comédiens venus prêter leur voix à Victor Hugo.
COMPTE RENDU INTÉGRAL
(La séance exceptionnelle est ouverte à quinze heures dix.)
Débats, lectures et témoignages
M. Christian Poncelet, président du Sénat. Monsieur le Président de la République de Lituanie, monsieur le ministre de l'éducation nationale, chers collègues, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers jeunes amis, le Sénat est heureux de vous accueillir dans son hémicycle pour cette séance exceptionnelle, qui coïncide avec la journée de la tolérance instituée par l'UNESCO - dont je salue la directrice générale adjointe -, et qui clôt le cycle des célébrations et des manifestations organisées par le Sénat pour le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo, ce géant dont la proximité, l'actualité et l'universalité sont des données immédiates de nos consciences.
Le Sénat est heureux d'accueillir aujourd'hui, en présence de leur ministre, M. Luc Ferry, les collégiennes et les collégiens, les lycéennes et les lycéens qui ont réfléchi sur le thème de la tolérance. Par leur présence, ces jeunes apportent un point d'orgue aux célébrations de l'année, baptisée à juste titre « année Victor Hugo ». En effet, c'est ici, en ces lieux mêmes, qu'ils peuvent le mieux saisir l'activité de Victor Hugo homme politique, dans cette salle où ses pas ont résonné, où sa voix a tonné, où son génie s'est exprimé ! Pair de France, sénateur, Victor Hugo reste l'une des hautes figures qui ont contribué à sculpter le personnage de l'écrivain fortement engagé.
Retour vers le passé, cette manifestation se projette vers le futur, comme le Sénat lui- même, riche de son histoire et de ses traditions, mais aussi constamment force de propositions et laboratoire de prospectives. A cet égard, il est particulièrement significatif que ce soit avec des jeunes que s'achève cette célébration de Victor Hugo, qui, grâce à vous et au souvenir que vous en garderez, étendra ses racines loin dans ce nouveau siècle, qui « a deux ans » à peine.
La tolérance, beau thème, relativement récent, est le sujet de vos réflexions. Après la révocation de l'édit de Nantes, les Lumières ont imposé l'idée de la tolérance religieuse ; Victor Hugo lui a donné une portée universelle.
Et pourtant, ce concept de tolérance est encore à réinventer. Les événements récents ont montré, hélas ! que l'intolérance, l'intégrisme, le fanatisme, les guerres de religion, les conflits de civilisation, les tensions raciales et ethniques, sont toujours - et même, dirai-je, plus que jamais - d'actualité.
Toujours, il apparaît que c'est l'absence de tolérance qui fait de l'autre un différent, qui fait de l'autre l'ennemi. Mais c'est précisément cela qui fait le prix de la tolérance.
Car, ne nous le cachons pas, la différence n'est pas facile à admettre spontanément. Elle intrigue, inquiète, étonne, choque. Les peuples, souvent, éprouvent le besoin de marquer leur différence, et nous-mêmes n'y échappons pas.
Comment ne pas transformer la conscience de sa différence en mépris des autres, voire en haine des autres ? C'est là la question.
Les stoïciens avaient théorisé une forme particulière de l'indifférence, la suspension du jugement, qui les rendait insensibles au monde extérieur. Mais ce serait une bien triste paix entre les hommes que celle qui viendrait de leur indifférence les uns aux
autres.
La tolérance est donc une voie, une voie plus belle, qui suppose l'acceptation et le respect des différences. La tolérance, ce concept étrange, doit être synonyme non pas de dédain, de ce qu'on accepte simplement de tolérer, mais de respect et de considération.
Ce concept étrange peut aussi être victime de son succès. La tolérance universelle ne doit pas devenir universel relativisme. A trop dénoncer les intégrismes, ne manifeste-t-on pas un moindre attachement à l'intégrité de la vérité ?
La tolérance ne doit pas s'exercer au-delà des limites de la vérité : pas de tolérance pour le révisionnisme, pour le négationnisme, pour les thèses qui n'ont aucune considération envers l'homme.
La tolérance n'est pas contradictoire avec notre droit de ne pas tolérer l'intolérable.
De même, la tolérance ne peut pas être unilatérale : à l'évidence, elle suppose la réciprocité. La question est alors la suivante : comment coexister au XXI e siècle ? Sans doute par la promotion des libertés individuelles. Car je veux croire que les fanatismes sont solubles dans la démocratie, dans une démocratie vivante, qui tend à effacer les inégalités sociales.
Voilà ce qui fait la modernité de ce thème, mais aussi, soyons-en bien conscients, sa difficulté. La tolérance est encore et sera pour longtemps un combat.
Je forme donc le voeu que la force créatrice de Victor Hugo vous arme et vous inspire pour pouvoir encore mieux lutter, comme il le disait. Souvenez-vous qu'il avait écrit : « La vie est un combat et ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. » (Applaudissements. )
M. Jean-Pierre Elkabbach, président de Public Sénat. Nous sommes tous vos hôtes, monsieur le président du Sénat. Nous sommes aussi ceux de Victor Hugo.
Pour ma part, je suis impressionné d'être là pour la première fois à cette place et parmi vous.
Je pense que Victor Hugo aimerait cette journée-événement, qui est retransmise par la chaîne de télévision parlementaire, Public Sénat.
Je pense qu'il aimerait vous voir tous ainsi rassemblés dans cet hémicycle du Sénat, où il a siégé, lui qui voulait une chambre haute composée aussi d'écrivains, de savants, d'artistes et de jeunes.
Vous, les jeunes, vous avez, outre la jeunesse, la légitimité, l'autorité morale et, aujourd'hui, aussi, une certaine influence, comme vous allez le montrer à travers vos questions.
Cela paraît évident et simple. Mais, comme l'a rappelé à l'instant le président Christian Poncelet, il a fallu des luttes pour donner à cette institution l'indépendance et la dignité que nous célébrons aujourd'hui. Faut-il vous rappeler que, pour protester contre le Sénat, qui était alors aux ordres de Napoléon le Petit, le provocateur Hugo
avait trouvé drôle d'appeler son chien « Sénat » ?
Le Sénat du XXI e siècle qui vous accueille aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, a la tête haute.
Je voudrais saluer M. Valdas Adamkus, président de la République de Lituanie, M. Simcon de Saxe-Cobourg-Gotha, Premier ministre de Bulgarie, ancien roi de ce pays, qui symbolise aujourd'hui la jeune démocratie bulgare, appelée à entrer dans l'Europe élargie, M. Luc Ferry, ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Mme Françoise Rivière, directrice générale adjointe de l'UNESCO, M. Jorge Semprun, écrivain, homme politique et homme de courage, M. François Cheng. Nous n'avons pas attendu que l'Académie française vous accueille, monsieur Cheng, pour admirer à la fois l'exilé de la Chine de Mao Zedong et l'écrivain.
Je saluerai aussi M. Bachir Boumaza, ancien président du Conseil de la nation en Algérie, ami du président Christian Poncelet - peut-être aussi, je le dis modestement, le mien -, grand expert et connaisseur de Victor Hugo, qui a connu vingt-sept années d'exil, du fait des Français, mais surtout du fait de son propre pays, l'Algérie.
Vous avez de la chance, vous, les jeunes élus du bicentenaire de Victor Hugo, d'avoir près de vous ces figures qui incarnent les drames et les espoirs du XX e siècle.
L'un des invités, M. Gürsel, qui est turc, rappelait hier dans le journal Le Monde, que la littérature du XX e siècle est une littérature d'exil, avec une destinée commune, le départ de l'errance, dont il témoignera.
Quant à Victor Hugo, il est toujours ici: une salle porte son nom, où vous y avez travaillé ce matin. Dans deux semaines, Victor Hugo accueillera au Panthéon son ami Alexandre Dumas, dont il dit dans Choses vues qu'il était peut-être « un peu trop frisé ». L'UNESCO a fait de ce samedi 16 novembre la journée mondiale de la tolérance.
Madame Françoise Rivière, qui représentez PUNESCO et son directeur général, M. Matsuura, nous allons écouter votre message.
Mme Françoise Rivière, directrice générale adjointe de l'UNESCO. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement le Sénat et son président Christian Poncelet d'avoir voulu associer l'UNESCO à ce qui est, bien lus qu'une commémoration, une véritable invitation à action.
Victor Hugo est, bien sûr, une figure emblématique tout à la fois de l'exil et de la tolérance. Le rejet de l'autoritarisme politique fut certainement l'un des principaux motifs de son exil. Mais cet exil lui-même a fortifié d'autres combats contre l'intolérance, sociale ou humaine, qu'il s'agisse de la cause des femmes, des droits des enfants, de la peine de mort ou de l'esclavage.
Bien des combats menés par Victor Hugo ont été gagnés depuis lors. En témoigne le corpus - sans cesse complété - des droits universellement reconnus. Et si les principes et valeurs démocratiques sont loin d'être universellement appliqués, ils sont pour le moins, aujourd'hui, très largement revendiqués.
Pourtant, force est de constater que, dans le même temps, l'intolérance a progressé partout et qu'elle fait des victimes à une échelle sans précédent, même si ses causes et ses manifestations ont beaucoup changé de nature. De la résurgence des rancoeurs historiques dans les Balkans à la recrudescence des agressions racistes en Europe de l'Ouest, du génocide du Rwanda au terrorisme fanatique d'Al-Qaida, l'intolérance, si elle pose toujours des problèmes éthiques, est de plus en plus considérée comme une menace majeure pour la démocratie, la paix et la sécurité.
C'est que, depuis la fin de la guerre froide, les guerres ont changé de nature : elles n'opposent plus, bien souvent, des États ni même nécessairement des armées. Elles déchirent les sociétés elles-mêmes et puisent leurs racines dans la discrimination, l'exclusion sociale et des préjugés ancestraux qui sont autant d'alibis éthnico-culturels.
Et que dire de ces « nouvelles ignorances » qui sont nées de la mondialisation et de l'incapacité d'affronter le contact direct avec l'autre autrement que comme une agression ? Les processus de mondialisation ont comme libéré le monde de toute frontière : ce faisant, ils ont propulsé - au moins symboliquement - des populations et des individus les uns contre les autres, sans initiation ni préparation d'aucune sorte, dans le brassage quotidien des villes multiethniques ou dans cette étrange immédiateté que créent les nouveaux médias. Nous n'avons que trop d'exemples des manichéismes et des amalgames de toute sorte qui peuvent en résulter, tout comme de ce repli sécuritaire qui a affecté tant de pays après les événements du 11 septembre 2001.
La tolérance devrait donc être abordée, aujourd'hui, dans une perspective profondément renouvelée, liée non plus tant à l'exil et à la séparation qu'à la rencontre et à la coexistence. Dans un monde devenu interdépendant, dans des sociétés de plus en plus multiethniques, multireligieuses et multilingues, le vrai défi est d'assurer une interaction harmonieuse et un « vouloir vivre ensemble » de populations, de groupes, de personnes aux identités culturelles très diversifiées. Tolérance et diversité culturelle ont ainsi partie liée, cette diversité qui est notre richesse, et qui est même, comme vient de le reconnaître l'UNESCO, un patrimoine commun à l'humanité tout entière. Comme telle, la diversité culturelle - à l'instar de la diversité biologique - doit être préservée, car elle est source d'innovations, d'échanges et donc de créativité. Mais, pour que la diversité culturelle, qui est d'ailleurs aujourd'hui terriblement menacée par le rouleau compresseur de la mondialisation, reste une diversité créatrice et non pas suicidaire, il faut, comme disait Lévi-Strauss, « qu'elle se réalise sous des formes dont chacune soit une contribution à la plus grande générosité des autres ».
C'est sans doute cela la tolérance, au XXI e siècle : une vertu qui permet de retirer du contact avec l'autre, comme de soi-même, la plus grande générosité. Tel est le sens de la déclaration de principe sur la tolérance qui a été adoptée par l'UNESCO - par les États membres de l'UNESCO - le 16 novembre 1995, il y a donc sept ans jour pour jour, à l'occasion du 50 e anniversaire de la création de notre institution. Une déclaration, me diriez-vous, ce ne sont que quelques mots jetés sur le papier. Mais ces quelques mots peuvent parfois changer la face du monde : il suffit de penser à la Déclaration universelle des droits de l'homme !
Cette déclaration sur la tolérance - dont des copies sont disponibles dans l'hémicycle - propose d'abord une définition nouvelle du mot, à l'opposé de la conception passive communément admise - celle que traduit, par exemple, l'expression « maison de tolérance ». Elle vise à une définition dynamique que Victor Hugo n'aurait certainement pas reniée : « La tolérance n'est ni concession, ni condescendance, ni complaisance. La tolérance est avant tout une attitude active animée par la reconnaissance des droits universels de la personne humaine et des libertés fondamentales. » En d'autres termes, il ne s'agit pas de « tolérer l'intolérable », mais, bien au contraire, de le combattre. La tolérance est un refus, refus de toute violation des droits de l'homme et de toute atteinte à la dignité humaine. Mais elle est aussi une attitude d'ouverture et d'empathie, qui rend possible non seulement le respect, l'acceptation, mais aussi l'appréciation de l'autre. La tolérance, c'est le contraire de l'indifférence : c'est une volonté d'écoute et de compréhension. Autant d'attitudes qui ne sont pas innées, qui supposent un minimum de connaissances - sur la diversité des modes d'expression, des manières d'être, des croyances et des systèmes de valeurs -, ainsi que l'aptitude à l'interaction et au dialogue.
La tolérance est donc tout à la fois une vertu - d'ordre éthique - et une nécessité, aussi bien juridique que politique. Elle engage la responsabilité des États, mais aussi celle des groupes et des individus.
La tolérance a bien évidemment besoin, pour exister, d'un État de droit ; elle nécessite des lois qui garantissent le respect des droits de l'homme, tous les droits de l'homme, civils et politiques, mais aussi économiques, sociaux et culturels. Et là, nous sommes sans doute encore bien loin du compte, même dans les démocraties dites avancées. Il nous faudra beaucoup d'imagination et d'innovations sociales pour pouvoir garantir, un jour, une réelle égalité de traitement aux différents groupes et individus qui composent une société, pour faire vivre un authentique pluralisme culturel, qui intègre sans assimiler, pour assurer une totale liberté d'expression, tout en protégeant les droits et la dignité de chacun, dans la presse écrite et audiovisuelle mais aussi - et c'est encore plus ardu - dans l'Internet et le cyberespace. Mais si les comportements peuvent être encadrés par le droit et par la loi, les attitudes, elles, sont du ressort individuel. Et les attitudes se forment dès le plus jeune âge. D'où l'importance cruciale de l'éducation. Il faut éduquer plus, c'est vrai ; il faut peut-être surtout éduquer mieux. Il faut mettre en place une sorte d' « éducation de base » aux différentes cultures et - pourquoi pas ? - une « anthropologie religieuse » - c'est-à-dire une présentation objective, même si elle est succincte, des principales religions. Il faut développer l'enseignement des langues étrangères, tant il est vrai qu'une langue n'est pas seulement un outil de communication, mais une vision du monde. Il faut développer les aptitudes relationnelles chez l'élève et le fonctionnement démocratique de l'école. Il faut éliminer les préjugés et les stéréotypes des manuels scolaires par le biais des révisions bilatérales ou multilatérales. Bref, il faut faire de l'éducation - qui est un processus permanent, appelé à durer tout au long de la vie - le véritable bras armé du combat pour la tolérance.
Dans le même temps - et c'est ainsi que je conclurai -, je ne pense pas que l'on puisse tout attendre des gouvernements et des institutions. Il en va de notre responsabilité individuelle. L'intolérance d'une société n'est, après tout, que la somme de l'intolérance de ses membres. L'intolérance engendre l'intolérance, on le sait, et nous sommes tous partie intégrante du problème, autant que de sa solution. L'action non violente, et toutes ses techniques, dont les figures comme Gandhi ou Martin Luther King ont démontré la puissance, est possible. Rien ne nous empêche de former un groupe ou d'organiser un réseau pour manifester une solidarité active avec des victimes de l'intolérance ; rien ne nous empêche de réfuter un préjugé ou de discréditer une propagande haineuse.
La force de l'exemple est considérable. La force de la pensée est considérable, celle de la parole aussi. Tel est bien le pari sur lequel l'UNESCO a été créée : son acte constitutif lui donne pour mission de « bâtir les défenses de la paix dans l'esprit des hommes » en s'appuyant sur la « solidarité intellectuelle et morale de l'humanité ». Tel est, aussi, l'objectif de cette journée internationale de la tolérance qui a été créée il y a sept ans sur l'initiative de l'UNESCO, et qui est désormais célébrée tous les ans le 16 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est une occasion pour susciter des idées nouvelles, des débats, des prises de conscience, des engagements individuels et collectifs. La réunion d'aujourd'hui - qui regroupe responsables politiques, intellectuels, lycéens - est de bon augure. Merci donc au Sénat d'avoir organisé cette rencontre, qui nous autorise à croire que le combat pour la tolérance, un jour, pourra être gagné. (Applaudissements.)
M. Jean-Pierre Elkabbach. Madame Françoise Rivière, vous venez de présenter le programme d'action et les beaux engagements de l'UNESCO. Quel dommage que vous n'ayez pas le pouvoir d'imposer cette valeur qu'est la tolérance ! Je m'adresserai maintenant à l'intellectuel et au philosophe Luc Ferry plutôt qu'au ministre pour lui demander de nous dire ce qu'est la tolérance et s'il la conçoit comme une valeur de résistance et de combat.
M. Luc Ferry, ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour ouvrir le débat et vous provoquer un peu, je dirai qu'il faut garder l'idée que la tolérance n'est pas forcément une bonne chose. Je vous demande d'y réfléchir.
On a tendance à dire que la tolérance, c'est une valeur extraordinaire, c'est le respect des autres. Mais, quelquefois, la tolérance peut être dangereuse.
Les deux précédents orateurs, notamment le président Christian Poncelet, ont souligné que l'intolérable existait. Faut-il donc tolérer l'intolérable ? Telle est la vraie question que pose l'idée de tolérance.
Je prendrai deux exemples.
Vous avez sans doute travaillé toute l'année sur les oeuvres de Victor Hugo.
Quelqu'un parmi vous se souvient-il des endroits où Victor Hugo a été exilé ?
Plusieurs élèves. Guernesey!
M. Luc Ferry, ministre. Oui. Et avant d'être à Guernesey, a-t-il été exilé ailleurs ?
Plusieurs élèves. A Jersey !
M. Luc Ferry, ministre. Et avant Jersey ?
Plusieurs élèves. En Belgique !
M. Luc Ferry, ministre. Très bien !
Je voudrais encore vous poser une question. Par qui Victor Hugo a-t-il été exilé?
Plusieurs élèves. Napoléon III !
M. Luc Ferry, ministre. Très bien !
Pendant son exil, il apprend que d'autres exilés comme lui préparent un attentat contre Napoléon III, pour le tuer. Que fait alors Victor Hugo ? Dans un long discours, il leur dit : « Même si c'est notre adversaire, même si c'est lui qui nous a exilés, il ne faut pas le tuer. » Vous le savez, Victor Hugo était contre la peine de mort.
Un jour, dans un collège que j'ai visité, deux jeunes âgés de seize ans et de dix-sept ans ont racketté des petits, et ont jeté sur un sol en béton d'une balustrade haute de plusieurs mètres un enfant âgé de dix ans et demi qui ne voulait pas payer. Il aurait pu se tuer. Il s'est simplement cassé un bras, une jambe et quelques côtes.
Si vous êtes un jour le témoin d'une telle scène, croyez-vous qu'il faudra la tolérer ?
Plusieurs élèves. Non !
M. Luc Ferry, ministre. Il y a des moments où la tolérance est une grande valeur, et il y a des moments où elle est une lâcheté, une forme de complicité. C'est toute la difficulté de l'idée de tolérance.
Nous devons donc nous demander quels sont les critères de ce que l'on doit tolérer et de ce que l'on ne doit pas tolérer. C'est, me semble-t-il, la vraie question.
M. Jean-Pierre Elkabbach. Le philosophe Luc Ferry nous dit que si l'on n'est ni Gandhi, ni le Christ, ni le Dalaï-Lama, ni Nelson Mandela, on peut ne pas être tolérant avec celui qui n'est pas tolérant.
M. Luc Ferry, ministre. Même le Christ, lorsqu'il chasse les marchands du temple n'est pas très tolérant ; il les « engueule » fermement, pour parler franchement. (Sourires.)
Il faut faire attention, tout n'est pas tolérable.
M. Jean-Pierre Elkabbach. La tolérance s'apprend-elle ?
M. Luc Ferry, ministre. Oui, elle s'apprend. Quand on a des enfants, on sait que ceux de deux ans ne sont pas tolérants, ils ne supportent rien. Si les yeux des petits de deux ans étaient des mitraillettes, l'humanité aurait disparu depuis longtemps ! On apprend la tolérance, on devient tolérant, mais il ne faut pas non plus tout supporter. Telle est la difficulté.
M. Christian Poncelet, président du Sénat. Il ne faut pas que la tolérance s'apparente à un lâche soulagement, qui peut par la suite avoir des conséquences particulièrement douloureuses, comme certains événements récents nous l'ont montré.
M. Jean-Pierre Elkabbach. Vous allez maintenant entendre le message que le grand violoncelliste Rostropovitch, ami de Sakharov et de Soljenitsyne, nous adresse à l'occasion de la journée mondiale de la tolérance.
C'est Yann Weibel, du collège Victor-Hugo, de Colmar, qui va le lire du haut de cette prestigieuse tribune. C'est un honneur de prêter sa voix à Rostropovitch, l'exilé, le dissident, qui n'a cessé, tout au long de sa vie et au nom de la vie, de défendre les droits de l'homme.
Yann Weibel, comment avez-vous connu Rostropovitch ? L'avez-vous vu ou entendu jouer de son violoncelle ?
M. Yann Weibel. Il est difficile d'ignorer une telle personnalité, surtout quand elle orne la couverture de notre livre d'histoire-géographie ! (Rires.) Oui, je le connais ; j'apprécie beaucoup sa musique ; j'aime beaucoup cet homme.
« Chers amis !
« Tout d'abord, laissez-moi vous exprimer les regrets que j'ai à ne pas me trouver parmi vous aujourd'hui, quand - sous l'égide de Victor Hugo, dont les oeuvres m'accompagnent dans mon perpétuel tour du monde - vous évoquez deux idées si intimement liées à mon destin : l'exil et la tolérance. Je tiens à rendre un hommage particulier à M. le président du Sénat ainsi qu'au bureau de la Haute Assemblée, dont l'heureuse initiative me permet de partager avec vous ces quelques réflexions. « Lorsque Galina Vishnevskaïa, mon épouse, et moi-même avons appris que nous étions déchus de notre nationalité, j'ai abruptement pris conscience de l'état d'exil dans lequel vivaient déjà un certain nombre de nos amis. Pour fuir cet exil peut-être, j'ai recréé dans mon appartement parisien un espace entièrement meublé d'objets russes acquis au gré de mes tournées dans le monde entier. C'est là que pendant de nombreuses années je me suis "exilé" moi-même, "exilé" du reste du monde, "exilé" de mon état d'exil, dans un espace qui n'était ni ma patrie ni l 'étranger", et les deux à la fois.
« Cependant Dieu m'avait offert le plus beau et le plus reconnu des passeports : la musique. Je me suis engouffré à corps perdu dans le tourbillon des concerts donnés sur tous les points du globe. J'observais chaque pays, chaque ville, chaque langue, chaque visage, en y cherchant ce que je pensais avoir perdu : la sérénité de savoir être chez soi quelque part. Et tous ces pays, toutes ces villes, toutes ces langues et ces visages - emportés par les notes que je leur jouais - m'ont offert de trouver ce dont je suis sûr aujourd'hui : la sérénité de savoir être partout chez moi. « Actuellement, c'est avec l'aide précieuse d'amis français, américains, espagnols, allemands, britanniques et de tant d'autres personnalités, que Galina et moi couvrons pour l'enfance en Russie ; je suis fier de savoir qu'en 2004 nous aurons concouru à la vaccination de tous les enfants russes. Un travail de titans qui n'a pu aboutir que grâce à l'union de tous ces enthousiasmes et de toutes ces compétences exaltés par delà les pays, les villes, les langues et les visages.
« Je veux croire que ces enfants, comme ceux qui sont ici maintenant, sauront perpétuer cet élan d'intelligence et d'amour : la tolérance. « Je vous souhaite à tous une riche et belle journée. « Votre Slava. » (Applaudissements.)
M. Jean-Pierre Elkabbach. Yann Weibel, je vous remercie d'avoir lu ce très beau message de Mstislav Rostropovitch.
Votre génération connaît ou devrait connaître Andrzej Wajda, ce grand réalisateur, autrefois interdit par les dirigeants communistes de son pays, la Pologne.
Àndrzej Wadja, retenu chez lui pour des raisons de santé, a demandé à un excellent comédien que vous allez reconnaître, Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie française, de lire son message.
M. Denis Podalydès. « Monsieur le président du Sénat, mesdames, messieurs, le bicentenaire de la naissance de Victor Hugo, ainsi que son exil tragique de France nous obligent à nous souvenir de ce que nous, Polonais, savons sur l'émigration forcée. Le XIX e siècle fut l'époque de la grande émigration polonaise qui a trouvé en France sa seconde patrie et dont le sort douloureux est évoqué dans mon film Pan Tadeusz.
« Le XX e siècle ne nous a pas permis d'oublier cette peine cruelle qu'infligeait le pouvoir aux auteurs et aux artistes, laissant ceux qui étaient restés au pays dans une situation caractérisée par des ambiguïtés morales.
« Permettez-moi donc de réfléchir sur ma vie et d'évoquer ainsi le thème de l'exil dans un pays et à une époque où il m'a été donné de vivre.
« Depuis 1958, lorsque le jury du Festival de Cannes a remarqué et a primé mon film Canal, la question revenait sans cesse : "Pourquoi n'avez-vous pas quitté la Pologne communiste et pourquoi ne cherchez-vous pas votre place dans le monde libre ?" Je trouve la meilleure réponse à cette question dans les Notes de l'exil écrites par le plus grand poète polonais Czeslaw Milosz, durement éprouvé par de longues années d'exil : "La censure peut bien tolérer les diverses facéties d'avant-garde, car celles-ci occupent le temps de l'écrivain et font de la littérature une distraction anodine pour une élite très restreinte. Mais, dès que l'écrivain montre de l'intérêt pour la réalité, la censure se met à frapper. Si, par suite d'un bannissement, ou par sa propre décision, il se trouve en exil, il déverse sa colère, longtemps contenue, ainsi que ses réflexions et ses observations, considérant tout cela comme son devoir et sa mission. Cependant, ce qui est considéré dans son pays avec gravité, comme une question de vie ou de mort, n'intéresse personne à l'étranger, ou alors suscite de l'intérêt pour des raisons hasardeuses. Aussi bien, l'écrivain constate qu'il ne peut pas s'adresser à ceux qui tiennent à ces questions, en revanche il peut s'adresser uniquement à ceux qui ne se sentent pas concernés."
« L'école polonaise de cinéma a rejeté "les facéties d'avant-garde", par conséquent, mon conflit avec la censure était inévitable. Mais, pour moi, ce n'était pas le plus important. Ce qui comptait le plus, c'était la réponse à la question portant sur mon expérience de vie que je voulais transmettre aux autres, ce que j'avais à dire au monde et ce que je souhaitais lui montrer à travers mes films, puisque j'ai vécu la guerre la plus horrible de nos temps.
« Jusqu'au jour, ô Pologne ! où tu nous montreras
« Quelque désastre affreux, comme ceux de la Grèce,
« Quelque Missolonghi d'une nouvelle espèce,
« Quoi que tu puisses faire, on ne te croira pas.
« Battez-vous et mourrez, braves gens. - L'heure arrive.
« Battez-vous, la pitié de l'Europe est tardive.
« Il faut des levains qui ne soient point usés !
« Battez-vous et mourez, car nous sommes blasés ! »
Alfred de Musset A la Pologne (1831).
« Justement, j'avais une vision de ce "désastre affreux" et c'est moi qui avais, grâce à la puissance du cinéma, la possibilité de le faire voir à mes contemporains. Il est vrai que les queues-de-pie et les toilettes de soirée des dames, arborées lors de ce Festival de Cannes de 1958, n'allaient pas très bien avec l'image des Polonais pataugeant dans les égouts. Mais l'Europe réunie à cette soirée, bien "qu'à la pitié tardive", ne s'est pas pour autant montrée blasée. J'en ai tiré des conclusions et je suis resté en Pologne. Lorsque, sous l'occupation allemande, j'apprenais pendant des cours clandestins l'histoire de la Grèce antique, il m'était difficile de comprendre pourquoi les Grecs avaient placé le bannissement en tant que peine la plus sévère infligée à leurs concitoyens, juste après la peine de mort. En effet, quitter cet enfer que représentait la Pologne au temps de la guerre était le rêve de tout un chacun. « Dans les années soixante, je voyais déjà le problème de manière différente. Un écrivain vivant à l'étranger peut créer dans sa langue maternelle des oeuvres qui seront peut-être publiées des années plus tard et qui occuperont la place qui leur est due dans la littérature de son pays d'origine. Un cinéaste ne peut travailler que lorsqu'il aura trouvé des moyens et des hommes têts à relever avec lui le risque de la réalisation d'un film.
« A l'époque, j'ignorais que toutes les hésitations et tous les doutes étaient encore devant moi et j'ai profité de ce que le monde occidental voulait savoir ce qui se passait au-delà du mur de Berlin et qu'il percevait avec un réel intérêt tous les signaux contenus dans nos films, réalisés de l'autre côté du mur. « Pourtant, mon travail à Paris sur le film Danton, en 1982, et cette grande récompense que fut pour moi la réception de la Légion d'honneur m'ont bien fait réfléchir sur cette éventualité : la "douce France" ne pouvait-elle pas devenir pour moi, comme pour tant d'autres Polonais, une seconde mère ? Ce n'est que plus tard que j'ai compris pourquoi cela ne s'était pas fait. « L'exil est moralement suspect, car il rompt la solidarité avec le groupe. Petit à petit, j'ai acquis la conscience qui, comme le dit Hamlet, "fait de nous des lâches". J'ai eu peur de cette solitude et je n'ai pas pu étouffer en moi cette peur. C'est alors que j'ai compris la cruauté de la peine de bannissement dans l'antique Athènes.
« Il est vrai que j'avais pour ma défense mes deux films qui montraient comment naît la résistance ouvrière dirigée contre le pouvoir "ouvrier", films que personne d'autre que moi n'aurait pu réaliser de ce côté du mur L'Homme de marbre et L'Homme de fer, primé par la Palme d'Or à Cannes. Mais est-ce que cela pourrait suffire et, sinon, que restait-il à faire ?
« Et je n'avais toujours pas de bonne réponse à la question : pourquoi n'ai-je pas cherché pour moi une place dans le monde libre ?
« La réponse à une autre question s'est révélée, elle, inéluctable. Si j'ai pu échapper à la peine de bannissement, c'est que, peut-être, je ne l'ai pas méritée !
« Il ne me reste donc qu'à rechercher une justification. J'ai vécu une époque qui n'a laissé personne dans l'indifférence et qui réclamait à chacun une réponse : oui, oui- non, non ! Je n'ai pas donné de réponse claire. Est-ce bien étonnant ? J'ai eu peur de l'image d'un exilé par laquelle Czeslaw Milosz commence ses Notes de l'exil :
« Il était conscient de sa mission et des gens attendaient ses paroles, mais on lui a interdit de parler. Là où il habite à présent, il est libre de parler, mais personne ne l'écoute et, qui plus est, il a oublié ce qu'il avait à dire. »
« Que cette citation du grand poète soit ma justification. »
« Andrzej Wajda. » (Applaudissements.)
M. Jean-Pierre Elkabbach. Denis Podalydès, je vous remercie d'avoir lu le message d'Andrzej Wajda. Vous avez été emporté par la dynamique du texte et nous avons pu voir combien chacun de ces exilés porte en lui le besoin à la fois de s'expliquer et de dire ce qu'il a vécu, ce qu'il a souffert.
Monsieur le président de la République de Lituanie, je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation du président Christian Poncelet et, par là même, du Sénat.
La Lituanie est l'un des trois États baltes qui a souffert des dictatures du XX e siècle.
Elle s'en est libérée et s'invente un avenir.
Monsieur Valdas Adamkus, pour vous, est-ce que tolérer c'est pardonner ?
M. Valdas Adamkus, président de la République de Lituanie. 1 ( * ) Monsieur le président, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à ce colloque, qui rend hommage à l'un des fils les plus illustres de la France.
Au XIX e siècle, Victor Hugo a évoqué des principes, des idées, qui sont très fortes et toujours d'actualité, à savoir la tolérance, l'humanisme et l'égalité sociale.
Mon pays et moi-même nous sommes retrouvés dans une situation qui a été en quelque sorte, celle de Victor Hugo en son temps : c'est le totalitarisme qui a mis des barrières sur notre chemin.
Lorsque nous parlons de tolérance, tout semble très clair. Mais, lorsque nous sommes confrontés au problème de la violation des droits de l'homme, nous nous rendons compte que nous devons lutter contre ces violations jusqu'au bout.
Près de 100 000 de mes compatriotes ont fait le choix de la lutte ; c'est la raison pour laquelle nous avons été amenés à vivre pendant presque cinquante ans en dehors de notre pays, en exil.
Nous avons entendu le message de Victor o, d'après qui il fallait lutter pour ses idéaux jusqu'à la Hugo. C'est ce que nous avons fait, et finalement nos efforts ont été couronnés de succès. Nous avons remporté la victoire !.
M. Jean-Pierre Elkabbach. Il est bien de reconnaître qu'il y a des Lituaniens qui ont combattu et qui ont souffert. Comme toujours dans ces pays, on a tendance à oublier ceux qui ont été parfois complices ou complaisants à l'égard de ceux qui les ont occupés ou dominés.
Comme le président de la République de Lituanie, le président du Sénat et le ministre de la jeunesse l'ont dit tout à l'heure, il ne faut pas oublier que la tolérance est un combat.
Maintenant Mme Nada Strancar va nous lire un texte de Victor Hugo.
Madame, vous êtes assise à la place du sénateur Victor Hugo. Je suis sûr qu'il aurait apprécié votre participation, pas seulement parce que vous êtes une femme, pas seulement parce que vous êtes une impressionnante comédienne, mais avant tout parce qu'il défendait toutes les grandes causes, notamment la tolérance, en se référant parfois à Montaigne, à Pascal, à Voltaire.
Mme Nada Strancar. « À Toulouse, le 13 octobre 1761, on trouve dans la salle basse d'une maison un jeune homme pendu. La foule s'ameute, le clergé fulmine, la magistrature informe. C'est un suicide, on en fait un assassinat. Dans quel intérêt ? Dans l'intérêt de la religion. Et qui accuse-t-on ? Le père. C'est un huguenot, et il a voulu empêcher son fils de se faire catholique. Il y a monstruosité morale et impossibilité matérielle ; n'importe ! ce père a tué son fils, ce vieillard a pendu ce jeune homme. La justice travaille et voici le dénouement. Le 9 mars 1762, un homme en cheveux blancs, Jean Calas, est amené sur une place publique, on le met nu, on l'étend sur une roue, les membres liés en porte-à-faux, la tête pendante. Trois hommes sont là sur l'échafaud, un capitoul nommé David chargé de soigner le supplicié, un prêtre, qui tient un crucifix, et le bourreau, une barre de fer à la main. Le patient, stupéfait et terrible, ne regarde pas le prêtre et regarde le bourreau. Le bourreau lève la barre de fer et lui brise le bras. Le patient hurle et s'évanouit. Le capitoul s'empresse, on fait respirer des sels au condamné, il revient à la vie ; alors, nouveau coup de barre, nouveau hurlement ; Calas perd connaissance ; on le ranime, et le bourreau recommence ; et comme chaque membre, devant être rompu en deux endroits, reçoit deux coups, cela fait huit supplices. Après le huitième évanouissement, le prêtre lui offre le crucifix à baiser, Calas détourne la tête, et le bourreau lui donne le coup de grâce, c'est-à-dire lui écrase la poitrine avec le gros bout de la barre de fer. Ainsi expira Jean Calas. Cela dura deux heures. Après sa mort, l'évidence du suicide apparut. Mais un assassinat avait été commis. Par qui ? Par les juges.
« Alors, ô Voltaire, tu poussas un cri d'horreur, et ce sera ta gloire éternelle ! « Alors tu commenças l'épouvantable procès du passé, tu plaidas contre les tyrans et les monstres la cause du genre humain, et tu la gagnas. Grand homme, sois à jamais béni !
« Messieurs, les choses affreuses que je viens de rappeler s'accomplissaient au milieu d'une société polie ; la vie était gaie et légère (...), la cour était pleine de fêtes, Versailles rayonnait, Paris ignorait
« En présence de cette société frivole et lugubre, Voltaire, seul, ayant là sous ses yeux toutes les forces réunies, (...) Voltaire, seul, je le répète, déclara la guerre à cette coalition de toutes les iniquités sociales, à ce monde énorme et terrible, et il accepta la bataille. Et quelle était son arme ? Celle qui a la légèreté du vent et la puissance de la foudre. Une plume.
« Avec cette arme il a combattu, avec cette arme il a vaincu.
« Voltaire a vaincu (...). Il a vaincu la violence par le sourire, le despotisme par le sarcasme, l'infaillibilité par l'ironie, l'opiniâtreté par la persévérance, l'ignorance par la vérité.
« Je viens de prononcer ce mot, le sourire, je m'y arrête. Le sourire, c'est Voltaire (...). Ah ! soyons émus de ce sourire. Il a eu des clartés d'aurore. Il a illuminé le vrai, le juste, le bon (...). Étant lumineux, il a été fécond. La société nouvelle, le désir d'égalité et de concession et ce commencement de fraternité qui s'appelle la tolérance, la raison, reconnue loi suprême (...), l'harmonie, la paix, voilà ce qui est sorti de ce grand sourire (...).
« A Voltaire, un cycle nouveau commence. On sent que désormais la suprême puissance gouvernante du genre humain sera la pensée (...). Plus d'autre souveraineté que la loi pour le peuple et la conscience pour l'individu. Pour chacun de nous, les deux aspects du progrès se dégagent nettement, et les voici : exercer son droit, c'est-à-dire, être un homme ; accomplir son devoir, c'est-à-dire, être un citoyen. » (Vifs applaudissements.)
M. Jean-Pierre Elkabbach. On le voit bien, ce sont toujours des textes forts. D'une certaine manière, Victor Hugo est présent dans cet hémicycle grâce à Jacques Seebacher, qui fait partie des quelques hugoliens français ayant aidé à faire connaître Victor Hugo.
Monsieur Seebacher, Victor Hugo aurait-il aimé ce cortège d'hommages qui lui sont rendus ou bien en aurait-il été agacé ?
M. Jacques Seebacher. Victor Hugo aimait les hommages quand ils étaient mérités, comme cet hommage à Voltaire que nous venons d'entendre. Il aimait les hommages quand ils étaient sincères et quand ils venaient de l'intelligence aussi bien que du coeur.
Il ne détestait pas le public, qui est déjà une forme érigée de la foule, une forme presque accomplie du peuple, la responsabilité du public venant s'ajouter à sa représentativité.
M. Jean-Pierre Elkabbach. Je me permets de saluer M. Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha, qui est Premier ministre de Bulgarie.
Nous vous souhaitons la bienvenue en France, où vous avez rencontré le Président de la République, le président du Sénat et le premier ministre.
La France vous accueille avec plaisir, en attendant l'entrée prochaine de votre pays au sein de l'Europe élargie, selon le calendrier qui est en préparation.
A présent, cinq élèves de différents lycées et collèges vont, à tour de rôle, poser une question au nom des commissions qui ont travaillé ici sous la présidence de sénateurs : Mmes Marie-Claude Beaudeau, Hélène Luc, Monique Papon, MM. Jean Arthuis, Robert Del Picchia, Roger Lagorsse et Georges Mouly.
QUESTION A MME FRANÇOISE RIVIERE,
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE DE L'UNESCO
M. Jean-Pierre Elkabbach. La parole est à M. Alexandre Schulteiss, qui est en classe de quatrième au collège Victor-Hugo de Carmaux dans le Tarn.
M. Alexandre Schulteiss. Ma question s'adresse à Mme Françoise Rivière, directrice générale adjointe de l'UNESCO.
Quelles sont les actions concrètes menées par l'UNESCO contre la prostitution des enfants ? Ces mesures concernent-elles à la fois les pays pauvres et les pays riches ?
M. Jean-Pierre Elkabbach. La parole est à Mme Françoise Rivière.
Mme Françoise Rivière, directrice générale adjointe de l'UNESCO. Je vais reprendre une des remarques qui ont été faites, en introduction, par M. Elkabbach. Il est vrai que, à la différence des gouvernements nationaux, l'UNESCO, pas plus que les autres institutions du système des Nations unies, n'a d'armée, de tribunaux, de police ou de prisons pour faire respecter la loi.
Cela ne, veut pas dire que nos nations ne peuvent pas élaborer de lois. Elles peuvent faire des déclarations - on en a parlé tout à l'heure - et même plus, des conventions qui., lorsqu'elles sont signées par les États, ont force de loi.
Cela dit, quand les États ne les appliquent pas, il est difficile de faire autre chose que de les dénoncer, à travers des rapports, des statistiques. Cela a parfois beaucoup d'effet, notamment dans un domaine dont s'occupe particulièrement l'UNESCO - je veux parler de l'éducation.
Récemment, nous avons publié un rapport sur les efforts faits par les gouvernements depuis un certain nombre d'années pour aller vers ce que l'on appelle « l'éducation pour tous », qui comprend, notamment, l'enseignement primaire, universel et obligatoire...
M. Jean-Pierre Elkabbach. Ce sont les principes, madame Rivière. Mais ce que veulent savoir les élevés, c'est s'il existe, au sein de l'UNESCO, des pays qui ne respectent rien ou qui sont complices de ceux qui ne respectent rien et que tout le monde tolère.
Mme Françoise Rivière, directrice générale adjointe de l'UNESCO. Bien sûr qu'il en existe ! Surtout que l'UNESCO regroupe presque tous les pays du monde. Mais cette institution ne peut pas exclure les pays qui ne respectent pas les lois qu'ils ont signées !
M. Jean-Pierre Elkabbach. C'est dommage !
Mme Françoise Rivière, directrice générale adjointe de l'UNESCO. En revanche, il y a la force de la parole, dont on nous a dit tout à l'heure qu'elle pouvait être importante.
J'en reviens à la question qui m'a été posée sur la prostitution des enfants. L'UNESCO ne s'occupe pas spécifiquement de ce domaine. C'est l'UNICEF qui en est plus particulièrement chargée et qui d'ailleurs a publié la fameuse Déclaration des droits de l'enfant, proscrivant notamment la prostitution des enfants. Nous pouvons, en revanche, nous attaquer aux causes de cette prostitution. En effet, le travail ou la prostitution des enfants sont liés au fait que des enfants sont dans la rue. Ils sont alors obligés de trouver les moyens de survivre et c'est pour cela qu'ils ne sont pas à l'école. L'objectif de l'UNESCO est de faire en sorte qu'ils y retournent. Mais, pour y parvenir, des lois ou la police ne suffisent pas ! Il faut essayer de réinsérer progressivement ces enfants en leur offrant, d'abord, non pas de l'éducation, mais un moyen de survie. A cet égard, nous avons un programme appelé « le programme des enfants de la rue », qui se développe assez rapidement dans le monde entier, y compris dans les pays développés.
Permettez-moi de vous citer le très bel exemple de « L'orchestre aux pieds nus », au Brésil, qui vient d'ailleurs de faire l'objet de l'émission de télévision « Faut pas rêver ». C'est l'histoire d'une personne qui, elle aussi, vient de la rue. N'ayant pas de nom, elle a décidé de s'appeler Mozart. Elle a regroupé les enfants chez qui elle avait détecté un goût pour la musique et qui ont accepté de la suivre pour leur apprendre un instrument et leur apporter un peu d'éducation. Peu à peu, ils ont formé un orchestre qui a acquis une certaine réputation.
M. Jean-Pierre Elkabbach. Madame Rivière, nous souhaitons à M. Lula de créer de très nombreux orchestres comme celui que vous venez de citer et de favoriser tous les Mozart du Brésil, de l'Argentine, de l'Amérique latine, de l'Afrique ! Vous parliez de la force de la parole. Je n'irai pas qu'à vous demander de nommer les pays proxénètes. Cela vous serait d'ailleurs peut-être difficile !
Mme Françoise Rivière, directrice générale adjointe de l'UNESCO. Ce n'est pas le rôle de l'UNESCO ! En revanche, nous montrons du doigt les pays qui ne remplissent pas leurs engagements par rapport à l'éducation, car c'est le domaine de l'UNESCO, en espérant que cela aura un certain effet. C'est d'ailleurs souvent le cas. je pourrais vous citer beaucoup d'exemples.
QUESTIONS À M. JORGE SEMPRUN
M. Jean-Pierre Elkabbach. La parole est à Mlle Marine Rocton, qui est en classe de troisième au collège Victor-Hugo du Donjon dans l'Allier.
Mlle Marine Rocton. Ma question s'adresse à M. Jorge Semprun.
Après votre exil, considérez-vous certains de vos ouvrages comme une thérapie personnelle ?
M. Jorge Semprun. Sur un plan personnel, je ne crois pas être très représentatif, car je ne me sens pas exilé. Mon exil à moi est un exil collectif. En effet, je suis solidaire de l'exil républicain espagnol qui mériterait toute une séance pour rappeler l'histoire, les engagements et la souffrance liés à cet extraordinaire renversement de l'histoire qui a contribué à rétablir en Espagne la monarchie parlementaire. La monarchie était, en Espagne, la meilleure façon de rétablir la res publica, c'est-à-dire l'intérêt général et la chose publique. C'est un aparté politique, en quelque sorte. Je ne suis donc pas un très bon exemple pour parler de thérapie personnelle d'exil. A partir du moment où je m'exprime dans la langue du pays qui m'a accueilli, la France, sans trop de difficultés (Sourires), où je peux même l'écrire (Nouveaux sourires), où je suis membre d'une académie, l'Académie Goncourt, qui a modifié ses statuts pour qu'un écrivain de langue française puisse en être membre, je ne me sens pas exilé !
Dans une ville où il y a un fleuve, des bibliothèques et des cafés, je suis chez moi, ou alors je ne suis chez moi nulle part, parce que le sentiment d'étrangeté au monde est d'ordre métaphysique.
Je n'ai donc aucune thérapie personnelle de l'exil, sinon la thérapie collective de l'exil des Espagnols républicains, dont je fais partie et pour qui j'ai peut-être encore des livres à écrire.
M. Jean-Pierre Elkabbach. La question portait sur certains de vos ouvrages comme thérapie personnelle.
M. Jorge Semprun. Pas de l'exil !
M. Jean-Pierre Elkabbach. Marine Rocton, vous avez la parole pour poser votre deuxième question.
Mlle Marine Rocton. Avec ce que vous avez vécu et vu au camp de Buchenwald et après avoir été exclu pendant si longtemps de votre pays d'origine, pensez-vous que l'on puisse encore être tolérant ?
M. Jorge Semprun. Je pense qu'il faut être d'autant plus tolérant !
L'expérience des camps, l'expérience de l'exil vous poussent à la tolérance, mais à la tolérance dont ont déjà parlé certains des intervenants, notamment le ministre, le philosophe, mon ami, Luc Ferry.
Il est évident que la tolérance est un combat, car elle ne s'établit que contre l'intolérance. Depuis un certain temps, nous avons eu l'occasion plus de lutter contre l'intolérance que de nous laisser aller à la tolérance, comme si c'était quelque chose de facile.
Pour moi, la tolérance et l'intolérance peuvent s'inscrire autour du thème de l'oubli et du pardon, qui a fait l'objet de débats et dont les philosophes ont beaucoup parlé.
L'oubli fait partie des thérapies de la démocratie, depuis la Grèce et Athènes jusqu'à l'édit de Nantes. Souvenez-vous du premier article de l'édit de Nantes, écrit dans un français admirable, qui interdisait de rappeler les troubles du passé, postulait l'oubli comme thérapie collective pour effacer l'impact des guerres de Religion. L'oubli peut donc jouer un rôle et il est parfois nécessaire, mais il faut surtout savoir pardonner. Ce n'est que sur le thème de l'oubli et du pardon que l'on peut construire une tolérance collective qui soit une lutte contre l'intolérance.
M. Jean-Pierre Elkabbach. Vos propos doivent toucher Marine Rocton, qui vient d'un département, l'Allier, où l'on sait ce qu'est la proscription. Je lui demande de nous en parler.
Mlle Marine Rocton. Deux des anciens habitants de notre commune, Le Donjon, sont partis en exil avec Victor Hugo et étaient donc également proscrits. Nous savons donc un peu ce que c'est, d'autant que nous en avons beaucoup entendu parler ces derniers temps au moment de la préparation de ce concours.
M. Jean-Pierre Elkabbach. Vous savez penser à eux et leur rendre hommage, chaque fois qu'il le faut.
QUESTION À M. SIMEON DE SAXE-COBOURG-GOTHA,
PREMIER MINISTRE DE BULGARIE
M. Jean-Pierre Elkabbach. La parole est à M. Guillaume Dechriste, qui est en classe de troisième au collège Victor-Hugo de Colmar, dans le Bas-Rhin.
M. Guillaume Dechriste. Ma question s'adresse à M. Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha.
Quelle compréhension des événements a-t-on et qu'éprouve-t-on lorsqu'on est roi à six ans et exilé à dix ans ?
Quels souvenirs de cette époque conservez-vous ?
M. Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha, Premier ministre de Bulgarie. Il faut être tout à fait franc et ne pas prétendre qu'un enfant de cet âge-là a une compréhension profonde des événements. Dans mon cas, j'ai éprouvé de la peur, car quelque chose n'allait pas chez les adultes, et du chagrin, parce que plusieurs personnes de mon entourage avaient été exécutées. On avait même reçu les condoléances des personnes qui avaient mené ces exécutions à leur terme. Des gens que je voyais tous les matins ne paraissaient plus et je savais qu'ils avaient été exécutés.
Je ressentais de la peur, de l'inquiétude. C'est le souvenir que l'on garde parce que cela vous marque. Je tiens à dire de tout coeur un grand bravo - c'est prétentieux, au regard de la qualité intellectuelle de la personne - à M. Jorge Semprun, parce qu'il faut se rappeler, mais il faut certainement pardonner.
M. Jean-Pierre Elkabbach. Vous êtes d'accord avec lui pour dire que l'oubli, c'est aussi une valeur collective. Mais il faut savoir pardonner !
M. Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha, Premier ministre de Bulgarie. Il faut savoir, en quelque sorte, discerner qu'entre l'oubli et le pardon il y a aussi le degré de tolérance.
M. Jean-Pierre Elkabbach. Dans votre pays, il y a eu tellement de souffrances ! C'est aussi un problème d'actualité ! Peut-être faut-il avoir la capacité de tourner la page.
M. Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha, Premier ministre de Bulgarie. C'est sans doute important pour construire l'avenir. Il ne faut pas regarder tout le temps en arrière. Il faut peut-être, à la rigueur, regarder dans le rétroviseur pour mieux conduire en avant! (Applaudissements.)
QUESTIONS À M. LUC FERRY, MINISTRE DE LA JEUNESSE,
DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
M. Jean-Pierre Elkabbach. La parole est à Mlle Pauline Berthelot, qui est en classe de terminale au lycée Victor-Hugo de Poitiers, dans la Vienne.
Mlle Pauline Berthelot. Ma question s'adresse à M. Luc Ferry. Monsieur le ministre, pour le respect de la tolérance dans les établissements scolaires, serait-il possible de mettre en place une journée d'entraide et de service entre les élèves et d'étendre cette expérience aux hôpitaux, aux prisons et aux associations ?
M. Luc Ferry, ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche. Tout à fait ! C'est même une idée que je vous volerai volontiers. On mettra cela en place prochainement sous un nom un peu différent : on va parler de « journée de l'engagement », en particulier de l'engagement des jeunes à l'égard des autres, parce que j'ai 1a conviction que, aujourd'hui, les jeunes en ont assez d'être assimilés à l'image que l'on donne souvent d'eux à la télévision : des sauvageons, des casseurs, des auteurs d'incivilité, de violence. Or beaucoup d'entre vous ont justement la volonté de s'engager dans des actions d'utilité publique, qui, à la fois, donnent du sens à ce que vous entreprenez et qui sont utiles pour les autres. J'aimerais donc organiser, au mois d'avril prochain, une journée de l'engagement, qui ressemblera beaucoup à ce que vous venez de décrire.
M. Jean-Pierre Elkabbach. Concrètement, comment imaginez-vous cette journée, monsieur le ministre ?
M. Luc Ferry, ministre. Nous proposerons aux jeunes un petit guide des engagements dans lequel figureront 10 000 propositions pour s'engager dans des domaines différents : premièrement, dans le domaine de l'aide à apporter à autrui, par exemple, dans le secteur humanitaire ou caritatif; deuxièmement, dans le domaine de la culture, par exemple, la création d'un événement culturel ; troisièmement, dans le domaine du civisme ; quatrièmement, dans le domaine de la création d'entreprise.
Nous allons donc proposer, au printemps prochain, 10 000 projets d'engagement aux jeunes de notre pays, parce que j'ai la conviction qu'ils ont envie d'être reconnus dans la cité pour leur utilité aux autres et certainement pas d'être stigmatisés, comme c'est si souvent le cas, à la télévision en particulier, comme fauteurs de troubles et sauvageons de tous ordres, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité de la jeunesse d'aujourd'hui.
M. Jean-Pierre Elkabbach. Une journée de l'engagement aura donc lieu au printemps prochain !
M. Luc Ferry, ministre. Exactement !
M. Jean-Pierre Elkabbach. C'est bien de l'avoir annoncé ici, devant les élèves des collèges et des lycées. Pauline Berthelot, vous avez la parole pour poser votre deuxième question.
Mlle Pauline Berthelot. Monsieur le ministre, comment peut-on, dans le même temps, diminuer les budgets de la recherche et de l'enseignement (Sourires) et augmenter celui de l'armement ? (Applaudissements.)
M. Jean-Pierre Elkabbach. Pauline Berthelot, aucun politique ne vous a soufflé la question ? (Sourires.)
M. Luc Ferry, ministre. Je propose que, la prochaine fois, Pauline siège du côté gauche de l'hémicycle. Ce sera plus clair ! (Sourires.)
Je ne sais pas qui vous a raconté que le budget de la recherche diminuait : il continue d'augmenter, il faut que vous le sachiez, mais moins que nous ne l'aurions souhaité. Par ailleurs, le Gouvernement accomplit un effort important en ce qui concerne l'équipement des armées.
Évidemment, lorsqu'on parle de l'équipement des armées et que l'on dit que le Président de la République a décidé de faire construire un autre porte-avions, souvent, ce n'est pas très populaire chez les jeunes comme vous. Vous considérez que construire un porte-avions, des canons, des équipements destinés à frapper, à tuer, ce n'est pas très gentil ; on ferait mieux de bâtir des hôpitaux, des écoles, etc. Mais il faut voir un peu plus loin. Il faut savoir que l'armée peut servir à attaquer : ce n'est pas bien, nous en sommes tous d'accord ! Elle peut servir à se défendre vous pourriez dire qu'aujourd'hui on n'est pas menacé. Mais l'armée peut aussi servir à protéger les autres. Rappelez-vous la guerre qui a eu lieu dans les Balkans et qui a provoqué des centaines de milliers de morts. Trouvez-vous normal que ce soient les Américains qui, pour l'essentiel, soient intervenus, afin d'empêcher des Européens de se battre entre eux, et que les Européens ne soient pas capables d'envoyer des armées pour se protéger les uns des autres ?
Il faut être idéaliste, mais au bon sens du terme. Il faut imaginer que, si l'on n'a pas une armée forte, on ne pourra pas protéger ces gens qui se font la guerre entre eux. Et à moins d'imaginer qu'il n'y ait plus de guerre dans le monde - malheureusement, il y en a et tout près de chez nous - nous avons besoin d'une armée, ne serait-ce que pour assurer ces missions d'intervention presque humanitaires, qui supposent malgré tout que l'on ait assez de force pour empêcher les gens de se battre entre eux. L'armée peut aussi servir à cela !
C'est l'un des grands paradoxes du monde contemporain : l'armée peut remplir des fonctions humanitaires. Par conséquent, il faut dire, sans démagogie, que l'on a aussi besoin, malheureusement, d'avions et de porte-avions.
M. Jean-Pierre Elkabbach. Peut-être l'insécurité extérieure est-elle toujours présente ?...
M. Luc Ferry, ministre. En plus ! Mais j'essayais de plaider le dossier avec les meilleurs arguments. (Applaudissements.)
QUESTIONS À M. VALDAS ADAMKUS,
PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE
M. Jean-Pierre Elkabbach. La parole est à Mlle Laurie Gleizes, qui est en classe de troisième au collège Victor-Hugo de Lavelanet, dans l'Ariège.
Mlle Laurie Gleizes. Ma question s'adresse à M. Valdas Adamkus. Pourquoi avez-vous été exilé ?
M. Valdas Adamkus, président de la République de Lituanie 2 ( * ) . En ce qui concerne mon exil, je dirais que personne ne choisit la voie de l'exil de sa propre volonté.
Mon pays a été occupé par une puissance étrangère. Les droits de l'homme ont été bafoués, l'humanisme a été bafoué. Il n'était plus possible de réfléchir librement, de parler librement, de vivre librement. A ce moment-là, nous nous sommes posé la question de savoir s'il était possible de tolérer cette situation et, dans ce contexte, j'ai choisi la voie de l'exil, la voie de la résistance. C'est ce qui m'a amené à vivre pendant une longue période hors d e mon pays.
J'ai choisi un environnement qui était propice à la tolérance, et cela pour pouvoir grandir, pour pouvoir mûrir, afin de m'exprimer et réfléchir librement, être libre, et ensuite partager cette liberté avec les autres.
J'ajouterai que, dans mon esprit, la tolérance est intimement liée à une dimension éthique, à un choix spirituel, à partir duquel nous comprenons et nous pouvons agir avec discernement, en sachant ce qui est bon et ce qui est mauvais.
Je crois que si nous optons pour cette dimension morale, et si elle se traduit dans les faits, le monde d'aujourd'hui pourra avoir un autre visage.
Tout cela, je l'ai appris dans une société libre et ouverte. Malheureusement, cela s'est passé en dehors de mon pays natal. J'espère que je pourrai transmettre tout ce que j'ai appris là-bas aux jeunes générations en Lituanie. (Applaudissements).
M. Jean-Pierre Elkabbach. Laurie Gleizes, vous avez la parole pour poser votre deuxième question.
Mlle Laurie Gleizes. Pour votre pays, la Lituanie, qu'attendez-vous de la France et de l'Union européenne ?
M. Valdas Adamkus, président de la République de Lituanie 3 ( * ) . Nous allons vers l'Europe pour coopérer, pour travailler ensemble, avec la France comme avec Union européenne.
Notre intégration a avant tout pour objet d'offrir à la Lituanie une possibilité de participer à une aventure commune : la création d'un environnement favorable au développement de tous. (Applaudissements.)
QUESTIONS À M. CHRISTIAN PONCELET, PRÉSIDENT DU SENAT
M. Jean-Pierre Elkabbach. La parole est à Gwenaelle Valot, qui est en classe de troisième au collège Victor-Hugo de Lugny, en Saône-et-Loire.
Mlle Gwenaelle Valot. Monsieur le président, quelles mesures le Sénat pourrait-il contribuer à prendre pour lutter contre la violence dans les établissements scolaires ?
M. Christian Poncelet, président du Sénat. Le Sénat, depuis fort longtemps, s'intéresse à la situation dans les établissements scolaires et, en particulier, à certains mouvements de violence qui peuvent s'y constater.
Nous avons constitué, au sein du Sénat, une commission d'enquête qui a consacré ses travaux notamment à ce problème ; de nombreuses sénatrices et de nombreux sénateurs y ont participé. Cette commission a rendu ses conclusions et publié un rapport dans lequel elle prône un certain nombre de mesures fondées sur la conviction que c'est dès la pré-scolarité qu'il faut apprendre à l'enfant, qui deviendra adulte, la tolérance.
En ce sens, je me félicite de ce que, depuis très longtemps, le Sénat se soit orienté vers la jeunesse, vers sa formation. Et si Victor Hugo a mis en exergue la tolérance et le respect de l'autre, après lui un autre éminent sénateur des Vosges - permettez-moi de le citer : Jules Ferry -, comprenant que l'école jouait un rôle essentiel dans la formation de l'homme, a voulu une école gratuite, laïque et obligatoire, une école de l'intelligence où l'on puisse tisser des relations humanistes, des relations fraternelles entre les uns et les autres, pour que chacun apprenne que, s'il ne partage pas l'idée de l'autre, il doit être en mesure de dire un jour, comme Voltaire : « Je ne partage pas vos idées, mais je suis prêt à me battre pour les défendre. »
Par conséquent, c'est dès l'école qu'il faut prendre certaines mesures, et je sais que ce rapport du Sénat a inspiré l'action du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, M. Luc Ferry, un nom éminent que l'on retrouve ici oeuvrant au bénéfice de la jeunesse. (Applaudissements.)
M. Jean-Pierre Elkabbach. Vous voyez que, dès que l'on parle de tolérance, ils s'échauffent tous ! (Sourires.) Il y a, dans nos échanges, tout à la fois de l'émotion et de la détermination.
Monsieur le président du Sénat, la loi peut-elle aider à favoriser la tolérance, la loi telle qu'elle peut aussi se fabriquer dans cette enceinte ?
M. Christian Poncelet, président du Sénat. Je l'ai indiqué, la tolérance consiste à ne pas accepter certaines attitudes qui sont intolérables ; par conséquent, il y a un compromis à trouver. Il est vrai que, pour ce faire, il ne faut pas que nous hésitions à sanctionner ce qui est intolérable. Le racisme, l'antisémitisme sont intolérables, et il ne peut pas y avoir de tolérance à l'égard d'attitudes de ce type. Il faut sanctionner, cela m'apparaît indispensable, et nous y veillons au travers de la loi.
M. Jean-Pierre Elkabbach. Gwenaëlle Valot, vous avez la parole pour poser votre deuxième question.
Mlle Gwenaëlle Valot. Monsieur le président, comment le Sénat peut-il aider les pays étrangers à mettre en place des institutions démocratiques ?
M. Christian Poncelet, président du Sénat. Il existe, au sein du Sénat, des groupes d'amitié, un groupe d'amitié entre la France et la Lituanie, entre la France et la Bulgarie, par exemple. Ces groupes d'amitié procèdent, avec l'intervention du Sénat in globo, en son entier, à des échanges, c'est-à-dire que des sénateurs français vont dans ces pays et, à l'inverse, des sénateurs de ces pays viennent en France, ce qui nous donne l'occasion de recevoir, bien souvent, des élus étrangers : ils viennent se familiariser avec la démocratie, avec nos méthodes de travail, voir comment nous nous efforçons de respecter au maximum, dans notre procédure législative, la compréhension, le respect de l'autre, l'ouverture aux idées d'autrui. Je me félicite de ce que le Sénat, par exemple, soit allé en Géorgie pour installer, avec le concours de sénateurs français, le Parlement géorgien. Ce Parlement se mettait en place et la Géorgie voulait, à l'image de la France, avoir un Parlement démocratique, composé, bien sûr, de deux assemblées, l'une qui est, en quelque sorte, l'Assemblée nationale française, l'autre, le Sénat français, dont le rôle, comme vous le savez, est de regarder si l'Assemblée nationale travaille bien (Sourires), si le Gouvernement travaille bien (Nouveaux sourires), et de jouer un rôle de contre- pouvoir, même si le Gouvernement n'aime pas cela ! Par conséquent, beaucoup de pays sollicitent le Sénat français pour aller introduire chez eux la démarche française, une démarche qui doit toujours se parfaire, d'ailleurs !
M. Jean-Pierre Elkabbach. A en juger aux éminentes personnalités étrangères présentes dans cet hémicycle, on voit qu'il y a vraiment ici une volonté d'ouverture. Gwenaelle Valot, vous avez la parole pour poser votre dernière question.
Mlle Gwenaëlle Valot. Monsieur le président, pourquoi n'y a-t-il pas de sénateurs de couleur ?
M. Christian Poncelet, président du Sénat. Je ne sais pas si vous êtes venue souvent au Sénat, mais, je peux vous rassurer, il y a des sénateurs de couleur.
M. Jean-Pierre Elkabbach. Gwenaëlle Valot voulait sans doute dire qu'il n'y a pas assez de sénateurs de couleur. Et ce n'est pas M. Poncelet qui les désigne ! (Sourires.)
M. Christian Poncelet, président du Sénat. Le Sénat est composé de représentants de toutes les collectivités territoriales. Il appartient à ces collectivités territoriales, de métropole et d'outre-mer, de désigner leurs sénateurs. C'est un scrutin très difficile, parce que vous ne verrez jamais, je vous dis cela au passage, de candidats sénateurs « parachutés » comme on peut avoir des députés « parachutés ». Pour être sénateur, il faut, bien sûr, connaître les gens et le terroir, comprendre leurs problèmes, pour bien les assimiler et être en mesure de répondre aux attentes. Nous avons des sénateurs de tous les territoires et de différentes couleurs, de différentes couleurs politiques, aussi, d'ailleurs ! (Rires.) C'est une assemblée extrêmement ouverte. Si vous venez un jour assister à une séance du Sénat, vous verrez qu'il y a des sénateurs de couleur qui siègent ici.
M. Jean-Pierre Elkabbach. Maintenant, Mme Nada Strancar va lire un poème de Victor Hugo, le proscrit, le pauvre, l'homme du droit et des libertés, qui s'est battu quoi que cela lui ait coûté.
Mme Nada Strancar. Voici quelques vers des Châtiments, écrits à Jersey, en décembre 1852 :
« Puisque le juste est dans l'abîme,
« Puisqu'on donne le sceptre au crime,
« Puisque tous les droits sont trahis,
« Puisque les plus fiers restent mornes,
« Puisqu'on affiche au coin des bornes
« Le déshonneur de mon pays ;
« O République de nos pères,
« Grand Panthéon plein de lumières,
« Dôme d'or dans le libre azur,
« Temple des ombres immortelles,
« Puisqu'on vient avec des échelles
« Coller l'empire sur ton mur ;
« Puisque toute âme est affaiblie,
« Puisqu'on rampe; puisqu'on oublie
« Le vrai, le pur, le grand, le beau,
« Les yeux indignés de l'histoire,
« L'honneur, la loi, le droit, la gloire,
« Et ceux qui sont dans le tombeau ;
« Je t'aime, exil ! douleur, je t'aime !
« Tristesse, sois mon diadème.
« Je t'aime, altière pauvreté !
« J'aime ma porte aux vents battue.
« J'aime le deuil, grave statue
« Qui vient s'asseoir à mon côté.
« J'aime le malheur qui m'éprouve ;
« Et cette ombre où je vous retrouve,
« O vous à qui mon coeur sourit,
« Dignité, foi, vertu voilée,
« Toi, liberté, fière exilée,
« Et toi, dévouement, grand proscrit ! » (Applaudissements.)
M. Jean-Pierre Elkabbach. Je m'adresse maintenant à M. le Premier ministre de Bulgarie, Son Excellence Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha. Vous est-il arrivé de dire, comme Victor Hugo, « J'aime l'exil » ? Dans ces années d'épreuve, quand vous et votre famille étiez seuls, au loin, pensiez-vous retrouver votre pays, votre trône, disons, le pouvoir ? Vous êtes-vous dit, comme Victor Hugo : quand la liberté rentrera, je rentrerai !
M. Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha, Premier ministre de Bulgarie. Oui, en quelque sorte, parce que je suis effectivement rentré quand la liberté est revenue. Je ne serais pas rentré autrement.
Aimer l'exil... J'ose dire que ce poème m'a paru sublime, mais que je ne partage pas sa teneur. J'ai eu la chance d'habiter l'Espagne : j'y ai ma maison, j'y ai fondé une famille; dans ce sens, je peux dire que j'aime ce pays, mais certainement pas associé à l'exil.
Quant à imaginer que je reviendrais en Bulgarie... Ce n'était d'ailleurs pas tant ce que je pouvais penser qui importait, car c'est évidemment toujours subjectif, mais il fallait observer, étudier la situation sur place. A l'époque, franchement - je pense partager cette opinion avec l'illustre criminologue - je ne croyais pas devoir jamais assister à l'implosion de l'empire soviétique. Je ne pouvais donc penser à un retour que dans les très rares moments où je me laissais aller à la fantaisie. Mais je suis affreusement terre à terre et pragmatique !
M. Jean-Pierre Elkabbach. La réalité a dépassé votre imagination : vous êtes rentré au pays, vous avez gagné, en 2001, les élections législatives et vous gouvernez aujourd'hui avec des responsabilités et une immense tâche devant vous, celle de transformer la Bulgarie, votre pays, qui a été longtemps sous le joug du grand voisin soviétique, en une démocratie libérale... par étapes.
M. Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha, Premier ministre de Bulgarie. Le but, c'est, en effet, de moderniser le pays. Vous parliez des élections et je reviens à la tolérance. Ce n'est pas l'exil qu'il faut souligner, mais bien la façon dont le peuple bulgare a accepté ces résultats électoraux. Certaines personnes n'éprouvent aucune sympathie envers moi ou envers ce que je représente pour ce que j'ai été dans une autre vie, si je puis dire. Pourtant, voilà que nous pouvons parfaitement tous penser au bien et à l'avenir du pays.
M. Jean-Pierre Elkabbach. L'élargissement de l'Europe devrait vous aider, comme le disait M. Valdas Adamkus tout à l'heure
M. Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha, Premier ministre de Bulgarie. Certainement. Plus nous nous intégrerons, plus nous aurons de garanties quant à la marche du pays vers la normalité et l'accès aux valeurs démocratiques communes.
M. Jean-Pierre Elkabbach. C'est important parce que, si j'ai bien lu, la Bulgarie compte 18 % de chômeurs, notamment des jeunes qui parfois émigrent et que l'on retrouve ici ou là en France. Le meilleur moyen, comme le disait Mme Rivière, de les maintenir dans le pays, c'est le développement, l'ouverture. C'est ce à quoi nous contribuons aujourd'hui ici.
M. Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha, Premier ministre de Bulgarie. Oui, il s'agit de créer les conditions pour que ces jeunes restent. C'est une lourde tâche, mais nous y travaillons très énergiquement.
QUESTIONS À M. FRANÇOIS CHENG
M. Jean-Pierre Elkabbach. La parole est à M. Hugo Saulnier, en classe de quatrième au collège Victor-Hugo de Nantes, en Loire-Atlantique.
M. Hugo Saulnier. Ma question s'adresse à M. François Cheng. Après nous avoir exposé les causes de votre exil, pourriez-vous nous dire si, à votre arrivée en France, vous avez rencontré des difficultés pour être intégré dans ce pays qui vous était presque inconnu ?
M. François Cheng. Je me sens assez démuni pour vous répondre. J'ai pris connaissance de ces questions en arrivant ici et, entre-temps, bien sûr, je me suis employé à écouter tous les autres orateurs, je n'ai donc pas eu le temps de réfléchir. Mais, en résumé, je préférerais répondre à votre troisième question. (Rires.) Pour les autres questions, ce sera plus difficile.
M. Jean-Pierre Elkabbach. Vous êtes comme Woody Allen, vous choisissez vos questions ! (Nouveaux rires.) M. François Cheng. Non, je vais répondre tout de même !
Vous me vieillissez beaucoup en me ramenant à ma jeunesse. Je suis arrivé en France en 1948. J'avais dix-neuf ans. La France sortait alors de la guerre. C'était donc un pays lui-même très démuni, mais qui commençait aussi à panser ses plaies et esquissait un mouvement ascensionnel vers le progrès. À cette époque-là, les difficultés étaient d'abord d'ordre matériel. Il était très difficile de trouver un travail régulier et rémunéré. Donc, j'ai connu près de dix ans de « galère ». J'ai eu aussi, bien sûr, des difficultés d'ordre linguistique, car je suis arrivé en France sans connaître un mot de français, dans des circonstances inattendues. Cependant, dans le même temps, la France connaissait une immense effervescence. C'était, bien sûr, la période de l'existentialisme, la pensée de Sartre et de Camus dominait. Donc, il y avait une sorte d'éveil de la jeunesse, on participait à des mouvements d'émancipation. Moi-même, en Chine, dès mes quinze ans, j'ai commencé à lire la littérature occidentale, grâce à des traductions. Quand je dis « occidentale », cela comprend bien sûr la littérature française, mais aussi les littératures anglaise, allemande et russe.
Donc, en dépit des difficultés matérielles et de la barrière de la langue, j'ai moi- même connu cette époque d'effervescence sur le plan personnel : tout m'était ouvert. En France, on pouvait suivre des cours, assister à des concerts, aller visiter les expositions. Voilà comment, très maladroitement, sans doute, je peux décrire cette époque.
M. Jean-Pierre Elkabbach. Ce n'est pas maladroit, c'est beau. Académicien, vous avez publié, chez Albin Michel, un roman intitulé L'Éternité n'est pas de trop. Beaucoup se demandent, ou pourraient se demander, pourquoi l'homme de la montagne qu'est l'auteur, ayant été témoin du bouillonnement intellectuel du XVII e siècle, l'époque des Ming, s'est consacré à un récit de passions amoureuses.
M. François Cheng. La vraie passion amoureuse a souvent été vécue à des époques de quête spirituelle. Pour ne citer que l'Occident, Abélard et Héloïse, Dante, les romantiques allemands vivaient de grandes époques où l'humanité était en quête. Ainsi, raconter la passion amoureuse, c'est aussi le moyen de décrire ces grandes époques.
M. Jean-Pierre Elkabbach. Vous le dites vous-même, au-delà de la passion amoureuse, de l'affaire du coeur ou des sens, cela relève aussi de l'esprit. Quand on rencontre des interlocuteurs qui viennent de loin, nous dites-vous, qui sont donc différents de nous, il faut du temps pour se comprendre. Vous terminez le prologue par ces mots : « Par-delà les paroles, il y a un regard, un sourire qui suffit pour que chacun s'ouvre au mystère de l'autre ».
M. François Cheng. Tout à l'heure, on a évoqué la tolérance. Or je n'utilise pas souvent ce mot, car je ne me contente pas de tolérer les autres, je les sollicite. Toute ma vie, finalement, est devenue une sorte de dialogue. En tant que personne ayant survécue à l'exil, qui s'est intégrée à son pays d'adoption, je suis devenu cet être habité à la fois par deux cultures et deux langues, et par le souci de faire dialoguer la meilleure part de chaque culture.
M. Jean-Pierre Elkabbach. Hugo Saulnier, vous avez la parole pour poser votre deuxième question.
M. Hugo Saulnier. Pensez-vous avoir rapproché les deux cultures en changeant votre prénom en François - qui se rapproche de français - et en gardant votre nom chinois ?
M. François Cheng. Mon nom est François Cheng, ce qui peut choquer au premier abord. D'aucuns peuvent même se demander si cela ne traduit pas un état de déchirement, voire de schizophrénie. Pas du tout ! Je cite une phrase de Teilhard de Chardin : « Tout ce qui monte converge ». Ce nom, à lui seul, résume la culture chinoise et la culture française qui montent en moi et qui, finalement, sont parvenues à cette synthèse.
Pour moi, toute culture est condamnée à mourir si elle s'enferme en elle-même.
La Chine connaît les bienfaits du dialogue. Vous évoquez le XVII e siècle. La Chine, ayant embrassé le bouddhisme venu de l'Inde, a connu les périodes d'épanouissement extraordinaire que sont la dynastie des Tang et des Song. Ensuite, toujours au XVII e siècle, des Jésuites sont venus en Chine.
L'Occident a, pour sa part, eu deux grandes sources, la culture grecque et la tradition judéo-chrétienne. Par la suite, il a aussi dialogué avec l'islam et avec d'autres cultures.
Peut-être le moment est-il venu, pour l'Europe occidentale, de dialoguer avec les pays d'Asie, en particulier avec la Chine. Je m'y suis personnellement employé.
Je voudrais dire que, aujourd'hui, je parle en tant que Français. Je suis Français et j'ai participé, à ma modeste manière, au destin de la France.
Tout à l'heure, un collégien a interrogé le président du Sénat sur la façon dont la France pouvait aider les autres pays dans le domaine de la démocratie et des droits de l'homme. La France doit d'abord s'efforcer de donner l'exemple. Pour moi, la France est ce pays multiethnique, multiconfessionnel, dont les habitants participent tous à une même culture.
Comment définir cette culture ? Ordinairement, on a de la culture une idée vague. En fait, la culture est un système organique qui permet à un très grand groupe d'hommes de vivre ensemble en lui proposant des lois fondamentales, des principes éthiques et, sans doute aussi, un idéal.
Or, pour ce qui concerne la France, la tâche est simple. La culture française est d'abord fondée sur la langue française. Ensuite, elle sait proposer un idéal. Aucune autre culture ne l'a formulé de manière aussi claire que la France, c'est-à-dire : « liberté, égalité, fraternité». Donc, le programme est là.
C'est à la France d'essayer d'incarner inlassablement cet idéal. Pour moi, pour un Chinois qui vient du Pays du milieu, la France est le « pays du milieu » de l'Europe occidentale. En raison de sa situation historique et géographique, elle a, depuis toujours, fait l'effort d'assimiler les influences venant de tous côtés et, en même temps, de tendre vers l'universel. C'est sa vocation. C'est en étant digne de sa vocation que la France aidera les autres pays à tendre vers la démocratie. (Applaudissements.)
M. Jean-Pierre Elkabbach. Nous sommes encore plus fiers d'être Français, mais vous nous donnez des tâches et des devoirs importants, François Cheng ! Je pense que Jorge Semprun est d'accord avec ce qu'il vient d'entendre.
M. Jorge Semprun. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Elkabbach. Maintenant, Mme Nada Strancar va lire un texte de Victor Hugo.
Mme Nada Strancar. « Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. Être libre, rien n'est plus grave ; la liberté est pesante, et toutes les chaînes qu'elle ôte au corps, elle les ajoute à la conscience; dans la conscience, le droit se retourne et devient devoir. Prenons garde à ce que nous faisons ; nous vivons dans des temps exigeants. Nous répondons à la fois de ce qui fut et de ce qui sera. Nous avons derrière nous ce qu'ont fait nos pères et devant nous ce que feront nos enfants. Or à nos pères nous devons compte de leur tradition et à nos enfants de leur itinéraire. [...] Il serait puéril de se dissimuler qu'un profond travail se fait dans les institutions humaines et que des transformations sociales se préparent. Tâchons que ces transformations soient calmes et s'accomplissent, dans ce qu'on appelle (à tort, selon moi) le haut et le bas de la société, avec un fraternel sentiment d'acceptation réciproque. Remplaçons les commotions par les concessions. C'est ainsi que la civilisation avance. Le progrès n'est autre chose que la révolution faite à l'amiable. « Donc, législateurs et citoyens, redoublons de sagesse, c'est-à-dire de bienveillance. Guérissons les blessures, éteignons les animosités ; en supprimant la haine nous supprimons la guerre ; [...] ôtons aux fureurs et aux colères une raison d'être ; ne laissons couver aucun ferment terrible. C'est déjà bien assez d'entrer dans l'inconnu ! Je suis de ceux qui espèrent dans cet inconnu, mais à la condition que nous y mêlerons dès à présent toute la quantité de pacification dont nous disposons. Agissons avec la bonté virile des forts. Songeons à ce qui est fait et à ce qui reste à faire. Tâchons d'arriver en pente douce là où nous devons arriver ; calmons les peuples par la paix, les hommes par la fraternité, les intérêts par l'équilibre ; n'oublions jamais que nous sommes responsables de cette dernière moitié du XIX e siècle, et que nous sommes placés entre ce grand passé, la révolution de France, et ce grand avenir, la révolution d'Europe. « Paris, juillet 1876. » (Applaudissements.)
M. Jean-Pierre Elkabbach. La parole est à M. Bachir Boumaza, ancien président du Conseil de la nation en Algérie, ami exigeant, très exigeant du président Bouteflika.
Vous avez connu, monsieur Boumaza, vingt-sept années de prison et d'exil à cause des Français et des dirigeants algériens. Vous avez été l'un des acteurs de l'indépendance de l'Algérie. Vous étiez, lorsqu'on a jeté des Algériens dans la Seine, un des responsables de la fédération FLN de Paris. Vous avez été ministre d'Ahmed Ben Bella, de Houari Boumediene. Lorsque vous n'étiez pas d'accord avec leur pouvoir personne, vous alliez le leur dire ; ils vous envoyaient alors en prison ou en exil et, comme vous l'avez raconté un jour à M. le président Poncelet et à moi-même, vous aviez toujours Victor Hugo avec vous.
M. Bachir Boumaza. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu à votre invitation. Avec mon ami le président du Sénat français, nous en avons souvent parlé, garantir l'avenir, c'est déjà préparer la jeunesse à cet avenir. Comme M. Poncelet le sait, j'ai eu le privilège d'être à l'initiative de telles rencontres entre les parlementaires et les jeunes d'Algérie.
Je l'ai fait, peut-être, par expérience. Mes biographes disent que j'ai commencé à lutter pour l'indépendance de l'Algérie à l'âge de quinze ans. Ces jeunes sont les adultes de demain et, travailler pour l'avenir, c'est déjà rallier cette jeunesse à certaines idées.
M. Jean-Pierre Elkabbach. Pourquoi Victor Hugo ?
M. Bachir Boumaza. Lorsque j'ai connu Victor Hugo, je ne savais pas que je serai un jour ministre ou sénateur, je l'ai connu pendant ma jeunesse, dans les écoles françaises, et je peux dire que je me suis nourri à certaines de ses sources. D'abord, j'ai admiré cet homme qui aimait son pays. Toutefois, il n'aimait pas son pays parce que c'était la France ; il l'aimait à sa façon. Permettez-moi de citer un autre de vos grands hommes, Michelet, qui déclarait, avec un certain excès, que les riches aiment la France comme leur maîtresse et les pauvres comme leur mère. Ce sont deux manières d'aimer la France. Les Misérables, avec ce regard sur les démunis, les déshérités, Notre-Dame de Paris et toute une série d'oeuvres m'ont fait aimer Victor Hugo.
Vous avez parlé de compagnonnage, j'ai été avec Ben Bella - peut-être auriez-vous dû commencer en citant Messali Hadj -, avec Boumediene. Vous avez évoqué mes exigences : je suis un homme très difficile. Je me suis moi-même demandé souvent comment j'étais resté d'accord avec cet homme, ce grand homme, cet homme-océan, alors que, souvent, je n'approuve pas sa manière de voir.
M. Jean-Pierre Elkabbach. Il faut dire qu'il ne vous a pas envoyé en prison, lui !
M. Bachir Boumaza. Non, mais je fais la même réponse que pour le général de Gaulle. Je suis un homme de sensibilité de gauche, mais j'ai un respect immense pour ce dernier, sans doute parce qu'il représente une certaine idée de la France.
J'ai une certaine idée de la France et je n'accepterai jamais que l'on puisse dire que je suis anti-français. Non ! j'ai lutté contre le système colonial français, mais je me suis souvent inspiré des valeurs françaises. Victor Hugo était l'un de ceux qui m'ont donné les armes pour me battre.
Monsieur Elkabbach, vous êtes également un grand ami. J'ai le privilège d'être l'un des derniers orateurs et j'ai pu entendre citer Teilhard de Chardin, qui est un chrétien ; or le musulman que je suis l'admire beaucoup.
J'ai entendu déclamer la belle page du Discours pour Voltaire de Victor Hugo.
Figurez-vous qu'au lendemain de mon retour en Algérie on a censuré certains de mes propos qui faisaient référence à Voltaire, un esprit libre comme Victor Hugo.
Nous sommes actuellement en période de ramadan, vous le savez. Dans cinq jours, nous allons commémorer une grande bataille militaire de l'islam naissant.
Je suis de ceux qui ont une lecture particulière de l'islam. A mes yeux, l'islam a triomphé non par les nombreuses batailles militaires qu'il a livrées, mais par une grande bataille d'idées, celle d'Hudaibiya : c'est elle qui a permis à Mahomet de rentrer à La Mecque et de vaincre les polythéistes. Je crois donc davantage à ce genre de combat.
Voltaire disait que, soixante ans après la mort de Louis XIV, on continuait de parler des grandes batailles qu'il avait remportées, mais que ces grandes batailles nous faisaient oublier ce qu'avaient été le Roi-Soleil et son règne : Versailles, les peintures de Poussin, les fables de La Fontaine, Boileau. C'est cela, le siècle de Louis XIV, et non le règne des destructeurs. Pour conclure, je voudrais dire que j'ai assisté, le mois dernier, dans une capitale arabe, à des débats sur Victor Hugo, qui portaient notamment sur Les Misérables.
Victor Hugo est votre meilleur ambassadeur, et c'est peut-être grâce à Victor Hugo que nous avons été des anticolonialistes, c'est-à-dire des partisans des droits de l'homme, mais jamais des anti-Français.
S'agissant de la tolérance et de l'intolérance, je poserai le problème différemment. Il faut se battre contre l'intolérance, l'intolérance est comme les mauvaises herbes vous pouvez avoir été victime de l'intolérance et devenir à votre tour intolérant. Je ne crois pas du tout que l'exil puisse guérir de l'intolérance.
Je me réjouis, encore une fois, d'avoir été invité à assister à cette rencontre de jeunes qui sont l'avenir de la France. (Applaudissements.)
M. Jean-Pierre Elkabbach. La parole est à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
M. Luc Ferry, ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche.
Ce que vient de dire M. Bachir Boumaza rejoint très directement ce qu'a dit tout à l'heure François Cheng sur le fait que la France a émis des idées qui peuvent aussi servir à la critiquer. C'est cela, l'universalité à laquelle vous faisiez très joliment allusion, monsieur Boumaza.
Je voudrais maintenant formuler une remarque à l'adresse des jeunes qui nous
écoutent.
J'ai commencé, un peu par provocation, par vous dire que la tolérance n'est pas forcément une notion merveilleuse ; elle peut aussi avoir des mauvais côtés. Pour être simple, je dirai qu'il faut être très tolérant à l'égard des idées, même quand elles vous déplaisent beaucoup, mais qu'il ne faut pas être tolérant du tout vis-à-vis de la violence. C'est le critère fondamental. Il faut que vous appreniez à être extrêmement vigilants à l'égard de la violence, notamment de la violence physique. Par ailleurs, un poème célèbre de Victor Hugo, Booz endormi, que tout le monde connaît plus ou moins par coeur, montre comment l'âge adulte peut être un âge formidable. Je voudrais que les enfants et les jeunes échappent à ce que les psychanalystes ont appelé le syndrome de Peter Pan, ce petit garçon qui ne veut pas vieillir et pense que devenir adulte est une catastrophe. Ce n'est pas vrai ! Le fait de grandir, de vieillir peut être absolument extraordinaire. Si vous lisez avec attention le très beau poème de Victor Hugo que j'ai évoqué, vous comprendrez pourquoi. (Applaudissements.)
M. Jean-Pierre Elkabbach. Je vous suggère, après avoir lu le poème de Victor Hugo, d'aller voir le film italien Juste un baiser, qui porte à peu près sur le même thème.
La parole est à M. le président du Sénat.
M. Christian Poncelet, président du Sénat. Je crois que nous serons unanimes à penser que ces deux journées auront été particulièrement enrichissantes. Je voudrais tout de suite remercier celles et ceux qui, à différents titres, ont participé à la réussite de cette journée.
Nous pouvons en tirer l'enseignement que la tolérance est un combat qui ne sera jamais achevé, comme le combat que nous devons conduire pour faire le bonheur des hommes et des femmes. Par conséquent, vous, jeunes, qui cherchez parfois à vous engager dans une aventure, au sens noble du terme, engagez-vous dans ce beau combat pour le respect de l'autre, pour le respect de la dignité humaine. C'est le seul combat qui vaille ! Mais n'oubliez jamais d'introduire dans votre démarche une dimension, hélas ! trop rare, que je regrette de ne pas rencontrer assez souvent, à savoir la dimension du coeur. Il faut toujours aller vers l'autre avec un sentiment d'affection, un sentiment d'amour, afin que la fraternité, ce mot qui figure dans la devise de notre beau pays et auquel on se réfère souvent, devienne une réalité. Je vous remercie de votre participation. (Applaudissements.)
M. Jean-Pierre Elkabbach. Monsieur le président, je vous invite maintenant à rejoindre votre fauteuil habituel pour présider le vote de la résolution de la jeunesse. (M. Christian Poncelet s'installe au fauteuil de la présidence.)
M. le président. Je prie Son Excellence Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha, Premier ministre de Bulgarie, de bien vouloir venir s'exprimer à la tribune. (Applaudissements.)
M. Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha, Premier ministre de Bulgarie. Chers jeunes gens, je suis déjà d'un certain âge et j'ai pu, grâce à une vie très intéressante, voir et connaître de nombreuses circonstances et situations. C'est pour moi un honneur tout particulier de m'adresser aujourd'hui à vous, depuis cette tribune, en raison de ce que la France représente, de ce que cette maison représente.
Vous qui, dans cette France, dans l'Europe, avez l'avenir devant vous, pensez toujours à la démocratie, à sa valeur. Il faut savoir la défendre, et pour cela tous les efforts méritent d'être consentis. Vive la démocratie ! (Vifs applaudissements.)
Résolution sur la tolérance
M. le président. Nous allons maintenant passer à la discussion des propositions de résolution sur la tolérance. Je rappelle que ces propositions sont le résultat du travail que les élèves ont d'abord effectué au sein de leurs établissements, respectifs, puis, ce matin, au sein de sept commissions présidées par un membre du Sénat. Je profite de cette occasion pour saluer mes nombreux collègues sénatrices et sénateurs qui assistent à nos débats cet après-midi.
Deux propositions ont été sélectionnées par les rapporteurs des sept commissions au cours d'une réunion qui s'est tenue avant le déjeuner.
Ces deux propositions de résolution vont être soumises au vote. Elles ont été distribuées.
Je vais donner la parole aux rapporteurs des sept commissions.
Les deux rapporteurs des propositions de résolution sur la tolérance vont d'abord nous présenter leur texte. Ils disposent chacun de quatre minutes pour s'exprimer.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION N° I
M. le président. La parole est à Mlle Coralie Jourdin, du collège Victor-Hugo de Bourges, rapporteur de la commission A, présidée par Mme Monique Papon, sénatrice de la Loire-Atlantique. Elle va nous présenter la proposition de résolution n° 1. (Applaudissements.)
Mlle Coralie Jourdin. Nous avons travaillé ce matin sur une résolution présentée comme un préambule, que je vais maintenant vous lire.
« Nous avons tous un point commun: nous appartenons à la même famille humaine.
Nous ressentons les mêmes joies, les mêmes peines, les mêmes colères, au-delà de nos différences de peau, de sexe, d'âge, d'opinions, de culture, de tradition.
« Nous n'acceptons pas toujours cette diversité. Pensons en particulier aux cinq millions de personnes handicapées en France, qui sont évoquées dans la résolution de la commission B. Les gens s'ignorent, s'insultent, se rejettent, se battent, s'entretuent, sont exclus et même exilés, cela s'appelle l'intolérance.
« Nos divergences sont pourtant enrichissantes. Chaque individu a une histoire différente et unique. Ne faudrait-il pas apprendre à mieux se connaître et à s'écouter les uns les autres pour créer des liens ?
« L'intolérance est punie par la loi.
« Mais la loi ne suffit pas. Dans une démocratie, chacun doit faire preuve de civisme et de civilité.
« La tolérance est une qualité indispensable que chacun doit développer pour vivre en société. L'important est d'accepter les autres tels qu'ils sont.
« En conséquence :
« Article 1er. - Je défendrai le droit de chacun à exprimer ses opinions et à vivre selon sa volonté dans le respect des autres.
« Article 2. - Je m'abstiendrai de tout comportement discriminatoire et de toute action qui entraînerait une exclusion.
« Article 3. - Je m'informerai en toute circonstance pour me faire ma propre opinion et éviter tout préjugé à l'encontre de personnes et de communautés quelles qu'elles soient. » (Applaudissements.)
PROPOSITION DE RESOLUTION N° 2
M. le président. La parole est à Mlle Harmony Lakhdari du lycée Victor-Hugo de Marseille, rapporteur de la commission C, présidée par M. Jean Arthuis, sénateur de la Mayenne, par ailleurs président de l'importante commission des Finances de la Haute Assemblée. Elle va nous présenter la proposition de résolution n° 2. (Applaudissements.)
Mlle Harmony Lakhdari. Au nom de la commission C, je voudrais avant tout remercier le Sénat de nous avoir accueillis aujourd'hui.
La motion retenue par la commission C est le résultat de nombreuses discussions.
Nous sommes partis de deux propositions, la première présentée par Steven, du collège Victor-Hugo de Créteil, et la seconde par Monique, du lycée Victor-Hugo de Marseille. La première proposition traitait de la sécurité routière et la seconde, un peu plus générale, de la notion d'intolérance.
La proposition que nous avons adoptée est ainsi rédigée :
« Les participants à la journée mondiale pour la tolérance organisée au Sénat par l'UNESCO le 16 novembre 2002,
« Considérant la montée de l'intolérance et des préjugés racistes, le non-respect des droits de l'homme et la recrudescence des conflits dans de nombreux pays,
« Constatant les effets croissants de la mondialisation, des moyens de communication et le développement des migrations,
« Déclarent que la tolérance, en tant qu'acceptation positive des différences, doit être considérée comme une valeur fondamentale de notre société,
« Considèrent que le système éducatif est le lieu privilégié de la formation des citoyens solidaires et responsables, Que, comme tel, il doit favoriser la sensibilisation aux dangers résultant des manquements à la loi, notamment les dangers de la vitesse, de l'alcool, des drogues, de l'utilisation des portables et de non-utilisation de la ceinture de sécurité,
« Proposent que soit organisée, dans chaque année scolaire, une semaine de la tolérance. » (Applaudissements.)
EXPLICATIONS DE VOTE
M. le président. Les cinq autres rapporteurs vont à présent nous faire part de leur appréciation sur les deux propositions de résolution. Ils disposent chacun de 4 minutes.
La parole est à Mlle Sofia Nabet, élève du collège Victor-Hugo de Chauny, rapporteur de la commission B, présidée par Mme Hélène Luc, sénatrice du Val-de-Marne. (Applaudissements.)
Mlle Sophie Nabet, rapporteur de la commission B. Monsieur le président du Sénat, je vous remercie de me donner la parole.
La Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen affirme que tous les hommes naissent libres et égaux en droits. Les différences physiques, sociales et religieuses existent et font que chacun a son propre degré de tolérance. Celui-ci peut dépendre de l'éducation transmise par les parents, de la personnalité de chacun et de son histoire personnelle.
Aujourd'hui, on ne tolère pas qu'un autre ait la même chose que nous, on lui fait du mal.
On ne tolère pas qu'il ait plus que nous, on le vole. On ne tolère pas assez les personnes handicapées, on évite leur regard. Il y a cinq millions de personnes handicapées en France. La tolérance nous impose à tous de faire une place digne et pleine aux handicapés dans notre société. Nous demandons que la loi soit systématiquement appliquée, voire améliorée, de façon que chaque handicapé, imité dans son autonomie, soit réellement intégré et recouvre la plus grande liberté possible.
On ne tolère plus les personnes âgées, on les isole. On ne tolère tout simplement plus l'autre.
On, c'est qui ? C'est nous, vous et moi, nous tous. Ouvrons les yeux, acceptons-nous les uns les autres et refusons le vol, le crime, la douleur, la haine, la guerre, toute forme d'intolérance. La tolérance, c'est vous qui la faites. Tolérez-vous que je vous aie interpellés ainsi ? (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mlle Émilie Cottereau, élève du lycée Victor-Hugo de Château-Gontier, rapporteur de la commission D, présidée par Mme Marie- Claude Beaudeau, sénatrice du Val-d'Oise. (Applaudissements.)
Mlle Émilie Cottereau, rapporteur de la commission D. Monsieur le président du Sénat, je vous remercie de me donner la parole.
Ce matin, dans notre commission, après avoir lu et étudié les propositions de résolution d'un collège et d'un lycée, nous avons retenu la proposition de résolution en faveur de la tolérance envers les gens du voyage. Nous avons donc choisi de militer en faveur de la tolérance pour une minorité. Nous avons un peu modifié le texte initial après en avoir débattu.
Je vous donne lecture du début du texte que nous avons adopté : « Dans notre monde, nous dénonçons les injustices ; des enfants maltraités aux femmes battues, la liste est longue. Mais nous oublions que, dans notre pays, celui des libertés, de l'égalité et de la fraternité, nous retrouvons de nombreuses intolérances. Celle dont je vais vous parler existe depuis longtemps. Les gens du voyage sont en effet mal connus, non reconnus, et sont poursuivis par un cliché qui fait d'eux des voleurs.
« Comment pouvons-nous leur interdire de séjourner sur des terres alors qu'ils n'ont que trop peu d'endroits pour vivre ? Comment pouvons-nous leur demander de se taire alors qu'ils n'ont jamais eu le droit à la parole citoyenne ?
« Aujourd'hui, nous devons les reconnaître même s'ils ont choisi ce mode de vie. »
Nous avons ensuite proposé la mise en place de lieux d'accueil pour les gens du voyage dans toutes les villes. Nous avons aussi essayé de trouver une solution pour leur faciliter l'accès aux urnes. Voici notre proposition :
« Le droit de vote est un droit acquis par la nation française depuis deux siècles, qui n'a jamais pris en compte les gens du voyage, pour la seule raison qu'ils se déplacent de commune en commune.
« Nous proposons l'établissement d'une liste électorale nationale spécifique aux gens du voyage et l'ouverture de bureaux de vote pour leur permettre de voter dans chaque préfecture. »
Cette résolution n'a pas été retenue, mais je pense que la résolution n° 2 se rapproche des valeurs de la nôtre par la mise en place d'une semaine de la tolérance, car elle généralise l'idée de tolérance et englobe les autres victimes de l'intolérance. Cette résolution a aussi particulièrement attiré mon attention car une semaine de la tolérance me semble un bon moyen de sensibiliser tous les élèves. (Applaudissements.)
M. le président. A une certaine époque, de nombreux gens du voyage ont participé à la résistance française et ont lutté pour que nous retrouvions notre intégrité territoriale et nos libertés. Il ne faut pas l'oublier dans notre raisonnement.
La parole est à M. William Le Quéré, élève du collège Victor-Hugo de Nantes, rapporteur de la commission E, présidée par M. Georges Mouly, sénateur de Corrèze. (Applaudissements.)
M. William Le Quéré, rapporteur de la commission E. Monsieur le président du Sénat, je vous remercie de me donner la parole.
Je commencerai par vous donner lecture de notre motion, qui explique les raisons pour lesquelles nous demandons la tolérance :
« Tous les hommes appartiennent à la même espèce, mais nous ne pourrions survivre si nous étions tous semblables.
« La tolérance, c'est accepter la différence, qu'elle soit physique, culturelle ou qu'elle concerne les choix de vie, c'est accepter les divergences d'opinion.
« Mais au-delà des mots, chaque individu doit appliquer concrètement ces principes, à savoir la Liberté, l'Égalité, la Fraternité.
« La tolérance, c'est aussi ne pas accepter l'inacceptable, c'est refuser l'intolérable.
« Car de l'ignorance naît l'intolérance. »
Pour ma part, j'ai préféré la résolution n° 2, notamment parce que ses auteurs proposent d'organiser chaque année une semaine de la tolérance. Mais je rejoins aussi la demande formulée par la commission D en faveur des gens du voyage et celle qui l'a été par la commission B pour aider les handicapés. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mlle Alice Delattre, élève du lycée Victor-Hugo de Château-Gontier, rapporteur de la commission F, présidée par M. Roger Lagorsse, sénateur du Tarn. (Applaudissements.)
Mlle Alice Delattre, rapporteur de la commission F. Monsieur le président du Sénat, je vous remercie de me donner la parole.
Notre motion, qui résulte de deux textes proposés par les groupes de Tulle et de Poitiers, a été réécrite par l'ensemble des élèves de ma commission.
Il s'agit d'un texte très général, que je vous lis :
« Intolérables sont les inégalités et les injustices, les violences et les discriminations de toute nature.
« Tous, aidons-nous à rendre l'intolérance absurde, inique, horrible et détestable.
« Frères et sueurs de sang, enfants des mêmes rêves et espérances, vivons ensemble dans un monde unifié où le seul sang versé est celui du crépuscule d'un jour de fête.
« Nous écrivons ton nom, nous sommes nés pour te connaître, pour te faire vivre, pour te nommer : Tolérance. »
Cette motion n'a pas été retenue. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié la motion de la commission A, qui, selon moi, traite le problème de la tolérance d'une façon authentique et émouvante. Elle dénonce toutes les sortes d'intolérance possible, tout en indiquant la marche à suivre pour la combattre et les bienfaits que la société peut tirer de ce combat. (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mlle Zalhata Bacari, élève du lycée Victor-Hugo de Marseille, rapporteur de la commission G, présidée par M. Robert Del Picchia, sénateur représentant les Français établis hors de France. (Applaudissements.)
Mlle Zalhata Bacari, rapporteur de la commission G. Ce matin, la commission G, présidée par le sénateur M. Robert Del Picchia, a examiné deux motions. La première, du collège de Tulle, mettait l'accent sur la violence, le racisme, les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant. La seconde, du collège de Lugny, était centrée sur les problèmes liés au respect de l'environnement. Nous avons décidé d'ajouter cette dernière idée à la première motion, qui nous paraissait mieux rédigée.
Un amendement a été proposé par le lycée de Marseille afin d'instaurer une semaine sur la tolérance dans les établissements scolaires.
Je vous donne lecture du texte final adopté par la commission :
« Profondément scandalisés par toutes les manifestations de violence, de racisme,
d'atteintes aux droits de l'homme, de la femme et de l'enfant,
« Profondément attachés à la protection de la terre et de l'environnement,
« Conscients et convaincus que les responsables politiques doivent principalement se soucier de préserver la vie, droit premier et inaliénable,
« Nous demandons à ces responsables politiques
« D'accorder une priorité au respect des droits de l'homme et à la promotion de la tolérance, de renforcer les lois sur l'environnement,
« Et d'instituer, chaque année, une semaine consacrée à la tolérance dans tous les établissements scolaires français. »
En ce qui concerne les deux résolutions qui vont être soumises à notre vote, la résolution n° 2 nous paraît plus intéressante. En effet, celle-ci reprend les idées fondamentales de lutte contre le racisme et de respect des droits de l'homme. Elle contient un élément concret de mise en oeuvre avec la semaine d'éducation à la tolérance, que nous souhaitons également. (Applaudissements.)
VOTE SUR LES PROPOSITIONS DE RESOLUTION
M. le président. J'ouvre une parenthèse. Mes chers collègues et amis sénatrices et sénateurs, avez-vous observé que tous les intervenants ont rigoureusement respecté leur temps de parole ? (Sourires.) Veuillez donc vous inspirer de cet excellent exemple ! (Applaudissements.)
Je vous propose de statuer sur les deux propositions qui vous ont été présentées. Les élèves qui souhaitent voter pour la proposition de résolution n° 1 remettront aux huissiers un bulletin bleu. Les élèves qui souhaitent voter pour la proposition de résolution n° 2 remettront aux huissiers un bulletin blanc. Le scrutin est ouvert. Messieurs les huissiers, veuillez recueillir les bulletins. Le scrutin est clos. Il va être procédé au dépouillement du scrutin.
Je demande à Mlle Léa Leynaud, élève du collège Victor-Hugo de Colmar, et à M. Jérémy Soucier, élève du collège Victor-Hugo du Donjon, de bien vouloir gagner la tribune présidentielle pour superviser les opérations de dépouillement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin concernant les deux propositions de résolution sur la tolérance Nombre de votants : 215
Pour la proposition de résolution n° 1 : 104
Pour la proposition de résolution n° 2 : 111
La résolution n° 2 est adoptée. (Applaudissements.)
LECTURE DE LA RÉSOLUTION ADOPTEE
M. le président. J'invite Mlle Anne-Sophie Grandguillotte, élève du lycée Victor Hugo de Poitiers, à nous lire la résolution sur la tolérance qui vient d'être adoptée. J'indique aux élèves composant l'assemblée que cette résolution sera distribuée et mise en ligne sur le site Internet du Sénat.
Mlle Anne-Sophie Grandguillotte. Voilà le texte de la résolution qui a été adoptée :
« Les participants à la journée mondiale pour la tolérance organisée au Sénat par
l'UNESCO le 16 novembre 2002,
« Considérant la montée de l'intolérance et des préjugés racistes, le non-respect des droits de l'homme et la recrudescence des conflits dans de nombreux pays,
« Constatant les effets croissants de la mondialisation, des moyens de communication et le développement des migrations,
« Déclarent que la tolérance, en tant qu'acceptation positive des différences, doit être considérée comme une valeur fondamentale de notre société,
« Considèrent que le système éducatif est le lieu privilégié de la formation des citoyens solidaires et responsables,
« Que, comme tel, il doit favoriser la sensibilisation aux dangers résultant des manquements à la loi, notamment les dangers de la vitesse, de l'alcool, des drogues, de l'utilisation des portables et de la non-utilisation de la ceinture de sécurité,
« Proposent que soit organisée, dans chaque année scolaire, une semaine de la tolérance. »
(Applaudissements.)
M. le président. Au nom du bureau du Sénat, nous allons remettre les prix honorant les établissements spécialement distingués par le jury du concours Victor Hugo. Les établissements distingués sont ceux de Bourges, Le Donjon, Lugny, Nantes, Château-Gontier et Créteil, qui ont obtenu une mention spéciale. (Applaudissements.)
A chacun de ces établissements sont offertes les oeuvres complètes de Victor Hugo.
J'invite Mme Françoise Rivière, directrice générale adjointe de l'UNESCO, à remettre le prix au représentant du collègue de Créteil. (Applaudissements).
(Il est procédé à la remise du prix.)
M. le président. J'invite Mme Hélène Waysbord, inspectrice générale de l'éducation nationale, à remettre le prix au représentant du lycée de Château-Gontier. (Applaudissements.)
(Il est procédé à la remise du prix.)
M. le président. J'invite M. François Cheng à remettre le prix au représentant du collège de Bourges. (Applaudissements.)
(Il est procédé à la remise du prix.)
M. le président. J'invite M. Jorge Semprun, écrivain, membre de l'académie Goncourt, à remettre le prix au collègue du Donjon. (Applaudissements.)
(Il est procédé à la remise du prix.)
M. le président. J'invite M. Bachir Boumaza à remettre le prix au représentant du collège de Lugny. (Applaudissements.)
(Il est procédé à la remise du prix.)
M. le président. J'invite M. Valdas Adamkus à remettre le prix au représentant du collège de Nantes. (Applaudissements.)
(Il est procédé à la remise du prix.)
M. le président. Les quatorze autres établissements lauréats recevront prochainement l'ouvrage, cosigné par Paul Marcus, intitulé Victor Hugo : la voix des libertés. (Applaudissements.)
Je vais avoir le plaisir de remettre ce bouquet de fleurs à la comédienne Mme Nada
Strancar, qui nous a lu excellemment des textes de Victor Hugo, en la remerciant. (Applaudissements.)
Il me reste à vous remercier une nouvelle fois toutes et tous, sans distinction, de votre participation active à cette manifestation honorant Victor Hugo, lui qui nous a tracé la voie de l'avenir et de la tolérance. (Vifs applaudissements.)
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-sept heures quarante.)
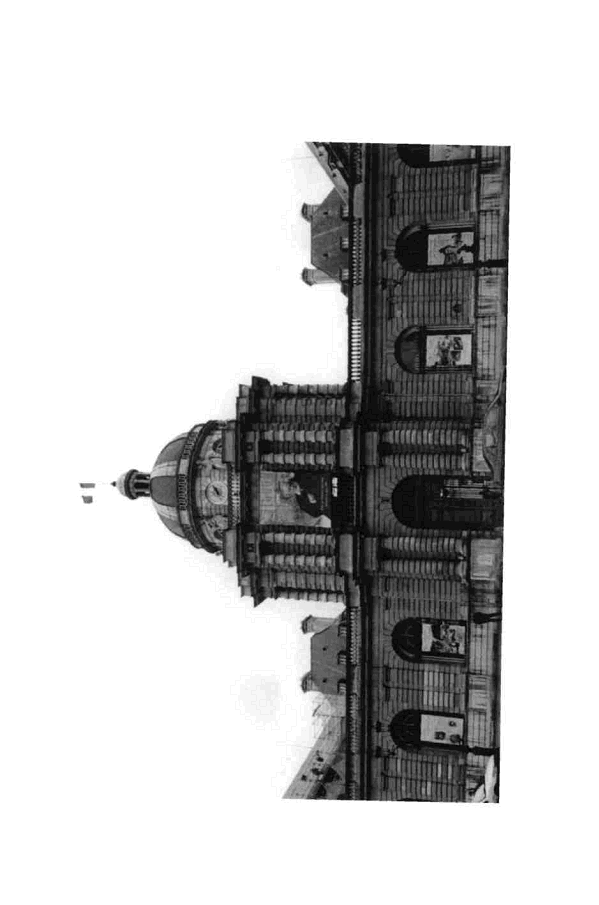
Victor Hugo a compté parmi les membres les plus éminents de la Seconde Chambre française, à la fois comme pair de France sous la Monarchie de juillet et comme sénateur élu du département de la Seine dans le Sénat de la III e République de 1876 à sa mort, le 22 mai 1885.
Ce volume rend compte des quatre temps forts de la commémoration du bicentenaire de Victor Hugo par le Sénat :
le 20 février 2002, un hommage solennel a été rendu en séance publique par M. Christian Poncelet, président du Sénat et six sénateurs représentant chacun des groupes politiques. Mlle Rachida Brakni, pensionnaire de la Comédie-Française, a lu ensuite à la tribune un extrait des Misérables. La présence inhabituelle d'une comédien- ne dans l'hémicycle du Sénat a souligné le caractère exceptionnel de cet hommage. La manifestation s'est achevée par l'inauguration de l'exposition Victor Hugo, témoin et acteur de son siècle, réalisée par le service de la Bibliothèque du Sénat.
- le 26 février 2002, jour anniversaire de la naissance de Victor Hugo, une délégation du Bureau du Sénat, conduite par M. le président Christian Poncelet, s'est rendue à Jersey et à Guernesey sur les traces de Victor Hugo en exil : rocher et cimetière des Proscrits à Jersey, maison de Hauteville House à Guernesey.
- le 15 novembre 2002, le Sénat a accueilli un colloque international sur l'exil.
Dans la vie et l'oeuvre de Victor Hugo, l'expérience de l'exil tient une place essentielle. En demeurant en exil pendant près de vingt ans (1851-1870), Victor Hugo s'affirme en tant qu'opposant politique face au pouvoir impérial. C'est pendant cette période qu'il écrit et publie les chefs d'oeuvre de la maturité (Les Châtiments, Les Contemplations, La Légende des Siècles, Les Misérables...). Défenseur de la liberté et de la République, ''ouvrier du progrès", il met sa plume au service des causes pour lesquelles il combat. Avec ce colloque, le Sénat entendait permettre une réflexion sur les rapports entre exil et opposition politique dans l'histoire, sur la diversité des expériences et leurs implications dans la création artistique.
- le 16 novembre, déclarée journée de la tolérance par l'UNESCO, le Sénat a reçu dans son hémicycle les élèves lauréats du concours Victor Hugo qui ont présenté leurs travaux et dialogué avec les personnalités internationales invitées, au cours d'une séance exceptionnelle animée par Jean-Pierre Elkabbach.
Ainsi, tout au long de l'année, le Sénat s'est employé à cheminer aux côtés de l'un de ses plus illustres membres. Il a ranimé ses combats, révélé les différentes faces de son génie, réalisé le lien entre celui qui écrivit L'art d'être grand-père et les jeunes générations. Fidèle à sa vocation, il a ainsi accompli son rôle de lien entre les traditions les plus accomplies et l'espoir nécessaire en l'avenir.
* 1 Donald Greer, The Incidence of the Emigration during the French Revolution, Cambridge, 1951. Cette étude, contestée dans ses modes de calcul mais qui n'a pas encore été remplacée, évalue le nombre total des émigrés à 100 000 ou 150 000 individus. 16 à 25 % d'entre eux seraient nobles, 25 à 35 % seraient membres du clergé, le reste étant membres du tiers état. Pour une vision générale de l'émigration, voir : Jean Vidalenc, Les Émigrés français 1789-1825, Caen, 1969.
* 2 Y. Shain cité par Stéphane Dufoix, Politiques d'exil. Hongrois, Polonais et Tchécoslovaques en France après 1945, Paris, 2002, p. 24.
* 3 Karine Rance, Mémoires de nobles émigrés dans les pays germaniques pendant la Révolution française. Thèse de doctorat, Université Paris 1, 2001.
* 4 Claude-Isabelle Brelot, La noblesse de Franche-Comté de 1789 à 1808, Annales littéraires de l'université de Besançon, n° 134, Paris, 1972.
* 5 Henri Carré, La noblesse de France et l'opinion publique française au XVIII e siècle, Paris, 1920, p. 463-472.
* 6 Samuel F. Scott, « L'armée royale et la contre-révolution », dans Roger Dupuy, François Lebrun (éd.), Les résistances à la Révolution, Paris, 1987, p. 191-201, ici p. 196.
* 7 Christian Henke, Coblentz : Symbol für die Gegenrevolution, Stuttgart, 2000, p. 203-206.
* 8 Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen, Berlin, 1963, p. 28-30.
* 9 Sur la faiblesse des transferts culturels, voir : Thomas Höpel, Emigranten der Französischen Revolution in Preußen 1789-1806, Leipzig, 2000.
* 10 Paul-André Rosental, « Maintien/rupture: un nouveau couple pour l'analyse des migrations », Annales E. S. C, juillet-septembre 1990, p. 1403-1431.
* 11 Jean-Clément Martin (éd.), La Contre-Révolution en Europe. XVIII e - XIX e siècles. Réalités politiques et sociales, résonances culturelles et idéologiques, Rennes, 2001, p. 8.
* 12 Archives nationales : AB XIX 196, doss. 1, lettre de Faymoreau à son commandant, Hambourg, 14 octobre 1796
* 13 Gérard Noiriel, Le creuset français, Paris, 1988, p. 193.
* 14 Stéphane Dufoix, op. cit., p. 28 et suiv.
* 15 Coblenz et Quiberon. Souvenirs du comte de Contades, pair de France, publiés par le comte Gérard de Contades. Paris, E. Dentu, 1885.
* 16 Charles de Lacombe, Le comte de Serre, sa vie, son temps, Paris, 1881, 2 vol. Jean Vidalenc, « Les "départements hanséatiques" et l'administration napoléonienne », Francia, 1 (1973), p. 414-450, ici 421-422.
* 17 La paix imposa de réduire le nombre d'hommes de 500 000 à 223 000, voir Guillaume de Bertier de Sauvigny, La Restauration, Paris, 1955, p. 103.
* 18 Le roi prononça une amnistie qui n'excluait que les conventionnels régicides ayant rallié Napoléon pendant les Cent Jours qui furent bannis. Sur ces autres exilés, voir : Sergio Luzzatto, Mémoire de la Terreur. Vieux montagnards et jeunes républicains au XIX e siècle, Lyon, 1991.
* 19 Almut Franke-Postberg, Le milliard des émigrés. Die Entschädigung der Emigranten im Frankreich der Restauration (1814-1830), Bochum, 1999.
* 20 André Gain, La Restauration et les biens des émigrés. La législation concernant les biens- nationaux de seconde origine et son application dans l'est de la France, Nancy, 1929, 2 vol., ici vol. l, p. 108-109.
* 21 Souvenirs et fragments pour servir aux mémoires de ma vie et de mon temps, par le marquis de Bouillé, publiés pour la Société d'histoire contemporaine, par P.-L. de Kermaingant. Paris, Picard, 1906-1911,3 vol., ici vol. l,p. 66.
* 22 Mémoires d'Outre-Tombe, nouvelle édition critique, établie, présentée et annotée par Jean- Claude Berchet, Paris, Garnier, 1989-1998, 3 vol., ici vol. 1, p. 513.
* 23 Chateaubriand, op. cit. vol. 1, p. 136.
* 24 Chateaubriand, op. cit. vol. I, p. 166.
* 25 Chateaubriand, op. cit. vol. I, p. 161.
* 26 Claudette Delhez-Sarlet, « Chateaubriand : scissions et rassemblement du moi dans l'histoire », dans Maurizio Catani, Claudette Delhez-Sarlet, Individualisme et autobiographie en Occident, Bruxelles, 1983, p. 193-208, ici, p. 201.
* 27 Les Misérables, Paris, Garnier-Flammarion, 1967, t. II, p. 415.
* 28 Les Misérables, t. II, p. 358.
* 29 Choses vues, souvenirs, journaux, cahiers, 1870-1885, Paris, Gallimard, 1972, p. 87.
* 30 L'Année Terrible, in Victor Hugo, OEuvres complètes, t. III, Poésie, p. 1 17-118, Paris, Robert Laffont, 1985.
* 31 Choses vues, p. 268.
* 32 Choses vues, p. 266.
* 33 L'Année terrible, p. 181.
* 34 L 'Année terrible, p. 124.
* 35 Le Rhin, Conclusion, OEuvres complètes de Victor Hugo, vol. Voyages, Robert Laffont, coll. « Bouquins », édition désormais désignée par « Laffont ».
* 36 Sur la couverture de l'édition originale des Burgraves. Voir Laffont, Théâtre II, p. 260.
* 37 Du fait de l'implication des troupes françaises dans l'écrasement de la République romaine. Voir notamment les discours à l'Assemblée législative, « Affaire de Rome - 19 octobre 1849 » et « La liberté d'enseignement - 15 janvier 1850 », Actes et paroles - I ; avant l'exil, Laffont, Politique.
* 38 Voir ses discours d'ouverture et de clôture, les 21 et 24 août 1849, Actes et paroles - I ; avant l'exil, Laffont, Politique et Philippe régnier, « Victor Hugo et le pacifisme d'inspiration saint- simonienne » in Hugo et la guerre, actes du colloque de l'université Paris VII, textes réunis et présentés par Claude Millet, Maisonneuve et Larose, 2002.
* 39 « Quoi ! parce que, après dix ans d'une gloire immense, d'une gloire presque fabuleuse à force de grandeur, [Napoléon] a, à son tour, laissé tombé d'épuisement ce sceptre et ce glaive qui avaient accompli tant de choses colossales, vous venez, vous, vous voulez, vous, les ramasser après lui, comme il les a ramassés, lui, Napoléon, après Charlemagne, et prendre dans vos petites mains ce long sceptre des Titans, cette épée des géants ! Pour quoi faire ? (Longs applaudissements.) Quoi ! après Auguste, Augustule ! Quoi ! parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit ! (La gauche applaudit, la droite crie. La séance est interrompue pendant plusieurs minutes. Tumulte inexprimable.) » (« Révision de la constitution », 17 juillet 1851, Actes et Paroles - I ; avant l'exil, Laffont, Politique, p. 289-290)
* 40 Par l'instauration de la République, le « peuple français a taillé dans un granit indestructible et posé au milieu même du vieux continent monarchique la première assise de cet immense édifice de l'avenir, qui s'appellera un jour les États-Unis d'Europe ! (Mouvement. Long éclat de rire à droite.) » (op. cit., p. 275).
* 41 Lettre du 23 avril 1856, édition des OEuvres complètes de Victor Hugo, Le Club français du livre (édition désormais désignée par « CFL »), tome X, p. 1242. Hugo s'exécutera le 26 mai, par une lettre « A l'Italie » qui sera reproduite dans les journaux anglais, belges et italiens (voir Actes et paroles II ; pendant l'exil, Laffont, Politique, p. 507-509).
* 42 Il faut ajouter : cinq aux États-Unis d'Amérique, un à la Chine, deux au Mexique, deux à Cuba...
* 43 Actes et paroles - II ; pendant l'exil, Laffont, Politique, p. 679.
* 44 « À l'Italie », Actes et paroles - II ; pendant l'exil, Laffont, Politique, p. 507-508.
* 45 « Congrès de la paix à Lausanne », Actes et paroles - II ; pendant l'exil, Laffont, Politique, p. 624.
* 46 « Pour la Serbie », Actes et paroles - IV ; depuis l'exil, Laffont, Politique, p. 951.
* 47 Au moins depuis son discours du 9 juillet 1849 à l'Assemblée législative (Actes et paroles - I ; avant l'exil, Laffont, Politique), Hugo ne cesse de le répéter : il s'agit non pas de soulager la misère, mais bien de l'abolir. On peut citer parmi de multiples exemples cette phrase de Gauvain, Républicain universaliste de l'avenir, à Cimourdain, Républicain jacobin du présent, dans Quatrevingt-Treize (phrase qui figura récemment sur les banderoles d'une association de défense des mal logés) : « Vous voulez les misérables secourus, moi je veux la misère supprimée » (III, VII, 5, Laffont, Roman III, p. 1057).
* 48 Lettre du 29 août 1852, CFL, tome VIII, p. 1030.
* 49 Lettre à Gloss du 2 avril 1853, CFL, tome VIII, p. 1053.
* 50 Voir la lettre de Hugo du 2 février 1852, CFL, tome VIII, p. 976.
* 51 Voir notamment la lettre à Louise Colet du 1 er juin 1854 : « Où le vent va-t-il m'emporter ? Les journaux espagnols annoncent que le Gouvernement d'Espagne m'offre l'hospitalité. Je suis bien tenté de ce beau soleil, moi qui suis citoyen du ciel bleu. » (CFL, tome IX, p. 1078).
* 52 Lettre du 24 mai 1856, CFL, tome X, p. 1253.
* 53 CFL, tome IX, p. 1096. Herzen, alors à Londres, lançait sa revue L'Étoile polaire et sollicitait le soutien et la participation de Hugo ; cette lettre sera reproduite dans le premier numéro de la revue.
* 54 Passé et méditation, tome II, ch. XXXVII, p. 335-336, Lausanne, L'Âge d'homme, 1976. Sur l'expérience et l'idiosyncrasie des exilés de la génération de 1848, voir les travaux de Sylvie Aprile (notamment « « Qu'il est dur à monter et à descendre l'escalier d'autrui » - L'exil des proscrits français sous le Second Empire », dans Romantisme, n° 1 10, SEDES, 2000).
* 55 « Madier de Montjau et Charras m'ont prié, au nom de tous nos co-proscrits de Belgique, de voir ici Mazzini, Ledru-Rollin, Kossuth, pour régler avec eux les intérêts de la démocratie européenne. Ils m'ont dit : parlez comme notre chef. Ceci me retiendra à Londres jusqu'à mercredi » (lettre à Adèle du 2 août 1852 ; CFL, tome VIII, p. 1026).
* 56 Voir « Déclaration à propos de l'Empire - Jersey, 31 octobre [1852] », Actes et paroles - II ; pendant l'exil, Laffont, Politique.
* 57 CFL, tome VIII, p. 1052-1053.
* 58 Commentant sa décision de ne réclamer aucun droit d'auteur pour l'exploitation de ses oeuvres à des fins patriotiques durant toute la durée de la guerre, Hugo écrivait dans ses carnets le 27 novembre 1870: « Ce que j'écris n'est pas à moi. Je suis une chose publique » (Laffont, Voyages, p. 1068).
* 59 Le Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse (édition de 1983), pour sa part, le définit ainsi : « Situation de quelqu'un qui est expulsé ou obligé de vivre hors de sa patrie ; lieu où cette personne réside à l'étranger ». IL est intéressant de noter que l'Encyclopaedia Universalis n'inclut pas un article sur l'exil.
* 60 EGL'INNOCENTI Maurizio, « L'esilio nella storia contemporanea », in L'esilio nella storia del movimento operaio e l'emigrazione economica, a cura di M. Degl'Innocenti, Bari/Rome, Lacaita, 1992, p. 8.
* 61 MILZA Pierre, « Introduction et problématique générale », L'émigration politique en Europe aux XIX e et XX e siècles, Rome, École Française de Rome, 1991, p. 7.
* 62 Ibid., p. 7.
* 63 Pour le Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, le réfugié est une « Personne ayant quitté son pays d'origine pour des raisons politiques, religieuses ou raciales et ne bénéficiant pas, dans le pays où elle réside, du même statut que les populations autochtones, dont elle n'a pas acquis la nationalité » . Un autre dictionnaire encyclopédique, le Robert, définit le réfugié comme « une personne qui a dû fuir le lieu, le pays qu'elle habitait afin d'échapper à un danger (guerre, persécutions politiques ou religieuses, etc.) ». L' Encyclopaedia Britannica définit le réfugié comme « any uprooted, homeless, involuntary migrant who has crossed a frontier and no longer possesses the protection of his former government ».
* 64 Le facteur religieux a souvent joué un rôle important dans le phénomène de l'exil, mais son importance a diminué dans les exils européens du XX e siècle par rapport à celle de facteurs plus spécifiquement ou explicitement politiques.
* 65 HOBSBAWM Eric, The Age of Extremes. A History of the World. 1914-1991. New York, Vintage Books, 1995.
* 66 Cf. Michael R. MARRUS, Les exclus. Les réfugiés européens au XX e siècle, Paris, Calmann- Lévy, 1986 (en anglais The Unwanted. European Refugees in the Twentieth Century, Oxford, Oxford University Press, 1985).. Marrus écrit : «Chassés par les guerres et les persécutions, et contraints de chercher asile à l'étranger, les réfugiés hantent le continent européen depuis des temps immémoriaux, mais il faut attendre le XX e siècle pour qu'il constitue un véritable problème de politique internationale, susceptible d'affecter gravement les relations entre États. (...) L'émigration forcée prend en effet, à l'époque moderne, une ampleur jamais vue » (MARRUS M., op. cit., p. 11).
* 67 « Le mot réfugié a été forgé pour désigner les protestants chassés de France au XVII e siècle, mais jusqu'à la fin du XIX e siècle les mots émigré et exilé ont plus volontiers été utilisés et ce n'est qu'ensuite que le mot réfugié l'a emporté sur les autres, pour décrire des phénomènes de plus en plus massifs » ( MATHIEU Jean-Luc, Migrants et réfugiés, Paris, PUF, 1991, p. 11).
* 68 Cité par MARRUS M., op. cit.,, p. 16.
* 69 Ibid.
* 70 Ibid.
* 71 Une partie de ces émigrés juifs, surtout après la révolution russe de 1905 et sa répression, était composée de militants politiques socialistes, en particulier de membres du Bund (le parti social- démocrate juif de Lituanie, Pologne et Russie), et il est intéressant de noter que beaucoup d'ex- bundistes jouèrent ensuite un rôle important dans le mouvement ouvrier juif et dans le mouvement syndical aux États-Unis.
* 72 MARRUS M., op. cit., p. 38.
* 73 Les mémoires d'Alexandre Herzen. Passé et méditations (Lausanne, L'Age d'Homme, 1981, 4 vol.) offrent un portrait saisissant de ce monde des exilés révolutionnaires du XIX e siècle.
* 74 LEQUIN Yves, « Métissages imprudents ? », in : LEQUIN Y. (dir.). Histoire des étrangers et de l'immigration en France, Paris, Larousse, 1992, p. 393.
* 75 Dans la langue allemande, le terme Fliichtling, s'impose, pour désigner les réfugiés, au lendemain de la Première guerre mondiale.
* 76 Comme par exemple celui que délivre en France l'OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides) aux demandeurs d'asile qu'il reconnaît, après examen, comme de « vrais » réfugiés.
* 77 Voir « Émigrés », par Massimo Boffa, dans FURET François, OZOUF Mona, Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, Flammarion, 1988, pp. 346-359. On estime à plus de 150 000 le nombre de ces émigrés.
* 78 Cf. PONTY Janine, « Réfugiés, exilés, des catégories problématiques », Matériaux pour l'histoire de notre temps, n.° 44, octobre-décembre 1996, p. II.
* 79 Elle utilise également, pour indiquer les émigrés politiques, les mots Verbannte (bannis) et Vertriebene (chassés, expulsés). Dans l'un des Svendborger Gedichte (Londres, Malik Verlag, 1939) intitulé « Über die Bezeichnung Emigranten » (« Sur l'appellation d' « émigré » »), écrit pendant son exil au Danemark, Bertold Brecht refuse l'appellation Emigranten, qui lui semble trop proche d'Auswanderer, c'est-à-dire d'émigré volontaire, et préfère se dire Verbannte et Vertriebene : « Immer fand ich den Namen falsch, den man uns gab : Emigranten. Das heisst doch Auswanderer. Aber wir wanderten doch nicht aus, nach freiem Entschluss wählend ein anderes Land. Wanderten doch auch nicht ein in ein Land, dort zu bleiben, womöglich für immer. Sondern wir flohen. Vertriebene sind wir, Verbannte. Und kein Heim, ein Exil soll das Land sein, das uns da aufnahm ». (BRECHT Bertold, « Über die Bezeichnung Emigranten », in : Literarische und politische Texte aus dem deutschen Exil 1933-1945, hrsg. v. Ernst LOEWY, Stuttgart, 1979, pp. 484-485).
* 80 WEIL Patrick, La France et ses étrangers, Paris, Gallimard, 1995, p. 500, note 14. Gérard Noiriel note que « le mot « immigration » (et ses dérivés, « immigre », « immigrant ») fait partie du lexique qui se constitue en même temps que la IIIe République » (NOIRIEL Gérard, Le creuset français. Histoire de l'immigration XIX e -XX e siècle, Paris, Seuil (Coll. Points), 1988, pp. 78 sq.)
* 81 La première grande vague de migrants européens en direction des États-Unis, qui commença dans les années 40, fut suivie par une deuxième, encore plus massive, à partir des années 80, en provenance surtout d'Europe orientale et méridionale. L'Amérique latine devint elle aussi la destination de puissantes vagues migratoires. La diffusion des bateaux à vapeur, ainsi que des chemins de fer, rendit possibles ces déplacements massifs de population.
* 82 MILZA P., art. cit., p. 6.
* 83 Janine Ponty note que « nombre d'étrangers en France au XX e siècle affirment être des « émigrés » parce qu'ils portent en eux le souvenir du pays d'origine » (art. cit., p. 10).
* 84 Cf. SIMPSON John II., The Refugee ProbleM. Report of a Survey, Oxford, 1939.
* 85 Comparé au XX e siècle, avec ses deux guerres mondiales, le XIX e apparaît comme une époque relativement pacifique, en dépit des guerres (guerres napoléoniennes, guerre de Crimée, guerre austro-prussienne, guerre franco-prussienne, guerres du Risorgimento italien, guerre d'indépendance grecque) qui le ponctuèrent jusqu'aux années 70. Aucune de ces guerres ne créa des masses de réfugiés comparables à celles des guerres du XX e siècle.
* 86 Cf. l'article « Réfugiés » (par Pierre Bringuier) de l'Encyclopaedia Universalis, Paris, 1996, p. 684. Cf. aussi ZOLBERG Aristide, « The Formation of New States as a Refugee Generation Process », Anna/s of the American Academy of Political and Social science, mai 1983 ; Id. « Contemporary Transnational Migrations in Historical Perspective : Patterns and Dilemmas », in KRITZ Mary M., éd., U.S. Immigration and Refugee Policy. Global and Domestic Issues, Lexington, 1983, pp. 18-19.
* 87 Ce dernier toutefois se reconstitua rapidement sous l'autorité des bolcheviks.
* 88 Le concept même de frontière d'État fixe, fermée et contrôlée, est lié à l'affirmation définitive des États nationaux entre la fin du XIX e siècle et le début du XX e . Avant le XIX e siècle on passait d'un pays à l'autre sans besoin de passeports ou de visas, et même au XIX e on circulait beaucoup plus facilement qu'au XX e . Les frontières étaient infiniment plus perméables qu'aujourd'hui.
* 89 « Somme toute, les réfugiés représentent les laissés-pour-compte des arrangements de 1919, ceux dont les traités ne savent que faire et que les grandes puissances considèrent, si tant est qu'elles s'en préoccupent, comme un phénomène de second ordre » (MARRUS M., op. cit., p. 58). Avant la première guerre mondiale, écrit Pierre Bringuier, « les réfugiés, pris en tant qu'individus ou en masse, étaient accueillis dans tel ou tel pays à partir de la très ancienne tradition de l'asile, qui s'appuyait sur des considérations religieuses ou philosophiques et non pas sur le droit. L'absence quasi totale du droit est facilement explicable : la relation entre l'individu et la puissance publique (le prince ou la cité) était finalement plus personnelle que juridique, de sorte que l'essentiel était à cette époque de renouer un lien personnel de même type avec un autre prince ou une autre cité.
Tout change à partir du moment où l'État-nation devient le modèle normal de l'organisation politique. Les relations personnelles s'effacent devant les liens juridiques. L'individu qui ne peut plus se réclamer d'un État est, à l'époque moderne, dans une situation dramatique de ce seul fait. Or le réfugié est non seulement une personne déracinée, dans des conditions matérielles souvent extrêmement pénibles, mais c'est encore une personne privée de ce lien de rattachement essentiel à un État dont, cependant, elle garde la nationalité » (Pierre BRINGUIER, « Réfugiés », Encyclopaedia Universalis, Paris, 1996, vol. 19, p. 684).
* 90 MARRUS M., op. cit., pp. 57-58.
* 91 RÖDER Werner, STRAUSS Herbert A. (éd.), Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933, vol. I. München-New York-London-Paris, Saur, 1980, p. XIII et XXXV ; RÖDER Werner, « Emigration nach 1933 ». in M. BROSZAT u. H. MÖLLER (Hg.), Das Dritte Reich. Herrschaftsstruktur und Geschichle, Munich, Beck, 1983, p. 232. On estime le nombre des émigrés politiques proprement dits entre 25.000 et 30.000. Cf. MEHRINGER Hartmut, « L'esilio socialista tedesco 1933-1945. La strada dal socialismo rivoluzionario alla democrazia sociale », in L'esilio nella storia del movimento operaio e l'emigrazione economica, cit., p. 209.
* 92 Cf. DREYFUS-ARMAND Geneviève, L'exil des républicains espagnols en France. De la guerre civile à la mort de Franco, Paris, Albin Michel. 1999. La majorité de ces réfugiés rentra en Espagne, mais plus de 150.000 restèrent en France (Cf. ibid., p. 80). Sur l'exil espagnol en Amérique latine et en particulier au Mexique voir LIDA Clara, Inmigracion y exilio. Reflexiones sobre el caso español, Madrid, Siglo XXI Editores, 1997.
* 93 Cf. MARRUS M., op. cit., chap. V
* 94 MARRUS M., op. cit., p. 46.
* 95 TARTAKOWER Arieh, GROSSMANN Kurt R., The Jewish Refugee, New York, 1944, p. 1.
* 96 Avant 1945 la législation américaine ne distinguait pas les réfugiés des immigrés. Le problème des réfugiés ne se posait donc pas en tant que tel, mais exclusivement dans le cadre des lois sur l'immigration. Dans les années 30 le système des quotas par pays, introduit par l'Immigration Act de 1924, fut appliqué de manière particulièrement restrictive et dans beaucoup de cas les quotas par pays ne furent pas remplis. Par ailleurs, les États-Unis ne faisaient pas partie de la SdN et ne reconnaissaient pas les « passeports Nansen » créés par la SdN pour protéger certaines catégories de réfugiés, comme les Russes ou les Arméniens. Cf. DAVIE Maurice R., Refugees in America. Report of the Commission for the Study of Recent Immigration from Europe, New York, Harpcr and Brothers, 1947 (Reprint 1974, Grenwood Press, Westport.
* 97 En ce qui concerne l'Amérique latine, Clara Lida note que « en las decadas de 1930 y 1940 la legislacion fue cerrando una a una las puertas de los demás paises receptores de America » (LIDA C., Inmigración y exilio, cit., p. 140), comme le Mexique l'avait déjà fait à partir de la Constitution de 1917. La généreuse politique d'accueil du Mexique à l'égard des exilés républicains espagnols fut une exception, motivée par des raisons de solidarité politique, et ne remit pas en cause l'attitude restrictive en matière d'immigration.
* 98 Sur cette problématique voir NOIR1EL Gérard, Réfugiés et sans papiers. La République face au droit d'asile XIXe-XXe siècle, Paris, Hachette, 1998. Dans ses souvenirs l'écrivain autrichien Stefan Zweig décrit le choc que représenta pour lui le fait d'être privé, à la suite de l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie en 1938, de sa nationalité et de son passeport, et conclut : « Et j'étais forcé de me souvenir sans cesse de ce que m'avait dit des années plus tôt un exilé russe : « Autrefois, l'homme n'avait qu'un corps et une âme. Aujourd'hui, il lui faut en plus un passeport, sinon il n'est pas traité comme un homme » » (ZWEIG Stefan, Le monde d'hier. Souvenirs d'un européen, Paris, Belfond, 1993, p. 500. Dans le roman de Mikhaïl Boulgakov, Le Maître et Marguerite, le Maître répond ainsi à Koroviev, qui s'était exclamé « Plus de papiers, plus d'homme » : « Vous avez très bien dit, commenta le Maître, frappé par la perfection du travail de Koroviev. Plus de papiers, plus d'homme. Et justement, je n'existe plus, puisque je n'ai plus de papiers » BOULGAKOV Mikhaïl, Le Maître et Marguerite, in Id., Romans, Paris, R. Laffont (Coll. Bouquins), 1993, p. 886.
* 99 REALE Egidio, Le régime des passeports et la SDN, Paris, Arthur Rousseau, 1930 (Cité dans NOIRIEL Gérard, La tyrannie du national, Paris, Calmann-Lévy, 1991, p. 101).
* 100 WYMAN David, Paper Walls. America and The Refugee Crisis, 1938-1941, Amherst, Univcrsity of Massachussetts Press, 1968.
* 101 La philosophe Hannah Arendt, qui faisait partie elle aussi de ces réfugiés juifs allemands, analysait ainsi, dans un article publié en 1940 aux États-Unis, la transformation qu'avait subie la notion de réfugié :
« Jusqu'à présent le terme de réfugié évoquait l'idée d'un individu qui avait été contraint à chercher refuge en raison d'un acte ou d'une opinion politique. Or, s'il est vrai que nous avons dû chercher refuge, nous n'avons cependant commis aucun acte répréhensible, et la plupart d'entre nous n'ont même jamais songé à professer une opinion politique extrémiste. Avec nous, ce mot « réfugié » a changé de sens. On appelle de nos jours « réfugiés » ceux qui ont eu le malheur de débarquer dans un nouveau pays complètement démunis et qui ont dû recourir à l'aide de comités de réfugiés » (ARENDT Hannah, « Nous autres réfugiés ». in ARENDT H., La tradition cachée, Paris, Christian Bourgois, 1987, pp. 57 sg.).
* 102 RÖDER Werner, « German Politics in Exile, 1933-1945. A Survey », in L'émigration politique en Europe aux XIX e et XX e siècles, Rome, École Française de Rome, 1991, p. 396.
* 103 Cf. SEGRE Dan V., « L'émigrazione ebraica sarà stata un'emigrazione politica ? », in L'émigration politique en Europe aux XIX e et XX e siècles, cit., pp. 95-103 ; DONNO Antonio, « L'emigrazione politica degli ebrei dell'Europa orientale negli Stati Uniti (1880-1920) », in L 'esilio nella storia ciel movimento operaio e l'emigrazione economica, cit., pp. 121-135
* 104 DEGL'INNOCENTI M., art. cit., p. 8.
* 105 Sur cet aspect cf. ANGOUSTURES Aline, « Les réfugiés européens au coeur du statut de
réfugiés », Matériaux pour l'histoire de notre temps, n.° 44, octobre-décembre 1996, pp. 66-71.
* 106 C'est la définition qu'en donne l'Encyclopaedia Universalis.
* 107 Il faut ajouter que chaque État est libre non seulement de ratifier ou de ne pas ratifier une convention internationale, mais aussi d'y introduire des limitations en cas de ratification. Il est donc indispensable d'étudier, cas par cas, la politique de chaque État vis-à-vis des demandeurs d'asile : étudier les règles juridiques, d'une part, et les pratiques administratives, de l'autre. Dans le cas des pays d'immigration, il est essentiel de savoir si leur législation fait la distinction entre les réfugiés politiques et les autres immigrés et si elle prévoit un traitement particulier pour les premiers.
* 108 Cf. ROLLAND Denis, TOUZALIN Marie Hélène, « Un miroir déformant ? Les Latino- Américains à Paris depuis 1945 », in MARES Antoine, MILZA Pierre (dir.), Le Paris des étrangers depuis 1945, Paris, Publications de la Sorbonne, 1994, pp. 263-289.
* 109 Ce fut le cas notamment de nombreux émigrés politiques allemands et autrichiens. Cf. SAINT- SAUVEUR-HENN Anne (dir.), Zweimal verjagt. Die deutschsprachige Emigration und der Fluchtweg Frankreich-Lateinamerika 1933-1945, Berlin, Metropol Verlag, 1998.
* 110 Et qui émigrèrent ensuite aux États-Unis. On distingue donc, pour ce groupe, plusieurs émigrations. Cf. LIEBICH André, « At home abroad. The Mensheviks in the second Emigration », Canadian Slavonic Papers, 37, 1995, n.° 1-2, pp. 1-13.
* 111 Sur la situation des réfugiés en France et l'attitude de l'opinion et des pouvoirs publiques à l'égard des étrangers dans l'entre-deux-guerres voir SCHOR Ralph, L'opinion française et les étrangers en France 1919-1939, Paris, Publications de la Sorbonne, 1985; Id., Histoire de l'immigration en France de la fin du XIX e siècle à nos jours, Paris, A. Colin, 1996, pp. 120-165 ; BARTOSEK Karel, GALLISSOT René, PESCHANSKI Denis (dir.), De l'exil à la résistance. Réfugiés et immigrés d'Europe centrale en France 1933-1945, Paris, Presses Universitaires de Vincennes / Arcantère, 1989.
* 112 DREYFUS-ARMAND Geneviève, TEMIME Émile, Les camps sur la plage: un exil espagnol, Paris, Éditions Autrement, 1995 ; GRANDO René, QUERALT Jacques, FEBRES Xaxier, Camps du mépris ; des chemins de l'exil à ceux de la Résistance (1939-1945). 500 000 républicains d'Espagne « indésirables » en France, Perpignan, Llibres des Trabucaire, 1991. Une thèse d'État sur les camps d'internement en France de 1938 à 1946 sera soutenue en novembre 2000 à l'Université de Paris I.
* 113 L'URSS accueillit même un certain nombre de réfugiés politiques d'Europe et d'ailleurs, communistes pour la plupart. Dans les années 30, au moment de la grande terreur, la protection dont bénéficiaient théoriquement ces exilés s'avéra des plus précaires : nombreux furent les communistes étrangers qui tombèrent victimes, en URSS, de la répression stalinienne. Plusieurs études ont été publiées en Allemagne et en Autriche sur ce sujet, surtout après l'ouverture des archives est-allemandes et russes. Cf. par ex. TISCHLER Carola, Die UdSSR und die Politemigration. Das deutsche Exil in der Sowjetunion zwischen KPD, Komintern und sowjetischer Staatsmacht (1933-1945), Phil. Diss., Kassel, 1995 ; WEBER Hermann, « Weisse Flecken » in der Geschichte. Die KPD-Opfer der Stalinschen Säuberungen und ihre Rehabilitierung, Berlin, Links, 1990 ; SCHAFRANEK Hans, Zwischen NKWD und Gestapo. Die Auslieferung deutscher und österreichischer Antifaschisten ans der Sowjetunion an Nazideutschland 1937-1941, Francfort, ISP-Verlag, 1990. Sur le sort des communistes autrichiens réfugiés en URSS voir McLOUGHLIN Barry, SCHAFRANEK Hans, SZEVERA Walter, Aujbruch Hoffnung Endstation. Österreicherinnen und Österreicher in der Sowjetunion 1925-1945, Vienne, Verlag fur Gesellschaftskritik, 1997.
* 114 Sur la participation des étrangers à la Résistance en France voir SCHOR R., Histoire de l'immigration ....cit., pp. 181-191.
* 115 L'émigration politique espagnole coexistait en France avec une importante colonie d'immigrés économiques, qui augmenta fortement dans les années 50 et 60 lorsque le régime franquiste permit l'émigration économique. Dans les années 60 on vit arriver également de nombreux immigrés portugais.
* 116 D'après des estimations, plus de 200.000 Hongrois en 1956 et environ 500.000 Tchécoslovaques en 1968 quittèrent leurs pays respectifs. Plus de la moitié des réfugiés hongrois quitta ensuite l'Europe pour s'installer dans d'autres pays, principalement en Amérique du Nord (DEGL'lNNOCENTI M., art. cit., p, 14).
* 117 De 1945 a 1961 plus de 3.700.000 Allemands de l'Est se réfugièrent en Allemagne occidentale. Cf. l'article « Refugee » dans l' Encyclopaedia Britannica.
* 118 La force d'attraction de l'URSS comme terre d'asile fut toujours faible en dehors des milieux communistes ; mais même dans le cas des communistes, seule une petite partie de ceux qui auraient souhaité s'y réfugier y fut admise. Compte tenu du sort tragique que connurent dans les années 30 de nombreux communistes étrangers, en particulier allemands, réfugiés dans ce pays, cette politique restrictive en matière d'asile contribua, paradoxalement, à sauver la vie de beaucoup de militants, obligés de chercher refuge ailleurs.
* 119 Cf. ANGOUSTURES A., art. cit. Pour un bilan général de l'application de la convention voir Les Réfugiés en France et en Europe. Quarante ans d'application de la convention de Genève, 1952-1992, Paris, OFPRA, 1994.
* 120 TEMIME Émile, « Émigration 'politique' et émigration 'économique' », in L'émigration politique en Europe aux XIX e et XX e siècles, cit., pp. 57-71.
* 121 HOERDER Dick, « Labor Migration and Workers Consciousness in the Atlantic Economies, 1830s to 1930s », in L'esilio nella storia del movimento operaio e l'emigrazione economica, cit., pp. 33-37 ; DEGL '1NNOCENTI M., art. cit., pp. 16-17.
122 GROPPO Bruno, « Entre immigration et exil : les réfugiés politiques italiens dans la France de l'entre-deux-guerres », Matériaux pour l'histoire de notre temps, n.° 44 (Numéro spécial « Exilés et réfugiés politiques dans la France du XX e siècle »), octobre-décembre 1996, pp. 27-35.
* 123 Ainsi, par exemple, aux États-Unis jusqu'au lendemain de la seconde guerre mondiale Cf. Maurice R. DAVIE, Refugees in America. Report of the Commission for the Study of Recent Immigration from Europe, New York, Harper and Bothers, 1947, p. 397.
* 124 Comme le montre, dans le cas de la France, la comparaison entre les réfugiés politiques italiens des années 20, qui purent s'insérer rapidement dans le marché du travail, et les réfugiés allemands des années 30, qui connurent les pires difficultés.
* 125 Avec l'exception, bien entendu, de la guerre civile grecque et de la guerre d'Algérie, qui s'est déroulée, sous la forme d'actes de terrorisme, même sur le territoire métropolitain. Au niveau de l'Europe dans son ensemble, ce sont les guerres de Yougoslavie qui ont interrompu presque un demi-siècle de paix.
* 126 De nombreux tsiganes (Roms), provenant surtout de Roumanie, ont demandé l'asile en Europe occidentale après 1989, mais il n'est pas sûr qu'on puisse les considérer comme des réfugiés proprement dits, en dépit des doutes qu'on peut avoir sur la nature démocratique du système politique post-communiste en Roumanie. IL en va de même pour les nombreux Albanais qui cherchent à s'installer en Italie et dans d'autres pays européens et qui sont des migrants économiques plutôt que des réfugiés politiques.
* 127 Même s'il ne faut oublier que l'exil est une constante de l'histoire latino-américaine au XIX e siècle.
* 128 DEGL'INNOCENTI M., « L'esilio nella storia contemporanea », art. cit., pp. 10 et 18.
* 129 « Au XIX e siècle, les exilés politiques sont les vecteurs classiques des idées révolutionnaires à travers l'Europe et l'Outremer. La dynamique et la circulation des idées politiques rentre dans un schéma connu d'un mouvement à double sens : d'un côté les exilés politiques diffusent leurs idées dans les pays qui les accueillent, de l'autre, ceux qui rentrent d'exil importent les idées et les expériences assimilées dans les pays où ils ont trouvé refuge » (C1UFFOLETTI Zeffiro, « L'esilio nel Risorgimento » , in L'esilio nella storia del movimento operaio e l'emigrazione economica, cit., p. 54.). Cf. aussi HAUPT Georges, « IL ruolo degli emigrati e dei rifugiati nella diffusione delle idee socialiste all'epoca della Seconda Internazionale », in Anna Kuliscioff e l'età del riformismo, pp. 59-68 ; DEGL'INNOCENTI M., art. cit., pp. 23-26.
* 130 Cf. PALMIER Jean-Michel, Weimar en exil. Le destin de l'émigration intellectuelle allemande antinazie en Europe et aux États-Unis, Paris, Payot, 1988.
* 131 L'exemple le plus éloquent est sans doute la Casa de España, devenue le Colegio de Mexico. Cf. L1DA Clara, La Casa de España en Mexico, Mexico. El Colegio de Mexico, I 988.
* 132 WOODFORD M , Revolutionary Exiles : The Russians in the First International and the Paris Commune, Londres, F.Cass, 1979. Voir aussi HAUPT G., art. cit.
* 133 Cf. GROPPO Bruno, « La figure de l'émigré politique », in DREYFUS Michel, GROPPO Bruno et al. (dir.), Le siècle des communismes, Paris, Éditions de l'Atelier, 2000, pp. 425-439.
* 134 L'exemple des mencheviks russes en exil est, de ce point de vue, particulièrement intéressant. Voir à ce sujet L1EBICH André, From the Other Shore. Russian Social Democracy a/ter 1921, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1997.
* 135 Cf. COLLOMP Catherine, GROPPO Bruno, « Le Jewish Labor Committee et les réfugiés en France 1940-1941 », communication présentée au colloque international «La France du repli : les réfugiés dans le Midi, 1940 » (Montauban, 10-14 mai 2000).
* 136 Il est opportun de ne pas confondre les régimes fascistes ou fascisants d'avant 1945 (et même d'après 1945, pour la péninsule ibérique) et les dictatures militaires, bien que ces dernières empruntent en général certains traits du fascisme (comme le nationalisme exaspéré et le recours à la violence).
* 137 Cf. à ce propos le poème de Bertold Brecht « Pensées sur la durée de l'exil », dans les Svendborger Gedichte, déjà cités.
* 138 Cf., pour une étude de cette problématique appliquée à l'émigration communiste italienne en France, GROPPO Bruno, « Los militantes comunistas italianos en Francia y el movimiento obrero francès en la entreguerras », Cuadernos del CISH (Centro de Investigaciones Socio Historicas, Universidad Nacional de La Plata), n.° 4, 1998, pp. 141-173.
* 139 BETTATI M., L'asile politique en question: un statut pour les réfugiés, Paris, PUF, 1985 ; NOIRIEL Gérard, La tyrannie du national. Le droit d'asile en Europe, 1793-1993, Paris, Calmann-Lévy, 1991 (réédité sous le titre Réfugiés et sans-papiers. La République face au droit d'asile XIXe- XXe siècle, cit.) ; NOREK Claude, DOUMIC-DOUBLET Frédérique, Le droit d'asile en France, Paris, PUF (Coll. Que sais-je ?), 1989 ; « Réfugiés et demandeurs d'asile », numéro spécial élaboré en commun par Hommes et Migrations, n. 1198-1199, et Hommes et Libertés, n. 89-90, mai-juin 1996; « Réfugiés et exilés », numéro spécial de la revue Relations Internationales, n. 74, été 1993.
* 140 Cf. MARQUES Pierre, Les enfants espagnols réfugiés en France (1936-1939), Paris, 1993 ; SCHAFRANEK Hans, Kinderheim Nr. 6. Österreichische und deutsche Kinder im sowjetischen Exil, Vienne, Döcker, 1998 ; PLA Dolores, Los niños de Morelia, Mexico, 1999.
* 141 Un exemple intéressant est le volume qui réunit quatre mille biographies de volontaires italiens qui combattirent en Espagne pour la République. Cf. AICVAS (Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna), La Spagna nel nostro cuore 1936-1939. Tre anni di storia da non dimenticare, Milan, AICVAS, 1996.
* 142 Pour l'émigration juive allemande voir par ex. BENZ Wolfgang (éd.), Das Exil der kleinen Leute. Alltagserfahrungen deutscher Juden in der Emigration, Munich, Beck, 1991.
* 143 Voir lettre à Mme Hugo du 19 janvier 1852.
* 144 Hugo le dit lui-même, à propos d'un co-proscrit de Jersey, M. de Treveneuc : "IL était encore au nombre de ces hommes qui doutaient de moi [...] croyant que je servais un peu tous les gouvernements, et avec une apparence de raison; me croyant ingrat à l'égard des Orléans [...] et croyant également avec une apparence de raison que je m'étais jeté dans la démocratie par esprit d'ambition et dans le but de devenir président de la République [aux élections de 1852]. Depuis, mon exil a changé tout. Alors cela lui a ouvert les yeux, comme à tous les hommes honnêtes qui [...] se rendent à l'évidence." (Le Journal d'Adèle Hugo, procuré par F.V. Guille, Minard, 1984, t. II, p. 210; les références seront données dans cette édition. Ajoutons que cette source est fiable : elle est souvent confirmée et jamais démentie par la correspondance, où, plus d'une fois, Hugo reprend, dans les mêmes termes, des propos tenus à son entourage -à moins que ce ne soit l'inverse.).
* 145 Cette confiance fut brève. Dès avril Hugo écrit à Adèle : "Je me défie un peu de notre coup d'oeil d'exilés et le tâche de ne pas me flatter. Après tout, que la Providence fasse ce qu'elle voudra. J'ai dix ans d'exil au service de la République." (lettre du 14 avril 1852) Dès ce moment Hugo prépare son installation, avec toute la famille, à Jersey, et la vente de son mobilier parisien.
* 146 Lettre à André van Hasselt du 6 janvier 1852.
* 147 Cité par Hugo dans une lettre à Adèle, sa femme, du 8 mars 1852.
* 148 On sait qu'elle résulte de la pression diplomatique française lorsqu'est connue la publication prochaine de Napoléon le Petit qui paraît en juillet 1852. Mais dès avril les bruits d'une invasion française puis les menaces de rétorsion ont beaucoup tempéré la solidarité belge envers les exilés et Hugo note "L'hospitalité belge devient de plus en plus maussade pour nos co-proscrits." Puis, en mai, "Il y a une sorte de persécution contre les proscrits français, persécution à laquelle j'échappe, je ne sais trop pourquoi ni comment." (Lettres à Adèle du 25 avril 1852 et à A. Vacquerie du 8 mai 1852) C'est le moment où, renonçant à Bruxelles, Hugo se tourne vers Londres pour son projet de librairie révolutionnaire internationale et pour le Moniteur universel des peuples; le mandataire de l'entreprise, Trouvé-Chauvel, s'y heurte aux mêmes réticences.
* 149 À Guernesey, l'accueil fut froid mais respectueux : on se découvre au passage de Hugo; mais il y eut des meetings en Angleterre pour protester contre l'expulsion.
* 150 Il est vrai que Hugo n'est pas dans le besoin. Le 25 décembre 1851, il annonce à sa femme qu'il a converti ses rentes françaises en titres anglais et belges, pour les mettre à l'abri d'une éventuelle spoliation, et qu'il compte en tirer 8000 F de rente annuelle. Après avoir craint de le perdre, il conserve aussi son traitement de l'Institut (1000 F par an). Mais ses ressources les plus importantes, celles du théâtre, sont perdues et les autres deviennent incertaines. Or il a une maisonnée nombreuse et volontiers dépensière à entretenir et il sait depuis longtemps que l'indépendance financière d'un écrivain engage la qualité même de son oeuvre. De là -avec un certain goût de l'austérité- les termes d'une de ses toutes premières lettres d'exil à sa femme : "...il faut vivre ici stoïque et pauvre et leur dire à tous : je n'ai pas besoin d'argent [...] Qui a besoin d'argent est livré aux faiseurs d'affaires, et perdu. Voir Dumas. Moi, j'ai un grabat, une table, deux chaises..." (11 janvier 1852). La vente aux enchères de son mobilier parisien fut tout à la fois une manifestation militante, une ressource et une précaution contre la confiscation. En revanche tous les documents indiquent que la proscription est largement indigente en raison de l'impossibilité où se trouvent la plupart des proscrits d'exercer leur métier. De là quantité d'initiatives auxquelles Hugo participe très régulièrement et avec générosité : collectes dès Bruxelles, "bazar" (vente de charité) organisé au profit des proscrits à Jersey en février 53, appel public à la solidarité des républicains "de l'intérieur" (Actes et Paroles, II, 4, "Appel aux concitoyens - 14 juin 1854, OEuvres complètes, "Politique", p. 467; les références aux oeuvres seront désormais données dans cette édition) qui a rapporté, au bout de trois mois, 1300 F, selon le Journal d'Adèle Hugo (t. 3, p. s310). Vers 1860, Hugo décide, en règle générale, d'exiger désormais et de faire verser à la caisse de secours des proscrits les droits annexes de son oeuvre (chansons par exemple, voir la lettre du 15 avril 1861 à A. Vacquerie). Ensuite, c'est au bénéfice des enfants pauvres de Guernesey qu'il verse ces revenus -ceux, par exemple, du livre de gravures tirées de ses dessins publié par l'éditeur Castel (voir lettre du 5 octobre 1862).
* 151 Mais la fille de Hugo note dans son journal, le jour même de son arrivée : "Il ne se trouve en fait de personnages connus à Jersey que le général Le Flô."
* 152 Lettre de V. Hugo à son fils François-Victor du 14 avril 1852.
* 153 Lettre à Mme de Girardin du 4 janvier 1855.
* 154 Lettre à Adèle du 17 mai 1 852.
* 155 Phrase notée par Hugo dans son agenda, entre guillemets et sans commentaire, à la date du 3 octobre 1858. (Agendas de Guernesey, V. Hugo, OEuvres complètes, édition J. Massin citée, 1.10, p. 1456) Dix ans après, c'est chose faite : "Je voudrais que tous vous reprissiez en gré ce pauvre Hauteville-House, si désert sans vous. Mon coeur se remplit d'ombre quand j'entre dans vos chambres vides." (lettre à Mme Hugo, 22 novembre 1867)
* 156 Les affaires les plus connues, mais ce ne sont pas les seules, concernent Heurtebise en 1 854 et, en 1853, Hubert. Hugo a lui-même écrit le récit de cette dernière, voir Choses vues. Le Temps présent V, Affaire Hubert dans OEuvres complètes, vol. "Histoire", Laffont-Bouquins, 1987, p. 1261 et suiv. Voir aussi note suivante et cette définition de Hugo : "La Proscription est un composé de mouchards et de héros; c'est un excellent consommé dans lequel M. Bonaparte a fait ses ordures." (Le Journal d'Adèle Hugo, t. III, p. 160)
* 157 Le Journal d'Adèle Hugo, édition citée, t. III, p. 304.
* 158 Hugo s'en amuse souvent, mais les autres proscrits s'exaspéraient dans des querelles absurdes, s'abstenant par exemple d'aller au théâtre pour ne pas devoir se lever au God save the Queen...
* 159 On ne peut pas faire mieux sur ce point que de renvoyer à l'étude très précise de Pierre Angrand, Victor Hugo raconté par les papiers d'État, Gallimard, 1961.
* 160 Hugo en a une conscience très exacte, à preuve cette analyse subtile des différentes sortes d'exil "littéraire" : "...j'ai l'exil, l'exil sombre, exil abandonné. Je n'ai même pas cet exil consolant qu'on avait sous la Restauration, ou cet exil à Coppet de Mme de Staël, cet exil paré et consolé par les correspondances de toute la presse. C'est à peine si aujourd'hui la presse française ose prononcer mon nom. Le Siècle a été averti pour un article fait sur moi et si demain je me cassais la jambe, Émile de Girardin oserait à peine mettre dans La Presse : Un accident fâcheux est arrivé à M. Victor Hugo. Hier en tombant de cheval, il s'est cassé la jambe." (Le Journal d'Adèle Hugo, t. III, p. 207) Il est vrai que ce commentaire date de 1854; quelques années plus tard, il ne serait plus adéquat.
* 161 La mémoire et le savoir, relayant en quelque sorte l'exil par l'oubli, se sont longtemps détournés de ces malheureux. Il faut saluer le travail de pionnier que Sylvie Aprile a entrepris de leur consacrer et regretter que nos pages, trop générales et trop rapides, ne puissent en retenir qu'une impression diffuse.
* 162 Lettre à Paul Meurice du 9 décembre 1858.
* 163 Hernani, II, 4; édition citée, "Théâtre 1", p. 580.
* 164 Lettre du 22 juillet 1855.
* 165 Lettre du 23 décembre 1855.
* 166 Lettre à Villemain du 9 mai 1856.
* 167 Lettre à Frantz Slevens du 10 avril 1856.
* 168 Le thème alimente tout Châtiments, mais aussi l'échange personnel. Voir, par exemple, ceci, dans une lettre à Louise Colet (17 mars 1857): "IL me semble qu'on est bien heureux en France en ce moment. Bonheur de cloaque, mais bonheur [...]. Je ne l'envie pas ce bonheur, j'aime l'exil. Il est âpre, mais libre."
* 169 Carnets, albums, journaux, dans V. Hugo, OEuvres complètes -édition chronologique publiée sous la direction de Jean Massin, C.F.L., t. 9, p. 1 148.
* 170 Ibid.
* 171 Ce que c'est que l'exil. II, édition citée, vol. "Politique", p. 398.
* 172 Ibid. XIII, p. 414.
* 173 Ibid.
* 1 Compte rendu établi à partir de la traduction simultanée.
* 2 Compte rendu établi à partir de la traduction simultanée.
* 3 Compte rendu établi à partir de la traduction simultanée.







