C. LES MARCHÉS FINANCIERS ET LA SPÉCULATION
Nous avons dit, dans un souci de simplification, que les marchés financiers et les institutions qui les supportent se contentaient de recycler l'épargne qui, à défaut, resterait économiquement stérile. Dit aussi que, sans l'intervention des banques commerciales, ce circuit ne produisait ni valeur ni monnaie. La réalité est nettement plus compliquée, du fait :
- qu'entre les acteurs intervenant sur et autour des marchés les titres échangés fonctionnent comme une quasi-monnaie tant qu'on est capable d'attribuer un prix à chacun ;
- que les marchés fonctionnent, et de plus en plus, comme des machines à bulles spéculatives et comme des casinos.
1. La nature plurielle de la monnaie
Quelque part, un titre monétaire obtenu en échange d'un bien ou d'un service (billet de banque, dépôt bancaire...) est un droit de tirage sur la richesse commune à ceux qui partagent la même monnaie. C'est une « promesse » de consommation future pour celui qui le possède, un titre convertible en un bien de même valeur, l'un des problèmes étant la conservation dans le temps de cette valeur. Or, celle-ci pourra varier en fonction de l'évolution du rapport entre la richesse disponible et la quantité de monnaie en circulation, et aussi de la crédibilité de l'autorité qui garantit cette monnaie. Ainsi tient-on généralement l'État pour seul légitime à « battre monnaie » puisque seul capable de garantir, éventuellement par le cours forcé, que la monnaie en circulation ne deviendra pas une « monnaie de singe ». Si l'Histoire peut accréditer ce sentiment largement fondé s'agissant des économies prémodernes, peu monétarisées et largement agricoles, il ne correspond aucunement à la complexité des économies modernes monétaires. Plutôt que de la monnaie au singulier, il serait plus exact de parler de monnaies au pluriel.
La plus ancienne est la monnaie émise par les banques centrales, plus ou moins sous le contrôle des États selon les époques. Vient ensuite la monnaie scripturale émise par les banques commerciales et enfin, aujourd'hui, fonctionnant comme une monnaie quand tout va bien, ce qu'on peut appeler une « quasi-monnaie », composée de titres financiers échangeables entre eux et au final contre de la monnaie banque centrale.
Pour bien faire comprendre ce qu'est la monnaie, son rôle très particulier dans la machine économique, John Kenneth Galbraith racontait, avant tout exposé technique, un apologue dont est librement inspiré celui qui suit.
Dans une minuscule principauté imaginaire, l'ensemble des besoins des habitants était satisfait par huit commerçants et artisans pratiquant chacun 25 % de marge bénéficiaire.
Un matin, le tailleur voit, débarquant d'une splendide voiture, un homme décidé, habillé du dernier chic. Une fois dans la boutique, sans discuter les prix, il achète pour 1 000 florins de costume qu'il règle par chèque sur la banque locale, au nom de...Rothschild.
Le tailleur ne revient ni des 250 florins de bénéfice qu'il vient de faire, ni de celui à qui il le doit. Se souvenant qu'il devait achever la construction de sa maison, tout heureux, il endosse le chèque et se précipite chez le maçon pour lui conter l'affaire et lui demander de venir terminer le travail qu'il avait dû arrêter faute de moyens. Il paie avec le chèque de 1000 florins que le maçon endosse à son tour, ébloui lui aussi par ce bénéfice inattendu de 250 florins et plus encore qu'il puisse le devoir à Rothschild.
Le manège se répète ainsi jusqu'au huitième artisan-commerçant qui, lui, se rend à la banque pour y déposer le chèque où Rothschild est censé avoir son compte... et apprend que le chèque est une contrefaçon sans valeur. Dépité et furieux, il retourne auprès de celui qui lui avait remis le chèque, avec celui-ci auprès du sixième escroqué et ainsi de suite, jusqu'au premier de la chaîne. Désemparés, les voilà tous devant le banquier qui leur tient à peu près ce langage : « Messieurs, vous avez deux solutions. La première, vous laissez votre collègue avec son chèque sans provision sur les bras. Il fera probablement un procès à celui dont il le tient, ce dernier au précédent ; jusqu'au premier berné qui pourra légitimement plaider la bonne foi. Seule chose certaine dans ce genre d'aventure judiciaire : elle coûtera à tous, plus que chacun ne peut espérer en retirer.
« La seconde solution, celle que je vous recommande, serait de vous arranger. Après tout, chacun a réalisé 1 000 florins de travaux et 250 florins de bénéfice, comme l'attestent vos livres de comptes. En acceptant de mettre la moitié de ces 250 florins dans un pot commun, vous réunirez 1 000 florins et de quoi honorer le chèque en bois qui ne sera plus qu'un mauvais souvenir. »
Ainsi, 1 000 florins de monnaie de singe ont-ils produit 8 000 florins de PIB de la principauté et 1 000 florins de bénéfices dans les livres de comptes de ses brillants entrepreneurs.
On l'aura compris, pour que le système marche, la circulation des créances qui fonctionnent ainsi comme une « quasi-monnaie » ne doit pas s'arrêter, le moment crucial étant celui de sa transformation en monnaie banque centrale, le seul « équivalent général » accepté par tous. Tant que ce moment est différé, les affaires peuvent continuer.
Compte tenu des difficultés qu'aurait engendrées la faillite de l'appareil productif de la principauté, on peut parier que sa banque centrale aurait échangé le chèque en bois présenté par la banque où les artisans ont leur compte, contre des florins, le chèque allant dormir pour l'éternité dans son bilan. C'est en tous cas ainsi que les choses se sont passées lors des crises systémiques, les banques centrales (Fed, BCE, BoE 8 ( * ) ...) rachetant aux banques commerciales les titres dépréciés, voire sans valeur, qui plombaient leurs bilans. Mais comme c'est profondément immoral, mieux vaut entourer cela d'un halo de brume.
Fondamentalement, le système économico-financier mondial fonctionne comme celui de notre principauté imaginaire. Il est parcouru, inextricablement liés, de flux de biens et de monnaies plus ou moins « liquides », c'est-à-dire plus ou moins facilement échangeables contre d'autres monnaies et d'autres biens, selon une gradation allant de la monnaie banque centrale (équivalent général) aux reconnaissances de dettes qui n'ont qu'une fiabilité d'emprunt, en passant par la monnaie scripturale des banques.
Le moteur du système, c'est le crédit, premier créateur de monnaie ; la fausse (créances douteuses des bilans) comme la vraie, garantie en bout de course par les banques centrales et les États. Ce sont autant de droits de tirage sur une fraction de la richesse du monde.
Comme dit l'économiste Pierre-Noël Giraud dans son ouvrage éponyme, la finance, dans son ensemble, n'est jamais qu'un « commerce de promesses » 9 ( * ) . Tant que la confiance règne, tout va bien, le prix des actifs, les dividendes et les taux d'intérêt augmentent. Quand le commerce des promesses devient spéculation et s'emballe, le doute sur leur qualité s'installe, la liquidité d'une bonne partie du flux monétaire disparaît, le système bancaire se bloque et c'est le krach.
2. La spéculation
La valeur des titres censés financer l'économie qui s'échangent sur les marchés - des actions par exemple - dépend non pas seulement, voire même de moins en moins, du revenu qu'on en espère - fonction lui-même de la santé économique des entreprises qui les émettent - mais de l'engouement ou de la défiance pour le titre . L'engouement fait monter les prix, ce qui en retour augmente l'engouement, dans l'espoir de revendre avant que le château de cartes ne s'effondre.
Le premier à avoir analysé ce qui allait devenir l'une des caractéristiques des marchés financiers « modernisés » d'aujourd'hui, c'est John Maynard Keynes, dans la Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie , ouvrage publié en 1936, alors même que la Grande crise n'était pas achevée.
Keynes entend par « spéculation » la tendance à investir non pas en fonction des revenus tirés de l'entreprise, de l'activité dont on acquiert un titre de propriété (action), mais en fonction de ce qu'on imagine que les autres pensent de l'évolution de la valeur de ce titre de propriété en bourse, en fonction de la tendance, du « consensus » : « Le risque d'une prédominance de la spéculation [sur le revenu issu de l'entreprise] tend à grandir à mesure que l'organisation des marchés financiers progresse. Dans une des principales bourses des valeurs du monde, à New York, la spéculation [...] exerce une influence énorme [...] Il est rare, dit-on, qu'un Américain place de l'argent "pour le revenu" ainsi que nombre d'Anglais le font encore ; c'est seulement dans l'espoir d'une plus-value qu'il est enclin à acheter une valeur. Cela n'est qu'une autre manière de dire que, lorsqu'un Américain achète une valeur, il mise moins sur le rendement escompté que sur un changement favorable de la base conventionnelle d'évaluation, ou encore qu'il fait une spéculation au sens précédent du mot. Les spéculateurs peuvent être aussi inoffensifs que des bulles dans un courant régulier d'entreprise. Mais la situation devient sérieuse lorsque l'entreprise n'est plus qu'une bulle d'air dans le tourbillon spéculatif. Lorsque, dans un pays, le développement du capital devient le sous-produit de l'activité d'un casino, il risque de s'accomplir en des conditions défectueuses. Si on considère que le but proprement social des bourses de valeurs est de canaliser l'investissement nouveau vers les secteurs les plus favorables sur la base des rendements futurs, on ne peut revendiquer le genre de succès obtenu par Wall Street comme un éclatant succès du laisser-faire capitaliste [...]
« Devant le spectacle des marchés financiers modernes, nous avons parfois été tentés de croire que si, à l'instar du mariage, les opérations d'investissement étaient rendues définitives et irrévocables, hors le cas de mort ou d'autre raison grave, les maux de notre époque pourraient en être utilement soulagés ; car les détenteurs de fonds à placer se trouveraient obligés de porter leur attention sur les perspectives à long terme et sur celles-là seules . »
3. La fonction économique nouvelle de la spéculation
La spéculation n'est pas plus dangereuse pour le financement de l'économie que les casinos tant qu'elle reste marginale, qu'elle ne représente, comme écrit Keynes, seulement que quelques « bulles » dans le courant d'investissement dont l'économie a besoin et tant que les spéculateurs risquent uniquement leur propre argent. Elle le devient quand c'est l'entreprise qui apparaît comme support de la spéculation et inversement l'un des moteurs essentiels de l'économie. C'est précisément ce qui s'est passé.
a) L'entreprise parasitée par la spéculation
Les revenus spéculatifs vont, en effet, prendre de plus en plus de place à côté des dividendes pour les actionnaires. On est loin de l'image d'Épinal de l'Investisseur garant du bon fonctionnement de l'économie.
Résultats à court terme et valorisation financière des entreprises qui en découle deviennent l'objectif prioritaire des actionnaires comme des gestionnaires. S'ils concèdent un droit d'existence à l'entreprise, c'est comme support de la spéculation, au détriment de l'investissement, de l'emploi et des salaires, perversion principale du système et cause systémique de la crise.
Un taux de 15 % de ROE (« return on equity »), c'est-à-dire de rendement des fonds investis, souvent pour une courte période, devient l'objectif normalement attendu des entreprises, objectif intenable sans suppressions massives d'emplois par des fusions-acquisitions, des délocalisations et diverses acrobaties, comme le rachat de ses propres actions par une entreprise, pour en faire grimper le cours et rassurer les actionnaires.
Les stock-options sont un autre moyen d'améliorer la rémunération des cercles dirigeants des entreprises et de lier leurs intérêts à ceux des actionnaires. Ce qui guide les grands managers est non plus le pouvoir par la construction d'un empire industriel, comme au temps du capitalisme managérial des Trente Glorieuses décrit par John Kenneth Galbraith, mais l'enrichissement patrimonial.
Le rêve des libéraux les plus extatiques serait que la rémunération du travail, par la distribution d'actions négociables ou qui se valoriseraient à l'infini, se substitue au salaire. Ainsi prendrait fin la lutte des classes, du moins le pensent-ils !
Les entreprises pouvant être achetées à crédit, on peut s'enrichir facilement en leur faisant payer, une fois acquises, le remboursement de l'emprunt ayant servi à les acquérir. Si l'opération n'est pas assez juteuse, reste à la revendre par morceaux, la valeur des actifs de l'entreprise étant souvent plus élevée que son prix de vente.
La valeur de l'action d'une entreprise comptant tout autant que le dividende versé, il peut aussi être plus intéressant pour les managers de racheter leurs propres actions pour en faire monter le prix, plutôt que d'investir la liquidité dont dispose l'entreprise pour la rendre plus productive. D'autant que, en période de stagnation économique, nombre de grandes entreprises regorgent de cash . Ce qui manque, ce sont les consommateurs.
Une autre conséquence fâcheuse de cette transformation de l'entreprise en support de la spéculation, c'est de la soumettre à la dictature du court terme. Son développement, ses investissements sont pensés non plus sur le long terme mais en fonction de la rentabilité immédiate. L'avenir est ainsi sacrifié au court terme.
Signe qui ne trompe pas, la diminution de la durée moyenne de détention des actions . De l'ordre d'un an en 1930 à la bourse de New York, elle grimpe à sept ans et trois mois en 1960 pour redescendre à un an en 2010. Même chute pour la bourse de Londres : sept ans en 1970, huit mois en 1985 et en 2010, après une baisse quelques années plus tôt. Selon une enquête de la Banque de France, en 1999, la durée de détention moyenne des actions françaises cotées était de huit mois, ce qui est du même niveau.
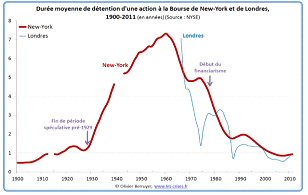
Cela dit, après l'explosion du trading haute fréquence (THF) 10 ( * ) , on peut s'interroger sur la signification de ces moyennes quand on sait que cette pratique récente sur les actions représenterait globalement quelque 90 % des ordres et 40 % des échanges (75 % des échanges aux États-Unis et 30 % en Europe). En fait, faute de chiffres fiables, on conclura simplement :
- que les durées de détention des actions varient de façon abyssale selon les types d'investisseurs, vocable qui n'a plus aucun sens s'agissant du THF ;
- que cette excroissance monstrueuse qu'est devenu le THF sur le corps économique serait sans grande portée pratique si elle ne signifiait pas une neutralisation de fonds qui seraient mieux employés ailleurs et que cette pratique ne mettait pas les entreprises à la merci d'une bouffée spéculative délirante.
b) La spéculation, moteur économique
Dopée par la hausse régulière du prix des biens et par les prêts hypothécaires « rechargeables », c'est-à-dire augmentables en fonction de la hausse des biens qui les garantissent, la spéculation immobilière a été l'un des moteurs essentiels de la croissance économique mondiale des dix années précédant la crise dite des « subprimes », du nom de ces prêts hypothécaires accordés par wagons à des débiteurs peu, voire non solvables.
La consommation des ménages américains conditionnant 70 % de la croissance des États-Unis et 30 % de la croissance mondiale, personne n'avait intérêt à décourager la bulle financière qui se constituait. On estime à 13 % du PIB américain le produit de cette spéculation immobilière, responsable en 2005-2006, selon les spécialistes, de la moitié de la croissance. Sans elle, la Grande-Bretagne et la zone euro seraient entrées en récession avant la crise, tout particulièrement l'Espagne. Hormis l'Allemagne, qui devait sa faible croissance à ses exportations, c'est largement l'endettement immobilier des ménages qui a alimenté la progression du PIB jusqu'à la crise. Pour les années de référence, on lui devait 5 % de la hausse des PIB espagnol et britannique, et la moitié des 2 % de croissance française.
Ces possibilités spéculatives vont se trouver décuplées par le rajeunissement d'un vieil outil, le prêt hypothécaire devenu « rechargeable », et par une innovation, la « titrisation » 11 ( * ) . Les titres dérivés de crédits hypothécaires 12 ( * ) représentaient, en 2007, 5 200 milliards de dollars, contre 4 900 milliards de dollars pour les obligations d'État du Trésor américain. À part ça, c'est l'endettement public qui serait à l'origine de la crise de 2008, dit-on !
c) Quand les banquiers peuvent se prévaloir de leur propre turpitude
Mais la spéculation n'est pas seulement un danger pour l'entreprise, elle l'est aussi pour les déposants des banques quand celles-ci se mettent à spéculer avec les dépôts qui leur ont été confiés , au risque de les voir s'envoler si les choses tournent mal.
Illégale aux États-Unis depuis le Glass-Steagall Act (1933), l'une des premières mesures de Roosevelt, cette pratique sera progressivement réintroduite dès le milieu des années 1970 avant d'être légalisée par le Financial Services Modernization Act, sous l'administration de Bill Clinton (1999).
En France, l'obligation de séparation des banques de dépôt et d'investissement sera effective jusqu'à la loi bancaire Mauroy-Delors (1984), créant le modèle français de banque universelle.
Au moment de la crise, il deviendra clair que ce privilège accordé aux banquiers de pouvoir spéculer avec des fonds qui ne leur appartiennent pas et sans l'accord de leurs propriétaires représente un moyen de chantage à l'intervention des États en cas de catastrophe . Sous la menace de voir emportée dans la déroute une foule de déposants et d'épargnants qui n'y sont pour rien, de voir à leur tour en difficulté les établissements avec lesquels la banque faillie est en relation d'affaires, les États et les banques centrales sont obligés de venir à son secours. « Too big to fail », pourquoi se priverait-elle d'en profiter ? D'autant plus que cette garantie assurée gratuitement par l'État permet aux grandes banques d'emprunter sur les marchés à des taux plus bas que les petites...
4. L'impératif de la liquidité
En cas de besoin, les banques peuvent obtenir la monnaie la plus liquide auprès de la banque centrale. C'est aussi, dans la zone où elle a cours légal, la seule à être totalement liquide, c'est-à-dire à conserver sa valeur quelle que soit la quantité échangée. Que l'on dépense 100 euros ou 100 000 euros, les billets gardent la même valeur.
Sur le marché des titres, il en va différemment. Celui qui vend dix mille actions a toutes les chances que leur prix unitaire soit plus bas que s'il n'en vendait que cent. Plus un marché assure la stabilité des prix indépendamment des quantités échangées, plus il est dit liquide. On l'aura compris : plus les marchés sont étroits, moins ils sont liquides, d'où la recherche de leur globalisation. Rien à voir avec une croisade contre la xénophobie.
On l'aura aussi compris : maintenir la liquidité des marchés, garante de « l'échangeabilité » des titres à tout moment, est essentiel à leur bon fonctionnement. Corrélativement, pour que des titres soient échangeables, il faut qu'on en connaisse le prix à tout moment. Le prix étant fourni par le marché, il est tout aussi essentiel d'entretenir les achats et les ventes des titres, même sans finalité économique ou financière, essentiel qu'il y ait des « teneurs de marché ».
C'est l'une des justifications du trading haute fréquence et de la spéculation elle-même. La spéculation crée le besoin de spéculation.
* 8 Federal Reserve, Banque centrale européenne, Bank of England.
* 9 Le commerce des promesses. Petit traité sur la finance moderne - Seuil - 2001.
* 10 Transactions financières exécutées à grande vitesse, en quelques microsecondes, grâce à l'utilisation d'algorithmes informatiques. Cette pratique, dominante aux États-Unis depuis 2005, s'est imposée dans le système boursier international, ce qui peut poser des problèmes réglementaires et éthiques.
* 11 Voir infra, dans la troisième partie, le développement intitulé « La financiarisation de l'économie ».
* 12 RMBS, Residential Mortgage Backed Security.







