Rapport Général n° 85 Tome I - Projet de loi de finances pour 1998 - Le budget de 1998 et son contexte économique et financier
M. Alain LAMBERT, Sénateur
Commission de finances, du Contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation - Rapport n° 85 Tome I - 1997/1998
Table des matières
- INTRODUCTION
-
CHAPITRE PREMIER
LE CADRAGE ECONOMIQUE DU PROJET DE BUDGET :
DES HYPOTHESES FRAGILES
- I. L'ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE : LE PARI RISQUÉ DU GOUVERNEMENT
-
II. RENFORCEMENT DES ALÉAS EXTÉRIEURS ET EFFETS PERVERS DE LA NOUVELLE
POLITIQUE ÉCONOMIQUE
- A. NUAGES SUR L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL DE LA FRANCE
-
B. UN FACTEUR AGGRAVANT : LES DÉCISIONS DU NOUVEAU GOUVERNEMENT
- 1. La reprise de la consommation des ménages est conditionnée par l'amélioration de l'emploi et contrainte par l'alourdissement des charges fiscales globales
- 2. L'investissement : une attente toujours déçue dont la politique du gouvernement risque d'éloigner encore le terme
- 3. Le faux débat du partage de la valeur ajoutée
-
CHAPITRE II
LES DANGERS DE LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES "A LA FRANÇAISE"- I. UNE MAÎTRISE DES DÉPENSES QUI RESTE À ACCOMPLIR
-
II. LA RÉFORME DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES DOIT ÊTRE ENGAGÉE
- A. L'IMPACT DES CHARGES FISCALES ET SOCIALES SUR LA LOCALISATION D'ACTIVITÉ
- B. LA COMPÉTITIVITÉ HANDICAPÉE PAR LA STRUCTURE FISCALE FRANÇAISE
-
C. L'ALLÉGEMENT DU POIDS DE LA FISCALITÉ FRANÇAISE DOIT ACCOMPAGNER LA
NÉCESSAIRE HARMONISATION DES FISCALITÉS EUROPÉENNES
- 1. L'Union Economique et Monétaire encourage la concurrence fiscale
- 2. La France, qui dispose d'un système fiscal non compétitif par rapport à ses concurrents européens, pourrait bénéficier des progrès de l'harmonisation européenne
- 3. L'harmonisation européenne est à l'ordre du jour
- 4. Il est toutefois nécessaire d'aller plus loin
-
CHAPITRE III
LES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
DE L'ÉQUILIBRE PROPOSÉ- I. L'ÉQUILIBRE PROPOSÉ REPOSE SUR UNE AGGRAVATION DE LA PRESSION FISCALE
- II. LA MAÎTRISE DES DÉPENSES EST INEXISTANTE
- III. L'ÉQUILIBRE PROPOSÉ N'AMÉLIORE PAS SUFFISAMMENT LE SOLDE BUDGÉTAIRE
-
CHAPITRE IV
LES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DE LA CROISSANCE DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
EN 1998 -
CHAPITRE V
LA NON-MAÎTRISE DES DÉPENSES EN 1998-
I. UN EFFORT D'ÉCONOMIE ?
- A. LES DEUX APPROCHES POSSIBLES
-
B. LES CHOIX DE RÉDUCTION DE DÉPENSES EN 1998
-
1. La révision des services votés répartie entre trois budgets
- a) Au budget des charges communes : un ralentissement de la politique d'allégement de charges sur les bas salaires
- b) Au budget de l'emploi : des suppressions de mesures pourtant majoritairement ciblées au bénéfice de l'emploi privé
- c) Au budget du logement : une restriction de l'aide à l'accès à la propriété
- 2. Les "autres économies"
- 3. Les économies sur le budget de la défense : une révision lourde de conséquences
-
1. La révision des services votés répartie entre trois budgets
- II. QUELLES PRIORITÉS BUDGÉTAIRES ?
- III. ALLER PLUS LOIN DANS LA MAÎTRISE DES DEPENSES PUBLIQUES
-
I. UN EFFORT D'ÉCONOMIE ?
- EXAMEN EN COMMISSION
N° 85
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès verbal de la séance du 20 novembre 1997.
RAPPORT GÉNÉRAL
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi de finances pour 1998 , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE ,
Par M. Alain LAMBERT,
Sénateur,
Rapporteur général.
TOME I
LE BUDGET DE 1998
ET SON CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Christian Poncelet,
président
; Jean Cluzel, Henri Collard,
Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Philippe Marini,
René Régnault,
vice-présidents
; Emmanuel
Hamel, Gérard Miquel, Michel Sergent, François Trucy,
secrétaires
; Alain Lambert,
rapporteur
général
; Philippe Adnot, Bernard Angels, Denis Badré,
René Ballayer, Bernard Barbier, Jacques Baudot, Claude Belot,
Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël
Bourdin, Guy Cabanel, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Yvon
Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut,
Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Marc Massion, Michel
Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Maurice Schumann,
Henri Torre, René Trégouët.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
230, 305
et
T.A.
24
Sénat
:
84
(1997-1998).
|
Lois de finances. |
INTRODUCTION
La France est un grand pays, la quatrième puissance
industrielle du monde, mais l'ouverture de son économie au monde appelle
de sa part une adaptation rapide.
Pourtant, elle voudrait croire encore, pour un temps, qu'elle pourrait imposer
son modèle et que pour elle, peut-être, rien ne pourrait changer.
Mais les faits sont têtus : l'économie n'a plus de
frontières et le fléau du chômage frappe durement. Ces deux
raisons au moins interdisent au pays de différer plus longtemps les
ajustements nécessaires.
Au fond d'elle-même, la France sait que pour relever ce défi, il
lui faut accepter de se réformer.
Alors, elle hésite, elle doute, elle tente une dernière
chance : elle accélère les alternances, elle change ses
gouvernements pour éviter de changer ses habitudes.
Mais, rien n'y fera : la compétition économique mondiale
dans laquelle elle est inscrite l'oblige à s'adapter, sans remettre en
cause l'impératif de cohésion sociale.
La France saura concilier ces exigences car elle en a le génie. Il lui
faut cependant imposer à ses gouvernants d'abandonner leurs mauvaises
habitudes : dépenser plus que nos concurrents, et donc lever plus
d'impôts qu'eux ; reporter sur les générations futures
le poids de nos déficits ; freiner le dynamisme de nos entreprises
en les chargeant de prélèvements fiscaux et sociaux toujours plus
lourds et pratiquer la traque fiscale sur les plus performants des nôtres
au risque de les décourager et de les voir fuir à
l'étranger.
Les solutions sont là ; elles sont à notre portée
pour peu que, dans un face à face sincère avec la
réalité, une politique courageuse soit proposée au pays.
Elle se résume simplement :
dépenser moins pour
prélever moins,
donner à la France et aux Français
l'ambition, l'envie d'entreprendre et de partir à la conquête du
monde, non pour y imposer un modèle économique
périmé, mais pour y ouvrir le chemin qui concilie performance et
cohésion, efficacité économique et harmonie sociale en
France et en Europe.
Ce sera le devoir et l'honneur du Sénat d'incarner cette nouvelle
politique, celle de la responsabilité et du progrès.
CHAPITRE PREMIER
LE CADRAGE ECONOMIQUE DU PROJET DE
BUDGET :
DES HYPOTHESES FRAGILES
I. L'ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE : LE PARI RISQUÉ DU GOUVERNEMENT
La prévision de croissance pour 1998 associée au
projet de loi de finances s'élève à 3 %.
Le tableau ci-dessous expose l'évolution du produit intérieur
brut et de ses différents déterminants en 1997 et 1998.
L'équilibre du PIB en volume en 1997 et en 1998
Taux de croissance annuel
(en %)
|
1997 |
1998 |
|
|
Demande intérieure totale
|
1,5
|
2,5
|
|
Commerce extérieur
|
6,9
|
5,7
|
|
PIB |
2,2 |
3,0 |
Source : INSEE
On constate que la croissance de l'activité, en reprise dès 1997,
s'accélérerait encore en 1998, passant entre ces deux
années de
2,2 % à 3 %.
L'année prochaine verrait donc l'amplification d'un mouvement
amorcé dès cette année. Celle-ci serait permise par une
accélération de la demande intérieure.
A. LA REPRISE AMORCÉE À PARTIR DE FIN 1996...
1. Bref retour sur 1996
La croissance économique s'était établie
en 1996 à 1,2 % en volume. Le premier semestre 1996 avait,
dans le prolongement du dernier trimestre de l'année
précédente, débouché sur un rythme très
faible de l'activité. Le second semestre devait enregistrer un
début d'amélioration de la conjoncture mais, au total, la
croissance fut décevante.
Le tableau ci-après rend compte des écarts entre les
prévisions économiques pour 1996 et l'évolution
économique effectivement constatée.
(en %)
|
Taux de croissance
annuel
|
Taux de croissance annuel
|
|
|
Demande intérieure totale
|
2,9
|
0,7
|
|
Commerce extérieur
|
5,1
|
4,8
|
|
PIB |
2,8 |
1,2 |
Source : INSEE
Les écarts entre la prévision de croissance et la croissance
réalisée en 1996 s'expliquent
par une erreur portant sur
l'évolution de la demande intérieure
qui s'est
révélée trop optimiste, et que n'a pas suffisamment
compensée
une erreur de prévision sur l'évolution du
commerce extérieur
qui, finalement, fut plus favorable
qu'escompté.
Au total, la contribution de la demande intérieure à la
croissance du PIB a été inférieure de 2 points aux
prévisions tandis que celle du commerce extérieur a
été supérieure de 0,5 point.
Toutes les composantes de la demande intérieure ont
évolué moins vite que prévu, mais l'écart a
été maximal sur la demande des entreprises.
Plutôt que
de s'accroître de 8 %, l'investissement des entreprises a
décru de 1,5 %. Quant aux variations de stocks, on attendait
qu'elles contribuent pour 1 point à la croissance du PIB alors
qu'elles ont engendré une contraction de 0,5 point de la production.
A l'inverse, mais dans des proportions plus réduites, le commerce
extérieur a apporté un soutien conséquent à la
croissance
, en expliquant 0,5 point, malgré une expansion des
exportations moins forte que prévu, mais grâce à une
croissance des importations beaucoup moins élevée
qu'escompté.
L'année 1997 s'ouvrait donc sur un panorama
contrasté
:
- un faible acquis de croissance de 0,8 % en volume calculé
sur la base du PIB du dernier trimestre 1996,
- un frémissement de reprise depuis le second semestre 1996,
- une composition de la croissance où la part des échanges
extérieurs était primordiale, malgré une évolution
de la consommation des ménages plus soutenue que l'évolution de
leur pouvoir d'achat aurait permis de supposer.
L'évolution de l'investissement pouvait être jugée comme la
manifestation d'une situation plus globale de défaut de dynamisme de la
demande intérieure.
2. Début de reprise en 1997 ?
a) Un consensus des prévisionnistes
Un consensus s'est établi entre les différents prévisionnistes pour estimer à 2,2 % la croissance en 1997 . Les différentes prévisions pour 1997 sont en effet les suivantes.
Principales prévisions pour 1997
|
BUD.ECO 1 |
BIPE |
CDC |
COE |
GAMA |
REXECODE |
OFCE |
AFEDE |
EXPANSION |
|
|
VOLUMES
|
|||||||||
|
PIB |
2,2 |
2,3 |
2,3 |
2,2 |
1,9 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,2 |
|
Importations |
4,3 |
6,0 |
6,3 |
5,7 |
4,6 |
5,7 |
4,2 |
6,0 |
6,6 |
|
Consommation des ménages |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FBCF totale
|
1,3 |
0,7 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
- 0,2 |
- 0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
SQS-EI |
1,8 |
1,0 |
0,7 |
1,0 |
0,8 |
0,6 |
0,4 |
0,7 |
0,5 |
|
Ménages hors EI |
- 0,1 |
0,2 |
- 1,3 |
- 1,3 |
- 1,3 |
- 0,6 |
- 1,0 |
- 1,0 |
|
|
Exportations |
6,9 |
8,9 |
10,5 |
9,7 |
8,1 |
10,1 |
9,1 |
9,5 |
10,0 |
|
Variations des stocks (contribution à la croissance du PIB) |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,5 |
1. Budgets économiques
Source : Commission des comptes et des budgets économiques de la Nation. Octobre 1997.
Il s'agit bien là de prévisions puisque, malgré la date assez avancée dans l'année où est rédigé ce rapport, les seuls résultats connus concernent le premier semestre de l'année en cours.
b) Des résultats relativement encourageants
Résultats du premier semestre 1997
(en milliards de francs)
|
1997 |
1995 |
1996 |
Acquis 3 |
||
|
T1 1 |
T2 2 |
1997 |
|||
|
Produit intérieur brut
|
958,5
|
968,1
|
3.743,4
|
3.800,8
|
|
|
Importations
|
284,6
|
293,4
|
1.087,2
|
1.117,3
|
|
|
Total des ressources
|
1.243,2
|
1.261,5
|
4.830,6
|
4.918,1
|
|
|
Consommation finale des
ménages
|
574,4
|
574,3
|
2.248,3
|
2.296,0
|
|
|
Consommation finale des
adm.
|
184,7
|
185,3
|
720,0
|
730,2
|
|
|
FBCF totale
|
187,7
|
187,8
|
760,3
|
756,2
|
|
|
Exportations
|
298,2
|
312,5
|
1.087,8
|
1.138,6
|
|
|
Variations de stocks |
- 1,8 |
1,8 |
14,3 |
- 2,9 |
|
|
Total des
emplois
|
1.243,2
|
1.261,5
|
4.830,6
|
4.918,1
|
|
1) Premier trimestre.
2) Deuxième trimestre.
3) Sur la base du PIB du 2ème trimestre de l'année
Source : INSEE. Comptes trimestriels.
Le tableau ci-dessus confirme que la croissance a atteint un
rythme annualisé de
2,6 %
au premier semestre de
l'année
.
L'essentiel de l'activité continue à être
"tirée" par le commerce extérieur
. Au premier trimestre, la
croissance du PIB de 0,3 point s'expliquait pour 0,5 point par le
solde extérieur, les autres facteurs de croissance contribuant
négativement à la croissance. Au deuxième trimestre
où le PIB s'accroît de 1 point, la contribution du commerce
extérieur s'élève à 0,6 point.
C'est donc
qu'à partir du deuxième trimestre, la demande
intérieure commence à exercer une contribution favorable à
la croissance. Ce phénomène est en réalité
entièrement dû aux variations de stocks
qui, ayant produit un
effet négatif au premier trimestre de l'ordre de 0,3 point de PIB
et prenant la forme d'une augmentation des stocks au deuxième trimestre,
expliquent 0,4 point de la croissance du PIB. Les autres facteurs de la
demande intérieure sont neutres, ce qui marque, pour la consommation des
ménages, qui avait cru de 0,2 % le trimestre
précédent, une détérioration, et pour
l'investissement, en baisse au cours des trois premiers mois de l'année
de 1,2 %, une timide amélioration.
L'acquis de croissance
1(
*
)
pour 1997
s'élève ainsi à 1,6 % à la fin du premier
semestre de l'année.
c) Vers une accélération de la croissance en fin d'année
Sur la base de l'acquis mis en évidence et de la
dynamique de croissance constatée au deuxième trimestre, les
conjoncturistes s'accordent à considérer
qu'une croissance de
2,2 à 2,3 % pourrait être enregistrée en 1997
.
Le tableau qui suit rend compte des facteurs d'accélération de
la croissance tels que les prévoit l'INSEE.
Equilibre ressources-emplois des biens et des
services
(aux prix de 1980, en milliards de francs et en % de
variation t/t-1)
|
1997 |
1996 |
1997 |
||
|
T3 1 |
T4 2 |
|||
|
Produit intérieur brut
|
977,1
|
985,9
|
3.800,8
|
3.889,5
|
|
Importations
|
302,2
|
308,5
|
1.117,3
|
1.188,7
|
|
Total des ressources
|
1.279,3
|
1.294,4
|
4.918,1
|
5.078,2
|
|
Consommation finale des
ménages
|
582,0
|
585,9
|
2.296,0
|
2.316,7
|
|
Consommation finale des
adm.
|
186,4
|
186,6
|
730,2
|
742,9
|
|
FBCF totale
|
189,1
|
190,7
|
756,2
|
755,4
|
|
dont SQS et EI
|
104,8
|
106,0
|
416,8
|
418,6
|
|
Ménages hors EI
|
46,2
|
46,5
|
185,8
|
184,2
|
|
Exportations
|
317,8
|
324,5
|
1.138,6
|
1.253,0
|
|
Variations de stocks |
3,9 |
6,6 |
- 2,9 |
10,3 |
|
Total des
emplois
|
1.279,3
|
1.294,4
|
4.918,1
|
5.078,2
|
1) Troisième trimestre.
2) Quatrième trimestre.
Source : INSEE. Comptes trimestriels.
Au second semestre, le rythme de croissance atteindrait ainsi 3,5 % en moyenne annuelle sous l'effet combiné de la poursuite de bonnes performances du commerce extérieur mais surtout d'un redémarrage de la demande intérieure.
Demande intérieure
(croissance semestre s + 1/s)
|
Premier semestre 1997 |
Second semestre 1997 |
|
|
Consommation des
ménages
|
0
|
1,7
|
d) L'évolution incertaine des facteurs de la croissance
L'amélioration des composantes de la demande
intérieure toucherait tous ses compartiments, l'hypothèse
d'accélération de leur croissance reposant toutefois beaucoup sur
un
retournement de comportement des entreprises
particulièrement
en matière de stocks.
Les dernières informations conjoncturelles envoient toutefois des
signaux ambigüs.
La consommation des ménages
en produits manufacturés a
certes augmenté de 2,7 % au troisième trimestre de
l'année, laissant percevoir une reprise de la consommation des
ménages, mais cette performance a été entièrement
acquise au mois de juillet. Depuis, la consommation des ménages se
replie, de 1,9 % en août et de 1,5 % en septembre. Or, le
rebond de la consommation observé en juillet provenait pour l'essentiel
d'un rattrapage portant sur les achats d'automobiles qui avaient
été inhabituellement faibles en juin
(112.000 immatriculations contre un rythme mensuel proche de 150.000).
Le profil de la consommation constaté depuis s'inscrit donc davantage
dans la norme, et celle-ci apparaît peu favorable.
Malgré cela,
les échanges extérieurs,
ont
enregistré une dégradation sensible au mois d'août 1997,
l'excédent de 11 milliards de francs révélant une
chute de 10,5 milliards du solde constaté en juillet. Cette
dégradation, qui touche tous les secteurs, résulte d'une baisse
des exportations (- 2,4 %) et d'une forte hausse des importations
(+ 5,6 %). Ces évolutions sont délicates à
interpréter.
La baisse des exportations concerne surtout les pays de l'Union
européenne, ce qui contredirait l'idée d'une reprise en Europe
continentale.
La hausse des importations provient essentiellement des échanges avec
les pays de l'OCDE extérieurs à l'Union européenne, ce qui
infirmerait l'idée selon laquelle la hausse du dollar serait favorable
à une croissance modérée des importations.
En tout état de cause, même si des commentaires plus amples
apparaissent prématurés, il apparaît que, si ces
évolutions devaient se poursuivre, l'économie française
perdrait le soutien principal à sa croissance.
Car
l'investissement
, pas plus que la demande des ménages, ne
paraît pas, jusqu'à présent, avoir enclenché la
phase haute d'un cycle qu'il parcourt encore sur la pente descendante. C'est
ainsi qu'au premier semestre, l'investissement a décru par rapport au
dernier trimestre de l'année 1996.
D'ores et déjà, les
prévisions du gouvernement relatives à l'investissement des
entreprises pour 1997 paraissent hors d'atteinte
. L'INSEE table d'ailleurs
sur une croissance de l'investissement des entreprises de 0,4 % en 1997
contre une prévision gouvernementale de 1,8 %.
B. ... RISQUE DE NE PAS SE CONFIRMER EN 1998
1. Objectif 1998 : l'accélération de la croissance
Equilibre des biens et services pour 1998
|
BUD.ECO 1 |
BIPE |
CDC |
COE |
GAMA |
REXECODE |
OFCE |
AFEDE |
EXPANSION |
|
|
VOLUMES
|
|||||||||
|
PIB |
3,0 |
3,3 |
2,7 |
2,9 |
3,0 |
2,5 |
3,0 |
2,7 |
3,0 |
|
Importations |
3,8 |
6,5 |
6,9 |
8,2 |
5,5 |
6,2 |
5,2 |
7,0 |
8,2 |
|
Consommation des ménages |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FBCF totale
|
3,1 |
4,6 |
4,0 |
3,9 |
3,3 |
2,0 |
3,5 |
2,0 |
2,6 |
|
SQS-EI |
4,1 |
5,7 |
4,7 |
6,0 |
4,3 |
3,6 |
4,7 |
3,0 |
4,0 |
|
Ménages hors EI |
2,5 |
3,7 |
1,8 |
1,8 |
1,3 |
2,8 |
1,2 |
1,0 |
|
|
Exportations |
5,7 |
6,7 |
7,2 |
7,5 |
4,0 |
7,3 |
7,8 |
8,5 |
9,0 |
|
Variations des stocks (contribution à la croissance du PIB) |
0,3 |
0,3 |
0,1 |
0,3 |
0,9 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
1. Budgets économiques
Source : Commission des comptes et des budgets économiques de la Nation. Octobre 1997.
Le projet de loi de finances est construit sur la base
d'une croissance du PIB de 3 % en volume et de 4,2 % en valeur. Le
PIB passerait de 8.104 à 8.448 milliards de francs.
La croissance en volume s'accélérerait donc, passant d'un rythme
de 2,2 % en 1997 à un rythme de 3 % en 1998. Un même
phénomène concernerait les prix du PIB qui, en progression de
0,9 % en 1997, connaîtraient une augmentation de 1,2 % en 1998.
La croissance française excéderait celle de ses partenaires
qui, pour la moyenne des pays de l'OCDE, ne serait que de 2,7 %.
Elle serait par ailleurs supérieure à la croissance potentielle,
estimée par l'OCDE à 1,9 %, par le FMI à 2,2 %
et par le ministère de l'économie et des finances à
2,5 %.
L'écart à la croissance potentielle :
"l'écart de croissance"
Le taux de croissance potentielle est celui qui serait
atteint si les facteurs de production -le travail et le capital pour
l'essentiel- étaient normalement utilisés. L'écart entre
le taux de croissance potentielle et le taux effectif de croissance
-"l'écart de croissance"- permet de rendre compte, lorsque le second
est
plus élevé que le premier, des phénomènes de
rareté et d'inflation.
Lorsque la situation inverse se présente, il permet de rendre compte de
phénomènes de sous-utilisation des facteurs de production
(chômage, sous-investissement).
Cependant, l'observation d'un "écart de croissance" n'a guère de
portée explicative en tant que telle, parce que la mesure de la
croissance potentielle suppose que soient résolues des questions aussi
importantes que celle du niveau normal d'utilisation des facteurs ou encore
celle du niveau de leur productivité.
Partant, l'observation d'un "écart de croissance" n'a une valeur
opératoire efficace que pour autant que ces questions soient
correctement résolues.
Pour illustrer la signification de ces deux observations, on peut raisonner
sur l'exemple de l'emploi.
La croissance potentielle dépend d'une utilisation normale du facteur
travail disponible. La population active détermine
quantitativement
les disponibilités. Mais la question des acteurs
déterminant
qualitativement
l'utilisation "normale" de la
population active se pose en de tout autres termes. La réponse
donnée à cette question suppose un jugement normatif et passe
généralement par l'idée qu'une utilisation normale de la
population active est celle qui n'engendre pas de tensions inflationnistes ou
de tensions salariales.
On remarquera d'abord que l'une et l'autre de ces deux conditions ne sont pas
entièrement assimilables -tensions salariales et inflationnistes ne vont
de pair qu'à partage inchangé des gains de productivité
entre profits et salaires.
On remarquera surtout que l'évaluation du taux de chômage
nécessaire pour que lesdites tensions soient contenues est conjecturale
et très certainement variable en fonction de multiples
paramètres : le coût du travail bien sûr mais aussi la
qualité de la main d'oeuvre ou encore l'organisation des relations de
travail.
Ainsi, le rapprochement de la croissance effective et de la croissance
potentielle suppose de résoudre des problèmes
méthodologiques considérables et, en même temps, de prendre
parti sur les raisons -du même ordre- qui expliquent l'écart entre
les deux grandeurs.
2. Hypothèse forte sur la demande intérieure
Le scénario de croissance repose sur les prévisions indiquées plus haut qui supposent un rythme plus élevé d'activité et au terme desquelles la contribution à la croissance des différentes composantes du PIB serait modifiée par rapport à 1997 comme il apparaît dans le tableau ci-dessous.
Contributions à la croissance du PIB
|
1997 |
1998 |
|
|
Demande intérieure hors
stocks
|
1,2
|
2,1
|
|
Variations de stocks |
0,2 |
0,3 |
|
Commerce extérieur
|
0,7
|
0,6
|
|
PIB |
2,2 |
3,0 |
La composition de la croissance serait donc
différente de celle observée en 1997 :
La contribution du commerce extérieur à la croissance serait
minorée de 0,1 point. Elle resterait cependant largement positive,
avec 0,6 point de PIB et exercerait donc un soutien important à
l'activité intérieure.
La contribution de la demande intérieure s'accroîtrait beaucoup,
passant de 1,2 à 2,1 point de PIB.
Elle serait la plus
importante jamais observée depuis six ans
. Ajoutée à
la contribution des stocks, elle expliquerait 2,4 points de croissance. Le
tableau ci-dessous confirme le caractère exceptionnel de la
prévision.
Contribution de la demande intérieure totale à
la croissance
|
|
|
|
|
|
|
|
Ecart 98/ moyenne 92-97 |
|
0,2 |
- 1,7 |
0 |
1,8 |
0,8 |
1,4 |
2,7 |
+ 2,3 |
L'écart de croissance entre 1997 et 1998
s'expliquerait par les variations suivantes :
|
Ecart de
croissance
(1)
|
+ 0,8
|
(1) Aux arrondis près
3. Révision à la hausse des prévisions de mars 1997
Il est intéressant de se reporter aux prévisions du mois de mars qui annonçaient une croissance de 2,8 %.
a) Optimisme excessif sur l'environnement international
Les prévisions actuelles du gouvernement sont
tributaires d'un environnement international favorable, amélioré
par rapport à ce qui était alors prévu.
La croissance des partenaires de l'OCDE serait de 2,7 % en 1998, la
croissance atteignant 2,5 % aux Etats-Unis et 2,9 % en Allemagne. Ces
prévisions sont plus optimistes que celles du mois de mars où la
croissance des pays de l'OCDE n'était que de 2,5 %,
l'activité progressant de 2,3 % aux Etats-Unis et de 2,7 % en
Allemagne.
La prévision retient en outre une hypothèse plus propice à
la croissance en ce qui concerne la parité du franc contre dollar. En
mars, cette dernière était de 5,65 francs contre 1 dollar en
1998 comme en 1997. Elle s'élève désormais à
5,88 francs pour 1997 et à 6,07 francs en 1998.
Il en résulte que la croissance moyenne des exportations au cours des
deux années sous revue serait en 1997 et 1998 de 6,3 % contre une
estimation antérieure de 5,5 %. De la même manière,
les importations ne s'accroîtraient plus que de 4 %, contre
4,4 % dans la prévision de mars.
La réestimation des perspectives de croissance est donc
entièrement due à la réévaluation des performances
extérieures de l'économie française.
b) Pari fort sur l'accélération de la demande intérieure
En revanche, par rapport aux prévisions de mars, les
estimations de croissance de la demande intérieure n'ont guère
évolué
. Elles reposent toujours sur une
accélération de la demande intérieure, mais le rythme de
celle-ci reste inchangé si ses composantes sont quelque peu
modifiées :
- la contribution des stocks à la croissance passe de 0,2 à
0,3 point,
- la consommation des ménages est considérée avec un peu
plus d'optimisme, son augmentation s'élevant à 2 % contre
une prévision de 1,9 % antérieurement,
- en revanche, l'estimation portant sur l'investissement est
révisée à la baisse (+ 3,1 % contre 3,8 %)
sous l'effet d'une évolution moins favorable que prévu de
l'investissement des entreprises (+ 4,1 % contre + 5,4 %).
Il n'en reste pas moins que le scénario du gouvernement est construit
sur un redémarrage de la demande intérieure. Celle-ci repartirait
d'abord sous l'effet d'
une hausse de la consommation des ménages qui
atteindrait 2 %.
Le
revenu disponible des ménages
progresserait en volume de
2,3 %
. L'évolution de ses composantes serait la
suivante :
Revenu disponible brut des ménages pour 1998
(taux de croissance annuels en valeur)
|
1998 |
|
|
Ressources |
|
|
Salaires bruts |
3,5 |
|
- Cotisations sociales salariales |
5,1 |
|
Salaires nets |
3,2 |
|
Excédent brut d'exploitation des EI |
2,9 |
|
Prestations sociales brutes |
2,5 |
|
Intérêts et dividendes |
6,6 |
|
Autres ressources |
1,3 |
|
Emplois |
|
|
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine |
3,6 |
|
Intérêts et dividendes |
0,5 |
|
Autres emplois |
1,9 |
|
Revenu disponible brut |
3,7 |
La masse salariale s'accroîtrait de 3,5 % en
valeur et de 2,1 % en volume
sous l'effet d'une évolution de
1,2 % du salaire par tête.
Le bilan des opérations de redistribution serait
défavorable
aux ménages : les cotisations sociales
salariales progresseraient de 5,1 % tandis que les prestations sociales
reçues par les ménages s'accroîtraient de 2,5 %.
Les ressources tirées des versements d'intérêts et de
dividendes augmenteraient sensiblement (+ 6,6 %).
Ces différentes variations doivent être appréciées
compte tenu de la structure du revenu disponible des ménages que
rappelle le tableau ci-après.
Structure du revenu disponible des ménages en 1996
(en millions de francs)
|
Niveau |
(x/A)
|
(x/C)
|
|
|
Ressources |
|||
|
Excédent brut d'exploitation |
1.402,4 |
16,8 |
25,6 |
|
Salaires et cotisations sociales employeurs |
4.103,2 |
49,1 |
74,9 |
|
Revenus des créances |
730,2 |
8,7 |
13,3 |
|
Prestations sociales |
1.979,3 |
23,7 |
36,1 |
|
Divers |
141,2 |
1,7 |
2,6 |
|
Total (A) |
8.356,3 |
100 |
152,5 |
|
Emplois |
|||
|
Impôts courants sur le revenu et le patrimoine |
598,3 |
- 7,1 |
- 10,9 |
|
Cotisations sociales |
1.826,6 |
- 21,8 |
- 33,3 |
|
Charges d'endettement |
345,4 |
- 4,1 |
- 6,3 |
|
Divers |
110,4 |
- 1,5 |
- 2 |
|
Total (B) |
2.880,7 |
- 34,5 |
- 52,5 |
|
Revenu disponible brut (A - B = C) |
5.475,6 |
65,5 |
100 |
Quelques données sur le revenu des ménages
Les ressources des ménages s'élèvent
à 1,5 fois leur revenu disponible brut.
Hors ressources diverses, leur revenu provient essentiellement de leur
activité à hauteur de 65,9 %, des prestations sociales
qu'ils reçoivent pour 23,7 % et de leur situation de
créditeurs pour 8,7 %.
Il est amputé à titre principal par des
prélèvements obligatoires dans une proportion de
29,9 points, et par les charges d'endettement pour 4,1 point.
Le bilan des transferts noués entre les ménages et les
administrations publiques pèse apparemment sur le revenu des
ménages qui reçoivent des prestations sociales inférieures
au montant cumulé de leurs impôts courants et de leurs cotisations
sociales, le solde s'établissant à 445,6 milliards de francs.
Dans la réalité, il faut prendre en compte la contribution des
salaires et cotisations versées par les administrations publiques
à la formation de la masse salariale, soit 1.140,9 millions de
francs en 1996. Dans ces conditions, le bilan global des transferts entre les
deux secteurs apparaît favorable aux ménages à hauteur de
695,3 milliards de francs.
L'investissement des entreprises connaîtrait un rebond, progressant de
4,1 % en 1998 et, en moyenne annuelle sur 1997 et 1998, de 2,9 %.
Cette prévision est justifiée, par le gouvernement, par la
combinaison du maintien de conditions financières jugées
"très favorables" et par le redressement des perspectives de demande.
Elle est jugée prudente.
En bref, l'effet d'accélérateur viendrait dynamiser un
investissement favorisé par la restauration de la situation
financière des entreprises.
Cette dernière est décrite dans le tableau ci-dessous.
|
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Taux de marge
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taux
d'épargne
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Intérêts nets/EBE |
23,3 |
28,1 |
26,3 |
21,2 |
20,2 |
18,1 |
15,4 |
15,2 |
|
Intérêts nets/VA |
7,2 |
8,5 |
8,0 |
6,5 |
6,2 |
5,5 |
4,7 |
4,7 |
|
Taux d'investissement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taux
d'autofinancement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La croissance de l'investissement en 1998 s'accompagnerait d'un léger redressement du taux d'investissement des entreprises qui passerait de 15,1 à 15,5 %.
II. RENFORCEMENT DES ALÉAS EXTÉRIEURS ET EFFETS PERVERS DE LA NOUVELLE POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Avec une croissance de 3 % en 1998, le scénario du gouvernement est particulièrement optimiste compte tenu du passé récent de la croissance en France et des perspectives à moyen terme.
La croissance française en perspective
L'Observatoire français des conjonctures
économiques a réalisé une projection de l'économie
française au moyen du modèle Mosaïque pour le compte de la
Délégation du Sénat à la Planification.
Son résultat essentiel est que le sursaut de croissance observé
en 1998 serait exceptionnel. Au cours de la période 2000-2002, la
croissance annuelle serait en moyenne de 2,2 % à nouveau
inférieure au taux permettant de stabiliser le taux de chômage.
Le tableau suivant décrit la projection de croissance :
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000-2002* |
|
|
POURCENTAGE ANNUEL DE VARIATION (en volume) |
||||
|
- PIB total |
2,1 |
3,2 |
2,9 |
2,2 |
|
- PIB marchand |
2,1 |
3,2 |
2,8 |
2,1 |
|
- Importations |
4,1 |
5,3 |
5,8 |
4,4 |
|
- Consommation des ménages |
0,7 |
1,6 |
1,8 |
2,2 |
|
- Investissement des entreprises |
- 0,2 |
3,4 |
3,7 |
1,9 |
|
- Investissement logement des ménages |
- 1,2 |
2,8 |
0,5 |
0,3 |
|
- Exportations |
8,7 |
7,4 |
6,7 |
4,5 |
|
- Variations des stocks (contribution à la croissance en points de PIB) |
|
|
|
|
|
* Taux de croissance annuel moyen pour les années 2000, 2001 et 2002. |
||||
Outre certaines discordances avec la prévision du
gouvernement pour 1997 et 1998 -la contribution du commerce extérieur
est plus élevé dans la projection de l'OFCE sous l'effet d'une
hypothèse d'appréciation du dollar plus forte ; en revanche, la
contribution de la demande intérieure et moins importante- le tableau de
résultats indique que malgré une consommation des ménages
plutôt dynamique, la faiblesse des investissements des entreprises et le
retour à une situation de solde extérieur neutre viendraient
limiter la progression du PIB.
Chacun souhaite bien sûr le retour de la croissance. Mais la raison comme
la sagesse sénatoriale commandent de ne pas se cacher les aléas
défavorables que le scénario choisi semble écarter.
A. NUAGES SUR L'ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL DE LA FRANCE
Les hypothèses choisies pour décrire
l'environnement international de l'économie française lui sont
plutôt favorables : l'activité mondiale serait soutenue et
rééquilibrée au profit de l'Europe continentale ; les
conditions monétaires et financières seraient durablement
modifiées au profit de notre pays. Cette atmosphère d'optimisme
est confortée par la vision d'une insertion excellente de la France dans
cet environnement international : notre compétitivité serait
bonne ; nos performances financières et monétaires
continueraient à bénéficier d'une
crédibilité sans tache.
Malheureusement, un certain nombre de nuages pèsent sur ce ciel radieux.
S'ils venaient à éclater, ils viendraient remettre en question la
prévision de croissance associée au projet de loi de finances.
1. Les nuages monétaires et financiers
Plusieurs risques planent sur l'environnement monétaire et financier international.
a) Les éléments d'incertitude de la période transitoire vers la troisième phase de l'union économique et monétaire
L'adoption d'une monnaie unique en Europe est une chance
historique pour notre continent. Au-delà de la composante symbolique
qu'elle recèle, elle permettra de disposer d'un instrument
monétaire capable de s'imposer comme grande devise internationale. En
outre, elle réduira les frais de transaction des agents
économiques, complétant ainsi l'intégration
économique des pays européens, et viendra anéantir les
primes de risque de change subies jusqu'alors par tous les pays
extérieurs à la zone d'influence du mark.
Mais, la période nous séparant de l'institution de l'euro n'est
pas sans dangers. Les marchés qui disposent de marges de manoeuvre sans
commune mesure avec leurs capacités réelles seront,
peut-être, tentés de tester les parités des monnaies
susceptibles de contribuer à la formation de l'euro.
A cet égard, la décision prise d'émettre à leur
intention un signal fort en fixant dès mars 1998 les parités
irrévocables sur lesquelles l'euro sera construit quelques mois plus
tard n'est pas sans risques. Elle supposera de la part des banques centrales en
charge des monnaies concernées une forte coopération et sans
doute une solidarité exemplaire.
Rien ne permet de douter de celle-ci. En revanche, des interrogations
subsistent sur son efficacité et le sens que pourrait prendre la
politique monétaire dans l'hypothèse de perturbations frappant
les monnaies européennes.
b) La situation financière des Etats-Unis
Les Etats-Unis connaissent une expansion ininterrompue depuis
6 ans qui devrait aller s'accélérant encore en 1997.
L'écart de production qui mesure la différence entre la
production effective et la production potentielle, c'est-à-dire celle
qui résulterait d'un emploi non inflationniste des facteurs de
production est, au cours de ces dernières années, resté
négatif ou proche de l'équilibre. Mais, selon les chiffres de
l'organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE), il ne devrait plus en aller ainsi à partir de
1997. L'écart de production serait positif de 0,9 point en 1997 et
encore de 0,6 point en 1998 malgré une prévision de
croissance modérée, de 2 %, correspondant à un
scénario d'atterrissage en douceur de l'économie
américaine.
Ainsi, si jusqu'à présent les tensions inflationnistes n'ont
pas perturbé la croissance américaine, les prévisions
économiques deviennent moins favorables de ce point de vue.
Cette situation nouvelle alliée à la croissance importante de
l'endettement des ménages américains pourrait provoquer des
relèvements de taux d'intérêt de la part de la banque
centrale américaine.
Celle-ci pourrait au demeurant être d'autant plus tentée par de
tels relèvements que son président a, à plusieurs
reprises, estimé que la Bourse américaine avait connu une
progression exagérée.
L'écart de taux d'intérêt à court terme entre les
Etats-Unis et l'Europe pourrait donc se creuser davantage
. Cette situation
ne s'accompagnerait pas nécessairement d'une hausse des taux à
long terme si les agents devaient la considérer comme garantissant un
objectif de stabilité des prix. Si ce sentiment ne devait pas
l'emporter, une hausse des taux à long terme serait d'autant plus
probable.
Elle s'accompagnerait inévitablement d'une appréciation du dollar
sous certaines réserves -voir infra c)- ce qui serait plutôt
favorable à l'économie européenne.
Elle s'accompagnerait aussi ce qui est moins favorable, d'un ralentissement de
l'activité aux Etats-Unis sous l'effet de trois facteurs au moins :
le renchérissement des crédits, la correction boursière
qui provoquerait des effets de richesse négatifs, la
détérioration de la compétitivité extérieure
américaine.
Dans ces conditions, l'activité européenne pâtirait d'un
ralentissement de l'économie américaine probablement plus
marqué qu'il n'est escompté.
c) La situation financière des pays émergents
Les pays émergents partagent plusieurs
caractéristiques communes : des déficits extérieurs
considérables, des systèmes bancaires fragiles, des monnaies
faibles, c'est-à-dire très soumises à des aléas
extérieurs à la hausse comme à la baisse. De façon
générale, leurs économies sont très fortement
dépendantes de l'épargne extérieure et des investissements
directs étrangers.
On ne peut pas dire que l'allure de l'activité économique dans
ces pays influence considérablement l'activité économique
des grands pays occidentaux. Toutefois, elle contribue à cette
dernière et parfois -voir infra- dans des conditions non
négligeables.
En revanche, ce qui est établi, c'est que
la situation
créditrice des pays occidentaux à l'égard de ces pays rend
les économies développées très vulnérables
à l'évolution de la valeur de leurs créances
.
Autrement dit, un choc monétaire ou boursier survenant dans les pays
émergents est susceptible de pénaliser leurs créditeurs.
L'apparition de crises de change suivies de crises boursières et
bancaires dans divers pays de l'Asie du Sud-Est est un de ces chocs. Pourraient
suivre des phénomènes semblables en Amérique latine.
Outre les effets à court terme de telles crises sur la croissance des
économies concernées et leur impact direct sur la croissance des
pays développés, il y a lieu d'être préoccupé
des perturbations financières qu'elles occasionnent et qui, même
surmontées, devraient laisser place à des pertes de richesses
pour les créanciers de ces économies.
d) La politique monétaire en Europe
L'Europe qui s'apprête à constituer une zone
monétaire solide pourrait donc être confrontée à un
climat d'instabilité monétaire et financière. Les grands
pays de l'Union européenne étant créditeurs nets
pourraient subir des pertes de revenus. En outre, leur activité pourrait
être affaiblie. Mais l'essentiel est ailleurs, c'est-à-dire dans
la réaction des autorités monétaires européennes
devant la situation monétaire et financière des Etats-Unis.
D'emblée, il faut noter qu'il n'est pas sûr que les
autorités monétaires soient en mesure de s'opposer à une
hausse des taux à long terme qui constituerait, si elle devait survenir
aux Etats-Unis, le pire des scénarios.
Quant à la réaction des autorités monétaires
européennes face à un creusement de l'écart de taux
à court terme entre Etats-Unis et Europe, il n'est guère
aisé de la prévoir et encore moins de juger quelle elle devrait
être. Il apparaît toutefois que, compte tenu du niveau de
croissance en Europe, de l'orientation donnée aux politiques
budgétaires, de l'inflation sous-jacente particulièrement faible
et de la situation d'épargne des agents privés, une restriction
monétaire ne s'imposerait pas.
2. Les nuages sur la croissance des partenaires et l'insertion de l'économie française dans l'environnement international
L'insertion de l'économie française dans l'environnement économique international est certes devenue plus satisfaisante depuis un peu plus d'une décennie, mais moyennant des conditions que les orientations données à la politique économique et sociale de notre pays pourraient altérer.
a) Les aléas pesant sur la croissance dans le monde
Dans son dernier rapport sur l'économie mondiale, le
Fonds monétaire international prévoit une croissance de l'ordre
de 4 % en 1997 et 1998 allant donc s'accélérant. Toutefois,
le Fonds rappelle que les épisodes récents de croissance rapide
ont tous été suivis d'un ralentissement sévère et
même, pour certains pays, de récessions.
Or, les facteurs expliquant les prévisions du Fonds, à savoir la
poursuite d'une expansion solide et non inflationniste aux Etats-Unis et au
Royaume-Uni, l'amplification de la reprise en Europe continentale, l'expansion
des pays en développement d'Asie paraissent pour la plupart incertains.
(1) L'environnement international de l'Europe pourrait être moins bien orienté
A cet égard,
le cycle américain et ses
aspects inhabituels est évidemment au centre des débats et des
inquiétudes.
On ne saurait trop insister sur certains éléments de
fragilité comme la faiblesse du taux d'épargne des
ménages, l'importance de leur endettement -qui rend essentielle la
contribution au dynamisme de l'économie américaine des effets de
richesse favorables aux ménages issus de l'appréciation des
marchés financiers-, l'écart de production positif, indicateur
avancé de tensions inflationnistes...
Dans ces conditions, si un atterrissage en douceur de l'économie
américaine, tant prévu mais jamais advenu au cours de ces
dernières années, n'est pas à exclure, il est
indispensable de se souvenir que la croissance américaine a connu dans
un passé proche de vraies déconvenues. Ainsi, après une
croissance de 3,4 et 1,3 % en 1989 et 1990, l'année 1991
s'était traduite par une récession, le produit intérieur
brut reculant de 1 %.
(2) La demande intérieure en Europe reste sous contraintes
Ayant rappelé les dangers qui entourent les
économies des pays d'Asie du Sud-Est et du Japon,
il faut encore se
demander si les perspectives de croissance de l'Europe continentale sont
vraiment solides
Plusieurs facteurs ont stimulé la croissance en Europe mais,
jusqu'à présent, il s'est agi principalement de facteurs
extérieurs comme l'orientation de l'activité dans le reste du
monde, l'appréciation du dollar et la vivacité de
l'activité économique dans certains pays européens, le
Royaume-Uni et les pays d'Europe centrale et orientale en particulier.
Or, ces soutiens pourraient, on l'a vu, ne pas perdurer. Deux exemples
significatifs des effets d'une telle interruption peuvent être
trouvés :
dans l'effet sur l'économie européenne de l'appréciation
du dollar, le PIB européen étant supérieur de 1 %
à la suite d'une dépréciation de l'euro par rapport au
dollar de 10 % ;
et dans la part prise par les importations polonaises dans les exportations
allemands qui s'élève à 10 % des exportations de
l'Allemagne, moyennant une croissance de 30 % des importations de la
Pologne, peu soutenable à terme.
En tout état de cause, la demande intérieure n'a pas encore
redémarré en Europe continentale.
De ce point de vue, des perspectives pour 1997 et 1998 peuvent paraître
optimistes au regard des trois caractéristiques majeures des
économies continentales européennes que sont la
nécessité d'entreprendre une politique budgétaire
restrictive, le maintien de taux d'intérêt réels
supérieurs aux prévisions de croissance et la persistance d'un
chômage élevé.
La gestion des finances publiques demeurera en effet restrictive
compte
tenu de la situation atteinte en 1996 et des objectifs fixés par le
traité de Maastricht et le pacte de stabilité et de croissance en
Europe. Les besoins d'ajustement peuvent être approchés à
partir du tableau ci-dessous, rappelant la situation de capacité de
financement des administrations publiques dans les principaux pays
européens.
Capacité ou besoin de financement
des
administrations publiques en Europe
(En % du PIB)
|
1996 |
|
|
France
|
- 4,1
|
Source Rapport économique, social
et financier pour 1998.
Quant aux taux d'intérêt
, la détente significative
des taux d'intérêt à court terme n'empêche pas les
taux à long terme d'excéder les perspectives de croissance
économique.
Taux d'intérêt à long terme
dans
l'Union européenne (août 1997)
|
Allemagne
|
5,7
|
Source : Fonds monétaire international
Mais, c'est le niveau de chômage qui apparaît
encore comme la contrainte permanente la plus sévère qui engendre
un certain pessimisme quant à la croissance européenne
. Tous
les pays sont concernés mais la situation allemande est plus
particulièrement préoccupante.
L'Allemagne n'a en effet pas achevé son processus d'unification
économique si bien que les restructurations industrielles qui restent
indispensables sont fortement créatrices de chômage. On rappelle
que les gains de productivité sont de l'ordre de 12 % par an dans
l'industrie allemande.
La situation de chômage en Europe pèse à deux titres sur
les perspectives de croissance en altérant les conditions d'un
redémarrage de la demande intérieure et en limitant les
possibilités de production du fait de l'inemploi d'une part toujours
plus grande des facteurs disponibles.
b) La bonne insertion de l'économie française dans son environnement est remise en cause
La prévision de croissance pour 1998 fait apparaître un décalage entre la France et ses partenaires : notre pays connaîtrait une activité plus soutenue qu'ailleurs comme le montre le tableau qui suit.
Produit intérieur brut des pays industrialisés
(évolution en %)
|
1997 |
1998 |
|
|
France
|
2,2
|
3,0
|
Source : Rapport économique social et financier pour
1998.
A cette situation est, en général, associée une
dégradation des performances du commerce extérieur. La
prévision du gouvernement ne retient pas un tel
phénomène
. Le solde du commerce extérieur
s'améliorerait encore même si cette amélioration,
étant moins forte que lors de l'année en cours, la contribution
du commerce intérieur à la croissance du PIB serait un peu plus
basse (0,6 point contre 0,7 point en 1997). Ce résultat
suppose que la compétitivité-prix de la France continue de
s'améliorer, c'est-à-dire que la valeur du franc contre monnaies
tierces soit moins élevée qu'en 1997 et que les prix nationaux
évoluent moins vite que ceux des concurrents. Il suppose aussi que la
compétitivité structurelle de notre pays soit bien adaptée
à l'évolution de notre économie et de celle de nos
partenaires.
S'agissant de
la compétitivité structurelle
, on sait que,
en période de forte reprise de l'investissement, l'offre
étrangère profite davantage du supplément de demande
interne que l'offre nationale. Ainsi, la reprise de l'investissement entre 1987
et 1989 s'était-elle traduite par une forte dégradation du solde
des produits manufacturés. Il n'est donc pas certain qu'une
cohérence marque la prévision pour 1998, pour l'investissement et
le commerce extérieur, si l'on se réfère au passé.
Mais, il faut aussi s'interroger sur les perspectives relatives à la
compétitivité-prix
. Le redressement des soldes
extérieurs de l'économie française, autrement dit le
desserrement de la contrainte extérieure, s'est bâti en effet sur
une politique de
désinflation compétitive
dont
l'efficacité, de ce point-de-vue, n'a été remise en cause
que du fait des dévaluations compétitives des monnaies de
certains pays européens. Or, il entre dans les intentions du
gouvernement d'abandonner cette politique. C'est en tout cas ce qui
résulte du jugement formulé dans le rapport économique,
social et financier selon lequel le partage de la valeur ajoutée, socle
de la politique de désinflation compétitive, aurait
été défavorable à la consommation et à
l'emploi. C'est aussi ce qui apparaît au vu des orientations
données par le gouvernement à sa politique fiscale, avec
l'alourdissement des prélèvements sur les entreprises, et
à sa politique sociale, la réduction du temps de travail devant
se traduire par un alourdissement des coûts salariaux unitaires.
Ces diverses décisions remettent en cause l'insertion de
l'économie française dans son environnement international
.
C'est évidemment préoccupant, d'autant plus que le gouvernement
devrait avoir pleine conscience de l'inopportunité d'une gestion
économique et sociale isolée de celle des partenaires,
c'est-à-dire non coordonnée avec eux.
B. UN FACTEUR AGGRAVANT : LES DÉCISIONS DU NOUVEAU GOUVERNEMENT
L'accélération de la croissance en 1998 proviendrait, on l'a vu, d'un regain de dynamisme de la demande intérieure.
1. La reprise de la consommation des ménages est conditionnée par l'amélioration de l'emploi et contrainte par l'alourdissement des charges fiscales globales
Les ménages seraient mieux à même de
consommer et leur comportement s'adapterait à leurs
capacités
: la consommation des ménages progresserait
presque parallèlement à leurs gains de pouvoir d'achat, de 2 %
contre 2,3 % pour ces derniers.
Cette prévision marque une rupture avec les évolutions
récemment observées.
C'est d'abord le cas si on la compare avec les données tendancielles des
années 1990 à 1996 où le volume de la consommation
des ménages s'est accru de seulement 1 % par an.
Mais ce l'est aussi dès lors qu'on a à l'esprit le défaut
de parallélisme entre la progression du revenu des ménages et
celle de leur consommation. En 1995, malgré un taux de croissance en
volume du revenu disponible de 2,8 %, la consommation des ménages
n'avait progressé que de 1,7 %. Inversement, en 1996, à une
progression du revenu des ménages de 0,2 % avait correspondu un
accroissement de leur consommation de 2,1 %. De la même
manière en 1997, le supplément de pouvoir d'achat des
ménages, + 2 %, ne devrait s'accompagner que d'un
surcroît modeste de leur consommation (+ 0,9 %).
En bref, alors que la consommation des ménages est apparue fort peu
corrélée avec les évolutions de pouvoir d'achat ces
dernières années, la prévision du gouvernement table sur
un retour à une étroite corrélation entre variation du
pouvoir d'achat des ménages et de leur consommation.
Il s'agit là d'une hypothèse importante au regard de la
prévision de croissance économique mais aussi de
l'équilibre des finances publiques.
Elle s'appuie principalement sur la prévision d'une évolution
dynamique de la masse salariale -+ 3,5 %- sous l'effet conjoint d'une
augmentation des emplois et du salaire par tête, ces deux facteurs
étant dans une certaine mesure dépendants l'un de l'autre.
La croissance du nombre d'emplois prévue pour l'année prochaine
dans le secteur marchand s'élève à
210.000 unités, à comparer avec une augmentation du nombre
d'emplois estimée à 135.000 unités en 1997.
La variation du nombre des emplois traduirait donc une croissance des effectifs
de 0,8 % en 1997 et de l'ordre de 1,2 % en 1998. S'y ajouteraient les
"emplois des jeunes", pour 50.000 unités en 1997 et
100.000 unités supplémentaires en 1998.
Ces résultats s'appuient sur une hypothèse de gains de
productivité par tête inchangés en 1997 et 1998,
estimés à 1,8 % dans les entreprises non financières
non agricoles et, au total, de l'ordre de 1,6 %.
Cette hypothèse suppose que la rupture avec l'évolution de long
terme de la productivité apparente du travail observée depuis le
début des années 1990 se poursuive.
L'évolution de la productivité apparente du
travail
Gains de productivité à long terme (1979-1990, % par an)
|
Industrie |
Services |
|
|
Etats-Unis |
3,7 |
0,3 |
|
Allemagne |
2,2 |
1,5 |
|
France |
2,8 |
2,0 |
|
Royaume-Uni |
4,3 |
0,9 |
|
Japon |
3,5 |
2,9 |
Source : OCDE
Sur le long terme, entre 1979 et 1990, la France a enregistré des gains
annuels de productivité du travail de 2,8 % dans l'industrie et de
2 % dans le secteur des services. Cette situation manifeste un retard dans
l'industrie que d'ailleurs partage l'Allemagne par rapport aux autres pays
industrialisés et, au contraire une avance dans les services où
les gains d'efficience ont été plus élevés en
France que dans les pays comparables, excepté le Japon.
Les tableaux qui suivent démontrent cependant qu'une double rupture
s'est produite au tournant des années 1980 et 1990.
Productivité horaire apparente du travail
(en % par rapport à l'année précédente)
|
Années |
Ensemble des secteurs |
|
1981
|
3,1
|
Les gains de productivité du travail se sont globalement ralentis.
Productivité apparente du travail (en % et par an) entre 1992 et 1995
|
1992-1995 |
|
|
Industrie
Industrie manufacturière BGCA Commerce + transports Télécommunications + services marchands |
4,0
4,2 - 0,4 0,0 |
Source : INSEE
Cette évolution n'est toutefois pas générale,
l'industrie accroissant ses gains de productivité, le secteur des
services au sens large connaissant un net ralentissement des siens.
La signification de ces évolutions doit être
précisée.
La productivité apparente du travail apparaît comme un
résultat qui peut être considéré comme un indicateur
du contenu de la croissance en emplois.
Ainsi, compte tenu d'un niveau de
croissance du PIB donné, les gains de productivité du travail
apparaîtront d'autant plus bas que le nombre des emplois
créés sera plus élevé et inversement. Comme il est
difficile de construire des équations expliquant l'évolution de
la productivité du travail, il faut la poser en hypothèse compte
tenu d'évolutions observées dans le passé. Cette
méthode est évidemment décevante si l'on considère
que les progrès de productivité s'expliquent par des variables
économiques et sociales identifiables comme l'investissement ou le
niveau de l'éducation. Elle l'est encore plus et les résultats de
ces dernières années avec elle, si l'on pense que de forts
progrès de productivité sont susceptibles de favoriser la
croissance en en améliorant par exemple l'efficience
2(
*
)
.
Elle fait place à un certain arbitraire comme le démontre
semble-t-il la prévision du gouvernement. En effet,
l'hypothèse privilégiée par celle-ci d'un gain de
productivité moyen de 1,8 % apparaît discutable.
On
rappelle qu'existe un "cycle de productivité" qui traduit le fait
qu'en
période de reprise économique, le supplément d'embauches
provoqué par celle-ci est retardé, les entreprises ne percevant
pas immédiatement la reprise et s'efforçant de faire face
à l'activité supplémentaire avec les moyens en place.
L'accroissement de la productivité du travail observé en 1994
-voir tableau ci-dessus- s'est inscrit dans le cadre de ce
phénomène.
C'est d'ailleurs sur des gains de productivité beaucoup plus
importants, de 2,3 % en 1997 et de 2,7 % en 1998, qu'est bâtie
la projection à moyen terme réalisée par l'Observatoire
français des conjonctures économiques pour la
Délégation du Sénat pour la planification.
Ces écarts ne sont pas seulement théoriques puisqu'ils exercent
une influence directe sur le niveau des emplois qu'on peut associer à
une prévision : soit un point supplémentaire de gains de
productivité, l'emploi marchand salarié ne s'accroîtrait
plus que de l'ordre de 0,1 %
3(
*
)
.
Dans ces conditions, le chômage s'aggraverait un peu plus et les
dépenses liées à lui également. Un tel
"appauvrissement" de la croissance en emplois pourrait d'autant plus
survenir
que le gouvernement entend supprimer certaines mesures d'allégements de
charges qui ont favorisé l'enrichissement de la croissance en emplois et
que l'importante progression du travail à temps partiel, qui concerne
16,5 % des salariés, pourrait s'interrompre.
La formation des salaires en serait moins favorable aux salariés :
le salaire par tête s'accroîtrait moins et la masse salariale
serait, par construction, moins dynamique. L'ensemble des salaires progresse
dans la prévision du gouvernement de 3,5 % en niveau. Les salaires
distribués par secteur marchand non agricole augmentent un peu plus vite
du fait d'une progression des effectifs (+ 1,4 %) plus rapide que
dans le secteur non marchand.
Le salaire moyen par tête, au sujet duquel manquent d'ailleurs les
informations statistiques complètes nécessaires à une
estimation robuste, pourrait progresser moins vite que prévu.
Mais l'essentiel est ailleurs :
un facteur d'incertitude
considérable pèse sur la prévision, l'évolution de
la durée légale du travail
. Facteur d'incertitude pour la
prévision, mais aussi pour les entreprises que les perspectives en la
matière pourraient inciter à rechercher des gains de
productivité peu favorables à l'emploi.
2. L'investissement : une attente toujours déçue dont la politique du gouvernement risque d'éloigner encore le terme
L'investissement est la première composante de la demande des entreprises. Ce n'est pas la seule puisque les comportements de stocks influencent également celle-ci.
Stocks et activité
Dans la définition qu'en donne le système
élargi de comptabilité nationale, "les stocks comprennent tous
les biens autres que les biens de capital fixe, détenus à un
moment donné par les unités productrices résidentes".
Dans les comptes de patrimoine des secteurs institutionnels, le montant des
stocks est estimé à 1.817,4 milliards de francs pour 1995
-dont 1.557,6 milliards de francs pour les sociétés et
quasi-sociétés non financières- en diminution de
2,2 % par rapport à 1994 (- 41,1 milliards de francs).
Les stocks constituent une production non vendue. Leur niveau résulte
donc d'un décalage entre l'offre et la demande de produits. Lorsque
celle-ci augmente moins que celle-là, le niveau des stocks
s'accroît mécaniquement puis se résorbe à mesure que
les producteurs s'adaptent à la demande.
Mais, si les variations de stocks résultent de la croissance, elles
l'influencent aussi. Les phénomènes de déstockage
amortissent la croissance de l'activité dès lors que la
progression de la demande peut être satisfaite par la production
déjà réalisée que sont les stocks.
A ces relations mécaniques, il faut ajouter deux
phénomènes qui revêtent une certaine actualité. Le
niveau des stocks ne dépend en effet pas que de réglages
automatiques ; il résulte aussi de comportements des entreprises. A
ce propos il convient de souligner :
- que les entreprises ont adopté ces dernières années un
comportement de plus en plus marqué de réduction de leurs stocks,
popularisé sous la dénomination de politique de "zéro
stock" ou encore de "flux tendus" ; ce comportement
structurel pourrait
expliquer la tendance au déstockage observée sur moyenne
période ;
-et, surtout, que le niveau jugé souhaitable des stocks dépend
de l'appréciation que se forment les entreprises d'une série de
variables économiques.
Celles-ci peuvent être objectives : le coût financier de
détention des stocks dépend du niveau du coût de l'argent.
Elles peuvent être plus conjecturales lorsqu'il s'agit d'estimer la
croissance future de la demande ou encore l'évolution prévisible
du prix de vente de leurs secteurs d'activités.
Les relations entre les stocks et l'activité emprunteront donc deux
voies :
- les stocks contribuent, par leur variation, à expliquer le rythme de
croissance ;
- le rythme de croissance escompté et la valeur attendue des biens
expliquent les variations des stocks.
En période de reprise et lorsque les anticipations de prix sont
caractérisées par une prévision d'augmentation, les
entreprises ont tendance à reconstituer leurs stocks.
L'activité économique est, en France, très
dépendante des cycles portant sur les stocks.
Le tableau qui suit illustre cette influence entre 1991 et 1997.
|
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
|
Croissance du PIB |
0,8 |
1 |
- 1,3 |
2,6 |
2,1 |
1,3 |
2,2 |
|
Croissance du PIB hors variations de stocks |
|
|
|
|
|
|
|
Hors accident conjoncturel de 1993, la croissance,
calculée comme si les stocks ne variaient pas, évolue le plus
souvent dans une fourchette de 1,5 à 1,9 % alors que, compte tenu
des stocks, la fourchette des taux de croissance est beaucoup plus large :
0,8 - 2,6 %.
S'agissant de l'investissement
, la prévision d'une croissance de
4,1 % en 1998 de l'investissement des entreprises, et donc d'une
progression de 2,9 % de l'investissement en moyenne annuelle en 1997 et
1998, est l'une des incertitudes majeures du scénario. A son terme,
l'investissement des sociétés passerait de 416,8 milliards
de francs -au prix de 1980- à 424,3 milliards de francs en 1997 et
441,7 milliards de francs en 1998, soit, en volume, une progression de
17,4 milliards de francs entre ces deux dernières années.
D'ores et déjà, cette prévision doit être
corrigée. En 1997, selon l'INSEE, l'investissement des entreprises ne
progresserait que de 0,4 %, contre 1,8 % prévu par le
gouvernement.
L'investissement des entreprises ne s'élèverait donc qu'à
435,6 milliards de francs en 1998, soit un écart négatif de
6,1 milliards de francs par rapport à la prévision. Cette
correction conduit à réviser la croissance du PIB qui ne serait
plus de 3 % mais de 2,92 %.
Mais la prévision de croissance de l'investissement des entreprises de
4,1 % est-elle crédible ? C'est une question en débat
tant le comportement récent des entreprises en matière
d'investissement a déjoué les prévisions reposant sur ses
déterminants traditionnels.
Le niveau de l'investissement est, en 1996, très inférieur au
niveau moyen, des années 1989 à 1992.
Formation brute de capital fixe des sociétés (prix de 1980)
(en millions de francs)
|
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
|
422.838 |
441.242 |
441.183 |
434.535 |
399.533 |
406.350 |
419.870 |
416.777 |
La chute de l'investissement qui s'est produite en 1993
n'a pas été compensée. La reprise intervenue en 1994 et
1995 paraît stoppée.
L'information statistique est cependant contradictoire sur ce point puisque
s'oppose à la vision donnée par l'INSEE d'une stagnation des
investissements, celle offerte par le ministère de l'industrie qui
évoque une forte croissance dans l'industrie.
En tout état de cause, le niveau d'utilisation des capacités de
production met tout le monde d'accord sur un point :
il n'existe pas de
contraintes fortes de capacité pouvant justifier une reprise des
acquisitions de capital fixe.
Taux d'utilisation des capacités de production
(en pourcentage)
|
ANNEES |
Industries agricoles et alimentaires |
Biens intermédiaires |
Biens d'équipement |
Biens de consommation |
Industrie |
Ensemble |
|
1994 |
79,7 |
84,8 |
82,3 |
80,0 |
82,4 |
82,0 |
|
1995 |
81,4 |
87,1 |
84,0 |
81,6 |
84,3 |
83,8 |
|
1996 |
80,6 |
85,1 |
82,7 |
80,4 |
82,8 |
82,5 |
Sans doute, le retard d'investissement évoqué
plus haut pourrait-il inciter les entreprises à entreprendre des
investissements, ne serait-ce que par souci de modernisation. Mais, ceci
supposerait diverses conditions qui ne paraissent pas remplies.
Il faudrait d'abord que les perspectives de rentabilité des
investissements physiques soient mieux orientées qu'elles ne le sont.
Il faudrait ensuite que les grandes entreprises privilégient des
investissements de capacité par rapport à d'autres emplois de
leur épargne, comme les investissements directs à
l'étranger ou les prises de participation dans des entreprises
nationales.
Il faudrait aussi que le retard d'investissement soit perçu comme un
handicap, ce qu'il n'est pas compte tenu des taux d'utilisation des
capacités de production et, probablement, d'une meilleure utilisation
des investissements en place.
Il faudrait enfin que les conditions financières des entreprises soient
améliorées et, à tout le moins, préservées.
Or, les ponctions supplémentaires opérées par le
gouvernement, qui altèrent au demeurant la stabilité fiscale
nécessaire au lancement de projets, viennent dégrader une
situation sans doute meilleure que dans un passé récent, mais
encore fragile.
Dans ces conditions, la prévision du gouvernement apparaît fort
incertaine. Pour mesurer l'aléa, il suffit d'indiquer que sans
investissement supplémentaire en 1998, la croissance ne
s'élèverait plus qu'à 2,7 % contre les 3 %
prévus par le gouvernement.
3. Le faux débat du partage de la valeur ajoutée
Pour expliquer la faible croissance de l'économie
française, le gouvernement insiste sur le préjudice causé
à la consommation et à l'emploi par les modalités de
partage de la valeur ajoutée
4(
*
)
. Le
partage de la valeur ajoutée aurait bridé la consommation des
ménages, ce qui aurait ensuite freiné l'investissement des
entreprises.
Cette appréciation pose d'abord des problèmes de méthode.
Elle est fondée sur des données globales alors même que les
questions posées par le partage de la valeur ajoutée sont
évidemment à contenu fortement sectoriel.
Elle repose partiellement sur un commentaire de l'évolution de la part
des salaires dans la valeur ajoutée mesurée aux coûts des
facteurs qui, discutable économiquement, conduit à afficher des
écarts maximaux, sans doute utiles à la démonstration,
mais qui n'emportent pas la conviction. Elle conduit à focaliser le
débat sur un type de partage de la valeur ajoutée qui n'est pas
pertinent.
Ainsi, s'il est exact que les charges salariales directement supportées
par les employeurs contribuent à la formation du revenu des
ménages, celle-ci est dépendante de bien d'autres facteurs dont
l'évolution influence à son tour le revenu disponible brut des
entreprises. Car, s'il est vrai que l'excédent brut d'exploitation est
un élément de ressources pour les entreprises, on doit en
déduire une série d'opérations pour aboutir à
l'épargne brute utilisable par les entreprises pour financer leurs
investissements.
En bref, tout comme le revenu disponible brut pour les ménages,
l'épargne brute des entreprises apparaît comme une variable plus
pertinente pour apprécier leurs capacités financières que
l'excédent brut d'exploitation.
En toute hypothèse, la situation décrite dans le rapport
économique et financier est factuellement contestable. Dans les faits,
le taux de marge des entreprises -hors grandes entreprises nationales- qui
rapporte leur excédent brut d'exploitation à leur valeur
ajoutée qui s'était considérablement dégradé
en 1975, passant de 29,4 % en 1974 à 26 %, a stagné
jusqu'en 1984 autour de 25 %. Puis, il s'est redressé
progressivement sous l'effet de la politique de désinflation
compétitive pour atteindre 31,8 % en 1989.
Depuis, le taux de
marge des entreprises s'est à nouveau dégradé, de l'ordre
de 1,5 point entre 1989 et 1996.
Pour 0,6 point, cette dégradation a correspondu à une
augmentation de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Pour
0,9 point, elle s'explique par un alourdissement des impôts
liés à la production supportés par les entreprises.
Enfin, le débat ainsi posé ignore certaines données
fondamentales.
L'évolution du taux de marge des entreprises a, en
réalité, été très
différenciée
. Si l'on ne dispose pas d'éléments
permettant d'en appréhender facilement l'évolution selon la
taille de l'entreprise, une discrimination peut être opérée
en fonction des branches d'activité auxquelles se rattachent les
entreprises.
Evaluation du taux de marge entre 1982 et 1992
dans les
branches industrie et commerce et services marchands
|
1982 |
1989 |
1992 |
|
|
Industrie |
24,8 |
36,3 |
34,8 |
|
Commerce et services marchands |
40,6 |
43,1 |
42 |
Le tableau qui précède apporte la
démonstration que si le taux de marge dans l'industrie s'est beaucoup
accru depuis 1982, la progression du taux de marge dans le secteur du commerce
et des services marchands qui inclut pour une part la
rémunération des exploitants individuels a été,
elle, très modérée. En outre, le taux de marge des deux
secteurs a diminué depuis 1989.
La déformation du partage de la valeur ajoutée n'a donc
été significative que dans l'industrie.
En outre
, contrairement à ce qui est suggéré,
elle n'a pas entraîné de baisse des salaires.
L'exemple du secteur industriel est à cet égard très
parlant. Dans ce secteur, la progression annuelle moyenne du taux de marge
s'est élevée à 3,4 % sous l'effet d'un accroissement
de l'excédent brut d'exploitation de 9,3 %. Dans le même
temps, la rémunération versée à chaque
salarié du secteur s'est accrue de 6,7 % par an. La variable
d'ajustement a donc été l'emploi qui a reculé de plus de
16 % entre 1982 et 1992. En bref, les gains de productivité
réalisés sous l'effet d'une réduction des emplois ont
été distribués aux salariés pour 90 % d'entre
eux, le reste, soit un point par an, servant à améliorer le taux
de marge des entreprises qui s'est en effet redressé de 10 points
en 10 années.
La déformation du partage de la valeur ajoutée n'a donc pas
sacrifié le pouvoir d'achat des salariés de l'industrie. Leurs
salaires réels se sont accrus de 1,9 % par an entre 1982 et 1992.
En revanche, le partage du surplus de productivité s'est fait au
détriment des chômeurs, puisque le nombre des emplois dans le
secteur a diminué de 1.169.000 unités, soit de 1,5 %
par an.
C'est donc un meilleur partage du surplus de productivité entre
emplois et salaires qu'il convient de rechercher pour résoudre le
problème du chômage plutôt qu'un meilleur partage de la
valeur ajoutée entre salaires et profits.
De la même manière, on ne peut considérer que le partage
de la valeur ajoutée aurait été excessivement favorable
aux entreprises et sans effet sur l'investissement.
Les comparaisons internationales démontrent que la part des salaires
dans la valeur ajoutée estimée aux coûts des facteurs, si
elle est plus élevée aux Etats-Unis et au Japon qu'en Europe, se
trouve en France, avec 66,2 %, proche de la moyenne européenne
(68,2 %) et plus élevée qu'aux Pays-Bas et qu'en Allemagne.
Il existe d'ailleurs en Europe une réelle convergence à ce sujet
à laquelle n'échappe que la Grèce. S'éloigner des
performances de nos concurrents reviendrait à dégrader notre
compétitivité internationale. Les capacités
financières des entreprises s'en trouveraient en outre amoindries, ce
qui ne serait pas favorable à l'investissement. Le taux de rendement du
capital des entreprises s'infléchirait.
Or, contrairement à ce qui est fréquemment indiqué, le
rapprochement entre les capacités financières des entreprises
et leurs investissements ne démontre pas que ceux-ci seraient
substantiellement inférieurs à celles-là
.
On établit usuellement ce diagnostic en arguant de la valeur prise par
le taux d'autofinancement des entreprises qui s'établit, pour l'ensemble
des sociétés et quasi-sociétés non
financières, à 111,6 %.
Rappelons que le taux d'autofinancement au sens strict est le rapport entre
l'épargne brute des entreprises et leur formation brute de capital fixe
nette des cessions
5(
*
)
. Il est frappant
d'observer que
cette grandeur ne commence à devenir positive qu'en
1993, première année pour laquelle des comptes nationaux
définitifs ne sont pas disponibles
. Or, il existe un
désaccord entre l'INSEE et le ministère de l'industrie sur
l'évolution de l'investissement industriel. Selon le dernier rapport sur
l'industrie française, la croissance de l'investissement industriel
aurait été de 9,3 % depuis 1993, soit sensiblement plus
soutenue que celle retenue par l'INSEE. A cette incertitude sur le niveau
réel de l'investissement des entreprises s'ajoute un problème de
méthode. Le taux d'autofinancement ne comporte pas à son
dénominateur les investissements incorporels qui, dans une
économie qui se dématérialise, acquièrent une
importance relative toujours plus grande. Corrigé de ceux-ci, le taux
d'autofinancement serait très proche de 100 en 1996.
Mais au-delà de ces graves problèmes statistiques, l'analyse
selon laquelle les capacités de financement des entreprises
censées être apparues depuis 1993 constituent une situation
économique peu satisfaisante
6(
*
)
est
entièrement erronée compte tenu du niveau réel des
coûts de financement, de l'économie mondialisée dans
laquelle les entreprises évoluent et des exigences de retour financier
des prêteurs. On doit ajouter d'ailleurs que l'investissement
obéit à des cycles et que les années 80 et le début
des années 90 s'étant traduites par une très forte
croissance de la FBCF, il n'est pas anormal que l'investissement se soit
ralenti depuis 1993.
CHAPITRE II
LES DANGERS DE LA GESTION DES
FINANCES PUBLIQUES "A LA FRANÇAISE"
Dans son projet de loi de finances pour 1998, le gouvernement
a préféré stabiliser le solde budgétaire
grâce à l'accroissement des prélèvements,
plutôt que de poursuivre l'effort de réduction des
dépenses. Cette orientation, qui ne remet pas en cause la qualification
de la France pour la "première vague" de l'euro, la marginalise
néanmoins au sein des pays de l'OCDE et pose la question de la
soutenabilité à long terme de la politique budgétaire
française.
Une politique ambitieuse de réduction de la dépense pour
permettre un allégement des prélèvements obligatoires est
pourtant possible. Elle recréérait les conditions d'un dynamisme
de l'économie française.
Une variante macroéconomique a été réalisée
par l'OFCE à la demande de la Commission des Finances pour simuler les
effets d'une baisse de un point de PIB des dépenses publiques
associée à une baisse de même montant des cotisations
sociales supportées par les employeurs.
Ses résultats sont retracés dans le tableau
ci-après :
Ecarts par rapport au compte central
|
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
|
PIB
|
- 0,46
|
- 0,06
|
0,20
|
0,41
|
0,57
|
Il apparaît que, en dépit de l'effet
"keynésien" défavorable sur le PIB de la baisse des
dépenses publiques en début de période, la mesure serait
neutre sur l'activité dès la deuxième année et
favorable au-delà. La compétitivité extérieure
serait améliorée de même que les capacités
financières des entreprises dont l'investissement réagirait en
conséquence. Le supplément de croissance et la baisse du
coût du travail provoqueraient un redressement de l'emploi favorable au
revenu des ménages dont la consommation s'accroîtrait par paliers.
Les finances publiques en sortiraient confortées, le déficit
régressant dès la deuxième année pour
s'établir à - 0,25 point de PIB en fin de
période sous le seul effet de la mesure.
I. UNE MAÎTRISE DES DÉPENSES QUI RESTE À ACCOMPLIR
A. UNE COMPARAISON INTERNATIONALE DEFAVORABLE A LA FRANCE
La France est particulièrement mal classée parmi ses partenaires étrangers en termes de dépenses publiques : en effet, une comparaison toute récente effectuée par l'institut Rexecode (octobre 1997) permet de situer le niveau et la nature des dépenses publiques de la France par rapport à celles des onze pays de l'OCDE.
1. Un niveau de dépenses publiques élevé
Les dépenses publiques de la France se placent au
quatrième rang de celles des pays du monde développés
derrière les pays scandinaves hors Norvège. Les dépenses
publiques sont "au-dessus" des dépenses publiques allemandes de
5,5 points de produit intérieur brut.
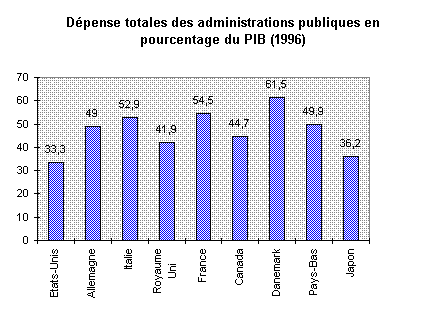
2. Un accroissement récent des dépenses primaires
Ce classement de la France se retrouve si l'on ne considère que les dépenses "hors dette". En effet, la France a augmenté ses dépenses "primaires" de + 5,8 points de PIB entre 1980 et 1996, alors que, excepté l'Italie, les autres pays de l'Union européenne de développement comparable ont connu soit une baisse de ces mêmes dépenses (Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas) soit une hausse modérée (Danemark, Suède).
3. Des postes de dépenses particulièrement lourds
La spécificité la plus forte des dépenses publiques françaises est le poids de sa fonction publique : en France, le poids des administrations publiques dans l'emploi total atteint presque 25 %. Même si la comparaison ne peut être directe en raison des différences institutionnelles entre les deux pays, les effectifs sont comparables à ceux des fonctionnaires allemands, mais pour une population de 58,4 millions au lieu de 82 millions d'habitants.
La France à contre-courant en matière de
réduction des dépenses
de fonction publique
Depuis la fin des années 80, la réduction du
volume de l'emploi public est un élément essentiel des
stratégies de maîtrise des dépenses publiques chez les
partenaires de la France.
Les programmes de réduction des effectifs publics mis en oeuvre par de
nombreux partenaires de la France peuvent surprendre par l'ampleur des coupes
proposées. Ainsi, les emplois du secteur public britannique ont
diminué de 22 % entre 1987 et 1990. En Suède, un plan de
réduction de 23 % des effectifs en deux ans a été
adopté en 1989. Il a plus tard été révisé
à la hausse. Au Canada, l'emploi dans les services publics a
diminué de 5 % entre 1985 et 1993. Aux Etats-Unis, un objectif de
compression de 13 % des effectifs, soit 272.000 fonctionnaires, a
été fixé en 1993. En Allemagne, l'emploi public a
été réduit de 250.000 postes entre 1991 et 1995. Aux
Pays-Bas, les effectifs de la fonction publique ont décru de 0,4 %
par an depuis 1987.
Les modalités de réalisation de ces programmes varient d'un pays
à l'autre. En Grande Bretagne, la réduction du nombre de
fonctionnaires est largement due à la réduction de la taille du
secteur public. Aux Etats-Unis, l'administration essaie de limiter le nombre de
licenciements en développant des programmes d'"achat" des
départs. Aux Pays-Bas, la baisse du nombre d'emplois publics s'est
accompagnée d'une forte augmentation du nombre de fonctionnaires
allocataires de pensions d' "incapacité", si bien que l'impact de la
baisse des effectifs sur les finances publiques est difficilement
évaluable. Au Canada, en revanche, l'assainissement a été
obtenu grâce à des mesures de restrictions budgétaires
aboutissant au regroupement ou à la suppression d'agences
gouvernementales, ainsi que la réduction du nombre de ministères.
En France, la progression du nombre d'emplois publics a été
continue jusqu'en 1996. De 1973 à 1996, la variation de l'emploi total,
soit + 1 million, résulte d'une création de
1,6 million d'emplois publics et d'une destruction de 600.000 emplois
dans le secteur privé marchand.
B. DES EFFORTS DE FREINAGE ENCORE INSUFFISANTS
1. La nécessaire réduction de la dépense publique
L'impératif de réduction de la dépense publique a été affirmé pour la première fois dans la loi quinquennale de maîtrise des finances publiques du 24 janvier 1994 préparée par le gouvernement Balladur : partant de la nécessité de réduire les déficits publics à 3 % en 1997, de la mécanicité de la progression des charges de la dette, d'une hypothèse d'augmentation de recettes parallèle à celle du PIB, un tableau permettait d'afficher la nécessité de réduire le volume des dépenses hors dette dès 1995.
2. Une situation de départ apparue entre 1990 et 1992
Cette nécessité de réduire la dépense est apparue dans un contexte dégradé : en effet, entre 1990 et 1992, le total des dépenses civiles nettes des charges de la dette avait progressé de 10,7 %. Au cours de ces trois années, les charges de personnel avaient augmenté de 10,4 % (soit en moyenne + 3,3 % par an), les dépenses d'intervention de 9,8 %, alors que les dépenses d'investissement de l'Etat reculaient, sur la même période, de près de 25 %.
3. Les résultats des années 1993 à 1996 n'atteignent pas les objectifs
Dans son rapport sur l'exécution des lois de finances pour l'année 1996, la Cour des Comptes compare les résultats obtenus en termes de maîtrise de la dépense sur ces trois dernières années aux objectifs de la loi quinquennale de maîtrise des dépenses publiques.
Evolution des dépenses de l'Etat
|
1994 |
1995 |
1996 |
|
|
Dépenses nettes du budget général (hors charges de la dette) |
+ 1,4 % |
+ 2,8 % |
+ 3 % |
|
Dépenses nettes du budget général, y compris charges de la dette et charges des comptes spéciaux du Trésor |
|
|
|
Source : Cour des comptes
Comme le souligne la Cour : "
Force est de constater que la
stabilisation complète des dépenses en volume, prévue
dès 1995 par la loi d'orientation, n'a pas été atteinte.
Surtout le ralentissement des dépenses n'a pas été obtenu
de la manière prévue
". En effet, en 1996, le ralentissement a
été dû pour l'essentiel à une évolution plus
modérée que prévu des charges de la dette, et au
quasi-équilibre des opérations temporaires des comptes
spéciaux du Trésor.
En particulier, l'examen rétrospectif des dépenses des
titres III (Personnel et fonctionnement) et IV (Interventions publiques)
montrent la difficulté rencontrée à maîtriser les
dépenses dites "primaires" :
ces titres ont augmenté, en
exécution, de 3,4 % en moyenne entre 1993 et 1996.
C. ALLER PLUS LOIN
1. Faut-il continuer à réduire la dépense publique ?
Dans le contexte actuel où les
prélèvements obligatoires atteignent 46 % du PIB -et ont
manifestement dépassé le seuil de tolérance de nos
concitoyens-, il n'y a d'autre solution pour contenir le déficit que de
réduire la dépense.
Cette impérieuse nécessité de réduction de la
dépense publique est d'ailleurs la conclusion des travaux d'audit
conduits par MM. Jacques Bonnet et Philippe Nasse :
"
Pourtant, agir sur la dépense est le seul moyen de réduire
les déficits, comme la France s'y est engagée, sans
accroître des prélèvements obligatoires déjà
très lourds. Ce résultat ne pourra donc être obtenu que par
des actions de fond. Il faudra tout à la fois rendre les services de
l'Etat plus productifs et leur activité plus efficace. Dans le premier
cas, c'est l'organisation des services, centraux et déconcentrés,
et leur fonctionnement qui est en cause. Dans le second, c'est
l'instabilité, la complexité et l'efficacité, souvent
inconnue et parfois contestable, des législations qui gouvernent les
diverses interventions de l'Etat.
Enfin, certaines questions très délicates telles que l'avenir des
régimes de retraites publiques ne pourront pas être
indéfiniment éludées, même si elles ne peuvent
être abordées qu'avec précaution. La compatibilité
durable du maintien d'un certain rôle régulateur et protecteur de
l'Etat avec un niveau de prélèvements obligatoires ne
pénalisant pas notre économie par rapport à celle de nos
grands concurrents est à ce prix.
"
Toutefois, il ne faut pas perdre de vue le véritable objectif, qui n'est
pas de faire passer le déficit budgétaire dans le "chas" des
3 %", mais de stabiliser l'endettement. Or, pour y parvenir, c'est une
réduction de dépenses de 98,7 milliards de francs qui
devrait être opérée en 1998...
2. Peut-on réduire la dépense publique ?
Il est communément admis que le budget de l'Etat est
très peu flexible.
Au minimum, il faut en effet considérer que plus de la
moitié des dépenses de l'Etat -soit les
charges de
personnel
et les
charges de la dette
- ne peuvent donner lieu
à un freinage massif à court terme.
Poids des charges de personnel et de dette dans le budget général
(en milliards de francs)
|
LFI 1997 |
en % du budget |
|
|
Charges de personnel |
591,355 |
37,8 |
|
Charges de la dette |
250,583 |
16 |
|
TOTAL |
841,938 |
53,8 |
|
TOTAL DEPENSES BUDGET |
1.564 |
100 |
MM. Jacques Bonnet et Philippe Nasse, après
avoir regretté que la Direction du Budget ne soit pas en état de
mesurer la "rigidité" des dépenses de l'Etat, estiment à
près de 90 % les charges inéluctables de l'Etat à
législation constante
7(
*
)
.
Au sein de ces dépenses, les
charges de pensions
sont
amenées à progresser, au cours des années à venir,
dans des proportions considérables.
Les retraites de la fonction publique : une explosion programmée
Comme le reconnaît le ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie, le poids des retraites de la
fonction publique va changer de dimension au cours des quinze années
à venir :
"Les retraités de la fonction publique représentent actuellement
près de 600.000 militaires et 1.200.000 pensionnés
civils (y compris les retraités de La Poste et France
Télécom). Si le nombre des retraités militaires est
à peu près stable, celui des pensionnés civils augmente de
façon significative. En 1995, le rapport du nombre des actifs cotisants
au nombre de retraités de droit direct s'établissait à
2,53 pour les fonctionnaires civils. Il se compare favorablement à celui
du régime général de la sécurité sociale
(1,75 à la même date).
Ce rapport est un paramètre déterminant de l'équilibre
d'un régime : plus il est faible, plus la charge du financement par
actif est lourde. Pour les seuls fonctionnaires civils, il serait presque
divisé par deux en vingt ans (1,39 à l'horizon 2015) alors que
durant la même période, ce même rapport ne baisserait que
d'environ un tiers pour le régime général (1,37 en 2015).
L'écart tient pour une large part à une croissance plus rapide du
nombre de retraités fonctionnaires en liaison avec des âges de
départ à la retraite plus précoces que dans le
régime général.
Au-delà des éléments démographiques,
l'évolution des charges et des ressources des régimes
considérés dépend de paramètres plus
économiques, notamment de la croissance plus ou moins rapide du niveau
moyen des pensions et de l'évolution des salaires de leurs cotisants.
Ainsi,
pour les fonctionnaires civils
, l'évolution
démographique combinée à la croissance de la pension
moyenne conduira à
un coût croissant des charges de
pensions
du régime qui devrait mettre à la charge de la
collectivité, à
l'horizon 2010
, un coût
additionnel, par rapport à aujourd'hui, de
près de
79 milliards de francs en francs constants.
S'il apparaît, à la lumière des évolutions mises en
avant ci-dessus, qu'une réforme structurelle devra inévitablement
être mise en oeuvre dans les années à venir, il convient de
noter toutefois que toute réforme en matière de retraite, ne
conduit que très lentement à des économies significatives
en raison d'une application limitée aux seuls flux des départs en
retraite.
A titre d'illustration
, une réforme qui réduirait de 1 %
supplémentaire chaque année pendant dix ans
, de 1998 à
2007,
le montant moyen des nouvelles pensions concédées
(- 10 % par rapport au montant tendanciel en 2007 pour les
concessions 2007)
ne procurerait
que 3,9 milliards de francs
d'économies
(en francs constants),
soit 2,5 % du montant
total des pensions et 8,5 % de la dérive de leur coût
résiduel
pour l'Etat sur la période envisagée.
S'il apparaît que la situation financière attendue à moyen
et long terme du régime des fonctionnaires de l'Etat comme de l'ensemble
des régimes spéciaux de retraite nécessitera une
adaptation de ces régimes, celle-ci doit être envisagée de
façon globale, car les mesures mises en oeuvre ne peuvent pas se
concevoir sans aborder tous les aspects propres à l'acquisition des
droits.
Seule cette démarche d'ensemble et concertée avec les
intéressés peut permettre de dégager des moyens de
pilotage du régime plus performants et d'asseoir une certaine
stabilité financière."
Par ailleurs, les crédits d'
investissement
sont en baisse
continue depuis plusieurs années et ne représentent plus, en
1997, que 160,6 milliards de francs (soit un peu plus de 10 % du
budget de l'Etat).
L'effort doit donc porter sur les dépenses de
fonctionnement
(hors personnel) et les dépenses d'
interventions
publiques
.
Celles-ci se répartissent ainsi en 1997 :
Dépenses de fonctionnement (hors personnel) et
d'interventions publiques en 1997
|
(en milliards de francs) |
|
|
Dépenses de fonctionnement (hors personnel) |
115,247 |
|
Interventions publiques |
456,641 |
|
TOTAL |
571,888 |
Au total, la somme des dépenses de personnel et de fonctionnement s'établit à 706,125 milliards de francs.
a) Les dépenses de fonctionnement : un effort inégal de maîtrise.
Les dépenses de fonctionnement se répartissent de la manière suivante en 1997 :
(en millions de francs)
|
Dépenses |
Montant |
|
Matériel et fonctionnement des services |
45.284,9 |
|
Travaux d'entretien |
1.657,6 |
|
Subventions de fonctionnement |
52.008,5 |
|
Dépenses diverses |
16.296,2 |
Les dépenses directes de
matériel
et
fonctionnement
de l'administration ont subi plusieurs années
de baisse, portant davantage sur les services civils que sur le budget de la
défense.
En effet, les grandes opérations d'informatisation des ministères
sont en général terminées.
Par ailleurs, ces chapitres ont, notamment, subi les effets de
régulations budgétaires successives, qui ont réduit des
dépenses telles que les crédits de communication qui avaient eu
tendance à s'accroître au début des années 1990.
Les dépenses de
travaux d'entretien
connaissent une baisse
régulière, qui a ramené leur niveau total à un peu
plus de 1 % du budget de l'Etat.
En revanche, les
subventions de fonctionnement
ont connu, entre
1993 et 1996, une progression de 13,1 %.
En 1997, cette augmentation se poursuit, à un taux de 3,19 %.
Evolution des dépenses de subventions de
fonctionnement
(en exécution)
(en millions de francs)
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
Variation 96/95 |
|
|
Recherche |
19.074 |
18.581 |
19.456 |
19.942 |
2,5 % |
|
Enseignement supérieur |
5.137 |
5.557 |
5.750 |
6.260 |
8,9 % |
|
Travail, emploi et formation professionnelle |
4.648 |
4.981 |
5.131 |
5.317 |
4,5 % |
|
Industrie et postes et télécommunications |
3.487 |
4.417 |
4.546 |
4.579 |
0,7 % |
|
Education nationale |
4.110 |
3.985 |
4.021 |
4.014 |
- 0,2 % |
|
Culture |
2.345 |
2.472 |
2.768 |
3.283 |
18,6 % |
|
Affaires étrangères |
1.485 |
1.348 |
1.458 |
1.545 |
6,0 % |
|
Météorologie |
0 |
901 |
915 |
932 |
1,9 % |
|
Total des budgets civils |
43.779 |
46.014 |
47.834 |
49.501 |
3,5 % |
|
Défense (pour mémoire) |
889 |
923 |
943 |
1.029 |
9,1 % |
|
TOTAL |
44.668 |
46.937 |
48.777 |
50.530 |
3,6 % |
Source : Cour des Comptes.
Cette progression mérite de donner lieu à un
examen attentif : l'Etat, en effet, ne peut pas permettre aux
établissements publics ce qu'il ne se permet plus à
lui-même...
Les "
dépenses diverses
", dont le montant est de
16,3 milliards de francs en 1997, recouvrent des dotations de nature
totalement hétérogène, et dont l'évolution n'est
pas régulière : frais de gestion des protocoles avec les
Etats étrangers, financement des partis politiques,
rémunération des prestations de la Banque de France. Pour autant
elles ne doivent pas échapper à l'effort de maîtrise de la
dépense publique : on y trouve ainsi des dépenses dont la
progression est continue, telles que les frais de justice qui atteignent
1,4 milliard de francs en 1997, et dont l'augmentation n'est aucunement
maîtrisée.
b) Les dépenses d'interventions : des choix politiques difficiles
La nature des dépenses d'intervention
Ces dépenses représentent
456,6 milliards de francs en
1997
, en progression de 1,96 %.
La structure des dépenses d'interventions publiques en 1997 est la
suivante :
(en milliards de francs)
|
Interventions publiques
Interventions politiques et administratives
|
21,547
|
|
Action éducative et
culturelle
|
78,144
|
|
Action économique
|
146,229
|
|
Total général |
456,641 |
Une progression soutenue
La progression des dépenses du titre IV est restée soutenue
au cours des dernières années : + 5,2 % en 1994,
+ 4 % en 1995
8(
*
)
, + 3,3 % en
1996, + 1,96 % en 1997.
Le poste le plus important est celui de
l'action sociale, assistance et
solidarité
: 149,4 milliards de francs, qui progresse de
1,52 % en 1997 ; au sein de ces dépenses figurent notamment le
RMI, et l'allocation aux adultes handicapés.
Le poste le plus dynamique est incontestablement celui de l'
action
économique
-encouragement et interventions, dont l'augmentation
est de + 10,04 % en 1997 (soit 146,2 milliards de francs). En
effet, pour l'essentiel, ces dépenses recouvrent les mesures de la
politique de l'emploi.
Le troisième poste de dépenses, par ordre d'importance, est celui
de
l'action éducative et culturelle
: 78,1 milliards de
francs en 1997, soit - 4,6 %. Ces dépenses portent notamment
sur l'aide à l'enseignement privé, les bourses et services
d'études, et la formation professionnelle.
Par nature, les dépenses d'intervention apparaissent a priori comme
les plus flexibles, car traduisant des décisions de politique
économique et sociale délibérées de l'Etat. Elles
présentent une vraie difficulté dès lors qu'elles
enregistrent une croissance continue depuis de nombreuses années, ainsi
qu'en témoignent les exemples suivants.
L'expansion du revenu miminum d'insertion
Ainsi, les crédits consacrés au revenu minimum
d'insertion connaissent depuis l'institution du dispositif une progression
continue : le nombre de bénéficiaires est en effet passé
de 407.081 en décembre 1989 à 1.010.472 en décembre 1996.
L'évolution des crédits depuis 1989 a été la
suivante :
(en milliards de francs)
|
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
6 |
8,6 |
14,3 |
13,17 |
16,63 |
19,22 |
22,02 |
23,18 |
24,4 |
|
+ 45 % |
+ 65 % |
- 8 % |
+ 26 % |
+ 16 % |
+ 15 % |
+ 5 % |
+ 5 % |
Depuis 1989, le nombre des bénéficiaires s'est accru de 148 % et le montant des allocations (en francs courants) de 306 %.
La progression continue de l'allocation aux adultes handicapés
Les crédits consacrés à l'allocation aux adultes handicapés évoluent de manière inquiétante :
(en milliards de francs)
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
17,8 |
18,6 |
20,08 |
21,52 |
22,26 |
Le nombre de bénéficiaires est passée de 495.000 en 1987 à 630.000 en 1996 et ce malgré la réforme instituée par la loi de finances pour 1994, prévoyant que les bénéficiaires doivent justifier d'un taux minimal d'incapacité -fixé à 50 % par un décret du 16 mai 1994-.
L'inexorable (?) progression des aides personnelles au logement
Bien que leur généralisation à l'ensemble
de la population sous conditions de ressources soit achevée depuis 1993,
les aides personnelles au logement continuent de croître inexorablement.
La charge budgétaire s'élève à 33,1 milliards de
francs en 1998, en augmentation de 11,5% sur la dotation prévue pour
1997.
|
Part de l'Etat dans le financement des différentes aides |
||||||||||
|
(en milliards de francs) |
||||||||||
|
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
|||
|
Total Etat
(1)
|
18,690
|
20,521
|
19,450
|
19,415
|
28,428
(2)
|
27,500
|
29,942
|
32,050
|
||
|
Part de l'Etat dans le financement total |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
(2) dont 2 milliards au titre des aides à la personne versées par les Caisses en 1992, régularisées en 1993.
Cette progression des dépenses est directement liée à celle du nombre de ménages bénéficiaires, particulièrement de l'allocation de logement sociale (ALS) ainsi que l'illustre le graphique suivant :
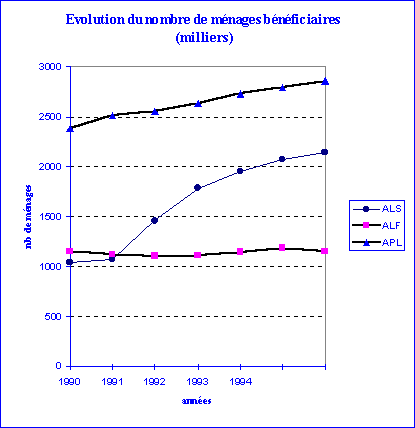
Le nombre de ménages bénéficiaires est
ainsi passé de 4,579 millions en
1990 à
6,148 millions en 1996.
Mais cette explication ne suffit pas
à comprendre pourquoi l'effet "boule de neige" perdure actuellement
La réalité est que notre système d'aides personnelles
est paramétré de telle sorte qu'il est voué à
coûter toujours plus cher
.
9(
*
)
On peut tout d'abord constater que
la France a une conception
généreuse de la population justifiant d'une aide personnelle
,
ce qui entraîne un coût par habitant parmi les plus
élevés d'Europe. On considère ainsi que plus du quart des
ménages ont besoin d'une aide au logement, contre 20% au Royaume-Uni, et
8 % seulement en Allemagne. Cette conception généreuse tend
à faire des aides à la personne un revenu normal pour une frange
importante de la population.
Ensuite,
on doit observer que le bouclage intervenu entre 1990 et 1993 a
quelque peu perverti la notion de conditions de ressources
en profitant
massivement aux étudiants, quel que soit le niveau de revenus de leur
famille. Ainsi, au 31 décembre 1996, sur 997.120 ménages
ayant bénéficié du bouclage de l'ALS de 1990 à
1996, 533.000 sont des étudiants,
soit 53 % des ménages
"bouclés"
. Or on peut souhaiter que la population étudiante
augmente plus vite que le nombre de ménages modestes.
Enfin, au-delà des imperfections liées aux méthodes de
prises en compte des ressources, l'hystérésis budgétaire
des aides personnelles provient surtout de ce qui fait leur essence même
:
elles augmentent au fur et à mesure qu'augmentent les
dépenses de logement des ménages bénéficiaires.
La France a également une conception généreuse de la
prise de la dépense de logement par l'aide, avec 52%, derrière le
Royaume-Uni (90%), qui couvre une fraction plus faible de sa population, mais
devant l'Allemegne (34%) et les autres pays comparables.
Or, plus le parc de logements se rénove et se renouvelle, plus son
confort croît, plus son coût est élevé : les loyers
s'élèvent davantage que les ressources des ménages. Les
aides personnelles tendent donc structurellement à augmenter.
Les difficultés rencontrées pour maîtriser les
dépenses d'intervention s'illustrent parfaitement à travers les
crédits pour l'emploi : leur expansion est continue, et leur
flexibilité est faible, sauf à s'interroger sur
l'efficacité jamais vraiment mesurée de cet empilage de
dispositifs.
L'exemple de la rigidité
des mesures pour
l'emploi
Une analyse rapide des crédits pour l'emploi illustre
la difficulté à désigner des pistes
d'économies : en 1997, ces crédits s'élèvent
à
150 milliards de francs
, soit près de 10 % des
dépenses de l'Etat, en progression de 8 % par rapport à 1996.
Sur ce total :
14 milliards de francs
sont consacrés au fonctionnement
du service public de l'emploi : ministère du travail, Agence
nationale pour l'emploi, Association pour la formation professionnelle des
adultes.
8,5 milliards de francs
représentent des dotations de
décentralisation de la formation aux régions, indexées
automatiquement sur l'évolution des prix ;
7,5 milliards de francs
sont consacrés à
l'indemnisation des chômeurs de fin de droits ;
4,7 milliards de francs
correspondent à la garantie de
ressources accordée automatiquement aux handicapés qui
travaillent pour leur assurer un revenu minimum ;
1,5 milliard de francs
sont destinés aux
bénéficiaires des conventions sociales de la sidérurgie.
Ce total de 36,5 milliards de francs paraît a priori peu flexible.
Sur les 113,5 milliards de francs restants :
42 milliards de francs
sont destinés à
l'allégement du coût du travail peu qualifié, sous forme de
compensation de la ristourne de charges sociales accordée
automatiquement pour les salaires allant jusqu'à 1,33 SMIC.
Les 71,5 milliards de francs restants
financent des
dispositifs d'aide à l'emploi :
16,4 milliards de francs
sont consacrés à la
prévention ou à l'encouragement des licenciements
économiques (préretraites, chômage partiel...) ;
7,6 milliards de francs
financent des actions pour les
jeunes, essentiellement sous forme d'apprentissage et de contrats de
qualification... ;
40,33 milliards de francs
sont destinés aux actions
pour les demandeurs d'emploi : CES, contrat initiative emploi,
formations ;
2,2 milliards de francs
sont consacrés à des
mesures d'exonérations de charges sociales ciblées : zones
franches, zones de revitalisation rurale, outre-mer...
Au total, cette enveloppe de
71,5 milliards de francs
finance
1.520.000 entrées
dans des dispositifs divers. La question
pour l'Etat est de savoir comment maîtriser cette dotation, dans un
contexte où plus de 3.500.000 personnes sont recensées comme
demandeurs d'emploi.
Des choix difficiles
L'ampleur et le dynamisme des dépenses d'intervention
révèlent le rôle redistributeur de l'Etat dans la vie
économique et sociale
10(
*
)
.
La réduction de ces dépenses doit résulter d'un examen
attentif de chacune de leurs composantes -certaines étant d'ailleurs non
flexibles comme les dotations de décentralisation ou les participations
aux organisations internationales.
Cet examen doit consister :
- à vérifier, en premier lieu, la bonne utilisation des
fonds : c'est le cas pour l'allocation aux adultes handicapés par
exemple ;
- à s'interroger sur l'efficacité de la
dépense : les stages pour les chômeurs de longue durée
sont-ils utiles pour les intéressés ? Mène-t-on une
politique cohérente en matière d'encouragement à la
construction ?
- à recalibrer, le cas échéant, les bases mêmes
de la dépense : les aides personnelles au logement ne doivent-elles
pas être reconsidérées en fonction du niveau des ressources
des ménages ?
- voire à remettre en cause le principe même d'une
intervention de l'Etat : ainsi celui-ci doit-il encore financer son
programme de formation professionnelle, celle-ci étant
décentralisée aux régions depuis 1983 ?
Ce n'est qu'au prix de cet examen minutieux et approfondi des
mécanismes de formation de la dépense que la maîtrise des
crédits d'intervention pourra être enfin assurée
.
II. LA RÉFORME DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES DOIT ÊTRE ENGAGÉE
Les prélèvements obligatoires, plus lourds dans
l'Union Européenne qu'aux Etats-Unis ou au Japon (41,8 % du PIB en
1995 contre moins de 30 %), le sont encore plus particulièrement en
France où ils atteignent 46 % du PIB en 1997.
Caractérisés par un niveau élevé et une tendance
à la progression, ils pèsent particulièrement sur la masse
salariale brute en France.
Or, il s'avère qu'au delà des charges sociales traditionnellement
plus lourdes en France,
la fiscalité des entreprises
joue
aujourd'hui
un rôle
non négligeable
dans la localisation
d'activité
.
A. L'IMPACT DES CHARGES FISCALES ET SOCIALES SUR LA LOCALISATION D'ACTIVITÉ
1. Les prélèvements obligatoires sont un handicap majeur pour la France
Plusieurs études soulignent l'incidence des
différentiels de taxation et de charges sociales sur les marchés
des biens, des capitaux et du travail.
En 1992, le comité de réflexion des experts indépendants
sur la fiscalité des entreprises
11(
*
)
concluait après une étude empirique que "
des
différences fiscales entre Etats membres de l'Union européenne
peuvent affecter les décisions d'implantation à l'étranger
des entreprises multinationales et entraîner des distorsions de
concurrence, en particulier dans le secteur financier
".
Plus récemment, l'étude France Industrie 2000
réalisée par les cabinets BIPE Conseil et Price
Waterhouse
12(
*
)
révèle que le
poids de la dépense publique et donc des
prélèvements
obligatoires
constituent, aux yeux des opérateurs industriels
interrogés, un
handicap majeur de la France
dans le concert des
pays industrialisés. Les critiques des milieux industriels se
concentrent sur deux types de prélèvements : les charges
sociales d'une part, et la taxe professionnelle d'autre part, qui cristallise
les défauts attribués au système fiscal.
L'étude constate en outre que les arbitrages de localisation ne se
décident plus seulement entreprise par entreprise, ou unité de
production par unité de production, mais portent aussi sur des fonctions
de recherche et développement, de logistique, de service à la
clientèle, de comptabilité, qui se trouvent ainsi mises en
concurrence au niveau européen, là où elles restaient
d'ordinaire liées à des choix de localisation de sièges.
Il ressort par ailleurs d'une étude réalisée
récemment par l'institut
Rexecode
pour la commission des finances
du Sénat, que
les questions fiscales sont très souvent une
considération importante pour la localisation d'activité
même si l'estimation varie de manière significative suivant les
fonctions considérées dans l'entreprise.
Ainsi, la fiscalité ne serait pas un facteur important pour les
fonctions "installation de production", "point de vente" et
"centre de
recherche-développement"
13(
*
)
, mais elle
entrerait de manière significative dans la détermination des pays
d'accueil pour l'implantation de certaines activités du secteur
tertiaire en développement, comme les centres de coordination, les
centres de gestion des marques et plus encore les centres de services
financiers. Il s'agit de fonctions que l'on peut qualifier de
"nomades" pour
lesquelles l'environnement juridique et fiscal est déterminant.
Certaines entreprises ont implanté une holding, des centres
administratifs ou de services financiers (trésorerie) à
l'étranger plutôt qu'en France pour des considérations
fiscales. Celles-ci peuvent d'ailleurs être très pointues
(fiscalité des fusions-acquisitions, des apports, des brevets).
D'une manière générale, si l'investissement direct
international obéit à des considérations de
stratégie commerciale de long terme, le système fiscal du pays
d'accueil est toujours considéré comme un " facteur
pertinent " de la décision d'implantation.
La fiscalité
influence donc particulièrement l'implantation des
fonctions
" nomades "
(départements informatiques, centres de
gestion administrative, gestion des marques et brevets, salles de
marché, lieux de stockage) d'autant que se développent des
opérations à " implantation variable " (création
de joint-ventures, de holdings..).
2. L'impôt sur les sociétés influence la répartition géographique de l'investissement
Enfin, l'analyse du lien entre fiscalité et
investissement direct étranger montre que
l'influence de
l'impôt sur les sociétés sur la répartition
géographique de l'investissement ne doit pas être
négligée
.
En effet, le modèle théorique élaboré par Thomas
Horst (1977) à partir d'une entreprise multinationale
" représentative " ayant opté pour la maximisation du
profit et à laquelle toutes les caractéristiques fondamentales du
système américain d'imposition des sociétés sont
applicables, permet de simuler l'impact d'une variation du taux étranger
moyen d'imposition des sociétés non seulement sur
l'investissement mais également sur le comportement financier des
multinationales.
Il apparaît qu'une diminution de 20 % du taux de l'impôt sur
les sociétés dans un pays étranger, a pour
conséquence un accroissement de 12 % de l'investissement
réel dans ce pays de la part des filiales américaines
(élasticité de 0,6). Inversement, il en résulte une
diminution des investissements aux Etats-Unis de 6 %.
Des études économétriques menées dans l'Union
Européenne (Bernard Snoy, 1975) relèvent également
l'incidence négative sur l'investissement direct étranger du
relèvement du taux d'imposition effectif des sociétés
dans le pays d'accueil.
B. LA COMPÉTITIVITÉ HANDICAPÉE PAR LA STRUCTURE FISCALE FRANÇAISE
En regard de ces considérations, la France affiche un
manque de compétitivité certain de sa fiscalité. Certes
les comparaisons internationales sont difficiles du fait de la diversité
des assiettes et des taux et ne permettent pas de conclure de façon
définitive.
Néanmoins,
l'évolution récente de la législation
fiscale traduit une certaine perte de compétitivité fiscale de la
France par rapport à ses principaux concurrents. En outre, la
fiscalité, et notamment celle des entreprises, pèche par sa
complexité, son manque de lisibilité et sa très forte
instabilité.
1. Un coût du travail élevé
a) Le coin socio-fiscal
Il est possible de mesurer le taux des
prélèvements obligatoires qui pèsent sur le facteur
travail à travers la différence entre le coût total pour
l'employeur et ce que reçoit l'employé après impôt.
Cet indicateur, dénommé " coin socio-fiscal ", est
pertinent économiquement puisqu'il donne l'importance de la distorsion
introduite sur le marché du travail par les prélèvements
fiscaux et sociaux.
Un " coin" élevé est en outre souvent présenté
comme risquant d'entraîner une perte de compétitivité dans
la concurrence internationale. En effet, en théorie économique,
la taxation perturbe l'équilibre du marché en introduisant un
" coin " entre le prix d'offre (le salaire net reçu par le
salarié) et le prix de demande (le coût du travail pour
l'employeur). Le poids de prélèvements obligatoires et notamment
les chocs répétés à la hausse expliqueraient ainsi
la croissance du chômage en France et la stagnation du pouvoir d'achat.
Le "coin" socio-fiscal : une étude de Rexecode
L'institut Rexecode a tenté pour la Commission des
finances du Sénat de mesurer le " coin socio-fiscal " dans
trois grands pays européens : la France, l'Allemagne et le Royaume
Uni.
Les résultats conduisent aux observations suivantes :
Des trois pays étudiés, la France et l'Allemagne se distinguent
nettement du Royaume Uni par le niveau plus élevé du coût
total pour l'employeur correspondant à un même niveau de salaire
net,
in fine
, pour l'employé.
La France se distingue nettement des deux autres pays par un taux de charges
fiscales et sociales pour l'employeur nettement plus fort.
L'impôt sur le revenu des personnes physiques est en revanche plus
faible en France qu'en Allemagne et au Royaume Uni, mais le barème est
plus progressif.
Les charges payées par l'employeur sont nettement moins
dégressives en France qu'en Allemagne et dans une moindre mesure qu'au
Royaume-Uni.
L'exonération des charges sur les bas salaires introduit une forte
progressivité des taux de charges patronales sur la tranche des salaires
allant du SMIC à 30 % au dessus du SMIC ; il en résulte
une faible incitation à augmenter les salaires dans le bas de
l'échelle.
enfin, la combinaison d'un barème fiscal fortement progressif et de
cotisations sociales élevées et peu dégressives conduit
à un coin socio-fiscal plus fort en France qu'en Allemagne et au Royaume
Uni pour les salaires relativement plus élevés.
En réalité, les études empiriques montrent qu'il n'existe
pas de corrélation directe entre le coin socio-fiscal et le coût
total du travail, compte tenu, d'une part, de la possibilité de
réaliser des gains de productivité pour compenser toute
augmentation des prélèvements obligatoires, et d'autre part, de
l'élasticité variable du salaire net.
En effet, si l'on raisonne en terme de coût unitaire du travail et non en
terme de coût horaire, il est vraisemblable qu'une entreprise fera face
à une augmentation des charges pesant sur sa masse salariale en essayant
de compenser la hausse du coût horaire du travail par des gains de
productivité, auquel cas, sa compétitivité ne serait pas
atteinte.
Par ailleurs, si l'obligation de payer instituée par le système
des prélèvements obligatoires correspond exactement à la
fonction d'utilité collective de la population, le salaire net s'adapte
à la baisse de telle façon que le coût du travail reste
inchangé pour l'employeur.
A cet égard, il semblerait que les salaires nominaux français
soient plus flexibles qu'en Allemagne, où l'élasticité du
coût du travail aux cotisations patronales est unitaire, mais plus
rigides qu'au Royaume Uni. Aux Etats-Unis, où le marché du
travail est très flexible, l'augmentation des cotisations patronales
n'affecte pas du tout le niveau des salaires réels.
Le tableau ci-après retrace l'élasticité des coûts
de la main d'uvre à une modification des taux d'imposition. Lorsque
l'élasticité est unitaire, cela signifie que l'augmentation des
cotisations sociales se transmet tout entière en terme de coût
pour l'employeur, sans que le niveau des salaires s'adapte à la baisse.
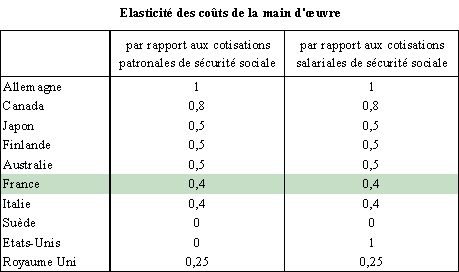
b) Le coût élevé du travail en France
Néanmoins, il apparaît selon une enquête
Eurostat sur les coûts du travail dans l'industrie, dont les
résultats sont retracés dans le tableau ci-après, que
le coût du travail est nettement plus élevé en France
qu'aux Etats-Unis et que dans la plupart des pays européens
. La
France se situerait au niveau des Pays-Bas et du Japon, très au dessus
du Royaume-Uni. Seule l'Allemagne présente un coût du travail
supérieur à celui de la France.
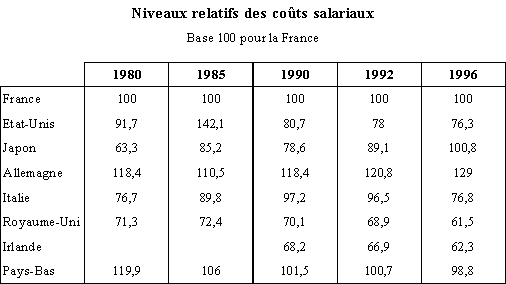
Les comparaisons internationales mettent par ailleurs en évidence une
diminution depuis 1980 de la pression fiscale et sociale de nos principaux
concurrents et des coûts relatifs par rapport à la France.
Ainsi, entre 1980 et 1992, les Etats-Unis, les Pays-Bas et le Royaume-Uni
ont vu diminuer leur coût du travail relativement à celui de la
France
. Seuls le Japon et l'Allemagne ont vu leur position relative se
dégrader par rapport à la France. L'Italie occupe une position
médiane puisque le niveau relatif des coûts salariaux s'est accru
jusqu'en 1990 pour diminuer ensuite.
Or, dans un article de la revue Droit social de mars 1997, la direction
économique et financière de la Caisse des dépôts et
consignations a, sous la plume de Patrick Artus, dégagé un lien
entre la structure de la fiscalité et la performance économique.
Il apparaît que les pays qui, comme la France, se caractérisent
par le niveau élevé de leurs charges sociales et le niveau
modéré ou faible de leurs impôts directs, donnent
systématiquement de mauvais résultats en matière d'emploi.
c) Le poids élevé des charges patronales
Par ailleurs, il ressort de l'étude
réalisée par l'institut Rexecode, que les charges patronales sont
particulièrement élevées et non dégressives en
France.
Pour des salaires supérieurs au seuil d'exonération de charges
sur les bas salaires, le taux de charges patronales est de l'ordre de
50 %. L'effet dégressif des cotisations patronales
consécutif aux plafonds de la sécurité sociale ne devient
pertinent que pour des salaires très élevés, proches de
100.000 francs par mois. Le tableau ci-après met en évidence
le poids des charges patronales dans le salaire brut :
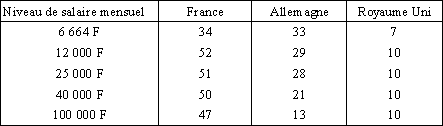
Enfin, si l'on prend en compte, outre les charges sociales patronales, tous les
éléments de la fiscalité assis sur les entreprises,
la
France apparaît dans une position particulièrement
défavorable
: les prélèvements obligatoires
pesant sur les entreprises s'établissent en effet à 19,5 %
du PIB en 1996, contre 14 % en Allemagne, 10,9 % au Royaume-Uni et
9,6 % aux Pays-Bas.
Le tableau ci-après présente une comparaison internationale de la
pression fiscale :
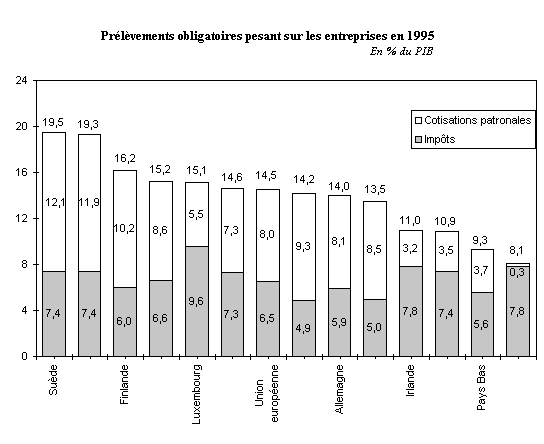
2. Une politique fiscale contraire à celle de nos concurrents
S'il est exact que le poids des impôts directs
pèse comparativement moins sur les entreprises françaises que sur
leurs concurrentes, les récentes mesures urgentes à
caractère fiscal et financier (MUFF)
adoptées par
l'Assemblée nationale en dernière lecture le 21 octobre dernier
vont dans le sens d'un accroissement des charges fiscales directes des
entreprises.
En effet, en portant le taux de l'impôt sur les sociétés
à 41,66 %, la contribution temporaire de 15 % sur le taux de
l'impôt sur les sociétés place la France au
troisième rang des pays européens juste derrière l'Italie
et l'Allemagne. Mais, il importe d'observer que le taux italien de
l'impôt sur les sociétés (53,2 %) incorpore, outre le
taux de l'imposition d'Etat de 37 %, un taux d'imposition locale de
16,2 %. Quant à l'Allemagne, elle distingue entre
bénéfice distribué, taxé au taux de 30 %, et
bénéfice non distribué imposé au taux de 45 %.
A ces deux taux, s'ajoute une surtaxe de solidarité de 7,5 %
portant le taux marginal à 48,37 %.
L'augmentation de l'impôt sur les sociétés diverge non
seulement de la tendance suivie jusqu'à présent par la France,
mais également de la tendance européenne à la diminution
des charges pesant sur les entreprises.
En effet, il convient de rappeler que le taux de l'impôt sur les
sociétés avait progressivement été porté de
42 % à 33,1/3 % entre 1989 et 1993.
Cette réforme s'était organisée autour de trois axes :
- une baisse régulière du taux de l'impôt qui a ainsi
été ramené par étapes de 50 % en 1985 à
33,1/3 % en 1993 ;
- un élargissement de l'assiette, par l'intégration dans la base
taxable au taux normal de différents produits de placements financiers
bénéficiant auparavant du régime des plus-values ;
- la mise en place de régimes spécifiques (fiscalité de
groupe notamment) qui ont contribué à moderniser de façon
importante notre législation et à la rendre plus attractive,
notamment au regard de nombreux dispositifs étrangers.
Il est pour le moins paradoxal que la France renonce à la position
compétitive à laquelle elle était parvenue sur
l'impôt sur les sociétés au moment où nos principaux
partenaires économiques suivent l'exemple initialement donné par
la France en réduisant substantiellement la fiscalité pesant sur
leurs entreprises
. Ainsi, l'Italie vient-elle d'annoncer l'institution d'un
taux de taxation réduit pour les bénéfices
réinvestis. L'Allemagne prévoit d'harmoniser la fiscalité
des bénéfices distribués et non distribués pour les
ramener de 30 et 28 % en 1998 puis au taux unique de 25 % en 1999.
Enfin, la Grande-Bretagne a ramené son taux d'imposition marginal de 33
à 31 % et prévoit de substituer un taux unique au
régime progressif actuel.
De surcroît, la taxation au taux de droit commun des plus-values
à long terme
14(
*
)
va à
contre-courant des législations fiscales de la plupart de nos
partenaires économiques.
En effet, les plus-values sur cessions d'actifs immobilisés
réalisées par les entreprises bénéficient, dans la
généralité des pays, d'un régime d'imposition
particulier, ces profits étant, compte tenu de leur nature propre, soit
soumis à un taux d'imposition réduit lorsque l'actif
cédé est détenu depuis un certain temps par l'entreprise
au moment de sa cession, soit exonérés sous condition de remploi.
Les Etats-Unis, le Japon et la Belgique ont, de façon presque constante
appliqué la première de ces solutions, alors que l'Allemagne,
l'Espagne, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne retiennent au contraire la
seconde.
En outre, certains régimes étrangers de
sociétés-holdings existant aux Pays-Bas et, dans une moindre
mesure, au Luxembourg, en Belgique et dans certains cas en Allemagne,
exonèrent totalement les plus-values sur les cessions de participations.
La suppression du régime de taxation réduite des plus-values
en France place ainsi nos entreprises en situation anti-concurrentielle.
Il importe d'ailleurs de noter que
sur le critère fiscal
jugé comme important par nombre de répondants interrogés
par BIPE Conseil et Price Waterhouse,
la position de la France est
jugée globalement mauvaise, voire très mauvaise
. Il convient
de noter une différence entre les industriels français et
étrangers sur ce point : 67 % des industriels étrangers
interrogés jugent ce critère important contre 42 % des
Français, et parmi ceux pour lesquels ce critère est important,
seuls 15 % des étrangers jugent la fiscalité
française attractive, contre 22 % des Français.
3. Une fiscalité contestée
a) La taxe professionnelle est un impôt anti-économique
La taxe professionnelle est unanimement condamnée
par le monde économique qui la considère trop
élevée et calculée sur une assiette
anti-économique.
C'est un impôt qui, en raison d'une assiette
déconnectée de la santé économique de l'entreprise,
est considéré comme pénalisant par les entreprises qui
investissent et créent des emplois.
En effet, les bases de la taxe évoluent de façon
indépendante de la capacité contributive des entreprises et de la
conjoncture économique
, et ce, essentiellement sous l'effet de la
part équipements et biens mobiliers. En outre, la
référence à la valeur historique des immobilisations sans
prise en compte de la dépréciation due au vieillissement des
matériels, apparaît peu justifiable économiquement et
explique largement l'augmentation du prélèvement. On constate
ainsi, paradoxalement, que la charge relative de la taxe augmente lorsque les
entreprises vont mal.
D'autre part, la taxe professionnelle apprécie la faculté
contributive des entreprises au travers d'indices - la masse salariale, les
immeubles et les biens d'équipement - pour lesquels il existe des
différences de productivité entre secteurs d'activité et
entre entreprises. Ainsi, la répartition des cotisations de taxe
professionnelle entre les secteurs économiques n'est pas en rapport avec
la valeur ajoutée qu'ils dégagent. A titre d'exemple, les
transports, la production d'énergie et les industries de biens
intermédiaires et de biens d'équipement sont surimposés,
tandis que les services financiers bénéficient comparativement
d'une situation favorable.
Par ailleurs,
le prélèvement a fortement augmenté
avec un taux de croissance annuel moyen de 6,8 %. Cet accroissement
très sensible est, pour les deux tiers, le résultat de la
progression rapide des bases qui ont augmenté, en volume, à un
rythme quatre fois plus rapide que le produit intérieur brut
15(
*
)
. Ce phénomène a provoqué
à la fois un accroissement de la charge fiscale pour les entreprises et
du coût supporté par l'Etat
16(
*
)
.
La taxe professionnelle constitue ainsi désormais la
principale
charge fiscale pour les entreprises
puisque son montant brut
(169 milliards de francs en 1996) dépasse celui de l'impôt
sur les sociétés (mais la taxe professionnelle est
déductible de l'assiette de l'IS), dont le produit net s'est
établi à 144 milliards de francs en 1996.
Il apparaît en outre qu'un impôt, dont un tiers du produit
théorique est acquitté par l'Etat en raison du plafonnement en
fonction de la valeur ajoutée et des divers
dégrèvements
17(
*
)
, n'est
plus un bon impôt
.
Les critiques portent également sur le
caractère
inégalitaire
de la taxe. L'essentiel de la charge fiscale
pèse en effet sur un faible nombre d'entreprises,
généralement de grande taille et relevant du secteur industriel.
La taxe n'est acquittée que par 2,1 millions de redevables tandis que
1,5 million d'entreprises en sont exonérées.
Enfin,
la taxe professionnelle se caractérise par la
variabilité géographique de ses taux et par leur grande
instabilité dans le temps
. En effet, la disparité des
bases
18(
*
)
explique les écarts de taux
entre communes
19(
*
)
, bien que la relation entre
le potentiel fiscal et le niveau de la pression fiscale ne soit pas
automatique. Cette disparité des taux peut être à l'origine
de
délocalisations
, au moins au sein d'une même
agglomération ou entre deux agglomérations voisines.
Outre ces distorsions locales de concurrence, le poids de la taxe
professionnelle,
pris en compte dans les simulations de rentabilité,
joue en défaveur de la localisation en France d'un
investissement
. En effet, la taxe professionnelle étant fixe quel
que soit le profit de l'investissement, elle est incluse dans les coûts
de fonctionnement au cours du processus de décision des investissements.
Les coûts de fonctionnement (
operating costs
) permettent de
calculer un résultat opérationnel avant les diverses taxes sur le
profit, etc. Mais étant atypique, il n'existe pas de rubrique
spécifique dans laquelle l'isoler. Elle est donc
intégrée :
- soit au niveau de la masse salariale, et la main d'uvre française
apparaît alors comme trop chère (la taxe peut représenter
un surcoût de 70 % pour un emploi non qualifié) ;
- soit au niveau du coût des immobilisations, le surcoût pouvant
alors être masqué si ces immobilisations sont bon marché en
France, ou, au contraire, les rendre non compétitives.
Ainsi, le poids de la taxe professionnelle peut conduire à
éliminer certains projets sans que les dirigeants aient approfondi
l'analyse jusqu'à considérer les facteurs qui pourraient
être favorables à leur localisation en France.
L'enquête France Industrie 2000 cite le cas
de la compagnie
californienne de semi-conducteurs International Rectifier
, qui
a
récemment invoqué le montant de la taxe professionnelle pour
expliquer l'abandon d'un projet d'investissement de 2,6 milliards de
francs près de Bayonne, projet finalement réalisé en
Irlande, malgré 500 millions de francs de subventions
mobilisés par l'Etat et les collectivités locales et une promesse
d'assistance de l'Union européenne.
Au total, la taxe professionnelle ne répond pas aux
caractéristiques d'un bon impôt à savoir une assiette
large, modérée dans son taux, proportionnée aux
capacités contributives des contribuables et aisément recouvrable
par l'administration (Définition du Conseil des impôts). Les
entreprises appliquant en particulier les normes comptables internationales,
préfèrent un impôt local sur le bénéfice
à un impôt sur l'appareil de production.
La difficulté de réformer la fiscalité
des entreprises :
l'exemple de la taxe professionnelle
En dépit du constat unanime sur les
inconvénients posés par la taxe professionnelle, la
nécessaire réforme de cet impôt est l'exemple type du
" serpent de mer ". Les rapports et les groupes d'études sur
la réforme de la taxe professionnelle se succèdent sans aboutir.
Grâce aux multiples aménagements accordés par la
législation, il a été possible de passer d'une situation
de contestation violente à l'équilibre précaire que l'on
connaît aujourd'hui. Néanmoins, les inconvénients majeurs
demeurent.
Le rapport du groupe de travail sur la réforme des
prélèvements obligatoires présidé par Dominique de
la Martinière et le récent rapport du Conseil des impôts
recensent chacun les diverses pistes de réformes, envisagées pour
certaines et mises en uvre pour d'autres, pour conclure de façon
divergente.
Les conclusions du rapport La Martinière
Soulignant les problèmes techniques
20(
*
)
et l'importance des transferts de charge qu'induirait la substitution de
l'assiette actuelle par la valeur ajoutée, le rapport La
Martinière juge indispensable de poursuivre les actions engagés
par la loi de finances pour 1996 qui consistaient en l'instauration d'une
cotisation minimale, d'une part, et dans le gel des taux pris en compte pour la
détermination du plafonnement pris en charge par l'Etat, d'autre part.
Il propose en outre de limiter la prise en compte des nouveaux investissements
dans l'assiette de la taxe professionnelle, en autorisant leur amortissement
partiel. Il suggère enfin d'instituer une part nationale de taxe
professionnelle, sans préciser son assiette, ni son taux.
Le rapport du Conseil des impôts
Quant au Conseil des impôts, il exclut d'emblée toutes les
solutions qu'il qualifie de " radicales " consistant, soit à
supprimer la taxe professionnelle, soit à modifier son assiette, soit
enfin à spécialiser les impôts locaux par niveau de
collectivité.
Il préconise quelques aménagements ponctuels afin de pallier les
inconvénients les plus significatifs de la taxe professionnelle. Outre
la mise en application des nouvelles valeurs locatives cadastrales, il
suggère ainsi de limiter l'impact inflationniste des nouveaux
investissements sur les bases en déduisant l'amortissement ou en
plafonnant leur prise en compte dans le calcul de l'assiette. S'agissant des
taux, le Conseil encourage le recours aux formules d'intercommunalité
à taxe professionnelle unique et le renforcement de la règle du
plafonnement de l'augmentation des taux. Enfin, constatant que la modulation du
seuil de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur
ajoutée est un facteur de complication, le Conseil suggère de
porter ce seuil à 4 % pour toutes les entreprises, quel que soit le
montant de leur chiffre d'affaires.
Néanmoins,
toute réforme d'ampleur de l'assiette et des taux
de la taxe professionnelle se heurte au principe de la localisation des bases
et à celui du vote des taux par les collectivités
territoriales
. Le Conseil des impôts estime que la
détermination de l'impôt local par plus de 50.000 décideurs
publics est un obstacle au nécessaire resserrement des
inégalités de taux et condamne à l'inefficacité
toute réforme d'assiette. "
Le défaut principal de la
taxe professionnelle tient à l'absence d'adéquation entre son
niveau de perception, essentiellement communal, et la géographie
économique
", écrit-il.
En effet, les collectivités territoriales seraient sans doute
amenées à compenser le ralentissement de l'augmentation des bases
par une hausse sensible des taux
21(
*
)
.
Les propositions de réforme du Conseil des impôts
Le Conseil des impôts conclut en conséquence que la réforme
du mode de perception de la taxe professionnelle est un préalable
à toute réforme d'assiette. Il préconise ainsi la
perception de la taxe professionnelle dans un cadre non plus territorial mais
national, d'une part, et l'affectation de son produit aux collectivités
locales, d'autre part. Il suggère en outre de moderniser l'assiette du
prélèvement par la prise en compte des valeurs nettes comptables.
Il propose enfin de diminuer le poids de la taxe professionnelle pour les
entreprises et, par voie de conséquence, pour l'Etat.
Observant que les deux tiers des ressources des collectivités
territoriales allemandes (parmi lesquelles les Länder) proviennent de
transferts étatiques à travers le partage d'impôts
nationaux ou des dotations budgétaire, le Conseil des impôts
réfute l'argument selon lequel l'autonomie des collectivités
locales résiderait dans leur capacité à lever
l'impôt.
Il conclut que
la mutualisation de la taxe professionnelle
sur le
modèle de la Gewerbesteuer allemande
permettrait de résoudre
l'intégralité des problèmes posés par cet
impôt
, à savoir la multiplicité des taux, la
complexité des divers dispositifs d'écrêtement ou
d'abattement, le coût de la taxe professionnelle pour le budget de
l'Etat, le dynamisme de l'assiette et la faible efficacité des
mécanismes de péréquation. Une telle réforme,
pourvu qu'elle soit mise en uvre sur une période suffisamment longue
pour éviter des transferts de charge trop abrupts, serait, selon le
Conseil des impôts, conforme à l'intérêt
général et à l'efficacité économique.
b) La fiscalité des transmissions d'entreprises est déstabilisante
La fiscalité des transmissions d'entreprises est
déstabilisante, en raison de son poids
(elle est 4 fois plus
élevée en France qu'en Allemagne ou en Italie)
et
particulièrement de la progressivité du barème des droits
de mutation.
Si l'Allemagne applique le taux maximum de 35 % à
partir d'une fraction de part nette taxable de 100 millions de deutschemark, le
seuil correspondant est de 5 millions de francs en France. La forte
progressivité du barème des droits de mutation, à laquelle
il faut ajouter la fiscalisation des dividendes, pénalise
particulièrement les PME patrimoniales.
En définitive, les droits de mutation pour une succession sont trois
fois plus élevés en France qu'en Allemagne et deux fois plus
qu'au Royaume-Uni. Si les conséquences sont difficilement
évaluables, il faut noter que le poids des droits de mutation
entraîne fréquemment une perte de contrôle des actionnaires
familiaux, avec le risque de délocalisation à l'étranger
de certains centres de décision. Ceci explique la relative faiblesse du
nombre d'entreprises moyennes indépendantes en France par rapport
à l'Allemagne.
c) La fiscalité rend les stocks options inutilisables
La France est par ailleurs très mal évaluée par les industriels sur la fiscalité des stock options , à la suite de l'évolution de leur encadrement fiscal. Dans le cas où un salarié vend une action obtenue par le biais d'un plan de stock options moins de cinq ans après la date d'octroi de l'option, la plus-value générée est réintégrée dans les revenus salariaux. Les entreprises concernées doivent alors s'acquitter des charges patronales, le salarié des charges sociales et de l'impôt sur le revenu. La France est ainsi passée d'un régime peut-être trop favorable, qui autorisait certains abus, à une situation dans laquelle les stock options sont presque inutilisables, surtout dans les métiers à rotation rapide des cadres.
d) La fiscalité de " l'innovation " incite à la délocalisation
Enfin, la fiscalité des marques et brevets est
devenue préoccupante.
Un arrêt récent du Conseil d'Etat
considère en effet ces éléments du patrimoine de
l'entreprise comme des actifs incorporels et n'admet pas, en
conséquence, la déductibilité des frais afférents
aux demandes d'enregistrement. En outre, les plus-values de cession de brevets
sont désormais imposées au taux normal de l'impôt sur les
sociétés.
Ces mesures pourraient inciter les entreprises à accroître leur
délocalisation de gestion des marques.
4. Une fiscalité complexe
La
législation fiscale française
concernant les entreprises est par ailleurs perçue par les
opérateurs économiques français et étrangers comme
extrêmement complexe
. Cette perception tient notamment à la
multitude de taxes la caractérisant (impôt foncier, impôt
sur l'actif net, sur la mutation, sur les transactions, taxe professionnelle,
contributions au Fonds National pour l'Emploi). La France affiche 6 taxes
spécifiques contre 4 en Allemagne et en Italie et 3 au Royaume-Uni.
En 1995, l'impôt sur les sociétés était plus faible
en France mais les impôts spécifiques nettement plus
élevés (3,2 % du PIB contre 1,7 % en Allemagne et
2,3 % au Royaume-Uni). Contrairement à la situation de la
Grande-Bretagne, de l'Italie et des Pays-Bas, les impôts
spécifiques pesaient plus lourdement que l'impôt sur les
sociétés sur les entreprises françaises.
En outre, la législation fiscale française s'est fortement
compliquée depuis quelques années avec la création des
différentes catégories de zones franches dans le cadre du Pacte
de relance pour la ville, la modulation de certaines règles fiscales
suivant les zones d'aménagement du territoire, la multiplication des
dérogations sectorielles. Cette "déstructuration" de la
fiscalité vient en outre s'ajouter à un nombre déjà
très élevé de seuils, d'assiettes ou d'exemptions, aussi
bien en matière de prélèvement fiscaux que sociaux, qui
sont dépourvus le plus souvent de logique économique.
La complexité du système fiscal
français :
l'exemple de la taxation privilégiée des petites et moyennes
entreprises
L'exemple du traitement fiscal privilégié des
petites et moyennes entreprises est particulièrement significatif du
manque d'homogénéité et de lisibilité de la
fiscalité française.
La variabilité des critères de définition des
PME
Ainsi, si de nombreuses dispositions du code général des
impôts tendent à abaisser le poids de la fiscalité pour les
petites et moyennes entreprises afin d'encourager leur création et la
constitution de fonds propres, les critères de définition de ces
entreprises sont variables d'une disposition à l'autre, ce qui est
préjudiciable aux entreprises qui en sont précisément la
cible. En effet, les petites et moyennes entreprises, contrairement aux plus
grosses structures, ne disposent pas des services juridiques et fiscaux leur
permettant d'expertiser la réglementation fiscale pour en tirer le plus
grand bénéfice.
Un recensement de la totalité des mesures destinées aux PME
serait fastidieux mais on peut noter d'emblée que l'expression PME
apparaît assez peu dans les textes fiscaux. D'une manière
générale, on préfère parler de " petites
entreprises ".
Or,
l'appréciation de la "petite entreprise" peut varier en
fonction
de la nature de l'impôt en cause
: par exemple, pour les
impôts calculés sur les salaires, une entreprise employant un
faible nombre de salariés sera une petite entreprise, alors qu'elle peut
réaliser un chiffre d'affaires important, ce qui ne permet pas de la
classer parmi les " petites entreprises " pour
l'application de la
TVA ou de l'impôt sur les bénéfices.
Le
critère tiré du montant du chiffre d'affaires
est le
plus ancien et il demeure le plus fréquemment utilisé. C'est ce
critère qui conditionne l'application des divers régimes
d'imposition (forfait
22(
*
)
, régime
réel simplifié
23(
*
)
, régime
des micro-entreprises). Mais ce critère pouvant conduire à des
abus (par exemple, la scission artificielle de l'entreprise en plusieurs
filiales afin de bénéficier des régimes de faveur), il a
été progressivement complété par des conditions
d'application plus contraignantes. En outre, des préoccupations de
nature plus "interventionniste" ont conduit à prendre en
considération des conditions tenant aux modalités d'exploitation.
Ainsi, les plus-values réalisées par une entreprise sont
exonérées lorsque les recettes n'excèdent pas le double
des limites du forfait ou de l'évaluation administrative, et à
condition que l'entreprise ait exercé son activité pendant une
durée minimale de 5 ans.
On retrouve des préoccupations de même nature pour l'application
de la réduction d'impôt au titre des souscriptions en
numéraire au capital de sociétés non cotées. La
société doit être soumise à l'impôt sur les
sociétés, ne pas réaliser plus de 140 millions de francs
de chiffre d'affaires hors-taxe ou bien ne pas totaliser plus de
70 millions de francs d'actifs à son bilan. Enfin, le capital doit
être détenu pour plus de 50 % par des personnes physiques.
Ces mêmes critères complétés par une
condition
relative au nombre de salariés
fondent l'éligibilité
à la disposition autorisant un amortissement égal à
25 % du prix de revient pour les matériels utilisés dans les
zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine.
Outre la satisfaction des conditions ci-dessus, les entreprises doivent en
effet employer moins de 250 salariés.
Le critère du nombre de salariés peut également être
retenu à titre principal, essentiellement pour l'application des taxes
assises sur les salaires, la distinction essentielle, en la matière,
étant constituée par les entreprises employant plus ou moins de
10 salariés. Il peut enfin intervenir à titre principal en
étant complété par un
critère fondé sur
la nature de l'activité
.
C'est ainsi que les entreprises de moins de 50 salariés
installées dans les zones franches urbaines sont exonérées
de taxe professionnelle à hauteur de 3 millions de francs de bases
taxables lorsqu'elles exercent des activités de proximité. Le
plafond de 50 salariés tranche avec celui de 150 qui déclenche
l'exonération dans les autres zones prioritaires d'aménagement du
territoire, quelle que soit l'activité exercée par l'entreprise
bénéficiaire.
En outre, ni le seuil de 50 salariés, ni les conditions relatives
à la nature de l'activité ne déterminent
l'éligibilité au dispositif d'exonération de l'impôt
sur les bénéfices dans ces mêmes zones, ce qui aboutit
à un
véritable casse-tête pour les entreprises
. En
effet, pour ce dernier dispositif, toutes les entreprises sont éligibles
mais pour un montant de bénéfices limité à
400.000 francs, ce qui constitue un critère supplémentaire
de définition de la PME.
Au total, on constate que la définition de la PME varie, non
seulement selon la nature de l'impôt concerné, mais
également en fonction de l'administration qui est à l'origine de
la mesure, et des objectifs poursuivis
, en dépit de l'harmonisation
qui est opérée par le ministre des finances. Ainsi, le
ministère de l'aménagement du territoire et celui de la ville et
de l'intégration, qui sont à l'origine des mesures de
"
discrimination fiscale positive
" en faveur des
zones
prioritaires, ont-ils " enrichi " le code général des
impôts de conditions tenant à la localisation des activités
et à la nature des activités à encourager.
Un début d'harmonisation
Les définitions des " petites entreprises " se sont
succédé au gré des différents " plans
PME ". On peut cependant déceler un progrès dans la
période récente, la définition de la PME se rapprochant de
la
définition européenne de la petite entreprise
figurant
dans une recommandation de la Commission européenne datée du 3
avril 1996. Il s'agit des entreprises :
- dont le chiffre d'affaires n'excède pas 7 millions d'écus (50
millions de francs) ;
- et qui respectent le critère d'indépendance mesuré
à l'aune de la propriété du capital : sont ainsi
considérées comme indépendantes les entreprises
détenues à plus de 75 % par des personnes physiques.
Ainsi, le taux réduit (19 %) de taxation des
bénéfices des sociétés institué par
l'article 10 de la loi de finances pour 1997, en faveur des entreprises qui
capitalisent leurs bénéfices ainsi taxés, est-il
réservé aux entreprises satisfaisant à ces deux
conditions. De même, le Gouvernement a exonéré de la
contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés
instituée par la loi portant mesures urgentes à caractère
fiscal et financier, les entreprises répondant aux mêmes
critères.
On peut regretter néanmoins que ces deux dispositions soient
calquées sur la
référence la plus étroite de la
Commission européenne
et non sur la définition large de la
PME qui fixe à 40 millions d'écus (soit 260 millions de francs)
le plafond de chiffre d'affaires à ne pas excéder.
Une exception récente
Cependant, une disposition du présent projet de loi de finances diverge
assez radicalement des définitions évoquées ci-dessus en
faisant référence, pour définir les petites et moyennes
entreprises, au montant des provisions qu'elles ont constitué. En effet,
l'Assemblée nationale vient de décider de ne pas obliger les
entreprises qui ont constitué des provisions pour fluctuation des cours
à réintégrer ces provisions dans leur résultat
imposable en deçà d'un seuil de 60 millions de francs. Cet
amendement tend à amoindrir les conséquences relativement
pénalisantes pour les petites et moyennes entreprises transformatrices
de matières premières de la suppression de la provision pour
fluctuation des cours prévue par l'article 6 du projet de loi de
finances pour 1998. Cet article prévoit en effet de
réintégrer les dotations pratiquées à ce titre dans
les résultats imposables sur une durée de trois ans, ce qui a
pour conséquence d'accroître dans des proportions très
importantes l'impôt sur les sociétés à acquitter par
certaines entreprises.
Une pratique contraire à la neutralité fiscale
D'une façon générale, outre la complexité
engendrée par la variation des critères pris en compte,
votre
rapporteur général considère que l'institution de mesures
catégorielles et de seuils d'exonération,
quel que soit le
critère économique déterminant
, rompt
l'égalité des contribuables devant l'impôt et est contraire
au principe de la neutralité fiscale
. Au demeurant, la notion de
chiffre d'affaires, qui est la plus courante, n'a pas la même
signification en fonction des secteurs d'activité
considérés.
Enfin,
de telles pratiques encouragent les entreprises à optimiser
leurs décisions en fonction de considérations fiscales
plutôt qu'économiques
, ce qui n'est pas conforme à une
allocation optimale des ressources et favorise les comportements de fuite
devant l'impôt.
Or, l'exercice visant à "verrouiller" les divers dispositifs fiscaux
pour éviter l'optimisation fiscale des entreprises tend à
mobiliser un pourcentage croissant des experts fiscaux du service de
législation fiscale de Bercy. Les différents verrous ainsi
institués pour " moraliser " les entreprises alourdissent
à l'excès le code général des impôts, rendent
sa compréhension ardue pour les entreprises et obligent ces
dernières à consacrer une part croissante de leur temps et de
leurs ressources à "décrypter" la législation fiscale.
5. Une fiscalité instable
Outre la complexité de son système de
prélèvements obligatoires, la France se caractérise par la
très forte instabilité de sa législation fiscale
.
Ainsi, l'étude France Industrie 2000 souligne que
"
la France est
perçue comme un pays où la lisibilité de l'environnement
est faible
: instabilité de l'environnement, mesures ayant des
effets rétroactifs ou perçus comme tels par la communauté
économique et financière internationale, administrations
enfermées dans des modèles de pensée et appliquant des
référentiels non ouverts sur le monde extérieur, ayant par
conséquent du mal à communiquer et n'ayant pas assimilé
les paradigmes de l'entreprise moderne.
"
Selon l'institut Rexecode, la fiscalité française est
perçue comme trop incertaine pour deux raisons :
- la multiplicité des taxes donne une idée imprécise du
poids exact de la fiscalité ;
- le manque de stabilité fiscale est le facteur le plus important. Les
entrepreneurs déplorent en particulier les hausses à
répétition avec effet rétroactif de l'impôt sur les
sociétés. Ce n'est pas tant la hausse qui est critiquée
que le fait que les règles du jeu peuvent changer à tout instant.
A cet égard, on peut craindre que la dernière augmentation du
taux de l'impôt sur les sociétés, qui porte ce dernier
à 41,6 %, et le doublement de la taxation des plus-values à
long terme dégradent l'attractivité de notre pays.
Or, la crédibilité, la prévisibilité et la
stabilité de la politique fiscale dans la longue durée, sont des
déterminants majeurs pour évaluer la rentabilité
économique des investissements
. "
Investir
, écrit
Rexecode,
c'est prendre un pari sur l'avenir. L'entreprise évitera de
s'engager si l'avenir paraît trop incertain. Tout élément
qui contribue à accroître l'incertitude décourage
l'investisseur. Lorsqu'il s'agit d'établir le plan financier d'un
projet, il est classique d'ajouter au coût du capital un facteur
représentatif du risque (
prime de risque
). L'investissement n'est
retenu que si la rentabilité attendue est supérieure à la
somme des coûts précédents
. "
Un investissement industriel est en effet souvent peu mobile et se juge sur une
durée comprise entre 10 et 20 ans. Par conséquent, un pays qui
donne une image d'instabilité réduit sensiblement son
attractivité industrielle. 92 % des industriels interrogés
par BIPE Conseil et Price Waterhouse, considèrent ce critère
comme important ou très important.
A cet égard, pour les sites de fabrication, la position de la France est
jugée mitigée pour les entreprises installées en France
(52 % de satisfaits contre 40 % de mécontents) et bonne en ce qui
concerne les investisseurs étrangers (68 % de satisfaits contre 20
% de mécontents).
En conséquence, réserver les incitations fiscales à des
politiques structurelles (par exemple le développement des secteurs de
pointe) semble être la solution la plus pertinente. Ces incitations
doivent être simples et leurs conséquences clairement
perçues.
La forte instabilité de la législation fiscale française : l'exemple de la taxation des plus-values à long terme
L'évolution de la fiscalité des plus-values
illustre l'instabilité chronique de la législation fiscale
française.
En effet, au cours de la période récente, le taux, mais aussi
l'assiette de l'impôt sur les plus-values à long terme, ont
été modifiés treize fois.
S'agissant du taux, initialement fixé à 10 %, il a
été relevé à 15 % en 1973 puis, en 1974, un
taux de 25 % a été créé pour les terrains
à bâtir. Ces taux sont restés identiques jusqu'en 1989. La
loi de finances rectificative pour 1989 a relevé le taux de taxation de
15 à 19 %, mais en excluant les produits de la
propriété industrielle (brevets) qui demeurent taxés
à 15 %. La loi de finances pour 1990 a relevé le taux
d'imposition des plus-values à caractère financier (qui concerne
tous les titres sauf les actions) pour les soumettre au taux de l'impôt
sur les sociétés à 25 %. Enfin, la loi de finances
rectificative pour 1991 a ramené le taux de taxation des plus-values
à 18 %.
S'agissant du champ d'application, la loi de finances pour 1991 a exclu du
régime les opérations à caractère financier (sauf
les ventes d'actions) pour les soumettre à l'impôt sur les
sociétés au taux normal. Puis, l'article 11 de la loi de finances
pour 1992 a extrait du régime des plus-values les gains nets
retirés de la cession de " titres de trésorerie ".
Enfin, l'article 25 de la loi de finances pour 1995 a exclu de ce régime
de faveur tous les éléments du portefeuille de valeurs
mobilières des sociétés autres que ceux revêtant le
caractère de titres de participation sur le plan comptable.
A l'issue de ces réformes, le régime des plus-values à
long terme semblait enfin avoir trouvé son équilibre : en
effet, en restreignant le champ d'application du régime des plus-values
à long terme aux seules plus-values de cessions d'éléments
d'actifs et de titres de participation, à l'exclusion de toutes les
plus-values réalisées sur des cessions de titres de
trésorerie et de placement, les lois de finances pour 1991, pour 1992 et
pour 1995 ont mis fin à l'avantage fiscal dont
bénéficiaient les placements financiers.
Toutefois, le Gouvernement a récemment
24(
*
)
réduit une fois encore le champ d'application
du régime des plus-values à long terme en le réservant aux
seules plus-values issues de la cession de titres de participation et au
résultat net de la concession d'éléments de la
propriété industrielle (brevets, inventions brevetables). Le taux
de taxation pour les autres plus-values à long terme est en
conséquence porté de 20,9 à 41,6 %.
Or, ce texte prend effet au 1
er
janvier 1997. Cela signifie que des
plus-values réalisées depuis cette date seront taxées au
taux de 41,6 % alors même que la décision de vendre l'actif
à l'origine de ces plus-values aura été prise par le chef
d'entreprise en considération du taux qui prévalait le jour de sa
décision, c'est-à-dire 20,9 %.
Votre commission des finances a exprimé son opposition ferme à
de telles pratiques. Il lui semble en effet que les personnes physiques et
morales qui ont établi des relations dans un contexte juridique
particulier ne doivent pas pouvoir le voir totalement remis en cause, de
façon rétroactive, soudaine et sans nécessité
impérieuse.
En définitive, certaines mesures fiscales ont un impact largement plus
négatif pour l'investisseur que ce qu'elles rapportent à l'Etat.
Les faiblesses de la politique fiscale française, auxquelles il faut
remédier, tiennent autant au poids de certains impôts qu'à
la multiplicité des taxes et à l'incertitude liée à
l'évolution constante et imprévisible de la pression fiscale.
C. L'ALLÉGEMENT DU POIDS DE LA FISCALITÉ FRANÇAISE DOIT ACCOMPAGNER LA NÉCESSAIRE HARMONISATION DES FISCALITÉS EUROPÉENNES
1. L'Union Economique et Monétaire encourage la concurrence fiscale
Il n'est pas à exclure qu'avec l'Union
économique et monétaire, l'accroissement de la concurrence
fiscale fasse courir un risque de délocalisation non seulement des
entreprises françaises mais aussi de la main d'uvre très
qualifiée.
En effet, si la concurrence fiscale est d'une relative innocuité en
régime de changes flexibles, elle peut avoir des conséquences
dans une union monétaire. Dans le premier cas, les entrées de
capitaux induites par la mise en place dans un pays d'une fiscalité
très favorable vont conduire à une appréciation de la
monnaie de ce pays qui dégradera sa compétitivité et
annulera l'effet des allégements fiscaux. En revanche, dans le second
cas, si un pays réduit par exemple les charges sociales, aucun mouvement
du change n'apparaît par construction, et l'avantage compétitif
est conservé. Il apparaît donc une forte incitation à
substituer la concurrence fiscale et sociale à la concurrence par les
changes.
On constate ainsi que la concurrence fiscale entre les Etats membres de l'Union
Européenne a jusqu'à présent constitué un jeu
à somme négative, qui explique en partie l'érosion des
recettes fiscales des Etats membres. L'évolution à la baisse des
taux de la fiscalité s'est en effet traduite en Europe par des
phénomènes de délocalisations et de surtaxation du
travail. C'est sur ce dernier facteur, beaucoup moins mobile que les capitaux,
que les Gouvernements se retranchent pour faire face à la perte de
ressources fiscales induite par les délocalisations.
Ainsi, entre 1981 et 1995, le taux implicite de prélèvement sur
le facteur travail a été porté de 34,9 à 42 %,
tandis que ce même taux est passé, pour les autres facteurs, de
45,5 à 35 %. Selon la Commission européenne, le
phénomène de distorsion fiscale au niveau européen
explique 4 points du taux de chômage européen qui
s'élève à 10,6 %.
2. La France, qui dispose d'un système fiscal non compétitif par rapport à ses concurrents européens, pourrait bénéficier des progrès de l'harmonisation européenne
La poursuite de l'harmonisation de la fiscalité au
niveau européen est urgente. Elle est d'autant plus conforme aux
intérêts français que la structure de la fiscalité
française apparaît peu compétitive, comme il a
été démontré précédemment. En effet,
la France pourrait pâtir de la trop forte divergence de sa
fiscalité par rapport aux tendances européennes.
En effet, si la France ne s'inscrit pas dans le processus d'harmonisation de la
fiscalité européenne, elle sera confrontée à deux
solutions :
- le maintien d'une fiscalité atypique, à un niveau
élevé, mais avec des ressources diminuant du fait des
délocalisations.
- l'alignement à terme de son système fiscal sur les niveaux les
plus bas de fiscalité locale, de taxation des bénéfices du
revenu du capital, de protection sociale ...pour faire face à
l'amplification de la concurrence.
3. L'harmonisation européenne est à l'ordre du jour
Les premières traductions de cette harmonisation ont
visé la taxe à la valeur ajoutée. Le programme d'action
adopté en juillet 1996 vise ainsi à introduire un système
commun de TVA fondé sur la taxation dans le pays d'origine à
l'horizon de la fin de l'année 1999.
Plus récemment, la communication du groupe de politique fiscale de la
Commission européenne, adoptée le 1er octobre 1997, comporte
plusieurs éléments visant à réduire les distorsions
fiscales en matière d'imposition des entreprises et de l'épargne,
notamment par :
- l'instauration d'un code de bonne conduite visant à la suppression de
la concurrence fiscale dommageable en matière d'imposition des
entreprises via un système d'informations mutuelles sur les
régimes fiscaux dérogatoires et l'instauration d'un gel de ces
régimes, prélude à leur démantèlement.
- le maintien d'un niveau minimum d'imposition de l'épargne des
non-résidents.
- la suppression des retenues à la source sur les paiements
transfrontaliers d'intérêts et de redevances afin
d'éliminer les entraves au développement des échanges et
opérations transfrontaliers dans la perspective de l'achèvement
du marché unique.
L'idée est d'éliminer la concurrence fiscale dommageable dont les
caractéristiques sont :
- un niveau d'imposition nettement inférieur au niveau
général du pays,
- des facilités réservées aux non-résidents,
- l'octroi d'avantages fiscaux indus,
- des règles pour la détermination des bénéfices
des entreprises faisant partie d'un groupe multinational qui divergent des
normes généralement admises au niveau international, notamment de
celles approuvées par l'OCDE,
- le manque de transparence.
La France n'est pas le premier pays concerné par la notion de
" concurrence fiscale dommageable " mais le manque de
lisibilité de son système fiscal, caractérisé par
une superposition de taxes, pourrait, à la limite, être
perçu comme un frein à l'harmonisation européenne.
4. Il est toutefois nécessaire d'aller plus loin
Rappelons que les conclusions et recommandations du
comité de réflexion des experts indépendants sur la
fiscalité des entreprises (comité Ruding) remises à la
commission européenne le 18 mars 1992 ont été le point de
départ de la réflexion en matière de fiscalité des
entreprises dans l'Union européenne.
Il ressortait des analyses de ce comité que les distorsions les plus
importantes résultaient essentiellement de la double imposition
internationale des dividendes mais également, et dans une moindre
mesure, de trois éléments :
- les retenues à la source prélevées par les pays
d'origine sur les paiements transfrontaliers d'intérêts entre
sociétés ;
- les différences entre les systèmes d'impôt sur les
société appliqués par les Etats membres ;
- les différences entre les Etats membres en ce qui concerne la base de
l'impôt sur les sociétés.
Parmi ses recommandations, le comité Ruding proposait d'instituer un
taux nominal minimal de l'impôt sur les sociétés de
30 %, que les bénéfices soient ou non distribués sous
la forme de dividende, et d'adopter pour tous les Etats membres un taux nominal
maximal de l'impôt sur les sociétés de 40 %.
La Commission européenne a depuis choisi de promouvoir un dispositif
d'harmonisation graduelle, notamment par un code de bonne conduite à
caractère non-contraignant, pour respecter la souveraineté des
Etats. Toutefois, l'intervention d'un accord politique sur les mesures de
coordination fiscale et le code de bonne conduite avant la fin de 1997, ainsi
que l'élaboration d'une directive sur la fiscalité de
l'épargne permettraient de préparer utilement la
réalisation de l'euro.
CHAPITRE III
LES CARACTÉRISTIQUES
ESSENTIELLES
DE L'ÉQUILIBRE PROPOSÉ
L'exercice en cours a été riche
d'épisodes budgétaires : de la note "confidentielle" de la
Direction du Budget au "testament" budgétaire d'Alain Juppé, puis
de l'audit des finances publiques à l'annonce des premières
mesures dites de redressement. De surcroît, le caractère souvent
elliptique du domaine budgétaire ne permet pas aisément de rendre
compte des évolutions d'un exercice sur l'autre.
Votre rapporteur général estime que le souci pédagogique
et surtout celui d'assurer une information en continu doivent être mieux
pris en compte pour permettre au Parlement d'exercer pleinement les
prérogatives constitutionnelles qui sont les siennes.
Plusieurs propositions présentées par votre commission en juillet
dernier à l'occasion de la publication de l'audit des finances publiques
et ci-dessous rappelées se révèlent d'une pertinence
renforcée.
Propositions de la commission des finances pour une modernisation des procédures budgétaires : les propositions de la commission des finances
Rétablir la "sincérité" de la
loi de finances
Au fil des années, la loi de finances est devenue un document à
rendre perplexe un commissaire aux comptes. Le projet présenté au
Parlement est incomplet (les fonds de concours n'y figurent pas),
contracté (près de 250 milliards de francs de
prélèvements sur recettes sont des charges n'apparaissant pas),
hétérogène (des dépenses identiques sont
traitées différemment selon qu'elles figurent au budget de l'Etat
ou dans des comptes spéciaux du Trésor).
Ainsi, le budget voté pour 1995 prévoyait 1.616 milliards de
dépenses à caractère définitif. En loi de
règlement
25(
*
)
, le montant des charges
s'est en définitive établi à 3.757 milliards de
francs, soit une différence de
2.141 milliards de francs
. Il
est nécessaire de faire apparaître la réalité :
le budget de l'Etat atteint 2.369 milliards en total net des
crédits ouverts, et dépasse le budget social
(2.300 milliards).
Institutionnaliser la distinction entre l'investissement et le
fonctionnement.
Depuis 1992, une part du déficit budgétaire (115 milliards
de francs en 1997) finance des dépenses courantes : l'Etat
s'endette pour vivre au jour le jour. Sans en avoir conscience, nous laissons
ainsi à nos enfants le soin et la charge de régler demain nos
consommations d'aujourd'hui. Cette atteinte aux droits des
générations futures n'est pas admissible. Par analogie avec la
"règle d'or" inscrite dans la Constitution allemande, elle appelle une
réforme de l'ordonnance du 2 janvier 1959, identifiant la section
de fonctionnement de l'Etat et les conditions de son équilibre
obligatoire, s
eul l'investissement étant dorénavant
financé par l'emprunt.
Certifier les méthodes comptables
L'évolution rapide des phénomènes économiques ne
permet pas de comparer des projets de loi de finances à "structure
constante". Cette instabilité inévitable -mais irritante- doit
être corrigée par la présentation au Parlement, sous le
contrôle de la Cour des Comptes, d'une annexe au projet de loi de
finances recensant les modifications de présentation budgétaire.
Inspirée du principe comptable de "permanence des méthodes",
cette réforme préviendra les polémiques sur les
"débudgétisations".
Instaurer une procédure de suivi des dépenses
sociales
Le vote de la loi de financement de la Sécurité sociale implique
que le Parlement puisse en contrôler l'exécution en cours
d'année. Cela suppose la création d'indicateurs mensuels rendus
d'autant plus nécessaires que les comptes sociaux se
caractérisent par leur extrême émiettement et que les
chiffres de l'ACOSS ne sont pas rendus publics.
Accélérer la mise en oeuvre de la comptabilité
patrimoniale
L'appréciation de la fidélité des documents
budgétaires implique une amélioration de la comptabilité
patrimoniale de l'Etat, dans le sens des travaux initiés par Jean
Arthuis. En effet, les déclassements d'opérations
budgétaires en opérations de trésorerie, la mise en jeu de
la responsabilité pécuniaire de l'Etat et les systèmes de
vases communicants entre le budget général et les comptes des
entreprises publiques ne sont finalement retranscrits que dans le compte de la
dette et non dans les lois de finances. Les pertes en capital n'apparaissent
pas, et pas davantage les charges de retraite non provisionnées.
Moderniser les procédures de régulation
budgétaire
Les rapports de la Cour des Comptes fournissent, chaque année, les
exemples d'une "comptabilité créatrice" visant tant à
lisser sur plusieurs exercices, qu'à réguler en cours
d'année les flux de dépenses et de recettes. L'ordonnance de 1959
n'est plus respectée : les conditions mises à la publication
de décrets d'avance, d'arrêtés d'annulation et de textes
créant des dépenses nouvelles
26(
*
)
ne sont plus
appliquées. Elles doivent
être adaptées.
En revanche, et malgré quelques améliorations récentes, le
Parlement ne peut accepter d'être mis en permanence devant des faits
accomplis, d'apprendre que des correctifs sont apportés à la loi
de finances dont l'encre est à peine sèche, voire de constater
que des crédits annulés au printemps sont rétablis
à l'automne.
Deux pistes méritent d'être
explorées
. La Cour des Comptes pourrait être saisie pour avis
du projet de loi de finances -à l'image du Conseil d'Etat- et porter un
jugement sur l'adéquation du niveau des dotations inscrites. Les
commissions des finances devraient être appelées à
débattre des régulations mises en oeuvre.
Fixer un nouveau rendez-vous budgétaire
Les grandes entreprises arrêtent des comptes semestriels. L'Etat ne
s'impose pas cette discipline. Il convient donc que le Parlement soit saisi, en
fin de premier semestre, d'un état commenté de l'exécution
des comptes publics, analogue au travail commandé aux deux magistrats de
la Cour des Comptes
27(
*
)
-dont
l'élaboration pourrait être confiée à la Cour dans
l'esprit de l'article 47 de la Constitution. Un jugement politique pourra
alors être porté sur la pertinence de l'exécution de la loi
de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale.
I. L'ÉQUILIBRE PROPOSÉ REPOSE SUR UNE AGGRAVATION DE LA PRESSION FISCALE
A. CETTE AGGRAVATION EXPLIQUE LE MODE DE CONSTRUCTION DU BUDGET
Ainsi qu'il a été dit, la présentation
des chiffres faite par le ministère des Finances ne rend pas
aisées les comparaisons ; elle ignore l'exigence de clarté
que s'impose le législateur. Cette opacité suscite des
controverses qui obscurcissent les débats de fond.
On peut ainsi s'interroger sur les raisons pour lesquelles un budget
réputé "infaisable" en début d'année est devenu
finalement -en apparence- presque simple à boucler au mois de septembre.
La réponse est simple. Le choix politique que traduisent les conditions
de l'équilibre budgétaire est radicalement inversé.
L'objectif du précédent gouvernement était : moins de
dépenses pour moins d'impôts. Le choix arrêté par le
nouveau gouvernement est plus d'impôts pour ne pas réduire les
dépenses.
1.
Le projet de loi de finances pour 1998 présente donc un solde
de budget général en amélioration de
21,8 milliards de francs
(de 284,1 à 262,3). Pour
apprécier son amélioration "réelle" de 59,3 milliards
de francs, il convient d'ajouter la recette non reconductible de la soulte
France Télécom de
37,5 milliards de francs
Mais cette amélioration du déficit est réalisée au
moyen d'un alourdissement des impôts.
2.
Les principales décisions d'alourdissement fiscal sont les
suivantes :
(En milliards de francs)
|
A. Abandon du
programme
quinquennal de réduction de
l'impôt sur le revenu adopté l'année dernière, soit
une économie :
|
16,2
|
3.
Le rapprochement de ces deux masses
financières (59,3 et 50,7 milliards) illustre la façon dont
le budget pour 1998 a été globalement construit :
- abandon de la loi de programmation militaire ;
- abandon de la programmation de réduction d'impôts sur le
revenu
- accroissement massif de la
pression
fiscale ;
Le surplus étant offert par la croissance en 1998 qui
générera de bien précieuses recettes
supplémentaires par l'effet de l'évolution spontanée.
L'amélioration du solde résulte donc bien d'un accroissement
des recettes et non d'une maîtrise des dépenses.
B. CETTE AGGRAVATION SE LIT DANS L'ÉVOLUTION DU DÉFICIT DE FONCTIONNEMENT DE L'ETAT
1. La présentation du budget dans les formes de la comptabilité communale
Depuis la publication du rapport du gouvernement
déposé à l'occasion du débat d'orientation
budgétaire pour 1996, la présentation du budget dans les formes
de la comptabilité communale livre de précieux enseignements.
L'analyse du budget de l'Etat pour 1997, tel qu'il a été
voté en loi de finances initiale, met clairement en évidence la
nécessité urgente et absolue pour l'Etat de cesser de faire
supporter aux générations futures les conséquences de son
incapacité à maîtriser ses dépenses et ses
déficits.
La section de fonctionnement affichait en 1997 un déficit de
115 milliards de francs, soit près de 7 % du total des charges
de la section. L'Etat s'est endetté ainsi pour un montant
équivalent, aux seules fins de financer des dépenses de
fonctionnement, par exemple, des rémunérations, des subventions
ou les intérêts de la dette elle-même. Le seul endettement
"sain" est celui qui permet de préparer l'avenir en finançant des
investissements. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
L'Etat porte ainsi gravement atteinte aux droits des générations
à venir qui paieront, avec charge supplémentaire
d'intérêts, ce dont elles n'auront en aucun cas
bénéficié. La solidarité entre les
générations n'est-elle pas, de ce fait, gravement
affectée ?
Ne pourrait-on pas dire que cette pratique durable de report sur les
générations à venir de nos déficits est le reflet
de notre lâcheté d'aujourd'hui qui consiste à ne pas oser
prélever sur les Français ce que l'on s'autorise à
dépenser en leur nom ?
2. Les conséquences de l'aggravation de la fiscalité en 1998
En comparant la loi de finances initiale 1996 à celle
de 1997, il apparaît que la légère dégradation du
déficit de fonctionnement (6 milliards de francs) provient d'une
baisse des impôts et taxes de 6 milliards de francs.
En revanche, en rapprochant la loi de finances initiale 1997 du projet de loi
de finances 1998, deux différences majeures apparaissent :
- la hausse des charges est plus lourde : + 35 milliards de
francs environ ;
- la hausse des impôts et taxes est considérable : plus de
51 milliards de francs.
Il est donc clair que l'amélioration du déficit de
fonctionnement (de - 115 à - 100 milliards de francs)
résulte bien d'une absence de maîtrise des dépenses et
d'une augmentation très forte de la pression fiscale.
Projet de loi de finances pour 1998
Section de fonctionnement
(en milliards de francs)
|
Dépenses |
LFI 1997 |
PLF 1998 |
Variation |
Recettes |
LFI 1997 |
PLF 1998 |
Variation |
|
1. Charges à
caractère
général
|
|
|
|
1. Produits de gestion courante (recettes non fiscales) |
|
|
|
|
2. Charges de
personnel
|
591,35
|
610,72
|
+ 19,37 |
2. Impôts et taxes (recettes fiscales) |
|
|
|
|
3. Autres charges de gestion
courante
|
|
|
|
3. Produits
financiers
|
25
|
20
|
+ 5 |
|
4.
Charges
financières
|
250,58
|
248,65
|
- 1,93 |
4. Produits exceptionnels |
0 |
0 |
|
|
5. Charges exceptionnelles |
0,00 |
0,00 |
5. Reprises sur amortis-sements et provisions |
|
|
||
|
6. Dotations aux amortis-sements et provisions |
|
|
|||||
|
7. Reversements sur
recettes
|
|
|
|
Déficit section de fonctionnement |
|
|
|
|
TOTAL |
1.665,605 |
1.701,185 |
+ 35 |
1.666 |
1.701,71 |
+ 35 |
Section d'investissement
(en milliards de francs)
|
Dépenses |
1997 |
1998 |
Recettes |
1997 |
1998 |
|
1. Dépenses
d'investissement
|
169,56
|
158,05
|
Déficit section de fonctionnement |
- 115 |
- 100 |
|
2. Dépenses
opérations
financières
|
399
|
392
|
Cessions d'immobilisations
financières
|
|
|
|
TOTAL |
569 |
550 |
569 |
550 |
C. CETTE AGGRAVATION COMBINE SES EFFETS AVEC CEUX DU PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tableau des recettes fiscales et sociales nouvelles
(LFI)
|
1997 |
Mesures d'urgences à caractère fiscal et financier (MUFF) |
+ 24 milliards de francs |
|
1998 |
1°) P.L.F.I.
|
+ 17 milliards de francs
|
|
Total IS |
+ 23,7 milliards de francs |
|
|
Impôt sur le revenu |
+ 17,37 milliards de francs |
|
|
TIPP |
+ 3,89 milliards de francs |
|
|
TVA nette |
- 1,76 milliard de francs |
|
|
Assurance-vie |
+ 0,2 milliard de francs |
|
|
Contribution logements sociaux |
+ 0,2 milliard de francs |
|
|
ISF (modification du barème) |
- 0,09 milliard de francs |
|
|
Taxe aux liaisons radio-électriques |
+ 0,02 milliard de francs |
|
|
TOTAUX 1998 A |
+ 43,53 milliards de francs |
|
|
Totaux des nouveaux prélèvements fiscaux (1997+1998) |
67,53 milliards de francs |
|
|
2°) PLFSS |
||
|
CSG nette |
+ 4,6 milliards de francs |
|
|
1 % CNAF et CNAV |
+ 4,5 milliards de francs |
|
|
Divers |
+ 0,8 milliard de francs |
|
|
AGED |
+ 0,9 milliard de francs |
|
|
Diverses taxes (tabac, médicaments) |
+ 1,9 milliard de francs |
|
|
TOTAL |
+ 12,7 milliards de francs |
|
|
Totaux des nouveaux prélèvements |
||
|
1998 |
+ 56,23 milliards de francs |
|
|
1997 + 1998 |
+ 80,23 milliards de francs |
Le total des recettes fiscales et sociales nouvelles
telles
qu'elles résultent des projets initiaux du gouvernement
s'élèverait en 1998 à 56,23 milliards de francs, en
intégrant les augmentations liées à l'abandon de la
réforme quinquennale de l'impôt sur le revenu votée en
1996.
Cette somme, qui représente 0,66 % du PIB estimé pour 1998,
se décompose, en recettes fiscales, pour 43,5 milliards et, en
recettes sociales, pour 12,7 milliards.
S'agissant des recettes sociales, l'augmentation du
prélèvement proposé par le gouvernement est minorée
du fait de la prolongation de la Caisse d'amortissement de la dette sociale de
5 ans
prévue par le projet de loi de financement de la
sécurité sociale. Cette prolongation conduit là encore
à faire supporter aux générations futures la charge des
déficits constatés en 1997, et le déficit prévu
pour 1998, à hauteur de 12 milliards, pour éviter de relever
le taux des contributions au remboursement de la dette sociale.
Ce report de
prélèvements s'élève à 10 milliards de
francs.
S'agissant des recettes fiscales nouvelles
, leur montant
s'élève en 1998 à 43,53 milliards de francs. Il
inclut les produits attendus de l'abandon de la réforme de l'impôt
sur le revenu engagée en loi de finances pour 1997. En revanche, ce
montant doit être compris, déduction faite de l'actualisation du
barème de l'impôt sur le revenu, à hauteur de l'inflation
escomptée.
A ce stade, plusieurs observations s'imposent
.
L'abandon de la réforme de l'impôt sur le revenu n'est pas,
à proprement parler, un prélèvement supplémentaire
sur les ménages. Il s'agit néanmoins d'un reniement de la parole
de l'Etat puisque la loi a été votée pour cinq ans.
L'opportunité d'une décrue de cette imposition avait
été démontrée l'année dernière. Il
suffit de se reporter aux travaux du Sénat de l'année
passée.
S'agissant de l'actualisation des barèmes de l'imposition des revenus,
ce n'est que par convention que le fascicule "Voies et moyens" en
évalue
l'effet comme s'il s'agissait d'une mesure nouvelle négative. Une
convention contraire pourrait être retenue ; elle consisterait
à assimiler une non-actualisation des barèmes à une mesure
d'alourdissement de l'imposition, strictement équivalente à la
hausse d'un taux sur une assiette réestimée. Le vote intervenu en
première lecture à l'Assemblée nationale sur
l'article 13 offre d'ailleurs un exemple de cette équivalence
arithmétique. Mais la méthode consistant à accroître
les prélèvements au moyen d'effets purement nominaux
mérite d'être dénoncée tant elle est contraire
à notre tradition fiscale.
En définitive, le cumul des recettes fiscales et sociales nouvelles
supportées entre juillet 1997 et la fin 1998 s'élèvera
à 80,23 milliards de francs.
II. LA MAÎTRISE DES DÉPENSES EST INEXISTANTE
Une loi de finances est un ensemble complexe qui regroupe le
budget général, les budgets annexes et les comptes
spéciaux du Trésor
28(
*
)
.
Leur agrégation est délicate, en raison de leurs
spécificités respectives. En équilibre par
définition, les budgets annexes n'interfèrent ni sur les
dépenses, ni sur les recettes, ni sur le solde. S'agissant des comptes
spéciaux du Trésor, leur solde seul est pris en compte dans la
présentation traditionnelle. Ils ne s'imputent donc pas, eux non plus,
pour la totalité de leurs recettes et de leurs dépenses.
Dans ces conditions, il est délicat de retracer en un seul chiffre
l'évolution des dépenses de la loi de finances. Le chiffre le
plus précis, conformément d'ailleurs à la tradition des
Assemblées, est probablement celui qui retrace les dépenses
définitives, quel qu'en soit le cadre (budget général,
C.A.D.) auquel s'agrège le solde des opérations temporaires des
autres comptes spéciaux du trésor. Ce chiffre peut être
considéré comme représentatif des charges "réelles".
Comme le souligne le rapport de l'Assemblée nationale :
"La
procédure d'affectation de recettes est un mode de financement qui ne
modifie pas le périmètre des dépenses de l'Etat. En
d'autres termes, une inscription de charges à caractère
définitif sur un compte d'affectation spéciale n'est pas une
débudgétisation. L'agrégat du Gouvernement la traite
pourtant comme telle, dans la mesure où les comptes d'affectation
spéciale sont presque toujours inscrits en équilibre. Cet
agrégat permet enfin de neutraliser les changements
de structure qui
se produisent chaque année, lorsque des dépenses du budget
général sont transférées sur un compte
spécial du Trésor et vice-versa".
A. LES CHARGES RÉELLES DE L'ETAT S'ACCROÎTRONT PLUS VITE QUE L'INFLATION EN 1998
Trois présentations différentes permettent de constater une même réalité.
1. L'article d'équilibre
|
Ressources brutes |
Dépenses brutes ou plafonds de charges |
Soldes |
|
|
Budget général
|
1.623,981
|
1.877,45
|
|
|
Total opérations définitives |
1.787,711 |
2.041,218 |
|
|
Solde opérations définitives (A) |
- 253,507 |
||
|
Total opérations temporaires (C.S.T.) |
371,903 |
376,265 |
|
|
Solde opérations temporaires (B) |
2.159,614 |
- 4,362 |
|
|
Total général |
2.417,483 |
||
|
Solde général (A + B) |
- 257,869 |
L'article d'équilibre fait apparaître les opérations définitives (budget général, budgets annexes, comptes spéciaux du Trésor) et leur solde, puis les opérations temporaires des comptes spéciaux du Trésor et leur solde.
2. L'exposé des motifs
Cette présentation révèle trois
différences essentielles avec la précédente :
- les opérations définitives des comptes d'affectation
spéciale ne sont présentées qu'en solde (ce qui minore le
"volume" du budget) ;
- les opérations des budgets annexes ne sont retracées ni dans le
total des ressources ni dans celui des dépenses puisqu'elles sont, par
construction, équilibrées en ressources et en emplois ;
- les dépenses du budget général sont
présentées nettes des dépenses d'ordre et des recettes
d'ordre, liées à la gestion de trésorerie de l'Etat ainsi
que des remboursements et dégrèvements d'impôts.
|
LFI 1997
|
PLF 1998
|
Variation
|
|
|
A. Titre I (hors dépenses et recettes d'ordre) |
235,9
|
238,3 |
+ 1,0 |
|
B. Budgets civils
|
4,3
|
4,4
|
+ 2,7
|
|
C. Défense
|
154,6
|
157,2
|
+ 1,7
|
|
D. Total des charges du budget général A+B+C) |
1.564,0 |
1.585,3 |
+ 1,36 |
|
E. Solde des comptes spéciaux du Trésor |
- 0,7 |
+ 4,4 |
n.s |
|
F. Total des Charges (D+E) |
1.563,3 |
1.589,7 |
+ 1,69 |
|
G Recettes nettes |
1.278,5 |
1.331,8 |
+ 4,18 |
|
H. Solde général (G-F) |
- 284,8 |
- 257,9 |
n.s. |
3. Les dépenses réelles
(en milliards de francs)
|
|
Exécution 1996 (a) |
PLF 97/ LFI 96 (c) |
|
|
Evolution 1998/1997
|
|
|
1.
Dépenses nettes du
budget
général
|
1.558,19
|
1.568,74
|
+ 0,86
|
1.582
|
1.599,12
|
+ 1,08 %
|
|
Charges du budget de l'Etat
:
présentation du
tableau d'équilibre :
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges du
budget de
l'Etat en termes de dette
nette :
|
|
|
|
|
|
|
(a) Hors FMI et hors fonds de concours (égaux
à 73,3 milliards de francs en 1996). Dépenses nettes du
budget général y compris fonds de concours :
1.642,04 milliards de francs.
(b) Y compris retraites de France Télécom (fonds de concours
jusqu'en 1996).
(c) Hors retraites France Télécom.
L'Assemblée nationale a développé depuis plusieurs
années une méthode de présentation des dépenses qui
permet de mettre en évidence les dépenses "réelles". Cette
présentation, intermédiaire entre celle de l'article
d'équilibre et celle du PLF, permet de mieux apprécier
l'évolution de ces dépenses.
Cette présentation permet de mettre en évidence plusieurs
indicateurs des dépenses budgétaires dont l'évolution peut
être contrastée, ainsi que l'illustre le tableau
ci-après :
|
PLF 1998/
|
PLF 1997
(a)/
|
|
|
Dépenses du budget
général
|
+ 1,36 %
|
+ 0,8 %
|
(a) Hors retraites France Télécom
Quelle que soit la présentation retenue, la discussion sur des
variations au millième de point apparaît byzantine tant en raison
de l'importance des sommes traditionnellement non budgétées, que
des régulations ou mesures nouvelles intervenant en cours d'exercice.
Il demeure qu'à présentation constante, l'évolution
des charges réelles pour 1998 est supérieure à l'inflation.
De l'utilisation des statistiques
Le gouvernement présente, dans son dossier de presse, un graphique fondé sur le taux de croissance des charges nettes du budget général en LFI et en francs constants . Ce tableau conduit à affirmer que : "jamais, ces dernières années, il n'y avait eu une telle stabilisation des dépenses de l'Etat" .
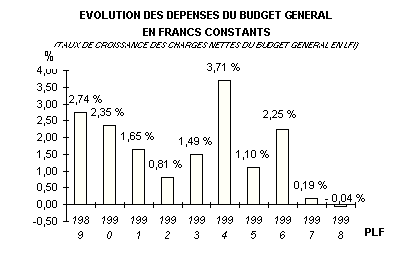
Ce tableau retrace l'évolution des dépenses en
seule LFI sur longue période, sans tenir compte des lois de
règlement. Il en appelle un autre retraçant l'évolution
des dépenses en exécution.
En exécution, jamais les dépenses ne se sont autant accrues
qu'entre 1990 et 1993 et jamais elles n'ont autant diminué que depuis
cette date.
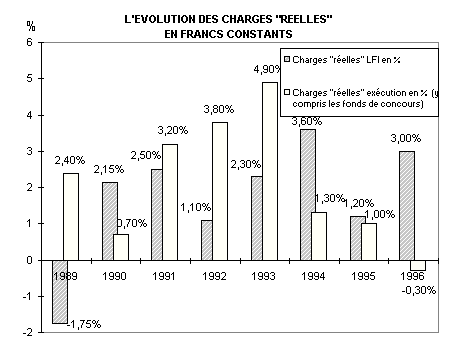
B. LE CAS PARTICULIER DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT SOULIGNE LA DIVERSITÉ DES AGRÉGATS BUDGÉTAIRES
Le partage du projet de loi de finances en trois sections
(budget général, CST, budgets annexes) ne permet pas d'identifier
aisément l'effort d'investissement civil de l'Etat.
En effet, le projet de loi de finances révèle une baisse des
crédits des titres V et VI (- 0,4 %), mais
l'exposé des motifs souligne que "les investissements civils de
l'Etat... progressent de 2,4 % en crédits de paiement par rapport
à la loi de finances initiale pour 1997 (hors dotations en capital et
reconstitution de fonds internationaux) ".
Ces deux assertions sont exactes, mais empruntent deux logiques
contradictoires : la première permet de présenter une hausse
modeste des dépenses de l'Etat, la seconde de souligner l'accroissement
de l'effort d'investissement. En tenant compte des budgets annexes, il est
même possible de retenir un chiffre de croissance supérieur
(+ 2,6 %).
Cependant, en prenant en compte l'investissement militaire, la
présentation du budget en section d'investissement fait apparaître
une forte baisse des crédits d'investissement (- 6,8 %).
(en milliards de francs)
|
LFI 1997 |
PLF 1998 |
Variation |
|
|
Budget général (A) |
71,9 |
71,6 |
- 0,4 % |
|
Budget général (B) (1) |
68,8 |
66,4 |
- 7 % |
|
CST (C) (2) |
9,9 |
14,1 |
+ 42,4 % |
|
Budgets annexes (D) |
2,9 |
3,2 |
+ 13,4 % |
|
Effort d'investissement global (B)+(C)+(D) |
81,6 |
83,7 |
+ 2,6 % |
(1) Hors reconstitution de fonds internationaux.
(2) Hors reconstitution de fonds internationaux et dotations en capital.
Cette méthodologie, exigeant des retraitements, est celle qui a
reçu l'aval de la Cour des Comptes, ainsi qu'il ressort de l'extrait
ci-après de la réponse apportée à une question de
votre rapporteur général
29(
*
)
.
Détermination de l'effort d'investissement de l'Etat
L'évaluation traditionnelle que fait la Cour dans son
rapport annuel sur l'exécution des lois de finances concerne le budget
général, les budgets annexes et les comptes spéciaux du
Trésor. Dans le domaine des investissements elle se prononce
traditionnellement, sur les montants des crédits ouverts puis
disponibles, sur les dépenses constatées et sur la gestion de
l'ensemble des autorisations de programmes depuis leur ouverture en loi de
finances jusqu'à leur utilisation. Cette double vision annuelle
(dépenses constatées) et pluriannuelle (consommation des
autorisations de programme) donne une bonne image de l'effort d'investissement
de l'Etat.
La prise en compte éventuelle, dans ces montants, de dépenses qui
figureraient sur d'autres titres ou chapitres, fausserait la notion de
dépense en capital, telle qu'elle ressort de la définition
figurant dans l'ordonnance organique. Faute de pouvoir nettement distinguer,
dans certaines subventions d'équilibre accordées par l'Etat, la
part qui relève du fonctionnement de celle qui pourrait concerner des
investissements, il paraît sage de se limiter dans la comptabilisation de
l'effort d'investissement de l'Etat aux seules dépenses imputées
sur les titres et chapitres budgétaires prévus pour retracer les
dépenses en capital.
III. L'ÉQUILIBRE PROPOSÉ N'AMÉLIORE PAS SUFFISAMMENT LE SOLDE BUDGÉTAIRE
A. LA BOULE DE NEIGE DE L'ENDETTEMENT GONFLE TOUJOURS
Sous l'effet d'une croissance de leurs déficits plus
rapide que celle du PIB,
la dette des administrations publiques
rapportée au PIB s'est considérablement accrue depuis 1985
.
Représentant alors 31 % du PIB, elle s'élèverait
à 57,8 % du PIB en 1998. D'un montant de 1.457 milliards de
francs en 1985, elle passerait à 4.861 milliards de francs en 1998,
soit une multiplication par 3,3 et une progression annuelle moyenne de
9,71 %.
La dette brute de l'Etat est quant à elle passée de
1.408 milliards de francs en 1985 -elle s'élevait à
677 milliards de francs en 1981, soit une augmentation de 20,1 % par
an entre ces deux dates- à 4.272 milliards de francs en 1996. A
cette date, elle représentait 98 % de la dette brute des
administrations publiques, le solde (88 milliards de francs) étant
porté par les autres composantes du secteur public.
Cette augmentation considérable de l'endettement s'est
accompagnée d'une hausse très vive des intérêts.
Ceux-ci s'élevaient à 168,3 milliards de francs en 1989
(Etat 111,8 ; autres : 56,5). Ils ont été
portés en 1996 à 320,4 milliards de francs (Etat :
236,8 ; autres : 85,6), soit une progression de 11,3 % par an en
moyenne (Etat 13,3 % ; autres : 7,2 %).
Ce phénomène, qualifié d'effet "boule de neige" a
réduit à néant les marges de manoeuvre
budgétaires.
L'Etat, qui consacrait 8,8 % de ces emplois aux paiements
d'intérêts en 1989, leur en consacrait 14 % en 1996.
A elle seule, la variation des charges d'intérêt explique
près de 2/3 de la dégradation de la capacité de
financement de l'Etat constatée entre 1989 et 1996.
Ainsi, "dévoreuse des marges de manoeuvre budgétaires", la
dérive des charges d'intérêt de la dette anéantit
toute tentative d'assainissement de ses finances publiques.
La dynamique propre à la dette publique est en effet supérieure
à celle du PIB qui, elle-même, est spontanément
supérieure à celle des recettes fiscales.
Le tableau ci-dessous le démontre.
La dynamique de la dette publique
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Encours de la dette
Maastricht
|
|
|
|
|
|
|
|
La réduction des déficits publics est donc un
impératif absolu, elle s'impose par priorité à tout. Elle
doit aller au-delà des objectifs de déficit fixés par le
Traité sur l'Union européenne. C'est ce que montre la simulation
effectuée par l'OFCE à l'horizon 2002.
Dans cette simulation, le déficit public est, au sens du traité,
de 3 % en 1998 et en 1999 et de 2,9 % en moyenne au-delà
jusqu'à 2002.
Malgré ce résultat, le ratio de la dette publique dans le PIB
s'accroît continûment pour atteindre 60 % en 2002.
A cet accroissement correspond une très faible diminution de la part des
charges d'intérêt dans le PIB. En effet, malgré des taux
d'intérêt à court terme inférieurs au taux de
croissance du PIB, celle-ci passerait de 3,6 % à 3,5 % entre
1997 et 2002.
Ces résultats ne doivent pas surprendre. La croissance est, en
projection, de 3,8 % alors que les auteurs du Traité sur l'Union
européenne, qui visaient la stabilisation à long terme de
l'endettement des administrations publiques, avaient retenu une
hypothèse de croissance de 5 % en valeur, grâce à
laquelle un déficit limité à 3 % du PIB autorisait
cette stabilisation.
B. LE DÉFICIT, MÊME RÉDUIT, LAISSE SUBSISTER UN SOLDE PRIMAIRE NÉGATIF LOIN DE PERMETTRE LA STABILISATION DE LA DETTE
Avant discussion à l'Assemblée nationale, le
projet de loi de finances laissait apparaître un solde déficitaire
de 257,9 milliards de francs correspondant à 3,05 points de
PIB.
Le déficit primaire
, soit le déficit hors charges nettes
de la dette et des garanties
s'élève dans cette
hypothèse à 23,7 milliards
de francs
contre
52,2 milliards en 1997, soit une amélioration de
28,5 milliards de francs.
Le déficit de l'Etat se traduira donc spontanément par une
aggravation de la dette à hauteur du chiffre prévu (soit
257,9 milliards de francs).
Le stock de la dette de l'Etat alimenté par le déficit de l'Etat,
sur la base d'un encours de dette à fin 1997, de 3.727,3 milliards
de francs, progressera de 6,9 %, soit un taux supérieur à
celui du PIB en valeur (4,2 %).
Le poids de la dette de l'Etat dans le PIB s'alourdit donc, passant de
45,99 % à 47,17 %.
Pour stabiliser la part de la dette dans le PIB, il aurait fallu que le
déficit de l'Etat n'excède pas 157,9 milliards de francs en
1998, soit un solde amélioré de 98,7 milliards de francs par
rapport à l'objectif retenu.
Autrement dit, la stabilisation de la dette exige de porter le solde primaire
à un excédent de 75 milliards de francs contre un
déficit annoncé de 23,7 milliards de francs.
C. LE BESOIN DE FINANCEMENT AU REGARD DES CRITÈRES DE MAASTRICHT
Le tableau qui suit présente, selon le rapport économique, social et financier pour 1998, l'évolution de la capacité de financement des administrations publiques, au sens de la comptabilité européenne depuis 1995.
Capacité de financement des administrations
publiques
au sens de la comptabilité européenne
(en % du PIB)
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Etat
|
- 4,1
|
- 3,65
|
- 2,9
|
- 3,1
|
|
Total des administrations publiques |
- 5,0 |
- 4,15 |
- 3,1 |
- 3,0 |
La réduction du besoin de financement des
administrations publiques, a été très marquée entre
1994 et 1997, passant de 5,6 % à 3,1 %
30(
*
)
.
L'exercice 1998 introduit, hélas, une rupture dans cette
évolution. Elle provient, pour une part importante, du
non-renouvellement des effets favorables pour 1997 du versement de la soulte
versée par France-Télécom. Abstraction faite de cette
ressource exceptionnelle, l'effort de diminution du déficit de l'Etat
peut être évalué à 0,26 point de PIB, soit deux
fois moins qu'entre 1995 et 1996.
L'écart entre le solde d'exécution des lois de
finances
et la capacité de financement de l'Etat
Le solde d'exécution des lois de finances est
l'addition des soldes d'exécution du budget général, des
budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
Pour passer de ces soldes à la capacité de financement de l'Etat
au sens de la comptabilité nationale, qui mesure les flux de dettes nets
des flux de créances de l'Etat, il faut opérer plusieurs
corrections.
Il convient d'abord de déduire du solde d'exécution des lois de
finances les seules opérations financières inscrites au budget de
l'Etat. Celles-ci ne modifient en effet pas le patrimoine de l'Etat
puisqu'à une dépense correspond un accroissement de
créances (exemple : les dotations en capital).
En revanche, il faut ajouter au solde d'exécution des lois de finances
certaines opérations non budgétaires qui peuvent avoir une
incidence sur le patrimoine de l'Etat telles que les opérations
d'abandon de créances.
L'écart entre la capacité de financement de
l'Etat
et la capacité de financement des administrations
publiques
au sens du traité d'Union économique et
monétaire
Une première source d'écart entre les deux
concepts provient de différences de champ : les administrations
publiques comprennent certes l'Etat, mais également les administrations
publiques locales, les administrations de sécurité sociale et les
organismes divers d'administration centrale.
Mais, une seconde source d'écart provient de différences entre
les concepts de la comptabilité nationale et ceux de la
comptabilité européenne.
Ainsi par exemple, les avances remboursables à l'industrie
aéronautique, considérées comme des opérations
budgétaires non financières au niveau national, ne le sont pas en
comptabilité européenne.
Ces chiffres révèlent également que les administrations
publiques, au titre de leur capacité de financement,
bénéficient de la sagesse budgétaire des administrations
publiques locales, et des excédents réalisés par les
organismes divers d'administration centrale (ODAC).
Si l'Etat a tenu quant à lui ses objectifs, il n'en est hélas pas
de même des administrations de sécurité sociale dont les
déficits ne sont pas redressés à la hauteur prévue
même si leur repli a été sensible entre 1995 et 1997
(- 0,25 point). C'est pourquoi, les prévisions du gouvernement
pour 1998 apparaissent audacieuses. L'objectif d'un déficit de
l'ensemble des administrations publiques de 3 % du PIB se fonde en effet
sur une hypothèse très volontariste, celle d'une réussite
entière du plan de redressement de la sécurité sociale
pour 1998. Or, si l'on peut rester optimiste sur la maîtrise des
dépenses de l'Etat, il n'en va pas de même des dépenses de
sécurité sociale qui dépendent de variables externes sur
lesquelles les autorités publiques ont finalement peu de prise.
Il eût donc été plus prudent et sage de marquer une
exigence plus forte quant à l'évolution du solde de l'Etat.
Une telle exigence aurait d'ailleurs permis de mettre nos finances publiques en
conformité avec nos engagements européens pris lors du sommet
d'Amsterdam du mois de juin 1997.
Le premier volet du pacte de stabilité et de
croissance :
l'article 103 du Traité
Le pacte de stabilité et de croissance comprend un
premier règlement du Conseil pris sur le fondement de l'article 103
paragraphe 5
"relatif au renforcement de la surveillance des
situations
budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des
politiques économiques".
Ce règlement a pour objet d'arrêter les modalités de la
procédure de surveillance multilatérale organisée par les
paragraphes 3 et 4 de l'article 103 du traité.
I. L'ARTICLE 103 DU TRAITE
L'article 103 énonce le principe selon lequel les Etats membres
"considèrent leurs politiques économiques comme une question
d'intérêt commun"
et par ailleurs qu'ils
"les coordonnent
au sein du Conseil"
.
Ces règles ne sont pas purement "formelles" puisque
l'article 102 A et l'article 103 paragraphe 2 leur donnent
un contenu matériel en précisant que :
- les Etats membres conduisent leurs politiques économiques en vue de
contribuer à la réalisation des objectifs de la
Communauté : "un développement harmonieux et
équilibré des activités économiques dans l'ensemble
de la Communauté, une croissance durable et non inflationniste
respectant l'environnement, un haut degré de convergence des
performances économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale
élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de
vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité
entre les Etats membres ;
- ils le font dans le contexte des grandes orientations des politiques
économiques des Etats membres et de la Communauté
déterminées à la majorité qualifiée par le
Conseil, comme le prévoit l'article 103 paragraphe 2 ;
- et ils agissent dans
"le respect du principe d'une économie de
marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une
allocation efficace des ressources"
et basée sur
"des prix
stables, des finances publiques et conditions monétaires saines et une
balance des paiements stable"
.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement, le
Conseil exerce sa surveillance
"afin d'assurer une coordination plus
étroite des politiques économiques et une convergence soutenue
des performances économiques"
sur la base d'informations fournies
par les Etats membres sur les mesures importantes prises par eux
"en
vérifiant la conformité des politiques économiques aux
grandes orientations visées au paragraphe 2 de
l'article 103"
(voir supra).
Si le Conseil constate que
"les politiques économiques d'un Etat
membre"
ne sont pas conformes à ces grandes orientations ou qu'elles
risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union, il
peut
adresser les recommandations nécessaires qu'il
peut
rendre
publiques.
II. LE NOUVEAU REGLEMENT ISSU DU CONSEIL D'AMSTERDAM
Le nouveau règlement entend préciser la procédure de
surveillance prévue par l'article 103 du traité. Son apport
paraît limité à l'édiction d'une obligation nouvelle
imposée aux Etats membres et d'une obligation nouvelle imposée au
Conseil. Mais, quelques ambiguïtés doivent être mises en
évidence.
A. UNE OBLIGATION NOUVELLE IMPOSEE AUX ETATS MEMBRES ET AU CONSEIL
1. Une obligation nouvelle imposée aux Etats membres
Le règlement impose aux Etats membres de présenter pour les
Etats membres participants -ceux qui auront adopté la monnaie unique-
un programme de stabilité
et pour les Etats membres non
participants -ceux qui n'auront pas adopté la monnaie unique-
un
programme de convergence
avant le 1er mars 1999.
Le contenu
desdits programmes est défini par les informations
qu'ils doivent comporter. Il existe en réalité peu de
différences entre programmes de stabilité et de convergence. Tous
deux doivent fournir l'objectif à moyen terme d'une situation
budgétaire proche de l'équilibre ou excédentaire, les
principales hypothèses économiques, la description des mesures
budgétaires et les autres mesures de politique économique
envisagées pour parvenir à l'objectif budgétaire de moyen
terme, des variantes permettant d'évaluer l'incidence d'un changement
portant sur une hypothèse économique. En outre,
les programmes
de convergence
doivent mentionner les objectifs à moyen terme de la
politique monétaire et le lien entre ces objectifs et la
stabilité des prix et des taux de change.
L'horizon temporel
des programmes est défini : ils doivent
couvrir, sur une base annuelle, l'année en cours et l'année
précédente et, au moins, les trois années suivantes. Les
Etats membres doivent présenter des programmes actualisés chaque
année.
Une obligation leur est enfin imposée
: celle de rendre
publics leurs programmes.
2. Une obligation nouvelle imposée au Conseil
Le Conseil doit désormais rendre un avis sur les programmes initiaux
dans les deux mois
de leur transmission. Il
peut
rendre un avis
sur les programmes actualisés. Il
doit
, s'il estime que les
objectifs et le contenu d'un programme devraient être renforcés,
inviter l'Etat membre concerné à adapter son programme. De
même, il
adresse
des recommandations à l'Etat membre
concerné si dans le suivi de la mise en oeuvre des programmes il
constate un dérapage sensible de la situation budgétaire par
rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou si ce
dérapage persiste et s'aggrave.
Par rapport à la situation qui prévaut tant que le
règlement ne s'applique pas, les novations introduites consistent donc
à encadrer dans le temps l'exercice de la surveillance du Conseil et
à lui imposer d'émettre un avis sur les programmes initiaux ou
une recommandation en cas de dérapage des seules finances publiques par
rapport aux objectifs de programmes.
B. QUELQUES AMBIGUÏTES
1. Une conception restreinte de la surveillance multilatérale
L'article 103 du traité concerne la surveillance de
l'évolution économique dans les Etats membres et dans la
Communauté ainsi que de la conformité des politiques
économiques avec les grandes orientations adoptées par le Conseil.
Or, la conception de la surveillance multilatérale prônée
par le règlement est beaucoup plus restreinte puisqu'elle concerne
presque exclusivement les finances publiques.
Sans doute une référence est-elle concédée
à l'examen de la conformité des programmes aux grandes
orientations ou du point de savoir si le contenu des programmes
"favorise
une coordination plus étroite des politiques économiques"
mais le reste du dispositif ne comporte aucune sanction de cet examen, à
l'inverse de ce qui est prévu en matière de finances publiques.
D'ailleurs aucune définition n'est donnée de ce que serait un
programme favorisant la coordination des politiques économiques.
On peut conclure que le règlement n'a pas arrêté les
modalités d'une surveillance multilatérale des politiques
économiques autres que les politiques budgétaires à une
exception près, d'ailleurs problématique -voir infra.
Comme le règlement n'a pas vocation à se substituer à
l'article 103 mais simplement à le compléter, il reste une
place à l'exercice de la surveillance des politiques économiques
des Etats membres. Mais, elle dépendra dans les faits de la
volonté du Conseil de l'exercer alors que le nouveau règlement
lui offre un mode d'emploi pratique de l'article 103 qui ne s'y
réfère pas.
2.
Une consécration implicite d'une politique d'équilibre
budgétaire
En l'état, le Conseil est libre d'adresser toutes recommandations qu'il
souhaite, dès lors qu'il juge que les politiques économiques d'un
Etat membre ne sont pas conformes aux grandes orientations définies par
lui. Il peut donc recommander à un Etat membre de respecter telle norme
de déficit public qu'il souhaite dès lors qu'il l'a
lui-même promue. Avec le nouveau règlement, cette latitude devient
une obligation et, du coup, l'orientation de la politique budgétaire
dans les Etats membres est prédéterminée sans
référence aux grandes orientations définies par le Conseil.
Une norme implicite de gestion des finances publiques est en effet
posée : l'objectif budgétaire à moyen terme
fixé par le programme de stabilité ou de convergence doit offrir
la marge de sécurité nécessaire à la
prévention d'un déficit excessif.
Les Etats devront donc
présenter des objectifs budgétaires assortis d'un déficit
sensiblement inférieur à trois points de PIB.
Il y a cependant lieu de souligner que la notion d'objectif budgétaire
à moyen terme offrant une marge de sécurité
nécessaire à la prévention d'un déficit excessif
est floue. Deux interprétations en sont en effet possibles, soit que
l'on privilégie le terme du programme et alors qu'on s'attache à
une trajectoire budgétaire permettant de dégager ladite marge de
sécurité, soit qu'on privilégie la "durabilité" de
la gestion budgétaire et alors qu'on recherche si chaque année
celle-ci offre la marge de sécurité nécessaire.
3. Quelques problèmes techniques
L'exercice de la surveillance est, on l'a dit, centré sur la
politique budgétaire sauf pour les "non participants" qui doivent
donner
des informations sur leur politique monétaire. Cette obligation peut
être jugée déconcertante si l'on garde à l'esprit
que les Banques centrales, et donc la définition des politiques
monétaires, sont indépendantes des gouvernements sur qui
pèse cette obligation. Ce paradoxe n'est en réalité
guère gênant puisqu'aussi bien l'examen des programmes de
convergence tel qu'il est organisé par le nouveau règlement ne
suppose pas de jugement direct sur la politique monétaire menée
dans les Etats concernés.
Le règlement n'harmonise pas la présentation temporelle
des programmes de stabilité et de convergence qui doivent certes couvrir
au moins les trois années à venir mais peuvent couvrir, cette
condition étant remplie, tous les horizons temporels imaginables. Il
n'est pas certain que ce défaut d'harmonisation favorise les
comparaisons entre les politiques budgétaires des Etats membres, non
plus d'ailleurs que celles entre les décisions du Conseil ou l'exercice
par celui-ci de l'examen de la coordination des politiques budgétaires.
Compte tenu de la place de la Commission dans le dispositif, c'est elle
qui instruit même si le Conseil décide, il serait plus que
souhaitable que ses rapports soient systématiquement transmis aux
commissions compétentes des Parlements nationaux.
Le texte conserve la latitude offerte au Conseil de rendre publiques
ses recommandations lorsque le dérapage budgétaire persiste mais
il ne dit rien sur le statut des avis formulés par le Conseil sur les
programmes. Il y a là une lacune. En tout cas, il serait souhaitable
pour le débat public que les avis et recommandations du Conseil soient
systématiquement adressés aux commissions compétentes des
Parlements nationaux.
Dans ces conditions, l'objectif budgétaire retenu par le gouvernement
pour l'an prochain n'apparaît pas assez prudent. Il s'écarte
d'ailleurs significativement du programme de convergence notifié par la
France en janvier 1997.
Le programme de convergence de janvier 1997
Fondé sur une perspective de croissance moyenne de 2,5 % l'an entre 1998 et 2001, le programme de convergence décrit les objectifs du gouvernement en matière de déficit public et leur impact sur le niveau de la dette publique.
Programme de convergence - principaux résultats
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
|
Taux de croissance du PIB (en volume) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Déficit public (en % du PIB) |
- 5,6 |
- 4,8 |
- 4,0 |
- 3,0 |
- 2,8 |
- 2,3 |
- 1,8 |
- 1,4 |
|
Dette publique (en % du PIB) |
48 ½ |
53 |
56 ½ |
58 |
59 |
59 ½ |
59 ½ |
59 |
La croissance économique
envisagée
suppose une reprise de l'activité qui serait favorisée par une
croissance dynamique de la demande étrangère adressée
à la France et par un changement de comportement des entreprises.
Celles-ci profiteraient d'un environnement financier propice pour mettre un
terme au destockage et réaliser les investissements nécessaires
au rattrapage du retard enregistré en ce domaine. Compte tenu de
l'enrichissement de la croissance en emplois, l'économie
française créerait 175.000 emplois salariés privés
en 1997 avec une croissance de 2,3 %. Pour les années 1998 à
2001, le scénario central -2,5 % de croissance annuelle- est celui
d'un rythme de croissance tendancielle. Il suppose que les partenaires
extérieurs de la France connaissent eux-mêmes une telle
croissance, que l'investissement des entreprises reste bien orienté et
que le taux d'épargne des ménages s'infléchisse un peu. Il
est à noter qu'une telle croissance ne suffit pas à combler
l'écart négatif de croissance de 3 % observé ces cinq
dernières années et qu'ainsi le chômage ne reculerait pas.
Une variante est proposée présentant un scénario de
croissance de 3 % l'an. Elle repose sur des hypothèses
d'investissement des entreprises plus favorables, sur une baisse
accentuée du taux d'épargne des ménages et sur un
environnement international plus porteur. Elle décrit l'amorce d'une
réduction du taux de chômage.
Les résultats du programme de convergence en matière de
finances publiques
sont variables selon le rythme de croissance
envisagé.
Mais, la politique budgétaire décrite par le
programme est volontariste.
Le déficit public serait, dans le scénario central, ramené
de 3 % du PIB en 1997 à 2,8, 2,3, 1,8 et 1,4 % du PIB au cours
de chacune des années suivantes. A partir de l'an 2000 la part de la
dette publique dans le PIB serait stabilisée et commencerait à se
replier.
Les recettes de l'Etat croîtraient en moyenne de 3,9 % l'an avant
réduction de l'impôt sur le revenu -soit environ 3,75 % en en
tenant compte- contre une croissance du PIB de 4,35 %.
L'élasticité des recettes serait donc inférieure à
l'unité.
Les dépenses de l'Etat resteraient sous contrôle. Elles
s'accroîtraient de 0,75 % en 1998 puis de 1,25 % l'an
au-delà. Leur élasticité par rapport à
l'évolution du PIB serait également inférieure à
l'unité.
La pression fiscale s'atténuerait donc un peu tandis que le poids des
dépenses publiques dans le PIB reculerait plus significativement.
Quant aux comptes sociaux, la croissance des recettes serait de 4,3 % l'an
en 1998-2001, ce qui suppose une évolution de leur assiette
parallèle au PIB, tandis que les dépenses ne progresseraient que
de 0,7 % en francs constants (environ 2,2 % par an en valeur). Les
dépenses d'assurance-maladie seraient stabilisées en francs
constants de même que les prestations familiales jusqu'en 2000. Les
dépenses de la branche vieillesse s'accroîtraient de 3,9 % par an
en valeur.
Moyennant l'hypothèse d'un équilibre des comptes des
administrations publiques locales et d'un maintien de l'excédent des
autres administrations autour de 0,2 point de PIB,
c'est de la
maîtrise des dépenses publiques que proviendrait principalement le
retour à une situation budgétaire meilleure
. Celui-ci serait
plus rapide si la croissance était supérieure de 0,5 point
par an à partir de 1998 comme l'illustre le tableau suivant.
En % du PIB
|
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
|
Capacité de financement |
- 5,6 |
- 4,8 |
- 4,0 |
- 3,0 |
- 2,7 |
- 2,0 |
- 1,5 |
- 1,2 |
|
Dette |
48 |
52 ½ |
56 ½ |
58 |
58 ½ |
58 ½ |
58 |
57 |
Le poids de la dette publique dans le PIB serait
stabilisé plus tôt, dès 1999, et serait inférieur au
niveau atteint dans le premier scénario sous le double effet d'un
déficit un peu réduit et d'une progression plus importante du
dénominateur.
Le déficit public cumulé ne serait plus de 8,3 % du PIB mais
de 7,4 % du PIB moyennant un supplément d'allégements
fiscaux de l'ordre de 0,4 point de PIB. Les recettes seraient plus
dynamiques si bien qu'en particulier les régimes sociaux reviendraient
à l'équilibre en 1998 et dégageraient des excédents
par la suite.
Préparée dans un contexte économique supposé
plus favorable, la loi de finances pour 1998 ne manifeste pas une ambition
suffisante de redressement des finances publiques.
Les évaluations du solde structurel issues des grands organismes
économiques internationaux confirment cette assertion.
|
En points de
PIB
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Capacité de
financement des APU (déf. Maastricht)
|
|
|
|
|
|
|
Source : Rapport économique, social et financier pour 1998.
Nonobstant les estimations du ministère de l'économie et des finances, on constate que et l'OCDE et le FMI jugent que le solde structurel, qui avait été amélioré de près de deux points entre 1993 et 1997, se dégrade en 1998, signe d'une volonté insuffisante d'assainissement des finances publiques.
CHAPITRE IV
LES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
DE LA CROISSANCE DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
EN 1998
Avec 1.345,7 milliards de francs, les recettes dont
disposerait l'Etat en 1998 progresseraient de 3,4 % par rapport à
1997, année où, hors mesures de relèvement de l'imposition
des sociétés adoptées récemment, les recettes
à la disposition de l'Etat n'auraient progressé que de 0,1 %.
L'évolution desdites recettes est tributaire d'évolutions
contrastées portant sur leurs grandes composantes.
Evolution des recettes du budget de l'Etat
(en millions de francs)
|
1996 |
1997 2 |
1998 |
Ecarts |
||
|
1997/1996 |
1998/1997 |
||||
|
Recettes fiscales nettes |
1.359,5 |
1.403,7 |
1.446,7 |
3,2 |
3,1 |
|
Recettes non fiscales |
159,5 |
150,8 |
154,7 |
- 5,4 |
2,5 |
|
Prélèvements sur
recettes
|
243
|
253
|
255,7
|
4,1
|
1,1
|
|
TOTAL |
1.276 |
1.301,5 |
1.345,7 |
2 |
3,4 |
1. Hors fonds de concours et recettes
extra-budgétaires
2. Estimations révisées.
Les recettes fiscales nettes
s'accroîtraient de 3,1 %, soit
un supplément de produit de 43 milliards de francs. Leur
progression calculée sur la base des recettes qui auraient
été perçues si la loi portant mesures urgentes à
caractère fiscal et financier n'avait exercé ses effets en 1997,
s'élèverait à 4,8 % contre un rythme d'accroissement
des recettes de 1,5 % entre 1996 et 1997
31(
*
)
.
Les recettes non fiscales
qui se replieraient de 5,4 % entre ces
dernières années s'accroîtraient de 2,5 % l'an
prochain par rapport au niveau atteint en 1997.
Quant aux prélèvements sur recettes
, leur croissance n'est
modérée que parce que les prélèvements au profit
des collectivités locales qui en représentent 64,2 %
s'infléchiraient en valeur, compensant ainsi l'importante progression
-+ 5,5 %- de notre contribution au budget des Communautés
européennes. Ces prélèvements nouveaux s'inscriraient dans
la problématique décrite dans le tableau ci-après.
Tableau des recettes fiscales et sociales nouvelles
(LFI)
|
1997 |
Mesures d'urgences à caractère fiscal et financier (MUFF) |
+ 24 milliards de francs |
|
1998 |
1°) P.L.F.I.
|
+ 17 milliards de francs
|
|
Total IS |
+ 23,7 milliards de francs |
|
|
Impôt sur le revenu |
+ 17,37 milliards de francs |
|
|
(Impôt hors abandon de la "réforme Juppé) |
+ 1,23 milliard de francs |
|
|
(Impôt hors "actualisation du barème et hors Juppé) |
+ 4,75 milliards de francs |
|
|
TIPP |
+ 3,89 milliards de francs |
|
|
TVA nette |
- 1,76 milliard de francs |
|
|
Assurance-vie |
+ 0,2 milliard de francs |
|
|
Contribution logements sociaux |
+ 0,2 milliard de francs |
|
|
ISF (modification du barème) |
- 0,09 milliard de francs |
|
|
Taxe aux liaisons radio-électriques |
+ 0,02 milliard de francs |
|
|
TOTAUX 1998 A |
+ 43,53 milliards de francs |
|
|
(Hors abandon de la "réforme Juppé" B |
27,39 milliards de francs |
|
|
(Hors abandon de la "réforme Juppé" et hors "actualisation des barèmes") C |
30,91 milliards de francs |
|
|
Totaux des nouveaux prélèvements fiscaux (1997+1998) |
67,53 milliards de francs |
|
|
(Hors abandon de la "réforme Juppé") |
53,89 milliards de francs |
|
|
(Hors abandon de la "réforme Juppé" et hors "actualisation des barèmes") |
57,51 milliards de francs |
|
|
2°) PLFSS |
||
|
CSG nette |
+ 4,6 milliards de francs |
|
|
1 % CNAF et CNAV |
+ 4,5 milliards de francs |
|
|
Divers |
+ 0,8 milliard de francs |
|
|
AGED |
+ 0,9 milliard de francs |
|
|
Diverses taxes (tabac, médicaments) |
+ 1,9 milliard de francs |
|
|
TOTAL |
+ 12,7 milliards de francs |
|
|
Totaux des nouveaux prélèvements |
||
|
1998 |
+ 56,23 milliards de francs |
|
|
+ 40,09 milliards de francs |
||
|
+ 43,61 milliards de francs |
||
|
1997 + 1998 |
+ 80,23 milliards de francs |
|
|
+ 66,59 milliards de francs |
||
|
+ 70,2 milliards de francs |
I. LES RECETTES FISCALES NETTES S'ACCROISSENT
Evolution des recettes fiscales
(en millions de francs)
|
1996 |
1997 1 |
1998 |
Ecarts en % |
||
|
1997/1996 |
1998/1997 |
||||
|
Recettes fiscales |
1.620,1 |
1.671,1 |
1.725 |
3,1 |
3,2 |
|
Impôt sur le revenu |
314,1 |
290 |
296,6 |
- 7,8 |
2,3 |
|
Autres impôts directs |
37,9 |
46,2 |
48 |
21,9 |
3,9 |
|
Impôt sur les
sociétés
|
171,7
|
203,1
|
220,2
|
18,3
|
8,4
|
|
Autres impôts directs et taxes assimilées |
79,8 |
82,1 |
82,3 |
2,9 |
0,2 |
|
Impôts directs bruts |
603,5 |
621,5 |
647,1 |
3 |
4,1 |
|
TVA
|
728,2
|
753
|
776,8
|
3,4
|
3,2
|
|
TIPP |
148,4 |
150,6 |
154,9 |
1,5 |
2,9 |
|
Enregistrements et autres taxes indirectes |
140 |
146 |
146,2 |
4,3 |
0,01 |
|
Impôts indirects bruts |
1.016,6 |
1.049,6 |
1.077,9 |
3,2 |
2,7 |
|
Remboursements et dégrèvements |
260,6 |
267,4 |
278,3 |
2,6 |
4,1 |
|
dont : autres que TVA et IS |
104,4 |
104,4 |
105,8 |
0 |
1,3 |
|
Recettes fiscales nettes |
1.359,5 |
1.403,7 |
1.446,7 |
3,2 |
3,1 |
1. Estimations révisées
La progression du produit des recettes fiscales nettes
s'élèverait à 3,1 %
de
1997 à 1998,
soit une progression de 43 milliards de francs
L'évolution des recettes fiscales doit être mise en regard du
montant des recettes fiscales nettes qui aurait été
constaté si la loi portant mesures d'urgence à caractère
fiscal et financier n'avait alourdi les prélèvements en 1997.
Les conclusions de l'audit sur les recettes
confrontées à la révision opérée dans le
cadre de la préparation de la loi de finances pour 1998
L'audit sur l'état des finances publiques remis le
21 juillet 1997 au Premier ministre a conclu à la
nécessité de réviser les recettes publiques par rapport
aux estimations de la loi de finances pour 1997.
Le montant de la révision des recettes fiscales préconisée
par les auditeurs s'élevait à 17 milliards de francs. Ce
chiffre était, selon les auditeurs, proche de celui retenu par les
administrations concernées à l'issue de la réunion
d'arbitrage des recettes fiscales tenue fin juin par les principales directions
du ministère de l'économie et des finances. Il équivalait
à 0,21 point de PIB, toujours selon les estimations des auditeurs.
L'examen des révisions opérées dans le cadre de la
préparation du projet de loi de finances pour 1998 permet de
déceler les postes concernés et leur cohérence avec les
chiffres de l'audit.
Il apparaît que
les recettes fiscales brutes s'accroissent davantage
que prévu
; la révision conduit à mettre en
évidence une plus-value de recettes. Hors loi portant mesures urgentes
à caractère fiscal et financier, le produit des recettes fiscales
brutes aurait été révisé de 2,5 milliards de
francs à la hausse, passant de 1.644,6 milliards de francs en loi
de finances à 1.647,1 milliards de francs en exécution.
Ce sont les recettes fiscales nettes qui sont concernées par une
révision à la baisse
. En effet, les remboursements et
dégrèvements qui avaient été évalués
à 249,4 milliards de francs s'élèveraient à
266,9 milliards de francs en exécution.
Au total, la révision de recettes fiscales nettes s'élève
à 15 milliards de francs. Ce chiffre est inférieur de
2 milliards à la révision proposée par les
auditeurs
32(
*
)
.
Etant donné la discordance portant sur la valeur du PIB en 1997 entre
l'exercice d'audit et celui de préparation de la loi de finances pour
1998, la révision jugée nécessaire par le gouvernement
s'élève à 0,18 % du PIB contre 0,21 % selon les
auditeurs.
Il apparaît que la moins-value de recettes par rapport aux produits
attendus pour 1997 se serait élevée à 15,1 milliards
de francs, le total des recettes atteignant effectivement
1.380,2 milliards de francs contre une estimation de
1.395,3 milliards de francs.
Dans ces conditions, le supplément de prélèvement
obligatoire résultant du projet de loi portant mesures d'urgence
à caractère fiscal et financier avec 24 milliards de francs
apparaît largement supérieur à ce qui aurait
été nécessaire pour compenser le déficit de
recettes supposé résulter de l'exécution
budgétaire.
En tout cas, hors les produits ainsi encaissés en 1997, la progression
des recettes fiscales nettes s'élèverait à 4,8 % en
1998, soit un rythme d'augmentation plus rapide que celui du PIB.
La croissance spontanée des recettes fiscales nettes apparaît
modeste au regard de la prévision de croissance du PIB en 1998.
Ce résultat n'apparaît guère cohérent compte tenu de
l'hypothèse de croissance posée pour préparer le budget de
1998, supérieure à la croissance observée en 1997.
Mais, compte tenu des liens distendus qu'entretiennent croissance et
encaissement de recettes fiscales, seule une analyse détaillée
par impôt permet de juger de la pertinence d'ensemble de la
prévision.
A. LA RÉVISION DES REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS DEVIENT DE PLUS EN PLUS FRAGILE
Une fois n'est pas coutume, le commentaire peut, cette
année, commencer par l'analyse des remboursements et
dégrèvements dont la prévision apparaît de plus en
plus fragile.
Sur les 278,3 milliards de francs prévus par le projet de loi de
finances, au titre des remboursements et dégrèvements, un peu
plus de la moitié (140,5 milliards, soit 50,3 %) concerne la
TVA, 11,5 % l'impôt sur les sociétés, le reste, soit
105,8 milliards et 38,2 % des dégrèvements et
remboursements se partageant entre :
les dégrèvements et remboursements sur les autres
contributions directes pour 101,95 milliards de francs, dont
55,65 milliards sur des contributions locales, 5,5 milliards de
remises et annulations de droits et 6 milliards de restitutions relatives
à des retenues à la source et à des
prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers ;
les remboursements sur les autres produits indirects pour
3,85 milliards de francs.
La structure des dégrèvements et remboursements est donc la
suivante en 1998 :
|
Dégrèvements et
remboursements sur
contributions directes
|
48,1
|
|
Dégrèvements et
remboursements sur
contributions indirectes
|
51,9
|
|
TOTAL |
100 |
1. Hors remboursement forfaitaire aux agriculteurs non
assujettis à la TVA et compte de partage avec Monaco.
L'évaluation "ex-ante" des remboursements et
dégrèvements constitue un exercice délicat
.
Initialement estimés à 220,4 milliards en 1995, ils se sont
élevés effectivement à 222,2 milliards de
francs ; pour 1996, ces chiffres ont atteint respectivement 241 et
260 milliards de francs.
A nouveau, en 1997, les estimations initiales ont été
révisées, les remboursements et dégrèvements
s'élevant à 267,4 milliards de francs contre une
prévision de 249,4 milliards.
Les causes principales expliquant ces incertitudes semblent relever des
facteurs suivants :
Les
remboursements de TVA
dépendent du montant des
déductions dont l'imputation n'a pu être opérée. Ils
sont particulièrement sensibles au niveau des exportations.
Les
remboursements d'impôt sur les sociétés
sont
issus des mécanismes de liquidation de cet impôt. Les
sociétés versent quatre acomptes sur la base du
bénéfice imposable du dernier exercice clos. Si ces acomptes
excèdent l'impôt dû, l'administration procède
à remboursement.
L'accroissement des remboursements signifie que la
situation bénéficiaire globale des sociétés se
dégrade
en 1997.
La révision en hausse des remboursements et dégrèvements
en 1997 concerne à titre principal ces deux catégories : les
remboursements au titre de l'impôt sur les sociétés pour
4 milliards, ceux au titre de la TVA pour 10,7 milliards de francs.
Les dégrèvements sur contributions directes revenant à
l'Etat sont, quant à eux, réestimés de 2,5 milliards
de francs.
L'ampleur des révisions qui atteignent 8,7 % des estimations
initiales pour la TVA et 15,1 % pour l'impôt sur les
sociétés illustre la difficulté technique d'une part
importante des prévisions de recettes.
C'est cette même
difficulté qui invite à prendre avec précaution les
chiffres révisés et les estimations pour 1998.
L'on doit d'abord constater une forte progression des remboursements et
dégrèvements au cours des trois dernières années.
Dégrèvements et remboursements 1995-1998
(en millions de francs)
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Dégrèvements sur
impôts
directs
|
|
|
|
|
|
Remboursement sur
TVA
|
|
|
|
|
|
Totaux pour la TVA (1) |
106,2 |
128,3 |
134,5 |
140,9 |
|
Restitution de droits de
douane,
d'enregistrement de timbre,
de contributions indirectes et de divers autres impôts
|
|
|
|
|
|
Totaux |
222,2 |
260,5 |
267,4 |
278,3 |
|
(1) Les écarts -minimes- entre les chiffres de ce tableau et ceux évoqués plus haut tiennent à des différences de champ choisies pour assurer la cohérence des comparaisons avec les années précédentes. |
||||
Entre 1995 et 1997, le montant des remboursements et
dégrèvements s'est accru de 20,3 %. L'essentiel de cette
progression s'est réalisé entre 1995 et 1996. Entre 1997 et 1998,
elle ne serait plus que de 4,1 %.
Les opérations relatives à la TVA expliquent, on l'a dit, une
partie importante des remboursements et dégrèvements
supplémentaires. Selon la direction générale des
impôts, ce phénomène résulte pour moitié de
l'augmentation de 2 points du taux normal de TVA réalisée en
1995 et pour le reste, de la progression des crédits des entreprises
exportatrices. Il reste à examiner si des opérations moins
orthodoxes pourraient être mises en évidence pour expliquer la
forte augmentation observée.
En tout état de cause, la croissance des remboursements de TVA
retenue dans le projet de loi de finances pour 1998 -4,9 %- peut
apparaître assez conservatrice compte tenu des hypothèses portant
sur les exportations. Si l'on avait privilégié le choix de
retenir les évolutions tendancielles depuis 1995, c'est à un
chiffre supérieur de 4,6 milliards que l'on aurait
arrêté le montant des remboursements de TVA pour 1998.
B. LES IMPÔTS DIRECTS S'ACCROISSENT ÉGALEMENT
Les impôts directs bruts représentent 37,5 %
des recettes fiscales brutes en 1998, contre 37,2 % en 1997. Leur produit
s'accroîtrait de 4,1 % contre une progression de 3 % l'an
dernier.
Deux impôts, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les
sociétés représentent près de 80 % de
l'ensemble des recettes fiscales issues des impositions directes.
1. L'impôt sur le revenu : l'abandon de la réforme ou le reniement de la parole de l'Etat
Après avoir connu une réduction sensible en
1997, les recettes de l'impôt sur le revenu se redresseraient en 1998
pour atteindre 296,6 milliards de francs, soit une progression de
2,3 %.
En 1997, le produit de l'impôt sur le revenu se replierait principalement
sous l'effet de la réforme du barème entrepris par le
précédent gouvernement. Son impact est estimé à
25,8 milliards de francs en 1997. Sans cette réforme, le produit de
l'impôt se serait élevé à 315,5 milliards de
francs. Il s'ensuit que la dynamique spontanée de l'impôt sur le
revenu aurait été très modeste, de l'ordre de 0,4 %.
La faiblesse de la progression du revenu des ménages en 1996 explique
l'essentiel de ce résultat.
La progression attendue de l'impôt sur le revenu en 1998 résulte
de plusieurs facteurs :
L'abandon de la réforme de l'impôt susciterait, par rapport
à l'état de la législation, un supplément de
produit de 16,14 milliards de francs.
Les autres mesures d'aménagement des droits proposées par le
gouvernement dans son projet initial se traduiraient par un supplément
de produit de 1,23 milliard. Il est à noter que, hormis la
revalorisation traditionnelle du barème, basée sur une
hypothèse d'inflation de 1,1 %, les mesures nouvelles
proposées par le gouvernement rapporteraient 4,75 milliards de
francs.
Il apparaît ainsi que
la prévision du gouvernement suppose une
croissance spontanée de l'impôt de l'ordre de 1,85 %, un peu
inférieure à l'évolution en volume du revenu des
ménages.
Cette évolution pose évidemment problème puisqu'elle vient
confirmer qu'en dépit de sa progressivité, le rendement de
l'impôt sur le revenu serait tributaire d'une élasticité
inférieure à l'unité. Les phénomènes
d'optimisation fiscale qui peuvent expliquer ce résultat paraissent donc
bien ancrés, ce qui n'est évidemment pas illégitime par
principe.
Il est en tout cas impossible de déduire du différentiel de
croissance entre le produit de l'impôt et son assiette que l'Etat
consentirait aux ménages un transfert en leur faveur.
Outre que, par rapport à la législation en vigueur, le
gouvernement manifeste une volonté de prélever quelque
16 milliards de francs supplémentaires sur le revenu des
ménages, les dispositions accompagnant le projet de loi de financement
de la sécurité sociale se traduiraient par un alourdissement des
prélèvements directs sur le revenu des ménages. Celui-ci
peut être estimé à au moins 10 milliards de francs,
malgré la décision de reporter la charge de la dette sociale sur
les générations futures qui "allège" le surcroît
d'imposition nécessaire à l'équilibre de la CADES de
10 milliards. Il est d'ailleurs remarquable qu'au terme de ce projet de
loi, le produit de la contribution sociale généralisée
(CSG) dépasserait de beaucoup les recettes issues de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques, s'élevant à 334 milliards
de francs contre 296,6 milliards pour ce dernier.
A l'issue de la combinaison des relèvements d'impôt sur le revenu
et du taux de la CSG,
c'est à une aggravation des
prélèvements directs sur les revenus des ménages de plus
de 11 milliards de francs que l'on aboutirait. Un chiffre de
27 milliards devrait être retenu si l'on devait comparer les
prélèvements directs effectifs en 1998 aux
prélèvements opérés selon un état constant
de la législation.
Il reste à évaluer la pertinence des prévisions produites
par le gouvernement.
Celle-ci est avant tout dépendante de l'évolution du produit de
l'impôt sur le revenu en 1997. A ce propos, le gouvernement table sur une
recette de 290 milliards de francs.
Or, les données de l'exécution budgétaire indiquent
qu'à fin août 1997, les recettes tirées de l'impôt
sur le revenu s'élevaient à 194,2 milliards de francs. Elles
s'inscrivaient ainsi en baisse de 1,1 % par rapport au produit
recouvré en août 1996 contre une baisse attendue de 7,7 %
entre 1996 et 1997. Il faudrait donc que les produits recouvrés au cours
des quatre derniers mois de 1997 s'élèvent à
95,8 milliards pour que la prévision de recettes pour 1997 soit
conforme aux prévisions. Ceci supposerait une diminution relative des
recouvrements de 18,6 % par rapport à la situation observée
l'an dernier.
Il n'est pas sûr qu'une telle diminution advienne. Sans doute, la majeure
partie des allégements fiscaux prévus par la loi de finances pour
1997 devrait-elle concerner le dernier tiers provisionnel acquitté dans
les derniers mois de l'année. Mais, les recouvrements jusqu'alors
effectués ont d'ores et déjà été
minorés de 6 % conformément aux termes de la loi à
l'occasion de la perception du premier tiers provisionnel. Il en est
allé de même des premières mensualités. Par
conséquent, une partie de l'impact de la réforme de 1997 a
déjà été absorbée et s'est déduite
des recouvrements constatés à fin août 1997.
L'Institut national de la statistique et des études économiques
en tient d'ailleurs compte dans ses commentaires sur l'évolution du
pouvoir d'achat du revenu des ménages au premier semestre.
Le produit de l'impôt sur le revenu pourrait donc être un peu
supérieur aux estimations retenues pour 1997.
Il s'ensuivrait un supplément de recettes pour 1998. Mais, une inconnue
pèse sur ce point. Il entre en effet, semble-t-il, dans les intentions
du gouvernement de rendre déductible tout ou partie de la majoration de
la CSG. Si tel était le cas, les recettes seraient inférieures
aux estimations produites.
Faute de précision, il est en l'état impossible de citer un
chiffre précis concernant les recettes de l'impôt sur le revenu en
1998.
Cette donnée est à elle seule importante car elle est
symptomatique de l'opacité, pour les agents économiques, des
approximations de la politique fiscale.
Quoi qu'il en soit, alors que le précédent gouvernement avait
adressé un message clair aux contribuables en adoptant une
réduction programmée de leur impôt sur le revenu, ce
message est aujourd'hui brouillé, voire inversé, par le nouveau
gouvernement. Bien plus, les prélèvements nouveaux sur le revenu
des ménages se traduiront par une ponction supplémentaire qui
viendra compromettre la croissance de leur pouvoir d'achat sur laquelle repose
pourtant une grande partie du scénario de reprise imaginé par le
gouvernement pour 1998.
2. L'impôt sur les sociétés en forte augmentation : l'effet MUFF
Le produit net de l'impôt sur les sociétés atteindrait 188,2 Milliards de francs marquant une progression de 8,7 % par rapport à 1997 et de 31,4 % par rapport à 1996.
Evolution de la part de l'impôt sur les
sociétés dans le PIB
|
1996 |
1997 |
1998 |
Ecart 1998-1996 |
|
1,82 |
2,19 |
2,22 |
+ 0,4 |
La forte augmentation des recettes provient d'abord de
l'effet
des mesures d'urgence à caractère fiscal et financier (M.U.F.F.).
Déduction faite de ceux-ci, le produit de l'impôt sur les
sociétés serait passé de 143,2 milliards de francs en
1996 à 149,6 milliards en 1997 et 171,2 milliards en 1998.
Mais, l'accroissement des recettes d'impôt sur les sociétés
provient aussi de mesures projetées en loi de finances par le
gouvernement et estimées par lui à 6,7 milliards de francs.
A législation constante, le produit net de l'impôt sur les
sociétés s'élèverait ainsi à
164,5 milliards en 1998.
La progression spontanée comprise comme celle qui concernerait le
produit de l'impôt sur les sociétés, hors les mesures
nouvelles proposées par le présent projet et adoptées dans
la loi portant mesures d'urgence à caractère fiscal et financier
serait donc de 4,5 % en 1997 et de 5,6 % en 1998.
Le total cumulé des nouveaux prélèvements nets au titre de
l'impôt sur les sociétés décidés par le
nouveau gouvernement s'élève donc à 47,2 milliards de
francs. En déduisant l'incidence sur le produit de l'impôt sur les
sociétés des mesures relatives à EDF, le total
cumulé des prélèvements supplémentaires
s'élève encore à 43,5 milliards de francs. La
répartition de ces prélèvements supplémentaires, y
compris l'imposition d'EDF, entre 1997 et 1998 serait la suivante :
. 1997 : + 24 milliards de francs ;
. 1998 : + 23,7 milliards de francs.
Le gouvernement justifie ces prélèvements supplémentaires
par un souci d'équité fiscale et la considération de leur
relative innocuité sur la croissance.
S'agissant du premier argument, qui privilégie la thèse selon
laquelle l'impôt sur les sociétés serait une alternative
crédible à l'imposition des ménages, il ne serait
recevable que si le supplément d'impôt sur les
sociétés n'était pas répercuté sur les
salaires ou sur l'emploi. Or, il semble bien que cette répercussion se
produise sur le moyen terme.
Plus marginalement, il est notable que l'alourdissement de l'imposition des
profits distribués résultant des phénomènes de
double imposition issus de l'agencement technique de la mesure devrait
dissuader la distribution de dividendes par les sociétés. Ce
phénomène devrait à son tour handicaper davantage les
titulaires de revenus relativement modestes pour lesquels le revenu
apparaît plus sensible aux dividendes qu'ils reçoivent que celui
des titulaires de revenus relativement plus importants mieux à
même de compter sur la valorisation de leurs portefeuilles.
En ce qui concerne l'effet économique du relèvement de
l'impôt sur les sociétés, le moins qu'on puisse en dire est
qu'il n'est pas favorable à la reprise de la demande intérieure
souhaitée par chacun mais dont le gouvernement assume la
responsabilité.
L'impôt sur les sociétés est d'abord, par nature,
inflationniste.
Si l'ampleur du risque est limitée par les
impératifs de la compétitivité internationale des
entreprises, il ne faut pas oublier qu'une partie des entreprises appartient au
secteur abrité de ces contraintes et sera vraisemblablement
tentée de récupérer par un comportement de marges une part
du fardeau nouveau. Les effets d'un tel phénomène pourraient
être défavorables aux ménages si l'évolution de leur
revenu devait ne pas compenser la hausse supplémentaire des prix. Ils
perdraient alors en pouvoir d'achat.
Mais, le relèvement de l'impôt sur les sociétés
est susceptible de produire d'autres effets défavorables sur les
ménages.
Si les entreprises devaient privilégier un objectif de profit net
d'impôt inchangé, elles auraient tendance à entreprendre
des gains de productivité en économisant sur la main-d'oeuvre, ce
qui aurait des effets défavorables sur l'emploi et les salaires. En
outre, alors que les revenus de la propriété occupent une place
toujours plus grande dans la formation du revenu des agents, l'effet de
dissuasion envers la distribution de dividendes pourrait se traduire par une
baisse relative de la richesse des agents et, en particulier, des
ménages.
Si les enchaînements économiques susceptibles d'advenir du fait
du surcroît de pression fiscale supporté par les
sociétés sont peu favorables pour les ménages et donc pour
la consommation, ils ne le sont pas plus s'agissant de l'investissement des
entreprises qui est pourtant au coeur de la prévision de croissance pour
1998.
L'impôt sur les sociétés est, en effet, un impôt sur
le capital qui dégrade la profitabilité de l'investissement. Il
n'est indolore, relativement, qu'à la condition que les entreprises
soient en mesure de s'endetter pour investir. Les charges d'endettement se
déduisent en effet du bénéfice des entreprises et
diminuent donc leur bénéfice fiscal, réduisant la charge
de l'impôt pour les entreprises. Mais, il se trouve
précisément que les entreprises jugent leur endettement trop
élevé et ce malgré la baisse du coût du
crédit qui, favorable à la croissance, n'est cependant pas encore
suffisante pour que les entreprises soient garanties contre un effet de boule
de neige de leur dette. Dans ces conditions, la hausse de l'impôt sur les
sociétés apparaît inappropriée d'autant qu'elle
réduit l'attractivité des entreprises françaises pour
l'épargne susceptible de venir abonder leurs fonds propres
33(
*
)
.
Les développements qui précèdent ne sont pas seulement
théoriques
. L'ampleur considérable du
prélèvement supplémentaire sur les entreprises a
d'ailleurs conduit les responsables de la direction de la prévision
à réviser à la baisse leurs estimations d'investissement
en 1998 à hauteur de 0,5 point. Cette révision, qui
s'élève à quelque 3,5 milliards de francs de
déficit d'investissement paraît très conservatrice au
regard de la surcharge imposée aux entreprises. L'avenir dira si
celle-ci n'aura pas brisé un ferment indispensable à la
croissance pour 1998 contribuant ainsi à creuser le retard
d'investissement de l'économie française susceptible d'en
handicaper, à terme, le dynamisme. Mais, en toute hypothèse,
l'insécurité fiscale que de telles mesures comportent s'ajoute
à la nocivité de leurs effets pour que soit, raisonnablement,
rendu un jugement très négatif sur elles.
C. LES IMPOTS INDIRECTS
Les impôts indirects, avec
1.077,9 milliards de
francs de recettes brutes
représentent
62,5 % du total des
recettes brutes de l'Etat.
Compte-tenu de l'importance prise par les
remboursements et dégrèvements pour ces recettes, leur part dans
les recettes fiscales nettes est un peu inférieure mais reste largement
prépondérante.
Des impôts indirects, la TVA nette constitue près des 2/3, la taxe
intérieure sur les produits pétroliers -la TIPP- en
représentant environ 16 %.
1. La taxe sur la valeur ajoutée (la TVA) en croissance nette de 2,6 %
Les recettes brutes de TVA
qui avaient
été estimées à 757,5 milliards en loi de
finances
pour 1997 s'élèveraient à 753 milliards
de francs
cette année. La révision est ainsi minime. En
revanche, la révision des recettes nettes de TVA est, elle, beaucoup
plus importante. Elle atteint 15,2 milliards de francs sous l'effet d'une
réestimation à la hausse -+ 10,7 milliards- des
remboursements de taxe.
Pour 1998, les prévisions du gouvernement évaluent les
recettes de TVA à 776,8 milliards pur les recettes brutes et
636,2 milliards de produits nets
. Elles laissent ainsi supposer une
croissance des recettes brutes de 3,2 % et des recettes nettes de
2,6 % seulement.
Hors les mesures du présent projet de loi, la TVA nette
s'accroîtrait de 2,9 %.
Les principales mesures nouvelles projetées en matière de TVA
conduisent en effet, à des pertes de recettes modérées du
fait de l'incidence sur les remboursements de TVA de l'application du taux
réduit aux travaux de réhabilitation et de rénovation des
logements sociaux.
L'indicateur des emplois taxables à la TVA étant supposé
croître de 3,4 % en 1998, la progression des recettes nettes de TVA
serait ainsi très inférieure. Cet écart s'explique
principalement par l'effet en année pleine de l'application du taux
réduit de TVA aux livraisons à soi-même et aux ventes de
logements locatifs neufs effectuées par les constructeurs sociaux
conformément à l'article 17 de la loi de finances pour 1997.
Compte tenu de cet effet, la progression spontanée des recettes de
TVA serait de 3,2 % donc très proche de celle estimée pour
les emplois taxables.
Cette estimation repose elle-même sur une croissance spontanée des
remboursements et dégrèvements de 2 % en 1998. Cette
dernière estimation paraît "a priori" plutôt favorable
compte tenu des évolutions passées -v. ci-dessus-.
Elle partage cette caractéristique avec l'hypothèse posée
d'une évolution spontanée des recettes de TVA parallèle
à celle des emplois taxables et avec les hypothèses retenues pour
évaluer la croissance de ces derniers.
En ce qui concerne cette dernière hypothèse, elle est,
rappelons-le, tributaire d'une évolution favorable du revenu des
ménages et de leur consommation qui serait presque parallèle.
Pour ce qui concerne la première de ces hypothèses, elle suppose
qu'une modification de structure de la consommation des ménages
défavorable au rendement de la TVA ne survienne pas.
2. La taxe intérieure sur les produits pétroliers (la TIPP) s'accroît de 2,9 %
Les produits de la TIPP atteindraient 154,9 milliards
de francs et s'accroîtraient de 2,9 %.
A législation constante, l'évolution du produit de la taxe serait
celle retracée dans le tableau ci-dessous.
|
Consommation
|
Quotités 1997
|
Produit
|
|
|
Supercarburant |
189.400 |
403,51 |
76.424.794 |
|
Gazole |
292.330 |
232,79 |
68.051.501 |
|
Fioul domestique |
209.210 |
50,36 |
10.535.816 |
|
Autres produits |
789.700 |
||
|
Total brut |
690.940 |
155.801.811 |
|
|
Détaxe de l'essence en Corse |
1.300 |
6,63 |
-8.619 |
|
Avantage fiscal sans plomb |
127.460 |
27,28 |
-3.477.109 |
|
Avantage fiscal biocarburants |
4.900 |
-1.256.350 |
|
|
Total net |
151.059.733 |
L'évolution des consommations que suppose cette
prévision repose sur une croissance de 1,14 % de la consommation
globale des produits pétroliers et de 1,8 % pour le fioul
domestique.
L'évolution des consommations des différents produits
taxés est rappelée dans le tableau ci-dessous :
|
Produits |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 1 |
|
Superplombé |
171,1 |
151 |
133,8 |
120,5 |
102,3 |
87,3 |
74,2 |
|
Super sans plomb |
60,3 |
77,5 |
90,4 |
100,9 |
103,2 |
111 |
119,1 |
|
Essence |
4,4 |
1,5 |
0,4 |
n.s. |
n.s. |
n.s. |
n.s. |
|
Gazole |
214,2 |
226,2 |
240,2 |
257,7 |
267,2 |
273,4 |
283 |
|
Fioul domestique |
216,5 |
205,7 |
208,4 |
197,7 |
197,3 |
203,9 |
205,5 |
|
1.Prévisions Source : Direction Générale des douanes et droits indirects |
|||||||
On peut y lire la
déformation de la structure de la
consommation de produits pétroliers et de fioul domestique.
En 1991, la consommation de supercarburant s'élevait à
34,9 % de l'ensemble, celle de gazole à 32,3 %, celle de fioul
domestique à 32,8 %. Six ans plus tard, ces proportions ont
beaucoup évolué et s'élèvent respectivement
à 28,3, 41,5 et 30,2 %.
Dans un contexte de très faible accroissement de la consommation des
produits pétroliers, 3 % en 6 ans, sous l'effet
conjugué de la baisse de la consommation de supercarburant et de fioul
domestique,
la part du gazole a progressé de 9,2 points.
Compte tenu des tarifs différenciés de la taxe appliquée
aux produits pétroliers, cette évolution a pesé sur le
dynamisme de la TIPP dont le produit n'a cru que sous l'effet de
relèvements répétés des quotités applicables.
Les prévisions pour 1998 relèvent de phénomènes
analogues. La consommation de supercarburant s'infléchirait de 2 %
tandis que celle de gazole progresserait de 3,3 %. La consommation de
fioul domestique s'accroîtrait, on l'a dit, de 1,8 % quant à
elle.
Par rapport aux tendances observées depuis 1991, le repli de la
consommation de supercarburant serait un peu moins rapide, la progression de la
consommation de gazole s'infléchirait tandis qu'une inversion de
tendance verrait la consommation de fioul augmenter. Dans ces conditions, le
produit de la taxe progresserait spontanément de 0,3 %.
C'est le relèvement de ses tarifs qui justifie la prévision du
projet de loi de finances d'une augmentation de produit de 2,9 %.
Les relèvements de tarifs proposés consistent à actualiser
les taux dans les proportions de la hausse des prix et à augmenter de
8 centimes par litre les taux appliqués aux carburants automobiles.
Sous le seul effet de cette dernière hausse, les tarifs de la TIPP
passeraient ainsi pour le litre de supercarburant de 4,03 francs à
4,11 francs et par litre de gazole de 2,33 à 2,41 francs.
L'avantage octroyé au gazole ou le handicap imposé au
supercarburant resterait stable à 1,7 franc.
II. LES RECETTES NON FISCALES
La croissance des recettes non fiscales qui atteindraient 154,7 milliards de francs s'élèveraient à 2,5 % en 1998 contre une diminution de 5,4 % de 1996 à 1997.
Evolution des recettes non fiscales
(en millions de francs)
|
1996 |
1997 1 |
1998 |
Ecarts |
|||
|
1997/1996 |
1998/1997 |
|||||
|
1 |
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
|
|
|
|
|
|
2 |
Produits et revenus du domaine de l'Etat |
979,6 |
2.020,1 |
1.914 |
X 2,1 |
- 5,2 |
|
3 |
Taxes, redevances et recettes assimilées |
23.074,5 |
24.419,2 |
25.437 |
+ 5,8 |
+ 4,2 |
|
4 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
|
|
|
|
|
|
5 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat |
|
|
|
|
|
|
6 |
Recettes provenant de l'extérieur |
1.494 |
1.499 |
1.493 |
+ 0,3 |
- 0,4 |
|
7 |
Opérations entre administrations et services publics |
|
|
|
|
|
|
8 |
Divers |
82.139,6 |
63.698,5 |
65.675,8 |
- 22,4 |
+ 3,1 |
|
TOTAL |
159.517,7 |
150.842,2 |
154.669,9 |
- 5,4 |
+ 2,5 |
|
1. Evaluations révisées.
Le projet de loi de finances est d'abord construit sur des recettes non
fiscales révisées à la baisse pour 1997. La moins-value
s'élèverait, en exécution, à 4,3 milliards de
francs. Elle n'exerce pas d'effets sensibles sur la prévision pour 1998
à l'inverse de ce qui advient pour les recettes fiscales, mais son
origine mérite d'être précisée. Elle proviendrait
des mouvements suivants :
Les recettes non fiscales seraient accrues de 757 millions de francs
sous l'effet d'une correction concernant l'imputation budgétaire de la
redevance pour occupation du domaine public versée par les
sociétés concessionnaires d'autoroutes qui, auparavant,
traitée comme fonds de concours du budget de la défense, est
désormais budgétée et rattachée en recettes aux
produits et revenus du domaine de l'Etat. Cette amélioration comptable
mérite d'être saluée, même si persiste la question de
son entière orthodoxie.
Elles seraient, en revanche, réduites de 4,6 milliards de
francs sous l'effet d'une baisse des recettes venant en atténuation des
charges de la dette, elle-même due à la dégradation des
conditions créditrices offertes à l'Etat par la Banque de France
et les opportunités de marché et d'un report sur 1998 des
paiements de France Télécom lié au changement de statut de
l'entreprise.
Progressant moins vite que le produit intérieur brut en 1998 et que les
recettes fiscales, la part des recettes non fiscales dans le PIB, mais aussi
dans le financement des dépenses de l'Etat s'infléchirait un peu.
Le tableau qui suit récapitule les variations des principales
catégories de recettes non fiscales et indique la structure de ces
recettes.
Les variations relevées traduisent un certain "existentialisme" des
recettes non fiscales dont les unes obéissent à des variables
exogènes, les autres paraissant plus sujettes au pouvoir
discrétionnaire du gouvernement.
Variations des recettes non fiscales en 1998
|
Variation en
niveau
|
Part dans le total |
|||
|
1997/1996 |
1998/1997 |
1997 |
1998 |
|
|
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
|
|
|
|
|
Produits et revenus du domaine de l'Etat |
+ 1.040,5 |
- 106,1 |
1,3 |
1,2 |
|
Taxes, redevances et recettes assimilées |
+ 1.344,7 |
+ 1.017,8 |
16,2 |
16,4 |
|
Intérêts des avances, prêts et dotations en capital |
- 848,8 |
+ 363,5 |
4 |
4,2 |
|
Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat |
+ 9.409 |
+ 696,2 |
23,6 |
23,5 |
|
Recettes provenant de l'extérieur |
+ 5 |
- 6 |
1 |
1 |
|
Opérations entre administrations et services publics |
- 0,6 |
+ 5 |
0,3 |
0,3 |
|
Divers |
- 18.441,1 |
+ 1.977,3 |
42,3 |
42,5 |
|
TOTAL |
- 8.675,5 |
+ 3.827,7 |
100 |
100 |
Quelques observations de méthode s'imposent de
façon liminaire.
L'état des recettes non fiscales de l'Etat est loin d'être
exhaustif et comporte en revanche des produits qui ne devraient pas y
être retracés.
Le recensement des recettes non fiscales n'est pas exhaustif
. Il manque en
effet au recensement opéré de comprendre l'ensemble des recettes
extra-budgétaires de nature non fiscale perçus par diverses
administrations, aux premiers rangs desquels le ministère des finances,
celui de l'agriculture et celui de l'équipement. Comme, par
définition, ces recettes ne sont pas recensées, il est impossible
d'en donner une évaluation précise. Tout au plus peut-on indiquer
que selon la Cour des comptes, le montant des recettes extra-budgétaires
des services du ministère des finances s'élevait en 1994 à
quelque 2,2 milliards de francs.
Le fascicule "Voies et moyens" ne récapitule pas davantage les
recettes
non fiscales versées aux comptes spéciaux du Trésor, ce
qui est normal puisqu'il ne concerne que le budget de l'Etat. Mais cette
situation incite, d'une part à exiger qu'un fascicule de cette nature
soit spécifiquement consacré aux comptes spéciaux du
Trésor et, d'autre part, n'excuse pas le fait que les versements en
provenance des comptes spéciaux du Trésor ne soient pas
évalués en loi de finances initiale.
Non exhaustif, le recensement des recettes non fiscales retrace pourtant
des recettes qui ne devraient pas y être évaluées.
Il en va tout particulièrement ainsi des recettes inscrites à la
ligne 309 des recettes non fiscales "Frais d'assiette et de
recouvrement
des impôts et taxes établis ou perçus au profit des
collectivités locales et de divers organismes". Les produits
accumulés sur cette ligne sont, à l'évidence, issus de
l'application de taxes dont la principale est la taxe de 4,4 % du montant
des impôts dus qui est prélevée auprès du redevable
des taxes locales. Contrairement à une idée
généralement répandue, ce prélèvement n'est
en effet en rien une redevance pour services rendus, étant
opéré sur les contribuables et non sur les collectivités
locales, sans au demeurant que son calcul permette d'établir un lien
direct de contrepartie entre les coûts d'un prétendu service et
son tarif.
Il est donc indispensable de mettre plus d'ordre dans la
présentation des recettes de l'Etat.
A. LES PRODUITS DES EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER
Avec 16,9 milliards de francs de produits attendus,
ces recettes représentent près de 11 % des ressources non
fiscales.
L'essentiel en est constitué par un prélèvement sur les
produits des jeux exploités par La Française des Jeux qui atteint
6,6 milliards de francs
, soit une stabilisation par rapport à
1997. Ces produits ont tendance à stagner. Ils s'élevaient en
1996 à 11,6 milliards de francs. L'établissement qui est
lié à l'Etat par une convention prélève une
quotité importante des mises au titre des frais de gestion. Fixée
à 6,4 % pour 1998, elle devrait représenter, selon les
hypothèses retenues, 752,7 millions de francs. Le produit
résiduel est partagé entre l'Etat et les joueurs.
Les prélèvements opérés par l'Etat sont de deux
sortes :
- le prélèvement via la taxe perçue au profit du Fonds
national de développement du sport serait accru de 108 millions de
francs sous l'effet de l'augmentation du taux de la taxe -de 2,6 %
à 2,9 %- votée par l'Assemblée nationale pour
s'inscrire à 959 millions de francs ;
- le prélèvement imputé aux recettes non fiscales qui,
lui, stagnerait, s'élevant à 6.570 millions de francs.
Au total, l'Etat bénéficierait d'une recette de
7.529 millions de francs -il faut y ajouter des produits fiscaux
divers dont l'impôt sur les sociétés-.si bien que les
enjeux distribuables aux joueurs s'élèveraient à
3.479,5 millions de francs, soit 29,6 % des mises.
Il faudrait être un spécialiste des jeux pour estimer si la part
des récompenses promises aux parieurs est susceptible d'assurer la
viabilité du système, mais il est d'emblée remarquable
d'observer que les recettes publiques issues des jeux animés par la
Française des Jeux s'élèvent à près de
68 % du produit de l'impôt sur la fortune.
La question se pose en tout cas de la pertinence du niveau de
prélèvement opéré par l'Etat et de sa
répartition entre ressources affectées et ressources
générales.
De ce dernier point de vue, il n'apparaît guère satisfaisant,
compte tenu des reports permanents et importants observés sur le compte
d'affectation spéciale de nourrir davantage une structure dont seule la
trésorerie profite des éléments de recettes
supplémentaires.
Le produit des participations de l'Etat dans des entreprises non
financières s'élèverait à 6,8 milliards de
francs,
accusant une baisse de 2,9 milliards de francs par rapport aux
évaluations initiales pour 1997 et une quasi-stabilisation
(- 203,2 millions de francs) par rapport aux évaluations
révisées pour tenir compte du changement de statut de France
Télécom qui a conduit à un report de versement de 1997
à 1998.
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières
(en millions de francs)
|
|
|
|
|
|
Prévisions révisées 1997 |
1997 : écart révisé-LFI |
|
|
|
EDF
|
665
|
965
|
1.938
|
1.500
|
1.552
|
3.050
(a)
|
-250
|
1.100
|
|
Total |
4.328 |
4.577 |
8.492 |
8.970 |
8.536,9 |
6.986,2 |
- 2.646,8 |
6.783 |
(a) EDF et GDF ont versé au budget
général un complément de dividende à l'Etat
(respectivement 2,45 milliards de francs et 0,55 milliard de francs)
au titre de l'exercice 1996, suite au règlement du contentieux entre
EDF-GDF et l'URSSAF de la Haute-Garonne.
(b) Le versement 1995 correspond aux produits des années 1993, 1994 et
1995
(c) A partir de 1998, les montants ne sont plus individualisés en
prévision de la loi de finances initiale.
(d) Dont DCI (Défense Conseil International) : 92 millions de
francs en 1995.
Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
L'évolution de ces produits est dépendante du
périmètre du secteur public, les opérations de cessions de
titres publics tendant à assécher ces recettes.
Mais elle est aussi conditionnée par les résultats des
entreprises publiques. Les prévisions pour 1998 sont, de ce point de
vue, très alarmantes.
Hors EDF-GDF et France Télécom,
la capacité du secteur industriel à rémunérer
l'Etat actionnaire apparaît quasiment nulle.
Cette prévision
qui tranche avec les hypothèses de profits retenues par ailleurs laisse
à penser que l'Etat renoncerait à exercer ses droits à
dividendes en 1998. Cette "générosité" apparaît
à vrai dire largement contrainte compte tenu de la
nécessité de laisser les entreprises reconstituer leurs fonds
propres à partir des redressements des résultats que
l'année 1997 laisse entrevoir.
Le produit des participations de l'Etat dans les entreprises
financières
progresserait de 386,2 millions de francs et
atteindrait 2.180 millions de francs. L'essentiel des recettes
proviendrait des contributions exigées de la Banque de France et de la
Caisse des dépôts et consignations. La dynamique de ces produits
est mal orientée compte tenu des privatisations opérées
ces dernières années et de la situation financière
difficile de la plupart des entreprises du secteur demeurant publiques.
B. LES TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES
Les produits s'élèveraient à
25,4 milliards de francs
en progression de 4,1 % par rapport
à 1997.
Pour 43,3 %, il s'agit des "frais d'assiette et de recouvrement des
impôts et taxes établis ou perçus au profit des
collectivités locales et de divers organismes" qui progresseraient de
près de 5 %.
L'inclusion de ces recettes dans la catégorie des recettes non fiscales
pose à l'évidence des problèmes de principe
34(
*
)
.
En tout cas, leur forte progression résulte elle-même de la
variation des produits attendus des impôts qui constituent l'assiette des
taxes d'où sont issues ces recettes.
C. LES RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ÉTAT
Leur montant s'élèverait à
36,3 milliards de francs
soit une progression de l'ordre de 2 %.
Pour l'essentiel, il s'agit des retenues pour pensions civiles et militaires
qui atteindraient 25,6 milliards de francs, soit une croissance de
1,6 % reflétant l'hypothèse posée pour calculer la
progression de la masse salariale dans la fonction publique.
L'accroissement de la contribution aux charges de pension de France
Télécom serait plus rapide (2,9 %), soit un écart
significatif compte tenu de l'homogénéité des statuts des
agents.
D. LES RECETTES DIVERSES
Avec 65,7 milliards de francs, les recettes
diverses
qui constituent une part considérable des recettes non
fiscales (42,5 %), s'accroîtraient de 3,1 % par rapport aux
estimations révisées pour 1997 mais diminueraient par rapport aux
évaluations initiales pour l'année en cours (- 1,6 %).
Par ordre d'importance, figurent d'abord
les recettes en atténuation
des charges de la dette et des frais de trésorerie
avec
13,8 milliards de francs. Elles seraient très inférieures
aux estimations faites en loi de finances initiale pour 1997
(17,98 milliards de francs) et proches des estimations
révisées (13,4 milliards de francs).
Evaluations pour 1998
(en milliards de francs)
|
Rémunération du compte
du Trésor à
la Banque de France et des pensions sur titres d'Etat
|
1.393
|
|
Total |
13.813 |
Les prévisions pour 1998 sont résumées
dans le tableau ci-dessus.
La rémunération du compte du Trésor à la Banque de
France et résultant des prises en pensions sur titres d'Etat procurerait
1.393 millions de francs. En 1996, ce montant s'était
élevé à 2.742 millions de francs. Cette variation
à la baisse résulte de la diminution du niveau de la
rémunération obtenue par le Trésor sur ses
opérations de trésorerie liée elle-même à la
baisse des taux d'intérêt à court terme. L'augmentation de
6 % du taux des appels d'offres de la Banque de France acquise en
octobre 1997 pourrait conduire à une progression de cette
ressource, très sensible à l'évolution de la
trésorerie de l'Etat. A ce propos, on rappelle l'importance de
l'incidence des recettes disponibles logées dans les différents
comptes spéciaux du Trésor et, en particulier, dans le
compte 902-24.
Les recettes de coupons courus
sont également
comptabilisées ici. Leur importance dépend du programme
d'émission de l'Etat, mais aussi du choix opéré par lui,
du taux nominal de ses emprunts. La part relative des recettes sur les
différentes échéances est un indicateur de la duration de
la dette publique nouvellement émise.
Les versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale
(12 milliards de francs) -la CADES- sont issus de l'ordonnance de janvier
1996 mettant à la charge de la Caisse le remboursement à l'Etat
des charges (amortissement et intérêts) de la dette du Fonds de
solidarité vieillesse (FSV) transférée à lui.
Or, l'Etat ne dépense dans son budget que les charges
d'intérêt liées à cette dette. La Cour des Comptes
a, de façon récurrente, indiqué que les charges
d'amortissement de cette dette n'étaient pas subies par le budget,
faisant l'objet d'opérations financières extrabudgétaires.
Le rattachement de l'intégralité du versement de la CADES au
titre des recettes non fiscales de l'Etat a donc pour effet de minorer le
déficit budgétaire affiché. Il surestime en effet la
compensation budgétaire des charges budgétaires associées
à l'opération de reprise de dette décrite plus haut.
Il conviendrait donc que soit déduite du versement sous revue la part
représentative de l'amortissement du capital de cette dette et de ne
verser au budget de l'Etat que la somme correspondant aux dépenses
d'intérêt qui sont les seules qu'il supporte.
CHAPITRE V
LA NON-MAÎTRISE DES
DÉPENSES EN 1998
La présentation du projet de loi de finances pour 1998
par le gouvernement laisse entendre que toutes les actions nouvelles ont
été financées par redéploiements : en effet la
progression des dépenses est limitée au total à
21,3 milliards de francs, ce qui correspond à l'augmentation
inéluctable des charges de personnel (+ 19,1 milliards de
francs), et de la dette (+ 2,2 milliards de francs).
En fait, le tableau ci-dessous montre la
sagesse très relative
de
ce projet de loi de finances pour 1998 en termes de dépenses.
Les dépenses pour 1998
Tableau de bord simplifié
|
- croissance continue des
dépenses de personnel
|
+ 3,3 %
|
Titre III
|
|
- interventions économiques
(169,5 milliards)
|
- 0,9 %
|
Titre IV
|
|
- dépenses civiles en capital
|
- 0,4 %
|
Titres V et VI
|
|
- dépenses ordinaires militaires |
+ 1,7 % |
I. UN EFFORT D'ÉCONOMIE ?
A. LES DEUX APPROCHES POSSIBLES
1. La présentation en ratio de PIB pour marquer l'absence d'économie
Le gouvernement illustre de deux manières
différentes
l'effort d'économies
réalisé
dans le projet de loi de finances pour 1998.
- D'un point de vue macro-économique, l'effort de maîtrise des
dépenses est présenté par rapport au poids des
dépenses de l'Etat dans le PIB. Les dépenses du budget
général (nettes des recettes d'ordre) s'élevaient à
1.564 milliards de francs en loi de finances initiale 1997. Si la part des
charges nettes de l'Etat dans le PIB était restée constante, les
charges nettes auraient augmenté de 4,2 %, soit
+ 65,7 milliards de francs. Cette augmentation étant
limitée à 21 milliards de francs en projet de loi de
finances pour 1998, l'écart s'établit à
44,7 milliards de francs.
La croissance du PIB passant (en volume) de 2,3 à 3 %, on aurait pu
en inférer une amélioration automatique du solde
budgétaire grâce à de meilleures rentrées fiscales
et à de moindres dépenses. L'année n, une croissance
de 1 point de PIB engendrée par l'exportation offre une
amélioration du solde de 0,1 point ; une croissance de
1 point de PIB liée à la consommation des ménages se
traduit par une amélioration de 0,2 point de PIB.
Dans ces conditions, la présentation macroéconomique de la
maîtrise des dépenses (à hauteur de 44,7 milliards de
francs) apparaît surestimée.
2. Une augmentation de 60 milliards de francs des services votés
L'appréciation des économies doit se faire
à la lumière de la construction du budget en services
votés
35(
*
)
et mesures nouvelles.
Pour 1997, les dépenses du budget général
s'établissent comme suit (en milliards de francs) :
|
|
|
|
|
|
|
|
1.720 (services votés) |
|
|
(dépenses du budget général) |
(remboursements et dégrèvements) |
(recettes en atté-nuation de dépenses) |
(crédits votés) |
110,4 (mesures nouvelles) |
Pour 1998, l'égalité se décompose comme
suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
1.780 (services votés) |
|
|
(dépenses du budget général) |
(remboursements et dégrèvements) |
(recettes en atté-nuation de dépenses) |
(crédits votés) |
96,4 (mesures nouvelles) |
L'accroissement de 21,3 milliards de francs des
dépenses du budget
général résulte donc d'une
augmentation
de 60,1 milliards de francs des services votés
corrigée des variations en mesures nouvelles (- 14), en
remboursements et dégrèvements (- 29,1) et en recettes en
atténuation de dépenses (+ 4,1).Il convient ensuite de tenir
compte des mesures acquises (- 50,1 milliards).
Selon les calculs du gouvernement, cette progression de 21,3 milliards de
francs tient compte, en fait, de
27,24 milliards de francs
d'économies. Selon les mêmes conventions, le montant
d'économies était de 64 milliards de francs pour 1997
(dont 29,2 au titre de la révision des services votés).
B. LES CHOIX DE RÉDUCTION DE DÉPENSES EN 1998
Economies budgétaires dans le projet de loi de finances pour 1998
(en millions de francs)
|
SECTIONS |
Révision des services votés |
Autres économies |
Economies sur les dépenses en capital |
Total des économies |
|
Affaires étrangères et coopération : |
||||
|
I.- Affaires étrangères |
456 |
456,4 |
||
|
II.- Coopération |
428 |
50 |
477,5 |
|
|
Agriculture et pêche |
327 |
27 |
354,5 |
|
|
Aménagement du territoire et environnement : |
||||
|
I.- Aménagement du territoire |
19 |
18,6 |
||
|
II.- Environnement |
10 |
22 |
32 |
|
|
Anciens combattants |
414 |
64 |
477,8 |
|
|
Culture et communication |
660 |
660,1 |
||
|
Economie, finances et industrie : |
||||
|
I.- Charges communes (crédits nets) |
6.500 |
600 |
7.100 |
|
|
II.- Services financiers |
342 |
341,6 |
||
|
III.- Industrie |
19 |
87 |
105,8 |
|
|
IV.- Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat |
22 |
22,3 |
||
|
Education nationale, recherche et technologie : |
||||
|
I.- Enseignement scolaire |
464 |
463,9 |
||
|
II.- Enseignement supérieur |
64 |
64,2 |
||
|
III.- Recherche et technologie (voir BCRD) |
||||
|
Emploi et solidarité : |
||||
|
I.- Emploi |
1.310 |
1.309,9 |
||
|
II.- Santé, solidarité et ville |
335 |
802 |
316 |
1.452,9 |
|
Equipement, transports et logement : |
||||
|
I.- Urbanisme et services communs |
143 |
142,8 |
||
|
II.- Transports : |
||||
|
1. Transports terrestres |
||||
|
2. Routes |
1 |
1 |
||
|
3. Sécurité routière |
||||
|
4. Transport aérien |
||||
|
5. Météorologie |
11 |
10,9 |
||
|
III.- Logement |
1.004 |
260 |
1.264,4 |
|
|
IV.- Mer |
24 |
26 |
49,8 |
|
|
V.- Tourisme |
22 |
21,6 |
||
|
Intérieur et décentralisation |
174 |
25 |
199,5 |
|
|
Jeunesse et sports |
278 |
278,1 |
||
|
Justice |
13 |
23 |
36,1 |
|
|
Outre-mer |
290 |
52 |
342,8 |
|
|
Services du Premier ministre : |
||||
|
I.- Services généraux |
145,5 |
0,2 |
145,7 |
|
|
II.- Secrétariat général de la défense nationale |
9 |
5 |
14 |
|
|
III.- Conseil économique et social |
||||
|
IV.- Plan |
3 |
3 |
||
|
Budget civil de recherche de développement |
169 |
18 |
422 |
609,3 |
|
Total des budgets civils |
13.658 |
1.619 |
1.180 |
16.456,7 |
|
Défense |
2.958 |
100 |
7.705 |
10.763,2 |
|
TOTAL DU BUDGET GENERAL |
16.616 |
1.719 |
8.885 |
27.242,8 |
Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Le gouvernement comptabilise l'essentiel de ses
économies : 16,6 milliards de francs sur un total de
27,2 milliards de francs, en "révision des services votés",
le solde étant dû pour l'essentiel (7,7 milliards de francs)
aux réductions de dépenses en capital du budget de la
défense.
L'expression "révision des services votés" s'applique aux
réductions de crédits résultant de décisions
volontaires, par opposition aux autres économies qui relèvent de
constatation.
1. La révision des services votés répartie entre trois budgets
La moitié de l'effort de révision des services votés se répartit entre trois budgets et représente bien la traduction de choix politiques.
a) Au budget des charges communes : un ralentissement de la politique d'allégement de charges sur les bas salaires
La diminution de crédits de 6,5 milliards de
francs apparaissant au budget des charges communes est la résultante de
trois décisions proposées dans l'article 66 du projet de loi
de finances :
- une économie de 4 milliards de francs est liée à la
suppression de l'avantage procuré au temps partiel par la
non-proratisation de la ristourne dégressive de charges sur les bas
salaires ;
- une économie de 2,1 milliards de francs est liée à
l'abaissement du plafond des salaires concernés par la ristourne
dégressive, de 1,33 à 1,3 SMIC ;
- enfin, une économie de 400 millions de francs est procurée
par le gel, en 1998, du montant du SMIC servant de base au niveau atteint en
1997.
b) Au budget de l'emploi : des suppressions de mesures pourtant majoritairement ciblées au bénéfice de l'emploi privé
Sur un total de 1,31 milliard de francs de
révision des services votés :
- une économie de 243 millions de francs apparaît du fait de
la suppression de l'exonération en faveur des travailleurs
indépendants créant ou reprenant une activité ("loi
Madelin"), proposée par l'article 66 du projet de loi de
finances ;
- une économie de 183,3 millions de francs apparaît du fait
de la suppression des emplois-ville proposée à l 'article 64
du projet de loi de finances ;
- en revanche, une économie de 400 millions de francs est
liée à un prélèvement sur la trésorerie des
fonds pour l'alternance afin de contribuer au financement des primes pour
l'apprentissage : il s'agit là d'une opération de technique
budgétaire sans support législatif.
c) Au budget du logement : une restriction de l'aide à l'accès à la propriété
La révision des services votés porte sur un
milliard de francs répartis entre :
- 500 millions de francs justifiés par des "mesures de
rationalisation et d'économie" portant sur les aides personnelles au
logement. Votre rapporteur a maintes fois dénoncé le
caractère illusoire de cette économie, introduite depuis
plusieurs exercices budgétaires dans les projets de loi de finances, et
toujours suivie d'abondements en cours d'année (décrets d'avance
ou collectifs). Une fois encore, l'affichage de cette économie n'est
associée d'aucune mesure concrète de rationalisation de l'APL,
alors que cette rationalisation serait indispensable ;
- 500 millions de francs transférés au Fonds pour le
financement de l'accession à la propriété : ce
transfert est présenté comme une véritable
économie, car 500 millions de francs d'économies sont
réalisées par ailleurs sur ce Fonds, avec la restriction de
l'accès au prêt à taux zéro aux seuls
primo-accédants à la propriété (décret du
30 octobre 1997).
Au total, près de la moitié de l'effort d'économies
affiché par le gouvernement répond à des orientations tout
à fait contestables :
freinage de l'allégement des
charges sociales sur les bas salaires, suppression des exonérations pour
les travailleurs indépendants reprenant ou créant une entreprise,
suppression des emplois-jeunes, absence de rationalisation des aides
personnelles au logement, restriction des conditions d'accès au
prêt à taux zéro pour les acquéreurs de logement...
2. Les "autres économies"
Les économies considérées comme
"constatées" s'élèvent à 1,6 milliard de
francs et appellent peu de commentaires. Il s'agit essentiellement :
- au budget des charges communes, de la diminution des crédits de
rachats de cotisations à l'assurance volontaire vieillesse :
- 450 millions de francs ; il s'agit d'une économie de
constatation d'une baisse des flux de rapatriés concernés par la
loi du 4 décembre 1985 ;
- au budget de la santé, de la diminution de la subvention au Fonds
spécial de retraites de la Caisse autonome de sécurité
sociale dans les mines : - 779 millions de francs.
3. Les économies sur le budget de la défense : une révision lourde de conséquences
Le projet de budget de la défense marque une diminution
des crédits d'équipement de 7,7 milliards de francs par
rapport aux prévisions de la programmation 1997-2002 ; celle-ci
était déjà en retrait de 20 % sur les crédits
prévus par la précédente programmation 1995-2000.
Si l'on ajoute une amputation de 3,7 milliards de francs sur la gestion
1997, ce sont presque 12 milliards de francs qui manqueront sur les deux
premières annuités de la programmation, si tant est que le budget
de 1998 ne connaisse ni "gel", ni annulation de crédits.
Or la programmation qui doit conduire jusqu'aux premières années
du siècle prochain repose sur un équilibre fragile (que
confortait, il est vrai, un engagement exprès du chef de l'État
quant au strict respect de ses annuités budgétaires). La
réduction significative des crédits d'équipement par
rapport aux prévisions précédentes trouvait, en effet, sa
contrepartie dans des gains significatifs de productivité -devant
atteindre 30 % sur 6 ans- des industries de l'armement,
assurées pour plusieurs années de commandes et de livraisons
stables ; les armées, pour leur part, subissaient une
réduction quantitative de leurs équipements mais moindre que la
réduction des effectifs, appelés, au total, à être
mieux équipés.
Cet équilibre est d'ores et déjà rompu.
Présenté comme une simple "encoche" dans la programmation, le
budget en projet annonce ainsi, en réalité, une nouvelle
réduction programmée des ressources de la Défense,
réduction qui doit préparer une "revue de programmes" d'ores et
déjà entamée.
L'on sait que toutes les "revues" précédentes ont conduit en fait
à des réductions de "cibles" et à des étalements
dans le temps. Apportant un soulagement financier immédiat, ces
pratiques accroissent, à terme, les prix des programmes par les
surcoûts qu'ils provoquent. Ils contribuent à grossir la "bosse"
des engagements financiers sans cesse reculés mais inexorablement accrus
par ces expédients.
Les restes à financer sur les programmes en cours s'élevaient au
début de l'année à plus de 500 milliards de francs,
les ¾ de ce montant allant à cinq programmes arrivés en
phase de production (avion de combat RAFALE, SNLE-NG, char LECLERC,
porte-avions nucléaire, hélicoptère TIGRE). Compte tenu du
financement d'autres opérations programmées (entretien,
infrastructures, études amont etc.) la part réservée aux
programmes, environ 40 % des dotations annuelles, selon les estimations de
la Cour des Comptes, correspond à quinze années au moins de
crédits.
L'équation financière des prochains budgets militaires est donc
simple à poser mais elle ne peut être résolue qu'en
modifiant substantiellement l'un de ses termes ; en majorant
significativement les crédits d'équipement ou en abandonnant des
programmes dont le financement a déjà mobilisé plusieurs
dizaines de milliards de francs. Mais ces abandons en amoindrissant les
capacités, industrielles et opérationnelles, nécessiteront
inéluctablement une révision des stratégies lourde de
conséquences.
II. QUELLES PRIORITÉS BUDGÉTAIRES ?
Le projet de loi de finances définit de la
manière suivante les priorités budgétaires pour 1998 :
"
Les priorités du gouvernement se traduisent par la progression
des dépenses en faveur de l'emploi et de celles relatives aux missions
régaliennes et aux investissements.
"La priorité accordée à l'emploi se traduit par une
croissance de 6,5 milliards de francs de crédits de la politique de
l'emploi (y compris crédits inscrits à ce titre aux charges
communes). Le programme en faveur de l'emploi des jeunes (8 milliards de
francs) s'accompagne du maintien des dispositifs destinés aux personnes
qui connaissent des difficultés particulières d'insertion et de
la recherche d'une plus grande efficacité des aides à l'emploi.
"Les autres priorités du gouvernement se traduisent, hors charges de
personnel, par une progression de 1,1 milliard de francs des
dépenses en faveur de
missions prioritaires (éducation
nationale, justice, culture)
. Les dépenses du budget civil de
recherche et développement
progressent par ailleurs de
3,1 milliards de francs, y compris dépenses de personnel.
"Les dépenses de
solidarité
sont en augmentation de
3 milliards de francs (minima sociaux et action sociale) et les
dépenses en faveur de la
coopération internationale
progresseront de 1,1 milliard de francs.
"Enfin, les dépenses d'
équipement et de logement
augmentent de 1,1 milliard de francs. Compte tenu de ces décisions
et de celles affectant les autres budgets civils, les investissements civils de
l'Etat progressent de 5,6 % en autorisations de programme et de 2,4 %
en crédits de paiement par rapport à la loi de finances initiale
pour 1997 (hors dotations en capital et reconstitution de fonds
internationaux)."
A. DES PRIORITÉS SECTORIELLES CONSISTANT EN DES MOYENS SUPPLÉMENTAIRES EN PERSONNEL
La lecture des documents budgétaires ne permet pas de
retrouver les chiffres dont le gouvernement assortit ses
priorités : en effet, ces chiffres sont issus de retraitements
comptables reposant sur des conventions internes au ministère de
l'économie. Il semble toutefois que ces priorités comportent dans
les faits :
- la simple reconduction de progressions quasi-automatique telles que celles du
RMI (+ 1,1 milliard de francs), de l'allocation aux adultes
handicapés (+ 1,13 milliard de francs), des aides personnelles
au logement (+ 2,9 milliards de francs), ou de l'aide juridique ;
- quelques actions plus volontaristes, telles qu'une progression de
180 millions de francs des diverses interventions culturelles, ou de
100 millions de francs au soutien à la recherche.
En réalité,
l'essentiel des priorités
budgétaires consiste en une progression des moyens en personnel
, que
ceux-ci apparaissent directement, ou à travers les subventions de
fonctionnement des établissements publics.
B. UNE PRIORITÉ INQUIÉTANTE DONNÉE À L'EMPLOI PUBLIC
Face à l'ampleur de la progression spontanée des dépenses de fonction publique, le gouvernement n'a pas fait le choix de la maîtrise : au contraire, le projet de loi de finances pour 1998 affiche la priorité redonnée à l'emploi public.
1. Une progression importante des dépenses de fonction publique
L'augmentation de 20 milliards de francs de la
dépense "induite" de fonction publique
36(
*
)
montre l'ampleur de la progression spontanée
de cette dépense (sous réserve d'une augmentation de
3,6 milliards de francs destinée à financer la
négociation avec les syndicats de la fonction publique, seule mesure
"volontariste" pour 1998).
|
Effets en Milliards de francs |
PLF 98 |
LFI 97 |
Effectifs |
Point |
Catégoriel |
GVT |
Autres(1) |
|
Rémunérations |
7,0 |
- |
1,4 |
||||
|
- civils |
5,8 |
||||||
|
- Défense |
1,2 |
2,3 |
4 |
1 |
|||
|
Cotisations et prestations |
2,3 |
- |
0,6 |
||||
|
- civils |
1,4 |
0,5 |
|||||
|
- défense |
1,0 |
0,1 |
|||||
|
Pensions |
6,5 |
3,2 |
1,4 |
1,1 |
0,8 |
||
|
- civils |
5,8 |
3,3 |
1 |
0,7 |
0,8 |
||
|
- Défense |
0,7 |
- 0,1 |
0,4 |
0,4 |
|||
|
Enseignement privé |
1,1 |
0,4 |
0,7 |
||||
|
Anciens combattants |
- 0,5 |
- 0,7 |
0,2 |
||||
|
Frais de déplacements |
|||||||
|
Autres (2) |
3,6 |
3,6 |
|||||
|
Total |
20,0 |
2,5 |
4,0 |
8,1 |
5,4 |
||
2. Une priorité donnée à nouveau à l'emploi public
a) Le mouvement stoppé de réduction des effectifs de la fonction publique
Le gouvernement a décidé de stopper le mouvement
de réduction des effectifs de la fonction publique amorcé l'an
dernier : 5.599 emplois civils étaient en effet
supprimés au total (résultant de 9.283 suppressions et
3.684 créations) dans la loi de finances pour 1997.
En 1998, le solde des créations et suppressions d'emplois civils
redevient positif, de 490 unités (solde de 7.337 suppressions
et 7.827 créations).
L'essentiel des créations concerne l'éducation nationale : +
1.320, et surtout l'enseignement supérieur : + 4.194.
b) L'emploi dans les établissements publics : un mouvement important de créations
L'évolution des effectifs budgétaires ne retrace
pas la totalité de l'évolution des emplois financés par le
budget de l'Etat.
En effet, les emplois des établissements publics n'apparaissent
qu'à travers leurs subventions de fonctionnement.
A cet égard, le projet de loi de finances pour 1998 consacre un
mouvement important de créations d'emplois : ainsi, au budget de la
recherche, apparaît la traduction budgétaire de la création
de 379 emplois de chercheurs, et de 176 emplois d'ingénieurs,
de techniciens et administratifs, la dépense correspondante étant
d'environ 200 millions de francs.
c) Les emplois-jeunes : une réponse d'urgence, mais de court terme
L'augmentation des moyens pour l'emploi en 1998 résulte
en tout premier lieu des
emplois-jeunes
, créés par la loi
du 16 octobre 1997, préfinancés à hauteur de
2 milliards de francs par un décret d'avances du 15 juillet
1997, ces emplois mobilisent 8,05 milliards de francs au budget de
l'emploi en 1998, et 300 millions de francs au budget de l'outre-mer, pour
un nombre de bénéficiaires prévu de 150.000 à la
fin de l'année prochaine.
Ces emplois, s'ils représentent une réponse d'urgence pour des
milliers de jeunes, s'assimilent à des emplois publics -c'est le cas
pour les 40.000 emplois jeunes qui seront financés à
100 % par le budget de l'emploi dans le secteur de l'éducation
nationale- ou quasi publics : ils donnent lieu en effet à une prise
en charge de l'Etat sur la base de 80 % du SMIC avec charges sociales.
Comment ne pas imaginer que cette prise en charge, même pour cinq ans,
débouchera sur une intégration dans la fonction publique ?
Cette réponse de court terme va donc à l'encontre de la
démarche constamment préconisée par votre commission des
finances d'encouragement à l'emploi par les entreprises, et ce d'autant
plus que les emplois-jeunes sont, budgétairement, "gagés" par le
freinage de l'allégement des charges sur les bas salaires.
Des coûts associés aux recrutements d'agents publics
Les coûts de création directe d'emplois publics
ont été appréhendés à partir d'un exercice
de variante réalisé à la demande de la commission des
finances du Sénat par l'OFCE.
Il s'est agi de tester l'impact sur les finances publiques de la
création de 350.000 emplois publics réalisés en trois
ans. Au terme des recrutements, le coût budgétaire direct de la
mesure s'élève à 47,5 milliards de francs, soit
74,5 milliards de francs de traitements supplémentaires desquels il
faut déduire un montant de 27 milliards de francs de cotisations
sociales acquittées par les nouveaux employés. Il est remarquable
que
les coûts de cette mesure seraient deux fois plus
élevés que ceux associés, selon les simulations
disponibles, à la mesure concernant les emplois des jeunes
récemment adoptée et qui constitue, selon toute vraisemblance, un
prélude à des créations d'emplois publics.
On doit aussi souligner que les effets indirects sur les finances publiques de
la mesure ici testée viennent réduire son coût direct.
Cependant, la capacité de financement des administrations publiques se
trouve dégradée de 53,5 milliards de francs au terme des
trois années de montée en charge des recrutements.
Enfin, la réduction du chômage n'est que de
240.000 unités, alors que le nombre des nouveaux emplois
s'élève à 350.000. Une flexion des taux d'activité
se produit en effet qui accroît la population se présentant sur le
marché du travail et nuit à l'efficacité de la mesure sur
le niveau de chômage. Celle-ci serait encore moins favorable si la mesure
devait être équilibrée financièrement. A titre
d'exemple, une baisse à due concurrence de l'investissement public
supprimerait plus de 50.000 emplois du secteur marchand selon les
estimations des experts.
d) La revalorisation salariale : une provision de 3,575 milliards de francs
Enfin, une provision de 3 milliards de francs au budget des charges communes, de 0,575 milliard de francs au budget de la défense, est prévue, afin d'accompagner les négociations salariales entamées au mois d'octobre avec les syndicats de la fonction publique, les revendications des syndicats portant notamment sur un "rattrapage" du gel du point qui avait été opéré en 1996.
III. ALLER PLUS LOIN DANS LA MAÎTRISE DES DEPENSES PUBLIQUES
A. STOPPER TOUTE PROGRESSION DES DÉPENSES DU BUDGET GÉNÉRAL
Votre rapporteur général considère que le
projet de loi de finances pour 1998 ne comporte pas de réel effort de
maîtrise des dépenses : les charges de personnel progressent de
20 milliards de francs (1 milliard de francs d'économies
étant d'ailleurs permises par les suppressions d'emploi
opérées en 1997), la charge de la dette ne progresse "que" de
2 milliards grâce à la seule baisse des taux
d'intérêt.
Cette progression des dépenses en 1998 n'est plus
défendable
37(
*
)
dans un contexte
où le niveau des prélèvements obligatoires --45,9 %
du PIB- doit diminuer, et où le solde budgétaire doit être
contenu.
C'est pourquoi votre rapporteur général vous proposera, lors de
l'examen de l'article d'équilibre de la loi de finances, de ramener le
montant des dépenses du budget général à celui de
la loi de finances initiale pour 1997 en francs courants, et d'opérer,
par voie de conséquence, une réduction de dépenses de
21,3 milliards de francs.
B. DES RÉDUCTIONS CIBLÉES ET FORFAITAIRES
Afin d'atteindre ce montant d'économies, votre
rapporteur général vous proposera d'adopter deux démarches
complémentaires :
Des économies ciblées sur certains budgets, correspondant
à des décisions politiques :
- ainsi,
au budget des charges communes
, qui rassemble 675 millions
de francs de dépenses, soit 42,6 % du total des dépenses du
budget général, en progression de 3,7 % en 1998, des
réductions de crédits concernant la politique de la fonction
publique, le passage à la semaine des 35 heures, ou la prime
d'épargne logement. Dans ce dernier cas, il s'agit d'attirer l'attention
du gouvernement sur le dévoiement d'un dispositif qui coût de plus
en plus cher à l'Etat à mesure qu'il s'éloigne de son
objectif, l'encouragement à la construction de logements ;
- au
budget de l'emploi
(112,6 millions de francs en 1998, soit
+ 9,3 %), des réductions de crédits concernant les
dépenses nouvelles de créations d'emplois publics aux
dépens du soutien à l'emploi privé ;
- au
budget de l'enseignement scolaire
(286 millions de francs en
1998, soit + 3,1 %), des réductions de dépenses
permettant un resserrement raisonnable des effectifs.
Par ailleurs, sur les autres budgets affichant des progressions de
dépenses, des réductions de crédits forfaitaires seront
proposées, portant exclusivement sur les dépenses ordinaires,
les dépenses en capital devant être
préservées pour l'avenir
, et subissant déjà
une diminution sérieuse en 1998.
C. PERMETTRE UN ALLÉGEMENT DES PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES
Cet effort d'ajustement des dépenses, ainsi calibré, doit permettre une poursuite de la politique d'allégement d'impôt sur le revenu amorcée en 1997 : cette réforme ne trouvait sa cohérence que dans son déroulement pluriannuel, et devait permettre à terme une baisse significative de l'impôt sur le revenu, d'autant plus forte que les revenus étaient modestes et le nombre de parts élevé.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mardi 4 novembre 1997 sous la
présidence de M. Christian Poncelet, président, la
commission la commission a procédé à l'examen des
principaux éléments de l'équilibre du projet de loi de
finances pour 1998, sur le rapport de M. Alain Lambert, rapporteur
général.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a tout d'abord
présenté l'environnement macro-économique dans lequel
s'inscrivait ce budget. Il a souligné que le "consensus", qui
régnait encore au début de l'été, commençait
à s'effriter, et que l'hypothèse de 3 % de croissance en 1998
tendait plus à relever du "volontarisme" que du "réalisme",
tant
les aléas s'étaient accumulés, liés à des
phénomènes externes ou aux mesures de politique économique
prises ou envisagées par le Gouvernement.
Dans ces conditions, il apparaît que le pari du budget de 1998, celui
d'une relève des exportations par la consommation et l'investissement,
n'est pas gagné d'avance. En effet, pour atteindre le taux de croissance
affiché, l'investissement des entreprises doit s'accroître de plus
de 4 %. Plusieurs indices économiques militent incontestablement en ce
sens, mais l'investissement exige un cadre fiscal et institutionnel stable et
prévisible qui semble compromis par les effets conjoints du
prélèvement fiscal supplémentaire, des incertitudes sur le
passage aux 35 heures, de la baisse de la ristourne dégressive sur les
bas salaires et de l'absence de maîtrise effective des dépenses
publiques.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a estimé
également que des craintes sérieuses pouvaient être
émises sur le partage du revenu entre l'épargne et la
consommation, sans parler de l'inquiétude croissante manifestée
par les Français sur l'avenir de leurs retraites et qu'au total, cette
sensibilité rendait fragile l'objectif d'un solde budgétaire
fixé à 3,05 % du produit intérieur brut qui est pourtant
le garant de notre crédibilité vis-à-vis de nos principaux
partenaires. Or, cette crédibilité est déjà
relative dans la mesure où la France occupe, au regard du critère
du déficit public, l'avant-dernier rang parmi les pays de l'Union
européenne.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a rappelé
l'intérêt pour l'Etat de respecter le critère de
plafonnement à 3 % du PIB pour les déficits publics : en
effet, 3 % du PIB représentent 16 % des dépenses de l'Etat, ce
qui revient à dépenser 16 % de plus que ce qu'il est possible de
prélever sur les contribuables ; c'est aussi un solde qui, pour
simplement stabiliser la dette de l'Etat, devrait être
amélioré de 98,7 milliards de francs ; enfin, c'est un niveau de
déficit qui aboutira encore à accroître le stock de la
dette de 257 milliards de francs en 1998.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a souligné que ces
indications confirmaient qu'au-delà du respect de nos engagements
européens, la réduction du déficit était une
nécessité incontournable, et un impératif absolu qui
devait être partagé par toute la Nation et rassembler toutes les
sensibilités politiques républicaines.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a ensuite estimé que
les dépenses de l'Etat n'apparaissaient pas maîtrisées : en
effet, la croissance des charges réelles sera supérieure en 1998
à celle prévue pour l'année en cours (+ 1,87 % pour les
charges réelles contre + 0,81 % dans le projet de loi de finances pour
1997), et ce alors même que le surcroît de croissance prévu
devrait donner une marge de manoeuvre supplémentaire.
Cette augmentation de 21,3 milliards de francs correspond, au franc
près, aux conséquences des dérives spontanées des
frais de personnel (+ 19 milliards) et de la charge de la dette (+ 2,2
milliards).
Face à ce constat, M. Alain Lambert, rapporteur général, a
rappelé que la préconisation constante de la commission de mener
à bien une remise en ordre des finances publiques n'était pas
reprise par ce projet de budget.
En effet, alors même que la commission avait salué la diminution
des effectifs opérée par la loi de finances pour 1997, le projet
de budget pour 1998 se caractérisait par un nouveau renversement de
tendance en créant 6.500 emplois nouveaux, dont 490 au titre des budgets
civils. Cette nouvelle pression sur la dépense s'accroîtra en
outre considérablement à terme, tant par la création
annoncée de 350.000 emplois-jeunes que par le refus de réexaminer
les régimes spéciaux de retraite. Dans ces conditions, il est
à redouter qu'à l'instar des années 80, le Gouvernement
recrée les conditions d'un emballement de la dépense publique. En
effet, les crédits civils de rémunérations et charges
sociales se sont accrus de près de 120 milliards de francs entre 1987 et
1996, les retraites totales augmentant, elles, de 56 milliards sur la
période (soit + 52 % environ).
De la même manière, M. Alain Lambert, rapporteur
général, a estimé que les transferts sociaux
n'étaient toujours pas sous contrôle, comme en témoignent
les crédits consacrés au revenu minimum d'insertion, à
l'allocation pour adultes handicapés et aux aides personnelles au
logement, qui continuent de s'accroître sensiblement (de 5 milliards de
francs en 1998), portant ainsi leur augmentation, depuis 1992, à
près de 70 %.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a souligné que,
dès lors que l'ajustement ne s'opérait ni sur les frais de
personnel, ni sur les transferts sociaux, c'était l'investissement,
notamment militaire, qui devenait la variable d'ajustement et continuait
d'être amputé de 8 milliards de francs en 1998. Le rapporteur
général a souligné également que la politique
d'allégement du coût du travail peu qualifié était
sérieusement infléchie (de - 6,5 milliards de francs) et que les
économies présentées comme telles n'étaient en fait
que des jeux d'écriture, par le truchement de transferts de
dépenses vers les comptes spéciaux du Trésor, de
prélèvements sur diverses trésoreries, de prises en charge
de dépenses de compensation démographique par le régime
général...
M. Alain Lambert, rapporteur général, a estimé qu'au
total, il n'y avait pas de véritable maîtrise des dépenses.
Il a insisté par ailleurs sur le fait qu'un certain nombre d'actions
annoncées n'étaient pas budgétées, en tout ou
partie, telles que la prise en charge de 20 milliards de francs de dette de la
SNCF, le financement du nouveau plan textile, le financement de la future loi
sur l'exclusion, de la loi d'orientation agricole, des conséquences du
passage aux 35 heures.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a estimé que la
commission ne pouvait adhérer à ces choix qui vont à
l'encontre de ses conclusions constantes, sans cesse réaffirmées
depuis 1992 : aussi, a-t-il annoncé qu'il recommanderait de proposer au
Sénat de marquer, sans ambiguïté, sa volonté et sa
constance dans la voie de la maîtrise des dépenses et d'inscrire
l'oeuvre de redressement dans la durée en ramenant le montant des
dépenses du budget général à celui de la loi de
finances initiale pour 1997 et en opérant, par voie de
conséquence, une réduction de dépenses de 21,3 milliards
de francs.
Afin d'atteindre ce montant d'économies, M. Alain Lambert, rapporteur
général, a estimé qu'il pourrait être proposé
au Sénat d'engager deux démarches complémentaires : en
premier lieu, la réalisation d'"économies ciblées" sur des
crédits consacrés à des politiques du Gouvernement qu'il a
estimées contestables, comme la fonction publique, l'emploi,
l'éducation nationale et, en second lieu, une réduction
forfaitaire appliquée aux autres budgets, à l'exception des
budgets présentés en diminution et des "budgets
régaliens", qui porterait sur les dépenses des titres III et IV,
à l'exclusion des dépenses en capital.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a ensuite estimé
que, contrairement à la présentation faite par le Gouvernement,
les prélèvements obligatoires ne baisseraient pas en 1998.
Les recettes fiscales nettes pour 1998, comparées aux estimations
révisées de 1997, sont en progression en valeur de 43 milliards
de francs. La loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et
financier permet optiquement de réduire cette progression : sans
l'intervention de ces mesures urgentes, l'augmentation de recettes
s'élèverait à 66,5 milliards de francs. La prise en compte
de ce projet de loi permet d'ailleurs de comprendre comment un budget
réputé "infaisable" en début d'année 1997 devient
un budget presque "simple" à boucler à l'automne.
Si l'on exclut l'effet de la soulte de 37,5 milliards de francs de France
Telecom, l'amélioration du déficit entre 1997 et 1998 est de 59,3
milliards de francs.
Afin d'expliquer le bouclage du budget de 1998, M. Alain Lambert, rapporteur
général, a estimé qu'il convenait de mettre en perspective
les effets de l'abandon de la deuxième année du plan quinquennal
de baisse de l'impôt sur le revenu, les effets de la loi portant mesures
d'urgence à caractère fiscal et financier, les effets des
augmentations d'impôts associés au projet de loi de finances pour
1998 et enfin, la diminution des dépenses militaires. En effet,
l'addition de ces éléments donne un total voisin de 51 milliards
de francs.
Si l'on tient compte ensuite de l'effet favorable de la croissance sur les
recettes, il apparaît que ce sont l'accroissement de la fiscalité
et l'abandon de la trajectoire de la loi de programmation militaire qui
permettent d'atteindre l'équilibre du budget pour 1998, alors qu'aucune
maîtrise des dépenses civiles n'est engagée.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a souligné que la
concomitance des discussions du projet de loi de finances et du projet de loi
de financement de la sécurité sociale obscurcissait
singulièrement le débat en créant une incertitude sur
l'étendue de la déductibilité de la contribution sociale
généralisée, et sur les effets sur la consommation de la
surtaxation de l'épargne par des prélèvements sociaux.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a insisté sur le
fait qu'à législation constante, les prélèvements
sur les entreprises s'accroîtraient de 23,7 milliards de francs en 1998,
avant prise en compte des aggravations adoptées par l'Assemblée
nationale (environ 2 milliards de francs) avec des effets nuisibles tels que la
recherche de productivité au détriment de l'emploi, les hausses
de prix dans les secteurs abrités, l'attentisme en matière
d'investissement et la dégradation de notre compétitivité
fiscale par rapport à nos grands concurrents étrangers.
Pour les ménages, et selon les mêmes hypothèses,
l'aggravation serait de 10 milliards de francs au titre du projet de loi de
finances et de 23 milliards de francs supplémentaires au titre du projet
de loi de financement de la sécurité sociale, soit 8 milliards de
francs de plus que le gain de 15 milliards de francs induit par le basculement
de la cotisation d'assurance maladie sur la contribution sociale
généralisée.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a estimé que ces
choix fiscaux aboutissaient à renier les engagements de l'Etat puisque
l'abandon du processus quinquennal d'allégement de l'impôt sur le
revenu, adopté l'année dernière, ajouterait (au poids
déjà élevé de l'impôt), la nuisible
réputation d'instabilité et d'absence de lisibilité de
notre fiscalité. Il a annoncé qu'il proposerait donc le
rétablissement du dispositif de réduction de l'impôt sur le
revenu adopté l'an dernier, tel qu'il avait été
configuré pour 1998. A l'inverse, il ne proposerait pas de revenir sur
les mesures d'urgence, bien que rejetées par le Sénat, mais
adoptées récemment par l'Assemblée nationale, dans le
souci de ne pas changer à tout moment la règle fiscale, ce qui
découragerait les contribuables.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a précisé
qu'il proposerait, au Sénat, de réduire les
prélèvements sur les Français, au titre du budget pour
1998, de 22,450 milliards de francs, dont 18 milliards de francs environ pour
la baisse de l'impôt sur le revenu engagée en 1997, afin de
marquer ainsi la volonté du Sénat de poursuivre la décrue
des impôts amorcée l'année dernière.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a conclu en rappelant que
la politique du Gouvernement, telle qu'elle se traduit dans le projet de loi de
finances pour 1998, aurait pu justifier, comme en 1992, un rejet du budget pour
exprimer clairement le désaccord du Sénat. Toutefois, cette
démarche aurait eu pour effet d'empêcher la Haute Assemblée
de proposer les alternatives souhaitables et possibles aux choix du
Gouvernement. Aussi, la solution préconisée par le rapporteur
général sera d'adopter un "budget infléchi" comportant les
corrections nécessaires, c'est-à-dire une vraie réduction
des dépenses, pour prélever moins d'impôts, grâce
à la mise en oeuvre d'une nécessaire et urgente réforme de
l'Etat.
Un large débat s'est ensuite instauré au sein de la commission.
En réponse à M. Roland du Luart, le rapporteur
général a estimé à 43 milliards de francs le
montant des prélèvements fiscaux prévus dans le projet de
loi de finances pour 1998, tandis que le projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 1998 préconisait des
prélèvements supplémentaires de 12,7 milliards de francs.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a ensuite souligné
que le respect des critères de Maastricht en 1998 supposait une
hypothèse optimiste d'amélioration des comptes spéciaux.
Il a, par ailleurs, annoncé qu'il soumettrait à l'examen de la
commission, après vérifications techniques, une
présentation du budget de l'Etat en sections de fonctionnement et
d'investissement pour 1997 et 1998.
S'agissant des dépenses de fonction publique, M. Alain Lambert,
rapporteur général, a souligné qu'elles progressaient de
3,3 % en 1998, pour atteindre 610 milliards de francs, et que l'administration
française, dont le poids était manifestement excessif, se devait
d'améliorer son efficacité. Il a insisté sur la
nécessité pour l'Etat de moderniser la gestion de ses ressources
humaines, une étude récente de l'OCDE montrant que la France, par
rapport à ses partenaires, avait très nettement
privilégié l'emploi public tout en aggravant la situation du
chômage.
Répondant à M. Marc Massion, le rapporteur général
a insisté sur le fait que ses positions s'inscrivaient dans la
continuité des positions prises sur les précédents
budgets, et il a estimé que les précautions prises par le
Gouvernement pour afficher les prévisions économiques
n'étaient en rien une garantie contre une fragilisation du solde
budgétaire. Il a enfin souligné que le niveau et l'affectation
des effectifs publics ne devaient pas être figés dans un contexte
où les missions de l'Etat évoluaient fortement.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a, par ailleurs,
précisé que des informations sur l'augmentation des
prélèvements obligatoires au cours des années
passées figureraient dans le rapport général sur le projet
de loi de finances pour 1998. Il a souligné que les hausses
d'impôts opérées par le précédent
Gouvernement n'avaient pas été remises en cause par le
Gouvernement actuel.
En réponse à M. Maurice Blin, le rapporteur général
a adhéré à la suggestion de séparer, dans
l'appréciation portée sur la fonction publique, les agents
affectés à la gestion de l'Etat traditionnel de ceux
affectés aux nouveaux problèmes économiques et sociaux.
Répondant à MM. Roland du Luart et Philippe Marini, le rapporteur
général est convenu de la nécessité de
réexaminer les méthodes d'examen du projet de loi de financement
de la sécurité sociale, afin, ou bien de "consolider" ce texte
avec celui du projet de loi de finances, ou bien d'affecter l'examen des
dépenses sociales à la commission des affaires sociales, en
réservant l'examen des recettes à la commission des finances.
Répondant à M. Jean-Philippe Lachenaud, le rapporteur
général a rappelé que les recommandations de l'audit
réalisé au mois de juillet dernier par MM. Nasse et Bonnet, quant
à la nécessité de rendre plus efficiente la dépense
publique, avaient été perdues de vue dans l'élaboration du
projet de loi de finances pour 1998.
En réponse à M. Joël Bourdin, le rapporteur
général est convenu de la surestimation possible du taux de
croissance pour 1998.
M. Alain Lambert, rapporteur général, a ensuite approuvé
l'observation de M. Yann Gaillard, soulignant que la note récente de M.
Jean Choussat sur la fonction publique, commentée dans la presse,
était un document interne à l'inspection générale
des finances. Il a estimé indispensable d'approfondir le contrôle
sur les crédits dévolus aux dépenses de fonction publique,
en passant outre aux réticences éventuelles des ministères.
Répondant à M. Philippe Adnot, le rapporteur
général a estimé que le rôle des rapporteurs
spéciaux était de contrôler très
précisément l'utilisation des crédits des budgets
concernés. Il est convenu de l'existence de doublons dans
l'administration, à ses divers échelons.
En réponse à M. Denis Badré, le rapporteur
général a rappelé que les travaux menés l'an
passé par la commission sur la dépense fiscale avaient
été complétés par des études menées
par la Cour des Comptes. Il a précisé que les dépenses de
remboursements et dégrèvements ne pouvaient être
considérées comme dépenses fiscales, n'ayant pas d'objet
économique ou social.
Répondant à M. Paul Loridant, le rapporteur général
a souligné la différence de principe entre la démarche
qu'il préconisait sur la maîtrise de la dépense et la
recherche d'économies, en cours de discussion budgétaire,
à laquelle s'était livrée l'Assemblée nationale
lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1997.
En conclusion, M. Christian Poncelet, président, a insisté sur
l'intérêt de la démarche de maîtrise de la
dépense publique préconisée par le rapporteur
général, et a rappelé la nécessité de
pouvoir faire le point chaque année de l'utilisation des crédits
du budget de l'Etat en cours d'exercice, sur présentation des
rapporteurs spéciaux de la commission.
1
L'acquis de croissance est le
taux de croissance annuel qui serait observé si la variable
concernée restait au niveau atteint le dernier trimestre connu au cours
du reste de l'année ou de la période examinée.
2
Il est à ce propos intéressant de relever que la
satisfaction que procure la faiblesse des gains de productivité en
période de sous-emploi laisse place à la crainte qu'elle suscite
dès qu'on se rapproche du plein emploi des facteurs
3
On rappelle qu'en 1996, l'emploi total avait diminué
de 84.000 unités.
4
Voir P. 21 du Tome I du rapport économique,
social et financier.
5
Le terme brute signifie que les amortissements ne sont pas
décomptés de l'investissement.
6
Cette analyse se fonde d'ailleurs sur une
méconnaissance de la contribution importante des remises de dettes
classées en comptabilité nationale en "Autres transferts en
capital" à l'évolution de la capacité de financement des
entreprises.
7
Ainsi, le total des dépenses courantes de la dette et
de la fonction publique passe de 51 % du budget en 1990 à
près de 64 % en 1997. De leur côté, les
dépenses relatives à l'emploi et aux divers "guichets sociaux"
montent de 12,5 % en 1990 à près de 17 % en 1997. En
toute rigueur, il faudrait y ajouter les dépenses résultant
d'engagements, notamment contractuels, de l'Etat et une partie des
interventions économiques dont le déclenchement est automatique.
8
A structure constante, une diminution de 9,55 milliards de
francs étant enregistrée en 1995 parallèlement à
l'affectation d'un produit supplémentaire de TVA au budget annexe des
prestations sociales agricoles.
9
Ceci n'est pas propre à la France. Voir "le compte du
logement 1997" pages 143 à 169 - Edition Economica. Voir
également "Livre blanc sur les aides personnelles au logement" -Union
des HLM- Congrès de bordeaux 1996, et "Les évolutions des aides
à la personne en Europe" -. Laurent GHEKIERE - CECODHAS.
10
Sous son angle budgétaire : L'Etat mène
aussi des politiques d'intervention à travers la dépense fiscale,
de l'ordre de 360 milliards de francs en 1997.
11
Rapport du comité de réflexion
présidé par M. Onno Ruding et portant sur les orientations
en matière de fiscalité des entreprises dans le cadre de
l'approfondissement du marché intérieur. 18 mars 1992.
12
Etude réalisée pour le compte du Ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie entre mars et septembre
1997.
13
les entreprises tiennent compte d'autres éléments
tels l'environnement politique et juridique, la qualité des
infrastructures, le coût du travail, la formation des employés ...
14
à l'exception des titres de participation et de la
concession d'éléments de la propriété industrielle
(licences d'exploitation de brevets ou d'inventions brevetables).
15
Les bases ont augmenté de 42 % en volume entre 1988 et
1995, alors que le PIB n'a crû que de 12 % en volume sur la
même période.
16
Entre 1988 et 1995, le produit perçu par les
collectivités a augmenté de 71 % en francs courants et de
44 % en francs constants. Les cotisations pesant sur les entreprises ont
crû de 50 % en francs courants et de 30 % en francs constants,
et la charge totale directe de la taxe professionnelle pour le budget de l'Etat
a augmenté de 110 %.
17
Ces dispositifs ont coûté 53,5 milliards de francs
à l'Etat en 1995, ce qui représentait plus du tiers du produit
perçu par les collectivités territoriales, contre moins du quart
en 1988.
18
En 1995, plus de la moitié des communes avaient une base
par habitant inférieure de 80 % à la base nette moyenne par
habitant (10.742 francs).
19
Alors que l'écart va de 1 à 6 pour la France
continentale toutes collectivités bénéficiaires
confondues, il atteint 1 à 44 pour les communes.
20
Le remplacement de l'assiette actuelle par la valeur
ajoutée alourdirait le coût du travail, les frais de personnel ne
représentant que 35 % de la base actuelle contre 70 % avec une
assiette valeur ajoutée ; par ailleurs, la valeur ajoutée
n'étant pas localisable géographiquement, une assiette de ce type
supposerait de nationaliser le prélèvement ; enfin, la
valeur ajoutée ne reflète pas forcément la
santé économique et financière d'une entreprise.
21
De 1988 à 1995, les augmentations du produit de taxe
professionnelle qui peuvent être attribués à des hausses de
taux ont été de 21,4 milliards de francs.
22
Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables
sont fixés forfaitairement pour les entreprises dont le chiffre
d'affaires n'excède pas 500.000 F pour les entreprises dont l'objet
principal est de vendre des produits et 150.000 F pour les autres
entreprises.
23
Les limites du régime réel simplifié sont
respectivement de 5 millions de francs et de 1,5 million de francs.
24
Loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et
financier adoptée par l'Assemblée nationale en dernière
lecture le 21 octobre 1997.
25
Y compris les opérations temporaires et les
remboursements et dégrèvements d'impôts.
26
Articles 11 et 13 et article premier de l'ordonnance. A titre
d'exemple, l'arrêté du 10 juillet 1997 annule la quasi
totalité des crédits du fonds de gestion de l'espace rural alors
même que l'abondement de ce fonds avait fait l'objet de longs
débats au Parlement : l'Assemblée nationale et le Sénat
avaient "obtenu" une majoration de 150 millions de francs des
crédits correspondants.
27
L'ordonnance de 1959 dispose judicieusement, en son article 38,
que : "si aucun projet de loi de finances rectificative n'est
déposé avant le 1er juin, le Gouvernement adresse au
Parlement un rapport sur l'évolution de l'économie nationale et
des finances publiques
." Toutefois, et de pratique constante, ce
rapport est muet sur l'aspect finances publiques considérées
dans l'optique de l'exécution budgétaire.
28
Parmi ceux-ci, il convient de distinguer les comptes
d'affectation spéciale -qui financent souvent des actions analogues
à celles du budget général à partir de ressources
affectées- des autres catégories de comptes spéciaux. Les
dépenses des CAS sont en outre des opérations à
caractère définitif.
29
Rapport sur le projet de loi de finances portant
règlement définitif du budget de 1994 (Sénat
n° 428, question n° 1 Page 91) sur la comptabilisation
des dépenses d'investissement de l'Etat.
30
L'objectif du précédent gouvernement était
d'atteindre 3 % en 1997.
31
En tenant compte des mesures d'aménagement des droits de
la loi de finances pour 1997.
32
Il est vrai que ces derniers avaient retenu une fourchette
allant de 15 à 17 milliards de francs pour estimer la
révision de recettes fiscales. Mais ils avaient cependant
privilégié le chiffre haut de la fourchette.
33
Et ce sans préjudice de l'aggravation de la
fiscalité de l'épargne prévue par ailleurs.
34
Rapport de la Cour des comptes sur l'exécution des lois
de finances pour l'année 1996.
35
Aux termes de l'article 33 de l'ordonnance organique du
2 janvier 1959 : "les services votés représentent le
minimum de dotations que le gouvernement juge indispensables pour poursuivre
l'exécution des services publics dans les conditions qui ont
été approuvées l'année précédente par
le Parlement.
36
La dépense "induite" de fonction publique comporte,
au-delà des charges de personnel, les pensions aux anciens combattants,
indexées sur les traitements de la fonction publique, ainsi que la
subvention à l'enseignement privé.
37
Cette proposition illustre la continuité des
réflexions et des prises de position de votre commission des finances.
En effet, dans tous ses travaux, la commission a insisté sur la
nécessaire maîtrise de la dépense publique,
préalable à la décrue des prélèvements
obligatoires. Lors de l'analyse du projet de budget pour 1996 (Sénat
n° 77, annexe au procès-verbal de la séance du
21 novembre 1995), elle a souligné la nécessité
absolue d'une politique d'économies et tracé les grandes lignes
d'une stratégie pour le Parlement.
A l'occasion de l'examen de la résolution sur la situation de
déficit excessif en France (Sénat n° 447, annexe au
procès-verbal de la séance du 19 juin 1996), elle s'est
notamment félicitée de ce que : "la recommandation encourage
le gouvernement à réduire les dépenses de l'Etat en termes
réels pour 1997". Au terme d'une analyse des politiques
budgétaires conduites dans plusieurs pays de l'OCDE, elle a
constaté que "les politiques d'ajustement ayant permis une diminution du
ratio dette publique/PIB ont toutes comporté des mesures de
réduction des dépenses et, plus particulièrement, des
dépenses sociales et de transfert et des dépenses de personnel."
Enfin, son rapport d'information sur le débat d'orientation
budgétaire de 1996 (Sénat n° 369, annexe au
procès-verbal de la séance du 15 mai 1996),
préconisait une "action forte sur les dépenses" et proposait
plusieurs améliorations de la procédure budgétaire
susceptibles de permettre d'atteindre cet objectif.







