Projet de loi sur l'innovation et la recherche
TREGOUET (René)
AVIS 210 (98-99) - COMMISSION DES FINANCES
Table des matières
- I. LE POTENTIEL SCIENTIFIQUE DE LA FRANCE EST IMPORTANT
- II. TOUTEFOIS LA VALORISATION INDUSTRIELLE DE LA RECHERCHE EST DÉCEVANTE
- III. LES CAUSES DE CE DÉCALAGE SONT MULTIPLES
- I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX RÈGLES RELATIVES AUX PERSONNELS DE LA RECHERCHE
-
II. LES MESURES FAVORISANT LE RAPPROCHEMENT DE LA
RECHERCHE PUBLIQUE ET DES ENTREPRISES
- A. L'INSTAURATION D'UNE PROCÉDURE D'APPROBATION TACITE DE LA PARTICIPATION D'ORGANISMES PUBLICS DE RECHERCHE À DES STRUCTURES PRIVÉES DE COOPÉRATION
- B. L'EXTENSION AUX ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET AUX ORGANISMES PUBLICS DE RECHERCHE DE LA POSSIBILITÉ DE COTISER AUX ASSEDIC POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL
- C. L'ASSOCIATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ AU PROCESSUS DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
- III. LA MISE EN PLACE DE STRUCTURES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
- I. UN PROJET DE LOI SILENCIEUX SUR LE FINANCEMENT DE L'INNOVATION
-
II. UN PROJET DE LOI TIMORÉ EN MATIÈRE DE
STOCK-OPTIONS
- A. LE DURCISSEMENT RÉCENT DU RÉGIME DES PLANS D'OPTIONS SUR ACTIONS
- B. UNE AMÉLIORATION MARGINALE DES BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CRÉATEUR D'ENTREPRISE
- C. LES PROPOSITIONS ADDITIONNELLES DE LA COMMISSION DES FINANCES
- D. LE DÉBAT SUR LA DIFFUSION DES STOCK-OPTIONS
- E. LA NÉCESSITÉ D'UN RAPPROCHEMENT AVEC LES PRATIQUES ÉTRANGÈRES
N°
210
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 février 1999
AVIS
PRÉSENTÉ
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi sur l' innovation et la recherche ,
Par M.
René TRÉGOUËT,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Alain Lambert,
président
; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude
Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet,
vice-présidents
; Jacques-Richard Delong, Marc Massion,
Michel Sergent, François Trucy,
secrétaires
; Philippe
Marini,
rapporteur général
; Philippe Adnot, Denis
Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse
Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin,
Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean
Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard,
Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Claude
Lise, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne,
Joseph Ostermann, Jacques Pelletier,
Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri
Torre, René Trégouët.
Voir le numéro
:
Sénat
:
152
(1998-1999).
Recherche.
" Je crois que nous aurons fait un grand pas dans ce pays lorsque nos
enfants comprendront que la meilleure façon de diriger une entreprise
c'est encore de la créer et qu'à côté de la voie
royale de la fonction publique, existe une voie royale de
l'entreprise ".
Christian Poncelet
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi en première lecture du présent projet
de loi qui tend à soutenir la création d'entreprises innovantes
et à favoriser les transferts entre la recherche et l'industrie. Sa
principale disposition vise à lever les incompatibilités
résultant des règles de la fonction publique et de celles du code
pénal entre le statut des chercheurs et leur participation à des
entreprises de valorisation. Le système français de
recherche-développement est en effet caractérisé par un
découplage important entre la qualité du potentiel scientifique
de notre pays et l'insuffisance de ses retombées industrielles. C'est
pourquoi il est proposé d'assouplir les modalités de l'essaimage.
Il convient toutefois de rappeler que le présent projet de loi s'inspire
largement, d'une part, de dispositions du projet de loi portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF) pour 1997, que la
dissolution de l'Assemblée nationale a rendu caduc, et, d'autre part,
d'une proposition de loi de M. Pierre Laffitte, adoptée par le
Sénat le 22 octobre dernier, tendant à faciliter la
création d'entreprises innovantes par des chercheurs, en fixant les
règles déontologiques de leur création.
Ces dispositions d'ordre institutionnel et statutaire sont nécessaires
mais sont apparues insuffisantes à votre rapporteur pour avis. En effet,
il convient de rappeler que la recherche et l'innovation sont deux notions
distinctes : la recherche relève des scientifiques, et l'innovation
des entrepreneurs. Or, si le présent projet de loi permet aux chercheurs
de mieux articuler leurs travaux avec le monde de l'entreprise, il
n'améliore guère l'environnement fiscal des entrepreneurs. C'est
pourquoi, votre commission des finances a jugé indispensable
d'étoffer considérablement son volet fiscal, en proposant, d'une
part, un dispositif équilibré sur les stock-options, et, d'autre
part, des dispositions relatives au financement des entreprises innovantes,
consistant à aménager le régime des fonds communs de
placement dans l'innovation (FCPI) et à orienter l'épargne de
proximité vers le renforcement des fonds propres des entreprises de
haute technologie.
CHAPITRE PREMIER
LE CONTEXTE DU PROJET DE LOI
I. LE POTENTIEL SCIENTIFIQUE DE LA FRANCE EST IMPORTANT
A. LES ATOUTS SCIENTIFIQUES DE LA FRANCE
La
recherche française est d'excellente
qualité.
Les
succès d'Ariane 5, d'Airbus, du TGV, ou encore l'attribution de trois
prix Nobel à des chercheurs français au cours des années
1990 en constituent de bonnes illustrations.
En outre,
les publications scientifiques françaises sont en
développement.
Comme le montre le tableau ci-après, la part
de la production scientifique française est en augmentation dans le
monde, alors que la part dans les publications des pays de l'Union
européenne est stable depuis 1990.
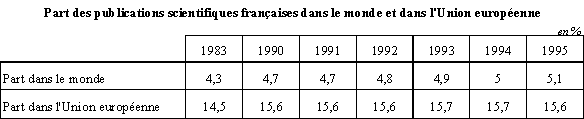
La
France est particulièrement présente dans
les
mathématiques
, avec 7,1 % des publications mondiales. En revanche,
les sciences pour l'ingénieur constituent moins de 4 % des publications
mondiales.
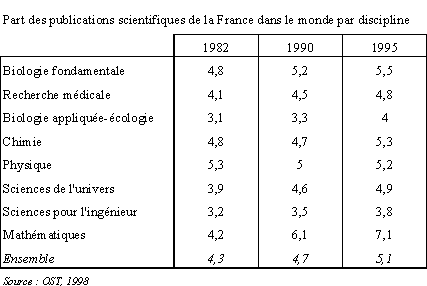
Il faut y voir, probablement, les conséquences du niveau
d'éducation élevé de la population française. En
outre, et les interlocuteurs que votre rapporteur pour avis a rencontrés
l'ont souligné, l'excellence des ingénieurs français est
reconnue dans le monde entier.
B. L'EFFORT BUDGÉTAIRE EN FAVEUR DE LA RECHERCHE
L'effort de recherche d'un pays est évalué
selon
deux approches complémentaires :
- le financement de la recherche-développement
, qui
appréhende les moyens financiers affectés à la RD par les
agents économiques nationaux : l'agrégat correspondant est
la dépense nationale de RD
(DNRD)
, qui s'élevait à
184,6 milliards de francs en 1997 ;
- l'exécution de la recherche-développement
, qui
décrit les dépenses de RD effectuées dans les secteurs
économiques, quelles que soient l'origine des ressources et la
nationalité des bailleurs de fonds : l'agrégat correspondant
est la dépense intérieure de RD
(DIRD)
, qui
s'établissait à 183,6 milliards de francs en 1997.
La différence entre ces deux agrégats correspond aux flux de
financement entre la France et l'étranger dans lequel on comprend les
organisations internationales, comme le CERN ou l'Agence spatiale
européenne, ainsi que les programmes européens.
Le tableau ci-après retrace l'évolution de ces deux ratios en
France depuis 1990.
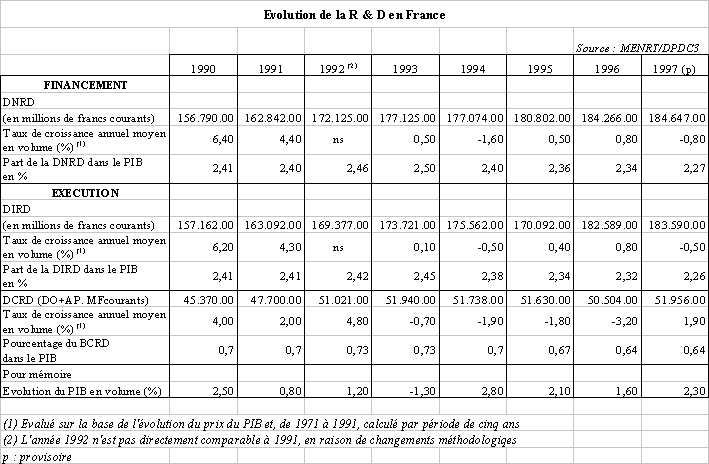
La RD exécutée en France a présenté, de 1979
à 1993, une croissance plus rapide que celle du PIB. Sa part est
passée de 1,73 % en 1978 à 2,45 % en 1993 mais, depuis
1993, cette part décroît, et l'on constate un ralentissement de
l'effort portant sur les dépenses de recherche, comme dans la plupart
des pays industriels.
Toutefois, le rapport du Conseil d'analyse
économique consacré à l'innovation précise :
" La France améliore plus nettement sa position en Europe que
dans le monde car la position de l'Europe tend à régresser dans
le monde ".
Le tableau ci-après permet de comparer les moyens alloués par la
France à la recherche à ceux de huit autres pays
développés.
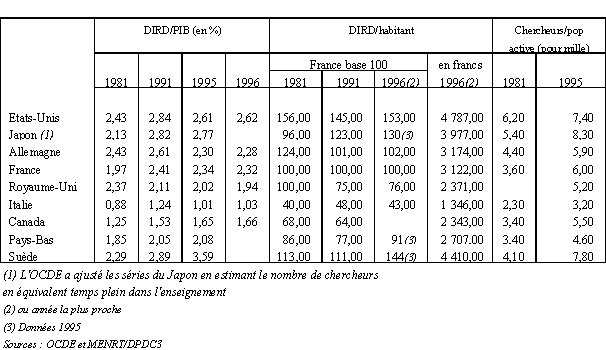
On y constate que l'effort financier consacré par la France à la
recherche-développement par rapport au produit intérieur brut
(PIB) est globalement satisfaisant. La France se situe en effet au
deuxième rang en Europe
(2,3 %)
après la Suède
(3,3 %) et devant l'Allemagne (2,3 %) et le Royaume-Uni (1,9 %)
pour le ratio de DIRD par rapport au PIB, et se situe dans les premiers pays de
l'OCDE pour cet indicateur, très proche des Etats-Unis (2,6 %) et
du Japon (2,75 %). La DIRD en France représente 21 % du total de
l'Union européenne et plus de 6 % du total de la zone OCDE. Enfin,
la France compte environ 150.000 chercheurs, soit 18 % des effectifs de l'Union
européenne et presque 6 % de ceux de la zone OCDE.
Le système français de recherche-développement se
caractérise par l'importance de la recherche conduite dans le cadre
public.
La part de la recherche effectuée dans les entreprises
françaises est longtemps restée inférieure à celle
de nos principaux partenaires. Elle se situe aujourd'hui à un niveau
comparable, quoique toujours inférieur, à celui de l'Allemagne ou
du Royaume-Uni, mais bien en dessous de celui du Japon et des Etats-Unis.
Depuis 1995, la contribution financière des entreprises
dépasse celle des administrations.
Ainsi, en 1996, les entreprises
ont financé plus de 51 % de l'effort national total de recherche,
contre 44 % quinze ans plus tôt.
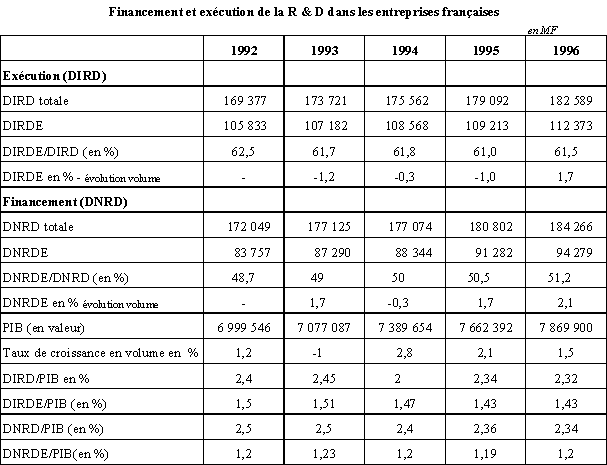
II. TOUTEFOIS LA VALORISATION INDUSTRIELLE DE LA RECHERCHE EST DÉCEVANTE
A. UN CONSTAT DÉSORMAIS BIEN ÉTABLI
Dans
leur lettre de mission adressée le 31 juillet 1997 à M. Henri
Guillaume, les ministres de l'éducation nationale, de la recherche et de
la technologie, de l'économie, des finances et de l'industrie, et le
secrétaire d'Etat à l'industrie notaient :
" Notre
pays dispose d'un potentiel scientifique et technologique de premier plan, mais
à l'instar d'autres pays européens, le couplage de ces
découvertes et de ces connaissances avec les activités
industrielles s'effectue moins facilement qu'aux Etats-Unis et au
Japon. "
Le constat est en effet maintenant bien établi et admis par
tous : les retombées industrielles de la recherche française
sont médiocres. Il est ainsi significatif de noter que la bonne tenue,
rappelée plus haut, des publications scientifiques françaises
n'empêche pas l'affaiblissement des positions technologiques de notre
pays.
L'Institut de l'entreprise, dans un rapport de janvier 1998 intitulé
Innover et entreprendre
, avait dressé un tableau du
positionnement de la France vis-à-vis de l'innovation, duquel il ressort
que notre pays présente de nombreux handicaps.
Trop peu de grandes entreprises françaises sont présentes dans
les secteurs à forte croissance.
En 1996, 24 % des entreprises françaises présentes au sein
des 500 premières entreprises mondiales appartiennent au secteur
à croissance négative (équipement industriel,
ingénierie et construction), et 42 % au secteur à croissance
faible (chimie de base, aéronautique, automobiles et
équipementiers...). En revanche, 47 % des entreprises
américaines et 50 % des entreprises britanniques
équivalentes appartiennent aux secteurs à croissance moyenne
(télécommunications, assurances, grandes surfaces...) ou forte
(pétrole, pharmacie, produits financiers...), contre seulement 34 %
des entreprises françaises.
Le retard de la France dans des domaines d'avenir, notamment les
technologies de l'information et les biotechnologies, est patent.
Notre
pays dispose d'une compétitivité technologique médiocre
dans ces secteurs mais excellente dans le domaine de l'aérospatial,
très représentatif du modèle français des grands
programmes technologiques.
Dans le domaine des nouvelles technologies de la communication et de
l'information, il apparaît que les dépenses informatiques en
France sont environ moitié moindres que celles des Etats-Unis. En 1997,
ce pays comptait 40 serveurs Internet pour 1.000 habitants. Ce chiffre
était de 25 en Suède et de 7 en Allemagne. La France occupait la
dernière position, avec 4 serveurs pour 1.000 habitants, juste devant
l'Italie (3 serveurs). D'une manière générale, la position
de la France dans ce secteur s'est affaiblie au cours des années 1990.
En outre, la France privilégie trop la recherche fondamentale au
détriment de l'innovation et du développement de produits
nouveaux.
Selon la Commission européenne, en 1990, notre pays consacrait
51,4 % de ses dépenses de recherche et développement
à la recherche fondamentale et appliquée, et 48,6 % au
développement de produits nouveaux. A la même époque, les
principaux pays industrialisés attachaient plus d'importance au
marché des produits finis, pour lequel l'Allemagne consacrait 51 %
de ses dépenses de recherche et développement, les Etats-Unis
62,2 % et le Japon 63,2 %.
La France présente également une situation défavorable
en matière de brevets.
Les parts mondiales de dépôts de brevets dans les systèmes
européen et américain mesurent les positions technologiques des
pays concernés. Or, il apparaît que
les positions
technologiques de la France ont chuté de 20 %
depuis 1987
, le
rythme de cette contraction de la part mondiale de la France s'accentuant,
comme le montre le tableau ci-après. En outre, la part de la France
diminue au sein de l'Union européenne. L'industrie française a vu
sa part dans le brevet européen et américain chuter,
respectivement, de 18 et 19 % entre 1990 et 1996, et sa part de
marché international diminuer de 2 %. Elle se situe au
9
ème
rang en matière de dépôt de brevets,
alors qu'elle occupe la deuxième place pour son effort de recherche.
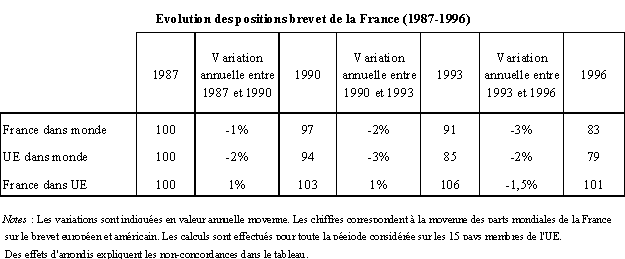
En outre,
les brevets déposés par les entreprises
françaises se situent plutôt dans les secteurs à faible
croissance.
Selon l'Office mondial de la propriété
industrielle, les Français déposent 2,2 brevets pour 1.000
habitants contre 4,7 en Allemagne et aux Etats-Unis. En outre, la France se
montre peu innovante dans les secteurs d'avenir : elle représente
6 % des dépôts mondiaux de brevets européens en 1993,
contre 11 % au Royaume-Uni et 54 % aux Etats-Unis. Les proportions
sont relativement similaires dans le secteur de l'informatique ou dans celui
des produits pharmaceutiques. Enfin,
la balance technologique de la France,
qui reflète l'écart entre les achats et les ventes de brevets,
est déficitaire.
Les entreprises françaises sont nettement moins créatrices de
valeur que les entreprises anglo-saxonnes.
En 1995, l'accroissement de la capitalisation boursière des 200 premiers
groupes français était inférieur à 400 milliards de
francs, tandis qu'il était de 434,5 milliards de francs pour les 4
premiers groupes britanniques et de 986,6 milliards pour les 4 premiers groupes
américains.
B. LA FAIBLESSE DES CRÉATIONS D'ENTREPRISES
Depuis 1991, la création d'entreprises en France diminue, comme le montre le tableau ci-dessous :
|
Années |
Créations pures |
Indice |
|
1987 |
195 000 |
100 |
|
1988 |
199 000 |
103 |
|
1989 |
204 000 |
104 |
|
1990 |
195 000 |
100 |
|
1991 |
179 000 |
94 |
|
1992 |
173 000 |
92 |
|
1993 |
171 000 |
92 |
|
1994 |
185 000 |
98 |
|
1995 |
179 000 |
95 |
|
1996 |
172 000 |
92 |
|
Source : APCE |
|
|
En 1996,
275.000 entreprises ont été créées, reprises ou
réactivées. Près de 172.000 entreprises ont
été créées
ex nihilo
, notamment dans le
secteur du commerce et des services aux entreprises, contre 195.000 dix ans
plus tôt. 58.000 entreprises étaient réactivées et
46.000 reprises. La plupart des créations pures concernent des
entreprises de très petite taille : 76 % des entreprises
créées n'emploient aucun salarié en dehors du chef
d'entreprise. 50 % des créateurs ont investi moins de 50.000
francs. En 1997, 272.000 entreprises ont été
créées, soit un niveau inférieur à celui atteint
l'année précédente. Cette légère baisse
résulte du recul de 2,4 % des créations nouvelles, tandis
que le nombre des reprises et des réactivations évolue peu.
Les entreprises créées ou reprises ont engendré, en 1996,
541 000 emplois. 17 % des salariés du secteur
privé appartiennent à des entreprises créées ou
reprises depuis moins de 5 ans.
Le taux de mortalité des entreprises nouvellement
créées apparaît relativement élevé.
Une
entreprise sur deux n'existe plus sous sa forme initiale au bout de 5 ans. Il
convient cependant de préciser que de fortes disparités de survie
existent selon la nature de l'activité de l'entreprise
créée. Ainsi, le taux de survie est très
élevé dans le secteur des services aux particuliers, mais faible
dans celui des hôtels-cafés-restaurants. Enfin, la durée de
vie des entreprises créées est d'autant plus longue qu'elles
comptent davantage de salariés.
D'une manière générale,
la création
d'entreprises en France présente trois grandes
caractéristiques :
- le nombre d'entreprises créées diminue lentement depuis
plusieurs années, et même si ce processus semble s'être
inversé depuis 1998, il n'est pas certain que cette inflexion de
tendance soit durable.
- en moyenne, une entreprise sur deux n'existe plus 5 ans après sa
création ; toutefois, le taux de continuité de ces
entreprises, qui peuvent subsister sous une autre forme, est de 58 %, soit un
taux comparable à celui des autres pays développés ;
- la France compte peu d'entreprises moyennes, mais beaucoup de très
petites entreprises, dont la moitié n'emploie aucun salarié.
La conjonction d'un niveau relativement faible de créations
d'entreprises et d'un positionnement défavorable sur les secteurs
à forte croissance explique que la France ne bénéficie que
faiblement des bienfaits de l'innovation.
Depuis la fin des années 1980 et le début des années 1990,
de nouvelles théories économiques mettent en exergue le
rôle de l'innovation dans le processus de croissance.
Ces
théories de la " croissance endogène "
font de
l'innovation le moteur du développement économique : elles
rejoignent des théories plus anciennes soulignant le rôle du
progrès technique.
Or, de nombreuses études révèlent une
corrélation entre innovation et création d'emplois
. Dans
le rapport du Conseil d'analyse économique précité, MM.
Robert Boyer et Michel Didier indiquent qu'
" une politique dynamique
d'innovation permet d'obtenir un emploi supérieur d'environ
1,2 % "
, alors même que la conjoncture a été
globalement défavorable à l'emploi au cours de la première
moitié de la décennie 1990. Les auteurs
ajoutent :
" Les entreprises innovantes sont plus souvent
exportatrices, elles ont une croissance plus élevée et elles
investissent davantage que les autres entreprises ".
En outre,
l'innovation engendre une plus grande différenciation des produits, et,
grâce au renforcement de la concurrence qu'elle induit, contraint les
entreprises à plus de flexibilité et de réactivité
face aux évolutions du marché.
Le faible bénéfice tiré par notre pays de l'innovation
a des conséquences très tangibles sur les créations
d'emplois.
De 1973 à 1997, le nombre d'emplois a augmenté
d'à peine un million en France, mais de 43 millions aux Etats-Unis.
Oubliant la thèse du déclin qui prévalait à la fin
des années 1980, les Etats-Unis ont pleinement tiré profit d'une
croissance durablement soutenue, d'un marché du travail souple et
dynamique et d'une explosion des nouvelles technologies. Si, depuis 1980,
l'économie américaine a perdu 44 millions d'emplois, elle en a
aussi créé 73 millions, contre 4 millions seulement en Europe.
Dans l'ensemble des pays de l'OCDE, de 1983 à 1995, seul le secteur des
hautes technologies a vu l'emploi croître de 3,3 %, alors que
l'industrie manufacturière a connu une régression de ses
effectifs de 19,4 %. 80 % des 7,7 millions d'emplois
créés aux Etats-Unis entre 1991 et 1995 proviennent des
entreprises de croissance.
III. LES CAUSES DE CE DÉCALAGE SONT MULTIPLES
La faiblesse des retombées industrielles de la recherche a plusieurs causes, à la fois culturelles, institutionnelles et fiscales.
A. LES CAUSES CULTURELLES
De
nombreux industriels soulignent l'inadaptation des mentalités
françaises à l'innovation et à l'esprit d'entreprise en
général.
Cette " exception française " a, en partie, des
origines
historiques
. Il est désormais courant de souligner la distinction
qui existait, à la fin de l'Ancien Régime, entre, d'une part, les
nobles français, refusant de travailler par crainte de déroger,
et, d'autre part, la noblesse anglaise, ayant un penchant naturel pour les
activités commerciales et industrielles et promotrice de la
Révolution industrielle.
La France aurait ainsi été marquée durablement par les
réglementations très rigides héritées du
système des corporations. Elle présente également un
certain nombre de comportements qui caractérisent l'ensemble de la
société, y compris les élites : méfiance
envers l'argent, surtout rapidement gagné, signe d'agissements
vraisemblablement malhonnêtes, sacralisation de la fonction publique et
de ses statuts, valorisation extrême de la réussite scolaire, avec
passage obligatoire par des grandes écoles, et,
a
contrario
, dramatisation de l'échec.
A cet égard, la comparaison avec la situation américaine est
instructive. Aux Etats-Unis, on célèbre les
" self-made-men " ; en France, on raille les
" parvenus ". Outre-Atlantique, l'échec est
considéré comme une étape enrichissante vers le
succès. Il permet de progresser et de tirer des leçons pour
l'avenir : il est formateur et s'inscrit normalement dans un parcours
d'apprentissage. Il peut même apparaître comme un
" pré-requis " pour créer une nouvelle entreprise.
Dans notre pays, l'échec est sévèrement jugé et
sanctionné.
L'absence de droit à l'échec fait de la
France une société de défiance et non de confiance.
Il
conviendrait, par exemple, de revoir la législation sur les faillites et
son application.
En outre,
le système éducatif français est conçu
pour former des salariés et non des entrepreneurs. Il est peu soucieux
de son impact sur les activités industrielles et commerciales.
Une
enquête réalisée en avril 1998 par la SOFRES à la
demande du ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie, et dont les résultats ont été publiés
dans
Les notes bleues de Bercy
, révèle que les jeunes
âgés de 18 à 30 ans jugent le système
éducatif responsable de la faiblesse de l'esprit d'entreprise en France.
Sa performance est jugée, par 62 % des jeunes interrogés,
plutôt mauvaise en matière de développement chez les jeunes
du goût de la recherche et de l'innovation. 73 % des 18-30 ans
expriment le même sentiment s'agissant de la formation aux
réalités du monde de l'entreprise et 79 % en matière
d'incitation à créer sa propre entreprise. Dans le même
temps, et l'étude le note, les jeunes interviewés sont assez
largement imprégnés d'une culture dont ils soulignent par
ailleurs les effets néfastes sur l'esprit d'entreprise. En effet,
52 % d'entre eux estiment que les innovations à venir seront le
fait des grandes entreprises plutôt que des petites
sociétés développant des hautes technologies. En outre,
seuls 18 % souhaiteraient intégrer une PME et 15 % créer une
entreprise.
Enfin, - et il s'agit d'une caractéristique profonde de la
société française -
le poids de la sphère
publique est considérable
. MM. Robert Boyer et Michel Didier, dans
leur rapport précité, notent :
" La recherche
fondamentale et une partie significative de la recherche appliquée sont
menées au sein d'établissements publics. En outre, les
entreprises nationalisées et les dépenses publiques ont longtemps
joué un rôle d'impulsion dans la genèse et la diffusion
technologiques, organisationnelles et sociales ".
Ces deux auteurs font allusion au
" modèle "
français du " grand programme "
qui s'est épanoui
notamment dans le domaine militaire. M. Henri Guillaume relève,
dans son rapport
La technologie et l'innovation
, que
" en 1994,
les grands groupes liés à la Défense et leurs filiales
percevaient 98 % des crédits militaires, mais aussi 86,3 % des
contrats des grands programmes civils et le quart des crédits
incitatifs. Ils étaient donc destinataires de 83 % des 23,2
milliards de francs de financement public ".
Cette illustration met également en exergue la
forte concentration
des financements publics sur un nombre restreint de grands groupes industriels.
Pourtant, M. Henri Guillaume se montre très critique sur le
financement public de la recherche :
" il n'existe pas, au niveau
de l'Etat, de vision de synthèse sur l'affectation et l'utilisation des
crédits publics, ni a fortiori de procédure systématique
d'évaluation de leur impact technologique et économique. [...]
Ces lacunes reflètent un phénomène plus profond et plus
inquiétant : l'absence de stratégie de l'Etat en
matière de coordination et de suivi du financement public de la
RD ".
La politique de recherche française est aujourd'hui contrainte de
se
réorienter.
La fin de la guerre froide entraîne de
moindres dépenses de recherche dans le domaine militaire, tandis que la
mondialisation des économies impose la mise en place d'un système
davantage concurrentiel, ce qui ne se fait pas sans douleur dans un pays sujet
à ce que d'aucuns ont appelé la " nostalgie fordiste ".
A cet égard, la position défavorable de la France dans les
nouvelles technologies de l'information et de la communication peut
s'expliquer, en partie, par le fait que ce secteur est largement piloté
par les mécanismes de marché, l'articulation de la recherche
publique et du marché posant précisément problème
dans notre pays.
B. LES FREINS ADMINISTRATIFS ET STATUTAIRES
D'une
manière générale, il convient d'éviter que l'esprit
d'entreprise ne soit étouffé par un excès de bureaucratie.
Les mesures favorisant la simplification administrative sont donc bienvenues et
doivent être encouragées, notamment lorsqu'elles visent les PME.
De l'enquête précitée de la SOFRES, il ressort que
38 % des jeunes de 18 à 30 ans interviewés estiment que les
tracasseries administratives constituent un frein à l'innovation, tandis
que 32 % d'entre eux les considèrent comme le principal obstacle
à la création d'une entreprise, même si ce facteur n'est
cité qu'en 5
ème
position.
Votre rapporteur pour avis souligne depuis plusieurs années, dans son
rapport consacré à l'examen du budget de la recherche, les
obstacles administratifs et statutaires à la création
d'entreprises innovantes.
En effet,
les règles posées par le statut
général de la fonction publique sont incompatibles avec la
création d'entreprise par les chercheurs à partir des
résultats de leurs travaux, ce qui ne facilite pas l'essaimage.
L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, dite loi " Le Pors ", dispose que
" les fonctionnaires ... ne peuvent exercer à titre
professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que
ce soit ".
Il poursuit :
" Les fonctionnaires ne peuvent
prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une
entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils
appartiennent ou en relation avec cette dernière, des
intérêts de nature à compromettre leur
indépendance ".
En outre, les articles 432-12 et 432-13 du code pénal sanctionnent la
prise illégale d'intérêts.
L'article 432-12 dispose que
" le fait, par une personne ...
chargée d'une mission de service public ..., de prendre, recevoir ou
conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque
dans une entreprise ... dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la
charge d'assurer la surveillance, l'administration ..., est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende ".
L'article 432-13 précise qu'
" est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 200.000 francs d'amende le fait, par une personne ayant
été chargée, en tant que fonctionnaire public ou agent ou
préposé d'une administration publique, à raison même
de sa fonction, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une
entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec
une entreprise privée ... de prendre ou de recevoir une participation
par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant
l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la cessation de cette
fonction ".
Ces dispositions tendent à prévenir un éventuel conflit
d'intérêt entre le service public et les fonctionnaires.
Dans un souci de valorisation de la recherche, qui constitue l'une des missions
des métiers de la recherche et du service public de l'enseignement
supérieur,
les personnels de la recherche publique
bénéficient de règles statutaires assouplies.
L'article 26 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et
de programmation pour la recherche et le développement technologique de
la France prévoit d'ailleurs
" des adaptations au régime
des dispositions prévues par le statut général des
fonctionnaires et des dérogations aux règles relatives aux
mutations afin de faciliter la libre circulation des hommes et des
équipes entre les métiers de la recherche et les institutions qui
y concourent ".
De telles dérogations sont fixées par le décret
n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions
statutaires communes aux corps de fonctionnaires des EPST. Son article 243
précise les règles relatives au
détachement
dans
des entreprises, des organismes privés ou des groupements
d'intérêt public, effectué pour exercer notamment des
fonctions de recherche ou de mise en valeur des résultats de la
recherche. L'article 244 concerne la
mise à disposition
de
fonctionnaires auprès d'entreprises afin d'y assurer le transfert des
connaissances et leur application. Enfin, l'article 245 prévoit la
mise en disponibilité
de fonctionnaires qui peuvent ainsi
créer une entreprise à des fins de valorisation de la recherche.
Ces positions statutaires
sont favorables mais limitées dans le
temps, prévues en général pour une durée de trois
ou cinq ans maximum renouvelable. Du reste, elles
sont peu
utilisées.
M. Henri Guillaume, dans son rapport précité, note :
" Lorsqu'on examine les données des organismes de recherche, on
ne peut qu'être frappé par la faiblesse des mouvements de
mobilité et, plus grave, par leur tendance à la
décroissance ".
En effet, la mobilité statutaire
(mise à disposition, détachement, disponibilité) a
concerné, pour l'ensemble des EPST et des EPIC, 30 à 40 personnes
par an en 1995 et 1996, sur un total de plus de 25.000 chercheurs, soit entre
0,10 et 0,15 %.
Surtout, ces règles ne sont pas adaptées à la
création d'entreprises innovantes, dont le succès tient à
l'imbrication du monde de la recherche et du monde des entreprises
,
imbrication que les règles statutaires considérées rendent
précisément impossible, le chercheur étant contraint de
choisir entre son appartenance au service public et sa participation à
la création d'une entreprise.
Déplorant
la faible mobilité des chercheurs vers
l'enseignement supérieur
, votre rapporteur pour avis
écrivait, dans son rapport sur le projet de loi de finances pour
1999 :
" Il apparaît que deux systèmes d'organisation
des ressources humaines sont possibles en matière de recherche. Le
modèle anglo-saxon comporte un nombre important de thésards et de
post-doctorants au sein des organismes de recherche, tandis que la part des
chercheurs statutaires est beaucoup plus élevée dans le
modèle français. Les organismes de recherche publics, dans les
pays anglo-saxons, n'accueillent de jeunes docteurs que pendant quelques
années. Ensuite, ces derniers rejoignent le secteur privé. Ainsi,
la moyenne d'âge dans les laboratoires publics est moins
élevée mais, surtout,
les fertilisations croisées entre
le secteur public et le secteur privé sont plus nombreuses, la recherche
fondamentale publique mieux valorisée et plus en adéquation avec
les besoins des entreprises ".
En outre, les chercheurs sont placés devant une alternative
douloureuse : soit ils ne remplissent pas la mission assignée au
service public de la recherche, à savoir la valorisation de la
recherche, soit ils la remplissent au risque de se trouver en infraction avec
la loi.
C. UN SYSTÈME DE FINANCEMENT INADAPTÉ
D'une
manière générale, le système fiscal et financier
français est marqué par des spécificités bien
connues : importance du déficit budgétaire, niveau excessif
- et bien supérieur à celui des grands pays industrialisés
- des prélèvements obligatoires et des charges sociales,
impôt sur le revenu décourageant, impôt de solidarité
sur la fortune (ISF) pénalisant, absence de fonds de pension qui
drainent l'épargne sur longue période permettant de financer
l'économie...
Assurément, ces spécificités
freinent la croissance et pénalisent la création d'entreprises,
notamment de PME innovantes.
La création d'entreprises innovantes requiert en effet une structure
de financement particulière.
Le manque de fonds propres et le
partage du risque de financement sont des problèmes fondamentaux lors de
la création ou du développement des PME, notamment pour les
entreprises innovantes. Le financement de l'innovation s'avère difficile
car les prêteurs n'ont pas de garanties aisément évaluables
et ne peuvent procéder à une analyse du risque selon des
critères habituellement retenus.
Dans une étude de cette année consacrée à la
politique de recherche et d'innovation technologiques, l'OCDE note :
" Le financement privé des jeunes entreprises innovantes en France
a traditionnellement fait dépendre les décisions d'investissement
plus du niveau et de la nature des garanties que des espérances de
profit. En faisant peser l'essentiel du risque sur le créateur ou sur
l'Etat, ce système aboutissait tout à la fois à un
découragement de l'esprit d'entreprise, une mauvaise sélection
des projets, et un sevrage des capitaux à des stades cruciaux de la vie
de l'entreprise (naissance et sauts de croissance) ".
Dans ces conditions, il s'agit avant tout d'améliorer l'environnement
des entreprises afin de favoriser l'accès des PME au marché du
crédit et à celui des capitaux.
Les jeunes entreprises
manquent souvent de fonds propres, indispensables pour les aider à
surmonter des difficultés initiales. Dès lors, l'importance du
capital d'amorçage
(
seed money
) est considérable.
Aux Etats-Unis, une partie du capital d'amorçage provient des amis et de
la famille de l'entrepreneur, mais également de
investisseurs
providentiels
, entrepreneurs établis décidés à
aider des entreprises récemment créées en leur apportant
des ressources financières et un capital d'expérience. Or, dans
son rapport précité, l'OCDE note, s'agissant de la France,
" une concentration des aides financières à l'innovation
sur l'aval du processus, au détriment des phases critiques que sont les
études de faisabilité, l'incubation ou le
démarrage ".
Plusieurs mesures ont été prises en faveur du financement de
l'innovation, qui sont rappelées plus loin. Il faut toutefois insister,
dès à présent, sur le fait qu'elles restent insuffisantes
eu égard, d'une part, à leur caractère trop parcellaire,
et, d'autre part, aux capacités de financement qui seraient
dégagées par la mise en place de fonds de pension.
Mais le principal problème qui s'oppose à la création
d'entreprises innovantes en France est le faible développement du
capital risque, malgré une très nette progression depuis 1996.
Dans son rapport précité, M. Henri Guillaume a dressé
l'état des lieux du capital risque en France, et a souligné la
faiblesse des investissements des sociétés de capital risque.
Quelques chiffres sont éloquents. Dans notre pays, le capital-risque est
proportionnellement 40 fois moins élevé qu'aux Etats-Unis. En
1997, près de 60 milliards de francs ont été investis dans
le capital risque outre-Atlantique (hors amorçage, qui représente
plus de 350 milliards), contre moins de 1,5 milliard de francs en France.
Le développement du capital risque devrait être favorisé
par la création, en 1996, de marchés boursiers
spécialisés : le Nouveau marché (NM) français,
destiné à s'insérer dans un réseau européen
de bourses interconnectées (Euro NM), et l'EASDAQ, équivalent
européen du NASDAQ américain qui est le marché
spécialisé dans les entreprises de nouvelles technologies.
Toutefois, M. Henri Guillaume écrit :
" le capital risque
continue de souffrir d'une rentabilité insuffisante ".
Il
souligne également le nombre trop restreint de sociétés de
capital risque : il y a en France 200 sociétés de
capital-investissement, une dizaine seulement atteignant une taille nationale,
c'est-à-dire des fonds gérés supérieurs ou
égaux à 150 millions de francs. Ces fonds de capital risque
investissent chaque année plus d'un milliard de francs, mais cet effort,
pour être proportionné à celui accompli aux Etats-Unis
devrait être cinq fois plus important, soit 5 à 7 milliards de
francs.
Sociétés spécialisées sur les start-up
|
Intervenants |
Actifs gérés |
|
Sofinnova |
900 MF |
|
Innovacom |
500 MF |
|
CDC - Innovation |
400 MF |
|
Finovelec |
300 MF |
|
Thomson-CSF Ventures |
300 MF |
|
Partech International |
250 MF |
|
Atlas Venture |
200 MF |
|
Epicéa |
200 MF |
|
Banexi Ventures |
150 MF |
|
Galiléo |
150 MF |
|
Source : AFIC |
|
En
outre, les sociétés de capital risque sont peu présentes
au niveau de l'amorçage. Selon l'AFIC, 19 opérations
d'amorçage ont été conduites en France en 1993, mais
seulement 9 en 1995 et 4 l'année suivante.
L'ANVAR établit le même diagnostique. Ainsi, dans sa lettre
mensuelle de janvier 1999, après avoir rappelé que
l'activité du capital-investissement hexagonal avait progressé de
44 % entre 1996 et 1997 pour atteindre 8,3 milliards de francs, elle
s'inquiète du maillon faible que constitue le niveau
" foetal " des projets innovants. Elle constate qu'alors qu'aux
Etats-Unis, ce sont souvent des structures privées qui financent le
stade amont des projets (
seed money
), le capital d'amorçage n'en
est qu'à ses balbutiements en France.
Un fonds de capital risque axé sur l'amorçage et
géré par la Caisse des dépôts et consignations a
été mis en place en 1998 par l'Etat. 600 millions de francs
prélevés sur les recettes de l'ouverture du capital de France
Télécom lui ont été affectés. Il s'agit d'un
" fonds de fonds " destiné à prendre des participations
minoritaires dans des sociétés de capital risque privées
afin d'accroître l'effet de levier.
Il convient de se féliciter d'une telle initiative. Toutefois, comme le
note l'OCDE dans son rapport précité, on peut s'interroger
" sur son opportunité à un moment où les fonds de
capital risque privés éprouvent plus de difficultés
à trouver de bons projets qu'à réunir des
capitaux ".
Les nombreuses auditions effectuées par votre rapporteur pour avis lui
ont permis de constater que la France ne manquait ni d'argent à
investir, ni de projets d'entreprises. Une enquête récente de
l'Association pour la création d'entreprises (APCE) indique ainsi que
2,5 millions de nos compatriotes nourriraient l'idée d'entreprendre
et qu'1,2 million auraient un projet précis.
Il convient
dès lors d'aider les créateurs à transformer ces
idées en entreprises, c'est-à-dire à viabiliser des
projets qui ne sauraient perdurer sans conseils et financements
adéquats. Car sans étude approfondie sur la faisabilité,
sans
business plan
, un créateur n'a aucune chance de
séduire d'éventuels investisseurs.
Or,
il ressort des différentes auditions menées par votre
rapporteur pour avis que seules les entreprises qui recèlent un
potentiel de croissance important et qui justifient de lourds investissements
trouvent des lignes de financements auprès des organismes de collecte de
l'épargne à risque. A l'inverse, les projets plus modestes et
potentiellement moins prometteurs en termes de rentabilité ou de chiffre
d'affaires, ne sont pas retenus par les professionnels de la gestion
collective, même s'ils sont susceptibles de créer des emplois.
Ainsi, le coût de gestion d'un Fonds communs de placement dans
l'innovation (FCPI) oblige ses gestionnaires à privilégier un
nombre de lignes de financement limité, quitte à sacrifier de
plus petits projets dont la viabilité et la rentabilité seraient
pourtant avérés.
Votre rapporteur pour avis considère que ces petits projets pourraient
trouver les financements et les conseils qu'ils requièrent auprès
d'anciens entrepreneurs plus avertis si ces derniers pouvaient, par des mesures
fiscales adéquates, limiter le risque qu'ils prennent. Il s'agit de
mieux reconnaître le rôle des investisseurs providentiels ou
Business Angels
à travers des mesures fiscales incitatives. Il
convient également de desserrer les contraintes qui enserrent les
gestionnaires de FCPI dans le choix des entreprises cibles afin de faciliter
les placements.
Au total, la priorité consiste aujourd'hui, d'une part à
encourager le capital d'amorçage, et, d'autre part, à
mieux
faire coïncider les projets et les sources de
financement.
Enfin, le développement du capital risque ne saurait être
apprécié en dehors d'un contexte plus général que
l'on peut qualifier de défavorable à l'initiative privée.
Dans son rapport de 1997 consacré à la fiscalité de
l'épargne, M. Alain Lambert, alors Rapporteur
général, écrivait :
" la volonté de
favoriser une sorte de microclimat fiscal en faveur du capital risque a peu de
chances d'aboutir tant elle s'insère dans un environnement
défavorable à la création de richesses ".
Il est désormais établi que l'environnement fiscal et social
français est, en partie, à l'origine d'une " fuite des
cerveaux " vers les Etats-Unis ou le Royaume-Uni. Le départ de
jeunes Français hautement qualifiés devient d'autant plus
préoccupant qu'il revêt depuis quelques années une
dimension croissante. Selon les données du ministère des Affaires
étrangères, 131.109 Français s'étaient
expatriés aux Etats-Unis en 1990 ; ils étaient 233.277 en
1997, dont 51.961 étaient enregistrés au consulat de Los Angeles,
soit une progression de près de 78 % en sept ans. Tout laisse supposer
que la majorité d'entre eux sont des actifs salariés ou des
entrepreneurs.
Les raisons de ces départs ne sont pas toujours
précisément identifiables, en ce sens qu'elles tiennent davantage
à un environnement général marqué par une
accumulation d'obstacles à la création d'entreprises plutôt
qu'à un motif particulier. Des chefs d'entreprise ou des cadres
supérieurs peuvent choisir de s'expatrier en raison du niveau trop
élevé des charges sociales, d'une fiscalité excessive, de
tracasseries administratives ou d'un contrôle fiscal tatillon... Il est
donc essentiel d'introduire plus de souplesse dans cet environnement à
une époque où la mondialisation touche également la
" matière grise ".
CHAPITRE II
UN PROJET DE LOI CONSACRÉ ESSENTIELLEMENT À
L'AMÉLIORATION DU STATUT DES CHERCHEURS
I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX RÈGLES RELATIVES AUX PERSONNELS DE LA RECHERCHE
Le présent projet de loi comporte plusieurs dispositions donnant une plus grande souplesse aux règles régissant les personnels de la recherche.
A. LA CONCILIATION DES MISSIONS DE SERVICE PUBLIC ET DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES CHERCHEURS
L'article 1
er
, alinéa IV, du
présent
projet de loi tend à poser les règles juridiques permettant la
collaboration des personnels de la recherche avec les entreprises tout en
assurant la déontologie des fonctionnaires et la protection des droits
et intérêts des collectivités publiques. Il s'agit de
concilier les impératifs résultant des obligations
d'exclusivité professionnelle et de désintéressement,
affirmées par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires et sanctionnées par les
articles 432-12 et 432-13 du code pénal, avec la nécessaire
participation des chercheurs à la création ou au
développement d'entreprises qui ont des liens avec le laboratoire
où ils exercent.
Ainsi, à ce jour, les chercheurs ou enseignants-chercheurs doivent
être placés en position de disponibilité ou de
délégation avant de créer une entreprise et de pouvoir
négocier les contrats d'exploitation des résultats de la
recherche publique.
Cette contrainte est dissuasive car elle impose une
rupture dans une phase délicate de développement où la
prise de risque est importante
. Par ailleurs, le concours scientifique
apporté par un chercheur à une entreprise de valorisation
dépasse largement le champ des consultations et expertises couvert par
le décret-loi de 1936, lequel n'a envisagé que des consultations
ponctuelles.
L'article 2 du projet de loi vise à proposer un cadre juridique
clair et cohérent aux personnels de recherche qui souhaitent s'engager
dans la création d'une entreprise ou apporteur leur concours
scientifique à une entreprise valorisant leurs travaux ou encore
participer au rapprochement entre recherche et entreprise par la
présence dans des conseils d'administration de sociétés
anonymes, sans risquer des conflits d'intérêts, ni compromettre
leur carrière scientifique. Il s'insère dans la loi du
15 juillet 1982 sur l'orientation et la programmation de la recherche qui
confiait déjà aux personnels de recherche une mission de
transfert et d'application des connaissances dans les entreprises.
Le présent projet de loi propose trois dispositifs qui reposent sur
la mise en place d'un régime d'autorisation administrative
.
Néanmoins, pour le premier, ce régime se substitue à ceux
prévus par l'article 72 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat et par l'article 87 de la loi
n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie
économique et des procédures publiques. En effet, dès lors
que le chercheur aura été autorisé, après avis de
la commission de déontologie, à participer à la
création d'une entreprise aux fins de valorisation des résultats
de ses travaux, il n'aura pas à solliciter de nouveau une
décision de l'administration quand il souhaitera être placé
en disponibilité ou cesser définitivement ses fonctions publiques
pour se consacrer exclusivement à cette entreprise.
La commission de déontologie voit son rôle étendu
puisqu'elle est amenée à donner son avis avant que l'organisme de
recherche ne se prononce sur la demande d'autorisation dans les cas
visés aux nouveaux articles 25-1, 25-2 et 25-3.
Il convient, toutefois, de souligner que
le champ d'application
n'est
pas limité aux personnels des établissements publics à
caractère scientifique et technologique (EPST) visés à
l'article 7 de la loi du 15 juillet 1982 précitée mais
s'étend aux agents de tous les services publics ayant une mission de
recherche
ainsi que le prévoit l'article 14. Les agents non
fonctionnaires peuvent également, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, être autorisés à
participer à la valorisation de leurs travaux de recherche. Cette
disposition vise notamment les doctorants ou jeunes docteurs ayant un statut
d'agent non titulaire de l'Etat tels que les allocataires de recherche ou les
attachés temporaires d'enseignement et de recherches (ATER) ainsi que
les praticiens hospitaliers, personnels titulaires non régis par le
statut de la fonction publique.
L'extension À des enseignants associÉs et À des
universitaires ou chercheurs Étrangers de la participation aux organes
de recrutement des enseignants-chercheurs
Le deuxième alinéa de l'article 56 de la loi du
26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur
prévoit que l'examen des questions individuelles qui portent sur le
recrutement, l'affectation et la carrière des enseignants-chercheurs
relève, dans chacun des organes compétents, des seuls
représentants des enseignants-chercheurs et personnels titulaires
assimilés.
Il est prévu, à l'article 2, alinéa VI,
d'élargir aux organes de recrutement des enseignants-chercheurs les
dispositions applicables aux chercheurs permettant la participation
d'universitaires ou de chercheurs étrangers ainsi que d'enseignants
associés. L'enseignement supérieur bénéficiera
ainsi de leur expertise notamment dans les disciplines peu
représentées parmi les enseignants-chercheurs
titulaires.
B. L'EXTENSION DE L'ÉMÉRITAT AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ASSIMILÉS AUX PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS
Les
professeurs des universités bénéficient de
l'éméritat depuis l'intervention de la loi n° 84-434 du
13 septembre 1984, relative à la limite d'âge dans la
fonction publique.
Ces dispositions qui s'ajoutent à celles du maintien en activité,
prévu par la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986
qui donne la possibilité aux professeurs des universités de
continuer à exercer leurs fonctions, sur leur demande, jusqu'à
l'âge de 68 ans, permettent, notamment aux professeurs des
universités atteints par la limite d'âge, de continuer à
diriger des travaux de thèses après leur admission à la
retraite.
Les enseignants-chercheurs de rang magistral relevant de statuts
spécifiques étant naturellement amenés à effectuer
une grande partie de leur service sous forme de direction de thèses,
séminaires ou recherches, il convient de leur ouvrir la
possibilité déjà accordée à leurs homologues
universitaires, ce que réalise l'article 5.
II. LES MESURES FAVORISANT LE RAPPROCHEMENT DE LA RECHERCHE PUBLIQUE ET DES ENTREPRISES
L'insuffisance de la collaboration entre l'enseignement supérieur et la recherche mais aussi entre les entreprises et les laboratoires se constate tant sur le plan des structures. Or, la nécessité d'échanges étroits entre l'administration publique de la recherche et le monde de l'économie demeure un impératif catégorique du développement économique et social. Il s'agit donc d'assurer à la fois le transfert des connaissances et la valorisation des résultats de la recherche, tout en maintenant sinon en accroissant la capacité nationale de production des oeuvres scientifiques.
A. L'INSTAURATION D'UNE PROCÉDURE D'APPROBATION TACITE DE LA PARTICIPATION D'ORGANISMES PUBLICS DE RECHERCHE À DES STRUCTURES PRIVÉES DE COOPÉRATION
Actuellement, la procédure de création de
filiales ou
de sociétés communes nécessite un arrêté
interministériel d'approbation, qui implique parfois la signature de
plus de cinq ministres (tel est le cas pour FIST SA). Cette contrainte ne
permet pas toujours de satisfaire aux impératifs économiques de
rapidité, tels que la levée d'options pour l'achat ou la cession
d'actions, alors même que les ministères de tutelle ont
exprimé leur approbation lors de la délibération du
conseil d'administration des établissements publics concernés.
Par ailleurs, elle n'impose pas aux différentes autorités de
tutelle de délai au-delà duquel leur réponse serait
considérée comme acquise, et favorise donc l'accumulation des
retards dans l'instruction des dossiers.
Il apparaît donc nécessaire de rendre applicable aux EPST la
procédure en vigueur dans les autres catégories
d'établissements publics, notamment les établissements
d'enseignement supérieur et les établissements publics à
caractère industriel et commercial.
La mesure proposée par l'article 1
er
, alinéa II,
facilitera l'établissement de filiales de valorisation communes entre
les établissements de recherche et les entreprises et permettra de
développer le transfert de résultats de la recherche publique
vers l'économie privée.
B. L'EXTENSION AUX ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET AUX ORGANISMES PUBLICS DE RECHERCHE DE LA POSSIBILITÉ DE COTISER AUX ASSEDIC POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL
Les
établissements publics de l'Etat employant des agents non fonctionnaires
entrent dans le champ d'application de la législation des travailleurs
involontairement privés d'emploi en application de l'article L.351-3 du
code du travail. Leurs personnels ont droit à l'allocation d'assurance
chômage dans les mêmes conditions, les mêmes taux et la
même durée que les autres salariés.
Toutefois, pour la mise en oeuvre de cette indemnisation, les
établissements publics de l'Etat ne relèvent pas de l'article
L.351-4 du code du travail, mais de régimes particuliers décrits
à l'article L.351-12.
Le régime particulier qui est prévu pour les
établissements d'enseignement supérieur et les EPST est
particulièrement pénalisant pour les missions de collaboration
avec les entreprises et de transfert de technologie que ces
établissements doivent assurer.
Le principal inconvénient consiste dans les difficultés qu'ont
les EPST et les établissements d'enseignement supérieur à
recruter du personnel contractuel pour effectuer des recherches
financières par les entreprises ou par l'Union européenne. En
effet, ces établissements doivent assurer eux-mêmes le paiement
des indemnités pour perte d'emploi quand le programme de recherche vient
à son terme.
Ceci freine les collaborations entre les entreprises et organismes
d'enseignement supérieur et de recherche et constitue un obstacle
à la diffusion des résultats de la recherche.
La fragilité du dispositif actuel, et l'objectif de limiter
désormais l'intervention d'associations dans la gestion des contrats des
EPST et des établissements d'enseignement supérieur plaident donc
pour une modification du code du travail leur permettant de cotiser aux
ASSEDIC, ce que propose l'article 4.
C. L'ASSOCIATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ AU PROCESSUS DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
Les
actions d'innovation et de transfert de technologie réalisées par
les lycées d'enseignement général et technologique et les
lycées professionnels présentent de multiples avantages, autant
au plan pédagogique qu'au plan économique.
On évalue les établissements disposant des capacités pour
réaliser des transferts de technologie en faveur des PME/PMI à
une vingtaine en moyenne par académie, soit, à l'échelon
national, le tiers des lycées professionnels. A l'heure actuelle,
quelques lycées se sont d'ores et déjà engagés dans
cette voie mais hésitent à développer ce type d'actions du
fait de l'absence de cadre juridique adapté. Effectivement,
l'évolution des textes en vigueur constituera un message fort envers le
monde enseignant qui souffre d'une absence de reconnaissance dans leurs
démarches d'ouverture vers le monde économique.
Ce dispositif, prévu par l'article 6, ouvre deux modalités
d'intervention. Soit les actions sont organisées et
réalisées selon des conventions conclues par
l'établissement local d'enseignement avec une ou plusieurs entreprises.
Soit l'établissement s'engage dans un partenariat avec les autres
acteurs du développement économique local
- universités, chambres consulaires, entreprises, autres structures
de transfert de technologie - en constituant avec eux un groupement
d'intérêt public (GIP).
III. LA MISE EN PLACE DE STRUCTURES DE VALORISATION DE LA RECHERCHE
A. LA CRÉATION D'INCUBATEURS
Les
structures d'incubation au sein des universités et des organismes de
recherche jouent un rôle très important dans le
développement des jeunes entreprises de haute technologie, que ce soit
dans certains pays d'Europe (par exemple les Pays-Bas ou la Finlande) ou aux
Etats-Unis. Ces structures d'incubation offrent en effet à des porteurs
de projets ou à des entreprises déjà créées,
au-delà du partage d'infrastructures physiques, une panoplie de services
financiers, juridiques ou commerciaux ainsi qu'un environnement favorable
à la création et au développement de ces entreprises,
qu'il s'agisse de la proximité de centres de recherche ou de la mise en
relation avec les investisseurs. Ces services donnent lieu à une
contrepartie financière, même si celle-ci n'est pas toujours
payée au démarrage immédiat de l'entreprise.
En France, seuls quelques grands organismes ou universités ont
essayé de mettre en place des structures d'incubation, sans y parvenir
d'ailleurs toujours totalement.
Dans certains cas, la création de ces structures s'est heurtée
à des obstacles liés au manque de moyens financiers ou au manque
d'expérience de leurs dirigeants.
Mais, la plupart du temps, ce sont les problèmes juridiques qui ont
empêché la création de telles structures
. En effet, les
conditions dans lesquelles les universités et les organismes de
recherche peuvent mettre à la disposition des entreprises, par le biais
de ces incubateurs, des locaux et des moyens matériels et humains, ne
sont pas éclaircies, ce qui est de nature à mettre en jeu la
responsabilité des dirigeants devant la Cour des comptes et peut
éventuellement poser problème vis-à-vis des règles
de concurrence. Les présidents d'universités et les directeurs
d'organismes de recherche sont ainsi demandeurs de règles claires leur
permettant de bien conduire leur action de transfert de technologie et d'aide
à la création d'entreprises de haute technologie.
Les articles 1
er
et 2 ont pour objet de tracer le cadre
général des missions confiées aux structures d'incubation
et de donner une base juridique à la création de telles
structures, qui sera précisée par décret.
Les conditions dans lesquelles s'effectue la mise à disposition de
moyens aux entreprises seront approuvées par le conseil d'administration
de l'organisme de recherche et de l'université ou, le cas
échéant, de sa filiale.
Dans le cas où l'incubateur est créé sous forme de
filiale, une convention cadre établira les relations entre cette filiale
et l'organisme de recherche ou l'université.
A l'heure actuelle, moins d'une centaine d'entreprises de haute technologie
sont créées tous les ans en France et, parmi celles-ci, une
quarantaine le sont à l'initiative de chercheurs ou
d'enseignants-chercheurs. Un bilan de ces expériences montre notamment
que les entreprises créées à l'initiative de chercheurs
sont en moyenne trois fois plus créatrices d'emplois que les autres avec
un effectif moyen de onze salariés quelques années après
leur création.
Nombre d'entre elles sont promises à une forte croissance et on peut
déjà constater qu'une bonne fraction des entreprises candidates
à l'entrée sur le nouveau marché sont nées dans ces
conditions.
On recense actuellement quinze entreprises qui ont été
créées par des chercheurs de l'Institut national de recherche en
informatique et en automatique (INRIA). Depuis 10 ans, l'INRIA a
constitué un club informel de sociétés technologiques qui
réunit les entreprises créées dans sa mouvance. Au total,
ces sociétés emploient près de 850 personnes et produisent
un chiffre d'affaires cumulé voisin de 500 millions de francs. Trois de
ces entreprises sont des filiales, aujourd'hui minoritaires, de l'INRIA :
Simulog (informatique scientifique), Ilog (intelligence artificielle) et 02
Technologies (bases de données orientées objets). Ilog est
entrée au Nasdaq au début de 1997. Pour renforcer ce mouvement de
création et de développement de sociétés de haute
technologie, l'INRIA a créé, au début de 1998, une filiale
- INRIA-Transfert - qui est actionnaire à 34 % de la
société de gestion du fonds d'amorçage I-Source qui a
déjà levé près de 100 millions de francs.
A l'Institut national de la santé et de la recherche médicale
(INSERM), on recense treize entreprises représentant 600 emplois.
Dix-huit entreprises créées par des chercheurs mis en
disponibilité sont répertoriées au Centre national de la
recherche scientifique (CNRS), chiffre qui ne prend pas en compte les
entreprises créées avec le concours scientifique d'un chercheur
demeurant en activité.
Cinq entreprises ont été créées par des chercheurs
de l'Institut national de recherche agronomique (INRA). En outre, l'INRA est
partie prenante dans deux GIP, et a mis en place avec plusieurs partenaires le
groupement d'intérêt économique (GIE) Labogena dans le
domaine de la génétique animale. Elle participe également
à deux sociétés, l'une issue de la recherche, Transgene,
l'autre appartenant au secteur bancaire, Agrinova, pour soutenir le
développement des PME de la sphère agro-alimentaire.
Un fort développement de ces créations d'entreprises est attendu
dans le domaine des industries de la santé et des biotechnologies, comme
le montre le bilan positif des entreprises créées à partir
de travaux de l'INSERM qui commercialisent une centaine de réactifs de
recherche, une dizaine de dispositifs de génie biologique et
médical et un médicament.
B. LA CRÉATION DE SERVICES D'ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Les
activités industrielles et commerciales des établissements
d'enseignement supérieur s'exercent actuellement, soit au sein de
filiales ou de groupements d'intérêt public, lorsqu'elles sont
exercées en collaboration avec d'autres partenaires, soit au sein de
services internes des établissements. Elles représentent
20 % en moyenne des budgets des établissements et
s'élevaient à 1.995 millions de francs en 1991 et
2.458 millions de francs en 1995.
Cependant, toutes les activités de nature industrielle et commerciale
n'ont pas vocation à être confiées à des filiales,
en raison soit de la faiblesse relative ou du caractère temporaire de
ces activités, soit de leur rentabilité insuffisante. Il est par
ailleurs très difficile pour les établissements d'enseignement
supérieur de gérer ces activités au sein de services
internes, dan la mesure où les règles budgétaires et
comptables qui s'appliquent à ces services ne sont ni claires ni tout
à fait adaptées. Enfin, les établissements n'ont quasiment
pas la possibilité de recruter du personnel sur les ressources propres
tirées de ces activités. Les réflexions sur les moyens
permettant une adéquation entre les besoins de flexibilité de
gestion des activités commerciales et un contrôle rigoureux de
l'activité des établissements d'enseignement supérieur ont
amené à envisager la création de services
d'activités industrielles et commerciales, non dotés de la
personnalité morale.
La fonction de ces services serait d'organiser, avec les autres composantes et
services communs, les activités commerciales de l'établissement
en :
- déterminant une politique commerciale au niveau de
l'établissement ;
- fixant une politique tarifaire ;
- gérant matériellement les contrats.
La création de ces services dans les universités et les autres
établissements d'enseignement supérieur, avec des règles
de fonctionnement adaptées, constituerait ainsi une réponse aux
problèmes évoqués ci-dessus. Ils auraient vocation
à regrouper des activités comme la gestion des brevets, les
prestations de service, voire des activités éditoriales.
CHAPITRE III
UN VOLET FISCAL À ENRICHIR
Le
projet de loi qui nous est soumis ne comporte qu'une seule disposition fiscale
en faveur des entreprises innovantes. L'article 3 propose en effet
d'aménager le régime des bons de souscription de parts de
créateur d'entreprise créé en décembre 1997 afin
d'en élargir le champ d'application. Il propose d'en étendre le
bénéfice aux entreprises détenues à 25 % au
moins - au lieu de 75 % dans la rédaction actuelle - par
des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des
personnes physiques.
S'il convient de se réjouir d'un assouplissement opportun, on peut en
revanche s'étonner qu'un projet de loi destiné à
encourager l'innovation et la recherche n'aborde pas le problème du
financement des entreprises innovantes dont on a vu
1(
*
)
qu'il constituait un des obstacles majeurs à la
création d'entreprises de haute technologie.
Par ailleurs, le gouvernement a finalement renoncé à
insérer dans le présent projet de loi la réforme
d'ensemble des plans d'option sur action qu'il s'était engagé
devant le Sénat à présenter dans les meilleurs
délais, et dont il a d'ailleurs déjà rendu publiques les
grandes lignes.
I. UN PROJET DE LOI SILENCIEUX SUR LE FINANCEMENT DE L'INNOVATION
Le
financement de l'innovation est assuré par l'Etat essentiellement par
l'intermédiaire des aides de l'Agence nationale de valorisation de la
recherche (ANVAR). Pour le reste, il n'existe, à l'exception du
crédit d'impôt-recherche qui s'applique en cas d'augmentation des
dépenses de recherche
2(
*
)
, qu'un seul
mécanisme fiscal spécifiquement conçu pour financer les
entreprises innovantes. Il s'agit des fonds communs de placement dans
l'innovation (FCPI) créés par M. François d'Aubert en
décembre 1996.
Compte tenu de leurs coûts d'expertise et de gestion, ces fonds
n'investissent pour l'essentiel que dans des sociétés non
cotées qui se trouvent déjà dans une phase de
post-amorçage. Seules les " grosses Start Up " ont une chance
de trouver des fonds. En outre, le champ d'investissement des FCPI
s'avère excessivement restrictif, les conduisant à se livrer une
concurrence sévère pour placer les importantes sommes
collectées (1,2 milliard de francs).
Or, on l'a vu plus haut,
le maillon faible de la chaîne de financement
de l'entreprise innovante est la phase d'amorçage
,
c'est-à-dire la transformation d'une idée en une entreprise
viable et potentiellement créatrice d'emplois. Une fois
réalisé l'amorçage du processus qui conduira au lancement
du produit sur le marché, le financement des phases de
développement du produit, de son industrialisation, et de sa
commercialisation fait appel à des outils financiers bien
expérimentés (sociétés de capital-risque,
financements bancaires, FCPI).
Il convient dès lors d'essayer de drainer des fonds en provenance des
épargnants de proximité ou des investisseurs providentiels. C'est
l'objectif de la loi dite " Madelin " qui a institué une
réduction d'impôt pour souscription au capital de
sociétés non cotées. Toutefois, cette aide fiscale qui
aboutit à réduire le risque d'un quart, ne draine que
relativement peu de capitaux en raison de plafonds de souscription trop
restrictifs.
Votre rapporteur pour avis vous proposera en conséquence
d'améliorer les dispositifs existants et de créer un dispositif
spécifique pour les " Investisseurs providentiels " qui
souhaiteraient consacrer une partie de leurs économies au financement
d'entreprises innovantes.
A. AMÉNAGER LE DISPOSITIF DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION
1. Les Fonds communs de placement dans l'innovation
Créés par la loi de finances pour 1997, les fonds communs de placements dans l'innovation (FCPI) sont une sous-catégorie de fonds communs de placements à risques (FCPR) qui viennent eux-mêmes se placer au sein des FCP, eux-mêmes placés au sein des OPCVM. Ils présentent deux caractéristiques : des contraintes de gestion et d'investissement spécifiques par rapport aux FCPR, un régime fiscal plus avantageux entre les mains des détenteurs de parts.
a) Des contraintes d'allocations d'actifs spécifiques
La
spécificité des FCPI au sein des FCPR porte exclusivement sur
leurs contraintes d'allocations d'actifs.
L'actif de ces fonds doit en effet être constitué pour 60 %
au moins
3(
*
)
de valeurs mobilières, parts
de SARL et avances en comptes courants
4(
*
)
émises par des sociétés remplissant les conditions
suivantes :
Être soumises à l'impôt sur les
sociétés ;
Compter moins de 500 salariés ;
Être majoritairement détenues par des personnes physiques ou
par des personnes morales détenues par des personnes physiques
5(
*
)
;
Être innovantes. Cette condition s'apprécie au regard de
l'un ou l'autre des deux critères suivants :
- avoir réalisé, au cours des trois exercices
précédents, des dépenses de recherche d'un montant au
moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé
réalisé au cours de ces trois exercices (c'est la condition
donnant accès au crédit d'impôt recherche) ;
- ou justifier de la création de produits, procédés ou
techniques dont le caractère innovant et les perspectives de
développement économiques sont reconnus, ainsi que le besoin de
financement correspondant. Le décret n° 97-237 du 14 mars 1997
a désigné l'ANVAR comme organisme délivrant
l'agrément pour une durée de trois ans.
En pratique, la quasi-totalité des sociétés qui figurent
dans l'actif des FCPI ont été agrées par l'ANVAR, surtout
lorsque leurs dépenses n'entrent pas dans le champ d'application du
crédit d'impôt recherche. C'est évidemment le cas des
entreprises nouvelles.
b) Un régime fiscal avantageux
Les
souscriptions de parts de FCPI effectuées par des particuliers entre le
1
er
janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ouvrent droit
à une réduction d'impôt de 25 % du montant des
versements, dans une limite de 75 000 francs pour les contribuables
célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 francs
pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction
d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions
(PEA).
Très classiquement, une reprise d'impôt est prévue lorsque
les conditions pour bénéficier de l'avantage fiscal ne sont plus
remplies. Outre les conditions propres au FCPI, celles-ci sont de deux
ordres :
- l'engagement de conserver les parts pendant au moins cinq ans ;
- l'interdiction de détenir en famille plus de 10 % des parts
du fonds ou plus de 25 % des droits dans les bénéfices des
sociétés figurant dans l'actif du fonds, et ce depuis au moins
cinq ans avant la souscription au fonds ou l'intégration des titres
considérés dans le fonds.
Ces deux conditions sont très proches de celles retenues pour le droit
commun des FCPR. Elles sont destinées à favoriser la
détention de titres à long terme, nécessaire à la
logique du financement en fonds propres, et à éviter le
détournement du dispositif à des fins d'optimisation fiscale.
Enfin, comme pour les FCPR, les revenus et les plus-values à la sortie
sont exonérés d'impôt (hormis le CSG et la CRDS) à
condition que les parts du FCPI aient été conservées
pendant cinq ans.
Étant donné la spécificité des FCPI, les gains
devraient surtout s'observer sur les dernières années de
détention, lorsque les entreprises sélectionnées auront
pleinement tiré profit de leurs marché. S'il l'on prend une
hypothèse de rendement de 6 %, l'avantage fiscal permet de porter
la rentabilité à près de 10 % l'an.
2. Des placements contraints
Les FCPI
rencontrent un grand succès auprès des épargnants depuis
leur création en décembre 1996, au point que certaines demandes
risquent de ne pas être toutes satisfaites malgré une offre plus
abondante en 1998. Certaines banques réservent les FCPI à leurs
meilleurs clients.
Ainsi, à l'heure où ce rapport est mis sous presse, le montant de
la collecte de capitaux placés dans les quelques dix FCPI existants est
évalué à 1,2 milliard de francs (340 millions de francs
collectés en 1997 et 800 millions francs en 1998). Les FCPI
disposent de deux exercices pour investir 60 % de ces sommes dans des
sociétés innovantes non cotées de moins de 500
salariés. Jusqu'à présent, ils ont pratiquement tous
placé environ la moitié du quota exigé, soit 30 % des
capitaux collectés, ce qui représente au total une centaine de
millions de francs en 1997. Toutefois, une forte concurrence s'exerce entre eux
pour placer le reste des sommes.
Or, la principale difficulté du capital-investissement est la
sélection des entreprises où investir : celles ayant un fort
potentiel sont rares par nature et cette rareté est accentuée par
les conditions législatives et réglementaires.
Le dispositif des FCPI souffre en effet d'un double goulot
d'étranglement :
- à l'entrée, rares sont les entreprises qui satisfont à
l'ensemble des conditions d'éligibilité ;
- au cours de la vie du FCPI, encore moins nombreuses sont les entreprises qui
continuent de satisfaire à l'ensemble des conditions sur la
durée. Or, il est nécessaire qu'une entreprise demeure
suffisamment longtemps dans le portefeuille de participations d'un FCPI pour
que celui-ci puisse en retirer tous les fruits et réaliser des
plus-values.
3. Des aménagements jusqu'à présent insuffisants
Le
régime des FCPI a été aménagé à deux
reprises depuis décembre 1996 :
- s'agissant de la condition relative à la détention majoritaire,
par des personnes physiques, du capital des sociétés dont les
titres peuvent figurer dans le quota de 60 % des FCPI, la loi de finances
rectificative pour 1997 a proposé de ne pas tenir compte de
l'éventuelle participation d'organismes ayant vocation à soutenir
le capital-investissement et l'innovation (sociétés de
capital-risque, sociétés de développement régional,
sociétés financières d'innovation, fonds communs de
placements à risques et FCPI). Un tel assouplissement a levé un
obstacle important aux possibilités d'investissement des FCPI. En effet,
les entreprises innovantes étant peu nombreuses, les mêmes
investisseurs en capital ont tendance à se retrouver dans les
différents tours de table.
- la loi de finances pour 1999 a de nouveau assoupli les conditions
d'éligibilité des sociétés en appréciant au
moment de l'investissement initial les conditions relatives au caractère
innovant et au nombre de salariés de ces sociétés, et non
pas tout au long de la vie du FCPI. Cette même loi a prorogé
jusqu'au 31 décembre 2001 le bénéfice de la
réduction d'impôt pour souscription au capital d'un FCPI.
Toutefois, votre rapporteur pour avis rejoint le rapporteur
général du budget pour considérer que
ces
aménagements restent insuffisants
.
En particulier, et en dépit de la neutralisation des participations des
organismes spécialisés dans le capital-investissement,
la
condition relative à la détention majoritaire du capital des
entreprises éligibles par des personnes physiques est jugée
draconienne par les sociétés gestionnaires de FCPI
dans la
mesure où - à la différence des autres
conditions -
elle continue d'être appréciée tout au
long de la présence de la société dans le FCPI
.
Or, les besoins de financement sont souvent tels pour une entreprise de
croissance que
la part du capital détenue par des personnes physiques
est progressivement diluée
à l'occasion des augmentations de
capital successives jusqu'à devenir minoritaire. Il est en effet rare
qu'une personne physique puisse " remettre au pot " à chaque
étape de la croissance de son entreprise. Les gérants de FCPI
peuvent ainsi être amenés à se déposséder de
leur participation dans une société à très fort
potentiel de croissance au moment où les besoins de financement de cette
dernière l'obligent à ouvrir la majorité de son capital
à des personnes morales (par exemple des établissements
financiers) et avant d'avoir pu rentabiliser son investissement.
Le gouvernement est lui même sensible à ce problème
puisqu'il propose de ramener de 75 % à 25 % la part du capital
qui doit être détenue par des personnes physiques ou des personnes
morales détenues par des personnes physiques, afin que cette entreprise
puisse émettre des bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise (BSPCE). On peut ainsi lire dans l'exposé des motifs du
présent projet de loi :
" Cette mesure étendra le champ d'application de ce dispositif
aux entreprises innovantes créées par des inventeurs ou des
chercheurs, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas les moyens de
posséder une part importante du capital et où ils doivent
s'associer à des investisseurs industriels. Elle permettra
également à ces entreprises de continuer à émettre
des BSPCE en phase de croissance, lorsqu'elles ouvriront leur
capital. "
4. Un élargissement nécessaire du champ des entreprises éligibles
Votre
rapporteur estime qu'un relâchement de certaines contraintes
législatives et réglementaires s'impose, d'une part pour
faciliter le placement par les FCPI de l'argent collecté, et d'autre
part pour ne pas obliger un FCPI à revendre ses parts dans une
société dont la réussite l'amènerait à ne
plus remplir la condition de détention majoritaire du capital par des
personnes physiques.
En effet, votre rapporteur pour avis considère que le ciblage
volontairement restrictif des sociétés éligibles au quota
de 60 % des FCPI ne doit pas avoir pour corollaire une diminution de la
qualité des investissements que les FCPI sont appelés à
réaliser et, en conséquence, un accroissement du risque pris, au
détriment des épargnants.
Mais surtout, en imposant un critère de détention par des
personnes physiques,
il n'entrait pas dans la volonté initiale du
législateur de restreindre à l'excès le champ des
sociétés éligibles mais d'empêcher
l'éligibilité aux FCPI des filiales de grands groupes
.
En effet, si l'on se reporte au rapport de la commission des finances du
Sénat sur la loi de finances rectificative pour 1997
6(
*
)
, on y lit sous la plume d'Alain Lambert, alors
rapporteur général :
" Le régime des FCPI est
bâti pour bénéficier à d'authentiques jeunes PME
innovantes, de façon à éviter son détournement au
profit de filiales créées de toutes pièces à cette
fin par de grands groupes, risque qui existe dans la plupart des dispositifs
réservés aux PME ".
De même, le rapport de M. Didier Migaud, rapporteur
général de la commission des finances de l'Assemblée
nationale, souligne
7(
*
)
:
" Cette
disposition a pour but d'éviter la création de filiales ad hoc
dont les titres seraient éligibles aux FCPI, alors même qu'elles
seraient en situation de dépendance vis-à-vis de grandes
sociétés ".
La rédaction retenue s'inspirait alors de la définition
communautaire des petites et moyennes entreprises
8(
*
)
. Toutefois, il est tout à fait envisageable
d'adopter une rédaction qui permette d'exclure les filiales de grands
groupes tout en permettant l'ouverture du capital des PME éligibles
à d'autres partenaires financiers. C'est ce que vous proposera votre
commission.
Un tel amendement ne devrait pas avoir de conséquences sur la
dépense fiscale dès lors que les fonds ont déjà
été collectés et qu'il s'agit juste de supprimer un goulot
d'étranglement à la sortie. En effet, cette mesure vise à
étendre le nombre des entreprises éligibles et non à
augmenter le nombre de souscripteurs de parts de FCPI.
Par ailleurs, il ressort des auditions réalisées par votre
rapporteur pour avis qu'une autre contrainte peut être pénalisante
pour les sociétés qui souhaitent ouvrir leur capital à un
FCPI. Il s'agit de l'impossibilité pour un FCPI d'investir dans une
holding qui détiendrait à hauteur de 90 % de ses actifs des
participations dans des sociétés innovantes répondant aux
conditions d'éligibilité.
Or, il peut être intéressant pour un créateur d'entreprise
de détenir son entreprise par l'intermédiaire d'une
société holding, ce mode de structuration lui permettant
notamment de conserver le contrôle majoritaire de la
société en cas de dilution du capital suite à
l'arrivée d'investisseurs ayant une plus grande surface
financière.
Un tel assouplissement est d'ailleurs prévu pour les
sociétés de capital risque en vertu de l'instruction 4
H-2-92 du 14 janvier 1992. Il est ainsi admis que les titres d'une
société holding qui détient 90 % de ses actifs
immobilisés et de ses placements en participations dans une
société qui répond aux conditions prévues pour que
ses titres soient inclus dans le portefeuille exonéré en cas de
participation directe de la SCR, soient pris en compte dans le quota de
50 % des SCR, à condition que la société holding
participe activement à la gestion et au contrôle des
sociétés non cotée dans lesquelles elle détient des
actions ou des parts.
B. RELEVER LES PLAFONDS D'INVESTISSEMENTS DE LA LOI MADELIN
Les
166.000 entreprises créées en France en 1997 ont mobilisé
environ 18 milliards de francs. Ces fonds proviennent d'une part du financement
public (pour en moyenne 20 %) sous forme d'aides diverses et notamment
locales, d'autre part du concours bancaire (pour environ 22 % des projets)
et enfin de la mobilisation de l'épargne du créateur ou de ses
proches (pour les 58 % restants).
Cette dernière a été fortement encouragée par la
loi dite " Madelin " du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle qui a institué un
dispositif d'aide à la mobilisation de l'épargne de
proximité en faveur des petites et moyennes entreprises.
Une réduction d'impôt de 25 % est ainsi accordée aux
personnes physiques qui souscrivent en numéraire au capital initial ou
aux augmentations de capital de sociétés non cotées entre
le 1
er
janvier 1994 et le 31 décembre 2001
9(
*
)
.
Toutefois, les versements ne sont retenus dans la limite de 37.500 francs pour
un célibataire et de 75.000 francs pour un couple marié.
L'avantage fiscal est accordé lorsque les trois conditions suivantes
sont remplies simultanément :
la société est soumise à l'IS dans les conditions de
droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou
artisanal ;
en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la
société n'a pas excédé 260 millions de francs ou le
total du bilan n'a pas excédé 175 millions de francs au cours de
l'exercice précédent
10(
*
)
;
le capital de la société est détenu majoritairement par
des personnes physiques soit directement, soit par l'intermédiaire de
" holdings " familiaux.
On le voit, par construction, ce dispositif s'adresse essentiellement aux
personnes qui connaissent le dirigeant de l'entreprise ou qui sont suffisamment
informés des performances de cette dernière.
En outre, le bénéfice de cette réduction d'impôt
n'est définitivement acquis que si le contribuable conserve ses titres
durant cinq ans.
Enfin, le bénéfice de la réduction d'impôt ne peut
se cumuler avec d'autres avantages fiscaux et les actions ou parts qui ont
ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent figurer dans
un plan d'épargne en actions.
Selon le fascicule budgétaire " Voies et moyens "
annexé au projet de loi de finances pour 1999, la dépense fiscale
résultant pour l'Etat d'une telle réduction d'impôt est
estimée à 360 millions de francs pour 1997
11(
*
)
et évaluée à
380 millions de
francs pour 1998
.
" Force est de constater ",
écrit Jacques Singer,
président du salon des entrepreneurs et rapporteur du livre blanc de la
création d'entreprise publié en octobre 1998,
" que cet
ensemble reste insuffisant, si l'on s'en tient notamment au sentiment de
difficulté qui habite les créateurs potentiels, qui placent, pour
près de la moitié d'entre eux, le problème du financement
de leur projet comme frein majeur à l'aboutissement de sa
réalisation ".
" Si les Français épargnent chaque année un montant
significatif de leurs ressources, ils le font dans des placements en
général peu risqués et très souvent assortis d'une
défiscalisation plus ou moins importante. Cette épargne ainsi
collectée ne va que très rarement dans des projets de
création d'entreprise ".
Eu égard aux risques importants qui sont attachés à la
souscription directe au capital de sociétés non cotées,
votre commission estime qu'il convient de dynamiser le dispositif de la loi
Madelin en doublant les plafonds de versements donnant droit à la
réduction d'impôt et en supprimant tout délai de
souscription dans le temps.
Cette proposition avait été adoptée par le Sénat
à l'occasion de l'article 94 de la loi de finances mais
écartée par le gouvernement au motif que les plafonds de
versements actuels ne sont pas atteints par une majorité de redevables
de l'impôt sur le revenu
12(
*
)
.
M. Christian Sautter déclarait ainsi :
" En ce qui concerne les célibataires, 11.000 foyers fiscaux sur
66.000 atteignent [la limite de 75.000 francs], soit à peine
17 % et 900 foyers fiscaux sur 3.500 sont concernés par la seconde
limite [150.000 francs], c'est-à-dire à peu près le
quart ".
Le ministre du budget faisait cependant allusion aux plafonds
de versements donnant droit à une réduction d'impôt au
titre des souscriptions de parts de FCPI qui représentent le double des
plafonds actuels de la loi Madelin.
Votre commission vous proposera par conséquent d'aligner les plafonds de
versements donnant droit à la réduction d'impôt au titre
des souscriptions directes au capital de sociétés non
cotées sur ceux des FCPI.
Il n'y a en effet aucune raison de ne pas
accorder un avantage fiscal aussi puissant que celui accordé aux
souscripteurs de parts de FCPI dès lors que le risque pris par un
investisseur en direct est équivalent voire plus important que celui
pris dans le cadre des FCPI
dont le rôle est
précisément de mutualiser et de circonscrire les risques par des
contraintes de dispersion des placements.
Enfin, une telle augmentation des plafonds de souscription de la loi Madelin et
sa pérennisation dans le temps montrerait que la création
d'entreprises est une priorité nationale et qu'elle dépend de
l'effort de tous les Français.
C. ENCOURAGER L'ENTRÉE DES " INVESTISSEURS PROVIDENTIELS " DANS LE CAPITAL DES SOCIÉTÉS INNOVANTES
Le
capital d'amorçage permet le financement des premiers besoins de
l'entreprise et représente à ce titre un véritable enjeu.
En France, il est apporté par les fondateurs eux-mêmes ou leur
entourage proche, plus rarement par des investisseurs privés
(" Investisseurs providentiels "). Seuls les dossiers exceptionnels,
proches du zéro défaut, trouvent aujourd'hui des fonds
auprès de ces derniers.
Les " investisseurs providentiels ", créateurs d'entreprises
ou investisseurs privés ayant fait fortune et souhaitant à leur
tour aider d'autres à créer leur entreprise, sont très
actifs aux Etats-Unis où ils financent une grosse partie des besoins
initiaux des " Start Up ". En France, ils sont encore peu nombreux
même si, fédérés au sein de l'association
Leonardo
, leur nombre tend à augmenter.
En effet, en raison d'une fiscalité du patrimoine prohibitive
13(
*
)
(droits d'enregistrement en cas de transmission
d'entreprises, impôt de solidarité sur la fortune),
nombreux
sont les chefs d'entreprise français ayant réussi qui
s'expatrient dans des pays à l'environnement fiscal plus
clément
. Ce sont ainsi entre 600 et 1.500 milliards de francs qui
sont sortis de France depuis deux ans selon différentes sources
dont l'association des moyennes entreprises patrimoniales (ASMEP).
Un facteur aggravant a probablement été la limitation du
mécanisme de plafonnement de la cotisation d'impôt de
solidarité sur la fortune en fonction du revenu disponible en
décembre 1995. En effet, cette mesure oblige désormais certains
redevables de l'ISF à aliéner une partie de leur patrimoine pour
payer leur cotisation. Le Sénat préconise depuis avec constance
le retour au régime de plafonnement du total de l'ISF et de
l'impôt sur le revenu en fonction des revenus disponibles instauré
en décembre 1990, mais il se heurte à l'opposition de la
majorité gouvernementale. Il semble que le gouvernement n'ait pas pris
conscience des
effets pervers d'une fiscalité confiscatoire
puisque la dernière loi de finances a encore alourdi la fiscalité
pesant sur les très hauts revenus en élargissant l'assiette
globale de revenus en fonction de laquelle est plafonné l'impôt
des redevables de l'ISF
14(
*
)
.
Plutôt que de laisser perdurer un mouvement qui devient
préoccupant, votre commission estime qu'
il convient d'atténuer
le prélèvement fiscal des dirigeants d'entreprises qui
réinvestissent en France le produit de leur réussite
entrepreneuriale dans de jeunes entreprises innovantes
en création.
Elle vous proposera ainsi une disposition tendant à permettre aux
redevables de l'ISF de réduire leur cotisation à proportion de
20 % de leurs investissements dans des sociétés innovantes.
Cette mesure ne serait évidemment pas cumulable avec d'autres
dispositifs fiscaux incitatifs tels la loi Madelin.
II. UN PROJET DE LOI TIMORÉ EN MATIÈRE DE STOCK-OPTIONS
Le
Gouvernement s'est à plusieurs reprises engagé devant le
Sénat à proposer une réforme d'ensemble des stock-options
dans le cadre du présent projet de loi.
Le 27 mai 1998, en réponse à M. Alain Lambert, rapporteur
général, qui présentait dans le cadre du DDOEF un
amendement tendant à prévenir les délits d'initiés
en matière de stock-options, M. Christian Sautter, secrétaire
d'Etat au budget, répondait : "
le Gouvernement est défavorable
à cet amendement, car il compte réviser en profondeur le
régime des plans d'option. Afin que cette réforme ne soit pas
abordée de façon partielle, il souhaite que M. le rapporteur
retire son amendement. La Haute Assemblée pourra examiner
ultérieurement un dispositif complet qui lui sera
présenté
."
Le 7 décembre 1998, en réponse à M. Philippe Marini,
rapporteur général, qui présentait dans le cadre de la loi
de finances pour 1999 un amendement tendant à revenir au taux
d'imposition de 16 % pour les stock-options, M. Christian Sautter,
secrétaire d'Etat au budget, répondait : "
le Gouvernement
,
comme l'a annoncé le premier ministre, le 12 mai dernier lors des
assises de l'innovation, prépare un réaménagement complet
du dispositif des bons de souscription de façon à le rendre
parfaitement favorable à la création d'entreprises, à la
création de richesses et à la création d'emplois."
La procédure d'engagement de cette réforme législative a
été poussée très loin. Un avant-projet a
été communiqué au conseil d'administration de l'ACOSS,
dont les grandes lignes ont été annoncées par le ministre
de l'économie et des finances et largement diffusées dans la
presse.
Néanmoins, peu avant l'adoption du présent projet de loi par le
conseil des ministres, le Gouvernement a décidé d'en retirer le
volet relatif aux options de souscription ou d'achat d'actions, face aux
réticences de principe de sa propre majorité. Le motif
officiellement invoqué est que le Conseil d'Etat aurait demandé
la disjonction des dispositions incriminées, en raison de leur
caractère trop éloigné de l'objet du projet de loi.
Sur un plan juridique, votre rapporteur pour avis observe que le Gouvernement
n'est pas tenu par les avis du Conseil d'Etat, et qu'il dispose d'une grande
liberté pour déterminer le périmètre des projets de
loi qu'il soumet au Parlement. D'ailleurs, le Gouvernement n'a pas
hésité à faire un usage généreux de cette
faculté pour certains textes récemment examinés par votre
commission des finances, tel le dernier DDOEF, qui comportait une cinquantaine
d'articles dans son texte initial et plus d'une centaine dans son texte
définitif, y compris l'ensemble des dispositions nécessaires au
passage à l'euro.
En tout état de cause, votre rapporteur pour avis se félicite que
le Gouvernement ait maintenu dans son texte initial l'article 3, relatif aux
bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE). Cette
modeste disposition fiscale fonde juridiquement le droit du Parlement à
introduire dans le texte un volet plus ambitieux sur les stock-options, dont
les BSPCE ne sont qu'une variante.
Sur un plan politique, votre commission des finances juge non seulement
opportun, mais urgent de remettre à plat le système des stock
options, ainsi qu'elle le réclame depuis de nombreuses
années.
A. LE DURCISSEMENT RÉCENT DU RÉGIME DES PLANS D'OPTIONS SUR ACTIONS
1. Le mécanisme des plans d'options sur actions
Directement inspiré du
stock options plan
anglo-saxon,
le plan d'options sur actions a été introduit en droit
français par une loi du 31 décembre 1970, qui a
complété la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales par les articles 208-1 à 208-8
relatifs aux options de souscription ou d'achat d'actions.
Il s'agit d'une forme mixte d'intéressement et de participation au
capital, dans laquelle l'entreprise consent à son personnel le droit
d'acquérir ses propres actions à des conditions
privilégiées, lui offrant ainsi l'opportunité de
réaliser une plus-value spécifique.
Son principe est simple. Le mécanisme s'inscrit dans le temps pour se
décomposer en trois étapes bien distinctes.
L'attribution
:
la société attribue au
bénéficiaire le droit, pendant une période donnée,
de se porter acquéreur d'un certain nombre de titres à un prix
déterminé. Ce prix, éventuellement inférieur au
prix du marché, reste fixe pendant toute la période durant
laquelle le droit, ou "option", est ouvert au bénéficiaire.
La levée
:
le bénéficiaire choisit de
"lever" l'option qui lui a été attribuée,
c'est-à-dire d'exercer son droit d'acquisition. Bien entendu, il n'a
intérêt à le faire que si le cours, pour les actions
cotées, ou la valeur, pour les actions non cotées, se sont
maintenus ou ont progressé au-delà du prix invariable
initialement fixé lors de l'attribution de l'option : il
réalise alors une
plus-value dite d'acquisition
. Cette
étape implique pour lui une sortie de fonds, puisqu'il doit payer au
prix convenu les actions sur lesquelles portait son option.
La cession
: le bénéficiaire revend les actions
qu'il a acquises sur option
15(
*
)
. Ce n'est
qu'à ce stade qu'il rentre dans ses fonds et que la plus-value
d'acquisition, jusque là virtuelle, se concrétise. Il peut par
ailleurs réaliser une
plus-value supplémentaire, dite de
cession
, si la valeur des actions a continué de s'apprécier
depuis la levée de l'option.
Cette troisième et dernière étape constitue le fait
générateur de l'impôt pour l'ensemble du processus.
Ainsi, le gain retiré d'un plan d'options sur actions est
différé, aléatoire et lié à la contribution
des bénéficiaires à la prospérité de
l'entreprise.
Ces trois caractéristiques font du plan d'options sur
actions un instrument remarquablement efficace de motivation et de
fidélisation des cadres supérieurs et dirigeants des
sociétés.
2. Un régime fiscal et social avantageux jusqu'en 1995
Comme
les autres mécanismes d'intéressement et de participation, le
plan d'options sur actions bénéficie d'un régime fiscal et
social avantageux. Ou plutôt, bénéficiait d'un
régime avantageux jusqu'en 1995. Car l'évolution récente
de la législation a beaucoup réduit l'intérêt d'un
dispositif qui reste délicat à gérer pour les
sociétés, et aléatoire pour les intéressés.
Le mécanisme des plans sur options est avantageux à la fois pour
la société qui attribue les options et pour le
bénéficiaire.
Pour la société
Indépendamment de son pouvoir de motivation du personnel, le plan
d'options sur actions est une forme de rémunération
particulièrement intéressante pour l'entreprise au regard de
l'impôt et des cotisations sociales.
Tout d'abord, l'avantage représenté par la plus-value
d'acquisition (différence entre le prix de souscription ou d'achat et la
valeur réelle de l'action à la date de la levée de
l'option) était
exonérée des cotisations patronales de
sécurité sociale ainsi que de toutes taxes assises sur les
salaires.
Toutefois, cette exonération ne suffirait pas à rendre les plans
d'option plus avantageux pour la société que les formes
classiques de rémunération si les coûts correspondants
n'étaient pas fiscalement considérés comme des charges
déductibles du résultat imposable.
Tel n'était pas le cas dans le régime initial des plans d'options
sur actions, et cette possibilité fondamentale de déduction a
été introduite par la loi du 9 juillet 1984 sur le
développement de l'initiative économique. Ainsi,
l'article 217 quinquies du code général des
impôts, tel qu'il résulte de cette loi, dispose que
"pour la
détermination de leurs résultats fiscaux,
les
sociétés peuvent déduire les charges exposées du
fait de la levée des options
de souscription ou d'achat d'actions
consenties à leurs salariés"
. C'est-à-dire :
- les frais de rachat des titres destinés à être remis au
personnel, lorsqu'il s'agit d'options d'achat ;
- les frais d'augmentation de capital, lorsqu'il s'agit d'options de
souscription ;
- les frais de gestion des actions rachetées ou émises
jusqu'à la date de levée de l'option ;
- et surtout, les moins-values résultant pour la société
de la différence entre le prix d'achat et la valeur réelle des
actions.
Le coût des plans d'options sur actions se trouve ainsi fiscalement
neutralisé pour la société qui recourt à cet
instrument.
Pour le bénéficiaire
En principe, la plus-value d'acquisition réalisée par le
bénéficiaire d'une option est considérée comme un
complément de salaire et soumise comme tel à l'impôt sur le
revenu (article 80 bis I du code général des
impôts). La taxation de cet avantage n'a pas lieu lors de la levée
de l'option, mais lors de la cession des actions. Il est alors fait application
d'un système de quotient destiné à atténuer les
effets de la progressivité de l'impôt, qui prend en compte le
nombre d'années entières écoulées entre la date
d'attribution de l'option et la date de cession des titres
(article 163 bis C II du code général des
impôts).
Toutefois, l'avantage peut être soumis à un régime
d'imposition plus favorable, sous réserve de deux conditions
(article 163 bis C I du code général des
impôts) :
- les actions acquises doivent revêtir la forme nominative ;
- elles doivent demeurer indisponibles pendant une période de cinq
années à compter de la date d'attribution de l'option (et non de
sa levée).
Si ces deux conditions sont remplies, la plus-value d'acquisition
était taxée antérieurement à 1996, toujours lors de
la cession des titres, selon le régime des plus-values
mobilières, au taux de 16 %.
Il est prévu par ailleurs un certain nombre de cas de force majeure
où le possesseur d'actions acquises sur options peut exceptionnellement
disposer de ses titres avant l'expiration du délai
d'indisponibilité de cinq ans, sans perdre pour autant le
bénéfice de ce régime d'imposition conditionné.
Ces hypothèses correspondent à certaines de celles qui autorisent
le déblocage anticipé des fonds issus de la participation :
- licenciement du titulaire ;
- mise à la retraite du titulaire ;
- invalidité du titulaire ;
- décès du titulaire (au profit de ses héritiers).
Ce régime d'imposition est sensiblement plus avantageux que le
précédent, puisque le taux d'imposition des plus-values
mobilières est très inférieur au taux marginal
d'impôt sur le revenu généralement atteint par les
bénéficiaires d'options.
Cela explique qu'en pratique la
quasi-totalité des bénéficiaires d'options respectent le
délai fiscal d'indisponibilité, pour se placer sous le
régime d'imposition le plus favorable.
Enfin, l'avantage résultant de la levée d'options était
exonéré, antérieurement à 1997, de toute cotisation
salariale de sécurité sociale. Il est en revanche soumis à
la CSG et à la CRDS, au titre des revenus salariaux ou au titre des
revenus du patrimoine, selon les cas.
3. Un amoindrissement récent des avantages fiscaux et sociaux
Depuis
son instauration par la loi n° 70-1322 du 31 décembre
1970, le mécanisme des options de souscription ou d'achat d'actions a
connu un
amoindrissement progressif des avantages fiscaux
qui lui sont
attachés.
Exception notable en sens inverse, l'article 39 de la première loi
de finances rectificative pour 1993 a
supprimé le délai de
portage d'un an
entre la levée de l'option et la cession des titres,
que devait respecter le bénéficiaire pour avoir droit au
traitement fiscal le plus avantageux.
Mais depuis ce dernier assouplissement, toutes les évolutions de la
législation fiscale et sociale applicable aux options de souscription ou
d'achat d'actions se sont faites
dans un sens moins favorable :
-
l'article 49 de la loi portant diverses dispositions d'ordre social
du 4 février 1995 a
soumis aux cotisations sociales
la part
excédant 5 % du rabais consenti sur le prix de l'option par rapport
au prix du marché ;
- l'article 70 de la loi de finances initiale pour 1996 a
porté
à 30 % le taux d'imposition
applicable à la plus-value
d'acquisition réalisée lors de la levée d'option ;
- l'article 11 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1997 a
soumis aux cotisations sociales
la plus-value
d'acquisition lorsque le délai fiscal d'indisponibilité de cinq
ans entre l'attribution de l'option et la cession des titres n'est pas
respecté.
- la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a
entraîné un
accroissement massif des
prélèvements sociaux sur l'épargne
, avec la forte
hausse de la CSG et l'extension-fusion des deux prélèvements de 1
% sur les revenus du patrimoine affectés respectivement à la
CNAVTS et à la CNAF. Ceux-ci atteignent désormais un taux
cumulé de 10 % : 7,5 % de CSG + 0,5 % de CRDS + 2 % de
prélèvement social fusionné.
4. Un système différent des régimes de stock-options étrangers
Il est
fréquemment avancé que le régime des stock-options
"à la française" est moins favorable que ses homologues
étrangers. Cette assertion est vraie pour les aspects de droit fiscal et
social, notamment depuis trois ans. Mais elle est moins avérée
pour les aspects de droit des sociétés.
En effet, le rapport d'information de MM. Arthuis, Loridant et Marini relevait
que l'évolution de la législation commerciale applicable aux
plans d'options sur actions, depuis leur instauration en 1971, s'est faite
constamment dans le sens d'un double assouplissement.
a) L'extension du champ d'application
Initialement défini de façon étroite, le
champ
d'application des plans d'options sur actions a été élargi
dans deux directions.
D'une part, la loi du 9 juillet 1984 a autorisé une
société à consentir des options aux salariés des
sociétés liées à elle, directement ou
indirectement, par des participations au sein d'un groupe.
Ainsi, l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 prévoit que des
options peuvent être consenties aux salariés des
sociétés ou des groupements d'intérêt
économique:
- dont au moins 10 % du capital ou des droits sont détenus par la
société consentant les options;
- détenant au moins 10 % du capital ou des droits de la
société consentant les options ;
- dont 50 % au moins du capital ou des droits sont détenus par
une société détenant elle-même 50 % au moins du
capital de la société consentant les options.
Par ailleurs, l'article 31 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 sur la
participation a soumis expressément au régime fiscal de droit
commun les options consenties par une société
étrangère aux salariés d'une société
française dont elle est la mère ou la filiale.
D'autre part, le bénéfice des plans d'options, initialement
réservé aux seuls salariés des sociétés, a
été étendu à leurs mandataires sociaux.
Cet élargissement a été réalisé
progressivement, en trois étapes :
- la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de
l'initiative économique a ouvert la possibilité de consentir des
options de souscription d'actions aux mandataires sociaux qui participent avec
des salariés à la création ou au rachat d'une
société ;
- la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier a ouvert la possibilité de consentir des
options de souscription ou d'achat d'actions aux mandataires sociaux qui
occupent une fonction de direction et ont antérieurement exercé
une activité salariée durant au moins cinq ans dans la
société qui émet les options, ou dans une entreprise du
même groupe ;
- enfin, la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne a ouvert sans
condition particulière le bénéfice des options de
souscription ou d'achat d'actions aux mandataires sociaux occupant des
fonctions de direction (président-directeur général,
directeurs généraux, membres du directoire ou
gérants).
b) La levée de certaines contraintes
En
même temps que le champ d'application des plans d'options sur actions
était ainsi élargi, un certain nombre de contraintes ont
été supprimées ou assouplies :
- alors que la possibilité de consentir des options d'achat
était initialement réservée aux seules
sociétés cotées, cette faculté a été
également reconnue aux sociétés non cotées par la
loi du 17 juin 1987 ;
- alors que le délai obligatoire de conservation des titres dont la
société peut assortir les options consenties pouvait initialement
aller jusqu'à cinq ans, ce délai maximum a été
abaissé à trois ans par la loi du 9 juillet 1984 ;
- alors que la durée de validité des options à
compter de leur attribution était initialement fixée à
cinq ans, cette durée a été laissée à
l'appréciation de la société par la loi du 17 juin
1987 ;
- alors qu'aucune possibilité de réduction du prix des options
par rapport au prix du marché n'était initialement possible, la
loi du 9 juillet 1984 a autorisé un rabais de 10 %, que la loi
du 17 juin 1987 a porté à 20 % ;
- alors que le montant des options attribuées à un
même salarié était initialement limité au double de
son salaire annuel ou à dix fois le montant du plafond de
sécurité sociale, ce plafond individuel a été
supprimé par la loi du 17 juin 1987.
Le dernier assouplissement de la législation commercial applicable aux
plans d'options sur actions a été la suppression du
" délai de portage " intervenue en 1994.
Jusqu'alors, pour bénéficier du régime d'imposition le
plus favorable, le titulaire des options devait conserver les actions pendant
un certain temps après leur acquisition. Ce " délai de
portage ", initialement fixé à cinq ans, avait
été, dans un premier temps, réduit à un an par la
loi du 9 juillet 1984. L'article 39 de la loi de finances
rectificative pour 1993 du 22 juin 1993 l'a supprimé.
Ainsi, seul subsiste aujourd'hui le délai d'indisponibilité de
cinq ans entre la date d'attribution des options et la date de cession des
actions. Mais, dès lors que ce dernier est respecté,
rien ne
fait plus obstacle à ce que l'option soit levée et les titres
revendus quasiment dans la même journée.
Au terme de cette évolution des textes législatifs, il ne
subsiste plus aujourd'hui que deux importantes restrictions, relatives à
l'impact des plans d'options sur la propriété du capital de la
société.
L'une est
globale
: le nombre total des options ouvertes et non
encore levées ne peut donner droit à souscrire plus du tiers du
capital social.
L'autre est
individuelle
: les salariés ou mandataires
sociaux détenant plus de 10 % du capital social ne peuvent se voir
attribuer d'options (la société peut, si elle le souhaite,
abaisser ce seuil, qui peut toutefois être porté à
33 % en cas de création ou de rachat d'une entreprise).
Le rapport d'information de MM. Arthuis, Loridant et Marini comporte en annexe
des éléments d'information sur les systèmes de plans
d'options sur actions en vigueur aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne,
à Singapour et au Japon.
Cette information, qui mériterait sans doute d'être
actualisée, présente l'avantage d'être de première
main : elle avait été fournie au groupe de travail de la
commission des finances par les conseillers financiers de nos ambassades dans
les pays concernés.
Votre rapporteur pour avis se permet donc de renvoyer à l'annexe du
rapport précité. Il estime toutefois intéressant de
reprendre ici un extrait de la présentation des plans d'options sur
actions aux Etats-Unis, qui sont le plus souvent pris comme
référence en la matière.
Les stock-options plans aux Etats-Unis
Les
régimes de stock-options aux Etats-Unis sont extrêmement
variés. Il existe deux grandes catégories de plans de
stock-options : les
plans d'actionnariat collectifs
, largement ouverts
au personnel et à contributions définies, et les
plans
individuels
, qui font généralement l'objet d'arrangement
contractuels.
Le régime le plus proche des plans d'options de souscription ou d'achat
d'actions français est celui des
"
stock-options plans
".
a)
Les
" incentive stock options "
ou
" ISO "
ne peuvent être offertes par une entreprise
qu'à ses employés, ce, obligatoirement sur la base d'un plan
écrit, et enregistré auprès de l'autorité
fédérale de réglementation des titres, la Securities and
Exchange Commission/SEC. Les conditions d'attribution des
ISOs
ne
doivent pas obligatoirement être uniformes pour les
bénéficiaires. Le plan doit impérativement limiter
à un maximum de 100.000 dollars la valeur des options pouvant
être levées annuellement par chacun des
bénéficiaires ; il peut cependant prévoir que toutes
les options dont la valeur excéderait ce seuil doivent être
traitées comme des
" non-qualifed stock options "/NSO
.
Le délai de levée des options ne peut excéder dix ans, et
la valeur de celle-ci ne peut être inférieure au cours réel
effectif des actions sur le marché au moment où les options sont
offertes. Cependant, pour les actionnaires détenant plus de 10 % du
capital de l'entreprise, le délai de levée ne peut être
supérieur à cinq ans, et la valeur des options ne peut pas
représenter moins de 110 % du cours réel du marché au
moment où les options sont offertes.
-
Rôles du conseil d'administration et de l'assemblée
générale
: le plan écrit doit recueillir
l'approbation des actionnaires de l'entreprise.
- Traitement fiscal des ISO
: si les actions sont toujours
détenues par le bénéficiaire un minimum de deux ans
après la date d'offre d'options et un minimum d'un an après la
date de levée de celles-ci, le différentiel existant entre le
prix de l'option et sa valeur sur le marché au moment de la levée
n'est imposable (au taux maximum de 28 % applicable aux gains en capital
à long terme) qu'au moment où les actions sont
cédées par le bénéficiaire. En revanche, si les
actions sont cédées avant l'expiration des délais
mentionnés, le montant imposable est égal à la plus petite
des deux sommes : le montant du différentiel à la date de
levée de l'option ou celui du gain réalisé au moment de la
cession, et il est traité, pour le bénéficiaire, comme
simple revenu. Dans ce cas, l'employeur est autorisé à une
déduction du même montant.
b)
Les
" non-qualified stock options "
ou
" NSO "
,
en revanche, peuvent être offertes
aux employés, à des membres du conseil d'administration de
l'entreprise, ou à des consultants travaillant pour le compte de
celle-ci. Les conditions d'attribution, délais de levée, prix des
options, et la valeur globale de celles-ci ne sont pas soumis à des
conditions spécifiques (le prix des options ne peut cependant être
inférieur de plus de 10 % au prix réel effectif des actions
sur le marché à la date de l'offre).
- Rôles du conseil d'administration et de l'assemblée
générale :
le nombre global de
NSO
accordées fait l'objet d'une approbation par le conseil d'administration
de l'entreprise -qui peut également déterminer la quantité
consentie à chacun des principaux dirigeants- mais la direction de
l'entreprise dispose fréquemment d'un " bloc " non
alloué, qu'elle a toute latitude de distribuer au sein de l'entreprise.
L'octroi de
NSO
n'est pas soumis à l'approbation des actionnaires.
- Traitement fiscal des NSOs
: le bénéficiaire est
imposable au moment de la levée de l'option sur le différentiel
dégagé entre la valeur de l'action à la date de
levée et la valeur de l'option la date de l'offre ; l'employeur est
autorisé à une déduction du même montant.
Cette présentation sommaire des
stock-options plans
aux
Etats-Unis montre que ceux-ci sont assortis de limites quantitatives et de
contraintes de transparence qui n'existent pas en France.
Plus généralement, une comparaison internationale rapide montre
que le régime fiscal des plans d'options sur actions est par beaucoup
d'aspects plus incitatif en France que dans les principaux pays
étrangers qui connaissent aussi cette pratique,
sous la
réserve fondamentale des taux d'imposition applicables.
En général, les dispositifs étrangers combinent deux des
trois contraintes suivantes :
-
l'interdiction du rabais
sur les prix de souscription ou d'achat ;
- l'obligation de respecter un
délai de conservation des actions
pour bénéficier d'une imposition allégée ;
- le
plafonnement individuel
du montant des options attribuées,
donc du gain qui peut en être retiré.
Au terme de son processus d'assouplissement progressif, le régime
français des plans d'options ne comporte plus aucune de ces trois
restrictions.
Régime fiscal des plans d'options de souscription ou
d'achat
d'actions
|
|
|
MODALITES D'IMPOSITION |
|
|
|
|
|
|
de l'avantage (excédent de la valeur de l'action à la date de levée de l'option, sur le prix de cette dernière) |
de la plus-value (excédent du prix de vente de l'action sur la valeur de cette dernière à la levée de l'option) |
DELAI DE CONSERVATION DES ACTIONS |
|
|
ALLEMAGNE |
L'Allemagne n'a pas institué de régime de plans d'options de souscription ou d'achats d'actions. Il existe, en revanche, des systèmes de participation des salariés au capital comportant des avantages fiscaux subordonnés à un délai de conservation des actions d'au moins six ans. Mais le système allemand ne peut pas être pour autant rapproché des régimes de plans d'options. |
||||
|
BELGIQUE |
Non |
Exonération |
Exonération (régime général des plus-values) |
2 ans après l'acquisition des actions |
25 % des rémunérations annuelles imposables versées par la société dans la limite de 500 000 FB par an |
|
CANADA
|
Non |
Imposition à l'impôt sur le revenu au moment de la cession. Si conservation des actions plus de 2 ans, imposition sur les trois quarts de la valeur. |
Impôt sur les plus-values : taxation à l'impôt sur le revenu des trois quarts du gain. |
2 ans après l'acquisition des actions |
Non |
|
ETATS-UNIS
|
Non (Surcoût si le salarié détient plus de 10 % du capital de la société) |
Imposition lors de la cession selon le régime des plus-values si le délai de conservation est respecté (taux maxi 28 %) ou comme un revenu dans le cas contraire (taux maxi actuel 39,6 %). |
Imposition selon le régime des plus-values (taux maxi 28 %). |
- 2 ans
après l'attribution de l'option
|
100 000 $ annuels, plus (1) report non utilisé des années antérieures |
|
ROYAUME-UNI
|
Non, en général. Si existence d'un rabais : imposition comme un salaire |
Exonération |
Imposition de la plus-value selon le barème de l'IR de droit commun (taux maxi 40 %) |
Non |
Quatre fois le montant des salaires annuels ou 100 000 $ par an si plus élevés. |
(1) Des options peuvent être offertes au delà de ce montant, mais la plus-value est alors taxée au taux marginal du barème (39,6 %).
Source : Service de la législation fiscale - Ministère du budget.
Il
convient de nuancer la précédente observation, en soulignant que
le niveau de la pression fiscale et sociale sur les revenus d'activité
et les plus-values mobilières est considérablement plus
élevé en France qu'à l'étranger.
Comme le relève le rapport d'information de MM. Arthuis, Marini et
Loridant, ce "biais social et fiscal" explique, même s'il ne le justifie
pas, certains détournements d'objet des plans d'options sur actions,
lorsqu'ils sont utilisés comme un substitut de
rémunération.
Toutefois, la correction de cet effet pervers ne réside pas dans
l'aggravation de la fiscalité applicable aux plus-values sur options de
souscription ou d'achat d'actions, ni dans leur assujettissement aux
cotisations sociales.
Elle réside dans un accroissement de la transparence des plans
d'options, et surtout dans une diminution de la pression fiscale et sociale sur
les rémunérations d'activité.
B. UNE AMÉLIORATION MARGINALE DES BONS DE SOUSCRIPTION DE PARTS DE CRÉATEUR D'ENTREPRISE
1. Un substitut de stock-options pour les sociétés de création récente
L'article 76 de la loi de finances pour 1998 a instauré,
à titre provisoire
, un régime de bons de souscription de
parts de créateurs d'entreprise (article 163
bis
G du code
général des impôts) inspiré de celui des options de
souscription ou d'achat d'actions.
Le Gouvernement a cherché à éviter, dans la
dénomination du dispositif, toute similitude avec les plans d'options de
souscription ou d'achat d'actions. Pour autant, les bons de souscription de
parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) ne sont pas autre chose qu'une
forme de stock-options, particulièrement avantageuse,
réservée aux sociétés qui en ont un besoin vital
pour se développer.
Les bénéficiaires des BSPCE sont les
salariés
de la
société et ses
mandataires sociaux
soumis au
régime fiscal des salariés
.
Les sociétés concernées sont les
sociétés
non cotées créées depuis moins de quinze ans
16(
*
)
qui satisfont aux conditions suivantes :
- ne pas exercer une activité bancaire, financière, d'assurance,
de gestion ou de location d'immeuble ;
-
être passible en France de l'impôt sur les
sociétés, ce qui exclut les sociétés
étrangères exerçant leur activité sur le territoire
national ;
-
être détenue directement et de manière continue
pour 75% au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales
détenues par des personnes physiques. Toutefois, les participations des
divers organismes intervenant en matière de capital-risque ne sont pas
prises en compte pour cette condition, dès lors qu'elles restent
minoritaires (sociétés de capital risque, sociétés
de développement régional, sociétés
financières d'innovation, fonds communs de placement à risques,
fonds communs de placement dans l'innovation) ;
-
ne pas avoir été créée dans le cadre d'une
concentration, d'une restructuration, d'une extension ou de la reprise
d'activités préexistantes. Il doit donc s'agir d'activités
entièrement nouvelles, notion qui fait l'objet d'interprétations
diverses et donne lieu à beaucoup de contentieux fiscal.
Le mécanisme des BSPCE est comparable à celui des options de
souscription ou d'achat d'actions.
Le BSPCE, qui est incessible, ouvre
à son bénéficiaire le droit de souscrire les titres de la
société à un prix fixé lors de son attribution.
Le bénéficiaire peut donc
réaliser une plus-value
si la valeur de la société a augmenté
entre le
moment de l'attribution du bon et le moment de la revente des titres
correspondants.
Il convient toutefois de souligner qu'il s'agit de titres
par définition peu liquides, puisque non cotés.
Le régime fiscal proposé est avantageux : les gains
réalisés sont imposés selon le taux proportionnel de
16 % applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières.
Ce taux est
a priori
plus favorable que le barème de
l'impôt sur le revenu applicable aux rémunérations
, mais
aussi que le taux spécifique de 30 % applicable aux gains sur
options de souscription ou d'achat d'actions.
Toutefois, ce taux de 30 % est applicable lorsque le
bénéficiaire exerce son activité dans la
société depuis moins de trois ans.
Par ailleurs, à la différence des options sur actions, le
bénéfice de ce régime fiscal favorable n'est assorti
d'aucune durée d'indisponibilité des titres. Les droits
afférents aux bons peuvent donc être exercés dès
leur attribution.
A la différence des gains sur options de souscription ou d'achat
d'actions également, les BSPCE sont
totalement exonérés
de cotisations sociales
.
Ce dispositif a été institué à titre provisoire,
pour une période de deux ans, à compter du 1
er
janvier
1998 et
jusqu'au 31 décembre 1999
.
2. La position de la commission des finances
Lors de
leur création par la loi de finances pour 1998, la commission des
finances n'avait pas accueilli les bons de souscription de parts de
créateur d'entreprise avec grand enthousiasme.
Non pas que
l'idée soit mauvaise en soi, mais au contraire parce qu'elle
apparaissait trop timorée.
M. Alain Lambert, dans son rapport général sur le projet de loi
de finances pour 1998, estimait que "
la mesure proposée par le
Gouvernement apparaît inutilement complexe, avec un champ restreint et
une multiplicité de conditions qui en réduiront la portée,
induiront des effets de seuil et généreront vraisemblablement des
contentieux. Elle sera également perçue comme fragile par les
entreprises, puisque très provisoire et a priori suspecte aux yeux du
Gouvernement.
Cette mesure a du moins le mérite de réhabiliter le
mécanisme des options d'achat ou de souscription d'actions, dont elle
n'est qu'un succédané.
Le Gouvernement reconnaît ainsi
les vertus de ce mécanisme, qui a été beaucoup
décrié mais apparaît irremplaçable pour les
entreprises nouvelles et en développement. Il aurait d'ailleurs
été mieux inspiré, pour mettre en place une mesure
réservée à certaines entreprises, de partir de ce
dispositif qui a fait ses preuves et est bien connu des sociétés.
Néanmoins, dans la mesure où il s'agit de l'une des rares mesures
prétendument favorables aux entreprises du présent projet de loi
de finances, elle vous propose d'accepter sa mise en place, en lui apportant
des améliorations sur quatre points."
Votre commission des finances n'a finalement eu gain de cause que sur une
seule des quatre améliorations proposées, à savoir
l'extension du dispositif aux sociétés créées par
voie d'essaimage
.
Dans son rapport général sur la loi de finances pour 1999, M.
Philippe Marini, tout en rappelant ces réserves de principes, avait
donné un avis favorable à l'extension du dispositif aux
sociétés de moins de quinze ans.
Il s'était toutefois interrogé sur la raison pour laquelle
l'extension de champ proposée devait s'appliquer à compter du 1er
septembre 1998, c'est-à-dire avant même que le projet de loi de
finances ait été examiné en conseil des ministres et
quatre mois avant l'adoption - alors éventuelle - des dispositions
juridiquement nécessaires par le Parlement.
Il observait en effet que "
l'entrée en vigueur anticipée de
modifications législatives de la règle fiscale reste toujours
aussi choquante sur le plan des principes. Elle est parfois justifiée en
pratique, lorsque l'entrée en vigueur à la date de publication de
la loi de finances pourrait entraîner des comportements de temporisation
préjudiciables à la bonne marche de l'économie. (...)
Mais on voit mal en quoi une entrée en vigueur anticipée est
justifiée pour l'attribution de BSPCE par des sociétés de
moins de quinze ans, car il s'agit pour elles de l'ouverture d'un droit
entièrement nouveau qui ne peut, par définition, perturber des
projets en cours
."
3. L'amélioration proposée par le présent projet de loi
Un seul assouplissement du dispositif actuel est proposé par l'article 3 : l'abaissement de 75 % à 25 % de la part du capital qui doit obligatoirement être détenue par des personnes physiques.
C. LES PROPOSITIONS ADDITIONNELLES DE LA COMMISSION DES FINANCES
1. Rappel des positions constantes de la commission des finances
En
matière de stock-options, la commission des finances peut se
prévaloir d'une constance sans faille dans ses positions. Toutefois,
cette constance ne peut apparaître avec suffisamment de clarté
qu'aux observateurs attentifs des débats parlementaires. Un bref rappel
historique n'est sans doute pas inutile.
1.
Dans le cadre du débat sur le projet de loi de finances pour
1995, la commission des finances proposait de rétablir le délai
de portage d'un an supprimé en 1994, afin de prévenir certains
abus qui avaient été portés à sa connaissance. La
commission, après avoir finalement renoncé à cette
proposition d'amendement, décidait alors de créer un groupe de
travail sur les plans d'options.
2.
Le rapport d'information du groupe de travail de la commission,
présenté au printemps 1995 par MM. Arthuis, Loridant et Marini,
comportait une triple conclusion :
- les abus du système des plans d'options sur actions sont réels,
même si rien ne permet de dire qu'ils constituent la pratique majoritaire
;
- les avantages du régime des plans d'options sur actions sont
parfaitement justifiés, compte tenu à la fois de leur
intérêt pour les entreprises et du contexte de forte pression
fiscale et sociale propre à la France ;
- il est nécessaire et urgent d'introduire une plus grande transparence
dans le système des stock options, pour prévenir les abus qui
risquent de le discréditer.
3.
Le 30 juin 1995, M. Philippe Marini posait une question orale
à M. Alain Madelin, ministre de l'économie et des finances,
pour l'interroger sur les suites données au rapport d'information de la
commission.
En réponse, le ministre s'était engagé à mettre en
oeuvre rapidement une réforme inspirée des propositions du
rapport, considérant que "
ces propositions constituent une base
précieuse pour la réflexion et pour l'action
".
4.
En septembre 1995, M. Philippe Marini déposait une proposition
de loi tendant à améliorer l'information des actionnaires et
à prévenir les délits d'initiés en matière
d'options de souscription ou d'achat d'actions.
5.
Dans le cadre de la loi de finances pour 1996, M. Arthuis
étant devenu ministre de l'Economie et des finances, le gouvernement
instaurait un taux de prélèvement libératoire
spécifique de 30 % pour les plus-values d'acquisition sur options,
avec l'avis favorable de la commission des finances.
6.
Dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier du printemps 1996, à l'initiative de
M. Philippe Marini, la commission des finances proposait d'instaurer,
d'une part, une obligation de consolidation de l'information des actionnaires
au sein des groupes de sociétés, et d'autre part, une
interdiction d'attribuer des options pendant certaines périodes
sensibles au regard du délit d'initié.
Ces dispositions, qui avaient reçues l'avis favorable du gouvernement,
ont été votées et figurent désormais dans la loi du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
7.
Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1997, le Sénat, à l'initiative de sa commission des
affaires sociales et sans que sa commission des finances ait à se
prononcer, décidait d'assujettir les gains sur options aux cotisations
sociales lorsque le délai d'indisponibilité fiscale de cinq ans
n'est pas respecté.
8.
Dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 1996, la
commission des finances réparait une erreur rédactionnelle de la
disposition récemment votée dans la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1997, qui aboutissait à
exonérer de CSG et de CRDS les gains sur options lorsque le délai
d'indisponibilité fiscale est respecté.
9.
Dans le cadre de la loi de finances pour 1998, le gouvernement
proposait la création des bons de souscription de parts de
créateur d'entreprise pour certaines sociétés de moins de
sept ans.
La commission des finances, M. Alain Lambert étant rapporteur
général, se déclarait favorable à la mesure tout en
regrettant son caractère restrictif, et proposait par ailleurs au
Sénat de revenir au taux d'imposition de droit commun de 16 % pour
les plans d'options.
10.
Dans le cadre de la loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier du printemps 1998, la commission des finances de
l'Assemblée nationale proposait de revenir sur le caractère
économiquement rétroactif de l'assujettissement aux cotisations
sociales pour les seules sociétés de moins de quinze ans.
Pour sa part, la commission des finances du Sénat a défendu
l'extension de cette mesure de bon sens à toutes les
sociétés, indépendamment de leur âge.
11.
Dans le cadre de la loi de finances pour 1999, le gouvernement
proposait d'étendre des bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise aux sociétés de moins de quinze ans. La commission
des finances, M. Philippe Marini étant rapporteur
général, proposait de nouveau au Sénat de revenir au taux
d'imposition de droit commun de 16 % pour les plans d'options.
12.
Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999, votre rapporteur pour avis présentait un amendement
rétablissant l'exonération de cotisations sociales pour les gains
sur options, mais rejeté par la commission des affaires sociales.
Ce rappel historique montre la parfaite continuité des positions de
la commission des finances du Sénat en matière de stock-options,
indépendamment des initiatives parfois malencontreuses de la
précédente majorité sur le sujet.
Il est d'ailleurs permis de penser que, si les recommandations de plus grande
transparence formulées dès 1995 par la commission des finances
avait été écoutées en leur temps, le régime
fiscal et social des stock-options n'aurait vraisemblablement pas connu les
déboires récents qui doivent être aujourd'hui
corrigés.
Dans le cadre parfaitement adapté du présent projet de loi, la
commission des finances veut remettre à plat l'ensemble du
système des stock-options, en proposant un
ensemble
cohérent
qui modifie à la fois les bons de souscription de
parts de créateur d'entreprise et les plans d'options sur
actions.
2. Propositions relatives aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise
La
commission des finances propose tout d'abord une nouvelle dénomination,
plus concise : celle de "bons de créateur d'entreprise".
Elle propose par ailleurs d'apporter
trois assouplissements
supplémentaires
au mécanisme des bons de souscription de
parts de créateur d'entreprise :
- suppression de la discrimination entre les personnes qui ont plus de trois
ans d'ancienneté dans l'entreprise, taxées à 30 %, et
les personnes qui ont moins de trois ans d'ancienneté, taxées
à 16 % ;
- consolidation de la condition de détention par des personnes
physiques, par ailleurs ramenée à 25 % du capital comme
proposé par le Gouvernement, qui serait appréciée à
la date d'attribution des bons et non plus de manière continue ;
- pérennisation du dispositif.
3. Propositions relatives aux plans d'options sur actions
La
commission des finances veut proposer un
dispositif équilibré
en termes d'avantages et de contraintes
pour les plans d'options de
souscription ou d'achat d'actions.
S'agissant des contraintes nouvelles, la commission souhaite
renforcer la
transparence du système
sur les trois points suivants :
- faire obligation à l'assemblée générale
extraordinaire, qui autorise la mise en place des plans d'options, de
préciser les conditions dans lesquelles les actionnaires sont
informés chaque année des attributions nominatives d'options.
Cette information nominative devra porter, au minimum, sur les options
consenties aux mandataires sociaux ainsi qu'aux dix salariés qui en sont
les premiers bénéficiaires ;
- supprimer la possibilité de consentir un rabais, qui peut
actuellement aller jusqu'à 20 %, sur le prix des options par
rapport au cours des actions ;
- préciser les périodes sensibles durant lesquelles le
conseil d'administration ne peut pas attribuer d'options, afin de
prévenir les délits d'initiés (" fenêtres
négatives ").
En contrepartie, la commission des finances propose de
revenir à un
régime fiscal et social des plans d'options réellement
incitatif
en l'améliorant sur les trois points suivants :
- raccourcissement de cinq à trois ans du délai
d'indisponibilité fiscal entre l'attribution des options et la cession
des actions, qui doit être respecté afin de
bénéficier des règles d'imposition les plus
favorables ;
- rétablissement du taux d'imposition de droit commun de 16 %
lorsqu'un délai de portage d'un an est respecté entre la
levée de l'option et la cession des actions. A défaut, le taux
majoré de 30 % instauré en 1996 reste applicable.
- retour à la situation d'exonération de cotisations
sociales antérieure à la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1997, les diverses contributions sociales
de droit commun restant dues à hauteur de 10 % (CSG, CRDC,
prélèvement de 2 % sur les revenus du patrimoine).
D. LE DÉBAT SUR LA DIFFUSION DES STOCK-OPTIONS
1. La répartition des options au sein du personnel de la société
L'une
des dérives des stock-options "à la française" qui
à le plus nui à leur image dans l'opinion est leur excessive
concentration sur quelques uns des principaux dirigeants de la
société, voire sur le seul président-directeur
général.
Cette pratique, favorisée par l'opacité actuelle du
système, est parfaitement contraire à la logique même du
mécanisme des plans d'options sur actions, qui n'a de sens que s'il est
utilisé pour motiver l'ensemble du personnel de la société
dont une forte implication personnelle est requise. D'ailleurs, les groupes de
sociétés intelligemment gérés ont des plans
d'options très largement diffusés, qui peuvent concerner des
milliers de cadres à travers le monde.
Votre rapporteur pour avis est personnellement favorable à la plus
large diffusion possible des options, mais estime que cet objectif ne peut
être imposé par la loi.
Certes, il serait facile d'introduire dans la loi du 24 juillet 1966 une
contrainte nouvelle de diffusion minimale des plans d'options parmi le
personnel de la société. Toutefois, une telle clause uniforme
serait forcément inadaptée à la diversité des
besoins des sociétés.
Ainsi, un seuil de diffusion fixé à 20 % au minimum du personnel
serait adapté pour une entreprise moyenne employant du personnel
très qualifié dans un secteur de haute technologie. Il serait
bien trop élevé pour un groupe industriel employant des milliers
de salariés dans un secteur traditionnel.
C'est donc avec pragmatisme que votre commission des finances a jugé
préférable de laisser le degré de diffusion des plans
d'options à l'appréciation des dirigeants de la
société, sous le contrôle des actionnaires renforcé
par des obligations nouvelles de transparence.
2. Les autres instruments d'intéressement et de participation
Même lorsqu'elle concerne l'ensemble des cadres de la
société, la diffusion des stock-options peut être
jugée encore insuffisante. Mais une approche égalitariste
revendiquant l'attribution des options à tous les salariés sans
distinction ignore la véritable nature des stock-options.
En effet, pour pouvoir réaliser la plus-value, il faut d'abord mobiliser
les fonds nécessaires à l'acquisition des actions. Par force, les
options ne peuvent être utilement consenties qu'aux cadres
supérieurs, qui seuls ont un niveau de revenu leur autorisant cet
investissement personnel.
Les autres formes d'intéressement
conviennent mieux aux salariés moyens ou modestes, dans la mesure
où elles ne nécessitent pas ou peu d'apport personnel.
Par ailleurs, le
plan d'options sur actions demeure un instrument
risqué
. D'abord, parce que l'occasion de plus-value offerte peut ne
jamais se concrétiser. Ce caractère aléatoire des options
tend certes à passer au second plan dans un contexte
général de hausse de la valeur des actions. Mais
l'évolution erratique des cours de bourses dans la période
récente, et plus encore les incidents de parcours de certaines
sociétés, ont redonné toute son importance à ce
facteur.
Il suffit ici de rappeler que le Crédit Lyonnais avait mis en place un
plan d'options concernant environ 2 % de son personnel qui, pour des
raisons évidentes, a désormais fort peu de chances de
déboucher sur des plus-values avant son échéance.
L'élément de risque inhérent aux options est
évidemment fortement aggravé si celles-ci sont assorties par la
société ou par la loi d'une obligation de conservation des
actions.
L'attributaire ne s'expose plus alors seulement à ne pas
pouvoir concrétiser de plus-value en levant ses options, mais bien
à subir une perte sur les sommes qu'il a placées en actions de sa
société.
E. LA NÉCESSITÉ D'UN RAPPROCHEMENT AVEC LES PRATIQUES ÉTRANGÈRES
Le
régime fiscal des stock-options "à la française" est sans
équivalent à l'étranger. Schématiquement, les pays
dans lesquels existent des stock-options les traitent selon trois logiques
alternatives :
- soit une exonération fiscale complète ;
- soit une application du régime de droit commun des plus-value ;
- soit un assujettissement au barème de l'impôt sur le revenu.
Il n'y a qu'en France que le régime fiscal des stock-options combine le
barème de l'impôt sur le revenu, avec un taux marginal
particulièrement élevé, le taux forfaitaire d'imposition
des plus-values, avec un taux majoré spécifique de 30 %, des
contributions sociales de 10 % dans tous les cas, et les cotisations
sociales à hauteur de 80 % dans certains cas.
Votre rapporteur pour avis estime nécessaire de rapprocher le
régime fiscal des stock-options en France du "standard" international en
la matière.
En effet, si l'on veut favoriser le développement en France des
entreprises à forte croissance, innovantes ou non, et conserver sur
notre territoire les services stratégiques et dirigeants des grands
groupes internationalisés, il n'est pas possible de continuer à
pénaliser les stock-options.
Il convient de souligner que, dans une logique de compétition fiscale
internationale, de nombreux Etats accordent un statut avantageux aux
non-résidents, qui leur permet d'attirer sur leur territoire de nombreux
cadres étrangers. Au sein de l'Union européenne, tel est
notamment le cas des pays du Bénélux et de l'Irlande. Ce statut
fiscal de non-résident se traduit par une exonération des
stock-options dont peuvent bénéficier les cadres
"impatriés", indépendamment des règles applicables aux
résidents.
Bien sûr, le rapprochement du "standard" international ne vaut pas
uniquement pour la fiscalité applicable aux stock-options, mais
également pour les règles de transparence qui existent à
l'étranger.
EXAMEN
DES ARTICLES
ARTICLE
PREMIER
Création d'entreprises
par des chercheurs et d'incubateurs par des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche
Commentaire
: le présent article vise à :
- proposer un cadre juridique permettant aux personnels de la recherche de
créer une entreprise valorisant leurs travaux ou de lui apporter leur
concours scientifique, ou encore d'être membres du conseil
d'administration d'une société anonyme ;
- étendre aux organismes de recherche, d'une part, la procédure
d'approbation tacite des prises de participation à des structures
privées de coopération, et, d'autre part, la procédure de
conclusion de contrats pluriannuels avec le ministère de tutelle ;
- autoriser les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur à créer des structures d'incubation.
-
I. LE CADRE JURIDIQUE PROPOSÉ POUR RAPPROCHER LES CHERCHEURS DES ENTREPRISES
L'article 25 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France dispose que " les statuts des personnels de la recherche ou les règles régissant leur emploi doivent garantir ... leur participation à l'évaluation des travaux qui leur incombent " et que " ces statuts doivent favoriser ... la mobilité des personnels ... entre ces services et établissements [de recherche et d'enseignement supérieur] et les entreprises ".
Il convient de rappeler que les règles posées par le statut général de la fonction publique , notamment l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont incompatibles avec la création d'entreprise par les chercheurs à partir des résultats de leurs travaux. En outre, les articles 432-12 et 432-13 du code pénal sanctionnent la prise illégale d'intérêts.
Le IV du présent article , afin de lever ces obstacles juridiques, propose d'insérer , après l'article 25 de la loi de 1982 précitée, trois articles visant à mettre en place un cadre juridique destiné à faciliter le rapprochement des chercheurs avec les entreprises.
Le nouvel article 25-1 qui est proposé autorise les personnels de recherche à participer en qualité d'associé, de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ou de dirigeant à une entreprise nouvelle qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont effectués.
Le fonctionnaire est alors soit mis à la disposition de l'entreprise ou d'un organisme public ou privé compétent en matière de valorisation de la recherche, soit détaché auprès de cette entreprise. Il doit alors cesser toute activité au titre du service public dont il relève, à l'exception d'activités d'enseignement. Cette période de mise à disposition ou de détachement ne peut excéder six ans - deux ans renouvelables deux fois. A l'issue de cette période, le chercheur choisit entre sa réintégration au sein de son service d'origine - il doit alors céder ses participations et mettre un terme à sa collaboration avec l'entreprise - et son appartenance définitive à l'entreprise.
Le nouvel article 25-2 permet aux chercheurs d'apporter, pour une période de cinq ans renouvelable, leur concours scientifique ou technique à une entreprise qui assure la valorisation de travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent également, sous certaines conditions, prendre une participation, limitée à 15 %, dans le capital social de l'entreprise.
Le chercheur ne pourrait exercer les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ni les fonctions de dirigeant.
Une convention conclue entre la personne publique qui emploie le chercheur et l'entreprise précise les modalités du concours apporté. Elle peut également prévoir que le chercheur reçoit de l'entreprise un complément de rémunération.
Le nouvel article 25-3 permet à des chercheurs d'être membres, à titre personnel, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme. Leur participation au capital de l'entreprise est alors limitée à 5 % du capital social.
- B. PRÉVENIR LES RISQUES DE CONFLIT D'INTÉRÊT
Cette autorisation administrative est délivrée sur la base de conditions précises prenant en considération le respect des intérêts matériels et moraux de l'organisme de recherche mais aussi l'absence d'implication du chercheur dans la négociation des contrats passés entre son entreprise et l'organisme auquel il appartient.
En outre, le chercheur qui ne respecterait pas les conditions édictées par la loi se verrait retirer son autorisation administrative et pourrait encourir des sanctions disciplinaires.
La commission de déontologie précitée est garante du respect des dispositions prévues par le présent article.
- II. L'ASSOUPLISSEMENT DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX ORGANISMES DE RECHERCHE
Le II du présent article propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 19 de la loi de 1982, de telle sorte que les organismes de recherche puissent bénéficier, comme les établissements d'enseignement supérieur, d'une procédure d'approbation tacite de prise de participation, de constitution de filiales ou de participation à des groupements.
- III. LA CRÉATION DE STRUCTURES D'INCUBATION
Les prestations de service ainsi réalisées sont régies par une convention conclue entre l'entreprise bénéficiaire et l'établissement. Une contrepartie financière est prévue, l'établissement public bénéficiant d'une rémunération et participant aux résultats de l'entreprise.
Avis de la commission : votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article dans la rédaction proposée par la commission des affaires culturelles.
ARTICLE 2
Création de services
d'activités industrielles et commerciales au sein des
établissements d'enseignement supérieur
Commentaire : le présent article tend, dans un souci de valorisation des résultats de la recherche, à permettre aux établissements d'enseignement supérieur de créer un service d'activités industrielles et commerciales et de mettre en place des " incubateurs ".
Le
présent article modifie la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur
l'enseignement supérieur sur plusieurs points, afin de permettre la
création de services d'activités industrielles et commerciales et
de structures d'incubation, ainsi que la participation d'enseignants
associés et étrangers au recrutement des enseignants-chercheurs.
I. LA CRÉATION DE SERVICES D'ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET
COMMERCIALES
L'article 7 de la loi de 1984 précitée énumère les
missions du service public de l'enseignement supérieur, parmi
lesquelles :
" la diffusion des résultats de la
recherche "
ainsi que
" l'innovation ".
Son dernier
alinéa prévoit que
" les établissements qui
participent à ce service public peuvent être prestataires de
services pour contribuer au développement socio-économique de
leur environnement ".
L'article 20 précise que les
établissements d'enseignement supérieur
" peuvent
assurer, par voie de convention, des prestations de service à titre
onéreux, exploiter des brevets et licences, et commercialiser les
produits de leurs activités ".
Le I du présent article
complète l'article 7 de la loi de
1984 par un alinéa précisant que les activités
susmentionnées sont exercées dans des conditions fixées
par les statuts des établissements en question.
Le nouvel alinéa proposé pour l'article 7 par le I du
présent article et
le
II
, qui modifie le dernier
alinéa de l'article 20 de la loi de 1984, prévoient que
les
activités considérées sont gérées par un
service d'activités industrielles et commerciales, non doté de la
personnalité morale.
Le III du présent article
complète l'article 25 de la loi
précitée, relatif aux diverses composantes des
universités. Le troisième alinéa concerne les services
communs créés, dans des conditions fixées par
décret, pour assurer l'organisation des bibliothèques et des
centres de documentation, le développement de la formation permanente,
ainsi que l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants.
Le
III du présent article ajoute à cette liste
" l'exploitation d'activités industrielles et
commerciales ".
Deux dispositions déterminent le cadre financier et les
règles de recrutement applicables aux services d'activités
industrielles et commerciales.
D'une part, le IV du présent article
modifie le dernier
alinéa de l'article 42 de la loi de 1984, relatif au
régime
financier des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel
, en précisant qu'un
décret en Conseil d'Etat
" fixe ... le régime financier des
services d'activités industrielles et commerciales et les règles
applicables à leurs budgets annexes ".
Des
règles
budgétaires plus souples
devraient ainsi permettre de prendre en
considération la nature et les spécificités de telles
activités.
D'autre part,
le V
introduit une exception au principe
posé par le deuxième alinéa de l'article 53 de la loi de
1984, selon lequel
" les établissements ne peuvent pas recruter
par contrat à durée indéterminée des personnes
rémunérées, soit sur des crédits alloués par
l'Etat ou d'autres collectivités publiques, soit sur leurs ressources
propres ".
En effet, le nouvel alinéa que le I du
présent article propose pour compléter l'article 7 de la loi de
1984 dispose que, pour le fonctionnement des services d'activités
industrielles et commerciales,
" des agents de droit public non
titulaires peuvent être recrutés par contrat à durée
déterminée ou
indéterminée
".
Les
agents employés dans de tels services sont donc des
agents de droit
public non titulaires.
- II. LA MISE EN PLACE D'INCUBATEURS
La disposition proposée mentionne clairement trois points :
- la finalité des " incubateurs " est la valorisation de la recherche ;
- les liens établis, via les incubateurs, entre les établissements et les entreprises ne peuvent être que temporaires ;
- les prestations de service ainsi assurées donnent lieu à la conclusion d'une convention entre l'entreprise bénéficiaire et l'établissement , qui " établit notamment les modalités de rémunération de l'établissement et de sa participation aux résultats de l'entreprise " ; les conventions devraient s'inspirer d'une convention-cadre.
- III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
Il s'agit de bénéficier de compétences extérieures au monde universitaire stricto sensu, provenant, par exemple, du secteur privé ou de domaines peu représentés dans l'enseignement supérieur.
Avis de la commission : votre commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article dans la rédaction proposée par la commission des affaires culturelles.
ARTICLE 3
Assouplissement des conditions
d'attribution des bons
de souscription de parts de créateur
d'entreprise
Commentaire : pour l'attribution de bons de souscription de
parts de
créateur d'entreprise, le présent article propose d'abaisser de
75 % à 25 % la part du capital de la société qui doit
obligatoirement être détenue par des personnes physiques, ou par
des personnes morales détenues par des personnes physiques.
Le système des bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise (BSPCE), instauré par la loi de finances pour 1998, a
déjà été présenté dans
l'exposé général du présent avis
17(
*
)
.
Le gouvernement propose d'assouplir sur un point unique les conditions
d'attribution des bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise, qui sont nombreuses et cumulatives.
Actuellement, aux termes de l'article 163
bis
G du code
général des impôts, les BSPCE ne peuvent être
attribués que par les sociétés non cotées, de moins
de quinze ans, qui n'exercent pas d'activités bancaires,
financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles,
à la condition que leur capital soit détenu
directement et de
manière continue
pour 75 % au moins par des personnes physiques
ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques.
Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital risque, des sociétés de
développement régional et des sociétés
financières d'innovation ne sont pas prises en compte, à la
condition qu'elles n'aboutissent pas à un contrôle de la
société qui attribue les bons. De même, ce pourcentage ne
tient pas compte des participations des fonds communs de placement à
risque ou des fonds communs de placement dans l'innovation.
Votre commission des finances se félicite que le gouvernement propose
d'assouplir considérablement l'une des conditions les plus
contraignantes des BSPCE.
Elle estime toutefois opportun de saisir l'occasion de cette disposition de
nature fiscale pour remettre à plat le dispositif français des
stocks-options dans ses deux composantes actuelles, les BSPCE et les plans
d'actions sur options.
S'agissant des BSCPCE, qui font l'objet du présent article, l'amendement
que vous propose la commission des finances modifie le dispositif sur quatre
points.
Le
paragraphe I
supprime la discrimination qui est faite entre les
salariés ayant moins de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise
attribuant les bons, qui sont taxés à 30 %, et les
salariés ayant plus de trois ans, qui sont taxés à
16 %.
Lors de la création des BSPCE, votre commission des finances avait
contesté la pertinence de cette différence de traitement entre
les bénéficiaires. En effet, on voit mal pourquoi un
salarié intégrant une société récemment
créée devrait se trouver ainsi discriminé fiscalement..
Sous prétexte de " fidéliser " les salariés,
cette règle pénalise les derniers arrivés. En
réalité, elle vise à sanctionner l'attribution de BSPCE
à des collaborateurs occasionnels de la société. A cet
égard, elle ignore les besoins réels des entreprises
récemment créées, qui ont un besoin vital de
collaborations temporaires de haut niveau pour franchir les étapes
cruciales de leur développement.
C'est d'ailleurs pourquoi votre rapporteur pour avis est favorable à
l'extension des BSPCE aux consultants extérieurs des
sociétés, sur le modèle américain
. Sans
sous-estimer les difficultés de qualification juridique et fiscale d'un
tel type de collaboration, il considère que celles-ci doivent être
surmontables.
Le
paragraphe II
substitue à la dénomination actuelle de
" bons de souscription de parts de créateur d'entreprise "
celle, plus concise et commode, de " bons de créateur
d'entreprise ".
La dénomination actuelle entretient une confusion avec celle de
" parts de fondateur ", qui correspond à un type de titres
négociables très particulier, instaurés par une loi du 23
janvier 1929, et dont l'émission est désormais interdite par
l'article 264 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales.
Le
paragraphe III
reprend le nouveau seuil minimal de détention
par des personnes physiques de 25 % proposé par le texte initial, mais
propose en outre que cette conditions soit appréciée
à
la date d'attribution des bons
et non plus de manière continue.
Cette consolidation de la condition de participation des personnes physiques
est indispensable à la bonne gestion des BSPCE. Actuellement, si une
société tombe en dessous du seuil de 75 %, les bons
déjà attribués deviennent " illégaux ".
Il est d'ailleurs permis de s'interroger sur la portée juridique exacte
de la rupture d'une condition ainsi appréciée de manière
continue. La seule certitude est que les bons déjà
attribués ne pourront plus être exercés par leurs
bénéficiaires, même si ceux-ci n'ont par ailleurs aucune
maîtrise de l'évolution du tour de table de leur entreprise.
La règle actuelle ignore manifestement les étapes classiques
de l'évolution d'une entreprise de création récente et en
croissance rapide, qui ne peut soutenir son développement qu'en ouvrant
son capital
. Cette ouverture du capital se traduit dans l'immense
majorité des cas par une dilution de la participation des personnes
physiques qui ont été à l'origine de la création de
l'entreprise.
En réalité, l'appréciation de la condition en continu a
pour objectif de prévenir certains montages dans lesquels les dirigeants
de la société feraient transitoirement passer le pourcentage de
participation des personnes physiques au-delà du seuil requis, à
seule fin de pouvoir distribuer des BSPCE, avant de revenir à un
contrôle de fait par une personne morale.
Votre rapporteur pour avis estime difficile d'évaluer la
réalité du risque de tels montages. En tout état de cause,
il considère qu'ils tomberaient sous le coup des procédures de
droit commun prévues pour sanctionner fiscalement les abus de droit.
Le
paragraphe IV
pérennise le système des BSPCE en
supprimant les dispositions de l'article 163
bis
G du code
général des impôts en vertu desquelles les bons ne peuvent
être attribués que jusqu'au 31 décembre 1999.
Lors de la création des BSPCE, le gouvernement actuel avait
souhaité conférer un caractère expérimental au
dispositif, afin de surmonter les réticences de sa propre
majorité à l'égard des stock-options. Votre commission des
finances, qui estime que le dispositif mérite d'être
pérennisé, refuse bien sûr d'entrer dans ces
considérations politiques.
Par ailleurs, le caractère juridiquement éphémère
du dispositif des BSPCE obéit à la tactique, hélas de plus
en plus répandue, consistant à afficher des avantages fiscaux
transitoires afin d'inciter les agents économiques à se
précipiter. Or, cette tactique à courte vue ne saurait recevoir
l'aval de la commission des finances.
Tout au contraire, votre commission des finances estime qu'une bonne
législation fiscale doit être pérenne, de manière
à s'intégrer normalement dans les calculs rationnels des agents
économiques.
Si le mécanisme des BSPCE est un dispositif réellement conforme
à l'intérêt de l'entreprise qui les attribue, et non pas
une simple niche fiscale, il n'a nul besoin de ce genre de
booster
artificiel.
Il pourrait même être dommageable que la
décision d'attribuer des bons soit influencée par des
considérations d'aubaine, et pas uniquement par des
considérations de bonne gestion de l'entreprise.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter cet article dans la rédaction qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
3
Renforcement de la transparence des plans d'options sur actions
Commentaire : cet article additionnel vise à renforcer
la
transparence des plans d'options de souscription ou d'achat d'actions en
créant une obligation d'information nominative sur les
bénéficiaires, en supprimant la possibilité de consentir
un rabais sur le prix des actions, et en précisant les périodes
sensibles de la vie de l'entreprise durant lesquelles l'attribution d'options
est interdite.
I. LA SUPPRESSION DU RABAIS
Les règles d'imposition des gains produits par un plan d'options sont
compliquées par le traitement particulier réservé au
rabais qui peut être consenti sur le prix des actions.
En effet, lorsqu'une société met en place un plan d'options et
détermine le prix de souscription ou d'achat, elle peut établir
celui-ci en-dessous de la moyenne des cours cotés aux vingt
séances de bourse précédentes. Toutefois, en vertu du
dernier alinéa de l'article 208-1 de la loi du 24 juillet
1966, ce rabais ne peut pas être supérieur à 20 % du cours
officiel.
Lorsque les options portent sur des titres non cotés, le prix des
actions est déterminé sous le contrôle des commissaires aux
comptes de la société. Le rabais ne peut excéder 20 %
du prix moyen d'achat par la société de ses propres actions au
titre de la participation des salariés ou, à défaut, du
prix déterminé d'une manière certifiée
sincère par les commissaires aux comptes.
Fiscalement, la partie de ce rabais qui excède 5 %, dite
" rabais excédentaire ", est traitée de façon
moins favorable que le restant de la plus-value d'acquisition. Le rabais
excédentaire est imposable dans la catégorie des traitements et
salaires
au titre de l'année de la levée de l'option
.
Toutefois, afin d'éviter une double imposition, il est déductible
de la plus-value d'acquisition taxée l'année de la cession des
titres.
Par ailleurs, depuis que la loi du 4 février 1995 portant diverses
dispositions d'ordre social a complété en ce sens le code de la
sécurité sociale, le rabais excédentaire est soumis de
plein droit aux cotisations de sécurité sociale
,
tant
patronales que salariales, et à la CSG.
Votre commission des finances vous propose de supprimer la
possibilité de consentir un rabais sur le prix des actions lors de
l'attribution des options, qui est déjà fiscalement et
socialement découragée.
En effet, le rabais est contraire à la logique même du plan
d'options, qui doit être un pari sur la valorisation future de la
société, et non pas un cadeau sur sa valeur passée.
Tel est l'objet du
I. du
paragraphe A
de l'article additionnel
proposé par la commission des finances.
II. LA PRÉVENTION DES DÉLITS D'INITIÉS
Dans le cadre de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier du printemps 1996, à l'initiative de M. Philippe Marini, le
Sénat a introduit une disposition qui précise le système
des options sur deux points (article 10).
D'une part, cet article prévoit ce qu'il est convenu d'appeler une
"consolidation de l'information" sur les plans d'options. En clair, lorsqu'un
plan d'options sur actions est mis en place dans la filiale d'un groupe, il
faut désormais en informer le conseil d'administration de la
société mère, et non pas seulement celle de la filiale
concernée. Cette mesure est d'application directe et ne pose pas de
problème.
D'autre part, cet article prévoit que les options ne peuvent être
attribuées durant une période précédant et suivant
l'arrêté et la publication des comptes sociaux, ainsi que tout
événement de nature à affecter significativement la
situation et les perspectives de la société. Il s'agit
d'empêcher que les options soient attribuées à un prix
artificiellement bas, parce que n'intégrant pas toute l'information
relative à la société. Ces périodes durant
lesquelles il est interdit d'attribuer des options, ou "fenêtres
négatives", devaient être fixées par décret.
Or, le décret prévu n'est jamais paru, car ce dispositif
législatif a été déclaré difficilement
applicable, parce que trop large.
En effet, dans les grandes sociétés, les comptes sont
publiés trimestriellement. En définissant chaque "fenêtre
négative" par une durée raisonnable d'un mois avant et d'un mois
après la date de publication, ce sont huit mois de l'année qui se
trouveraient ainsi neutralisés. Si l'on ajoute les
"événements significatifs" qui peuvent intervenir au cours des
mois restants, l'attribution des options deviendrait de fait
problématique.
C'est pourquoi votre commission des finances avait proposé, dans le
cadre du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier du printemps 1998, un amendement qui précisait le
dispositif introduit dans le code des sociétés par l'article 10
du DDOEF de 1996, de manière à le rendre applicable.
Le II du paragraphe B de l'article additionnel qu'elle vous propose reprend
ce dispositif.
Les modifications portent sur deux points :
1.
D'une part, le champ de la mesure est limité aux seules
sociétés cotées, car c'est uniquement pour elles qu'existe
un risque d'utilisation indélicate d'informations
privilégiées. En effet, dans les sociétés non
cotées, la valeur des titres dépend de l'actif net, établi
annuellement par l'arrêté des comptes sous le contrôle des
commissaires aux comptes.
2.
D'autre part, les "fenêtres négatives" sont
définies en fonction de la date de publication des seuls comptes
annuels, ou consolidés pour les groupes, à l'exclusion des
comptes trimestriels provisoires. Elles restent par ailleurs définies en
fonction de tout événement de nature à influencer le cours
des titres de la société, notion bien circonscrite par la
jurisprudence sur le délit d'initié.
Dans la nouvelle rédaction que votre commission des finances vous
propose, l'ampleur des "fenêtres négatives" est
précisée. Elle est d'un mois précédant et suivant
la publication des comptes annuels dans le premier cas. Dans le second cas,
elle coure de la date à laquelle les organes sociaux de la
société ont eu connaissance de l'information
privilégiée, au mois suivant la date à laquelle cet
événement est rendu public.
Ainsi, aucun décret d'application n'est nécessaire, la
disposition législative étant d'application immédiate.
III. L'OBLIGATION D'INFORMATION NOMINATIVE
Les éléments d'information que le conseil d'administration ou le
directoire est tenu de délivrer durant la phase de déroulement
d'un plan d'options restent embryonnaires, et leur contenu dépend pour
partie de la bonne volonté et du souci de transparence des dirigeants de
l'entreprise. Aussi, là encore, les situations les plus diverses peuvent
se rencontrer, avec une
nette dominante pour la discrétion
.
En vertu de l'article 208-8 de la loi du 24 juillet 1966,
l'assemblée générale doit, chaque année, être
informée des opérations réalisées dans le cadre du
plan d'options.
Le contenu de ces informations est par ailleurs précisé par
l'article 174-20 du décret de 1967. Doivent ainsi être
mentionnés :
- le nombre et le prix des options consenties,
- les bénéficiaires,
- le nombre d'actions souscrites ou achetées.
Toutefois,
aucun texte ne fixe les modalités pratiques de cette
information.
Elle peut donc être fournie, selon les cas, dans le
rapport annuel, dans un document annexe, ou " par tout autre moyen ".
Les solutions retenues par les sociétés sont dans les faits
très variables.
Dans certaines situations, l'information
apparaît uniquement au détour d'une phrase.
Dans la plupart des cas, elle figure dans la partie du rapport consacrée
à l'évolution du capital social. Généralement, elle
fait ressortir le nombre d'options levées en fin d'exercice, et celui
d'options non encore exercées. L'indication du nombre d'options
nouvelles attribuées en cours d'exercice reste moins fréquente,
alors que le nombre et la qualité des bénéficiaires ne
sont jamais mentionnés.
De fait, et sauf à admettre que le conseil d'administration fournit aux
actionnaires des précisions complémentaires qui ne sont pas
reprises dans le document public et ses annexes, l'obligation légale
d'information est interprétée de façon restrictive.
En revanche, quelques entreprises observent une plus grande transparence,
notamment lorsqu'elles ont adopté la procédure de " document
de référence " préconisée par la Commission
des opérations de bourse. Elles font ainsi ressortir, au-delà des
données classiques, le montant global ou l'ordre de grandeur des options
consenties aux dirigeants.
Votre commission des finances estime opportun de sortir
définitivement de l'opacité actuelle et d'instaurer une
obligation légale d'information nominative sur les principaux
bénéficiaires des plans d'options.
Le
paragraphe C
de l'article additionnel qu'elle vous propose
complète l'article 208-8 de la loi du 24 juillet 1966 afin de permettre
à l'assemblée générale extraordinaire, qui autorise
la mise en place du plan d'options, de préciser les conditions dans
lesquelles elle souhaite que les actionnaires soient tenus informés
chaque année des attributions nominatives d'options.
Cette information nominative devra porter, au minimum, sur les options
consenties aux mandataires sociaux ainsi qu'aux dix salariés qui en sont
les premiers bénéficiaires.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article
additionnel qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
3
Raccourcissement du délai fiscal
d'indisponibilité des options de souscription ou d'achat d'actions
Commentaire : cet article additionnel vise à abaisser
de cinq
à trois ans le délai d'indisponibilité entre l'attribution
de l'option et la cession des actions, qui conditionne le
bénéfice du traitement fiscal le plus favorable.
En principe, la plus-value d'acquisition réalisée par le
bénéficiaire d'une option est considérée comme un
complément de salaire et soumise comme tel à l'impôt sur le
revenu (article 80
bis
I du code général
des impôts). La taxation de cet avantage n'a pas lieu lors de la
levée de l'option, mais lors de la cession des actions. Il est alors
fait application d'un système de quotient destiné à
atténuer les effets de la progressivité de l'impôt, qui
prend en compte le nombre d'années entières
écoulées entre la date d'attribution de l'option et la date de
cession des titres (article 163
bis
C II du CGI).
Toutefois, l'avantage peut être soumis à un régime
d'imposition plus favorable, sous réserve de deux conditions
(article 163
bis
C I du CGI) :
- les actions acquises doivent revêtir la forme nominative ;
- elles doivent demeurer indisponibles pendant une période de cinq
années à compter de la date d'attribution de l'option (et non de
sa levée).
Si ces deux conditions sont remplies, la plus-value d'acquisition
était taxée antérieurement à 1996, toujours lors de
la cession des titres, selon le régime des plus-values
mobilières, au taux de 16 %.
La plus-value d'acquisition est désormais taxée, pour les options
attribuées à compter du 20 septembre 1995, à un taux
spécifique majoré de 30 %.
Il est prévu par ailleurs un certain nombre de cas de force majeure
où le possesseur d'actions acquises sur options peut exceptionnellement
disposer de ses titres avant l'expiration du délai
d'indisponibilité de cinq ans, sans perdre pour autant le
bénéfice de ce régime d'imposition conditionné.
Votre commission des finances vous propose de réduire de cinq
à trois ans le délai fiscal d'indisponibilité, pour trois
raisons différentes.
Premièrement, le deuxième alinéa de l'article 208-1 de la
loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales autorise le
conseil d'administration ou le directoire à fixer des clauses
d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions, sans
que le délai imposé pour la conservation des titres puisse
excéder trois ans à compter de la levée de l'option.
Or, depuis la loi de financement de la sécurité pour 1997,
l'assujettissement aux cotisations sociales de la plus-value d'acquisition
lorsque le bénéficiaire ne respecte pas le délai fiscal
d'indisponibilité fait peser sur les sociétés qui mettent
en place des plans d'options sur actions un risque financier non
maîtrisable.
Pour s'en prémunir, les sociétés attributrices d'options
les assortissent désormais systématiquement d'un délai
contractuel d'indisponibilité, qui ne peut être rompu par le
bénéficiaire. Toutefois, ce délai ne peut être
supérieur à trois ans alors que le délai fiscal reste de
cinq ans, ce qui laisse une fenêtre de deux ans pour le risque
d'assujettissement aux cotisations sociales.
Dès lors, il semble logique d'aligner le délai fiscal
d'indisponibilité des actions, à compter de l'attribution des
options, sur le délai contractuel prévu par l'article 208-1 de la
loi du 24 juillet 1966.
Deuxièmement, votre commission estime opportun de rapprocher sur ce
point les options de souscription ou d'achat d'actions des BSCPE, pour lesquels
il n'existe aucun délai fiscal d'indisponibilité.
En effet, la distinction en fonction de l'ancienneté des
bénéficiaires des bons, selon qu'elle est supérieure ou
inférieure à trois ans, conditionne uniquement l'application du
taux de 16 % ou celle du taux de 30 %. Mais le barème
progressif de l'impôt sur le revenu n'est applicable dans aucune
hypothèse, tandis que les bons peuvent être exercés le jour
même de leur attribution.
Troisièmement, le raccourcissement du délai fiscal
d'indisponibilité atténue la rigueur du rétablissement
d'un délai de portage d'un an que votre commission des finances vous
propose par ailleurs, dans un autre amendement portant article additionnel.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article additionnel qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
3
Retour
au taux d'imposition de droit commun pour les gains sur options
conditionné par le respect d'un délai de portage d'un an
Commentaire : cet article additionnel tend à revenir au
taux
d'imposition de droit commun de 16 % pour les plus-values
réalisées grâce à des options de souscription ou
d'achat d'actions, à la condition que le bénéficiaire
conserve les actions pendant un an au minimum à compter de la
levée de l'option.
Votre commission des finances vous propose de revenir sur l'aggravation
récente de la fiscalité des options de souscription ou d'achat
d'actions.
La loi de finances pour 1996 a prévu pour l'imposition des gains
réalisés sur options de souscription ou d'achat d'actions un taux
spécifique de 30 %, soit un taux presque double du taux de
16 % applicable aux plus-values sur cession de valeurs mobilières.
Votre commission des finances avait alors admis que ce taux majoré
correspondait à la réalité des plans d'options sur actions
qui, dans les faits, sont trop souvent utilisés comme un substitut de
rémunération. Néanmoins, les plans d'options
présentent des caractéristiques qui interdisent de les assimiler
purement et simplement à une rémunération.
Toutefois,
deux éléments nouveaux sont intervenus
depuis :
- d'une part, la loi de financement de la sécurité sociale pour
1997 a soumis à cotisations sociales les gains sur options de
souscription ou d'achat d'actions, lorsque le délai
d'indisponibilité de cinq ans n'est pas respecté ;
- d'autre part, la loi de financement de la sécurité sociale pour
1998 a porté à 10 % le total des prélèvements
sociaux sur les revenus de placement (CSG + CRDS + prélèvement
spécifique de 2 %). Comme pour tous les revenus soumis à
prélèvement libératoire, la CSG n'est pas
déductible.
Le taux d'imposition total des gains sur options de souscription ou d'achat
d'action est ainsi de 40 %, hors cotisations sociales éventuelles.
Le régime fiscal et social des plans d'options de souscription ou
d'achat d'actions apparaît désormais exagérément
restrictif au regard des objectifs de ce mécanisme et de son
intérêt pour les entreprises. Votre commission des finances estime
donc opportun de revenir au régime antérieur à 1996.
Le coût réel de cette mesure est difficile à estimer,
aucune information exhaustive n'existant sur le volume des plus-values sur
options. Néanmoins, il est nul à moyen terme, dans la mesure
où le nouveau taux de 30 % ne s'applique qu'aux options
nouvellement attribuées, à compter du 20 septembre
1995
18(
*
)
.
Compte tenu du délai
d'indisponibilité actuel de cinq ans, ce taux majoré ne
s'appliquera effectivement qu'à compter de septembre 2000, les options
levées dans l'intervalle bénéficiant encore du taux de
16 %.
Au-delà de l'amendement présenté par votre commission des
finances, le rétablissement d'un meilleur équilibre entre les
contraintes et les avantages du mécanisme peut seul mettre un terme
à la tentation permanente de le remettre en cause. Cet équilibre
justifie que le régime des stock options puisse être globalement
plus favorable que les autres formes de rémunération et
d'intéressement, qui ne comportent pas la même part d'incertitude
et ne supposent pas le même investissement personnel.
Ce souci d'un régime plus équilibré conduit
également votre commission des finances à réouvrir la
réflexion sur le "délai de portage" supprimé en 1993.
En effet, seul le portage effectif des actions par le
bénéficiaire pendant une certaine durée après la
levée des options peut justifier, en pure logique fiscale, le traitement
fiscal du gain ainsi réalisé comme une plus-value sur valeurs
mobilières ordinaire.
L'investissement personnel concret et le risque afférent de moins-value
ultérieure justifie alors que ce gain soit considéré comme
une plus-value sur valeurs mobilières, soumise à l'impôt
sur le revenu à un taux proportionnel et exonérée de
cotisations sociales, et non pas comme une rémunération. Or, la
suppression du délai de portage permet aujourd'hui de revendre les
actions le jour même où l'option est levée, sans aucune
sortie effective de trésorerie, ni risque réel en capital pour le
bénéficiaire.
Le délai de portage, qui était initialement de cinq ans, a
été réduit à un an en 1984, avant d'être
totalement supprimé en 1993.
Or, l'assouplissement accordé en 1993 a vraisemblablement beaucoup
contribué à ce que les gains sur options de souscription ou
d'achat d'actions aient été depuis traités fiscalement et
socialement comme une quasi-rémunération.
Techniquement, l'article additionnel proposé par votre commission des
finances complète l'article 200 A du code général des
impôts afin de réserver le taux d'imposition aggravé de 30
% instauré par la loi de finances pour 1996 au cas où les titres
sont cédés moins d'un an après la levée de l'option.
A contrario
, on revient au taux d'imposition des plus-value de droit
commun, soit 16 %, lorsqu'un délai de portage d'un an est
respecté entre la levée de l'option et la cession des titres.
Ainsi, les bénéficiaires d'options resteront libres de
s'affranchir du délai de portage d'un an. Simplement, ils seront alors
soumis à un taux de prélèvement supérieur de 14
points au taux d'imposition de droit commun. Cet écart de taux peut
être considéré comme le prix du risque financier qu'ils
refusent, ou ne peuvent, assumer.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article
additionnel qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
3
Rétablissement de l'exonération de cotisations
sociales des plus-values sur options de souscription ou d'achat d'actions
Commentaire : cet article additionnel tend à revenir
à
la situation antérieure à la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1997, c'est-à-dire à une
exonération totale des plus-values d'acquisition sur options de
souscription ou d'achat d'actions.
Votre commission des finances, qui n'a pas eu à connaître de
l'article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour
1997, estime nécessaire de revenir à une situation
d'exonération totale de cotisations sociales pour les gains sur options
de souscription ou d'achat d'actions.
Sa position est motivée par des considérations de principe, par
des considérations pratiques, et par des considérations de
stabilité juridique.
Sur le plan des principes
, un gain sur options de souscription ou
d'achat d'actions est une plus-value sur valeurs mobilières, et doit
être fiscalement traité comme tel. Cette qualification fiscale est
renforcée par le délai de portage d'un an que la commission des
finances vous demande de rétablir par ailleurs.
Si l'on met à part les abus mis en lumière dès 1995 par le
rapport d'information de votre commission, qui relèvent de l'abus de
droit, il n'est pas exact d'assimiler les stock-options à des
"
sur-rémunérations sous-fiscalisés
",
selon l'expression de M. Philippe Marini. Ces abus devraient devenir encore
plus rares, avec les dispositions tendant à renforcer la transparence
des plans d'options que votre commission des finances vous propose par ailleurs.
D'autre part, votre rapporteur pour avis conçoit mal pourquoi le plan
sur options serait le seul instrument de participation et
d'intéressement soumis à cotisations sociales. En revanche, la
CSG et la CRDS sont normalement dues, comme pour les autres formes de
participation.
Sur le plan pratique
, le paiement des cotisations sociales est
très délicat à gérer pour la société
qui attribue les options. En effet, celle-ci choisit le moment où elle
attribue l'option, mais elle ne décide ni du moment où le
bénéficiaire lève l'option en achetant les titres, ni du
moment où celui-ci revend les titres. Il lui est même difficile
d'en être simplement informée. Les URSSAF et les services du
Trésor ont dû mettre en place un circuit
ad hoc
de
recoupement des informations, avec un retour vers l'entreprise concernée.
La société qui a attribué les options peut ainsi se
retrouver redevable de la part patronale des cotisations sociales plusieurs
années après avoir attribué les options. Ce risque
inhérent au simple fait de mettre en place un plan d'options sur actions
doit être obligatoirement provisionné, cette provision
n'étant pas fiscalement déductible.
Ceci explique que, depuis l'entrée en vigueur de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 1997, la quasi totalité des
plans d'options nouvellement mis en place sont assortis par les
sociétés, sur une base contractuelle, d'une interdiction faite
aux attributaires de céder leurs titres avant le terme du délai
de trois ans autorisé par l'article 208-2 de la loi du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales.
Ainsi, l'assujettissement aux cotisations sociales des gains sur options
réalisés avant cinq ans a eu ne porte en fait que sur les plus
values réalisées entre la quatrième et la cinquième
année. Par ailleurs, les bénéficiaires ont
intérêt à respecter le délai fiscal de cinq ans pour
échapper à la fois à la part salariale des cotisations
sociales et au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
De ce fait, le rendement attendu de la mesure, soit 300 millions de francs
destinés à l'époque à financer un assouplissement
de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie pour 1997, est
vraisemblablement plus proche de zéro. Le rétablissement d'une
situation d'exonération de cotisations sociales ne privera donc pas les
régimes sociaux de recettes significatives.
Sur le plan de la stabilité juridique
, l'assujettissement aux
cotisations sociales voté en novembre 1996 souffre d'être
" rétroactif ", sinon au sens strictement juridique, du moins
au sens économique du terme.
En effet, les dispositions correspondantes de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1997 s'appliquent au stock des options qui
ont été attribuées antérieurement à son
entrée en vigueur, c'est-à-dire dans des conditions
d'exonération. Il y a donc un bouleversement de l'équilibre des
plans d'options en cours, et un risque pour les entreprises de devoir payer
a posteriori
des cotisations sociales au titre d'options
attribuées avant le 1er janvier 1997.
Ce problème de rétroactivité est si réel que
l'Assemblée nationale, en dépit de son hostilité de
principe aux stock-options, a inséré dans la loi portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier n° 98-546 du 2 juillet
1998 une disposition tendant à rétablir l'exonération de
cotisations sociales pour les options attribuées antérieurement
au 1
er
janvier 1997 par les sociétés de moins de
quinze ans.
Lors des débats à l'Assemblée nationale, la limitation de
cette mesure de correction opportune aux sociétés de moins de
quinze ans visait, d'une part, à "
éviter que les grands
groupes n'utilisent ce mécanisme
" et, d'autre part, à
"
favoriser les PME et PMI innovantes, tournée vers les
nouvelles technologies
".
Toutefois, dans son rapport sur le projet de loi portant DDOEF, M. Alain
Lambert avait estimé que "
ces arguments soulèvent des
objections de trois ordres différents :
1. En opportunité, la motivation du personnel résultant des
options de souscription ou d'achat d'actions n'est pas moins utile dans les
grands groupes que dans les petites entreprises, tandis que les
difficultés résultant du caractère "rétroactif" de
la mesure votée en 1996 n'y sont pas de nature différente.
2. En droit, le fait de distinguer selon l'âge de la
société introduit une discrimination qui n'existait pas dans la
mesure initiale d'assujettissement, et dont la constitutionnalité
paraît douteuse. Elle provoque, en effet, une rupture au regard de
l'égalité devant les charges publiques qui est par
définition dépourvue de tout effet incitatif, puisqu'il s'agit
d'options déjà attribuées, et ne peut être
justifiée par un intérêt général.
3. En fait, le critère d'âge proposé n'apparaît pas
pertinent. En effet, une entreprise récente n'est pas forcément
une entreprise innovante, tandis qu'inversement, une entreprise centenaire peut
être tout à fait innovante.
Par ailleurs, une société de création récente peut
fort bien être une filiale d'une entreprise plus ancienne, et même
de l'un des "grands groupes" que les députés cherchent à
priver du bénéfice de la mesure. Inversement, une jeune
société qui réussit peut être rachetée par un
groupe déjà établi. Enfin, la situation devient
inextricable en cas de fusions ou d'absorptions de sociétés, car
les plans d'options existants qui peuvent être transférés
portent alors sur les actions de la nouvelle entité issue de la
restructuration."
C'est pourquoi votre commission des finances avait proposé au
Sénat de voter, en première lecture, un amendement tendant
à étendre le bénéfice de la mesure à toutes
les sociétés, indépendamment de leur âge. La
" rétroactivité " de l'article 11 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1997 devait être
ainsi corrigée pour toutes les sociétés.
L'argumentaire contestant la pertinence du critère de quinze ans ayant
été repris par les sénateurs auteurs de la saisine du
Conseil constitutionnel, ce dernier s'est contenté d'un contrôle
a minima
, considérant de manière sibylline que ce
critère n'était pas manifestement inadapté à
l'objectif poursuivi par le législateur.
Pour l'ensemble des raisons développées ci-dessus, votre
commission vous propose de rétablir complètement
l'exonération de cotisations sociales dont bénéficiaient
les plans d'options sur actions antérieurement au 1er janvier 1997.
Cette mesure s'applique à toutes les sociétés, sans
distinction selon leur âge, et à toutes les options
déjà attribuées.
Votre rapporteur pour avis a déjà eu l'honneur de
présenter un amendement identique dans le cadre de la discussion de la
loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Il tient
d'ailleurs à remercier M. Pierre Laffitte, qui en était
cosignataire, d'avoir bien voulu le défendre en séance publique
un lundi après-midi, étant lui-même retenu en province.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article
additionnel qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
3
Extension du champ des entreprises éligibles au
dispositif des fonds communs de placement dans l'innovation
Commentaire
: le présent article additionnel a
pour
objet d'étendre le nombre d'entreprises dans le capital desquelles
peuvent entrer les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI). Il
s'agirait de remplacer la disposition selon laquelle ne sont éligibles
au quota de 60 % des FCPI que les entreprises dont le capital est
détenu en majorité par des personnes physiques ou par des
personnes morales détenues par des personnes physiques, par une
disposition interdisant à la filiale d'un grand groupe d'entrer dans le
quota de 60 % d'un FCPI.
Comme indiqué dans l'exposé général (voir chapitre
III, titre I, A), à l'heure actuelle, l'actif des FCPI doit être
constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières, parts
de SARL et avances en compte courant, émises par des
sociétés non cotées, soumises à l'IS, comptant
moins de 500 salariés et dont le capital est majoritairement
détenu par des personnes physiques ou par des personnes morales
détenues par des personnes physiques.
Or, si les conditions relatives au caractère innovant et au nombre de
salariés de ces sociétés s'apprécient à
l'entrée, ce n'est pas le cas de la dernière condition qui doit
être respectée par la société tout au long de sa
présence dans le portefeuille de participations du FCPI.
Cette dernière condition apparaît excessivement restrictive. En
effet, en supposant que la majorité du capital de la
société est initialement détenu par son créateur,
il est rare qu'une personne physique puisse financer toutes les étapes
de la croissance de son entreprise. Au contraire, les besoins de financement
sont souvent tels pour une entreprise de croissance que
la part du capital
détenue par des personnes physiques est progressivement
diluée
à l'occasion des augmentations de capital successives,
jusqu'à devenir minoritaire. Les gérants de FCPI peuvent ainsi
être amenés à se déposséder de leur
participation dans une société à très fort
potentiel de croissance au moment où les besoins de financement de cette
dernière l'obligent à ouvrir la majorité de son capital
à des personnes morales et avant d'avoir pu rentabiliser son
investissement.
Des cas concrets où la condition relative à la détention
majoritaire du capital par des personnes physiques dissuade les FCPI d'inscrire
un investissement dans le quota de 60 % ont été
présentés à votre rapporteur pour avis.
Or, en imposant un critère de détention par des personnes
physiques, il n'entrait pas dans la volonté initiale du
législateur de restreindre à l'excès le champ des
sociétés éligibles au quota de 60 % mais
d'empêcher le financement par des FCPI de filiales de grands groupes.
La rédaction retenue s'inspirait alors de la définition
communautaire des petites et moyennes entreprises
19(
*
)
.
Votre commission aurait pu proposer un alignement du seuil de détention
du capital par des personnes physiques sur celui retenu par l'article 3 du
présent projet de loi pour les bons de souscription de parts de
créateur d'entreprise (BSPCE), c'est-à-dire 25 %. Toutefois,
un tel seuil continue d'être trop restrictif pour des
sociétés qui seront, selon toute probabilité,
amenées à ouvrir plus de 75 % de leur capital à des
partenaires industriels.
Elle préfère revenir à l'intention initiale du
législateur en prévoyant qu'aucune personne morale membre d'un
groupe ne doit détenir, directement ou indirectement, la majorité
du capital de la société.
Un tel amendement ne devrait pas avoir de conséquences sur la
dépense fiscale dès lors qu'il vise simplement à
étendre le nombre des entreprises éligibles et non à
encourager les épargnants à placer leur épargne dans des
FCPI.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article
additionnel qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
3
Possibilité pour un fonds communs de placement dans
l'innovation d'investir dans une holding
Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de permettre à un FCPI d'investir dans une holding qui détiendrait à hauteur de 90 % de ses actifs des participations dans des sociétés innovantes répondant aux conditions d'éligibilité au quota de 60 % des FCPI.
Il
ressort des auditions réalisées par votre rapporteur pour avis
qu'une autre contrainte peut être pénalisante pour les
sociétés qui souhaitent ouvrir leur capital à un FCPI. Il
s'agit de l'impossibilité pour un FCPI d'investir dans une holding qui
détiendrait à hauteur de 90 % de ses actifs des
participations dans des sociétés innovantes répondant aux
conditions d'éligibilité.
Or, il peut être intéressant pour un créateur d'entreprise
de détenir son entreprise par l'intermédiaire d'une
société holding, ce mode de structuration lui permettant
notamment de conserver le contrôle majoritaire de la
société en cas de dilution du capital suite à
l'arrivée d'investisseurs ayant une plus grande surface
financière.
Une société gestionnaire de FCPI auditionnée par votre
rapporteur pour avis citait ainsi le cas d'une entreprise qui se trouve
aujourd'hui dans un stade intermédiaire de son développement et
qui désire constituer un réseau de distribution. L'une des voies
envisagées pour ce faire passe par l'acquisition de
sociétés de distribution et d'installation. Les investisseurs
doivent donc nécessairement investir au travers d'une
société holding pour participer dans de meilleures conditions
à l'éventuelle cession du groupe ainsi constitué et ne pas
perdre le bénéfice de leur prise de risque.
Or, si cette forme d'investissement indirect est permise pour les
sociétés de capital risque, elle ne l'est pas pour les FCPI dont
la réglementation ne prévoit pas ce cas.
Ainsi, il résulte de l'instruction 4 H-2-92 du 14 janvier 1992 que
les titres d'une société holding qui détient 90 % de
ses actifs immobilisés et de ses placements en participations dans des
sociétés qui répondant aux conditions pour que ses titres
soient inclus dans le portefeuille exonéré en cas de
participation directe de la SCR peuvent être pris en compte dans le quota
de 50 % des SCR à condition que la société holding
participe activement à la gestion et au contrôle des
sociétés non cotée dans lesquelles elle détient des
actions ou des parts.
Le présent article additionnel propose d'étendre un tel
assouplissement aux FCPI.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article
additionnel qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
3
Relèvement du plafond de versements donnant droit
à la réduction d'impôt pour souscription au capital de
sociétés non cotées
Commentaire : le présent article additionnel a pour objet de doubler les plafonds de versements donnant droit à la réduction d'impôt de 25 % pour souscription au capital de sociétés non cotées.
Comme
indiqué dans l'exposé général (chapitre III, titre
I, B) la loi dite " Madelin " du 11 février 1994 relative
à l'initiative et à l'entreprise individuelle a institué
un dispositif d'aide à la mobilisation de l'épargne de
proximité en faveur des petites et moyennes entreprises.
Une réduction d'impôt de 25 % est ainsi accordée aux
personnes physiques qui souscrivent en numéraire au capital initial ou
aux augmentations de capital de sociétés non cotées entre
le 1
er
janvier 1994 et le 31 décembre 2001
20(
*
)
.
Toutefois, les versements ne sont retenus dans la limite de 37.500 francs pour
un célibataire et de 75.000 francs pour un couple marié.
L'avantage fiscal est accordé lorsque les trois conditions suivantes
sont remplies simultanément :
la société est soumise à l'IS dans les conditions de
droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou
artisanal ;
en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la
société n'a pas excédé 260 millions de francs ou le
total du bilan n'a pas excédé 175 millions de francs au cours de
l'exercice précédent
21(
*
)
;
le capital de la société est détenu majoritairement par
des personnes physiques soit directement, soit par l'intermédiaire de
" holdings " familiaux.
On le voit, par construction, ce dispositif s'adresse essentiellement aux
personnes qui connaissent le dirigeant de l'entreprise ou qui sont suffisamment
informés des performances de cette dernière.
En outre, le bénéfice de cette réduction d'impôt
n'est définitivement acquis que si le contribuable conserve ses titres
durant cinq ans.
Enfin, le bénéfice de la réduction d'impôt ne peut
se cumuler avec d'autres avantages fiscaux et les actions ou parts qui ont
ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent figurer dans
un plan d'épargne en actions.
Selon le fascicule budgétaire " Voies et moyens "
annexé au projet de loi de finances pour 1999, la dépense fiscale
résultant pour l'Etat d'une telle réduction d'impôt est
estimée à 360 millions de francs pour 1997
22(
*
)
et évaluée à
380 millions de
francs pour 1998
.
Eu égard aux risques importants qui sont attachés à la
souscription directe au capital de sociétés non cotées,
votre commission des finances estime qu'il convient de dynamiser le dispositif
de la loi Madelin en doublant les plafonds de versements donnant droit à
la réduction d'impôt et en supprimant tout délai de
souscription dans le temps.
Le présent article additionnel propose d'aligner les plafonds de
versements donnant droit à la réduction d'impôt au titre
des souscriptions directes au capital de sociétés non
cotées sur ceux des FCPI.
Il n'y a en effet aucune raison de ne pas
accorder un avantage fiscal aussi puissant que celui accordé aux
souscripteurs de parts de FCPI dès lors que le risque pris par un
investisseur en direct est équivalent voire plus important que celui
pris dans le cadre des FCPI
dont le rôle est
précisément de mutualiser et de circonscrire les risques par des
contraintes de dispersion des placements.
Le présent article additionnel supprime en outre tout délai de
souscription dans le temps, afin de montrer que le financement des entreprises
par l'épargne de proximité est une nécessité
structurelle qui nécessite une action à long terme.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article
additionnel qu'elle vous propose.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE
3
Réduction d'impôt de solidarité sur la
fortune pour souscription au capital de sociétés innovantes
Commentaire : le présent article additionnel a pour objet d'instituer une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune égale à 20 % du montant des sommes investies dans le capital de sociétés non cotées innovantes.
Les
chefs d'entreprise qui réussissent disposent d'une volonté
d'épargne et de capacités d'investissement importantes. Ils
constituent les apporteurs de capitaux idéaux pour l'entreprise au
premier stade de sa création (amorçage). En effet, les organismes
de capital-risque n'interviennent que lorsque l'entreprise montre
déjà une assise financière et des résultats
encourageants.
Les " Business Angels " ou investisseurs providentiels sont ainsi
nombreux aux Etats-Unis où ils entrent à titre privé au
capital de jeunes sociétés et les accompagnent de leurs conseils.
Or, en raison d'une fiscalité du patrimoine prohibitive
23(
*
)
(droits d'enregistrement en cas de transmission
d'entreprises, impôt de solidarité sur la fortune),
nombreux
sont les chefs d'entreprise français ayant réussi qui
préfèrent s'expatrier dans des pays à l'environnement
fiscal plus clément
. Selon l'association des moyennes entreprises
patrimoniales (ASMEP), ce sont ainsi plus de 1.500 milliards de francs qui sont
sortis de France depuis deux ans.
Plutôt que de laisser perdurer un mouvement qui devient
préoccupant, votre commission estime qu'
il convient d'atténuer
le prélèvement fiscal des dirigeants d'entreprises qui
réinvestissent en France le produit de leur réussite
entrepreneuriale dans de jeunes entreprises innovantes
en création.
Le présent article additionnel vise ainsi à permettre aux
redevables de l'ISF de réduire leur cotisation à proportion de
20 % de leurs investissements dans des sociétés innovantes.
Cette mesure ne serait évidemment pas cumulable avec d'autres
dispositifs fiscaux incitatifs tels la loi Madelin.
Donneraient droit à un tel avantage les souscriptions en
numéraire au capital de sociétés non cotées qui
répondent aux conditions suivantes :
Être soumises à l'impôt sur les
sociétés ;
Être majoritairement détenues par des personnes physiques
ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques ;
Être innovantes au sens de l'article 22-1 de la loi
n° 88-1201 du 23 décembre relative aux organismes de placement
collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds
communs de créance, c'est-à-dire :
- avoir réalisé, au cours des trois exercices
précédents, des dépenses de recherche d'un montant au
moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé
réalisé au cours de ces trois exercices (c'est la condition
donnant accès au crédit d'impôt recherche) ;
- ou justifier de la création de produits, procédés ou
techniques dont le caractère innovant et les perspectives de
développement économiques sont reconnus par l'ANVAR, ainsi que le
besoin de financement correspondant.
Par ailleurs, les parts dont la souscription donnerait droit à la
réduction d'impôt ne pourraient pas constituer des biens
professionnels au sens de l'article 885 O bis du code
général des impôts. En conséquence, un contribuable
qui souhaiterait bénéficier de la réduction d'ISF devrait
posséder moins de 25 % des droits financiers et des droits de vote
attachés aux titres émis par la société et ne
pourrait être membre de l'équipe dirigeante.
Enfin, les bénéficiaires de cet avantage devraient conserver
leurs parts pendant au moins cinq ans.
Avis de la commission : votre commission vous demande d'adopter l'article
additionnel qu'elle vous propose.
ARTICLE 4
Extension aux
établissements d'enseignement supérieur et aux organismes de
recherche du régime de droit commun
d'indemnisation du
chômage
Commentaire : le présent article tend à permettre aux établissements d'enseignement supérieur et aux organismes publics de recherche de cotiser aux ASSEDIC pour leur personnel contractuel.
Actuellement, en vertu du quatrième alinéa de
l'article L. 351-12 du code du travail, les collectivités territoriales,
pour leurs agents non titulaires, et les établissements publics
administratifs autres que ceux de l'Etat, pour leurs agents non statutaires,
peuvent adhérer au régime d'assurance chômage prévu
à l'article L. 351-4, selon lequel
" tout employeur est tenu
d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont
l'engagement résulte d'un contrat de travail ".
Le présent article propose d'étendre cette disposition aux
établissements publics d'enseignement supérieur et aux
établissements publics à caractère scientifique et
technologique (EPST), pour leurs agents non titulaires.
Ainsi, lorsque des travaux de recherche seront terminés, les personnels
contractuels bénéficieront des prestations versées par les
ASSEDIC, les établissements d'enseignement supérieur et de
recherche n'ayant plus à assurer eux-mêmes la gestion et le
paiement des indemnités pour perte d'emploi. Il s'agit d'une mesure de
simplification administrative
qui devrait inciter ces
établissements à passer davantage de contrats avec les
entreprises.
Avis de la commission : votre commission a émis un avis favorable
à l'adoption de cet article.
ARTICLE 5
Extension de la qualité de
professeur émérite
Commentaire
: le présent article tend à
faire
bénéficier de l'éméritat les enseignants-chercheurs
de rang magistral appartenant à des statuts spécifiques, afin de
leur permettre, après leur mise à la retraite, de continuer
à diriger des travaux de thèse et de recherche.
Les professeurs des universités bénéficient de
l'éméritat depuis l'intervention de la loi n° 84-434 du 13
septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction
publique. L'article 58 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984
modifié en précise les conditions d'attribution et d'exercice.
" Les professeurs admis à la retraite peuvent pour une
durée déterminée par l'établissement recevoir le
titre de professeur émérite par décision du conseil
d'administration prise à la majorité des membres présents
sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte
aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de
recherche dans un établissement, prise à la majorité
absolue des membres composant cette formation. Les professeurs
émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses
et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation ".
Ces dispositions, qui s'ajoutent à celles du maintien en
activité, prévu par la loi n° 86-1304 du 23 décembre
1986 qui donne la possibilité aux professeurs des universités de
continuer à exercer leurs fonctions, sur leur demande, jusqu'à
l'âge de 68 ans, sont très utilisées par les
établissements. Elles permettent notamment aux professeurs des
universités atteints par la limite d'âge de continuer à
diriger des travaux de thèses après leur admission à la
retraite.
Les enseignants-chercheurs de rang magistral relevant de statuts
spécifiques étant naturellement amenés à effectuer
une grande partie de leur service sous forme de direction de thèses,
séminaires ou recherches,
il convient de leur ouvrir la
possibilité déjà accordée à leurs homologues
universitaires.
Les professeurs émérites sont des fonctionnaires
retraités à qui est reconnue la qualité de collaborateurs
bénévoles du service public.
Ils ne peuvent donc percevoir
aucune rémunération pour les services qu'ils rendent à ce
titre. Seuls les frais de mission qu'occasionnent éventuellement les
tâches qui leur sont confiées peuvent faire l'objet d'une
indemnisation en application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
De même, en cas d'accident, leur couverture sociale est assurée
par l'université.
La mesure peut concerner environ 120 enseignants-chercheurs.
Avis de la commission : votre commission a émis un avis favorable
à l'adoption de cet article.
ARTICLE 6
Contribution des
lycées
d'enseignement général et technologique et des lycées
professionnels à la diffusion de l'innovation technologique
Commentaire
: le présent article propose
d'étendre le processus de valorisation de la recherche aux
établissements de l'enseignement du second degré.
Le présent article vise à compléter la loi n° 89-486
du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation afin de
développer la valorisation de la recherche au niveau de l'enseignement
du second degré.
Le I du présent article
propose d'insérer un nouvel
article dans la loi de 1989 précitée, permettant aux enseignants
de participer à des actions en faveur de l'innovation technologique et
du transfert de technologie. Il est précisé que de telles actions
doivent être conformes aux activités prévues par le projet
de l'établissement.
Dès lors, l'innovation et le transfert de technologie deviennent des
activités à finalité pédagogique.
Le II du présent article
tend également à introduire
un nouvel article dans la loi de 1989, qui donne aux lycées
d'enseignement général et technologique ainsi qu'aux
lycées professionnels la possibilité d'assurer des prestations de
service à titre onéreux en vue de réaliser des actions de
transfert de technologie.
De telles actions peuvent être réalisées de
deux
manières
.
Soit
, les établissements d'enseignement concernés passent
une convention
avec une ou plusieurs entreprises.
Soit
, ils
développent leurs actions de transfert dans le cadre d'
un groupement
d'intérêt public
(GIP) créé en application de
l'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le
développement du mécénat, lequel dispose que
" des
groupements d'intérêt public dotés de la
personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent
être constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de droit
public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de
droit public pour exercer ensemble, pendant une durée
déterminée, des activités dans les domaines de la culture,
de la jeunesse, de l'enseignement technologique et professionnel du second
degré et de l'action sanitaire et sociale, ainsi que pour créer
ou gérer ensemble des équipements ou des services
d'intérêt commun
nécessaires à ces
activités ".
Avis de la commission : votre commission a émis un avis favorable
à l'adoption de cet article.
TRAVAUX DE LA COMMISSION
I. COMPTE-RENDU DES AUDITIONS
Mardi
19 janvier 1999
La commission a procédé à l'
audition
de
M. Henri Guillaume, président
du
comité
d'engagement des fonds publics pour le capital risque.
M. Alain Lambert, président,
a indiqué, à titre
liminaire, que cette audition ouvrait un cycle consacré à
l'innovation et à la recherche et il a tenu à en souligner
l'intérêt dans la perspective du prochain examen, par le
Sénat, du projet de loi sur l'innovation et la recherche.
M. Henri Guillaume
a tout d'abord relevé la faiblesse de
la recherche technologique en France, révélée par un
décalage croissant entre la position scientifique de la France et sa
position technologique qui se dégradait, notamment dans les domaines de
la biotechnologie et de l'information, et cela en raison d'une insuffisante
collaboration entre le secteur de la recherche publique et le monde
économique. Il a rappelé que cette coopération
était essentielle comme le soulignait la volonté croissante, de
la part des entreprises, de travailler en liaison avec les
établissements de recherche. Il a indiqué que, selon lui,
plusieurs raisons pouvaient expliquer ce mauvais couplage. Il a tout d'abord
fait état d'attitudes culturelles ou de différences de
mentalité se traduisant par le faible nombre des passages entre les deux
sphères des entreprises et de la recherche, phénomène qui
était particulièrement marqué s'agissant des petites et
moyennes industries (PMI). Il a ensuite relevé l'existence de blocages
statutaires et réglementaires et s'est alors félicité du
prochain examen du projet de loi sur l'innovation et la recherche qui devrait
permettre de lever certaines ambiguïtés existant en ce domaine, et
notamment de fournir à ces relations un cadre déontologique
adéquat. Il a ainsi rappelé qu'aux Etats-Unis les
universités disposaient de filiales chargées
spécifiquement de gérer les brevets et qui constituaient des
structures intermédiaires entre le monde de la recherche et le monde de
l'entreprise, facilitant ainsi la tâche des chercheurs.
Il a enfin souligné la faiblesse des moyens affectés au
financement du capital risque, tout en relevant que cette situation
était en voie d'amélioration, notamment avec la création
du " Nouveau Marché " qui permettait d'accroître la
liquidité de ces sociétés, ou la
généralisation de " success-story " concernant des
dirigeants qui privilégiaient désormais la croissance de leur
entreprise plutôt que le contrôle du capital de celle-ci. Il a par
ailleurs indiqué que les capitaux apportés étaient
à hauteur de 50 % en provenance de fonds de pensions d'origine
anglo-saxonne, le reliquat étant réparti entre les particuliers
à hauteur de 30 % et les investisseurs institutionnels pour
20 %. Il a également fait état de mesures gouvernementales
positives, telles que la possibilité de réinvestir dans des
conditions fiscales favorables les capitaux issus de la revente d'une
entreprise (mécanisme du " roll-over "), ou le
développement des fonds publics pour le capital risque.
M. Henri Guillaume
a néanmoins fait état de deux
points faibles tenant, d'une part, aux difficultés rencontrées
lors de la phase précédant la création de l'entreprise,
" l'amorçage ", période dont le financement
n'était pas encore suffisamment assuré en France. Il s'est ainsi
déclaré favorable à l'octroi de dotations
complémentaires en faveur de ces fonds d'amorçage. D'autre part,
il a évoqué les risques liés à l'importance de la
participation des fonds de pensions anglo-saxons au capital de ces entreprises
et souhaité que l'épargne longue française puisse
être réorientée vers le capital risque grâce à
une évolution en ce sens de la fiscalité ou à la mise en
place de fonds de pensions à la française.
M. René Trégouët
a confirmé la
réalité des difficultés rencontrées par de
nombreuses entreprises lors de la phase d'amorçage et souhaité,
à ce titre, connaître les moyens d'y remédier.
S'agissant de l'amorçage,
M. Henri Guillaume
a
préconisé la mise en place d'un dispositif à plusieurs
étages permettant tout d'abord au monde de la recherche, à celui
de l'industrie et à celui de la finance de se regrouper afin de
travailler ensemble.
Il a également souhaité que puissent être mis en place des
fonds d'amorçage régionaux ayant une action de proximité
et rappelé l'intérêt du mécanisme fiscal du
" roll-over ". Il est enfin convenu de la difficulté d'arriver
à changer les attitudes culturelles, changement qui se traduirait
notamment par la reconnaissance du droit à l'erreur ou le renforcement
des liens et des synergies devant exister entre les gestionnaires et les
entrepreneurs.
M. Jean-Philippe Lachenaud
a souhaité obtenir des
précisions concernant l'implication des conseils régionaux et
généraux dans les fonds de capital risque. S'agissant des
stock-options, il s'est par ailleurs interrogé sur
l'intérêt de mettre en place un régime fiscal
spécifique au profit des entreprises innovantes, ainsi que sur la nature
des dispositions pouvant en accroître la transparence globale.
M. Henri Guillaume
a tout d'abord relevé, de façon
générale, la faible connaissance statistique des interventions
économiques des collectivités locales. Il a néanmoins
estimé que l'action des collectivités locales était plus
orientée vers le capital-investissement, c'est-à-dire vers l'aide
aux entreprises déjà existantes que vers le capital risque. Il a
également rappelé que les collectivités locales devaient
avoir un rôle important à jouer mais qu'il fallait cependant
veiller à ce que les capitaux privés soient également
présents et que, parallèlement, existe une expertise technique
indépendante. Il s'est par ailleurs déclaré favorable au
mécanisme des stock-options qui permettait de financer le risque et de
récompenser la création de richesse et qui devait s'effectuer
dans la transparence. Il a souhaité, à ce titre, que l'on puisse
sanctionner les éventuels abus plutôt que de réformer
l'ensemble du dispositif.
M. Joël Bourdin
l'a interrogé sur la nature des
relations existant entre le monde de l'université et le monde de
l'entreprise, ainsi que sur l'intérêt de mettre en place un statut
spécifique aux enseignants-chercheurs.
M. Henri Guillaume
lui a indiqué que le texte actuel du projet de loi sur l'innovation
permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes
déjà rencontrés par les chercheurs, notamment en mettant
fin à certains conflits d'intérêt, tout en rappelant que le
statut des enseignants-chercheurs, qui relevaient du statut de la fonction
publique, leur offrait déjà une latitude d'action non
négligeable.
Mme Maryse Bergé-Lavigne,
après avoir relevé
le faible nombre de chercheurs détachés auprès
d'entreprises, a souhaité que les relations entre l'entreprise et
l'université puissent se renforcer notamment par le biais de contrats
liant un " chercheur-visiteur " à des PMI.
M. Henri Guillaume
a rappelé l'intérêt pour
les entreprises de cette fonction d'expertise et de consultance
extérieure, et indiqué que certaines formules
expérimentées au plan local permettaient déjà, de
façon souple et peu coûteuse pour les PMI, d'associer les
chercheurs au fonctionnement de l'entreprise.
M. Alain Lambert, président,
s'est demandé si la
France ne manquait pas plus de projets de création d'entreprises que des
moyens de les financer, et si le report de la décision du Gouvernement
en matière de réforme des stock-options ne constituait pas un
signal négatif adressé aux entreprises et à leurs
dirigeants. De façon plus générale, il s'est
demandé si le niveau actuel de l'impôt sur le revenu et de
l'impôt de solidarité sur la fortune n'exerçait pas un
effet défavorable sur le développement de l'esprit d'entreprise
en France.
- M. Henri Guillaume lui a indiqué, s'agissant des entreprises de capital risque, que le niveau actuel des financements publics lui apparaissait satisfaisant et qu'à ce titre il était plutôt préférable de développer les financements privés en mettant en contact offre et demande de financement. S'agissant des stock-options, il a rappelé la nécessité de trouver une solution reposant sur la moralisation et la plus grande transparence du dispositif. Il a enfin souligné l'absence de données statistiques fiables permettant de mesurer de façon complète la réalité et l'ampleur du phénomène de " fuite des cerveaux ". Il a estimé par ailleurs indispensable que la fiscalité de l'épargne soit réorientée vers l'épargne à risque et les actions.
M. Bruno Vanryb s'est, dans un premier temps, félicité de l'existence du projet de loi sur l'innovation et la recherche, qui traduit une évolution des mentalités prenant en considération une réalité économique trop souvent négligée dans le passé. Il a rappelé que les 500 premières entreprises de croissance européennes avaient créé 180.000 emplois depuis cinq ans, ce chiffre révélant les gisements d'emplois considérables de l'innovation. Il a rappelé que le taux de chômage américain était de 4 %, alors même que le secteur de l'industrie continue à détruire des emplois, les services à haute valeur ajoutée faisant plus que compenser la disparition des emplois industriels.
M. Bruno Vanryb a indiqué que le projet de loi reprenait beaucoup de mesures que l'association " Croissance plus " avait proposées dans son livre blanc sur l'innovation. Il a, à cet égard, précisé qu'il se prononçait davantage sur l'esprit du texte que sur le détail de ses dispositions, considérant que chaque avancée législative, même partielle, était bénéfique à l'innovation et à l'emploi.
Il a jugé très positive la possibilité donnée aux chercheurs de créer une entreprise ou de participer à son capital, et de bénéficier d'une disponibilité d'une durée de deux ans. Il a cependant fait part de sa crainte de voir cette disposition remise en cause en raison des abus, même très limités, qu'elle engendrera nécessairement.
Il s'est en revanche montré beaucoup plus réservé sur les dispositions relatives aux fonds d'amorçage, estimant qu'il s'agissait de distribuer des subventions aux entreprises. Il a considéré que la création d'entreprises innovantes devait résulter de modifications fiscales. Il a, par exemple, proposé de faire de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) un impôt plus citoyen en faisant bénéficier d'un crédit d'impôt de 50 % les sommes aujourd'hui imposables à l'ISF, qui seraient investies dans des entreprises innovantes. Il a assuré que cette réforme permettrait de mobiliser des capitaux considérables.
M. Bruno Vanryb a souhaité que le crédit d'impôt recherche fasse l'objet d'un remboursement par avance, les entreprises innovantes étant avant tout confrontées à un problème de trésorerie. Il a regretté à cet égard que le crédit d'impôt ait été simplement prolongé par la loi de finances pour 1999.
Il a déploré que le volet fiscal relatif aux stock-options ait été finalement retiré du projet de loi, tout en insistant sur la divergence d'appréciation au sein même du Gouvernement. Le système des stock-options apparaît aujourd'hui déconsidéré en raison des abus auxquels il a donné lieu et de sa réputation de salaire déguisé pour les dirigeants d'entreprises. Il a dès lors proposé d'étendre ce dispositif à au moins 20 % du personnel de l'entreprise afin d'accroître la participation des salariés au capital et d'éviter une fuite des cerveaux préjudiciable à l'économie française. Il a également plaidé pour l'introduction d'une plus grande transparence du dispositif.
S'agissant des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, il a considéré que l'extension du dispositif, qu'il a qualifié de " mini stock-options ", était tout à fait favorable aux " start up ", mais a exprimé son souhait de le voir prolongé au-delà de l'an 2000.
Il a ainsi estimé que l'ensemble des dispositions du projet de loi allaient dans le bon sens et qu'elles devaient selon lui être soutenues, d'autant plus qu'elles surviennent dans un contexte difficile pour les entreprises, marqué notamment par la loi sur les 35 heures.
M. Philippe Marini, rapporteur général, a exprimé son accord avec l'orientation générale des propos du président de " Croissance plus ", et a également insisté sur la décrispation des positions gouvernementales sur la question des stock-options. Il s'est interrogé sur la manière d'éviter que les stock-options n'apparaissent comme " des sur-rémunérations sous-fiscalisées ", alors qu'ils doivent favoriser la prise de risque. Il a également rappelé que l'attribution d'options sur le capital de filiales réduisait les exigences de transparence, et augmentait les risques d'abus. Il s'est ainsi interrogé sur l'équilibre qu'il fallait trouver entre un devoir de transparence et une indispensable incitation fiscale.
Il a fait part de son scepticisme relatif aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, qui constituent une nouvelle espèce de valeurs mobilières compliquant un droit commercial déjà archaïque. Il s'est alors interrogé sur le fait de réserver ce dispositif aux entreprises innovantes, et a souhaité connaître la définition que donne " Croissance plus " d'une entreprise innovante, alors même que l'environnement économique et fiscal de toutes les entreprises devrait être amélioré.
M. Bruno Vanryb a affirmé partager l'avis du rapporteur général sur la nécessité pour les entreprises de bénéficier de dispositions fiscales simples et globales, mais a expliqué que l'urgence actuelle imposait une démarche pragmatique, la tentative d'élaborer des mesures globales risquant d'être infructueuse. Il a estimé qu'il était préférable de parler d'entreprises de croissance plutôt que d'entreprises innovantes, et a proposé une définition de l'entreprise de croissance combinant deux critères, le doublement du chiffre d'affaires sur cinq ans, et la création d'emplois. Il a dès lors jugé qu'il existait, d'une part, des entreprises de croissance, et, d'autre part, des entreprises jeunes, une entreprise ancienne pouvant être innovante.
M. Bruno Vanryb a expliqué qu'il était souhaitable de ne plus assimiler les stock-options à un complément de rémunération. Pour ce faire, " Croissance plus " propose de supprimer le rabais permettant d'obtenir une option à un niveau inférieur de 20 % à son cours de bourse, et d'établir une période d'indisponibilité fiscale de trois ans. Il a également suggéré de désigner les attributaires de stock-options, comme c'est le cas dans les pays anglo-saxons, afin d'accroître la transparence du dispositif, mais aussi de permettre d'élargir le nombre de participants au capital, qui est, par exemple, de 40 à 50 % du personnel d'une entreprise de la Sillicon Valley. La possibilité pour les salariés de devenir actionnaires de leur propre entreprise constitue la meilleure façon de récompenser le travail. Il s'est déclaré hostile à l'attribution d'options sur le capital d'une filiale, les salariés de cette dernière devant plutôt bénéficier d'options de la maison mère.
M. René Trégouët a insisté sur le fait que, contrairement à des affirmations persistantes, le Sénat n'était pas hostile aux entreprises innovantes. Il a souhaité connaître le nombre d'entrepreneurs français quittant chaque année leur pays pour l'étranger.
M. Bruno Vanryb a rappelé que les statistiques ne faisaient pas apparaître une fuite des cerveaux revêtant le caractère d'un mouvement de masse. Il a néanmoins estimé que beaucoup d'entrepreneurs quittaient la France en raison de l'injustice qu'ils ressentent face à une fiscalité qu'il a qualifiée de " confiscatoire " et qui ne prend pas en considération le travail considérable qu'ils ont accompli, notamment au moment de la création de leur entreprise. Il a jugé préoccupant le départ de jeunes diplômés français pour l'étranger, rappelant que le marché du travail était désormais pour eux européen et non plus national. Cet exode, à sens unique, trouve son origine dans la fiscalité.
M. Jean-Philippe Lachenaud a indiqué que le Sénat préférerait une disposition générale à une disposition applicable aux seules entreprises innovantes, et a estimé qu'un régime spécifique n'était motivé que par des raisons politiques. Il a ajouté qu'un régime spécifique devait être juridiquement solide, et a, à cet égard, considéré fragiles les critères ébauchés pour définir une entreprise de croissance.
M. Bruno Vanryb a souligné que " Croissance plus " était favorable à un régime général applicable aux entreprises de croissance. Mais il a rappelé que le contexte actuel militait en faveur de l'extension des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, qui réduisent considérablement les abus et qui sont réservés aux entreprises de croissance de petite taille. A cet égard, le projet de loi sur l'innovation constitue une position de repli, qui ne nécessite pas, de ce fait, une définition précise de la notion d'entreprise de croissance.
M. René Ballayer a souhaité obtenir des précisions s'agissant des propositions fiscales de " Croissance plus ". Il a voulu savoir comment seraient sélectionnés les 20 % de salariés d'une entreprise auxquels seraient attribuées des options. Puis, il s'est interrogé sur le nombre d'entreprises ayant doublé leur chiffre d'affaires depuis 5 ans.
M. Bruno Vanryb a estimé que l'Etat était un mauvais actionnaire et qu'il allouait des subventions aux grandes entreprises sans prendre véritablement en considération leurs besoins. Il a considéré que l'action de l'Etat en faveur des entreprises devait porter sur le niveau des charges sociales et sur la fiscalité. S'agissant des charges sociales, il a estimé que l'Etat devait éviter de mettre en place des réductions de charges ciblées, sur les bas-salaires par exemple, et a préconisé une diminution globale de leur niveau. Il a rappelé que l'ISF était un impôt confiscatoire, pénalisant les investissements productifs.
Il a souligné que, actuellement, le seul moyen de récompenser les salariés les plus méritants résidait soit dans l'augmentation des salaires, soit dans l'attribution de primes. Eu égard aux inconvénients de ces deux solutions, il a estimé que seul l'octroi d'options aux salariés d'une entreprise permettait de récompenser leur investissement professionnel.
Il a fait état de mauvaises connaissances statistiques qui rendent impossible un chiffrage exact du nombre d'entreprises ayant doublé leur chiffre d'affaires en cinq ans, mais a toutefois précisé qu'environ 20.000 entreprises étaient inscrites sur le fichier européen des entreprises de croissance.
Mme Maryse Bergé-Lavigne a considéré que l'un des principaux avantages de la loi sur les 35 heures était de permettre aux femmes d'accéder à des postes d'encadrement au sein des entreprises. Elle a en effet rappelé que les cadres féminins, pour concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, ne bénéficiaient que de perspectives de carrière trop souvent limitées à la fonction publique.
M. Bruno Vanryb a indiqué que les entreprises adhérentes à l'association " Croissance plus " comportaient un nombre important de femmes à des postes d'encadrement. Il a en outre souligné que, en termes d'horaires de travail, la différenciation habituelle entre les cadres et les non-cadres était inopérante dans les entreprises de croissance, qui connaissent un mode de travail très souple, reposant essentiellement sur l'annualisation du temps de travail. Il a rappelé que " Croissance plus " n'était pas hostile au principe de la réduction du temps de travail, qui constitue une avancée sociale, mais que la loi sur les 35 heures avait un caractère technocratique satisfaisant essentiellement les grandes entreprises. La logique de "pointeuse " qui a présidé à son élaboration est incompatible avec le mode de fonctionnement des petites entreprises de croissance. Il a jugé préférable de réduire le temps de travail en augmentant le nombre de journées de congé plutôt que de réduire les horaires hebdomadaires.
M . Maurice Blin a voulu savoir si M. Bruno Vanryb avait obtenu des aides particulières lors de la création de son entreprise. Puis il s'est interrogé sur le niveau de la productivité des entreprises françaises.
M. Bruno Vanryb a expliqué que, s'étant retrouvé au chômage en 1983, il a bénéficié, afin de payer les premiers salaires de ses employés, de six mois d'allocation chômage versée en une seule fois. Il a également obtenu de ne pas payer d'impôts pendant trois ans puis de les payer de manière dégressive pendant deux ans, cette mesure étant réservée alors aux entreprises nouvelles. A cet égard, il a estimé préjudiciable, à la création d'entreprise, l'instabilité législative ayant affecté cette disposition. Il a ajouté que la réussite professionnelle aux Etats-Unis ne nécessitait pas des qualités personnelles remarquables, alors que la France célèbre des entrepreneurs présentés comme ayant des qualités exceptionnelles. Il a d'ailleurs estimé que les aides publiques devaient être essentiellement destinées aux nombreux entrepreneurs qui restent inconnus. Il a considéré que la période actuelle constituait un contexte très favorable à la création d'emplois, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, et qu'il fallait tirer profit de cette fenêtre de tir dont la durée sera nécessairement brève.
M. Bruno Vanryb a affirmé que les ingénieurs français étaient probablement les plus créatifs mais que les entreprises françaises souffraient d'un handicap en termes d'action commerciale. Il a estimé que la productivité des entreprises françaises était très bonne, bien meilleure que celle des entreprises allemandes, même si le niveau plus élevé des salaires Outre-Rhin permettait de consommer davantage. De même, aux Etats-Unis, le niveau très élevé des salaires dans les entreprises de croissance fait plus que compenser le faible niveau des charges sociales.
Mercredi 3 février 1999
La commission a procédé à l' audition de M. Jean-René Fourtou, président directeur général du groupe Rhône-Poulenc
M. Alain Lambert, président , a rappelé que cette audition s'inscrivait dans le cadre des consultations régulières de grands entrepreneurs français auxquelles est attachée la commission des finances du Sénat, mais que le témoignage de M. Jean-René Fourtou, auteur du rapport " Innover et entreprendre ", publié en 1998 par l'Institut de l'entreprise, visait également à préparer le rapport pour avis, confié à M. René Trégouët, sur le projet de loi sur l'innovation et la recherche.
M. Jean-René Fourtou a rappelé que la société Rhône-Poulenc était vieille de plus d'un siècle, et qu'il s'était assigné un double objectif depuis qu'il était à sa tête : recentrer les activités sur la chimie des spécialités, et développer le secteur de la pharmacie. Il s'est félicité de l'introduction en bourse, au mois de juin 1998, des branches chimie et fibres rassemblées dans la société " Rhodia ", et a précisé que la fusion récemment annoncée de Rhône-Poulenc avec la société allemande Hoechst pour créer la firme Aventis, dont le siège sera situé à Strasbourg, s'accomplira sur une période de trois ans.
M. Jean-René Fourtou s'est ensuite réjoui de la progression (23 %) des résultats de Rhône-Poulenc, d'un exercice à l'autre, et a estimé que cette évolution était autant due aux nombreuses cessions et acquisitions auxquelles il a procédé qu'au produit des innovations récentes, notamment en matière de lutte contre le cancer et les maladies cardiaques, et dans le domaine des insecticides et herbicides. Au total, jamais le groupe n'avait mis sur le marché autant de spécialités nouvelles.
Il a précisé que les raisons de la récente fusion -opération toujours délicate- avec Hoechst sont à rechercher dans l'ampleur des investissements désormais requis pour mener des recherches sur le génome et sur les molécules, ainsi que pour en commercialiser les résultats sur les marchés internationaux.
Avec un budget de recherche et de développement de trois milliards de dollars par an, la société Aventis se situera au premier rang mondial, devant Novartis qui y consacre 2,5 milliards de dollars par an.
M. Jean-René Fourtou a estimé que seule une forte capacité d'innovation permettrait aux firmes occidentales de résister à la concurrence asiatique bénéficiant de faibles coûts de main d'oeuvre, mais a constaté que notre pays n'était guère performant en matière d'innovation.
C'est pour tâcher de remédier à cette faiblesse nationale que l'Institut de l'entreprise, qui regroupe une centaine de capitaines d'industrie, lui a confié la rédaction du rapport sur la création d'entreprises. Ses conclusions peuvent se résumer en trois actions prioritaires, dans les domaines de l'éducation, de la fiscalité et du rapprochement des capacités de recherche publiques et privées.
L'éducation dispensée en France apporte un bon niveau de connaissances, mais développe trop peu l'initiative. Un colloque, récemment organisé à Lyon à la suite de la publication de son rapport, a fait ressortir une forte demande des grandes écoles françaises en matière de formation à l'innovation.
M. Jean-René Fourtou a évoqué l'éventualité d'un tour de France des régions pour sensibiliser tous les acteurs impliqués dans l'innovation.
Il a, par ailleurs, regretté que les créateurs soient si fortement bridés par la fiscalité française, à la différence de celle prévalant aux Etats-Unis, et a estimé que seul un allégement fiscal direct inciterait les personnes physiques à engager des fonds dans les activités innovantes, qui sont toujours soumises à des risques financiers.
Après avoir rappelé que la société Rhône-Poulenc avait été parmi les premières à conclure des contrats de recherches simultanément avec le CNRS (centre national de recherche scientifique) et d'autres sociétés privées, comme l'Oréal, Michelin ou Saint-Gobain, M. Jean-René Fourtou a conclu en évoquant la nécessité de soutenir fortement la création de petites entreprises françaises, qui sont le vivier des courants d'innovation, et a rappelé que près de 2.000 de ces entreprises étaient annuellement créées aux Etats-Unis dans le seul domaine de la biologie.
C'est ainsi que la société Rhône-Poulenc a institué un fonds pour la création de nouvelles sociétés d'innovation technologique, dont le jury scientifique est présidé par M. Pierre-Gilles de Gennes, professeur au Collège de France.
Au terme de cet exposé, M. Philippe Marini, rapporteur général, a interrogé M. Jean-René Fourtou sur l'état de l'harmonisation européenne en matière de droit des sociétés, et sur la nature des blocages qui retardent la mise au point d'une société de droit européen. Il a également souhaité savoir si les méthodes de cogestion en vigueur en Allemagne ne s'opposeraient pas à la réelle intégration d'Hoechst et de Rhône-Poulenc au sein d'Aventis.
Evoquant les dispositifs fiscaux d'incitation à l'innovation, M. Philippe Marini, rapporteur général, a rappelé la récente émergence d'une rupture de traitement entre sociétés de plus ou moins de quinze ans d'âge, et s'est interrogé sur la pertinence de ce chiffre. Il a enfin souhaité recueillir l'avis de M. Jean-René Fourtou sur le dispositif optimal d'incitation fiscale à l'innovation.
M. Alain Lambert, président, a rappelé le souci permanent de la commission du maintien de la compétitivité des entreprises françaises, qui ne doivent pas être lésées par des mesures fiscales en constante évolution.
En réponse, M. Jean-René Fourtou a souligné la difficulté éprouvée par les entreprises françaises à retenir les meilleurs talents, qui trouvent aux Etats-Unis un contexte général beaucoup plus favorable à leur réussite.
Il a confirmé qu'il n'existait, à l'heure actuelle, aucune harmonisation européenne du droit des sociétés, essentiellement du fait de l'attachement des syndicats allemands au système de cogestion, qui n'est pourtant pas efficace : on peut, en effet, estimer que les entreprises allemandes sont, du fait de ce système, privées de facto de conseil d'administration ou de surveillance.
Il a reconnu que la création progressive d'Aventis, à partir de deux entreprises, l'une française et l'autre allemande, serait inévitablement compliquée par cet aspect, qui oppose non seulement patronat et syndicat, mais également syndicats français et allemands.
Puis M. René Trégouët, rapporteur pour avis du projet de loi sur l'innovation et la recherche, a interrogé M. Jean-René Fourtou sur la localisation, dans le monde, des chercheurs employés par Rhône-Poulenc, sur l'impact éventuel du poids de la recherche publique française sur les faibles performances de notre pays en matière de dépôts de brevets, et sur l'apport du projet de loi à l'évolution des mentalités françaises vers une meilleure reconnaissance de l'innovation.
En réponse, M. Jean-René Fourtou a précisé que la majorité des chercheurs employés par Rhône-Poulenc travaillaient en France : ils sont 5.000 dans ce cas, 2.000 d'entre eux travaillant en Grande-Bretagne et un millier aux Etats-Unis.
Il a rappelé que la création d'Aventis faisait à nouveau rentrer l'ancienne société Roussel, et ses importants laboratoires de recherche, dans le giron français.
Il a regretté que le système public de recherche français incite plus les chercheurs à publier qu'à innover, ce qui conduit à l'expatriation des plus dynamiques d'entre eux, mais il a constaté que notre tradition nationale était fortement et profondément réfractaire à l'innovation : seul un long et patient travail d'éducation permettra de faire évoluer les mentalités sur ce point.
M. Jean-René Fourtou a précisé qu'en 1998, 27 % du chiffre d'affaires de Rhône-Poulenc avait été réalisé aux Etats-Unis contre 18 % en France et que plus de la moitié du capital de son entreprise était détenue par des actionnaires étrangers.
Puis M. François Trucy a interrogé M. Jean-René Fourtou sur le nombre de nouvelles molécules produites par sa société, ainsi que sur la place de Rhône-Poulenc dans la compétition internationale.
M. Claude Belot a souhaité être informé des résultats de la privatisation de Rhône-Poulenc, et des modalités retenues pour le futur " Tour de France de l'innovation " évoqué par M. Jean-René Fourtou.
Mme Marie-Claude Beaudeau s'est interrogée sur les méthodes fiscales ou budgétaires les plus efficaces pour encourager la recherche industrielle, et sur le rôle des industries pharmaceutiques dans la maîtrise des dépenses de santé.
M. Maurice Blin a rappelé que la fusion de Rhône-Poulenc et d'Hoechst avait été décrite par certains comme " la réunion de deux faiblesses ". Il a souhaité savoir si le marché américain du médicament était protectionniste, et s'est également interrogé sur la possibilité de concilier l'individualisme inhérent au processus de création avec la lourdeur des investissements évoquée par M. Jean-René Fourtou : enfin, il a souhaité recueillir l'avis de M. Jean-René Fourtou sur la qualité de la recherche d'Etat en France.
M. Jean-Philippe Lachenaud s'est interrogé sur l'état de la structuration du capital de Rhône-Poulenc, et sur ses relations avec l'université française.
M. René Ballayer a souhaité connaître le délai requis pour la diffusion d'une nouvelle spécialité, et le produit le plus vendu par Rhône-Poulenc.
Enfin, M. Joseph Ostermann s'est réjoui de l'implantation d'Aventis à Strasbourg et a souhaité connaître l'impact de la réduction du travail à 35 heures sur des sociétés comme Rhône-Poulenc.
En réponse, M. Jean-René Fourtou a précisé que les nouvelles molécules issues de la recherche du groupe Rhône-Poulenc-Hoechst étaient très nombreuses en pharmacie et en agrochimie, ce qui n'est pas le cas pour les biotechnologies.
Il a rappelé la forte progression du titre Rhône-Poulenc, dont le cours a été multiplié par 2,5 depuis sa privatisation. Cette progression est, en partie, due à la séparation opérée entre les activités de chimie et de pharmacie, qui a rendu plus claire l'organisation de Rhône-Poulenc, ce qui a avantagé la société en bourse. Le titre Aventis disposera, quant à lui, d'un fort potentiel de croissance boursière.
S'agissant des incitations fiscales, M. Jean-René Fourtou s'est prononcé en faveur d'avantages directs plutôt que d'un accroissement de l'aide publique. Les incitations les plus efficaces sont celles qui " raccourcissent le circuit fiscal ".
Il a déploré que la presse française présente presque toujours négativement les évolutions industrielles de notre pays, ce qui n'est pas le cas de la presse anglo-saxonne.
Il a précisé que la politique américaine du médicament était très exigeante en matière de qualité, mais pas protectionniste. La conciliation entre individus et firme de grande ampleur est possible : l'innovation exige en effet de très gros moyens, notamment informatiques, mais s'opère au mieux au sein de petites équipes.
La recherche publique française comprend des individus d'excellente qualité, comme l'illustrent les remarquables résultats des laboratoires mixtes associant des chercheurs de Rhône-Poulenc et d'autres issus du CNRS ; et ce sont les universités qui produisent les meilleurs chercheurs, plus que les grandes écoles.
Le temps d'innovation a été progressivement réduit de 10 à 7 ans.
En nombre d'unités, le produit le plus vendu par Rhône-Poulenc est le Doliprane, et, en chiffre d'affaires, le plus rentable est le Lovenox.
Enfin, M. Jean-René Fourtou a conclu en rappelant les conséquences positives de la fusion avec Hoechst, et le caractère pérenne de l'implantation à Strasbourg d'Aventis.
Puis la commission a procédé à l'audition de M. Pierre-Gilles de Gennes, professeur au Collège de France.
En introduction, M. Pierre-Gilles de Gennes a tenu à préciser qu'il occupait ses fonctions non pas à l'université mais d'une part, au Collège de France et d'autre part, à l'école de physique et de chimie dont il a souligné la culture particulière, notamment dans la gestion des brevets.
Ensuite, il a constaté que l'innovation était très menacée dans l'ensemble des pays industriels. Alors que les années 1900-1990 se caractérisaient par des centres de recherches associés à des grands pôles industriels, désormais, la recherche à long terme souffre de la stratégie des actionnaires qui privilégient leur intérêt à court terme.
Il a également estimé que les concentrations d'entreprises réalisées sous la pression des actionnaires menaçaient les centres de recherche.
Il a expliqué que cette tendance aux Etats-Unis était compensée par le fort développement de petites entreprises de " high-tech " soutenues par l'Etat et les capitaux-risqués.
Puis il a fait remarquer qu'en France, le niveau de la recherche était tout à fait satisfaisant, mais que la persistance d'un préjugé contre les applications avait des conséquences dramatiques.
A cet égard, il a rappelé qu'il y a quelques années une prime de recherche avait été créée pour encourager les universitaires à faire de la recherche, mais que les chercheurs conseillers d'entreprises privées avaient été exclus du bénéfice de ladite prime.
Concernant le projet de loi sur l'innovation, il a estimé que ce dernier constituait un progrès réel. Ainsi, il permettra à un chercheur d'être le dirigeant d'une entreprise qu'il anime ou encore de prendre une participation de 15 % dans le capital de l'entreprise qu'il souhaite créer.
Toutefois, il a estimé cette dernière disposition trop timide et a souhaité que le chercheur puisse entrer à hauteur de 50 % du capital de son entreprise.
Il s'est également félicité de la création " d'incubateur " de petites entreprises, sous réserve de la proximité d'un pôle scientifique.
En revanche, il a critiqué la logique du projet de loi qui oblige un jeune désireux de créer sa société à soumettre son projet à un comité d'examen administratif. En effet, il a reproché à ces comités d'être constitués de membres des agences comme l'ANVAR (l'agence nationale de valorisation de la recherche) qu'il a jugés défavorablement comme trop administratifs et sans expérience industrielle.
Il a souligné qu'aux Etats-Unis les chercheurs soumettent leurs projets à des investisseurs privés entourés d'experts de leur choix. Il s'est donc opposé à l'examen des projets par des commissions purement administratives.
Un large débat s'est alors instauré. M. René Trégouët a demandé des renseignements complémentaires sur le retard pris par la France en matière de gestion des brevets. Par ailleurs, face à l'influence croissante des actionnaires, il s'est demandé si la singularité française, à savoir l'importance de la recherche publique, ne pouvait pas constituer un atout par le développement d'accords entre la recherche privée qui s'occuperait du court terme et la recherche publique qui aurait le monopole du long terme.
Ensuite, il a regretté le décalage entre l'importance reconnue par tous de l'entreprise, et la mauvaise image de marque de l'entrepreneur et s'est interrogé sur les moyens à utiliser pour rénover l'image de ce dernier.
Enfin, il a constaté qu'aux Etats-Unis beaucoup d'industriels, dont on salue la réussite, ont en réalité auparavant essuyé un échec. Or, en France, peu d'industriels ont droit à une seconde chance. Il s'est donc demandé s'il ne fallait pas remédier à cette situation.
M. Maurice Blin a souhaité modérer les propos tenus par M. Pierre-Gilles de Gennes , concernant les obstacles rencontrés par les chercheurs du fait des actionnaires. Il s'est également étonné que la France ait perdu la position de pionnière dans la recherche qu'elle occupait au début du siècle.
Ensuite, il a demandé des précisions sur la culture particulière de l'école de physique et de chimie.
Mme Marie-Claude Beaudeau s'est interrogée sur l'effort consenti par la France pour la formation des nouveaux chercheurs au regard de la compétition internationale.
M. Jean-Philippe Lachenaud a demandé des informations complémentaires sur l'organisation et la circulation de la documentation scientifique et technique au niveau international ainsi que sur les conséquences du statut de la fonction publique sur l'efficacité de la recherche. Il a également souhaité savoir si M. Pierre-Gilles de Gennes avait été consulté pour l'élaboration des nouveaux programmes des lycées et des collèges afin de favoriser le développement des applications de recherche.
M. François Trucy s'est demandé si la taille des unités des laboratoires de recherches était adéquate.
En réponse, M. Pierre-Gilles de Gennes a décrit l'originalité du système de gestion des brevets développé par l'école de physique et de chimie. Il a précisé que les enseignants de cette école étaient encouragés à prendre des brevets puisque l'école ne prélevait aucun droit. En contrepartie, il leur faut obtenir les licences et contrôler la qualité de la production des produits résultant des brevets.
Il a ajouté que le personnel du CNRS doit soumettre ses brevets à l'agence du CNRS (Centre national de recherche scientifique). Deux cas se présentent alors : soit l'agence accepte le brevet et l'achète, soit elle ne le retient pas et son auteur est libre de le commercialiser sous sa propre responsabilité.
Concernant les actions en faveur d'un rapprochement entre la recherche et l'entreprise, M. Pierre-Gilles de Gennes a cité les investissements sous forme de bourse-thèse, le projet commun entre Rhône-Poulenc et le CNRS dénommé " Bioavenir ", ou encore la création d'équipes mixtes, notamment entre Rhône-Poulenc et le Centre d'études atomiques (CEA).
Concernant la rénovation de l'image de l'entrepreneur, il a plaidé pour une forte action de sensibilisation, voire d'éducation des enseignants. Ainsi, il a rappelé que 90 % des instituteurs avaient fait des études littéraires et ignoraient complètement le monde de l'entreprise. Il a estimé que l'envoi de professeurs pendant au moins 6 mois dans des PME en formation serait très utile pour développer des liens entre l'enseignement et l'entreprise.
Puis il a fortement défendu le " droit à l'échec " dont M. René Trégouët avait fait mention et a regretté que, faute de personnel suffisant pour tester leurs projets, de nombreuses entreprises sont obligées de se tourner vers l'agence nationale de valorisation de la recherche.
Concernant l'esprit particulier de l'école de physique et de chimie, après avoir rappelé ses origines, il a estimé qu'elle se caractérisait par une mentalité très pragmatique dont témoigne la création de nombreuses entreprises commercialisant les inventions de chercheurs de l'école.
Il a ensuite décrit l'évolution de cette école et a précisé que la création de la section biologie avait demandé douze années de négociations ardues, alors même que ce domaine sera le nouveau champ de création pour le XXIe siècle. A cet égard, il a regretté que les nouveaux biologistes ne trouvent pas de postes auprès des entreprises qui continuent de privilégier l'embauche de vétérinaires, de pharmaciens, d'agronomes ou de médecins.
Concernant les conflits d'intérêt entre les chercheurs et les actionnaires, il a reconnu que la situation variait d'une entreprise à l'autre. Toutefois, il a cité l'exemple des entreprises pétrolières qui, à défaut de l'accord de leurs actionnaires, ne peuvent investir dans des domaines porteurs comme les nouvelles énergies ou le recyclage des combustibles.
Sur la formation des chercheurs, il a rappelé qu'il existait deux voies : d'une part, l'université et, d'autre part, le CNRS et l'INSERM (institut national de la santé et de la recherche médicale). Il a critiqué le mauvais fonctionnement du recrutement universitaire qui favorise les laboratoires bien établis au détriment des laboratoires récents parfois plus dynamiques.
En revanche, il a estimé satisfaisant le fonctionnement des commissions de recrutement pour le CNRS et a constaté que le statut offert par ce dernier permettait aux chercheurs un travail plus rigoureux en diminuant la pression liée à la précarité de l'emploi.
Au sujet de l'évolution des supports de la documentation scientifique et technique, M. Pierre-Gilles de Gennes a insisté sur la nécessité de former les bibliothécaires aux nouvelles technologies dans la mesure où le support papier disparaît peu à peu.
Sur les conséquences du statut public de la recherche, il a estimé qu'il s'agissait d'un avantage si la fonction publique était capable de développer la mobilité en son sein.
A propos des programmes des lycées et des collèges, il a rappelé qu'il avait participé à un mouvement de concertation dans les années 1992-1995 et s'est félicité que certaines remarques aient été prises en compte par les directives ministérielles de 1996 et 1997.
Concernant la taille des unités de recherche, il a noté que les Etats-Unis privilégiaient des petites équipes de jeunes professeurs entourés de nombreux étudiants. Au contraire, la France a longtemps favorisé un système dans lequel la qualité d'un centre de recherches dépendait de la renommée de son directeur. Tout en reconnaissant que le modèle français avait permis la création de laboratoires de renom, il a constaté que les besoins avaient évolué et que les grandes structures pouvaient s'avérer étouffantes. Il a toutefois mis en garde contre le danger de l'émiettement couru par les universités cherchant à couvrir toutes les disciplines.
II. EXAMEN EN COMMISSION
Mercredi 10 février 1999
Au cours d'une première séance tenue dans la matinée
du mercredi 10 février 1999,
la commission des finances
a procédé à
l'examen
du
rapport
pour
avis
de
M. René Trégouët
sur le
projet
de
loi n° 152
(1998-1999) sur l'innovation et la recherche.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis,
a tout
d'abord fait observer que le projet de loi sur l'innovation et la recherche
constituait une heureuse initiative, qui s'inspirait toutefois de dispositions
proposées par le Gouvernement de M. Alain Juppé dans le projet de
loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
déposé le 2 avril 1997, mais que la dissolution de
l'Assemblée nationale avait rendu caduc. Il a précisé que
le Sénat, à l'initiative de M. Pierre Laffitte, avait
adopté en octobre dernier une proposition de loi tendant à
faciliter la création d'entreprises innovantes par des chercheurs, en
fixant les règles déontologiques de leur création.
Il a estimé toutefois que le Gouvernement avait arrêté un
choix contestable au regard des dispositions que ce projet de loi ne contenait
pas, notamment en matière de financement de l'innovation.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis
, a ensuite
présenté le contexte dans lequel intervient ce projet de loi.
Il a rappelé le constat, établi par M. Henri Guillaume, selon
lequel la France souffre d'un décalage important entre la qualité
de son potentiel scientifique et les retombées industrielles de la
recherche. En effet, notre pays dispose d'atouts scientifiques
indéniables comme l'illustrent les succès d'Ariane V, d'Airbus,
du TGV, ainsi que les prix Nobel français. Il a également
évoqué la qualité des publications scientifiques
françaises, notamment dans les mathématiques, dont la part
mondiale a crû de 4,3 % en 1983 à 5,1 % en 1995. Il a
également souligné que la France consacrait un effort
budgétaire important en faveur de la recherche, la dépense
intérieure de recherche-développement s'élevant à
environ 184 milliards de francs, soit 2,3 % du produit intérieur
brut. Il a toutefois rappelé que le système français de
recherche-développement était caractérisé par
l'importance de la recherche conduite dans le cadre public, la contribution
financière des entreprises ne dépassant celle des administrations
que depuis 1995. Il a fait observer que la France avait longtemps
cultivé le goût des grands programmes pilotés par l'Etat,
notamment dans le domaine militaire ou aéronautique.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis
, a cependant
déploré que cet effort considérable n'ait que des
répercussions médiocres en termes industriels et technologiques.
Ainsi, trop peu de grandes entreprises françaises sont présentes
dans les secteurs à forte croissance. Le retard de la France est patent
dans les technologies de l'information et les biotechnologies. Il a
rappelé que les positions technologiques françaises ont chu de 20
% depuis 1987 et que notre balance technologique était
déficitaire.
Il a indiqué que ces performances médiocres se retrouvaient en
matière de création d'entreprises, qui ont beaucoup
diminué au cours des années 1990. Il a remarqué que la
conjonction d'un niveau relativement faible de création d'entreprises et
d'un positionnement défavorable sur les secteurs en forte croissance
explique que la France ne bénéficie que faiblement des bienfaits
de l'innovation, notamment en matière de création d'emplois. Il a
souligné que, de 1973 à 1997, le nombre d'emplois avait
augmenté d'à peine un million en France mais de 43 millions aux
Etats-Unis.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis
, a ensuite
évoqué les causes de ce découplage technologique.
Certaines d'entre elles sont d'ordre culturel : elles tiennent notamment
aux réglementations très rigides héritées du
système des corporations ainsi que de la méfiance de la
société française envers l'argent. Il a également
regretté que l'échec soit en France frappé d'opprobre
tandis qu'il est considéré comme enrichissant aux Etats-Unis. Il
a également indiqué que la création d'entreprises
innovantes se heurtait à des obstacles administratifs et statutaires et
a cité les nombreuses tracasseries administratives, puis les
règles posées par le statut général de la fonction
publique qui sont incompatibles avec la création d'entreprises par les
chercheurs à partir des résultats de leurs travaux, les articles
432-12 et 432-13 du code pénal sanctionnant la prise illégale
d'intérêts. Or, le succès des entreprises innovantes tient
souvent à l'imbrication du monde de la recherche et du monde de
l'entreprise. Enfin, il a souligné l'inadaptation du système de
financement français, qui freine la croissance et pénalise la
création de petites et moyennes entreprises (PME) innovantes. Il a
cité l'importance du déficit budgétaire, le niveau
excessif des prélèvements obligatoires et des charges sociales,
l'aspect pénalisant de l'imposition des revenus comme de l'imposition de
la fortune ainsi que l'absence de fonds de pension drainant l'épargne
longue. A cet égard il a rappelé que la création
d'entreprises innovantes demandait une structure de financement
particulière, en raison de la difficulté éprouvée
par les prêteurs à procéder à une analyse du risque
selon des critères habituellement retenus. Il a jugé
nécessaire, dans ces conditions, d'améliorer l'environnement des
entreprises afin de favoriser l'accès des PME au marché du
crédit et à celui des capitaux et a souligné l'importance
du capital d'amorçage (seed capital). Il a estimé que, en France,
les investisseurs providentiels n'étaient pas fiscalement
favorisés, à l'inverse de ce qui se passe aux Etats-Unis
où ils apportent des ressources financières et un capital
d'expérience aux PME innovantes. Il a également rappelé le
développement insuffisant du capital-risque en France.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis
, a
estimé que le projet de loi sur l'innovation et la recherche comportait
un ensemble de dispositions d'ordre statutaire ou institutionnel allant dans le
bon sens, notamment parce qu'elles permettent de rapprocher les chercheurs du
monde de l'entreprise. La mise en place d'un cadre juridique permettant aux
personnels de la recherche de créer une entreprise valorisant leurs
travaux ou de lui apporter leur concours scientifique, ou encore d'être
membres du conseil d'administration d'une société anonyme, ainsi
que la possibilité donnée aux établissements
d'enseignement supérieur de créer en leur sein un service
d'activités industrielles et commerciales et des incubateurs, de
même que la participation des établissements d'enseignement du
second degré au processus de valorisation de la recherche, sont des
mesures très positives. Il a dès lors recommandé de donner
un avis favorable à l'adoption de ces différents articles dans la
rédaction proposée par la commission des affaires culturelles,
saisie au fond.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis
, a en
revanche estimé indispensable d'enrichir le volet fiscal de ce projet de
loi et d'aller bien au-delà de la disposition proposée par
l'article 3, relative à l'extension du champ d'application des bons de
souscription de parts de créateur d'entreprise.
Il a indiqué qu'il entendait présenter neuf amendements relevant
d'une logique globale en faveur du financement des entreprises innovantes. Il a
ainsi affirmé sa volonté de faciliter la création
d'entreprises en favorisant fiscalement les " investisseurs
providentiels ", d'améliorer la loi Madelin afin de mieux orienter
l'épargne de proximité vers les PME de croissance et de rendre
les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) plus
opérationnels. Il a également fait part de son souhait
d'introduire des dispositions relatives aux stock-options, rappelant que la
commission des finances du Sénat travaillait sur ce sujet depuis de
nombreuses années. Il a en effet rappelé que les stock options
avaient souffert de l'existence d'abus dans leur utilisation, liés en
partie à l'absence de transparence du dispositif. Il a jugé en
outre peu efficace la fiscalité de l'innovation en France, ce qui
conduit de nombreux chefs d'entreprises et cadres supérieurs à
quitter notre pays pour s'installer à l'étranger, et notamment
aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne où se sont établies 650
entreprises françaises.
M. Philippe Marini, rapporteur général
, s'est
entièrement associé à l'analyse du rapporteur pour avis et
s'est déclaré en accord avec la ligne qu'il avait exprimée.
M. Jean-Philippe Lachenaud
a également exprimé son accord
sur les orientations fiscales retenues en faveur de l'innovation. Il s'est
interrogé sur la possibilité pour le Gouvernement de motiver un
éventuel rejet des dispositions introduites par le Sénat par
l'argument juridique exprimé par le Conseil d'Etat selon lequel le
projet de loi aujourd'hui en examen ne devait pas contenir de mesures fiscales.
Il a voulu savoir si le dispositif proposé par le rapporteur pour avis
concernait l'ensemble des entreprises ou s'il était
réservé aux entreprises innovantes.
M. Maurice Blin
a estimé que les stock options constituaient le
seul mode de gratification du mérite et du risque aux Etats-Unis mais,
constatant l'écart important entre la situation américaine et la
situation française, il s'est interrogé sur la possibilité
de s'inspirer d'exemples européens, celui de la Grande-Bretagne en
particulier. Il a voulu obtenir des précisions sur l'insuffisante
irrigation du secteur privé par la recherche publique.
M. Michel Charasse
a rappelé que l'article 1
er
du
projet de loi permettait à un chercheur de créer une entreprise,
mais s'est inquiété de ce que la rédaction, selon lui,
imprécise de cet article permettait à un chercheur de
présider une commission d'appel d'offres. Il a estimé que le
même article introduirait une distinction entre les chercheurs et les
autres fonctionnaires, les premiers n'ayant droit qu'à des jetons de
présence du fait de leur participation à un conseil
d'administration. Il s'est également inquiété de ce que la
commission de déontologie devant laquelle un chercheur devrait passer
pour entrer dans une entreprise pourrait lui interdire de quitter son
administration d'origine au titre de la législation sur le
" pantouflage ". Il a regretté que le texte du projet de loi
n'aborde pas le problème de l'utilisation des moyens de la recherche
publique au profit des entreprises. Il a estimé qu'un système
d'agrément devrait être mis en place afin d'éviter aux
entreprises bénéficiaires du crédit
d'impôt-recherche d'être l'objet de contrôles fiscaux
systématiques. Enfin, il s'est demandé si l'avis du Conseil
d'Etat ne traduisait pas le souci de la haute juridiction administrative
d'écarter toute disposition fiscale importante d'un texte de loi autre
qu'une loi de finances, jurisprudence qu'il a jugée contraire à
l'ordonnance organique de 1959.
M. Philippe Adnot
a estimé que le projet de loi allait dans la
bonne direction, rappelant que de nombreux fonds d'amorçage disposaient
d'au moins 20 millions de francs. Il a exprimé son
inquiétude de voir les petites entreprises exclues des aides
financières que pourraient leur apporter ces fonds. Il s'est
également interrogé sur les risques de rigidité
administrative induite par la volonté de donner une base
législative aux incubateurs.
M. Alain Lambert, président
, a jugé que la
possibilité d'encourager et de récompenser les Français
les plus dynamiques et les plus entreprenants n'était en rien
incompatible avec le principe constitutionnel d'égalité, ni avec
la préservation de l'harmonie sociale. Rappelant l'ampleur
inquiétante que prend la "fuite des cerveaux ", il a
considéré que la France était tout à fait capable,
elle aussi, d'être attractive pour les jeunes diplômés
étrangers. Il a enfin jugé que le Sénat devait saisir
l'opportunité de l'examen de ce projet de loi en première lecture
pour introduire des dispositions importantes et novatrices, tout en laissant
à l'Assemblée nationale une marge d'appréciation de leur
pertinence.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis
, a
rappelé que le projet de loi comportait une disposition fiscale,
l'article 3, et que dès lors, le droit d'amendement des parlementaires
pouvait s'exercer dans sa plénitude. Il a ajouté que le
Gouvernement, lors de l'examen au Sénat du projet de loi de finances
pour 1999, s'était engagé à faire figurer dans le projet
de loi en examen des dispositions fiscales en faveur de l'innovation. Il a
expliqué que les bons de souscription de parts de créateurs
d'entreprise concernaient les entreprises innovantes, mais que les dispositions
introduites sur les stock options étaient ouvertes à l'ensemble
des entreprises. Il a en effet précisé que les stock options
s'inscrivaient dans un contexte marqué par le déclin relatif du
salariat et le développement de l'actionnariat, ajoutant que de
nombreux salariés de Microsoft avaient fait fortune grâce aux
stock options.
Il a rappelé que les chercheurs français étaient
évalués beaucoup plus par les publications que par le
dépôt de brevets. Il a indiqué que la commission des
affaires culturelles devrait examiner plusieurs amendements tendant à
améliorer les dispositions du projet de loi évoquées par
M. Michel Charasse. Il a rappelé qu'un agrément, le rescrit
fiscal, existait déjà pour le crédit
d'impôt-recherche mais que les entreprises en faisant la demande ne
recevaient pas nécessairement une réponse pertinente de la part
de l'administration fiscale. Il a précisé qu'il proposait
d'améliorer la mobilisation de l'épargne de proximité afin
de développer le capital d'amorçage dans notre pays.
Puis la commission a procédé à l'examen des amendements
présentés par son rapporteur pour avis.
A l'
article 3
, relatif à l'extension du champ
d'application des bons de souscription de parts de créateur
d'entreprise, la commission a adopté un amendement modifiant la
dénomination de ces titres en " bons de créateurs
d'entreprise " pérennisant le dispositif, assouplissant la
condition de détention du capital par des personnes physiques, et
supprimant la discrimination fiscale en fonction de l'ancienneté du
bénéficiaire dans l'entreprise.
Après une intervention de
M. Jean-Philippe Lachenaud
,
M.
René Trégouët, rapporteur pour avis
, a estimé
qu'une amélioration supplémentaire pouvait être
apportée en étendant le dispositif aux consultants
extérieurs, l'attribution de bons de créateurs d'entreprise
pouvant offrir l'opportunité à de jeunes entreprises de
rétribuer les services des consultants dont elles ont besoin.
La commission a ensuite examiné une série d'amendements portant
articles additionnels après l'article 3.
La commission a adopté un amendement visant à renforcer la
transparence du mécanisme des plans d'options de souscription ou d'achat
d'actions (stock-options) sur trois points :
- l'assemblée générale extraordinaire devrait
préciser les conditions dans lesquelles les actionnaires sont
informés chaque année des attributions nominatives d'options,
cette information nominative devant porter au minimum sur les options
consenties aux mandataires sociaux, ainsi qu'aux dix salariés qui en
sont les premiers bénéficiaires ;
- la possibilité de consentir un rabais sur le prix des options
par rapport au cours des actions serait supprimée ;
- des périodes sensibles durant lesquelles le conseil
d'administration ne peut pas attribuer d'options seraient définies, afin
de prévenir les délits d'initiés.
M. Philippe Marini, rapporteur général,
a
rappelé la position constante de la commission, selon laquelle les
stock-options ne sauraient être des
" sur-rémunérations sous-fiscalisées ". Il
a estimé que le dispositif proposé permettait d'atteindre un
équilibre entre l'incitation à la création d'entreprises,
d'une part, et des règles du jeu contraignantes, d'autre part. Il a
souligné que le dispositif proposé tendait à
améliorer la transparence des stock-options, dont les conditions sont
définies par l'assemblée générale, qui peut
décider d'aller au-delà d'une information nominative concernant
les mandataires sociaux, ainsi que les dix premiers salariés de
l'entreprise.
Il a estimé que la disposition relative aux " fenêtres
négatives " permettrait d'éviter des risques de
délits d'initiés, rappelant qu'une telle disposition avait
déjà été adoptée dans le cadre de la loi
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier de 1996,
mais qu'elle avait été jugée trop rigoureuse et
était demeurée inappliquée à ce jour faute du
décret prévu.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis
, a
ajouté qu'un tel dispositif existait dans de nombreux pays, notamment
aux Etats-Unis, où la transparence du système était
cependant plus assurée à l'initiative de l'autorité
boursière -la securities exchange commission (SEC)- que par la loi.
M. Jean-Philippe Lachenaud
a souhaité obtenir des
précisions sur les différences entre le dispositif proposé
par le rapporteur pour avis et le texte initialement prévu par le
Gouvernement. Il a également voulu savoir s'il était possible
d'attribuer des stock-options dans les filiales et s'il était
prévu un seuil minimum des effectifs de l'entreprise concernés
par l'attribution de stock-options.
M. Paul Loridant
a rappelé que le principal défaut du
système français de stock-options tenait à sa totale
opacité, l'assemblée générale n'abordant la
question de la transparence qu'avec une extrême réserve. Il a fait
part de sa perplexité sur le dispositif des stock-options dans les
sociétés non cotées, et a estimé que le rachat
d'options par l'entreprise à un prix fixé à l'avance
risquait de poser des problèmes sur le plan fiscal.
M. Roland du Luart
s'est interrogé sur la suppression du rabais
sur le prix des levées d'options par rapport au cours des actions au
regard des avantages accordés par l'Etat aux salariés achetant
les actions d'une entreprise publique privatisée ou faisant l'objet
d'une ouverture de capital.
M. Michel Charasse
a estimé qu'il était indispensable
d'être prudent sur la question des informations nominatives. Il a en
effet considéré que le secret-défense s'imposait dans les
entreprises concernées, dont les dix premiers salariés ne sont
pas toujours connus.
M. Alain Lambert, président,
a jugé que
l'établissement de règles pertinentes en matière de
stock-options devait concilier deux préoccupations parfois
contradictoires : la volonté de principe d'une totale transparence, et
la prise en considération pragmatique des contraintes de gestion des
entreprises. A titre personnel, il a estimé qu'en matière de
transparence, le mieux pouvait être l'ennemi du bien.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis,
a
rappelé qu'aux Etats-Unis, le dispositif des stocks options était
régulé par l'ensemble du système boursier et non par une
loi fédérale, et a précisé que la SEC se montrait
très exigeante en matière de transparence, laquelle existait
également dans les industries américaines de défense. Il a
estimé que les informations nominatives concernant les dix premiers
salariés de l'entreprise ne risquaient pas de favoriser le
débauchage de ces derniers par des chasseurs de tête, qui ne
travaillent pas sur l'organigramme de l'entreprise mais à partir
d'entretiens individuels. Il a précisé que les textes
français prévoyaient déjà un dispositif
d'attribution de stock-options dans les filiales. Il a ajouté que
l'établissement d'un seuil minimum d'attributaires n'irait pas dans le
sens de la simplicité du dispositif, pour les grandes entreprises en
particulier, et que cette question ne devait pas être abordée par
la loi, mais débattue librement au sein de l'assemblée
générale.
Citant l'exemple des entreprises de la Silicon Valley qui peuvent embaucher
des cadres de haut niveau grâce aux stock-options, il a estimé que
la valeur du risque était beaucoup moins importante dans les entreprises
cotées que dans les PME innovantes non cotées. Il a jugé
que la vente d'actions d'entreprises publiques privatisées et
l'attribution de stock-options n'étaient pas comparables, dans la mesure
où le détenteur de stock-options a, en tant que salarié de
l'entreprise, une responsabilité sur la valorisation des actions.
M. Michel Charasse
a considéré que, dans les faits, les
Américains prenaient beaucoup de liberté avec la transparence sur
les stock-options, notamment dans les entreprises de défense.
.
Après l'article 3
, la commission a ensuite adopté un
amendement portant
article additionnel
ayant pour objet de
réduire de 5 à 3 ans le délai d'indisponibilité
entre l'attribution des options et la cession des actions, qui conditionne
l'application du régime plus favorable de taxation forfaitaire de la
plus-value.
Elle a ensuite adopté un amendement portant
article additionnel
après ce même article, rétablissant le taux d'imposition
sur les plus-values de droit commun de 16 %, lorsqu'un délai de
portage d'un an est respecté entre la levée de l'option et la
cession des titres.
Toujours
après l'article 3
, elle a adopté un amendement
portant article additionnel
tendant à revenir à la
situation antérieure à la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1997, en exonérant les plus-values
de cotisations sociales (à l'exception des contributions de droit
commun), même lorsque le délai d'indisponibilité fiscale
n'est pas respecté.
Puis elle a adopté un amendement portant
article additionnel
visant à assouplir la règle selon laquelle les
sociétés innovantes éligibles aux fonds communs de
placement dans l'innovation (FCPI) doivent être détenues à
hauteur de 50 % de leur capital au moins par des personnes physiques ou
par des personnes morales détenues par des personnes physiques.
La commission a ensuite adopté un amendement portant
article
additionnel
permettant aux FCPI de placer leur investissement, non pas au
niveau de la société innovante, mais au niveau d'une
société-mère de sociétés innovantes.
Elle a ensuite adopté un amendement portant
article additionnel
tendant, d'une part, à doubler le plafond des versements ouvrant droit
aux réductions d'impôt sur le revenu prévues par la loi
Madelin, et, d'autre part, à supprimer la limite de souscription dans le
temps.
Enfin, toujours
après l'article 3
, elle a examiné un
amendement portant
article additionnel
autorisant les contribuables
à l'impôt de solidarité sur la fortune qui souscrivent au
capital initial ou aux augmentations en capital de sociétés non
cotées de réduire le montant de leur impôt jusqu'à
hauteur de 20 % de leurs investissements.
M. Jean-Philippe Lachenaud
a jugé cette proposition tout
à fait pertinente mais s'est demandé si le taux de 20 %
n'était pas trop restrictif.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis
, a
expliqué que ce dispositif poursuivait l'ambition de permettre à
des " investisseurs providentiels " (entrepreneurs ayant
cédé leur entreprise et titulaires d'un patrimoine important)
d'investir dans des entreprises en croissance et ainsi de limiter les
départs de citoyens français à l'étranger en raison
du poids excessif de l'ISF. Il a toutefois expliqué que son intention
n'était pas de créer un système permettant
d'échapper légalement à l'impôt.
M. Michel Charasse
a jugé intéressant le système
proposé par le rapporteur pour avis. Il a souligné l'importance
des capitaux ayant quitté notre pays, estimés à 600
milliards de francs, et s'est interrogé sur la manière de
dissuader une telle délocalisation.
Suite à une intervention de
M. Philippe Marini
,
rapporteur
général
,
M. René Trégouët,
rapporteur pour avis,
a proposé de rectifier son amendement de
manière à réserver le dispositif qu'il propose aux
entreprises innovantes. La commission a alors adopté cet amendement.
M. Roland du Luart
a évoqué la possibilité pour la
commission de mener une mission d'information sur la délocalisation des
capitaux.
M. Philippe Marini, rapporteur général
, a estimé
que ce phénomène s'expliquait par un contexte
général peu propice à la création de richesses dans
notre pays.
M. Michel Charasse
a estimé que la direction
générale des impôts connaissait le nombre de contribuables
ayant quitté définitivement la France, les candidats au
départ devant obligatoirement obtenir un quitus de l'administration
fiscale.
M. René Trégouët, rapporteur pour avis
, a conclu sur
la nécessité de prendre conscience de l'importance des
entrepreneurs pour l'avenir de la France.
La commission a alors décidé de donner un
avis favorable
à l'adoption du projet de loi sur l'innovation et la recherche ainsi
amendé.
PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR
|
Monsieur Pierre BATTINI, |
directeur du fonds public de capital risque (FCPR) géré par la Caisse des dépôts et consignations |
|
Monsieur Patrick SCHMITT, |
chef de service de la direction des affaires scientifiques et techniques du MEDEF |
|
Monsieur Pierre AMOUYEL, |
délégué général de l'association nationale de la recherche technique (ANRT) |
|
Monsieur Thierry JACQUILLAT, |
président de la commission des affaires économiques et financières de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris |
|
Messieurs Antoine DECITRE et Jean-Luc RIVOIRE, |
fondateurs de l'association SICOB pour la création d'entreprise |
|
Monsieur Emmanuel KESLER, |
conseiller technique au cabinet du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie |
|
Monsieur Alexandre TESSIER, |
directeur de l'association française des entreprises privées (AFEP) |
|
Monsieur Christophe LEVY, |
directeur de la recherche et du développement de l'entreprise Chryso (Groupe Lafarge) |
|
Monsieur Olivier CADIC, |
président de l'association La France libre... d'entreprendre (à Londres) |
|
Monsieur Daniel MOLLARD, |
directeur général adjoint de la SOFARIS |
|
Monsieur Emmanuel LEPRINCE, |
délégué général du comité Richelieu |
|
Monsieur Lucien PFEIFFER, |
président du CECIA |
|
Madame Fabienne SORIN et Monsieur Rémi LESERVOISIER, |
de l'AFG - ASSFI |
|
Monsieur Michel DIDIER, |
président de REXECODE |
|
Monsieur Philippe JURGENSEN, |
président de l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) |
|
Monsieur Laurent KOTT, |
directeur général d'INRIA-Transfert |
|
Monsieur Stéphane BOUJNAH, |
conseiller technique au cabinet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
|
Monsieur Jean-Dominique PERCEVAULT, |
président-directeur général de Services pétroliers Schlumberger |
AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
___
|
Texte
en vigueur
|
Propositions de la Commission
|
|
Code
général des impôts
I. - Le
gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en
exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II
et III est imposé dans les conditions et aux taux prévus aux
articles 92 B, 92 J ou 160, ou au 2 de l'article 200 A.
|
Article 3
Rédiger ainsi cet article :
|
|
II. - Les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent, à condition d'avoir été immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans, attribuer aux membres de leur personnel salarié, ainsi qu'à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, incessibles, et émis dans les conditions prévues à l'article 339-5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
II. Dans le premier alinéa du II, les mots : " bons de souscription de parts de créateur d'entreprise " sont remplacés par les mots : " bons de créateur d'entreprise ". |
|
1. La société doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et être passible en France de l'impôt sur les sociétés ; |
|
|
2. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation ; ................................................................................ .... |
III. La première phrase du troisième alinéa (2.) du II est ainsi rédigée : " à la date d'attribution des bons, le capital de la société doit être détenu directement pour 25 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. ". |
|
V - Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au II peuvent être attribués à compter du 1er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre 1999, ou jusqu'à l'expiration du délai de quinze ans prévu au II si celle-ci est antérieure. Ces modifications s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués à compter du 1er septembre 1998. |
IV. Le V est supprimé. |
|
|
B. Les pertes de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
Loi
n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales
|
Article additionnel après l'article 3 A. L'article 208-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est ainsi modifié : |
|
L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à la souscription d'actions. L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à cinq ans. |
|
|
Le conseil
d'administration ou le directoire fixe les conditions dans lesquelles seront
consenties les options. Ces conditions pourront comporter des clauses
d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans
que le délai imposé pour la conservation des titres puisse
excéder trois ans à compter de la levée de l'option.
|
|
|
Le prix de souscription est fixé au jour où l'option est consentie, par le conseil d'administration ou le directoire, selon les modalités déterminées par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport des commissaires aux comptes. Si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix de souscription ne peut pas être inférieur à 80 p. 100 de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant ce jour, aucune option ne pouvant être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d'un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital. |
I. Dans le quatrième alinéa, les mots : " 80 p. 100 de " sont supprimés. |
|
Les options ne peuvent être consenties durant une période, fixée par décret, qui précède et qui suit l'arrêté et la publication des comptes sociaux ainsi que tout événement de nature à affecter significativement la situation et les perspectives de la société. |
II. Le
cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
|
|
|
" - dans le délai d'un mois précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ; |
|
|
" - dans un délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'un événement qui, s'il était rendu public, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et le mois suivant la date à laquelle cet événement est rendu public. " |
|
Art. 208-3
L'assemblée générale extraordinaire peut
aussi
autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à
consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de
la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit
à l'achat d'actions provenant d'un rachat effectué,
préalablement à l'ouverture de l'option, par la
société elle-même dans les conditions définies aux
articles 217-1 ou 217-2.
|
B. Au deuxième alinéa de l'article 208-3 de la loi précitée, les mots : " 2 et 4 " sont remplacés par les mots : " 2, 3, 5, 6 et 7 ". |
|
Art. 208-8 L'assemblée générale ordinaire est informée chaque année, dans des conditions déterminées par décret, des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles 208-1 à 208-7. |
C.
L'article 208-8 de la loi n° 66-537 de la loi précitée
est ainsi rédigé :
|
|
|
- les
membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de
surveillance ;
|
|
Code
général des impôts
I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou 160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option. ...............................................................................< /font> |
Article additionnel après l'article 3 A. Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les mots : " cinq années " sont remplacés par les mots : " trois années ". |
|
|
B. La perte de recettes résultant du A ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
Code
général des impôts
1.
(Abrogé).
|
Article additionnel après l'article 3
|
|
5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies à l'article 92 B ter est imposé au taux de 22,5 p 100 si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année. |
|
|
6. L'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 p 100 ou, sur option du bénéficiaire, à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. |
" Si les actions sont cédées moins d'un an après la date de levée de l'option, " |
|
|
B. La perte de recettes résultant du A ci-dessus est compensée par le relèvement à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
Code de
la sécurité sociale
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. |
Article additionnel après l'article 3 |
|
Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, est considéré comme une rémunération le montant déterminé conformément au II du même article. Toutefois l'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. ...............................................................................< /font> |
A. Le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est abrogé. |
|
|
B. La perte de recettes résultant du A ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
Loi
n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative
Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 p 100 au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article 22 de la présente loi, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui comptent moins de cinq cents salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent l'une des conditions suivantes : |
Article
additionnel après l'article 3
|
|
- avoir
réalisé, au cours des trois exercices précédents,
des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f
du II de l'article 244 quater B du code général des impôts,
d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus
élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;
...............................................................................< /font> |
|
|
|
B. La perte de recettes résultant des dispositions du A ci dessus est compensée par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du CGI. |
|
|
Article additionnel après l'article 3 A. Avant le dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
" - ou détenir à hauteur d'au moins 90 % de l'actif des participations dans des sociétés répondant à l'une des conditions mentionnées dans les alinéas précédents. " |
|
Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant des sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds. |
|
|
|
B. La perte de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus est compensée par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du CGI. |
|
Code général des impôts 14° : Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés non cotées ainsi qu'au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation . Art. 199 terdecies - 0 A I. A compter de l'imposition des revenus de 1994, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 p 100 des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées. .............................................................................. |
Article
additionnel après l'article 3
|
|
II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 25 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. ................................................................................ |
" II. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont retenus dans les limites annuelles de 75 000 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 francs pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. " |
|
|
Article additionnel après l'article 3
A.
Après l'article 885 L du code général des impôts, il
est inséré un article 885 L bis ainsi rédigé :
|
|
|
" - la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 ; |
|
|
" - le capital de la société est détenu majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques ; |
|
|
" - la société est innovante au sens de l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. |
|
|
" Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter, 163 quinquies A et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 terdecies-0 A et 199 terdecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au premier alinéa. |
|
|
" Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt mentionnée au premier alinéa ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D. Elles ne doivent pas constituer pour le redevable des biens professionnels au sens de l'article 885 O bis. |
|
|
" Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise de la réduction obtenue, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs. " |
|
|
B.- Les pertes de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus sont compensées par le relèvement à due concurrence du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du CGI. |
1
voir chapitre I, titre III, C.
2
Votre rapporteur constate d'ailleurs avec étonnement que le
crédit d'impôt-recherche donne lieu à des
difficultés d'application sur le terrain. En effet, il semble qu'en
dépit du dispositif de " rescrit fiscal " étendu par la
loi de finances pour 1997 aux entreprises souhaitant bénéficier
du crédit d'impôt-recherche (voir article L. 80 B
3° du livre des procédures fiscales), l'administration retarde
l'octroi de son agrément tacite à un projet de recherche pouvant
donner droit au crédit d'impôt. En outre, les entreprises ayant
bénéficié du CIR font assez systématiquement
l'objet d'un contrôle fiscal.
3
Les 40 % restant sont soumis aux règles
générales des FCPR.
4
Telles que définies par les deux premiers alinéas de
l'article 22 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative
aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant
création des fonds communs de créances : il s'agit de
valeurs mobilières non admises à la négociation sur un
marché réglementé français ou étranger, de
parts de SARL ou d'avances en compte courant consenties par le fonds aux
sociétés dans lesquelles il détient une participation.
5
Depuis la loi de finances rectificative pour 1997, il n'est pas
tenu compte des participations des sociétés de capital-risque,
des sociétés de développement régional et des
sociétés financières d'innovation pour
l'appréciation de cette condition, à condition qu'il n'existe pas
de lien de dépendance avec ces dernières sociétés.
De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations
des FCPR et des FCPI.
6
Rapport Sénat n° 168 page 122.
7
Rapport AN n° 456, page 175.
8
Sont considérées comme indépendantes au sens
communautaire, les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur
de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou
conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la
définition de la PME. Ce seuil peut toutefois être
dépassé si l'entreprise est détenue par des
sociétés publiques de participation, des sociétés
de capital-risque ou des investisseurs institutionnels, à condition que
ceux-ci n'exercent, à titre individuel, ou conjointement, aucun
contrôle sur l'entreprise.
9
Le délai de souscription devait s'achever le 31
décembre 1998. Il a été prorogé de trois ans par la
loi de finances pour 1999.
10
Ces plafonds résultent de la loi de finances pour 1999.
Ils s'élevaient auparavant respectivement à 140 et 70 millions de
francs.
11
Pour 1997, le rapporteur général de la commission
des finances de l'Assemblée nationale fait état de 63 500
déclarations de souscription enregistrées au titre de
l'imposition des revenus de l'année 1996 pour un montant total de 2.430
millions de francs. Le nombre de foyers bénéficiaires aurait
été de 56 200 et le montant total des réductions
d'impôt de 340 millions de francs. Ces chiffres sont encore provisoires
et fondés sur une exploitation partielle des rôles.
12
Voir Séance du Sénat du 7 décembre 1998, JO
des débats page 6065.
13
Ainsi, selon les dernières données disponibles
fournies par l'OCDE, les impôts sur le patrimoine représentaient
5 % des prélèvements obligatoires en France en 1996 contre
2,9 % en Allemagne, la moyenne européenne s'élevant à
4 ,2 %.
14
Ne sont plus déductibles les déficits
catégoriels autres que professionnels et sont désormais
intégrés dans le calcul du revenu global les revenus
exonérés d'impôt sur le revenu.
15
Dans les sociétés cotées, ceci suppose un
accord de liquidité aux termes duquel le bénéficiaire
reçoit la garantie de trouver un acquéreur au prix convenu.
16
Initialement, le dispositif était réservé
aux sociétés de moins de sept ans. L'article 4 de la loi de
finances pour 1999 en a étendu le bénéfice aux
sociétés de moins de quinze ans.
17
cf. CHAPITRE III UN VOLET FISCAL À ENRICHIR page 60
18
Cette rétroactivité de la mesure par rapport
à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1996 s'explique
par le souci de prévenir tout effet d'aubaine à compter du moment
où le relèvement de taux projeté a été rendu
public.
19
Sont considérées comme indépendantes au sens
communautaire, les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur
de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou
conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la
définition de la PME. Ce seuil peut toutefois être
dépassé si l'entreprise est détenue par des
sociétés publiques de participation, des sociétés
de capital-risque ou des investisseurs institutionnels, à condition que
ceux-ci n'exercent, à titre individuel, ou conjointement, aucun
contrôle sur l'entreprise.
20
Le délai de souscription devait s'achever le 31
décembre 1998. Il a été prorogé de trois ans par la
loi de finances pour 1999.
21
Ces plafonds résultent de la loi de finances pour 1999.
Ils s'élevaient auparavant respectivement à 140 et 70 millions de
francs.
22
Pour 1997, le rapporteur général de la commission
des finances de l'Assemblée nationale fait état de 63 500
déclarations de souscription enregistrées au titre de
l'imposition des revenus de l'année 1996 pour un montant total de 2.430
millions de francs. Le nombre de foyers bénéficiaires aurait
été de 56 200 et le montant total des réductions
d'impôt de 340 millions de francs. Ces chiffres sont encore provisoires
et fondés sur une exploitation partielle des rôles.
23
Ainsi, selon les dernières données disponibles
fournies par l'OCDE, les impôts sur le patrimoine représentaient
5 % des prélèvements obligatoires en France en 1996 contre
2,9 % en Allemagne, la moyenne européenne s'élevant à
4 ,2 %.







