Rapport de groupe interparlementaire d'amitié n° 133 - 6 mai 2016
-
OUVERTURE
-
PREMIÈRE PARTIE - DONNÉES DE
L'OCCUPATION : CADRAGE GÉNÉRAL
-
DEUXIÈME PARTIE - VIVRE EN TERRITOIRE
OCCUPÉ
-
TROISIÈME PARTIE - LE REGARD DE LA
SOCIÉTÉ ISRAÉLIENNE
-
CLÔTURE : DEUX ÉTATS, UN
ÉTAT ?

Groupe interparlementaire d'amitié
France-Palestine
(1
(
*
))
|
LA VIE QUOTIDIENNE EN TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS |
Actes du colloque du 14 décembre 2015
Palais du Luxembourg
Salle Clemenceau

Ouverture du colloque par M. Gilbert Roger, Président du groupe d'amitié France-Palestine

Allocution d'ouverture dans la Salle Clemenceau du Palais du Luxembourg
OUVERTURE
M. Gilbert ROGER,
Président du groupe interparlementaire d'amitié France-Palestine du Sénat
Monsieur l'Ambassadeur de Palestine,
Mes chers collègues,
Mesdames et Messieurs,
C'est avec un très grand plaisir que je vous accueille ce matin au Sénat au nom du groupe d'amitié France-Palestine de notre assemblée. Je tiens à saluer la venue du nouvel ambassadeur de Palestine en France, S.E. M. Salman El Herfi, qui souhaitera peut-être nous dire quelques mots après mon intervention. Le Sénat, dont l'image traditionnelle en fait une chambre de réflexion, de dialogue, de proposition et de concertation apaisée, était le lieu tout désigné pour organiser un colloque sur la vie quotidienne dans les Territoires palestiniens occupés, en vue d'une connaissance plus fine et d'une meilleure prise en compte des réalités du terrain.
Je souhaiterais tout d'abord dire un mot sur cette initiative et sa genèse. C'est au cours d'un déplacement d'une délégation de notre groupe d'amitié à Jérusalem, Ramallah, Naplouse et dans la région d'Hébron, en mars 2014, qu'a germé l'idée de l'organisation d'un colloque qui rendrait compte de ce que nous avions vu sur place, des témoignages des acteurs de terrain que nous avions rencontrés. Je pense notamment à celui de Yehuda Shaul, directeur des Relations internationales de l'ONG Breaking the Silence , qui a accepté notre invitation à ce colloque, et que je tiens à remercier chaleureusement pour sa venue. C'est à l'occasion de deux visites spécifiques, conduites par les ONG Ir Amim et Breaking the Silence , que notre délégation a pu mesurer l'ampleur de la colonisation, qui tend aujourd'hui à compromettre définitivement la construction d'une solution à deux États.
Ce déplacement a permis à notre délégation de constater la situation économique, sociale et humanitaire très dégradée dans les Territoires occupés. Le taux de chômage, à 23,7%, connaît une hausse préoccupante, avec un taux de 43,1% pour les jeunes âgés de 20 à 24 ans. La colonisation israélienne représente un obstacle majeur pour le développement d'une économie solide, et ce malgré le haut niveau de formation des chefs d'entreprise palestiniens.
Lors d'une table ronde avec des représentants de la communauté d'affaires palestinienne, la délégation a pu apprécier les difficultés croissantes auxquelles fait face l'économie palestinienne : contrôle des exportations et des permis de construire par l'administration militaire israélienne ou restrictions de circulation des personnes et des biens. Lors d'une visite dans la ville nouvelle de Rawabi, immense projet palestinien soutenu par plusieurs investisseurs de la diaspora, notre délégation a pu constater le blocage des chantiers de construction d'infrastructures du fait des contraintes imposées par la partie israélienne : autorisation pour obtenir eau, électricité et droits d'accès par la route.
Vingt ans, déjà, se sont écoulés depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin, le 4 novembre 1995, par un extrémiste juif. Depuis, le conflit au Proche-Orient est parvenu à un point de non-retour : la guerre à Gaza, à l'été 2014, après le meurtre d'un jeune Palestinien de 15 ans, et la flambée de violence actuelle que connaît la région, en sont la preuve. Jamais le fossé entre les deux peuples n'a paru aussi grand, la ville de Jérusalem aussi divisée, et aussi peu partagée, alors que Benjamin Netanyahou a rétabli les barrières que Moshe Dayan avait enlevées de la Ligne Verte en 1967.
Tout au long des années 2000, la colonisation s'est accélérée à un niveau jamais atteint par le passé, comme le confirment les rapports de l'ONG israélienne Peace Now , que nous avons eu l'occasion de rencontrer lors de notre déplacement. Je souhaite remercier Mme Anat Ben Nun, directrice du développement et des relations internationales du département « Colonisation » de l'ONG, d'avoir accepté notre invitation à faire une communication ce jour. On compte aujourd'hui 350 000 colons israéliens en Cisjordanie, dans de véritables villes qui morcellent le territoire, rendant de moins en moins viable la création d'un État palestinien. C'est lors d'une visite de terrain avec l'ONG israélienne Ir Amim , qui se bat contre les projets de colonisation, que la délégation a pris la mesure de l'urgence à faire cesser ce processus de colonisation à marche forcée.
Lors d'une session avec la délégation de notre groupe d'amitié, les organisations internationales et les ONG ont fait le constat unanime d'une dégradation préoccupante de la situation humanitaire dans les Territoires occupés, principalement dans la Zone C (sous contrôle total de l'armée israélienne, soit 62% des Territoires occupés), et à Gaza.
Le statut de la Zone C interdit aux Palestiniens de construire des logements et empêche aujourd'hui 300 000 habitants de pouvoir vivre normalement. Les destructions de constructions « illégales », visant notamment des communautés bédouines ou troglodytes en zone C, sont en hausse et les projets humanitaires internationaux, qui font l'objet de procédures d'approbation lentes et aléatoires, sont parfois menacés par l'armée israélienne.
C'est pour rendre compte de la réalité de l'occupation, pour faire émerger ces témoignages, peu portés en France, que j'ai souhaité organiser cette journée de réflexion, et réunir pour ce faire des acteurs de terrain, des universitaires, des diplomates, français, israéliens et palestiniens, dans le respect du pluralisme.
Mieux comprendre la réalité de l'occupation, mieux percevoir l'ampleur du phénomène de colonisation, c'est saisir les obstacles de plus en plus nombreux à l'édification d'un État palestinien indépendant et souverain. Je crois toujours à la nécessité d'un processus politique sérieux, et la période 2009-2015 a vu la reconnaissance de l'État palestinien à l'Organisation des Nations Unies, ainsi que l'amorce d'une dynamique européenne, portée par la décision du Royaume de Suède de reconnaître officiellement l'État de Palestine, mais également par les résolutions des Parlements britannique, irlandais, espagnol, italien et français qui ont tous appelé leurs gouvernements à procéder à cette reconnaissance.
Je continue à plaider pour une reconnaissance de l'État de Palestine par l'État français. La reconnaissance d'un État palestinien souverain, vivant en paix aux côtés de l'État d'Israël, est la seule solution qui permette de redresser l'asymétrie qui régit depuis des décennies les rapports entre les deux parties, israélienne et palestinienne. Il n'y a pas d'autre démarche possible que celle-ci.
La solution à deux États, en n'abandonnant ni l'exigence de sécurité pour Israël, ni celle de la justice pour les Palestiniens, ne pourra aboutir si la colonisation se poursuit. Les spécialistes et acteurs de terrain qui interviendront à l'occasion de ce colloque feront un bilan de la situation de terrain et traceront des perspectives d'évolution, pour les Israéliens et les Palestiniens.
Notre journée s'organisera autour de trois tables rondes, animées par Benjamin Sèze, ancien journaliste à l'hebdomadaire Témoignage chrétien et spécialiste du dialogue entre les religions et du Proche-Orient.
La première table tracera un cadrage général de l'occupation dans les Territoires palestiniens.
M. Ardi Imseis ouvrira nos travaux en nous donnant le large éclairage d'un acteur de terrain. Par sa contribution, il fournira un cadre général de l'état actuel de l'occupation, en s'appuyant notamment sur des cartes et des données chiffrées.
Mme Anat Ben Nun, en charge du département « Colonisation » de l'ONG Peace Now apportera quant à elle un éclairage plus précis sur l'implantation des colonies. Leur expansion en Cisjordanie et à Jérusalem-Est est très rapide et demeure l'un des noeuds du conflit. Elle nous expliquera comment ces colonies maillent et isolent les territoires, empêchant toute continuité territoriale, et rendant de plus en plus difficile la création d'un État palestinien.
M. Pierre Duquesne, ancien Ambassadeur chargé des questions économiques de reconstruction et de développement au ministère des Affaires étrangères et du Développement international, nous fournira les clés de compréhension de l'économie palestinienne : ses ressources, ses perspectives et bien entendu les défis que l'occupation fait peser sur cette économie prometteuse, mais aussi entravée.
La deuxième table ronde sera consacrée plus spécifiquement à la vie quotidienne en territoire occupé.
M. Daniel Seidemann, qui sera le premier intervenant de cette table ronde, est LE spécialiste de Jérusalem. Il brossera un portrait de cette ville qui fut voici quelques semaines le foyer d'un nouveau cycle de violence. Il fournira des explications sur la spécificité de la ville, la difficulté d'intégrer le règlement de son statut dans un accord définitif, et apportera des précisions sur le décalage de vie quotidienne entre les habitants de la partie Ouest et de la partie orientale de la ville.
Mme Asma Al Ghoul transmettra un témoignage de Gazaouie, pour évoquer la réalité de la vie quotidienne dans cette enclave martyre qui porte encore les plaies quasi intactes de l'opération militaire de l'été 2014. Au-delà, elle tentera de transmettre les aspirations et attentes de la population de Gaza.
MM. Gaël Léopold et Jehad Abu Hassan, quant à eux, nous présenteront la spécificité de la Zone C et de son administration par les autorités israéliennes. Ils évoqueront les régimes juridiques qui régissent la vie des Palestiniens sur place, et notamment celle des Bédouins.
Enfin, notre dernière table ronde portera sur la société israélienne. M. Yehuda Shaul, ancien soldat qui a notamment été déployé à Hébron, nous donnera son éclairage sur les jeunes soldats de Tsahal, mais plus largement sur la façon dont la société israélienne perçoit l'occupation et réagit aujourd'hui aux critiques qui émanent de ceux-là même qui sont chargés de son application.
M. Jeff Halper, anthropologue et militant, tentera de nous donner une perspective plus large sur l'état de la société israélienne aujourd'hui, et ouvrira sur la possibilité de penser un seul État, et non deux.
Débat qui sera repris en conclusion, par le professeur Chagnollaud.
Ce sont ces sujets infiniment complexes que nous souhaitons aborder aujourd'hui avec modestie et dans le respect des expériences les plus diverses.
Je vous souhaite à tous un excellent colloque.

Allocution de M. Salman El Herfi, Ambassadeur de Palestine en France
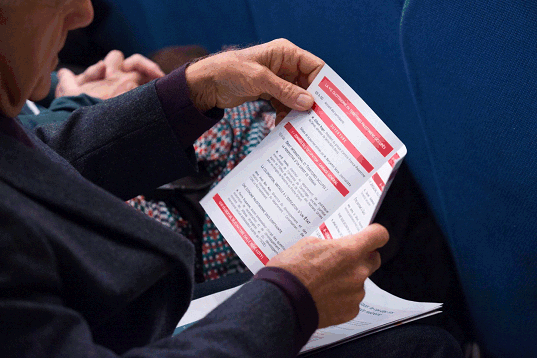
S.E.M. Salman EL HERFI,
Ambassadeur de Palestine en France
Mesdames et Messieurs,
Je suis très honoré aujourd'hui d'être parmi vous. Nous sommes toutes et tous très fiers de votre solidarité avec le peuple palestinien. Nous avons besoin de cette solidarité, aujourd'hui encore plus que jamais. Nous sommes très reconnaissants de toutes ces initiatives de soutien, qu'elles émanent du Sénat dans son ensemble, du groupe d'amitié France-Palestine en particulier, mais également de toutes les organisations d'amitié et de solidarité avec le peuple palestinien.
Nous traversons ces jours-ci des moments très difficiles, très critiques dans notre histoire. La situation à laquelle nous faisons face, est celle de l'humiliation de notre peuple, un peuple qui vit sous l'occupation depuis plus de 70 ans. Notre jeunesse doit faire face à ces humiliations quotidiennes, sans entrevoir la fin de cette situation inique. Nous ne ménageons aucun effort pour tenter de retenir les gestes de désespoir de cette jeunesse. Nous menons un travail politique, social, économique, culturel énorme pour éviter le glissement vers des actions désespérées. Le gouvernement israélien pousse de plus en plus toute la région dans la violence. Nous voulons lui dire qu'il n'est pas dans l'intérêt du peuple israélien, ni du peuple palestinien, de s'affronter. Il est aujourd'hui temps de mettre fin à l'occupation. Les dirigeants israéliens prétendent qu'Israël est une démocratie, mais on ne peut pas être démocrate et occupant en même temps. Il est temps de réfléchir, de prendre des décisions courageuses et de mettre en oeuvre tous les accords signés avec l'Autorité palestinienne et avec l'Organisation de Libération de la Palestine. Nous faisons appel à la communauté internationale pour la protection du peuple palestinien face à l'agression permanente contre nos jeunes, contre notre peuple. Nous voulons seulement vivre en paix comme d'autres peuples à travers le monde. C'est notre message : vivre en paix, côte à côte, avec le peuple israélien, en voisins. Nous ne cherchons pas la guerre, nous cherchons toujours la paix. Nos enfants ont besoin de vivre comme tous les autres. C'est pour cette raison que nous condamnons toute forme de terrorisme, toute forme d'agression, toute forme d'occupation. Nous appelons le monde entier à condamner ce qui s'est passé en France récemment. Nous sommes solidaires avec le peuple français, avec le gouvernement français. Nous avons manifesté notre solidarité dans les Territoires occupés et ailleurs parce que nous sommes, nous aussi, les victimes du terrorisme. Nous savons comment vit un peuple victime de terrorisme. Le terrorisme n'a pas de religion, il n'a pas d'identité, c'est une chose à condamner. Nous sommes toujours unis contre le terrorisme et nous vaincrons, et nous sommes sûrs de la victoire contre ce phénomène qui secoue le monde entier.
Je vous remercie.
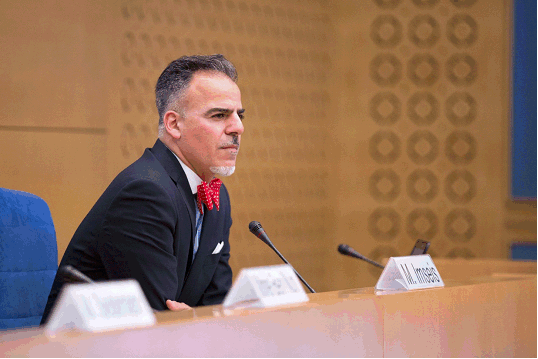
M. Ardi Imseis
PREMIÈRE PARTIE - DONNÉES DE L'OCCUPATION : CADRAGE GÉNÉRAL
I. DROIT INTERNATIONAL ET TERRITOIRES OCCUPÉS : LA PERSPECTIVE D'UN EXPERT DE TERRAIN
M. Ardi IMSEIS,
chercheur au
département de politique internationale de l'Université de
Cambridge, ancien juriste auprès de l'Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient
(UNRWA)
M. Benjamin Sèze : Bonjour à tous.
L'objet de cette matinée est de tracer un cadre général de l'occupation dans les Territoires palestiniens. Pour cela, je vais laisser la parole à un acteur de terrain, Monsieur Ardi Imseis, chercheur au département de politique internationale de l'Université de Cambridge, précédemment juriste auprès de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Au moyen de cartes et de données chiffrées, nous allons faire le point sur la réalité juridique, géographique et démographique de l'occupation.
M. Ardi Imseis : Je souhaite tout d'abord remercier M. le Sénateur Gilbert Roger et le Sénat de m'avoir invité ce matin pour cet exposé. On m'a demandé de parler du droit international applicable dans les Territoires occupés. Je le ferai en me servant de mon expérience de terrain. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à m'interrompre.
Nous parlerons d'abord des principes juridiques qui s'appliquent dans le droit international sur l'occupation de territoires ennemis. J'étudierai ensuite les mesures prises par Israël en tant que puissance occupante de la Palestine, en distinguant celles qui sont en vigueur en Cisjordanie de celles appliquées à Gaza.
La loi relative à l'occupation recouvre le champ de la loi humanitaire internationale qui s'applique aux Territoires occupés, c'est-à-dire la façon dont ils sont gouvernés par une puissance occupante dans le cadre d'un conflit armé international. Elle se fonde sur deux principes. Le premier est celui d'occupation temporaire. Qu'entend-on par là ? Si l'on examine les pratiques des États, on se rend compte qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'occupation de l'Allemagne et celle du Japon ont duré, respectivement, quatre et sept ans. L'occupation se voulait temporaire. Or la loi a changé, notamment sous l'effet du pacte Briand-Kellogg (1928) et de la Charte des Nations Unies (1945), qui interdit désormais l'acquisition de territoires par la menace ou l'utilisation de la force dans les relations internationales. Jusqu'au 19 e siècle, lorsque les États et les armées entraient en guerre, ils gardaient la souveraineté sur les territoires qu'ils avaient réussi à envahir. Cela a pris fin en 1945 ; depuis, l'occupation est censée être temporaire. C'est le premier principe inhérent à l'occupation.
Le second principe est celui de non-souveraineté. Il est lié au principe d'occupation temporaire, dans la mesure où l'occupation en soi n'est pas reconnue comme un droit des puissances occupantes à exercer leur souveraineté sur les Territoires occupés. Il existe des normes de droit international, auxquelles on ne saurait déroger, notamment celle de l'interdiction de l'acquisition de territoires par la menace ou la force ; et celle de l'obligation pour tous les États, erga omnes , de respecter le droit à l'autodétermination des peuples. Je vais donner un exemple : lorsque la France, ou une partie de la France, a été occupée au cours de la Seconde Guerre mondiale, le peuple français n'a jamais cessé d'être souverain. Sa souveraineté sur son territoire a été seulement interrompue, et restaurée sur la base d'un traité de paix. On voit là l'application des deux principes mentionnés précédemment : l'aspect temporaire de l'occupation et la non-souveraineté sur ces territoires.
A la lumière de ces deux principes, je passe maintenant à la deuxième partie de mon exposé. Depuis 1967, Israël fait appliquer, dans les Territoires palestiniens qu'il occupe, un certain nombre de pratiques destinées à changer irrévocablement le statut de ces territoires. Nous connaissons en général les mesures qui ont été adoptées, mais je vais prendre un peu de temps pour en développer certaines plus spécifiquement, et les comparer au droit international que je viens de présenter rapidement.
L'un des principaux moyens utilisés par Israël, depuis 1993, a été de fragmenter le territoire, notamment celui de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Les accords d'Oslo entre Israël et les représentants du peuple palestinien (Organisation de libération de la Palestine - OLP) ont entraîné la division de la Cisjordanie en trois zones. La zone A comprend environ 80 à 85% de la population palestinienne, et représente 7 à 10% de l'ensemble du territoire. Dans cette zone, il incombe à l'Autorité palestinienne d'assurer les droits civils et la sécurité. La seconde zone, la zone B, est plus vaste, puisqu'elle représente environ 22% du territoire palestinien. Les Israéliens y contrôlent la sécurité, et les Palestiniens les affaires civiles. La majorité du territoire (plus de 60%) se trouve dans la troisième zone, la zone C. Cette fragmentation du territoire devait initialement rester temporaire, selon les accords d'Oslo de 1993, et être abandonnée en mai 1999. Mais, bien sûr, elle n'a pas pris fin, et les négociations relatives au statut final n'ont pas abouti à un accord. Cela fait désormais vingt-et-un ans que cette situation perdure, de telle sorte que la fragmentation territoriale semble avoir été cristallisée par la puissance occupante. Un autre moyen mis en oeuvre par Israël est celui de la colonisation. Selon l'article 49 de la quatrième convention de Genève pour la protection des civils en temps de guerre, signée en 1949, les puissances occupant un territoire n'ont absolument pas le droit d'y implanter des colonies. Il n'existe ni dérogation à l'application de cette loi internationale, ni exception. Je vous invite à lire des articles sur le sujet, notamment les commentaires du Comité international de la Croix rouge de 1958 publiés sous la direction de Jean Pictet, selon lesquels l'objectif de la prohibition posée par l'article 49 est de s'assurer que les puissances occupantes ne puissent pas coloniser des territoires de façon définitive en y établissant leur souveraineté. Il s'agit de l'affirmation des deux principes d'occupation temporaire et de non-souveraineté énoncés précédemment.
Néanmoins, depuis 1967, la puissance occupante, c'est-à-dire Israël, a colonisé les Territoires occupés, qui n'étaient pas initialement habités par des civils israéliens. En 1973, ils étaient environ 1500. En 1988, pendant la Première Intifada, le nombre est porté à 95 000. A la veille de la signature des accords d'Oslo, en 1993, on en comptait 250 000. Entre 1993 et aujourd'hui, le chiffre a encore été multiplié par plus de deux. Environ 560 000 colons israéliens vivent maintenant en Palestine occupée, dans la bande de Gaza, à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, couvrant un vaste territoire. Dans les faits, la grande majorité de la zone C est colonisée, seul 1% de la zone est disponible pour la croissance palestinienne, ce qui est absolument insuffisant. D'un côté, la puissance occupante limite la capacité de la population palestinienne protégée à croître et à se développer - ce qu'elle devrait pouvoir faire selon la loi internationale. De l'autre, la même puissance occupante continue à repeupler ces territoires et à les redécouper en faveur de citoyens israéliens transférés dans ces zones, ou de personnes autorisées à immigrer en vertu de la loi sur le retour, c'est-à-dire, de manière euphémique, de personnes de confession juive.
Il faut également mentionner les réserves naturelles, qui couvrent une partie de la zone C. Cela n'a pas l'air très important, une réserve naturelle, des espaces verts et cætera , mais parfois le diable est dans les détails, et c'est ce qu'on voit en Palestine. La puissance occupante a érigé en « réserves naturelles » de vastes espaces, où aucun permis de construire n'a pu être délivré à quiconque, qu'il soit juif ou palestinien, pendant une vingtaine d'années. Et soudain, le statut de ces espaces est modifié de façon unilatérale, et ces terres sont placées sous la responsabilité de « l'Administration de la terre d'Israël » ou d'instances d'administration des colonies, sous couvert de poursuite de l'intérêt général. En réalité, cette démarche sert des objectifs coloniaux. Les réserves naturelles deviennent un outil grâce auquel la puissance occupante parvient à geler le statut de certaines zones. Il devient donc impossible, pour les peuples occupés, de construire sur ces territoires.
Bien sûr, il y a également le Mur et son régime particulier. À partir de 2003, la puissance d'occupation a commencé à construire cette « barrière de sécurité ». Certaines institutions onusiennes, comme l'Office pour la coordination humanitaire (OCHA), dont j'utilise ici les cartes, emploient le terme de « barrière », mais d'autres, à l'instar de l'Assemblée Générale des Nations Unies, parlent de « mur ». À partir de 2003, Israël a commencé à construire ce Mur à la limite et à l'intérieur des Territoires palestiniens occupés, immédiatement à l'intérieur de la ligne d'armistice de 1949, appelée également « Ligne Verte », qui sépare Israël de la Cisjordanie. Aujourd'hui, environ 70% du Mur est terminé, et 9,8% est en cours de construction. Une fois achevé, le Mur sera deux fois plus long que la ligne d'armistice de 1949. En juillet 2004, le principal organe judiciaire des Nations Unies, la Cour de justice internationale (CIJ), a dû délibérer sur les conséquences légales, pour Israël, les États tiers et la communauté internationale, de la construction d'un mur par Israël dans les Territoires occupés palestiniens. La CIJ a jugé que ce Mur était illégal et contraire au droit international, en partie sur le fondement des principes mentionnés plus haut. Une puissance occupante n'a pas le droit de construire des murs afin d'annexer de facto des territoires occupés. Selon cet arrêt, le tracé du Mur, qui serpente le long des colonies de façon stratégique, a pour conséquence que la grande majorité - je dirais 80% - des colonies sont en fait du « côté israélien » du Mur. Autrement dit, la terre entre la Ligne Verte et le Mur, la « zone tampon », est inaccessible pour les populations occupées, alors qu'elles y ont des terres agricoles et autres moyens de subsistance. L'objectif est une tentative d'annexion des Territoires occupés, en violation du principe d'interdiction de l'acquisition des territoires par la menace ou l'utilisation de la force. Néanmoins, tant la construction du Mur que la colonisation se poursuit.
D'autres mesures ont été imposées à la population protégée de Palestine, des restrictions d'accès et des fermetures de zones notamment. Il y a des centaines de barrières, de checkpoints , présents sur l'ensemble du territoire de la Palestine occupée. Aussi, il est impossible pour le peuple palestinien, ainsi que pour les entreprises, les biens et les services, de circuler d'une ville à l'autre. Cette situation montre bien la fragmentation du territoire en des centaines de petits cantons, ce que l'on pourrait appeler des « bantoustans », expression utilisée lors du régime d'apartheid en Afrique du Sud. Ces fermetures et restrictions ont peu d'incidence sur la vie des colons, voire aucune. Les colons vivant en Palestine occupée « apportent » avec eux l'application extraterritoriale de la loi civile israélienne. Cela veut dire qu'en se déplaçant vers la Palestine occupée, les colons arrivent avec tous les avantages des lois qui s'appliquent à eux en tant que citoyens israéliens, dans tous les aspects de leur vie, c'est-à-dire les lois civiles, bancaires, pénales,... Ces lois civiles sont moins contraignantes que les réglementations militaires qui s'appliquent aux populations civiles palestiniennes vivant au même endroit. Deux systèmes juridiques différents coexistent ainsi sur un même territoire : l'un, très contraignant, est la loi militaire s'appliquant aux Palestiniens protégés selon la loi internationale d'occupation ; l'autre est la loi civile, qui s'applique aux colons israéliens dans les Territoires occupés. Il y a bien sûr aussi les zones militaires disséminées un peu partout, qui sont des zones fermées, hors de tout contrôle palestinien.
J'en viens maintenant à la bande de Gaza. Elle se situe au Sud-Ouest, sur la mer Méditerranée, et compte 1,8 millions d'habitants, dont 70% sont enregistrés par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNWRA) 2 ( * ) en tant que réfugiés palestiniens, et viennent de terres qui sont près de Jaffa, dans la partie Sud de la Palestine mandataire. Israël, pour contrôler la bande de Gaza, a construit ce qu'il appelle une « clôture » - il s'agit de barrières en béton - tout au long de la ligne d'armistice de 1949. Cela me donne l'occasion d'évoquer le « plan de désengagement ». En 2005, le gouvernement d'Ariel Sharon, Premier ministre d'Israël à l'époque, a décidé de se « désengager » de la bande de Gaza. Il a fait partir quelque 8 000 colons qui étaient installés depuis 1967. Les colonies au centre, au Sud et au Nord étaient divisées par des bases militaires qui séparaient la bande de Gaza. Cela s'est arrêté en 2005 avec le désengagement d'Israël. Ce qui est intéressant, c'est qu'en demandant aux colons de partir, Israël a affirmé que l'occupation de la bande de Gaza avait pris fin. Or cela était-il le cas ? Je dirais que non et, même si je ne travaille plus pour elles, je peux vous assurer que les Nations Unies, et leurs organes politiques principaux, considèrent que ces territoires sont encore occupés. Cette position se fonde sur ce qui, en droit international, s'appelle le test de contrôle effectif, qui provient du jugement du tribunal militaire américain de Nuremberg dans ce qui a été appelé le « procès des otages » ( États-Unis contre Wilhelm List et al., 1948-1949) : lorsqu'une puissance d'occupation se retire, celle-ci peut toujours encercler le territoire et, de façon efficace, continuer à le contrôler. Dans ce cas-là, on considère que l'état d'occupation de ce territoire persiste. Pour ce qui est de la bande de Gaza, le test conclut à la poursuite de l'occupation.
Les termes eux-mêmes de ce désengagement ont été conçus par Ariel Sharon et son cabinet : Israël garde le droit d'entrer quand il le souhaite dans la bande de Gaza, il conserve le contrôle du champ électromagnétique, de l'espace aérien et maritime, ainsi que des points de passage, exception faite de la frontière avec l'Égypte ; enfin, il peut contrôler les registres de la population palestinienne dans la bande de Gaza.
Je voudrais maintenant parler des restrictions applicables à l'espace maritime. Selon les accords d'Oslo, l'Autorité palestinienne pouvait mener des activités civiles - principalement de pêche - jusqu'à 20 milles nautiques de ses côtes. Le résultat des conflits armés a été la réduction de cet espace en 2002, les accords Bertini ramenant la distance à 12 milles nautiques. Israël a continué à imposer de façon unilatérale des restrictions jusqu'à 6 milles nautiques en 2006, et aujourd'hui avec une décision encore une fois israélienne, l'Autorité palestinienne ne dispose plus que de 3 milles nautiques. Et ce alors que, selon les lois internationales, les eaux territoriales palestiniennes s'étendent jusqu'à 12 km de leurs côtes, les pêcheurs palestiniens peuvent se faire tirer dessus à balles réelles, et doivent mettre leur vie en danger simplement pour nourrir leur famille et leurs proches.
Voilà pour la bande de Gaza. Avant de passer aux questions, je souhaiterais conclure en quelques mots. S'il n'y avait qu'une chose à retenir de cette présentation rapide concernant le droit de l'occupation, ce serait le message suivant : l'occupation doit être un état temporaire, elle ne doit pas durer 50 ans, notamment l'occupation militaire. Deuxièmement, par définition, la puissance occupante n'a pas le droit d'être souveraine sur ce territoire. Le résultat est qu'au regard de ces deux principes, les occupants n'essaient pas simplement, depuis 1967, d'administrer des territoires sur la base de la confiance des civils, mais de coloniser ces territoires de manière irréversible, d'étendre ces mouvements de colonisation en Palestine occupée, et donc de faire en sorte que l'État de Palestine ne puisse pas émerger en tant qu'État souverain, indépendant et libre. Merci.
M. Benjamin Sèze : Merci beaucoup, Monsieur Imseis, pour cet exposé très intéressant qui nous permet de mieux appréhender le phénomène de la colonisation et qui pose des bases précises pour la suite des travaux tout au long de cette journée. Pour entamer les échanges avec la salle, je voudrais commencer moi-même par une question sur ce que vous venez de dire. D'après votre conclusion, la colonisation ne serait donc pas un phénomène opportuniste où les autorités israéliennes profitent de l'inaction internationale pour consolider un état de fait, mais serait plutôt le fruit d'un processus à long terme, un processus pensé avec une stratégie et un but. Confirmez-vous cela ?
M. Ardi Imseis : Malheureusement, je n'ai pas pu assister aux réunions de cabinet des différents gouvernements israéliens depuis 1967, je ne peux donc pas vous dire ce qui était dans la tête des personnes impliquées quand elles ont pris ces décisions concernant les Territoires occupés. Ce que je peux vous dire est basé sur les archives. Il en ressort très clairement que les gouvernements israéliens successifs ont implanté des colonies dans les Territoires palestiniens en affirmant ostensiblement dans un premier temps que c'était pour garantir la sécurité des Israéliens. C'était le cas au début, mais il y avait également des fondements religieux et une logique nationaliste. Puis les juristes et les intellectuels ont expliqué que la quatrième convention de Genève, interdisant l'occupation de territoires, ne s'appliquait pas, ce qui est une idée véritablement fantastique. Ce sont les seuls universitaires au monde qui pensent cela. Si l'on examine les faits historiques avérés et le soutien de l'intelligentsia israélienne à cette théorie dans les domaines civils, judiciaires et administratifs, on ne peut que conclure très clairement qu'il y a eu une tentative ouverte, publique et très directe de coloniser les territoires. Cela est prémédité, systématique et de grande envergure, à tel point que je dirais que l'article 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), qui dispose que « le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire » constitue un crime de guerre international pouvant engager la responsabilité individuelle des auteurs, s'applique pleinement ici.
Question de la salle : J'aimerais aborder plusieurs sujets. Premièrement, lorsque vous parlez d'occupation, à quelle superficie, à quels territoires pensez-vous ? Deuxièmement, en tant que spécialiste du droit international, il me paraît important d'utiliser des mots justes : si l'on emploie le bon mot, la solution se trouve plus facilement. Pour parler de territoires occupés , il me semble que l'on doit parler d'un État, d'un gouvernement. C'est pour cela que l'on entend parfois parler de territoires « disputés ». Troisièmement, je pense que sur les cartes que vous nous avez montrées, il faudrait également dessiner un mur le long de la frontière avec l'Égypte. Je vous remercie.
M. Ardi Imseis : Lorsque je parle de Palestine occupée, je fais référence à la Cisjordanie, la bande de Gaza, y compris Jérusalem-Est, soit 22% de la Palestine sous mandat, occupés par Israël en 1967, territoires auparavant occupés par l'Égypte et la Jordanie en 1949. Certains pensent que ces parties de la Palestine mandataire qui étaient allouées à « l'État arabe » par la résolution « de partition » (résolution 181 adoptée par l'ONU le 21 novembre 1947) et qui ont été envahies par le nouvel État d'Israël, c'est-à-dire Jaffa, Nazareth, Haïfa, etc. représentent aussi des territoires occupés. C'est un argument juridique très intéressant que l'on peut avancer et il doit être pris au sérieux, mais je ne pense pas qu'il soit acceptable et recevable. Depuis lors, plusieurs événements sont intervenus au niveau international. En 1988 tout d'abord, à Alger, lors de la 19 ème session du Conseil national palestinien, l'OLP a pris une décision stratégique visant à reconnaître l'État d'Israël et adopter formellement la proposition de deux États. On pourrait avancer que cette mesure prise par l'OLP à l'époque, qui a été suivie par d'autres actions pour reconnaître l'État d'Israël, a balayé toute idée que le mouvement national palestinien prétendait à une souveraineté sur les territoires du putatif État arabe occupés par Israël en 1949. Cependant, l'une des dernières questions restant à régler dans le cadre du processus d'Oslo sur le statut des territoires est celle des frontières. Les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité de l'ONU constituent des bases pour ces discussions, mais ce ne sont pas les seules : il y a également, entre autres, des résolutions de l'Assemblée générale, dont la résolution 181. Des négociateurs inventifs pourraient dire que la frontière devrait aller dans l'autre sens, qu'il ne s'agit pas toujours seulement de la bande de Gaza et de la Cisjordanie et que des échanges de territoires sont possibles. Mais au fond, les six principaux organes des Nations Unies, l'Assemblée Générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, la Cour internationale de justice et le Secrétariat, ont tous décidé que ces parties de la Palestine mandataire occupées par Israël après 1967 (la bande de Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est) étaient constitutives des Territoires occupés. Depuis le 29 novembre 2012, l'Assemblée générale reconnaît ces territoires comme l'État de Palestine, État non-membre de l'ONU.
Question de la salle : Bonjour, merci infiniment pour cette présentation très claire. J'ai une question concernant le rapport présenté en 2004 par la CIJ. En 1991 a eu lieu la conférence de Madrid. On sait que c'était l'époque où les Nations Unies avaient été marginalisées, les États-Unis ayant pris les rênes. Mais le rapport de 2004 était fort intéressant, car il redonnait à l'ONU - ainsi qu'au droit - toute sa place au sein du processus. Comment se fait-il qu'aucune action juridique n'ait était entamée, bien que tout fût écrit dans ce document ? Qu'est-ce qui a été fait, n'a pas été fait, et pourquoi n'en a-t-on pas plus parlé ?
M. Ardi Imseis : Merci de cette question très importante, qui rejoint mon travail et mes préoccupations quotidiens. Sur le plan technique, la CIJ peut prendre deux types de décision. Tout d'abord pour tout ce qui concerne les affaires contentieuses, c'est-à-dire une dispute entre plusieurs État membres qui se présentent devant la Cour, les États peuvent se mettre d'accord au préalable pour que la Cour rende une décision qui sera contraignante. La Cour peut aussi rendre des avis consultatifs sur des questions juridiques, si elle a été saisie par un organe autorisé. Lors de l'affaire de 2004, la CIJ, saisie par l'Assemblée générale, selon l'article 96 de la Charte des Nations Unies, a ainsi rendu une opinion consultative, donc non-contraignante. Cependant, la Cour, organe judiciaire principal de l'ONU, chargée par la Charte des Nations Unies de faire appliquer le droit international public, a simplement confirmé des décisions juridiques qui avaient déjà été prises par d'autres organes de l'Organisation et qui trouvent leur racine dans le droit international coutumier, la plus grande partie des commentateurs et observateurs juridiques, des membres des organes principaux des Nations Unies, et d'autres, estiment que cette opinion constitue la représentation dominante du droit international applicable à cette question.
En ce qui concerne le suivi des décisions, un registre de l'Organisation des Nations Unies a aussi été créé concernant les dommages causés aux personnes morales et physiques par la construction du Mur dans les Territoires palestiniens occupés. Il y a eu peu de suivi de la part des acteurs concernés, même parmi les États membres des Nations Unies.
D'aucuns - dont je fais partie - pensent qu'il serait dans l'intérêt de l'État de Palestine de demander un nouvel avis consultatif à la CIJ. L'avis consultatif de 2004 fut une révolution car il affirmait l'illégalité de nombre de mesures prises par le pouvoir occupant, notamment de l'occupation et de la construction d'un mur. Mais au paragraphe 162 de son avis, la Cour précise qu'elle « [...] croit de son devoir d'appeler l'attention de l'Assemblée générale [...] sur la nécessité d'encourager ces efforts en vue d'aboutir le plus tôt possible, sur la base du droit international, à une solution négociée des problèmes pendants [...] ». Soyons francs, il ne peut y avoir de négociations bilatérales entre les représentants de la population occupée de l'État de Palestine et ceux de l'État d'Israël, qui est une puissance nucléaire : il y a une énorme asymétrie de pouvoir entre les deux. On voit depuis plus de 20 ans que toute recherche de solution par la discussion bilatérale est vouée à l'échec et permet même à l'occupant de consolider son pouvoir sur le terrain. Je pense que cet avis consultatif de 2004, dans la mesure où il s'agit d'une réponse « pavlovienne » faisant par réflexe référence à de telles « négociations », porte préjudice à l'administration de la justice. Il faudrait donc demander un second avis consultatif sur une question simple : après 50 ans d'occupation en Palestine, quelles sont les conséquences juridiques de la présence continue d'Israël en Palestine et cette présence doit-elle cesser immédiatement, sans faire l'objet de négociations ? Ce sont de vraies questions, les dirigeants en Palestine ne les prennent pas complètement au sérieux bien qu'ils les examinent. Ils se concentrent sur le fait qu'ils poursuivent Israël pour des actions qui sont des crimes au sens du traité de Rome.
Question de la salle : Je voudrais poser une question. Qu'est-ce qui empêche les Nations Unies d'imposer une sanction contre Israël ? On parle de beaucoup de résolutions qui ont été votées mais il n'y a pas de sanctions. On ne peut avancer, soit dans la direction de la paix, soit dans celle d'une vie acceptable pour les Palestiniens. On a imposé des sanctions contre l'Iran, la Russie, mais pas contre Israël.
M. Ardi Imseis : L'ONU est une organisation « schizophrène », c'est à la fois la somme de tous ses États membres et, en même temps, une organisation internationale indépendante. En tant qu'ancien conseiller juridique des Nations Unies, je vous répondrai que l'ONU peut mener ou organiser des relations internationales avec d'autres organisations car elle est indépendante. Mais le pouvoir d'imposer des sanctions, qu'elles soient militaires ou non, dépend principalement d'un organe, le Conseil de sécurité, dominé par ses cinq membres permanents et donc également politique. Or les États-Unis ne permettraient jamais l'imposition d'une sanction contre Israël. Le Conseil de sécurité est incapable d'apporter des solutions qui ne soient pas militaires, qui relèvent de la diplomatie, pour mettre un terme à une occupation israélienne d'un demi-siècle. Si le Conseil de sécurité ne peut pas le faire, qui le pourrait ? Techniquement, l'Assemblée Générale peut prendre le contrôle sur une question de paix et de sécurité internationales après avoir constaté l'incapacité du Conseil de sécurité à prendre une décision (résolution de l'Assemblée générale 57/337 sur la prévention des conflits armés). L'État de Palestine a déjà utilisé cette possibilité pour faire voter un certain nombre de résolutions et la question qui était posée à la CIJ en 2004 était basée sur une de ces résolutions de l'Assemblée générale. Le fait de pouvoir utiliser cette possibilité n'est donc pas totalement exclu, notamment afin que l'Assemblée générale puisse recommander une forme de sanction contre l'État d'Israël, mais est-ce que les États agiraient par la suite ? Le droit est seulement un outil dans un monde d'interactions humaines et sociales, et parfois, c'est l'outil le plus faible. Il ne faut jamais considérer que le respect du droit par les États est acquis. Les États sont à la fois sujets et acteurs du droit international ; souverains, ils peuvent dans certaines circonstances s'exclure de son champ d'application. C'est ce que l'on voit dans le cas de la Palestine, étant donné que les moyens d'application du droit ont été arrêtés par les différents États membres.
Question de la salle : Soyons réalistes, seule une résolution sous le chapitre VII de la Charte des Nations Unies demandant le retrait des Territoires occupés sous six semaines, comme pour l'Irak en 1990-91, pourrait amener la fin de l'occupation. C'est ce que M. Jacques Chirac avait suggéré le 16 janvier 1991 à l'Assemblée nationale. Il faut qu'au moins un ou deux chefs d'État des cinq membres permanents du Conseil de sécurité puissent être déstabilisés. Ma question : va-t-on enfin débattre de politique étrangère lors de l'élection présidentielle française ?
M. Benjamin Sèze : Je ne suis pas sûr que M. Imseis soit le bon interlocuteur pour répondre à cette question. (Applaudissements dans la salle). Monsieur Imseis, une question pour rebondir : vous dites que l'Assemblée générale peut recommander des sanctions. Vous vous demandez ensuite si les États agiraient. Comment cela pourrait-il se passer d'un point de vue pratique, si l'Assemblée générale se saisissait de la question ?
M. Ardi Imseis : Très bonne question. La responsabilité juridique des États repose sur de nombreuses sources : premièrement, dans le cadre de l'organisation même de l'ONU, sur une résolution de l'Assemblée Générale qui peut, dans certains cas, être contraignante pour les États ; deuxièmement, sur le droit national de chacun de ces États ; troisièmement, sur les obligations internationales juridiques que ces États contractent, hors des liens qu'ils ont avec les Nations Unies. La France, par exemple, est partie à la quatrième convention de Genève pour la protection des personnes civiles en temps de guerre. L'article 1 de cet accord stipule que « Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente convention en toutes circonstances », c'est-à-dire qu'elles doivent respecter le traité et s'assurer également que celui-ci soit respecté par les autres États. Le droit national peut incorporer des dispositions du droit international. Le Canada, par exemple, est maintenant responsable de s'assurer qu'Israël respecte la quatrième convention de Genève. Si un État manque à ses obligations, alors ses citoyens, ses contribuables, ont le droit de se retourner contre lui et de demander à leurs parlementaires de faire respecter les engagements pris. Voilà comment on peut mettre la pression en France sur les autorités françaises pour qu'elles agissent « correctement ». Les autorités françaises pourront alors répondre qu'elles l'ont déjà fait en se déchargeant de leur responsabilité sur l'Union européenne, qui a récemment déclaré qu'elle imposait le marquage des biens importés provenant des colonies israéliennes. Cet exemple montre comment un État pourrait ne pas faire face à ses obligations dans le cadre de ses engagements internationaux. De nombreuses mesures sont envisageables, comme le marquage de biens qui viennent des Territoires occupés, ou d'autres outils, comme des sanctions par exemple sur des entreprises qui sont actives en Palestine occupée. C`est un point d'entrée pour des citoyens engagés qui veulent que leurs parlementaires travaillent sur ces idées, pour parvenir à les faire aboutir.
M. Benjamin Sèze : Merci beaucoup, Monsieur Imseis. Nous allons passer au deuxième exposé.

M. Daniel Seidemann et Mme Anat Ben Nun

M. Salman El Herfi, Ambassadeur de Palestine en France
II. LA COLONISATION, OBSTACLE À L'ÉDIFICATION D'UN ÉTAT
Mme Anat BEN NUN, Directrice du développement et des relations internationales du département « Colonisation » de l'ONG Peace Now
Mme Anat Ben Nun : Merci de m'accueillir. On m'a demandé de parler de la colonisation en général et de son expansion sous le gouvernement Netanyahou. Je vais donc tenter de vous fournir une vue d'ensemble de la situation sur le terrain et d'évoquer avec vous les tendances récentes de développement de cette colonisation. Avant de commencer, je souhaite me présenter en quelques mots. Je représente ici l'ONG Peace Now (La Paix Maintenant). C'est le plus ancien mouvement israélien qui fait pression sur le gouvernement pour aboutir à la paix. Nous voulons mobiliser des gens qui pensent que la création de deux États est la seule solution pour mettre fin au conflit israélo-palestinien, et faire comprendre qu'il nous faut envisager des compromis pour que les deux États voient le jour. Au fil des ans, nous avons pris conscience que la colonisation est l'obstacle principal à la construction de deux États, à l'aide de notre projet Settlement Watch qui étudie la colonisation. Nous analysons les évolutions dans les zones occupées et nous étudions, grâce à des enquêtes sur le terrain, au Freedom of Information Act , et à des publications ce que fait le gouvernement au-delà de la Ligne Verte. Nous en parlons au public israélien et aux parties prenantes afin qu'ils sachent que ces événements ont lieu et qu'ensuite ils puissent s'exprimer pour essayer de faire annuler certains plans, et réagir en général contre cette politique à grande échelle menée par le gouvernement israélien.
Je vais commencer par les implantations de colonies israéliennes. En voici un aperçu général. L'orateur précédent a déjà bien expliqué les fondements de la colonisation israélienne. Je vous montre donc juste quelques cartes qui vous dépeignent l'évolution, c'est-à-dire la progression du nombre d'implantations, de colonies et de colons depuis le début de l'occupation en 1967. Vous voyez que depuis les accords d'Oslo, le nombre de colons a beaucoup augmenté : aujourd'hui nous comptons environ 370 000 colons en Cisjordanie, selon le bureau central de statistiques d'Israël en 2014. A Jérusalem-Est, on compte un peu plus de 200 000 colons qui habitent dans différents types d'implantations, souvent dans des communautés juives au-delà de la Ligne Verte et des zones annexées par Israël, et qui, maintenant, selon Israël, font partie de la municipalité de Jérusalem à l'Est de la ville. Et puis quelques milliers de colons résident aussi dans des quartiers palestiniens pour essayer de faire changer l'équilibre de ces quartiers et de les « israéliser », si je puis dire. Il y a également des projets de tourisme idéologique à Jérusalem-Est. C'est une colonisation aussi parce que, par ces projets, l'objectif est d'augmenter le nombre d'habitants juifs israéliens dans des zones qui sont en fait des zones considérées comme palestiniennes. Dans ce cas-là, il sera beaucoup plus difficile pour les Israéliens de rendre ces zones, de les abandonner lorsque le moment sera venu d'envisager une solution de retrait.
Je suis certaine que mes collègues en parleront plus longuement, Daniel Seidemann notamment. Pour ma part, je vais plutôt me concentrer sur la situation en Cisjordanie.
Donc aujourd'hui, il y a plus de 570 000 colons au total. Nous allons maintenant mettre ces chiffres en perspective et considérer la population totale en Cisjordanie. Nous constatons un fort pourcentage de terres accaparées par les colons. Les colons de Cisjordanie représentent 12% de la population totale de Cisjordanie, mais ils ne représentent que 4% de l'ensemble de la population israélienne. Parfois on a l'impression et on craint que ces pourcentages soient plus élevés parce qu'on les entend beaucoup [ces colons NDLR], et qu'ils s'expriment fortement. En fait, ils ne représentent que 4% de la population israélienne, ce n'est donc pas à eux de déterminer le destin de l'État d'Israël.
Le chiffre qui est encore plus intéressant à étudier est le nombre de personnes qui devraient être évacuées dans le cadre d'une solution à deux États. Selon nos estimations, si nous avons bien compris ce que nous pouvons faire dans les limites d'une future frontière, (et il faut prendre pour base les frontières de 1967 avec des échanges de terres), le nombre de foyers à évacuer dans le cadre d'un accord se situe, à l'heure actuelle, entre 25 000 et 30 000. Pour nous, ce chiffre est tout à fait envisageable. Il est possible d'évacuer les colons sur la base notamment de ce qui s'est passé en 2005 avec le retrait de Gaza, mais également en se basant sur la capacité qu'a eu Israël d'absorber quasiment un million d'immigrants depuis dix ans, venant principalement de l'ancienne Union Soviétique. Donc sur la base de ces éléments, la solution à deux États est tout à fait envisageable, et c'est, selon moi, la seule solution pour que ce conflit prenne fin. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous voyons qu'il n'y a pas de désir politique de suivre ce chemin. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne verra jamais le jour. Néanmoins, ces 25 000 à 30 000 foyers, c'est un chiffre que nous avons à l'heure actuelle mais la population de colons va augmenter. Plus la population de colons augmentera, plus la solution sera difficile à trouver, et plus le prix sera élevé à payer, plus la situation sur le terrain sera complexe pour envisager une solution à deux États.
Je souhaiterais maintenant parler de la colonisation pendant le gouvernement Netanyahou pour tenter d'expliquer ces augmentations de population depuis son arrivée au pouvoir. Le Premier ministre parle de manière différente de la solution à deux États selon qu'il s'exprime en hébreu ou en anglais. Il fait de même lorsqu'il évoque les colonies. En octobre, Netanyahou a pris la parole lors d'une réunion privée de son parti le Likoud. Il a alors dit en hébreu que les colonies avaient augmenté de 40% depuis 7 ans, qu'on n'avait jamais vu ce chiffre auparavant, et il avait l'air d'être très fier de cette réussite. Une semaine après, il s'est exprimé, en anglais cette fois, au congrès de l'Organisation sioniste mondiale et il a évoqué une diminution du nombre de constructions, ajoutant qu'il était le Premier ministre dont le mandat avait connu le moins de constructions au cours de la dernière décennie. Alors, laquelle de ces informations est juste ? Car les deux affirmations sont contradictoires. Netanyahou utilise dans ce cas-là des types de données bien particulières pour essayer de faire passer certaines idées à différents publics. Et quand Netanyahou parlait à l'Organisation sioniste mondiale en disant qu'il y a eu une baisse des constructions, il parlait en fait de la construction moyenne annuelle par Premier ministre. Ce que l'on a essayé de faire, c'est de regarder les taux de construction dans ces implantations par gouvernement depuis le début des années 2000. Nous avons alors constaté, que les taux de construction annuels moyens en 2013-2014 sous le gouvernement Netanyahou étaient les taux de construction de loin les plus élevés de tous les gouvernements depuis 2001. Donc des taux de construction beaucoup plus élevés que ceux que nous avions constatés auparavant, notamment sous les gouvernements Sharon et Olmert. Aussi cette déclaration de Netanyahou est inexacte si l'on regarde le taux de construction sur le terrain.
La construction continue de façon constante. Si vous conduisez à travers la Cisjordanie, vous verrez des sites de construction un peu partout, et qui se situent même parfois dans des colonies très isolées, notamment dans des zones très sensibles. Peace Now , notre ONG, est opposée à tout type d'implantations et de colonies. En termes d'appels d'offres pour des logements, depuis l'arrivée au pouvoir de Netanyahou il y a dix ans, leur augmentation est graduelle, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, avec le chiffre le plus élevé atteint en 2014. En 2009-2010, les chiffres sont beaucoup plus bas du fait du moratoire sur les colonies, dû à une tentative de négociations. Les groupes de pression au niveau international obtiennent des résultats. Depuis un an, la communauté internationale étudie attentivement tout ce qui se passe au-delà de la Ligne Verte. La communauté internationale le faisait bien sûr auparavant, mais elle le fait désormais de façon plus efficace. La raison principale est que depuis 2015 en Israël gouverne l'un des gouvernements les plus à droite de l'histoire du pays. La communauté internationale est plus attentive à ce qui se passe sur le terrain et une pression internationale peut s'exercer. Netanyahou sait qu'il devra être comptable de ses actes, de ses plans, de ses appels d'offres, et le résultat depuis un an est que quasiment aucun nouveau plan de construction de logements n'a été envisagé. Depuis un an, on dénombre moins d'appels d'offres que durant la période précédente. Il faut bien comprendre que c'est une procédure longue, avec de nombreuses étapes, et ce n'est pas simplement une procédure bureaucratique, qui serait typiquement israélienne au-delà de la Ligne Verte, c'est une procédure politique avant tout. Il y a des étapes pour la construction qui doivent être approuvées par le ministère de la défense et donc par le Premier ministre. Ce qui veut dire que chaque approbation d'un plan nouveau, qui ailleurs serait uniquement bureaucratique, est à Jérusalem-Est et en Cisjordanie une étape, une mesure politique qui peut être perçue comme un aspect d'une politique gouvernementale plus large, et donc être condamnée. Cette diminution des appels d'offres pour des logements dans les colonies en 2015 est le seul petit élément positif que je puis vous présenter aujourd'hui.
Je poursuis en évoquant des tendances plus générales que l'on voit se développer avec Netanyahou. Tout d'abord, les constructions dans ce qu'on appelle les Settlement Blocks : ces blocs de colonies et d'implantations, qui semblent faire consensus en Israël, alors qu'on ne sait pas vraiment ce qu'ils sont. En fait, ils n'ont jamais vraiment été définis de façon officielle, on ne sait pas exactement ce qu'ils recouvrent. Cependant, Netanyahou, il y a quelques semaines, s'est entretenu avec le Secrétaire d'État américain John Kerry et lui a demandé que les Américains reconnaissent les constructions dans les Settlement Blocks , pour tenter de créer un consensus autour d'un concept qui ne ressemble pas aux autres constructions de colonies. Pour Peace Now, les constructions dans ces Settlement Blocks sont les constructions les plus dangereuses car ces blocs de colonies se situent exactement là où les frontières sont négociées. Donc la colonisation dans ces zones change la réalité de terrain, et constitue une démarche israélienne unilatérale pour déterminer l'emplacement futur des frontières. Ainsi cette colonisation rend le tracé de futures frontières beaucoup plus difficile car si on regarde les frontières de 1967 avec échange de terres, on voit que les terres à échanger ne sont pas illimitées. L'autre problème avec ce qu'on appelle ces grandes zones de colonies, ces Settlement Blocks , c'est qu'il sera difficile d'avoir un État palestinien viable en continuant les constructions, les colonies, autour de ces grandes zones, de ces grands blocs de colonies. Il sera alors plus difficile pour le futur État de se développer, de prospérer et d'avoir une véritable continuité territoriale, au-delà d'un ensemble de villes et villages reliés entre eux par des tunnels et des ponts. Qu'il n'y ait pas de continuité territoriale réelle ne permettrait pas alors de former un État viable. Voilà donc un autre problème qui peut être engendré par l'évolution de la colonisation dans ces zones, accrue sous le gouvernement Netanyahou.
Si l'on regarde la colonie d'Ephrat, on constate l'augmentation des mises en construction depuis 2011. Or Ephrat se situe à l'Est de la route 60 qui traverse la Cisjordanie du Nord au Sud. Est-ce une partie future d'un bloc de colonies ? Je l'ignore, mais cela pose également un problème de développement de la ville de Bethléem dans sa partie septentrionale. Ariel est également une colonie où la construction s'accélère. Cela fait partie en théorie du même bloc, or cette colonie se situe à 20 km à l'Est de la Ligne Verte. Lors des débats de l'Initiative de Genève, Ariel n'était pas inclue dans les discussions pour des raisons de sécurité, car ses frontières auraient été trop difficiles à protéger. Et elle crée de surcroît une rupture territoriale entre le Nord et le Sud de la Cisjordanie.
Passons maintenant à l'étude d'une autre tendance lourde, celle de la légalisation des postes avancés ( outposts ). Après les accords d'Oslo, Israël s'était engagé à ne pas construire de nouvelles colonies. On a alors vu se développer ces postes avancés. Si selon le droit israélien les colonies sont légales, ces postes avancés, qui sont des colonies sauvages, sont construits sans l'accord du gouvernement et sont donc illégaux. Mais au fil du temps, ces pratiques ont reçu des soutiens, notamment de municipalités dans les colonies, et on assiste depuis 2011 à des légalisations rétroactives de ces constructions. Cette vingtaine de régularisations agit désormais comme un feu vert pour les colons qui souhaitent étendre la colonisation de cette manière. De surcroît, ces légalisations se font bien souvent avec la délivrance de permis de construire davantage autour des bâtiments nouvellement régularisés. On a ainsi pu constater l'arrivée de 20 000 nouveaux colons consécutivement à la délivrance de ces nouveaux permis.
Je souhaiterais également évoquer la question de la confiscation des terres. Depuis la « Feuille de route », il n'y avait pas eu de déclarations d'appropriation de terres par Israël. Mais avec l'arrivée de Netanyahou au pouvoir, elles se multiplient. L'une des pratiques est de déclarer des terres en Zone C comme des terres d'État. Dans 98% des cas, ces zones sont ensuite utilisées pour y bâtir des colonies. Peace Now a porté ces confiscations de terres devant la Cour Suprême israélienne.
La dernière tendance que je souhaite porter à votre connaissance est celle du développement des infrastructures. Notre analyse ne doit pas se limiter à la construction de logements et de colonies. Prenons l'exemple des routes de contournement ( bypass roads ) dont Netanyahou a annoncé l'augmentation. Il s'agit de routes qui contournent les villages palestiniens de Cisjordanie. Cela conduit à faire de ces colonies isolées de véritables banlieues, à Jérusalem par exemple. Elles permettent à des personnes qui ne cherchaient pas à vivre dans les colonies pour des motifs idéologiques à franchir le pas afin d'obtenir des logements à prix modéré, désormais très accessibles depuis le centre-ville, comme celui de Jérusalem. Cela contribue donc fortement à l'accroissement de la population des colons.
Je laisserai Daniel Seidemann évoquer une tendance
supplémentaire que je n'aborderai pas, mais qui est celle de
l'accaparement de logements palestiniens par des colons à
Jérusalem-Est.
J'en terminerai donc par quelques observations.
Tout d'abord, ayez à l'esprit que la politique de Netanyahou
éloigne la viabilité d'une solution à deux États
par sa politique active de colonisation que nous venons de décrire.
Donc, lorsqu'il affirme encore sur la scène internationale qu'il est
engagé à faire émerger cette solution à deux
États, la réalité est toute autre, et c'est de fait une
situation à un seul État qui progresse chaque jour. Il convient
également de remettre en cause les termes de
statu quo
.
L'absence de solution politique engendre plutôt une rapide
détérioration de la solution sur le terrain (colonisation,
violences, etc.). Il faut donc y substituer une politique constructive, active.
Néanmoins, il n'y a plus à ce jour de possibilité de
négociations bilatérales. Netanyahou n'est pas prêt
à faire des concessions qu'Abbas pourrait accepter. L'engagement
européen dans le processus de paix est donc indispensable selon moi,
afin d'une part de préserver sur le terrain les conditions d'une
solution à deux États, et d'autre part de pousser à la
résolution du conflit dans le cadre de cette solution. J'en ai fini et
suis donc disposée à répondre à toutes vos
questions.
M. Benjamin Sèze : Merci Madame, je souhaiterais avoir votre regard sur la position de l'opinion israélienne à l'égard des colonies. Les citoyens israéliens ont-ils conscience de l'impact de la colonisation sur la possibilité de règlement définitif du conflit ?
Mme Anat Ben Nun : Selon moi, le public israélien n'a pas conscience des conséquences de l'occupation. Il n'en ressent pas les conséquences dans sa vie quotidienne. Il est plus simple de débattre de questions économiques et sociales dans un café de Tel-Aviv que de réfléchir à des questions plus larges relatives à la colonisation, à l'occupation et à l'absence de processus de paix. L'opinion publique israélienne est donc très largement indifférente à ces questions. On a pu néanmoins malheureusement observer un virage à droite de la société israélienne au cours des dernières années. Il y a plusieurs facteurs à cela. L'un est l'idée assez répandue que nous avons quitté Gaza, et que nous avons été récompensés par des roquettes ! Bien entendu ce n'est pas tout à fait vrai, et cela résulte d'un choix israélien et pas d'une solution négociée, mais ce type de traumatismes marque la psyché de l'opinion publique israélienne. L'idée qu'il n'y a pas de partenaires, de l'autre côté, pour faire la paix, est très répandue. Malgré tous ces éléments, les études d'opinion des dernières années continuent à montrer qu'une majorité d'Israéliens soutient la solution à deux États. Il y a donc l'idée que pour maintenir un État juif et démocratique, il faut deux États vivant en paix côte à côte.
Question de la salle : Premièrement, votre ONG s'occupe-t-elle de toute la colonisation israélienne ? Quid par exemple du plateau du Golan ? Deuxièmement, pouvez-vous citer un seul gouvernement qui n'a pas pratiqué l'expansion des colonies ? Troisièmement, une observation : Netanyahou ne recherche pas un seul État, mais le Grand Israël, qui est une vision sioniste et qui est au coeur de la création de l'État d'Israël.
Mme Anat Ben Nun : Peace Now se concentre surtout sur les colonies en Cisjordanie car nous travaillons principalement sur le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. Concernant votre question relative aux gouvernements israéliens précédents, clairement tous les gouvernements israéliens se sont adonnés à la colonisation. Peace Now critique les gouvernements, de gauche comme de droite, pour leurs programmes d'implantation de colonies. Nous nous opposons à la construction de toute colonie et nous allons donc continuer à critiquer tous les gouvernements qui pratiquent cette approche. Pour répondre enfin à votre dernière observation, je pense que Netanyahou préfère le statu quo , donc pas au sens littéral comme je l'ai expliqué précédemment, mais au sens de la détérioration progressive de la situation sur le terrain. Il ne fera rien en faveur de la solution à deux États mais, à mon sens, il ne recherche pas plus que cela une solution à un seul État. Ce qu'il souhaite par-dessus tout, c'est garder le pouvoir. Donc je considère que c'est quelqu'un à qui le statu quo convient. Mais bien entendu si on observe la réalité de terrain, il nous pousse peu à peu, par sa politique, vers une solution à un seul État.
Question de la salle : Je souhaiterais intervenir sur le dernier point que vous avez souligné, à savoir l'engagement de l'Europe que vous estimez très important. De quel type d'engagement s'agit-il ? Récemment, l'instauration par l'Europe de l'étiquetage des produits issus des colonies a fait réagir fortement Israël qui a assimilé ces actes à des mesures antisémites. Il a même menacé l'Europe de rétorsion. L'Europe, elle, pourrait sanctionner Israël en application de son accord d'association avec Tel-Aviv en suspendant cet accord tant qu'Israël ne respecte pas les droits de l'Homme. Quelle est sur ce sujet la position de votre mouvement alors qu'en Europe, et en France en particulier, il devient de plus en plus difficile d'agir via le boycott des produits israéliens, notamment des colonies, à cause d'une circulaire qui interprète de manière erronée la loi et permet de poursuivre les militants qui portent ces actions de boycott ?
Mme Anat Ben Nun : Je pense que l'Europe devrait continuer à s'engager. Un pas important a été fait avec ces lignes directrices en faveur de l'étiquetage des produits des colonies. Peace Now est opposée au boycott d'Israël mais nous avons soutenu cette démarche de l'Union européenne d'étiqueter les produits des colonies. Je ne comprends pas en revanche pourquoi l'Europe a présenté cette mesure comme technique alors qu'il s'agit avant tout d'une mesure politique. En faisant cela, elle prête le flanc aux critiques populistes des responsables politiques israéliens. Les Européens auraient dû défendre plus fermement leur politique. De surcroît, elle est un moyen de réduire le champ d'action du mouvement BDS [Boycott, Désinvestissement et Sanctions, NDRL] qui prône le boycott total d'Israël. L'Europe devrait aussi continuer à montrer au public israélien qu'elle soutient Israël mais s'oppose à toute mesure d'occupation et de colonisation, afin de bien marquer une différenciation entre le soutien à l'État et l'opposition à certaines de ses politiques.
M. Ardi Imseis : Je pense qu'il est important de regarder ce qu'autorise la loi française à la lumière des obligations légales internationales de la France, et de voir si les personnes physiques et les entreprises respectent la loi française dans le cadre des obligations internationales de la France. À titre d'exemple, il y a eu, je crois, des litiges juridiques impliquant les sociétés Veolia et Alstom pour leurs activités économiques dans les Territoires occupés, qui participaient au processus illégal d'occupation. Ces démarches juridiques ont un impact très important. Autre exemple, lorsque des Français vivent en Territoires palestiniens occupés, comme colons, ils ont toujours des obligations en tant que citoyens français et peuvent donc avoir à répondre légalement de leurs actes. La difficulté, pour revenir à ce qu'Anat disait il y a quelques instants, c'est d'établir une séparation claire entre Israël d'une part, et ses actions dans les Territoires occupés d'autre part. Car la réalité de terrain, à la lumière de la politique unilatérale israélienne, a vu cette séparation s'estomper peu à peu. Prenons, pour illustrer mon propos, la question bancaire. Les colonies n'existeraient pas sans soutien bancaire et sans présence dans ces colonies de moyens de procéder à des opérations bancaires courantes pour les colons. Les groupes bancaires les plus importants en Israël, la banque Leumi, la banque Hapolim, et les autres, font des affaires des deux côtés de la Ligne Verte. Ils font des affaires également avec des entreprises françaises. Voici un point d'entrée juridique intéressant.
Question de la salle : Vous avez parlé d'échanges de territoires. Quels sont, du côté israélien, les territoires qui sont susceptibles d'être échangés, et ce alors qu'il y a un plan de la droite israélienne pour se débarrasser d'une partie de sa population arabe ? Israël pourrait alors échanger des morceaux de Galilée contre des colonies. Par ailleurs, j'ai été surpris d'entendre qu'un terroriste arabe israélien avait fait son service militaire dans l'armée israélienne alors que je croyais qu'il n'y avait pas d'arabes au sein de Tsahal.
Mme Anat Ben Nun : Lorsque j'évoquais les échanges de territoires, je faisais référence aux lignes de 1967 avec échanges de territoires. Ces échanges ont fait l'objet de discussions lors des précédentes négociations. Il semble qu'un accord de paix potentiel devrait passer par 3% à 4% de territoire de la Cisjordanie qui serait échangé entre Israël et la Palestine, à condition d'une équivalence en taille et en qualité. Quant à votre seconde question, je ne suis pas une spécialiste de l'armée. Je sais seulement qu'il y a quelques arabes dans l'armée israélienne, mais dans des proportions non représentatives du nombre d'arabes dans la société israélienne.
Question de la salle : Je souhaiterais faire une remarque sur le boycott des colonies. Vous dites que Peace Now la voit d'un bon oeil. Je trouve dommage de considérer que seuls les produits des colonies sont boycottables, comme si on cherchait à faire pression sur une entité qui s'appellerait « les colonies » alors qu'on sait parfaitement qu'elle n'est pas indépendante, ni politiquement, ni économiquement, ni militairement de l'État d'Israël. On sait que malheureusement, les ressources naturelles sont accaparées dans les Territoires palestiniens, et sont distribuées à tous les Israéliens, quel que soit l'endroit où ils vivent. Il serait donc intéressant de soutenir une démarche de boycott plus générale pour mettre la pression sur l'État d'Israël, et pour que le public israélien réalise que la politique de colonisation a un prix. Vous disiez que l'Israélien moyen de Tel-Aviv ne ressent pas les problématiques de colonisation et d'occupation. Peut-être serait-ce une manière de les lui faire ressentir, car plus il les ressentira plus, selon moi, il avancera vers la paix. Le boycott sert à faire ouvrir les yeux, pas à autre chose. Par ailleurs, je souhaite savoir si Peace Now peut travailler librement, circuler librement, où est-ce que le gouvernement israélien vous met des bâtons dans les roues ?
Mme Anat Ben Nun : En tant qu'israélienne, qui chérit Israël, mais s'oppose à l'occupation, je ne soutiens pas le boycott d'Israël dans son ensemble. Je pense qu'il existe d'autres moyens pour parvenir à une solution au conflit. Moi je suis engagée pour qu'Israël agisse mieux. Je ne veux pas que mon pays soit un État qui pratique l'occupation. Je souhaite vivre en Israël en tant que citoyenne juive aux idées de gauche, comme beaucoup de gens qui me ressemblent. J'aime Israël et je ne souhaite pas voir souffrir mon pays jusqu'à un point de non-retour. Donc selon moi, il existe d'autres moyens de pression que le boycott de l'État. Notre action à Peace Now inclut une éducation des Israéliens à la réalité de l'occupation, par des débats, des manifestations, des présentations, etc. Nous tentons de créer les moyens nécessaires pour que la paix vienne de la pression de la société civile israélienne, plutôt qu'elle ne soit imposée de l'extérieur. Pour répondre à votre seconde question, oui, nous pouvons nous déplacer assez librement, notamment en Cisjordanie. Notre problème est le texte qui va être débattu à la Knesset dans les semaines à venir, la loi sur les ONG. Cette loi tente de délégitimer les financements étrangers, notamment étatiques, pour les ONG israéliennes défendant les droits de l'Homme. Nous condamnons fermement ce projet de loi.

M. Gilbert Roger, Président du groupe d'amitié France-Palestine
III. UNE ÉCONOMIE PALESTINIENNE SOUS CONTRAINTE
M. Pierre DUQUESNE , ancien Ambassadeur chargé des questions économiques de reconstruction et de développement au ministère des Affaires étrangères et du développement international (actuel Ambassadeur auprès de l'OCDE)
M. Benjamin Sèze : Bienvenue à tous. Nous allons poursuivre nos travaux en commençant avec de M. Pierre Duquesne. Monsieur l'Ambassadeur, nous allons aborder avec vous les particularités de l'économie palestinienne et les défis que l'occupation fait peser sur elle. Cette intervention est sans lien avec vos fonctions actuelles puisque vous êtes aujourd'hui Ambassadeur auprès de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Mais c'est un sujet que vous connaissez bien eu égard à vos anciennes fonctions : vous avez été Ambassadeur chargé des questions économiques de reconstruction et de développement au ministère des Affaires étrangères et du Développement international.
M. Pierre Duquesne : Je vous remercie et vous prie d'accepter mes excuses : il était prévu que j'intervienne plus tôt dans la journée, mais j'étais ce matin aux obsèques de M. Denis Pietton, qui fut notamment Consul général à Jérusalem et Ambassadeur à Beyrouth.
Comme cela vient d'être dit, jusqu'à l'automne 2014, j'étais en charge des pays en difficulté, et notamment, pendant sept ans, de la Palestine. J'ai effectué d'innombrables voyages sur place. Cela m'autorisera à placer le sujet dans une perspective longue. Mon propos visera à montrer que ce qui est fait en matière économique a un fort lien avec ce qui est fait en matière politique. Je m'appuierai pour cela sur plusieurs dates : d'abord le 29 novembre 2012, puis le 17 décembre 2007, le 13 avril 2011, le 12 octobre 2014 et enfin le 30 septembre 2015.
L'économie palestinienne n'est certes pas celle d'Adam Smith, puisqu'il n'y a pas en Palestine de liberté de circulation des hommes ni des biens et services ni des capitaux. Mais bien qu'elle ne soit pas un exemple d'économie classique, elle existe, ce qui suscite toujours un peu d'étonnement.
La première date sur laquelle je m'attarderai est celle du 29 novembre 2012, que vous avez tous en tête : c'est le jour de la reconnaissance de la Palestine comme État observateur non membre des Nations Unies. Il est intéressant de noter c'est que c'est bien un « État », non pas à l'instar du Vatican comme cela a pu être dit, mais un État avec le même statut que celui qu'avaient l'Autriche, le Japon et la Suisse avant de devenir pleinement membres des Nations Unies. Le vote a été acquis à une très large majorité et si Israël et les États-Unis ont voté contre, ils n'ont à aucun moment dit que les Palestiniens étaient incompétents ou corrompus, comme ils l'auraient peut-être dit il y a cinq ou dix ans. Ils ont critiqué « l'unilatéralisme » de cette décision, ce qui est un peu cocasse s'agissant de l'entrée dans une institution multilatérale. Le vote de reconnaissance de la Palestine a traduit juridiquement ce qui était déjà incontestable et constatable dans les faits. Je prétends qu'il y a plus d'État -au sens d'institutions étatiques- en Palestine que dans bien des « États » du monde, et certainement plus que dans le dernier État qui a rejoint les Nations Unies, le Sud Soudan. Je qualifie la situation palestinienne « d'État sans l'État », c'est-à-dire qu'il y a les institutions de l'État sans la pleine souveraineté.
Le vote du 29 novembre 2012 a traduit le travail collectif de la communauté internationale et des Palestiniens depuis la conférence internationale des donateurs pour l'État palestinien qui s'est ouverte -c'est la deuxième date que je souhaite évoquer- le 17 décembre 2007, à Paris, et que j'avais eu l'honneur d'organiser. En dépit des vicissitudes des négociations de paix, cette étape a marqué le début d'un processus de construction de l'État par le bas, c'est-à-dire la création de l'État par les institutions. L'idée était de montrer, dans les faits, que les Palestiniens avaient les capacités de gérer un État, alors que d'aucuns pensaient que cela n'était pas nécessaire parce que les Palestiniens auraient un droit inaliénable à la construction d'un État. L'examen a été réussi : le vote l'a prouvé. Les Palestiniens ont fait, en matière économique, plus de réformes qu'ils n'avaient promis à Paris et ils ont reçu sur la période couverte par cette conférence (de 2008 à 2010) plus d'aides qu'anticipé, ce qui ne s'était jamais produit auparavant, ni pour la Palestine, ni pour aucun autre pays. Le processus de construction de l'État a permis à la fois de créer des institutions et de développer la croissance économique. Celle-ci a progressé, passant de 7% en 2008 à 12% en 2011. Les résultats sont visibles à l'oeil nu et les réformes se sont poursuivies après la fin de la période couverte par la conférence (2008 à 2010) en dépit d'un environnement économique, financier, politique, beaucoup moins favorable. En effet, l'aide versée par les pays donateurs (les États-Unis d'Amérique, les pays arabes, l'Europe) a diminué et Israël poursuit la rétention injustifiée et répétée des droits et taxes qu'il perçoit de l'Autorité palestinienne aux frontières de la quasi-union douanière entre les deux pays.
Il me semble indispensable de dire quelques mots de ce dernier problème. Comme dans une union douanière classique, Israël perçoit des droits et taxes, qui sont appelés des clearance revenues . À la différence de ce qui se passe dans une union douanière classique, cependant, Israël s'arroge le droit de ne pas reverser ces droits et taxes, en fonction de la situation politique du moment, comme cela a encore été le cas entre décembre 2014 et janvier 2015. Or il suffit que ces droits et taxes ne soient pas transférés à la bonne date chaque mois pour que l'Autorité palestinienne perde les deux-tiers de ses ressources internes. Par ailleurs, tout se passe comme si Israël gérait un second budget de la Palestine à côté du premier puisque quiconque en Israël a une créance sur l'Autorité palestinienne peut aller la présenter au Trésor israélien, qui la déduira du montant des droits et taxes qu'il transfère chaque mois. Cette déduction s'effectue sans une vérification absolument systématique, puisque les contrôles sont toujours un peu moins rigoureux lorsqu'il ne s'agit pas de payer.
Le contexte général a donc considérablement changé depuis le 17 décembre 2007, après que le test a été réussi et en dépit d'une aggravation nette de la situation économique et financière. Les réformes conduites par l'Autorité palestinienne se sont poursuivies, à un rythme certes ralenti, et tout se passe comme si, après la période d'euphorie des années 2008 à 2010, la Palestine s'était soumise à une sorte de « test de résistance » ( stress test ) permanent qui a permis de mettre à l'épreuve les capacités et la volonté politique palestinienne de maintenir le cap. Le test a été concluant, mais on ne peut pourtant pas encore dire que la situation actuelle est stable.
La troisième date que je voudrais aborder est probablement la moins connue et sans doute la plus importante. Le 13 avril 2011, lors d'une réunion semestrielle classique des donateurs au sein d'un « comité de liaison ad hoc » que préside la Norvège et auquel participe Israël, sur la base de rapports du Fonds Monétaire International (FMI), de la Banque Mondiale et des Nations Unies, il a été collectivement jugé, pour la première fois, que l'Autorité palestinienne était « au-delà du seuil d'un État fonctionnel dans les secteurs clés ».
Et la Banque Mondiale avait même estimé que si l'Autorité palestinienne maintenait sa performance dans la construction des institutions et la fourniture des services publics, elle serait bien placée pour pouvoir établir un État à n'importe quel moment dans un avenir proche. Il s'agit d'abord de réformes emblématiques pas toujours réalisées dans les autres pays en développement, dans les secteurs de l'eau et de l'électricité, de la sécurité, de la fonction publique, du système des allocations sociales. Plus que d'autres pays de la région ne l'ont fait, elle a mené à bien ou initié des réformes dans le secteur de l'éducation, de la justice, de la gouvernance. Elle fournit des services publics. Sieyès affirmait qu'une société démocratique commençait avec des réverbères et des places publiques. J'aime assez cette citation, qui dit que la fourniture de services publics a aussi un impact sur la démocratie. L'Autorité palestinienne a donc fait des réformes qui ne sont pas toujours conduites dans des pays en développement, ni parfois dans les pays développés. Le déficit public était, en 2007, de 28 points de produit intérieur brut (PIB). De manière très soutenue jusqu'en 2011 puis plus lente, il a été ramené à 10 points de PIB aujourd'hui, ce qui reste évidemment trop élevé. Mais il faut saluer cette réduction de déficit ! Le budget de l'Autorité palestinienne est publié sur internet, tous les 15 du mois, en engagements et en décaissements, ce qui n'est pas le cas de la France par exemple. Les comptes publics sont certifiés, bien qu'avec retard actuellement. La corruption s'est réduite, de même que son pendant qu'est la bureaucratie.
Le secteur financier a été totalement réformé et l'autorité monétaire de Palestine a été qualifiée par le FMI de « banque centrale sans monnaie » : il y a un système de règlement livraison, de registre de crédit, de garantie des dépôts, etc. -autant de dispositifs qui n'existent pas nécessairement tous dans les pays « développés »- mais le dollar, le shekel, le dinar jordanien et la livre sont utilisés dans les deux zones. Tout cela a conduit la Banque Mondiale à considérer, en 2011, que les réformes accomplies par l'Autorité palestinienne pouvaient être un modèle pour la zone dans son ensemble y compris en matière de droit des affaires et de lutte contre la corruption. Voilà donc la démonstration faite que les Palestiniens ne sont ni incompétents en matière économique et institutionnelle, ni corrompus financièrement, ni laxistes en matière de sécurité. Tout cela n'est d'ailleurs pas contesté par la très grande majorité des dirigeants israéliens. Mais la politique l'emporte souvent sur les autres considérations.
Cela m'amène à la date du 12 octobre 2014, qui est le jour de la conférence du Caire sur la reconstruction de Gaza. Je voudrais souligner que les réformes évoquées ne concernent pas seulement la Cisjordanie mais aussi Gaza. Il faut savoir que la moitié des 160 000 fonctionnaires de l'Autorité palestinienne sont en poste à Gaza, et ils sont payés par Ramallah au moyen de transferts bancaires électroniques. Le Hamas a sous son autorité ces agents payés par Ramallah, tout en entretenant parallèlement sa propre fonction publique, essentiellement pour le secteur sécuritaire. La fonction publique est ainsi pléthorique. L'autorité monétaire de Palestine contrôle les banques de Gaza : aucune des 45 succursales de banques installées à Gaza n'est infiltrée par le Hamas. Les transferts électroniques, comme je le disais, se font. L'Autorité palestinienne de l'eau travaille avec les collectivités locales notamment. Certains grands projets se réalisent, parfois soutenus par l'aide française à la Palestine, dont un tiers est dirigé vers Gaza.
Le blocus n'a pas eu d'effets politiques, mais il a eu des effets économiques considérables. En vérité, le blocus de Gaza a toujours été insupportable, mais il l'est devenu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus encore depuis l'été 2013 et la fermeture des tunnels avec l'Égypte. Ce qui est fascinant, c'est que non seulement de nombreux produits sont interdits d'entrée, sous la crainte d'un double usage, mais surtout que les exportations sont également interdites. Si on peut comprendre l'obsession sécuritaire sur les importations, on peut s'interroger sur le danger qu'il y aurait à permettre l'exportation de meubles, de vêtements et de produits agricoles, qui étaient massivement vendus en Israël et en Cisjordanie. Le paradoxe, c'est qu'à la suite de fortes pressions de la communauté internationale, les exportations sont possibles vers le reste du monde. Une toute première expérience d'exportation de produits agricoles vers Israël est en cours, mais c'est parce que la Communauté internationale n'a cessé d'insister. Cela relève du simple bon sens : l'envoi de fleurs, de fruits, de légumes en Israël ne pose pas de problème sécuritaire. Par ailleurs, les marchés perdus par les agriculteurs gazaouis ont été repris par les agriculteurs israéliens.
Je voudrais évoquer sous l'angle économique trois autres zones de Palestine. Les colonies sont, sur le plan du droit fiscal et du droit social, des exceptions au fonctionnement normal de l'économie : on n'y paye pas d'impôts, et le droit fiscal et social israélien ne s'y applique pas. Depuis quelques années, les relations commerciales entre la Cisjordanie et Jérusalem-Est, qui étaient restées possibles même après 1967, le sont de moins en moins, et ce pour des raisons que l'on qualifie en Israël de « phytosanitaires ». Donc la viande et les produits laitiers de Cisjordanie qui entraient sans difficultés à Jérusalem-Est en sont désormais empêchés. En ce qui concerne enfin la zone C, c'est-à-dire 60% de la Cisjordanie, un rapport de la Banque mondiale d'il y a deux ans a montré que sans évacuer les colonies, donc avec un système politique « inchangé », le simple fait de donner les autorisations de construction longtemps attendues pour tel ou tel projet et d'autoriser l'accès à la mer Morte permettrait au PIB palestinien, qui s'élève à environ 12 milliards de dollars, de s'accroître d'à peu près un tiers. Les recettes fiscales s'élèvent à 800 millions de dollars, c'est-à-dire environ une année d'aide budgétaire à la Palestine. Il n'y a plus de place en zone A et B pour un développement économique, donc il faut absolument permettre le développement de la zone C.
Le conflit qui a frappé Gaza à l'été 2014 a conduit à la récession ; en 2015, on a ainsi enregistré une baisse du PIB de 15%. Une modeste reprise technique est attendue cette année. L'ensemble de la Palestine était en récession (- 0.4%) l'an dernier, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Les promesses d'aides faites au Caire ont été servies pour un tiers, ce qui est peu aux yeux de la Banque Mondiale et du FMI mais plus que ce à quoi je me serais attendu dans ces conditions. La zone est cependant maintenant en état de « dé-développement ». Le taux de pauvreté atteint 40% ; 25% des Gazaouis sont dépendants de l'aide internationale.
J'en termine donc avec la date du 30 septembre 2015, qui est celle de la réunion semestrielle des donateurs, qui s'est tenue à New York. Comme vous l'aurez compris, j'avais déjà quitté mes fonctions antérieures, je n'y participais donc pas. Il y a été dit que l'Autorité palestinienne reste un État en devenir, et qu'elle rencontre toujours des problèmes. L'aide budgétaire, qui finance non pas des projets mais directement le budget de l'Autorité palestinienne, est en forte diminution : il manque, en ce moment, 400 à 500 millions de dollars à la Palestine pour boucler son budget, d'où un développement des arriérés à l'égard des fournisseurs et un effet récessif. Pour les institutions financières internationales, les 8% de croissance en moyenne qu'a connus la Palestine de 2007 à 2011 seraient atteignables -une fois encore, sans changer le statut actuel- à la condition que les restrictions de mouvements et d'accès aux libertés économiques de base soient levées. Il n'en demeure pas moins que, côté palestinien, il faut poursuivre les réformes, notamment dans le secteur administratif. L'Autorité s'est remise à embaucher, or elle a déjà une fonction publique assez nombreuse et a augmenté les salaires. Les niches fiscales se multiplient, les dépenses de santé ne sont pas vraiment sous contrôle.
Côté israélien, deux types de réponses sont mis en avant : ou bien des mesures de facilitation ponctuelles (augmentation du nombre de permis pour les Palestiniens qui travaillent en Israël, accord sur les exportations ou les importations, etc.), ou bien la mise en valeur de grands projets emblématiques, tels que l'exploitation des gisements de gaz en Méditerranée. Une véritable « paix économique », si cette expression peut et doit avoir un sens, consisterait non pas en un tel « saupoudrage » de mesures, en fonction de l'humeur du moment, mais en une stratégie conjointe israélo-palestinienne. Les économies israélienne et palestinienne sont toutes deux de petite taille et largement liées l'une à l'autre, notamment dans les secteurs de l'eau, de l'électricité, du tourisme, etc. L'objectif d'une « paix économique » serait atteignable au travers d'une libéralisation en zone C, d'une diminution des difficultés de circulation à l'intérieur même de la Cisjordanie, c'est-à-dire par la mise en place de ce que j'appelle l'économie d'Adam Smith, et bien entendu la fin du blocus de Gaza. Tout cela ne saurait certes pas remplacer la négociation pour l'établissement de l'État de Palestine, mais constituerait déjà une avancée appréciable.
En guise de conclusion, je sortirai du cadre de mon sujet pour dire qu'il n'y a de solution que dans la création d'un État palestinien viable indépendant qui est, faut-il le répéter, la seule garantie de long terme à la sécurité d'État d'Israël, sécurité qui, pour la France, n'est pas négociable. Je vous remercie.
M. Benjamin Sèze : Merci, Monsieur l'Ambassadeur. Quels sont les principaux secteurs porteurs de l'économie palestinienne, est-ce une économie agricole, manufacturière ?
M. Pierre Duquesne : L'économie est largement agricole. En ce qui concerne l'industrie, des médicaments génériques sont produits, mais pas uniquement ; la France soutient d'ailleurs ce secteur. Il y a également une activité de service, notamment informatique. Le secteur touristique, fort de ses 120 000 visiteurs en 2014, pourrait aussi être une composante importante de l'économie palestinienne. Enfin, il faut citer le secteur du bâtiment.
Ce qui m'a vraiment fasciné, pendant ces sept années durant lesquelles j'ai eu le bonheur de m'occuper de la Palestine, d'aller là-bas tous les trois mois et n'ai pas cessé de rencontrer des chefs d'entreprise, y compris à Gaza, c'était de voir que dans un système de contraintes absolument infernales, les Palestiniens arrivaient à maintenir une économie. Il y a le potentiel d'une économie non pas totalement développée ni en développement mais de « pays de revenu intermédiaire ».
En ce qui concerne plus spécifiquement Gaza, trois secteurs sont à citer : agriculture, petit textile, petit mobilier. Il va sans dire que les chefs d'entreprise palestiniens et israéliens ont mille points communs.
Question de la salle : Les Palestiniens devraient-ils obtenir leur souveraineté monétaire ?
M. Pierre Duquesne : Au cours de ma carrière professionnelle, j'ai eu le bonheur d'être le négociateur français du Traité de l'Union économique et monétaire, qui a donc conduit à l'abandon de la souveraineté monétaire de notre pays. Bien que j'en mesure la portée symbolique, je ne pense pas que cette dernière soit dans l'intérêt des Palestiniens, et ce pour des raisons économiques.
Question de la salle : Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez parlé de paix économique. Pensez-vous que celle-ci soit vraiment possible à partir du moment où le Hamas a tant d'autorité à Gaza ?
M. Pierre Duquesne : L'expression de « paix économique » n'est plus utilisée par les autorités israéliennes. Même lorsqu'elle l'était, elle ne consistait qu'en des mesures ponctuelles. C'était là le défaut du système.
La relation économique avec Gaza implique nécessairement des contacts avec le Hamas, par les canaux les plus divers, y compris le système des Nations Unies. Il en va de même pour le versement de l'aide après la Conférence du Caire.
Il y a un fort lien économique entre la Cisjordanie et Gaza, qui se distend depuis la mise en place du blocus. Il faudrait maintenir ce lien, et j'espère que l'Autorité palestinienne (qui, je le répète, n'est pas totalement absente de Gaza) et le Hamas s'en rendent compte.
Question de la salle : Peut-on avoir un peu plus d'informations sur l'impact de l'occupation sur cette économie palestinienne très dynamique ?
M. Pierre Duquesne : J'ai tout à l'heure essayé de quantifier cet impact pour la zone C, évalué à un tiers du PIB. La non-délivrance d'autorisations (toute activité y est soumise à autorisation) a une incidence majeure. Il est cependant difficile de tout quantifier, de tout additionner, de tout mesurer des effets de stocks et de flux, des lenteurs bureaucratiques, des retenues et transferts de droits et taxes, etc.
Question de la salle : J'ai moi-même effectué une vingtaine de déplacement en Palestine et je partage votre sentiment sur le dynamisme qui y règne. Vous avez cité un taux de croissance de 8%, or on estime que le niveau de sortie de la pauvreté s'établit à 7 à 8%. Si effectivement la Palestine a atteint ce niveau, c'est qu'il y a un système éducatif relativement performant.
En dehors du contexte économique, la France, tout du moins la diplomatie française et tout particulièrement le Consulat général de France à Jérusalem, a toujours manifesté une très grande compréhension de ce qui se passe en Palestine. À cet égard nous devrions observer une minute de silence à la mémoire de M. Denis Pietton, ancien Consul général à Jérusalem, qui a joué un rôle extrêmement important sur place. N'y a-t-il cependant pas certaines dissonances entre la diplomatie française d'un côté, et le Premier ministre et le Président de la République de l'autre ?
M. Pierre Duquesne : Je voudrais souligner que le 29 novembre 2012, la France a annoncé à l'avance qu'elle voterait pour la reconnaissance de l'État de Palestine et nous avons battu le rappel, fait des démarches diplomatiques, etc. Pour honorer de nouveau la mémoire de M. Denis Pietton, je peux vous dire que le ministre M. Laurent Fabius a, ce matin, lors des obsèques, fait un peu de politique dans l'hommage qu'il a rendu à Denis, en disant qu'il s'était occupé du processus de paix, avant d'ajouter immédiatement qu'il n'y avait aujourd'hui ni processus ni paix.
Le processus d'étiquetage des produits des colonies, quant à lui, poursuit son chemin. Il n'y a pas de raison que des produits qui ne viennent pas d'Israël bénéficient du traitement favorable accordé aux produits israéliens en matière commerciale. Si votre question est de demander si on sait faire la paix, si la France sait imposer la paix au Proche Orient, je crains que la réponse ne soit négative. Je ne pense néanmoins pas qu'on puisse distinguer la position de notre diplomatie de celle du gouvernement et de l'Élysée. Le Président de la République précédent avait fait voter l'entrée de la Palestine comme membre plein à l'UNESCO en novembre 2011. À la conférence de Charm-El-Cheikh de mars 2009, à laquelle j'ai assisté, Gaza a été publiquement qualifiée de prison à ciel ouvert. Ce terme a été repris depuis par l'actuel Président de la République. Il me semble qu'il est trop facile de dire qu'il y a une distinction entre le Quai d'Orsay et le reste de l'État.
Question de la salle : Je voulais avoir votre sentiment, en tant que diplomate, concernant l'accord entre l'Union européenne et Israël. On dit parfois que suspendre ou corréler le maintien des traités commerciaux entre l'UE et Israël à son respect du droit international pourrait servir de moyen de pression sur nos amis israéliens. Est-ce que cette option est évoquée dans les sphères du pouvoir ?
Je voulais également savoir si, dans les accords de coopération et dans les échanges autour des questions économiques qu'il peut y avoir entre la France et l'État naissant de Palestine, Israël demandait à avoir son mot à dire, et si Israël s'invitait automatiquement à la table des négociations.
Enfin, avez-vous réfléchi à quantifier l'impact sur l'économie palestinienne d'un éventuel boycott des produits israéliens ? Est-ce que celui-ci pourrait avoir un impact sur la société palestinienne en termes économiques ? On entend souvent en Israël qu'il toucherait les travailleurs palestiniens en premier lieu. Est-ce de la rhétorique ou y a-t-il des arguments économiques ?
M. Pierre Duquesne : Je commence par la dernière question. Comme je suis ici le seul représentant officiel de la diplomatie française, et alors même que ce ne sont plus mes compétences, je vais redonner la position de la France. Nous sommes totalement hostiles au boycott d'Israël. C'est clair. En revanche, nous ne considérons pas, contrairement à Israël, qu'étiqueter les produits des colonies comme venant des colonies, c'est boycotter les produits israéliens.
Les économies israélienne et palestinienne sont fortement interpénétrées. Il y a effectivement des travailleurs palestiniens légaux. Leur nombre a augmenté. Des illégaux, dont on ne sait pas, par hypothèse, combien ils sont, travaillent aussi en Israël. Je ne parle même pas là des Palestiniens qui travaillent dans les colonies. Sur un strict plan économique, je pense donc que ce boycott aurait des conséquences pour les Palestiniens. Mais je répète, encore une fois, pour qu'il n'y ait absolument aucun doute sur ce point, que la France est hostile au boycott d'Israël.
En ce qui concerne votre question relative à la coopération franco-palestinienne et à la position israélienne vis-à-vis de celle-ci, la réponse varie selon qu'on se trouve en zone A, B ou C : en zone A, il n'y a aucune intervention d'Israël ; en zone C, la mise en oeuvre de projets se heurte à des problèmes majeurs, et les réalisations peuvent finalement être détruites par Israël ; enfin, en zone B, il faut négocier.
Au mois de novembre dernier, s'est tenu le premier « séminaire intergouvernemental » franco-palestinien. Des projets communs ont été évoqués. En septembre, M. Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, a inauguré un projet de zone industrielle à Bethléem, à l'initiative duquel j'avais été associé en 2007. En dépit de l'enchevêtrement des compétences des collectivités territoriales et de la nécessité permanente d'une négociation avec Israël, la construction de cette zone industrielle n'aura finalement pas été plus longue que celle d'une zone industrielle en périphérie de ville française. On y est arrivé. Et des industries s'y sont installées.
La France mène aussi des projets à Gaza : un projet d'aide à la confection de jeux électroniques, qui n'a pas posé de problèmes physiques, des projets d'écoles, qui marchent plutôt bien, y compris au Sud de la bande, ... Il y a aussi un projet ancien de station d'épuration, absolument indispensable à Israël, dont l'objet était de remplacer une station au Nord. Cette usine est dans l'intérêt absolu d'Israël, puisque le bassin aquifère et la mer sont pollués. Le site a parfois été bombardé.
J'en viens à votre première question, sur les relations commerciales entre l'Union européenne et Israël. On ne peut pas se mettre à suspendre des accords commerciaux sur la base de raisonnements politiques. Il est commun de dire que l'Union Européenne se contente de payer, mais ce n'est pas vrai. Par exemple, le concept de « Jérusalem, capitale de deux États », que l'on doit à la France, a été repris dans les conclusions du Conseil des Affaires Étrangères de décembre 2008.
Il est long et compliqué de faire quoi que ce soit à 28, et a fortiori au sujet d'Israël, parce que les positions des uns et des autres sont effectivement assez marquées et peuvent varier considérablement selon la couleur politique du moment dans l'État membre considéré. En tout état de cause, il est absolument faux de dire que l'UE signe des chèques sans se préoccuper de ce qui se passe sur le terrain. L'étiquetage des produits des colonies est là pour en témoigner puisque c'est l'application d'un accord. Les préférences tarifaires qui sont octroyées à Israël ne sont pas octroyées aux colonies en Palestine, c'est très clair.
Question de la salle : Certains rapports récents de l'ONU, notamment du Conseil des Droits de l'Homme, évoquent l'existence d'un « système d'apartheid » dans les Territoires palestiniens occupés. Je cite, à titre d'exemple, les rapports du professeur Richard Falk, qui parle « d'apartheid pratiqué par Israël ». En prenant la définition juridique de l'apartheid, on peut identifier deux éléments principaux : la domination et l'oppression. Je laisse de côté l'oppression, pour évoquer la domination. Pensez-vous que l'occupation continue en Territoires palestiniens maintient en place un système de domination économique en faveur d'une partie de la population ? Je vous remercie.
M. Pierre Duquesne : Je ne veux pas me prononcer sur le terme « apartheid ». Je crois que je vous ai bien décrit comment cette économie palestinienne fonctionne. Quand une bonne partie des recettes fiscalo-douanières sont dans les mains d'un tiers, on ne peut pas parler d'un système complètement libre. Si vous voulez me faire dire qu'effectivement Israël exerce un certain nombre de contraintes de fonctionnement sur l'économie palestinienne, je crois que c'est déjà fait, mais je peux le répéter.
Israël argue que tout cela est fait pour sa sécurité. Quand cela est en effet le cas, nous le comprenons, nous l'acceptons. Quand il s'agit d'interdire l'exportation de tomates cerises de Gaza, nous le comprenons moins. Je pense avoir été assez clair.
Mais dans le même temps, je crois très sincèrement qu'en fonctionnement normal, ces deux économies devraient avoir des liens forts. L'économie palestinienne ne pourrait pas fonctionner sur le modèle de l'Albanie d'Enver Hoxha donc il ne faudrait pas croire qu'elle pourrait fermer les frontières. Cela ne fonctionnerait pas, et d'ailleurs, ce n'était pas le cas avant. C'est une économie qui a toujours eu des liens commerciaux forts avec Israël.
M. Benjamin Sèze : Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur, pour ces éclairages très intéressants.
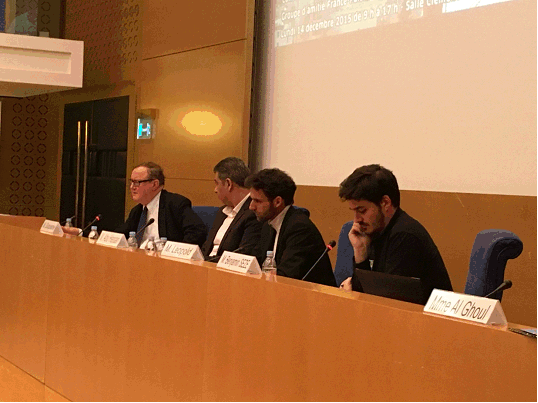
M. Pierre Duquesne et MM. Jehad Abu Hassan et Gaël Leopold
DEUXIÈME PARTIE - VIVRE EN TERRITOIRE OCCUPÉ
I. JÉRUSALEM, VILLE DIVISÉE ET OCCUPÉE
M. Daniel SEIDEMANN, fondateur et directeur de l'ONG Terrestrial Jerusalem
M. Benjamin Sèze : Merci, nous allons débuter cette deuxième table ronde avec M. Daniel Seidemann, fondateur et directeur de l'ONG israélienne Terrestrial Jerusalem , et surtout grand spécialiste de Jérusalem. M. Seidemann, merci d'être parmi nous ce matin, vous allez nous parler des spécificités de Jérusalem et de l'enjeu particulier que cette ville représente dans la recherche d'un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Vous pourrez également nous expliquer le contexte général du cycle de violence qui s'est amorcé au mois d'octobre dans cette ville.
M. Daniel Seidemann : Merci d'avoir bien voulu organiser ce colloque et de nous y accueillir. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les approches générales qui ont été présentées par mes collègues et amis M. Imseis et Mme Ben Nun et je vais tenter pour ma part de présenter les choses un peu différemment. Je souhaiterais brosser le portrait de Jérusalem aujourd'hui car la ville est différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a 18 ou 24 mois. Jérusalem est l'épicentre, le paradigme du conflit. Si vous comprenez le conflit à Jérusalem, vous comprendrez mieux le douloureux conflit israélo-palestinien.
Je peux vous citer avec précision le jour où j'ai commencé à travailler sur la ville de Jérusalem. C'était au cours de la nuit du 9 octobre 1991, il y a 24 ans déjà, quand les colons sont pour la première fois entrés dans Silwan 3 ( * ) . En tant qu'avocat, je me suis dit que j'allais m'y opposer, notamment auprès des membres de la Knesset. Je suis entré alors dans un engagement donc je ne suis jamais ressorti. Depuis 24 ans, j'ai arpenté chaque jour Jérusalem-Est, sans aucune crainte. Mais ça, c'était jusqu'à il y a quatorze mois. Pendant la Seconde Intifada, dans un périmètre de 200 mètres autour de mes bureaux, il y a eu dix attentats-suicides à la bombe, Jérusalem Ouest était particulièrement dangereuse. Mais ça n'était pas dangereux pour un juif israélien à Jérusalem-Est. J'y étais bien accueilli. Pourtant, au cours des quatorze derniers mois, je n'ai pas pu visiter Jérusalem-Est sans, dans 90% des cas, être accompagné d'un collègue palestinien ou par un véhicule diplomatique. Je suis le bienvenu mais je suis accompagné, je ne suis jamais seul. Et ce témoignage ne doit pas être perçu comme le pleurnichage d'un Israélien qui vous raconte à quel point il est difficile d'être juif. À mes amis palestiniens qui travaillent à Jérusalem Ouest, on recommande de ne plus rentrer seul chez eux. Le serveur palestinien du café où je me rends chaque jour a été invité par son patron à ne même-plus sortir seul les poubelles dans la rue par crainte de représailles anti arabes gratuites. La haine est plus forte, plus endémique aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été depuis 1967. Vous allez peut-être croire que cette perception que je vous livre est très subjective, alors je vais vous donner quelques statistiques particulièrement intéressantes.
Le Shin Bet, notre service de sécurité, a publié une étude en 2008 sur l'implication des Palestiniens de Jérusalem-Est dans des actes de violence durant la Seconde Intifada (2001-2008). Pendant les sept années pleines de la Seconde Intifada, les forces de sécurité israéliennes ont arrêté 270 Palestiniens pour des infractions liées à la sécurité. Cette année, depuis la veille de Rosh Hashana (le nouvel an juif) le 13 septembre, et jusqu'au 31 octobre, il y a eu 797 arrestations de Palestiniens de Jérusalem-Est pour des infractions liées à la sécurité. En sept semaines, trois fois plus de personnes ont été détenues qu'en sept années d'Intifada. Et ça n'a pas débuté en octobre 2015. Cela s'est déclenché dès le mois de juillet 2014, mais n'a commencé à intéresser le grand public que lorsque cela a commencé à déborder sur la partie occidentale de Jérusalem. Les quartiers de Jérusalem-Est se sont embrasés quasiment chaque soir depuis le 2 juillet 2014. Nous sommes au coeur d'un soulèvement populaire comme nous n'en avons jamais vu depuis 1967. Plus de la moitié des détenus sont des gamins. Nous avons arrêté près de 1% des jeunes garçons palestiniens de Jérusalem-Est de moins de dix-huit ans depuis le mois de juillet 2014. Ce taux est absolument stupéfiant. Et ce que je cherche à comprendre, c'est qui motive ces milliers de jeunes, qui ne sont pas incités à la violence par leurs familles, qui ne lisent pas la presse occidentale, ou qui ne sont pas entraînés dans leurs actes par un très charismatique Mahmoud Abbas ! Qu'est-ce qui leur donne envie d'affronter chaque soir la police ? Ce qui est saisissant, c'est que personne chez les officiels israéliens ne se pose la question. Oh, bien entendu, je suis certain que plusieurs personnes au sein de la police ou du Shin Bet se posent la question, secrètement, mais certainement personne au gouvernement, ni Netanyahou, ni le maire de Jérusalem, ne s'interroge ainsi. La raison c'est qu'ils sont engagés par un article de foi imperméable à la réalité empirique : « Jérusalem, la capitale indivisible d'Israël, qui ne sera jamais plus divisée », qu'ils doivent savoir répéter sept fois à la suite pour être certains que soit ensuite élu le candidat républicain à la présidence des États-Unis !
La croyance profonde que Jérusalem est telle qu'elle devrait être, à savoir sous seule souveraineté israélienne, crée une situation unique au monde de déni de la réalité empirique de la part du maire et du Premier ministre de la ville qu'ils prétendent gouverner. Car Jérusalem est en réalité une ville binationale. C'est une ville israélienne, la plus grande ville juive de l'histoire, 2,5 fois plus grande qu'à son apogée au temps de Jésus. Mais 37 à 38% de la population est palestinienne, et est privée de ses droits. Elle ne peut pas voter aux élections nationales. 35% du territoire privé de Jérusalem-Est a été exproprié par le gouvernement israélien pour y construire 55 000 logements pour des Israéliens. Israël a construit des logements pour les Palestiniens, bien sûr, mais 600, et les derniers le furent au milieu des années 1970. Mon ami et collègue Jeff Halper vous parlera également des démolitions de maisons un peu plus tard dans la journée. Nous avons une étrange théorie en Israël. Si nous souhaitons maintenir une majorité israélienne robuste sur ce territoire, nous devons alors artificiellement mettre une limite au développement palestinien. Par conséquent, nous ne laissons pas les Palestiniens construire légalement. Nous avons une seconde théorie étrange qui est que si on ne les laisse pas construire légalement, ils perdront alors l'envie de faire des enfants. Nous n'accordons donc pas de permis de construire aux Palestiniens et lorsqu'ils construisent, illégalement, nous détruisons leurs habitations.
Mais toutes ces observations ne répondent pas à ma question centrale : pourquoi ce soulèvement ? La réponse apportée par la communauté internationale est plutôt crédible et raisonnable, mais je la trouve inadéquate. Récemment, nous avons constaté une détérioration des relations entre chrétiens, juifs et musulmans, essentiellement entre juifs et musulmans d'ailleurs, et plus particulièrement autour de l'Esplanade des Mosquées - le Mont du Temple, où on a pu observer une radicalisation des positions et des actes de violence. L'extrémisme croît, et ceux que l'on appelle les Temple-mounters , une frange marginale d'illuminés souhaitant la reconstruction du Temple 4 ( * ) , deviennent dominants dans le débat public. Ils souhaitent changer le statu quo sur l'Esplanade des Mosquées - le Mont du Temple, et ne le cachent plus. Cela se produit avec une radicalisation religieuse en toile de fond, qui s'insinue à tous les niveaux : des colons motivés par des idées messianiques et des partisans de la reconstruction du Temple pour les juifs, aux chrétiens évangéliques qui considèrent Jérusalem comme le lieu de l'Apocalypse à venir (marginalisant par là même les églises traditionnelles), jusqu'aux pires branches des Frères musulmans qui ont leurs propres raisons d'espérer une guerre religieuse.
Nous assistons à la militarisation de la foi par des groupes de croyants. Jérusalem doit donc être considérée non pas comme l'explosif mais comme son détonateur. Et ce qui se passe autour de l'Esplanade des Mosquées - le Mont du Temple alimente cette situation. Mais ce n'est pas la seule explication à ce cycle de violence, à ce soulèvement. Car la situation dans les lieux saints de Jérusalem s'est, temporairement probablement, un peu apaisée. Malgré tout, le soulèvement à Jérusalem se poursuit, et il nous faut donc en chercher les raisons profondes.
La réponse m'est venue comme une révélation quand j'ai réalisé qu'il n'y avait pas un seul soulèvement à Jérusalem mais deux. L'un se passe dans la rue, il est l'oeuvre de gamins, et se coordonne sur Twitter et Facebook, et non pas par un quelconque ordre qui viendrait de Ramallah. Le second se déroule sur l'Esplanade des Mosquées - le Mont du Temple, et est largement l'oeuvre des femmes. C'est fascinant car la société civile palestinienne est dynamique et bouillonnante mais elle demeure encore très largement patriarcale. L'homme est le chef du foyer, de la famille. Il y a donc un message quand on observe qu'un soulèvement vient d'enfants et de femmes. Ce message c'est celui de la faillite des pères à remplir leur devoir, celle de permettre à la famille d'entrevoir un futur. Or la perception des femmes et des enfants est celle de l'échec, de ne pas avoir de futur. C'est cette rage, précisément, qui alimente le conflit. Je connais ces gamins et leurs parents, et ce sont des gens bien. Notre gouvernement soutient le contraire et prône la répression. Il soutient que la vie est assez bonne pour eux, que leur volonté d'obtenir une partie de Jérusalem est un rêve, et que seuls des gens intrinsèquement mauvais se comportent ainsi. Or ces gamins savent très bien qu'ils ne font pas partie intégrante de la Palestine, qu'ils en sont séparés par le Mur, qu'ils ne sont pas considérés par une Autorité palestinienne dysfonctionnelle qui les utilise. Ils savent qu'ils ne sont pas israéliens, et ne le seront jamais, qu'ils n'ont aucun pouvoir politique et nulle part où aller. Ces quinze dernières années, Israël a écrasé toute forme d'expression politique à Jérusalem-Est, jusqu'aux rassemblements scouts !
Alors est-ce que ce soulèvement va continuer indéfiniment ? Je ne le pense pas. Nous assistons au lent déclin de ce cycle de violence, non pas grâce aux politiques menées par Israël, ou parce que certains problèmes auraient été réglés. Les cycles de violence ont leur propre dynamique et s'essoufflent, mais nous ne reviendrons plus jamais à la situation qui préexistait à celui-ci. Si les Palestiniens de Jérusalem-Est que je connais se sont impliqués dans ce mouvement, avec le sentiment d'être une population marginalisée, étrangère chez elle, c'est qu'il s'est passé quelque chose de fondamental au cours des douze à dix-huit mois passés, et qui ne sera pas oublié.
Je souhaite l'illustrer par trois événements qui à eux seuls résument tout ceci. Tout d'abord, voici un mois, Israël a détruit la maison de deux familles de deux terroristes palestiniens impliqués dans l'horrible massacre dans une synagogue à Jérusalem Ouest. Les terroristes ont été tués sur place, les familles n'étaient pas complices de leurs actes, mais leurs maisons ont tout de même été démolies ou emmurées. Les Israéliens considèrent cela comme mérité mais la communauté internationale elle, parle de crimes de guerre. Les Palestiniens que je connais à Jérusalem-Est, eux, pensent différemment. En effet, le 2 juillet 2014, un jeune Palestinien de 15 ans, Mohamed Abou Khdeir, a été enlevé puis brûlé vivant, et a ensuite succombé à ses blessures. Ses ravisseurs ont été arrêtés et sont sur le point d'être inculpés. Tous les Palestiniens que je connais posent la même question : quand est-ce que les maisons de ces terroristes juifs vont être démolies ? La différence de traitement entre Palestiniens et Israéliens alimente une rage et l'impression que le sang israélien est sang quand le sang palestinien n'est qu'eau.
Le deuxième exemple est fourni par Nir Barkat, le maire de Jérusalem, qui a appelé voici six semaines ses administrés à porter des armes pour se défendre. C`est un signal puissant car les Israéliens ont droit au port d'une arme alors que les Palestiniens non. Donc le maire d'une ville binationale appelle la majorité, c'est-à-dire 63% de ses administrés qui sont déjà en position de force, à porter leurs armes pour se protéger d'une minorité désarmée.
Troisième exemple, il y a un mois, Netanyahou, et d'autres « force de modération » israéliennes, ont appelé à l'exclusion de Jérusalem de 80 000 Palestiniens supplémentaires. En 1967, d'un coup de baguette magique, il avait été décidé que ces personnes seraient jérusalémites, et d'un coup d'un seul, on décide désormais de les exclure de ce statut. Personne ne s'est demandé si cela allait poser des problèmes économiques à ses nouveaux exclus. Où vont-ils aller travailler, prier, comment vont-ils ensuite rendre visite à leur famille ? On leur envoie un message très violent même si en réalité cette exclusion n'aura pas lieu.
Je suis en règle générale particulièrement réticent à établir des comparaisons entre la situation des noirs américains pendant la ségrégation et celle des Palestiniens aujourd'hui. Je trouve que ces analogies ont tendance à porter préjudice à ces causes. Mais le mouvement américain Black Lives Matter auquel nous assistons, pourrait être résumé côté israélien à Palestinian Lives don't Matter .
Maintenant que va-t-il se passer ? Ce soulèvement va s'essouffler mais la rage va perdurer. Depuis 1967, il y a eu des périodes durant lesquelles l'occupation était un « cancer en rémission ». Ce n'était pas une situation optimale mais elle était supportable. Aujourd'hui l'occupation est comme un cancer très agressif et qui métastase. Le soulèvement auquel nous assistons a détruit dans tous les esprits le mythe d'une ville de Jérusalem unie, excepté pour ceux qui sont aveuglés par l'idéologie. Et la réponse israélienne à ce soulèvement a détruit le mythe d'une occupation bénigne.
Il est donc probable que les périodes de calme entre deux soulèvements se réduisent, et que les niveaux de violence de ces soulèvements s'accroissent. Et en tout état de cause ça ne cessera pas, donc il faut réfléchir à comment en finir avec ces situations de violence. Cela ne prendra pas fin par des mesures punitives, en bouclant les quartiers palestiniens ou en détruisant plus de maisons. Cela ne prendra pas fin non plus en traitant mieux les Palestiniens, en leur construisant des égouts ou des écoles. Cela prendra fin lorsque l'occupation cessera et l'occupation ne prendra fin que par l'établissement d'une frontière. Sur ce sujet, je suis en désaccord avec mon ami Jeff Halper que vous entendrez un peu plus tard. Je crois profondément à la solution à deux États et l'occupation ne peut cesser que par un divorce : que les Israéliens se gouvernent et que les Palestiniens fassent de même. C'est brutal mais c'est ainsi. Je ne parviens pas à imaginer une alternative, que ce soit une confédération ou un seul État. La réconciliation ne pourra commencer qu'après le divorce, matérialisé par une frontière. Et cette frontière passera par Jérusalem, je peux même vous montrer précisément à quel endroit.
J'en termine par un propos très personnel et un sentiment d'urgence que je souhaite partager. Hier j'ai eu mon père au téléphone à l'occasion de son anniversaire, de ses 91 ans. C'est un juif de Manhattan qui a vécu son adolescence dans l'Allemagne nazie de 1933 à 1940 puis l'a quittée via Moscou, Pékin, Tokyo, Seattle et enfin Washington. Il est arrivé aux États-Unis en 1941, a obtenu son diplôme d'université en 1943 et est revenu en Allemagne en 1944, mais cette fois sous l'uniforme de l'armée américaine. C'est ça mon sionisme. Le monde est un endroit dangereux, et plus dangereux encore pour les juifs, comme pour les Palestiniens. Que je vienne d'une famille de réfugiés ne fait pas de mes amis réfugiés palestiniens de Dheisheh 5 ( * ) des sous-réfugiés. Les tragédies de la Shoah et de la Nakba se regardent en miroir et cela rend les choses particulièrement compliquées. Si je suis autorisé à chercher un refuge dans ce monde dangereux, les Palestiniens devraient aussi y avoir droit. Donc si tout ceci doit prendre fin, ce sera par l'établissement d'une frontière et par la création de deux États. Et sachez que nous sommes face au grand danger, très proche, de perdre cette solution. Détruire cette solution ne fera pas, selon moi, naître une alternative sur ses cendres.
Il y a trois dangers qui pèsent sur cette solution à deux États. Le premier est territorial, car la balkanisation de la Palestine, démontrée avant mon propos par Ardi Imseis et Anat Ben Nun, rend à peu près impossible le tracé d'une frontière. Le second est la situation autour de l'Esplanade des Mosquées, Mont du Temple, qui voit ce conflit, un conflit politique, et donc solvable par des êtres humains rationnels, se transformer peu à peu en un conflit religieux insoluble. Le troisième est que ce soulèvement va s'éteindre mais ce sera une affaire de mois avant qu'il ne renaisse. Et nous risquons désormais à tout moment de faire face à une seconde catastrophe, comme l'effondrement de l'Autorité palestinienne, où les forces palestiniennes pourraient retourner leurs armes contre les forces israéliennes ; ou l'on pourrait également assister en Cisjordanie à une répression sanglante semblable au massacre de Sharpeville 6 ( * ) . Et nous ne sommes vraiment plus très loin d'une telle catastrophe.
Le conflit israélo-palestinien que le président Obama léguera à son successeur ressemblera fort à l'Irak dont il avait hérité de son prédécesseur : une situation hémorragique, et non soluble. Mon père a fait face dans sa jeunesse à la remise en cause même de l'existence du peuple juif. Il fut une victime du nazisme et un combattant contre ce régime. Je considère que je fais à mon tour face au défi du peuple juif de cette génération qui se recoupe avec le défi des Palestiniens, c'est-à-dire de mettre fin à l'occupation. Il n'y a pas de plus grande menace à l'existence d'Israël que cette occupation. Perdre la solution à deux États, c'est condamner mes amis palestiniens à vivre sous mon occupation et cela me condamne à vivre dans un pays occupant perpétuel, qui n'y survivra pas. Voici ce qui est en jeu. Je vous remercie.
M. Benjamin Sèze : Merci pour ces éclairages qui ont permis d'aborder un grand nombre de problématiques. Je passe maintenant la parole à celles et ceux qui souhaitent intervenir dans la salle.
M. Naji Owdah : Bonjour, je suis un Palestinien du camp de réfugiés de Dheisheh, proche de Bethléem. Ce que j'entends aujourd'hui me touche car, généralement, lors de tels événements, on n'aborde pas la réalité vécue sur le terrain par les Palestiniens. Pour ma part, je suis opposé à la création d'un seul État, qui serait un État juif, colonial, d'apartheid. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, c'est l'accaparement des terres et des punitions croissantes pour les Palestiniens. Et je puis vous dire que nous ne voyons pas de différence entre la gauche et la droite lorsqu'elles gouvernent en Israël.
M. Daniel Seidemann : J'ai bien précisé qu'Israéliens et Palestiniens avaient tous deux un droit à l'autodétermination. Vous ne m'avez pas entendu parler d'État juif. Bien sûr je me pose des questions sur ce terme, ce concept, mais la façon dont le Premier ministre d'Israël l'emploie est inacceptable. Cela crée un Israël qui serait non seulement néfaste aux Palestiniens mais également aux Israéliens. Je comprends très bien pourquoi les Palestiniens s'opposent à la reconnaissance d'un État juif d'Israël. Dans aucun cas la terminologie qui désigne cet État ne devrait être un obstacle à une égalité totale en droits de tous les Israéliens, y compris ceux membres de la minorité arabe d'Israël. Le terme « État juif » est utilisé comme une arme, un prétexte, et ceci est indéfendable.
M. Ardi Imseis : Daniel Seidemann se demande pourquoi ce soulèvement a lieu ? Il vous a exposé ses explications, son sentiment. Selon moi, si on observe ce qui se passe aujourd'hui non seulement à Jérusalem-Est, mais également en Cisjordanie, à Gaza et en Israël même, tout découle d'un seul élément à savoir la folie d'une volonté de suprématie juive sur un territoire rempli de non juifs. Naji, vous qui venez de nous interpeler, vous avez évoqué la question des réfugiés. Daniel tu as évoqué la question de Jérusalem comme le point central, le noeud gordien du conflit. Pour moi qui ai servi les réfugiés pendant douze ans, je pense que le coeur du problème est qu'en 18 mois, de novembre 1947 à avril 1948, quelques 80% des habitants de la Palestine mandataire ont subi une forme de nettoyage ethnique, et ont dû quitter leurs terres. Et que vous pensiez qu'Israël ait fait ceci délibérément ou non, ce qui est clair c'est que depuis lors, Israël a délibérément refusé le retour de cette population, et ce sur la seule base de leur non judéité. Cela reste ancré au coeur de la question palestinienne, même quatre générations plus tard. C'est cette rage que les jeunes Palestiniens dénués de droits, vivant à Jérusalem, que Daniel a si bien décrits, ont au fond de leur coeur. Cette quête de la suprématie juive sur une terre arabe a motivé toutes les politiques israéliennes depuis 1947. Je pose donc la question à Daniel : que penses-tu de la folie de cette volonté de suprématie ?
M. Daniel Seidemann : J'y suis opposé ! Je suis contre cette suprématie. Mais parlons clairement, est-ce que ce conflit entrera dans un nouvel équilibre une fois que l'occupation aura pris fin, ou quand Israël aura disparu ?
M. Ardi Imseis : Dans aucun des deux cas !
M. Daniel Seidemann : Donc si tu me soutiens que l'occupation a encouragé des tendances sous-jacentes en Israël, et que tu les appelles « suprématie juive », je suis d'accord avec toi. Je ne crois pas que la société israélienne pansera ses plaies jusqu'à ce que l'occupation ait pris fin. La fin de l'occupation ce n'est bien sûr pas la fin de ce conflit, mais ce sera un renouveau. Soyons directs, les Palestiniens et les Israéliens n'ont pas vraiment des tempéraments de type scandinave, cherchant le compromis ! Nous ne serons dès lors pas transformés en tant que peuples par un accord politique. Mais nous commencerons à nous reconstruire. Je ne me trompe pas, je ne considère pas que l'occupant et l'occupé sont deux victimes. L'occupé est bien le seul à être la victime. Et je suis, en tant qu'israélien, ton occupant. Mais mettre fin à l'occupation libérera non seulement la Palestine mais également Israël. Peut-être que nous allons, nous Israéliens, tirer très mal partie de cette libération ! Mais les Palestiniens vont alors aussi découvrir que la souveraineté c'est la liberté, y compris celle de prendre de mauvais chemins, plutôt que de pouvoir imputer ces erreurs à l'occupant.
Question de la salle : Je suis médecin d'origine palestinienne, à la tête d'une association médicale. Je comprends les critiques contre la politique de Netanyahou, mais selon moi c'est un rideau de fumée, car si on parle depuis plus de vingt ans d'un État palestinien sans que rien n'arrive, le peuple palestinien, lui, voit chaque jour ses droits violés sans que rien ne change. Le droit d'être un homme libre devrait supplanter tous les droits, même celui d'un État. Le 10 décembre nous avons fêté l'anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme qui fut votée en 1948 par les Nations Unies. Cette déclaration, dans son article premier, dit que tous les êtres humains naissent et demeurent égaux en droit. Un autre article dit que chacun peut quitter son pays et y revenir quand il le souhaite. Nous les Palestiniens, nous sommes partis, nous avons été chassés en 1948 et nous ne pouvons plus revenir dans notre pays. Nous proposer ce que Peace Now propose, c'est-à-dire de rentrer ailleurs, je ne l'ai pas lu dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ; ni que je n'ai pas le droit au retour chez moi, dans mon village de Silwan, à côté de Jérusalem, parce que je menacerais le caractère juif de l'État d'Israël. Ce droit à un État « pur » sur le plan racial ou religieux, je ne l'ai pas non plus trouvé dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Dire que les réfugiés palestiniens pourront rentrer dans l'État palestinien naissant, c'est nier aux Palestiniens le droit de rentrer chez eux. Nelson Mandela en Afrique du Sud ne prônait pas le droit des noirs à avoir leur propre Etat, mais simplement leur droit à être les égaux des blancs, c'est-à-dire one man one vote . Le droit au retour et à la sortie de chez soi devrait être reconnu, notamment pour les Gazaouis, pour pouvoir se soigner.
M. Daniel Seidemann : Je suis un patriote israélien. La création de l'État que je chéris tant a eu un rôle majeur dans la tragédie nationale du peuple palestinien, la Nakba. Il n'y aura donc pas de règlement définitif du conflit sans la reconnaissance de la responsabilité d'Israël dans cette tragédie. Mais ce péché originel ne signifie pas qu'Israël est un péché en soi. Bien entendu, le conflit ne se réglera pas non plus sans régler la ô combien douloureuse question des réfugiés et de leur droit au retour. Ardi, je ne me suis sans doute pas bien fait comprendre, Jérusalem n'est pas l'épicentre du conflit, mais les questions brûlantes du conflit sont des questions identitaires : les réfugiés palestiniens, leur droit au retour et Jérusalem. Il n'y aura pas de résolution de ces questions sans se confronter à celle des réfugiés. Il faudra un droit au retour en Palestine, des restitutions, des compensations, la relocalisation de familles. Mais je ne vais pas vous décevoir, il n'y aura pas de droit au retour massif en Israël parce que cela mettrait alors en péril la logique qui sous-tend la création de deux États. Car des centaines de milliers de Palestiniens retournant en Israël, cela crée un État binational. Le droit au retour devra donc être mis en oeuvre en compatibilité avec la logique sous-tendant la création de deux États. Je mentirais si je prétendais le contraire.
Question de la salle : Je pense que la société civile en Israël a le pouvoir d'imposer une solution au conflit, et que d'elle seule viendra cette solution. Comment faites-vous, Monsieur Seidemann, Madame Ben Nun, pour le faire comprendre aux Israéliens ?
M. Daniel Seidemann : Pour être honnête nous ne nous débrouillons pas très bien ! Pour moi, il y a un plus grand obstacle encore à la résolution de ce conflit que les seules colonies : ce sont les cafés et les centres commerciaux de Tel Aviv. Les Israéliens boivent leur cappuccino au bord du cratère d'un volcan et ne s'en rendent pas compte. Si vous vous rendez à Ramallah, vous observerez alors un profond désespoir car la politique ne marche pas, et nous n'avons pas avancé d'un pas vers la fin de l'occupation. À ce désespoir palestinien, il faut opposer le déni à un stade clinique des Israéliens. Les Israéliens ont besoin de doses croissantes de réalité pour comprendre ce qui se passe chez eux. Et c'est pourquoi je soutiens pleinement l'étiquetage des produits des colonies. Nous, Israéliens, devrions écouter nos amis car nous sommes en train de nous engager sur la voie du suicide. Nous sommes en train de nous détruire, et nos amis ne nous rendent pas service en nous laissant faire. Les vrais amis ne laissent pas leurs amis prendre le volant ivres. Nous devons entendre que nous aurons des comptes à rendre si nous poursuivons l'occupation. Ce n'est pas en boycottant les produits de Ahava, de Sodastream, ou le sel de la mer Morte que cela fonctionnera. Toutes les organisations et sociétés israéliennes devraient être mises au pied du mur, en indiquant que si d'ici un ou deux ans (et cela inclut les banques Leumi et Hapolim) elles continuent à se rendre complices de l'occupation, elles ne pourront plus faire d'affaires en Israël. Nous avons besoin d'un processus politique crédible. Si les choses vont si mal, c'est qu'il n'y a plus d'horizon politique. Je suis engagé depuis 25 ans et c'est la première fois que nous sommes arrivés à ce stade de refus d'engagement de la communauté internationale, et des États-Unis en particulier. Quand je fais le tour des capitales européennes, je constate que les gouvernements s'en remettent à un leadership américain qui n'existe pourtant plus. Le centre de gravité se déplace vers l'Europe et nous avons besoin de votre engagement. Si vous prenez vos responsabilités, vous verrez alors que les forces modérées en Israël se relèveront. Nous sommes des gens bien, mais nous avons besoin d'un second souffle. Thomas Jefferson a dit un jour que l'esclavage était semblable à empoigner un loup par les oreilles : vous êtes terrifié de le tenir ainsi mais craignez de le relâcher. La plupart des Israéliens sont terrifiés face à la situation actuelle mais craignent de lâcher l'occupation. Nous ne pourrons nous en sortir seuls, nous agirons, nous agirons, mais avec de l'aide. Je vous remercie.
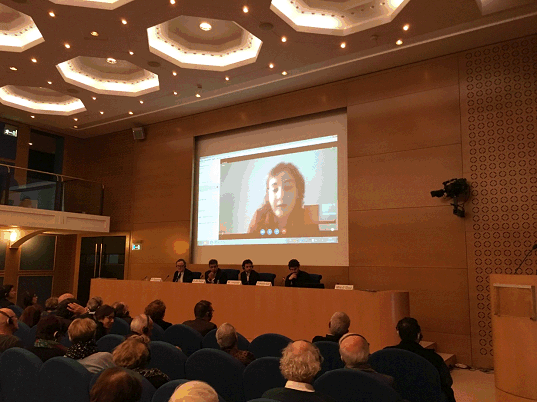
Allocution de Mme Asma Al Ghoul depuis Gaza
II. ÊTRE ENFERMÉ À GAZA
Mme Asma AL GHOUL, blogueuse, journaliste et activiste féministe palestinienne vivant à Gaza
M. Benjamin Sèze : Merci beaucoup, Monsieur Seidemann, pour ces éclairages très intéressants. Nous devons poursuivre notre après-midi car nous sommes attendus. Nous allons nous pencher sur une question plus spécifique déjà évoquée ce matin avec M. Daniel Seidemann, à savoir la vie quotidienne en Territoires occupés. Pour ce faire, nous avons rendez-vous via Skype avec Mme Asmaa Al Ghoul qui, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, n'a pas eu l'autorisation de sortir de Gaza. C'est donc par vidéo-conférence que nous allons communiquer avec elle. Mme Asmaa Al Ghoul est blogueuse, journaliste et militante féministe palestinienne à Gaza.
Mme Asma Al Ghoul : Bonjour, et merci de m'avoir invitée à cette conférence, à Paris. Je vais m'exprimer en arabe car je m'exprime avec plus d'aisance dans cette langue.
On m'a demandé de parler de mon quotidien à Gaza. Je ne sais pas exactement ce que je suis censée dire de ce quotidien. Mais ce que je constate, c'est que le désespoir est devenu le sentiment le plus répandu autour de moi. Lorsque le sourire déserte les visages des passants dans la rue, lorsque l'on voit les destructions autour de soi, il ne peut y avoir de reconstruction. Il ne peut y avoir de reconstruction tant que les États du monde ne décideront pas de soutenir cette population. Tout ce que nous faisons est d'attendre. Nous attendons la reconstruction, nous attendons des sourires, nous attendons des voyages, nous attendons l'opportunité d'une vie normale à Gaza.
Tout ce que nous avons essayé de construire pendant des décennies en tant que journalistes, activistes ou institutions, en termes de développement, de vie culturelle et sociale, a disparu en un clin d'oeil à la suite de trois guerres. Je ne reconnais plus la rue que je connaissais si bien. Mes repères changent au gré des guerres et de leurs fins. Je suis une réfugiée, et j'ai été élevée dans le camp de Rafah que j'ai longtemps considéré comme mon « point d'ancrage ». Les bombes israéliennes y ont rayé tout ce que nous, réfugiés, avions connu : les visages, les proches, les édifices, les rues...
Comment demander aux gens de sourire lorsque la pauvreté touchait à la fin de l'année 2014 38% de la population, et le chômage 44%, selon les chiffres du Centre Palestinien pour les Droits de l'Homme? Comment sourire lorsque 25 000 voyageurs sont en suspens, des étudiants, des malades, qui ne peuvent quitter la bande de Gaza ? Comment sourire alors qu'il y a plus de 10 000 maisons détruites ? Et enfin, comment sourire si l'horizon le plus lointain que nous pouvons contempler est celui de la mer de Gaza, sauf si une embarcation israélienne vient nous boucher la vue.
Ici, personne ne peut sourire, car le désespoir est notre unique épidémie. Je suis journaliste et je suis mère, je connais toutes les tragédies politiques et sociales. Comment écrire la paix et y élever mes enfants alors qu'ils grandissent au seul son de la guerre ? La guerre, le blocus, les divisions internes ; ils n'ont jamais vu la paix. Comment pourront-ils en connaître le sens ? Je ne parle pas que de mes enfants, je parle des jeunes générations autour de moi.
Je ne vous parlerai pas ici de Gaza assiégée et des résultats de ce blocus, des entrepôts de médicaments vides ou la dépendance des citoyens aux produits israéliens, car c'est ce que l'on raconte toujours de nous. Je veux vous dire comment les habitants d'une ville de plus de deux millions d'habitants ne croient plus qu'il y a encore de la lumière au bout du tunnel. Si vous avez la malchance d'être un pêcheur de Gaza et que vous allez au-delà de 3 km du rivage, soit moins que les 10 km sur lesquels Israéliens et Palestiniens s'étaient entendus, il y a des chances pour que vos filets, votre embarcation, ou vous-même, soient atteints par les balles israéliennes, selon l'humeur des soldats. Si vous avez la malchance d'avoir des terres agricoles sur la frontière israélienne, il y a une forte probabilité que les chars israéliens vous empêchent de les atteindre, après avoir arraché vos oliviers. Et si vous voulez chasser le moineau, aux confins des collines orientales, il est plus probable que vous vous fassiez chasser par les soldats israéliens, plutôt que vous ne chassiez vous-même les oiseaux.
Je souhaite être la plus sincère possible et ne pas répéter de slogans. L'empathie avec les victimes exige l'abandon de beaucoup de convictions, comme les idéologies, les nationalismes... Je ne veux pas susciter votre compassion en comparant la perte de la famille de mon oncle pendant l'été 2014 par un obus israélien dans le camp de Rafah, à la perte de vos proches lors des attaques de Paris (du vendredi 13 novembre 2015, NDLR). Vous avez fait l'expérience depuis quelques semaines du sentiment de la perte, de la terreur, de la peur de se faire tuer. Je voudrais seulement vous dire que les villes (Paris, Gaza, le Yémen, la Syrie, Beyrouth) peuvent devenir amies dans la douleur. La souffrance humaine quotidienne est le tribut payé aux conflits pour le pouvoir, pour la religion, ou pour l'argent.
Comment garantir à l'enfant qui a perdu sa mère à cause d'une bombe à Gaza, ou au Yémen, ou à Beyrouth, ou en France, qu'il ne grandisse pas dans la haine ? Ou qu'il puisse croire aux droits et à l'acceptation de l'autre, ou qu'il ne développe pas un complexe de victime ? Je croyais que l'expérience de la guerre et de la souffrance commune pouvait supprimer les différences entre les hommes, mais après chaque conflit, après chaque guerre, nous sommes en proie à toutes sortes de phobies. Les idéologies, les partis, mais aussi nos complexes nous séparent. Des phobies se développent : la phobie de l'islam, de l'occupation, de l'Occident. Quand arriverons-nous au moment où notre différence marquera notre vitalité et ne portera plus le signe de la haine et de la rancoeur ?
Je ne nie pas qu'en tant que journaliste laïque, je diffère beaucoup de mon environnement. Je dois sans cesse me justifier, me défendre, que ce soit vis-à-vis d'une société conservatrice, ou vis-à-vis du gouvernement du Hamas, dont je ne partage pas le programme social, islamiste. Mais je ne suis pas la seule dans ce cas. Nous sommes des centaines, à Gaza et en Cisjordanie en désaccord avec le principe de coordination sécuritaire avec Israël à Ramallah et avec la suppression des libertés individuelles à Gaza par le gouvernement du Hamas. Nos désaccords ont disparu en l'espace de ces trois guerres, car nous étions tous sous la pression de la machine de guerre israélienne, comme si nous nous trouvions dans la colonie pénitentiaire de Kafka.
Je dirais simplement que les gens de Gaza pourraient retrouver leur sourire si le monde comprenait davantage leur douleur, si le monde comprenait que ma petite ville a perdu l'espoir et qu'elle a besoin de le retrouver. Si nous voulons que les âmes des 4000 victimes des trois guerres et celles des centaines que nous avons perdues lors des attaques de Paris reposent en paix, si nous décidons de partager ce monde sur les bases du droit, de la justice et de la paix, loin des intérêts des politiciens, des hommes de religion, loin des armes et de l'argent, et leur asservissement de l'humanité, alors nous serons libres.
Merci

Mme Hala Abou-Hassira, Conseillère politique et M. Nasser Jadallah, Premier conseiller de l'Ambassade de Palestine en France
III. VIVRE SOUS OCCUPATION EN ZONE C
MM. Jehad ABU HASSAN et Gaël LEOPOLD, ONG Première Urgence Internationale
M. Benjamin Sèze : Je vais maintenant donner la parole à Messieurs Gaël Léopold et Jehad Abu Hassan, de l'ONG Première Urgence Internationale. Ils vont nous parler respectivement de la situation humanitaire dans les territoires et de l'accès à la terre dans la bande de Gaza.
M. Gaël Léopold : Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir invités à nous exprimer ici. Je suis le chef de mission de Première Urgence Internationale en Territoires palestiniens occupés. Première Urgence Internationale est une ONG française qui existe depuis plus de 20 ans, qui n'est ni politique ni religieuse, et l'objet de notre propos aujourd'hui est justement d'essayer de rester dans le cadre de notre mandat humanitaire. M. Jehad Abu Hassan est notre coordinateur terrain à Gaza ; il vous parlera du quotidien à Gaza en général, dont vous avez déjà eu un aperçu, et il abordera plus spécifiquement ce qu'on appelle la zone d'accès restreint dans la bande de Gaza.
M. Jehad Abu Hassan : Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le Sénateur Gilbert Roger et son équipe, qui m'ont aidé à sortir de la bande de Gaza et à venir jusqu'ici pour vous voir ce qui, comme vous l'avez compris, n'est pas chose aisée. Lorsque nous devons quitter la bande de Gaza, nous devons non seulement avoir un permis côté israélien, mais également un permis émis par l'Autorité à Gaza et, enfin, un permis côté jordanien. Parfois, on a bien l'un mais pas l'autre, donc c'est compliqué. Cette situation pose beaucoup de problèmes aux habitants de Gaza, notamment parce que le point de passage de Rafah vers l'Égypte est fermé. Les autorités égyptiennes ouvrent le passage tous les deux, trois mois pour un ou deux jours, permettant en général le passage d'au maximum 1 000 personnes, alors qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui attendent. Je vis à Gaza, je suis né à Gaza, je suis de Gaza, mes parents sont originaires d'un autre village à côté d'Ashkelon et je travaille à Gaza depuis 5 ans maintenant avec Première Urgence Internationale. Notre travail est surtout axé sur l'aide aux fermiers qui se trouvent dans la zone d'accès restreint. Ce matin, pendant la présentation de M. Imseis, vous avez pu voir une carte de la bande de Gaza qui montrait également que la zone accessible aux pêcheurs palestiniens était réduite, selon la volonté des autorités israéliennes, à 6 milles nautiques, mais en réalité, les pêcheurs ont beaucoup de difficultés au-delà de 3 milles nautiques. En ce qui concerne l'accès à la terre, que je vais traiter maintenant, la zone de non-construction et de non-accès était distante de 50 mètres de la frontière à l'époque du processus d'Oslo, puis elle s'est élargie jusqu'à constituer une bande de 300 mètres de large. Ce sont des « zones d'exclusion » ( no go zones ), indiquées en rouge sur cette carte. Les fermiers notamment ne peuvent pas y travailler et, de 300 à 1 500 mètres, l'accès est risqué. Dans les faits, la zone d'exclusion s'étend jusqu'à 500 mètres. Dans le village de Khuza'a, dans le gouvernorat de Khan Younès, dans le Sud de la bande de Gaza, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) veille aussi, en coordination avec les autorités israéliennes, à laisser passer quelques fermiers pour pouvoir cultiver leur terres dans la zone de 300 mètres.
La zone d'accès restreint représente pratiquement 35% de la terre arable à Gaza. Le ministère de l'agriculture estime les pertes résultant de cette situation à près de 60 millions de dollars chaque année. M. Duquesne disait tout à l'heure que le secteur agricole pouvait soutenir l'économie palestinienne. Malheureusement, il est très touché, particulièrement depuis la dernière guerre de Gaza : ces 51 jours ont été très dévastateurs, notamment dans cette zone à accès restreint du fait du passage des chars israéliens. L'opération terrestre, qui a eu lieu au mois de juillet 2014, n'a rien épargné, ni les infrastructures, ni les puits, ni les cultures. C'est donc une perte très conséquente pour les fermiers palestiniens. Cela s'ajoute à la situation économique, qui est déjà très difficile à cause du blocus qui restreint les possibilités d'exporter ou d'importer des biens. La fermeture de tunnels côté égyptien a également eu des conséquences : les fermiers vivant dans la zone à accès restreint ont été obligés, par exemple, de changer de type de culture car ils n'ont plus le droit de cultiver des cultures qui ont une hauteur de plus de 80 cm. Ils n'ont pas le droit d'investir, de construire des infrastructures, de réparer les puits. C'est donc un problème aussi lié à l'accès à l'eau pour l'irrigation. Ils ont interdiction d'aller cultiver leurs terres avant le début de la journée. Ils doivent partir dès que la nuit tombe. Les fermiers sont souvent sous le feu de coups de sommation et on dénombre parfois des blessés. Après la guerre de 2012, la guerre de 8 jours, les autorités israéliennes ont annoncé que les fermiers pourraient désormais aller jusqu'à 100 mètres de la clôture et cultiver leur terre. Après deux mois, ils ont changé d'avis en décrétant qu'ils devraient maintenant aller jusqu'à 300 mètres. Officiellement, il n'y a pas de dessin réel de la zone à accès restreint. Les Israéliens ne sont pas clairs là-dessus. D'après l'agence des Nations Unies pour les Droits de l'Homme en Palestine en 2013, 60 personnes ont été blessées dans ces zones. Sur les 60 personnes blessées, 9 étaient des fermiers. Ces pressions économiques affectent aussi toute la famille : la violence se développe au sein de la famille, il y a des conséquences sur le genre, le mariage précoce. Et les enfants sont parfois obligés de quitter l'école pour pouvoir aider leur famille économiquement. Comme vous le savez, 80% des Gazaouis vivent de l'aide humanitaire. On observe également que les gens consomment de plus en plus de nourriture de mauvaise qualité. Certains sont aussi contraints à manger en plus faible quantité ou à se séparer de certains effets personnels afin de subvenir à leurs besoins. Les gens font face à des difficultés car leurs dettes s'accumulent. C'était l'accès aux terres qui permettait de générer un revenu convenable pour la population. Avant la Première Intifada de 1987, étaient alors exportés beaucoup de produits agricoles palestiniens vers Israël, la Cisjordanie et la Jordanie. Les fermiers sont aujourd'hui confrontés à des difficultés quotidiennes. Ils risquent leur vie chaque jour lorsqu'ils tentent d'accéder à leurs terres pour les cultiver.
Notre association, Première Urgence, les aide. Nous avons aidé un paysan possédant une terre à l'Est de la ville de Khan Younès. Nous lui avons donné, après la guerre de 2012, des engrais, des réseaux d'irrigation, des semences et également une formation technique. Il a pu cultiver sa terre et tout allait bien. Après la guerre de 2014, ses cultures ont été arrachées, ses réseaux d'irrigation aussi. Même si cette personne pouvait générer un revenu en cultivant sa terre, la guerre est revenue et tout est perdu à nouveau. C'est malheureusement le cas d'environ 70% des fermiers que nous avions aidés. Avec trois guerres en trois années, la situation à Gaza est catastrophique.
M. Benjamin Sèze : Merci Monsieur Abu Hassan, je vous propose qu'on passe à l'exposé de votre collègue Monsieur Léopold qui va dresser un portrait complet de la situation sur l'ensemble des Territoires palestiniens et nous passerons ensuite aux questions.
M. Gaël Léopold : Avant de vous parler de la Cisjordanie, je voudrais rajouter quelques mots sur Gaza. La guerre de l'an dernier a détruit environ 17 500 maisons et mis à la rue 100 000 personnes. Un an après, ce que nous constatons sur le terrain est validé par les chiffres des institutions autorisées pour en parler. La reconstruction n'a toujours pas lieu. Il s'agit d'une conséquence directe du blocus malgré la tentative de mettre en place le GRM (Gaza Reconstruction Mecanism), un système tripartite entre le gouvernement israélien, le gouvernement palestinien et les Nations Unies, qui ne fonctionne pas. Les Israéliens éditent une dual used items list , une liste d'articles à utilisation double qui peuvent avoir non seulement une utilisation civile mais également une utilisation militaire. Dans cette liste, vous trouvez absolument tout, par exemple des billes d'acier de plus de 6 mm de diamètre, des poteaux en bois d'un certain diamètre ou d'une certaine résistance, des ciments d'un certain type etc. Cela réduit considérablement l'approvisionnement en matériaux de construction.
Depuis quelques mois, on peut seulement observer la reconstruction de quelques maisons. C'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins gazaouis actuels. Ceci est véritablement une conséquence directe du blocus. Pour rendre concret ce qu'est le blocus pour la population palestinienne, voici un exemple que m'a donné un collègue qui était à Rafah. Il m'a raconté qu'il essayait de passer les checkpoint s en utilisant son réseau. Il m'a ensuite dit : « J'ai abandonné quand, à côté de moi, une personne qui avait développé une gangrène à la main, en était à sa sixième tentative de passage. C'était désormais une amputation du bras qui l'attendait ». C'est la réalité du blocus. C'est de ça dont on parle concrètement. Pour passer côté Cisjordanie, ce n'est pas forcément de meilleures réjouissances. Un de nos bailleurs principaux m'a dit, quand je suis arrivé à Jérusalem : « il n'y a pas de crise humanitaire en Palestine ». Je suis un peu l'actualité et j'étais déjà en poste sur place voici une quinzaine d'années. J'ai quand même été assez étonné par cette assertion. Je comprends qu'il plaçait la Palestine dans un contexte global en la comparant à la Syrie, à l'Irak. Effectivement, si on compare à ces crises humanitaires, la crise humanitaire en Palestine est très différente. Mais il y a une réalité humanitaire en Palestine qui est très diverse. À Ramallah, l'économie est relativement florissante avec un taux de croissance décent, autour de 3,5% cette année. Cependant, dès que vous sortez de Ramallah et que vous allez dans les petits villages du Nord de la Cisjordanie ou du Sud, qui sont constamment encerclés par les colonies, la situation est absolument différente. Il y a des zones rurales, des zones urbaines et ensuite il y a ce qu'on appelle la zone C. Ce matin nous vous avons montré sur la carte que la zone C représente à peu près 62% de l'intégralité de la Cisjordanie. Et dans ces 62% on retrouve à peu près 530 lieux d'habitation. Il s'agit de contextes ruraux, semi-ruraux. Cela représente jusqu'à 300 000 personnes. Les chiffres ne sont pas clairs et varient entre 180 000 personnes et 300 000 personnes qui vivent en zone C. Et dans cette même zone, on compte entre 335 000 et 350 000 colons israéliens. Comme vous pouvez le voir sur la carte, la zone C s'étend essentiellement dans la vallée du Jourdain mais pas seulement. C'est une zone qui, en fait, morcelle complètement la Cisjordanie, même dans la partie Ouest. Les zones A et B sont souvent des îlots perdus dans un océan de zone C. Il n'y a donc pas de continuité administrative ou territoriale entre les différentes zones A et B qui constituent la Cisjordanie. Dans la zone C, les communautés font face à des frustrations, des restrictions, imposées par le gouvernement israélien. Il n'y a, pour ainsi dire, aucun permis de construire délivré aux Palestiniens. Il me semble que seulement 3% des demandes de permis de construire sont approuvées par l'autorité israélienne. On constate des restrictions d'accès aux terres, que cela soit des terres agricoles ou des terres de pâturage. Dans ces zones-là, l'économie est essentiellement agricole et souvent basée sur l'élevage. L'accès aux terres de pâturage est donc restreint. Les restrictions portent sur tout type d'infrastructure, que ce soit des écoles, des maisons ou des abris pour les animaux. Dès que vous construisez un glacis de béton et de parpaings, il faut une autorisation. Si c'est fait sans autorisation, le risque est qu'à terme la structure soit détruite par Israël. Plusieurs éléments font que les populations qui vivent dans la zone C ont une perspective de développement quasiment inexistante. Leur perspective est plutôt une perspective de redéveloppement.
On parle beaucoup en ce moment de 46 communautés de Bédouins. Je parle ici de Bédouins sédentarisés qui historiquement pouvaient être des Bédouins nomades. Ils sont installés dans des structures assez éphémères, des maisons en tôle construites avec du bois, du plastique. Ce sont des maisons très rudimentaires. Ces 46 communautés risquent un transfert forcé, f orcible transfer , qui est défini dans la Convention de Genève comme étant, potentiellement, un crime de guerre. Ces populations sont menacées d'un transfert car elles gênent le développement des colonies israéliennes. Effectivement, elles sont souvent localisées à proximité de colonies, elles reçoivent donc régulièrement des ordres de démolition ou des ordres d'arrêt de travail. Ces ordres de démolition sont accrochés dans les arbres ou laissés sous une pierre avec un délai pour y répondre. Souvent, les personnes concernées ne découvrent que trop tardivement ces ordres qui permettent à l'autorité israélienne de venir et de détruire les structures concernées. On compte 459 structures qui ont été démolies entre le 1 er janvier et le 30 septembre de cette année 2015. Cela inclut, comme je le disais tout à l'heure, des maisons mais aussi des abris pour animaux, pour les outils etc. Ceci incite forcément la population concernée à partir. Nous pouvons alors parler de transferts forcés. D'après les Nations Unies, environ 6 000 personnes se sont déplacées depuis 2008. Ces déplacements ne se font pas manu militari puisque les Israéliens ne les poussent pas physiquement à partir mais ils les y incitent fortement puisqu'il n'y a plus de moyens de subsistance à l'endroit où ces personnes étaient installées. Du fait de leur déplacement vers les zones A et B, les personnes libèrent des terres qui sont ensuite accaparées par Israël. Parfois Israël propose des lieux de relocalisation qui ne correspondent pas du tout aux standards culturels ou traditionnels de la population. Bien sûr, ces lieux ne répondent pas à la problématique des moyens de subsistance puisque ces personnes qui vivaient de leurs terres sont démunies de moyens de subsistance lorsqu'elles se retrouvent en ville.
Je vais vous donner un exemple très concret. Dans une communauté qui s'appelle Al Hadidiya, dans le nord de la vallée du Jourdain, vivent 82 personnes dont 35 enfants, dans 13 maisons. La communauté n'est ni connectée à l'eau ni à l'électricité, et sa principale source de revenu est le pâturage, l'élevage. Un des représentants de la communauté disait déjà en 2011 que d'après lui, depuis 1997 et à la suite de toutes ces restrictions qui sont imposées sur sa communauté, environ 40 familles ont quitté la communauté pour aller s'installer en zone A et B, ou ailleurs, afin d'essayer d'avoir une vie un peu plus décente et un meilleur futur. La semaine dernière, les ordres de démolition qui avaient été petit à petit délivrés dans cette communauté ont été en partie mis à exécution. Israël a détruit 14 structures dans la communauté et, de fait, 15 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile pour aller s'installer ailleurs. Une des réponses que nous apportons à travers un consortium d'ONG est une réponse en termes d'hébergement. Nous fournissons, bien que cela puisse sembler dérisoire, des caravanes, des mobil-homes, des tentes pour que ces personnes restent sur place et éviter qu'elles ne partent trop loin afin qu'elles ne libèrent pas complètement la terre. Cela peut être une solution temporaire pour leur permettre de réagir et de reconstruire pour rester sur place. C'est absolument dérisoire et, à terme, la situation se répète : cette communauté a déjà subi des destructions dans le passé. Il y en a eu l'année dernière et il y en en aura forcément dans le futur. Nous aidons, et Israël revient démolir ce qu'on avait installé la veille ou l'avant-veille avec le consortium d'ONG. C'est la réalité de la vie dans la zone C de Cisjordanie.
Je voulais ensuite évoquer le problème de la violence des colons. C'est une thématique sur laquelle nous travaillons énormément et qui impacte fortement la population palestinienne, pas uniquement en zone C mais aussi en zone A et B. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si vous habitez en zone B, vos terres sont souvent situées en zone C. C'est là que vous avez vos animaux, vos oliviers, une partie de votre héritage culturel et familial. On a pu observer la violence des colons avec ce qui s'est passé le 31 juillet 2015 à Douma. Elle peut se concrétiser par du harcèlement, de l'intimidation. Par exemple, cela peut être un colon qui passe avec son quad tous les vendredis matin à pleine vitesse à travers un village pour faire peur à tout le monde. Bien sûr, il est souvent armé. Cela peut prendre la forme d'attaques physiques concrètes, comme on l'a vu à Douma où des cocktails Molotov, lancés dans une maison, ont provoqué la mort de trois personnes dont un bébé de 18 mois. Cela peut aussi prendre la forme de champs brûlés, de champs de céréales qui étaient prêts pour la récolte notamment, cela peut être le déracinement d'oliviers, etc.
On recense depuis le début de l'année 210 attaques de colons en Cisjordanie, ce qui incite la population concernée à se réfugier à l'intérieur des zones B et A en libérant ainsi l'espace pour un accaparement éventuel du gouvernement israélien, essentiellement pour des raisons d'extension de la colonisation. Je vais terminer avec un dernier point sur cette violence des colons. Une de nos collègues de Yesh Din , une ONG israélienne de défense des droits de l'homme, a enquêté sur les plaintes déposées par les victimes de violences de la part des colons israéliens. Lorsqu'un Palestinien est sujet à des attaques de colons israéliens, il doit se rendre dans l'équivalent d'un commissariat pour porter plainte. Or, le commissariat se trouve dans la colonie, il est donc compliqué de s'y rendre car les gens ne sont pas forcément autorisés à entrer dans la colonie. L'ONG Yesh Din est à l'origine des chiffres suivants.
91,6% des dépôts de plainte des victimes ne débouchent ni sur l'ouverture d'une enquête, ni sur une mise en examen. Sur les 8,4% restant, il y a seulement 1,9% de l'ensemble des plaintes qui débouchent sur une condamnation. Ces chiffres font état de l'échelle de l'impunité dont jouissent les colons israéliens en Cisjordanie. La situation humanitaire que connaît la Palestine n'est pas celle de la Syrie, de pays africains, ou de l'Irak. Cependant, il y a assez de restrictions dans les déplacements, dans les conditions économiques, pour que, dans ce pays qui pourrait fleurir économiquement, et je suis toujours aussi sidéré de voir que malgré tout ils arrivent à développer leur économie, 27% de la population vive en situation d'insécurité alimentaire. La population ne meurt pas de faim, mais elle est en situation d'insécurité alimentaire, ce qui signifie que le moindre aléa climatique, le moindre problème comme un champ brûlé, peut amener une famille à être complètement dépendante de l'assistance alimentaire internationale.
L'accumulation de tous ces facteurs fait qu'entre 2008 et aujourd'hui, 6 000 personnes ont laissé leur terre, leur maison, leur terrain pour se mettre en sécurité et essayer de se construire un avenir meilleur.
M. Benjamin Sèze : Merci beaucoup pour ces deux exposés très intéressants et très éclairants. Nous allons maintenant passer aux questions, avant la troisième table ronde.
Question de la salle : Bonjour, je m'appelle Françoise Guiche, je milite au sein de l'association Amitié Palestine Solidarité et Échange Solidarité. On le sait, dans tous les conflits, les premières victimes sont les femmes et les enfants. Le 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté, à l'unanimité, la résolution 1325 sous la pression d'ONG. Cette résolution préconise la protection des femmes et des petites filles. Elle porte sur le genre, c'est donc une première, et sur la place des femmes dans la construction de la paix, dans les institutions représentatives, et sur la poursuite des crimes contre l'humanité commis par les pays. Les femmes palestiniennes, qui subissent des agressions, des kidnappings, des violences de la part des colons, ne cessent d'interpeler M. Ban Ki-moon pour l'application de cette résolution. Madame Fadwa Kheder, une des dirigeantes nationales du PPP, Parti du Peuple Palestinien, a profité de son séjour en septembre 2014 pour interpeler des élus et des associations, pour qu'on aide ces femmes à faire appliquer cette résolution, ce qui ferait aussi avancer la cause des femmes dans le monde entier. C'est ainsi que Madame Laurence Cohen, sénatrice du Val-de-Marne, a eu l'idée de créer un collectif Palestine Femme Paix et Sécurité, qui réunirait des associations et des élus, pour populariser cette thématique et lancer une pétition à l'adresse de M. Ban Ki-moon. Cette pétition a été signée dans un premier temps par 100 personnalités françaises et étrangères de différentes composantes politiques, des artistes, des scientifiques. Nous avons organisé une conférence de presse, seul le journal L'Humanité et la chaîne Public Sénat y ont assisté. Je vous invite donc, en sortant de la salle, à signer cette pétition. Nous espérons pouvoir faire avancer la cause des femmes à Gaza, en Palestine et partout dans le monde.
Question de la salle : Une question très simple et très rapide. Il y a un problème d'accès à l'eau potable en zone C, qui pose un réel problème de crime contre l'humanité. On n'a pas le droit de priver une population d'eau potable. Les gens réclament à boire parce qu'ils n'en ont pas.
M. Gaël Léopold : J'ai vu le même documentaire sur Arte il y a quelques semaines de cela. Pour prolonger votre propos, sachez qu'Israël, selon les accords d'Oslo, a contrôle et autorité, à la fois sur la surface, sous la surface, et dans l'espace aérien des Territoires palestiniens occupés. À partir du moment où l'on sait qu'il y a des nappes phréatiques tout à fait intéressantes en Cisjordanie, notamment du côté du Nord-Ouest, si un village souhaite creuser un puits (en Israël), cela était impossible il y a une dizaine d'années, et cela reste aujourd'hui une opération quasi-impossible.
Question de la salle : Bonjour, ma question concerne l'impact qu'ont pu avoir les changements politiques en Égypte sur la vie des Gazaouis, c'est-à-dire l'arrivée du Maréchal Sissi au pouvoir, et la présence de sympathisants de l'État Islamique au Nord du Sinaï. Comment ces changements ont-ils impacté la vie des Gazaouis depuis 3 ans ?
M. Jehad Abu Hassan : Je pense qu'il y a eu des conséquences, notamment après la fermeture des tunnels à Gaza. En réalité, malheureusement, des gens qui, par exemple, cultivaient leurs terres, ont, à un moment donné, pour des raisons économiques, été obligés de chercher un autre travail. On pousse ces gens à abandonner leurs terres. D'après une organisation des droits de l'Homme palestinienne, à peu près 30 000 personnes travaillaient dans les tunnels. Cela compte beaucoup pour l'économie de Gaza, et notamment dans le Sud. Cela se ressent également dans les sorties de Gaza. Les gens pouvaient plus facilement sortir via l'Égypte. Aujourd'hui, c'est pratiquement fermé. Il y a une semaine, à peu près 1 000 personnes sont sorties. Ces gens-là ont dû payer les autorités, pour pouvoir sortir, alors que ceux qui attendaient ne le pouvaient pas. Il y a beaucoup plus de difficultés à cause de la fermeture de tunnels. Avant aussi, les produits qui passaient à Gaza via la contrebande étaient moins chers. Si je prends l'exemple de l'essence, le litre coûtait 2,2 shekels, désormais sans cet approvisionnement la population ne peut plus qu'acheter le fuel israélien qui coûte environ 7 shekels le litre. Pour y remédier, les Gazaouis commencent à utiliser des bouteilles de gaz à la place de l'essence. Cela représente un risque pour leur vie. On entend également que, pour en finir avec les tunnels, les autorités égyptiennes ont commencé à pomper l'eau de la mer et à inonder les tunnels restants. Cela a un impact certain sur l'environnement. Déjà, l'eau à Gaza a un taux de salinité très important. Avec ce type de pratique, je pense qu'il y aura encore plus de problèmes.
Question de la salle : Bonsoir, on manque d'eau à Gaza, or au Liban, il y a des sources sous-marines d'eau potable. Est-ce que la France pourrait aider à faire un projet, si le gouvernement libanais était d'accord, de transfert de cette eau par un tuyau sous-marin jusqu'à Gaza, pour l'agriculture et l'eau potable ? La France défendrait-elle le point de vue juridique que ceci est compatible avec les accords d'Oslo ? Deuxièmement, j'étais à Gaza en 1994, après avoir pris contact avec un fabriquant de jus d'orange et avec la compagnie CMA CGM, grand transporteur à l'époque. J'avais fait un essai démontrant que les oranges mises dans un filet en plastique flottent juste en-dessous du niveau de la mer tout en étant préservées. Cela était très bien pour faire du jus de fruit. J'avais aussi vu le président de l'association des pêcheurs. J'avais donc pensé que les pêcheurs ramassent les oranges et, avec la coopérative, aillent jusqu'à la limite de la mer territoriale, lâchent ces oranges en mer au moment où les courants les emmènent. Un bateau privé serait chargé de récupérer ces oranges avec une grue pour les emmener puis les vendre. Une centaine de journalistes étaient prêts à faire cela, mais malheureusement le président de la coopérative était à Londres. Est-ce que la France y consentirait ? Je pense qu'elle doit prendre des risques juridiques pour faire appliquer le droit en faveur des exportations palestiniennes. Cela serait très symbolique.
M. Gaël Léopold : Je ne me prononcerais pas pour la France, mais concernant les oranges, je vous invite à regarder le documentaire L es 18 fugitives , sur une expérience d'autonomisation par rapport à une occupation menée pendant la Première Intifada à Bethléem. Des Palestiniens ont fait venir des vaches dans leur village, leur permettant d'avoir du lait et de ne pas acheter de lait israélien. Le gouverneur israélien a dit que ces vaches représentaient un danger pour l'État d'Israël. Je pense donc que les oranges en question risquent fortement d'être taxées de la même manière.
M. Benjamin Sèze : Merci Messieurs, nous allons passer à la troisième table ronde qui va porter sur le regard de la société israélienne.

MM. Jeff Halper et Yehuda Shaul
TROISIÈME PARTIE - LE REGARD DE LA SOCIÉTÉ ISRAÉLIENNE
I. LE REGARD D'UN SOLDAT
M. Yehuda SHAUL,
Directeur des relations
internationales de l'ONG
Breaking the Silence
M. Benjamin Sèze : Nous allons maintenant entendre M. Yehuda Shaul. Ancien soldat israélien ayant servi dans les Territoires occupés, il a fondé en 2004 l'association Breaking The Silence , dont le but est de faire témoigner les jeunes Israéliens, qui ont servi dans ces Territoires, sur les exactions qu'ils ont commises au nom d'Israël. Cette association a publié plusieurs livres, dont Le livre noir de l'occupation israélienne , paru en français en 2013, qui regroupe 145 témoignages de soldats sur leur quotidien de violence ordinaire et de tension permanente. En 2015, 115 témoignages ont été rendus publics concernant cette fois-ci des faits commis à Gaza pendant l'opération « Bordure protectrice ».
M. Yehuda Shaul : Je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre invitation, c'est un grand honneur d'être ici. Si vous le permettez, je voudrais dire quelques mots concernant mon parcours et l'association Breaking The Silence , et je voudrais dresser un tableau plus large de la situation, dépeint dans l'ouvrage qui vient d'être cité.
Je m'appelle Yehuda, j'ai 32 ans, je vis à Jérusalem, je suis juif orthodoxe, et j'ai grandi dans ce que l'on pourrait appeler la droite politique. La droite et la gauche en Israël n'ont rien à voir avec la droite et la gauche d'ici ni avec des choix de politique économique et sociale : il s'agit de l'occupation et des colonies, du point de savoir si nous sommes pour ou contre. J'ai fait mes études dans les colonies en Cisjordanie, près de Ramallah, ma soeur est actuellement colon en Cisjordanie, mon cousin était colon à Gaza jusqu'en 2005 - voici d'où je viens. Une fois diplômé, je suis rentré dans les forces de défense israéliennes 7 ( * ) : en Israël, le service militaire obligatoire est d'une durée de trois ans pour les hommes et de deux ans pour les femmes. D'une bonne forme physique, je suis devenu soldat puis officier. J'ai fait mes trois années de mars 2001 jusqu'en mars 2004. J'ai passé deux ans de mon service en Cisjordanie, dont plus d'un an à Hébron, la ville palestinienne la plus importante de cette région, à l'époque du pic de violence de la Seconde Intifada, période en comparaison de laquelle les jours actuels sembleraient paisibles. Même si le milieu dans lequel j'ai grandi est celui de la droite israélienne, j'avais quelques doutes sur ce qu'on faisait. Mais lorsque l'on est soldat, on trouve un moyen de se convaincre qu'il faut avancer, on ne trouve pas de temps pour les doutes. On se dit qu'il y a des missions et des choses plus grandes et plus compliquées. Il y a aussi, surtout, les liens de camaraderie dans l'armée. Quelles que soient vos convictions politiques sur ce que vous êtes en train de faire, si c'est à vous de vous lever à cinq heures du matin pour remplacer votre copain qui termine son tour de garde à six heures, vous le faites. Plus tard, je suis devenu officier : plus de responsabilités, moins de temps pour penser. Quand on est officier, on sait que si on ne réfléchit pas, ce sont les cinquante soldats derrière soi qui vont réfléchir, et dans l'armée, c'est la dernière chose que l'on veuille voir se produire : cinquante personnes qui réfléchissent en même temps ne permettent pas d'avancer, en tout cas dans l'armée. À la fin de mon service militaire, j'étais officier, je n'avais pas grand-chose à faire, je pensais à mon avenir et pour la toute première fois, je me suis senti adulte et j'ai réfléchi à ma vie civile. Cela a été un tournant pour moi. J'ai pris du recul et je me suis regardé, et d'un seul coup les choses ont été différentes. C'est à ce moment-là que la terminologie militaire, la façon militaire de réfléchir, ma vision du monde jusque-là, ont perdu tout sens pour moi. Ce moment était très effrayant pour moi, car 90% de mes actions se trouvaient tout à coup dénuées de fondement et je n'avais plus rien pour me soutenir.
Je dirais que c'est ce sentiment très fort qu'il y avait un problème qui m'a amené à ma position d'aujourd'hui. Je ne savais pas quoi faire, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer comme je l'avais fait. Je me suis tourné vers mes camarades, vers mes supérieurs, vers des soldats qui étaient sous mes ordres, et j'ai commencé à parler de mes sentiments, de ce que je pensais, et j'ai compris rapidement que les autres pensaient la même chose ; quelque part dans notre tête, nous nous disions qu'il y avait un problème. C'est comme ça que Breaking The Silence est né. Nous avons commencé à discuter des choses que nous avions faites et vues, et nous avons réalisé qu'en Israël, chez nous, dans notre société, les gens ne savaient pas ce qu'il se passait. Les gens qui nous envoyaient « faire le boulot » ne savaient pas ce que cela voulait dire. Nous avons donc décidé « d'amener Hébron à Tel-Aviv », c'était notre slogan. Nous voulions que les citoyens sachent ce qui était fait en leur nom. C'est comme ça que nous avons commencé à rompre le silence le 1 er juin 2004 avec une exposition de photos sur notre vie à Hébron. Cela se poursuit aujourd'hui. Nous faisons deux choses : la première, qui est au coeur de notre travail, est de recueillir des témoignages de soldats et d'ex-soldats qui parlent de leurs missions ; nous avons déjà enregistré plus de 1 000 femmes et hommes qui ont servi depuis le début de la Seconde Intifada, en 2000, jusqu'à aujourd'hui. Nous vérifions leur témoignage et les publions dans différentes langues. La deuxième chose, c'est que nous nous efforçons d'utiliser notre expérience personnelle et les témoignages que nous avons collectés comme un outil pédagogique. Nous organisons donc des cours, des présentations, des visites en Cisjordanie pour que les gens voient de leurs propres yeux ce que c'est que l'occupation, et la vie sous cette occupation.
Notre action et nos motivations sont simples. Nous sommes un groupe de vétérans qui estime que l'armée devrait être un instrument de défense, et non un outil d'oppression et d'occupation. Nous ne sommes pas des pacifistes, ne vous trompez pas. Israël a l'obligation de se défendre. Mais nous pensons que les gens doivent avoir le droit de se gouverner eux-mêmes et non par une armée étrangère, a fortiori par notre armée. C'est pour cela que nous voulons rompre le silence pour accroître la résistance à l'occupation. Nous avons choisi de faire cela en utilisant notre connaissance du système, de ce qu'il se passe, notre expérience personnelle pour imposer un débat public sur cette occupation permanente et l'imposition de nos règles sur d'autres. On recueille donc des témoignages et on publie des choses, on organise des campagnes. Notre dernier livre regroupe des témoignages de plus de soixante-dix soldats qui ont été en mission lors des derniers combats à Gaza en juillet et août 2014, pendant l'opération « Bordure protectrice ».
Je ne voudrais pas parler d'opérations spécifiques, je voudrais vraiment dresser un tableau un peu plus général de ce qu'il se passe. Il y a six ans, après quelques années de travail dans Breaking The Silence au cours desquelles j'avais interviewé près de 700 soldats et officiers de différentes unités, envoyés dans diverses régions, nous avons pensé que nous pouvions essayer de raconter une histoire plus large et plus grande, pas simplement les anecdotes et les témoignages qui concernent une unité à un instant donné, dans un endroit donné. Nous voulions dire ce que nous faisions, nous, en tant que militaires dans les Territoires occupés. Cela a donné le Livre noir de l'occupation israélienne , qui a été traduit en français. Je ne vais pas vous parler du livre tout entier - je vous recommande chaleureusement de vous le procurer - mais je voudrais parler de nos conclusions.
Depuis notre naissance, nous, Juifs, Israéliens, entendons que nos soldats sont dans les Territoires occupés pour défendre Israël du terrorisme. Nos concitoyens sont victimes de terrorisme palestinien, c'est un fait, nous devons être là pour défendre notre pays, et je me suis dit, pendant assez longtemps, que c'était comme cela. Mais au fur et à mesure que nous avons commencé à travailler pour préparer ce livre, en écoutant des milliers d'heures de vidéos et de témoignages, nous nous sommes rendu compte que les actions défensives ne sont qu'une infime partie de ce que fait l'armée dans les Territoires occupés. Ce que l'on fait principalement dans les Territoires occupés est de jouer un jeu offensif. Principalement, on maintient et on préserve notre domination militaire absolue sur les Palestiniens. D'une certaine façon, l'occupation n'est pas simplement une campagne offensive contre le terrorisme, c'est une campagne offensive contre l'indépendance palestinienne. Lorsque l'on parle d'occupation militaire, peu importe que l'on soit expert en droit international, en politique, en études stratégiques, on pense toujours qu'il s'agit d'une réalité temporaire. C'est pour cela que ces tactiques et méthodes de gestion des civils, de contre-insurrection, etc., ont été mises au point : l'idée était qu'à la fin, après avoir conquis un territoire au moyen d'une guerre, on ne peut pas simplement disparaître du jour au lendemain sans s'être assuré d'une certaine stabilité ni avoir permis l'émergence d'institutions et d'un espace politique. Aujourd'hui, on envahit parfois un pays pour démolir un régime spécifique, comme en Irak, mais même quand on fait cela, l'idée de base est d'arriver dans le pays pour initier un processus de construction d'État ( nation building ). Je ne suis pas ici pour dire que cela fonctionne - je pense que notre région apportera la preuve que cela n'est pas nécessairement un succès - ni que c'est une très bonne idée, mais l'intention est bel et bien celle-là. On entre, on agit, et on se retire du pays.
Si on examine précisément les tactiques et stratégies employées par les forces israéliennes dans les territoires, on constate qu'elles font exactement le contraire de ce qui est fait pas les armées occidentales quand elles parlent d'occupation temporaire. On ne laisse pas d'espace politique pour que quelque chose puisse naître et se développer. On fait le contraire, on ne veut pas voir l'émergence de quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de faire de la contre-insurrection. Les tactiques mises en oeuvre conduisent à briser peu à peu et à diviser la population palestinienne.
Le langage que nous utilisons en tant que militaires nous trompe également. Il ne s'agit pas seulement du fait que l'on qualifie de « défensive » une campagne qui est en fait offensive. Le langage militaire utilisé pour parler de défense ne porte en réalité pas sur la défense. Nous avons identifié quatre catégories de langage qui sont des mots de code que connaissent tous les soldats israéliens. Lorsqu'on les entend, les connotations sont très défensives et positives, mais si on compare cela à ce qui se fait sur le terrain par l'armée, c'est offensif.
Le premier mot de code est « prévention » ; le deuxième est « séparation » ; le troisième, « tissu de vie » ; puis « application du droit ». Ce sont les quatre piliers que nous avons distingués en ce qui concerne l'action des militaires israéliens. Le soldat lambda connaît très bien tout cela. Examinons seulement le terme de « prévention », qui sonne vraiment défensif. En Israël, tout le monde l'entend très couramment et l'associe presque automatiquement à la « prévention ciblée ». « Prévention ciblée » est le nom de code pour les assassinats dans les médias. Imaginons le scénario suivant : un assaillant avec une ceinture d'explosifs sur le point de commettre un attentat-suicide se dirige vers un bus plein d'enfants se rendant à l'école. On ne peut pas l'arrêter mais on ne va pas non plus lui permettre de faire sauter le bus, donc on envoie quelqu'un qui va faire une prévention ciblée avant qu'il y ait une attaque terroriste. C'est complètement défensif ! Mais si l'on écoute les soldats parler de prévention, on comprend rapidement que ce concept au sein des forces de défense israéliennes est tellement vaste qu'il couvre quasiment tout acte de défense comme d'attaque. On le voit dans chaque tactique militaire utilisée sur le terrain. Je vais vous donner quelques exemples en parlant tout d'abord des assassinats, c'est-à-dire de la prévention ciblée. On commence par les assassinats des personnes qu'on n'arrive pas à arrêter. Il s'agit bien dans ce cas de prévention. Puis on vise des personnes qu'on pourrait arrêter, mais plutôt que de le faire, on les assassine, car cela a un impact beaucoup plus fort. Au plus fort de la Seconde Intifada, il y a même eu des actes de pure vengeance. Par exemple, le 19 février 2002, sur un checkpoint des forces de défense israéliennes à Ramallah, il y a eu une attaque au cours de laquelle six ingénieurs soldats ont été tués. La nuit suivante, trois unités des forces spéciales ont été envoyées pour se venger. A 2 heures du matin, les instructions étaient simples : qui que ce soit qui se présente au checkpoint , avec ou sans uniforme, avec ou sans arme, doit mourir. Les trois unités, opérant respectivement à Gaza, Ramallah et Naplouse, relevaient de trois commandements différents et avaient reçu exactement le même ordre, le même horaire, la même mission. Il ne s'agit pas d'un officier qui aurait « craqué ». Tout était délibéré, planifié, au moins au niveau du vice-chef d'état-major des forces israéliennes, si ce n'est au-dessus.
J'en viens aux arrestations, une autre tactique militaire. On arrête les « méchants » dès le début, puis ensuite les cousins, puis les cousins des cousins de ces personnes, pour mettre la pression sur celles-ci. Après ont lieu les « arrestations massives » : nous encerclons un village et arrêtons tous les hommes par tranche d'âge. Le propos est, dans le jargon militaire, de « faire ressentir notre présence ». Si les Palestiniens ont l'impression que l'armée israélienne est là, partout, tout le temps, ils renonceront à attaquer. En Cisjordanie, cette présence se manifeste de façon différente selon les endroits. À Hébron, la plus grande ville palestinienne en Cisjordanie, où j'ai servi pendant un an, trois patrouilles militaires ont pour objectif d'être très visibles. La ronde de nuit dure de 22 heures à 6 heures du matin. Les patrouilles bloquent les rues de la vieille ville, encerclent et entrent dans une maison, choisie au hasard par la personne qui dirige la patrouille - il s'agit d'une maison au sujet de laquelle l'armée ne dispose d'aucun renseignement -, réveillent tous les occupants, mettent les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, fouillent les lieux. Imaginez ce qui se passe quand des militaires font irruption dans une maison à 2 heures du matin... Les militaires sortent ensuite dans la rue, font du bruit, frappent aux portes, envahissent aléatoirement une autre maison, réveillent la famille, fouillent les lieux, ressortent, vont sur les toits, sautent d'un toit à l'autre, descendent par les balcons, entrent dans une nouvelle maison,... sept jours sur sept, 24 heures sur 24, par tranche de huit heures. Depuis le début de la Seconde Intifada, en septembre 2000, cela ne s'est jamais arrêté à Hébron. Cette nuit, pendant votre sommeil, vingt à vingt-cinq familles vont être réveillées. Pour les militaires israéliens, l'idée est de créer une impression de persécution dans l'ensemble de la population palestinienne. Chaque Palestinien doit sentir le souffle d'un soldat israélien sur sa nuque, sans jamais savoir où, quand, comment, pendant combien de temps il sera face à une patrouille.
Pour finir, je vais évoquer une dernière tactique, celle des fausses arrestations. Vous n'avez sans doute jamais entendu cette expression, qui désigne une arrestation qui n'est pas réelle. On en entend parler dans les témoignages de soldats depuis cinq ou six ans, de manière croissante, alors que cela ne se faisait guère pendant mon service militaire, parce que la Seconde Intifada ne laissait pas l'occasion de se livrer à ce genre de jeux. Une unité se déploie pour la première fois dans un endroit. La première arrestation qu'elle mène ne doit pas être une vraie arrestation. On choisit un village palestinien très calme, on consulte une photo aérienne, on regarde le numéro de code de chaque maison, on choisit au hasard une maison, on appelle les services secrets et on s'assure que la personne qui vit dans cette maison est bien innocente, afin de ne pas interférer dans une opération de renseignement en cours. Une fois l'aval obtenu, on encercle la maison, de nuit, comme s'il s'agissait d'une véritable arrestation. On met les menottes à une personne, on lui couvre les yeux, on l'emmène à la Jeep. Après dix à quinze minutes, quelqu'un à la radio dit « fin de l'exercice, arrêtez la Jeep, relâchez la personne, retournez à la base et allez-vous coucher ». Maintenant, vous vous demandez probablement pourquoi faire cela. Les soldats aussi posent cette question à leurs officiers. La réponse est simple : premièrement, c'est une bonne formation ; si l'entraînement peut se faire dans un vrai village palestinien, dans une vraie maison, sur un vrai Palestinien, c'est d'autant mieux. Deuxièmement, cela permet d'être vu. Les gens dans le village se réveillent, ils voient qu'un innocent a été arrêté, ils demandent pourquoi, puis ils voient que la personne est relâchée, et ils se disent que cela n'a aucun sens. Ils ont ainsi encore plus de questions à se poser. Quand le but est d'intimider les gens, l'absence de logique est la logique parfaite, le manque d'ordre est l'ordre parfait. C'est pour cela que l'éditeur de notre dernier livre en anglais a choisi le titre Our harsh logic (« Notre dure logique »). Je dirais que le titre était meilleur en hébreu, et je le dis d'autant plus facilement que je n'en suis pas l'auteur. Le titre veut dire littéralement « l'occupation des territoires » mais il est très difficile de le traduire convenablement. Notre message est que, pour la plupart des Israéliens, cette occupation est un événement historique, révolu, qui a eu lieu en juin 1967. Mais en fait, si vous écoutez les témoignages, vous vous apercevez que ce n'est pas du tout un événement historique. L'occupation des territoires est quelque chose qui a lieu à chaque instant. Bien sûr, on réoccupe le territoire physiquement en construisant de nouvelles colonies, mais chaque maison ouverte par les Israéliens en pleine nuit pour donner un sentiment de persécution, chaque checkpoint placé aléatoirement entre deux villages pour empêcher le déroulement normal de la vie quotidienne, permet également de réoccuper les territoires. Tout cela est le sens de ce que nous faisons. À chaque fois, nous allons de l'avant, et ne faisons jamais un pas pour reculer. Cela donne un nouveau sens à l'expression de statu quo . Ce n'est pas une réalité figée. C'est quelque chose qui évolue, c'est une occupation qui s'ancre depuis quarante-huit ans et qui n'a pas encore été arrêtée. Je crois que c'est ce que nous devons cesser de faire maintenant.
 De gauche à
droite : MM. Jean-Paul Chagnollaud, Yehuda Shaul, Jeff Halper et Benjamin
Sèze
De gauche à
droite : MM. Jean-Paul Chagnollaud, Yehuda Shaul, Jeff Halper et Benjamin
Sèze
II. LE REGARD D'UN INTELLECTUEL
M. Jeff HALPER, anthropologue, conférencier et militant politique, co-fondateur et Directeur de l'ONG The Israeli Commitee Against House Demolition (ICADH)
M. Benjamin Sèze : Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de poursuivre avec la présentation de M. Jeff Halper qui va élargir l'analyse à l'ensemble de la société israélienne. Nous prendrons les questions à l'issue de son intervention. Jeff Halper est anthropologue et militant politique, il est co-fondateur et directeur de l'ONG Comité israélien contre les destructions de maisons qui depuis 1997 répertorie et compile des données sur les démolitions de maisons et plus généralement sur les avancées de la colonisation israélienne en Palestine.
M. Jeff Halper : Merci beaucoup de m'avoir invité. Yehuda Shaul n'est pas toujours facile à suivre mais nos propos sont complémentaires. Je suis directeur du Comité israélien contre les destructions de maisons, qui est une toute autre facette de l'occupation. Certains orateurs ont déjà abordé ce sujet. Je souhaite en parler parce que c'est l'une des méthodes centrales de l'occupation et comme Yehuda l'a dit, cela nous aide dans notre plaidoyer parce que ces pratiques n'ont rien à voir avec la sécurité. Israël, depuis 1967, a détruit environ 46 000 foyers palestiniens, maisons et autres types de structures où les gens vivaient. Tout ceci est très bien documenté. Mais lorsqu'est concerné un bâtiment avec des appartements de sept étages à Gaza ou en Cisjordanie, avec peut-être trente familles à l'intérieur, c'est parfois considéré comme une seule démolition. Donc il est toujours difficile de compter les démolitions, mais on dénombre environ 46 000 foyers démolis depuis 1967. Et bien sûr, au moment de la Nakba, en 1948 et dans les années qui ont suivi, Israël a démoli environ 60 000 autres foyers palestiniens, des villages entiers, des villes, des zones urbaines. Et puis bien sûr beaucoup de démolitions ont eu lieu à l'intérieur d'Israël. Il n'y a presque pas de différence entre les Territoires occupés et Israël, si vous êtes palestinien. Les citoyens palestiniens d'Israël vivent seulement un tout petit peu mieux que les Palestiniens qui vivent en Cisjordanie. Regardez les démolitions de maisons : l'année dernière, si je mets de côté Gaza, il y a eu trois fois plus de maisons démolies en Israël, de citoyens israéliens (qui sont tous arabes, soit palestiniens, soit druzes) qu'il y en a eu dans les Territoires occupés. Donc c'est la même politique, c'est la suite de ce qui s'est passé en 1948. L'un des slogans en Israël est qu' « on n'a jamais terminé le boulot de 1948 ». On poursuit donc ce qui a commencé en 1948. Si vous additionnez tout, la Nakba, les démolitions au sein d'Israël et les démolitions dans les Territoires occupés qui continuent encore à ce jour, il s'agit en fait de 120 000 foyers détruits, et donc des communautés entières qui ont été effacées de la carte. Ce sont des dizaines de milliers, des centaines de milliers de familles traumatisées, sans foyer, sans abri et dont évidemment la terre a été saisie. L'une des raisons pour lesquelles ces démolitions sont une vraie problématique, et pourquoi cela nous intéresse, c'est que cela change le cadre même du conflit. Ce dont Israël essaie de nous convaincre, et d'ailleurs je crois qu'il y arrive parfois très bien avec vos gouvernements, c'est que ce qu'il fait l'est au nom de la sécurité. En réalité, quasiment aucun de ces foyers, sur 120 000 qui ont été démolis, n'avait quelque lien que ce soit avec la sécurité. Pendant la Nakba, les villages, les villes, les zones urbaines ont été démolis après les combats, après que les gens se sont échappés. Dans les Territoires occupés, il y a des démolitions parce qu'il y a des invasions de l'armée. Ce matin notamment, on a vu qu'il y a environ 18 000 foyers qui ont été démolis à Gaza à l'été 2014. Ils n'ont pas été particulièrement ciblés, mais sont ce qu'on appelle des dégâts collatéraux. Ils étaient sur le chemin de l'armée, c'est tout. Voilà. En Cisjordanie ou en Israël des foyers sont démolis parce que les permis de construire ne sont pas octroyés aux Palestiniens. Les constructions palestiniennes ont été gelées en 1948, ou en 1967 pour ce qui est des Territoires occupés. Ces démolitions n'ont rien à voir avec la sécurité, ce ne sont pas des foyers de terroristes. Si vous posez la question des raisons de ces destructions aux gens dans les rues de Tel Aviv ou de Paris, soit ils ne savent pas de quoi vous parlez, soit ils vous donnent la réponse officielle : ce sont des foyers de terroristes. Sinon pourquoi Israël, alliée de la France, seule démocratie du Moyen-Orient, ferait cela ?
Donc la problématique des démolitions permet de recadrer le conflit en passant du thème de la sécurité à quelque chose d'autre. Trois éléments y concourent. Le premier élément, c'est qu'Israël refuse de reconnaître qu'il y a une occupation. Il dit soit que cela n'existe pas, soit : « notre pays va du Jourdain à la Méditerranée, donc comment peut-on occuper son propre pays ? ». Il refuse par conséquent l'application de la 4 e convention de Genève.
Nous, activistes, rétorquons qu'il y a bien une occupation car les Nations Unies, la Cour internationale de Justice et le droit international le disent. Une fois que l'occupation rentre dans le discours, dans ce cas-là cela change la perception du conflit. Il n'y a plus qu'une puissance occupante car les Palestiniens ne vont pas occuper Tel Aviv. Cela prouve l'asymétrie, il y a une puissance occupante face à un peuple qui lui est occupé.
Le deuxième élément de notre recadrage qui ressort des démolitions de maisons est que l'occupation n'est pas défensive, ce n'est pas une réaction au terrorisme. Cela n'a rien à voir avec le terrorisme, c'est une démarche active. Tout au long de notre journée de travaux, nous avons entendu des témoignages de cette démarche résolue. Israël nie l`occupation, nie l'existence d'un peuple palestinien pour saisir l'intégralité d'un pays au dessein d'en faire un État juif.
La troisième partie de notre recadrage est de soutenir que, contrairement à la manière dont il se présente, Israël n'est pas une victime. En étant la troisième puissance nucléaire au monde et en occupant un territoire depuis plus de 50 ans, Israël réussit toujours à se présenter en victime, et donc à vouloir ne pas être tenu pour responsable de ses actes. Nous refusons cette situation et présentons Israël comme une vraie puissance économique et militaire. Si le monde commence à regarder l'État d'Israël tel qu'il est réellement, un État occupant, alors Israël pourra être tenu responsable de ses actes en vertu du droit international.
Nous devons continuer à résister à l'occupation mais nous devons nous diriger vers une solution. Pour moi, il y a trois options possibles à cette évolution du conflit.
L'une est la solution à deux États que le camp de la paix israélien a acceptée pendant des années. Certains des intervenants de ce jour y croient encore. Je n'y vois pas d'inconvénient. Je ne trouve pas cette solution juste, mais si elle est acceptée par les Palestiniens, je ne vais pas être plus palestinien que les Palestiniens ! Cela leur octroierait, il est vrai, une certaine quantité d'autodétermination. Le problème, c'est que cette solution à deux États est perdue, c'est la réalité sur place, nous l'avons vu ce jour. Les 600 000 colons, l'annexion de Jérusalem-Est, les sept blocs de colonies (S ettlement blocks ), les vingt-huit autoroutes spéciales, cet ensemble de fragmentations du territoire, ainsi que le Mur bien sûr, font qu'il ne reste plus de place pour un État palestinien.
Certains arguent que logistiquement il est possible de parvenir à une solution à deux États, que 600 000 colons c'est peu si l'on compare ce chiffre aux millions de personnes déplacées à la fin du Second Conflit Mondial. Mais cela ne fonctionnerait qu'avec la volonté internationale de forcer Israël à se retirer, or elle n'existe pas. Vous imaginez la France, l'Allemagne ou les États-Unis, forcer au retrait de Maale Adumim 8 ( * ) où résident 50 000 personnes, ou de Jérusalem-Est ? C'est tout simplement inconcevable !
Il n'y a déjà en fait plus qu'un seul État. La solution à deux États a disparu, et je pense que nous devrions arrêter de l'évoquer. Plus on parle d'une solution irréaliste, plus on pollue le débat. Bien entendu, cela ne me réjouit nullement, pas plus que cela ne réjouit les Palestiniens pour qui c'était la seule solution d'avoir leur propre État. Mais il faut prendre en considération la réalité physique, géographique et politique du terrain. De la vallée du Jourdain à la Méditerranée, aujourd'hui déjà, il n'y a qu'un État. Il n'y a qu'un gouvernement. Ne me dites pas que l'Autorité palestinienne a un pouvoir effectif. Il n'y a évidemment qu'une armée et qu'une monnaie, le shekel, contrôlé par le gouvernement israélien, que vous viviez à Gaza, Hébron ou Tel Aviv. Il n'y a également qu'un réseau autoroutier, électrique et hydrographique. Il n'y a donc qu'un État.
La seconde solution est donc l'apartheid. Il n'y a aujourd'hui qu'un État, d'apartheid. Dans sa définition légale, l'apartheid repose sur la séparation et la domination. Et c'est la solution que souhaite Israël, car cela lui permet de disposer de tout le territoire tout en restant un État juif puisque la population arabe de Palestine n'a pas la citoyenneté, et peut être maintenue dans ses 70 enclaves territoriales environ qui ne représentent que 10% de la Palestine historique. Et Israël pense qu'elle peut continuer, contrairement à l'Afrique du Sud, avec ce type de système. Mais bien entendu, cette solution n'est pas acceptable.
Il nous faut donc réfléchir à une troisième solution. Il faut accepter qu'Israël a fermé la porte à la solution à deux États, et n'en souhaite en réalité qu'un seul. Nous l'acceptons, mais cela ne peut être un État d'apartheid. Il doit être un État démocratique, binational, avec égalité des droits pour tous ses citoyens. Il y a donc deux groupes nationaux qui doivent être représentés et intégrés à égalité. Et j'en finirai en disant qu'il faut un mouvement BDS [Boycott, Désinvestissement et Sanctions, NDRL] très fort. Et je sais qu'en France il est illégal. Mais en réalité, les États ne font pas ce qu'il faut car ils ne suivent pas les principes du droit international et des Droits de l'Homme. On a d'ailleurs critiqué le président Jimmy Carter qui avait fait des Droits de l'Homme la matrice de sa politique étrangère. Donc si nous voulons une solution juste à ce conflit, il faut que les peuples la réclament. Et cela ne peut être fait que via le mouvement BDS. C'est la raison pour laquelle les gouvernements n'en veulent pas, car c'est le moyen de redonner le pouvoir aux citoyens. Le slogan en anglais, que je veux vous transmettre est le suivant : BDS for BDS, Boycott, Divestment and Sanctions for a Binational Democratic State .
M. Benjamin Sèze : Je vous propose de garder vos questions sur la question d'un État, ou deux États pour après la conclusion de Jean-Paul Chagnollaud, puisque cela va être un des sujets de son exposé. En revanche, toutes les questions sur les conditions de l'occupation, les démolitions, l'occupation militaire, sont les bienvenues.
Question de la salle : J'ai une question pour Yehuda Shaul dont j'admire le travail. Régulièrement des sergents recruteurs de l'armée israélienne viennent en France avec dans leurs valises trois programmes : un destiné aux Franco-Israéliens, un deuxième aux Français juifs mais qui ne sont pas israéliens, et un troisième pour des Français ni juifs ni israéliens. Ceux qui sont visés en premier lieu sont ceux des deux premières catégories afin qu'ils s'engagent dans l'armée israélienne. Un certain nombre ont rejoint Tsahal, s'en vantent d'ailleurs dans les réseaux sociaux, et sont souvent impliqués dans des crimes commis contre les Palestiniens dans les Territoires palestiniens occupés. Ce fut le cas fin octobre au checkpoint de Zatara, où une jeune recrue française qui avait passé deux années dans l'armée israélienne a tué deux jeunes Palestiniens de 16 et 17 ans qui étaient sur un scooter. Puis ensuite, avec des photos bien prises, deux couteaux ont été posés à côté des cadavres. Le gouvernement français n'a pas réagi, sauf un député français M. Meyer Habib, représentant des Français de l'étranger pour la circonscription d'Israël, Turquie, etc., qu'on appelle le député israélien de l'Assemblée nationale. Il se félicite que ce soit une Française qui ait tué ces présumés terroristes palestiniens. Est-ce que vous avez des données sur l'engagement des étrangers, français ou autres dans l'armée israélienne, et leur implication dans d`éventuels crimes commis par l'armée israélienne dans les Territoires palestiniens occupés ?
M. Yehuda Shaul : De façon générale la réponse est non. Nous n'arrivons pas à collecter ce type de données. Concernant les soldats étrangers qui se sont engagés dans l'armée, je ne pense pas que ce genre d'informations soit particulièrement intéressant à étudier. Ce qui nous intéresse est de regarder de près l'occupation et le prix à payer pour cette occupation, et utiliser ces éléments pour la combattre. Je ne connais pas l'affaire dont vous parlez, mais je pense que cela n'a pas pu se passer comme vous l'avez dit. Je ne connais pas les détails de cette affaire, mais je n'ai jamais entendu parler d'une situation où les soldats ont tiré sur des Palestiniens et ont ensuite posé des couteaux près des corps.
Question de la salle : Bonjour, je suis membre d'une plateforme des ONG françaises pour la Palestine, merci à vous deux. Je voudrais poser à Yehuda Shaul une question sur l'aspect militaire et une autre à vous deux sur l'aspect général : comment votre action à l'une et l'autre association est-elle perçue par la population israélienne dans son ensemble ? On nous reproche souvent que dans nos conférences, nous faisons des raccourcis, en disant « Israël » de manière générique, et nous rétorquons toujours que nous parlons des autorités israéliennes, du gouvernement israélien. Il n'empêche que ce gouvernement a été élu extrêmement majoritairement et que parfois je m'interroge sur la différence que l'on peut faire entre la population israélienne dans son ensemble, politiquement parlant, et les attitudes gouvernementales. Êtes-vous perçus comme les ennemis de l'intérieur, êtes-vous rejetés par votre société ? Êtes-vous en danger ? Plus particulièrement pour Yehuda, vous êtes membre d'une association de vétérans, Breaking the Silence , mais qu'en est-il des soldats d'active ? Comment êtes-vous perçus par les soldats aujourd'hui sur les checkpoints , et à Hébron notamment quand vous amenez des groupes de visiteurs pour observer le ravage de l'occupation militaire ? Êtes-vous là encore soumis à des vexations, des menaces, ou pouvez-vous mener vos activités citoyennes et militantes en toute liberté ?
M. Jeff Halper : Avant que Yehuda ne parle, sachez que nous appartenons à des organisations tout à fait différentes l'une de l'autre, et je laisserai à Yehuda le soin de définir son organisation. Notre organisation, l'ICAHD (The Israeli Committee Against House Demolitions) qui est contre les destructions de maisons, est une organisation politique. On utilise cette problématique de destruction de maisons pour résister à l'occupation, mais au-delà on l'utilise pour faire avancer nos arguments, pour aller à l'étranger, pour essayer de mobiliser la société civile à l'étranger, et on cherche au final à résoudre le conflit. Nous ne sommes pas une organisation sioniste. Je pense que la différence avec Daniel ou Anat qui ont parlé ce matin, c'est qu'eux se définissent clairement comme des sionistes. Donc cela veut dire qu'il faut une solution à deux États car il faut un État juif. Car comme le dit Daniel, sinon cela n'a aucun sens. Et le problème c'est qu'ils voient cette solution disparaître sans pouvoir s'y résoudre. Nous ne sommes pas des sionistes, nous sommes israéliens mais on peut partager avec les Palestiniens un État binational. Je ne veux pas divorcer d'eux, ce sont mes amis. Or ce sont les termes qui ont été utilisés ce matin, un langage un petit peu curieux tout de même. Mais notre vision est tellement minoritaire chez les Israéliens que nous sommes à peine visibles. Yehuda et ses amis, eux, sont visibles car ce sont des soldats. Et ils sont à l'épicentre du discours israélien. Nous, quand nous parlons d'une solution fondée sur un seul État sans être des sionistes, nous sommes complètement en marge de l'entendement des gens, donc on ne nous voit même pas. Nous tentons d'être efficaces à l'étranger mais nous ne pouvons pas toucher le public israélien.
M. Yehuda Shaul : Je pense que nous avons des points de vue de départ tout à fait différents. Je suis sioniste, je crois en la solution à deux États, je pense que les problèmes nationaux trouvent une solution au niveau national. Nous nous connaissons très bien et on sait que nous ne sommes pas d'accord sur tout. Par exemple Breaking the Silence est une organisation qui ne demande pas le BDS [Boycott, Désinvestissement et Sanctions, NDRL].
Si on remonte plusieurs années en arrière, Breaking the Silence a toujours été une organisation centrale, située sur le devant de la scène, parce que les ex-militaires ont gagné le droit de s'exprimer. Mais, je dirais que tout de même depuis cinq ou six ans maintenant, nous devenons de plus en plus une cible, probablement même en tête de la liste des ennemis d'État. Alors il faut mettre cela dans un contexte : nous avons le gouvernement le plus à droite jamais élu depuis la création de l'État d'Israël. La plus grande partie de notre travail se trouve en Israël et nous ciblons la société civile. On organise des présentations, on rencontre 10 000 personnes par an, le tiers étant des jeunes avant leur service militaire. Et cela énerve les forces en faveur de l'occupation. Nous sommes désormais au coeur d'une grande campagne contre nous. Notre ministre de la défense a demandé que les forces de défense israéliennes ne nous invitent plus à nous exprimer publiquement. Et il y a deux jours, une grande campagne a été lancée pour demander au président d'Israël Reuven Rivlin, qui devait s'exprimer à une conférence du quotidien Haaretz à New York, de boycotter cette conférence parce que Breaking the Silence y serait présent. Le président n'a pas boycotté la rencontre mais il a parlé de nous sans dire notre nom dans un message qui n'était pas très positif. On voit de plus en plus de tentatives de la droite au gouvernement de réguler ce que l'on a le droit de dire, publiquement, donc si vous m'aviez posé la question il y a cinq ou six ans en me demandant si je me sentais en sécurité j'aurais répondu : « bien sûr que oui, c'est évident, je suis israélien, je suis en Israël, aucun problème ». Au mois de mai, lorsqu'on a publié ce livre, les témoignages des soldats à Gaza, il a fallu payer les services de gardes pour les poster en faction à l'extérieur de nos bureaux. Rien n'a eu lieu, aucune attaque physique, mais le fait d'être obligé d'y penser ça vous démontre que les choses ont bel et bien changé, et ont beaucoup changé. Autrefois, j'avais beaucoup de liberté mais je pense que les choses changent.
Là encore, je regarde la situation de nos amis palestiniens à Hébron et on amène nos amis là-bas, et je réalise que le prix que je paie n'est rien comparé au prix qu'ils paient eux, tous les jours. Il y a quelques semaines, on devait organiser une lecture publique à Beer-Shera dans un bar et des militants de droite ont menacé nos vies et celle du propriétaire. Nous sommes allés au poste de police pour déposer plainte et une personne a été arrêtée. Cette personne est présentée devant les juges, mais au bout du compte la police est allée devant le juge pour que notre présentation n'ait pas lieu, plutôt que de nous protéger. La semaine d'après nous organisions la même chose à Tel Aviv. Le matin même, la police est arrivée et a commencé à examiner la licence du bar pour voir si les réglementations d'incendie et de sécurité étaient respectées. Cela fait des années que le bar existe, sans visites de la police, et étrangement, d'un seul coup, il est très important de contrôler les licences. Les choses changent, c'est triste. Mais que croyons-nous ? Après 48 ans d'occupation, les tendances non démocratiques que l'on voit naître dans les colonies franchissent la Ligne Verte et se répandent en Israël. Et c'est pour cela aussi qu'il faut mettre un terme à l'occupation.
Question de la salle : Miguel Hernandez, président de l'association Amitié Palestine Solidarité , je souhaiterais aborder avec vous la question des enfants. Nous en avons peu parlé et pourtant on entend beaucoup parler, sur le terrain, d'enlèvements, de sévices, voire de torture. Dernièrement, on a entendu parler de l'abaissement de l'âge d'emprisonnement des enfants à 16 ans. Je voulais savoir ce que vous en pensiez et peut-être évoquer avec vous cette situation difficile. Je souhaiterais également savoir quel lien vous avez avec des associations comme Addameer en Palestine qui défendent à la fois les enfants et les prisonniers politiques ?
M. Yehuda Shaul : Cette question de la détention d'enfants dans les Territoires occupés est une problématique qui attire davantage de regards et c'est très bien. Il y a quelques années, nous avons publié un livre que vous pouvez trouver sur notre site web, qui compile toute une série de témoignages relatifs au traitement des enfants dans les Territoires occupés. Nous travaillons peu sur les questions de la détention car l'armée n'est pas en charge des prisons. Je ne peux donc pas dire grand-chose sur ce sujet mais ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup d'organisations des droits de l'Homme nous ont demandé de quelles informations nous disposions sur le traitement des enfants. J'ai interrogé ma mémoire pour tenter de me souvenir. Est-ce que j'ai maltraité des enfants ? J'ai très peu de souvenirs des enfants car quand vous êtes sur le terrain, les enfants ne sont pas des enfants. Ce que je veux dire par là, c'est que votre monde n'est pas divisé entre enfants et adultes comme pour tout civil. Pour nous, soldats, c'était un monde divisé entre eux et nous. Et donc peu importait qu'il s'agissait d'un enfant de 10 ans ou d'un adulte de 21 ans. Il s'agissait d'eux et de nous. Et l'idée que c'est un garçon qui a 10 ans, qu'il a davantage de droits, ça n'a aucun sens quand vous êtes soldat et que vous êtes sur le terrain. Aujourd'hui, j'habite Jérusalem, et la police n'a pas le droit d'entrer dans ma maison car il faut l'ordre d'un juge. Or vous pensez bien que quand j'étais soldat je n'ai jamais demandé l'autorisation d'un juge quand j'entrais les gens en cassant la porte au rythme de dizaines de maisons par jour. Donc quand vous êtes soldat, vous ne distinguez pas les adultes et les enfants, ce n'est pas quelque chose que vous avez en tête. Et c'est pour cela que ça pourrait être un enfant à vos yeux, mais à mes yeux, à l'époque, pour un soldat, c'était l'ennemi. Je ne suis pas en train de dire que partout, tout le temps c'est comme ça bien sûr, mais c'est l'attitude générale et à partir de là en découle beaucoup de choses.
Question de la salle : Une rapide question pour vous Yehuda. Vous écoutant concernant les droits qui sont pertinents dans certaines situations, nous savons que les officiers des forces de défense israéliennes sont entraînés et instruits des lois, notamment internationales, gouvernant la guerre. Maintenant que la Palestine peut saisir la Cour pénale internationale (CPI), est-ce que votre organisation a cherché à informer les membres de l'armée des conséquences qu'ils encourent à titre individuel lorsqu'ils agissent sur le terrain ? Si vous ne faites pas ce travail, est-ce que vous envisagez de le faire, étant donné l'importance du Statut de Rome et le fait que l'armée est en train d'enfreindre ce Statut par ses actions sur les Territoires occupés ?
M. Yehuda Shaul : De façon générale, je dirais que non. Breaking The Silence ne travaille pas du tout avec ces questions de la CPI. De façon générale, on ne coopère pas avec ce type d'enquêtes. Ce que l'on fait davantage, c'est agir sur le terrain moral plutôt que sur le terrain juridique. Je ne suis pas avocat, je n'ai aucune formation juridique, j'ai une formation de soldat de combat, et je suis un être humain. Je voudrais croire que j'ai un certain sens moral, et cela ressemble au langage que Breaking The Silence tient sur le terrain. Il est important de comprendre qu'une formation normale dans l'armée, dans l'infanterie, n'enseigne pas le droit international. La seule chose que j'ai apprise, concernant le droit international, est que j'avais un petit bout de papier dans ma poche qui indiquait mon numéro d'identité en tant que soldat, mon groupe sanguin, mon rang, au cas où je me trouverais entre les mains de l'ennemi. La Convention de Genève me dit que je peux révéler tout cela. C'est tout ce que je savais.
Autre chose qu'il est important de souligner, c'est que Breaking The Silence ne croit pas que le problème soit la force armée israélienne. C'est pour cela qu'on ne rentre pas tellement dans ce monde juridique. Je ne pense pas que le militaire israélien soit le problème. Je pense que le problème, c'est la mission politique qui est confiée à l'armée. Toute armée qui est envoyée pour occuper des Territoires en privant ses occupants de droits et de leur dignité, pendant plus de 48 ans, se comportera ainsi sinon pire. Quand votre mission est immorale, qu'elle est de priver les gens de leur dignité, de leurs droits, c'est cela le problème, pas les actes individuels.
Question de la salle : Vous avez parlé de la solution à un État ou à deux États, mais ce n'est pas une question entre les Palestiniens ou les Israéliens, c'est un problème international. Tous les militants, les mouvements sociaux et politiques, doivent agir ensemble pour aider les Palestiniens. Nous ne sommes pas responsables de ce qu'il se passe en Palestine. Quels sont aussi vos projets d'action auprès de la société civile israélienne pour mettre la pression sur le gouvernement ? Il faut lutter contre la détention administrative. Aussi, pourquoi est-ce que les Israéliens continuent d'utiliser des balles qu'on appelle dum-dum, des projectiles expansifs, à fragmentation, qui font des dégâts considérables ? Il y a des victimes qui sont tuées par ces balles spéciales, et ce sont des balles interdites au niveau international.
Pourquoi aussi est-ce qu'Israël continue de tuer des jeunes qui manifestent de façon normale, qui ne sont pas armés ? Quand ils les tuent, ils prennent les corps, et ne le ramènent pas forcément immédiatement à la famille du défunt. Il reste encore beaucoup de corps non restitués par les Israéliens.
M. Benjamin Sèze : Merci Monsieur pour ce témoignage et ces éléments complémentaires.

Mme Florence Delaunay, députée
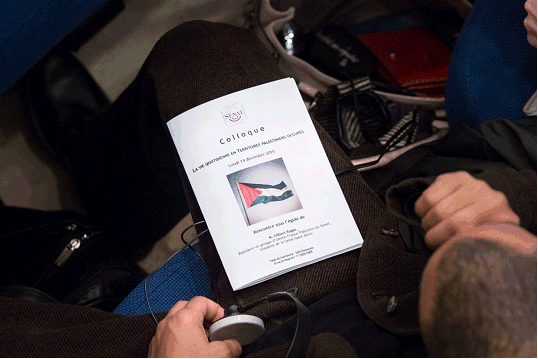
CLÔTURE : DEUX ÉTATS, UN ÉTAT ?
M. Jean-Paul CHAGNOLLAUD, Directeur de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée Moyen-Orient (iReMMO),
Professeur des Universités
M. Benjamin Sèze : Je propose que, à la suite de la question sur un ou deux États, on en profite pour passer directement à la conclusion de Jean-Paul Chagnollaud, directeur de l'Institut de recherche sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, et professeur des universités.
M. Jean-Paul Chagnollaud : Je vous remercie, c'est difficile de conclure un colloque si riche, surtout après avoir entendu des témoignages qui viennent du coeur de la société israélienne et de la société palestinienne, avec en particulier tout à l'heure cet émouvant témoignage depuis Gaza, et qui nous en disait beaucoup plus que tout ce qu'on pourrait analyser.
Je crois, puisque je suis cette question comme beaucoup d'entre vous depuis fort longtemps, qu'on aurait tort de penser que le conflit israélo-palestinien - et je ne pense pas que vous le pensiez - soit depuis des décennies avec les mêmes configurations. C'est sur ce point-là que je voudrais insister. Si on prend le conflit dans ses origines, il faudrait revenir aux années 1916-1917, et on pourrait ainsi facilement, en deux minutes, montrer les différentes périodes et comprendre que nous sommes, à mon avis, dans une autre séquence aujourd'hui. Si je devais résumer d'un trait, je dirais que c'était dans les années 1920 jusqu'à 1948, l'époque coloniale avec le mandat britannique ; ensuite de 1948 à 1957 un conflit qui fut essentiellement interétatique, on ne parlait pas des Palestiniens à part pour dire qu'il s'agissait de réfugiés. Puis on a eu une troisième période entre 1967 et 1993, qui a été une montée en puissance, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, du nationalisme palestinien, avec comme point d'orgue la Première Intifada et la proclamation de l'État en 1988 à Alger. C'était une séquence tout à fait importante où l'on a vu cet acteur s'imposer progressivement. Il y a eu la quatrième période, celle d'Oslo, qui va de 1993 jusqu'à 2000, quelques années où la configuration était différente. On a pu penser lucidement, malgré l'assassinat d'Yitzhak Rabin, qu'il y avait une possibilité de paix équilibrée entre deux peuples. Nous sommes, à mon avis, depuis les années 2000-2001, dans une nouvelle séquence historique. Si on n'appréhende pas cette séquence comme ce qu'elle est, avec évidemment les fondamentaux qui demeurent - l'occupation - il y a des choses qui changent et il faut en prendre conscience pour mieux agir. Cette séquence historique, dans laquelle nous sommes, pourrait se résumer en trois mots.
Le premier mot c'est le mot, avec tous les débats que cela implique, « hégémonie », un mot bien connu, familier, l'hégémonie nationaliste et religieuse en Israël. Cette hégémonie est relativement nouvelle. Je la date à peu près de cette période. Si on prend le point de vue électoral, en 1992, la gauche, même s'il ne faut pas opposer de manière simpliste la gauche et la droite car il y a des nationalistes aussi à gauche, mais en 1992 il y avait une majorité de 45 sièges rien que pour le parti travailliste. Si on rajoutait le Meretz, Rabin n'était pas loin d'une majorité. Aujourd'hui, et depuis 2001, le parti travailliste s'est dilué, et depuis l'arrivée de Sharon, pour moi c'est vraiment la coupure, on a des majorités de droite et d'extrême droite. Les dernières élections de cette année 2015 ont bien montré qu'il y avait un coeur de majorité qui était ce coeur autour de nationalistes et de religieux. Cette hégémonie politique s'est traduite depuis des années par une hégémonie idéologique. Il y a une phrase de Zeev Sternhell qui a dit il y a quelques mois, « notre génération a perdu la bataille des valeurs et des idées ». Je trouve que cela est très juste. Cela veut dire que certaines idées qui étaient autrefois marginales, en tout cas combattues, ne le sont plus aujourd'hui.
Tout à l'heure, on évoquait les ONG qui se battent, comme Breaking the Silence , il est bien clair qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile pour ces ONG de se battre qu'il y a 20 ans, car nous sommes dans cette hégémonie à la fois idéologique et politique, qui consiste à penser que l'intégralité de la Palestine est en fait la propriété d'un État juif et que, par conséquent, il n'y a pas d'occupation. Je crois que cette idée est vraiment de plus en plus forte. Cette idéologie, qui consiste à penser qu'Israël est propriétaire de l'ensemble de la Palestine, n'a jamais été aussi forte, avec ce que cela implique. C'est-à-dire que quand on est dans cette mentalité, on est dans une logique coloniale. Une caractéristique aujourd'hui est le retour en force des logiques coloniales. Dans celles-ci, il y a un point très fort qui est que l'autre, l'indigène, n'existe pas. L'indigène, on va pouvoir fermer les espaces dans lesquels il vit, l'enfermer dans les prisons, ou à Gaza comme cela était évoqué, cela va être de le tuer, et le rapport à la vie humaine est tout à fait en rapport avec cela. Ce triptyque, « fermer, enfermer, tuer » est plus prégnant qu'il ne le fut. On est vraiment dans cette espèce de chape de plomb idéologique qui fait que ceux qui essaient d'avoir d'autres regards sont en grande difficulté. C'est très caractéristique de cette séquence-là.
À cette hégémonie politique et idéologique s'ajoute une forme d'hégémonie sociologique. Il y a aujourd'hui dans l'armée, dans la bureaucratie de l'État, des gens qui sont complètement convaincus de l'idéologie dont je parle. Il y a des éléments importants à comprendre. L'armée d'aujourd'hui n'est certainement pas la même que celle de 1970. Aujourd'hui, les forces qui représentent les nationalistes, les religieux, et donc une bonne partie des colons, sont partout au pouvoir. Comment peut-on penser le rapport à la colonisation, ce n'est pas simplement une question de nombre, mais comment peut-on le penser si on a toujours été éduqué dans une perspective que ces colonies sont naturelles, après tout ? Cela a commencé depuis 1967, mais les premiers mouvements importants ce sont les années 80, des gens sont nés là-bas dans les années 80-90. Ce sont des gens qui considèrent que les colonies font partie du paysage, très naturellement.
On parle souvent du nombre de colons, de l'étendue spatiale de ces colonies, mais il y a une relation dialectique entre ces 500 000 colons et l'idéologie dont je parlais. Ce n'est plus simplement un groupe de pression, c'est une force politique qui est au pouvoir. Nous sommes dans un autre cas de figure que les séquences précédentes, et il faut que nos politiques arrivent à comprendre que nous ne sommes plus dans l'époque d'Oslo ou dans les années 1980. Nous sommes dans un schéma où les logiques coloniales tendent à l'emporter.
Face à cela, le deuxième mot, est le mot « renoncement ». Le renoncement de ce qu'on appelle la Communauté internationale. Il n'est pas vrai de penser que la Communauté internationale aurait toujours renoncé. Il y a des époques, notamment celle d'Oslo, où elle a essayé de jouer un rôle dans une autre configuration. Mais depuis, il y a un vrai renoncement de cette Communauté internationale. C'est le cas notamment des États-Unis, qui ont essayé de faire quelques pas avec John Kerry, mais en aucun cas n'ont cherché à bouger en quoi que ce soit cette nouvelle réalité. Et il faut bien comprendre que le renoncement est une décision politique. La France, dont on a parlé à plusieurs reprises, depuis 7-8 ans, depuis la présidence de François Hollande mais même avant celle-ci, a aussi renoncé sur le plan diplomatique. J'insiste bien là-dessus, car si Pierre Duquesne était là, il monterait sur ses grands chevaux en disant que sur le plan économique la France fait des choses, et cela est vrai. La France fait des choses sur le plan culturel, elle a une présence au Consulat de Jérusalem. Denis Pietton a fait un travail formidable, mais du point de vue diplomatique il est bien clair que la France a renoncé. Je vous cite une phrase qui résume tellement de choses. Nous étions à la Knesset 9 ( * ) en train d'écouter François Hollande, et j'attendais des références au droit international. Rien. Les collaborateurs qui étaient à côté de lui m'ont demandé ce que j'avais pensé de ce discours. « Il aurait au moins pu faire référence au droit international », dis-je. Ils me répondent alors « oui, on y a pensé au droit international, mais on voulait passer entre les gouttes ». La grande ambition de la France était donc d'éviter un incident au sein de la Knesset ! C'est quelque chose d'assez terrifiant ! Autre exemple de ce renoncement, qui est quelque part très pervers, c'est lorsqu'au 14 juillet de cette année, on parle du nucléaire, juste quelques jours après qu'il y a eu un accord entre la Communauté internationale et l'Iran. On pose la question à François Hollande de savoir s'il est satisfait. Il répond « oui je suis très satisfait de cet accord, parce que comme ça, ni l'Arabie Saoudite, ni Israël ne chercheront à avoir l'arme nucléaire ». Ce qui était absolument consternant, cela fait rigoler, mais c'est dramatique ! Les journalistes n'ont pas eu cette réaction élémentaire de dire qu'Israël est une puissance nucléaire, avec en plus ce que l'on appelle en termes techniques, la « triade dissuasive ». Nous sommes là dans une posture de renoncement. Même si nous avons un ministre des Affaires étrangères qui a tenté, il y a quelques mois, d'aller devant le Conseil de sécurité, avec le succès que l'on sait car il s'est fait bloquer par les États-Unis. On a vraiment quelque part un vrai renoncement. Si on prend l'Union européenne, bien sûr qu'elle a eu des positions très fortes du point de vue des textes. Incontestablement, elle a eu des positionnements très justes avec l'idée qu'il faut un État palestinien avec Jérusalem comme capitale. Ce sont vraiment des déclarations fortes. Mais une fois que l'on a dit ça, dans l'action il n'y a plus rien. Il n'y aucune espèce d'initiative forte, aucune espèce de volonté politique d'agir. Il y a au contraire une sorte de bousculade pour savoir qui sera le plus pusillanime. Là, vraiment, il y a beaucoup de bousculades. Nous sommes dans cette situation-là où la Communauté internationale, malheureusement, a renoncé et a renoncé à voir la réalité, et a renoncé davantage encore à agir. Quand je dis « voir la réalité », il ne faut pas qu'on nous dise qu'on ne sait pas, car il y a par exemple le rapport des Consuls à Bruxelles, qui nous donne chaque année un point très détaillé de la situation à Jérusalem-Est. Il suffit de les lire. De lire aussi les recommandations qui sont quelques fois d'une audace tout à fait étonnante, et on peut comprendre que nos politiques à Bruxelles n'osent pas, car parmi nos recommandations audacieuses et réalistes, figure la possible invitation d'une personnalité palestinienne dans nos Consulats. Même cela n'est pas possible.
Enfin, troisième mot pour caractériser cette situation aujourd'hui, et là aussi cela a été très différent dans les séquences historiques, et en particulier dans celle d'Oslo, et même avant, c'est la « division des Palestiniens ». Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on pourrait facilement montrer à quel point cette division est profonde. Elle est évidemment politique, on le sait, le Hamas d'un côté, le Fatah de l'autre. Mais même au sein du Hamas il y a des différences, au sein du Fatah il y en a sans doute encore davantage. Il y a des différences idéologiques très profondes, évidemment marquées par la coupure territoriale. Nous sommes dans une situation de division profonde et toutes les tentatives d'essayer de revenir vers de l'Union nationale ont été avortées, quelques fois du fait d'éléments extérieurs importants, mais la plupart du temps parce qu'ils ont été incapables de réaliser cette union. Il n'y a pas d'union, alors qu'ils ont pourtant essayé de faire une série d'accords qui, à chaque fois, donnaient de bons principes mais qui n'ont pas été mis en oeuvre. Cela fait qu'aujourd'hui les Palestiniens sont tout de même en situation très difficile. Je parle de la population palestinienne, en Cisjordanie, à Gaza, à Jérusalem-Est. Où est leur autorité ? Je dirais que le dernier sondage palestinien, sorti ce matin, dit qu'il y a deux-tiers des Palestiniens qui veulent la démission de Abbas. Dans le cas d'une présidentielle, s'il y avait un candidat du Hamas et un candidat du Fatah, c'est le candidat du Hamas qui l'emporterait, sauf si le candidat du Fatah, toujours d'après ces sondages, s'appelle Marouane Barghouti. On voit bien la crise politique profonde qu'il y a chez les Palestiniens !
Par rapport à cela, pour conclure, je crains que si on ne nomme pas cette séquence historique pour ce qu'elle est, on n'avance pas. Nous sommes aujourd'hui, non pas simplement dans un affrontement, dans une confrontation, mais plus que jamais dans un système, je dirais de nature néocoloniale qui génère un système d'apartheid. Par conséquent, l'idée qu'on puisse penser qu'il y ait un seul État aujourd'hui, c'est vrai, il existe, cet État, mais c'est un État d'apartheid. Il faudrait ajouter la situation beaucoup plus difficile qu'il y a 20 ans. On revient vraiment à une période où les Palestiniens d'Israël se retrouvent dans une situation où ils sont marginalisés. Par conséquent, prétendre qu'à partir de là on pourrait créer un État binational est évidemment, à mon avis, une utopie. Je crois vraiment qu'il faut se battre contre cette idée. Il faut d'abord voir et comprendre, comme disais Camus, que mal nommer les choses c'est ajouter aux malheurs du monde . Et bien nommons les choses pour ce qu'elles sont : c'est un apartheid, disons-le, montrons-le, et battons-nous contre cela, pour en revenir à une vraie chose possible, une vraie séparation où chacun aura son destin ! Cela implique de rester sur la ligne des deux États, de faire en sorte qu'il y ait un État palestinien à côté de l'État d'Israël. En ce sens, je critiquais la France, mais il faut saluer nos parlementaires qui font un beau travail. Je reviens, pour terminer, vers une résolution d'il y a exactement un an, ici même au Sénat, qui a été adoptée à quelques voix de majorité, et qui dit clairement qu'il faudrait absolument que le gouvernement français reconnaisse, dans un contexte particulier, un État palestinien. Je pense que c'est cela l'idée, il faut continuer à se battre pour un État palestinien, et faire comprendre qu'aujourd'hui nous sommes dans une séquence historique qui est particulièrement grave. Je vous remercie.
M. Benjamin Sèze : Merci beaucoup M. Chagnollaud pour cette conclusion. Merci à toutes et à tous pour votre participation et la pertinence des questions qui ont permis de riches échanges. C'est la fin de cette journée. Merci beaucoup.
* (1) Membres du groupe interparlementaire d'amitié France-Palestine : M. Gilbert ROGER, Président , Mme Leila AÏCHI, M. David ASSOULINE, Mme Marie-France BEAUFILS, Mme Esther BENBASSA, M. Michel BILLOUT, M. Jean-Pierre BOSINO, M. Yannick BOTREL, Mme Laurence COHEN, Mme Annie DAVID, M. Michel DELEBARRE, Mme Michelle DEMESSINE, Mme Évelyne DIDIER, Mme Josette DURRIEU, M.Bernard FOURNIER, M. Jean-Claude FRÉCON, M. Jean-Pierre GODEFROY, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, M. François GROSDIDIER, M. Loïc HERVÉ, M. Robert HUE, Mme Gisèle JOURDA, Mme Christiane KAMMERMANN, Mme Bariza KHIARI, Mme Élisabeth LAMURE, M. Jean-Yves LECONTE, M. Jacques MÉZARD, M. Jean-Vincent PLACÉ, Mme Christine PRUNAUD, M. Daniel REINER, M. Jean-Pierre SUEUR, Mme Catherine TASCA, M. Jean-Pierre VIAL, Mme Evelyne YONNET.
________________
N° GA 133 - Mai 2016
* 2 Programme de l'Organisation des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie.
* 3 Silwan est un quartier de Jérusalem-Est.
* 4 Le Temple de Jérusalem, lieu saint du judaïsme, détruit en 70 par Titus.
* 5 Camp de réfugiés palestiniens au sud de Bethléem.
* 6 Répression policière le 21 mars 1960 à Sharpeville, un township sud-africain de la ville de Vereeniging qui fit 69 morts et 178 blessés.
* 7 IDF : Israël Defense Forces.
* 8 Une des plus grandes colonies israéliennes en Cisjordanie occupée.
* 9 Le 18 novembre 2013, lors de la visite d'État du Président de la République en Israël.







