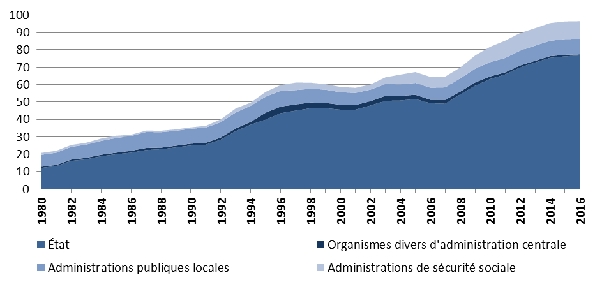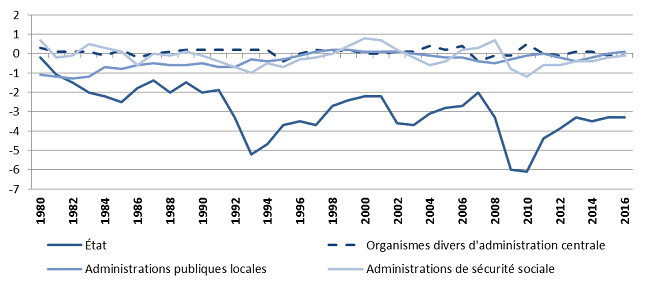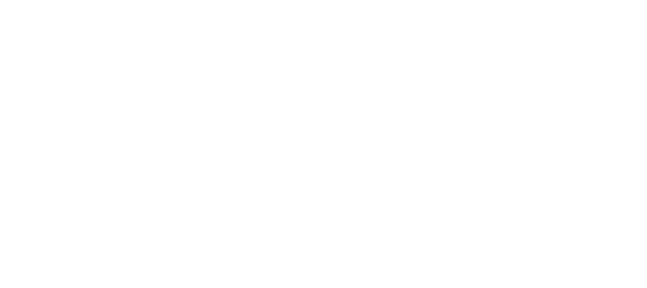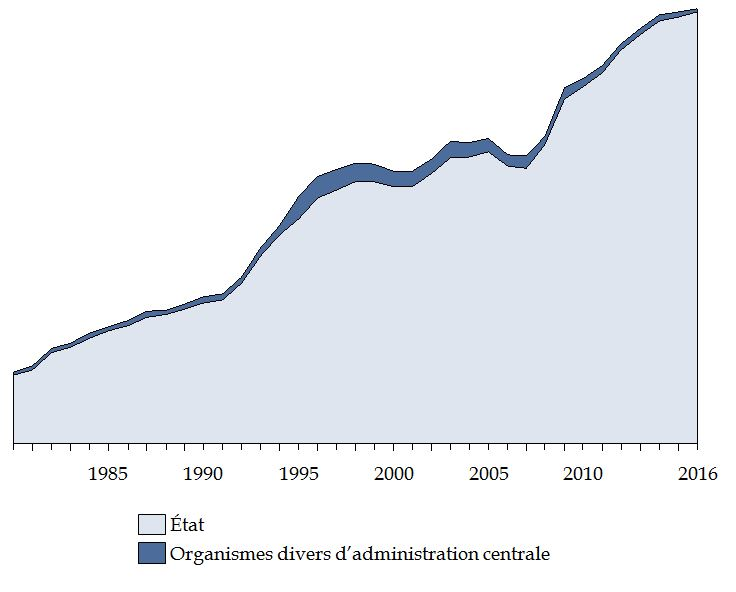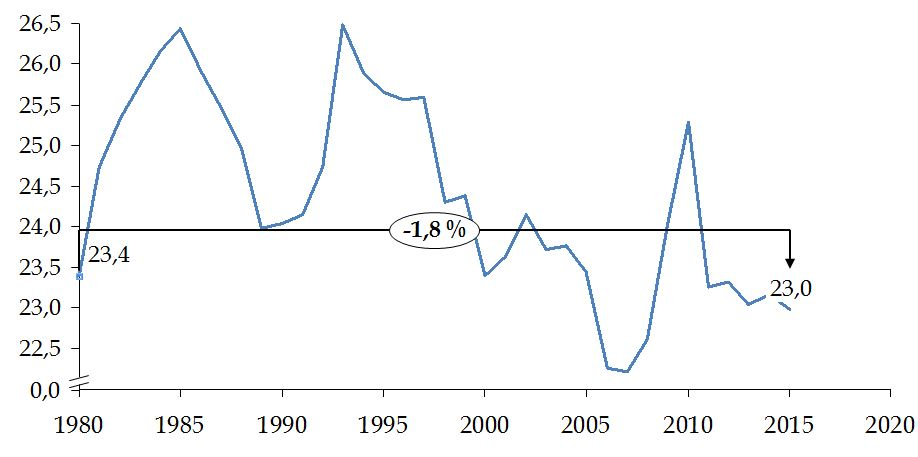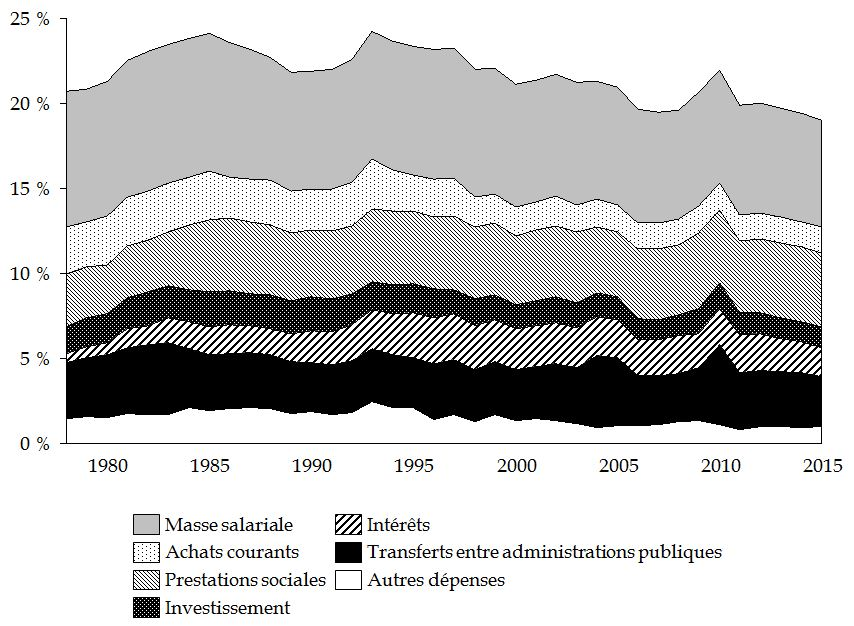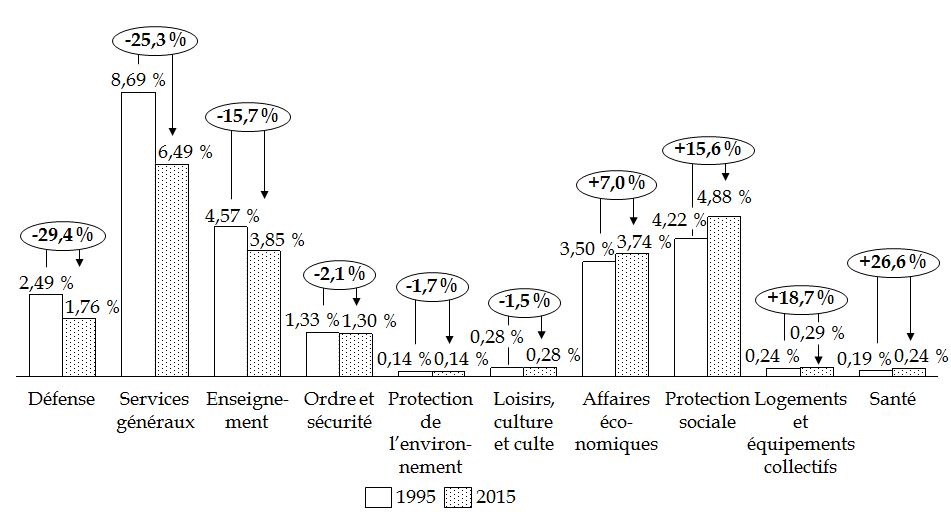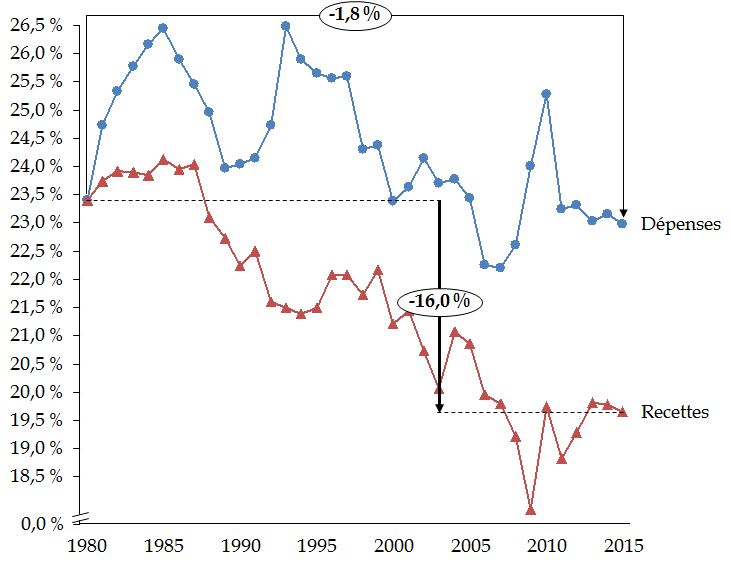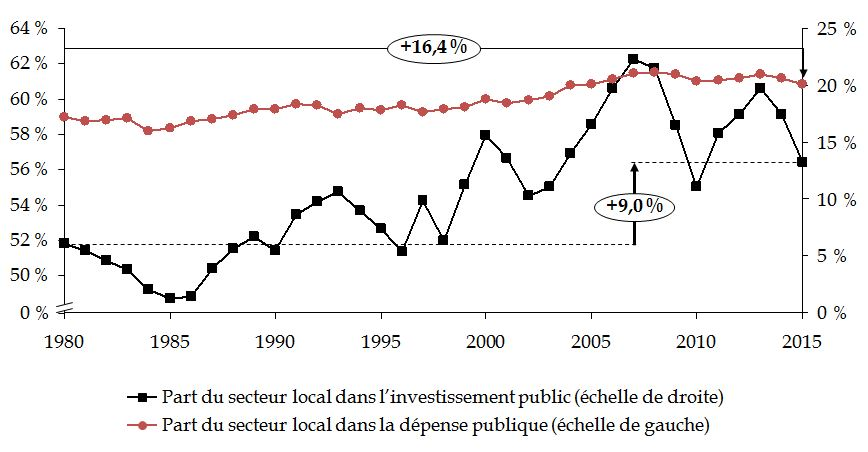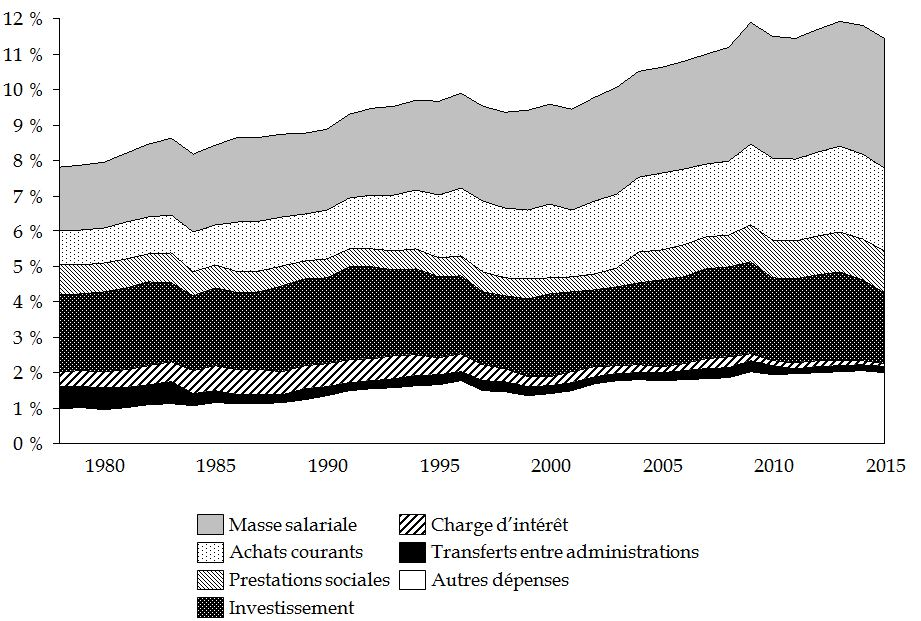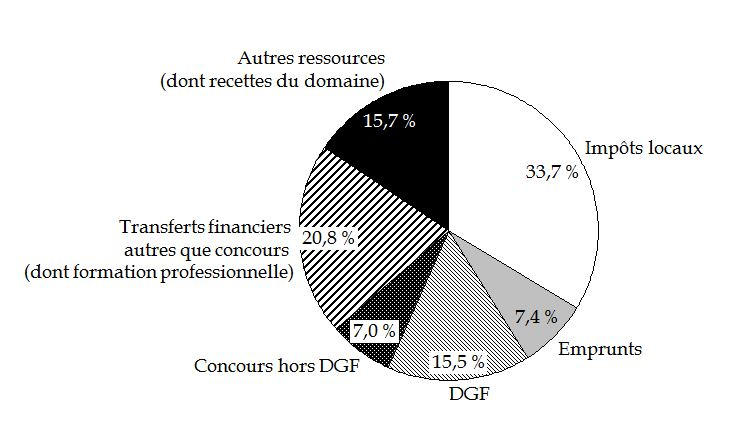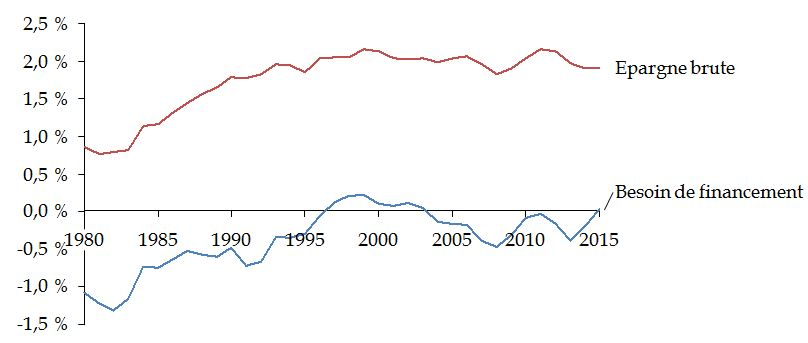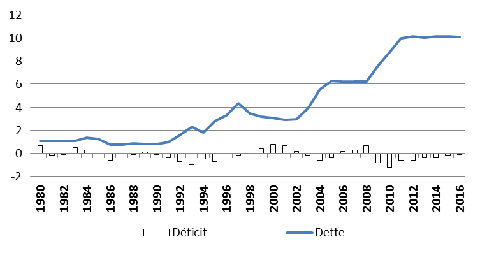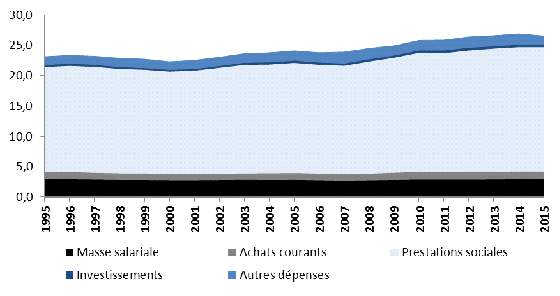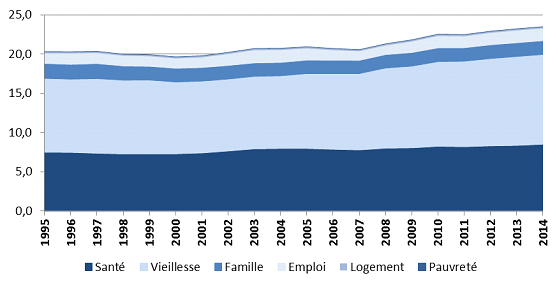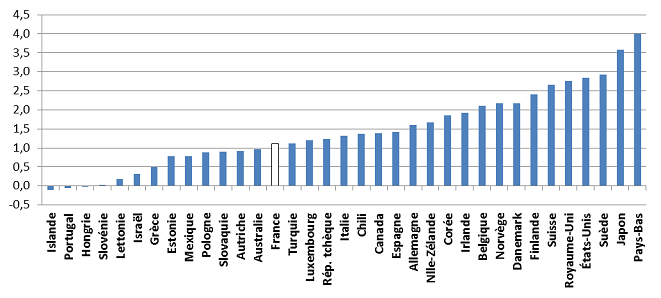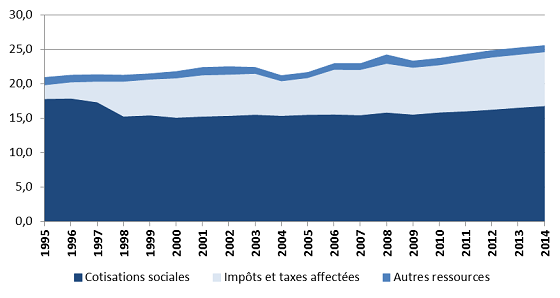Rapport d'information n° 566 (2016-2017) de M. Albéric de MONTGOLFIER , rapporteur général, fait au nom de la commission des finances, déposé le 31 mai 2017
Disponible au format PDF (3,7 Moctets)
-
AVANT-PROPOS
-
I. L'INEXORABLE ÉLÉVATION DU NIVEAU DE
LA DETTE PUBLIQUE
-
A. UNE DÉRIVE QUARANTENAIRE DES FINANCES
PUBLIQUES
-
1. Une succession de déficits publics qui ne
peut être imputée à la seule conjoncture
économique...
-
2. ...mais à une maîtrise insuffisante
de la dépense publique
-
3. Des recettes publiques qui demeurent
heurtées
-
4. Le ralentissement de la croissance et de
l'inflation
-
5. Des comparaisons européennes
défavorables à la France
-
1. Une succession de déficits publics qui ne
peut être imputée à la seule conjoncture
économique...
-
B. LA CONTRIBUTION DES DIFFÉRENTES
ADMINISTRATIONS À LA HAUSSE DE LA DETTE PUBLIQUE
-
1. L'État et ses opérateurs :
une croissance des dépenses contenue, mais plus dynamique que celle des
recettes
-
a) Des dépenses dont la croissance est
globalement contenue malgré le dynamisme des prestations sociales et de
la charge d'intérêts
-
b) Une diminution des recettes liée à
la baisse des impôts indirects
-
c) L'interdiction de recourir à
l'endettement s'appliquant aux organismes divers d'administration
centrale
-
a) Des dépenses dont la croissance est
globalement contenue malgré le dynamisme des prestations sociales et de
la charge d'intérêts
-
2. Les collectivités territoriales :
des dépenses en forte progression que l'alourdissement de la charge
fiscale ne finance que partiellement
-
3. Les administrations de sécurité
sociale : une forte hausse des dépenses incomplètement
compensée par une fiscalisation des ressources
-
1. L'État et ses opérateurs :
une croissance des dépenses contenue, mais plus dynamique que celle des
recettes
-
C. LA DIFFICILE DÉFINITION DU
PÉRIMÈTRE DE LA DETTE PUBLIQUE
-
1. La requalification de la dette
ferroviaire
-
a) La création du service annexe
d'amortissement de la dette (Saad)
-
b) La création d'un nouvel
établissement : Réseau ferré de France
-
c) 19 milliards d'euros de dette ferroviaire
réintégrée à la dette publique depuis 2007
-
d) Une dette à la soutenabilité
toujours incertaine malgré la création de SNCF
Réseau
-
a) La création du service annexe
d'amortissement de la dette (Saad)
-
2. L'impact asymétrique des programmes
d'assistance financière de la zone euro sur la dette publique de la
France
-
3. Les engagements hors bilan : un volume
global en hausse, des niveaux de risque variés
-
4. La question de l'exclusion de certaines
dépenses du périmètre de la dette publique
-
1. La requalification de la dette
ferroviaire
-
A. UNE DÉRIVE QUARANTENAIRE DES FINANCES
PUBLIQUES
-
II. LES ENJEUX MULTIPLES DE LA GESTION DE LA DETTE
PUBLIQUE
-
A. UN CONTEXTE COMMUN À TOUTES LES
ENTITÉS PUBLIQUES
-
B. DES GESTIONS DIFFÉRENCIÉES SELON
LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
-
1. La gestion de la dette de l'État
-
a) Du circuit du Trésor aux marchés
financiers
-
(1) 1945-1966 : Un système
« à robinets ouverts »
-
(2) De 1966 aux années 1980 : la
montée en puissance du recours par l'État aux marchés
financiers et à l'émission de dette de moyen et long terme
-
b) Le cadre juridique de la gestion de dette par
l'État
-
c) La France, un émetteur majeur de la zone
euro
-
d) Une gestion de la dette assurée par
l'Agence France Trésor
-
e) Le rôle des spécialistes en valeur
du Trésor
-
f) Des émissions par adjudication au prix
demandé
-
g) Prévisibilité, diversification et
liquidité
-
(1) Un programme d'émission
prévisible mais souple
-
(2) Une diversification des titres
-
(3) Le maintien de la liquidité des
titres
-
h) L'impact d'un contexte de taux faibles
-
(1) L'encaissement de primes à
l'émission
-
(2) Une légère hausse de la
maturité des titres de dette
-
i) Une gestion active de la dette se traduisant
par un volume important de rachats
-
a) Du circuit du Trésor aux marchés
financiers
-
2. La gestion de la dette des collectivités
territoriales
-
a) Un endettement local encadré par la
« règle d'or »
-
b) Les effets durables de la crise des emprunts
« toxiques » de 2008
-
(1) Des produits risqués souscrits en masse
par le secteur public local
-
(2) Un danger rendu manifeste par
l'éclatement de la crise américaine des
« subprimes » en 2008
-
(3) Une dette locale encore davantage
fragilisée avec l'appréciation brutale du franc suisse en
2015
-
c) Une recomposition du paysage financier local
qui n'est sans doute pas encore achevée
-
(1) Une concurrence accrue entre les financeurs du
secteur public local
-
(2) D'un point de vue juridique, un encadrement
renforcé limité aux seuls emprunts « à
risque »
-
(a) L'interdiction des produits les plus
complexes
-
(b) La validation législative des contrats
d'emprunts structurés
-
(3) Une montée en puissance de
l'endettement obligataire qui reste à confirmer
-
(a) Des émissions obligataires qui ont
longtemps été l'apanage des collectivités locales les plus
importantes
-
(b) La question du traitement prudentiel des
créances détenues sur des collectivités territoriales dans
le bilan des établissements financiers
-
(c) Un nouvel acteur dont le modèle est
inspiré de celui des agences scandinaves de financement
local : l'Agence France Locale
-
a) Un endettement local encadré par la
« règle d'or »
-
3. La gestion de la dette sociale
-
1. La gestion de la dette de l'État
-
C. LES DÉTENTEURS DE LA DETTE
PUBLIQUE
-
A. UN CONTEXTE COMMUN À TOUTES LES
ENTITÉS PUBLIQUES
-
III. LA DETTE FRANÇAISE, UN POIDS POUR
L'ÉCONOMIE
-
A. L'UTILITÉ LIMITÉE DE LA DETTE
PUBLIQUE FRANÇAISE
-
B. LES INCIDENCES DE LA DETTE PUBLIQUE SUR LA
CROISSANCE
-
C. LA MENACE D'UNE HAUSSE DE LA CHARGE DE LA
DETTE
-
D. LES RISQUES DE DÉRIVE DE LA DETTE
PUBLIQUE
-
A. L'UTILITÉ LIMITÉE DE LA DETTE
PUBLIQUE FRANÇAISE
-
IV. RÉDUIRE LA DETTE PUBLIQUE, RELANCER LA
CROISSANCE ÉCONOMIQUE : UNE CONCILIATION NÉCESSAIRE
-
A. LES ENJEUX DU REDRESSEMENT DES COMPTES
PUBLICS
-
B. UNE « RÈGLE DU
TIERS » DE LA CONSOLIDATION BUDGÉTAIRE
-
C. LES VOIES ET MOYENS DE LA MAÎTRISE DE LA
DÉPENSE PUBLIQUE
-
D. VERS UNE NOUVELLE NORME DE
DÉPENSES
-
1. Les outils actuels de suivi de la
dépense et leurs limites
-
2. La norme de dépenses : un
instrument d'autant plus efficace qu'il est simple et lisible
-
3. Une norme de dépenses s'appliquant
à l'ensemble des administrations publiques
-
4. Une norme associée à la
définition d'une trajectoire d'investissement public
-
1. Les outils actuels de suivi de la
dépense et leurs limites
-
A. LES ENJEUX DU REDRESSEMENT DES COMPTES
PUBLICS
-
I. L'INEXORABLE ÉLÉVATION DU NIVEAU DE
LA DETTE PUBLIQUE
-
EXAMEN EN COMMISSION
-
LISTE DES PERSONNES CONSULTÉES
N° 566
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017
|
Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 mai 2017 |
RAPPORT D'INFORMATION
FAIT
au nom de la commission des finances (1) sur les évolutions , les perspectives et la gestion de la dette publique de la France ,
Par M. Albéric de MONTGOLFIER,
Rapporteur général,
Sénateur
|
(1) Cette commission est composée de : Mme Michèle André , présidente ; M. Albéric de Montgolfier , rapporteur général ; Mme Marie-France Beaufils, MM. Yvon Collin, Vincent Delahaye, Mmes Fabienne Keller, Marie-Hélène Des Esgaulx, MM. André Gattolin, Charles Guené, Francis Delattre, Georges Patient, Richard Yung , vice-présidents ; MM. Michel Berson, Philippe Dallier, Dominique de Legge, François Marc , secrétaires ; MM. Philippe Adnot, François Baroin, Éric Bocquet, Yannick Botrel, Jean-Claude Boulard, Michel Bouvard, Michel Canevet, Vincent Capo-Canellas, Thierry Carcenac, Jacques Chiron, Serge Dassault, Bernard Delcros, Éric Doligé, Philippe Dominati, Vincent Éblé, Thierry Foucaud, Jacques Genest, Didier Guillaume, Alain Houpert, Jean-François Husson, Roger Karoutchi, Bernard Lalande, Marc Laménie, Nuihau Laurey, Antoine Lefèvre, Gérard Longuet, Hervé Marseille, François Patriat, Daniel Raoul, Claude Raynal, Jean-Claude Requier, Maurice Vincent, Jean Pierre Vogel . |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
La dette publique occupe une place toute particulière dans l'histoire de France, dès lors que la dégradation des finances royales et la forte hausse de l'endettement du pays ont compté parmi les causes de la Révolution. En effet, comme le souligne l'économiste américain Eugene White, « en 1788 [...] la dette dévorait le plus gros des recettes du roi, ce qui conduisit à l'insolvabilité du royaume et à la convocation des États-Généraux » 1 ( * ) ; jouissant traditionnellement du droit de consentir à l'impôt 2 ( * ) , ces derniers devaient « aider à surmonter toutes les difficultés [...] relativement à l'état de[s] finances » 3 ( * ) - pour reprendre les termes de la lettre adressée par le roi Louis XVI aux gouverneurs de provinces -, en particulier en apportant un soutien à une réforme fiscale longtemps repoussée. Toutefois, le 17 juin 1789, les députés du Tiers état, accompagnés de quelques représentants de la noblesse et du clergé aux États généraux, se constituaient en Assemblée nationale, ouvrant symboliquement la période révolutionnaire.
En dépit de cela, bien que la dette publique ait, au gré de ses évolutions durant les XIX e et XX e siècles - généralement en lien avec les conflits armés -, pu constituer épisodiquement un sujet de préoccupation, force est de constater qu'elle ne s'est que tardivement imposée comme un « problème politique », n'entrant que de manière progressive dans le débat public, notamment, à en croire Benjamin Lemoine 4 ( * ) , avec la publication, en 2006, du rapport dit « Pébereau » 5 ( * ) , commandé par Thierry Breton, alors ministre de l'économie et des finances, mais aussi en raison de la crise de la dette souveraine dans la zone euro en 2010-2011. L'initiative de Thierry Breton se justifiait, selon lui, par le fait que « la dette publique restait un sujet largement ignoré du grand public » 6 ( * ) , impliquant « d'éclairer les Françaises et les Français, de manière transparente, indépendante et non partisane sur notre endettement, son origine et ses conséquences » 7 ( * ) . Si le poids de la dette publique dans la richesse nationale était élevé - représentant près de 67 % du produit intérieur brut (PIB) -, elle restait cependant en deçà de ses niveaux « historiques » ; ainsi que le fait apparaître le graphique ci-après, la dette française atteignait 96 % du PIB en 1880, 237 % du PIB en 1921, ou encore 173 % du PIB en 1932. Même, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, la dette frôlait 270 % du PIB 8 ( * ) .
Graphique n° 1 : Évolution de la dette publique entre 1880 et 2012
(en % du PIB)
Note de lecture : pour certaines périodes, les données relatives à la part de la dette publique dans le PIB ne sont pas disponibles.
Source : Fonds monétaire international (2012)
Dans ces conditions, comment expliquer que la dette publique ne soit que récemment devenue une préoccupation politique à part entière ? De toute évidence, ce phénomène n'est pas propre à la France ; selon Julien Duval, l'endettement public n'a acquis une saillance politique qu'en 1989 aux États-Unis, en 2004 en Allemagne et en 2008 au Royaume-Uni 9 ( * ) . Or ces pays ont, avec la France, en commun d'avoir vu leur dette publique régulièrement progresser depuis les années 1970-1980, et ce sans que cela ne constitue la conséquence d'une guerre - contrairement à ce qui était usuellement observé jusqu'alors. Surtout, à la différence des évolutions intervenues au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la hausse des dettes publiques provoquée par les chocs pétroliers n'a pas été suivie d'une forte progression du PIB et de l'inflation, qui aurait permis, d'une part, une amélioration de la situation budgétaire et, d'autre part, une décrue de la part de l'endettement dans la richesse nationale.
En somme, l'émergence tardive de la dette publique en tant que « problème politique » s'explique par le caractère relativement inédit de la situation actuelle. Le niveau élevé de l'endettement public ne constitue pas, à proprement parler, le résultat de facteurs ponctuels - même si, au cours de la période récente, la crise économique de 2008 a largement contribué à son accroissement ; en effet, les causes de la dette actuelle s'inscrivent dans la durée et sont à rechercher dans les déficits publics qui se succèdent, en particulier en France, depuis la décennie 1970.
Face à une dette publique qui trouve davantage ses fondements dans la politique budgétaire et fiscale menée jusqu'à présent que dans des évènements conjoncturels, et dont le recul ne semble pas devoir être attendu d'éléments exogènes comme la croissance économique, une prise de conscience était impérative afin que soient prises les décisions qu'impose la nécessité de contenir la progression de l'endettement. Si la publication du rapport « Pébereau » a contribué à cette prise de conscience, l'éclatement de la crise économique en 2008, à l'origine d'une dégradation d'ampleur des finances publiques, a toutefois contrarié les espoirs d'une réduction, à moyen terme, du niveau de la dette française.
Aussi, selon les données de l'Insee, la dette publique atteignait-elle, à la fin de l'année 2016, 2 146,4 milliards d'euros, soit 96,3 % du PIB 10 ( * ) . Cela représentait une dette d'environ 75 850 euros par ménage. Malgré la faiblesse actuelle des taux d'intérêt, la charge de la dette de l'ensemble des administrations s'est élevée à 46,1 milliards d'euros 11 ( * ) la même année, c'est-à-dire un montant supérieur aux dépenses consacrées à la défense et au produit net de l'impôt sur les sociétés. À n'en pas douter, la dette publique et les charges qui s'y rattachent constituent un poids pour l'économie et viennent obérer les marges de manoeuvre budgétaires nécessaires pour faire face, le cas échéant, à un choc conjoncturel mais aussi pour engager les réformes et réaliser les investissements qui permettraient de renforcer notre potentiel de croissance.
Renoncer à maîtriser notre dette publique revient donc, aujourd'hui, à renoncer à maîtriser le destin de notre pays. Cela est vrai pour les générations actuelles, mais plus encore pour les générations futures dont nous préemptons la capacité à décider pour elles-mêmes. En somme, la dette publique constitue non seulement un « problème politique », mais aussi et surtout une question démocratique.
La tâche reste immense. Près de dix années après la publication du rapport « Pébereau », le présent rapport d'information a pour ambition de renouveler les analyses portant sur notre dette publique, alors que celle-ci a, au cours des dernières années, fortement progressé en raison de la crise économique, que ses modalités de gestion ont significativement évolué et que ses incidences potentielles sur la croissance économique sont désormais mieux connues.
Par ailleurs, ce rapport s'attache à examiner les voies et moyens d'une réduction de la dette publique. En effet, l'expérience récente - qui a mis en évidence les limites des politiques d'austérité - a montré que celle-ci ne pouvait constituer l'alpha et l'oméga de notre stratégie budgétaire ; en effet, si la consolidation des comptes publics doit bien tendre à réduire notre niveau d'endettement, elle doit également contribuer à la constitution de nouvelles marges de manoeuvre en vue de réduire les prélèvements obligatoires et accroître les investissements publics.
I. L'INEXORABLE ÉLÉVATION DU NIVEAU DE LA DETTE PUBLIQUE
À quelques brèves exceptions, généralement liées à une conjoncture économique favorable, la dette publique a inexorablement progressé, en France, depuis le milieu des années 1970 , passant de 15 % du PIB en 1974 à 96,3 % en 2016. Une telle évolution ne saurait surprendre dans la mesure où 1974 a constitué le dernier exercice au cours duquel les administrations publiques ont affiché un excédent budgétaire. Un déficit significatif apparaît dès l'année 1975, au cours de laquelle est déployé le plan de relance visant à contrer les effets du premier choc pétrolier. Depuis lors, le solde public est resté déficitaire en dépit de phases, ponctuelles, de redressement .
Graphique n° 2 : Évolution de la dette publique française entre 1974 et 2016
(en % du PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee et du FMI)
Comme le fait apparaître le graphique ci-avant, les accélérations de la dette publique font généralement suite à une dégradation de la situation économique . Pour autant, les facteurs de nature conjoncturelle n'expliquent que partiellement la dynamique de la dette au cours des décennies passées. Ainsi que s'attachent à le montrer les développements qui suivent, si au cours des périodes de ralentissement de la conjoncture, les pouvoirs publics ont effectivement - et ce de manière légitime - laissé s'accroître le déficit public, notamment en raison du jeu des stabilisateurs automatiques, ceux-ci n'ont, inversement, pas su profiter des embellies économiques pour assainir les comptes publics.
C'est donc bel et bien la gestion de nos finances publiques, plus que les facteurs conjoncturels, qui est à l'origine de notre niveau actuel d'endettement . Aussi, Michel Pébereau, auteur du rapport précité, parlait-il, à juste titre, de la « facilité de la dette » et l'ancien président de la commission des finances du Sénat, Philippe Marini, de « l'insoutenable légèreté des dettes publiques » 12 ( * ) . L'on ne saurait être surpris, dans ces conditions, que la France affiche, aujourd'hui, un niveau de dette publique plus élevé que ses partenaires européens .
|
La dette nette des administrations publiques
Les données précitées portent sur
la dette publique brute au sens de Maastricht
. Cette
dernière se distingue de la dette publique nette qui se calcule en
soustrayant à la dette brute certains actifs. Selon l'Insee, la dette
nette est égale à la dette brute après déduction
des dépôts, crédits et titres de créances
négociables, c'est-à-dire les actifs exigibles, qui sont
détenus par les administrations publiques. Force est de constater que si
celle-ci est moins élevée que la dette brute
Évolution de la dette publique nette entre 1995 et 2016 (en % du PIB) |
|
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee) S'il est également tenu compte des actifs physiques des administrations, il est alors question du patrimoine net des administrations publiques , qui affichait une valeur positive représentant 12,3 % du PIB en 2015, après avoir fortement décru à la suite de la crise économique puisqu'il atteignait 58,2 % du PIB en 2007, sans doute en lien avec le recul des investissements publics (voir infra ). |
A. UNE DÉRIVE QUARANTENAIRE DES FINANCES PUBLIQUES
L'alourdissement de la dette publique française durant les quatre dernières décennies trouve sa source dans une succession ininterrompue de déficits publics . Loin d'être imputable aux seuls aléas de la conjoncture, ce phénomène est aussi et surtout lié à la gestion des finances publiques, ainsi que tend à le montrer la dérive des dépenses publiques, qui ont affiché, au cours des dernières années, une croissance supérieure à la richesse nationale.
1. Une succession de déficits publics qui ne peut être imputée à la seule conjoncture économique...
Il ne fait aucun doute que l'évolution du solde public suit les mouvements de la conjoncture économique , tendant à se dégrader lorsque la croissance du PIB ralentit et à s'améliorer quand les circonstances sont plus favorables, comme le montre le graphique ci-après.
Graphique n° 3 : Évolution du solde et variations conjoncturelles
(en % du PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
Ce phénomène, relativement intuitif, s'explique tout d'abord par le jeu des stabilisateurs automatiques qui correspondent aux mécanismes par lesquels les finances publiques parviennent à atténuer les conséquences des évènements conjoncturels sur l'activité économique. À titre d'exemple, en cas de ralentissement conjoncturel, la baisse des recettes fiscales et la hausse des prestations sociales permettent d'atténuer les fluctuations de l'activité.
Il est délicat d'identifier la portion des déficits strictement imputable à la conjoncture dans la mesure où ces derniers découlent également de décisions dites discrétionnaires des pouvoirs publics. Pour autant, il est possible d'appréhender la part conjoncturelle - et, par conséquent, la part structurelle - du solde public à l'aide des hypothèses relatives au PIB potentiel 13 ( * ) .
Graphique n° 4 : Variations annuelles des composantes structurelle et conjoncturelle du solde public
(en points de PIB)
Note de lecture : entre 2008 et 2009, le solde public s'est dégradé de 4 points de PIB ; cette évolution a résulté d'un recul de 2,1 points de PIB du solde structurel et de 1,9 point du solde conjoncturel.
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee et de la Commission européenne)
Aussi, afin de déterminer la part conjoncturelle du déficit entre 1990 et 2016, ont été utilisées les estimations de PIB potentiel avancées par la Commission européenne au titre de la période 2007-2016 ; s'agissant des années antérieures, il a été retenu l'hypothèse d'une croissance potentielle de 2,1 % par an en volume, correspondant à la moyenne de la progression du PIB entre 1990 et le déclenchement de la crise économique. Sur cette base, le solde conjoncturel a été calculé à l'aide de la méthode appelée « règle du pouce », qui consiste à considérer qu'en pratique celui-ci est proche de la moitié de l'écart de production en France 14 ( * ) .
En dépit des limites inhérentes à la
méthodologie retenue
- notamment en raison des difficultés
liées à l'estimation du PIB potentiel -, cet exercice permet de
mettre en évidence les grandes « tendances »
à l'oeuvre
. Ainsi, le graphique ci-avant montre qu'au
début des années 1990 et de la décennie 2000 de même
qu'en 2008-2009, le creusement du déficit était en partie
dû à la conjoncture. Inversement, dans des proportions moindres,
l'amélioration du contexte conjoncturel a contribué à
l'amélioration du solde à la fin des années 1990 et en
2010-2011.
Surtout, les résultats obtenus mettent en évidence une gestion asymétrique des finances publiques au cours du cycle économique . Durant les phases de forte dégradation de la conjoncture, les pouvoirs publics ont déployé des politiques budgétaires et fiscales allant au-delà du seul jeu des stabilisateurs automatiques - ce qui se justifie par des motifs économiques ; cette tendance est particulièrement patente en 1992, en 2002 et plus encore en 2009, années marquées par une hausse significative du déficit structurel 15 ( * ) . Néanmoins, lors des phases d'amélioration du contexte économique, le souci des pouvoirs publics de stabiliser la conjoncture est moins évident, l'amélioration du solde structurel ayant été, en particulier, limitée entre 1998 et 2000 de même que, dans une moindre mesure, entre 2004 et 2007.
Graphique n° 5 : Évolution des soldes publics structurel et conjoncturel
(en % du PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee et de la Commission européenne)
Cela signifie que les pouvoirs publics n'ont pas
véritablement su profiter des embellies conjoncturelles pour redresser
les comptes publics
. De manière paradoxale, les ajustements
budgétaires sont essentiellement intervenus au cours de périodes
de croissance faible ou moyenne, comme en 1996 et, surtout, entre 2011 et 2013.
En 2010 déjà, Paul Champsaur et Jean-Philippe Cotis, alors
respectivement président de l'Autorité de la statistique publique
(ASP) et directeur général de l'Insee, indiquaient que
«
si, en revanche, l'effort avait été
également accompli en haut de cycle, en maîtrisant les
dépenses tout en veillant à éviter les baisses de
prélèvements non soutenables, notre déficit serait
aujourd'hui plus faible
»
16
(
*
)
. D'ailleurs, il est intéressant de relever
qu'
entre 1990 et aujourd'hui, à de rares exceptions
- en
1996 et 1997 -, les déficits publics ont été
principalement structurels
.
2. ...mais à une maîtrise insuffisante de la dépense publique
La succession de déficits publics constatée au cours des dernières décennies , y compris lors des périodes caractérisées par une conjoncture économique favorable, trouve son origine première dans une maîtrise insuffisante des dépenses publiques .
Graphique n°
6
:
Évolution des dépenses publiques, du PIB
et du ratio de
dépenses publiques
(évolution en %, sauf mention contraire)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
Sur l'ensemble de la période 1990-2016 , les dépenses publiques ont progressé plus rapidement que le PIB . En effet, les dépenses ont affiché une croissance moyenne en valeur de 3,6 % par an, contre une hausse moyenne du PIB en valeur de 3 %. Ce phénomène peut s'expliquer par une corrélation seulement partielle des dépenses aux évolutions conjoncturelles . Certes, les périodes de ralentissement conjoncturel ont généralement été marquées par une accélération des dépenses, comme au cours de la récession du début des années 1990 ou en 2002 - l'année 2009 faisant figure d'exception, dès lors que l'ajustement contra-cyclique semble alors avoir davantage reposé sur une baisse des recettes. Pour autant, durant les phases d'amélioration du contexte conjoncturel, les dépenses publiques ont rarement présenté un taux d'évolution inférieur à celui du PIB ; une telle situation n'a pu être observée, de manière prolongée, qu'entre 1997 et 2000, à la faveur d'une période d'expansion de l'activité.
Ces différents éléments permettent de comprendre l'évolution de la part des dépenses publiques dans le PIB. Si cette dernière a reculé d'environ 3 points de PIB entre 1997 et 2000, elle semble franchir un nouveau palier à chaque décélération de la conjoncture . Au total, entre 1990 et 2016, le poids de la dépense publique dans la richesse nationale a progressé de 6,6 points de PIB. Force est néanmoins de relever que les dépenses ont progressivement marqué le pas à compter de 2010-2011, sans pour autant parvenir à infléchir le ratio de dépenses publiques en raison de l'atonie de la croissance. Quoi qu'il en soit, il paraît avoir existé, jusqu'à présent, un « effet cliquet » de la dépense publique , en ce sens que toute hausse de cette dernière était difficilement réversible et apparaissait presque comme acquise.
Quelles sont les dépenses publiques ayant le plus contribué à cette dynamique ? À titre de rappel, ces dernières peuvent être ventilées en six catégories principales : la masse salariale, les achats courants, les prestations sociales, les investissements, les charges d'intérêts et les autres dépenses.
Ainsi que le fait apparaître le graphique ci-après, la progression des dépenses des administrations publiques a été, pour l'essentiel, portée par les prestations sociales - en particulier celles liées à la santé et au vieillissement (voir infra ). Entre 1980 et 2016, leur part dans le PIB est passée de 18,3 % en 1980 à 25,9 %. Sur la seule période 1990-2016, les prestations sociales expliquent près de 90 % de l'accroissement du ratio de dépenses, augmentant de 5,8 points de PIB sur un total de 6,6 points.
La masse salariale des administrations, elle, a affiché une faible progression, limitée à 0,3 point de PIB, entre 1980 et 2016, alors qu'elle a augmenté de 0,9 point de PIB entre 1990 et 2016 . En effet, après avoir diminué à la fin des années 1980, la masse salariale est repartie à la hausse en 1991 pour se stabiliser aux alentours de 13 % du PIB durant la décennie 1990.
Les achats courants ont présenté une relative stabilité , que soit considérée la période 1980-2016 (- 0,1 point de PIB) ou celle comprise entre 1990 et 2016 (+ 0,2 point de PIB).
Les investissements publics ont marqué un recul significatif , de 0,7 point de PIB entre 1980 et 2016 et même de 1,2 point de PIB au cours de la période 1990-2016. Cela laisse à penser, comme s'attachera à le montrer le présent rapport ultérieurement, que l'accroissement de la dette publique ne trouve pas véritablement sa source dans des dépenses ayant vocation à préparer l'avenir .
Surtout, les investissements apparaissent comme la principale « variable d'ajustement » lorsque des efforts budgétaires doivent être consentis ; au milieu des années 1990, leur niveau avait déjà reculé dans la perspective de l'intégration de la France à l'Union économique et monétaire (UEM), qui impliquait le respect de certains critères relatifs à la dette et au déficit publics, puis, de nouveau à compter de 2012, en vue de répondre aux exigences découlant de nos engagements européens en matière budgétaire.
Graphique n° 7 : Évolution des dépenses des administrations publiques
(en points de PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
Enfin, il convient d'examiner la situation particulière de la charge d'intérêts. Si cette dernière a augmenté de 0,6 point de PIB entre 1980 et 2016, elle est aujourd'hui plus faible qu'en 1990, et ce de 0,7 point de PIB. En effet, au cours des années récentes, la charge d'intérêts a suivi une évolution paradoxale ; la part de celle-ci dans le PIB a reculé entre 2002 et 2006, en 2008-2009 et a engagé un net déclin depuis 2013, qui ne s'est pas arrêté à ce jour, alors que la dette a continué à progresser (voir graphique ci-après).
Graphique n°
8
:
Évolution de la part de la dette publique
et de la charge
d'intérêts dans le PIB
(en points de PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
Ce phénomène est lié à une diminution quasi-constante des taux d'intérêt depuis le début des années 1990 . Ainsi, alors qu'il atteignait 9,5 % en 1983, le taux d'intérêt apparent de la dette publique s'élevait, en 2016, à seulement 2 %. Ce phénomène a été amplifié, de toute évidence, par la réduction de la prime de risque consécutive à l'intégration de la France à la zone euro et, plus récemment, par le programme de rachats d'actifs déployé par la Banque centrale européenne (BCE) depuis 2015.
Graphique n° 9 : Évolution du taux d'intérêt apparent de la dette publique
(en points de PIB)
Note de lecture : le taux d'intérêt apparent de la dette publique au cours d'une année n est le rapport entre la charge d'intérêts des administrations publiques constatée cette année n et le montant de la dette publique à la fin de l'année n - 1 .
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
Le recul des taux d'intérêt a permis aux pouvoirs publics de bénéficier d'importantes marges de manoeuvre budgétaires . À titre d'illustration, si le taux d'intérêt apparent constaté en 1990 s'était appliqué en 2016, la charge d'intérêts se serait élevée à 7,4 % du PIB au lieu de 2 % du PIB - ce qui aurait représenté une charge de la dette supérieure de près de 125 milliards d'euros à son montant constaté. Cela laisse entrevoir à quel point la baisse des taux d'intérêt a rendu moins aiguë la contrainte pesant sur l'évolution des dépenses publiques - et atténué, en particulier, les exigences d'efficience de la dépense.
3. Des recettes publiques qui demeurent heurtées
De toute évidence, au cours de la décennie 1990 et au début des années 2000, les recettes des administrations publiques, et notamment les prélèvements obligatoires, n'ont pas évolué au même rythme que les dépenses publiques . Ayant constaté que la progression des prélèvements obligatoires n'avait que partiellement suivi celle des dépenses, en 2010, Paul Champsaur et Jean-Philippe Cotis notaient : « à partir de 1997, une fois l'admission en UEM acquise, les pouvoirs publics semblent avoir manifesté une grande réticence à voir le taux de prélèvements obligatoires (en % du PIB) augmenter, fût-ce de manière spontanée, en phase haute de cycle » 17 ( * ) ; ces auteurs considéraient même que « le faux sentiment d'aisance financière qu'entraîne cette hausse purement temporaire des prélèvements obligatoires [en raison de l'embellie conjoncturelle] et la crainte de se voir reprocher une hausse des impôts dont ils ne sont pourtant pas à l'origine [ont] alors [poussé] les pouvoirs publics à abaisser la pression fiscale et sociale » 18 ( * ) .
Il en a résulté qu'une fois passé l'effet momentané de l'amélioration de l'activité sur les recettes, les baisses des prélèvements obligatoires, dès lors qu'elles n'étaient pas associées à une maîtrise des dépenses des administrations, conduisaient à une dégradation du déficit. À cet égard, Paul Champsaur et Jean-Philippe Cotis estimaient, en avril 2010, qu'« en l'absence de baisses de prélèvements, la dette publique serait d'environ 20 points plus faible » 19 ( * ) qu'elle ne l'était alors.
Pour autant, ceci ne doit pas conduire à conclure - si l'on examine la situation d'ensemble des administrations publiques - que l'ampleur du niveau actuel de la dette publique serait principalement imputable à des baisses de la fiscalité . En premier lieu, il convient de relever que le taux de prélèvements obligatoires n'est jamais revenu en deçà de son niveau de 1990. Force est même de constater que celui-ci a progressé de 1,5 point de PIB entre 1990 et 2007. En second lieu, conséquemment à la crise économique, la part des prélèvements obligatoires dans la richesse nationale s'est accrue de manière considérable ; entre 2009 et 2013, celle-ci a augmenté de 3,8 points de PIB, passant de 41 % à 44,8 % du PIB, avant de revenir progressivement à 44,3 % en 2016. Toutefois, cette évolution n'a permis de compenser que partiellement le creusement de l'écart entre les recettes et les dépenses publiques intervenu du fait de la crise - ces dernières ayant été marquées par un sursaut de 4 points de PIB entre 2008 et 2013.
Graphique n°
10
:
Évolution de la part des dépenses, des recettes
et des
prélèvements obligatoires dans le PIB
(en points de PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
Surtout, il apparaît que
si la première
augmentation des prélèvements obligatoires observée en
2010 et 2011 (+ 1,6 point de PIB) était associée à
une réduction du poids des dépenses (- 0,9 point de PIB), celle
opérée en 2012 et 2013 (+ 2,1 points de PIB) était
concomitante à une nouvelle hausse des dépenses (+ 1,1 point
de PIB)
. Ces données viennent confirmer que la forte
accélération de la dette publique durant la période
2012-2016, au cours de laquelle celle-ci a crû de plus de 10 points de
PIB, est liée, à titre principal, à une maîtrise
insuffisante des dépenses publiques
- qui, bien qu'ayant
été contenues en 2015 et 2016, n'en sont pas pour autant revenues
à leur niveau d'avant 2012. Par ailleurs, elles montrent que
le
levier fiscal ne peut plus guère être actionné afin de
consolider les comptes publics
eu égard au poids actuel des
prélèvements obligatoires.
4. Le ralentissement de la croissance et de l'inflation
L'évolution de la dette publique est, ainsi que cela a déjà été montré, étroitement liée aux aléas conjoncturels. Toutefois, le contexte économique peut également exercer une influence structurelle sur la dynamique de la dette publique et son poids dans la richesse nationale .
En particulier, le rythme de l'inflation et de la croissance du PIB a une incidence directe sur la charge de la dette publique, le solde public primaire et le ratio d'endettement . En premier lieu, l'inflation détermine le niveau du taux d'intérêt réel - qui correspond au taux d'intérêt nominal, convenu au moment de l'emprunt, minoré du taux d'inflation. Une hausse de l'inflation vient réduire le taux d'intérêt réel ; par suite, pour la part de la dette publique non indexée - qui constitue, en France, la majorité du stock de dette -, la charge d'intérêts s'en trouve réduite. Inversement, un ralentissement de l'inflation accroît le taux d'intérêt réel et donc la charge de la dette - qui contribue à l'augmentation du déficit des administrations et, par conséquent, de la dette publique.
En deuxième lieu, une décélération
de l'inflation et de la croissance du PIB est synonyme d'une moindre
progression des recettes publiques, qui évoluent avec le PIB et le
niveau des prix ; à titre d'illustration, le produit de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) suit le volume de la consommation mais aussi les
prix des biens échangés. Il en résulte un creusement de
l'écart entre les recettes et les dépenses publiques dont
l'évolution n'est que partiellement corrélée aux
mouvements du PIB et de l'inflation, compte tenu du poids, à ce jour,
des dépenses de santé et de celles liées au vieillissement
qui répondent, du moins en partie, à des facteurs d'une autre
nature - ainsi que s'attachent à le montrer les développements
ultérieurs portant sur la dette des administrations de
sécurité sociale (ASSO). Même, un recul non anticipé
de l'inflation peut conduire à une aggravation du déficit public
dès lors que les budgets sont généralement définis
et exécutés en termes nominaux
- impliquant que le
montant des dépenses soit arrêté sur la base
d'hypothèses de hausse des prix surévalués
20
(
*
)
. Toutes choses égales
par ailleurs,
ces phénomènes concourent au maintien du
solde public primaire - c'est-à-dire hors charge
d'intérêt - à un niveau élevé, à
l'origine d'un « effet boule de neige »
en vertu
duquel la hausse de la dette publique est autoentretenue sous le poids des
charges d'intérêts (voir
infra
).
Enfin, le rythme de la croissance du PIB et de l'inflation a une incidence mécanique sur le ratio de dette publique . En effet, pour un stock de dette et un taux d'intérêt réel donnés, une progression du PIB et du niveau des prix réduit la part de la dette dans le PIB, dans la mesure où elle entraîne une augmentation du PIB nominal.
Graphique n° 11 : Évolution de la croissance du PIB (1970-2015)
(évolution, en %)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de la Banque mondiale)
Graphique n° 12 : Évolution de l'inflation (1970-2015)
(évolution, en %)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de la Banque mondiale)
Dans ces conditions, le rapide déclin de la dette publique dans les pays occidentaux au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ne saurait surprendre . En France, le recul du ratio d'endettement, de 270 % du PIB en 1944 à environ 15 % du PIB à la fin des années 1960, a été encouragé par le fort dynamisme de la croissance économique et de l'inflation 21 ( * ) , qui a alimenté les recettes publiques mais aussi la hausse du PIB nominal.
Toutefois, il semble illusoire, aujourd'hui, d'attendre une réduction du poids la dette publique portée par la croissance du PIB et l'inflation . En effet, force est de constater que ces deux variables ont tendanciellement ralenti depuis les années 1970, et ce dans l'ensemble des pays industrialisés, comme le font apparaître les graphiques ci-avant. De multiples facteurs peuvent expliquer cette évolution, comme la fin du rattrapage économique des pays européens et du Japon ou la décélération de la production et, s'agissant de l'inflation, du déploiement à compter de la fin des années 1970 et du début des années 1980, à la suite des États-Unis et du Royaume-Uni, de politiques monétaires plus restrictives - dans un contexte d'internationalisation accrue des échanges commerciaux.
Quoi qu'il en soit, le couple croissance du PIB/inflation est passé, en France, de 4,1 %/8,9 % en moyenne au cours de la décennie 1970, à 2,4 %/7,4 % durant les années 1980, à 2,0 %/1,9 % pendant la décennie 1990, à 1,4 %/1,7 % au cours des années 2000 et à 0,9 %/1,1 % entre 2011 et 2015. Une telle évolution n'a pas, bien évidemment, favorisé une nette diminution de la part de la dette publique française dans le PIB . Pour autant, elle ne saurait expliquer à elle seule le niveau élevé de l'endettement de notre pays, qui demeure significativement supérieur à celui observé dans d'autres États, notamment européens, connaissant aussi un ralentissement de la croissance et de l'inflation.
5. Des comparaisons européennes défavorables à la France
Au cours des vingt dernières années, trois périodes peuvent être distinguées concernant l'évolution de la dette publique française . Dans un premier temps, entre 1995 et 2007, cette dernière a progressé d'un peu moins de 10 points de PIB, à un rythme proche de celui observé en Allemagne, et convergé vers la moyenne de la zone euro, qui lui est restée supérieure jusqu'en 2008. En dépit de la hausse enregistrée au cours de cette première période, force est de constater que la dette de la France a affiché un net ralentissement relativement aux années antérieures, celle-ci étant passée de 20,8 % du PIB en 1980 à 55,8 % en 1995.
Dans un deuxième temps, la dette publique française a connu une forte accélération à la suite du déclenchement de la crise économique et financière . Entre 2007 et 2013, elle a cru de 28 points de PIB, alors que le ratio moyen d'endettement progressait de 26,4 points de PIB dans la zone euro et 28,1 points de PIB dans l'Union européenne. Selon une étude du Fonds monétaire international (FMI) 22 ( * ) , cette forte progression de la dette dans l'ensemble des États de l'Union européenne s'expliquerait notamment, pour un tiers environ, par l'assistance financière apportée au secteur bancaire - le reste étant imputable aux pertes de recettes et à la hausse des dépenses sociales liées à la dégradation du contexte économique.
Graphique n° 13 : Évolution de la dette publique dans l'Union européenne
(en % du PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données d'Eurostat et de l'Insee)
Dans un troisième temps, enfin, la dette publique française a commencé à s'écarter, à compter de 2012-2013, de la trajectoire constatée dans la zone euro et, plus généralement, dans l'Union européenne. En effet, un écart est alors apparu entre le ratio d'endettement de la France et le ratio moyen constaté dans la zone euro. Celui-ci n'a eu de cesse de se creuser jusqu'à présent, d'autant que la part de la dette dans le PIB a commencé à reculer dans la zone euro à partir de 2015, la dette française continuant, elle, à progresser . Ainsi, en 2016, la dette publique de la France était supérieure de 7,1 points de PIB à la moyenne de la zone euro - alors qu'elle l'égalait encore en 2012 - et de 12,8 points de PIB à la moyenne de l'Union européenne.
Comment expliquer que la dette française demeure à l'écart des évolutions à l'oeuvre dans le reste de l'Europe ? Il apparaît, simplement, que la France continue d'afficher l'un des déficits publics les plus importants de l'Union européenne, ainsi que le montre le graphique ci-après. Seule l'Espagne, en 2016, présentait un déficit supérieur à la France, s'élevant à 4,5 % du PIB contre 3,4 % du PIB.
Graphique n° 14 : Le solde public dans l'Union européenne en 2015 et 2016
(en % du PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données d'Eurostat)
En 2016, la France figurait ainsi parmi les cinq derniers États de l'Union européenne faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif en application du Pacte de stabilité et de croissance (PSC) , aux côtés de la Croatie, de l'Espagne, de la Grèce, du Portugal et du Royaume-Uni. Or, au sein de ce groupe, la France est le pays affichant la plus faible amélioration de son solde effectif au cours de la période 2012-2016 , à hauteur de 1,4 point de PIB contre une moyenne de 5,8 points de PIB dans les autres pays ou de 2,6 points de PIB dans l'ensemble de l'Union européenne (voir graphique ci-après).
Graphique n° 15 : Évolution des soldes effectif et structurel des États membres soumis à la procédure de déficit excessif (PDE) entre 2012 et 2016
(en % du PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données d'Eurostat)
En revanche, en matière d'ajustement structurel , soit de réduction du déficit structurel, la France occupe une position « médiane » parmi les États soumis à la procédure de déficit excessif . Si l'amélioration de son solde structurel, de 1,7 point de PIB entre 2012 et 2017, selon les données publiées par la Commission européenne, a été supérieure à celle observée au Portugal et en Espagne, elle est demeurée en deçà de l'effort consenti en Grèce, en Croatie ou au Royaume-Uni.
En réalité, la France se distingue plus particulièrement par la composition de son ajustement budgétaire . Elle est, en effet, le seul pays en déficit excessif à connaître, au cours de la période 2012-2016, tout à la fois une hausse de la part de ses dépenses publiques dans le PIB et une augmentation de ses recettes. Comme le fait apparaître le graphique ci-après, le poids de la dépense dans la richesse nationale s'est accru de 0,3 point de PIB, quand celui des recettes progressait de 2 points. Si certains États, comme la Grèce, le Portugal ou la Croatie ont vu la part des recettes publiques dans le PIB croître davantage qu'en France, ces derniers ont accompagné ce mouvement d'une baisse de leurs dépenses. D'ailleurs, en moyenne, dans l'Union européenne, si le ratio de recettes publiques a légèrement augmenté de 0,9 point de PIB, la part des dépenses publiques dans le PIB a reculé de 2 points.
Graphique n° 16 : Évolution des dépenses et des recettes publiques des États membres soumis à la procédure de déficit excessif (PDE) entre 2011 et 2016
(en % du PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données d'Eurostat)
En somme, en plus d'être d'une ampleur relativement limitée, la consolidation des finances publiques en France a pour caractéristique d'avoir principalement reposé sur l'augmentation des recettes et non sur une véritable maîtrise des dépenses publiques , ainsi que s'était attaché à le mettre en évidence votre rapporteur général à l'automne dernier dans un rapport sur l'évolution des prélèvements obligatoires entre 2012 et 2016 23 ( * ) .
Dans ces conditions, il n'est guère étonnant que l'écart entre le ratio de dépenses publiques dans le PIB français et la moyenne de la zone euro se soit approfondi au cours des dernières années . Celui-ci est passé de 6,7 points de PIB en 2011 à 8,5 points de PIB en 2016. Cette évolution est liée au fait que la France a affiché une croissance moyenne de ses dépenses publiques entre 2012 et 2016, de 1,7 % par an en valeur, supérieure à celle de la zone euro (+ 1,3 %) et à l'Union européenne dans son ensemble (+ 1,5 %).
Graphique n°
17
:
Évolution de la part des dépenses publiques dans le PIB
au
sein de l'Union européenne
(en % du PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données d'Eurostat)
Il en résulte que, depuis 2016, la France est le pays de l'Union européenne dont le poids des dépenses publiques dans le PIB (56,2 % du PIB) est le plus élevé , et ce devant la Finlande désormais (56,1 % du PIB).
B. LA CONTRIBUTION DES DIFFÉRENTES ADMINISTRATIONS À LA HAUSSE DE LA DETTE PUBLIQUE
Toutes les catégories d'administrations publiques ont contribué, à des degrés divers, à la progression de la dette publique . Pour autant, il apparaît que cette évolution a été essentiellement portée par l'État, qui a été à l'origine, entre 1980 et 2016, de près de 85 % de la hausse du poids de l'endettement public dans la richesse nationale. À compter du début des années 1990, la dynamique de la dette publique a également été alimentée par la dette des administrations de sécurité sociale (ASSO) ; quasi inexistante auparavant, cette dernière explique environ 12 % de l'accroissement du ratio d'endettement français. La contribution des administrations publiques locales (APUL) à la croissance de la dette publique a été, quant à elle, plus modeste, approchant 3 %, tandis que celle des organismes divers d'administration centrale (ODAC) a été nulle, en dépit d'une élévation de leur niveau d'endettement à compter de 1995, résorbée depuis.
Graphique n° 18 : Évolution de la dette des différentes catégories d'administrations publiques
(en % du PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
Les contributions des différentes catégories d'administrations publiques à la hausse de la dette publique entre 1980 et 2016 sont cohérentes avec l'évolution de leurs déficits respectifs au cours de cette période . Ainsi que le fait apparaître le graphique ci-après, c'est bien au niveau de l'État que se sont concentrés les déficits successifs observés au cours des quarante dernières années, les déficits restant plus contenus en ce qui concerne les collectivités territoriales de même que les administrations de sécurité sociale (ASSO) et plus encore dans le cas des organismes divers des organismes d'administration centrale (ODAC).
Pour autant, il convient de relever que l'évolution des déficits des différentes catégories d'administrations est d'interprétation complexe , en raison, notamment, des interactions financières qui peuvent exister entre elles et des modifications de périmètres intervenues au cours du temps, en particulier à la suite des mouvements de décentralisation. Aussi une analyse fine des recettes des dépenses des sous-secteurs des administrations est-elle nécessaire afin de mieux appréhender les facteurs ayant concouru à la croissance de notre niveau d'endettement.
Graphique n° 19 : Évolution du déficit des différentes catégories d'administrations publiques
(en % du PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
1. L'État et ses opérateurs : une croissance des dépenses contenue, mais plus dynamique que celle des recettes
C'est l'administration publique centrale 24 ( * ) - et, en son sein, l'État - qui porte la majeure partie de la dette publique : en 2016, elle représentait 80 % du total de la dette publique. Si le poids de la dette centrale dans la dette publique a toujours été important, ce qui se comprend aisément au regard de l'organisation administrative française, il n'en reste pas moins qu'il a significativement crû au cours des quarante dernières années : environ 40 % de la dette publique était détenue par d'autres administrations au début des années 1980, contre moins de 20 % aujourd'hui. Ainsi, la part de la dette publique détenue par l'État a augmenté alors même que la proportion de dépenses publiques effectuées par l'État baissait.
Graphique n° 20 : Évolution de la dette des administrations centrales depuis 1980
(en % du PIB)
Source : commission des finances (à partir des données de l'Insee)
La dette des administrations publiques centrales a progressé de façon quasi-continue depuis le début des années 1980 : même si elle a légèrement reflué à la fin des années 1970 et des années 1990, ainsi que de 2004 à 2007, la dette de l'administration publique centrale par rapport au produit intérieur brut a été multipliée par 6 depuis la fin des années 1970.
Trois grands facteurs d'augmentation de la dette de l'État et de ses opérateurs peuvent être distingués.
Tout d'abord, le périmètre de la dette de l'administration publique centrale peut évoluer à la suite de la reprise ou de la requalification de dettes initialement détenues par d'autres entités publiques , voire privées comme dans le cas du service annexe d'amortissement de la dette (Saad) de la SNCF à la demande d'Eurostat en 2007. La question de la dette implicite de l'État et de l'évolution de son périmètre sera abordée ultérieurement dans le présent rapport.
La dette de l'État augmente également en fonction de son besoin de financement primaire , c'est-à-dire de l'excédent de ses dépenses (hors charge d'intérêt) sur les recettes.
Enfin, le paiement des intérêts de la dette peut lui-même concourir à une hausse de l'encours de dette. En effet, l'État fait « rouler » sa dette : en l'absence d'excédent primaire, il finance le remboursement du capital de la dette arrivée à échéance par un endettement supplémentaire - une pratique interdite aux collectivités territoriales. Le service de la dette contribue donc directement à augmenter le stock de dette.
Comprendre l'origine de l'accroissement de la dette de l'administration publique centrale suppose d'abord une analyse plus détaillée de ses recettes et de ses dépenses.
a) Des dépenses dont la croissance est globalement contenue malgré le dynamisme des prestations sociales et de la charge d'intérêts
Les dépenses de l'administration publique centrale peuvent être réparties en sept postes : outre ceux définis ci-avant pour l'ensemble des administrations publiques (masse salariale, achats courants, prestations sociales, investissement, intérêts et autres dépenses), doit être distinguée la catégorie des transferts aux autres administrations.
Les trois principaux postes de dépenses de l'administration centrale en 2015 étaient constitués de la masse salariale (qui représente 33 % du total des dépenses), des prestations sociales (23 %) et des transferts entre administrations publiques (16 %). Ces trois types de dépenses représentent, à eux seuls, plus de 70 % des dépenses de l'État et des organismes divers d'administration centrale.
Globalement, les dépenses de l'administration publique centrale rapportées au produit intérieur brut sont restées stables depuis la fin des années 1970 : elles sont passées de 23,4 % du PIB en 1980 à 23 % en 2015. Cette apparente fixité découle en réalité d'une succession de périodes d'augmentation de la dépense et de baisses, comme le met en évidence le graphique ci-après.
Graphique n° 21 : Évolution des dépenses de l'administration publique centrale depuis 1980
(en points de PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
En outre, cette stabilité globale correspond à des évolutions différenciées selon les dépenses considérées .
La réduction la plus forte concerne les investissements : leur part dans le PIB a été divisée par deux depuis la fin des années 1970. De même, les achats courants ont connu une diminution marquée, témoignant des efforts faits sur les dépenses de fonctionnement de l'État.
La masse salariale de l'État a également baissé , quoique de façon plus mesurée, en lien avec la légère réduction des effectifs de l'État qui ont reculé, en moyenne, de 1 % chaque année entre 2004 et 2014, la diminution plus accusée du nombre de fonctionnaires et de militaires (respectivement - 1,6 % et - 1,3 %) étant partiellement compensée par la hausse du nombre de contractuels (+ 2,3 %).
Cette tendance à la baisse pourrait cependant être remise en cause par le mouvement d'augmentation tant des effectifs que de la rémunération des personnels de l'État (recrutements dans les ministères dits « prioritaires » mais aussi dégel du point d'indice et mesures catégorielles) impulsé par le dernier Gouvernement : la hausse de la masse salariale de l'État pour 2017, qui pourrait atteindre 4 % en l'absence de mesures correctrices, annulerait presque l'intégralité des efforts de maîtrise réalisés depuis dix ans.
Graphique n° 22 : Évolution des principaux postes de dépenses de l'administration centrale depuis 1980
(en points de PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
En revanche, les prestations sociales ont fortement crû : elles sont supérieures d'environ un tiers à leur niveau de 1980 par rapport au PIB. La hausse la plus importante (proportionnellement au niveau initial de chaque catégorie de dépenses) touche la charge d'intérêts de l'État : malgré le contexte récent de faibles taux d'intérêt, celle-ci a été multipliée par trois sur la période et représente désormais 1,7 % du PIB.
Sur la période la plus récente, la nomenclature des dépenses par fonction (dite COFOG) permet de retracer, sinon les politiques publiques, du moins les secteurs qui ont porté la hausse des dépenses et ceux qui, au contraire, ont vu leur poids relatif réduit.
|
La nomenclature des dépenses par fonction (COFOG) Les dépenses des administrations publiques sont ventilées suivant une nomenclature internationale définie dans le système de comptes nationaux de 1993 et révisée en 1999 : la COFOG ( Classification of the Fonctions of Government ). Cette classification répartit les dépenses des administrations publiques en dix catégories selon leur finalit é : services publics généraux ; défense ; ordre et sécurité publics ; affaires économiques ; protection de l'environnement ; logement et équipements collectifs ; santé ; loisirs, culture et culte ; enseignement ; protection sociale. Le champ des administrations publiques et le montant des dépenses sont ceux de la comptabilité nationale. Conventionnellement, les dépenses d'intérêts de la dette, lorsque la finalité de ces dépenses d'intérêts ne peut être distinguée, sont comptabilisées dans la fonction « services publics généraux ». Source : Insee |
La défense est le secteur qui accuse la diminution la plus marquée : le poids des dépenses de défense dans le PIB est réduit d'un tiers entre 1995 et 2015. Les dépenses de recherche financées par l'administration publique centrale n'ont pas non plus été épargnées : elles ont diminué de plus de 17 % en dix ans.
Graphique n°
23
: Structure
des dépenses de l'administration centrale
en 1995 et 2015 par
fonction (nomenclature « COFOG »)
(en points de PIB et en %)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
Les secteurs qui, en revanche, ont vu leur poids augmenter sont d'abord la santé (+ 27 %), les logements collectifs (+ 18 %) et la protection sociale (+ 16 %).
Au total, la maîtrise des dépenses a donc d'abord pesé sur l'investissement, en particulier sur la recherche et développement, et le budget de la défense , alors que les dépenses d'intervention connaissaient une hausse particulièrement dynamique.
b) Une diminution des recettes liée à la baisse des impôts indirects
Le poids des recettes de l'administration centrale dans le PIB a décru depuis la fin des années 1970 : celles-ci représentaient 23,4 % de la richesse nationale en 1980, contre 19,6 % en 2015.
La diminution a touché les trois principaux types de recettes perçus par l'administration publique centrale : les impôts et cotisations sociales, qui ont ainsi été réduits d'environ 10 % entre 1980 et 2015, portent près de 90 % du total de la baisse, tandis que les revenus de la propriété (c'est-à-dire du domaine de l'État) et les recettes de production (qui comprennent les recettes liées aux activités industrielles et commerciales assurées par l'administration centrale) étaient amoindris dans des proportions plus importantes encore (respectivement - 18 % et - 35 %).
Graphique n° 24 : Part des recettes et des dépenses de l'administration publique centrale dans le PIB depuis 1980
(en points de PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
Au sein des impôts et des cotisations sociales, ce sont les impôts sur la production et les importations qui expliquent la majeure partie de la baisse constatée : leur poids dans le PIB passe de 12,4 % en 1980 à 8,4 % en 2015. Ces impôts correspondent principalement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) , les droits de mutation à titre onéreux, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 25 ( * ) (TICPE) et les taxes sur les tabacs et alcools.
Les impôts sur le revenu et le patrimoine affectés à l'administration centrale, qui recouvrent l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés ont, au contraire, légèrement augmenté depuis la fin des années 1970 : ils s'élevaient à 6,7 % du PIB en 1980, contre 6,6 % en 2015 - après un point haut à 6,9 % en 2013, qui n'avait pas été atteint depuis 1987. Les cotisations sociales ont également crû.
La réduction - quoique modérée - des recettes de l'administration publique centrale par rapport au PIB pourrait s'expliquer en partie par le phénomène de concurrence fiscale .
|
La concurrence fiscale Initialement développée pour rendre compte de certaines des tendances observées en matière de choix des assiettes et d'évolution des taux d'imposition locale au sein des fédérations existantes, et en premier lieu des États-Unis, la théorie de la concurrence fiscale a d'abord concerné les interactions entre gouvernements locaux situés à un même niveau dans la hiérarchie des entités fédérales et aux contextes dans lesquels les bases imposables sont mobiles entre les circonscriptions. Dans cette situation canonique de concurrence fiscale horizontale, chacun des gouvernements locaux est tenté d'adopter un taux d'imposition un peu inférieur à celui pratiqué dans les circonscriptions voisines, dans le but d'attirer une part plus importante de la matière imposable mobile. Plus le degré de mobilité est élevé - ou encore, de manière équivalente, plus les coûts de mobilité sont faibles -, plus la concurrence fiscale horizontale sera intense . Or, précisément, la mobilité de la base taxable a été sensiblement accrue au cours des quinze dernières années au sein de l'Union européenne , non seulement par l'achèvement du Marché unique (1993) et de l'Union monétaire (1999), mais aussi par des améliorations majeures dans les infrastructures de transport et de communications. Il est dès lors loisible aux entreprises d'exploiter les différences de fiscalité, notamment sur les bénéfices des sociétés (IS), soit en choisissant d'investir davantage là où les taux effectifs d'imposition sont les plus bas, soit, plus simplement, en faisant apparaître, grâce à la manipulation des prix de transfert entre établissements au sein d'une même multinationale ou grâce à des techniques de financement à base d'endettement - dont les intérêts sont déductibles de l'assiette de l'IS -, le bénéfice imposable dans les pays où son taux d'imposition est le plus faible. Enfin, il convient de souligner qu'il existe également une forme de concurrence fiscale, dite « par comparaison » ( yardstick competition ) qui repose non pas sur la mobilité des contribuables mais sur celle de l'information : les citoyens font alors pression sur leur gouvernement pour abaisser les taux d'imposition en arguant des exemples étrangers. Source : commission des finances du Sénat (d'après J. Le Cacheux « La concurrence fiscale dans l'Union européenne », Idées économiques et sociales , vol. 154, n° 4, 2008, p. 24-29). |
Cette analyse doit cependant être nuancée dans la mesure où les impôts sur la consommation - par définition plutôt captive - ont diminué alors qu'ont augmenté ceux portant sur le revenu des ménages et des entreprises, a priori plus exposés au risque de mobilité de l'assiette (délocalisation, départ des contribuables).
Trois autres facteurs explicatifs paraissent plus convaincants, bien qu'il soit évidemment délicat de déterminer avec exactitude leur influence respective sur le montant des recettes perçues par l'administration publique centrale.
Tout d'abord, comme le soulignent Paul Champsaur et Jean-Philippe Cotis 26 ( * ) , les excédents conjoncturels de recettes en phase haute de cycle économique se sont traduits par une baisse des taux de la plupart des impôts d'État depuis l'entrée de la France dans la zone euro .
Par ailleurs, la hausse des dépenses fiscales (crédits et réductions d'impôt), qui devraient s'élever à près de 90 milliards d'euros en 2017, a contribué à l'érosion du produit fiscal. Comme le souligne la Cour des comptes 27 ( * ) , « la forte croissance des dépenses fiscales à partir de 2004 coïncide avec la mise en oeuvre d'une norme de croissance ?zéro volume? des dépenses budgétaires , et ce sont les dépenses fiscales les plus substituables à des dépenses budgétaires qui ont le plus augmenté ». Une partie de la baisse des recettes de l'administration publique centrale pourrait donc être assimilée à une hausse de la dépense.
Enfin, une part significative des impôts sur la consommation, en particulier de la TVA, a été affectée à la sécurité sociale : à partir de 2006, des parts de TVA dites « sectorielles » ont été introduites afin de financer les allègements généraux de charges sociales (TVA brute sur les alcools, sur le tabac, sur les produits pharmaceutiques...) et les transferts sont allés croissants : comme le note le Conseil des prélèvements obligatoires dans un rapport de 2015, « avec les transferts opérés à l'occasion de la réforme des retraites en 2011, la TVA est devenue un véhicule budgétaire des relations financières entre l'État et la sécurité sociale » 28 ( * ) . Les principaux transferts d'impôt sur la consommation aux administrations de sécurité sociale s'élevaient ainsi à plus de 26 milliards d'euros en 2015 29 ( * ) .
Au total, le maintien d'un besoin de financement important de l'administration publique centrale malgré une relative maîtrise des dépenses est lié à la baisse des recettes perçues par l'État et les organismes divers d'administration centrale.
c) L'interdiction de recourir à l'endettement s'appliquant aux organismes divers d'administration centrale
Depuis 2012, les organismes divers d'administration centrale (ODAC) ne peuvent, en principe, recourir à l'endettement de moyen et long terme . En effet, l'article 12 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2011 à 2014 30 ( * ) a interdit aux ODAC de s'endetter auprès d'un établissement de crédit ou d'émettre un titre de créance d'une durée supérieure à 12 mois. D'après le rapport de la commission des finances du Sénat relatif au projet de loi de programmation 31 ( * ) , cette règle visait à mettre un terme à l'augmentation de la part des ODAC dans l'endettement public constatée au cours des années 2000 : celle-ci était ainsi passée de 6,2 % de l'endettement public en 2000 à 7,7 % en 2009.
La dette des ODAC devrait donc, en théorie, relever d'un simple encours « frictionnel » lié à l'existence de besoins de trésorerie en cours d'année.
Comme le souligne un rapport d'information de la commission des finances du Sénat publié en 2014 32 ( * ) , ces dispositions ont conduit à ce que des ODAC recourent aux avances pour financer des dépenses d'investissement .
En effet, la doctrine administrative d'emploi des avances, précisée dans les documents annuels de performance du programme 823 « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics », a été adaptée et prévoit depuis 2012 la possibilité que ce programme serve à octroyer des avances de moyen ou long terme aux ODAC concernés, étant entendu que « les avances de moyen terme doivent financer exclusivement des dépenses d'investissement ». Elles sont accordées « en principe » à des organismes dont l'activité dégage des ressources propres suffisantes pour couvrir le remboursement du prêt - la capacité de remboursement de l'organisme étant appréciée par la direction du budget.
L'objectif poursuivi par la réforme de 2012 était donc double : outre une limitation de l'encours de la dette, l'interdiction du recours à l'emprunt doit aussi permettre de lutter contre la fragmentation de la dette publique dans la mesure où sa centralisation auprès de l'Agence France Trésor (voir infra ) est censée permettre de diminuer le coût de financement total de l'administration publique centrale.
Cependant, le financement de moyen terme des ODAC par des avances conduit à une violation des règles de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) : des avances sont souvent accordées pour une durée de dix ans ou plus 33 ( * ) alors même que l'article 24 de la loi organique implique que des avances ne peuvent être accordées que pour une durée de deux ans renouvelable deux fois, soit six ans au total.
En outre, les règles de limitation des avances de moyen terme aux dépenses d'investissement ne sont pas toujours respectées .
Au total, l'interdiction faite aux ODAC de s'endetter, bien que son principe soit encore justifié et légitime, pose aujourd'hui des difficultés en matière de respect du droit budgétaire et crée le risque de voir se généraliser des « quasi-subventions » aux organismes en difficulté correspondant à des avances accordées sur de très longues durées à des établissements dont les capacités de remboursement sont incertaines.
Elle doit donc s'accompagner, de la part de l'État, d'un suivi resserré des dépenses de ces organismes afin que des situations de fragilité financière puissent être repérées au plus vite.
2. Les collectivités territoriales : des dépenses en forte progression que l'alourdissement de la charge fiscale ne finance que partiellement
Les administrations publiques locales 34 ( * ) ont vu leur dette augmenter de façon continue depuis les années 1980.
Les transferts de compétences liés au processus de décentralisation ont contribué à ce que les dépenses du secteur public local connaissent une croissance très dynamique. Les administrations locales réalisent ainsi aujourd'hui une part majoritaire de l'investissement public , qui est financé pour partie par l'emprunt. Même si elles ne peuvent pas financer des dépenses de fonctionnement par l'endettement, la hausse de leur masse salariale et, en particulier pour les départements, de leurs dépenses de prestations sociales diminue leur capacité d'autofinancement et accroît, par ricochet, le besoin de financement de la section d'investissement - d'autant plus que les recettes des collectivités territoriales ont augmenté moins vite que les dépenses .
a) Une hausse de l'ensemble des dépenses
Les dépenses des administrations publiques locales ont fortement crû depuis la fin des années 1970 : alors qu'elles ne représentaient que 7,9 % du PIB en 1980, elles atteignent aujourd'hui 11,4 % de la richesse nationale, soit une hausse de près de 46 % sur la période, ce qui signifie qu'elles ont, en moyenne, progressé 1 % plus vite que le PIB chaque année . Comme le souligne Pierre Richard 35 ( * ) , l'augmentation des dépenses a été particulièrement marquée pour les régions , moins pour les départements et les communes.
Graphique n° 25 : Part des recettes et des dépenses de l'administration publique centrale dans le PIB depuis 1980
(en points de PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
Graphique n°
26
: Part du
secteur local dans l'investissement public
et la dépense publique
depuis 1980
(en points de PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
L'accroissement des dépenses des administrations locales a, dans un premier temps tout du moins, été porté par celui de l'investissement local ; la contribution apportée par les administrations locales à l'investissement public , qui a toujours été importante, s'est encore accrue : elle est passée de 51,8 % en 1980 à plus de 60 % en 2013. Cependant, les années 2014 et 2015 ont vu une réduction marquée de l'investissement local, en lien avec le cycle électoral et la baisse des dotations de l'État, et la part du secteur local dans l'investissement public est retombée à 56,4 % en 2015.
Une partie de l'augmentation des dépenses du secteur public local provient des transferts successifs de compétences jusqu'alors détenues intégralement par l'État.
Ainsi, depuis les lois de décentralisation adoptées dans la première moitié des années 1980 36 ( * ) (dites « acte I » de la décentralisation), la compétence de droit commun en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage est échue aux régions, tandis que les communes ont été chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme et de la délivrance des autorisations d'utilisation du sol. Les départements se sont vu attribuer une compétence générale en matière de prestations d'aide sociale ainsi que de prévention sanitaire et de services sociaux. La gestion et l'entretien des locaux de l'enseignement public élémentaire et préélémentaire relèvent de la commune, les collèges du département, les lycées et certains établissements spécialisés de la région. La deuxième vague de transferts de compétences, débutée en 2002 et se poursuivant jusqu'en 2014 (« acte II » de la décentralisation) se compose de trois ensembles de mesures : outre la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 37 ( * ) , qui reconnaît un droit à expérimentation aux collectivités locales, la loi de finances pour 2002 a procédé à plusieurs modifications. La gestion des services régionaux de voyageurs a ainsi été attribuée aux régions 38 ( * ) , le RMI (puis le RSA) a été transféré aux départements . Une partie du personnel des directions départementales de l'équipement (DDE) relève désormais du département et les personnels techniciens, ouvriers et de service (dits « TOS ») de l'éducation nationale (qui ne comprennent pas les enseignants) sont désormais du ressort des départements (pour les collèges) ou des régions (pour les lycées). Enfin, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite « Maptam ») 39 ( * ) , ainsi que la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « NOTRe ») 40 ( * ) , prévoient également des évolutions relatives aux compétences des échelons territoriaux, par exemple en instaurant des chefs de file sur certains domaines (la région pour le développement économique, le département pour l'aide sociale...).
Ces transferts nombreux et de grande ampleur se sont inévitablement accompagnés d'une hausse des dépenses des collectivités territoriales . Ainsi, la décennie 1980 a constitué une période de forte accélération des dépenses locales, qui peut être observée pour toutes les catégories de dépenses. Après un ralentissement au cours des années 1990, la dépense est repartie à la hausse à partir de 1998, notamment en raison de l'attribution de nouvelles compétences en matière d'aide sociale aux départements.
Graphique n°
27
:
Évolution des principaux postes de dépenses
des
administrations locales depuis 1980
(en points de PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
Cependant, d'après une note d'analyse économique de la direction générale du Trésor 41 ( * ) , la décentralisation n'expliquerait que la moitié de l'augmentation des dépenses des collectivités territoriales .
Plusieurs autres facteurs ont favorisé l'accroissement des dépenses locales.
Aux transferts de compétences s'est en particulier ajoutée la création de nouvelles structures locales , comme les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou les métropoles, qui ont porté des dépenses supplémentaires sans que les dépenses des entités préexistantes ne diminuent dans les mêmes proportions. Ces groupements ont également entraîné la création de nouveaux emplois se traduisant par une hausse de la masse salariale .
Au total, la masse salariale locale a doublé depuis la fin des années 1970 . Une partie de cette augmentation est liée à la hausse des effectifs : ceux-ci ont connu une évolution dynamique depuis les années 1980, qui ne se dément pas sur la dernière décennie. Ainsi, selon le rapport annuel sur la fonction publique de 2016 42 ( * ) , les effectifs de la fonction publique territoriale ont crû de 2,2 % chaque année, en moyenne, sur la période 2004-2014 . C'est le nombre de fonctionnaires qui connaît la hausse la plus forte (+2,4 % par an en moyenne).
La hausse de la masse salariale des administrations territoriales dépend aussi de mesures décidées par l'État, comme la réduction du temps de travail à 35 heures qui, selon l'estimation proposée par la direction générale des collectivités locales (DGCL) à la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'évaluation des conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail en 2004, représente au moins un tiers de l'augmentation de 5,9 % des dépenses de personnel des collectivités locales relevée pour 2002, ou encore, plus récemment, le dégel du point d'indice qui devrait constituer une charge de 546 millions d'euros pour le budget des collectivités territoriales en 2016.
Les collectivités territoriales subissent en effet le contrecoup de mesures dont la mise en oeuvre est décidée par l'État . Ainsi, la hausse des dépenses des organismes divers d'administration locale constatée entre 1998 et 2003, qui représente plus du tiers de l'évolution de la masse salariale des administrations locales sur cette période - alors que les ODAL ne portent qu'environ 15 % du total des dépenses publiques locales - serait liée à la création des contrats aidés , dont l'impact a été important pour les établissements publics locaux d'enseignement.
La rigidité de la masse salariale des collectivités locales provient aussi des contraintes statutaires de la fonction publique territoriale , qui limitent les capacités des élus locaux à adapter tant le volume de leurs effectifs que leur composition à des missions changeantes dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint.
Il apparaît donc qu'une gestion plus souple des effectifs locaux pourrait permettre aux administrations locales de mieux piloter leur masse salariale .
Plus largement, le coût des nouvelles réglementations pesant sur les administrations publiques locales est devenu un enjeu de débat : d'après le Conseil national d'évaluation des normes, les normes nouvelles imposées par l'État auraient représenté un coût d'environ 6,9 milliards d'euros pour les collectivités locales en 2016 43 ( * ) - contre des économies potentielles avoisinant 1,4 milliard d'euros et des recettes supplémentaires limitées à 13 millions d'euros, soit une charge nette de 5,4 milliards d'euros correspondant à environ 2 % du total des dépenses des administrations locales.
b) Des recettes dont la croissance ne permet pas de compenser intégralement le dynamisme des dépenses
Le budget des collectivités territoriales est alimenté par trois principaux types de recettes : les impôts locaux (environ 33 % du total des recettes), les transferts financiers, provenant pour l'essentiel de l'État (concours financiers comme la dotation globale de fonctionnement (DGF), par exemple, et compensation de dégrèvements d'impôts locaux, soit 42,5 % du total des ressources) et, de façon plus marginale, les recettes de production (par exemple les ressources résultant de la gestion de cantines, de crèches...).
Il faut tout d'abord noter que les collectivités territoriales et leurs établissements doivent présenter des budgets à l'équilibre : la section de fonctionnement doit être équilibrée par des recettes de fonctionnement, qui ne peuvent inclure l'emprunt. Seule la section d'investissement peut être financée par l'endettement (voir infra ).
Graphique n°
28
:
Répartition des recettes alimentant le budget
des
collectivités territoriales en 2016
(en %)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données du « Jaune » relatif aux transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales annexé au projet de loi de finances pour 2017)
Graphique n°
29
:
Évolution du besoin de financement et de l'épargne brute
des
administrations publiques locales
(en points de PIB)
Source : commission des finances (à partir des données de l'Insee)
Cette « règle d'or » explique que le besoin de financement des administrations publiques locales soit resté modéré - il n'a jamais dépassé 1,3 % du PIB depuis 1980 et il est demeuré inférieur à 0,5 point de PIB ces quinze dernières années.
La hausse des dépenses a été partiellement financée par un renforcement de la pression fiscale locale : les impôts finançant les budgets locaux représentaient 3,3 % de la richesse nationale en 1980, contre 6,12 % aujourd'hui.
Elle s'est aussi traduite par une dépendance accrue des collectivités territoriales aux ressources transférées par l'État . Outre diverses dotations locales destinées à compenser des transferts de compétence, dont la dotation globale de fonctionnement (DGF) est la plus importante, l'État central compense également aux collectivités territoriales certains dégrèvements obligatoires d'impôts locaux. Au total, les transferts financiers de l'État en direction des collectivités locales devraient représenter près de 100 milliards d'euros en 2017 44 ( * ) dont environ la moitié de concours financiers (prélèvement sur recettes et crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ») et un tiers de fiscalité transférée.
Graphique n° 30 : Évolution des recettes des administrations locales depuis 1980
(en points de PIB)
Source : commission des finances (à partir des données de l'Insee)
3. Les administrations de sécurité sociale : une forte hausse des dépenses incomplètement compensée par une fiscalisation des ressources
Quasi inexistante avant le début des années 1990 , ainsi que cela a été souligné précédemment, la dette des administrations de sécurité sociale (ASSO) a progressé significativement durant les dernières décennies . Celle-ci représentait, en 2016, 225 milliards d'euros, après 220,4 milliards d'euros en 2015. Cette dernière comprend, tout d'abord, la dette sociale entendue au sens strict , qui correspond à la somme des déficits cumulés du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), conservés par l'Acoss, s'élevant à 28,5 milliards d'euros fin 2015, et de la situation nette de la Cades, d'un montant de 126,7 milliards d'euros cette même année. La dette sociale ne tient pas compte, cependant, des dettes accumulées par les branches vieillesse des régimes des mines et des exploitants agricoles, respectivement de 0,4 milliard d'euros et de 3,3 milliards d'euros en 2015, selon la Cour des comptes 45 ( * ) . Ensuite, la dette des ASSO intègre la dette de l'Unédic , qui était de 25,7 milliards d'euros en 2015, ainsi que la dette des établissements hospitaliers - évaluée à 30 milliards d'euros en 2015 par l'Assemblée nationale 46 ( * ) .
Graphique n° 31 : Évolution de la dette et du déficit des administrations de sécurité sociale
(en % du PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
La dette des administrations de sécurité sociale a engagé son ascension lorsque ces dernières ont commencé à afficher des déficits successifs à partir du début de la décennie 1990 (voir graphique ci-avant). Toutefois, l'apparition d'excédents entre 1998 et 2002 et entre 2006 et 2008 a permis un recul de la part de la dette des ASSO dans le PIB au cours de ces deux périodes. Après un sursaut entre 2008 et 2011, du fait de la crise économique, la dette sociale s'est stabilisée aux alentours de 10 % du PIB en dépit de déficits qui demeurent importants, et ce notamment grâce à des cessions d'actifs opérées, en particulier, par les régimes complémentaires.
En tout état de cause, le caractère chronique des déficits des administrations de sécurité sociale trouve son origine dans le fait qu'au cours des dernières décennies, les hausses de ressources de ces dernières, abondées par des recettes fiscales nouvelles, n'ont pas permis de refermer complètement l'écart avec des dépenses particulièrement dynamiques .
a) Des dépenses sociales particulièrement dynamiques
En 2015, les dépenses des administrations de sécurité sociale représentaient 578,5 milliards d'euros, soit 26,5 % du PIB . L'analyse par nature de ces dépenses montre que leur progression, de 3,4 points de PIB entre 1995 et 2015, a été portée par les prestations sociales qui représentent, à elles seules, plus de 20 % du PIB aujourd'hui, contre 17 % en 1995. Ces dernières ont augmenté, en moyenne, de 3,6 % par an en valeur au cours de la période 1995-2015, soit nettement plus vite que le PIB.
La masse salariale des ASSO, quant à elle, a
crû moins rapidement
, de 2,9 % en valeur par an en moyenne,
ce qui explique la relative stabilité de son poids dans le PIB, qui
approche 3 %. Cette évolution résulte, en particulier, de la
hausse des effectifs de la fonction publique hospitalière
- qui
atteignaient 1,2 million de personnes à la fin de l'année 2014 -,
de 1,1 % par an en moyenne entre 2004 et 2014, contre + 0,4 %
dans l'ensemble de la fonction publique
47
(
*
)
.
Si la part des autres dépenses de fonctionnement dans le PIB est également restée relativement stable entre 1995 et 2015, les dépenses d'investissement ont connu plusieurs sursauts , notamment du fait des deux programmes d'investissements - les plans Hôpital 2007 et Hôpital 2012 - lancés dès 2002.
Graphique n° 32 : Évolution des dépenses des administrations de sécurité sociale par nature
(en % du PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
Aussi, afin d'appréhender plus finement les déterminants de l'évolution des dépenses sociales, il convient de compléter l'analyse par nature de ces dernières par une étude par risque - fondée sur les données des comptes de la protection sociale .
Graphique n° 33 : Évolution des dépenses des administrations de sécurité sociale par risque
(en % du PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de la Drees)
En 2014, les dépenses des administrations de sécurité sociale étaient consacrées, pour près de 38 % à la santé, 49 % à la vieillesse, 7,5 % à la famille et 6,6 % à l'emploi . Les autres « risques sociaux », soit le logement et la pauvreté, mobilisaient quant à eux une part relativement réduite de ces dépenses - ceux-ci relevant essentiellement d'autres acteurs publics (voir graphique ci-avant).
La fraction des dépenses dédiées à la santé est passée de 7,5 % du PIB en 1995 à 8,5 % en 2014 , soit une progression annuelle moyenne de 3,7 % en valeur. Si la mise en place de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (Ondam), en 1996, a été à l'origine d'un meilleur encadrement du dynamisme de ces dépenses, elle n'a pas empêché un fort rebond de celles-ci entre 2000 et 2004 (+ 5,8 % par an en moyenne) en raison d'une hausse des indemnités journalières, d'une revalorisation tarifaire des actes de santé mais aussi de la mise en place des 35 heures dans les établissements publics hospitaliers 48 ( * ) . Depuis 2005, la croissance des dépenses de santé est plus contenue (+ 2,9 % par an en moyenne). Il en résulte que la France occupe une position plutôt favorable au sein de l'OCDE en ce qui concerne la hausse des dépenses publiques de santé entre 2000 et 2015 , la part de ces dernières dans le PIB ayant, dans le cas français, augmenté de 1,1 point, contre + 4 points de PIB aux Pays-Bas, + 2,8 points aux États-Unis ainsi qu'au Royaume-Uni et + 1,6 point en Allemagne (voir graphique ci-après).
Graphique n° 34 : Variation de la part des dépenses de santé dans le PIB au sein des pays de l'OCDE entre 2000 et 2015
(en % du PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'OCDE)
Le poids dans le PIB des dépenses des ASSO consacrées au risque vieillesse a progressé de 7,4 % à 11,4 % entre 1995 et 2014 , soit une hausse annuelle moyenne de 4,1 % en valeur au cours de cette période. Le principal déterminant du dynamisme de cette catégorie de dépenses réside dans l'évolution de la démographie française. La première réforme du système de retraites intervenue en 1993, qui a relevé de manière progressive le nombre d'années d'assurance nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein, a permis de contenir le rythme de croissance des dépenses vieillesse ; celles-ci ont toutefois été tirées, à compter de 2004, par l'instauration de la retraite anticipée et de l'arrivée à l'âge de la retraite des générations du « baby-boom ». Pour autant, les réformes de 2003 et 2008 ainsi que celles menées entre 2010 et 2015 - dont les lois du 9 novembre 2010 et du 20 janvier 2014 - produisent d'indéniables effets sur le rythme de croissance des dépenses dédiées au risque vieillesse 49 ( * ) . Il n'en demeure pas moins que le retour à l'équilibre financier des régimes de retraite , jusqu'à présent prévu dès le milieu des années 2020 par le Conseil d'orientation des retraites (COR) 50 ( * ) , pourrait intervenir plus tardivement ; en effet, les dernières projections démographiques avancées par l'Insee font apparaître une évolution moins dynamique qu'anticipé de la population active entre 2015 et 2060, en particulier au cours des dix prochaines années 51 ( * ) , ce qui conduirait à une dégradation du ratio cotisants-pensionnés. Ces éléments devraient faire l'objet d'un examen approfondi dans le prochain rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites qui paraîtra en juin prochain. Aussi de nouveaux ajustements pourraient-ils s'avérer nécessaires afin d'éviter un nouveau creusement du déficit des régimes de retraite à court et moyen termes qui viendrait alimenter la dette des administrations de sécurité sociale .
S'agissant du risque famille, la part dans le PIB des dépenses associées est restée stable entre 1995 et 2014 , s'établissant désormais aux alentours de 1,8 %. Au cours de la période considérée, ces dépenses ont crû, en moyenne, de 2,6 % par an en valeur ; toutefois, celles-ci ont fortement ralenti à partir de 2009, en lien avec l'intégration de l'allocation de parent isolé (API) au revenu de solidarité active (RSA) dont le versement est assuré par les départements. En outre, la période récente a été marquée par un recul des principales prestations d'entretien - allocations familiales, complément familial, prestations d'accueil du jeune enfant (PAJE), etc. - au profit des dépenses consacrées à la garde d'enfant 52 ( * ) .
Les prestations servies au titre de l'emploi recouvrent, pour l'essentiel, les régimes d'indemnisation du chômage, dont les dépenses sont très sensibles aux mouvements de la conjoncture . Cela explique le fort rebond des dépenses des administrations de sécurité sociale consacrées à l'emploi observé en 2009 du fait de la crise économique, dont la part dans le PIB s'établissait à 1,6 % en 2014, supérieure de 0,5 point de PIB à son niveau de 2008.
En somme, il apparaît que, l'indemnisation du chômage mise à part, les dépenses sociales sont particulièrement difficiles à infléchir , sauf à engager des réformes de structure, dans la mesure où celles consacrées à la santé et à la vieillesse dépendent de facteurs structurels et poursuivent leur évolution indépendamment de la conjoncture.
b) Une fiscalisation progressive des ressources sociales
Entre 1995 et 2014, la part dans le PIB des ressources hors transferts 53 ( * ) des administrations de sécurité sociale a crû de 5 points , soit davantage que les dépenses de celles-ci au cours de la même période (+ 3,8 points de PIB). Cette augmentation des recettes sociales n'a cependant pas permis de faire disparaître le besoin de financement des ASSO.
Graphique n° 35 : Évolution des ressources des administrations de sécurité sociale (hors transferts)
(en % du PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de la Drees)
L'accroissement des ressources des administrations de sécurité sociale a été alimenté par l'attribution de nouvelles recettes fiscales à ces dernières . La montée en puissance, à compter de 1991 mais surtout de 1997, de la contribution sociale généralisée (CSG) a permis de compenser la baisse des taux de cotisations salariales. En outre, 1996 a été marquée par la création de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), affectée à la Cades, et les exonérations de charges sociales ont été financées, tout d'abord par l'État, puis par l'octroi de taxes affectées, comme une fraction de la taxe sur les salaires, les droits de consommation sur les alcools, une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) assise sur les tabacs, etc. À cela s'ajoutent d'autres impôts et taxes affectées (ITAF), à l'instar de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S), ou encore les contributions dues par l'industrie pharmaceutique. Au total, le poids des impôts et taxes affectées (ITAF) dans la richesse nationale est passé de 2 % en 1995 à 7,8 % en 2014 ; ces derniers représentent aujourd'hui près de 30 % des ressources des administrations de sécurité sociale.
C. LA DIFFICILE DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE DE LA DETTE PUBLIQUE
La définition du périmètre exact de la dette publique n'est, en réalité, pas aussi simple qu'une première approche pourrait le laisser penser.
D'une part, la
distinction des secteurs public et
privé
peut, dans le cas de certaines entreprises fortement
soutenues par l'État, s'avérer factice
- comme en
témoigne l'exemple de la
dette liée au réseau
ferroviaire
, qui a été en partie requalifiée
comme dette publique à la suite de l'intervention des autorités
statistiques européennes.
D'autre part, au sein même des administrations publiques, une masse d'engagements financiers se situe à la lisière de la notion de dette : sans pour autant donner lieu à une dépense immédiate, donc sans impact direct sur le besoin de financement des administrations, ils sont néanmoins susceptibles d'avoir à court ou moyen terme un impact significatif sur les finances publiques et de peser sur la trajectoire de la dette. Leur évolution doit être analysée dans la mesure où le renforcement de la contrainte budgétaire peut créer la tentation d'un recours accru à ce type d'engagements financiers évitant la création d'une dépense mais se traduisant, de façon plus ou moins indirecte, par l'existence d'une charge.
La notion de dette implicite - qui n'a pas encore reçu de définition partagée par les principaux organismes statistiques - agrège ainsi des dettes « quasi-publiques » (par exemple la dette ferroviaire), des engagements financiers publics dont les effets sont presque certains, par exemple en matière de financement des retraites des fonctionnaires, et d'autres dont les conséquences réelles sur les finances publiques sont plus difficiles à prévoir, notamment lorsqu'ils découlent d'une garantie accordée par l'État dont la mise en jeu dépend de la réalisation d'un évènement particulier.
1. La requalification de la dette ferroviaire
La question du traitement de la dette ferroviaire et de son intégration à celle des administrations publiques n'est pas nouvelle : depuis le début des années 1990, des interrogations se font régulièrement jour sur la soutenabilité du niveau d'endettement du gestionnaire des infrastructures ferroviaires françaises (d'abord l'entreprise SNCF, puis Réseau ferré de France ou RFF et, depuis 2015, le groupe SNCF Réseau) qui ont entraîné une participation importante de l'État à l'amortissement de la dette ferroviaire, conduisant à une requalification partielle de cette dette.
a) La création du service annexe d'amortissement de la dette (Saad)
Ces inquiétudes ont d'abord donné lieu à la création, en 1991, d'une entité comptable sans personnalité juridique distincte de la SNCF, le service annexe d'amortissement de la dette (ou Saad) 54 ( * ) , visant à isoler la dette ferroviaire pour permettre son amortissement progressif sans peser sur l'activité commerciale de l'entreprise. Le service annexe d'amortissement de la dette devait assurer le service complet (intérêts et principal) du passif transféré pour un montant de 5,8 milliards d'euros courants lors de sa création .
Le Saad était financé très majoritairement par l'État : celui-ci devait contribuer annuellement à hauteur de 579 millions d'euros (constants de 1989) afin de couvrir le montant annuel des intérêts et de rembourser une partie du principal, contre un versement de 15 millions d'euros de la SNCF elle-même.
L'institutionnalisation d'un versement de l'État dans ce contexte ne constituait pas, en elle-même, une rupture par rapport à la pratique antérieure dans la mesure où l'État apportait déjà chaque année un « concours exceptionnel » au compte de résultat de la SNCF pour des montants similaires.
En revanche, d'un point de vue comptable , la création du Saad entraînait une conséquence inédite : la dette liée aux infrastructures ferroviaires était ainsi exclue tant des comptes de la SNCF que de ceux de l'État .
b) La création d'un nouvel établissement : Réseau ferré de France
Malgré ce montage, la SNCF se trouvait dans une situation très délicate puisqu'à la fin de l'exercice 1996, sa situation nette était proche de zéro, ce qui signifie que la valeur estimée de l'entreprise était quasiment nulle.
Un nouvel établissement public industriel et commercial, Réseau ferré de France (RFF) , est alors créé en 1997 pour gérer les voies et les infrastructures annexes (hors gares et centres d'entretien). En contrepartie, l'établissement a repris à sa charge un montant de dette équivalent à la valeur des infrastructures, soit plus de 20 milliards d'euros.
L'État assurait le remboursement de cette dette « héritée » jusqu'en 2008, d'abord par le biais d'augmentations de capital de l'établissement, financées par le compte d'affectation spéciale n° 902-24 « Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés », puis, à partir de 2004, par des contributions budgétaires de l'ordre de 800 millions d'euros par an 55 ( * ) .
À partir de 2004, la question de la qualification de la dette du Saad et plus largement de la dette ferroviaire émerge dans le débat public : un rapport de la commission des finances du Sénat qualifie le Saad d'« objet financier non identifié » en 2003 56 ( * ) et, en 2005, un autre rapport de cette dernière indique que « la constitution de comptes consolidés de l'État devrait être l'occasion d'une intégration de la dette du SAAD, comme celle de la CADES, au sein de la dette consolidée de l'État » 57 ( * ) .
c) 19 milliards d'euros de dette ferroviaire réintégrée à la dette publique depuis 2007
En 2007, l'organisme de statistiques européen Eurostat a indiqué à la France 58 ( * ) , à la suite d'un débat avec l'Insee débuté à la fin de l'année 2006, que la dette du Saad, qui s'élevait alors à près de 9 milliards d'euros, devait être intégrée au sein de la dette publique en raison des versements répétés de l'État permettant son amortissement. Jusqu'alors, l'Insee considérait que le Saad était rattaché, ainsi que sa dette, au secteur des entreprises non financières.
Cette décision provoquait l'arrêt des contributions budgétaires directes de l'État à l'établissement RFF. Leur suppression était alors compensée par une réforme de la tarification ferroviaire - l'État assurant le paiement d'une part significative des redevances d'accès finançant RFF.
Malgré tout, dès 2010, Eurostat exprimait des doutes sur la capacité de RFF à rembourser l'intégralité de sa dette sans aide de l'État 59 ( * ) .
En 2014, l'Insee a requalifié 10 milliards d'euros 60 ( * ) de dette détenue par RFF comme dette publique , ce qu'Eurostat a « provisoirement » accepté 61 ( * ) . La requalification mise en oeuvre n'a pas d'impact sur la dette nette de l'État car « il est en effet considéré que l'État s'endette pour prêter à RFF les fonds nécessaires à ses investissements . Cette créance, équivalente à l'endettement supplémentaire, est enregistrée à l'actif de l'État » 62 ( * ) .
d) Une dette à la soutenabilité toujours incertaine malgré la création de SNCF Réseau
Face à des difficultés financières persistantes et à de nombreux problèmes de coordination entre les différents acteurs ferroviaires, la réforme ferroviaire de 2014 63 ( * ) a réuni au sein d'un gestionnaire d'infrastructure unifié, dénommé SNCF Réseau , les activités auparavant exercées par Réseau ferré de France (RFF), SNCF Infra et la direction des circulations ferroviaires (DCF). Cet établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) a été intégré à un groupe public ferroviaire , composé d'un établissement « de tête », la SNCF, chargée du pilotage stratégique du groupe et de missions transversales ou mutualisées et chapeautant deux autres établissements publics : SNCF Mobilités d'une part, chargée de l'exploitation des services de transport, et SNCF Réseau d'autre part.
A également été instaurée une « règle d'or » de l'endettement , qui impose à SNCF Réseau de ne pas s'endetter pour financer de nouveaux projets de développement au-delà d'un certain ratio de dette nette sur la marge opérationnelle, devant être fixé par décret dans la limite d'un plafond de 18 64 ( * ) .
Cependant, ce ratio est déjà largement dépassé et, comme le souligne l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer), il « continue à s'éloigner du seuil plafond fixé par la réforme ferroviaire : de 19 en 2015, il atteindrait 22 en 2016 puis 24 selon le projet de budget pour 2017 » 65 ( * ) . L'application de la « règle d'or » a d'ailleurs été explicitement rendue inopposable à la participation de SNCF Réseau au capital de la société de projet concessionnaire des travaux de la ligne « Charles de Gaulle Express » 66 ( * ) et le contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau signé le 20 avril 2017, qui était censé participer au redressement de la trajectoire de SNCF Réseau 67 ( * ) , a fait l'objet d'un avis très critique de l'Arafer 68 ( * ) : la trajectoire financière prévue est jugée « irréaliste », se traduisant par une « dérive de l'endettement ».
La soutenabilité de la dette ferroviaire apparaît donc incertaine .
La possibilité d'une reprise de la dette par l'État et de la création d'une caisse d'amortissement spécifique a été évoquée par le Gouvernement en 2016 puis abandonnée.
Même en l'absence de toute mesure juridique au niveau national, les interrogations persistantes sur la dette ferroviaire pourraient se traduire, en l'absence d'amélioration des perspectives financières de SNCF Réseau dans un futur proche, par une nouvelle requalification d'une partie de l'encours impulsée par Eurostat.
Cette requalification pourrait avoir un impact significatif sur le montant de dette nette de l'État . En effet, il paraît peu probable que les infrastructures ferroviaires que la dette portée par RFF a permis de financer soient portées à l'actif de l'État, dans la mesure où c'est le réseau ferroviaire qui dégage les recettes commerciales finançant cette structure.
Une telle requalification emporterait également des conséquences relatives au déficit public : une reprise de la part de dette déjà requalifiée par l'Insee en 2010 constituerait une renonciation, de la part de l'État, à la créance qu'il détient sur SNCF Réseau, se traduisant par une dégradation de sa situation financière nette et du déficit public, à hauteur de la dette reprise. D'après le rapport du Gouvernement relatif à la trajectoire de la dette de SNCF Réseau remis au Parlement en août 2016, « une opération de reprise de 10 milliards d'euros de dette aurait pour effet d'augmenter le déficit public d'environ 0,5 point de PIB » 69 ( * ) .
2. L'impact asymétrique des programmes d'assistance financière de la zone euro sur la dette publique de la France
Une part significative du niveau d'endettement de la France résulte du soutien financier à la zone euro : celui-ci représente 3 points de PIB en 2015. La contribution de la France à l'assistance bilatérale accordée à la Grèce, ainsi qu'au Fonds européen de stabilité financière (FESF) et au Mécanisme européen de stabilité (MES) devrait, selon les données actuellement disponibles, se stabiliser à 65,9 milliards d'euros pour les années à venir.
Tableau n° 36 : Impact des programmes d'assistance financière de la zone euro sur la dette publique de la France
(en milliards d'euros)
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 (p) |
2018 (p) |
2019 (p) |
2020 (p) |
|
|
Grèce (prêts bilatéraux) |
4,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
11,3 |
|
FESF |
0 |
3,1 |
30,2 |
38,4 |
40,5 |
38,1 |
38,1 |
38,1 |
38,1 |
38,2 |
38,2 |
|
dont Grèce |
23,6 |
29,2 |
31 |
28,6 |
28,6 |
28,6 |
28,6 |
28,6 |
28,6 |
||
|
dont Irlande |
1,6 |
2,6 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
|
|
dont Portugal |
1,5 |
4 |
5,4 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
|
|
MES |
6,5 |
13 |
16,3 |
16,3 |
16,3 |
16,3 |
16,3 |
16,3 |
16,3 |
||
|
Total |
4,4 |
14,5 |
48,1 |
62,9 |
68,3 |
65,9 |
65,9 |
65,9 |
65,9 |
65,9 |
65,7 |
|
en % du PIB |
0,2 |
0,7 |
2,3 |
3,0 |
3,2 |
3,0 |
|||||
Source : ministère de l'économie et des finances (avril 2017)
La stabilisation des montants venant abonder la dette publique au titre de la participation de la France résulte principalement des modalités d'enregistrement comptable de l'assistance financière : alors que le FESF n'accorde plus de prêts depuis le 1 er juillet 2013, les emprunts octroyés par le MES ne participent pas à l'accroissement de la dette publique française.
En effet, seule la participation au capital du MES est prise en compte . Ainsi, le versement des deux premières tranches du programme d'aide à la Grèce, pour 34,4 milliards d'euros (dans le cadre d'un plan total de 86 milliards d'euros, mis à disposition de façon échelonnée) est resté sans effet sur le niveau de la dette publique française.
|
L'enregistrement comptable de l'assistance financière Selon le Système européen de comptes, sont prises en compte pour le calcul de la dette publique les unités institutionnelles relevant du secteur des administrations publiques. Pour être qualifiée d'unité institutionnelle, une entité doit jouir d'une autonomie de décision dans l'exercice de sa fonction principale (posséder en toute autonomie ses biens et ses actifs, prendre des décisions économiques, avoir la capacité de souscrire des engagements, etc.). Ainsi, déterminer si une structure doit être prise en compte dans le calcul de la dette publique implique de se poser deux questions : constitue-t-elle une unité institutionnelle ? Si tel est le cas, relève-t-elle du secteur des administrations publiques ? Si l'entité considérée ne constitue pas une unité institutionnelle, elle doit être intégrée dans l'unité institutionnelle qui la contrôle. C'est en faisant application de ces principes qu'Eurostat a déterminé le traitement comptable devant être réservé à la dette contractée par le FESF et le MES 1°) Concernant le FESF, Eurostat (avis du 27 janvier 2011) a estimé qu'il ne présentait pas les caractéristiques d'une unité institutionnelle, n'ayant ni capacité d'initiative, ni autonomie de décision. L'institut statistique en a donc conclu que la dette émise par le Fonds devait être enregistrée dans les comptes des États participants au prorata de leur quote-part dans les prêts octroyés ; elle accroissait donc la dette publique de ces derniers à due proportion de ces prêts ; 2°) Concernant le MES, Eurostat (avis du 7 avril 2011) a considéré qu'il constituait bien une unité institutionnelle eu égard à son autonomie réelle et à son statut juridique ; toutefois, dans la mesure où il s'agit d'une organisation internationale, elle ne saurait être rattachée au secteur des administrations publiques des États de la zone euro. Par conséquent, la dette émise par le MES lui est propre et n'a pas à être enregistrée dans les comptes des États. Par conséquent, alors que l'ensemble de la dette émise par le FESF devait être enregistrée au titre de la dette publique de la France - au prorata de la participation française dans le Fonds -, seule la participation au capital appelé du MES doit y figurer. |
3. Les engagements hors bilan : un volume global en hausse, des niveaux de risque variés
Les engagements hors bilan de l'État constituent l'ensemble des obligations potentielles , subordonnées à la réalisation de conditions ou d'opérations ultérieures, qui s'imposent à lui et sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur sa situation financière.
Ils sont recensés au sein de l'annexe au compte général de l'État , joint chaque année au projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes conformément à la loi organique relative aux lois de finances du 1 er août 2001. La LOLF prévoit également que les règles comptables de l'État ne se distinguent de celles qu'appliquent les entreprises qu'en raison des spécificités de l'action de l'État.
En l'espèce, comme le souligne le Conseil de normalisation des comptes publics, la particularité des engagements hors bilan « tient à l'absence de référentiel comptable transposable à l'État » 70 ( * ) , qui peut être appelé à couvrir des risques en tant qu'assureur « en dernier ressort » et dont les engagements, en tant que régulateur économique et social, ne découlent pas toujours d'un acte juridique précis. « Le recensement exhaustif des engagements s'avère donc plus difficile pour un État que pour une entreprise ».
Même si la certification des comptes de l'État, assurée par la Cour des comptes, a permis une amélioration de la qualité des données et de l'étendue du champ des engagements hors bilan recensés, il faut donc d'emblée se garder de considérer que les éléments chiffrés présentés dans le compte général de l'État correspondent à un inventaire complet de l'ensemble des engagements susceptibles d'avoir un effet sur la dette publique. Les engagements hors bilan des administrations locales ne sont ainsi pas retracés de façon centralisée, alors même que ceux-ci doivent être significatifs au regard du poids des administrations locales dans l'emploi et l'investissement publics, d'autant plus que les difficultés d'accès au crédit rencontrées par certaines collectivités locales à la suite de la crise des emprunts « toxiques » (voir infra) ont provoqué un développement des contrats de partenariat public-privé 71 ( * ) .
La Cour des comptes a d'ailleurs relevé l'insuffisance des informations relatives aux engagements hors bilan des administrations publiques qui ne sont pas soumises à une obligation de certification 72 ( * ) .
a) Une hausse des engagements hors bilan de l'État depuis dix ans
Les engagements hors bilan regroupent un grand nombre d'éléments marqués par une relative hétérogénéité : ils « recouvrent des obligations juridiques ou économiques de natures très diverses et dont la réalisation comme l'horizon d'exigibilité sont incertains » 73 ( * ) .
Cependant, trois grands ensembles se dégagent : les engagements pris dans le cadre d'accords bien définis (par exemple les garanties accordées à certains acteurs économiques), qui s'élevaient à 1 000,6 milliards d'euros en 2015, les engagements découlant de la mission de régulateur économique et social de l'État (481,5 milliards d'euros) et les engagements de retraites de l'État qui représentent, avec 1 723 milliards d'euros, plus de la moitié du total des engagements hors bilan.
Depuis 2007, comme le montre le graphique ci-après, chacune de ces trois catégories a crû dans des proportions importantes .
Graphique n° 37 : Évolution du montant des engagements hors bilan de l'État depuis 2006
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données du compte général de l'État)
Une part de la hausse est liée à des évolutions de périmètre ou des changements méthodologiques : l'amélioration du recensement des engagements peut se traduire par augmentation apparente des chiffres présentés sans que celle-ci ne correspondent à un accroissement réel des engagements de l'État.
Il n'en reste pas moins que la tendance est éclairante.
Ainsi, les engagements pris dans le cadre d'accords bien définis ont plus que doublé en dix ans et les engagements de retraites ont crû de 70 % depuis 2007 .
La masse la plus stable est celle des engagements découlant de la mission de régulateur économique et social de l'État , qui inclut le besoin de financement des régimes spéciaux de retraites subventionnés par l'État et les engagements pris au titre de diverses dépenses d'intervention de l'État (aides au logement, allocation aux adultes handicapés, aides à la pierre, bourses d'enseignement...).
b) Des niveaux de risque et un contrôle parlementaire variables
Les engagements hors bilan reflètent des niveaux de risque très divers et leur contrôle par le Parlement est variable .
Par exemple, les garanties accordées par l'État doivent, depuis l'entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), faire l'objet d'une autorisation législative et donnent lieu, lorsqu'elles sont appelées, à une information du Parlement en vertu de l'adoption d'une disposition en ce sens par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2016 74 ( * ) .
L'estimation du risque d'appel de la garantie est, en revanche, très délicate : pour certains dispositifs très répandus (par exemple en matière de soutien au commerce extérieur), le Gouvernement dispose de bases statistiques relativement fiables mais, pour des cas plus atypiques, le niveau de risque est presque impossible à estimer ex ante .
À l'inverse, certains engagements liés à des dépenses d'intervention se rapprochent de la notion de charge à payer et, à législation constante, leur probabilité de réalisation est proche de la certitude.
C'est pourquoi il paraît préférable de ne retenir que les engagements de retraite et les engagements découlant de la mission de régulateur économique et social de l'État pour calculer la dette publique implicite.
Au total, en suivant la méthode de calcul explicitée ci-avant, celle-ci s'élèverait en 2015 à 4 300 milliards d'euros - soit plus du double de la dette publique effective .
c) La dette implicite : un outil d'analyse utile, mais dont l'interprétation est délicate
La dette implicite, qui prend en compte les engagements hors bilan de l'État, voire les dettes « quasi-publiques » qui pourraient, à terme, être intégrées au périmètre de la dette publique, constitue une notion utile à l'analyse de l'endettement public en ce qu'elle permet de dépasser une approche strictement rétrospective sur l'encours de dette accumulé jusqu'à présent, pour s'intéresser à ses facteurs d'évolution dans le futur. Elle permet de faire apparaître que le choix d'un régime de retraite crédible, et plus largement d'un modèle d'intervention de l'État soutenable , est un préalable essentiel à la maîtrise de l'évolution de la dette.
Cependant, le concept de dette implicite pose aussi plusieurs difficultés qui ne sauraient être éludées : il s'agit d'un concept très large, agrégeant un stock de dette et des flux (de dépenses) futurs, des engagements dont la réalisation est presque certaine et d'autres qui ne créeront probablement jamais de charge sur le budget public. L'absence de critères clairs quant au périmètre de la dette implicite conduit à faire varier son montant, d'une analyse à une autre, du simple au triple.
Ces incertitudes ne résultent pas d'une carence du système d'information financier de l'État : la France est l'un des pays dont la comptabilité générale est la plus sophistiquée et la mieux contrôlée, à travers le travail de certification de la Cour des comptes - il ne s'agit donc pas de renforcer encore cet instrument, mais plutôt de mieux l'utiliser.
Plus qu'un indicateur dont le niveau ou l'évolution suffisent à juger de la soutenabilité des finances publiques, la notion de dette implicite paraît constituer un repère conceptuel particulièrement pertinent à deux égards : pour réfléchir au périmètre de la dette publique d'une part, et comme préalable à une analyse des risques financiers encourus par l'État d'autre part.
Au-delà de l'État stricto sensu , c'est le suivi de la dépense publique et des engagements financiers de l'ensemble des entités publiques - dont les engagements hors bilan ne font pas, aujourd'hui, l'objet d'un recensement centralisé et dont le système d'information comptable ne présente pas toujours le même degré de sophistication que celui de l'État - qui doit être resserré.
À ce titre, paraissent aller dans le bon sens le renforcement de l'encadrement des modalités de passation d'un contrat de partenariat public-privé (PPP) par les organismes divers d'administration centrale et la mise à disposition de ressources pour accompagner les collectivités territoriales sur ces montages juridiques complexes 75 ( * ) .
4. La question de l'exclusion de certaines dépenses du périmètre de la dette publique
Il ne s'agit pas seulement de savoir ce qu'intègre le périmètre de la dette publique, mais aussi ce qu'il pourrait ou devrait exclure.
En effet, à première vue, il pourrait sembler opportun de retrancher de la dette publique la part de l'encours découlant de certaines dépenses jugées utiles à la croissance économique , par exemple les dépenses d'investissement, de recherche et développement ou plus largement d'éducation, afin de distinguer une « dette de croissance » et une dette « improductive ». Dans cette perspective, la réduction de la dette publique ne constituerait plus un sujet en tant que tel : seule la dette « improductive » devrait être limitée, tandis que la dette « de croissance » serait intrinsèquement bénéfique à l'économie.
D'autres propositions sont relatives à la mutualisation d'une partie de la dette publique au niveau européen , par exemple à travers la création d'un fonds « de rédemption » 76 ( * ) , dont le fonctionnement se rapprocherait de celui du mécanisme européen de stabilité (MES) évoqué supra : une nouvelle structure émettrait des obligations de façon mutualisée afin de racheter la dette publique des États membres de la zone euro qui est supérieure au critère de 60 % du PIB fixé par le traité de Maastricht. Les partisans d'un tel mécanisme jugent qu'il devrait permettre de diminuer le niveau de dette publique des États européens les plus endettés tout en diminuant le coût de financement de certains pays dont la signature n'est pas jugée excellente. Certains proposent également des fonds « sectoriels », rachetant par exemple la part de l'encours de dette publique liée à aux dépenses de défense dans la mesure où ces dépenses concourent à l'intérêt commun des pays européens 77 ( * ) .
L'ensemble de ces propositions, malgré leur diversité, partagent un point commun : il s'agit in fine de diminuer les contraintes liées à l'exigence de réduction de la dette publique pour les États endettés - soit en distinguant une « bonne » et une « mauvaise » dette, soit en transférant une partie de l'encours à une structure tierce.
Certes, concilier la réduction de la dette avec le relèvement de la croissance et le financement des dépenses permettant à la France et à l'Europe de garantir leur souveraineté est une nécessité.
Cependant, en dehors même des problèmes spécifiques posés par chacune de ces suggestions (contournement des règles comptables, aléa moral...), il faut souligner que de telles approches ne doivent pas conduire, une fois de plus, à refuser de considérer la dette publique comme ce qu'elle est : un poids pour l'économie dont la maîtrise suppose une réflexion stratégique de l'ensemble des administrations publiques pour contenir les facteurs sous-jacents de son évolution et retrouver une trajectoire budgétaire et financière soutenable.
II. LES ENJEUX MULTIPLES DE LA GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE
Une analyse de la dette publique ne saurait se limiter à un regard purement quantitatif sur l'évolution du stock de dette et de ses déterminants, dans la mesure où la soutenabilité de la dette publique dépend aussi de sa composition (crédits bancaires ou créances, de court terme ou de long terme...) et de sa gestion une fois qu'elle a été contractée.
À cet égard, les administrations publiques ne mettent pas toutes en oeuvre la même stratégie : celle-ci varie en particulier selon leur taille, leurs besoins financiers, leur mode de gouvernance, leur facilité d'accès au marché financier et le cadre juridique dans lequel elles évoluent, qui peut être plus ou moins contraignant en matière d'endettement.
A. UN CONTEXTE COMMUN À TOUTES LES ENTITÉS PUBLIQUES
Toutes les administrations publiques cherchent, à travers leur gestion de la dette, à limiter tant le coût de leur financement que le risque qui lui est associé. Elles tendent également à se financer de façon croissante par recours aux marchés financiers, même si ce phénomène ne s'est affirmé que tardivement pour les collectivités territoriales et les administrations sociales, à la différence de l'État.
1. La conciliation du moindre coût et du moindre risque
La gestion de la dette poursuit deux principaux objectifs : maîtriser le coût du financement et limiter le risque financier . Ainsi que le précise une note d'analyse économique de la direction générale du Trésor, « alors que le coût peut naturellement être mesuré par la moyenne sur longue période des charges d'intérêt (en points de PIB), la mesure de risque doit représenter la ?variabilité? de ces charges » 78 ( * ) .
Si, sur le long terme, ces deux buts peuvent paraître converger, la perspective est toute différente à court ou moyen terme : un contrat d'emprunt structuré, par exemple, peut être avantageux durant les premières années de son application avant d'entraîner un surcoût significatif. De même, l'existence de taux d'intérêt négatifs sur des maturités faibles aurait pu inciter l'État à s'endetter davantage à court terme afin de bénéficier des facilités de trésorerie résultant des versements des créanciers, contribuant à diminuer la charge de la dette à court terme, mais une telle stratégie - qui n'a pas été retenue - aurait fortement accru le risque pesant sur les finances de l'État en cas de remontée des taux. De façon générale, une maturité moyenne élevée des titres minimise le risque si ceux-ci sont souscrits à taux fixe (puisque la charge de la dette n'évoluera qu'avec retard face à une hausse de taux) mais contribue aussi à augmenter, toutes choses égales par ailleurs, le coût du financement - puisque les taux de long terme sont, sauf exception, plus élevés que ceux de court terme.
Cette dissonance entre le court et le long terme peut créer des difficultés au regard de la complexité de certains produits financiers, comme en a témoigné la crise des « emprunts toxiques » détenus par les collectivités territoriales (voir infra ).
2. Un recours croissant bien qu'inégal aux marchés financiers
L'émission de titres de créances par les personnes publiques, par opposition au recours au crédit bancaire, connaît un relatif dynamisme pour l'ensemble des sous-secteurs d'administration publique . Ainsi, entre 1995 et 2016, la part des titres de créance au sein de la dette publique est passée de 65,6 % à 84,6 %.
Si l'État se finançait déjà très majoritairement, en 1995, par l'émission de titres financiers, la hausse a été particulièrement marquée pour les administrations de sécurité sociale : l'ampleur du recours à l'émission de titres de créances par ces entités a été multipliée par 7 en vingt ans.
Graphique n°
38
:
Évolution de la part des titres de créances au sein
de la
dette publique par sous-secteur, de 1995 à 2016
(en %)
Source : commission des finances (à partir des données de l'Insee)
Même si les titres de créances émis par des entités locales restent de faible ampleur au regard des crédits bancaires contractés par les collectivités locales, ces dernières n'en ont pas moins, elles aussi, accru leurs émissions : alors que les créances représentaient moins de 2 % du stock de dette locale en 1995, cette part s'élève à plus de 7 % vingt ans plus tard .
Un établissement public industriel et commercial, la Société du Grand Paris (SGP), devrait également procéder à l'émission de titres obligataires en 2017 pour un montant d'environ 700 millions d'euros.
Le recours à un financement désintermédié peut être, pour des acteurs de taille significative, moins coûteux que les prêts accordés par des établissements bancaires. Il peut également permettre un meilleur contrôle sur les caractéristiques de la dette contractée.
L'émission de titres de créance suppose cependant de surmonter de nombreuses barrières à l'entrée : d'une part, la régulation financière est complexe et le recours à un conseil spécialisé ou le recrutement de personnels compétents est onéreux. D'autre part, pour attirer des investisseurs, le volume des titres émis doit être suffisamment important , au minimum de l'ordre de la dizaine de millions d'euros. Enfin, les émetteurs doivent se faire connaître des investisseurs , ce qui suppose un investissement initial important.
3. Un coût de financement faible sur la période récente
Comme cela a été souligné précédemment, les taux d'intérêts bancaires et obligataires sont particulièrement faibles depuis plusieurs années .
Le caractère très bas des taux d'intérêt ne constitue pas un phénomène propre à la France, ni même à la zone euro : comme le montrent les données présentées dans un rapport de l'OCDE publié en 2016 79 ( * ) , les taux d'intérêt ont diminué dans tous les pays étudiés.
La faiblesse des taux d'intérêt s'explique à la fois par le caractère atone de la croissance et de l'inflation et par la politique monétaire accommodante de la Banque centrale européenne (BCE) , qui conserve des taux directeurs très faibles et procède à des rachats d'actifs, publics et privés, d'une ampleur significative. S'ajoute à ces facteurs macroéconomiques un phénomène de « fuite vers la qualité » , difficile à quantifier, qui conduit les investisseurs à privilégier, dans un environnement incertain, des titres jugés sûrs. Enfin, les nouvelles réglementations bancaires et prudentielles contraignent les acteurs financiers à détenir d'importants volumes de titres de très bonne qualité, dont font partie les obligations souveraines de la plupart des États des pays développés. Cependant, comme le souligne l'OCDE, « il est clair que le déclin des taux d'intérêt observé depuis la publication du dernier rapport de l'OCDE sur la dette souveraine constitue en réalité la continuation d'une tendance qui s'étale sur plusieurs décennies » 80 ( * ) .
Graphique n° 39 : Évolution des taux d'intérêt de six pays de l'OCDE depuis 1991
(en %)
Source : OCDE (2016)
Les facteurs sous-jacents à la diminution des taux d'intérêt sur longue période ne sont pas encore très bien identifiés : une réduction globale de l'investissement au niveau mondial est évoquée, de même que des surplus d'épargne ( saving glut ) dans certaines zones économiques peut-être liés à des facteurs démographiques (génération du « baby-boom »).
Quoiqu'il en soit, l'État français s'endette aujourd'hui à des taux d'intérêt très bas , globalement proches de ceux de l'émetteur de référence de la zone euro qu'est l'Allemagne. La situation bénéficie aussi aux administrations locales et sociales : l'observatoire des finances locales de l'entreprise Finance active indique ainsi que l'année 2015 représente un plus bas historique en matière de taux moyen de la dette des collectivités territoriales après une baisse continue depuis 2011 81 ( * ) .
4. La porosité des dettes publiques : une garantie implicite de l'État envers de nombreuses entités publiques
Bien que les différentes catégories d'administrations soient juridiquement et fonctionnellement distinctes, ce qui justifie une analyse indépendante de l'évolution de leur dette et de ses déterminants, force est de constater que la plupart des grandes entités publiques, qui portent des montants de dette importants, bénéficient d'une garantie explicite ou implicite de l'État , qui leur permet d'obtenir de meilleures conditions de financement - par exemple si l'organisme est perçu comme trop important pour que les pouvoirs publics le laissent faire défaut (« too big to fail »). L'existence d'une garantie implicite de l'État ou d'un « soutien systémique » est d'ailleurs un point examiné en détail par les agences de notation pour déterminer la note attribuée à un émetteur public 82 ( * ) . Cette approche n'est pas aussi explicite en matière d'emprunt bancaire dans la mesure où les modèles et les critères de notation des banques ne sont pas rendus publics, mais il est extrêmement probable que les établissements bancaires procèdent au même type d'analyse concernant la nature et l'ampleur du soutien que pourrait apporter l'État en cas de difficultés de paiement des échéances dues. Or, une aide de l'État se traduirait, pour celui-ci, par une augmentation de son besoin de financement.
L'existence de garanties implicites de l'État central envers nombre d'entités publiques amène donc à nuancer la distinction faite entre les dettes des différents sous-secteurs d'administrations publiques. Les dettes publiques sont au contraire marquées par une relative porosité : la soutenabilité de la dette de l'État central détermine, par ricochet, celle des autres entités publiques .
Le lien entre les dettes des différentes entités publiques est particulièrement manifeste en matière de notation : une dégradation de la note de la France serait répercutée sur l'ensemble des administrations publiques et en détériorerait immédiatement les conditions de financement, alors même que leur situation budgétaire et financière propre n'aurait pas connu de modification significative.
B. DES GESTIONS DIFFÉRENCIÉES SELON LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
La composition de la dette des sous-secteurs d'administration publique varie fortement, de même que les modalités de sa gestion : tandis que l'État s'appuie sur des adjudications régulières et prévisibles conduites par un service autonome en lien avec la Banque de France et un réseau de banques, l'amortissement de la dette sociale passe par une structure juridique dédiée, financée par des prélèvements obligatoires. La stratégie des collectivités territoriales est quant à elle marquée par une grande hétérogénéité, avec une recomposition de l'offre financière qui n'est pas encore totalement achevée à la suite de la crise des emprunts toxiques. Enfin, les organismes divers d'administration centrale ne peuvent plus s'endetter à long terme depuis 2012.
1. La gestion de la dette de l'État
Si la France est aujourd'hui l'État de la zone euro dont les émissions de dette sont les plus importantes, elle ne s'est cependant pas toujours financée principalement à travers les marchés financiers , et les modalités d'émission et de gestion de la dette souveraine ont fortement varié au cours du temps.
a) Du circuit du Trésor aux marchés financiers
Si la France a émis des titres de dette sur les marchés financiers dès le XIX e siècle, ceux-ci ont, pendant longtemps, cohabité avec d'autres modes de financement : la création monétaire, par le biais d'« avances » de la Banque de France, et l'orientation plus ou moins forcée de l'épargne nationale privée vers des emprunts publics.
Ainsi, le premier épisode d'accroissement massif du besoin de financement de l'État au XX e siècle , lié aux dépenses engendrées par la Première Guerre mondiale, fut principalement financé par la création monétaire 83 ( * ) : les « avances » accordées par la Banque de France à l'État étaient complétées par l'appel à l'épargne nationale. Quatre emprunts perpétuels 84 ( * ) furent lancés, d'un montant total de 67 milliards de francs. L'État émettait déjà des « bons du Trésor » à court terme, mais ceux-ci étaient exclusivement détenus par la Banque de France et s'apparentaient donc à des avances. La France s'endetta également auprès de pays étrangers, en particulier les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais pour des montants qui restaient limités (32 milliards de francs).
Graphique n° 40 : Composition de la dette de l'État depuis 1915
(en %)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
À l'issue de la Première Guerre mondiale, « les éléments les plus liquides de la dette sont majoritaires : 51 milliards de francs pour la dette flottante intérieure et 25,9 pour les avances de la Banque de France et de la Banque de l'Algérie » 85 ( * ) . La dette flottante correspond à des emprunts de très court terme , dont la maturité est inférieure à trois mois. Face à des difficultés de financement, l'État émet de nouveau des titres de dette perpétuelle , recourt de plus en plus fréquemment aux avances de la Banque de France et diversifie son offre de titres : rentes amortissables ou non, emprunts, bons du Trésor émis à des taux d'intérêt variés et à échéance variable. Les dévaluations monétaires contribuent aussi, indirectement, à alléger le poids de la dette de l'État.
Comme le souligne Laure Quennouëlle-Corre, « d'une guerre à l'autre, le financement de la dette publique a déjà changé : une dette flottante plus importante, un financement de plus en plus monétaire de la dette, un appui renforcé sur les banques » 86 ( * ) .
(1) 1945-1966 : Un système « à robinets ouverts »
Après la seconde guerre mondiale, l'État mit progressivement en place le « circuit du Trésor ». Comme le résume Benjamin Lemoine, « l'État finance ses découverts passagers en drainant de l'épargne et en collectant les ressources monétaires de son propre réseau, à la fois des particuliers mais aussi des institutions bancaires » 87 ( * ) . Le recours aux dépôts de trésorerie évite d'utiliser les avances de la Banque de France, dont le montant est encadré par le Parlement. Les dépôts sont complétés par des titres de dette à court terme, mais ceux-ci ne sont pas « proposés » aux acteurs financiers : les établissements bancaires ont l'obligation, à partir de 1948, de détenir une part conséquente de bons du Trésor dans leurs portefeuilles de liquidités . La part de bons du Trésor détenus ne peut alors descendre en deçà d'un certain « plancher », exprimé en proportion des dépôts détenus par les banques : celles-ci doivent détenir en effets publics 95 % de leur montant en portefeuille au 30 septembre de l'année précédente. En outre, toute augmentation des dépôts à vue et des comptes à échéance par rapport à cette date doit s'accompagner d'une hausse de l'encours des bons du Trésor représentant au moins 20 % 88 ( * ) .
Ce système, dit « à guichets » ou « robinets » ouverts, permet d'assurer à l'État une arrivée de liquidités permanente : « en 1955, le Trésor est le premier collecteur de fonds avec 695 milliards de francs collectés contre 617 pour le secteur bancaire » 89 ( * ) . Mais il présente l'inconvénient de contribuer à renforcer l'inflation : l'augmentation des dépôts au sein des banques s'accompagne d'une hausse des facilités de trésorerie de l'État et se traduit donc automatiquement par une progression de la masse monétaire.
Le circuit du Trésor limite également la capacité des banques à financer les entreprises. Comme le souligne Laure Quennouëlle-Corre, « l'effet d'éviction des valeurs publiques sur le marché des emprunts est d'autant plus fort que l'État propose des produits avantageux fiscalement » 90 ( * ) .
(2) De 1966 aux années 1980 : la montée en puissance du recours par l'État aux marchés financiers et à l'émission de dette de moyen et long terme
Compte tenu de ses incidences économiques, le circuit du Trésor est progressivement abandonné . Le taux « plancher » de bons du Trésor obligatoirement détenus par les établissements bancaires (voir supra ) est d'abord ramené de 95 % à 25 % en 1956, avant d'être abaissé plusieurs fois de 1962 à 1965 pour atteindre 5 %. Les adjudications, c'est-à-dire les ventes publiques de dette française par mise aux enchères 91 ( * ) , sont réintroduites pour les bons du Trésor à partir de 1963 ; selon Laure Quennouëlle-Corre, « cette mesure technique, si anecdotique qu'elle puisse paraître, est l'un des points de départ d'une transformation de la gestion de la trésorerie » 92 ( * ) .
En effet, quelques années plus tard, la réforme dite « Debré-Haberer » 93 ( * ) , de 1966 à 1968, supprime le « plancher » et met un terme définitif au circuit du Trésor 94 ( * ) . À partir de 1973, les conditions dans lesquelles l'État peut être financé par la Banque de France sont mieux encadrées : la possibilité pour le Trésor de présenter ses effets à l'escompte de la Banque de France est supprimée et les conditions dans lesquelles les avances sont obtenues doivent être organisées par une convention, qui doit recevoir une approbation du Parlement 95 ( * ) .
De façon concomitante à la libéralisation des marchés de capitaux et au recours désormais majoritaire à l'endettement obligataire par l'État, le système de l'adjudication s'étend à la dette à moyen et long terme en 1985 tandis que la composition de la dette de l'État est rationalisée par la création de trois catégories de titres standardisés : les OAT (obligations assimilables du Trésor), les BTAN (bons du Trésor à intérêt annuel) et les BTF (bons du Trésor à taux fixe), qui correspondent schématiquement à des titres respectivement de long, moyen et court terme.
Un des objectifs de ces réformes semble être d' encourager l'État à maîtriser ses dépenses en introduisant une réflexion sur le coût de l'emprunt et le service de la dette - ce que ne favorisait pas le circuit du Trésor et l'arrivée automatique et permanente de liquidités. En outre, l'encadrement des avances et le recours à l'endettement obligataire supposait dès le départ un contrôle parlementaire accru par rapport au système antérieur, sur lequel la représentation nationale n'avait aucun poids. Le Parlement vote les conventions d'avances introduites en 1973 et, si l'autorisation de recours à l'emprunt public n'était pas, jusqu'en 2005, assortie d'un plafond limitatif, l'endettement financier de l'État n'en était pas moins plus visible et facile à retracer que les liquidités fournies « à guichets ouverts » par les banques privées. Ces réformes devaient donc, in fine , contribuer à ce que l'endettement de l'État soit responsable et transparent .
Ces préoccupations ont trouvé des prolongements dans plusieurs textes juridiques , aux niveaux européen et national.
b) Le cadre juridique de la gestion de dette par l'État
Le cadre juridique de la gestion de la dette de l'État poursuit deux objectifs principaux : assurer la qualité de la gestion mise en oeuvre, afin d'éviter des pratiques peu orthodoxes susceptibles de nuire à l'économie française et européenne ou à la crédibilité de l'émetteur souverain, mais aussi mieux informer la représentation nationale de la situation financière de l'État .
Concernant l'information de la représentation nationale , c'est la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) qui en organise les principales modalités. Ainsi, son article 34 prévoit que la première partie de la loi de finances initiale comporte un tableau de financement récapitulant les besoins et les ressources de financement de l'État 96 ( * ) et fixe le plafond de variation nette de la dette négociable de moyen et long terme (c'est-à-dire de durée supérieure à un an) 97 ( * ) . En pratique, celui-ci est fixé dans l'article d'équilibre, qui comporte également l'autorisation de recourir à l'emprunt . Si les crédits prévus au titre de la charge de la dette sont évaluatifs, le Parlement doit être informé, le cas échéant, de leur dépassement et des motifs qui le justifient. L'article 22 prévoit aussi que les opérations budgétaires relatives à la dette et à la trésorerie de l'État, à l'exclusion de toute opération de gestion courante, sont retracées dans un compte de commerce déterminé 98 ( * ) .
Du point de vue de l'encadrement juridique des possibilités ouvertes à l'État pour son financement, les principales dispositions résultent des traités européens ; ainsi l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales nationales de financer directement des entités publiques . L'article 124 du même traité prévoit également que l'État ne peut bénéficier, sauf si cela est justifié par des considérations d'ordre prudentiel, d'un accès privilégié aux institutions financières - comme c'était par exemple le cas dans le cadre du « circuit du Trésor ».
Comme le souligne un récent rapport de l'Assemblée nationale, cette obligation devait jouer le rôle d'une « incitation supplémentaire à la discipline budgétaire , la dégradation des finances publiques d'un État étant supposée entraîner une augmentation de la prime de risque exigée par les prêteurs » 99 ( * ) . Ces articles sont complétés, en droit national, par la loi organique relative aux lois de finances de 2001 (LOLF) : les ressources et les charges de trésorerie sont énumérées de façon limitative aux articles 25 et 26 et ce dernier précise, en particulier, que « sauf disposition expresse d'une loi de finances, les emprunts émis par l'État sont libellés en euros . Ils ne peuvent prévoir d'exonération fiscale . Les emprunts émis par l'État ou toute autre personne morale de droit public ne peuvent être utilisés comme moyen de paiement d'une dépense publique. Les remboursements d'emprunts sont exécutés conformément au contrat d'émission ».
c) La France, un émetteur majeur de la zone euro
La France est aujourd'hui un émetteur souverain majeur au sein de la zone euro : son besoin de financement brut a rejoint celui de l'Allemagne en 2014 et l'a dépassé en 2015 .
Sans être l'émetteur de référence (c'est-à-dire celui qui s'endette au moindre coût), la France est le deuxième pays de la zone euro en montant d'émissions annuelles brutes . Ce statut constitue à la fois une chance, dans la mesure où le volume des titres émis favorise leur liquidité (voir infra ), et un défi, puisque cela signifie que des volumes importants doivent être absorbés très régulièrement par les marchés financiers.
En effet, aujourd'hui, la dette de l'État est constituée quasi-exclusivement de titres de créances négociables : ceux-ci représentent 94,2 % du total de sa dette. Le complément correspond aux dépôts des correspondants du Trésor, qui constituent des ressources de trésorerie (2,1 %) et à des crédits de long terme (3,7 % du total).
Graphique n°
41
:
Émissions brutes de dette souveraine de 2012 à 2016
de la
France et de l'Allemagne
(en milliards d'euros)
Note de lecture : pour l'Allemagne, les chiffres présentés sont ceux rendus publics dans le programme de financement publié, pour l'année n, en décembre de l'année n-1.
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Agence France Trésor et de la Deutsche Bundesbank)
Graphique n°
42
: Besoin de
financement brut de plusieurs États membres
de la zone euro en 2015
et 2016
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données d'Unicredit, 2015)
|
Les correspondants du Trésor L'État bénéficie du principe de centralisation des trésoreries publiques . En vertu de ce principe, la quasi-totalité des entités publiques françaises - en particulier les collectivités territoriales et les établissements publics de santé - ont l'obligation de déposer leurs fonds au Trésor. Les correspondants du Trésor regroupent l'ensemble des entités qui, par obligation législative, réglementaire ou par convention, disposent d'un compte ouvert au Trésor. Les encours déposés par les correspondants du Trésor constituent une ressource stable pour la trésorerie de l'État, permettant de limiter son recours à l'emprunt. L'AFT supervise au jour le jour les flux financiers sur le compte unique du Trésor en provenance des services centraux et déconcentrés de l'État, comme des correspondants du Trésor. Ces mouvements sont centralisés en temps réel par la Banque de France sur un compte unique. L'AFT est chargée de la gestion des liquidités disponibles sur le compte. Les relations entre l'État et la Banque de France, en tant que teneur de compte, sont régies par une convention de tenue de compte. Cette convention précise, en particulier, les conditions dans lesquelles l'État peut suivre en temps réel l'imputation sur son compte des opérations réalisées en recettes et en dépenses. Afin d'optimiser l'intérêt financier de l'État, l'AFT mène une gestion active de la trésorerie . Elle place les excédents journaliers par voie de mise en concurrence auprès de contreparties bancaires, sous forme de prêts sans collatéral ou de prises en pension de titres d'État. Ces excédents peuvent également être utilisés pour des prêts de court terme à des entités de la sphère publique ou à certains Trésors de la zone euro avec lesquels l'AFT a conclu des accords d'échange de trésorerie. Source : Agence France Trésor et projet annuel de performances de la mission « Engagements financiers de l'État » annexé au projet de loi de finances pour 2017 |
d) Une gestion de la dette assurée par l'Agence France Trésor
La création de l'Agence France Trésor (AFT), en 2001 100 ( * ) répondait à l'objectif de professionnalisation de la gestion de la dette et de la trésorerie de l'État, dans un contexte de sophistication des marchés financiers. L'Agence France Trésor, contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, n'est pas une agence indépendante mais un service à compétence nationale (SCN) rattaché à la direction générale du Trésor 101 ( * ) . Ses missions recouvrent : la gestion de la dette de l'État ; la gestion de la trésorerie de l'État et des relations avec les correspondants du Trésor ; les relations, dans le domaine des marchés de taux d'intérêt, avec les investisseurs, les intermédiaires financiers et les autres émetteurs ; les producteurs et les diffuseurs d'analyse économique , en particulier monétaire, ou portant sur les évolutions des marchés de taux d'intérêt ; les actions de communication nécessaires et enfin le contrôle interne et le contrôle des risques afférents à ses activités. Le comité stratégique de l'AFT, qui comporte des représentants d'institutions financières internationales, se réunit deux fois par an et conseille l'Agence sur les grands axes de la politique d'émission de l'État .
À la fin de l'année 2015, les équipes de l'Agence France Trésor étaient constituées de 41 agents , dont 13 contractuels - en raison des spécificités des missions de l'Agence, le recrutement de personnels ayant une expérience passée dans le secteur privé est nécessaire . Le directeur de l'Agence est nommé par le ministre des finances sur proposition du directeur général du Trésor.
e) Le rôle des spécialistes en valeur du Trésor
Les spécialistes en valeur du Trésor (SVT) sont de grands établissements bancaires, français et étrangers , disposant du monopole de l'achat de dette souveraine sur le marché primaire , c'est-à-dire lors des émissions. Ils revendent ensuite ces titres sur le marché secondaire dont ils sont chargés d'assurer l'animation - ils doivent en particulier éviter qu'un titre français ne soit plus disponible sur le marché, ce qui participe à la liquidité des titres français. Leurs droits et leurs devoirs sont résumés dans une charte rendue publique.
L'appartenance au réseau des SVT permet également à ces banques de participer aux syndications , qui sont plus lucratives puisqu'elles entraînent le paiement de frais, par l'émetteur, aux établissements bancaires participant à l'opération.
Au-delà de leur rôle de « primary dealers », c'est-à-dire d'acheteurs sur le marché primaire, les SVT constituent un lien entre l'AFT et les investisseurs , qui permet à l'émetteur souverain français d'adapter ses émissions aux besoins exprimés par les acheteurs finaux. L'Agence France Trésor rencontre également de nombreux investisseurs par le biais des SVT lors de circuits mondiaux de présentation de la dette française (dits « roadshows »).
Graphique n°
43
: Nombre
d'investisseurs rencontrés (dont rencontres
par l'entremise des SVT)
de 2011 à 2015
(en nombre d'investisseurs et en %)
Source : commission des finances du Sénat
Le rôle de conseil des SVT est très étendu et l'AFT définit le montant et la nature exacte des titres émis après avoir consulté les banques du réseau : une réunion avec les établissements spécialistes en valeur du Trésor précède toutes les annonces d'adjudication . Cette stratégie, parfois critiquée par certains comme un signe de complaisance ou de soumission aux desiderata du marché, vise en réalité à faire baisser le coût du financement de l'État, en partant du postulat que les investisseurs seront prêts à payer plus cher (donc à accepter un moindre taux d'intérêt) pour des titres qui les intéressent davantage.
Les spécialistes en valeur du Trésor sont classés chaque année et le palmarès des dix premières banques est rendu public . Depuis 2008, la première place du classement est attribuée à la banque BNP Paribas.
Le nombre de spécialistes en valeur du Trésor a diminué au cours des dernières années et il est passé de 22 membres en 2003 à 16 en 2017 . Cette réduction, si elle n'a pas de conséquences majeures - dans la mesure où elle reste modérée et ne remet pas en cause la capacité du réseau des SVT à assurer ses missions - témoigne néanmoins de la dégradation de l'attractivité de l'activité de spécialiste en valeur du Trésor .
Graphique n°
44
:
Évolution du nombre de spécialistes en valeur du Trésor
de 1999 à 2017
Note de lecture : la baisse observée en 2009 correspond à la fusion de plusieurs établissements (Dresdner a été repris par Commerzbank, tandis que Merrill Lynch et Bank of America, ainsi que Royal Bank of Scotland et ABN Amro, ont fusionné pour ne former qu'un seul groupe). La diminution depuis 2014 s'explique quant à elle par le retrait de certaines banques de l'activité de spécialiste en valeur du Trésor.
Source : commission des finances du Sénat
La fonction de SVT est en effet de moins en moins rentable au regard de la faiblesse prolongée des taux d'intérêt actuels et du durcissement de la réglementation bancaire , qui oblige les banques SVT, acheteuses de volumes importants de dette souveraine, à se doter de fonds propres conséquents pour couvrir le risque associé . Comme le note l'OCDE dans son rapport précité, « certaines des nouvelles règles en matière bancaire sont susceptibles de réduire la rentabilité (et par là même l'attrait) de l'activité de spécialiste en valeur du Trésor ou et/ou de réduire la capacité des spécialistes en valeur du Trésor à participer activement aux adjudications et/ou de détenir des volumes suffisants de titres souverains (ce qui conditionne la liquidité des différents marchés des titres d'État) » 102 ( * ) .
Cette situation n'est pas propre à la France : le groupe des spécialistes en valeur du Trésor du Royaume-Uni a également perdu plusieurs de ses membres, de même que celui du Japon, où c'est l'une des principales banques du pays, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, qui a choisi de se retirer du groupe des SVT.
f) Des émissions par adjudication au prix demandé
Les titres sont émis dans leur quasi-totalité par adjudication : l'État propose des titres au marché financier, qui est libre de les acheter ou non. En pratique, les montants et les caractéristiques des titres émis sont définis de telle sorte qu'ils répondent à une demande des investisseurs - grâce aux contacts étroits de l'AFT avec les marchés financiers, en particulier à travers les spécialistes en valeur du Trésor - et trouvent donc preneurs. Le taux de couverture des adjudications (c'est-à-dire le montant des ordres passés sur le montant des titres mis à la vente) est en moyenne de 2 pour les BTF et de 1,5 pour les OAT : en d'autres termes, le « carnet de commandes » communiqué à l'Agence France Trésor par les SVT est, en moyenne, 1,5 à 2 fois supérieur au volume de titres émis.
Ces adjudications sont dites « à la hollandaise », c'est-à-dire qu'elles sont faites au prix demandé . Chaque établissement bancaire souhaitant acheter les titres émis indique le volume et le prix qu'il souhaite payer - un même donneur d'ordre peut proposer plusieurs prix, par exemple indiquer qu'il souhaite acheter 2 milliards d'euros à 1 %, et 3 milliards d'euros à 1,2 %. Les offres sont ensuite agrégées, classées par prix et ceux qui sont les plus attractifs (c'est-à-dire ceux pour lesquels les taux d'intérêt sont les plus faibles) sont servis en premier, jusqu'à ce que le volume émis soit jugé suffisant par l'Agence France Trésor. Il faut noter que l'État ne met pas en vente un montant précis de titres, mais propose une fourchette au marché : il indique par exemple qu'il souhaite vendre entre 5 et 6 milliards d'euros d'OAT. Selon les offres qui lui sont faites, il peut décider d'émettre plus ou moins de titres. Les offres les plus chères ne sont donc pas nécessairement servies.
Ce système assure en principe le coût le plus faible pour l'État puisque les banques sont obligées de révéler leurs préférences de prix et qu'elles encourent le risque, si leur offre n'est pas assez intéressante, de ne pas pouvoir acheter de titres. Les adjudications sont donc privilégiées pour les titres « classiques », ne présentant pas de caractéristique très singulière au regard des titres déjà émis par l'État et dont l'absorption par le marché ne pose aucune difficulté.
En revanche, lorsque sont émis des titres nouveaux, inhabituels ou pour lesquels le marché est moins profond - par exemple des titres de très long terme, l'Agence France Trésor peut recourir à des syndications. Les investisseurs finaux passent leurs ordres à l'AFT à travers un « syndicat » de banques. Contrairement aux adjudications, le prix est défini ex ante après des échanges entre l'émetteur et les banques syndiquées. La syndication constitue donc un engagement des banques participantes d'acquérir des titres à un prix défini avec l'émetteur. L'État perd la capacité d'obliger les acheteurs à proposer des prix mais il sécurise le montant de titres vendus.
Les adjudications et les syndications présentent un point commun : dans tous les cas, les banques acheteuses font partie du réseau des « spécialistes en valeur du Trésor ».
g) Prévisibilité, diversification et liquidité
Comme cela a été expliqué précédemment, l'Agence France Trésor cherche, à l'instar de tout autre acteur institutionnel visant à couvrir son besoin de financement, à minimiser le coût de la dette à moyen terme, tout en maîtrisant le risque qui lui est associé. Toutes choses égales par ailleurs, le coût de la dette française diminue quand la demande des investisseurs augmente.
La demande de titres souverains français dépend elle-même de la qualité perçue de la signature française , dont l'évolution n'est bien sûr pas seulement imputable aux opérations sous le contrôle de l'Agence France Trésor : certains autres facteurs peuvent revêtir une importance cruciale, comme par exemple le rythme de consolidation des finances publiques, qui est examiné par les agences de notation. Ainsi, la deuxième dégradation de la note de la France par l'agence Standard & Poor's 103 ( * ) en 2013 104 ( * ) , de AA+ à AA, était justifiée par le fait que « la marge de manoeuvre budgétaire de la France s'est réduite » 105 ( * ) . La demande des investisseurs est aussi influencée par le contexte économique mondial.
Mais trois facteurs directement liés à la gestion de la dette paraissent particulièrement importants pour maintenir les conditions d'une bonne relation entre les investisseurs et l'émetteur souverain : la prévisibilité du programme d'émissions, la diversification des titres et surtout le maintien de leur liquidité.
(1) Un programme d'émission prévisible mais souple
Les émissions auxquelles procède l'État sont définies selon un calendrier très prévisible : une adjudication de bons du Trésor (titres de court terme) se tient chaque lundi à 14 heures 50. Les titres de moyen terme (OAT de maturité comprise entre 2 et 7 ans) et les titres indexés sur l'inflation (française ou européenne) sont proposés au marché le troisième jeudi ouvré du mois, à 10 heures 50 pour le moyen terme et à 11 heures 50 pour l'inflation. Enfin, les titres de long terme (dont la maturité est supérieure à sept ans) donnent lieu à une adjudication le premier jeudi ouvré du mois à 10 heures 50. En août et en décembre, les adjudications de moyen et long terme sont suspendues mais une adjudication optionnelle, le premier jeudi du mois, est possible si la demande le justifie. Le calendrier exact est rendu public de façon trimestrielle pour les titres de court terme (maturité inférieure à un an) et annuelle pour les titres de moyen et long terme.
Si le calendrier des émissions est donc très prévisible, l'émetteur souverain français n'en garde pas moins quelques marges de manoeuvre relatives aux caractéristiques des titres émis, à leur volume et à la fourchette d'émission . En effet, le nombre de lignes ouvertes, c'est-à-dire le nombre de titres différents émis 106 ( * ) , comme la taille de l'adjudication et l'ampleur de la fourchette d'émission 107 ( * ) , sont communiqués au marché le jeudi précédant l'adjudication (à 17 heures 15 pour les BTF et 18 heures 15 pour les OAT). Ces annonces sont à la fois suffisamment rapprochées des adjudications pour permettre à l'émetteur souverain français de s'adapter à l'état du marché, et assez éloignées pour éviter la tentation de mettre en oeuvre des stratégies opportunistes, qui peuvent faire baisser temporairement le coût de financement de l'État mais qui dégradent, à moyen terme, la qualité de la signature de la France.
Le programme d'émissions de la France est donc relativement souple. Il se distingue en cela de la stratégie de l'Allemagne, dont le programme d'émissions est défini très à l'avance , tant pour les dates d'émissions que pour les montants émis et les caractéristiques des titres créés - ce qui conduit à ce que certaines émissions ne soient pas totalement couvertes. Dans ce cas, l'Allemagne émet quand même les titres et les conserve quelques jours avant de les vendre aux marchés financiers. Une telle ligne de conduite est possible au regard du statut d'émetteur de référence de la zone euro dont jouit l'Allemagne.
(2) Une diversification des titres
L'émetteur souverain français a considérablement étendu la diversité des titres de dette proposés au marché.
Comme cela était indiqué précédemment, l'offre de titres français a d'abord été rationalisée en 1985 avec l'introduction d'une tripartition entre le court, le moyen et le long terme .
Les titres de court terme sont les bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté 108 ( * ) (ou BTF). La durée des BTF est exprimée en nombre entier de semaines . Les durées les plus fréquemment émises sont les 13, 26 et 52 semaines (correspondant respectivement à des durées de 3, 6 et 12 mois). Leur coupure nominale est de 1 euro. En 2015, le marché du BTF affichait en permanence entre 25 et 30 lignes (ce qui signifie que coexistaient une trentaine de titres différents).
Jusqu'en 2013, les titres de moyen terme correspondaient aux bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel (BTAN) , dont la maturité était comprise entre 2 et 5 ans. À partir du 1 er janvier 2013, les obligations assimilables du Trésor (OAT) , réservées originellement au long terme (au-delà de cinq ans) ont remplacé les BTAN « dans un souci de simplification » selon l'Agence France Trésor. Un stock résiduel de BTAN persiste. Les derniers BTAN arriveront à échéance le 25 juillet 2017.
Les titres de moyen et long terme sont donc aujourd'hui constitués d'obligations assimilables du Trésor. Leur maturité est comprise entre 2 et 50 ans .
Au sein des OAT, quatre types de titres différents peuvent être distingués. L'émetteur souverain a créé en 1998 des OAT indexées sur l'inflation française (OATi), complétées en 2001 par des OAT indexées sur l'inflation européenne (OAT€i). Les OAT indexées sur l'inflation représentent 12,3 % du total de l'encours de dette de l'État.
Plus récemment, en janvier 2017, ont été créées des OAT « vertes » (« green bonds »), c'est-à-dire des titres destinés à financer des dépenses liées à l'écologie (investissements dans l'efficacité énergétique des bâtiments, recherche et innovation dans le domaine des énergies renouvelables, agriculture biologique certifiée, gestion durable des forêts...). Le montant total des dépenses vertes éligibles identifiées pour les émissions de l'AFT au cours de l'année 2017 est supérieur à 10 milliards d'euros.
La maturité de l'OAT verte lancée en janvier 2017 s'élève à 22 ans ; le titre porte un coupon de 1,75 % et 7 milliards d'euros ont été émis (pour une demande totale de 23 milliards d'euros, soit un taux de couverture supérieur à 3) ce qui fait de l'obligation verte française, d'après l'AFT, « l'obligation verte de référence la plus importante en taille et la plus longue en maturité jamais émise ». La demande émanait principalement de gestionnaires d'actifs (33 %) et de banques (21 %), qui représentaient plus de la moitié du total, suivis par les fonds de pensions (20 %), les assureurs (19 %) et, de façon plus marginale, par des institutions publiques (4 %) et de gestions alternatives (3 %). Plus des quatre cinquièmes (81 %) des investisseurs étaient européens (en particulier français, néerlandais, britanniques et nordiques).
Ces titres donneront lieu à un compte-rendu régulier par l'État des projets auxquels les fonds ont été attribués . Un tiers indépendant doit certifier la qualité des projets : un « Conseil d'Évaluation de l'Obligation Verte », conseil scientifique et économique composé de personnalités indépendantes de réputation internationale (dont la composition précise est encore inconnue) sera chargé d'évaluer la performance environnementale des dépenses vertes éligibles de la France.
En pratique, les fonds levés via l'OAT verte seront traités comme ceux d'une OAT traditionnelle, dans le respect du principe d'universalité budgétaire : davantage que d'une affectation de recettes, il s'agit plutôt d'un engagement de l'État envers ses investisseurs à financer des dépenses « vertes » pour un montant au moins équivalent à celui des titres émis.
Au total, 67 lignes d'OAT sont ouvertes en 2017 (50 OAT et 17 OAT indexées sur l'inflation, dont 10 OAT indexées sur l'inflation européenne).
Un autre facteur de diversification des titres, même s'il ne relève pas directement de l'émetteur, réside dans la possibilité de les démembrer .
|
Le démembrement (ou « stripping ») des OAT Le démembrement d'un titre consiste à séparer les flux de paiement des intérêts et les flux de remboursement du capital d'une obligation , et de créer autant de titres dont le taux facial est nul (titres dits « à coupon zéro »). Cette technique permet de traiter séparément le capital d'une obligation et les intérêts qui lui sont attachés . Les titres démembrés permettent notamment aux investisseurs finaux d'améliorer la performance de leur portefeuille obligataire : en raison d'une sensibilité plus grande aux variations de taux d'intérêt, les investisseurs peuvent bénéficier d'un effet de levier bien supérieur à celui d'une OAT classique. Les titres démembrés permettent par ailleurs d'éliminer le risque de taux lié au réinvestissement des coupons d'un titre standard . En outre, les certificats d'OAT ont des durations plus longues et une courbe de convexité plus marquée qu'une OAT de même échéance : en d'autres termes, le prix des OAT démembrées réagit plus vite à une modification de leur rendement que celui des OAT classiques. Source : Agence France Trésor |
La France a en effet été, en 1991, le premier émetteur souverain en Europe à autoriser le démembrement de ses titres . La gestion des titres est confiée à un groupement d'intérêt économique (GIE) pour le démembrement et le remembrement des valeurs du Trésor réunissant Euroclear France 109 ( * ) et les spécialistes en valeur du Trésor, au sein duquel l'AFT participe en tant que censeur. En 2009, l'Agence France Trésor a accepté la mise en oeuvre de nouvelles règles prévoyant la fongibilité des intérêts et du principal des OAT démembrées .
La diversification des titres permet à l'État d'intéresser des investisseurs variés (voir infra ) : ainsi, les banques privilégient les maturités de moyen terme, inférieures à dix ans, quand les assureurs ou les fonds des pensions montrent plus d'intérêt pour des titres de long ou de très long terme ; les titres de court terme sont quant à eux utilisés par les banques centrales dont la monnaie n'est pas l'euro pour constituer leurs réserves de change.
(3) Le maintien de la liquidité des titres
Outre la prévisibilité des émissions et la diversification de l'offre, la stratégie française met aussi l'accent sur la liquidité des titres émis , c'est-à-dire la plus ou moins grande facilité avec laquelle ces titres pourront être échangés après avoir été acquis. Il pourrait sembler, de prime abord, que c'est un point qui n'intéresse pas directement l'État : une fois les titres de dette vendus, qu'importe leur devenir ? En réalité, la liquidité des titres émis dans le passé constitue un facteur d'attractivité de la dette émise aujourd'hui : l'idée est qu'un investisseur achètera d'autant plus facilement de la dette française, et à moindre coût, qu'il est certain ou quasi-certain de pouvoir la revendre facilement s'il le souhaite.
La liquidité dépend pour partie de la profondeur du marché , c'est-à-dire, schématiquement, du volume de titres émis. Des titres très spécifiques émis en petits volumes seront plus difficiles à échanger par la suite puisque les acheteurs intéressés seront nécessairement moins nombreux, tandis que des titres standards émis en gros volumes trouveront plus facilement preneur sur le marché secondaire. C'est donc l'objectif de maintien de la liquidité des titres émis qui explique que des titres aux caractéristiques similaires (même année d'échéance, même coupon, même mode de calcul) soient émis plusieurs fois au cours de l'année, voire plusieurs années : l'Agence France Trésor peut par exemple, en 2017, émettre un titre présentant les mêmes caractéristiques qu'un titre émis initialement en 2010 et dont la date d'échéance se situe en 2020. Pour permettre l'assimilation sur des souches existantes, les durées des titres sont alors adaptées sur des souches déjà ouvertes lors des émissions précédentes.
Ce type d'opération consiste à réabonder des « souches » existantes (émissions « off-the-run »), par opposition à la création de nouveaux titres (émissions « benchmark »). Le recours aux émissions « off-the-run » n'est pas propre à la France : les autres émetteurs souverains procèdent au même type d'émissions, indispensables à la liquidité des titres.
En outre, le montant des réabondements a dû être accru en raison du programme d'achats de la Banque centrale européenne qui a acquis d'importants montants de titres de dette souveraine qui ne sont pas destinés à être revendus par la suite, mais conservés dans son bilan. Cela signifie que, pour répondre à la demande des investisseurs « classiques », l'Agence France Trésor doit réabonder plus régulièrement certaines souches qui seraient, sans cela, en « rupture de stock ».
|
Le programme d'achat d'actifs de la Banque centrale européenne Le programme d'achats d'actifs de la BCE ( Asset Purchase Programme ou APP) est composé de quatre volets : - un programme d'achats d'obligations sécurisées ( Covered bond purchase programme 3 ou CBPP3), mis oeuvre depuis le 15 octobre 2014, tendant à faciliter le fonctionnement du marché monétaire européen ; - un programme d'achats de titres adossés à des actifs ( Asset Backed Securities ou ABS) lancé le 21 novembre 2014 visant à aider les banques à diversifier leurs sources de financement et à stimuler le crédit privé ; - un programme d'achats d'obligations privées ( Corporate Sector Purchase Programme ou CSPP) existant depuis le 8 juin 2016 afin d'apporter un soutien plus direct au financement des entreprises ; - et un programme d'achats de titres publics ( Public Sector Purchase Programme ou PSPP) lancé le 9 mars 2015. Les achats de titres publics et privés s'élèvent à environ 60 milliards d'euros par mois depuis avril 2017 (ils atteignaient également 60 milliards d'euros de 2014 à avril 2016 et 80 milliards d'euros d'avril 2016 à avril 2017). Au total, la BCE avait procédé, à la fin du mois d'avril 2017, à l'achat de titres pour 1 834,4 milliards d'euros, dont plus de 80 % de titres publics . Le programme d'achats de titres publics recouvre à la fois des titres souverains, des titres publics émis par des administrations nationales locales et sociales (par exemple, en France, la Cades, l'Agence France Locale, ou encore la Sfil sont éligibles au PSPP) et des titres émis par des entités supranationales (par exemple la Banque européenne d'investissement). La BCE procède à environ 20 % des achats ; le reste est effectué par les banques centrales nationales. La majeure partie des achats s'effectue sur le marché secondaire, de façon bilatérale . Cependant, la procédure d'enchères inversées , qui consiste à demander aux acteurs de marché le prix auquel ils sont prêts à vendre certaines catégories d'actifs et à acheter les offres faites au meilleur prix, a été testée par trois banques centrales nationales, dont la Banque de France, d'octobre à décembre 2015, et maintenue en raison de son utilité pour certaines catégories de titres peu liquides. Les titres publics doivent tous respecter plusieurs critères pour être éligibles au programme d'achats de l'Eurosystème (qui comprend la BCE et les banques centrales nationales) : leur maturité résiduelle doit être comprise entre 2 et 30 ans (pas de titres de court terme ni de très long terme) et l'Eurosystème ne peut pas détenir plus de 33 % d'une ligne obligataire émise par une autorité nationale (50 % dans le cas d'une autorité supranationale). En ce qui concerne la dette souveraine , la répartition des achats entre les États membres de la zone euro est, en principe, proportionnelle à la participation de chaque État au capital de la BCE (soit environ 26 % pour l'Allemagne, 21 % pour la France, 18 % pour l'Italie...). En réalité, les volumes d'achats sont adaptés selon le contexte financier et la France est surreprésentée par rapport à sa part dans le capital : 21,5 % des titres souverains achetés dans le cadre du PSPP sont français, soit une déformation de 2,4 points au regard de la répartition théorique. Les autres pays faisant l'objet d'achats plus importants que prévu sont l'Italie (+ 2 points) et, de façon beaucoup moins marquée, l'Espagne (+ 0,6 point), la Belgique (+ 0,4 point), l'Autriche (+ 0,3 point) et les Pays-Bas (+ 0,2 point). Jusqu'à janvier 2017, le rendement des titres achetés devait être supérieur au taux de la facilité de dépôt . Cependant, ce critère créait des difficultés pour l'Allemagne : l'offre de titres souverains allemands dont le rendement est supérieur au taux de la facilité de dépôt est trop faible pour que l'Eurosystème parvienne à respecter le programme d'achats dans ces conditions. Le 19 janvier 2017, la Banque centrale européenne a donc indiqué que les achats de titres publics dont le taux d'intérêt est inférieur au taux de la facilité de dépôt étaient désormais possibles en cas d'épuisement des autres titres - cet assouplissement ne s'applique qu'au programme d'achat de titres publics, et non aux achats de titres privés. Il s'agit d'une évolution importante dans la mesure où elle signifie que tout se passe comme si la BCE elle-même payait la liquidité qu'elle apporte aux États . Si le cas de l'Allemagne est extrême, le programme d'achats d'actifs publics de la BCE a eu des conséquences sur l'ensemble des États membres de la zone euro : il a contribué à faire baisser les taux d'intérêt tout en réduisant la liquidité des titres, nécessitant des abondements particulièrement importants sur certaines « souches » de titres souverains. |
h) L'impact d'un contexte de taux faibles
(1) L'encaissement de primes à l'émission
Il est évidemment possible et fréquent que le coupon des titres émis sur souches anciennes ne corresponde pas exactement au taux que le marché est prêt à payer . Par exemple, les taux d'intérêt étaient plus importants il y a quelques années qu'aujourd'hui : la plupart des investisseurs acceptent donc un rendement plus faible en 2017 qu'en 2010. Dès lors, une OAT émise en 2017 mais dont les caractéristiques sont calquées sur une OAT créée en 2010 présentera un coupon nettement supérieur à celui du marché. Il n'est évidemment pas question de faire cadeau aux investisseurs de cette différence : cela signifierait que l'État accepterait de s'endetter pour un coût plus élevé que celui du marché. Afin de concilier le maintien de la liquidité des titres émis et la maîtrise du coût de financement de l'État, la différence entre le rendement que les acheteurs sont prêts à accepter et le coupon du titre donne lieu à des primes (si le coupon est supérieur au taux du marché) ou des décotes (dans le cas contraire) à l'émission. En d'autres termes, dans le cas d'une prime à l'émission, la banque acheteuse versera à l'État, en une seule fois, la différence entre le taux de marché et le coupon. Ce versement annule la différence entre le coupon du titre et le taux du marché. L'État paiera ensuite des intérêts conformes au coupon du titre.
Le montant des primes à l'émission perçues par l'État en 2015 a été particulièrement élevé et a donné lieu à un débat sur le bien-fondé de la stratégie d'émission de la France, certains estimant que ces recettes constituaient une façon détournée, pour l'État, de reporter dans le futur la charge d'intérêts des titres émis.
Graphique n° 45 : Part des émissions sur souches anciennes et primes (nettes des décotes) à l'émission perçues par l'État depuis 2008
(en % et en milliards d'euros)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'AFT et des données présentées dans les projets annuels de performances de la mission « Engagements financiers de l'État »)
Il est difficile de souscrire à une telle analyse, dans la mesure où les primes à l'émission ne constituent pas une recette budgétaire, susceptible par exemple de diminuer artificiellement le déficit de l'État, mais bien, en comptabilité budgétaire, une ressource de trésorerie . Les primes ont été utilisées pour diminuer l'encours de titres de court terme - et non pour réduire les émissions de moyen et long terme - ce qui contribue à réduire l'exposition de l'État à une hausse des taux. En comptabilité nationale, les primes et décotes à l'émission sont étalées sur toute la durée de vie du titre et n'ont donc aucun impact sur le niveau du déficit public.
En outre, l'encaissement de primes (ou le versement de décotes) ne résulte pas d'un calcul politique, mais du choix de l'émetteur souverain de maintenir la liquidité des titres sur l'ensemble de la courbe des taux. Ce choix est bien antérieur au contexte de taux actuel : les émissions sur souches anciennes représentaient par exemple 38,5 % du total des émissions en 2009 et 40,5 % en 2011, contre 33,9 % en 2015 et 19,1 % en 2016.
L'encaissement de primes à l'émission était donc quasiment inévitable dans le contexte de taux actuel et n'aurait pu être empêché qu'à la condition de ne pas émettre de titres sur souches anciennes, ce qui aurait été préjudiciable à la liquidité des titres français et en rupture avec la stratégie jusqu'alors - et de longue date, quel que soit le contexte de taux - menée par l'Agence France Trésor.
Les primes à l'émission ne constituent donc ni une mesure de bonne gestion, ni un moyen détourné de reporter la charge de la dette dans le futur , mais une conséquence inévitable du maintien de la liquidité des titres français dans un contexte de taux très bas.
(2) Une légère hausse de la maturité des titres de dette
Peut être constatée, depuis 2014, une hausse de la maturité moyenne du stock de dette émis par l'État. La durée de vie de la dette a ainsi crû de 6,6 ans en 2009 à 7,6 ans en 2017, avec une inflexion marquée à partir de 2014 (la durée de vie de la dette s'élevait alors à 7 ans). Cette augmentation résulte de deux principales évolutions.
Graphique n°
46
:
Évolution de la maturité résiduelle de la dette de
l'État
depuis 2006
(en années)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'AFT)
D'une part, la part des titres de court terme dans les émissions a été réduite plusieurs années de suite : elle est passée de 18,6 % en 2009 à 8,3 % du total de l'encours de dette en 2016. Cette baisse résultait notamment de l'encaissement de primes à l'émission importantes sur les émissions de moyen et long terme, comme cela a été expliqué précédemment.
D'autre part, la faiblesse prolongée des taux d'intérêt favorisait un endettement de plus long terme, à la fois à la demande des investisseurs pour qui les maturités élevées permettaient de retrouver un rendement légèrement supérieur , et dans le but de limiter l'exposition de l'État à une remontée des taux : plus la maturité moyenne de la dette est élevée, et plus le renouvellement du stock de dette est graduel.
Au regard des autres pays européens, la maturité de la dette française, si elle est l'une des plus élevées de la zone euro, n'a rien d'exceptionnel ni d'inquiétant : elle est inférieure à celle de la dette belge ou autrichienne (dont la maturité est supérieure à 8 ans) mais supérieure à la durée de vie de la dette allemande ou italienne (qui se situe un peu en-dessous de sept ans).
Graphique n°
47
:
Évolution de la maturité de la dette souveraine de 33 pays
de
l'OCDE de 2007 à 2015
(en années)
Source : OCDE Sovereign Borrowing Outlook 2016
Comme le souligne le rapport précité de l'OCDE 110 ( * ) , cette tendance à l'augmentation de la maturité de la dette souveraine n'est pas propre à la France et la part des émissions de moyen et long terme, par opposition aux titres de court terme, croît dans la plupart des pays de l'OCDE dans des proportions beaucoup plus fortes qu'en France. En effet, « l'allongement de la durée de vie de la dette souveraine peut permettre de minimiser les coûts face à une forte incertitude concernant le contexte d'émissions futur ». Cette stratégie réduit en particulier le risque associé à l'amortissement de la dette qui « roule », qui constitue une part croissante du besoin de financement annuel de l'État.
i) Une gestion active de la dette se traduisant par un volume important de rachats
L'État dispose de plusieurs instruments pour mettre en oeuvre une gestion active de la dette , c'est-à-dire intervenir sur les titres déjà émis.
Quatre de ces outils sont assez peu utilisés aujourd'hui, pour des raisons variables.
La Caisse de la dette publique (anciennement la Caisse d'amortissement de la dette publique), établissement public administratif créé par la loi de finances pour 2003, peut effectuer, sur les marchés financiers, toutes les opérations concourant à la qualité de la signature de l'État , notamment sur le marché secondaire - principalement pour en assurer la liquidité. La Caisse de la dette publique peut ainsi amortir des titres émis par l'État ou repris à un tiers . Elle procède également aux opérations réalisées au titre de la facilité de pensions livrées. Schématiquement, cette facilité permet à certains spécialistes en valeur du Trésor de bénéficier de prêts de titres en cas de besoin. Les titres sont créés par l'AFT, prêtés à l'établissement bancaire pour une durée très courte (inférieure à une semaine) puis remis par la banque à l'AFT, qui procède alors à leur destruction. Il ne s'agit donc pas d'une émission, mais d'une possibilité accordée à un nombre très réduit de banques et qui ne saurait être utilisée trop fréquemment.
En pratique, l'activité de la Caisse ces dernières années est marginale : au total, depuis sa création en 2003, la Caisse de la dette publique a procédé à des rachats d'un montant total (en valeur courante) de 10 milliards d'euros.
Le caractère réduit des rachats opérés par la Caisse de la dette publique s'explique pour partie par la faiblesse des recettes allouées au désendettement de l'État . En effet, le Caisse est financée par des programmes budgétaires spécifiques visant à réduire la dette par l'affectation de ressources dédiées à des rachats. Deux comptes d'affectation spéciale (CAS) comprennent aujourd'hui un programme de désendettement : « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » (programme 755) et « Participations financières de l'État » (programme 732). Le CAS « Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien » qui en comportait également un, n'a jamais contribué au désendettement de l'État ; il a été supprimé par la loi de finances pour 2016 111 ( * ) . De même, le programme 721 « Désendettement de l'État » du CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l'État » a été supprimé par la loi de finances pour 2017 112 ( * ) . Les ressources affectées à ces programmes n'excèdent pas, dans le meilleur des cas, quelques milliards d'euros par an , ce qui ne permet pas de maîtriser la trajectoire de la dette publique.
En outre, le contexte actuel de faibles taux d'intérêt réduit la pertinence d'une stratégie de cession d'actifs : les recettes perçues par ce biais doivent être mises au regard de la dégradation durable du patrimoine financier de l'État, tandis qu'un endettement à bas coût sur moyen terme permettrait de préserver des actifs dont certains peuvent prendre de la valeur.
L'État peut aussi échanger des titres peu liquides, souvent anciens, contre d'autres titres plus demandés sur le marché : l'achat des titres nouveaux peut alors être « payé » par des titres anciens, ce qui conduit à les détruire. Cependant, aucune opération de ce type n'a eu lieu depuis 2008.
La liquidité des titres souverains reste donc avant tout assurée par la politique d'émissions et l'animation du marché secondaire par les SVT .
L'Agence France Trésor peut aussi gérer non pas la liquidité, mais la maturité de la dette en recourant à des contrats d'échanges de taux ( swaps ) pour diminuer la durée de vie de son portefeuille. La réduction de la maturité est particulièrement intéressante dans une situation caractérisée par une courbe des taux nettement ascendante, c'est-à-dire présentant des taux longs plus élevés et des taux courts plus faibles. Elle présente cependant l'inconvénient d'augmenter le risque car les taux courts sont plus volatils. Réduire la durée moyenne de la dette permet donc en principe de diminuer en moyenne, sur longue période, la charge d'intérêts, mais implique également que sa variabilité est accrue. Aucun contrat d'échange de taux n'a été conclu depuis 2002 en raison des conditions de marché, peu propices à de telles opérations : la courbe des taux s'est aplatie et ne justifie pas de réduction immédiate de la maturité de la dette.
La gestion active de la dette passe, aujourd'hui, principalement par les rachats de titres destinés à arriver à échéance l'année en cours, l'année suivante ou celle d'après : ils visent à lisser les échéances pour éviter que l'État n'ait à « faire rouler » un part trop importante de sa dette certaines années. Ils se distinguent des rachats de la Caisse de la dette publique car ils ne constituent pas un désendettement de l'État. Ces rachats constituent aussi un élément de souplesse pour la politique d'émission , à la fois vis-à-vis du Parlement et des marchés financiers : les montants qui figurent au tableau de financement voté par le Parlement sont indiqués nets des rachats et l'Agence France Trésor ne communique pas aux marchés financiers une cible de rachats.
Graphique n°
48
: Montant
des rachats et part dans les émissions (brutes)
de 2007 à
2016
(en milliards d'euros et en %)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'AFT)
Les rachats constituent le principal instrument de gestion active de la dette : ils ont significativement augmenté ces dernières années pour atteindre 33 milliards d'euros en 2015. Cette hausse s'explique par le pic d'émissions réalisées au cours de la crise économique et financière de 2008-2009 et qui arrivaient à échéance en 2016 et 2017. Le profil de remboursement de la dette souveraine va rester élevé jusqu'en 2021 et il est donc probable que les rachats se stabilisent à ce niveau pendant quelques années.
Au total, la stratégie de financement de l'État, qui a connu des inflexions très marquées depuis la deuxième moitié du XX e siècle, s'appuie de façon quasi-exclusive sur les marchés financiers. La qualité de la gestion de la dette permet, dans un contexte aujourd'hui particulièrement favorable, d'alléger le fardeau de la dette publique. Pourtant, la dette publique n'en demeure pas moins un poids réel pour l'économie française .
2. La gestion de la dette des collectivités territoriales
Le tissu local français manifeste une grande variété de situations financières . L'endettement local ne présente donc pas un seul visage et la gestion de la dette des administrations locales est d'abord marquée par l'hétérogénéité des collectivités territoriales .
La dette locale fait l'objet d' un encadrement juridique plus strict que celui de l'État : est ainsi interdit le recours à l'emprunt pour le financement de dépenses de fonctionnement et l'endettement est circonscrit aux dépenses d'investissement. Si ces règles ont fait la preuve de leur utilité, force est de constater, comme la crise des emprunts dits « toxiques » l'a souligné, qu'elles ne sont pas, par elles-mêmes, suffisantes pour garantir la soutenabilité de l'endettement local .
La recomposition du paysage financier local ne paraît à ce titre pas pleinement achevée , à la fois du point de vue de l'offre de financement - les acteurs traditionnels font face à une concurrence accrue et à la montée en puissance des émissions obligataires - et juridique : le renforcement des modalités d'accompagnement des collectivités locales face à une dette appelée à croître n'a jusqu'ici porté que sur les seuls emprunts « à risque ».
a) Un endettement local encadré par la « règle d'or »
Le budget des collectivités territoriales doit être voté et exécuté à l'équilibre réel : chacune des deux sections (de fonctionnement et d'investissement) doit se trouver en équilibre comptable, c'est-à-dire avec un solde positif ou nul. L'emprunt est budgétisé comme une ressource - ce qui n'est pas le cas pour l'État, dont les recettes budgétaires n'incluent pas l'endettement.
Mais l'emprunt local ne peut pas financer n'importe quelle dépense : les collectivités territoriales et leurs établissements ne peuvent pas financer des dépenses de fonctionnement par l'emprunt et ce principe est souvent surnommé la « règle d'or ».
L'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales oblige ainsi les collectivités territoriales à financer l'ensemble de leurs dépenses de fonctionnement par des recettes propres , et leur permet d'avoir recours à l'endettement uniquement pour financer leurs investissements.
En outre, contrairement à l'État, les collectivités territoriales ne peuvent pas recourir à l'emprunt pour financer le remboursement de leur dette arrivant à échéance. En effet, le remboursement du capital des emprunts doit être couvert par l'excédent de la section de fonctionnement (l'épargne brute) transféré en section d'investissement, augmenté des seules recettes propres de cette section à l'exclusion des nouveaux emprunts.
Enfin, les dépenses imprévues inscrites à la section d'investissement du budget ne peuvent être financées par l'emprunt 113 ( * ) .
Le respect de ces règles fait l'objet d'un double contrôle a posteriori : outre le contrôle de légalité préfectoral, le budget des collectivités locales est soumis à un contrôle budgétaire spécifique, exercé par le préfet et la chambre régionale des comptes (CRC).
|
Le traitement de l'emprunt dans la comptabilité des collectivités territoriales I. Une nomenclature comptable fondée sur une bipartition entre la section de fonctionnement et la section d'investissement Le budget des collectivités locales est construit sur la même nomenclature que leurs états comptables , contrairement au budget de l'État dont la présentation et la gestion obéissent à des règles bien distinctes de celles liées au compte général. En début d'exercice est voté le budget primitif , qui fixe les ressources et les charges de l'année à venir. Il peut être modifié par le biais de budgets modificatifs . À l'issue de la gestion, doit être voté le compte administratif qui arrête le résultat de l'exercice. Si la comptabilité des communes, des départements et des régions ne correspond pas tout à fait aux mêmes nomenclatures, certains grands principes sont communs - en particulier la bipartition entre section de fonctionnement et section d'investissement . La section de fonctionnement regroupe les dépenses nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité territoriale. Il s'agit donc principalement de dépenses qui reviennent chaque année, comme les charges de personnel, les achats de fournitures, les charges financières... La section d'investissement comprend des opérations qui se traduisent par une modification de l'ampleur ou de la valeur du patrimoine de la collectivité locale . Il peut donc s'agir d'achats de biens durables, de la construction ou de l'aménagement de bâtiments, de travaux d'infrastructure... L'acquisition de titres de participation est également comptabilisée en section d'investissement. Les sections de fonctionnement et d'investissement diffèrent non seulement en matière de dépenses, mais aussi de recettes : ainsi, les recettes fiscales provenant des impôts locaux, la dotation globale de fonctionnement (DGF) et les participations provenant d'autres organismes ou collectivités locales sont inscrites en fonctionnement, tandis que la dotation globale d'équipement (DGE), les subventions d'investissement, les versements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sont portées en investissement. Les deux sections doivent nécessairement être équilibrées en recettes et en dépenses. Si les recettes de la section de fonctionnement sont en excédent sur les dépenses, le différentiel correspond à l'épargne brute de la collectivité locale. II. Le traitement de l'emprunt En dépenses, le montant du remboursement en capital des emprunts fait partie des dépenses d'investissement , alors que les intérêts des emprunts sont imputés en section de fonctionnement . L'emprunt ne peut constituer une recette qu'en investissement . Cependant, cela ne signifie pas pour autant que le capital d'un emprunt contracté dans le passé puisse être remboursé grâce à un nouvel emprunt. En effet, la somme de l'épargne brute et des recettes d'investissement de la collectivité hors emprunt doit permettre de couvrir les annuités de remboursement du capital des emprunts . |
L'obligation du financement du remboursement du capital par l'épargne brute rend donc difficile le recours à des emprunts in fine , c'est-à-dire des emprunts dont le capital est remboursé en une seule fois au terme de la durée de l'emprunt. Les collectivités locales recourent donc presque exclusivement à des prêts amortissables , pour lesquels le remboursement du capital est étalé dans le temps, de façon similaire aux intérêts.
Leur justification économique est fondée sur l'idée que l'endettement n'est soutenable que s'il est utilisé pour accroître le patrimoine de la collectivité territoriale, et non pour faire face à des dépenses courantes. Si l'utilité de ces règles ne fait pas débat, il faut noter qu'elles ne sont pas nécessairement suffisantes pour assurer la soutenabilité de la dette locale , comme en témoigne la crise des emprunts dits « toxiques », qui a affecté de nombreuses collectivités territoriales et nécessité une intervention de l'État pour assurer la continuité de leur financement.
Schéma n° 49 : présentation simplifiée du financement de la section d'investissement d'une collectivité territoriale
Source : commission des finances du Sénat
b) Les effets durables de la crise des emprunts « toxiques » de 2008
La crise des emprunts dits « toxiques » correspond aux difficultés de financement rencontrées par les collectivités territoriales à partir de 2008 en lien avec un encours important d'emprunts à risque, souscrits en devise ou dont les taux d'intérêt étaient basés sur des indices volatils et sans lien avec les évolutions du besoin de financement des acteurs locaux.
(1) Des produits risqués souscrits en masse par le secteur public local
Comme le souligne le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les produits financiers à risque détenus par les acteurs publics locaux 114 ( * ) , publié en 2011, si les tous premiers emprunts sophistiqués apparaissent à la fin des années 1990 pour répondre aux besoins spécifiques d'organismes du logement social, d'hôpitaux ou de grandes collectivités, ils se sont rapidement répandus au cours des années 2000 . Du côté des banques, ces produits complexes permettaient aux établissements de se démarquer de la concurrence et de restaurer une partie de leurs marges, émoussées par la baisse des taux d'intérêt. Pour les collectivités territoriales, ces emprunts - dont le caractère périlleux n'était souvent pas clairement perçu par les exécutifs locaux, ni présenté comme tel par les commerciaux chargés d'en faire la promotion - présentaient l'avantage de comporter une période plus ou moins longue (en général concentrée au début du contrat) pendant laquelle les conditions de financement étaient particulièrement favorables : taux bonifiés, durée d'amortissement prolongée, différés d'amortissement importants 115 ( * ) ... Ces produits étaient d'autant plus attractifs que les collectivités locales étaient confrontées à des besoins de financement croissants , en lien avec l'acte II de la décentralisation 116 ( * ) (voir supra ). Il semblerait également que la forte remontée des taux d'intérêt entre 2006 et 2008 ait accentué l'attrait de produits qui proposaient des taux « bonifiés » les premières années du prêt.
Au total, la commission d'enquête précitée a recensé 10 690 prêts structurés et a évalué le total de l'encours d'emprunts à risques à 18,8 milliards d'euros .
|
Emprunts à risque et emprunts structurés La notion d'emprunt à risque ne recouvre que partiellement celle d'emprunt structuré . Un emprunt structuré est constitué d'une « combinaison entre prêt bancaire et dérivé de marché » 117 ( * ) . Il s'agit d'un emprunt bancaire dont certaines des caractéristiques - en général le taux - dépendent d'un ou de plusieurs sous-jacents dérivés, par exemple le rapport entre deux taux d'intérêt sur des maturités différentes (effet de pente) ou l'évolution du taux de change de deux monnaies (effet de change). À la différence d'un simple taux variable, la formule de calcul des emprunts structurés peut intégrer des effets de cliquet (« barrière activante » : l'augmentation du taux est irréversible, même si le sous-jacent évolue par la suite en sens inverse) ou « boule de neige » : le taux de l'échéance précédente est intégré au nouveau taux, qui augmente de façon cumulative au cours du temps. Elle peut également se composer de plusieurs formules , dont l'application est conditionnée à la réalisation d'un ou plusieurs évènements définis dans le contrat, et comporter des options. Si les emprunts structurés sont assurément plus complexes que des prêts à taux fixe ou à taux variable simple, ils n'ont sont pas pour autant tous « toxiques » ou particulièrement risqués . Un emprunt apparemment plus simple peut présenter plus de risque , par exemple s'il est souscrit en devises et que le risque de change n'est pas couvert. |
(2) Un danger rendu manifeste par l'éclatement de la crise américaine des « subprimes » en 2008
Les risques induits par les emprunts complexes ont été rendus manifestes par la crise des « subprimes » qui a éclaté aux États-Unis en 2008 mais dont les prémices étaient perceptibles quelques années plus tôt.
En effet, dès la fin de l'année 2006 , la courbe des taux sur l'euro s'aplatit puis s'inverse, ce qui signifie que les taux courts deviennent supérieurs aux taux longs - une situation très inhabituelle dans la mesure où le risque pris par les prêteurs est en principe plus faible à court terme et justifie des taux moins élevés.
L'inversion de la courbe des taux sur l'euro a dégradé la situation des acteurs locaux ayant souscrit des produits « de pente » , dont les intérêts pouvaient augmenter considérablement. Face à la hausse du coût du financement, de nombreuses collectivités ont décidé, au premier semestre 2007, de refinancer ces emprunts à l'aide d'autres produits structurés, qui semblaient permettre de limiter la hausse des taux - mais qui étaient souvent indexés sur la parité euro/franc suisse.
Or la défiance généralisée à l'égard des actifs titrisés a conduit à ce que le franc suisse devienne une valeur « refuge » et s'apprécie rapidement, ce qui a déstabilisé les collectivités locales ayant souscrit des produits « de change » ( swaps de change) fondés sur la monnaie suisse. D'après un rapport de la commission des finances du Sénat 118 ( * ) , les indemnités de remboursement anticipé de certains emprunts indexés sur le franc suisse pouvaient représenter 150 % de l'encours restant dû.
Enfin, l'assèchement des marchés financiers n'a pas épargné les collectivités locales . Comme le soulignait le Conseil d'analyse économique dans un rapport de 2008 119 ( * ) , la diminution des liquidités disponibles sur certains marchés - les banques rationnaient les volumes de prêts accordés car elles ne parvenaient plus à se financer elles-mêmes - s'est accompagnée d'une hausse des prix ; en effet, les taux d'intérêt augmentaient fortement, en lien avec le coût de financement des banques.
Au total, les collectivités locales ont vu leur charge d'intérêts augmenter dans des proportions importantes et leur offre de financement se raréfier , d'autant plus que Dexia, un acteur majeur du financement du secteur local, en particulier en matière d'emprunts structurés, rencontrait des difficultés récurrentes à partir de septembre 2008 qui ont finalement mené à son démantèlement à partir de 2011.
|
De Dexia à la Société française de financement local (Sfil) Dexia était une banque commerciale privée née de l'alliance, en 1996, du Crédit communal de Belgique avec le Crédit local de France. Si ses activités étaient avant tout centrées sur les prêts au secteur public local, l'établissement avait également investi les secteurs de l'assurance et de la gestion d'actifs à travers des acquisitions. Le portefeuille de l'établissement était marqué par une asymétrie entre l'actif et le passif : Dexia finançait la majeure partie de ses prêts et placements de long terme par une dette à court terme, qui était en théorie moins onéreuse et lui permettait donc de maintenir des marges élevées. Cette stratégie rendait cependant l'établissement très vulnérable à une crise du financement interbancaire , ce qui explique que dès septembre 2008, Dexia ne soit plus parvenue à se financer sur le marché interbancaire. L'établissement bancaire a donc fait l'objet d'une recapitalisation de 6,4 milliards d'euros par les États français, belge (ayant chacun contribué à hauteur de 3 milliards d'euros) et luxembourgeois (pour 400 millions d'euros). L'injection de capital s'est accompagnée d'une garantie d'État portant sur les nouveaux financements levés auprès des contreparties institutionnelles ou professionnelles, plafonnée à 150 milliards d'euros et dont la France assurait 36,5 % (contre 60,5 % pour la Belgique et 3 % pour le Luxembourg). Ce déséquilibre trouvait peut-être son origine dans les contraintes propres au financement des collectivités territoriales : les entités locales françaises ne peuvent pas effectuer de dépôt auprès de leurs établissements de crédit car elles sont contraintes de déposer leurs liquidités auprès du Trésor. « En conséquence, ce surplus d'actifs doit trouver un financement qui soit suffisamment peu onéreux - donc plutôt de court terme - pour garantir le maintien des marges » 120 ( * ) . En outre, l'établissement détenait également des produits financiers de mauvaise qualité , ou« subprimes », ce qui a contribué à le fragiliser encore davantage. Après la première recapitalisation de 2008, Dexia a tenté de se reconstruire mais une nouvelle raréfaction du crédit sur le marché interbancaire est intervenue au mois d'août 2011 avec l'aggravation de la crise de la dette souveraine en Europe et l'établissement paraissait trop fragile pour y faire face. Les États belge, français et luxembourgeois se sont alors engagés à garantir 90 milliards d'euros de financements obtenus par Dexia. La part de la France dans cette garantie s'établissait à 32,85 milliards d'euros et couvre les financements levés jusqu'au 31 décembre 2021, sans limite de maturité. Ces nouvelles garanties ne visaient pas à remettre l'établissement à flot mais à préparer son démantèlement : les entités encore viables ont été rachetées par l'État belge (Dexia Bank Belgium) et par la France (Dexia Municipal Agency), ou vendues (filiales luxembourgeoise et turque). L'établissement Dexia perdure comme « bad bank » , qui conserve l'ensemble des créances douteuses (environ 90 milliards d'euros d'actifs à risque) et les amortit peu à peu. Dexia Municipal Agency, qui assurait le financement des collectivités territoriales françaises, a été renommée « Caisse française de financement local » (Caffil) détenue et gérée par un nouvel établissement créé à cette fin : la Société de financement local (Sfil) , elle-même détenue à 75 % par l'État, à 20 % par la Caisse des dépôts et à 5 % par La Banque postale. Au total, le sinistre de Dexia aurait coûté environ 13 milliards d'euros aux contribuables français (ce chiffre incluant les recapitalisations successives par l'État et la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les indemnités de remboursement anticipé versées par les collectivités territoriales et les hôpitaux). |
Le démantèlement de Dexia décidé fin 2011 a accentué les difficultés de financement des collectivités territoriales et la création d'un nouvel établissement a pris du temps (la Sfil n'a finalement été mise en place que le 1 er février 2013).
Une enveloppe de secours de 3,6 milliards d'euros destinée à des prêts de très long terme et prélevée sur le Fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations 121 ( * ) a donc été débloquée par l'État en octobre 2011, puis portée à 5,6 milliards d'euros fin novembre (soit 2 milliards d'euros supplémentaires en 2012). En outre, trois enveloppes supplémentaires de 5 milliards d'euros chacune ont été mises à disposition des collectivités territoriales en 2008, 2011 et 2012, pour des financements de maturité plus courte. Les deux tiers du total ont été distribués à travers la Caisse des dépôts (CDC) et le reste l'a été par des banques commerciales.
Ces fonds répondaient donc partiellement au problème de liquidité rencontré par les collectivités territoriales, mais les prix étaient identiques à ceux pratiqués par le reste des établissements bancaires , c'est-à-dire particulièrement élevés, en lien avec les conditions de financement sur le marché interbancaire.
L'État a également créé, fin 2012, un fonds de soutien 122 ( * ) destiné aux collectivités territoriales et aux hôpitaux doté de 50 millions d'euros, ayant vocation à apporter une aide financière aux collectivités particulièrement fragiles qui n'auraient pas la possibilité de financer seules le coût de sortie ou de réduction du risque de leurs emprunts structurés les plus sensibles. Il était financé pour moitié par un prélèvement sur des recettes affectées aux collectivités locales.
Le fonds a été transformé et pérennisé en 2014 123 ( * ) . Sous l'égide d'un comité national d'orientation et de suivi (CNOS) chargé d'émettre des recommandations sur les modalités d'intervention du fonds, il est désormais prévu que le fonds soit abondé de 100 millions d'euros par an sur quinze ans. Afin de faire participer les banques à la résolution d'un problème qu'elles ont en partie créé, ce fonds est financé pour plus de moitié par le secteur bancaire à travers une « contribution volontaire » annuelle de 11,5 millions d'euros versée par Dexia et la Sfil et une taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales 124 ( * ) reprenant les principales caractéristiques de la taxe de risque systémique et dont le rendement s'est élevé en 2016 à environ 100 millions d'euros .
Au total, début 2015, le fonds a été doté depuis sa création de 1,6 milliard d'euros en autorisations d'engagement .
(3) Une dette locale encore davantage fragilisée avec l'appréciation brutale du franc suisse en 2015
La Banque centrale suisse a maintenu, de 2011 à 2015, un plancher de 1,2 franc suisse pour un euro : si ce taux de change était déjà élevé, il a protégé les collectivités territoriales de conséquences financières plus graves encore.
Ce plancher a été abandonné de façon inattendue au début de l'année 2015, entraînant un choc majeur pour les prêts indexés sur la parité euro/franc suisse . Comme le souligne le rapport de la commission des finances précité, « le calibrage des fonds de soutien ainsi que leur doctrine d'intervention sont alors devenus inadéquats par rapport aux objectifs poursuivis compte tenu du reste à charge pour l'emprunteur » 125 ( * ) .
L'État a donc décidé de renforcer la capacité d'intervention du fonds de soutien, qui a été doublé et porté à 3 milliards d'euros 126 ( * ) . Une partie de cette hausse est financée par le relèvement du taux de la taxe pesant sur le secteur bancaire affectée au fonds 127 ( * ) . Les conditions d'octroi des aides ont également été revues en 2015 afin de prendre en charge la quasi-totalité des surcoûts.
2,9 milliards d'euros avaient été engagés à la fin de l'année 2016 et environ 230 millions d'euros de crédits de paiement ont été effectivement décaissés depuis sa création. Au total, le fonds dispose de près de 400 millions d'euros de crédits de paiement en 2017 .
L'efficacité du fonds de soutien ne pourra être confirmée qu'après quelques années de fonctionnement. Pour l'heure, une incertitude subsiste, qui implique donc la plus grande vigilance quant au fonctionnement du fonds et à son abondement régulier en crédits de paiement , conformément aux engagements du Gouvernement.
c) Une recomposition du paysage financier local qui n'est sans doute pas encore achevée
A la crise des emprunts toxiques succède une période de relative accalmie en matière de financement des collectivités territoriales : la faiblesse prolongée des taux d'intérêt et la concurrence accrue entre les financeurs permettent à la plupart des collectivités locales de bénéficier d'un accès aisé à des emprunts dont le coût est contenu . Se développent des modes de financement alternatifs aux modèles proposés par les banques commerciales traditionnelles : la Banque européenne d'investissement (BEI) aurait ainsi représenté plus de 20 % des prêts souscrits en 2015 128 ( * ) et l'endettement obligataire , longtemps réservé à quelques-unes des plus grandes collectivités territoriales, monte peu à peu en puissance et aurait constitué environ 14 % des nouveaux emprunts en 2015 129 ( * ) . Ce mouvement est pour partie lié à l'émergence d'un acteur nouveau, l'Agence France Locale , dont le modèle de financement est calqué sur celui des agences scandinaves. Les prochaines années permettront de confirmer, ou non, la pertinence du modèle retenu.
D'un point de vue juridique, les difficultés rencontrées par le secteur public local en matière d'emprunts à risque ont donné lieu à un encadrement resserré des possibilités d'endettement des collectivités locales et de leurs établissements. Les nouvelles règles mises en place se limitent cependant à la question des emprunts risqués et la question plus large des conditions de soutenabilité de la dette locale reste ouverte .
(1) Une concurrence accrue entre les financeurs du secteur public local
Comme le souligne la Cour des comptes, « l'offre de crédit aux collectivités locales est désormais abondante ».
Outre les acteurs traditionnels que sont les banques mutualistes privées (groupe Banque populaire - Caisse d'épargne ou BPCE, Crédit mutuel et Crédit agricole), de nouveaux acteurs privés interviennent sur des opérations ponctuelles de grande ampleur . C'est notamment le cas de l'établissement allemand Pbb Deutsche Pfandbriefbank et de la banque française BNP Paribas.
Les banques publiques, françaises et européennes, représentent également une part importante du marché et, fin 2015, plus de 40 % de l'encours de dette des collectivités locales était détenu par quatre établissements publics : la Caisse des dépôts et consignations (CDC), la Banque européenne d'investissement (BEI), la Sfil-Banque postale et Dexia 130 ( * ) .
La Caisse des dépôts et la Banque postale ont en effet développé une offre destinée aux collectivités territoriales depuis 2011 , c'est-à-dire depuis le démantèlement de Dexia.
La CDC propose à la fois des prêts à taux zéro ou préférentiels de long terme, sur l'enveloppe de 20 milliards d'euros du Fonds d'épargne mise en place par l'État sur la période 2013-2017 (notamment les emprunts « croissance verte »), des facilités de préfinancement du FCTVA, et des offres commerciales comparables à celles de banques privées.
L'arrivée de nouveaux acteurs accentue la concurrence : ainsi, les collectivités locales dont la situation financière est saine, reçoivent des offres de crédits représentant généralement cinq à six fois le montant des besoins exprimés 131 ( * ) . Les établissements bancaires doivent également faire face à la montée en puissance de l'endettement obligataire .
(2) D'un point de vue juridique, un encadrement renforcé limité aux seuls emprunts « à risque »
Suite à la crise des emprunts toxiques, le cadre juridique du recours à l'emprunt par le secteur public local a été précisé pour prévenir la souscription des emprunts les plus risqués et limiter l'offre de financement à des produits relativement simples.
Si les emprunts futurs ont donc fait l'objet d'un encadrement renforcé, le stock de prêts risqués déjà souscrits a, quant à lui, été validé par une loi visant à éviter la remise en cause par voie de contentieux d'un grand nombre de contrats et la substitution du taux d'intérêt légal aux dispositions contractuelles.
(a) L'interdiction des produits les plus complexes
Ainsi, l'article 32 de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires 132 ( * ) prévoit que les contrats conclus par les collectivités territoriales 133 ( * ) en devises étrangères doivent faire l'objet d'une couverture intégrale contre le risque de change à travers un contrat d'échange de devises contre euros, qui doit être conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt.
Les taux variables ne sont pas interdits, mais un décret en Conseil d'État 134 ( * ) détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables : sont autorisés les taux d'intérêt indexés ou variant en fonction du taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou des emprunts émis par un État membre de la zone euro, de l'inflation, du prix d'un échange de taux entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire et des taux d'intérêt des livrets d'épargne réglementés. Certains de ces indices autorisés, comme le prix d'un échange de taux entre des maturités différentes ( constant maturity swap ) ou les taux d'intérêt réglementés, varient donc de façon peu ou pas corrélée à l'activité des collectivités territoriales.
La formule d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières . Ainsi, le taux d'intérêt, s'il est variable, doit se calculer comme la somme d'un indice et d'une marge fixe - ce qui exclut les effets « boule de neige » ou de cliquet. En outre, le taux d'intérêt ne peut jamais, tout au long de la durée de l'emprunt, excéder le double du plus bas taux d'intérêt constaté dans les trois premières années suivant la souscription du prêt - des taux « bonifiés » sur les premières années ne pourront donc plus être compensés par des taux très élevés les années suivantes.
La seule dérogation prévue concerne le cas où un nouvel emprunt complexe pourrait permettre de réduire le risque associé à un autre emprunt sophistiqué souscrit avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles. La loi prévoit cependant que, « dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation ».
(b) La validation législative des contrats d'emprunts structurés
Les contrats d'emprunts structurés ont initialement fait l'objet d'une jurisprudence plutôt protectrice pour les collectivités territoriales : deux décisions du tribunal de grande instance de Nanterre, en 2013 et en 2014, se sont appuyées sur l'absence de mention du taux effectif global (ou TEG) sur certains documents jugés contractuels 135 ( * ) ou des éléments erronés relatifs au calcul du TEG 136 ( * ) pour prévoir l'annulation des contrats et la substitution du taux d'intérêt légal , très avantageux, à la stipulation d'intérêts prévue par le contrat.
Le nombre de contentieux initiés par les collectivités territoriales a donc rapidement crû et il est passé de 66 en 2012 à près de 400 en 2014.
Ces décisions de justice impliquaient en principe un provisionnement du risque par les banques ayant conclu des contrats similaires, ce qui créait une charge financière potentielle pour l'État en raison des participations détenues dans Dexia et la Sfil, dont les contrats représentaient une part importante des contentieux. Ces deux banques auraient dû provisionner au minimum 3,6 milliards d'euros et l'ampleur maximale du risque financier était estimée à environ 10 milliards d'euros.
L'État a fait le choix de valider législativement les contrats . Après une première tentative en 2013 137 ( * ) , censurée par le Conseil constitutionnel en raison de l'imprécision de son champ d'application, un dispositif de validation a finalement été adopté en juillet 2014 138 ( * ) .
(3) Une montée en puissance de l'endettement obligataire qui reste à confirmer
À première vue, la répartition entre emprunts bancaires et créances obligataires peut paraître relativement stable dans la mesure où, depuis 1995, les crédits bancaires de long terme représentent la large majorité de la dette des administrations publiques locales et constituaient encore un peu plus de 91 % du stock en 2016.
Cependant, la part du financement désintermédié (emprunt obligataire) dans le total de l'encours a crû de façon significative ces dernières années , avec une nette inflexion à partir de 2010 : la part des titres obligataires a ainsi augmenté de 31 % en 2011 et de 20 % en 2012.
Graphique n° 50 : Structure de la dette des administrations publiques locales
(en %)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
Graphique n° 51 : Taux de croissance annuel de la part de l'endettement obligataire et bancaire des administrations locales
(en %)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
(a) Des émissions obligataires qui ont longtemps été l'apanage des collectivités locales les plus importantes
Alors que le marché obligataire local est très développé chez certains de nos voisins européens, en particulier en Allemagne et dans les pays scandinaves, le recours au financement désintermédié, en France, a longtemps été limité aux collectivités de taille plus importante , en raison de barrières à l'entrée tant quantitatives que qualitatives . Le montant de titres émis doit en effet atteindre, au minimum, l'ordre de la centaine de millions d'euros pour un placement par syndication et de la dizaine de millions d'euros pour des placements privés, et les collectivités locales doivent se conformer aux règles applicables à tous les émetteurs de titres obligataires et à celles qui régissent l'émission de titres, l'appel public à l'épargne et, le cas échéant, l'admission à la cote. Le respect de la législation financière et prudentielle nécessite soit le recours à un conseil spécialisé , soit le recrutement de personnel compétent . Pour accéder au marché obligataire public, les émetteurs doivent également être évalués par des agences de notation , ce qui constitue une difficulté supplémentaire pour de petites collectivités locales.
Un autre frein est relatif au type d'emprunts qui peuvent être contractés sur le marché obligataire : le standard à moyen et long terme est celui de titres in fine , tandis que la plupart des collectivités sont obligées de recourir à des prêts amortissables afin de pouvoir couvrir le paiement du capital par l'épargne brute de fonctionnement, comme la loi les y contraint.
L'ensemble de ces obstacles explique que l'emprunt obligataire ne représente que 14 % de la dette des régions, des départements et des communes et EPCI de plus de 100 000 habitants et qu'il soit quasiment inconnu des communes et EPCI de moins de 100 000 habitants 139 ( * ) .
Même les collectivités locales de taille conséquente ne recourent pas autant à l'emprunt obligataire que ce n'est le cas dans d'autres pays. Ainsi, d'après un rapport d'information du Sénat publié en 2012 140 ( * ) , dans le classement des quarante premières collectivités locales européennes émettant sur les marchés obligataires de 2009 à 2012, la région d'Île-de-France était la première collectivité française classée, en 23 e place, et la ville de Paris figurait en 35 e position , avec des montants très limités par rapport aux Länder allemands ou aux régions espagnoles, dont les émissions annuelles dépassent, pour les plus importantes d'entre elles, les dizaines de milliards d'euros.
Graphique n°
52
:
Répartition de la dette de la région d'Île-de-France
et
de la ville de Paris entre emprunts bancaires et émissions
obligataires
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances du Sénat
La région d'Île-de-France et la ville de Paris, qui sont les deux principaux émetteurs locaux en France, bénéficient d'une note identique à celle de l'État central et disposent de services internes spécialisés en matière de suivi et de gestion de la dette. Elles procèdent régulièrement à des émissions de plusieurs centaines de millions d'euros 141 ( * ) .
Les titres de moyen et long terme constituent ainsi aujourd'hui la principale source de financement de ces collectivités locales : ils représentent environ 65 % de l'encours de dette de la ville de Paris et 85 % de celui de la région d'Île-de-France.
Ces collectivités locales, dont les émissions restent de taille modeste par rapport aux principaux acteurs du marché obligataire public européen, procèdent le plus souvent par syndication 142 ( * ) . Elles s'efforcent de diversifier leurs produits , à la fois pour répondre à la demande des investisseurs et pour limiter le risque d'assèchement du marché - elles émettent par exemple, bien que de façon marginale, des titres allemands, les Schuldschein , qui constituent des produits hybrides demandés par les investisseurs allemands en raison de leur traitement fiscal spécifique en droit local, ou des obligations « vertes » pour s'adapter à la demande de certains acheteurs, en particulier les fonds d'investissement socialement responsables. Les obligations « vertes » représentent ainsi 1,45 milliard d'euros pour la région Île-de-France, qui a procédé à trois émissions de ce type depuis 2012, soit plus d'un quart du total de la dette et près d'un tiers de l'encours de titres obligataires. Elles émettent également en devises et couvrent le risque de change par des contrats d'échange de taux ( swaps de taux).
(b) La question du traitement prudentiel des créances détenues sur des collectivités territoriales dans le bilan des établissements financiers
Le traitement prudentiel des émissions de dette émanant de collectivités territoriales ne facilite pas non plus le financement obligataire du secteur public local français.
D'après le règlement européen n° 575/2013 143 ( * ) , le traitement prudentiel des collectivités territoriales peut être aligné soit sur celui des établissements de crédit, soit sur celui l'État central dès lors qu'il n'existe pas de différence de risque entre les expositions sur les unes et sur l'autre en raison du pouvoir des administrations locales de lever l'impôt et de l'existence d'accords institutionnels ayant pour effet de réduire leur risque de défaut. Dans le cas où les expositions sur les administrations locales ne sont pas traitées de façon identique aux expositions sur l'administration centrale, le même règlement européen prévoit qu'elles sont pondérées à 20 % .
Concernant le secteur assurantiel , à la suite de la réforme dite « Solvabilité II », les titres émis par des collectivités territoriales françaises sont assimilés à des titres souverains pour le calcul du montant de fonds propres que doivent détenir les assureurs afin de couvrir les risques liés à leur activité ( capital solvency requirement , ou SCR) 144 ( * ) . Les obligations du secteur public local peuvent 145 ( * ) donc, comme les titres émis par l'État central, être pondérées à 0 % , ce qui signifie que leur détention ne nécessite pas forcément d'augmenter le capital de solvabilité de l'assureur.
En revanche, la règle de droit commun prévoyant la pondération à 20 % en l'absence d'alignement sur l'État central perdure pour le secteur bancaire . Les établissements de crédit sont donc tenus de pondérer les titres émis par des collectivités territoriales au moins à 20 % - au contraire des obligations souveraines qui, si leur note est supérieure à AA-, peuvent être pondérées à 0 %.
Les banques peuvent donc manifester moins d'appétit que les assureurs pour les titres obligataires émis par des collectivités territoriales en raison des exigences en fonds propres qu'ils impliquent.
L'asymétrie du traitement prudentiel des expositions sur le secteur public local français entre les établissements d'assurance et les établissements de crédit, qui crée de facto une distorsion de concurrence , paraît difficile à justifier et appelle un alignement rapide : le profil de risque des collectivités locales n'a pas de raison de varier selon qu'il s'agisse du secteur assurantiel ou du secteur bancaire.
En outre, l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont, d'après la réglementation prudentielle européenne en matière assurantielle, exclus du champ des collectivités territoriales dont le traitement est aligné sur celui de l'État . Le champ d'application du règlement d'exécution ne comprend en effet que les communes, les régions et les départements. Par conséquent, les expositions sur les EPCI sont également pondérées à 20 % .
Ce choix est surprenant dans la mesure où les EPCI à fiscalité propre ont, tout comme les collectivités locales proprement dites, le pouvoir de lever l'impôt. A l'instar des communes, départements et régions, le service de la dette constitue pour les EPCI une dépense obligatoire 146 ( * ) .
Au regard du renforcement des compétences des EPCI prévu par la loi de 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite « Maptam ») 147 ( * ) et de la loi de 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « NOTRe ») 148 ( * ) , il paraît nécessaire, à tout le moins, de s'interroger quant à l'intégration des EPCI à fiscalité propre au champ des administrations locales dont le traitement prudentiel peut être aligné sur celui de l'État.
(c) Un nouvel acteur dont le modèle est inspiré de celui des agences scandinaves de financement local : l'Agence France Locale
L'Agence France Locale est un établissement de crédit dont le modèle économique est inspiré des agences de financement mutualisé qui existent dans plusieurs pays de l'Union européenne, en particulier les Pays-Bas et les pays scandinaves 149 ( * ) : plusieurs collectivités territoriales se regroupent pour se financer ensemble sur le marché obligataire. L'objectif est triple : obtenir un coût d'emprunt avantageux grâce à l'accès au financement désintermédié, maîtriser le risque par une politique prudente de gestion actif-passif et proposer des produits adaptés aux besoins des collectivités territoriales grâce aux liens étroits entre les entités locales et la structure de financement.
Le principe général repose sur une prise de participation au capital de l'agence par les collectivités territoriales participantes. Des titres sont ensuite émis pour des montants suffisamment importants, permettant l'accès au marché obligataire public et l'obtention de taux d'intérêt intéressants. Les titres sont conservés dans le passif de l'agence, qui attribue des prêts aux collectivités territoriales membres. Le montant des prêts accordés est en général fonction de la part du capital détenue par la collectivité territoriale.
L'absence de recherche de profit - aucun dividende n'est versé aux actionnaires - et la gouvernance multipartite des agences sont censées favoriser une politique d'émission et de gestion prudente de leur bilan. Force est de constater que les agences existant à l'étranger ont d'ailleurs bien résisté à la crise financière de 2008 et à ses suites et que certaines d'entre elles ont même racheté des créances détenues sur les collectivités territoriales par des banques commerciales qui n'étaient plus alors en mesure de se financer sur le marché interbancaire.
Le projet de création d'une telle agence en France était évoqué depuis 2008, mais la crise financière puis le démantèlement de Dexia n'ont pas constitué un terreau favorable à sa mise en place - d'autant plus que la question de la nature et de l'ampleur de la garantie accordée à l'établissement de crédit par les collectivités territoriales était délicate. En effet, les agences scandinaves, comme la Kommuninvest suédoise, prévoient que tous les actionnaires de l'établissement garantissent l'intégralité du passif, ce qui constitue un élément très sécurisant pour les investisseurs. Mais une telle garantie n'apparaissait pas conforme au droit français.
La création de l'Agence France Locale, autorisée par l'article 35 de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires précitée, est finalement intervenue en 2013. Le système de garantie retenue est adapté aux spécificités du droit français et chaque collectivité n'est garante qu'à due concurrence de sa participation au capital de l'agence .
Il s'agit d'un établissement de crédit bicéphale , avec d'un côté la Société territoriale et de l'autre l'Agence France Locale proprement dite.
La Société territoriale réunit les actionnaires : les membres du conseil d'administration sont des élus locaux , d'abord désignés au sein de leur collectivité territoriale puis choisis en assemblée générale. La Société territoriale réunit aujourd'hui 173 actionnaires, dont la région Pays de la Loire et une commune de 98 habitants.
Les statuts de la Société territoriale interdisent à l'Agence France Locale de proposer certaines catégories de produits et comportent des règles sur le profil des collectivités territoriales qui peuvent participer au projet, avec une grille de notation qui régule à la fois l'entrée au capital et le volume ainsi que le taux des emprunts qui pourront être accordés à la collectivité concernée. L'AFL est également censée aligner la durée moyenne des titres émis sur celle des emprunts accordés , avec une différence de maturité moyenne du passif et de l'actif s'élevant au maximum à un an.
L'Agence France Locale, quant à elle, est supervisée par un conseil de surveillance majoritairement composé d'experts de la finance bancaire.
L'AFL s'est vu attribuer, par l'agence Moody's, une première notation Aa2 d'émetteur à long terme, soit une note relativement favorable, mais un cran en-dessous de l'État central, qui reflète l'incertitude sur la viabilité du modèle dans le contexte français .
L'Agence, qui est éligible depuis le 2 juin 2016 au programme d'achat d'instruments de dette publique de la Banque centrale européenne, a lancé à ce jour trois opérations « benchmark » et une émission « off-the-run » en mars 2015 et mai 2016 d'une maturité de 7 ans pour un montant total de 2 milliards d'euros ainsi qu'une opération à court terme (2 ans) lancée en 2017 pour un montant d'environ 50 millions d'euros. Deux placements privés ont été effectués depuis la création de l'Agence, pour un total de 100 millions d'euros. L'agence est actuellement en discussion avec la Banque européenne d'investissement (BEI) afin de contractualiser une ligne de crédit à 25 ans. Aujourd'hui, l'AFL a ouvert plusieurs lignes de trésorerie aux collectivités territoriales pour un montant total de 135 millions d'euros. Elle a attribué environ 1 milliard d'euros de prêts de moyen et long terme depuis sa création et vise, à terme, l'obtention d'une part de marché de 25 %.
Il s'agit d'un objectif ambitieux au regard d'un contexte de marché relativement défavorable .
En effet, la politique accommodante de la BCE permet le maintien de conditions de financement bancaire très avantageuses , tandis que l'accès aux produits proposés par l'AFL suppose une dépense d'investissement de la part des collectivités territoriales pour entrer au capital, alors même que la baisse des dotations fait peser une contrainte importante sur leur budget. En outre, le renouvellement politique a été très fort en 2014, avec 40 % de nouveaux maires, qui n'ont pas forcément vécu de près la crise de 2008 et ressentent peut-être moins fortement le besoin de sécuriser leur financement à moyen et long terme. En outre, des incertitudes sur l'organisation institutionnelle locale, liées à la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), ont persisté en 2014 et 2015.
A ces facteurs conjoncturels s'ajoute une difficulté plus structurelle : un nombre important de grandes collectivités procèdent déjà à des émissions indépendantes - même si leur ampleur reste, dans la plupart des cas, limitée - et se sont dotées pour ce faire d'un service de gestion de la dette : leur intérêt à rejoindre l'AFL peut donc être faible.
L'Agence est également doublement touchée par la réglementation relative au traitement prudentiel des expositions sur les collectivités territoriales : au passif, comme cela a été expliqué précédemment les créances détenues sur les collectivités locales doivent être pondérées à 20 % pour calculer le montant de fonds propres nécessaires à la couverture du risque. À l'actif, la garantie des collectivités territoriales est considérée comme de moindre qualité que celle de l'État central 150 ( * ) , ce qui complexifie l'atteinte d'un encours suffisant d'actifs liquides de haute qualité ( high quality liquid assets ou HQLA).
La réussite de cette agence au modèle original dépendra donc à la fois de sa capacité à fédérer un nombre important de collectivités territoriales , afin de pouvoir donner de l'ampleur à son portefeuille et d'obtenir une notation identique à celle de l'État central, et de l'évolution du traitement prudentiel des créances détenues sur (ou garanties par) des collectivités territoriales par les établissements de crédit.
3. La gestion de la dette sociale
La dette sociale entendue au sens strict, qui résulte des déficits des branches du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), relève de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades) ainsi que, dans les faits, de l'Acoss. La gestion de celle-ci constitue un enjeu non négligeable compte tenu de leur montant cumulé , soit près de 155 milliards d'euros en 2016.
a) L'amortissement de la dette sociale
La Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades) a été créée en 1996 151 ( * ) avec pour finalité d' amortir, sur une durée limitée et grâce à des ressources dédiées, les dettes des organismes sociaux lui étant transférées par la loi - soit les déficits cumulés des différentes branches du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Selon les dernières estimations, l'extinction de la dette sociale devrait intervenir en 2024 ; à cet égard, il a été inscrit dans l'ordonnance susmentionnée par la loi organique du 13 novembre 2010 152 ( * ) , le principe selon lequel « tout nouveau transfert de dette à la [Cades] est accompagné d'une augmentation du produit d'impositions de toute nature ou de la réalisation d'actifs affecté à la caisse permettant de ne pas accroître la durée d'amortissement de la dette sociale ».
Parmi les recettes actuellement affectées à la Cades figure, tout d'abord, la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) qui a été, jusqu'en 2008, la ressource quasi-exclusive de la Caisse. Pour satisfaire à l'obligation précitée, consistant à ce que toute nouvelle opération de reprise de dette soit accompagnée de l'affectation de recettes nouvelles permettant de ne pas allonger la durée d'amortissement de la dette sociale, une fraction de 0,2 point de contribution sociale généralisée (CSG) , auparavant attribuée au FSV, a été affectée à la Cades à compter du 1 er janvier 2009. La reprise de dette votée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 s'est également accompagnée de l'attribution de 0,28 point de CSG supplémentaire , auparavant affecté à la branche famille du régime général, de 1,3 point du prélèvement social sur les revenus du capital , antérieurement affecté au Fonds de réserve des retraites (FRR) et un versement de ce dernier de 2,1 milliards d'euros sur la période 2011-2024.
Au total, les ressources perçues par la Cades se sont élevées à 16,8 milliards d'euros en 2016, permettant d'amortir 14,4 milliards d'euros de dette, les intérêts versés aux investisseurs étant de 2,4 milliards d'euros.
Entre 1996 et 2016, 124,7 milliards d'euros de dette ont été amortis , soit 47,9 % du total la dette reprise par la Cades (260,5 milliards d'euros). La dette sociale restant à amortir était de 135,8 milliards d'euros en 2016 .
Pour faire face à ses engagements, la Cades est habilitée à contracter des emprunts, selon une stratégie élaborée par son conseil d'administration dont les principes fondamentaux sont : la minimisation du coût des financements, avec un recours prioritaire aux financements de marché ; la crédibilité de la signature ; l'utilisation d'une grande palette d'instruments financiers ; une diversification géographique des sources de financement, le risque de change étant toutefois neutralisé ; un élargissement de la base d'investisseurs.
Aussi la dette portée par la Cades présente-t-elle une relative diversité en termes de maturités, de devises et d'instruments utilisés , comme le fait apparaître le graphique ci-après. L'encours de la dette affichait une maturité moyenne de 3,9 ans en 2016, était essentiellement libellée en euros (62,4 %), tout en accordant une place importante aux devises et notamment au dollar américain, et le financement est principalement assuré par des emprunts de référence à long terme en dollars et en euros.
Les modalités de gestion et de financement de l'amortissement de la dette sociale permettent à la Cades d'afficher une note financière de qualité, de Aa2 pour l'agence de notation Moody's et de AA pour Fitch Ratings.
Graphique n° 53 : Répartition de l'encours de la dette portée par la Cades
Source : Cades (2017)
La grande souplesse de gestion dont jouit la Cades lui permet d'adapter sa politique d'émission aux attentes des investisseurs . Les titres émis par la Caisse sont majoritairement achetés par les banques (31,9 % en 2016), mais aussi par les banques centrales (31,9 %) et des investisseurs institutionnels.
Jusqu'à présent, la dette portée par la Cades était gérée par une équipe autonome de spécialistes en opérations de marché et en activités de post-marché , agissant sous la supervision du conseil d'administration et, notamment, de son président. Cependant, un décret en date du 9 mai 2017 153 ( * ) a prévu un rapprochement des activités financières de la Cades et de l'Agence France Trésor. Concrètement, si la Cades conserverait une gouvernance propre, son équipe dédiée à la gestion des opérations financières serait intégrée aux services de l'AFT.
b) Les déficits conservés par l'Acoss
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) a pour mission d'assurer la gestion commune et centralisée de la trésorerie du régime général , par le biais d'un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Toutefois, l'Acoss est également amenée à conserver les déficits du régime général et du FSV n'ayant pas été transférés à la Cades (voir supra ) ; aussi l'Agence affiche-t-elle des besoins de financement élevés, qui étaient de 28,5 milliards d'euros au 31 décembre 2015, en dépit d'une reprise de dette par la Cades d'un montant de 10 milliards d'euros au premier trimestre 2015.
Il en résulte qu'hormis la gestion des flux d'exploitation, la trésorerie de l'Acoss se caractérise également par des opérations liées à la couverture des besoins de financement . Aussi l'Agence est-elle autorisée à recourir à des ressources non permanentes pour couvrir ces besoins 154 ( * ) dans la limite d'un plafond fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS). Le recours à ces ressources non permanentes est d'autant plus important qu'en cours d'année, l'Acoss doit faire face à des « points bas » de trésorerie d'ampleur ; à titre d'exemple, en septembre 2015, le « point bas » brut a atteint - 35,1 milliards d'euros (voir tableau ci-après).
Tableau n° 54 : Principales données de trésorerie de l'Acoss depuis 2010
(en milliards d'euros, sauf mention contraire)
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
Point haut annuel |
- 14,6 |
2,3 |
4,1 |
- 6,1 |
- 11,1 |
- 10,4 |
|
Point bas annuel |
- 49,7 |
- 49,5 |
- 18,4 |
- 27,2 |
- 29,6 (net) - 32,1 (brut) |
- 33,4 (net) - 37,8 (brut) |
|
Solde moyen |
- 33,3 |
- 14,4 |
- 8,1 |
- 19,0 |
- 22,2 |
- 26,4 |
|
Résultat net (en M€) |
- 324 |
- 142 |
- 15 |
- 26 |
- 27,9 |
16,4 |
Note : le « point bas » en brut comprend tous les financements mobilisés, y compris l'immobilisation de sommes sur des comptes de secours (CDC pour 500 millions d'euros et Banque de France pour 200 millions d'euros) pour pallier d'éventuels incidents, ainsi que les sommes liées aux « surémissions », notamment en amont de l'échéance des pensions.
Source : Commission des comptes de la sécurité sociale (2016)
En raison de l'importance de ses besoins, la structure de financement de l'Acoss laisse une large place aux instruments de marché , la part des concours de la Caisse des dépôts et consignations ayant reculé de 72 % en 2010 à 16 % en 2015 (voir graphique ci-après). À titre indicatif, les relations entre l'Acoss et la CDC sont actuellement régies par une convention couvrant la période 2015-2018 qui prévoit : des prêts fermes de moyen terme, de 3 à 12 mois, destinés à couvrir le socle des besoins de trésorerie ; des prêts fermes de court terme (ou prêts « tuiles ») à échéance de six jours ouvrés pour un montant de 2,5 milliards d'euros, mobilisés chaque mois pour faire face à l'échéance de versement des pensions de retraite ; des avances de trésorerie, de la veille pour le lendemain ou mobilisables le jour même, d'un montant maximum de respectivement 1 et 0,5 milliard d'euros. Pour autant, en 2016, seuls les prêts « tuiles » ont été mobilisés - les concours de la CDC, « grâce aux conditions particulièrement favorables pour recourir aux financements de marché, [...] ont été limités et [ont] représent[é] au total [...] 2 % du financement des besoins de trésorerie de l'Acoss » 155 ( * ) .
S'agissant des autres modes de financement, l'Acoss est autorisée à émettre directement sur les marchés financiers des billets de trésorerie ainsi que des Euro Commercial Papers (ECP) . En outre, depuis 2009, l'Agence est « également habilitée à rémunérer les disponibilités placées auprès d'elle par d'autres entités de la sphère sociale dans le cadre d'opérations de mutualisation de la trésorerie des organismes de sécurité sociale » 156 ( * ) .
Graphique n° 55 : Évolution de la structure de financement de l'Acoss
Source : Commission des comptes de la sécurité sociale (2016)
L'autorisation d'émettre sur les marchés financiers des billets de trésorerie (BT) - soit des titres de créances négociables d'une durée d'un jour à un an -, qui résulte de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 157 ( * ) , visait à permettre une diversification des modes de financement et une réduction du coût de ce dernier. La Commission des comptes de la sécurité sociale indique que « l'écart de taux entre les BT ACOSS et les bons du Trésor (BTF) varie [...] entre 5 et 10 points de base suivant les maturités et les conditions de marché » 158 ( * ) . Les billets de trésorerie émis sur les marchés sont devenus un instrument essentiel du financement de l'Agence, puisqu'il en représente entre 15 et 20% selon les années.
Par ailleurs, depuis 2010, l'Acoss peut émettre des Euro Commercial Papers (ECP) , qui sont des titres de créances négociables d'une durée inférieure à un an régis par le droit britannique. Le montant maximal du programme ECP est, à ce jour, de 25 milliards d'euros. Au cours des dernières années, les ECP se sont imposés comme le premier instrument de financement de l'Acoss, dans la mesure où ils couvrent plus de la moitié des besoins depuis 2015. Initialement réalisée avec l'assistance technique de l'Agence France Trésor, la gestion du programme ECP a été internalisée par l'Acoss en février 2016 - sous la supervision de la direction financière de l'Agence.
Les modalités de gestion des besoins de financement de l'Acoss ont permis, dans un environnement caractérisé par des taux d'intérêt faibles , à cette dernière d'afficher, en 2016, un résultat financier net prévisionnel des encaissements et décaissements positif, en lien, « comme l'année précédente, à la réalisation d'opérations de BT et d'ECP à taux négatifs, avec un taux EONIA moyen annuel linéaire de - 0,309 %. En effet, compte tenu du contexte atypique des marchés, les opérations de BT et d'ECP apportent des "produits financiers" [...] permettant ainsi de compenser la totalité des charges financières de l'année » 159 ( * ) .
C. LES DÉTENTEURS DE LA DETTE PUBLIQUE
La nature et la diversité des détenteurs de la dette publique renvoient à des enjeux à la fois économiques et politiques .
La diversification de la base des acheteurs de dette publique permet ainsi de réduire les risques d'illiquidité en multipliant les sources de financement tout en contribuant à faire baisser le coût de l'emprunt par une concurrence accrue.
La connaissance des investisseurs est également utile à l'émetteur afin d'anticiper leur stratégie et de prévenir d'éventuelles difficultés. Elle se heurte cependant à des contraintes techniques , juridiques et à la volonté d'un grand nombre d'investisseurs de rester discrets sur leur programme d'achats.
D'un point de vue politique, la détention de la dette publique est souvent perçue comme un enjeu de souveraineté : une part importante d'acheteurs étrangers limiterait les marges de manoeuvre des administrations publiques, soumises au bon vouloir d'investisseurs dont les intérêts ne convergent pas forcément avec ceux des pouvoirs publics. Le Japon est ainsi souvent érigé en « modèle » d'un endettement très élevé mais soutenable grâce à la part très majoritaire de titres détenus par des ménages et des acteurs financiers résidents. Un tel système s'accompagne cependant d'inconvénients majeurs et ne paraît pas applicable à la France .
1. Pourquoi acheter de la dette publique ?
Avant d'aborder la question de la répartition des investisseurs par zone géographique et par type d'acteur financier, il paraît opportun de faire un rapide retour sur les raisons pour lesquelles des acteurs financiers peuvent décider de financer la dette publique .
De façon schématique, les investisseurs qui disposent de liquidités cherchent à les placer de façon à obtenir le meilleur couple rendement/risque : pour un rendement donné, ils privilégieront les placements présentant le moins de risques et pour un certain niveau de risque perçu, il s'agira de maximiser le rendement attendu.
La sensibilité au risque des acheteurs dépend de leur stratégie financière - la politique de placement d'un fonds souverain se révélera, dans la plupart des cas, plus prudente que celle menée par un fonds spéculatif ( hedge fund ). Elle varie également en fonction de la réglementation prudentielle , qui peut imposer des contraintes plus ou moins importantes aux acheteurs de titres risqués.
À cet égard, la crise des subprimes a mis en évidence le besoin d'un encadrement plus strict des principales catégories d'investisseurs afin d'éviter des prises de risque excessives fragilisant, en cas de difficulté, l'ensemble du système financier. Au niveau européen, plusieurs directives et règlements ont renforcé les obligations pesant sur les acteurs financiers 160 ( * ) : à titre d'exemple, ceux-ci sont désormais tenus de détenir des fonds propres beaucoup plus importants que par le passé , dont une part doit être constituée d'actifs liquides d'excellente qualité ( high quality liquid assets ). Or les titres souverains sont considérés comme de tels actifs : la demande de dette publique de la part des acteurs financiers est donc importante.
La crise financière et la volatilité des indicateurs financiers qu'elle a entraînée ont également créé un phénomène de « fuite vers la qualité » : face à un futur incertain, nombre d'investisseurs ont favorisé des titres jugés « sûrs » malgré des rendements faibles. Le risque très limité associé à la dette souveraine contribue là encore à créer une pression à la hausse sur la demande de dette publique.
Il faut enfin noter que les banques centrales de la plupart des zones économiques développées ont lancé des programmes d'achat de titres publics et privés afin de relancer le financement de l'économie. Les achats des banques centrales s'ajoutent donc à la demande « privée » de dette publique et la politique monétaire accommodante de la Banque centrale européenne a eu un impact significatif sur la typologie des détenteurs de la dette publique française.
D'après la Commission européenne, « la dette française est un investissement recherché à des fins de respect d'exigences de fonds propres et de liquidité comme à des fins de diversification , parce qu'elle offre la possibilité de détenir des obligations libellées en euros aussi bien nominales qu'indexées sur l'inflation » 161 ( * ) .
2. Une diversification des investisseurs
Le mode d'émission de la dette souveraine (voir supra ), qui représente la majeure partie de la dette publique, empêche de facto l'État de favoriser certains acheteurs bien précis au détriment d'autres investisseurs . De même, les collectivités territoriales, qui se financent majoritairement par emprunt bancaire, ne sont pour la plupart pas en situation de « choisir » leur établissement de crédit par opposition à un autre investisseur. Seules les émissions de titres de dette par syndication, qui représentent moins de 5 % du total de la dette publique, sont plus propices à un contrôle - quoique limité - sur les investisseurs participant à l'opération.
Cependant, la variété de la base des acheteurs de dette publique peut être favorisée ou découragée par l'organisation réglementaire du marché financier ainsi que par les caractéristiques des titres émis.
La France a fait le choix d'une diversification des investisseurs , ce qui permet de réduire les risques d'illiquidité en multipliant les sources de financement, tout en contribuant à faire baisser le coût de l'emprunt par une concurrence accrue. La part des non-résidents, qui avait augmenté depuis le début des années 1990, diminue depuis quelques années en raison, pour partie, du programme d'achat de titres publics par la Banque centrale européenne effectué pour une large partie par le biais de la Banque de France.
Les développements qui suivent portent essentiellement sur la dette de l'État : le financement des collectivités territoriales étant majoritairement assuré par l'emprunt bancaire, la question des détenteurs ne se pose pas avec la même acuité et aucun chiffre agrégé n'est disponible concernant l'ensemble des administrations locales ou sociales.
a) Du côté des investisseurs français : la prépondérance des assureurs
Les investisseurs résidents représentent environ 40 % de la base d'acheteurs de la dette émise par l'État central .
Près de la moitié d'entre eux sont des assureurs et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) : cette part significative des assureurs renvoie à l'appétence des Français pour les placements d'assurance-vie.
Environ 10 % des détenteurs sont des établissements de crédit . Les titres d'État leur sont utiles « notamment pour constituer les réserves de liquidité qui leur permettent de couvrir les décaissements à court terme » 162 ( * ) .
Très peu de particuliers détiennent directement des titres souverains : d'après les chiffres avancés dans le rapport de l'Assemblée nationale relatif à la dette publique précité 163 ( * ) , les ménages français disposent de moins de 0,01 % de l'encours de dette de l'État en direct. La tentative, lancée au début des années 1990, de renouer avec la souscription en direct par les ménages d'obligations à moyen terme (appelées OAT particuliers) n'a pas été concluante : pour les souscripteurs, ces titres n'étaient pas particulièrement avantageux par rapport aux autres produits financiers (en particulier le livret A et l'assurance-vie) et du côté de l'État, le coût de financement était supérieur à celui qu'il aurait pu obtenir auprès d'autres investisseurs.
b) Une augmentation de la part des détenteurs non-résidents depuis la fin des années 1990 jusqu'à 2010
Pendant vingt ans, la part des détenteurs non-résidents de la dette souveraine a fortement crû : elle est passée de 28 % à la fin de l'année 1999 à 67 % en 2010, après un point haut de plus de 70 % atteint au deuxième trimestre 2010.
Cette hausse se décompose en deux temps.
Dans un premier temps, elle résultait de l'augmentation des achats de titres de la part d'investisseurs situés au sein de la zone euro . D'après les chiffres issus de l'enquête annuelle menée par le FMI 164 ( * ) , ceux-ci représentent, aujourd'hui, près de la moitié du total des investisseurs non-résidents. Cette évolution n'est pas propre à la France et a touché la plupart des pays de la zone euro. En effet, l'élimination du risque de change a permis aux investisseurs obligataires d'élargir plus facilement leurs achats aux titres émis par les autres États de la zone monétaire, entraînant une hausse des détentions croisées entre pays de la zone. Si le mouvement d'internationalisation des portefeuilles et d'intégration financière des pays européens avait précédé l'introduction de l'euro, la création de la monnaie commune a permis de l'accélérer 165 ( * ) .
Graphique n° 56 : Évolution de la part de la dette détenue par des non-résidents depuis 1999
(en %)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de la Banque de France)
Dans un second temps, à partir de la seconde moitié des années 2000, c'est la part des investisseurs hors zone euro qui a crû . Aujourd'hui, environ un tiers des acheteurs non-résidents proviendrait du reste de l'Europe 166 ( * ) (15,7 %), de l'Asie (10,3 %) et l'Amérique (7,3 %). La situation de la France est, de ce point de vue, comparable à celle de l'Allemagne : la forte proportion d'investisseurs ne partageant pas la monnaie d'émission témoigne du statut d'émetteur majeur dont bénéficie la France. Au contraire, les États dits « périphériques » de la zone euro, qui ont été les plus touchés par la crise des dettes souveraines de 2010, ont vu diminuer la part d'investisseurs étrangers en raison des craintes relatives à leur solvabilité voire, dans certains cas, à une possible sortie de la zone euro.
Graphique n°
57
: Part de la
dette souveraine détenue par les non-résidents
dans 12 pays
de l'Union européenne
(en %)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données d'Eurostat)
Les émissions auxquelles procède la Cades témoignent également de l'attrait des titres publics français aux yeux des investisseurs étrangers : les achats des acteurs financiers français ne représentent, en 2016, que 11 % du total des émissions de la Cades. La demande émanant de l'Asie est particulièrement importante et sa part a fortement crû pour atteindre 46 % en 2014, avant un léger repli à 27 % en 2016, soit un montant relativement proche de celui de la zone euro (34 %).
c) Une renationalisation de la dette d'État liée pour partie au programme de rachat de la Banque centrale européenne
Depuis la fin des années 2000, la part d'investisseurs non-résidents au sein de la dette française a diminué de façon marquée : alors qu'elle s'élevait à près de 68 % à la fin de l'année 2009, elle ne représentait plus que 58,5 % de l'encours en 2016.
Ce mouvement apparent de « renationalisation » de la dette d'État provient pour partie du programme d'achats de titres du secteur public (dit « PSPP » : Public Sector Purchase Program ) de la Banque centrale européenne. En effet, d'après l'Agence France Trésor, la BCE achèterait environ 8 milliards d'euros par mois de titres souverains et 1 milliard d'euros de titres d'autres émetteurs publics français comme la Cades, l'Unédic, Bpifrance ou encore l'Acoss. Or la majeure partie de ces achats sont effectués par la Banque de France, qui agit pour le compte de la Banque centrale européenne, ce qui conduit à une augmentation mécanique de la part des résidents au sein des détenteurs de la dette souveraine .
Un autre facteur expliquant l'augmentation de la part des investisseurs résidents est relatif à la diminution de l'encours de titres à court terme (pour les raisons exposées supra ). En effet, la proportion d'acheteurs résidant en France varie fortement selon la maturité des titres considérés : 44,2 % des acheteurs de titres de moyen et long terme (OAT) sont basés en France, contre 11,6 % seulement pour les titres de court terme (BTF). Cette asymétrie doit être mise au regard des stratégies de placement des acteurs financiers résidents les plus actifs que sont les assureurs et les OPCVM : ceux-ci recherchent plutôt, dans l'ensemble, des titres dont la maturité correspond à leur passif, c'est-à-dire à la durée des contrats des assurés - or l'assurance-vie constitue un produit d'épargne de moyen et long terme.
Enfin, il est également possible que les investisseurs étrangers, face à l'écrasement de la courbe des taux, se reportent sur d'autres titres dont les rendements sont plus importants et qui présentent un degré de sécurité élevé, par exemple les obligations d'entreprise, ou les titres souverains d'autres zones économiques, comme les États-Unis, dans la mesure où le relèvement des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine laisse présager une remontée du rendement des obligations émises par l'administration américaine.
3. Une information parcellaire
Les données sur les détenteurs de la dette publique sont relativement imprécises : outre l'absence de chiffres détaillés relatifs aux dettes locale et sociale, force est de constater que les informations concernant la dette souveraine permettent seulement de dégager des ordres de grandeur, et non pas de dresser un tableau exhaustif.
Diverses sources de données peuvent être recoupées. Les chiffres produits par la Banque de France sont fiables 167 ( * ) mais peu précis , dans la mesure où n'y figure aucune répartition catégorielle ou géographique des investisseurs non-résidents. Ils peuvent être complétés par les données issues de l'enquête « Coordinated Portfolio Investment Survey » du Fonds monétaire international (FMI), qui permettent de distinguer, au sein des non-résidents, les différentes zones géographiques dont ils proviennent. Cependant, celles-ci agrègent la dette publique et la dette privée et doivent donc être interprétées avec précaution, dans la mesure où il n'est pas certain que la structure de détention des titres privés soit identique à celle des titres publics. Enfin, l'Agence France Trésor dispose d'informations plus détaillées fournies par les spécialistes en valeur du Trésor : comme l'explique un rapport de l'Assemblée nationale, « en vertu d'une règle de reporting commune aux États membres de la zone euro, les SVT ont en effet l'obligation de communiquer leurs opérations d'achat et de vente, par type de maturité et par groupe de pays, que ces opérations aient lieu entre SVT ou avec des investisseurs finaux ». Cependant, ces données portent sur des flux (et non sur le total de l'encours de dette souveraine), ne permettent d'appréhender que la part des transactions effectuées par les SVT (laissant de côté 10 à 20 % du marché) et présentent un certain degré de confidentialité : contrairement aux chiffres de la Banque de France ou à l'enquête du FMI, les informations transmises par les SVT ne sont pas rendues publiques.
D'un point de vue juridique, aucun dispositif d'identification des porteurs de titres publics n'est prévu par la loi, tandis qu'une société émettrice d'actions 168 ( * ) peut, lorsque ses statuts le prévoient, demander à tout moment au dépositaire central de fournir l'identité des porteurs de titres de capital ou donnant accès au capital 169 ( * ) . Les personnes morales de droit public ont même été explicitement exclues de la réforme de 2014 étendant ce droit de communication, sous certaines conditions, aux sociétés émettrices d'obligations 170 ( * ) .
Le caractère parcellaire des données concernant les titres publics provient pour partie de contraintes techniques .
D'une part, les volumes émis par l'État sont sans commune mesure avec ceux des émetteurs privés : à titre d'exemple, en 2016, d'après les chiffres publiés par la Banque de France 171 ( * ) , l'État français a émis à lui seul autant de titres de dette que l'ensemble des sociétés non financières, et quatre fois plus que la totalité des établissements bancaires.
En outre, le marché secondaire des titres d'État est très actif : en 2016, le volume quotidien moyen de transactions s'élevait à près de 9 milliards d'euros. Dans ces conditions, il est difficile de suivre un titre donné , qui peut changer de détenteur plusieurs fois par an, d'autant plus que l'acquisition n'est pas toujours directe et peut faire intervenir une chaîne d'intermédiaires qu'il s'agirait alors de remonter.
A ces obstacles techniques s'ajoute un enjeu d'attractivité de la dette française : de nombreux investisseurs souhaitent rester discrets et, même dans le cas d'émetteurs publics de taille plus modeste que l'État (comme la Cades, l'Acoss ou l'Agence France Locale), dont les titres sont moins fréquemment revendus sur le marché secondaire et qui connaissent leurs acheteurs, la typologie exacte des détenteurs constitue une information confidentielle .
L'internationalisation des détenteurs et leur diversification a permis à l'État de maîtriser son coût de financement . Elle s'accompagne de quelques désagréments, au nombre desquels la perte de contrôle sur l'identité exacte de l'ensemble des investisseurs peut être comptée. Mais en matière de gestion de la dette publique, c'est la connaissance des stratégies des principaux acteurs , afin d'identifier les risques encourus, qui importe vraiment : pour l'heure, les informations transmises par les banques spécialistes en valeur du Trésor paraissent suffire à l'Agence France Trésor.
Face à ces difficultés d'identification des investisseurs et à la complexité des marchés financiers internationaux, il pourrait sembler plus rassurant de financer la dette publique par recours sinon exclusif, du moins majoritaire, aux ménages et entreprises résidant sur le territoire national .
Cette solution ne paraît cependant pas réellement applicable à la France, pour plusieurs raisons.
4. La détention par les résidents, une fausse solution
La dette publique de certains pays est majoritairement détenue par des investisseurs résidents : c'est par exemple le cas au Royaume-Uni, où 70 % de la dette souveraine est entre les mains de résidents. La proportion de détenteurs résidents est encore plus importante au Japon, où elle atteint 95 %.
À cet égard, le Japon est souvent cité comme un « modèle » : sa dette, bien que très élevée - elle a récemment dépassé 245 % du PIB - serait plus soutenable grâce au fort biais domestique de sa structure de détention . La moindre propension des investisseurs résidents à revendre leurs titres de façon opportuniste en cas de tensions sur les marchés financiers protégerait le Japon d'une hausse soudaine des taux d'intérêt, comme la zone euro en a connu plusieurs depuis la première crise des dettes souveraines de 2010.
Cependant, la détention par les résidents d'une dette publique aussi massive que celle du Japon entraîne d'autres risques, qui ne sont que rarement soulignés.
Un tel modèle suppose tout d'abord l'existence d'une épargne privée extrêmement abondante. Même si cette condition est remplie, il peut s'accompagner d'un effet d'éviction pour le secteur privé : la préférence des acteurs financiers pour les administrations publiques peut limiter les liquidités disponibles pour le financement du secteur marchand.
Un tel modèle de financement renforce également le lien entre risque souverain et risque bancaire , alors même que la crise financière débutée en 2008 et ses suites, dont la crise des dettes souveraines en Europe de 2010, tend à démontrer l'importance d'un découplage de ces deux risques afin d'éviter la propagation des crises.
Il fait, enfin, dépendre le financement des administrations publiques des anticipations et du cycle de vie des résidents . En effet, les ménages détiennent une part importante des titres souverains : si seulement 2,5 % de l'encours de dette publique est détenue de façon directe par des ménages japonais, la détention indirecte à travers des dépôts d'épargne dans les établissements de crédit, des fonds de pension et des produits d'assurance-vie, est beaucoup plus élevée : en 2013, la dette publique japonaise représentait 40 % du total des actifs détenus par les compagnies d'assurance et les fonds de pension, et environ 20 % des actifs des banques japonaises.
Or le vieillissement de la population - d'après les projections des Nations Unies, 37 % de la population japonaise sera âgée de plus de 65 ans en 2050 - laisse présager un mouvement de désépargne . En effet, comme l'a théorisé Franco Modigliani à travers la notion de « cycle de vie » 172 ( * ) le comportement des agents économiques dépend pour partie de leur âge. Au début de sa vie d'adulte, l'individu a des revenus faibles, inférieurs à sa consommation, ce qui implique qu'il doive s'endetter. Lors de sa vie active, l'agent peut rembourser les dettes contractées dans sa jeunesse puis constituer une épargne qui servira à financer la consommation de la période de vieillesse. La démographie japonaise pourrait donc, à moyen terme, déstabiliser le financement public en raison de ventes importantes de titres publics (ou par le non-renouvellement des obligations arrivées à échéance).
Au total, la détention par les résidents paraît donc créer autant de problèmes qu'elle n'en résout .
L'internationalisation du financement de l'État présente certes quelques inconvénients, parmi lesquels la faible transparence sur les détenteurs finaux de la dette et le caractère sans doute plus opportuniste des stratégies mises en oeuvre par les acheteurs.
Mais elle présente aussi des avantages qui ne doivent pas être négligés : la diversification des investisseurs permet de faire bénéficier les administrations publiques d'un coût de financement avantageux et de diminuer l'intrication du risque souverain et du risque bancaire.
III. LA DETTE FRANÇAISE, UN POIDS POUR L'ÉCONOMIE
Au milieu du XIX e siècle, l'économiste français Jean-Baptiste Say défendait l'utilité des « emprunts publics modérés », profitables s'ils sont employés en « établissements utiles » car ils offrent un « emploi à de petits capitaux situés entre des mains peu industrieuses » 173 ( * ) .
Cette assertion est à mettre en perspective, notamment, avec les incidences des dépenses publiques sur la croissance économique. À cet égard, différents travaux académiques ont mis en évidence le fait que les infrastructures publiques sont en mesure de renforcer la productivité des facteurs de production, venant soutenir les activités des ménages et des entreprises ; par exemple, les infrastructures routières viennent réduire les coûts et la durée des transport 174 ( * ) . Un raisonnement analogue peut être tenu avec les infrastructures de télécommunication, d'énergie, etc. Par ailleurs, par l'intermédiaire de l'augmentation de la productivité des facteurs de production, les infrastructures peuvent entraîner une augmentation du rendement du capital et favoriser, par conséquent, une hausse de l'investissement privé 175 ( * ) . Certains auteurs ont même identifié des liens plus indirects entre les infrastructures publiques et la croissance ; ainsi, les infrastructures de transport peuvent encourager les échanges commerciaux et, de ce fait, l'activité économique 176 ( * ) . Les dépenses publiques en matière d'éducation ont, elles aussi, un effet notable sur la progression du PIB 177 ( * ) , tout comme celles de recherche et développement .
Aussi, dès lors qu'elle trouve son origine dans des dépenses de cette nature, la dette publique peut-elle contribuer au relèvement de la croissance potentielle d'une économie. Toutefois, tel ne semble pas être le cas en France, où l'alourdissement de l'endettement des administrations n'est pas corrélé à une hausse des dépenses susceptibles de présenter une utilité dans l'avenir . Dans ces conditions, le niveau actuel de la dette est d'autant plus problématique que celle-ci pèse sur l'activité économique et qu'elle expose notre pays à une forte augmentation de la charge d'intérêts .
A. L'UTILITÉ LIMITÉE DE LA DETTE PUBLIQUE FRANÇAISE
L'examen des données disponibles fait, en effet, apparaître que l'élévation du niveau de la dette au cours des quarante dernières années ne s'est pas accompagnée d'un effort particulier consenti en faveur de l'investissement public ou encore de l'éducation et de la recherche , dépenses susceptibles d'accroître le potentiel de croissance de la France.
1. L'accélération de la dette publique ne provient pas d'un effort en faveur de l'investissement...
Il est possible de considérer que l'augmentation de la dette des administrations finance un effort en faveur de l'investissement lorsque le déficit excède les dépenses de formation brute de capital fixe (FBCF) - qui intègrent les acquisitions d'actifs, mais aussi, désormais, les dépenses en matière de recherche et développement (R&D) en application du nouveau système européen de comptes nationaux, dit « SEC 2010 », entré en vigueur en 2014.
Graphique n° 58 : Évolution des dépenses d'investissement des administrations et du déficit public
(en % du PIB)
* Formation brute de capital fixe (FBCF) dont a été déduite la consommation de capital fixe, soit la dépréciation subie par le capital au cours de la période considérée du fait de l'usure normale et de l'obsolescence prévisible.
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
Or, si entre 1980 et le déclenchement de la crise économique, le déficit est resté en deçà des moyens consacrés à l'investissement public - à l'exception de la période 1993-1995 -, force est de constater que, depuis 2009, le déficit des administrations a été systématiquement supérieur aux dépenses de formation brute de capital fixe (FBCF) , indiquant que la dette publique constituée depuis cette date a trouvé son origine, en partie, dans des charges de personnel, de fonctionnement, d'intervention, ou encore d'intérêts de la dette. Ce phénomène trouve son origine dans la hausse du déficit public, mais également dans le recul de l'investissement ; comme cela a été relevé précédemment, la part dans le PIB des investissements des administrations a tendanciellement baissé depuis 1990 (- 0,7 point), avec une accélération de ce mouvement entre 2009 et 2016 (- 0,5 point).
Une telle évolution doit être rapprochée du recul en valeur, mais aussi relativement au PIB, du patrimoine net des administrations publiques. Alors que ce dernier représentait, en 2007, 58,2 % du PIB, il ne s'élevait qu'à 12,3 % du PIB en 2016, révélant un relatif « appauvrissement » des administrations (voir graphique ci-après).
Graphique n° 59 : Évolution du patrimoine net des administrations publiques
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
2. ... ou de l'éducation et de la recherche
Deux catégories de dépenses publiques méritent une attention toute particulière en ce qu'elles contribuent de manière notable à notre potentiel de croissance , à savoir celles consacrées à la recherche - bien que, comme cela a été indiqué, les dépenses de recherche et développement (R&D) sont désormais enregistrées parmi les investissements - et celles dédiées à l'éducation, constituées essentiellement de dépenses de personnel et de fonctionnement.
S'agissant des dépenses publiques de recherche 178 ( * ) , il apparaît que leur part dans la richesse nationale a nettement reculé entre 1995 et 2015 , passant de 1,8 % du PIB à 1,3 % (voir graphique ci-après). Cette évolution est principalement liée à la diminution des dépenses en faveur de la recherche fondamentale, dont la part dans le PIB a été réduite de 0,3 point au cours de la période considérée. Elle n'a été que partiellement compensée par la montée en puissance du crédit d'impôt recherche (CIR), dont le montant rapporté au PIB s'est accru de 0,2 point de PIB au cours de la période considérée.
Graphique n° 60 : Évolution des dépenses publiques de recherche
(en % du PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
Un constat analogue peut être fait en matière d'éducation, dont la part des dépenses associées dans le PIB a diminué de 0,2 point de PIB entre 1995 et 2015 (voir graphique ci-après). Ceci s'explique par un recul de 0,3 point de PIB des dépenses consacrées à l'enseignement scolaire, qui regroupe notamment l'enseignement préélémentaire, élémentaire et secondaire.
En somme, il apparaît clairement que la progression de la dette publique ne s'est aucunement accompagnée d'un effort accru en direction de la recherche ou de l'éducation - bien au contraire -, les déficits récurrents s'expliquant essentiellement, dans notre pays, par le dynamisme des autres dépenses. Pour autant, si la part dans le PIB des dépenses publiques consacrées par la France à l'enseignement primaire et secondaire demeure supérieure à la moyenne de l'OCDE, celle-ci se place dans une position intermédiaire en termes de performances de ses élèves, comme le montrent les différentes enquêtes PISA, et ce sans véritable évolution au cours des dernières années, laissant penser que les efforts en faveur de la qualité des dépenses d'éducation sont, eux-aussi, limités. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de noter que si les dépenses d'éducation et de recherche avaient suivi la même croissance que la dépense publique prise dans son ensemble durant la période 1995-2015, ces dernières auraient été, aujourd'hui, supérieures de près de 20 % à leur niveau constaté .
Graphique n° 61 : Évolution des dépenses publiques d'éducation (hors recherche)
(en % du PIB)
* Enseignement non défini par niveau, services annexes à l'enseignement, etc.
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
B. LES INCIDENCES DE LA DETTE PUBLIQUE SUR LA CROISSANCE
Le fait que l'accroissement de la dette publique ne trouve pas son origine dans des dépenses contribuant à renforcer le potentiel économique de notre pays est d'autant plus problématique qu' un niveau d'endettement important est susceptible d'avoir des incidences négatives sur l'activité .
En premier lieu, une dette publique élevée prive les pouvoirs publics des marges de manoeuvre budgétaires nécessaires à la stabilisation, le cas échéant, de l'activité économique en cas de dégradation de la conjoncture ou encore le financement des investissements nécessaires au maintien voire à l'accroissement du potentiel de croissance.
En second lieu, un fort endettement public est susceptible de peser sur la croissance économique . Tout d'abord, celui-ci peut induire une diminution de la consommation des ménages, dans la mesure où ces derniers sont incités à épargner davantage dans la perspective des hausses d'impôts
futures, résultant de la nécessité d'assumer la charge de la dette 179 ( * ) . Ensuite, il serait à l'origine d'un effet d'éviction de l'investissement privé dans la mesure où une partie de l'épargne privée serait absorbée par l'acquisition de titres de dette publique - un tel effet peut également passer par l'exercice d'une pression à la hausse sur les taux d'intérêt induite, le cas échéant, par une perte de confiance des investisseurs dans les titres souverains, généralement considérée comme des actifs de référence. En outre, il peut être considéré qu'une dette publique élevée, surtout lorsqu'elle ne trouve pas son origine dans des dépenses « utiles » d'un point de vue économique, évince des ressources privées qui auraient pu être consacrées à la consommation et à l'investissement.
Est-ce à dire qu'il existerait un niveau au-delà duquel la dette publique produirait des effets significatifs sur l'activité économique ? Des travaux réalisés par les économistes américains Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff, ayant eu une résonnance particulièrement importante, avaient laissé entendre que lorsque la part de la dette publique d'un pays excédait 90 % du PIB, ses performances économiques s'en trouvaient affectées 180 ( * ) . Pour autant, cette conclusion avait été contestée 181 ( * ) et une étude ultérieure réalisée par des économistes du Fonds monétaire international (FMI) 182 ( * ) a proposé des résultats notablement différents. Ainsi, cette dernière montre que l'existence d'effets de la dette publique sur la croissance économique au-delà d'un certain seuil n'est pas établie . Elle indique, néanmoins, que la trajectoire de la dette importe autant que son niveau : les pays présentant un niveau d'endettement élevé mais dont la dette est en diminution afficheraient des performances économiques similaires à ceux dont le niveau d'endettement est faible.
Par suite, les incidences du niveau d'endettement sur la croissance semblent être ambiguës - même si, chacune à leur manière, les deux études précitées font apparaître qu'une maîtrise de la dette publique est plus favorable à l'activité économique.
Quoi qu'il en soit, un niveau élevé de dette publique expose à un accroissement rapide de la charge de la dette en cas de remontée des taux d'intérêt - dont il est proposé de quantifier les effets potentiels.
C. LA MENACE D'UNE HAUSSE DE LA CHARGE DE LA DETTE
1. Plusieurs facteurs de hausse des taux
Il est désormais envisageable que la période de très faibles taux d'intérêt sur la dette souveraine qui s'est ouverte à partir de 2012 s'achève dans les mois qui viennent, pour plusieurs raisons.
D'une part, les différents facteurs qui ont conduit à la baisse des taux vont progressivement s'estomper : il est probable que la croissance et l'inflation en zone euro repartent à la hausse en 2017 en lien avec la reprise du cours des matières premières et le redémarrage de la croissance mondiale. Le programme budgétaire expansionniste annoncé par le Président des États-Unis élu à la fin de l'année 2016 contribue aussi à relever les anticipations des investisseurs en matière d'inflation et de croissance mondiale.
La Banque centrale européenne a indiqué qu'elle poursuivrait sa politique monétaire accommodante jusqu'en décembre 2017, mais elle a réduit son programme de rachats de 80 à 60 milliards d'euros depuis avril 2017 : il est donc possible qu'en cas de reprise de l'activité et de l'inflation, elle engage une décélération plus marquée de son programme de rachats de titres et qu'elle relève ses taux directeurs à partir de 2018.
La Réserve fédérale américaine, quant à elle, a déjà mis fin à son programme de rachat d'actifs en 2014 et procédé, depuis 2015, à plusieurs hausses de son taux directeur : la cible de taux est passée de 0,0-0,25 % au début de l'année 2014 à 0,75%-1%. Deux relèvements supplémentaires sont attendus en 2017 183 ( * ) . Ce mouvement de réévaluation devrait se poursuivre en 2018 . En cas de consolidation de la croissance mondiale, il ne serait pas surprenant que le phénomène de fuite vers la qualité soit moins aigu.
D'autre part, il est à craindre que la prime de risque demandée par les acheteurs sur la dette souveraine des États membres de la zone euro ne connaisse une nouvelle hausse liée aux incertitudes politiques récurrentes sur l'avenir de la zone monétaire. Bien que les résultats de l'élection présidentielle française aient permis un relâchement temporaire de la tension sur les marchés financiers, le risque politique est désormais une composante essentielle des anticipations des investisseurs , comme en témoignent les tensions sur les taux d'intérêt et la hausse de l'écart de taux ( spread ) entre la France et l'Allemagne consécutives à l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis à la fin de l'année 2016 et des incertitudes entourant la campagne électorale présidentielle française à partir de la fin du mois de janvier 2017.
2. Des conséquences particulièrement lourdes sur la charge de la dette publique en l'absence de consolidation budgétaire
Les répercussions d'une hausse des taux d'intérêt sur la dette publique ne sont pas aussi simples et mécaniques qu'elles peuvent le paraître de prime abord. En effet, le renchérissement de la dette dépend de sa structure (maturité de l'encours et indexation éventuelle sur l'inflation) et des facteurs sous-jacents à la hausse : une augmentation brutale des taux liée à des inquiétudes relatives à la sortie d'un État de la zone euro, par exemple, ne provoquera pas les mêmes effets qu'une remontée progressive causée par la reprise de l'inflation.
a) Un impact qui dépend à la fois de la structure de la dette et des facteurs sous-jacents à la hausse des taux
Une hausse des taux d'intérêt ne se répercute pas immédiatement sur l'ensemble de l'encours : la part de la dette publique émise à taux fixe ne serait touchée par le relèvement des taux qu'à son arrivée à échéance, lorsque des emprunts nouveaux seraient souscrits pour la faire « rouler » (dans le cas de l'État).
Outre le volume de dette, c'est donc aussi la structure de l'encours de dette par maturité et par type de taux (fixe ou variable) qui module l'impact d'une augmentation des taux d'intérêt, dont les conséquences seraient très différenciées selon le secteur d'administration publique considéré : par exemple, une part importante 184 ( * ) de la dette des collectivités territoriales est souscrite à taux variable (indexé en particulier sur les taux interbancaires, l'inflation et le taux du livret A) ce qui signifie que les administrations locales subiraient plus rapidement les conséquences d'une remontée des taux d'intérêt .
De même, une partie importante des titres de dette de la Cades et de l'Acoss ne sont pas émis à taux fixe. À titre d'exemple, la Cades estime qu'une hausse des taux de 1 % entraînerait un surcoût de 1,5 milliard d'euros sur la période 2017-2024. Comme le souligne la Cour des comptes dans un rapport de 2016, « la CADES sera exposée à des risques de taux supplémentaires dès lors que de nouveaux transferts de dettes seront à organiser d'ici à 2020 » 185 ( * ) .
En revanche, l'État serait, dans un premier temps, relativement protégé dans la mesure où les titres indexés sur l'inflation ne représentent que 12,3 % de l'encours et que la part des titres de court terme (BTF) est inférieure à 10 % : ainsi, un choc de taux de 1 % se traduirait par une hausse de la charge de la dette de 2,1 milliards d'euros la première année . La loi de finances initiale pour 2017 a d'ailleurs intégré un léger renchérissement de la charge de la dette lié à l'hypothèse d'une remontée progressive des taux, au rythme de 75 points de base (soit 0,75 %) par an, soit un taux de 0,50 % à la fin de l'année 2016 et de 1,25 % fin 2017.
L'estimation du renchérissement de la charge de la dette ne suffit pas non plus à évaluer l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur les finances publiques : une forte augmentation du service de la dette publique peut être soutenable si la trajectoire globale des finances publiques est corrigée .
Ainsi, dans le cas où la remontée des taux serait liée à une reprise de la croissance, elle devrait toutes choses égales par ailleurs s'accompagner d'une hausse des recettes perçues par les administrations publiques et d'une diminution de certaines prestations sociales (comme le chômage) permettant, si le reste des dépenses est contenu, d'améliorer le solde budgétaire malgré l'augmentation du service de la dette.
Il faut souligner qu'une hausse des taux se traduit aussi par une accélération de la croissance de l'encours de dette publique : comme le souligne la Commission européenne dans un rapport de février 2017, « toutes choses restant égales par ailleurs, une hausse de 1 [point de pourcentage] du taux d'intérêt appliqué aux obligations nouvellement émises et à la dette refinancée ferait croître le ratio de la dette publique [française] au PIB de 6 points de pourcentage (équivalant à quelque 190 milliards d'euros) d'ici à 2027 parrapport à la projection de référence » ce qui dégraderait la soutenabilité de la trajectoire d'endettement public en France.
|
Seuil de défaut et seuil d'insoutenabilité La notion de « seuil de défaut » doit être différenciée de celle de « seuil d'insoutenabilité ». Le seuil de défaut correspond à la limite d'endettement des administrations publiques : au-delà, le marché ne reconnaît plus au débiteur public la capacité d'honorer la totalité de sa dette. Le « seuil d'insoutenabilité » peut être atteint pour des niveaux de dette plus faibles . Le marché continue à considérer que remboursement complet de la dette par les administrations publiques est possible, mais estime qu'une telle éventualité est très peu probable. La prime de risque réclamée par les investisseurs pèse alors si lourdement sur les comptes publics que le défaut devient, en l'absence de choc macroéconomique favorable, inévitable. La Commission européenne a analysé la soutenabilité de la dette de chacun des États membres de l'Union européenne dans un rapport dédié 186 ( * ) , dont les conclusions sont reprises et approfondies dans le cadre du semestre européen. Concernant la France, la Commission européenne considère que « le ratio élevé de la dette publique au PIB ne semble pas poser d'importants problèmes de soutenabilité à court terme » mais que « le sous-indice budgétaire à court terme fait, en revanche, apparaître un risque important , lié au niveau élevé des besoins bruts de financement, du déficit primaire et de la dette publique » 187 ( * ) . Des risques « élevés » pèsent sur la soutenabilité de la dette française à moyen terme . Source : d'après M. Guillard et H. Kempf, « L'insoutenable dynamique de la dette. Une analyse macroéconomique du défaut souverain », Revue d'économie politique , vol. 122, n° 6, 2012, p. 921-941. |
b) Une augmentation de la charge de la dette publique particulièrement importante en l'absence de consolidation budgétaire
Afin d'évaluer l'impact d'une augmentation des taux d'intérêt sur la charge de la dette de l'État, la commission des finances du Sénat a procédé à des simulations 188 ( * ) en faisant varier deux paramètres : l'ampleur de la hausse des taux d'une part, l'évolution du déficit budgétaire d'autre part.
Un premier scénario correspond à une hausse modérée des taux associée à une trajectoire de consolidation budgétaire volontariste : les taux augmentent de 100 points de base (soit 1 %) et le déficit budgétaire se réduit de 5 % chaque année. La hausse de la charge de la dette reste alors modérée et ne dépasse 10 milliards d'euros qu'après la cinquième année suivant le choc.
Dans un deuxième scénario, le choc de taux est plus important (+200 points de base, soit 2 %) mais la trajectoire budgétaire de l'État reste maîtrisée (diminution de 5 % an, identique au premier scénario). La charge de la dette augmente alors deux fois plus vite et atteint 13,4 milliards d'euros dès la troisième année qui suit le choc.
Un troisième scénario modélise le cas d'un choc de taux modéré de 100 points de base combiné à une dégradation du solde budgétaire de l'État de 5 % par an. L'augmentation de la charge budgétaire de la dette résultant de la hausse du taux atteint alors 18,7 milliards d'euros en 2026, contre 15,8 milliards d'euros dans le cas d'une amélioration du déficit budgétaire.
Enfin, le quatrième scénario correspond à un choc de taux de 200 points de base joint à une dégradation du déficit budgétaire de 5 % par an. La charge de la dette augmente alors dans des proportions très importantes : un surcroît de près de 25 milliards d'euros pèse sur le budget de l'État dès la cinquième année suivant le choc, en 2022, et il atteint 37 milliards d'euros en 2026.
Tableau n° 62 : Impact d'une hausse des taux d'intérêt sur la charge de la dette de l'État, en fonction de l'évolution du déficit budgétaire
(en milliards d'euros)
|
Scénario |
Évolution des taux d'intérêt |
Évolution du déficit budgétaire |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
1 |
+100 points de base (1 %) en début de période |
Amélioration de 5 % chaque année |
2,1 |
4,6 |
6,7 |
8,7 |
10,3 |
11,7 |
12,9 |
13,9 |
14,9 |
15,8 |
|
2 |
Dégradation de 5 % chaque année |
2,1 |
4,6 |
6,8 |
9,0 |
10,9 |
12,6 |
14,2 |
15,6 |
17,2 |
18,7 |
|
|
3 |
+200 points de base (2 %) en début de période |
Amélioration de 5 % chaque année |
4,2 |
9,2 |
13,4 |
17,4 |
20,6 |
23,4 |
25,8 |
27,8 |
29,8 |
31,6 |
|
4 |
Dégradation de 5 % chaque année |
4,3 |
9,3 |
13,7 |
17,9 |
21,3 |
24,6 |
27,8 |
30,8 |
34,0 |
37,2 |
Note de lecture : la charge d'intérêt résultant de la hausse des taux est répartie sur toute la durée de vie des titres émis.
Source : commission des finances du Sénat
Ces simulations ne sont pas particulièrement pessimistes : les chocs de taux envisagés restent limités et elles n'intègrent pas l'effet de la hausse sur le budget des administrations de sécurité sociale et les administrations locales. En outre, elles ne modélisent qu'un choc de taux unique, alors qu'il est probable qu'une remontée des taux verrait plusieurs paliers successifs avec des hausses répétées sur plusieurs années. Enfin, elles ne prennent pas non plus en compte l'effet des décotes à l'émission : si, sur le long terme, l'impact total sur le budget de l'État sera similaire, à court terme, les décotes se traduiront par une charge budgétaire accrue les premières années suivant le choc de taux 189 ( * ) .
Comme le montre le graphique ci-après, à court terme, c'est avant tout l'ampleur du choc de taux qui détermine le niveau de la hausse de la charge de la dette de l'État.
Graphique n° 63 : Impact d'une hausse des taux d'intérêt sur la charge de la dette de l'État, en fonction de l'évolution du déficit budgétaire
(en milliards d'euros)
Note de lecture : la charge d'intérêt résultant de la hausse des taux est répartie sur toute la durée de vie des titres émis.
Source : commission des finances du Sénat
Cependant, l'accumulation de déficits budgétaires importants finit par peser de façon de plus en plus significative sur la charge de la dette. Ainsi, après les cinq premières années qui suivent le choc de taux, le différentiel entre un scénario de consolidation budgétaire et un scénario de dégradation du déficit, à choc de taux égal, dépasse 1 milliard d'euros. En d'autres termes , plus le temps passe et plus la dégradation du déficit budgétaire amplifie l'impact budgétaire de la hausse des taux subie en début de période. En effet, la charge budgétaire résultant du surcroît de besoin de financement s'accumule pendant plusieurs années : à titre d'exemple, si le déficit de l'année est financé par une dette d'une maturité de 4 ans, il pèsera pendant 4 ans sur la charge de la dette.
La remontée des taux d'intérêt ne sera donc soutenable pour les administrations publiques que si elle s'accompagne d'une maîtrise des dépenses permettant de diminuer peu à peu l'ampleur du déficit public .
D. LES RISQUES DE DÉRIVE DE LA DETTE PUBLIQUE
L'ampleur des déficits publics observés au cours des dernières années a été à l'origine d'un alourdissement inexorable du poids de la dette dans la richesse nationale . En effet, la dette publique rapportée au PIB augmente si le solde public effectif est inférieur à un niveau appelé solde stabilisant. Ce dernier correspond au solde public pour lequel la dette et le PIB progressent au même rythme et qui permet de maintenir constant le ratio d'endettement public. Il correspond, approximativement, à l'opposé du produit de la croissance nominale du PIB par le ratio d'endettement de l'année précédente.
Or, il apparaît que depuis 1990, le solde public effectif n'a que très rarement été en deçà du solde public stabilisant . En effet, une telle situation n'a été observée qu'entre 1998 et 2001 ainsi qu'en 2006 et 2007, ce qui explique la progression quasi continue de la part de la dette publique dans le PIB au cours de la période considérée.
La progression de notre niveau d'endettement a été alimentée par l'effet dit « boule de neige » . La dette publique rapportée au PIB s'accroît indéfiniment sous le poids des charges d'intérêts si le solde public primaire, c'est-à-dire hors service de la dette, demeure inférieur au solde primaire stabilisant ; alors, la dette gonfle à la manière d'une boule de neige - ce qui explique la dénomination « effet boule de neige ». Dans le cas de la France, force est encore de constater que si le solde primaire est resté, la plupart du temps, supérieur au solde primaire stabilisant jusqu'au déclenchement de la crise, la situation s'est dégradée par la suite ; en effet, depuis 2008, le solde public primaire a été systématiquement inférieur au solde primaire stabilisant, ce qui indique que la France est bien exposée à un « effet boule de neige » - la croissance de notre dette étant autoentretenue du fait de l'accumulation des charges d'intérêts.
En tout état de cause, le solde stabilisant le ratio d'endettement dépend étroitement du taux de croissance du PIB ; or, notre potentiel de croissance semble avoir été affecté par la crise économique et financière (voir encadré ci-après), ce qui est susceptible de compliquer le retour du solde public à un niveau supérieur au solde stabilisant - donc un recul du poids de la dette publique dans la richesse nationale.
|
Les effets de la crise sur la croissance potentielle De nombreux éléments laissent penser que la crise a également eu une incidence sur le niveau de PIB potentiel, voire sur la croissance potentielle, même s'il est encore difficile, à ce jour, de mesurer ce phénomène. En effet, les canaux de transmission de la crise sur la production potentielle sont multiples et il est délicat de déterminer si ses conséquences sur l'emploi, le capital productif ou encore sur le progrès technique seront ou non durables . De manière générale, les crises financières affectent durablement les différents facteurs de production et entraînent des pertes durables de l'activité 190 ( * ) . Celles-ci touchent, tout d'abord, le rythme d'accumulation du capital , dès lors que les faillites et les fermetures d'unités de production qui les accompagnent sont à l'origine d'une destruction du capital existant ; de même, le rationnement du crédit réduit les investissements et limite le renouvellement du capital productif, entraînant un accroissement de son obsolescence. Ensuite, les crises financières ont des incidences sur le marché du travail . Toutefois, celles-ci peuvent être ambivalentes : si la participation au marché du travail peut reculer en raison du découragement des chômeurs de longue durée, la perte de revenu d'un chômeur peut inciter son conjoint inactif à rechercher un emploi - il s'agit de l'effet de travailleur additionnel 191 ( * ) . Pour autant, l'effet de découragement semble prévaloir. En outre, peut être constatée une dépréciation de l'expérience professionnelle , ce qui correspond à une perte de capital humain 192 ( * ) , en raison des pertes de « compétences » des chômeurs de longue durée et d'un manque d'accumulation des connaissances du fait de la dégradation des conditions d'emploi. Dès lors, les crises peuvent réduire en quantité et en qualité la main d'oeuvre disponible . Les effets des crises financières sur le progrès technique sont également difficiles à prévoir . Alors que, d'un côté, les crises peuvent amener les entreprises plus performantes à se développer au détriment des moins productives, voire encourager les firmes à se réorganiser et à innover - il s'agit du cleansing effect 193 ( * ) -, d'un autre côté, elles sont susceptibles d'entraîner une diminution des dépenses de recherche et développement (R&D), porteuses à long terme de progrès technique, en raison des contraintes financières qui pèsent sur les entreprises. Malgré tout, les études empiriques semblent indiquer que les dépenses de R&D sont pro-cycliques 194 ( * ) , ce qui tend à indiquer que, dans les faits, les crises s'accompagnent essentiellement d'une baisse de ces dépenses , venant minorer les perspectives de croissance de la productivité globale des facteurs (PGF).
À ces différents éléments,
s'agissant des États européens, viennent s'ajouter d'autres
« chocs », dont
la crise de la dette souveraine
dans la zone euro
à compter de 2010 et
les plans de
consolidation budgétaire
qui l'ont suivie. L'impact de ces
plans sur
l'activité a été estimé par l'Insee, pour la zone euro dans son ensemble, à - 0,4 point de PIB en 2011 et - 1,1 point de PIB en 2012 195 ( * ) - et à - 0,3 point de PIB et - 0,8 point de PIB pour ces deux années pour la France. En 2013, les effets du redressement des comptes publics sur le PIB de la zone auraient été de même ampleur qu'en 2012 196 ( * ) . Au total, la crise économique et financière semble avoir eu d'importantes incidences tant sur le capital productif, que sur la main d'oeuvre et la productivité globale des facteurs (PGF). Cependant, il demeure difficile à déterminer, même à ce jour, si celles-ci auront des conséquences durables, d'une part, sur la production potentielle et, d'autre part, sur la croissance potentielle . En effet, l'analyse économique n'exclut pas que les effets de la crise sur les facteurs de production puissent se résorber à moyen et long termes. Schémas récapitulatifs des trois scénarii d'évolution du niveau et de la croissance du PIB potentiel à la suite de la crise économique Source : M. Lemoine et J. Pavot (2009) Aussi est-il possible d'envisager trois scénarii d'évolution du PIB potentiel au lendemain de la crise 197 ( * ) (voir graphique ci-avant) : - un scénario dans lequel le PIB potentiel et sa croissance ne sont pas durablement affectés par la crise et peuvent être rapidement restaurés (scénario « trou d'air ») ; - un scénario dans lequel le niveau du PIB potentiel est durablement affecté par la crise car sa croissance ne retrouve que très progressivement son niveau d'avant-crise (scénario « effet sur le revenu ») ; - un scénario dans lequel le PIB potentiel et sa croissance sont affectés à long terme (scénario « effet sur le revenu et la croissance »). Alors que certaines études économiques peuvent laisser penser que le « scénario effet sur le revenu » est le plus probable 198 ( * ) , d'autres, plus récentes, identifient également une baisse durable du rythme de la croissance potentielle dans la plupart des pays de l'OCDE 199 ( * ) . |
Le dernier consensus de la croissance potentielle de la commission des finances 200 ( * ) (voir tableau ci-après) permet d'entrevoir quelles pourraient être les évolutions possibles de notre produit intérieur brut au cours des années à venir. Ainsi la croissance de celui-ci pourrait-elle progresser à un rythme compris entre 0,7 % et 1,5 % par an en moyenne au cours des prochaines années, avec une projection moyenne de + 1,2 % .
Aussi, afin d'appréhender les évolutions possibles de la dette publique en lien avec le ralentissement de la croissance potentielle , il peut être intéressant d'examiner l'évolution de celle-ci en fonction des scénarios macroéconomiques suivants :
- un scénario favorable, dans lequel la croissance du PIB s'élèverait à 1,2 % en 2017 - ce qui correspond à la hausse du PIB effectivement observée en 2016 201 ( * ) - puis rejoindrait progressivement un niveau de + 1,7 % en 2022 ;
- un scénario moyen, dans le cadre duquel la croissance de l'activité progresserait à un rythme de 1,2-1,3 % par an au cours de la période ;
- un scénario défavorable, dans lequel la croissance du PIB serait de 0,8 % en 2017 et reculerait progressivement à + 0,4 % en 2022.
Dans l'ensemble de ces scénarios, l'inflation est supposée rejoindre un niveau de + 1,75% dès 2019.
Tableau n°
64
: Consensus de
la croissance potentielle
de la commission des finances du Sénat
(juillet 2016)
(évolution, en %)
|
Prévisionnistes |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Moyenne 2015-2021 |
|
Axa AM |
1,2 |
1,4 |
1,4 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,6 |
1,4 |
|
BIPE |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
BNP Paribas |
0,8 |
1,0 |
1,1 |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,1 |
|
Citi |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
1,3 |
|
Coe-Rexecode |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
1,0 |
|
Crédit Agricole |
1,0 |
1,0 |
1,1 |
1,3 |
1,3 |
1,5 |
1,5 |
1,2 |
|
Euler Hermes |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
Exane |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
|
Natixis |
0,9 |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,7 |
|
OFCE |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
|
Oxford Economics |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
|
PAIR Conseil |
1,0 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,4 |
1,5 |
1,5 |
1,3 |
|
1,1 |
1,2 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,7 |
1,5 |
|
|
CONSENSUS (moy.) |
1,1 |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,2 |
|
Minimum |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,7 |
|
Maximum |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,7 |
1,5 |
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données transmises par les instituts cités)
En outre, l'évolution possible de la dette publique est examinée en présumant que les pouvoirs publics n'engagent pas d'efforts budgétaires supplémentaires , c'est-à-dire n'adoptent pas de mesures nouvelles en prélèvements obligatoires et ne réalisent pas d'économies en dépenses. Par suite, les recettes publiques évoluent avec le PIB et les dépenses publiques sont supposées croître de 1,8 % par an en volume - ce qui correspond au tendanciel d'évolution de la dépense avancée par le Gouvernement 202 ( * ) .
Ainsi, il apparaît que l'absence d'efforts budgétaires au cours des années à venir pourrait conduire à une véritable dérive de la dette publique . À supposer même que la croissance économique converge vers 1,75 % en 2022, le poids de l'endettement public dans la richesse nationale atteindrait 102 % du PIB en 2022. Dans le cadre du scénario défavorable, la dette s'élèverait à environ 116 % du PIB en 2022, contre 108 % dans le scénario moyen.
Graphique n° 65 : Évolutions de la dette publique sans efforts budgétaires
(en % du PIB)
Source : commission des finances du Sénat
IV. RÉDUIRE LA DETTE PUBLIQUE, RELANCER LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE : UNE CONCILIATION NÉCESSAIRE
Eu égard au niveau élevé de la dette publique et aux risques qui s'y rattachent, la maîtrise de cette dernière doit dorénavant constituer un impératif . Pour autant, la diminution du niveau d'endettement ne doit pas se faire au détriment de notre potentiel de croissance. Aussi les éléments qui suivent s'attachent-ils à identifier les moyens d'une réduction de la dette publique, mais aussi les voies permettant de concilier cette dernière avec le renforcement du potentiel de croissance français.
A. LES ENJEUX DU REDRESSEMENT DES COMPTES PUBLICS
De toute évidence, la maîtrise de la dette publique n'a jamais constitué, à proprement parler, une priorité . Pourtant, cette maîtrise s'impose désormais à nous par nécessité, mais aussi afin de respecter les nouvelles règles de gouvernance budgétaire européenne. Malgré cela, pour être crédible et soutenable, la trajectoire de redressement de nos comptes publics devra également être définie dans le souci de préserver et renforcer notre potentiel de croissance.
1. Réduire le poids de la dette publique
Force est de constater que la maîtrise de la dette publique n'a jamais constitué une priorité à part entière. Cela tend à être démontré par le fait que la perspective d'un retournement de la courbe de l'endettement dans le PIB a sans cesse été repoussée depuis près d'une décennie . Comme le fait apparaître le graphique ci-après, la loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 203 ( * ) prévoyait une diminution du poids de la dette dans le PIB à compter de 2012. Toutefois, le recul prévisionnel de celui-ci a été reporté à 2013 par la loi de programmation suivante 204 ( * ) , puis encore à 2016 par la loi de programmation pour la période 2014-2019 205 ( * ) ; même, selon le dernier programme de stabilité, présenté en avril 2017, la part de la dette dans la richesse nationale ne devrait se contracter qu'à partir de 2017.
En tout état de cause, la dette publique n'a cessé de progresser jusqu'à présent , atteignant 96,3 % du PIB en 2016 ; à en croire les dernières prévisions de la Commission européenne, celle-ci pourrait encore augmenter en 2017 et en 2018 206 ( * ) .
Graphique n° 66 : Comparaison des différentes trajectoires d'évolution de la dette publique présentées par le Gouvernement depuis 2010
(en % du PIB)
Source : commission des finances du Sénat (à partir des documents cités)
Cette progression non maîtrisée de la dette publique est d'autant plus problématique que d'importants risques sont associés à un niveau élevé d'endettement - comme cela a été montré précédemment dans le présent rapport. Alors que le ralentissement durable de la croissance rend possible une véritable dérive du poids de la dette dans la richesse nationale, celle-ci est susceptible de nuire à la croissance économique et une hausse des taux d'intérêt exposerait notre pays à un alourdissement significatif de la charge de la dette.
Face à un tel constat, il apparaît nécessaire de faire de la baisse de la dette publique un objectif central de la trajectoire de nos finances publiques . Quoi qu'il en soit, la France est tenue de respecter les européennes de gouvernance budgétaire. Or, depuis l'entrée en vigueur du Six Pack en novembre 2011, le critère de la dette publique figurant dans la Pacte de stabilité et de croissance (PSC) a été considérablement renforcé . Ainsi, tout État membre dont la dette excède 60 % de son PIB doit être soumis à la procédure de déficit excessif (PDE), si l'écart entre son ratio d'endettement et le seuil de 60 % n'est pas réduit de 1/20 e chaque année en moyenne sur trois ans.
Toutefois, pour les États d'ores et déjà soumis à la procédure de déficit excessif (PDE), une période de transition est prévue afin de laisser à ces derniers trois ans pour respecter le critère de la dette publique à partir du moment où ils seront sortis de la PDE. Au cours des trois années, le respect de ce critère est apprécié « selon la progression du solde structurel des États membres vers un niveau permettant le respect du critère de réduction d'un vingtième par an de l'écart entre le ration de dette publique et le niveau de référence de 60 % du PIB » 207 ( * ) . La France sera donc soumise à cette règle transitoire une fois son déficit public revenu en deçà de 3 % du PIB .
2. Renforcer notre potentiel de croissance
Pour autant, la réduction de la dette publique ne saurait constituer l'alpha et l'oméga de notre stratégie budgétaire . En effet, dans un contexte déjà marqué par un ralentissement de notre croissance potentielle - celle-ci ayant été estimée dans le cadre du consensus de la croissance potentielle de la commission des finances (voir infra ) à + 1,2 % par an en moyenne au cours de la période 2015-2021 -, la consolidation des finances publiques pourrait dégrader plus encore l'activité.
Aussi la maîtrise de la dette doit-elle s'accompagner de mesures à renforcer notre potentiel de croissance à moyen et long termes . D'ailleurs, une activité économique dynamique facilite l'allègement du poids de l'endettement, ainsi que cela a été mis en évidence précédemment.
Bien évidemment, certaines réformes structurelles seraient de nature à favoriser l'activité économique , comme celles relatives au marché du travail - à cet égard, votre rapporteur général avait mis en évidence les incidences fortes que pourrait avoir une évolution de la réglementation portant sur le temps de travail 208 ( * ) . Par ailleurs, une hausse des dépenses d'investissement pourrait avoir des effets significatifs sur la croissance du PIB - ainsi que le laissent entendre les études économiques disponibles -, et ce alors même que l'insuffisance des investissements publics, notamment dans le domaine des infrastructures, a été mise en évidence par le Fonds monétaire international (FMI) 209 ( * ) , l'OCDE 210 ( * ) ou encore la Commission européenne - ce qui a d'ailleurs justifié la mise en place du « plan Juncker ».
En outre, eu égard au niveau élevé des prélèvements obligatoires actuellement observé en France - ces derniers représentant, en 2016, 44,3 % de la richesse nationale -, un allègement de la charge fiscale serait de nature à accorder des marges de manoeuvre supplémentaires en faveur de l'emploi, de l'investissement et de la consommation .
En effet, en dépit du déploiement, au cours des dernières années, du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) ainsi que du Pacte de responsabilité et de solidarité, le coin fiscal reste élevé dans notre pays . Selon la Commission européenne, en 2015, le coin fiscal au niveau du salaire moyen était de 48,7 %, soit un niveau supérieur à la moyenne européenne (40,7 %) et « demeure l'un des plus élevés de l'UE, ce qui pourrait nuire au bon fonctionnement du marché du travail » 211 ( * ) . Ceci est notamment lié au fait que les cotisations sociales patronales, en pourcentage du coût total de la main d'oeuvre pour l'employeur, sont les plus élevées de l'Union européenne. Dans ces conditions, un nouvel allègement du coin fiscal serait de nature à encourager les créations d'emploi .
En outre, « la pression fiscale élevée exercée sur les sociétés freine leurs investissements et leur croissance » 212 ( * ) ; en effet, en 2016, le taux effectif moyen de l'impôt sur les sociétés était le plus élevé de l'Union européenne, atteignant 38,4 %. De même, les autres impôts sur la production - portant principalement sur le capital et le travail - sont particulièrement élevés , représentant, en 2015, 3,1 % du PIB, contre 2 % en Italie, 1,1 % en Espagne et 0,4 % en Allemagne.
Enfin, la charge fiscale des ménages devrait être, elle aussi, réduite . Comme l'a récemment montré votre rapporteur général, les prélèvements portant sur les ménages restaient, en 2016, supérieurs de 31 milliards d'euros à leur niveau de 2011 213 ( * ) . Abaisser les impositions supportées par les ménages permettrait d'accroître le pouvoir d'achat de ces derniers et donc la consommation mais aussi, si cette évolution passe également par une modification de la fiscalité du capital, de favoriser une meilleure orientation de l'épargne vers des investissements productifs 214 ( * ) .
B. UNE « RÈGLE DU TIERS » DE LA CONSOLIDATION BUDGÉTAIRE
L'enjeu consiste donc à concilier tout à la fois la réduction de la dette publique, la hausse des dépenses d'investissement des administrations et la diminution des prélèvements obligatoires. Avant de présenter les moyens d'y parvenir, il convient de noter que ces différents objectifs ne sont pas aussi contradictoires qu'il n'y paraît. En particulier, comme cela a déjà été souligné, le poids de la dette dans le PIB reculera d'autant plus vite que la croissance de l'activité sera dynamique ; de même, la baisse de la charge fiscale ne produira de réels effets sur le comportement des entreprises et des ménages que si elle est jugée crédible et durable par ces derniers , ce qui suppose qu'elle soit concomitante à une amélioration de la situation des finances publiques, visible à travers le fléchissement de la dette.
Aussi notre stratégie budgétaire pourrait-elle s'appuyer sur une « règle du tiers » qui consisterait à consacrer un tiers de l'effort de maîtrise de la dette à la hausse des investissements publics et à la baisse des prélèvements obligatoires . De cette manière, les efforts consentis en faveur de la diminution du niveau de l'endettement public, et ce en application des engagements européens de la France, s'accompagneraient nécessairement de mesures de nature à accroître la croissance potentielle.
Par ailleurs, la « règle du tiers » de la consolidation budgétaire imposerait un contrôle accru des dépenses , afin, d'une part, de financer la baisse de la dette publique et des prélèvements obligatoires et, d'autre part, de dégager les marges de manoeuvre nécessaires à la réallocation de moyens budgétaires en direction de l'investissement. Ainsi, la « règle du tiers » vient tout à la fois « accompagner » la trajectoire de désendettement et renforcer les exigences de maîtrise des dépenses et de qualité de ces dernières .
Afin d'appréhender les effets potentiels de la « règle du tiers » , il convient d'examiner quelle serait l'évolution des dépenses publiques, de l'investissement des administrations et des prélèvements obligatoires si elle venait à être appliquée dans les prochaines années - dans l'hypothèse où le poids de la dette publique dans le PIB reculerait conformément aux prescriptions du Pacte de stabilité et de croissance (PSC). À titre de rappel, ce dernier implique une réduction minimale de l'écart entre le ratio d'endettement et le seuil de 60 % du PIB d'un vingtième chaque année en moyenne sur trois ans ; toutefois, après avoir corrigé son déficit excessif - ce qui devrait être le cas de la France, en principe, en 2017 -, un État dispose de trois années pour respecter la règle de dette et est donc tenu, au cours de cette période transitoire, d'accomplir des progrès suffisants en vue de s'y conformer.
Graphique n° 67 : Évolution de la dette publique, des dépenses et des prélèvements obligatoires en application de la « règle du tiers »
(en % du PIB)
Source : commission des finances du Sénat
Par conséquent, dans le cadre de la présente projection, deux périodes sont distinguées : celle allant de 2017 à 2019 , au cours de laquelle un ajustement structurel de 0,5 point de PIB est réalisé chaque année, puis celle comprise entre 2020 et 2022 durant laquelle l'écart entre le ratio de dette et le seuil de 60 % est réduit de 1/20 e chaque année. Il est supposé que les objectifs budgétaires arrêtés dans le cadre du dernier programme de stabilité pour l'année 2017 sont respectés et que la croissance du PIB de même que l'inflation accélèrent progressivement au cours de la période considérée pour atteindre chacune + 1,75 % en 2022. En application de cette trajectoire, qui résulte des obligations découlant du Pacte de stabilité et de croissance - mais qui n'empêche en rien qu'un effort de désendettement plus important puisse être entrepris -, la part de la dette publique dans le PIB reculerait de 96,3 % en 2017 à 89,9 % en 2022 .
À titre d'illustration, entre 2019 et 2020, le ratio
d'endettement baisserait, dans le cadre de la projection, de 1,8 point de PIB.
Par suite, en application de la « règle du tiers »
de la consolidation budgétaire, un tiers de cette évolution, soit
0,6 point de PIB, serait consacré à l'augmentation des
investissements publics et à la diminution des
prélèvements obligatoires
- chacun de 0,3 point de PIB.
Ainsi, parallèlement à la réduction du poids de la dette publique dans la richesse nationale, de 6,4 points de PIB entre 2017 et 2022, la « règle du tiers » impliquerait, tout d'abord, une augmentation de la part des investissements dans le PIB de 3,4 % du PIB à 3,9 % (+ 0,5 point) , ce qui correspond, au cours de la période considérée, à un effort en investissement supérieur, en 2022, de près de 26 milliards d'euros au niveau de 2017 - en partant du principe que la part des dépenses réorientée vers les investissements publics le demeure par la suite. Ensuite, le taux de prélèvements obligatoires reculerait d'un point de PIB , passant de 44,3 % du PIB en 2017 à 43,3 % du PIB en 2022 ; les baisses d'impôts sous-tendant cette évolution approcheraient également 26 milliards d'euros .
Graphique n° 68 : Évolution des investissements et des prélèvements obligatoires en application de la « règle du tiers »
(en milliards d'euros)
Source : commission des finances du Sénat
Afin de mener à bien la baisse du ratio d'endettement, la hausse des dépenses d'investissement et la réduction des prélèvements obligatoires, il serait nécessaire de réaliser des économies au sein des dépenses publiques hors investissement d'un montant d'un peu moins de 80 milliards d'euros . Si l'on considère l'ensemble des dépenses publiques - intégrant donc l'augmentation des dépenses d'investissement -, l'économie réalisée serait de l'ordre de 45 milliards d'euros 215 ( * ) ; cela permettrait un recul du ratio des dépenses publiques de 2,3 points de PIB entre 2017 et 2022 , celui-ci étant ramené de 55,7 % du PIB à 53,4 % au cours de la période.
C. LES VOIES ET MOYENS DE LA MAÎTRISE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
Le relatif dynamisme de la dépense publique française n'est sans doute pas sans lien avec les difficultés rencontrées par le Gouvernement, au cours des cinq années passées, à engager des réformes structurelles d'économies , seules à même de ralentir durablement la progression de la dépense. Une étude réalisée par France Stratégie 216 ( * ) a permis de mettre en évidence le fait que les pays ayant le plus réduit leurs dépenses publiques étaient ceux qui s'étaient montrés les plus « sélectifs », c'est-à-dire ayant le plus modifié la structure de leurs dépenses - par opposition aux pays qui recourent à la stratégie du « coup de rabot », consistant à procéder à une réduction homothétique des dépenses.
Or, la France ne semble pas faire preuve d'une grande sélectivité dans la réduction des dépenses publiques . Le « coup de rabot » est resté, jusqu'à présent, largement utilisé afin de conforter la trajectoire budgétaire. Cette idée tend à être confirmée par le fait que l'essentiel des économies consenties jusqu'à présent a concerné les dépenses les plus aisées à réduire sans réformes . Ainsi, entre 2011 et 2016, les dépenses ayant affiché la baisse relative la plus prononcée sont celles d'investissement, leur part dans le PIB ayant reculé de 15 %. De même, le poids de la charge de la dette a reculé de 0,7 point de PIB, soit de 26,9 %. Les achats courants rapportés au PIB ont, eux, diminué de manière plus limitée et la masse salariale est restée stable, en lien avec le « gel » du point d'indice de la fonction publique (voir tableau ci-après).
Il apparaît donc que la réalisation des efforts d'économies au cours de la période 2011-2016 n'a pas reposé sur une sélectivité accrue de la dépense publique , les prestations sociales de même que les autres dépenses - portées notamment par la montée en charge du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) - ayant continué à progresser, leur part dans le PIB ayant progressé de respectivement 4 % et de 13,8 %. Il en a résulté que le poids des dépenses primaires dans la richesse nationale s'est accru de 3,1 points de PIB , correspondant à une hausse de 5,8 %.
Tableau n° 69 : Évolution des principales dépenses publiques (2011-2016)
|
% du PIB 2011 |
% du PIB 2016 |
Évolution relative 2016/2011 |
|
|
Masse salariale |
12,8 |
12,8 |
0,0 % |
|
Achats courants |
5,1 |
5,0 |
- 2,0 % |
|
Prestations sociales |
24,9 |
25,9 |
+ 4,0 % |
|
Investissements |
4,0 |
3,4 |
- 15,0 % |
|
Autres dépenses |
6,5 |
7,4 |
+13,8 % |
|
Dépenses primaires* |
53,3 |
56,4 |
+ 5,8 % |
|
Charges d'intérêts |
2,6 |
1,9 |
- 26,9 % |
* Dépenses primaires y compris crédits d'impôts
Source : commission des finances du Sénat (à partir des données de l'Insee)
Aussi, la mise en oeuvre d'un programme ambitieux et
crédible d'économies nécessitera d'engager des
réformes structurelles permettant de ralentir durablement
l'évolution de la dépense
. Parmi les pistes d'ores et
déjà avancées par votre rapporteur général
figurait, notamment,
une évolution du temps de travail dans la
fonction publique
; à cet égard, il avait
montré qu'une hausse de la durée légale du travail d'une
heure par semaine autorisait une économie de 2 milliards d'euros pour
l'ensemble des administrations, du fait d'une baisse des effectifs de
77 000 emplois environ
- l'économie étant même
portée à 5 milliards d'euros pour les trois fonctions publiques
si la durée hebdomadaire du travail était relevée à
37,5 heures, ce qui correspond à la durée habituelle de travail
déclarée par l'ensemble des actifs, du fait d'une
réduction des effectifs de plus 190 000 emplois
217
(
*
)
.
En outre, d'importantes économies en dépenses pourraient résulter de la suppression des « doublons » entre les collectivités territoriales et l'État - de même qu'entre les différents niveaux de collectivités. À titre d'exemple, en dépit du fait qu'une vaste partie du réseau routier national ait été confiée, à la suite de la loi de décentralisation du 13 août 2004, aux départements qui gèrent désormais 380 000 kilomètres de routes, près de 7 000 agents de l'État sont encore chargés de l'entretien du « reliquat » de routes nationales relevant de la responsabilité étatique. Une révision de la répartition des compétences en matière d'entretien des routes entre les départements et l'État constituerait, sans doute, un levier de diminution des effectifs de la fonction publique. Dans le même ordre d'idées, selon un rapport de l'Inspection générale des finances (IGF) 218 ( * ) , les « doublons » et interventions croisées entre les régions et directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) pouvait être évalués à 1 300 emplois.
Enfin, il sera difficile de faire l'économie d'une nouvelle réforme paramétrique des retraites . En effet, alors que les prestations de retraite ont constitué le premier facteur de progression des dépenses publiques au cours des dernières décennies, ainsi que cela a été mis en évidence, l'équilibre financier des régimes de retraite à court terme ne semble pas assuré (voir supra ) ; par ailleurs, la Commission européenne a souligné que les dépenses liées au vieillissement démographique faisaient peser un risque pour la soutenabilité de la dette française à moyen terme 219 ( * ) .
D. VERS UNE NOUVELLE NORME DE DÉPENSES
1. Les outils actuels de suivi de la dépense et leurs limites
Pour suivre l'évolution des finances publiques et assurer leur soutenabilité, le Parlement fixe, dans chaque loi de programmation des finances publiques, de nombreux objectifs, pour la plupart issus des engagements européens de la France, qui s'appliquent à l'ensemble des administrations publiques : il s'agit par exemple de l'évolution du solde structurel, du niveau de l'effort structurel, du ratio de dette publique ou encore du déficit public par sous-secteur d'administration publique.
Les normes pesant sur les finances publiques ont été renforcées au niveau européen à la suite de la crise financière et économique de 2008 et de la crise des dettes souveraines de 2010. Il s'agit en particulier du « Six-Pack » de novembre 2011 , prévoyant notamment que les États doivent poursuivre un objectif à moyen terme (OMT), défini en termes de solde structurel, correspondant à un déficit structurel de 1 point de PIB au maximum, et se rapprocher de cet objectif en réduisant le déficit structurel d'au moins 0,5 point de PIB par an. Les obligations européennes de la France ont également été durcies par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (TSCG) , mis en oeuvre par la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, ayant conduit à la définition d'une trajectoire de solde structurel en loi de programmation des finances publiques.
Au total, plus de 23 objectifs chiffrés sont définis en loi de programmation des finances publiques , qui font l'objet d'un suivi d'une qualité inégale et dont le mode de calcul peut prêter à confusion : à titre d'exemple, les taxes affectées aux opérateurs et plafonnées par l'article 46 de la loi de finances initiale pour 2012 faisaient jusqu'en 2014 l'objet d'une norme relative à leur évolution cumulée depuis le début de la période de programmation à périmètre constant. Le dispositif a été légèrement simplifié en 2014 en prévoyant une évolution annuelle et non cumulée.
Certaines des trajectoires définies en loi de programmation des finances publiques sont reprises et actualisées dans l'article liminaire des lois de finances, des lois de financement de la sécurité sociale et des lois de règlement des comptes et d'approbation du budget, ce qui favorise la régularité de leur suivi par le Parlement et leur appropriation par les responsables publics.
Mais aucune norme de dépenses s'appliquant à l'ensemble des administrations publiques n'existe aujourd'hui alors même qu'il s'agirait d'un outil simple et lisible.
Les normes de dépenses actuelles sont exclusivement sectorielles : il s'agit essentiellement de la double norme de dépenses en valeur et en volume pour l'État, qui existe sous sa forme actuelle depuis la loi de programmation relative aux années 2011 à 2014 220 ( * ) , et de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie (Ondam) pour les administrations sociales 221 ( * ) . Plus récemment, une norme non contraignante a été définie en matière d'évolution de la dépense publique locale (Odedel) 222 ( * ) .
Pour les administrations publiques prises dans leur ensemble, seuls des objectifs plus complexes et moins mobilisateurs existent déjà . Par exemple, la notion d'effort structurel, qui est l'un des piliers de la trajectoire budgétaire publique de la France, est exprimée en point de PIB potentiel : toute révision de la croissance potentielle modifie alors la cible à atteindre, limitant la lisibilité de cet objectif.
2. La norme de dépenses : un instrument d'autant plus efficace qu'il est simple et lisible
Or, comme le souligne une étude du FMI publiée en 2015 223 ( * ) , les normes de dépenses permettent d'améliorer la fiabilité et la crédibilité de la politique budgétaire et sont généralement mieux respectées que d'autres règles plus complexes, relatives par exemple au solde budgétaire.
À la différence des plafonds de déficit, les normes de dépenses sont également utiles en cas de « bonnes nouvelles » résultant par exemple d'une reprise de la croissance et de l'augmentation des recettes publiques dans la mesure où elles rendent plus visible - et donc moins attrayante - l'affectation du surplus de ressources à des dépenses nouvelles. Certes, l'utilisation d'un éventuel surcroît de recettes est encadrée, pour l'État, par une disposition de l'article d'équilibre 224 ( * ) en application de la loi organique relative aux lois de finances de 2001, mais cette règle est limitée à l'administration publique centrale, qui ne perçoit pas la majorité des recettes publiques et qui ne représente qu'une part minoritaire du total des dépenses publiques.
3. Une norme de dépenses s'appliquant à l'ensemble des administrations publiques
Créer une norme de dépenses portant sur l'ensemble des administrations publiques compléterait les dispositifs qui existent déjà . La commission des finances du Sénat avait d'ailleurs déjà instauré un dispositif proche dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 225 ( * ) : le Sénat avait alors adopté un plafond cumulé d'évolution des dépenses des administrations publiques.
Une norme de dépenses présenterait l'avantage d'être encore plus simple à définir et plus facile à suivre . Elle pourrait concerner l'ensemble des administrations publiques et être déclinée par sous-secteur, comme la trajectoire de déficit public l'est déjà. Afin de favoriser sa lisibilité et son caractère responsabilisant pour chacune des catégories d'administration publique, une telle norme pourrait être calculée en euros constants de la première année de la trajectoire et non en points de PIB. Selon l'étude du FMI précitée, le respect de la règle est significativement plus fréquent dans les 29 pays étudiés lorsque celle-ci est exprimée sous la forme d'un plafond spécifique, et non en points de PIB, en taux de croissance ou en évolution par rapport à l'année précédente. En effet, un mode de calcul lié à d'autres agrégats macroéconomiques réduit l'incitation à respecter la norme dans la mesure où, en cas de dépassement, il est plus difficile au Parlement de faire la part entre ce qui relève d'un laisser-aller de la dépense publique et ce qui peut être expliqué par l'évolution du contexte économique.
Afin de faire de cette norme un élément à part entière du débat sur les finances publiques de la France, elle pourrait être définie en loi de programmation des finances publiques et reprise dans l'article liminaire de la loi de finances, de la loi de financement de la sécurité sociale et de la loi de règlement.
Elle n'aurait pas de caractère contraignant à proprement parler, mais contribuerait à sortir du pilotage et de l'analyse des dépenses publiques « en silo » qui prévaut aujourd'hui . Elle permettrait de créer un lien entre les dépenses des administrations publiques et le respect des engagements européens pris par la France en matière de dette, de déficit et d'effort structurel. Il s'agirait, en somme, d'un outil direct et clair permettant au Parlement de disposer d'un point de repère afin d'évaluer la trajectoire des dépenses publiques .
4. Une norme associée à la définition d'une trajectoire d'investissement public
Comme on l'a vu, les dépenses d'investissement ont tendance à être les premières à diminuer et l'étude précitée du FMI indique d'ailleurs que « des doutes subsistent » 226 ( * ) quant à l'effet des normes de dépenses sur la structure de la dépense.
Il pourrait sembler, de prime abord, pertinent d'exclure les dépenses d'investissement de la norme . Cependant, cela complexifierait le suivi de la norme et limiterait sa lisibilité, tout en ouvrant de potentiels débats récurrents quant aux dépenses qui doivent ou non être incluses, en particulier concernant des dépenses dont l'effet sur la croissance potentielle peut être - mais n'est pas toujours - positif, par exemple les dépenses d'éducation.
La question du périmètre optimal de la norme de dépenses a été tranchée de façon diverse selon les pays considérés : par exemple, alors que la France, à l'instar de la Finlande, du Japon et de l'Espagne, exclut le service de la dette de la norme en valeur, la Croatie, le Pérou et l'Équateur ont choisi quant à eux de retirer les dépenses en capital du calcul et Israël exclut pour sa part les dépenses liées à la sécurité du pays 227 ( * ) .
En tout état de cause, une norme de dépenses doit constituer un outil simple, un point d'ancrage vis-à-vis duquel évaluer la trajectoire des finances publiques. Elle ne saurait être définie de façon trop restrictive, et n'inclure que des dépenses « improductives » par opposition à des dépenses « bonnes pour la croissance », dans la mesure où le tracé de la ligne de partage qui sépare les unes des autres paraît largement incertain : certaines dépenses de fonctionnement, par exemple la mise à niveau informatique des fonctionnaires dans le cadre d'un plan de dématérialisation de l'administration, peuvent être plus utiles que des investissements mal gérés.
Cependant, il ne saurait être question d'ignorer l'enjeu que représente l'investissement public .
La norme de dépenses pourrait donc être accompagnée d'une trajectoire d'investissement , définie sur la même durée pour l'ensemble des administrations publiques et déclinée par sous-secteur, afin de protéger ces dépenses utiles au pays et de garantir le retour à une situation financière saine, qui implique non seulement la maîtrise des dépenses mais aussi l'affermissement de l'investissement. La fixation d'une telle trajectoire permettrait également de mettre au regard des efforts consentis en dépense la participation de chaque catégorie d'administration à l'investissement public.
Une norme de dépenses s'appliquant à l'ensemble des administrations publiques pourrait, dans ces conditions, participer à la mise en oeuvre, sur la durée, d'une politique budgétaire équilibrée et crédible afin de réduire la dette tout en préservant la croissance .
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 31 mai 2017, sous la présidence de Mme Michèle André, présidente, la commission a entendu une communication de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, sur les évolutions, les perspectives et la gestion de la dette publique de la France.
M. Albéric de Montgolfier , rapporteur général . - La dette publique, en raison de son caractère faussement indolore, ne s'est que très progressivement imposée au sein du débat public. La crise des dettes souveraines dans l'Union européenne et l'abaissement de la note de la France à la fin des années 2000 nous en ont brusquement rappelé les dangers.
Elle n'a jamais cessé de croître, et ce depuis le milieu des années soixante-dix, en dépit du caractère anesthésiant de la baisse des taux d'intérêt. Elle est passée de 15 % du PIB en 1974 à 96,3 % du PIB en 2016. Elle représente près de 2 150 milliards d'euros, soit une dette moyenne de 75 850 euros par ménage.
En dépit de la faiblesse des taux d'intérêt, la charge de la dette de l'ensemble des administrations s'élève tout de même à 46,1 milliards d'euros en 2016, c'est-à-dire un montant supérieur aux dépenses consacrées à la défense et au produit net de l'impôt sur les sociétés.
L'alourdissement de la dette publique durant les quatre dernières décennies trouve sa source, non dans une politique d'investissement, mais dans une succession ininterrompue de déficits publics. Notre ancien collègue Jean-Pierre Fourcade le disait, il a été le dernier ministre des finances à présenter un budget en équilibre en 1974. Depuis, les administrations n'ont pas connu d'excédent.
Les ralentissements de la conjoncture n'expliquent qu'en partie cette situation. En effet, si les pouvoirs publics ont été au-delà des stabilisateurs automatiques lors des ralentissements économiques, en menant des politiques de relance, ils n'ont pas profité des embellies conjoncturelles pour redresser les comptes publics. Entre 1990 et aujourd'hui, à de rares exceptions près, les déficits publics ont été d'abord structurels.
Leur cause principale réside dans l'insuffisante maîtrise de la dépense des administrations. Au cours de même période, les dépenses publiques ont progressé plus rapidement que le PIB : de 3,6 % en moyenne et en valeur par an, contre 3 % pour le PIB.
Toujours entre 1990 et 2016, le poids de la dépense dans la richesse nationale a augmenté de 6,6 points de PIB. Le dynamisme des prestations sociales qui représentent désormais près de 26 % du PIB, l'explique à 90 %. La masse salariale de l'État et des administrations publiques a, elle, augmenté de 1 point de PIB. La charge de la dette a, quant à elle, reculé de 0,7 point de PIB en raison de la baisse quasi continue des taux d'intérêt depuis près de trois décennies.
Cette forte progression des dépenses est d'autant plus problématique qu'elle a alimenté la dette sans profiter à l'investissement ou à des secteurs porteurs d'avenir tels que l'éducation et la recherche.
Depuis 2009, le déficit public a été systématiquement supérieur aux dépenses d'investissement. Autrement dit, la dette publique constituée depuis cette date trouve essentiellement son origine dans les charges de personnel, de fonctionnement, d'intervention et d'intérêts de la dette. La part de l'investissement public dans le PIB a diminué de 0,5 point entre 2009 et 2016.
La part des dépenses publiques de recherche dans la richesse nationale a nettement reculé : 1,3 % du PIB en 2015, contre 1,8 % en 2015. Et ce, principalement aux dépens de la recherche fondamentale. Idem en matière d'éducation : la part des dépenses a diminué de 0,2 point de PIB durant la même période. Dans ces conditions, il est difficile d'affirmer que la hausse de la dette publique a contribué à créer de la richesse ou à préparer l'avenir.
D'après certains, le gonflement de la dette publique serait lié à un recul des prélèvements obligatoires. Pour autant, en dépit de diminutions ponctuelles entre 2000 et 2003, ainsi qu'entre 2007 et 2009, le taux de prélèvements obligatoires n'est jamais revenu en deçà de son niveau de 1990. Après une hausse de 4,2 points de PIB entre 1990 et 2013, il a enregistré une forte accélération après la crise de 2008, notamment à partir de 2012. Malgré un léger recul au cours de la période récente, les prélèvements obligatoires représentent encore 44,4 % du PIB en 2016.
En réalité, la dégradation de notre situation budgétaire provient, non d'une baisse de la fiscalité, mais de la dynamique des dépenses. Toutes les catégories d'administrations publiques y ont contribué mais à des degrés divers. L'État, au premier chef : il a été à l'origine de près de 85 % de la hausse de l'endettement public dans la richesse nationale entre 1980 et 2016. À partir du début des années quatre-vingt-dix, la dette des administrations de sécurité sociale, quasiment inexistante auparavant, a participé à hauteur de 12 % à la dynamique de la dette publique. La contribution des administrations publiques locales a été plus modeste, de 3 %, tandis que celle des organismes divers d'administration centrale a été nulle. Les collectivités locales, souvent montrées du doigt, ne sont pas responsables de l'endettement public.
C'est l'administration publique centrale et, en son sein, l'État, qui porte la majeure partie de la dette publique : en 2016, elle représente 80 % du total. Globalement, les dépenses de l'administration publique centrale rapportées au PIB sont restées stables depuis la fin des années soixante-dix : de 23,4 % du PIB en 1980 à 23 % en 2015. Cependant, cette stabilité globale masque des évolutions différenciées selon les dépenses considérées.
Malheureusement, la réduction la plus forte concerne les investissements : leur part dans le PIB a été divisée par deux depuis la fin des années soixante-dix. Les achats courants ont connu une diminution marquée ; la masse salariale de l'État a également baissé, quoique de façon plus mesurée. En revanche, les prestations sociales, qui incluent les retraites des fonctionnaires et des dispositifs ciblés comme les aides personnalisées au logement, ont fortement crû : elles sont supérieures d'un tiers à leur niveau de 1978 par rapport au PIB. La défense est le secteur qui accuse la diminution la plus marquée, ce qui est inquiétant dans le contexte international actuel. Les dépenses de recherche financées par l'administration publique centrale n'ont pas non plus été épargnées.
Bref, la maîtrise des dépenses a d'abord pesé sur l'investissement, en particulier sur la recherche et développement, et le budget de la défense, alors que les dépenses d'intervention ont connu une hausse particulièrement dynamique.
Quant aux recettes, leur poids par rapport au PIB a décru depuis la fin des années soixante-dix : 19,6 % de la richesse nationale en 2015, contre 22,4 % en 1978. Ce phénomène est lié à la concurrence fiscale, à la tendance à baisser les taux des impôts d'État en phase haute de cycle mais aussi à la progression des dépenses fiscales qui devraient s'élever à près de 90 milliards d'euros en 2017.
Concernant le secteur public local, qui intéresse particulièrement le Sénat, les transferts de compétences liés à la décentralisation ont alimenté la croissance très dynamique de leurs dépenses. Fait à souligner, les administrations locales réalisent une part majoritaire de l'investissement public, qui est financé pour partie par l'emprunt.
La masse salariale locale a doublé depuis la fin des années soixante-dix en raison de la hausse des effectifs mais aussi de mesures décidées par l'État, comme la réduction du temps de travail ou le dégel du point d'indice qui devrait représenter une charge de 546 millions d'euros pour le budget des collectivités territoriales en 2016.
La hausse des dépenses a été partiellement financée par celle des impôts locaux : ils représentent 6,1 % de la richesse nationale, contre 3,3 % en 1980. Elle s'est également traduite par une dépendance accrue des collectivités territoriales aux ressources transférées par l'État.
La dette sociale, presque inexistante avant les années quatre-vingt-dix, a significativement progressé ces dernières années. Cette tendance a été entretenue par le dynamisme des dépenses sociales qui ont crû de 3,6 % en valeur entre 1995 et 2015 alors que le PIB progressait seulement de 2,9 % par an en valeur. Les hausses les plus marquées sont celles des dépenses de santé, dont la part dans le PIB est passée de 7,5 % en 1995 à 8,5 % en 2014 et celles des dépenses de retraite, qui sont passées de 7,5 % à 11,4 % du PIB entre 1995 et 2014. Au total, la croissance des dépenses des administrations de sécurité sociale a été plus rapide que leurs ressources.
Il faut aussi dire un mot des engagements hors bilan de l'État, c'est-à-dire des obligations potentielles susceptibles de créer une charge financière et donc de peser sur la dette publique. Les engagements hors bilan de l'État, soit les engagements pris dans le cadre d'accords bien définis - les garanties accordées à certains acteurs économiques, les engagements découlant de la mission de régulateur économique et social de l'État et les engagements de retraites de l'État - qui représentent à eux seuls plus de la moitié de l'ensemble, ont crû dans des proportions importantes depuis 2007. Ainsi, les engagements pris dans le cadre d'accords bien définis ont augmenté de plus de 50 % et les engagements de retraite de 70 % en dix ans.
Une part de cette hausse est toutefois liée à un meilleur recensement de ces engagements - certains d'entre eux sont dorénavant soumis à l'accord du Parlement. En outre, les engagements hors bilan reflètent des niveaux de risque très divers et leur contrôle par le Parlement est variable. Je préfère donc retenir seulement les engagements de retraite et les engagements découlant de la mission de régulateur économique et social de l'État pour calculer la dette publique implicite. Cette dernière s'élève en 2015 à 4 300 milliards d'euros, soit plus du double de la dette publique effective et près de 200 % du PIB.
Une réduction significative du poids de la dette publique portée par la croissance du PIB et l'inflation, comme nous l'avons connue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, semble illusoire. De fait, les deux variables que sont la croissance économique et l'inflation ont tendanciellement ralenti depuis les années soixante-dix dans tous les pays industrialisés.
N'en concluons pas que le niveau actuel de notre dette publique trouve son origine dans le ralentissement de la croissance et l'inflation. En effet, après avoir été dans la moyenne européenne, nous nous en sommes écartés depuis 2012-2013. En 2016, notre ratio d'endettement est supérieur de 7,1 points de PIB à la moyenne de la zone euro, et de 12,8 points à celle de l'Union européenne. La France figure parmi les derniers États de l'Union européenne faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif, aux côtés de la Croatie, de l'Espagne, de la Grèce, du Portugal et du Royaume-Uni. Parmi eux, notre pays est le seul à avoir vu ses recettes ainsi que ses dépenses publiques augmenter entre 2011 et 2016. Cela explique le creusement de l'écart entre la part des dépenses publiques dans le PIB français et la moyenne de la zone euro, qui est passée de 6,7 points en 2011 à 8,5 points en 2016. Entre 2012 et 2016, la croissance moyenne des dépenses publiques françaises s'est élevée à 1,7 % par an en valeur, contre 1,3 % dans la zone euro et 1,5 % dans l'Union européenne. Depuis 2016, la France est le pays de l'Union européenne dont le poids des dépenses dans le PIB est le plus élevé. Et ce, devant la Finlande : 56,2 %, contre 56,1 % du PIB.
La France est un émetteur souverain majeur au sein de la zone euro : depuis 2014, nous nous endettons autant que l'Allemagne et plus que tous les pays de la zone euro, sinon l'Italie. Si ce statut constitue une opportunité pour l'Agence France Trésor, dans la mesure où le volume des titres émis favorise leur liquidité, cela représente également un défi, voire un risque. Des volumes importants doivent être absorbés très régulièrement par les marchés financiers or la France n'est pas l'émetteur de référence de la zone euro ; c'est l'Allemagne qui bénéficie des meilleurs taux. Fort heureusement, l'Agence France Trésor effectue un travail approfondi pour garantir que les émissions se déroulent dans les meilleures conditions possible.
Le contexte actuel est particulier : les taux sont très faibles, la Banque centrale européenne absorbe une part importante des émissions dans le cadre de son programme de rachats et une grande partie de l'encours de dette accumulé lors de la crise financière arrive à échéance dans les prochaines années. Ces spécificités emportent deux conséquences. D'une part, la faiblesse des taux d'intérêt favorise un allongement de la maturité de la dette, ce qui sécurise pour plusieurs années les conditions de financement actuelles de l'État : la durée de vie de la dette a ainsi augmenté entre 2009 et 2017, avec une inflexion marquée à partir de 2014. D'autre part, les rachats de dette, qui visent à lisser les échéances de remboursements, ont significativement augmenté ces dernières années pour atteindre 33 milliards d'euros en 2015. Cette hausse correspond aux émissions réalisées lors de la crise de 2008 qui arrivent à échéance aujourd'hui. Le profil de remboursement de la dette souveraine restera élevé jusqu'en 2021.
Les collectivités territoriales, après la crise des emprunts toxiques, connaissent une période de relative accalmie. La faiblesse prolongée des taux d'intérêt et la concurrence accrue entre les financeurs facilitent leur accès à des emprunts bancaires au coût contenu. En outre, se développent d'autres modes de financement, tel l'endettement obligataire. Le financement désintermédié représente aujourd'hui 7 % du total de la dette locale, soit un montant quatre fois supérieur à celui de 1980. Ce mouvement est lié, entre autres, à l'émergence de l'Agence France Locale, dont le modèle de financement est calqué sur celui des agences scandinaves.
La dette sociale représente 225 milliards d'euros en 2016. Elle est gérée par divers acteurs, à commencer par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades). Cette dernière a porté 126,6 milliards d'euros de dette en 2015 - provenant des déficits du régime général, de l'Acoss et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV). La Cades, depuis sa création en 1996, bénéficie de recettes dédiées : la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG), un versement du Fonds de réserve des retraites (FRR). En 2016, elle a amorti 124,7 milliards d'euros de dette. Lui reste donc 135,8 milliards d'euros à amortir - la dette sociale étant censée disparaître en 2024.
Grâce à la Cades, notre gestion de la dette sociale est particulièrement efficace : elle est fondée sur des émissions obligataires, notamment en devises. Avec le décret du 9 mai 2017, ses équipes seront intégrées à celles de l'Agence France Trésor. En revanche, et c'est heureux, la Caisse conservera une gouvernance autonome et elle continuera d'émettre en son nom propre.
L'Acoss, elle, est chargée de gérer les déficits cumulés des régimes de sécurité sociale qui n'ont pas été transférés à la Cades. Le montant de ces déficits a atteint 32,7 milliards d'euros en 2015. Auparavant financée par la Caisse des dépôts et consignations, l'Acoss recourt directement aux marchés financiers depuis 2005-2006.
L'Unédic porte une dette qui a atteint 25,7 milliards d'euros en 2015 en raison de la hausse du chômage. Sa stratégie financière, déterminée par son conseil d'administration, repose sur des obligations pour le long terme et des créances négociables pour les moyen et long termes. L'Union bénéficie d'une garantie de l'État.
Enfin, le reste de la dette sociale est constitué de celle des établissements publics de santé. Leur endettement a fortement augmenté au cours des quinze dernières années du fait des programmes d'investissement Hôpital 2007 et Hôpital 2012 ; elle représente 30 milliards d'euros en 2015.
La dette hospitalière présente des similarités avec la dette des collectivités territoriales : d'importantes difficultés financières au début des années 2010 ; un financement qui demeure essentiellement bancaire, mais repose également sur la Caisse des dépôts et consignations, la Banque européenne d'investissement et un recours accru à des financements désintermédiés. Ainsi, les émissions ont couvert près de 20 % des besoins de financement des hôpitaux en 2015. Si l'AP-HP est le principal émetteur d'obligations, certains hôpitaux recourent désormais à des émissions groupées.
La dette des administrations, en dépit d'une gestion à l'efficacité croissante, n'en reste pas moins un poids pour l'économie française. Elle limite les marges de manoeuvre budgétaires nécessaires à la stabilisation de l'activité en cas de dégradation de la conjoncture. De plus, elle incite les contribuables à moins consommer afin de faire face à d'éventuelles hausses d'impôt. Elle est également à l'origine d'un effet d'éviction de l'investissement privé, dans la mesure où elle absorbe une part significative de l'épargne.
Quoi qu'il en soit, une dette élevée nous expose à une forte hausse de la charge d'intérêts. Certes, le pire n'est pas toujours sûr ; toutefois, il est probable que les taux d'intérêt sur la dette souveraine remontent bientôt, pour plusieurs raisons. Premièrement, la croissance et l'inflation en zone euro repartiraient à la hausse en 2017. Deuxièmement, la Banque centrale européenne a indiqué qu'elle poursuivrait sa politique monétaire accommodante jusqu'en décembre 2017 mais elle a déjà réduit son programme de rachats de 80 à 60 milliards d'euros. En cas de reprise de l'activité et de l'inflation, elle pourrait réduire davantage son programme de rachats de titres et relever ses taux directeurs à partir de 2018. Troisièmement, la Réserve fédérale américaine a mis fin à son programme de rachat d'actifs en 2014 et procédé à plusieurs hausses de son taux directeur depuis 2015 ; ce mouvement de réévaluation devrait se poursuivre en 2017. Enfin, la prime de risque demandée par les acheteurs sur la dette souveraine des États membres de la zone euro pourrait connaître une nouvelle hausse.
L'impact d'une augmentation des taux d'intérêt sur la charge de la dette de l'État, dépend de deux paramètres : l'ampleur de la hausse des taux et l'évolution du déficit budgétaire. J'ai ainsi établi plusieurs scénarios.
Premier scénario : une augmentation des taux de 1 % et une réduction volontariste du déficit budgétaire de 5 % chaque année. Dans ce cas, la hausse de la charge de la dette resterait modérée : elle dépasserait 10 milliards d'euros après la cinquième année suivant le choc.
Deuxième scénario, un choc de taux plus important avec une hausse de 2 % mais une trajectoire budgétaire de l'État maîtrisée avec une diminution de 5 % du déficit budgétaire par an. La charge de la dette augmenterait deux fois plus vite pour atteindre 13,4 milliards d'euros dès la troisième année qui suit le choc.
Troisième scénario : une hausse des taux de 1 % combinée à une dégradation du solde budgétaire de l'État de 5 % par an. L'augmentation de la charge budgétaire de la dette représenterait 18,7 milliards d'euros en 2026.
Quatrième et dernier scénario, un choc de 2 % et une dégradation du déficit budgétaire de 5 % par an. Un surcroît de près de 37 milliards d'euros pèserait sur le budget de l'État en 2026.
À court terme, c'est avant tout l'ampleur du choc de taux qui détermine le niveau de la hausse de la charge de la dette de l'État. Cependant, l'accumulation de déficits budgétaires importants pèse de façon de plus en significative sur la charge de la dette. En d'autres termes, plus le temps passe et plus la dégradation du déficit budgétaire amplifie l'impact budgétaire de la hausse des taux subie en début de période.
Je ne crois pas crier au loup en formulant ces hypothèses. Ces simulations n'intègrent pas l'effet d'un choc de taux sur le budget des administrations de sécurité sociale et des administrations locales. En outre, elles modélisent un choc de taux unique et relativement modéré alors que les taux remonteront probablement par paliers successifs avec des hausses répétées sur plusieurs années.
D'après les simulations de la Banque centrale européenne dans son rapport sur la stabilité financière, un choc de taux conjugué à une dérive des dépenses publiques conduirait à augmenter la dette dans des proportions insoutenables pour les États fortement endettés. La remontée des taux d'intérêt ne sera donc soutenable, pour la France, que si elle s'accompagne d'une maîtrise de la dépense publique.
Existe-t-il un risque réel de dérive de la dette publique française ? On peut malheureusement le penser car, depuis 1990, le solde public effectif a rarement été en deçà du solde stabilisant le ratio d'endettement, ce qui explique l'accroissement du poids de notre dette dans le PIB. Ensuite, depuis 2009, le solde public primaire a été systématiquement inférieur au solde primaire stabilisant. La France est bel et bien exposée à un effet boule de neige : une croissance de la dette entretenue par l'accumulation des charges d'intérêts.
Sur la base des hypothèses du dernier consensus de la croissance potentielle de la commission des finances, que j'avais proposé en juillet 2016, j'ai souhaité examiner comment la part de la dette publique dans le PIB évoluait si aucun effort budgétaire supplémentaire n'était engagé.
L'absence d'efforts budgétaires au cours des années à venir conduirait à une véritable dérive de la dette publique. En 2022, le poids de l'endettement dans la richesse nationale atteindrait près de 105 % du PIB dans le scénario le plus favorable, 118 % du PIB dans le scénario le moins favorable, avec une moyenne à 110 %.
Dans ces conditions, la maîtrise de la dette publique représente une nécessité absolue. Toutefois, cela ne saurait constituer le seul objectif de notre stratégie budgétaire ; nous devons également relever notre potentiel de croissance, significativement affaibli par la crise économique. Une stratégie de consolidation équilibrée des finances publiques consisterait à consacrer un tiers de l'effort de maîtrise de la dette à la hausse des investissements publics et à la baisse des prélèvements obligatoires.
En application du Pacte européen de stabilité et de croissance, la France devra respecter une règle de dette lorsque son déficit sera revenu en deçà de 3 % du PIB. Elle impose une réduction d'un vingtième, chaque année, de l'écart entre le poids de la dette dans le PIB et le seuil de 60 %. La dette publique devrait donc reculer de 2,3 points de PIB entre 2020 et 2021. D'après la « règle du tiers » de la consolidation budgétaire, un tiers de cette évolution, soit 0,8 point de PIB, serait consacré, pour moitié, à l'augmentation des investissements publics et, pour l'autre moitié, à la diminution des prélèvements obligatoires. Cette règle du tiers n'est pas seulement une règle de répartition, elle implique aussi une exigence : la baisse des impôts et l'accroissement des investissements impliqueront un effort accru en dépenses, soit 80 milliards d'euros d'économies sur les dépenses hors investissement entre 2017 et 2022.
Comment réaliser ces économies ? Question récurrente dans notre commission des finances... A la technique du coup de rabot, largement utilisée ces dernières années, préférons des réformes de structure pour ralentir durablement l'évolution de la dépense ; faisons preuve de sélectivité. Hausse du temps de travail dans la fonction publique, que j'ai pratiquée dans ma collectivité territoriale ; révision du périmètre des missions de l'État et suppression des doublons - qu'il reste des routes nationales est assez délirant ! - ou encore l'inévitable réforme du système de retraites si nous voulons revenir à l'équilibre financier sont autant de pistes. De telles mesures ne sont pas exclusives d'une réforme du marché du travail créatrice d'emplois, qui serait de nature à diminuer les dépenses consacrées à l'indemnisation du chômage.
Pour suivre l'évolution des finances publiques, le Parlement fixe de nombreux objectifs, qui s'appliquent à l'ensemble des administrations publiques, en loi de programmation des finances publiques : solde structurel, effort structurel, ratio de dette publique... En revanche, il n'existe aucune norme de dépenses s'appliquant à l'ensemble des administrations publiques. Créons-en une pour veiller à la bonne application de la règle du tiers. Le Parlement disposerait ainsi d'un point de repère pour évaluer la trajectoire des dépenses publiques. Cette norme, définie en loi de programmation des finances publiques, serait reprise dans l'article liminaire de la loi de finances, de la loi de financement de la sécurité sociale et de la loi de règlement. Elle n'aurait pas de caractère contraignant mais contribuerait à sortir du pilotage et de l'analyse des dépenses publiques en silo qui n'a pas donné les résultats escomptés. Parce que les dépenses d'investissement sont les premières à diminuer, nous le voyons en examinant les décrets d'avance, la norme de dépenses pourrait s'accompagner d'une trajectoire d'investissement afin de protéger ces dépenses utiles au pays.
Voilà, en amont du débat d'orientation sur les finances publiques, les quelques pistes qui me paraissent favoriser une politique budgétaire équilibrée, crédible, afin de réduire la dette tout en préservant la croissance et l'investissement.
M. Éric Bocquet . - La dette publique, sujet intéressant qui mériterait d'amples débats... Je me limiterai à quelques remarques. Pourquoi en parle-t-on toujours sans évoquer l'actif de la France ? Le gonflement de la dette s'expliquerait par la dépense publique, le nombre de fonctionnaires ou encore les dépenses sociales. Mais soigner et éduquer, cela ne contribue-t-il pas à créer de la richesse ? Le budget de l'État ne se gère pas comme celui d'un ménage : couper dans les dépenses n'améliore pas automatiquement la situation financière, loin de là : la réduction des dépenses de l'État peut diminuer les recettes fiscales. Il est bon de rappeler que la dette des collectivités locales est maîtrisée et que les collectivités territoriales, dont on sait le rôle dans l'investissement public, présentent des budgets en équilibre, comme la loi l'exige d'ailleurs.
Une question naïve de béotien : comment se fait-il que la France emprunte sans difficulté des volumes aussi importants - 185 milliards d'euros en 2017 - si notre situation est aussi cataclysmique qu'on l'entend parfois ? Que je sache, la dette française se vend bien ; on se l'arrache !
M. Philippe Dallier . - Pourvu que ça dure !
M. Éric Bocquet . - Les États-Unis présentent un taux d'endettement supérieur à 100 % de leur richesse nationale, le Japon affiche une dette de plus de 200 % du PIB. Comme on le dit dans ma région, on dort mieux avec des dettes qu'avec des puces...
Quand disposerons-nous d'un véritable audit de la dette publique ? Elle provient de très nombreux éléments, dont des cadeaux fiscaux à l'efficacité douteuse, comme le CICE, ou encore le manque à gagner occasionné par l'évasion fiscale.
Enfin, puisque la Banque centrale européenne s'est partiellement affranchie de ses propres règles en mettant en oeuvre l'assouplissement quantitatif depuis quelques années, ne peut-on pas imaginer qu'elle finance les États européens et investisse pour créer la richesse de demain ?
M. Michel Bouvard . - Un regret pour commencer, celui que ce débat sur la dette ait été absent de la campagne présidentielle et, pour l'instant, de la campagne pour les élections législatives. Pouvez-vous en dire davantage sur ces « accords bien définis » dans le cadre des engagements hors bilan de l'État ? S'agit-il d'accords internationaux ? Concernant l'Acoss, ses lignes de trésorerie à 364 jours non consolidées en dette, qui m'ont valu d'être convoqué à Matignon il y a quelques années parce que je refusais de les augmenter, sont-elles comprises dans la dette sociale ? De même, y a-t-il une zone grise dans le traitement de la dette ferroviaire par Eurostat ?
Je partage l'analyse du rapporteur général sur la dichotomie entre hausse de la dette et insuffisance de l'investissement - et j'aimerais connaître l'évolution des investissements civils et militaires. Pour autant, l'investissement ne comprend pas les dépenses fiscales, comme le crédit d'impôt recherche, qu'il faudrait réintégrer. Éric Bocquet évoque le cas du Japon mais la question, pour la France, est d'abord de savoir si nous sommes dépendants à l'égard de l'étranger. Les derniers chiffres que j'ai en mémoire indiquaient que la dette était détenue à 40 % par des résidents nationaux. Y a-t-il eu une évolution ?
Effectivement, l'année 2021 sera une année sensible ; nous serons très exposés si les taux venaient à monter car nous aurons à renouveler une partie du stock d'emprunts constitué lors de la crise de 2008.
Enfin, le nouveau président de la République évoque une nationalisation de l'Unédic. Si elle survient, comment sera traitée la dette de cet organisme ?
M. Vincent Delahaye . - Financer le fonctionnement par l'endettement est anormal. À nous d'assumer nos dépenses, plutôt que de les reporter sur les générations futures, même si des liquidités sont disponibles sur les marchés financiers.
M. André Gattolin . - Les dépenses consacrées à la recherche comprennent-elles le crédit d'impôt recherche et le programme d'investissements d'avenir ? La réduction des dépenses publiques de recherche, en particulier des dépenses de recherche fondamentale, que souligne le rapporteur général, me semble cohérente avec la politique qui a été menée ces dernières années : il fallait, disait-on, tout faire pour inciter le secteur privé à investir dans la recherche...
Enfin, comment distinguer les dépenses de fonctionnement de celles d'investissement en matière de recherche ? Le salaire d'un chercheur tient des unes comme des autres.
En général, les comparaisons internationales ne me convainquent guère. Le périmètre des dépenses publiques varie selon les pays. Ainsi, les dépenses sociales, portées par le secteur public en France, relèvent du privé dans d'autres pays.
Enfin, les partenariats public-privé, Jean-Pierre Sueur et Hugues Portelli l'ont démontré, constituent une bombe à retardement pour l'endettement des collectivités territoriales. Face à des difficultés pour trouver des financements, les collectivités ont recouru à ces contrats, mais le risque est réel. Comme les programmes d'investissements d'avenir, leur statut est flou : on ne sait plus où commence et où finit la dépense publique.
M. Francis Delattre . - L'assurance maladie n'est pas mal gérée. Il est illusoire d'en espérer des milliards d'euros d'économies quand la population française vieillit et que se développent des maladies telles que le cancer et le diabète. Moins payer les vacations des médecins participe à l'extension du désert médical : dix ans d'études pour un salaire aussi modeste, cela n'attire pas grand monde. L'objectif national des dépenses d'assurance maladie, il faut le souligner, a joué son rôle pour contenir les dépenses. Surtout, pourquoi se polariser sur les 190 milliards d'euros de l'assurance maladie ? L'assurance chômage, gérée par un patronat qui aime tant nous faire la leçon et des syndicats qui le suivent la plupart du temps, est-elle bien gérée ? La gestion ne paraît pas fantastique... Bref, ne nous racontons pas d'histoires sur les économies à réaliser sur l'assurance maladie. Il serait beaucoup plus logique de mettre fin aux régimes spéciaux de certaines sociétés de transport qui coûtent 8 milliards d'euros par an ! La retraite à 52 ans, c'est déraisonnable par rapport aux autres Français.
La Cades, dont les ressources sont insuffisantes pour couvrir les besoins, était une petite structure légère et magnifiquement gérée. Et on va la supprimer...
M. Albéric de Montgolfier , rapporteur général . - Il y a fusion des équipes de gestion mais la gestion de la dette de la Cades demeurera indépendante !
M. Francis Delattre . - Quelle énorme erreur ! Cette petite structure qui enregistrait des résultats extraordinaires devait faire trop d'envieux au Trésor, il fallait visiblement à tout prix la faire revenir dans le giron de l'administration centrale. Mais puisqu'il semble y avoir consensus, je m'en tiens là. La période est au consensus...
M. Maurice Vincent . - À mon sens, la dette publique ne représente pas forcément un poids pour l'économie, elle le devient seulement quand elle est excessive et incontrôlée. Pourquoi les ménages consommeraient-ils moins quand elle atteint un niveau élevé ?
M. Albéric de Montgolfier , rapporteur général . - À cause de la hausse des prélèvements obligatoires !
M. Maurice Vincent . - On constate une reprise de la consommation depuis quelques semaines sans que la dette ait diminué. Quant au risque d'éviction de l'investissement privé, il se discute sérieusement : l'investissement public est parfois plus efficace.
Oui à des réformes de structure et à la sélectivité des dépenses plutôt qu'aux coups de rabot. Une dette représentant 90 % du PIB appelle à la plus grande vigilance en particulier compte tenu du risque budgétaire que représente une hausse des taux d'intérêt. Pour autant, les solutions pour y parvenir ne peuventb qu'être progressives. On peut, plutôt qu'augmenter le temps de travail des agents publics sans modifier leur rémunération, améliorer leur efficacité en recourant davantage au numérique. Quant à la réforme du système des retraites, ses effets se feront sentir à moyen terme seulement. En clair, les réformes doivent être progressives et s'accompagner de nouveaux investissements qui permettront de faire des économies plus tard.
M. Yvon Collin . - Quels sont les écarts de taux entre les émetteurs publics et les différentes catégories d'émetteurs privés ? Comment évaluez-vous les effets redistributifs de la dette publique par comparaison avec le financement fiscal des interventions publiques ?
M. Philippe Dominati . - À l'aube d'un nouveau quinquennat, je m'interroge sur la fameuse « règle d'or » budgétaire : nous voulions la graver dans la Constitution il y a cinq ans... Qu'est-elle devenue ?
M. Albéric de Montgolfier , rapporteur général . - Je serai synthétique car le Premier président de la Cour des comptes nous attend. L'endettement en soi n'est pas malsain, nous le savons dans les collectivités territoriales dont le budget, contrairement à celui des ménages, peut être comparé à celui de l'État. Ce qui en revanche pose problème, c'est de régler des dépenses courantes, de fonctionnement, par l'emprunt. Nous pouvons inscrire la règle d'or partout, que ce soit dans la Constitution ou dans une loi organique, lui donner tous les noms possibles, l'essentiel est de l'appliquer.
La dette publique suscite l'intérêt des marchés pour des raisons techniques, d'abord : les règles prudentielles fixées par « Bâle III » ou « Solvabilité II » imposent d'en détenir des volumes importants car les titres souverains sont considérés de bonne qualité. Ensuite, les banques centrales tirent la demande vers le haut en menant des politiques de rachats d'actifs. La dette est liquide, le marché secondaire fonctionne bien avec des titres diversifiés. Enfin la France dispose encore d'actifs et d'une épargne privée qui rassurent les investisseurs.
Faute de temps, je vous renvoie au rapport concernant la dette ferroviaire : 18 milliards d'euros ont déjà été requalifiés en dette publique.
Le crédit d'impôt recherche ne compense pas la baisse des dépenses publiques de recherche. Les dépenses d'investissement incluent bien les programmes d'investissements d'avenir.
Historiquement, la dette souveraine était détenue pour un tiers par des résidents, un tiers par des résidents de l'Union européenne et un tiers par des personnes du reste du monde. Aujourd'hui, la part des résidents français atteint 41,5 %, contre 32 % en 2009. L'épargne privée est en partie captée par l'endettement public, ce n'est un mystère pour personne.
Quand bien même la dette publique française est bien gérée, une hausse des taux d'intérêt pèsera sur notre économie.
La commission a donné acte à M. Albéric de Montgolfier de sa communication et en a autorisé la publication sous la forme d'un rapport d'information.
LISTE DES PERSONNES CONSULTÉES
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss)
Alain Gubian, directeur financier
Agence France Locale (AFL)
Olivier Landel, directeur général
Yves Millardet, président du directoire
Agence France Trésor (AFT)
Anthony Requin, directeur général
Maxime Quenin-Cahn, responsable de la Trésorerie
Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)
Arnaud Lunel, chef du département de la stratégie financière et patrimoniale
Philippe Rouvrais, chef du service « Financement et trésorerie »
Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades)
Patrice Ract-Madoux, président du conseil d'administration
Geneviève Gauthey, responsable budget et communication
Direction du Budget
Renaud Duplay, sous-directeur, 1 ère sous-direction
Stéphane Robin, chef du bureau de l'exécution budgétaire
Ville de Paris
Guillaume Robert, directeur des finances et des achats
Hervé Amblard, chef du service de la gestion financière
* 1 M.-L. Legay, J. Félix et E. White, « Retour sur les origines financières de la Révolution française », Annales historiques de la Révolution française , n° 356, 2009, p. 193.
* 2 Il convient néanmoins de rappeler qu'en 1789, les États généraux n'avaient pas été convoqués depuis 1614 (v. N. Delalande, Les batailles de l'impôt. Consentement et résistances de 1789 à nos jours , Paris, Éditions du Seuil, 2011).
* 3 « Lettre du Roi, pour la convocation des États généraux à Versailles, du 24 janvier 1789 », Archives parlementaires , vol. 1, n° 1, 1879, p. 611.
* 4 B. Lemoine, L'ordre de la dette , Paris, La Découverte, 2016.
* 5 M. Pébereau (dir.), Rompre avec la facilité de la dette publique , Paris, La Documentation française, 2006.
* 6 Ibid. , p. 3.
* 7 Id.
* 8 V. M.-P. Chélini, Inflation, État et opinion en France de 1944 à 1952 , Paris, IGPDE-CHEFF, 1998, p. 76.
* 9 J. Duval, « La dette publique, un problème politiquement construit ? », Regards croisés sur l'économie , vol. 17, n° 2, 2015, p. 67-78.
* 10 Insee, « En 2016, le PIB en volume augmente de 1,2 % », Informations rapides , n° 128, 16 mai 2017.
* 11 Insee, « En 2016, le déficit public s'élève à 3,4 % du PIB, le taux de prélèvements obligatoires diminue de 0,1 point à 44,3 % du PIB », Informations rapides , n° 82, 24 mars 2017.
* 12 Rapport d'information (n° 549, session 2008-2009) de Philippe Marini pour le débat sur les orientations des finances publiques fait au nom de la commission des finances du Sénat, 8 juillet 2009, p. 7.
* 13 Le PIB potentiel se définit comme le produit intérieur brut pouvant être obtenu durablement, c'est-à-dire sans produire de déséquilibre sur les marchés des biens et du travail. En cela, le PIB potentiel se distingue fondamentalement du niveau maximal de production réalisable à un instant donné ; en effet, il s'agit d'un niveau d'activité « soutenable » sur longue période, qui n'entraîne pas d'accélération de l'inflation ou d'accroissement des salaires. L'évolution du niveau de production « soutenable », soit du PIB potentiel est appelée croissance potentielle (v. rapport d'information (n° 764, session 2015-2016) d'Albéric de Montgolfier sur les estimations de la croissance potentielle de la France, en vue des prochaines programmations pluriannuelles des finances publiques fait au nom de la commission des finances du Sénat, 6 juillet 2016).
* 14 V. rapport d'information (n° 764, session 2015-2016) d'Albéric de Montgolfier, op. cit. , p. 11-13.
* 15 Il convient de relever que, dans le cadre de la présente évaluation, le solde structurel intègre les mesures ponctuelles et temporaires.
* 16 P. Champsaur et J.-P. Cotis, Rapport sur la situation des finances publiques , Paris, Présidence de la République, 2010.
* 17 P. Champsaur et J.-P. Cotis, op. cit. , p. 12.
* 18 Id.
* 19 Ibid. , p. 13.
* 20 Les conséquences d'une faible inflation sur les finances publiques françaises ont fait l'objet d'une analyse approfondie lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2016 (v. rapport général (n° 154, session 2015-2016), tome I, d'Albéric de Montgolfier sur le projet de loi de finances pour 2016 fait au nom de la commission des finances du Sénat, 19 novembre 2015, p. 41-44).
* 21 À titre indicatif, selon les données de l'Insee, entre 1960 et 1970, la croissance du PIB en volume a été, en moyenne, de 6 % par an ; les prix à la consommation ont, quant à eux, affiché une hausse annuelle moyenne de 4,1 % au cours de la même période.
* 22 L. Eyraud et T. Wu, « Playing by the Rules: Reforming Fiscal Governance in Europe », IMF Working Paper WP/15/67, 2015.
* 23 Rapport d'information (n° 113, session 2016-2017) d'Albéric de Montgolfier sur l'évolution des prélèvements obligatoires entre 2012 et 2016 fait au nom de la commission des finances du Sénat, 9 novembre 2016.
* 24 En comptabilité nationale, l'administration publique centrale agrège l'État et les organismes divers d'administration centrale (ODAC) qui sont des organismes contrôlés et financés majoritairement par l'État, dont l'activité est principalement non marchande et auxquels l'État a donné une compétence fonctionnelle spécialisée au niveau national.
* 25 Jusqu'en 2011, il s'agissait de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ou TIPP.
* 26 P. Champsaur et J.-P. Cotis, op. cit., p. 23.
* 27 Cour des comptes, Rapport public annuel, Paris, La Documentation française, 2011, p. 42.
* 28 Conseil des prélèvements obligatoires, La taxe sur la valeur ajoutée , Paris, La Documentation française, 2015, p. 51.
* 29 Jaune budgétaire « Bilan des relations financières entre l'État et la sécurité sociale » annexé au projet de loi de finances pour 2017, p. 39. Le chiffre indiqué correspond à la somme des parts transférées de TVA, de droits de consommation sur les alcools, de droits sur les bières et les boissons non alcoolisées et de droits de consommation sur les tabacs.
* 30 Loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
* 31 V. commentaire de l'article 11 du projet de loi (rapport (n° 78, session 2010-2011) de Philippe Marini sur le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 fait au nom de la commission des finances du Sénat, 27 octobre 2010).
* 32 Rapport d'information (n° 602, session 2013-2014) de Jean-Claude Frécon sur le compte de concours financiers « Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics » fait au nom de la commission des finances du Sénat, 11 juin 2014.
* 33 Par exemple, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) bénéficie d'avances dont le remboursement est étalé sur 12 ans, pour un montant total de 16 millions d'euros. De même, la chambre de commerce de région de la Guyane s'est vu octroyer une avance de 5 millions d'euros dont le remboursement est étalé sur 15 ans.
* 34 Les administrations publiques locales comprennent les collectivités territoriales à proprement parler et les organismes divers d'administration locale (ODAL).
* 35 P. Richard, Solidarité et performance, les enjeux de la maîtrise des dépenses locales , Paris, Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, 2006.
* 36 Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'État, loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'État et les collectivités territoriales et loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux.
* 37 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République.
* 38 Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002.
* 39 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
* 40 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
* 41 J. Marcoff, « Bilan des finances locales depuis 1980 », Diagnostics Prévisions et Analyses économiques , n° 97, 2006.
* 42 Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP), Rapport annuel sur l'état de la fonction publique , Paris, Ministère de la fonction publique, édition 2016, p. 97.
* 43 Conseil national d'évaluation des normes (CNEN), Rapport public d'activité 2016 , mars 2017, p. 26-27.
* 44 Jaune « Transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales » annexé au projet de loi de finances pour 2017, p. 31.
* 45 Cour des comptes. La Sécurité sociale. Rapport sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale , Paris, La Documentation française, 2016, p. 62.
* 46 Rapport d'information (n° 2944, 14 e législature) de Gisèle Biémouret sur la dette des établissements publics de santé fait au nom de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, 8 juillet 2015.
* 47 V. Direction générale de l'administration et de la fonction publique, op. cit. , p. 97.
* 48 Ainsi que l'a rappelé votre rapporteur général, la réduction du temps de travail dans la fonction publique hospitalière a été à l'origine de la création de près de 45 000 emplois entre 2002 et 2005 pour un coût d'environ 1,9 milliard d'euros (v. rapport d'information (n° 292, session 2015-2016) d'Albéric de Montgolfier sur les enjeux du temps de travail pour la compétitivité, l'emploi et les finances publiques fait au nom de la commission des finances du Sénat, 13 janvier 2016, p. 38).
* 49 C. Duc, H. Martin et J. Tréguier, « Les réformes des retraites menées entre 2010 et 2015 : effets sur la situation des assurés, les dépenses des régimes et l'équité », États et Résultats , n° 985, 2016.
* 50 Conseil d'orientation des retraites, Évolutions et perspectives des retraites en France. Rapport annuel du COR , juin 2016.
* 51 A. Marrakchi, « Projections de population active : analyse des révisions entre les deux derniers exercices de 2011 et 2017 », Note Insee pour le COR n° 2017-713, mai 2017.
* 52 Ce phénomène devrait être accentué par la réforme portée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, qui a institué une modulation des allocations familiales et de la PAJE en fonction des revenus.
* 53 Hors transferts financiers entre les différents régimes de protection sociale.
* 54 Créé le 1 er janvier 1991 en application de l'article 28 du contrat de plan entre l'État et la SNCF pour les années 1990 à 1994.
* 55 La budgétisation de la dotation au désendettement de RFF intervient en lien avec la décision du 21 août 2003 de l'organisme statistique européen Eurostat de requalifier les dotations en capital au profit de RFF comme des dépenses publiques.
* 56 Rapport général (n° 68, session 2002-2003), tome III, annexe n° 16, de Jacques Oudin sur le projet de loi de finances pour 2003 fait au nom de la commission des finances du Sénat, 21 novembre 2002, p. 28.
* 57 Rapport d'information (n° 476, session 2004-2005) de Paul Girod sur la gestion de la dette de l'État dans le contexte européen fait au nom de la commission des finances du Sénat, 12 juillet 2005.
* 58 Lettre du 8 septembre 2007 d'Eurostat au directeur de l'Insee relative au traitement méthodologique de la dette de la SNCF allouée au Saad.
* 59 Eurostat, Excessive Deficit Procedure (EDP) dialogue visit to France, Final Findings , novembre 2010.
* 60 9,9 milliards d'euros pour l'année 2009, 10,1 milliards d'euros pour l'année 2010 et 10,5 milliards d'euros pour l'année 2011.
* 61 Eurostat, Excessive Deficit Procedure (EDP) dialogue visit to France, Final Findings , juin 2014.
* 62 Insee, Fiche méthodologique de la base 2010 des comptes nationaux. Révision de la dette des administrations publiques au sens de Maastricht, de la dette nette, des actions cotées et titres de participations , mai 2014.
* 63 Loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire.
* 64 Article 193 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques modifiant l'article L. 2111-10-1 du code des transports. Le décret a finalement été pris en 2017 (décret n° 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des investissements de SNCF Réseau) et a fixé le seuil au niveau maximal prévu par la loi (c'est-à-dire 18).
* 65 Avis n° 2016-222 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) sur le projet de budget de SNCF Réseau pour l'année 2017, 14 décembre 2016.
* 66 Rapport (n° 77, session 2016-2017) de Louis Nègre sur le projet de loi relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, , fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, 26 octobre 2016, p. 20.
* 67 Encadré par l'article L. 2111-10 du code des transports.
* 68 Avis n° 2017-036 de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer) sur le projet de contrat pluriannuel de performance entre l'État et SNCF Réseau pour la période 2017-2016, 29 mars 2017.
* 69 Rapport du Gouvernement relatif à la trajectoire de la dette de SNCF Réseau, et aux solutions qui pourraient être mises en oeuvre afin de traiter l'évolution de la dette historique du système ferroviaire, remis aux commissions permanentes du Parlement compétentes en matière ferroviaire et financière, en application de l'article 11 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, p. 16.
* 70 Recueil des normes comptables applicables à l'État, 2015, p. 202.
* 71 Cour des comptes, Rapport public annuel , Paris, La Documentation française, 2013, p. 553.
* 72 Cour des comptes, La qualité des comptes des administrations publiques , Paris, La Documentation française, 2014, p. 29.
* 73 Rapport d'information (n° 579, session 2012-2013) de Jean-Claude Frécon sur l'enquête de la Cour des comptes relative au recensement et à la comptabilisation des engagements hors bilan de l'État fait au nom de la commission des finances du Sénat, 15 mai 2013, p. 44.
* 74 Article 141 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
* 75 Article 34 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.
* 76 Expert Group on Debt Redemption Fund and Eurobills, Final Report , 31 mars 2014.
* 77 A. Bauer, « Et si l'on reparlait d'une Europe de la défense ? », Les Échos , 7 juillet 2016.
* 78 J.-P. Renne et N. Sagnes, « Une modélisation analytique des stratégies d'endettement de l'État », Diagnostics Prévisions et Analyses économiques , n° 99, 2006, p. 1.
* 79 OCDE, Sovereign Borrowing Outlook , 2016, p. 24.
* 80 Id.
* 81 Finance Active, L'observatoire Finance Active de la dette des collectivités locales , 2016, p. 15.
* 82 Par exemple, l'agence Standard & Poor's prend en compte, pour déterminer la note des régions françaises, le cadre institutionnel de cette catégorie de collectivités. À titre d'illustration, s'agissant de la région Auvergne, elle jugeait en janvier 2015 celui-ci « très prévisible et équilibré » en raison notamment du « soutien systémique de l'État, de manière récurrente (régularité des encaissements au titre des principales dotations et des reversements de fiscalité) ou exceptionnelle - par exemple, la mise à disposition, à plusieurs reprises depuis 2008, de financements par l'intermédiaire des fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations (AA/Négative/A-1+) ».
* 83 J.-Y. Grenier (dir.), La Dette publique dans l'histoire , Paris, IGPDE-CHEFF, 2006.
* 84 Un emprunt perpétuel est assimilable à une rente : les intérêts sont dus indéfiniment par le débiteur, mais le capital n'est jamais remboursé.
* 85 L. Quennouëlle-Corre, « Dette publique et marchés de capitaux au XX e siècle : le poids de l'État dans le système financier français » in J.-Y. Grenier (dir.), op. cit. , p. 446.
* 86 Ibid. , p. 455.
* 87 B. Lemoine, « Dette publique, débat confisqué. Pourquoi la France emprunte-t-elle sur les marchés ? », La Vie des idées , 12 février 2013.
* 88 P.-J. Lehmann, Le système des réserves obligatoires et le contrôle de la masse monétaire , Rouen, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 1979, p. 281.
* 89 L. Quennouëlle-Corre, op. cit. , p. 458.
* 90 Ibid. , p. 459.
* 91 Par opposition à la vente réglementée de titres par « contingents » de titres à certains établissements bancaires choisis en amont de l'émission, avec un taux lui aussi défini ex ante , comme c'était la pratique depuis l'entre-deux-guerres.
* 92 L. Quennouëlle-Corre, op. cit. , p. 464.
* 93 Du nom du ministre de l'Économie et des Finances de l'époque, Michel Debré, et de son conseiller technique Jean-Yves Haberer, devenu par la suite directeur général du Trésor. « Les textes publiés en 1966-1967 constituent un arsenal impressionnant de réformes qui touchent tant au système de crédit qu'aux marchés financiers et à l'organisation bancaire » (v. L. Quennouëlle-Corre, La Direction du Trésor 1947-1967 . L'État-banquier et la croissance, Paris, IGPDE-CHEFF, 2000).
* 94 Décret n° 67-27 du 9 janvier 1967.
* 95 Loi n o 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France.
* 96 « Dans la première partie, la loi de finances de l'année : [...] comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'État prévues à l'article 26 et évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ».
* 97 « Dans la première partie, la loi de finances de l'année : [...] fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an ».
* 98 Il s'agit du compte de commerce intitulé « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État ». Les crédits liés au paiement de la charge de la dette sont ouverts, au sein du budget général, sur le programme 117 de la mission « Engagements financiers de l'État ».
* 99 Rapport d'information (n° 3936, session 2015-2016) de Jean-Claude Buisine, Jean-Pierre Gorges et Nicolas Sansu sur la gestion et la transparence de la dette publique, fait au nom de la commission des finances de l'Assemblée nationale, 6 juillet 2016, p. 54.
* 100 Arrêté du 8 février 2001 portant création d'une agence de la dette.
* 101 Cela signifie en particulier que l'Agence France Trésor ne dispose pas d'un budget propre et que ses effectifs sont intégrés au plafond d'emplois du ministère.
* 102 OCDE, op. cit. , p. 55.
* 103 Suivie par l'agence Fitch en 2014 et l'agence Moody's en 2015.
* 104 Précédée d'une première baisse en janvier 2012.
* 105 « L'agence S&P abaisse d'un cran la note de la France », Le Monde , 8 novembre 2013.
* 106 Par exemple, quand l'AFT émet des bons du Trésor à taux fixe, elle peut émettre des bons de maturité plus ou moins longue, dont le coupon est plus ou moins élevé et dont la date d'échéance est plus ou moins proche. Elle doit en particulier décider de la proportion de titres émis « off-the-run », sur souches anciennes (voir infra ). En général, sont émis chaque semaine un BTF trimestriel, un BTF semestriel et un BTF annuel.
* 107 En principe, celle-ci est de l'ordre de 1 milliard d'euros pour les OAT, de 400 millions d'euros pour les BTF et de 500 millions d'euros pour les OAT indexées sur l'inflation. Elle peut cependant être élargie de façon exceptionnelle, en cas d'incertitudes fortes sur la réaction du marché.
* 108 Le terme « précompté » signifie que les intérêts sont prélevés dès le début de la période sur laquelle ils sont dus : par exemple, un titre d'une valeur de 100 euros portant un intérêt précompté de 10 % donnera lieu au versement de 90 euros par l'acheteur.
* 109 Euroclear est une société internationale de dépôt et de règlement/livraison pour les obligations, actions et fonds d'investissement.
* 110 OCDE, op. cit., p. 30.
* 111 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
* 112 Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
* 113 Article L. 2322-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
* 114 Rapport (n° 4030, session 2011-2012) de Jean-Pierre Gorges fait au nom de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les produits financiers à risque détenus par les acteurs publics locaux, 6 décembre 2011, p. 28.
* 115 Les différés d'amortissement permettent aux emprunteurs de retarder le paiement de la première échéance du prêt de six ou douze mois, voire davantage. Ils sont appréciés des acteurs publics locaux dans la mesure où le rythme de décaissement des dépenses d'investissement peut être difficile à prévoir. Les incertitudes liées aux recompositions institutionnelles locales contribuent également à expliquer la préférence pour les financements de court terme.
* 116 Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République et loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002.
* 117 Rapport (n° 4030, session 2011-2012) de Jean-Pierre Gorges fait au nom de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les produits financiers à risque détenus par les acteurs publics locaux, 6 décembre 2011, p. 14.
* 118 Rapport d'information (n° 58, session 2015-2016) de Maurice Vincent sur le financement des collectivités et la résolution du problème des emprunts « toxiques » fait au nom de la commission des finances du Sénat, 14 octobre 2015, p. 40.
* 119 P. Artus, J.-P. Betbèze, C. de Boissieu et G. Capelle-Blancard, La crise des subprimes , Paris, Conseil d'analyse économique, 2008, p. 65.
* 120 Rapport (n° 4030, session 2011-2012) de Jean-Pierre Gorges, op. cit. , p. 93.
* 121 Le Fonds d'épargne transforme une partie de l'épargne « populaire » (livret A, livret de développement durable et livret d'épargne populaire) en prêts de long terme, jusqu'à 60 ans. Ces prêts financent des programmes d'intérêt général désignés comme prioritaires par l'État (logement social, politique de la ville, investissements des collectivités locales...).
* 122 Article 4 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
* 123 Article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
* 124 Article 26 de la loi de finances rectificative pour 2014 précitée. Un dispositif d'accompagnement distinct a été créé pour les hôpitaux.
* 125 Rapport d'information (n° 58, session 2015-2016) de Maurice Vincent sur le financement des collectivités et la résolution du problème des emprunts « toxiques » fait au nom de la commission des finances du Sénat, 14 octobre 2015, p. 48.
* 126 Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
* 127 Article 31 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.
* 128 Finance Active, op. cit. , p. 8.
* 129 Ibid.
* 130 Finances Active, op. cit.
* 131 Cour des comptes, La gestion de la dette publique locale , Paris, La Documentation française, 2011, p. 144.
* 132 Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
* 133 Leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de sécurité sont également intégrés dans le périmètre de la loi.
* 134 Décret n° 2014-984 du 28 août 2014 relatif à l'encadrement des conditions d'emprunt des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours.
* 135 TGI de Nanterre, 8 février 2013, Département de la Seine-Saint-Denis c. Dexia et TGI de Paris, 25 mars 2014, Département de la Seine-Saint-Denis c. Depfa Bank.
* 136 TGI de Nanterre, 7 mars 2014, Commune de Saint-Maur-des-Fossés c. Dexia.
* 137 II de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.
* 138 Loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public.
* 139 Finance Active, op. cit. , p. 7.
* 140 Rapport d'information (n° 598, session 2011-2012) d'Aymeri de Montesquiou fait au nom de la mission commune d'information (MCI) du Sénat relative aux agences de notation, 18 juin 2012.
* 141 La région Île-de-France recourt aux emprunts obligataires depuis 2001. Elle a été suivie par la Ville de Paris en 2007.
* 142 Les banques sélectionnées pour les syndications appartiennent souvent au réseau des spécialistes en valeur du Trésor.
* 143 Article 115 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.
* 144 Règlement d'exécution (UE) n° 2015/2011 de la commission du 11 novembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution concernant les listes d'autorités régionales et locales à considérer, en ce qui concerne les expositions à leur égard, comme le gouvernement central, en application de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil.
* 145 Leur pondération exacte peut dépendre de la notation interne du risque mise en place par les établissements d'assurance.
* 146 Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
* 147 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
* 148 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
* 149 Ces agences incluent en particulier les établissements suivants : KommuneKredit au Danemark, créée en 1898, Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) et Nederlandse Waterschapsbank (NWB) aux Pays-Bas, fondées respectivement en 1914 et en 1954, Kommunalbanken en Norvège créée en 1927, Kommuninvest en Suède à partir de 1986 et Munifin en Finlande, mise en place en 1989.
* 150 L'article 11 du règlement délégué (UE) n° 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit prévoit que les créances détenues sur des administrations locales, ou garanties par elles, sont classées comme des actifs de niveau 2A. Ceux-ci subissent une décote de 15 % sur leur valeur de marché pour le calcul du HQLA. En revanche, les obligations souveraines ne font l'objet d'aucune décote.
* 151 Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
* 152 Loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale.
* 153 Décret n° 2017-869 du 9 mai 2017 relatif à la Caisse d'amortissement de la dette sociale.
* 154 Il convient de noter que l'Acoss fait partie, à l'instar de l'État et d'autres organismes gestionnaires de régimes spéciaux, des personnes morales à qui la loi interdit de bénéficier d'un découvert de trésorerie.
* 155 Commission des comptes de la sécurité sociale, Les comptes de la sécurité sociale. Résultats 2015, prévisions 2016 et 2017 , septembre 2016, p. 268.
* 156 Ibid. , p. 62.
* 157 Article 38 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.
* 158 Commission des comptes de la sécurité sociale, op. cit. , p. 268.
* 159 Ibid. , p. 266.
* 160 Le « paquet CRD4 », visant à transposer dans le droit européen les règles dites de « Bâle III », composé de la directive dite « CRD4 » (directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement) et du règlement européen dit « CRR » (Règlement UE n° 575/2013), a été adopté le 26 juin 2013 pour une entrée en vigueur au 1 er janvier 2014. Doit également être citée la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (directive « Ficod »).
Le « paquet CRD4 » et la directive « Ficod » ont été transposés en droit français dans le code monétaire et financier par l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, le décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 et le décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014.
Concernant les établissements d'assurance, c'est l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 et le décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 qui ont transposé la directive dite « Solvabilité II » (directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l`accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice).
* 161 Services de la Commission européenne, Rapport 2017 pour la France comprenant un bilan approfondi des mesures de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques , SWD(2017) 75 final, février 2017, p. 25.
* 162 Rapport d'information (n° 3936, session 2015-2016) de Jean-Claude Buisine, Jean-Pierre Gorges et Nicolas Sansu, op. cit. , p. 99.
* 163 Ibid. , p. 97.
* 164 L'enquête du Fonds monétaire international (FMI) Coordinated Portfolio Investment Survey ne différencie pas la dette privée de la dette publique et ses résultats doivent donc être interprétés avec précaution (v. infra ).
* 165 Société Générale, « Le financement de la dette des États : vecteur de (dés) intégration des pays de la zone euro ? », Econote , n° 13, 2013, p. 2.
* 166 Royaume-Uni, Suisse, pays scandinaves, Russie.
* 167 Ces données proviennent d'une collecte auprès des établissements teneurs de compte-titres et sont complétées par les échanges d'informations au sein de l'Eurosystème prévues par le règlement de la BCE sur les statistiques de détention de titres.
* 168 Et, depuis 2014, des émetteurs privés d'obligations comme le prévoit l'article 18 de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises : « Sauf clause contraire du contrat d'émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d'obligations, autre que les personnes morales de droit public, a la faculté de demander l'identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux alinéas précédents. »
* 169 Article 228-2 du code de commerce.
* 170 V. l'article 18 de l'ordonnance n° 2014-863 précitée.
* 171 Banque de France, « Émission et détention de titres de dette au 31 décembre 2016 », Stat Info , 13 avril 2017, p. 2.
* 172 A. Ando et F. Modigliani, « The 'life-cycle' hypothesis of saving: aggregate implications and tests », American Economic Review , vol. 53, n° 1,ý 1963, p. 55-84.
* 173 J.-B. Say, Traité d'économie politique , Paris, Guillaumin, 1841, p. 546.
* 174 D. Aschauer, « Is Public Expenditure Productive? », Journal of Monetary Economics , vol. 23, n° 2, 1989, p. 177-200, et A. Munnell, « How Does Public Infrastructure Affect Regional Economic Performance? » in A. Munnell (éd.), Is There a Shortfall in Public Capital Investment? , 1990.
* 175 V. J. Albala-Bertrand et E. Mamatzakis, « The Impact of Public Infrastructure on the Productivity of the Chilean Economy », Review of Development Economics , vol. 8, n° 2 2004, p. 266-278.
* 176 V. S. Scandizzo et P. Sanguinetti, « Infrastructure in Latin America: Achieving High Impact Management », Discussion Draft 2009 Latin America Emerging Markets Forum , 2009.
* 177 V. P. Aghion et É. Cohen, Éducation et croissance , Paris, Conseil d'analyse économique, 2004.
* 178 Les dépenses de recherche, dans le cadre de la nomenclature COFOG (v. supra ), comprennent celles consacrées à la recherche fondamentale ainsi qu'à la recherche dans les domaines de la défense, de la sécurité, des affaires économiques, de l'environnement, des équipements collectifs, de la santé, de la culture, de l'enseignement supérieur et de la protection sociale.
* 179 Il s'agit de l'« équivalence ricardienne », aussi appelée « effet Ricardo-Barro ». Dans un article de 1974, l'économiste américain Robert Barro estimait que toute augmentation de l'endettement public conduit les agents à épargner, et donc à consommer moins, afin de léguer à leurs héritiers un montant leur permettant de financer des augmentations d'impôts futurs. Par conséquent, toute dépense publique, à supposer même qu'elles doivent être remboursées dans le long terme, entraînerait une épargne équivalente des agents économiques, ce qui aboutirait à une réduction de la croissance économique. Sans pourtant que l'article de Robert Barro ne cite jamais l'économiste britannique David Ricardo, il est apparu qu'une analyse proche avait été formulée par ce dernier dès 1820, tendant à montrer qu'une augmentation des dépenses publiques du fait du déclenchement d'une guerre conduisait les agents économiques à anticiper une hausse à venir des impôts qui épargnaient à en conséquence (v. Robert Barro, « Are Government Bonds Net Wealth ? », Journal of Political Economy , vol. 82, n° 6, 1974, p. 1095-1117).
* 180 V. C. Reinhart et K. Rogoff, « Growth in a Time of Debt », NBER Working Paper 15639 , 2010.
* 181 V. par exemple, Y. S. Nersisyan et L. R. Wray, « Un excès de dette publique handicape-t-il réellement la croissance », Revue de l'OFCE , n° 116, 2011, p. 173-190.
* 182 A. Pescatori, D. Sandri et John Simon, « Debt and Growth: Is There a Magic Threshold? », IMF Working Paper WP/14/34 , 2014.
* 183 La Réserve fédérale a indiqué, dans sa déclaration relative à la réunion du comité du 3 mai 2017, que le ralentissement de la croissance américaine constaté lors du premier trimestre de l'année 2017 est considéré comme probablement provisoire et qu'elle maintient donc son intention de procéder à un nouveau relèvement de la cible des taux directeurs avant la fin de l'année si les conditions économiques le permettent.
* 184 D'après les chiffres pour 2015 publiés par l'Observatoire Finance Active en 2016, environ 40 % de l'encours de dette des collectivités territoriales serait libellé à taux variable.
* 185 Cour des comptes, op. cit. , 2016, p. 67.
* 186 Commission européenne, Debt Sustainability Monitor 2016 , janvier 2017.
* 187 Services de la Commission européenne, op. cit. , p. 25.
* 188 Ces simulations s'appuient sur un modèle propre à la commission des finances du Sénat, distinct de celui du Gouvernement dont les résultats sont présentés dans le projet annuel de performances de la mission « Engagements financiers de l'État ». Le modèle de la commission des finances du Sénat, tout comme celui du Gouvernement, lisse la charge d'intérêt sur l'intégralité de la durée de vie des titres émis après le choc et n'intègre donc pas d'éventuelles décotes à l'émission, ce qui nécessiterait de formuler des hypothèses difficiles à tester concernant la part des titres émis sur souches anciennes.
* 189 En revanche, comme cela a été souligné précédemment, en comptabilité nationale, les décotes sont étalées sur toute la durée de vie du titre : elles ne dégradent donc pas le déficit public.
* 190 É. Chantrel, C. Sutter, M. Lequien et A. Montaut, op. cit.
* 191 J. Elmeskov et K. Pichelmann, « Unemployment and Labour Force Participation: Trends and Cycles », OECD Economics Department Working Papers No. 13 , 1993.
* 192 O. Blanchard et L. Summers, « Hysteresis and the European Unemployment Problem », in S. Fischer (éd.), NBER Macroeconomics Annual , MIT Press, 1986, p. 15-90.
* 193 P. Aghion et G. Saint Paul, « Virtues of bad times: interaction between productivity growth and economic fluctuations », Macroeconomic Dynamics , vol. 2, n° 3, 1998, p. 322-344.
* 194 D. Comin et M. Gertler, « Medium-term business cycles », American Economic Review , vol. 96, n° 3, p. 523-551.
* 195 M. Lequien et D. Roucher, « Prix du pétrole et crise de la dette : quels effets sur la croissance en zone euro ? », Insee Analyses , n° 7, décembre 2012.
* 196 Insee, « Consolidations budgétaires : leur impact sur l'activité dans la zone euro en 2013 », Note de conjoncture de l'Insee , juin 2013, p. 109-110.
* 197 M. Lemoine et J. Pavot, « Les effets de la crise sur la croissance à long terme », Questions actuelles , n° 2, 2009.
* 198 D. Furceri et A. Mourougane, « The effect of financial crises on potential output: new empirical evidence from OECD countries », OECD Economics Department Working Papers No. 699 , 2009.
* 199 L. Ball, « Long-term Damage from the Great Recession in OECD Countries », Document de travail de l'Université John Hopkins , mai 2014.
* 200 Rapport d'information (n° 764, session 2015-2016) d'Albéric de Montgolfier, op. cit.
* 201 Insee, « En 2016, le PIB en volume augmente de 1,2 % », Informations rapides , n° 128, 16 mai 2017.
* 202 V. rapport économique, social et financier (RESF) annexé au projet de loi de finances pour 2016, p. 143.
* 203 Loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
* 204 Loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017.
* 205 Loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.
* 206 Commission européenne, « European Economic Forecast. Spring 2017 », Institutional Paper 53 , mai 2017.
* 207 Programme de stabilité 2017-2020, avril 2017, p. 41
* 208 V. rapport d'information (n° 292, session 2015-2016) d'Albéric de Montgolfier, op. cit.
* 209 V. Fonds monétaire international (FMI), Perspectives de l'économie mondiale. Nuages et incertitudes de l'après crise , 2014.
* 210 P. Ollivaud, Y. Guillemette et D. Turner, « Links between weak investment and the slowdown in productivity and potential output growth across the OECD », OECD Economics Department Working Papers , n° 1304, 2016.
* 211 Services de la Commission européenne, op. cit. , p. 30.
* 212 Id.
* 213 Rapport d'information (n° 113, session 2016-2017) d'Albéric de Montgolfier, op. cit. , p. 25.
* 214 Comme le souligne la Commission européenne, « l'imposition du capital est élevée en France en comparaison d'autres États membres et elle favorise les investissements peu risqués, comme dans l'immobilier résidentiel et les dépôt, au détriment d'investissements plus risqués, par exemple en actions. En 2014, le ratio des impôts sur le capital au PIB, de 10,5 %, était le troisième plus élevé de l'UE (8,2 %) » (Services de la Commission européenne, op. cit. , p. 31).
* 215 Le montant des économies à réaliser est évalué à partir du taux de progression tendancielle des dépenses publiques, estimé à 1,8 % en volume par le Gouvernement (v. rapport économique, social et financier (RESF) annexé au projet de loi de finances pour 2016, p. 143).
* 216 N. Lorach et A. Sode, « Quelle sélectivité dans la réduction des dépenses publiques ? », La Note d'analyse - France Stratégie , n° 28, 2015.
* 217 V. rapport d'information (n° 292, session 2015-2016) d'Albéric de Montgolfier, op. cit. , p. 44-46.
* 218 B. Brassens, D. Laval, P. Blanchard, R. Toussain, J.-F. Magana, M. Mesclon-Ravaud et F. Trassoudaine, Évaluation de la mise en place des Direccte , Paris, Inspection générale des finances, 2012.
* 219 Services de la Commission européenne, op. cit. , p. 26.
* 220 Article 5 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
* 221 Créé par l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à l'organisation de la sécurité sociale.
* 222 Article 11 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019.
* 223 T. Cordes, T. Kinda, P. Muthoora et A. Weber, « Expenditure Rules: Effective Tools for Sound Fiscal Policy? », IMF Working Paper , février 2015.
* 224 À titre d'exemple, l'article 50 de la loi de finances initiale pour 2017 prévoit ainsi que « pour 2017, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire ».
* 225 Article 4 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
* 226 T. Cordes, T. Kinda, P. Muthoora et A. Weber, op. cit. , p. 3 [traduction de la commission des finances].
* 227 Ibid. , p. 7.