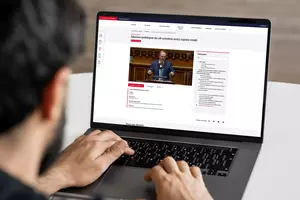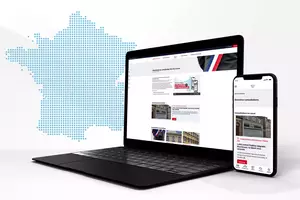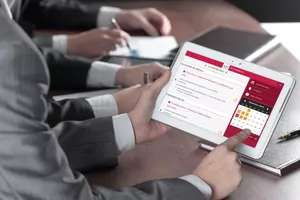M. Bruno Retailleau. Je n’ai jamais contesté le bouclier pendant la crise !
M. Bruno Le Maire, ministre. Je salue donc votre sollicitude pour tous ces secteurs d’activité, mais vous avouerez, monsieur le président Retailleau, que si elle est à votre honneur, elle est aussi à votre débit, ou à tout le moins à celui des comptes de la Nation.
Quoi qu’il en soit, je vous rejoins totalement quand vous déclarez que le pire de la politique, c’est la politique du pire, et que le choix fondamental, dans la situation actuelle, se joue entre laisser filer et rétablir, entre renouer avec nos vieux démons et essayer d’inventer un nouveau chemin.
Pour ma part, je propose que nous inventions, ensemble, ce nouveau chemin, celui d’une France capable de dépenser quand c’est nécessaire et d’économiser lorsque la situation s’est améliorée. Le covid-19 est derrière nous, l’inflation est derrière nous ! Nous avons réussi à maîtriser le covid-19, nous avons réussi à relancer l’économie ; nous devons en être fiers. Nous avons réussi à maîtriser en deux ans une crise inflationniste qui avait duré dix ans dans les années 1970 ; nous y sommes parvenus grâce à l’euro et à la protection qu’apporte la Banque centrale européenne. Eh bien, maintenant, rétablissons les comptes ! C’est le chemin que je vous propose.
Vous évoquez un déficit de travail : oui, c’est bien pour le résorber que nous avons réformé l’assurance chômage, les retraites et l’apprentissage. Le travail, le plein emploi, un taux d’activité plus élevé : voilà, bien entendu, la première réponse au déficit et à la dette, nous pouvons nous rejoindre sur ce point.
Vous invitez à mobiliser des ressources pour investir : vous avez raison également, c’est pourquoi nous proposons de mettre en place l’union des marchés de capitaux, afin que nos entreprises puissent grandir. Rejoignez-nous sur ce point aussi ; il me semble que nous avons suffisamment de points communs dans les choix stratégiques pour ne pas nous opposer sur des choix anecdotiques.
Monsieur Szczurek, vous faites de l’immigration la source de tous nos maux financiers. Hélas ! j’ai bien peur que toutes nos difficultés ne puissent être résolues par ce biais-là uniquement.
Monsieur Capo-Canellas, merci d’avoir salué l’efficacité d’Édouard Philippe dans le rétablissement des comptes publics. Je partage cette appréciation, d’autant que son ministre des finances était celui-là même qui occupe ce poste actuellement… (Sourires.)
Madame Senée, vous évoquez des cadeaux fiscaux qui auraient été faits aux entreprises. Je voudrais en la matière faire justice à notre politique fiscale et économique : il s’agit non pas de faire des cadeaux aux entreprises, mais tout simplement de leur permettre d’avoir la compétitivité nécessaire pour investir dans un monde qui ne fait pas de cadeaux !
Vous parlez de Renault ; mais si l’on veut que la nouvelle Renault 5 soit fabriquée à Douai plutôt qu’en Slovénie, en République tchèque, ou je ne sais où encore, il faut garantir à ce groupe des conditions de compétitivité satisfaisantes. C’est ce que nous faisons, et ce n’est nullement, comme vous l’affirmez, un comportement néolibéral et prédateur ; c’est tout simplement un comportement responsable et compétitif, pour que nos ouvriers gardent leurs emplois, dans nos villes et nos territoires.
M. François Patriat. Bravo !
M. Bruno Le Maire, ministre. Monsieur Bocquet, je veux vous rassurer : nous ne décidons pas seuls contre les oppositions. La qualité du débat que nous avons cet après-midi le prouve d’ailleurs ; je tiens à en remercier le Sénat. Ainsi, vous avez proposé une taxation des rachats d’actions ; le Premier ministre s’est montré ouvert à ce sujet.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Trois ans après !
M. Bruno Le Maire, ministre. Certes, mais ce n’est pas à vous, monsieur le président Raynal, que je vais apprendre qu’il faut forcer des portes en politique et que, parfois, la porte s’ouvre ! Tel est bien le cas ici : cette porte s’ouvre, de manière à garantir la justice fiscale à laquelle je sais que M. Bocquet est attaché.
Monsieur Daubet, vous nous invitez à mener un dialogue sincère avec la représentation nationale. Oui, bien sûr, c’est ce que nous faisons ! Merci d’avoir salué les fruits de notre politique de soutien à l’activité. Je remercie aussi Georges Patient de l’avoir relevé.
Madame Blatrix Contat, il faudrait selon vous augmenter massivement les impôts pour retrouver de la marge fiscale. Pour ma part, j’estime que les premiers qui doivent retrouver de la marge fiscale, ce sont nos compatriotes et certainement pas la puissance publique. Ceux qui travaillent doivent en avoir pour leur argent, ils doivent avoir le sentiment que tout ce qu’ils gagnent ne part pas dans des impôts ou des taxes. Rappelons qu’en France 10 % des contribuables paient 72 % de l’impôt sur le revenu ; il me semble qu’aller au-delà serait déraisonnable et injuste.
Enfin, monsieur Maurey, j’ai avant tout été heureux de voir un Eurois conclure ces interventions ! Je crois à l’atteinte de nos objectifs de déficit et de croissance, tout simplement parce que, les années passées, à l’exception des années de crise, nous les avons atteints. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. le président. Nous en avons fini avec le débat sur le programme de stabilité et l’orientation des finances publiques.
4
Planification écologique et COP régionales : quelle efficacité ?
Débat organisé à la demande du groupe Les Républicains
M. le président. L’ordre du jour appelle le débat, organisé à la demande du groupe Les Républicains, sur le thème : « Planification écologique et COP régionales : quelle efficacité ? »
Dans le débat, la parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour le groupe auteur de la demande.
M. Jean-Baptiste Blanc, pour le groupe Les Républicains. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, à la demande du groupe Les Républicains, nous nous penchons cet après-midi sur l’efficacité de la planification écologique et des COP régionales.
Une fois n’est pas coutume, commençons par un certain nombre de points, dont nous conviendrons, madame la ministre, qu’ils sont positifs.
Oui, le changement climatique rapide que nous vivons impose une évolution forte de notre économie, de notre agriculture, de nos partis pris d’aménagement du territoire, ainsi que de nos habitudes de vie et de consommation, sachant que le coût d’un changement climatique subi, sans réaction ni anticipation, serait colossal – jusqu’à 10 % du PIB en 2100 selon l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) –, sans compter les déstabilisations humaines et géopolitiques qui l’accompagneraient.
Oui, vous avez publié en septembre 2023 un document de planification nationale, qui offre une stratégie cohérente et une méthode générale indispensables face à ce défi.
Oui, enfin, certaines initiatives ou propositions récentes, même si nous en prenons un peu trop souvent connaissance au hasard des publications dans la presse, constituent des avancées intéressantes : je pense aux fonds d’indemnisation de la sécheresse de 2022 ou aux événements de retrait-gonflement des sols argileux (RGA), aux conclusions du rapport sur l’évolution de nos assurances en matière de catastrophes naturelles, aux réflexions qui semblent en cours sur le recul du trait de côte et enfin, bien évidemment, à la reprise de notre programme nucléaire.
Malheureusement, madame la ministre, la liste de ces satisfecit ne pourra guère être allongée davantage… En effet, ici comme ailleurs, le Gouvernement ne démord pas d’une démarche qui nous semble centralisatrice et bureaucratique, une approche sans doute d’un autre âge, d’autant que l’État n’en a pas, ou plus, les moyens ! Et c’est là, bien évidemment, que se pose la question de l’efficacité, c’est-à-dire de l’adéquation entre les objectifs posés et les résultats obtenus.
En effet, qui dit efficacité dit clarté sur les objectifs, sur le pilotage, sur les moyens et sur les méthodes. Nous craignons, madame la ministre, d’en être encore loin !
Efficacité sur les objectifs, disais-je en premier lieu : sauf erreur de ma part, le Parlement n’a jamais été saisi d’un texte cohérent et ordonné sur la planification écologique, c’est-à-dire sur les objectifs et les mesures envisagées en matière d’atténuation préventive du changement climatique, sur l’adaptation inévitable de notre pays à celui-ci, sur les énergies, sur la protection de nos paysages et de nos biodiversités, ou encore, entre tant de sujets, sur les évolutions nécessaires du traitement de nos déchets.
Il semblerait qu’il existe, ici ou là, sous forme de circulaires, de présentations PowerPoint – on n’en manque pas ! – ou de projets d’arrêté, un plan sur ceci, un schéma national sur cela, une stratégie générale sur le reste…le tout avec, bien entendu, les sigles et acronymes technocratiques qui vous passionnent : Pnacc3, SNB, PPE, Écophyto, SNBC… Force sigles, certes, mais aucune vision d’ensemble présentée à la représentation nationale !
Efficacité sur le pilotage, ensuite : là encore, comme trop souvent avec ce gouvernement, les pilotes, co-pilotes et presque-pilotes se croisent et s’entrecroisent : le Premier ministre et le secrétariat général à la planification écologique (SGPE), le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le commissariat général au développement durable (CGDD), le Haut-Commissariat au plan – dont on n’a toujours pas compris, même après un récent débat dans cet hémicycle, à quoi il servait –, les ministères de l’agriculture et de la santé, le Conseil national de la transition écologique, et vous-même madame la ministre… Mais qui fait quoi, en fin de compte, au sein de l’État central, sur ce sujet majeur ? Par ailleurs, n’oublions pas que beaucoup des domaines traités relèvent en réalité des compétences des collectivités locales.
Efficacité sur les moyens et les méthodes, enfin. Le constat est ici bien plus simple encore : en réalité, madame la ministre, vous n’avez aujourd’hui ni les moyens législatifs ni, a fortiori, les moyens financiers de mettre en œuvre la planification écologique nécessaire à notre pays. Pas de majorité, pas de loi… Il n’y a d’ailleurs pas d’accord au sein même de votre majorité relative sur un grand nombre de sujets touchant à la planification écologique.
Certes, nous connaissons tous le montant de la dette et du déficit. Il n’y a donc, de toute évidence, pas de moyens d’agir. Même les mesures ponctuelles les plus concrètes, comme l’aide à l’achat de véhicules électriques pour les Français les plus modestes ou le soutien à la rénovation des logements, ne trouvent plus de supports budgétaires à la dimension voulue. Vous êtes tout de même membre d’un gouvernement qui lance des mesures un 1er janvier pour les stopper net, du fait de caisses vides ou d’un imbroglio bureaucratique, dès le 15 février de la même année…
Quant à la méthode, le précédent du ZAN, le « zéro artificialisation nette » – il me faudrait quarante-cinq minutes pour traiter vraiment de ce sujet –, n’a visiblement pas servi de leçon : comme le Président de la République se refuse obstinément depuis 2017 à ouvrir une vraie négociation, en responsabilité, avec les collectivités locales, à conclure de vrais contrats d’engagement réciproque, vous vous retrouvez – nous nous retrouvons, sur le terrain – à devoir gérer tant bien que mal des « COP ».
Cet ersatz de dialogue commence par un tableau à la Mondrian – c’est très beau, bien entendu, mais on n’y voit que des chiffres tombés de Paris, censés éclairer les objectifs à atteindre localement. Il se poursuit avec des questionnaires dignes de Kafka, envoyés par mail à toutes les collectivités, et se terminera à coup sûr, comme vous le savez, par des demandes de contributions financières adressées aux collectivités sur des actions dont nous aurons à peine discuté et qui seront, en fait, sélectionnées à Paris.
En matière de planification écologique comme dans d’autres domaines, nous parlons de décentralisation et de responsabilités partagées quand vous parlez de « déclinaison » et de « mise en œuvre » locales.
En conclusion, madame la ministre, je voudrais vous adresser plusieurs questions relatives aux COP régionales et en particulier au ZAN, l’un des chapitres de la sobriété foncière. Sur ce point, ce sont les indicateurs de performance qui nous inquiètent, puisqu’il nous apparaît que l’État pourrait, en s’appuyant sur les régions, gouverner par le biais de ces intermédiaires : à ces dernières de veiller au respect parfait de ces indicateurs par les élus locaux. On est loin de la territorialisation que nous défendons ici sans relâche, car c’est à nos yeux la seule méthode qui permettrait d’atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette ! Nous aurons ce débat dans les prochaines semaines.
Mes questions sont simples, mais je conçois, madame la ministre, qu’elles puissent vous sembler délicates. Des réponses que vous leur apporterez dépend toutefois l’efficacité de notre adaptation nationale au changement climatique.
Premièrement, quand le Parlement sera-t-il enfin saisi, comme dans une démocratie normale, d’un texte complet, cohérent et précis traitant des différents sujets de la planification écologique – atténuation, adaptation, énergie, modes de production, déchets, agriculture, biodiversité – et détaillant nos objectifs et les contraintes et incitations nouvelles que le Gouvernement juge nécessaire d’instaurer pour les mettre en œuvre ?
Deuxièmement, quand le Parlement sera-t-il saisi d’une programmation financière claire et réaliste sur la planification écologique nécessaire à notre pays ? L’effort à accomplir est estimé à 100 milliards d’euros supplémentaires d’investissement chaque année pour les dix ans à venir. Combien mettra l’État, c’est-à-dire le contribuable ? Combien mettront nos entreprises, c’est-à-dire les consommateurs ? Combien mettront nos banques, c’est-à-dire nos épargnants ? Combien mettront nos collectivités locales, c’est-à-dire nous tous ? Ce débat sera douloureux, mais il est incontournable, et c’est au Parlement de statuer.
Troisièmement, à court terme, comment allons-nous financer, selon vous, les indemnités RGA, le rachat des biens touchés par le recul du trait de côte, et les mesures d’adaptation des services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) ou des bâtiments scolaires, sachant que le fameux fonds vert, déjà sollicité, mais en même temps raboté de toutes parts, ne représente qu’un volume très marginal de la réalité de terrain de ces sujets ?
Enfin, après les COP, quand engagerez-vous un vrai dialogue, une vraie négociation avec les collectivités locales sur un partage des objectifs, des priorités, des calendriers et des financements – bref, un dialogue moderne et normal dans une République décentralisée face à un enjeu national ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Dominique Faure, ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens tout d’abord à vous remercier de l’organisation de ce débat. La planification écologique et les COP régionales étant des sujets importants pour le Gouvernement, il est toujours bon de pouvoir les évoquer devant la représentation nationale.
Je vous demande de bien vouloir excuser le ministre Christophe Béchu, retenu à Turin par une réunion des ministres du G7 sur la transition écologique et énergétique.
Notre pays a traversé récemment des épisodes climatiques extrêmes, qui manifestent plus que jamais la réalité et l’intensité du dérèglement climatique que nous traversons. Du Pas-de-Calais aux Alpes-Maritimes, nos concitoyens et les élus locaux ont subi de plein fouet ses conséquences. Nous pouvons aujourd’hui avoir, ensemble, une pensée pour eux.
L’État est, bien sûr, à leurs côtés pour les aider à reconstruire, il est à leurs côtés pour les aider à adapter leur territoire à ce type d’événements, mais il est aussi pleinement engagé pour que nous puissions atteindre nos objectifs de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030 par rapport au niveau de 1990.
Cet engagement de baisse de nos émissions est fondamental pour préparer un avenir habitable, non pas pour les générations futures – nous n’en sommes plus là ! –, mais pour nous-mêmes et pour nos enfants. La bonne nouvelle est que nous avons fait la moitié du chemin. Le défi qui se présente à nous maintenant est de diminuer autant nos émissions en sept ans qu’en trente-trois ans.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je tiens, mesdames, messieurs les sénateurs, à vous rappeler l’origine de la démarche de planification écologique. Celle-ci est issue de la volonté du Président de la République, exprimée dans son discours de Marseille du 16 avril 2022. Elle est mise en œuvre depuis le mois de septembre 2023, par la Première ministre Élisabeth Borne, puis par le Premier ministre Gabriel Attal, en lien très étroit avec le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, et avec l’appui du secrétariat général à la planification écologique.
Grâce à cette démarche inédite dans le monde nous pourrons identifier tous les leviers qui nous permettront, secteur par secteur, de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre avec la bonne intensité.
Les COP régionales sont tout simplement la déclinaison territoriale de la planification écologique. Elles doivent permettre de mettre en œuvre de manière effective, dans les territoires, les objectifs que nous nous sommes donnés nationalement et sur lesquels la France s’est engagée internationalement.
Les COP régionales sont donc l’incarnation de la philosophie adoptée par le Gouvernement : une écologie proche des territoires, une écologie qui laisse aux acteurs du terrain la responsabilité d’identifier les leviers d’action et de s’organiser en conséquence – en somme, une écologie de cohérence.
Les COP sont une nouvelle façon d’organiser collectivement la transition écologique dans les territoires. Elles visent à créer un cadre commun qui permette un dialogue articulé entre les niveaux nationaux, régionaux, départementaux, intercommunaux et municipaux. Leur but est de faire émerger des actions qui relèvent des compétences des collectivités territoriales, mais aussi de valoriser les actions déjà engagées, car nous savons que les collectivités sont extrêmement actives en faveur de la transition écologique. L’objectif est que le territoire s’empare de la planification écologique.
Il s’agit, je le redis, d’un dispositif inédit : les COP, coanimées par le préfet de région et le président du conseil régional, permettent de faire discuter tous les échelons de nos collectivités et de les engager collectivement et localement.
Nous en attendons trois points de sortie : d’abord, un alignement des parties prenantes sur les objectifs de la planification écologique à l’échelle de la région ; ensuite, un état des lieux partagé du territoire sur les dynamiques en cours et les programmes déjà engagés ; enfin, un plan d’action cohérent et pragmatique qui tienne compte des initiatives prises par l’ensemble des collectivités et qui complète les actions éventuellement déjà engagées. En outre, tous les sujets ne pouvant pas être parfaitement traités en une seule fois et en un an, la liste des sujets à évoquer lors de la prochaine COP et les modalités de suivi devront en émerger.
J’ai évoqué le pourquoi et le comment ; permettez-moi désormais de vous faire un état des lieux du calendrier.
À l’heure actuelle, les COP ont été lancées dans toutes les régions, à l’exception de la Guyane et de Mayotte, avec des calendriers qui respecteront notre objectif de disposer de feuilles de routes d’ici à l’été prochain, ou juste après. Je me félicite que le calendrier de lancement ait préservé des temps de concertation en amont de la réunion des COP pour s’assurer de la bonne prise en compte des spécificités de chaque territoire.
Pour tenir ce calendrier, nous avons également déployé un accompagnement spécifique par les services de l’État, qui a pris plusieurs formes comme le recrutement de secrétaires généraux de COP dans chacune des régions concernées et la mise à disposition d’outils en support de la méthodologie.
Les résultats de la phase de diagnostic sont par ailleurs encourageants ; il est fait état d’une forte mobilisation des collectivités. Je crois que cela témoigne parfaitement de l’intérêt des élus pour la démarche. À ce jour, sept régions ont déjà clôturé le recueil des retours des collectivités pour leur phase de diagnostic, et plus de 70 % des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), conseils départementaux et conseils régionaux ont répondu.
Cette phase a permis à chaque territoire de disposer d’une vue concrète et structurée du type d’actions mises en œuvre ; on a ainsi embarqué les collectivités dans les COP en leur permettant d’exprimer leur point de vue, ou encore d’identifier les thématiques clés à mettre en débat.
Pour la suite du processus, chaque région a préparé sa phase de débat en associant toutes les parties prenantes. À ce jour, plus de 120 groupes de travail ont été mis en place dans toutes les régions, avec plus de 160 heures d’échanges. Ces débats ont été ouverts à tous les acteurs de la société civile, des professions agricoles aux associations de consommateurs, en passant par le personnel hospitalier, les associations de protection environnementale, les chambres consulaires ou encore les syndicats forestiers.
Ces débats se sont structurés autour des six thématiques de France Nation verte : mieux se loger, mieux se nourrir, mieux se déplacer, mieux consommer, mieux produire et mieux préserver et valoriser nos écosystèmes. Dans certaines régions, des groupes de travail transverses complémentaires ont également été mis en place pour traiter, par exemple, de l’adaptation au changement climatique ou encore des enjeux d’emploi et de santé.
À la suite de ces débats, l’État accompagnera la mise en place opérationnelle des feuilles de route au travers des contrats de relance et de transition écologique (CRTE). Ces contrats, cruciaux pour la réussite de la transition écologique, font l’objet d’une nouvelle circulaire, signée en avril dernier ; ils sont le cadre idéal pour mettre en œuvre les ambitions fixées par les COP à l’échelle de chaque bassin de vie. Les CRTE ont vocation à devenir le cadre de travail de droit commun entre l’État et les collectivités, sous la forme d’un contrat chapeau qui rassemble les programmes d’appui territorialisés comme Villages d’avenir, Territoires d’industrie ou encore Petites Villes de demain.
Je terminerai mon propos en rappelant, même si vous le savez déjà, que la mobilisation des collectivités est absolument essentielle à la réussite de la planification écologique. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
Débat interactif
M. le président. Nous allons maintenant procéder au débat interactif.
Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question et son éventuelle réplique.
Le Gouvernement dispose pour répondre d’une durée équivalente. Il aura la faculté, s’il le juge nécessaire, de répondre à la réplique pendant une minute supplémentaire. L’auteur de la question disposera alors à son tour du droit de répondre pendant une minute.
Madame la ministre, mes chers collègues, afin de ne pas retarder la tenue des questions d’actualité au Gouvernement, prévues à 17 heures 15, je demande à chaque orateur de bien vouloir respecter scrupuleusement son temps de parole et de faire autant que possible un effort de concision, qu’il s’agisse de la question, de la réponse, ou des éventuelles répliques.
Dans le débat interactif, la parole est à M. Fabien Genet. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Alain Duffourg applaudit également.)
M. Fabien Genet. Mon collègue Jean-Baptiste Blanc a très bien exposé notre soutien à une vraie feuille de route en matière de transition écologique, ainsi que nos réserves quant à la planification très verticale mise en place par votre gouvernement.
Concernant les COP régionales, je dois avouer que les réunions organisées par le préfet de Saône-et-Loire et le sous-préfet de Charolles ont eu le mérite d’informer le parlementaire que je suis de la stratégie du Gouvernement, puisqu’aucune présentation formelle n’en a été faite au Sénat et que notre Haute Assemblée attend toujours de pouvoir auditionner Antoine Pellion, secrétaire général à la planification écologique.
Cela étant dit, je souhaite vous faire part de plusieurs alertes sur les enjeux agricoles liés à cette démarche, dans sa dimension territoriale. En effet, il est essentiel de permettre à l’agriculture de prendre toute sa place dans l’atteinte des objectifs de décarbonation, de préservation de la biodiversité et de production d’énergies renouvelables.
À titre d’exemple, le secteur de l’élevage, très présent dans mon département de Saône-et-Loire, a déjà contribué, du fait de la décapitalisation à l’œuvre depuis plusieurs années, à une réduction des émissions de gaz à effet de serre correspondant à la moitié de l’objectif fixé.
Derrière ce qui pourrait sembler une bonne nouvelle se cache une vraie crainte. Chercher à décarboner le secteur de l’élevage par une réduction de la production sur notre territoire serait à coup sûr une grave erreur, car cela induirait une augmentation parallèle des importations de viandes.
Madame la ministre, quelle avancée pour le climat produiraient une diminution de notre souveraineté alimentaire, une délocalisation des émissions de gaz à effet de serre en dehors de nos frontières et une réduction de nos surfaces en prairies ?
La profession agricole mène actuellement un travail fin sur la gestion des troupeaux, l’alimentation des animaux, la diminution de la fertilisation azotée et la réduction des consommations d’énergie, qui est en mesure d’accélérer la voie de la décarbonation pour atteindre les objectifs de baisse d’émissions de gaz à effet de serre sans diminution du cheptel.
Par ailleurs, l’entretien des prairies et des haies joue un rôle fondamental dans la préservation de la biodiversité et les 13 millions d’hectares de prairies et parcours sur lesquels pâturent les bovins constituent des puits de carbone irremplaçables. L’élevage bovin français est non pas un problème, mais une solution pour l’environnement et le climat.
Madame la ministre, la territorialisation de la planification écologique permettra-t-elle de relever ce défi ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Dominique Faure, ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Monsieur le sénateur Genet, la réponse est oui ! Si nous n’en étions pas convaincus, je ne serais pas là, non plus que Christophe Béchu. La méthode est la bonne : elle est innovante et vise tout simplement à embarquer toutes les collectivités locales sur le sujet prégnant que vous évoquez.
La raison pour laquelle Christophe Béchu n’est pas venu vous présenter un projet de loi est simple : les textes sont déjà là. Cet engagement du Président de la République est porté par le SGPE ; nous le déclinons par un travail de concertation de six mois. Ici ou là, des sénateurs y ont été associés, ainsi que les associations d’élus, de manière à travailler ensemble à la mise en œuvre opérationnelle, dans les territoires, de ces objectifs nationaux.
J’en viens plus particulièrement à l’agriculture et à l’élevage, qui font l’objet de votre question. Les leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole permettront de réduire ses émissions directes de 18 % entre 2019 et 2030, ce qui représente un effort deux fois inférieur à l’objectif national, car la baisse des émissions agricoles est un processus qui prend beaucoup de temps.
Pour atteindre cet objectif, nous avons identifié trois leviers : premièrement, les changements de pratiques de fertilisation azotée, avec pour cible une baisse de 30 % de l’usage d’azote minéral entre 2020 et 2030 ; deuxièmement, la promotion de l’élevage durable, qui doit se faire en maintenant les effectifs bovins actuels, ceux-ci ayant déjà beaucoup baissé ; troisièmement, la décarbonation des bâtiments et machines agricoles, par exemple les serres.
S’y ajoutent les leviers d’augmentation de la capacité des sols à capturer le carbone, que ce soit par le développement de haies, le maintien des prairies ou le déploiement de pratiques de stockage.
Enfin, il faut mentionner les leviers de préservation de la biodiversité et de la santé, à savoir essentiellement le développement de l’agriculture biologique et la réduction de l’usage de produits phytosanitaires.
On pourrait débattre plus longuement de ces questions, mais le temps nous est compté et je pense avoir fourni quelques éléments de réponse à votre question.