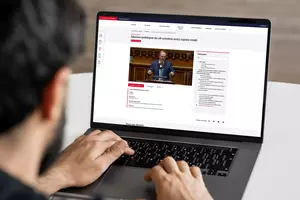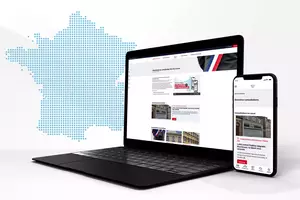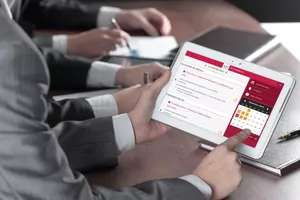- Mercredi 15 mai 2024
- Résilience des réseaux face aux aléas climatiques - Audition de MM. Hervé Champenois, Directeur technique d'Enedis, Charles-Antoine Gautier, Directeur général de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), Maurice Gironcel, Président du Syndicat Intercommunal d'Électricité (Sidélec) du Département de La Réunion, Antoine Jourdain, Directeur Systèmes Énergétiques Insulaires d'Électricité de France (EDF)
- « Transports pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : quels enjeux ? » - Audition de M. Patrice Vergriete, ministre délégué chargé des transports, et de Mme Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, présidente d'Île-de-France Mobilités
Mercredi 15 mai 2024
- Présidence de M. Jean-François Longeot, président -
La réunion est ouverte à 9 heures.
Résilience des réseaux face aux aléas climatiques - Audition de MM. Hervé Champenois, Directeur technique d'Enedis, Charles-Antoine Gautier, Directeur général de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), Maurice Gironcel, Président du Syndicat Intercommunal d'Électricité (Sidélec) du Département de La Réunion, Antoine Jourdain, Directeur Systèmes Énergétiques Insulaires d'Électricité de France (EDF)
M. Jean-François Longeot, président. - Mes chers collègues, la récente tempête en Bretagne et en Normandie, le cyclone Belal à la Réunion, les inondations dans le Nord de la France, mais également les nombreux incendies des étés passés ont montré combien les réseaux électriques et numériques sont vulnérables face aux aléas naturels, de plus en plus nombreux et intenses du fait du réchauffement climatique.
Cette problématique éprouvée par les sénateurs des territoires hexagonaux et ultramarins que nous sommes justifiait pleinement l'organisation d'une matinée consacrée à la résilience des réseaux électriques et numériques. Je remercie Audrey Bélim, sénatrice de la Réunion, qui nous a tout particulièrement sensibilisés à cette question et a souhaité que cette table ronde tienne compte de la spécificité des territoires ultramarins qui sont, à bien des égards, aux avant-postes de l'adaptation au changement climatique. Nous avons donc le plaisir de recevoir ce matin Hervé Champenois, directeur technique chez Enedis et Antoine Jourdain, directeur système énergétique insulaire chez EDF. Je rappelle qu'EDF est gestionnaire des réseaux d'électricité dans les zones non interconnectées. Votre présence nous permettra de faire un focus sur ces territoires si spécifiques. Nous accueillons également Charles-Antoine Gautier, Directeur général de la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies. Je remercie enfin Maurice Gironcel, président du syndicat intercommunal d'électricité du département de la Réunion, pour sa présence. Nous évoquerons avec lui le cas du cyclone Belal, qui a engendré des perturbations majeures sur les réseaux, notamment électriques et numériques.
Avant de vous laisser la parole pour un propos luminaire, je souhaiterais rappeler quelques éléments du contexte issus de publications récentes sur la problématique qui nous réunit ce matin. Un premier constat issu d'un rapport de France Stratégie de 2020 : la dépendance entre les différents types de réseaux accroît d'autant plus leur vulnérabilité. Or les actions d'adaptation mises en oeuvre, principalement de manière sectorielle, ne permettent pas pleinement de prendre en compte ces interdépendances, d'où la proposition de France Stratégie de définir une feuille de route commune à l'ensemble des réseaux. Un deuxième constat est issu du rapport public annuel de la Cour des comptes de 2024 : les gestionnaires de réseaux doivent prendre en compte les conditions climatiques à des horizons de temps plus éloignés que ceux aujourd'hui retenus dans le cadre des plans d'investissement. Concernant les réseaux électriques, la durée de vie moyenne des ouvrages pouvant aller jusqu'à 80 ans, voire plus, un équipement nouvellement mis en service devra être en état de fonctionner dans des conditions climatiques de 2100 et au-delà. La Cour des comptes estime donc que l'État devra veiller à la prise en compte adaptée de ces enjeux dans les investissements futurs à travers les contrats de service public.
La résilience des réseaux impliquera des enjeux financiers massifs. Une étude publiée par la Banque des Territoires et InfraNum en juillet 2023, consacrée à la fibre optique a estimé que des investissements compris entre 7 et 17 milliards d'euros sont nécessaires. Ces différents enjeux (prise en compte de l'interdépendance des réseaux, planification à des échelles de temps très longues, mobilisation des moyens financiers importants) sont-ils d'ores et déjà intégrés dans vos stratégies nationales et territoriales ?
M. Hervé Champenois, directeur technique d'Enedis. - Bonjour à tous. J'ai succédé à Antoine Jourdain, qui est aujourd'hui parmi nous en tant que directeur des systèmes énergétiques insulaires d'EDF, qui avait initié chez Enedis des travaux sur les investissements, ce qui me permet d'insister sur notre nécessaire vision de long terme sur les investissements et en particulier sur la résilience des réseaux.
Notre stratégie de résilience des réseaux s'inscrit dans notre stratégie d'investissement à 2040, qui donne une trajectoire d'investissement à 96 milliards d'euros. Ces investissements portent sur le raccordement des consommateurs aux énergies renouvelables, l'adaptation de l'infrastructure à toutes ces évolutions de consommation et de production. Plus d'un quart de ces investissements - soit 25 milliards d'euros - sont directement fléchés vers la résilience des réseaux.
Enedis couvre 95 % du territoire avec des réseaux que les collectivités nous ont confiés et que nous faisons vivre au travers de cahiers de concession. Cela représente 1,4 million de kilomètres de câbles, 17 000 kilomètres de réseaux construits chaque année pour des extensions ou renouvellement. Cela représente 2 200 postes sources et 820 000 postes de distribution publics dans chaque quartier, ainsi que 37 millions de compteurs Linky et une croissance extrêmement importante des énergies renouvelables. Le développement du réseau s'inscrit tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales chez Enedis.
En ce qui concerne la résilience des réseaux, les risques arrivent de toute part. Il s'agit des vents et des tempêtes pour le territoire métropolitain continental, avec un risque d'incendie qui s'accroît pour nos ouvrages, des risques de crues et d'inondations en augmentation et un risque de canicule extrêmement important. La probabilité de neige collante est le seul risque qui baisse et, parfois, les réponses à un risque ne sont pas les mêmes qu'à un autre risque. Par exemple, un réseau aérien est extrêmement précieux face aux crues et inondations, alors qu'il sera beaucoup plus sensible aux tempêtes. Nous avons bâti toute notre stratégie d'investissement autour de cette approche de risque établie avec des spécialistes.
Pour répondre à tous ces risques, nous investissons localement et discutons avec nos autorités concédantes, avec les collectivités locales. Le réseau de Bretagne n'est pas celui des Alpes et donc il nous faut adapter les investissements à chaque situation. Cela se décompose en cinq grands programmes. Tout d'abord, le plan aléa climatique, c'est-à-dire un enfouissement des réseaux, correspond à des actions ciblées dans les zones à risques climatiques avérés, notamment dans des zones boisées. Un enfouissement généralisé représenterait des milliards d'euros si on le menait sur l'ensemble des lignes. Par ailleurs, nous procédons à une montée en puissance de la rénovation programmée qui est nécessaire sur nos 1,4 million de kilomètres de lignes. Cette rénovation programmée, qui consiste à remettre les lignes à neuf, est un axe important. Nous constatons sept à huit fois moins de défauts sur les lignes rénovées que sur les lignes anciennes avant intervention. Cette démarche avait été lancée par Antoine Jourdain. Ensuite, nous allons vers une résorption progressive des câbles papier imprégné dans les zones urbaines denses. Ces câbles sont susceptibles de provoquer des incendies en période de fortes chaleurs. Or, l'an dernier, nous avons connu la période la plus chaude sur le territoire ; il y a deux ans, nous avons connu la période de chaleurs élevées la plus intense et la plus longue. Par ailleurs, nous visons, sur les lignes basse tension, la quasi-éradication des fils nus qui sont très sensibles aux aléas climatiques. Nous faisons l'effort de passer à des câbles torsadés, car ce sont des technologies qui sont très fiables et très faciles à réparer. Enfin, toujours sur les lignes basse tension, le câble papier présente une sensibilité, à l'inverse, au cours de l'hiver. Il nous faut donc les remplacer.
Voilà nos cinq programmes, qui représentent, sur la durée que je vous ai citée, près de 25 milliards d'euros jusqu'en 2040.
Nous devons également nous doter d'une organisation, d'une réactivité en cas d'événement : la « force d'intervention rapide électricité » (FIRE), qui nous permet d'intervenir dans les meilleurs délais, au plus près de l'événement. En cas de grosse tempête, la proximité avec les élus est extrêmement importante.
M. Antoine Jourdain, directeur Systèmes Énergétiques Insulaires d'Électricité de France (EDF). - Merci, Monsieur le Président. EDF Systèmes Énergétiques Insulaires d'Électricité (SEI) couvre les territoires de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, de la Guyane, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Corse et des îles du Ponant (Ouessant, Molène, Ile de Sein, Chausey...).
SEI a tendance à s'inspirer très fortement des politiques menées par Enedis. Mon prédécesseur à SEI était également mon prédécesseur à Enedis, ce qui permet une continuité sur les politiques techniques menées sur nos réseaux.
Nous nous inscrivons sur du temps long. Le réseau qu'on pose maintenant sera toujours en service en 2100. Une vision de long terme est donc nécessaire, ainsi qu'une prévision des évolutions liées au réchauffement climatique. SEI représente 40 000 kilomètres de réseau. SEI gère également le réseau de transport - de haute tension - contrairement à Enedis. SEI gère également l'équilibre système. Sur nos petits systèmes, il est d'autant plus important de réfléchir à la résilience des réseaux. Si une ligne est en défaut près d'une centrale, cela peut conduire à couper l'électricité pour un grand nombre de personnes. Réciproquement, le réseau doit être en mesure de reprendre la charge d'autres centrales en cas d'interruption d'une centrale. En somme, sur un petit système, l'interaction entre le réseau et la production est beaucoup plus ténue.
Avec notre programme de lignes haute tension, nous nous assurons que notre réseau est bien maintenu et permet de tenir les cyclones de catégorie 3. Nous déployons également un programme d'investissement sur les réseaux de moyenne tension et de basse tension, soit environ 250 millions d'euros d'investissements par an. 64 % de notre réseau moyenne tension est d'ores et déjà enfoui sur l'ensemble des îles. Comme Enedis, nous faisons à la fois du préventif et de la maintenance sur les réseaux, d'une part, du curatif avec des équipes qui sont prêtes à intervenir, d'autre part. Dans le cas de la tempête Belal, nous avons reçu le soutien des équipes d'Enedis.
Sur le long terme, nous avons également réalisé des analyses sur l'évolution du changement climatique. Les analyses sont différentes de celles d'Enedis, car nous ne sommes pas sur les mêmes parties du territoire. Les pluies intenses, les orages intenses, avec des glissements de terrain, sont appelés à augmenter, ainsi que les submersions marines. Nous n'anticipons pas plus de cyclones à l'avenir sur nos zones, mais ces cyclones risquent d'être un peu plus forts (ils pourraient passer en catégorie 4 ou en catégorie 5), en particulier dans les Antilles. Dans ces cas-là, nous avons construit un plan pour consolider nos réseaux haute tension, pour agir très rapidement et réparer très rapidement nos pylônes s'ils sont impactés. En ce qui concerne les températures, nous constatons nous aussi une montée des températures, mais comme nous opérons dans des climats très chauds, cela n'aura pas d'impact particulier sur la construction de nos différentes lignes.
Notre réseau SEI est complètement mobilisé pour être résilient dans les prochaines années. Nous continuons nos plans d'enfouissement et nos programmes de maintenance, avec bien entendu des activités d'élagage.
M. Charles-Antoine Gautier, directeur général de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). - Pour nous, l'électricité est un bien de première nécessité. Sans électricité, il n'y a plus d'eau, plus de gaz et plus de communications électroniques. La FNCCR gère l'ensemble des services publics de première nécessité que je viens de citer. Il y a une exigence de nos concitoyens pour que la qualité de l'électricité soit au rendez-vous, quel que soit le territoire, notamment les zones rurales. Nous constatons aussi un intérêt des territoires pour ces problématiques, qui conditionnent l'implantation des entreprises locales.
Nous voulions insister sur le nouveau cadre contractuel, avec Enedis et EDF SEI, qui constitue un cadre modernisé pour un service public de qualité. Ce nouveau cadre contractuel prévoit une nouvelle gouvernance des investissements, avec un schéma d'investissement de long terme sur la durée des contrats, typiquement pour une durée de trente ans, et une programmation pluriannuelle des investissements de quatre à cinq ans. Ces engagements d'investissement conjoints entre le gestionnaire de réseau et les autorités concédantes organisatrices de ce service public de l'électricité portent sur plusieurs items, notamment les investissements liés à la qualité, aux enfouissements de réseau et aux zones de qualité à renforcer. Sur ces zones de qualité à renforcer, plusieurs points doivent être mis en exergue, notamment par rapport aux durées de coupure et aux ambitions sur les territoires pour atteindre un niveau de qualité suffisant. Nous rappelons que les réseaux publics de distribution sont des propriétés des collectivités. Il s'agit de la véritable colonne vertébrale pour la transition énergétique et l'intégration des énergies renouvelables. Les sites d'injections décentralisés favorisent un développement de l'autoconsommation et des boucles locales qui peuvent améliorer la résilience des réseaux.
Comment agir face à ces aléas climatiques ? Plusieurs axes principaux peuvent être distingués. Tout d'abord, au moment des études, il est important de se pencher sur le dimensionnement des câbles et la sécurisation mécanique des lignes. Nous pouvons également entreprendre des actions d'exploitation, pour améliorer la digitalisation et le recours à l'intelligence artificielle des capteurs, afin d'améliorer la réactivité. En ce qui concerne les infrastructures, nous pouvons envisager la mise en place de plus en plus de bouclages. Certains réseaux sont en antenne, ce qui peut engendrer des problématiques particulières. Il faut également revenir sur le renouvellement de certains câbles souterrains, en papier imprégné. Ces engagements forts se retrouvent également dans le cadre contractuel entre les autorités concédantes et les gestionnaires de réseaux. Nos élus ont demandé d'enterrer davantage les lignes, compte tenu du fait que le territoire français est particulièrement boisé : nous souhaitons passer de 50 % d'enfouissement des réseaux aujourd'hui à 70 % sur les zones les plus impactées (zones boisées, zones littorales...).
La FNCCR continue également à s'investir et à travailler collectivement avec les gestionnaires de réseaux, en métropole ou dans les territoires ultramarins, sur les fils nus. Il s'agit en effet des zones les plus incidentogènes. À ce titre, nous portons une ambition avec Enedis et EDF SEI pour résorber la quasi-totalité de ces lignes à l'horizon 2035-2040.
Nous souhaitons insister sur le fait que les fonds, notamment le fonds vert ou le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale (Facé), pourraient être davantage utilisés. Le tarif d'utilisation public des réseaux d'électricité (Turpe), dont le nouveau montant est en cours de consultation, va également devoir être massivement mobilisé dans les années à venir : je rappelle que 96 milliards d'investissements sont prévus dans le réseau de distribution d'ici 2040.
Nous souhaitions rappeler au cours de cette audition l'importance du rôle des syndicats d'énergie aux côtés des gestionnaires de réseaux, EDF SEI, Enedis ou les entreprises locales de distribution (ELD), ainsi que le rôle des deux principaux maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire le gestionnaire de réseaux sur une grande partie du territoire, mais aussi les autorités organisatrices de la distribution d'électricité sur les zones rurales. Il faut en effet faire en sorte que les financements soient aussi au rendez-vous.
Notre Fédération se mobilise pour demander une enveloppe supplémentaire, notamment dans le cadre du Facé, qui n'a pas évolué depuis 2012, ni en termes d'indexation ni en termes de programmation.
Il faut également réviser le programme dédié à la sécurisation des réseaux. En la matière, un effort a été fourni, puisque 25 millions d'euros ont été mis sur la table pour investir dans les réseaux exposés aux tempêtes, notamment de l'ouest de l'Hexagone, mais ils ont été pris sur l'enveloppe existante, il ne s'agit pas de crédits supplémentaires. Nous souhaiterions donc aller plus loin et disposer de programmes spécifiques. À ce titre, nous avons réalisé des estimations des conséquences des tempêtes dans le Grand Ouest. Les premières estimations de nos adhérents de ces territoires font état de 9 millions d'euros pour le seul Finistère en 2024 et de 35 millions d'euros sur une période de quatre ans pour sécuriser ces réseaux. Il semble donc primordial d'augmenter ce programme au-delà de l'enveloppe qui est prévue. Les premières estimations chiffrées des territoires font état de besoins s'élevant à 60 millions d'euros supplémentaires.
Les demandes des élus de la FNCCR suite aux dernières tempêtes étaient plutôt adressées aux gestionnaires de réseau. Il s'agissait de recenser conjointement les points faibles du réseau, par la réalisation de diagnostics. Nous avions demandé également d'investir 10 milliards d'euros en cinq ans pour continuer à enfouir les réseaux, ce qui a été fait, mais un rythme peut-être plus élevé serait souhaitable. Nous avons demandé de conforter le rôle des collectivités dans l'engagement en termes d'investissement conjoint sur les territoires et sur les réseaux, et d'améliorer le dispositif de gestion de crise. À cet endroit, je souligne la qualité des échanges dans la gestion de la crise dans le cadre de la FIRE et notamment le nécessaire lien d'information continue entre les élus et les gestionnaires de réseaux, en amélioration significative depuis les dernières tempêtes. Il faut enfin affecter davantage le Turpe, aux investissements et en particulier aux investissements de sécurisation.
Nous avons conscience de la nécessité de disposer d'un réseau public d'électricité de qualité. Sans électricité, il n'y a pas de communication électronique : nous attirons votre attention sur cette interdépendance entre réseaux électriques et numériques. Nous devons avancer collectivement sur ce sujet. Un autre point pourrait être porté à votre attention : l'arrêté relatif au niveau de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité s'applique aux seuls territoires insulaires. Cet arrêté date pourtant de 2007.
M. Maurice Gironcel, président du Syndicat Intercommunal d'Électricité (Sidélec) du Département de La Réunion. - Merci de m'avoir invité à cette réunion de travail sur les problématiques d'énergie dans les zones non interconnectées.
Je suis le président du syndicat d'électricité de la Réunion et maire de la commune de Sainte-Suzanne, qui compte 25 000 habitants et qui est située dans le nord de la Réunion. Je préside également la communauté d'agglomération de la Cinor, qui regroupe 215 000 habitants.
Le problème de l'énergie est très important dans les zones non interconnectées, d'autant qu'il nous sera toujours impossible de nous connecter à un réseau continental. C'est la raison pour laquelle nous devons mener une réflexion particulière.
D'après le programme européen Copernicus concernant le réchauffement climatique, l'année 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée. Les territoires ultramarins sont les « sentinelles du réchauffement climatique ». Pour la France, les années 2022 et 2023 ont été les plus chaudes depuis 1850. Pour faire face aux conséquences du changement climatique, le sujet de l'adaptation et de l'atténuation est par nature planétaire. Il concerne toutes les parties : les pouvoirs publics, les scientifiques, les acteurs économiques, le mouvement associatif et les citoyens. Nous sommes tous concernés, parce que nul n'est à l'abri. Grâce à la recherche, nous savons que les événements climatiques seront de plus en plus intenses, violents et d'ampleur. Aucun point du globe n'est épargné. Les impacts du réchauffement climatique sont multiples. On peut notamment évoquer les impacts sur la biodiversité ; je rappelle que 85 % de la biodiversité française se trouve dans les territoires ultramarins.
Les coûts des dégâts sur les infrastructures liés aux inondations, aux incendies, aux tempêtes et bien sûr aux cyclones sont considérables. Lors du dernier cyclone à la Réunion, les assureurs ont évalué le coût des dégâts à plus de 100 millions d'euros. À cela, il faut ajouter 33 millions d'euros pour le monde agricole, dans une île où 36 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. D'une manière générale, nos îles, et la Guyane également, sont en première ligne du réchauffement climatique. C'est pourquoi je souscris pleinement et entièrement aux recommandations de la Cour des comptes qui, dans son rapport public annuel 2024, appelle à faire du dérèglement climatique une priorité dans les politiques publiques. Tous les secteurs sont concernés : l'habitat, l'aménagement du territoire, les mobilités, l'environnement, la santé et, bien évidemment, les réseaux comme celui du transport et de la distribution de l'électricité.
Le réseau public de transport et de distribution de l'électricité dans les zones non interconnectées est situé dans un environnement tropical avec trois caractéristiques majeures : de fortes températures, une hygrométrie et une salinité importantes. Cette situation accélère le vieillissement des réseaux. Nous devons donc anticiper. Il faut coconstruire, avec l'État et toutes les forces vives, un projet global, durable et solidaire pour répondre aux urgences sociales, économiques, écologiques et préparer la Réunion au passage à 1 million d'habitants. Nous sommes aujourd'hui 870 000 habitants et atteindrons le million d'habitants dans une génération ou deux.
Dans ce projet global, la question énergétique est centrale et fondamentale. Aussi, nous devons disposer d'un réseau fiable, robuste et flexible pour offrir à nos populations un service public de l'électricité de qualité partout, pour tous et tout le temps sur l'ensemble de nos territoires. Cela signifie notamment la nécessité d'adapter le réseau aux nouveaux usages liés à l'électromobilité, à l'accueil des productions d'énergie renouvelable et au changement climatique. Les enjeux permettant de renforcer la résilience du réseau sont identifiés : renouvellement des ouvrages, amélioration des délais de raccordement, qualité d'alimentation pérenne, enfouissement du réseau. À l'occasion de Belal, nous avons pu constater que le réseau haute tension était important. Il faut donc le sécuriser au maximum pour minimiser le nombre de coupures.
Il faut aussi prévoir un grand plan d'élagage, en sensibilisant la population, parce que souvent, l'élagage concerne aussi le particulier. Ce grand plan d'élagage concerne ainsi l'espace public et l'espace privé.
Avec la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, nous portons des préconisations de travail. Je pourrai y revenir dans la suite de cette table ronde.
Mme Audrey Bélim. - Le passage du cyclone Belal à La Réunion en janvier dernier a touché 150 000 foyers qui ont été privés d'électricité, soit 35 % des abonnés. Une semaine après ce passage, quasiment 10 000 abonnés étaient toujours privés d'électricité. La question unanime soulevée par de nombreux élus locaux était de savoir pourquoi les fils électriques, ceux de la téléphonie et également ceux d'Internet, n'étaient pas enfouis, alors que notre île est une terre de cyclones. Ce sujet n'est pas uniquement ultramarin. La même problématique se pose également dans l'hexagone. Suite au passage de la tempête Ciaran en novembre dernier, 1,2 million de foyers étaient privés de courant. Le dérèglement climatique va conduire à la multiplication de ces événements exceptionnels, voire hors normes. Ce qui nous lie entre territoires hexagonaux et ultramarins, c'est cette exposition aux risques et aux événements climatiques exceptionnels que nous subissons. Si nous sommes réunis ce matin, c'est pour mettre au coeur de nos réflexions ces territoires particuliers qui connaissent régulièrement des situations exceptionnelles. Ces situations exceptionnelles, finalement, n'en sont pas, de par notre localisation, de par notre géographie ou encore de par notre climat. Or au niveau national, la France affiche un retard significatif par rapport à ses voisins européens. 50 % du réseau électrique est enfoui dans notre pays, contre 63 % du réseau britannique ou encore 70 % du réseau allemand. Les territoires les plus touchés sont les territoires ruraux, alors qu'en ville, les lignes sont majoritairement enfouies. Il s'agit donc bien d'un véritable enjeu d'aménagement du territoire.
Il ne sera pas possible d'enfouir l'ensemble du réseau aérien au niveau national en raison d'impossibilités techniques pour des sites exposés au risque de glissement de terrain, par exemple. Cependant, des marges de progression existent. Existe-t-il une cartographie territoire par territoire ? Avez-vous la possibilité de nous indiquer le pourcentage de réseaux électriques qui pourraient être techniquement enfouis, en les priorisant sur le moyen terme et sur le long terme ? Cela pose également la question des financements. Depuis 2018, le montant des crédits ouverts en loi de finances sur le compte d'affectation spécial dédié au Facé est stable à 360 millions d'euros. Or depuis septembre 2022, la Cour des comptes souligne que les crédits affectés au Facé sont insuffisants. Alors que nous allons examiner le PLF 202 5à l'automne, les crédits du Facé sont-ils, selon vous, à la hauteur des enjeux ? Les autorités organisatrices de la distribution d'électricité, comme le Sidéléc, peuvent-elles, par exemple, être éligibles au fonds vert ? Enfin, les investissements que représenterait l'enfouissement des lignes sont significatifs. Cependant, des économies seront réalisées sur le long terme. En effet, le coût d'exploitation d'une ligne souterraine est quatre à cinq fois moins élevé que celui d'une ligne aérienne, d'une part, et la durée de vie des installations est améliorée en passant de 40 à 60 années, d'autre part. Pour réaliser des économies d'échelle, la coordination des gestionnaires de réseaux d'électricité, Internet et de téléphonie est indispensable, en lien avec les collectivités. Des instances de coordination locale vous semblent-elles pertinentes ?
M. Antoine Jourdain, directeur Systèmes Énergétiques Insulaires d'Électricité de France (EDF). - En ce qui concerne l'enfouissement des réseaux, pour nos territoires ultramarins, les réseaux sont plus enfouis que sur les territoires de l'Hexagone. Un effort a été fourni et continue d'être fourni pour enfouir progressivement. Cependant, les réseaux enfouis sont très incidentogènes également. Un nouveau câble souterrain en moyenne tension peut rester en l'état 60 ou 80 ans dans l'hexagone, contre 20 ans seulement dans nos territoires ultramarins. Cela montre un véritable problème de qualité de pose et de vieillissement de nos ouvrages, qui n'est pas lié à la technique ou au matériel. Or un réseau souterrain est beaucoup plus complexe et plus long à réparer. Bien entendu, effectivement, lorsque le réseau est enfoui, il pose moins de problèmes en cas de grand vent. Cependant, il pose problème lors d'inondations ou de glissements de terrain. Notre réseau souterrain actuel pose également problème en termes de maintenance au quotidien, notamment à la Martinique.
Les contrats de concession sont de très bons outils. Nous avons négocié avec la Réunion et la Guadeloupe deux contrats de concession, pour avoir une vision à 30 ans de ce que nous devons faire sur le réseau. Chaque année, nous partageons, avec les élus de la FNCCR, les points fragiles et les difficultés identifiées sur le terrain. L'outil pour planifier l'amélioration du réseau de manière concertée est le contrat de concession, qui a été renouvelé à La Réunion et en Guadeloupe et pour lequel nous sommes en négociation à la Martinique et en Guyane.
En ce qui concerne la coordination des réseaux, ce souci est permanent. Des plans de sécurisation doivent ainsi être mis en place et l'amélioration de la coordination entre les opérateurs doit être poursuivie. Cela permettrait de nous assurer que des points de communication puissent être maintenus plus longtemps. En nous coordonnant mieux, nous serions plus efficaces à tout point de vue.
Normalement, la cartographie est en open data. Donc elle est disponible pour tous.
M. Hervé Champenois, directeur technique d'Enedis. - Dans mon propos liminaire, je citais le montant à horizon 2040 de 25 milliards d'euros relatif à la résilience et au réseau. La plus grosse part de ce montant correspond au plan aléa climatique sur la moyenne de tension, c'est-à-dire à l'enfouissement (5 milliards d'euros). Malheureusement, comme vient de le dire Antoine Jourdain, il n'y a pas de solution miracle. Il convient de définir un équilibre de solutions entre l'aérien et le souterrain. Il est important de discuter localement, avec l'autorité concédante, dans le cadre des schémas directeurs et des plans pluriannuels d'investissements. Ce dialogue est essentiel. Les grands plans nationaux donnent des directives et grandes enveloppes, mais localement, les situations nécessitent des discussions.
Il faut insister sur l'interdépendance des réseaux. Sans moyens de télécommunications, nous ne savons plus exploiter le réseau. Lorsque nos agents interviennent sur le terrain, nous communiquons avec eux par un réseau télécom. L'interdépendance est extrêmement importante.
M. Patrick Chaize. - Il est très inquiétant que nous ne puissions pas nous doter d'une vision partagée sur le sujet de l'interdépendance des réseaux. Le réseau de communication électronique est la colonne vertébrale de l'ensemble des réseaux, mais cette colonne vertébrale est dépendante du réseau d'alimentation en énergie électrique.
Concernant les réseaux de communication, nous allons arrêter le réseau cuivre qui présentait la qualité d'être autoalimenté. Cet arrêt va donc fragiliser encore davantage le réseau de communication électronique.
Nous devons donc bâtir un véritable plan de résilience inter-réseaux à l'échelle nationale. Il faut mener une analyse territoriale des risques et des solutions à mettre en oeuvre. L'enfouissement ne constitue ainsi pas la solution à tout. D'autres solutions pourraient être mises en oeuvre, notamment installer des piles dans les box de téléphonie, afin que celles-ci puissent être opérationnelles en cas de besoin.
La consolidation du Facé est importante, notamment pour la résilience des territoires ruraux. Il faut aussi mettre en place le fonds de péréquation du numérique, créé au Sénat en 2009 sans jamais avoir été abondé, alors qu'il aurait de la pertinence.
M. Charles-Antoine Gautier, directeur général de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). - Nous nous mobilisons avec des remontées de parlementaires vers les ministres Béchu et Lescure. Plus d'une quarantaine de courriers ont été transmis dans ce sens pour essayer de redynamiser cette enveloppe, tant sur la partie « sécurisation tempêtes », que j'ai abordée dans mon propos introductif, que sur la partie générale. L'enveloppe du Facé n'a pas été indexée depuis un certain nombre d'années et il faudrait au moins 72 millions d'euros pour la remettre à niveau. Ces sommes devraient être orientées vers l'enfouissement de réseaux dans les zones les plus exposées et vers l'éradication des fils nus avant 2035-2040.
En matière de cartographie, nous sommes également engagés sur les territoires ultramarins dans une convention de partenariat pour aller un peu plus loin. Nous espérons valoriser cela lors de notre prochain congrès national, à Besançon.
M. Sébastien Fagnen. - L'enfouissement est un enjeu considérable sur nombre de territoires et notamment sur l'île de la Réunion, mais il ne constitue pas une fin en soi et nous devons nous adapter aux contraintes locales, les départements littoraux étant particulièrement concernés par les risques de submersion marine. Les questions majeures ont trait à l'interdépendance entre les deux réseaux et à la mutualisation dans les projets d'enfouissement. Je rejoins ma collègue Audrey Bélim sur la nécessité de pouvoir enfouir autant que possible, lorsque les contraintes techniques et géographiques le permettent, afin d'assurer la pérennité des réseaux. Si l'approvisionnement électrique est vital, aujourd'hui la pérennité des réseaux numériques est essentielle et stratégique, pour l'ensemble des activités sur nos territoires respectifs.
InfraNum et la Banque des territoires estiment le coût d'adaptation des réseaux très haut débit à 7 à 17 milliards d'euros. Cela pose la question du modèle à bâtir et des contributions des différents acteurs à envisager pour relever le défi de la résilience des réseaux.
M. Stéphane Demilly. - Je voudrais évoquer non pas les méfaits du vent, mais les méfaits de l'eau, puisque le sixième rapport du GIEC annonce une augmentation des inondations par ruissellement en ville, en fréquence et en intensité. De 2030 à 2050, les scénarios scientifiques prévoient des pluies intenses, apportant des volumes d'eau très importants sur des durées très courtes. Les Hauts-de-France conjuguent des occupations humaines en zones inondables importantes, avec une régression des prairies permanentes, et l'augmentation de la quantité de pluie. La Caisse centrale de réassurance a estimé à plus de 640 millions d'euros le coût des inondations de novembre et janvier dernier dans les Hauts-de-France. Ces inondations ont généré le fait que 10 000 foyers se sont retrouvés sans électricité, d'après les chiffres communiqués par Enedis. Une cellule de crise régionale a été mise en place, avec 200 salariés prestataires d'Enedis sur le terrain. Quelles leçons tirez-vous de cette douloureuse expérience ? Quelles adaptations envisagez-vous pour affronter de façon plus efficace des épisodes comme ceux-là, qui risquent d'être particulièrement récurrents ?
Monsieur Jourdain, vous n'avez pas cité Mayotte parmi votre périmètre. Pourquoi cela ?
M. Jean-Pierre Corbisez. - Samedi dernier, un nouvel épisode orageux a provoqué des inondations dans le Sud-Artois, avec de la grêle et des coulées de boue. Lors de la visite de notre mission d'information sur les inondations, à plusieurs reprises, les maires et de nombreux riverains se sont interrogés sur le positionnement des compteurs, qui sont souvent installés au ras du sol. Lors de nouveaux phénomènes d'inondation, tous ces compteurs se sont retrouvés sous l'eau. N'est-il pas envisageable de les positionner un peu plus haut, comme c'est le cas dans d'autres pays européens ?
M. Guillaume Chevrollier. - Je profite de mon intervention pour relayer les attentes de nos syndicats d'énergie sur le Facé et la dotation exceptionnelle du Facé sur le volet intempéries. Nous constatons un besoin de renforcer le réseau face aux besoins d'électrification plus importants. De plus, du fait de la production d'énergies renouvelables dans nos territoires, nous avons besoin de réseaux résilients.
D'après les différents opérateurs, quel niveau de réchauffement climatique est attendu à l'horizon 2100 pour faire en sorte que leurs réseaux soient résilients ? Cette question s'adresse à Enedis en particulier.
Pour assurer la résilience des transformateurs face à des aléas d'inondation, il faudrait anticiper des remises en service rapide, ce qui engendre des besoins d'alliage très particuliers et pose la question de l'approvisionnement de ce type de matériaux. Quelles sont vos actions en la matière ?
M. Hervé Gillé. - Au travers des différentes interventions, je voudrais aussi souligner, dans la prolongation de Patrick Chaize, l'intérêt de créer les conditions d'une résilience en termes de communication. Il faut aussi affirmer la planification territoriale, ainsi que les négociations et les plans à l'échelle des territoires et des communes, au travers des plans communaux de sauvegarde, mais également des plans de prévention des risques naturels prévisibles, afin de bâtir une vision planifiée. Cela permettrait de consolider et de partager ces objectifs dans une relation de subsidiarité entre les communes, les intercommunalités, les départements et les services de l'État.
Par ailleurs, vous avez cité des chiffres particulièrement élevés. Il est néanmoins toujours délicat d'analyser cette politique d'investissements au regard des chiffres d'affaires notamment. Combien ces programmes vont-ils réellement représenter ? Cela nous permettra d'objectiver au mieux les investissements à réaliser, compte tenu du risque assurantiel et dans un rapport coût-bénéfice.
Enfin, la question de la sécurisation se pose au travers des interconnexions européennes, avec le développement de lignes à très haute tension, dont l'impact paysager provoque au demeurant des difficultés en termes d'acceptabilité. Pourquoi ne pas trouver les moyens d'enfouissement qui permettraient une meilleure sécurisation des réseaux à l'échelle de l'Europe ?
M. Simon Uzenat. - Le Morbihan a été très impacté par la tempête Ciaran, notamment dans le nord du département. Je voulais, à cette occasion, saluer l'engagement des agents d'Enedis et rendre hommage à l'agent décédé dans notre région. Nous pensons à sa famille.
L'engagement d'Enedis est indiscutable, mais de nombreux élus ont eu le sentiment d'avoir été seuls dans les moments les plus critiques de la crise, et notamment juste avant son déclenchement effectif. Son intensité n'était sans doute pas prévisible en détail, mais de nombreux élus nous ont rapporté n'avoir pas été contactés dans les jours et les heures qui précédaient. Il s'agit sans doute là d'un axe d'amélioration.
Je souhaitais également évoquer le sujet de l'entretien et de la modernisation du réseau. J'aurais voulu vous interroger sur vos besoins complémentaires de financement. Enedis pourrait-elle par exemple objectiver davantage ses besoins, pour faire face, dans les temps impartis, aux défis qui sont devant nous ?
M. Jean-Claude Anglars. - Le Sénat a mis en place une mission de suivi du « zéro artificialisation nette ». Dans ce cadre, nous avons découvert que beaucoup d'élus se posent la question de la comptabilisation des postes-sources. Cela concerne Enedis et RTE, notamment. Quelle est la règle retenue par l'État en la matière ?
M. Ronan Dantec. - Patrick Chaize a bien expliqué la nécessité d'adopter une approche totalement systémique. Ma question est liée à la gouvernance des réponses à apporter. ENEDIS, RTE, la FNCCR et les acteurs du numérique apportent une certaine expertise. Pour vous, la réflexion collective est-elle satisfaisante entre l'ensemble de ces acteurs pour mettre sur la table la solution qui apparaîtrait la meilleure, à la fois en termes de résilience de l'ensemble des systèmes, mais aussi en termes de coûts ?
In fine, est-ce l'État qui doit payer ? Les usagers ? Les assurances ? Faut-il recourir à des fonds de type Barnier ?
M. Jean-François Longeot, président. - L'évolution du Turpe constitue également une question cruciale.
Mme Marie-Claude Varaillas. - Nous évoquons ce matin l'évolution des risques dus aux changements climatiques et les investissements nécessaires pour les anticiper. J'ai bien noté la somme des investissements que vous prévoyez, à hauteur de 96 milliards d'euros. Dans ce contexte, je vous interroge sur votre stratégie en matière de fonctionnement. Je suis régulièrement alertée par les élus et le personnel d'Enedis des difficultés résultant de la fermeture des agences. C'est le cas des agences dans mon département. Depuis 2002, Enedis a fermé pas moins de cinq agences d'exploitation et d'électricité de proximité en Dordogne. Cette stratégie interroge quant à l'allongement des délais de dépannage des usagers et l'augmentation du temps de travail des agents. Malgré cela, Enedis envisage encore la fermeture de deux sites de proximité supplémentaires, à Mussidan et Montignac, et de 40 % des sites à l'échelle régionale. Cette décision est inquiétante dans un département vaste et très boisé, où l'activité de maintenance est accrue et les déplacements des agents sur les routes secondaires sont bien plus longs. Pour preuve, le temps de coupure d'électricité est trois fois plus long dans mon département qu'au niveau national. Il est passé de 121 minutes en 2021 à 200 minutes en 2023. Vous avez peut-être une explication à fournir, mais les objectifs définis par Enedis d'ici 2040 pourraient ne pas être réalisables sans appui sur les agences d'exploitation de proximité.
M. Saïd Omar Oili. - Pour Mayotte, le réseau d'électricité est une priorité. Le financement des opérations de branchement est aidé par le Facé, qui est très insuffisant par rapport aux besoins du territoire. Du fait de sa dimension insulaire, le réseau électrique de Mayotte n'est pas connecté et il est donc plus vulnérable que les réseaux continentaux interconnectés. L'archipel reste très éloigné des objectifs d'autonomie énergétique, son électricité reste très largement dépendante des importations de fuel. Les objectifs de la diversification vers le solaire et la biomasse apparaissent très modestes.
Comment répondre aux besoins de Mayotte, dont la demande ne fait qu'augmenter chaque année du fait de la démographie très dynamique que connaît notre île ? Quelles sont vos recommandations ?
M. Hervé Champenois, directeur technique d'Enedis. - Tout d'abord, merci pour l'attention à notre collègue décédé. C'est moi qui ai reçu l'appel de cette nouvelle et j'en suis encore très touché.
Votre question sur les inondations prouve que le risque identifié avant 2023 était bien réel et se confirme. Avec du réseau aérien, l'alimentation est effectuée par le haut. Généralement, le compteur est situé à environ 1,50 mètre de hauteur. Dans des zones inondées, le réseau aérien présente cette vertu. Cette situation montre en tout cas l'absence de solution unique.
Dans la vallée du Nord de la France qui a été inondée, nous comptons deux postes sources contigus. Ces deux postes sources ont failli être coupés tous les deux, chacun représentant 20 000 clients.
Les études que l'on a déjà initiées et que l'on va intensifier portent sur les zones touchées par les inondations. Il est parfois compliqué de modéliser les inondations. Dans certains endroits, c'est évident, mais pas dans d'autres. Nous allons adapter certaines installations. Nous allons ainsi surélever des postes sources et de transformation.
Les 96 milliards d'euros que j'ai cités ne portent pas uniquement sur la résilience, mais également sur le raccordement. La moitié de ces investissements repose sur des estimations de la demande des clients pour raccorder des énergies renouvelables, des infrastructures de recharge de véhicules électriques ou tout simplement des bâtiments en consommation. Dans le même temps, nous poursuivons également une ambition de décarbonation, avec des investissements importants à réaliser dans le même temps.
Si nous agissons sur les cinq programmes d'investissement que j'ai cités, à horizon 2040, cela apporterait des résultats en matière de résilience. Le passage d'un réseau basse-tension nu en torsadé représente 18 fois moins d'incidents. Dans le Morbihan par exemple, les fils nus sont extrêmement présents. Nous avons d'ailleurs lancé un projet de reconstruction sur le territoire du Finistère, des Côtes-d'Armor et de la Manche pour accélérer les investissements sur ces territoires.
Toute cette trajectoire d'investissement est prise en compte par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), puisque nous entrons dans une période de nouveaux tarifs d'utilisation des réseaux d'électricité (Turpe). Le Turpe 7 sera effectif à partir de mi-2025 et nous présentons à la CRE les investissements, les coûts d'exploitation et tous les éléments qui permettent le fonctionnement d'Enedis. Dans la même période, RTE présente aussi ses investissements pour mettre à niveau l'infrastructure. Le coût final par le client sera évalué dans le cadre des négociations de tarifs qui sont en cours.
L'objectivation des moyens a été réalisée nationalement pour aboutir au chiffre de 96 milliards d'euros. L'objectivation se décline également localement, dans le cadre des plans pluriannuels d'investissements.
Vous avez évoqué l'anticipation lors de la tempête. La tempête a eu lieu la nuit du mercredi au jeudi. Nous avons commencé à avoir des bulletins à partir du week-end précédent. Nous recevons de tels bulletins deux à trois fois par an. Donc, toute la difficulté réside dans l'anticipation. En l'occurrence, nous ignorions si la tempête toucherait le Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, ou les trois régions. Nous avons positionné nos renforts au Mans, principalement, pour qu'ils soient en mesure d'aller en Normandie, en Pays de Loire ou en Bretagne. De plus, il n'est pas envisageable de déplacer près de 1 000 collaborateurs si cela n'est pas nécessaire. J'ai été appelé à trois heures et demie du matin et l'on m'a appris que 600 000 clients étaient privés d'électricité. Probablement pourrions-nous préciser aux élus nos informations météo. En revanche, dès le mercredi, nous avions été en communication avec toutes les préfectures. J'avais alors expliqué aux grands médias notre positionnement en vue de la crise à venir. Rapidement, les clients ont souhaité savoir quand ils seraient rétablis. Nous menons d'importants travaux pour être plus fins dans la prévision de rétablissement. Il reste qu'effectivement, la collaboration avec les collectivités locales pour favoriser l'anticipation est extrêmement importante. Pour la première fois, à l'occasion de cette crise, nous avons dédié une équipe aux relations avec les collectivités locales.
Madame Varaillas, vous avez cité notre présence dans les zones rurales. Je n'avais pas en tête les deux sites que vous avez cités. Il est vrai que nous avions auparavant une action coordonnée avec GRDF qui donnait lieu à des optimisations. Ces optimisations n'ont plus été possibles après la séparation de ces activités. Aujourd'hui, nous essayons de maintenir notre présence, aussi bien en zone urbaine que rurale.
En ce qui concerne le ZAN, nos postes-sources ne sont pas comptabilisés dans les projets d'intérêts nationaux. Notre objectif par rapport aux énergies renouvelables et la mobilité lourde, qui nous amènent à construire des postes-sources, correspond à une centaine de postes-sources à construire avant 2030, dont de nombreux en zones rurales, pour l'accueil des énergies renouvelables. Cela représente une construction de 15 postes par an, contre 2 par an aujourd'hui.
Néanmoins, les besoins en main-d'oeuvre sont cruciaux pour accompagner tous ces investissements. Cela passe par des entreprises locales, positionnées dans tous les territoires. Nous avons lancé l'école des réseaux électriques en partenariat avec l'éducation nationale, afin de disposer de main-d'oeuvre compétente pour notre entreprise et nos prestataires.
M. Antoine Jourdain, directeur Systèmes Énergétiques Insulaires d'Électricité de France (EDF). - Effectivement, je n'ai pas évoqué le cas de Mayotte, parce qu'EDF n'est pas l'opérateur à Mayotte. Il s'agit d'Électricité de Mayotte, dont EDF est actionnaire à 25 %. La situation à Mayotte est très complexe sur beaucoup d'aspects. Sur la partie électrique, cette entreprise est plutôt bien gérée, avec une perspective d'investissement et de croissance de la consommation liée à la désalinisation de l'eau et à la décarbonation de l'énergie. Nous ne sommes pas très loin de ce qui se fait dans les autres territoires ultramarins.
La coordination, pour les territoires ultramarins, est souvent prise très au sérieux par le préfet. Nous l'avons constaté pendant la tempête Bellal : le préfet était à la manoeuvre et a géré la situation de manière exceptionnelle. En matière de coordination, les préfectures effectuent en effet un travail considérable. La Direction générale de prévention des risques (DGPR) établit elle aussi des scénarios.
EDF SEI dispose effectivement des moyens lui permettant d'assurer ses missions. Il nous faut néanmoins parvenir à construire un tissu industriel qui nous permette de réaliser nos travaux. Dans nos contrats de concession, nous expliquons que nous voulons augmenter les investissements de manière significative. Nous accompagnons l'ensemble des acteurs pour disposer d'un tissu industriel compétent, qui nous permette de réaliser ces investissements.
N'oublions pas que, globalement, l'électricité, tous territoires confondus, fonctionne 99,9 % du temps. Effectivement, les événements exceptionnels sont insupportables pour les gens qui les subissent, mais il est toujours très compliqué de tout prévoir. Certes, nous devons nous améliorer, mais il faut également raison garder.
M. Jean-François Longeot, président. - En effet, cette mise en perspective devait être rappelée.
M. Maurice Gironcel, président du Syndicat Intercommunal d'Électricité (Sidélec) du Département de La Réunion. - La programmation pluriannuelle de l'énergie est en discussion actuellement. Nous insistons sur la nécessité d'adopter « le réflexe Outre-mer ». En Martinique, le 23 avril dernier, nous avons insisté sur la prise en compte des ZNI dans tout texte réglementaire relatif à l'énergie. Nous souhaitons inscrire dans la loi l'obligation de formaliser pour chaque ZNI un document d'orientation stratégique spécifique « Futur énergétique 2050 ZNI ».
Un autre aspect est important pour les territoires ultramarins : la péréquation tarifaire. Le coût de production de l'énergie dans nos pays est cher, ainsi que celui du réseau.
Nous proposons aussi d'étendre l'obligation de postes de panneaux solaires photovoltaïques sur les toitures de 150 m² et plus pour toutes nouvelles constructions. Cette orientation entraînerait des économies d'échelle à tous les niveaux.
Voilà deux propositions que je tenais à porter devant cette commission.
M. Charles-Antoine Gautier, directeur général de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). - En termes de proximité et de lien avec les élus, nous avions par le passé activé le dispositif des « correspondants Tempête » qui permettaient d'établir un lien de proximité. Ce dispositif pourrait être réactivé.
Nos élus commencent à se saisir de la planification territoriale, les PCS et les plans de prévention des risques, y compris dans le cadre contractuel. Nous essayons de travailler à la prévention des risques d'inondation pour surélever certains appareils, afin de les rendre accessibles. Enedis commence aussi à travailler sur des appareillages submersibles.
Ces questions rejoignent les sujets de gouvernance. Il nous faudrait un plan de résilience commun à plusieurs réseaux qui permettrait d'unir toutes les forces vives. Cette proposition nous semble intéressante et nous sommes prêts à y travailler avec vous.
Nos élus exécutifs aiment rappeler qu'il faut continuer à réarmer le Facé, qui est un outil puissant, ayant montré ses effets et les montrant encore, aidant les territoires à accélérer cette résilience des réseaux.
M. Jean-François Longeot, président. - Vous avez pointé l'absence de solution unique. Ce point me semble crucial, car les problèmes auxquels nous faisons face sont complexes. Nous avons des objectifs à atteindre, des prévisions à mettre en place et des efforts à fournir en matière de développement des services d'intervention, d'Enedis, etc. La relation doit également être forte entre les syndicats d'énergie et la FNCCR.
Je tenais également à vous remercier de vous être prêtés à ce jeu de questions-réponses.
Cette audition a fait l'objet d'une captation vidéo disponible sur le site internet du Sénat.
La réunion est close à 10 h 30.
- Présidence de M. Jean-François Longeot, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, et de M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport -
La réunion est ouverte à 16 h 35.
« Transports pendant les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : quels enjeux ? » - Audition de M. Patrice Vergriete, ministre délégué chargé des transports, et de Mme Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, présidente d'Île-de-France Mobilités
M. Jean-François Longeot, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. - Mes chers collègues, je suis heureux de vous accueillir cet après-midi aux côtés de Laurent Lafon pour cette audition conjointe de la commission de la culture, de l'éducation et du sport et de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Nous entrons dans la dernière ligne droite avant les jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024, seulement soixante et onze jours nous séparant aujourd'hui de la cérémonie d'ouverture. Il nous semble donc indispensable de faire un point sur la préparation de cet événement d'ampleur mondiale, plus spécifiquement en ce qui concerne l'organisation de nos réseaux et de notre offre de transport durant cette période.
L'organisation de ces Jeux devrait se traduire par un afflux massif de voyageurs et par des besoins de mobilité beaucoup plus élevés qu'à l'accoutumée dans l'ensemble des villes accueillant des épreuves, notamment en région Île-de-France. Près de 600 000 spectateurs pourraient se déplacer chaque jour - vous pourrez peut-être revenir sur les dernières estimations.
Cet événement sera aussi l'occasion de grandes premières : à titre d'exemple, ainsi que nous l'a indiqué Jean-Pierre Farandou lors d'une audition la semaine dernière, le Stade de France sera rempli et vidé deux fois le même jour. Dans ces conditions, pouvez-vous aujourd'hui nous indiquer si, d'après vous, l'offre de transport permettra d'absorber les flux supplémentaires de passagers ?
En d'autres termes, sommes-nous prêts à faire face aux défis posés par les jeux Olympiques et Paralympiques ? Les plans de transport doivent être adaptés pour augmenter les capacités de déplacements des usagers, mais les infrastructures doivent également être au rendez-vous. Aussi, pourriez-vous faire un point sur les calendriers d'ouverture des nouvelles lignes et des prolongements prévus dans le dossier de candidature de Paris 2024 ? En fin de compte, les promesses formulées en 2017 seront-elles tenues ?
Ces promesses concernaient aussi le prix du ticket pour l'usager. Autant dire que sur ce sujet, la situation a beaucoup évolué. Alors que le dossier de candidature prévoyait que tous les détenteurs de billets pour les épreuves olympiques pourraient voyager gratuitement sur l'ensemble du réseau d'Île-de-France le jour de la compétition à laquelle ils assisteraient, la décision a finalement été prise d'augmenter le prix du ticket de métro pour le porter à 4 euros. Madame la présidente, pourriez-vous revenir sur les raisons qui ont présidé à ces évolutions ?
Relever le défi des mobilités quotidiennes de centaines de milliers de voyageurs sur des durées extrêmement courtes suppose aussi de permettre à tous de se déplacer dans de bonnes conditions. C'est pourquoi je souhaiterais vous interroger sur la politique menée en matière d'accessibilité des réseaux aux personnes en situation de handicap. Dans quelle mesure l'offre sera-t-elle adaptée aux besoins des usagers ?
En outre, les jeux Olympiques et Paralympiques vont assurément conduire à des déplacements cadencés de personnes, au gré des différentes épreuves. Dans ces conditions, il est indispensable que le parcours des voyageurs, leur information en cas de difficulté ou de retard, mais aussi les systèmes de billettique soient accessibles, fluides et ergonomiques, afin de ne pas créer de nouveaux engorgements. Là encore, la France sera-t-elle au rendez-vous en matière d'information voyageur et de billettique ?
Enfin, je souhaiterais vous entendre sur un dernier sujet d'importance, celui des grèves. Comment appréhendez-vous les éventuelles grèves qui pourraient survenir pendant cette période ? La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'est récemment prononcée sur la proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève déposée par Hervé Marseille, qui propose de suivre le modèle italien. Y voyez-vous une réponse possible face à certaines situations ?
M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture. - Je remercie, à mon tour, le ministre et la présidente de la région Île-de-France d'avoir répondu à notre invitation. Je me réjouis de cette réunion commune sur un sujet qui intéresse nombre de nos concitoyens, déjà confrontés au quotidien à des problématiques de transport et inquiets des perturbations que pourraient entraîner les jeux Olympiques et Paralympiques.
Du 26 juillet au 8 septembre, la France accueillera en effet cet événement exceptionnel que sont les jeux Olympiques et Paralympiques. Le monde entier aura les yeux rivés sur notre pays. La réussite de cet événement, que nous souhaitons tous, comporte de multiples paramètres. Pour étudier l'ensemble de ces aspects, la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport a mis en place une mission d'information chargée du suivi de la préparation des Jeux, dont les rapporteurs sont Claude Kern et Jean-Jacques Lozach. Ceux-ci ont réalisé de multiples auditions au cours des dernières semaines, notamment sur la question des transports. Ils vous interrogeront également.
Le bon déroulement des compétitions appelle un dispositif inédit en matière de transports, auquel l'ensemble des acteurs travaille depuis déjà un moment.
Le défi est triple. Il s'agit d'abord de transporter les spectateurs, venus de France ou de l'étranger, vers et depuis les trente-cinq sites olympiques et dix-neuf sites paralympiques. Ces sites sont répartis sur tout le territoire français, mais ils sont particulièrement concentrés à Paris et en région parisienne.
Il s'agit aussi de transporter le plus efficacement possible les 10 500 athlètes olympiques et les 4 400 athlètes paralympiques, ainsi que l'ensemble des personnes accréditées par l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques et tout leur matériel, du moment de leur arrivée sur le territoire jusqu'à leur départ à la fin des compétitions.
Enfin, ces déplacements propres aux Jeux devront perturber le moins possible les déplacements usuels à cette période de l'année, tant pour les travailleurs que pour les vacanciers.
Le risque sécuritaire, réévalué l'an dernier à la hausse, ajoute une dimension supplémentaire à cette équation déjà complexe. Ce risque, multiple, comprend les menaces cyber. Il constitue une contrainte forte dans l'organisation des Jeux et un facteur de coûts supplémentaires pour l'ensemble des acteurs.
En 2022, à la suite des incidents survenus au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions, le rapport d'information commun des commissions de la culture et des lois a mis en évidence un certain nombre de dysfonctionnements, notamment dans la gestion des flux de personnes venant des RER. Ce rapport a identifié des problèmes de coordination entre les différents acteurs, respectivement responsables du bon fonctionnement des transports, de la sécurité et de l'organisation sportive.
Vous nous direz quels enseignements ont été tirés de cet incident, en précisant notamment comment est assurée la coordination entre vos services, ceux de la préfecture de police et du Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (Cojop).
L'arrivée de la flamme le 8 mai dernier à Marseille a lancé le compte à rebours des opérations : chacun souhaite que la fête soit réussie, et nous avons toutes les raisons de penser qu'elle le sera.
La question des transports a toutefois été identifiée, dès la candidature de Paris aux Jeux, comme une question sensible. C'est pourquoi il nous paraît important de faire un point sur ce sujet à quelques semaines de l'événement.
Mme Valérie Pécresse, présidente de la région d'Île-de-France, présidente d'Île-de-France Mobilités. - Nous sommes à soixante-douze jours des jeux Olympiques et Paralympiques, et nous sommes prêts comme jamais. Je le dis avec un peu d'expérience : lors des Jeux de Rio, auxquels j'avais assisté, les toilettes des athlètes avaient été installées pendant les Jeux, et l'on peignait encore les stades la semaine précédant les épreuves. Nous ne sommes pas dans ce cas : toutes les infrastructures sportives ont déjà été livrées.
J'ai entendu le Président de la République dire ne vouloir que des médailles d'or aux Jeux. En matière de transport, on pourrait chaque semaine décerner des médailles d'or aux opérateurs, aux spécialistes du secteur des bâtiments et travaux publics (BTP) ou à Alstom, qui livrent dans les délais des chantiers colossaux.
En réalité, les Jeux n'ont pas modifié nos ambitions pour les transports en Île-de-France. Ils ne sont pas à l'origine du plan d'accessibilité des transports, du projet Eole, du projet du tramway T3, du prolongement des lignes 11 ou 14 du métro. Ces projets existaient déjà et figuraient dans les contrats de plan État-région. Force est toutefois de constater que si dans notre pays rien n'arrive à l'heure, surtout pas les trains, grâce aux Jeux, tout arrive à l'heure.
Notre ambition est aussi de conserver pour un certain temps, car je doute que Los Angeles ou Brisbane parviennent à nous égaler sur ce point, la médaille d'or des Jeux entièrement accessibles en transport en commun. Cet engagement, que nous avions pris lors de la candidature de Paris 2024, n'a jamais été tenu par aucune autre capitale. De plus, nos bus et nos navettes fonctionneront non pas au diesel, mais de manière décarbonée.
Ces projets sont spectaculaires, pharaoniques. Ils battent des records : nous avons bouclé le tramway T3 et libéré la porte Maillot ; nous avons prolongé Eole jusqu'à la Défense. Nous inaugurerons prochainement le prolongement de la ligne 11 en Seine-Saint-Denis, après six ans de travaux, même si cette ligne n'est pas directement liée aux Jeux - nous ne voulions pas la sacrifier sur l'autel des Jeux, ni que les Franciliens aient le sentiment que nous n'ouvrions que les infrastructures des Jeux. Il s'agit du plus grand prolongement de ligne de métro jamais réalisé, qui s'étend sur six kilomètres. La ligne 14 sera prolongée au mois de juin entre Saint-Denis-Pleyel et Orly-Aéroport, où l'on pourra se rendre en train automatique sans crainte des grèves. Tous ces travaux sont rendus dans les temps grâce à l'effet magique des JOP.
Ce matin même, Patrice Vergriete et moi-même inaugurions la nouvelle gare de Saint-Denis, à l'issue du plus grand chantier de mise en accessibilité d'une gare en France. Ayant coûté 160 millions d'euros, financés par la région, Île-de-France Mobilités (IDFM) et la SNCF, ce projet concerne l'une des gares de Jeux, qui est la deuxième gare d'Île-de-France et la douzième gare de France, plus grande que celles de Lille ou de Bordeaux.
Nous avons accéléré notre plan d'accessibilité, les jeux Paralympiques nous imposant d'être exemplaires : 95 % des flux de passagers d'Île-de-France emprunteront des transports entièrement accessibles, et toutes les gares des Jeux seront entièrement accessibles. Là encore, les Jeux permettent un bond en avant.
Outre le réseau et les infrastructures, les coûts spécifiques des transports dus aux JOP, du 26 juillet au 12 août, puis du 28 août jusqu'au 10 septembre, représentent une dépense supplémentaire de 250 millions d'euros pour Île-de-France Mobilités.
Ces surcoûts s'expliquent par un renforcement de l'offre, à hauteur de 15 % en moyenne par rapport à un mois d'août habituel, mais à hauteur de 70 % sur le RER C en direction du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines ou des épreuves d'équitation à Versailles, ou encore sur le RER B, la ligne 14 ou la ligne 13. Toutes les lignes desservant les sites olympiques seront beaucoup plus utilisées que d'habitude.
À cela s'ajoutent 50 000 cartes gratuites de circulation pour les forces de police et de sécurité venant de toute la France, ainsi que 45 000 cartes gratuites pour les bénévoles. S'y ajoute également une série de coûts supplémentaires, notamment les primes actuellement négociées à la RATP, qui devront tenir dans l'enveloppe fixée conjointement avec l'entreprise et le ministère.
Nous augmentons également l'offre de transport en postant près de 450 navettes gratuites à des points névralgiques pour aider ceux qui ne pourraient pas se déplacer à pied jusqu'aux sites, par exemple entre la station Porte d'Auteuil et Roland-Garros, entre Charles-de-Gaulle-Étoile et ce même stade, entre Porte de Saint-Cloud et le Parc des Princes, entre la gare du RER C et le parc de Versailles, entre Massy et Saint-Quentin-en-Yvelines, ou encore à la sortie du RER E et du RER A pour se rendre à la base nautique de Vaires-sur-Marne. Pour ces endroits qui ne sont pas très bien desservis, il faut plusieurs plans de transport. Ces navettes gratuites, accompagnant les spectateurs dans les derniers kilomètres de leurs trajets, sont des bus articulés de dix-huit mètres, cadencés parfois à la minute.
L'offre de transport concerne également l'accessibilité. Dans les huit grandes gares d'Île-de-France, 150 navettes conduiront directement à la porte des sites olympiques les personnes en situation de handicap et leurs accompagnants, pour le tarif d'un ticket de métro.
Ces offres supplémentaires de transport expliquent les 250 millions d'euros de dépenses supplémentaires d'Île-de-France Mobilités durant les Jeux, sans compter les infrastructures, déjà prévues et financées.
À soixante-douze jours des Jeux, tous les plans de transport sont terminés, y compris le plan de transport spécifique de la cérémonie d'ouverture et la mise en place des différents périmètres de sécurité. Que les compétences des uns et des autres soient très claires : il ne m'appartient pas de contester une décision du préfet de police. Certes, durant les réunions préparatoires, nous discutons, et nous avons, par exemple, obtenu que les stations Invalides et Saint-Michel puissent rester ouvertes.
Lorsque l'on est obligé de fermer une sortie de métro à cause d'une infrastructure des JOP, ce sont les pompiers qui décident si le flux de passagers peut ou non s'écouler, et non la région. Si la fermeture de certaines gares ou de certaines correspondances cause des problèmes, il faut en discuter non pas avec la région, qui n'est qu'un exécutant, mais avec la préfecture de police. Cette dernière négocie avec le Cojop pour repousser le plus possible le moment où les gradins de la cérémonie d'ouverture seront montés, afin de fermer le plus tard possible les correspondances et les sorties de métro. Si les correspondances doivent être fermées à cause des infrastructures des Jeux, c'est pour assurer l'éventuelle évacuation du métro en cas d'incident. Personne ne souhaite que les recommandations des pompiers de Paris ne soient pas prises en compte.
Je me réjouis que la cérémonie d'ouverture ne réunisse finalement que 330 000 spectateurs. Île-de-France Mobilités était très inquiet à cause des flux de voyageurs induits, mais ce chiffre, même s'il est important, ne dépasse pas la jauge. La mise en place du périmètre de sécurité aura des impacts significatifs sur de nombreuses lignes de métro et de bus : dix-sept stations de métro et du RER C seront fermées du 18 juillet au 26 juillet inclus, ainsi que le tronçon central de la ligne 7 du métro, entre les stations Jussieu et Palais-Royal-Musée du Louvre. Il y a donc un certain nombre de désagréments pour les Franciliens, je le reconnais.
Par ailleurs, la cérémonie d'ouverture coïncide également avec le chassé-croisé entre les juilletistes et les aoûtiens dans les grandes gares parisiennes. Nous allons le plus possible renforcer l'offre de métros au moment de l'arrivée des spectateurs pour la cérémonie, entre 15 heures et 18 heures, ainsi que vers 23 heures 15, à la fin de la cérémonie. Nous avons décidé d'ouvrir toutes les lignes automatisées durant toute la nuit de la cérémonie d'ouverture, car nous avons pensé que cela permettrait de désaturer la ville si certains spectateurs voulaient prolonger la fête. Les Noctiliens seront renforcés, les lignes circulaires N01 et N02 étant notamment cadencées toutes les six minutes.
La nuit du samedi 10 août, lors du marathon pour tous et de la grande fête de clôture, toutes les lignes de métro et le RER C intra-muros fonctionneront toute la nuit en complément du Noctilien.
Un mot au sujet de la rentrée scolaire, avec laquelle coïncideront les jeux Paralympiques : nombre d'entre vous se sont émus des impacts du plan de transport prévu sur les transports scolaires. Nous donnerons des conseils aux Franciliens. Île-de-France Mobilités a mis en place une application traduite en six langues, Transports publics Paris 2024, qui donne de bons conseils de déplacements. Des itinéraires habituels seront déconseillés : la ligne 13, en raison de sa faible jauge capacitaire, ne rentrera pas dans le plan de transport des jeux Paralympiques pour préserver la rentrée des Franciliens, et les spectateurs seront invités à emprunter les lignes du RER B ou du RER D, ainsi que la ligne H ou les lignes 12 et 14 du métro. Pour l'accès au site de Vaires-sur-Marne, tous les trajets auront lieu sur le RER E, et le RER A ne fera pas partie du plan de transport, car il est trop utile pour la rentrée des Franciliens. Le plan de transport des jeux Paralympiques n'est pas le même que celui des jeux Olympiques.
Les agents et les opérateurs sont massivement mobilisés : il y aura 250 conducteurs de métro supplémentaires, dont 100 conducteurs de la SNCF venant en renfort de province, ainsi que 3 000 conducteurs de bus supplémentaires. Évidemment, les primes sont nécessaires, car on demande à ces agents de reporter leurs vacances : il faudra assurer le service en juillet, en août et aussi en septembre, à la rentrée. Un énorme travail de dialogue social est fait avec les opérateurs. Les discussions sur les compensations indemnitaires sont totalement légitimes, même si j'ai demandé à ce qu'elles respectent l'enveloppe fixée.
Un mot sur les tarifs. Tous les titres de transport seront dématérialisés et disponibles sur les appareils Android et Apple. Les tarifs des transports durant les Jeux ont été fixés à un niveau élevé. Je le sais, mais ce n'est pas ma faute, même si c'est ma responsabilité. C'est le Cojop qui avait promis la gratuité des transports, avant de réaliser en 2021 qu'il ne disposait pas de l'argent pour la financer. Je m'étais alors tourné vers l'État, qui m'avait indiqué qu'il ne pouvait pas non plus assurer ces coûts. Il revenait donc à la région d'Île-de-France d'assumer une dette de 250 millions d'euros. Je suis désolée, mais il était hors de question de laisser cette dette aux Franciliens, alors qu'elle représente une hausse du tarif du Pass Navigo de 8 euros.
Le premier objectif est donc de ne pas laisser la dette relative aux JOP aux Franciliens. Le deuxième objectif, non négligeable, est de réguler les flux de voyageurs, qui constituent le vrai problème auquel nous sommes confrontés. Nous ne voulons pas d'encombrements aux entrées des gares et des stations. Nous sommes obligés de laisser une possibilité d'achat au guichet ou auprès du conducteur, mais l'objectif est que chacun prenne ses tickets par internet, à l'avance, pour plus de fluidité. Nous le martèlerons : tout est accessible sur internet. Le passe Paris 2024 à 16 euros par jour permet l'accès aux aéroports, qui coûte aujourd'hui 12 euros. Il est au juste prix, il permet de circuler de manière illimitée dans toute l'Île-de-France. J'aurais préféré qu'il soit moins cher, mais personne n'a proposé de le financer.
Une signalétique dédiée sera installée, et la présence humaine sera renforcée. Nous déploierons1 000 agents de sécurité en plus dans les transports pendant les Jeux, 62 équipes de cynodétection pour repérer les colis abandonnés, 85 000 caméras équipant la totalité des gares, des bus, des tramways et des trains, et nous disposerons d'un centre de commandement unique financé par l'État et la région à la préfecture de police. De plus, nous créerons une brigade régionale des transports, et j'espère que, grâce à l'adoption rapide de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports de M. Tabarot en cours d'examen à l'Assemblée nationale, nous pourrons donner plus de pouvoir aux agents de sécurité dans les transports, ce qui sera très utile.
L'effort est collectif et l'ambition est olympique.
M. Patrice Vergriete, ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports. - Nous sommes en effet à un peu plus de soixante-dix jours du début des Jeux. Nous sentons avec l'arrivée de la flamme olympique le début d'un engouement populaire, ce dont je me félicite. Nous souhaitons tous que ces Jeux soient une fête qui nous permette de donner une très belle image de notre pays.
L'enjeu en matière de transport est important : il faut concilier différents flux, qui émanent, d'une part, directement des jeux Olympiques et Paralympiques, avec les spectateurs, les athlètes et les accrédités, et, d'autre part, des déplacements du quotidien. La conciliation de ces flux constitue le défi des transports.
Notre pays a souhaité démontrer son exemplarité : les Jeux seront entièrement accessibles en transport collectif ou à vélo, et nous donnons, avec notre politique de transport, l'image d'un pays qui privilégie les enjeux relatifs au développement durable.
Nous voulons que les différents acteurs, l'État, la région, la Ville de Paris, jouent collectif. Le comité stratégique des mobilités des JOP de 2024 a ainsi préparé ces travaux pour que les transports soient à l'heure au moment des Jeux.
Tous les plans de transport sont aujourd'hui validés. L'augmentation de l'offre globale de transports en Île-de-France atteint 15 % en moyenne, et plus de 70 % sur certaines lignes. La semaine dernière, j'étais à Châteauroux où des trains et des rames supplémentaires sont prévus le matin et le soir, ainsi que des navettes. En province, les plans de transport sont donc également largement validés.
Au sujet des plans de transport, le seul point qui reste en discussion lors des réunions du comité stratégique des mobilités des JOP de 2024 est celui de l'ouverture de la station Champs-Élysées-Clemenceau. Il semble que nous nous dirigions vers sa fermeture, mais j'ai souhaité que l'on étudie de plus près la possibilité de garder cette station ouverte, afin de faciliter les déplacements des Franciliens, notamment en ce qui concerne la correspondance avec la ligne 13.
Avons-nous rempli l'ensemble du cahier des charges pour les infrastructures ? Deux manquent à l'appel : le Charles-de-Gaulle Express ne sera pas au rendez-vous ni la ligne 15 au sud de l'Île-de-France. Pour tout le reste, le cahier des charges est tenu, témoignant du coup d'accélérateur permis par les jeux Olympiques.
Valérie Pécresse et moi-même avons déjà eu l'occasion d'inaugurer ensemble plusieurs infrastructures : le prolongement du tramway T3B, celui du RER E, la gare de Saint-Denis ce matin, demain après-midi nous inaugurerons le franchissement urbain Pleyel, puis au mois de juin le prolongement de la ligne 14 et la mise en accessibilité de la gare du Nord. Nous pouvons être fiers de voir toutes ces infrastructures au rendez-vous.
Il s'agira là d'un véritable héritage des Jeux. Il y aura peut-être des nuisances pour les déplacements au quotidien durant les Jeux, mais cet héritage, essentiel, améliorera largement les services de transports franciliens.
Nous pouvons y ajouter les travaux réalisés pour le vélo : 400 kilomètres de pistes cyclables, les « olympistes », 27 000 places de stationnement, 46 000 vélos en libre-service.
L'accessibilité a été un élément saillant des différents plans de transport. Un dispositif nous permet de disposer bientôt de 1 000 taxis accessibles, contre 250 actuellement. On peut également mentionner la mise en accessibilité de la gare de Saint-Denis et de la gare du Nord, ainsi que la formation des agents au handicap. Les personnes en fauteuil seront également mieux prises en charge dans les aéroports.
Le comité stratégique des mobilités des JOP de 2024 a fait le choix d'anticiper et de prévenir à temps la population afin de lui permettre d'adapter son comportement quand elle peut le faire. J'ai été frappé par la capacité d'adaptation des Franciliens lors de la fermeture de l'autoroute A13. Il est vrai qu'aujourd'hui il y a de nombreux embouteillages, et j'entends ceux qui les considèrent comme un enfer, mais ces embouteillages n'ont pas été aussi importants que ce que nous le craignions. La population s'est donc adaptée à la paralysie consécutive à cette situation.
Mme Pécresse a évoqué l'application développée par IDFM. Le Gouvernement a mis en place le site internet anticiperlesjeux.gouv.fr. Ces deux outils, en relation, permettent d'anticiper et de repérer en temps réel la fréquentation sur les différentes lignes et dans les différentes stations. Cela donnera une visibilité complète pour choisir son itinéraire en temps réel. La campagne de communication a plutôt été un succès : nous comptons 1,5 million de visiteurs du site, et 60 000 personnes se sont déjà abonnées à ses alertes. Un énorme travail a été mené avec les professionnels de la logistique urbaine pour trouver des itinéraires adaptés et optimiser les déplacements en temps réel.
Au sujet de la sécurité, Mme Pécresse a évoqué la proposition de loi de M. Tabarot, qui sera bientôt examinée par l'Assemblée nationale après avoir été adoptée par le Sénat. Elle donnera des outils complémentaires aux opérateurs, qui se sont déjà fortement mobilisés pour augmenter le nombre de patrouilles dans les transports.
L'accueil est aussi particulièrement développé, notamment grâce aux volontaires qui orienteront les spectateurs et les athlètes durant les Jeux : 1 500 volontaires à Aéroports de Paris (ADP), 10 000 à la SNCF, 3 000 à la RATP. Des moyens humains considérables sont déployés pour aider ceux qui se déplaceront à cette période.
Vous avez évoqué le risque cyber, que nous considérons avec beaucoup d'attention. Avec les institutions spécialistes, nous sommes en train de tester nos infrastructures numériques, notamment celles relatives aux transports, par des méthodes de crise.
Monsieur le président, vous avez évoqué la question de la grève. Le dialogue social en cours à la RATP et à la SNCF sur la question des primes relatives aux JOP est légitime si l'on parle d'annuler des congés et de faire accepter des règles qui imposent d'être présent à la fois durant l'été et pendant la rentrée. Je n'ai aucune raison d'être inquiet.
Je me suis exprimé sur ce sujet lors de l'examen de la proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève déposée par Hervé Marseille, en insistant sur le risque d'inconstitutionnalité qu'elle soulève. Je vous rappelle qu'en Italie, cette démarche trouvait son origine non pas dans la loi, mais dans un accord entre les partenaires sociaux, ensuite ratifié par la loi. Si nous devions emprunter cette voie, le faire par le dialogue social me semble la méthode la plus adéquate.
M. Philippe Tabarot. - Les jeux Olympiques seront un test grandeur nature, car ils solliciteront au plus haut point les infrastructures. Île-de-France Mobilités et les opérateurs seront les principaux acteurs d'une histoire qui, je le crois, se passera bien, tant l'investissement humain et matériel est au rendez-vous. Il est temps de couper court aux discours anxiogènes et aux polémiques prématurées selon lesquelles les déplacements vireront au cauchemar. Si c'était le cas, chacun rendra des comptes, mais en temps voulu.
Pour autant, d'évidentes crispations pourraient enrayer la qualité du service. Le premier sujet, ce sont les grèves. Depuis de nombreux mois, le Sénat a lancé plusieurs initiatives à leur propos. Bruno Retailleau, Hervé Marseille et moi-même avons déposé des propositions de loi pour lutter contre les abus manifestes du détournement du droit de grève. Pourquoi, monsieur le ministre, ne pas avoir repris nos propositions en temps et en heure ? Avez-vous payé toutes les rançons demandées pour passer les JOP sans encombre syndicale ? Si la prime pour les JOP est légitime, c'est la question du financement des départs en retraites qui a coûté la présidence de la SNCF à Jean-Pierre Farandou. L'augmentation durable de 400 euros demandée par le syndicat SUD-Rail pour tous les personnels de la SNCF outrepasse probablement les services sollicités pour cette période. Nous ne pourrons pas indéfiniment continuer à fermer les yeux et à baisser la tête face au colossal pouvoir considérable de nuisance d'une minorité contre la majorité des Français.
Le second sujet, c'est la sécurité dans les transports. Je vous rappelle qu'en 2023 près de 7 000 personnes ont été victimes de vols avec violences ou de coups et blessures dans les transports en commun. En parallèle, nous observons une forte hausse du port d'objets dangereux dans les transports. La SNCF estime ainsi que plus de 4 000 objets dangereux ont été introduits l'année dernière sur son réseau, notamment des hachoirs de boucher, des pics à glace, des couteaux ou des battes de base-ball.
La proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports a été adoptée par le Sénat. Elle vise à développer un arc de prévention élargi, à renforcer l'arsenal et les prérogatives des forces de sûreté, ainsi qu'à créer de nouveaux délits. Nous espérons, après l'examen plutôt positif ce matin même de plusieurs articles de ce texte en commission des lois à l'Assemblée nationale, son adoption rapide.
Monsieur le ministre, deux mesures relèvent directement de vous et du pouvoir réglementaire. Êtes-vous prêts à vous engager, à l'instar de votre prédécesseur, pour que les agents de la surveillance générale de la SNCF (Suge) ou du groupe de protection et de sécurité des réseaux de la RATP (GPSR) soient dotés de pistolets à impulsion électrique, dits Taser, ou pour mobiliser la réserve opérationnelle de la police nationale en complément des forces de sûreté et des forces de l'ordre, dans l'intérêt des usagers des transports en commun ?
Madame la présidente, l'État tiendra-t-il ses engagements une fois les Jeux passés, pour accompagner la région dans le financement et l'offre liée à ces infrastructures nouvelles du quotidien ?
M. Jean-Jacques Lozach. - Vous avez présenté la mise en place de l'organisation et de la fonctionnalité des infrastructures. Pourriez-vous nous apporter quelques précisions au sujet de la méthode de concertation retenue avant que les décisions relatives à l'organisation des JOP n'aient été prises ? L'avis des associations d'usagers, voire de leur fédération nationale, a-t-il notamment été pris en compte ?
Monsieur le ministre, nous sommes très sensibles à l'héritage olympique, formalisé dans le document France 2024, porté par le ministère des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, mais qui engage également d'autres ministères. Sur les 170 objectifs stratégiques de ce document, un seul concerne les mobilités, le plan vélo. Cela n'est-il pas décevant, et ce document de référence ne mérite-t-il pas d'être très rapidement complété ?
M. Hervé Gillé. - Madame la présidente, monsieur le ministre, je souhaite vous interroger sur trois enjeux soulevés par la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques.
Premièrement, il sera indispensable d'assurer une articulation efficace entre les différents modes de transport pour absorber le flux sans précédent de voyageurs. Le recours aux mobilités douces sera nécessaire pour limiter l'engorgement des transports collectifs et maîtriser les émissions polluantes tout au long des Jeux. Quelles mesures ont été prises pour renforcer l'offre en la matière et garantir une intermodalité fluide ? Les sites olympiques et paralympiques seront-il réellement accessibles par les mobilités douces ?
Deuxièmement, madame la présidente, vous aviez annoncé en début d'année qu'à compter du mois de juin, en cas de malaise voyageur, les conducteurs de métro seraient autorisés à repartir sans attendre l'arrivée des secours à quai pour assurer la régularité du service. Ce point peut être inquiétant pour la sécurité des voyageurs, d'autant qu'une chaleur caniculaire risque de peser à cette période. Ce protocole sera-t-il effectivement mis en place, et quelles mesures sont-elles prévues pour prévenir les malaises voyageurs liés à l'afflux des passagers et à d'éventuelles fortes chaleurs ?
Enfin, troisièmement, je souhaite aborder la question du transport de marchandises. Nous avons récemment reçu des responsables de ce secteur qui sera mis à rude épreuve cet été, du fait des risques de congestion du trafic et des restrictions de circulation. Quelles stratégies seront-elles mises en place pour accompagner les transporteurs et garantir le fonctionnement de la chaîne logistique jusqu'au coeur de la ville pendant les Jeux ? Il s'agit d'une opportunité pour expérimenter à grande échelle une logistique urbaine plus durable et fluide. Certaines mesures appliquées cet été sont intéressantes, notamment le recours accru au transport fluvial ou à la cyclologistique, les livraisons en horaires décalés ou l'augmentation de l'offre d'aires de livraison. Pourront-elles être pérennisées après les Jeux ?
M. Claude Kern. - J'ai trois questions complémentaires. Tout d'abord, vous avez indiqué que les plans de transport étaient terminés, tout en évoquant la nécessité d'un dispositif résilient pour faire face aux flux et répondre à tous les incidents éventuels. Il faut donc disposer de dessertes multiples pour tous les sites. Est-ce bien le cas ? Au cas où cette redondance ne serait pas assurée, comment répondrez-vous à un incident de circulation ?
Ensuite, des exercices sont réalisés pour anticiper des situations de crise. Que prévoyez-vous en cas de canicule, sachant que de nombreuses gares ne sont pas climatisées, et que les spectateurs sont incités à se déplacer à pied ou à vélo ?
Enfin, ma dernière question porte sur les retombées économiques des JOP. À l'évidence, ces retombées seront positives sur le tourisme et l'hôtellerie, mais des retombées négatives sont également à craindre pour de nombreux commerçants, en raison de la perturbation des transports et de la circulation. Ces impacts positifs et négatifs ont-ils été évalués à l'échelon de la région ?
M. Pierre Barros. - Je vous remercie de vos propos enthousiasmants : nous avons tous envie que la fête soit réussie.
Les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 seront l'occasion d'accueillir entre 10 et 15 millions de touristes dans Paris et sa métropole. Cette situation exceptionnelle met au défi plusieurs secteurs d'activité, en particulier l'hébergement et le transport, dont l'énorme travail mérite d'être salué.
En ce qui concerne les transports, les retards accumulés en matière d'investissement, y compris pour les projets en cours comme le Grand Paris Express, associés à une offre structurellement insuffisante, font craindre la saturation du réseau durant l'été, après celle que les Franciliens connaissent déjà au quotidien.
La candidature de Paris s'appuyait sur le prolongement de la ligne 14, la construction des lignes 15, 16 et 17, ainsi que sur celle du Charles-de-Gaulle Express. En définitive, seules les lignes 14 et 11 ainsi qu'une portion du RER E, jusqu'à Nanterre, seront livrés à temps.
L'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle devait être desservi par le RER B, le Charles-de-Gaulle Express et la ligne 17 du métro. L'aéroport du Bourget devait aussi être relié à cette dernière ligne. Malheureusement, cela sera impossible. Le RER B devra donc couvrir seul ces itinéraires, alors que même la Cour des comptes indiquait au sujet de cette ligne dans son rapport annuel qu'« il ne se passe pas une semaine sans que des incidents de toute nature fassent l'actualité ».
Ce constat peut d'ailleurs être étendu aux autres lignes de RER, tant la dégradation des conditions de transport est synonyme de galère pour les presque 5 millions d'abonnés du passe Navigo - hier soir, j'ai mis presque trois heures pour rentrer chez moi, dans le Val-d'Oise.
À cela s'ajoutent de nombreux « bugs » - je vous cite, madame la présidente -, liés à l'ouverture à la concurrence des lignes de bus en grande couronne, qui concerne notamment la DSP3 : lignes supprimées sans que les élus en soient clairement avertis, chauffeurs qui attendent pendant plusieurs heures des bus très usagés qui peinent à sortir des ateliers de réparation et doivent prendre leur service en retard... Il semblerait que les bus électriques tombent très facilement en panne, et doivent souvent être remplacés par des bus diesel.
Comment, dans ces conditions, envisager sereinement de transporter les millions d'usagers du quotidien et le public des JOP cet été ? Ne soyons pas naïfs au sujet de l'impact des départs en vacances et du télétravail : comment ne pas être inquiet quant à un éventuel délaissement de certaines dessertes, en particulier des quartiers populaires et ruraux qui ne sont pas situés à proximité de sites olympiques ? En plein coeur de Paris, il faut parfois attendre une heure pour prendre un bus sur une ligne intra-muros. En effet, dans ces conditions, il reste la marche... Comment ne pas s'interroger au sujet de la période d'après les jeux Olympiques et Paralympiques, quand les personnels qui auront assuré le service tout l'été poseront leurs droits à congés ? Le sujet concerne également les forces de l'ordre et de secours.
Nombre d'élus de banlieue sont inquiets, voire en colère : ils ne comprennent pas ces partis pris. Vous avez pris des engagements devant eux. Vous devrez les tenir, pour que ces JOP ne soient pas un bouchon continu, mais bien une fête pour toutes et tous.
M. Michel Savin. - Permettez-moi de parler à double voix avec ma collègue Agnès Evren, qui n'a pas pu être présente à cette réunion.
Mme Evren souhaitait vous interroger sur l'immense défi logistique que représentent ces Jeux, en raison du nombre de sites à desservir à Paris, ainsi qu'en petite et en grande couronne. L'ambition est de permettre à l'intégralité des près de 500 000 spectateurs attendus chaque jour de se rendre sur les sites olympiques en transport en commun. Comment la coordination opérationnelle entre les lignes des réseaux de la RATP et celles de la SNCF sera-t-elle assurée ? Comment avez-vous procédé pour élaborer ce plan de transport sur mesure pour les JOP, sur quels principes et sur quelles données vous êtes-vous appuyés pour adapter le réseau ?
Monsieur le ministre, vous avez mentionné l'objectif de disposer de 1 000 véhicules taxis accessibles, en Île-de-France comme dans les autres métropoles accueillant des épreuves. Combien de dossiers ont-ils été actuellement déposés, et quel est le coût pour l'État des aides à l'achat ou à la location de longue durée de véhicules ?
Mme Marta de Cidrac. - Monsieur le ministre, j'ai cru entendre une forme de satisfecit dans vos propos au sujet de la fermeture de l'autoroute A13. Restera-t-elle fermée plus longtemps que ce qui était prévu ? Pouvez-vous indiquer une date pour sa réouverture ? Nous sommes loin d'avoir la même impression que vous quant aux stratégies mises en place pour surmonter une situation qui pénalise nombre de franciliens qui utilisent quotidiennement cette partie de l'autoroute.... Je défends l'utilisation des transports en commun, mais certains ne peuvent pas faire autrement que d'utiliser leur voiture.
Mme Laure Darcos. - Je souscris pleinement aux propos de ma collègue Marta de Cidrac. Madame la présidente de région, vous avez évoqué la rentrée scolaire, qui aura lieu en même temps que les jeux Paralympiques. La situation risque en effet d'être difficile. Vous m'avez un peu rassurée, mais je reste inquiète notamment au sujet des transports scolaires en grande couronne. Pouvez-vous nous assurer que les cars scolaires seront disponibles pour tous les Franciliens au moment de la rentrée ?
Mon inquiétude porte également sur le télétravail dans les entreprises. J'ai entendu le message gouvernemental qui passe en boucle à la radio, mais ne faut-il pas être plus alarmiste vis-à-vis des entreprises qui n'ont toujours pris aucune disposition envers leurs salariés ? Ceux-ci éprouvent de l'angoisse à l'idée de devoir se rendre à leur travail cet été, mais n'osent pas demander eux-mêmes à leur employeur de télétravailler. La région ne pourrait-elle pas émettre des injonctions plus fortes afin d'alerter les entreprises, et leur indiquer que la situation risque d'être extrêmement compliquée si leurs salariés doivent emprunter les transports ?
M. Pierre Ouzoulias. - Étant conseiller départemental des Hauts-de-Seine, je ne m'exprimerai pas sur la situation engendrée par l'affaissement de l'autoroute A13.
Vous avez tout à fait raison, monsieur le ministre, l'application anticiperlesjeux.gouv.fr que vous avez mise en ligne est un franc succès : compte tenu des difficultés de transport annoncées sur cette application, les franciliens en déduisent que la meilleure solution est de partir ! Il me paraît contradictoire de dire que les JOP seront une immense fête populaire, à laquelle tout le monde doit participer, sauf en Île-de-France et dans les autres endroits où l'on n'aura pas les moyens de transporter la population...
Sur la ligne B, dont je suis un usager, les difficultés sont quotidiennes. On n'imagine pas qu'il puisse y avoir une affluence supplémentaire sur cette ligne, qui est déjà dans l'incapacité d'assurer ses missions de service public. Les usagers sont très inquiets. Votre site ne les a pas du tout rassurés ; au contraire ! Il leur donne le sentiment que les choses se passeraient beaucoup mieux sans eux.
Je pense que ce n'était pas le bon message à faire passer. On semble oublier que les JOP, c'est aussi le rassemblement de personnes qui s'unissent sur des valeurs universelles. À cet égard, on aurait pu faire montre d'une plus grande solidarité, y compris envers les Franciliens.
Mme Mathilde Ollivier. - Cet été, particulièrement pendant la période des jeux Olympiques, nous serons en période de chassés-croisés sur les routes, mais aussi dans les trains. Il a été indiqué qu'il n'y aurait pas de trains supplémentaires sur les lignes à grande vitesse de la SNCF. Je m'interroge sur la capacité de l'offre ferroviaire à assurer un trajet à l'ensemble des voyageurs, entre ceux qui voudront passer par la capitale pour rejoindre leur destination de vacances et ceux qui voudront se rendre à Paris pour les jeux Olympiques.
Les JOP constituaient l'occasion de laisser un héritage solide pour la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. Le taxi, les navettes dont vous nous avez parlé ne sont pas des solutions pérennes au défi de l'accessibilité des transports aux personnes handicapées. Comment combler ce retard ? Quel sera l'héritage pour le transport des personnes en situation de handicap après les jeux Olympiques et Paralympiques ?
Le projet de création, à titre expérimental, d'un vertiport, m'a stupéfaite. J'ai bien compris que cette expérimentation de taxis volants ne concernera que des invités, mais cela fera de Paris la première capitale au monde à mettre en oeuvre du transport aérien urbain. Ce mode de transport, particulièrement énergivore et réservé à des nantis, est-il une bonne idée, à l'heure où l'objectif est de réduire fortement les émissions de CO2 ? Il ne fera qu'augmenter la disproportion de l'empreinte carbone en fonction du niveau de richesse. Pouvez-vous revenir sur cette expérimentation et ses objectifs ? Avant de s'occuper du ciel, il est peut-être plus important de se concentrer sur la terre et le sous-sol.
M. Laurent Lafon, président de la commission de la culture. - C'est parfois complémentaire !
M. Adel Ziane. - Je me joins aux propos de mon collègue Philippe Tabarot. Nous en arrivons à une phase importante de la dimension événementielle, comme on l'a vu à Marseille.
Je veux insister sur le côté festif de l'événement et sur la prise de conscience par les Français et les Françaises de l'enjeu. Dans mon département de la Seine-Saint-Denis, l'héritage - que ce soit le village olympique, que nous avons inauguré il y a quelques semaines ; le franchissement urbain de Pleyel ; le centre aquatique, à Saint-Denis ; ou encore le village des médias - permettra d'accélérer l'amélioration du quotidien des habitants. Autre élément de cet héritage : le prolongement de la ligne 14, jusqu'à Pleyel - la gare a été inaugurée hier - et jusqu'à Orly prochainement.
On a compris qu'il y aurait trois types de flux durant les jeux Olympiques : celui des athlètes et de leurs accompagnants, celui des millions de spectateurs, dont on ignore encore le nombre précis, et, bien évidemment, celui des voyageurs habituels du réseau.
À la fin de l'année 2023, 5 lignes de métro étaient sous le seuil des 90 % de régularité. La ligne 13 sera stratégique pour desservir le stade de France durant les JOP, avec des journées où ce stade se remplira et se videra jusqu'à trois fois. Comment cet afflux exceptionnel va-t-il être traité ?
Je m'associe aux propos de Laure Darcos sur le télétravail. J'ai l'impression que, dans le secteur public, le message est en train de passer, mais peut-être faudrait-il une campagne de communication plus forte à destination des entreprises du secteur privé pour faciliter le télétravail - les capacités existent aujourd'hui.
Les agents de la fonction publique seront fortement mobilisés pour la réussite des jeux Olympiques, dans les transports en particulier. Après l'été se posera la question des compensations, des congés. Or ce sera le moment des jeux Paralympiques, de la rentrée des classes et du retour des Franciliens en Île-de-France.
Ma dernière question porte sur l'application éphémère Transport public Paris 2024. Le directeur d'Île-de-France Mobilités nous a annoncé, en janvier dernier, qu'une collaboration était en cours entre le ministère des transports et des acteurs comme Google Maps et Citymapper. Où en sont les discussions sur cet outil complémentaire pour permettre aux Franciliens et aux Franciliennes comme aux touristes qui viendront participer à l'événement de se repérer dans les différents lieux et sites olympiques de l'Île-de-France ?
Mme Colombe Brossel. - La fête va être belle. Nous allons vivre un événement extraordinaire, qui n'arrivera pas deux fois dans nos vies. Et nous allons tout faire pour que la fête soit réussie, populaire, et qu'elle laisse un héritage. Notre pays a bien besoin de tels moments !
Pour autant, pour que la fête soit belle, il faut qu'elle soit belle pour tout le monde. Évidemment, en tant que sénatrice de Paris, je m'interroge sur la compatibilité de tout cela avec les transports du quotidien des Parisiens et des Franciliens. De fait, une partie d'entre eux seront présents, comme tous les étés, et utiliseront les transports...
Je crois que personne ne remet en question la nécessité, à un certain nombre d'étapes - on a parlé de la cérémonie d'ouverture -, de fermer des stations de métro, pour des questions de sécurité. J'ai compris qu'il y avait un sujet sur la station Champs-Élysées-Clemenceau. Comment parvient-on à éviter des fermetures de stations ou de zones de transit qui seraient tellement longues qu'elles perturberaient la capacité des usagers du métro à se déplacer ? Comment sont organisés les itinéraires bis et, surtout, les connexions bis ? Comment communique-t-on spécifiquement sur ce sujet, qui n'est pas anecdotique ? J'avais compris qu'il y avait des interrogations concernant la station Franklin D. Roosevelt, mais je vous vois dire non de la tête. Sommes-nous vraiment parvenus au bout des discussions sur la durée de ces fermetures ?
Lors de son audition, j'avais interrogé le préfet Michel Cadot sur l'accompagnement des visiteurs, notamment dans les moments de flux très importants. Sa réponse m'avait laissée un peu sur ma faim... Quelques mois plus tard, je compte sur vous pour nous donner davantage d'éléments concrets.
On sait que c'est dans les endroits dans lesquels l'afflux sera important qu'il y aura des difficultés. Je pense notamment à l'ouest de Paris, avec le parc des Princes et Roland-Garros. Nous avons compris que l'offre de transport supplémentaire ne permettra pas d'absorber tous les flux et qu'il y aura un important dispositif humain pour permettre de les organiser et de les réguler. Dont acte ! Êtes-vous aujourd'hui en mesure de nous dire quels seront les ordres de grandeur de la mobilisation humaine sur ce point nodal ? C'est vraiment l'un des points de difficulté identifiés par tous depuis le début. J'imagine que des agents de la SNCF, de la RATP, des volontaires et, peut-être, les forces de sécurité seront mobilisés ?
Le préfet Cadot laissait entendre qu'il y aurait une mobilisation assez large. Combien y aura-t-il de bataillons ? Comment tout cela va-t-il s'organiser ?
Mme Valérie Pécresse. - Je veux encore une fois remercier publiquement Élisabeth Borne et Clément Beaune ainsi que le Parlement d'avoir voté les financements d'Île-de-France Mobilités pour l'après-Jeux. Il ne suffit pas d'ouvrir des lignes nouvelles ; encore faut-il pouvoir les faire fonctionner ! Nous avions besoin de cette contribution des entreprises pour rester à l'équilibre. Cela me permet de ne pas faire peser le financement de ces lignes sur les seuls usagers.
Je laisserai le ministre Patrice Vergriete répondre à Jean-Jacques Lozach sur l'offre de taxis, puisque cela relève de sa responsabilité. Je note tout de même que nous disposerons de 1 000 taxis à hydrogène, dont la région finance les bornes de recharge ainsi que le développement. Ce sera la première flotte urbaine de taxis hydrogène au monde ! C'est une première mondiale. Cela permettra de commencer à développer une offre de mobilité hydrogène en Île-de-France.
Pour ce qui concerne le plan vélo, 400 kilomètres de pistes cyclables sont prévus uniquement pour les Jeux - lancés à 50 % par la région -, et 30 000 places de parking sont déjà construites. Chaque fois que Patrice Vergriete et moi-même inaugurons des gares, nous inaugurons aussi d'immenses parkings vélo. Celui de la gare du Nord sera l'un des plus grands de France. Ces parkings seront évidemment sécurisés et offriront un « écosystème vélo », avec, notamment, la possibilité de faire réparer son vélo.
Je ne m'exprimerai pas sur Vélib, qui ne relève pas de ma responsabilité. En revanche, je puis vous dire qu'il y aura 2 000 vélos électriques Véligo supplémentaires en location longue durée durant les mois de juillet et d'août, pour permettre notamment aux bénévoles et à tous ceux qui travailleront pour les Jeux de se rendre sur les sites.
J'ajoute que nous ouvrirons, en juin, une plateforme qui s'appellera Emplois post-JO pour tous les métiers de transport, de l'hospitalité et de la sécurité. Nous avons déjà toute une série de grands partenaires qui recruteront les salariés et les bénévoles des JOP sur cette plateforme : Accor, Disney, Sodexo, mais aussi toutes les polices municipales, les grands opérateurs de transport... De fait, entre 35 000 et 50 000 personnes ayant reçu une formation ou obtenu un contrat JOP risquent de rester sur le carreau. La région organisera des formations passerelles, et les CV et les demandes des employeurs pourront être déposés dès juin. Ce dispositif est très important. Je pense notamment aux métiers de la sécurité, où la demande est énorme ; les collectivités, notamment, pourront se nourrir de ces 25 000 personnes supplémentaires que nous avons formées.
Monsieur Gillé, que ce soit à Londres ou à Tokyo, le protocole de sécurité pour les malaises voyageurs commande de sortir l'usager de la rame. Ce n'est pas le cas en France. Je ne connais pas l'historique de notre protocole de sécurité. Peut-être a-t-il été copié sur le protocole des pompiers pour les accidents intervenus dans la rue ?
Pour ma part, je défends depuis très longtemps les pratiques que j'ai pu observer à Londres et à Tokyo. L'objectif n'est pas de privilégier le fait de faire rouler la rame - ce sera la conséquence positive. Si l'on sort la personne de la rame, la rame poursuivra son chemin, mais ce qui importe, c'est de choisir le meilleur pour la sécurité de cette personne. Or, quand on la laisse dans la rame, on vide la rame, donc on remplit le quai, ce qui empêche les services secours d'atteindre le voyageur et risque de créer d'autres malaises. À l'inverse, si l'on sort la personne de la rame - il existe tout un protocole, supervisé par les pompiers et le Samu -, les services secours pourront accéder très vite à celle-ci, puisque le quai sera libre. On protège donc à la fois la personne et la régularité des trains, ce qui est gagnant-gagnant.
Ce protocole entrera en vigueur à la suite d'un processus de dialogue social à la RATP. Malheureusement, la SNCF ne pourra le mettre en vigueur que sur la station du RER B de la gare du Nord. J'aurais souhaité que ce soit beaucoup plus rapide, mais la modification d'un protocole de sécurité implique de la concertation et de la formation.
C'est d'autant plus important compte tenu du risque de canicule. J'ai réuni hier Jean Castex et Jean-Pierre Farandou et toutes les équipes de la RATP et de la SNCF pour que nous nous dotions d'un plan canicule. Celui-ci conduira à ce que 100 fontaines à eau, financées par Île-de-France Mobilités, soient installées dans les 50 gares des Jeux. Il y aura également des brumisateurs, des aspergeurs de gouttes d'eau, en lien avec les villes hôtes des Jeux. Cependant, un brumisateur implique d'avoir un point d'eau et un accès à l'eau, ce qui n'est pas toujours simple. La Ville de Paris a aussi travaillé sur l'accès aux points d'eau près des stations de bus. On voit que nous sommes tous en train de nous mobiliser. Bien évidemment, il faudra aussi distribuer des bouteilles d'eau. Nous sommes en train de réfléchir au stockage, à la logistique, pour pouvoir gérer une éventuelle situation caniculaire.
Je rappelle qu'il y a huit ans, avant que je ne sois présidente de région, Île-de-France Mobilités achetait des bus diesel non climatisés. Maintenant, nous n'achetons que des bus électriques et climatisés. Cela change la donne. Nous allons essayer de mettre le maximum de ces bus climatisés sur les Jeux - en tout cas, il n'y aura que des bus propres, tous les bus n'étant pas encore climatisés.
Nous pensons à l'inverse que les Jeux auront un impact très positif pour les commerçants, même si ce n'est pas forcément pour tout le monde ni dans tous les secteurs.
Je veux évoquer le précédent positif de la Coupe du monde de rugby. À écouter les hôteliers et les autres acteurs, la Coupe allait être une catastrophe sur le plan des transports et du tourisme ! Or tout s'est très bien passé. Nous avons eu 500 000 visiteurs de plus que d'habitude, avec des retombées économiques absolument spectaculaires, qui ont d'ailleurs peut-être conduit nos hôteliers à placer la barre un peu haut en termes de coût des nuitées. Les impacts négatifs, pour les commerçants, tiendront à des questions de logistique et de limitation de transport, sujets de sécurité qui ne relèvent pas de ma compétence.
M. Barros m'a demandé de faire un bilan des transports en Île-de-France. Hier, j'ai réuni Jean-Pierre Farandou, Jean Castex, la SNCF et la RATP. L'enquête annuelle de satisfaction, qui porte sur 150 000 voyageurs, a montré un taux de satisfaction de 86 % des voyageurs de la RATP et de 78,5 % pour la SNCF. S'il faut évidemment se focaliser sur les voyageurs mécontents - c'est ma préoccupation quotidienne -, je considère que, dans certains autres services publics, de tels taux de satisfaction seraient considérés comme énormes. Je le dis pour ceux qui voient toujours le verre à moitié vide, quand on pourrait le voir aux trois quarts plein.
Je ne nie pas que nous ayons trois lignes très en souffrance - les lignes B, C et D -, pour lesquelles il existe des plans de remédiation spécifiques. Sur le RER B, nous avons gagné deux points de régularité en commençant à mettre en place des mesures de mise en cohérence RATP-SNCF, dont je pensais qu'elles avaient été mises en oeuvre depuis longtemps, mais dont le rapport d'Yves Ramette a révélé qu'elles n'avaient pas encore été complètement prises. Nous continuons évidemment à avoir un plan de redressement pour toutes ces lignes. Le RER C était à 90 % de régularité le mois dernier ; même si elle demeure fragile, la situation s'améliore.
Monsieur Ziane, à la date d'hier, 10 lignes de métro étaient au-dessus de 90 % de régularité. S'il reste encore trois lignes de métro fragiles, et si la ligne 8 est en difficulté, le redressement est donc très tangible, des conducteurs et des mainteneurs ayant été recrutés. Ces changements améliorent évidemment la qualité de service.
Pour ce qui concerne les bus de Paris, le taux de non-réalisation du service est passé de 25 % l'année dernière à 8 % le mois dernier, dont 6 à 7 % liés uniquement aux difficultés de circulation dans Paris.
Michel Savin a relayé la question d'Agnès Evren sur l'organisation. Un transport manager, dépendant du ministre des transports, gérera tous les transports en commun de l'Île-de-France, toute la circulation - ce sujet totalement à part ne dépend pas du tout de nous - et l'organisation de la coordination de l'ensemble. Ce centre de coordination des transports olympiques (Coto) aura son siège au bâtiment Pulse, à l'instar du Cojo.
La sécurité relève quant à elle du Centre de coopération opérationnelle de la sécurité (CCOS), centre de commandement unique de la préfecture de police, infrastructure unique cofinancée par l'État et la région. Nous avons installé 80 000 caméras sur l'ensemble du réseau de transport. L'examen de la proposition de loi Tabarot, traduit une demande d'Île-de-France Mobilités, qui a financé le centre et gère déjà 1 300 agents de sécurité et des médiateurs afin de pouvoir entrer dans ce centre. Le préfet y est très favorable. De fait, il est extrêmement paradoxal que nous gérions 1 300 personnes, que nous financions à peu près toutes les dépenses de sécurité et que nous soyons interdits de CCOS !
Pierre Ouzoulias a évoqué le RER B. Il faut vraiment comprendre que l'affluence supplémentaire est calculée par rapport à un mois d'août normal.
Cela me permet de répondre aux questions sur le télétravail. Nous avons défini le plan de transport en considérant que tous les Franciliens se rendraient au travail. Nous avons fait comme s'il s'agissait d'un mois d'août normal, et nous avons ajouté le déplacement dans les infrastructures. Nous avons suivi un principe de précaution maximum pour avoir l'offre maximale. Évidemment, j'appelle les Franciliens qui le peuvent à télétravailler, mais nous ne forcerons personne, le plan de transport ayant été conçu pour que tout le monde puisse aller travailler.
En ce qui concerne l'accessibilité, l'héritage des Jeux est colossal, grâce au plan de 1,8 milliard d'euros cofinancé par l'État et la région. Ce plan nous a permis de faire en sorte que toutes les gares des Jeux soient 100 % accessibles. À cet égard, les Jeux ont pour impact de faire aboutir ces travaux d'accessibilité, qui étaient d'ores et déjà programmés.
Aujourd'hui, 95 % des voyageurs qui prennent le métro le font dans des gares 100 % accessibles, ce qui est énorme. Cela ne veut pas dire que 95 % des gares sont accessibles : c'est 95 % des flux qui le sont.
Il est très facile de caricaturer l'innovation qu'est le vertiport. Pour ma part, j'adore les innovations technologiques, surtout quand elles sont zéro pollution et zéro carbone. C'est le cas de ce taxi volant à décollage vertical, totalement électrique et décarboné. Étant, comme moi, très soucieuse de faire en sorte qu'il n'y ait plus de bouchons sur l'A1, vous serez évidemment intéressés par l'idée d'un transport qui a vocation à être collectif...
Le projet a été mal présenté, ce qui a créé une ambiguïté. M. le ministre me l'a d'ailleurs reproché, et il a eu raison. Cependant, c'est Aéroports de Paris et la RATP qui étaient à l'origine de ce projet. Je n'ai fait que saisir la balle au bond...
Le projet consiste à se doter d'une navette collective pour aller jusqu'à Roissy au départ d'un vertiport, cette navette pouvant transporter huit à dix personnes - ce ne sera jamais un Concorde ! L'objectif est de transporter les passagers des taxis en mettant huit voitures de moins sur la route. Le modèle économique ne consiste donc pas à transporter les nantis qui prennent leur jet au Bourget ! L'idée est de remplacer le taxi, donc de viser plutôt les classes moyennes aisées. Nous ignorons si ce projet de transport collectif zéro carbone plutôt haut de gamme, permettant de remplacer des voitures sur la route, de gagner du temps et d'avoir moins d'embouteillages fonctionnera.
Quoi qu'il en soit, il pourrait être utilisé pour le transport sanitaire dans les hôpitaux parisiens. Aujourd'hui, on utilise, à cette fin, des hélicoptères, dont on sait - je parle sous le contrôle de Colombe Brossel - qu'ils génèrent une pollution maximale et un bruit maximal... Le ministre est très favorable à cet usage d'intérêt général de ce transport électrique zéro carbone, qui occasionne très peu de bruit. Il a raison.
Être opposé au progrès technologique par idéologie n'apporte pas de solutions. Peut-être que ce projet n'aboutira pas, mais mon modus operandi, c'est d'essayer de trouver de nouvelles solutions.
La fermeture de la station Champs-Élysées-Clemenceau dépend du préfet de police. Nous essayons aujourd'hui d'obtenir du Cojo qu'il retarde au maximum l'arrivée de l'infrastructure de façon que l'on puisse laisser la gare ouverte le plus tard possible.
Une grande partie des 450 navettes gratuites seront dédiées à l'axe ouest - Charles-de-Gaulle-Étoile-Roland-Garros, Porte d'Auteuil-Roland-Garros... Cependant, je ne pense pas que ce sont les personnels de la RATP ou de la SNCF qui feront la gestion des flux entre l'infrastructure RER C et les stades - il y aura du monde qui remontera le boulevard Murat ou l'avenue de Versailles ! Cela relèvera de la signalétique JO. Je répète que, sur certains trajets, tous ceux qui sont en bonne santé et qui ont envie de profiter de l'été parisien et du Bois de Boulogne pourront faire quelques centaines de mètres à pied. Au reste, les statistiques montrent que les 25-35 ans constituent la première tranche d'âge des détenteurs de billets. On peut imaginer que certains d'entre eux aient envie de profiter de Paris, de se balader sur les quais de Seine...
M. Patrice Vergriete, ministre délégué. - Je commencerai par répondre à la question sur l'accord à la SNCF et la gestion des fins de carrière pour les métiers pénibles de M. le sénateur Tabarot, qui aime bien caricaturer.
M. Philippe Tabarot. - Le préavis du 21 mai prochain, ce n'est pas de la caricature ! C'est la réalité.
M. Patrice Vergriete, ministre délégué. - Nous sommes d'accord sur la réalité du préavis du 21 mai prochain. Pour ce qui concerne l'accord sur la gestion des fins de carrière, je répète qu'un accord signé en 2008 prévoyait déjà des départs anticipés jusqu'à 12 mois, que la décision de renégociation de cet accord est intervenue à l'issue des grèves de 2022 et n'est donc pas directement liée aux jeux Olympiques et que le coût s'élève à 35 millions d'euros, pour 1,3 milliard d'excédents à la SNCF. Je crois savoir comment il va être financé... Enfin, quasiment tous les grands groupes français se sont dotés d'un tel accord sur la gestion des fins de carrière des métiers pénibles - je pense à Airbus, Air France, Stellantis, Renault, etc. C'est dans leur intérêt, un tel accord étant préférable à des arrêts maladie ou à des licenciements. Je vois donc peu le rapport avec les JO.
Quant à la décision concernant la non-reconduction de Jean-Pierre Farandou à la tête du groupe SNCF, elle a été prise bien avant cet accord, puisqu'il était simplement atteint par la limite d'âge.
M. Philippe Tabarot. - Deux heures avant notre commission...
M. Patrice Vergriete, ministre délégué. - Comme vous avez pu le constater, je n'ai pas été signataire du communiqué de presse, mais je disposais de cette information avant l'accord salarial. Je vous livre les choses telles qu'elles sont, tout à fait honnêtement et sincèrement.
Nous sommes en train de travailler sur les points réglementaires liés à la sécurité avec les opérateurs, en particulier, évidemment, avec le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice. Il s'agit de faire respecter le droit et les libertés. J'espère arriver au bout de ce travail de manière pleinement satisfaisante. Cela dit, je partage votre objectif, comme vous le savez déjà, puisque nous avons engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi que vous avez déposée et qui est en cours d'examen par les députés justement pour pouvoir être au rendez-vous des jeux Olympiques. Je tiens à dire que nous travaillons en parfaite complémentarité sur ces questions.
Je le répète, la gestion de la logistique urbaine fera sans doute partie de l'héritage des Jeux. Le dispositif JOPtimiz permettra de définir des itinéraires, de savoir s'il faut un QR code pour entrer dans tel ou tel périmètre, de faciliter le contact avec les forces de l'ordre... Ce nouveau dispositif sera très utile après les Jeux pour faciliter la logistique urbaine. La France a beaucoup de progrès à faire en la matière, et créer des outils de ce type à l'occasion des jeux Olympiques peut nous permettre, demain, d'améliorer les choses. Il faudra aussi penser à la structuration de plateformes de logistique urbaine autour de nos grandes métropoles - c'est une autre question, que nous aurons sans doute l'occasion d'évoquer plus tard.
Nous en sommes aujourd'hui à 800 taxis sur 1 000, y compris avec les formations mises en oeuvre. À la date d'aujourd'hui, le coût s'élève à 5,9 millions d'euros pour 380 dossiers. Nous verrons ce qu'il en sera quand le nombre de taxis sera de 1 000.
Sur l'A13, il n'y a absolument pas de satisfecit ! Comment pourrais-je me satisfaire de la perte d'une infrastructure majeure pour la desserte de l'Île-de-France, dont, du reste, l'État n'est pas responsable ?
Mme Marta de Cidrac. - Vous sembliez satisfait de la gestion de cette fermeture !
Mme Laure Darcos. - Vous avez dit que cela s'était bien passé !
M. Patrice Vergriete, ministre délégué. - Pas du tout ! Comment pourrait-on être satisfait de la gestion d'une infrastructure qui dysfonctionne ?
Ce que j'ai voulu souligner, c'est la capacité de nombreux Franciliens à s'adapter qu'a montrée la comparaison établie dans le cadre de la modélisation. Je n'ai pas nié le problème, et je sais qu'il est extrêmement difficile pour vous, qui le subissez au quotidien ! Je constate simplement que la capacité d'adaptation de la population est systématiquement sous-estimée.
La réouverture de l'autoroute A13 est d'ores et déjà effective dans le sens Province-Paris pour les voitures - la voie est désormais empruntée par beaucoup de camions, raison pour laquelle les contrôles des forces de l'ordre devront sans doute être renforcés. Dans le sens Paris-Province, cette réouverture aura lieu probablement lors de la seconde quinzaine de juin. C'est ce qui a été annoncé par le ministère des transports, et je pense que cette échéance devrait être respectée.
De manière générale, je veux revenir sur la philosophie qui a guidé la région et l'État dans l'accompagnement des Franciliens. Nous essayons d'apporter des solutions collectivement à travers un plan de transport, mais nous ne pourrons évidemment pas nous adresser individuellement à chaque Francilien. Ce qu'il faut, c'est donner à chaque Francilien les éléments suffisants pour lui permettre de s'adapter, en connaissance de cause, dans son parcours spécifique dans la région.
L'outil numérique qui permet de connaître en temps réel l'état du trafic, l'état de la saturation et, ainsi, de modifier éventuellement ses horaires de travail et l'outil de parcours d'Île-de-France Mobilités qui permet de conseiller un trajet sont parfaitement complémentaires et permettent d'individualiser la réponse. Au reste, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. L'idée est donc de communiquer à chaque individu l'état du trafic et le parcours conseillé pour atteindre sa destination. C'est la philosophie qui nous a guidés pour essayer d'accompagner la population.
Sur l'avion à décollage et atterrissage verticaux, ou VTOL (Vertical Take-off and Landing), je partage ce qu'a dit la présidente de région. Avec le transport sanitaire, ce type de mobilité peut représenter une opportunité d'intérêt général demain. Je le dis très clairement : refuser l'expérimentation d'une innovation qui pourra sauver des vies ne me semble pas responsable. On peut débattre des usages d'une telle innovation, mais la refuser par principe me semble regrettable.
L'expérimentation permettra de mesurer le bruit, la gêne, les risques en termes de sécurité, la manière dont cela fonctionne concrètement - et si cela fonctionne, d'ailleurs. Il s'agit d'analyser le potentiel d'une telle innovation. Pour ma part, le transport sanitaire dans des villes comme Paris me paraît un usage stratégique pour demain. Je pense vraiment que cela peut sauver des vies.
J'en viens à l'accessibilité. Nous avons, ce matin, inauguré la gare de Saint-Denis. L'accessibilité est pérenne : après les Jeux, la gare ne redeviendra pas comme elle était avant. Le renfort d'accessibilité qui résulte de l'effort consenti pour les JO survivra à ces derniers. Au final, nous aurons largement renforcé l'accessibilité.
Certes, nous n'avons pas été tout à fait au rendez-vous dans toutes les gares en termes de sonorisation ; je pense en particulier à ce qui devait être fait pour les personnes aveugles dans le métro. Mais nous continuerons l'effort après les JO, pour résorber notre retard dans un certain nombre de stations. En tout état de cause, nous répondons aux besoins dans toutes les stations concernées par les Jeux.
Comme la présidente de région l'a expliqué, les plans de transport ont été calibrés pour tous les Franciliens qui travaillent, en rajoutant la surdemande. J'insiste sur le fait que l'on sera au mois d'août !
Mme Laure Darcos. - Et en septembre !
M. Patrice Vergriete, ministre délégué. - Certes, mais reconnaissons ensemble que l'affluence ne sera pas la même pour les jeux Paralympiques, à la rentrée.
Globalement, les plans de transport ont intégré les Franciliens, à qui l'on donnera des éléments de connaissance.
Au demeurant, d'autres mobilités sont possibles. Si tous les Franciliens ne sont pas en capacité de faire du vélo, pour d'autres, il n'y a pas d'obstacles. Pourquoi ne serait-ce pas le moment de sortir son vélo ? On sera en plein mois d'août ; c'est tout à fait possible ! L'offre de vélos que j'ai évoquée tout à l'heure - 26 000 vélos en libre-service - est considérable.
En résumé, tout a été calibré pour répondre aux besoins de transport collectif, mais il existe des alternatives.
Et je ne vois pas pourquoi on se sentirait obligé de quitter l'Île-de-France ! Je pense que tout a été prévu pour que chacun puisse profiter de ce qui sera une belle fête populaire.
Mme Valérie Pécresse. - Certains Franciliens mettront du beurre dans les épinards en louant leur appartement ... C'est aussi un héritage des Jeux !
- Présidence de M. Didier Mandelli, vice-président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, et de M. Michel Savin, vice-président de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport -
M. Didier Mandelli, vice-président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. - Les présidents des deux commissions ayant dû partir pour la Conférence des présidents, je vais conclure cette réunion, en mon nom et en celui de mon collègue Michel Savin, qui représente le président de la commission de la culture.
Madame la présidente, monsieur le ministre, je vous remercie pour toutes vos réponses à ces questions légitimes des membres de nos deux commissions. Nous partageons tous le souci d'atteindre l'objectif que nous sommes fixé collectivement : faire de ces Jeux une réussite, dans l'intérêt de notre pays.
Cette audition a fait l'objet d'une captation vidéo disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 18 h 20.