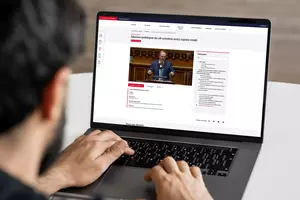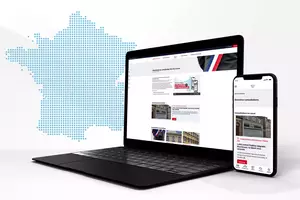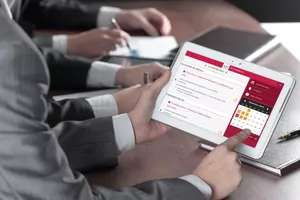- Mardi 30 avril 2024
- Programme de stabilité et orientation des finances publiques - Communication
- Bilan annuel d'application des lois - Communication
- Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l'argile - Désignation d'un rapporteur
- Questions diverses
- Mission d'information sur la dégradation des finances publiques depuis 2023, son suivi par l'administration et le Gouvernement et les modalités d'information du Parlement sur la situation économique, budgétaire et financière de la France - Audition de M. Pierre Moscovici, président du Haut conseil des finances publiques et Premier président de la Cour des comptes
Mardi 30 avril 2024
- Présidence de M. Claude Raynal, président -
La réunion est ouverte à 9 heures.
Programme de stabilité et orientation des finances publiques - Communication
M. Claude Raynal, président. - Comme il est de tradition, M. le rapporteur général va nous présenter son analyse sur le projet de programme de stabilité avant le débat en séance publique, dont la commission des finances est à l'origine.
Cette présentation intervient cette année dans un contexte bien particulier. En effet, on constate une dégradation des finances publiques particulièrement marquée depuis la fin de l'année 2023 et la loi de programmation des finances publiques (LPFP) fraîchement votée est déjà totalement obsolète. Il convient de noter que nous n'avons reçu le programme national de réforme (PNR) qu'hier soir ; nous vous l'avons fait parvenir ce matin par courriel. Cet envoi est particulièrement tardif, dans la mesure où il est supposé accompagner le programme de stabilité (PStab) qui a, lui, été présenté en conseil des ministres le 17 avril dernier.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Je vais donc vous exposer mon analyse du programme de stabilité, présenté il y a deux semaines en conseil des ministres par le ministre de l'économie et des finances, et qui doit être transmis aujourd'hui à la Commission européenne, de même que le programme national de réforme.
Renouant avec la pratique vertueuse d'il y a quelques années, pour le programme de stabilité, le Gouvernement a respecté le délai de quinze jours laissé au Parlement pour lire et commenter le document avant la date de transmission officielle. Sans doute les changements impressionnants dans les chiffres du déficit public pour 2023 et 2024 y sont-ils pour quelque chose. Je note toutefois que nous n'avons reçu qu'hier le programme national de réforme, autant dire sans avoir le temps d'en prendre vraiment connaissance.
La construction européenne repose sur des règles communes de coordination budgétaire, prévues par le pacte de stabilité et de croissance (PSC), qui vient d'être réformé. Le programme présenté est ainsi le dernier dans sa forme actuelle. En conclusion, je reviendrai sur l'évolution des règles budgétaires européennes et sur ce qui nous attend dès l'an prochain.
Le programme de stabilité qui nous est présenté me paraît symptomatique des errements et des renoncements du Gouvernement en matière de finances publiques et de politique économique.
J'évoquerai d'abord les performances économiques de notre pays. Certes, si l'on se limite à l'année 2023, nous faisons légèrement mieux, avec une croissance de 0,9 %, que la zone euro, laquelle enregistre une hausse de 0,5 %. Mais cela est principalement dû à la récession allemande (- 0,1 %), qui pourrait se prolonger en 2024. Au contraire, l'économie italienne a crû l'an dernier au même rythme que la nôtre, tandis que les économies portugaise, grecque et espagnole, par exemple, se montrent plus dynamiques, avec une croissance comprise entre 2,3 % et 2,5 %. Nous sommes loin derrière.
Entre la fin 2019 et la fin 2023, le PIB de la France a, certes, augmenté de près de deux points de plus que celui de l'Allemagne, mais il a progressé d'un point de moins que celui de la zone euro sur cette même période. Je ne veux pas, en citant ces chiffres, être catastrophiste. Mais l'optimisme forcené du Gouvernement en matière de prévisions tant de croissance que de déficit ne saurait masquer le faible dynamisme de notre économie. La stratégie, sans cesse répétée, selon laquelle la France aurait une croissance forte grâce à la politique économique du Gouvernement ne résiste pas aux faits. La France fait moins bien que l'Europe. Elle s'en sort juste mieux, à court terme, que l'Allemagne. J'aimerais beaucoup, pour ma part, que le Gouvernement se compare davantage à ce pays s'agissant des finances publiques...
Pour ce qui concerne la croissance du PIB en volume, le Gouvernement revient très fortement sur le scénario de la LPFP 2023-2027, dont je rappelle qu'elle a été promulguée le 18 décembre dernier.
Pour 2024, le ministre a, dès février, annoncé que la prévision de 1,4 % serait caduque, mettant en avant une prévision de 1 %. Cette révision, même à la baisse, est plus haute que toutes les autres prévisions officielles. Et elle est déjà battue en brèche par les principaux instituts de conjoncture, au point que seul Natixis envisage une croissance plus élevée. Le consensus des économistes, qui agrège les prévisions réalisées par une vingtaine d'instituts, retient pour l'instant 0,7 % de croissance. Le plan d'économies de 10 milliards d'euros, adopté fin février, et des économies supplémentaires annoncées pour l'année contribueront par ailleurs à réduire la croissance à très court terme.
Plus généralement, le scénario pour 2024-2027 n'est pas non plus partagé par les conjoncturistes et paraît très optimiste. Ainsi, le Gouvernement anticipe 1,5 % de croissance par an en moyenne, avec une augmentation, en cumulé, de 6 %. Or le consensus des économistes anticipe une croissance de seulement 1,2 % par an, et une augmentation en cumulé de 5 %.
Le principal écart, c'est la consommation des ménages, que le Gouvernement veut voir augmenter en moyenne de 1,8 % par an et qui ne progresserait, selon les conjoncturistes, que de 1,4 % par an. J'avais souligné lors de l'examen du projet de loi de finances (PLF) que la reprise de la consommation ferait peu de doute, du fait du reflux de l'inflation, mais qu'il y avait fort à parier que son ampleur serait modérée par des comportements d'épargne encore très attentistes, s'expliquant par une hausse du chômage et un niveau particulièrement faible de confiance des ménages. Le Gouvernement estime au contraire que le taux d'épargne diminuerait, sans expliquer pourquoi, et que le pouvoir d'achat se redresserait, du fait d'hypothèses particulièrement optimistes sur l'emploi, associées aux réformes de l'assurance chômage. Permettez-moi d'en douter.
Sur le début de la période du programme de stabilité, les effets du resserrement de la politique monétaire opéré entre juillet 2022 et septembre 2023 semblent également fortement sous-estimés. À titre d'exemple, le Gouvernement prévoit une contraction de 0,4 % de l'investissement en 2024, là où la Banque de France anticipe une baisse de 1,2 %, et l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) de 1,6 %. Ces baisses sont cohérentes avec la hausse du nombre de défaillances d'entreprises : si l'on exclut les microentreprises, on dénombre largement plus de défaillances en février 2024 qu'en moyenne entre 2010 et 2019.
Les hauts niveaux de croissance prévus sur la période couverte par le PStab reposent sur l'hypothèse que les capacités de rebond de l'économie sont particulièrement fortes, et que l'écart de production est encore loin d'être résorbé. Cela suppose donc que notre économie fonctionnerait, actuellement, en dessous de ses capacités, ce dont il est permis de douter au regard des difficultés actuelles à recruter dans beaucoup de secteurs. En 2027, l'écart de production s'élèverait à -0,6 point de PIB, alors même que, selon la Commission européenne, il serait d'ores et déjà résorbé en 2023. En ligne avec ces hypothèses, la croissance potentielle est évaluée par le Gouvernement à + 1,35 % par an, ce qui est élevé.
Une nouvelle fois, le scénario n'est pas partagé par la plupart des conjoncturistes. Ainsi, la croissance de long terme de la France serait limitée à 1,2 % par an en volume selon le Consensus Forecasts, comme pour le Fonds monétaire international (FMI), et à 0,9 % pour la Commission européenne. S'il convient de prendre ces chiffres avec distance, étant donné toutes les incertitudes entourant la mesure du PIB potentiel et de la croissance potentielle, le scénario de croissance potentielle du Gouvernement me paraît, comme l'a indiqué le Haut Conseil des finances publiques (HCFP), trop élevé.
Évidemment, tout est toujours possible, pourrait nous dire le Gouvernement, la prévision économique n'étant pas une science exacte. Mais le scénario macroéconomique qu'il présente repose sur un ensemble d'hypothèses trop favorables, trop optimistes, trop peu documentées et, en définitive, trop fragiles. Si les économies massives qui sont prévues étaient vraiment mises en oeuvre, elles pèseraient par ailleurs forcément sur la croissance, ce qui est de nature à discréditer encore davantage ce scénario. Il ne me semble pas sérieux d'utiliser des prévisions non rigoureuses uniquement parce que cela permet d'afficher une copie moins dégradée, et alors même que le rétablissement de nos comptes publics nécessiterait aujourd'hui de s'appuyer sur des hypothèses prudentes et consensuelles.
J'en viens maintenant à la trajectoire des finances publiques présentée par le Gouvernement, qui reflète singulièrement ses renoncements et ses errements.
Premier renoncement : le PStab 2023 est nul et non avenu, avec une dégradation du déficit d'en moyenne 0,4 point de PIB par an entre 2024 et 2027 dans le présent programme par rapport à celui de l'année dernière.
Le Gouvernement semble également avoir renoncé à respecter la LPFP, caduque quelques mois - voire quelques jours - à peine après sa promulgation, avec un déficit de 5,5 % du PIB en 2023 contre un niveau de 4,9 % initialement prévu. Loin d'offrir de la visibilité sur plusieurs années aux citoyens, aux acteurs économiques et à nos partenaires européens, notre loi de programmation, du fait de son obsolescence accélérée, ne sert à rien.
En matière d'endettement public, les prévisions sont plus alarmantes encore : la dette, qui devait progressivement diminuer pour atteindre 108,1 % du PIB en 2027, augmentera finalement sur la période, pour passer de 110,6 % de PIB en 2023 à 112 % en 2027, après un pic de 113,1 % en 2025.
Sans aller aussi loin, la loi de finances pour 2024 est déjà remise en cause, avec une prévision de déficit passant de 4,4 % à 5,1 % du PIB pour cette année. La France pourrait ainsi occuper la dernière place au niveau européen. On parle tout de même de 20 milliards d'euros de dégradation, alors que nous ne sommes qu'en avril ! Je ne crois pas prendre beaucoup de risques en avançant qu'avec une croissance très vraisemblablement inférieure à 1 % en 2024, le déficit sera finalement supérieur à 5,1 %. Il est, dans ces conditions, inacceptable que le Gouvernement ait renoncé à présenter un projet de loi de finances rectificative (PLFR) pour redresser les comptes. Le renoncement à redresser les comptes publics est probablement le plus grave de tous.
Je dois bien avouer que le cumul d'un exécutif qui, d'une part, méprise le Parlement - usage extrême de l'article 49.3, non-prise en compte de nos votes, non-présentation d'un PLFR - et qui, d'autre part, dégrade à ce point la situation budgétaire et financière du pays est pour moi une grande source d'inquiétude.
Au point où nous en sommes, il ne paraît même plus étonnant d'observer dans le présent PStab le renoncement à toute crédibilité : le scénario de finances publiques n'est pas documenté alors qu'il représente un effort sans précédent, encore accentué par rapport à la LPFP. En effet, en venant d'un déficit de 5,5 % en 2023 plutôt que de 4,9 %, le chemin sera encore plus étroit pour passer sous les 3 % en 2027.
Sans vision claire des politiques publiques prioritaires, il sera impraticable et inaccessible. Certes, le Gouvernement peut nous dire qu'il n'a pas encore détaillé toutes les économies à voter jusqu'en 2027. Mais, même pour 2024 - je vous rappelle que nous sommes déjà fin avril ! -, rien n'est clair : le Gouvernement a annoncé 10 milliards d'euros supplémentaires d'économies, en plus du décret de février, dont 5 milliards d'euros reposant sur le budget de l'État - on ne sait toujours pas de quoi il s'agit puisqu'il n'y aura pas de PLFR - et 2,5 milliards d'euros sur les collectivités, sans que cet effort soit documenté. Je crains donc que tout cela n'ait pas de réalité.
Le Gouvernement ne dit toujours rien des 16 milliards d'euros de crédits de 2023 reportés sur 2024, qui font plus que compenser les « efforts d'économies » annoncés. Il y a, grâce aux reports de crédits, encore plus de crédits disponibles en gestion en 2024 qu'il n'y en avait après l'adoption de la loi de finances initiale (LFI). Le Gouvernement s'est constitué une grosse cagnotte qui lui permet de financer ses dépenses sans repasser devant le Parlement.
Enfin, les nouvelles recettes liées à la taxation « des rentes » rapporteraient, selon le PStab, 3 milliards d'euros supplémentaires. Mais on ne sait toujours pas clairement de quoi il s'agit, exception faite de la taxation des énergéticiens, pour laquelle le Gouvernement avait prévu des recettes à hauteur de 12 milliards d'euros, puis de 8 milliards, et ensuite de 5 milliards, mais il n'a finalement encaissé que 600 millions d'euros ; il y a un problème...
Sur l'ensemble de la période, le manque total de crédibilité de l'effort affiché est encore plus patent. Le PStab prévoit que le déficit public serait de 5,1 % du PIB en 2024, de 4,1 % en 2025, de 3,6 % en 2026 et de 2,9 % en 2027. En termes structurels, l'ajustement représenterait près de 67 milliards d'euros entre 2024 et 2027, dont 27 milliards d'euros pour la seule année 2025.
J'ai regardé dans le rétroviseur : à la fin de l'année 2022, le Sénat avait adopté un projet de LPFP dans lequel l'ajustement structurel était inférieur ; il s'élevait à 58 milliards d'euros sur ces quatre années et permettait pourtant d'atteindre une cible largement plus ambitieuse - à - 1,7 % du PIB en 2027, au lieu de l'objectif de - 2,9 % du Gouvernement. Celui-ci nous avait vivement critiqués, l'effort que nous demandions aux Français étant, selon lui, trop important, voire même violent et radical ! Avec la dérive des comptes publics, ces temps sont révolus...
Je reviens au présent PStab. En excluant la charge de la dette qui, intégrée dans l'ajustement structurel, modère indûment l'impression d'effort, on obtient un ajustement structurel primaire de 97 milliards d'euros sur la période. On voit combien l'effort à fournir est massif et sans précédent en un si court laps de temps. Pourtant, comme le dit pudiquement le HCFP, « sa documentation reste à ce stade lacunaire ».
Côté recettes, peu de changements : le ratio de prélèvements obligatoires atteindrait, après 45,2 % du PIB en 2022 et 43,5 % du PIB en 2023, 44,1 % du PIB en 2027. Après des mesures de baisse des prélèvements obligatoires de 7,1 milliards d'euros en 2023, les mesures de hausse pour 2024 devraient représenter 9,2 milliards d'euros en 2024, dues essentiellement à la hausse de la fiscalité énergétique et aux mesures à venir sur les rentes. Aucune autre mesure en recettes n'est prévue pour les années suivantes. La baisse d'impôts de 2 milliards d'euros pour les particuliers semble absente du programme de stabilité.
L'effort de redressement porterait donc essentiellement sur les dépenses. Mais celui-ci n'est pas documenté. Le PStab ne comporte aucun développement, aucun tableau, aucune donnée permettant d'apprécier la trajectoire de dépenses des différentes catégories d'administration sur la période 2024-2027. Si le périmètre des dépenses de l'État adopté en loi de finances pour 2024 doit être, avec 492 milliards d'euros, inférieur de 4 milliards d'euros à celui adopté en loi de finances pour 2023, tout l'effort sur la période 2025-2027 reposerait sur les revues de dépenses.
Je tiens sur ce point à souligner un paradoxe de l'exécutif. Le Président de la République nous dit que le problème se situe au niveau non pas de la dépense, mais des recettes. Pourtant, tout l'effort de redressement présenté par le Gouvernement est un effort de baisse de la dépense. Toute la stratégie - ou, à défaut de stratégie, la communication gouvernementale - est en effet fondée sur une baisse historique de la dépense publique. Je finis par avoir du mal à comprendre...
S'agissant des collectivités, qui ne sont responsables que d'une petite part du déficit, avec - 0,4 point de PIB en 2024 - et encore ce déficit est-il essentiellement dû à la Société du Grand Paris (SGP) -, le dégagement d'un excédent de 0,4 point de PIB pour 2027 semble ne reposer que sur le cycle électoral de l'investissement local. Un tel effort me paraît plutôt relever du voeu pieux et arrange bien le Gouvernement pour contribuer à sa trajectoire de redressement.
En réalité, la majeure partie de l'effort déjà à l'oeuvre repose sur la sphère sociale, pourtant seul sous-secteur des administrations publiques à l'équilibre. La réforme des retraites et les réformes successives de l'assurance chômage devraient permettre de dégager d'importantes économies ; c'est bien le seul domaine où le Gouvernement, responsable de la dérive budgétaire inquiétante de l'État, semble actif.
L'effort est donc très mal réparti : les soldes des collectivités et de la sphère sociale doivent chacun augmenter de 0,8 point de PIB entre 2024 et 2027 (de - 0,4 à + 0,4 pour les collectivités, et de + 0,2 à + 1 pour la sphère sociale), mais celui de l'État seulement de 0,5 point.
Pourtant, depuis 2017, le déficit public est le produit presque exclusif de l'État, dont les dépenses sont surdimensionnées par rapport aux recettes, alors que les collectivités sont peu ou prou à l'équilibre et que la sphère sociale n'a accusé de déficit qu'en 2020 et 2021, en raison de la crise sanitaire. C'est donc sur le déficit de l'État qu'il conviendrait de se concentrer. Dans ces conditions, il est abusif de mettre en avant, comme l'a fait il y a deux mois Bruno Le Maire, les excès des dépenses sociales en se focalisant sur les transports médicaux, d'autant plus que l'État soustrait indûment à la sphère sociale des transferts de TVA visant à compenser des baisses et des exonérations de cotisations - je pense, par exemple, à l'Unédic.
Au total, les données que contient le PStab ne permettent en aucun cas d'espérer atteindre le seuil de 3 % de PIB en 2027 ; en tout cas, je n'y crois pas du tout, et je me demande si l'exécutif lui-même y croit ou se contente de faire de la communication. Les dernières prévisions du FMI, d'ailleurs, si elles sont en ligne avec celles du Gouvernement pour le début de la période, tablent sur un déficit de 4,3 % en 2027.
J'ai abordé successivement les prévisions de croissance et la trajectoire de finances publiques. Mais, en réalité, les deux sont étroitement liées par un effet de bouclage qui n'est manifestement pas pris en compte par le Gouvernement, ce qui rend ce programme de stabilité incohérent et d'autant moins crédible. En effet, on ne peut pas présenter, à la fois, une trajectoire de croissance aussi élevée et un effort en dépenses aussi massif.
Un effort de réduction de déficit tel que celui présenté par le Gouvernement, s'il est mis en oeuvre, pèsera sur l'activité, de sorte que la croissance sera inévitablement moindre que prévu, et le déficit plus élevé puisqu'il est rapporté au PIB. Il faudrait donc en fait, pour atteindre la cible prévue, faire un effort encore plus important que celui envisagé, ce qui dégraderait aussi la croissance. Inversement, une trajectoire de croissance telle que celle qui nous est présentée est incompatible avec un effort de réduction du déficit censé être le plus massif jamais connu en France.
En conclusion, ce programme de stabilité restera dans les annales comme l'ultime reflet des renoncements du Gouvernement, qui se fera inévitablement rattraper par la réalité : renoncement à sa propre LPFP, renoncement à une trajectoire de désendettement pour le pays, renoncement à redresser les comptes par un PLFR.
Si je ne suis pas toujours tendre avec le Gouvernement, je pense néanmoins tenir des propos empreints de modération. Mais je suis obligé de constater qu'il n'y a pas grand-chose qui va dans ce PStab. L'effort budgétaire, pourtant massif, n'est aucunement documenté et repose sur une trajectoire de croissance qui, même sans cet effort qui affaiblira nécessairement l'activité, est trop optimiste.
Je ne veux pas terminer cette communication sans dire un mot de ce qui devrait se passer l'an prochain. Du fait de la réforme du pacte de stabilité et de croissance, adoptée définitivement le 23 avril dernier par le Parlement européen, le PStab sera, à partir de 2025, remplacé par un plan budgétaire et structurel national à moyen terme, sorte de fusion du programme de stabilité et du programme national de réforme, dans lequel la France définira ses objectifs budgétaires et ses réformes et investissements prioritaires pour une période de quatre ou cinq ans : sauf révision, ce n'est qu'à l'issue de cette période qu'un nouveau plan serait adopté.
Ce serait en fait le rapport d'étape annuel, faisant le point sur la mise en oeuvre des objectifs prévus par le plan, qui viendrait prendre la place du PStab dans le calendrier de nos travaux. Le plan budgétaire et structurel serait élaboré en s'appuyant sur une trajectoire de référence fournie par la Commission européenne et visant à ramener la dette publique sur une trajectoire descendante et le déficit public sous les 3 % à l'issue d'une période d'ajustement de quatre ans, ou sept ans en cas de mise en oeuvre de réformes et d'investissements répondant aux objectifs de l'Union.
S'agissant du volet correctif, les changements sont moins nombreux, mais la trajectoire de dépense des États placés en procédure pour déficit excessif devra impérativement être cohérente avec la trajectoire de référence fournie par la Commission européenne. Comme aujourd'hui, pour les États qui connaissent une procédure pour déficit excessif du fait d'un déficit supérieur à 3 %, le déficit structurel devra diminuer de 0,5 point de PIB par an. Le Gouvernement a opportunément obtenu que le déficit structurel retenu pour l'application de cette procédure entre 2025 et 2027 exclue les charges d'intérêt supplémentaires enregistrées ces années-là. Pourquoi 2027 ? On se le demande, mais j'ai ma petite idée...
La réforme visait initialement une meilleure prise en compte des investissements et des particularités de chaque pays, une plus grande latitude laissée aux États membres dans la détermination des trajectoires de finances publiques, l'utilisation d'indicateurs moins contestables, une moindre procyclicité et une simplification pour assurer une meilleure appropriation des règles. N'en déplaise au ministre de l'économie, qui a présenté cette réforme comme équilibrée, ces objectifs sont imparfaitement atteints : les clauses de sauvegarde, qui supposeraient pour la France une diminution moyenne annuelle de la dette publique de 1 point de PIB et une diminution minimale annuelle du déficit structurel primaire de 0,25 point de PIB jusqu'à ce qu'il atteigne 1,5 point de PIB, diminuent fortement les possibilités de différenciation et sont potentiellement procycliques. On le voit d'ailleurs, l'indicateur du solde structurel, inobservable et donc susceptible d'entraîner des erreurs de diagnostic quant à l'effort fourni, est conservé.
De même, l'articulation des temporalités entre le plan budgétaire de l'État membre et la trajectoire de référence élaborée par la Commission, mais surtout la prolifération de chiffres et seuils en tout genre, induisent une telle complexité que Jean Pisani-Ferry n'a pas hésité à qualifier cette réforme de « cauchemar ».
J'aurais préféré terminer mon propos en évoquant des perspectives plus entraînantes et optimistes en espérant vivre un rêve éveillé, mais la réalité budgétaire m'en a privé.
M. Claude Raynal, président. - Merci, monsieur le rapporteur général, pour cet avis modéré !
M. Pascal Savoldelli. - Que pensez-vous du rendement de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui rapporte seulement 2,4 milliards d'euros ?
Une contribution sur la rente inframarginale des énergéticiens avait par ailleurs été annoncée et devait rapporter, selon le Gouvernement, 12,4 milliards d'euros... lesquels se sont transformés en 600 millions d'euros !
M. Thierry Cozic. - Le groupe socialiste approuve l'analyse du rapporteur général : avec ce PStab, la boucle des renoncements est bouclée.
Nous sommes d'accord avec le Président de la République lorsqu'il dénonce un problème de recettes dans la gestion des finances publiques... La destruction de près de 60 milliards d'euros de recettes fiscales par an, depuis dix ans, ne s'est pas traduite en termes de croissance, de ruissellement ou de progrès social. Le Gouvernement a allègrement contribué à organiser l'attrition des finances publiques. Après un tel désarmement fiscal, il ne dispose plus que de la dépense publique pour équilibrer les dérapages budgétaires qu'il a lui-même causés. Cette stratégie est injuste, car elle cible en premier lieu les dépenses de solidarité et celles de guichet, qui réduisent les inégalités sociales, et inefficace car l'élasticité à la baisse de la dépense publique n'est pas infinie. Les politiques publiques conduites aujourd'hui n'offrent pas de perspectives d'économies significatives, si l'on exclut les domaines sanctuarisés par le Gouvernement.
Nous partageons donc l'inquiétude du rapporteur général, même si les solutions que nous proposons ne sont pas les mêmes.
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. - Je remercie le rapporteur général d'avoir rappelé que la sphère sociale supportait l'essentiel de l'ajustement, alors qu'elle est celle dont la situation est la mieux rétablie depuis la crise du covid. Ce secteur doit certes prendre sa part de l'effort, mais le choix du Gouvernement risque d'aggraver la défiance de nos concitoyens et de fragiliser le consentement à l'impôt et aux cotisations.
M. Emmanuel Capus. - Je n'ai pas vraiment perçu la modération de votre réquisitoire, monsieur le rapporteur général...
Ce matin, l'Insee a publié de meilleures prévisions de croissance que celles du Gouvernement, avec un taux de 0,2 % lors des trois premiers mois de 2024. Peut-être les chiffres gouvernementaux ne sont-ils pas si hasardeux que vous le dites ?
M. Marc Laménie. - Selon vous, quand retrouverons-nous les lois de finances rectificatives ?
Les dépenses des organismes divers d'administration centrale (Odac) sont en hausse de 6,4 %. Cela comprend notamment celles de SNCF Réseau et de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit France). La situation ne serait donc pas si mauvaise ?
M. Vincent Capo-Canellas. - La situation des comptes publics est en effet critique. Ce débat relatif au PStab étant sans vote, chacun peut y aller gaiement, mais il faudra bien passer aux travaux pratiques. Le Parlement doit de nouveau jouer son rôle. Nous avons un problème de crédibilité parce que nous n'avons jamais tenu nos engagements. Les mesures présentées par le Gouvernement pouvant avoir un effet récessif, quelle est la façon de s'en sortir ?
Mme Christine Lavarde. - Je trouve, quant à moi, que la communication du rapporteur général était équilibrée !
En plus des 10 milliards d'euros d'économies annoncées, d'autres crédits devaient être gelés. Qu'en est-il ? Par ailleurs, la presse annonce tous les jours de nouvelles mesures de soutien pour tel ou tel secteur. Comment concilier de telles mesures avec les annulations de crédits ? Un PLFR serait nécessaire !
M. Stéphane Sautarel. - J'approuve les propos du rapporteur général. Un minimum de pédagogie est nécessaire au vu de la situation, inquiétante, de nos finances publiques. L'État, principal responsable de ce déficit, produira un effort plus modéré que les autres administrations ; cela interroge...
Le vieillissement de la population a un coût pour les finances publiques. Or cette situation est peu anticipée dans le PStab. Qu'en pensez-vous ?
Mme Ghislaine Senée. - Récemment élue au Sénat, je souhaite savoir s'il est habituel de recevoir le PNR - un document redondant qui ne répond pas aux questions posées sur les mesures d'économies - le jour même du débat relatif au PStab en séance publique. Le principe de respect du Parlement est foulé aux pieds, et cette façon de procéder nous rend chagrins !
M, Jean-François Husson, rapporteur général. - Je pense véritablement m'exprimer de façon modérée.
Monsieur Savoldelli, le produit de l'IFI était en 2018 de 1,3 milliard d'euros ; il s'élève à 1,9 milliard en 2023, ce qui est selon vous insuffisant. Je vous rappelle que la dépense de l'Etat a progressé depuis 2019 de 100 milliards d'euros. La France occupe à cet égard la première place parmi les pays développés ! Pour autant, le déficit et la dette de la France sont très élevés...
Le rendement de la contribution sur la rente inframarginale des énergéticiens n'est pas consolidé, et des questions se posent. Le Gouvernement se fera fort de communiquer le moment venu. Le ministre de l'économie et des finances a déclaré qu'il prendrait les 3 milliards d'euros qu'il en attend ; or il avait annoncé au départ que cette contribution représenterait 12 milliards... Il pourra donc y avoir débat sur ce point.
Monsieur Cozic, vous partagez mes propos mais, en même temps, vous êtes en phase avec la parole présidentielle en termes de recettes... Nous aurons la primeur de vos divergences lors du débat en séance publique !
Vous avez évoqué, mada me Carrère-Gée, l'effort supporté par la sphère sociale, dont la situation est pourtant relativement saine ; les comptes de l'Unédic, par exemple, sont à l'équilibre. Il faut veiller à établir un socle de confiance, ce que ne permettra pas le message envoyé par le Gouvernement au travers de ce PStab.
En effet, monsieur Capus, 0,2 % de croissance au premier trimestre 2024, c'est deux fois mieux que le dernier trimestre 2023, et le Gouvernement vise un taux de 1 % pour l'année... Pour autant, il faut éviter que l'effort de redressement ait l'effet récessif évoqué par M. Capo-Canellas, et trouver le juste équilibre. Je rappelle que le Sénat avait voté, dans le cadre du PLF 2024, des mesures d'économies à hauteur de 7 milliards d'euros, qui ont toutes été rejetées par le Gouvernement.
Monsieur Laménie, je vous propose d'interroger le Gouvernement, pour la énième fois, sur l'absence de PLFR. Pour ma part, je l'ai fait à cinq reprises et j'attends toujours la réponse. Par ailleurs, vous avez raison, les dépenses des opérateurs de l'État ont en effet tendance à filer...
Monsieur Sautarel, la démographie est au coeur non pas du PStab, mais du sujet des dépenses sociales, et risque à cet égard d'entraîner un décrochage. C'est aussi un enjeu pour l'éducation nationale.
Madame Senée, jusqu'à il y a trois ou quatre ans, nous recevions à peu près les documents dans les temps, mais depuis la crise sanitaire les envois sont tardifs, ce qui n'est pas satisfaisant. Par ailleurs, le Haut Conseil des finances publiques relève que la documentation est lacunaire.
Vous avez posé, madame Lavarde, une question sur le montant des gels. On nous annonce un décret d'annulation de 10 milliards d'euros, des gels et des surgels. On nous a informé de 7,4 milliards de gels sur le budget de l'État. Nous vous communiquerons le détail de tous ces chiffres. On relève notamment 2 milliards d'euros de gels sur la mission « Défense ».
La commission autorise la publication de la communication de M. Jean-François Husson, rapporteur général, sous la forme d'un rapport d'information.
Bilan annuel d'application des lois - Communication
M. Claude Raynal, président. - Comme chaque année, je souhaite vous présenter le bilan de l'application des lois renvoyées au fond à notre commission, et particulièrement celles promulguées lors de la session 2022-2023. Derrière un exercice de recensement et d'analyse technique des textes réglementaires se cache un contrôle démocratique essentiel réalisé par notre assemblée puisqu'il s'agit de s'assurer que les lois que nous avons adoptées peuvent bien être appliquées.
Au cours de la session 2022-2023, trois des quatre lois promulguées renvoyaient à la publication d'un texte réglementaire, d'une ordonnance ou d'un rapport. Il s'agit de la loi de finances rectificative pour 2022 de décembre 2022, de la loi visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces et de la loi de finances initiale (LFI) pour 2023.
Aucune mesure d'application n'était prévue par la loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer.
Quasiment trois quarts des mesures renvoyant à un texte réglementaire sont concentrées sur la seule loi de finances initiale pour 2023, avec 61 des 83 mesures attendues pour cette session.
D'un point de vue statistique, le taux de mise en application est en légère baisse, atteignant, hors mesures différées, 81 %, contre 87 % lors de la session précédente. Il convient toutefois de relever qu'encore une fois cette année une proportion plus importante de décrets est prise par rapport aux arrêtés.
Les délais moyens de publication des mesures prises continuent de diminuer, ce dont il convient de se féliciter. En effet, plus des deux tiers - 74 % - des mesures ont été publiées avant le délai de six mois prescrit par la circulaire du Premier ministre du 29 février 2008, contre 62,5 % et 56 % au cours des sessions passées 2021-2022 et 2020-2021.
Il convient également de noter et de saluer le fait que la quasi-totalité des mesures trouvant leur origine dans une initiative sénatoriale ont été adoptées.
J'en viens maintenant à quelques appréciations sur les mesures réglementaires attendues.
La loi de finances initiale pour 2023 concentre donc l'essentiel des mesures réglementaires à prendre.
Au 31 mars 2024, 14 mesures d'application de la loi de finances pour 2023 n'étaient pas encore prises, dont 5 sont facultatives, tandis que 9 autres mesures sont d'ores et déjà devenues sans objet. Parmi les mesures qui n'avaient pas encore été prises à cette date, on peut citer la mise en place d'un « reste à charge » du titulaire d'un compte personnel de formation (CPF) prévu par l'article 212. La mesure qui attendait un décret en Conseil d'État qui vient d'être pris était présentée par le Gouvernement comme un édadalément d'économie pour France Compétences.
Parmi les nombreux textes nécessaires pour l'application de la contribution sur la rente inframarginale, un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), n'a toujours pas été édicté pour déterminer une marge forfaitaire uniforme de fourniture déduite des revenus du fournisseur pour l'établissement des revenus de marché.
Un arrêté du ministre chargé du budget est également attendu au titre de l'article 3 de la LFI pour fixer la date de déclaration annuelle applicable aux débiteurs versant des traitements et salaires de source française et établis dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement. Cela paraît assez étonnant de devoir attendre plus de 15 mois pour qu'une telle date soit arrêtée. Il semblerait toutefois que cette déclaration se fasse en pratique en janvier, dans le cadre de la déclaration « Passage des revenus autres » (Pasrau).
La loi de finances rectificative de fin d'année 2022 est, quant à elle, entièrement applicable, avec trois décrets pris dans les temps impartis et un décret préexistant permettant déjà de répondre à la demande de l'article 21 relative aux conditions d'octroi de MaPrimeRénov.
S'agissant de la loi du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, 50 % des mesures réglementaires restaient en attente au 31 mars dernier, correspondant à 9 textes non pris.
Je mentionnerai en particulier, concernant les mesures directement traitées par la commission des finances - car certains articles étaient délégués à la commission des lois -, le fait que les textes nécessaires pour la mise en place d'une réserve opérationnelle douanière n'ont pas été pris. Il s'agit à la fois d'un décret en Conseil d'État et d'un arrêté visant notamment à fixer les conditions dans lesquelles les réservistes peuvent exercer leurs pouvoirs, les conditions de délivrance des autorisations de port d'armes et les conditions de santé requises pour être réserviste.
Concernant l'application des lois antérieures, le nombre de mesures en attente reflue légèrement, mais reste très élevé, avec 84 mesures en stock, pour 17 lois restant à examiner. Seules 12 des 77 mesures non facultatives des sessions antérieures ont été prises au cours de la session, auxquelles s'ajoutent 16 textes devenus sans objet.
C'est d'ailleurs le fait que les dernières mesures en attente soient devenues sans objet pour la loi de finances initiale pour 2012 et la troisième loi de finances rectificative pour 2020 qui permet à ces deux textes de sortir du stock des lois suivies dans le cadre de l'application des lois. Il est à noter que j'avais moi-même déjà proposé l'abrogation de la mesure concernant la LFI pour 2012 devenue sans objet dans le cadre de l'examen du PLF 2023 et le Gouvernement avait souhaité que je retire mon amendement. Je constate que, finalement, il a partagé notre position et a lui-même fait adopter son abrogation.
Cinq lois ont également vu leur taux d'application évoluer du fait de l'adoption d'une mesure en cours de session ou d'une mesure devenue sans objet, tandis que dix autres n'ont connu aucune modification.
Cela démontre encore une fois la multiplication des mesures réglementaires difficilement applicables ou dont la pertinence n'est pas établie. En outre, la non-application de la loi votée, en raison d'un décret ou un arrêté non publié, ne manque pas d'interroger au regard du principe constitutionnel de clarté et de lisibilité de la loi.
À titre d'exemple, la loi de finances initiale pour 2022, qui comptait encore 25 mesures restant en attente, a vu 6 nouveaux textes d'application être pris au cours de la session 2022-2023, en particulier le décret fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse.
S'agissant de la loi de finances initiale pour 2020, sur les 18 mesures restant à prendre, deux d'entre elles seulement l'ont été au cours de la session 2022-2023 et 6 mesures sont devenues sans objet.
Parmi les mesures non prises encore, figurent certaines qui ont vu leur date d'application repoussée par un texte postérieur : ainsi l'article 60, qui mettait en place la suppression progressive du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour les carburants non routiers, ou encore l'article 146, qui prévoit la mise en oeuvre d'une révision des valeurs locatives des locaux d'habitation en 2026 et l'application des dispositions prévues pour la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
Par ailleurs, il convient de noter qu'en vertu de l'article 16 de la LFI pour 2020, et la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, l'administration fiscale avait lancé dès le 23 janvier 2023 l'ouverture d'une procédure de déclaration en ligne pour les propriétaires, laquelle déclaration devait être accomplie avant le 30 juin. Or j'avais signalé l'an dernier que le décret prévu pour en fixer les modalités n'avait pas été pris au préalable. Fort heureusement, le texte a finalement été publié fin avril 2023 afin de sécuriser juridiquement cette procédure qui concernait 34 millions de propriétaires.
Parmi les dix lois n'ayant fait l'objet d'aucune mesure d'application supplémentaire au cours de la dernière session, je m'attarderai enfin sur la loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. Son article 26 a, en effet, complété les possibilités de suivi et de contrôle de la commission des finances sur les questions liées aux finances publiques en prévoyant, à l'article 57 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), que le président et le rapporteur général de la commission des finances des deux assemblées soient habilités à accéder à l'ensemble des informations qui sont, le cas échéant, couvertes par le secret statistique ou fiscal.
Or le décret en Conseil d'État nécessaire pour sa mise en oeuvre est toujours attendu. Cela n'est pas correct. Fort heureusement, nous avons obtenu certaines des données nécessaires à nos travaux dans le cadre du Centre d'accès sécurisé aux données (CASD).
En ce qui concerne le suivi des habilitations et des ordonnances, sur la session 2022-2023, le Gouvernement s'est vu habilité à prendre des mesures par voie d'ordonnance par deux lois.
Tout d'abord, par la loi de finances initiale pour 2023, son article 205 prévoyant ainsi de mettre en cohérence les codes et les lois non codifiées concernant le dispositif de sécurité sanitaire des produits cosmétiques et de tatouage, ainsi qu'un dispositif de certification des établissements mentionnés à l'article L. 5131-2 du code de la santé publique.
Ensuite, par la loi du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, dont l'article 36 prévoyait par ordonnance la recodification du code des douanes.
Aucune de ces ordonnances n'a été prise à ce jour.
Par ailleurs, une habilitation à légiférer par ordonnance restait en stock au titre de l'article 128 de la loi de finances initiale pour 2022, et elle a conduit à l'adoption au cours de la session de l'ordonnance du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions des biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales.
Aucune des 32 ordonnances faisant l'objet d'un suivi n'a été formellement ratifiée.
Enfin, en ce qui concerne les demandes de rapport, le taux de remise est en forte hausse, atteignant 50 %, contre 26 % lors de la session précédente, avec 9 rapports remis sur les 19 attendus, l'un d'entre eux étant par ailleurs devenu sans objet.
Toutefois, la qualité des rapports n'est pas toujours au rendez-vous. Ils sont en effet parfois très lacunaires. Par exemple, le rapport sur les moyens et les dépenses des personnes publiques en faveur du développement de l'économie sociale et solidaire, demandé à l'article 185 de la loi de finances initiale pour 2022, ne fait aucune analyse des dépenses des collectivités territoriales en la matière. De même, le rapport attendu sur le bilan des évaluations réalisées dans le cadre du dispositif national récurrent d'évaluation de la qualité de l'action publique est essentiellement consacré à une présentation du mécanisme des revues de dépenses, sans détails ou chiffrage sur les mesures d'économies susceptibles d'être identifiées à ce titre.
M. Hervé Maurey. - Les bilans sur l'application des lois se suivent et se ressemblent malheureusement. Je souhaite revenir sur un texte adopté en 2021, qui prévoyait la mise en oeuvre d'une expérimentation relative au financement participatif des projets des collectivités locales pour une durée de trois ans. L'arrêté n'ayant été publié que quinze mois après, il a fallu voter une prorogation de ce délai en 2023 dans un projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer, mais sans pouvoir remettre en cause les conditions fixées par l'arrêté, notamment l'obligation de fournir un certain nombre de documents, ce qui rendait l'expérimentation impossible. Le ministre de l'époque s'était engagé à modifier cet arrêté. À ma connaissance, cela n'a pas été fait. C'est l'exemple type du non-respect de la volonté du législateur. Avons-nous des éléments d'information de Bercy sur ce point ?
M. Claude Raynal, président. - Nous reviendrons vers vous pour vous indiquer si l'arrêté a été modifié, je n'ai pas d'information sur ce sujet particulier. Généralement le Gouvernement nous l'indique lorsqu'il opère ce type de modification pour répondre à nos objections à un texte réglementaire.
M. Éric Bocquet. - J'ai écouté avec attention votre compte rendu, monsieur le président. Une fois que le vote souverain du Parlement s'est exprimé, la loi devrait s'appliquer, mais la liste des obstacles à franchir est longue ! Cela laisse songeur... Est-on encore en démocratie parlementaire ? Quelle est d'ailleurs la différence entre un décret et un arrêté ?
M. Claude Raynal, président. - Un arrêté peut émaner directement des ministres tandis qu'un décret est pris par le Président de la République ou par le Premier ministre. Ils n'ont pas la même place dans la hiérarchie des normes
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l'argile - Désignation d'un rapporteur
La commission désigne Mme Christine Lavarde rapporteur sur la proposition de loi n° 513 (2022-2023) visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l'argile.
Questions diverses
M. Claude Raynal, président. - Je souhaite enfin vous informer de plusieurs délégations au fond décidées dans le cadre de l'examen de trois propositions de loi relevant de la compétence de notre commission.
Ainsi, s'agissant tout d'abord de la proposition de loi n° 536 (2023-2024) visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France, adoptée par l'Assemblée nationale et qui sera examinée par le Sénat en séance publique le 14 mai prochain, le texte a été renvoyé au fond à notre commission, qui a nommé Albéric de Montgolfier rapporteur. Je vous informe que l'examen au fond des articles 1er, 3, 10, 10 bis, 10 ter, 11 et 11 bis de la proposition de loi ont toutefois été délégués à la commission des lois, les dispositions qu'ils contiennent relevant principalement de sa compétence.
Ensuite, je vous informe que nous avons reçu délégation pour examiner sur le fond certains articles de deux propositions de loi qui seront examinées par le Sénat dans les semaines à venir.
En premier lieu, la commission examinera sur le fond les articles 3 et 4 de la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif, dont le rapporteur pour le compte de notre commission est Jean-François Husson.
En second lieu, la commission examinera sur le fond les articles 2, 3, 3 bis A et 3 bis B de la proposition de loi visant à faciliter la transformation des bureaux en logements, sur le rapport de Stéphane Sautarel.
La réunion est close à 10 h 20.
- Présidence de M. Bruno Belin,vice-président puis de M. Claude Raynal, président -
La réunion est ouverte à 16 h 20.
Mission d'information sur la dégradation des finances publiques depuis 2023, son suivi par l'administration et le Gouvernement et les modalités d'information du Parlement sur la situation économique, budgétaire et financière de la France - Audition de M. Pierre Moscovici, président du Haut conseil des finances publiques et Premier président de la Cour des comptes
M. Bruno Belin, président. - Nous entamons cet après-midi les auditions plénières de notre mission d'information sur la dégradation des finances publiques depuis 2023, son suivi par l'administration et le Gouvernement et les modalités d'information du Parlement sur la situation économique, budgétaire et financière de la France.
Si nous recevons régulièrement M. Moscovici, tantôt en tant que Premier président de la Cour des comptes, tantôt en tant que président du Haut Conseil des finances publiques (HCFP), nous lui avons demandé de venir aujourd'hui en ces deux qualités pour éclairer les débats de notre mission. Le sujet de la dégradation des finances publiques depuis 2023 le justifie, vu tout particulièrement sous l'angle du suivi de la situation budgétaire et financière par le Gouvernement, et de l'information, que nous trouvons actuellement insuffisante, du Parlement.
Cette mission d'information, monsieur le Premier président, a été ouverte à la suite de l'annonce par l'Insee d'un déficit public de 5,5 % du PIB en 2023, alors qu'il était prévu à 4,9 % dans la loi de finances de fin de gestion (LFFG) soumise au Parlement. De même, la loi de programmation des finances publiques (LPFP) s'est trouvée obsolète deux mois après sa promulgation.
Nous ne pouvons être que frappés par la rapidité de cette dégradation. À partir de quel moment la connaissance de cette dernière était-elle prévisible et identifiée, selon vous ? Pouvez-vous nous éclairer sur la méthode observée par le HCFP lors de la rédaction des avis qu'il fournit sur le projet de loi de finances (PLF), sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) et sur le programme de stabilité ? En particulier, comment sont réalisées et suivies les prévisions macroéconomiques et celles des principaux agrégats des finances publiques ?
Je sais que nos préoccupations rejoignent les vôtres. Ainsi, la Cour des comptes alerte depuis plusieurs années sur les difficultés croissantes en matière de prévision des recettes fiscales par le Gouvernement, et vous l'appelez à mieux justifier les estimations dans les projets de loi de finances rectificative (PLFR). Cette difficulté récurrente à apprécier les recettes fiscales a été particulièrement aiguë à la fin de l'année 2023, notamment pour ce qui concerne la TVA et l'impôt sur les sociétés. Comment le Gouvernement devrait-il faire pour améliorer ses méthodes ? D'une manière générale, conviendrait-il de publier des prévisions de recettes en fourchettes dans l'exposé général des projets de loi de finances ?
Au-delà du budget de l'État, les prévisions faites par le Gouvernement et l'information du Parlement au sujet de la situation financière des collectivités territoriales et des administrations de sécurité sociale présentent certainement des marges d'amélioration. Votre point de vue en la matière nous sera fort utile.
M. Pierre Moscovici, président du Haut Conseil des finances publiques et Premier président de la Cour des comptes. - Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre invitation. Je présenterai plusieurs travaux, qui s'appuient sur soixante et une notes d'analyse de l'exécution budgétaire ou fiscale, réalisés par la première chambre de la Cour des comptes, ainsi que des délibérations du Haut Conseil des finances publiques.
Je commencerai par nos analyses portant sur le budget de l'État. La loi organique relative aux lois de finances (Lolf) confie à la Cour le rôle essentiel d'éclairer l'examen de l'exécution budgétaire. Nous ne prenons pas cette responsabilité à la légère.
Le rapport sur le budget de l'État (RBDE) livre un constat sans appel. Lors de ma venue afin de présenter ce rapport public annuel, j'avais présenté l'année 2023 comme une année blanche en matière de réduction du déficit public. La chambre s'est interrogée : avons-nous été trop sévères ? En réalité, il s'agissait d'une année noire pour les finances de l'État !
En effet, le déficit budgétaire de l'État en 2023 est le deuxième le plus dégradé jamais enregistré. Il atteint presque le niveau record de l'année 2020, qui, pourtant, a été frappée de plein fouet par la crise sanitaire. Le déficit atteint 173 milliards d'euros en 2023, soit 21 milliards de plus qu'en 2022 et 9 milliards de plus qu'initialement prévu dans la loi de finances initiale pour 2023.
Si cette situation tient en premier lieu à une loi de finances initiale peu ambitieuse - nous l'avions souligné -, elle est aggravée par des facteurs multiples.
D'abord, sur les dépenses, le constat est clair et décevant : nous n'avons pas profité du reflux des dépenses exceptionnelles de crise et de relance pour diminuer les dépenses de l'État et pour réduire le déficit.
Après avoir augmenté de 110 milliards d'euros entre 2019 et 2022, les dépenses du budget général de l'État auraient dû logiquement diminuer. Il est vrai qu'un reflux des dépenses exceptionnelles, liées à l'urgence sanitaire et à la relance, a eu lieu, de l'ordre de 28 milliards d'euros. Néanmoins, cette baisse a été plus que compensée par la hausse des autres dépenses, lesquelles se chiffrent à 29,4 milliards d'euros. Les dépenses totales de l'État ont ainsi atteint 454,6 milliards d'euros en 2023, soit 1,9 milliard d'euros de plus qu'en 2022.
Toutes les composantes de la dépense de l'État ont progressé en 2023. Les mesures nouvelles, afin de prolonger les dispositifs de soutien face à la hausse des prix de l'énergie, ont représenté près de 15 milliards d'euros. La croissance des dépenses de l'État est aussi due à la hausse continue de ses dépenses ordinaires. La Cour estime leur progression à 14,5 milliards d'euros en 2023, contre moins de 2 milliards d'euros en 2022. Cette progression est notamment due à la hausse de 3,2 milliards d'euros de la charge de la dette, de 6 milliards d'euros de la masse salariale, après l'augmentation de la valeur du point d'indice en 2022 et en 2023, et à une hausse significative des effectifs de l'État, représentant 8 991 équivalents temps plein (ETP).
De surcroît, les reports atteignent des niveaux inédits depuis quatre ans et ne sont toujours pas en voie de normalisation : 16 milliards d'euros de crédits de 2023 ont à nouveau été reportés sur 2024.
Ces augmentations et ces reports étaient tous prévus et autorisés au travers de la loi de finances et de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027. Le constat est d'ailleurs singulier, à l'aube d'une trajectoire exigeante qui est supposée ramener le déficit public sous les 3 % du PIB. C'est la raison pour laquelle j'ai qualifié cette loi de finances initiale de peu ambitieuse, ce qui se vérifie en exécution.
Pour le dire simplement, la quasi-stabilité des dépenses de l'État, entre 2022 et 2023, malgré le reflux des dispositifs de sortie de crise et du « quoi qu'il en coûte », retarde encore la maîtrise des dépenses. Nous constatons que les revues de dépenses qui ont été engagées n'ont pas vraiment modifié la donne.
S'agissant des recettes de l'État, elles baissent en 2023 après deux années très dynamiques. Cette mauvaise surprise ne fait qu'aggraver le déficit.
En 2023, les recettes nettes du budget général ont diminué de 8,2 milliards d'euros par rapport à 2022 et se sont avérées inférieures de 7,4 milliards d'euros à la prévision de la loi de finances initiale. La diminution provient surtout de la baisse marquée des recettes fiscales, soit 7,4 milliards d'euros, et de l'augmentation des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales de 1,3 milliard d'euros.
Cette diminution en valeur est une véritable singularité alors même que l'année 2023 a été une année de croissance, bien que modeste. Les retournements de conjoncture ont beaucoup été mis en avant. Celle-ci n'est pas extraordinaire, mais la prévision de croissance a été correcte, puisqu'elle s'établissait à 1 %. Ce n'est pas de ce côté-là que provient le dérapage.
Le phénomène s'explique au moins en partie par les transferts de TVA, dont l'État n'est plus qu'un attributaire minoritaire. Je me souviens être venu devant cette commission présenter le rapport intitulé La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), un impôt à recentrer sur son objectif de rendement pour les finances publiques, qui soulignait cet effet négatif. En 2023, l'État a transféré 10,5 milliards d'euros de TVA supplémentaires dans le cadre de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). En pratique, les recettes de l'État sont plus volatiles et moins corrélées à la croissance économique. Plus généralement, le rendement de tous les grands impôts est en baisse.
Comment expliquer la mauvaise surprise de 2023 sur les recettes fiscales de l'État ? Plusieurs événements postérieurs à la loi de finances de fin de gestion expliquent cet écart inhabituel de près de 8 milliards d'euros. Une partie d'entre eux relève d'évolutions difficilement prévisibles, mais une autre aurait pu être anticipée au cours des débats parlementaires de novembre.
En particulier, les revenus du prélèvement sur les superprofits - je ne sais pas s'il faut les appeler ainsi... - des producteurs d'électricité étaient estimés à 12,3 milliards d'euros en loi de finances initiale. Ce montant a été réduit à moins de 3 milliards d'euros dans la loi de finances de fin de gestion, et il n'a finalement représenté que 0,6 milliard d'euros. Était-ce totalement imprévisible ? Dès lors que vous indexez une taxe ou une contribution sur l'inflation et que votre politique conduit, par ailleurs, à la désinflation, il n'est pas absurde que le rendement diminue, induisant une incohérence avec les hypothèses qui figuraient dans le projet.
Je suis, comme vous, attaché à ce que soient pleinement établies les raisons à l'origine d'un tel écart. L'administration l'explique par la baisse des prix de l'électricité tout au long de l'année 2023 alors que cette imposition exceptionnelle avait été conçue et estimée fin 2022 lorsque les prix étaient au plus haut. Des analyses complémentaires sont en cours pour apprécier si d'autres facteurs ont pu jouer.
Ces évolutions négatives sur le volet des recettes comme sur celui des dépenses ont contribué à accroître le besoin de financement et la dette de l'État, qui atteignent des niveaux très préoccupants.
En comptabilité budgétaire, le besoin de financement de l'État atteint le niveau historique de 314,6 milliards d'euros, quasiment le montant des recettes fiscales de l'État. Le corollaire est l'augmentation continue de l'encours de la dette : celui-ci est en hausse de 6,5 % sur l'exercice 2023.
En comptabilité budgétaire, la charge de la dette a, elle aussi, continué d'augmenter de manière soutenue après la brusque accélération de 2022. Après 50,7 milliards d'euros en 2022, elle s'est élevée à près de 54 milliards d'euros en 2023, soit désormais l'équivalent du budget du ministère des armées. Cette tendance est inquiétante, surtout dans un contexte où les taux d'intérêt ont augmenté - même s'ils devraient se tasser - et où les projections indiquent une progression continue de cette charge.
Si l'on suit le scénario central d'évolution des taux de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027, une hausse de la charge en intérêts de 9,5 milliards d'euros est en effet prévue en 2024, et près de 36 milliards d'euros à l'horizon 2027.
À l'issue de cette année 2023, j'aimerais partager avec vous un message d'alerte et de vigilance. L'absence de réformes et d'économies structurelles en 2023 pèsera fortement sur la trajectoire de retour du déficit à un niveau soutenable. Alors que se pose la question du financement des investissements nécessaires à la croissance et à la transition écologique et énergétique, la situation financière de l'État ne sera maintenue qu'au prix d'efforts considérables sur d'autres dépenses.
Je l'ai dit et je le répète, ces efforts sont difficiles, mais ils sont encore possibles et ils ne sont contradictoires en soi ni avec une politique de croissance, ni avec le maintien du modèle social français, ni avec les exigences de la transition écologique, s'ils portent sur des dépenses peu efficaces, que je qualifierais de faible qualité. Nous sommes invités collectivement à réfléchir à cette question.
Dans son rapport intitulé La situation et les perspectives des finances publiques, la Cour a proposé l'an dernier une sorte de mode d'emploi pour passer au tamis de la qualité les dépenses publiques. Je pense qu'il faut aller plus loin en ce sens. Nous y ferons écho au travers de trois revues de dépenses que nous préparons actuellement d'arrache-pied sur les collectivités territoriales, sur l'assurance maladie et sur les dispositifs de sortie de crise.
Concernant l'acte de certification des comptes de l'État pour 2023, la Cour des comptes a émis une opinion « avec réserves ». Deux réserves d'importance ont été levées. Toutefois, une nouvelle réserve est considérée comme une anomalie significative ; je veux parler de l'absence de mention, parmi les engagements donnés par l'État, de la garantie du remboursement de l'emprunt émis par l'Union européenne pour financer le plan de relance commun. Cet engagement, qui représenterait, le cas échéant, un accroissement de celui qui a été pris au titre du cadre financier pluriannuel du budget de l'Union, peut être évalué à hauteur de 75 milliards d'euros.
Au total, si les comptes de l'État sont utiles, riches en informations et représentent un grand progrès par rapport à la situation prévalant avant 2006, il reste un peu de chemin à parcourir avant qu'ils puissent être certifiés « sans réserve ».
Je tiens à attirer votre attention sur un point qui peut paraître technique, mais qui a toute son importance. Lorsque le Gouvernement communique sur les comptes de l'État, nous nous étonnons qu'il ne mentionne pas systématiquement les réserves, récurrentes, de la Cour. Ce constat soulève la question de la transparence et de la lisibilité de la situation financière de l'État. Quelle entreprise - je sais que certains d'entre vous ont travaillé dans le privé - pourrait présenter, comme l'État, des comptes faisant durablement figurer des anomalies ou des réserves sans signaler cette situation aux utilisateurs de ces états financiers, ne faisant pas figurer les avis des commissaires aux comptes ? Cela ne me paraît pas normal.
Je prends ma casquette de président du Haut Conseil des finances publiques pour vous présenter de manière plus détaillée les deux avis que nous avons rendus la semaine dernière, conformément aux dispositions prévues par la loi organique : un avis relatif au projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2023 et un avis relatif aux prévisions macroéconomiques associées au programme de stabilité pour les années 2024 à 2027.
L'avis relatif au projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2023, ou plus simplement projet de loi de règlement, porte sur le solde structurel de l'ensemble des administrations publiques, c'est-à-dire sur un champ qui comprend non seulement l'État, mais aussi ses opérateurs, les administrations de sécurité sociale, les collectivités territoriales et leurs opérateurs. Par ce texte, le HCFP doit juger si l'écart entre le solde structurel réalisé et celui de la loi de programmation des finances publiques est « important », au sens de la loi organique. S'il venait à le constater, le mécanisme de correction prévu par le traité sur la stabilité, la coordination et gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (TSCG) serait automatiquement déclenché. Le Gouvernement devrait alors en tenir compte, au plus tard dans le prochain projet de loi de finances ou le projet de loi de financement de la sécurité sociale, pour présenter les mesures de correction envisagées.
Les résultats présentés par l'Insee à la fin du mois de mars dernier font état d'un déficit public plus élevé que prévu dans la LPFP de 0,6 point de PIB. Il s'est établi à 5,5 points de PIB, alors qu'il était prévu à 4,9. Cette différence se traduit par un écart de 0,5 point de PIB sur le solde structurel, qui est le seuil de déclenchement du mécanisme de correction. De fait, la croissance a été un peu moins forte que prévu : 0,9 % au lieu de 1 %. Une petite partie de l'écart, soit 0,1 point de PIB, est de nature conjoncturelle.
Pour juger si cet écart est important, le Haut Conseil doit tenir compte des circonstances exceptionnelles de nature à justifier les écarts constatés. Après débat, il a considéré que la clause de circonstances exceptionnelles qui avait été mise en oeuvre en 2020 ne s'appliquait plus puisque les conditions d'exercice de l'activité économique, qui avait fortement pâti en 2020 et en 2021 de la crise sanitaire puis énergétique, se sont depuis nettement améliorées. En 2023, l'activité a continué de croître tandis que l'inflation a reculé.
Le Haut Conseil a voulu vérifier si l'écart de 0,5 point de PIB était « important » au sens prévu par la loi organique. Au final, il ne l'est pas en raison d'une réserve méthodologique due au passage de l'ensemble des données des comptes nationaux de la base dite 2014 à la base 2020, qui représentait une différence de 0,14 point. L'écart étant ainsi ramené à 0,36 point de PIB, il n'est pas « important » au sens de l'article 62 de la loi organique et ne relève donc pas du mécanisme de correction. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas significatif. Cette dérive contribue à accroître la divergence des finances publiques européennes, plaçant la France dans une situation préoccupante - j'emploie de nouveau cet adjectif ! - par rapport à nos principaux partenaires.
Conserver durablement un déficit élevé n'est pas sans conséquence, puisque cela ne permet pas de réduire notre ratio de dette publique, déjà parmi les plus élevés en Europe. Je l'ai déjà dit devant vous, le désendettement est impératif pour que la France retrouve des marges de manoeuvre et puisse faire face à d'éventuels chocs macroéconomiques, sans compter les investissements nécessaires en faveur de la transition écologique. La trajectoire des finances publiques de la loi de programmation, que le Haut Conseil avait jugée optimiste quand elle lui avait été soumise pour avis, est d'ores et déjà remise en cause - seulement quatre mois après sa promulgation !
Comment en est-on arrivé à de tels écarts, me demanderez-vous certainement à l'issue de mon propos ? Comme je l'ai évoqué précédemment, certaines mauvaises surprises, notamment en matière fiscale, étaient difficiles à prévoir ; d'autres doivent impérativement être expliquées.
L'expérience de l'année 2023 nous prouve surtout une chose : nous avons besoin - j'y insiste - d'échanges plus nourris et d'une communication plus transparente avec les administrations. Nous leur rappellerons qu'elles doivent communiquer à la Cour et au Haut Conseil les informations, les estimations, les notes ou les prévisions dont elles disposent, ce qui n'a pas été le cas à la fin de l'année 2023. Il ne s'agit pas de les « prendre au piège » : c'est une question de transparence - et même de bonne information -, nécessaire pour que chacun joue son rôle à sa place. La Cour des comptes a besoin de ces documents afin d'exercer sa mission constitutionnelle de vigie des finances publiques, à équidistance entre le Gouvernement et le Parlement.
Quoi qu'il en soit, la trajectoire des finances publiques tracée par la LPFP était déjà à revoir en ce début d'année ; ce constat m'amène au contenu de l'avis du Haut Conseil sur le programme de stabilité 2024-2027.
Le Haut Conseil a été saisi, comme les années antérieures, d'un nouveau programme de stabilité pour les années 2024 à 2027, qui sera vraisemblablement le dernier. En effet, la nouvelle réforme de la gouvernance économique, qui entre en vigueur après le vote du Parlement européen la semaine dernière, remplacera les programmes de stabilité par des plans dits budgétaires et structurels de moyen terme fixés pour au moins quatre ans, déterminant une trajectoire non plus de solde public, mais d'évolution de la dépense publique. Il s'agit, selon moi, d'un changement plutôt positif.
Désormais approuvé, le projet de réforme des règles européennes prévoit une saisine obligatoire des institutions budgétaires indépendantes, comme le HCFP, sur les hypothèses macroéconomiques sous-jacentes à la définition de l'objectif de dépenses publiques, mais seulement huit ans après que les règles seront rentrées en vigueur : autrement dit, le débat aurait lieu au début et à la fin. Rien n'interdit toutefois d'introduire cette obligation dès la transposition de ces règles en droit français et de prévoir une saisine annuelle du HCFP sur ces programmes. Pour vous le dire franchement et nettement, cela me semble nécessaire afin de pouvoir continuer à éclairer au mieux le Parlement et le citoyen sur les perspectives de nos finances publiques par une analyse impartiale, objective et pluraliste.
Si vous estimez - il me semble que tel est le cas - que le travail du HCFP est utile à l'information du Parlement et du citoyen, il me paraîtrait alors logique de modifier la loi organique afin de graver dans le marbre le rôle de notre institution budgétaire indépendante, pour pouvoir suivre annuellement la mise en oeuvre de ce programme. Dans le cas contraire, ce rendez-vous disparaîtrait, ainsi qu'une appréciation de moyen terme des évolutions à l'oeuvre. Je souligne ce point avec force : je ne dirais pas que nous jouons dans le même camp, car nous ne sommes pas opposés à un autre camp, mais nous contribuons à votre information.
Il me paraîtrait paradoxal qu'une approche plus « nationale » de la situation budgétaire des États membres de l'Union européenne se traduise par un recul du rôle de leurs institutions budgétaires indépendantes !
À la suite des nombreuses alertes sur nos finances publiques depuis le début de l'année 2024, le Gouvernement s'est doté d'une nouvelle trajectoire, profondément modifiée. Notre avis sur le programme de stabilité 2024-2027 s'articule autour de deux grands messages.
Tout d'abord, les hypothèses présentées par le Gouvernement sont trop optimistes, comme nous vous en avions déjà fait part lors de notre avis l'an passé.
Revenons rapidement sur la trajectoire de la LPFP, promulguée en fin d'année dernière : lorsqu'il avait eu à donner son avis sur le projet de LPFP, le Haut Conseil avait estimé que le scénario de croissance du Gouvernement était optimiste. Il avait relevé que la trajectoire des finances publiques était peu ambitieuse au regard des engagements européens de la France, alors même qu'elle supposait déjà la réalisation d'importantes économies structurelles, qui restaient à préciser.
De fait, le Gouvernement prend acte, dès ce programme de stabilité, que la trajectoire de la LPFP a été construite sur des hypothèses trop optimistes et doit déjà être fortement modifiée. Ainsi, le Gouvernement a d'ores et déjà dû corriger à la baisse - de 0,8 point - sa trajectoire de croissance sur la période 2023-2025 dans le programme de stabilité, et il a eu raison de le faire. La croissance a été de 0,9 % en 2023, contre 1 % prévu en LPFP ; les hypothèses sous-jacentes à la trajectoire de la LPFP, optimistes sur les comportements de dépense des ménages et des entreprises, sont remises en cause par des tendances récentes : l'investissement des ménages et des entreprises continue notamment de pâtir du durcissement passé des conditions de financement, entraîné par celui de la politique monétaire opérée par la Banque centrale européenne (BCE).
Le Gouvernement a ainsi dû réviser à 1 % sa prévision de croissance pour 2024, soit 0,4 point de moins que sa prévision précédente, et à 1,4 % sa prévision pour 2025, soit 0,3 point de moins que précédemment. Notons toutefois que la prévision de 1 % pour 2024 demeure encore supérieure au consensus des économistes, ou par exemple à la prévision de croissance pour la France présentée par le Fonds monétaire international (FMI), qui n'est pourtant pas pessimiste d'ordinaire. Pour être tout à fait exhaustif, l'Insee a publié ce matin des comptes trimestriels laissant entendre qu'un taux de croissance de 1 % était certes optimiste, mais pas hors d'atteinte.
Le scénario macroéconomique à l'horizon 2027 reste pour sa part optimiste, car il suppose un fort rebond du commerce mondial qui n'est pas acquis dans un contexte d'obstacles croissants aux échanges internationaux. Ayons également en tête certaines échéances géopolitiques, dont des élections qui pourraient renforcer les tendances protectionnistes, ainsi qu'une forte baisse du taux d'épargne des ménages qui n'est pas impossible, mais qui n'est pas pour autant très probable. L'évaluation de PIB potentiel associé, c'est-à-dire le niveau d'activité que l'on peut atteindre en l'absence de chocs - qu'ils soient favorables ou défavorables -, n'a été révisée qu'à la marge et reste donc avantageuse.
Malgré un scénario de croissance qui reste favorable, il en résulte que l'écart de production, c'est-à-dire la part du PIB de nature conjoncturelle qui est appelée à se résorber avec le retour à une conjoncture normale, reste négatif jusqu'en 2027 dans le projet de programme de stabilité : il s'agit là d'une configuration qui ne s'observe jamais dans les évaluations ex post de l'écart de production. Cela conforte le diagnostic du Haut Conseil selon lequel la trajectoire de PIB potentiel retenue dans la prévision du Gouvernement est surévaluée.
La trajectoire de finances publiques, elle aussi, a dû être révisée de manière substantielle. Elle est nettement plus dégradée que dans la LPFP : dès 2023, première année de la trajectoire de ladite loi, le déficit public observé est plus élevé de 0,6 point que prévu. Le résultat sur la dette publique, soit 110,6 points de PIB, est lui aussi plus élevé, de 0,9 point de PIB prévu dans la LPFP.
C'est également le cas en 2024, le déficit public étant prévu en hausse de 0,7 point par rapport à la LPFP pour atteindre 5,1 points de PIB. Le ratio de dette atteindrait 112,3 points de PIB en 2024, soit une augmentation de 2,6 points par rapport à la LPFP. En particulier, la prévision de prélèvements obligatoires, que le Haut Conseil avait déjà jugée optimiste, a dû être révisée à la baisse de plus de 25 milliards d'euros en 2024.
La cible de déficit public a également été relevée de 2,7 points de PIB à 2,9 points de PIB, même si le Gouvernement maintient l'objectif d'un retour sous 3 points de PIB à cet horizon. Cette trajectoire conduirait elle-même à une augmentation du ratio de dette à 112 points de PIB en 2027, ce qui signifierait que la France viendrait s'installer durablement sur le podium des trois pays les plus endettés de la zone euro, avec la Grèce et l'Italie, la dette grecque devant d'ailleurs diminuer très significativement.
J'en viens au second message de cet avis, qui me paraît être le plus important : même révisé par rapport à une loi de programmation trop optimiste, le scénario du programme de stabilité manque de crédibilité et de cohérence.
La nouvelle trajectoire de finances publiques est nettement plus dégradée que dans la LPFP : dès 2023, le point de départ s'éloigne de ce qui était inscrit dans cette loi, puisque le déficit public a atteint 5,5 points du PIB et non pas 4,9 points de PIB. Le déficit public est donc très élevé et est prévu, pour 2024, à 5,1 points de PIB, en hausse de 0,7 point par rapport à la trajectoire initiale, alors que l'horizon de temps se réduit. Pour le dire de manière imagée, la pente permettant de passer de 4,9 points de PIB à 2,7 points de PIB en l'espace de quatre ans était déjà escarpée : celle qui permettrait de passer de 5,1 points de PIB à 2,9 points de PIB en trois ans devient très raide !
Par ailleurs, le maintien d'un objectif de déficit public en dessous de 3 points de PIB en 2027 suppose un ajustement structurel primaire - c'est-à-dire hors charge d'intérêts - massif entre 2023 et 2027, à hauteur de 3,2 points de PIB sur quatre ans. Cet effort, totalement inédit, s'appuierait quasi exclusivement sur un effort d'économie en dépenses dans la mesure où rien n'est prévu en matière de prélèvements obligatoires.
Le Haut Conseil considère que cette prévision manque de crédibilité : un tel effort en dépenses n'a jamais été réalisé par le passé, sa documentation reste à ce stade lacunaire et sa réalisation suppose la mise en place d'une gouvernance rigoureuse associant l'ensemble des acteurs concernés qui n'est pas aujourd'hui totalement en place. Le Gouvernement indique qu'il s'appuiera sur les revues de dépenses engagées jusqu'alors, mais cela suppose un puissant coup d'accélérateur.
Le Haut Conseil considère aussi que cette prévision manque aussi de cohérence : la mise en oeuvre de l'ajustement structurel prévu ne manquerait pas de peser, à court terme, sur l'activité économique. En effet, on ne réduit pas la dépense publique aussi massivement et sur plusieurs années sans effet sur la croissance économique. Les prévisions de croissance élevées du Gouvernement - 1,7 % en 2026, 1,8 % pour 2027 - ne pourraient donc être atteintes que sous des hypothèses très favorables et fort peu probables.
Dans cette situation, il est possible soit de maintenir la prévision de croissance, sans atteindre de facto l'objectif d'un déficit public de 2,9 points du PIB ; soit de chercher à atteindre à tout prix ce dernier, mais avec alors une croissance et des recettes réduites, ce qui supposerait de réaliser encore plus d'économies que celles, pourtant inédites, qui sont prévues.
Un scénario cohérent supposerait donc de changer soit la prévision macroéconomique, soit la prévision de finances publiques. Mesdames et messieurs les sénateurs, je serai clair : si nous souhaitons rétablir des finances publiques saines, il faut avoir un discours de vérité et faire des choix. Nous ne pouvons pas, en effet, annoncer un tel ajustement structurel sans que celui-ci repose sur des hypothèses robustes.
Laissez-moi, pour conclure, vous préciser que le Haut Conseil n'est pas neutre et qu'il juge toujours indispensable la réduction du déficit public et du ratio de dette. Certes, cette réduction sera difficile, encore plus que ce qu'on pouvait penser quelques mois plus tôt, car nous avons tardé à maîtriser nos dépenses. La réduction du déficit public n'en est pas moins nécessaire et doit s'appuyer sur une stratégie articulée et crédible de réduction du poids de la dépense publique dans le PIB, ainsi que sur un réexamen des baisses prévues de prélèvements obligatoires. En clair, s'il n'est jamais interdit de décider de telles baisses, elles doivent être compensées par des économies supplémentaires en dépenses.
Voici les messages que je souhaitais porter devant vous avant de répondre à vos questions.
- Présidence de M. Claude Raynal, président -
M. Claude Raynal, président. - Merci pour ces éléments communiqués au titre de votre double responsabilité. Vous avez évoqué une éventuelle modification de la loi organique relative aux lois de finances à la suite de la révision des règles européennes : le rapporteur général se rappelle également que nous avions préconisé d'attendre ces nouvelles règles pour modifier la Lolf. Telle n'a pas été l'option retenue, hélas !, alors qu'un peu de patience aurait permis d'intégrer ces évolutions dans la loi organique dès le départ.
En outre, vous avez fait référence à la transparence dont doit faire preuve le Gouvernement et à la nécessité qu'il transmette toute note d'alerte utile : nous portons la même demande et nous ne goûtons pas le fait qu'il nous faille attendre les journaux pour obtenir les informations requises. Tout cela est très désagréable et a conduit le rapporteur général, à juste titre, à faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par la Lolf afin d'aller chercher les éléments d'appréciation que nous n'avions pas eus en temps et en heure.
M. Jean-François Husson, rapporteur général. - Votre présence ici, monsieur le Premier président de la Cour des comptes et président du Haut Conseil, tire son origine d'un jour de printemps. Notre mission d'information, qui porte sur la dégradation des finances publiques depuis 2023, son suivi par l'administration et le Gouvernement et les modalités d'information du Parlement sur la situation économique, budgétaire et financière de la France, a en effet été lancée à la suite de la parution, le 20 mars, d'un article de presse faisant état d'un fort décalage entre les prévisions de déficit public et la réalité.
Mon sang n'a alors fait qu'un tour, car on nous avait expliqué, depuis des mois, que les comptes étaient tenus et qu'il n'existait aucune difficulté, jusqu'à ce que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique annonce, le 18 février, en plein coeur des vacances de la région parisienne et à peine le projet de loi de finances pour 2024 adopté dans les conditions que l'on connaît, une première vague de coupes claires de 10 milliards d'euros, exactement deux mois après la promulgation de la LPFP.
L'enchaînement des événements et l'effet de surprise ont fait naître le sentiment d'avoir été soit contournés, soit mal informés. Or, il importe, dans une démocratie qui fonctionne correctement, que chacun soit respecté, qu'il exerce le pouvoir ou qu'il se trouve dans l'opposition ou la minorité, d'autant que la France est dotée de dispositifs de contrôle et d'évaluation. Je rappelle que le contrôle et l'évaluation de la dépense représentent une mission essentielle du Parlement, mais encore faut-il que celui-ci puisse s'appuyer sur les données adéquates.
Le Gouvernement vous transmet-il ses notes de service relatives à la situation économique et budgétaire, en sus des documents destinés à être rendus officiels ? Y a-t-il eu des carences dans les informations que vous auriez dû obtenir ? Le Gouvernement a, je pense, soit omis, soit choisi de ne pas vous rendre destinataire de certaines données : est-ce le cas pour certains types de documents et depuis quand ? Comment expliquez-vous ces décisions ?
Par ailleurs, quel est votre avis sur l'écart de déficit de 0,6 point de PIB - l'équivalent de 15 à 18 milliards d'euros - entre le PLF adopté par Parlement en décembre et la réalité constatée soixante jours après ? De votre point de vue, le Gouvernement aurait-il pu éviter ce décalage ? J'ai cru comprendre que le Haut Conseil s'était trouvé dans la même situation de manque d'informations que le Parlement : confirmez-vous ce point ?
M. Pierre Moscovici. - S'il ne m'appartient pas de choisir le moment pour modifier la Lolf, il me semble que le maintien de notre rendez-vous présente un intérêt, tant pour le débat public que pour le Parlement. En vertu des nouvelles règles, il serait biffé d'un trait de plume, ce qui ne pourrait qu'accroître le déficit d'information du Parlement : un point annuel consacré au suivi du plan budgétaire et structurel de moyen terme paraît sain et plus adapté qu'un débat tous les huit ans, qui laisserait subsister une « boîte noire » dans l'intervalle.
Concernant nos méthodes, le HCFP, avant la saisine officielle, envoie des questionnaires et des fichiers Excel à l'administration afin de disposer d'éléments chiffrés et explicatifs sur la prévision à venir. En règle générale, la réponse est transmise avec la saisine par le Gouvernement.
En amont de la saisine, nous auditionnons également les principaux prévisionnistes français, à savoir l'Insee, la Banque de France, Rexecode et l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), ce qui nous permet à la fois de connaître leurs prévisions, parfois avant qu'elles ne soient publiées, et surtout de disposer d'analyses de fond sur les questions du moment.
Après la saisine, nous auditionnons les administrations qui nous présentent le scénario macroéconomique et des finances publiques, en apportant des précisions sur certains points et en fournissant des informations manquantes. Le HCFP analyse ensuite les prévisions en les comparant avec les autres prévisions disponibles, qu'il s'agisse de celles de ses membres, des instituts auditionnés, des organisations internationales ou encore du consensus des économistes.
L'analyse des dernières informations conjoncturelles et leur confrontation avec les prévisions gouvernementales nourrissent notre réflexion : c'est ainsi que nous avons jugé optimiste la prévision de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) dans le PLF pour 2024, tout comme la prévision de prélèvements sociaux pour 2023. Nous mobilisons, en outre, des outils de prévision - notamment sur les prélèvements obligatoires - à titre de garde-fous, ce qui nous a conduits à juger la prévision de TVA pour 2024 élevée.
Enfin, l'analyse du réalisme et de la cohérence intrinsèque des prévisions s'appuie sur l'expertise et l'expérience des membres du HCFP. Je rappelle qu'il s'agit d'une instance pluraliste, composée de cinq personnalités qualifiées nommées par les présidents des deux assemblées, de quatre membres de la Cour des comptes et du directeur général de l'Insee. Les travaux sont toujours menés par consensus, avec, je tiens à le signaler, un secrétariat de taille bien plus réduite que dans les autres pays de l'Union européenne.
Nous disposons, au-delà des données publiques, de nombreux éléments d'information, dont des données d'exécution internes de Bercy, les encaissements mensuels des principaux impôts et les comptes mensuels des collectivités locales. S'y ajoutent des prévisions macroéconomiques relativement détaillées, des données des comptes des administrations publiques, sans oublier les réponses aux questionnaires envoyées en amont de la saisine. Sur ce point, nous sommes parfois amenés à formuler des demandes complémentaires, avec des fortunes diverses.
Je tiens à souligner, premièrement, que le HCFP ne dispose pas toujours de l'information nécessaire : les réponses aux questionnaires sont parfois imprécises, tandis que le Gouvernement ne nous fournit pas certaines données sur les comptes des administrations publiques, l'administration invoquant systématiquement des difficultés techniques. C'est pourquoi le Haut Conseil a adressé, en juillet 2023, une lettre au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et au ministre délégué chargé des comptes publics, en renouvelant la demande d'enrichissement de l'information transmise. Nous pourrons naturellement vous communiquer ce document, à la suite duquel des progrès ont été constatés : j'espère que d'autres seront possibles à l'avenir.
Deuxièmement, nous manquons de temps ! Le délai d'une semaine entre la saisine et la transmission de l'avis au secrétariat général du Gouvernement (SGG) n'existe pas pour tous les textes, par exemple pour le programme de stabilité : déjà très court, il devrait être imposé systématiquement et étendu à quinze jours pour le PLF et la LPFP. En l'occurrence, nous n'avons même eu que cinq jours pour rendre l'avis sur le programme de stabilité, afin de ne pas placer le Haut Conseil des finances publiques locales (HCFPL) devant le fait accompli. Ce délai est presque toujours respecté, même lorsque la loi organique ne l'impose pas, mais quand il ne l'est pas, notre travail devient extrêmement malaisé : une partie des informations demandées au sujet du programme de stabilité nous est ainsi parvenue moins de quatre jours ouvrés avant la transmission au SGG.
J'ajoute que les seules informations dont dispose le HCFP sur les prévisions de croissance et de déficit sont celles qui lui sont transmises par le SGG à l'occasion des saisines, et que nous n'avons pas accès à d'autres données. L'ensemble de ces éléments nous permet de travail en flux tendu et de produire des avis qui sont selon moi de grande qualité, malgré des informations incomplètes. De surcroît, nous ne parvenons pas à exploiter toutes les données disponibles, faute de temps, ce qui n'est pas une situation satisfaisante. C'est pour ces raisons que j'ai exprimé cette demande de transparence accrue, que vous portez également.
M. Antoine Lefèvre. - Dans son avis rendu le 16 avril, le HCFP note la prise en compte par le Gouvernement de la dégradation financière par rapport à la trajectoire prévue dans la LPFP, mais considère cependant que les hypothèses de croissance du Gouvernement sont encore avantageuses.
J'ai noté bien entendu votre proposition tendant à faire passer les dépenses publiques à travers un tamis qualitatif : quels seraient, selon vous, les principaux postes d'économies à privilégier afin de garantir un retour du déficit sous la barre des 3 points de PIB à l'horizon 2027, si tant est que cet objectif soit pleinement réalisable au regard de l'évolution de la charge de la dette et de la situation de notre balance commerciale ?
Par ailleurs, le ministre de l'économie a déclaré : « Je veux comprendre pourquoi il y a eu cet accident de 20 milliards d'euros sur l'évaluation des recettes ; en revanche, la dépense publique a été parfaitement exécutée. » Le terme « accident » ne fait pas oublier l'impact significatif de cette somme et ne semble pas approprié pour rendre compte du dérapage budgétaire de l'année 2023 : diriez-vous, comme le ministre, que la dépense publique a été parfaitement exécutée ?
M. Jean-Raymond Hugonet. - Monsieur le Premier président, je ne vous cacherai pas que la séquence à laquelle nous venons d'assister est proprement surréaliste. Nous venons d'entendre - j'allais dire supporter - pendant deux heures, en séance publique, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué chargé des comptes publics nous expliquer, la main sur le coeur, que tout va bien et que la volonté suffira ; à l'instant, vous nous adressez ici un message d'alerte et de vigilance en soulignant le besoin de réformes structurelles, en vous interrogeant sur la qualité de la dépense publique et en soulevant un problème de transparence.
Nous partageons pleinement votre perception, totalement inverse à celle du Gouvernement. En effet, ce dernier, même s'il procède de manière très policée, ne tient aucunement compte des avis émis par les structures éminemment importantes que vous présidez. Parallèlement, ce même gouvernement contourne le Parlement, avec l'aval du président de la République. Dans une démocratie qui reste vivante - même si on peut parfois en douter -, quel avenir voyez-vous pour le traitement des finances publiques ? Si nos concitoyens vivaient la même séquence que celle que nous venons de traverser, je pense que nous serions tous en grand danger.
Enfin, pensez-vous que le point de PIB soit encore l'unité adéquate pour mesurer les déficits ?
Mme Marie-Claire Carrère-Gée. - Je me réjouis que la Cour ait souligné, dans le cadre de la nouvelle réserve liée au processus de certification, l'absence de mention - au titre des engagements hors bilan du pays - des engagements pris dans le cadre du remboursement de l'emprunt émis par l'Union européenne au travers du plan de relance Next Generation EU, engagements qui s'élèvent à 75 milliards d'euros, soit environ la moitié du déficit annuel.
Dans un contexte où l'identification par l'Union européenne de ressources propres suffisantes paraît problématique et où la trajectoire du programme de stabilité semble assez peu crédible, il serait bon de faire savoir qu'il faudra rembourser ces 75 milliards d'euros non pas aux calendes grecques, mais à compter de 2028.
M. Michel Canévet. - Vous avez évoqué l'absence de réformes en 2023, mais je rappelle que nous avons beaucoup souffert des réformes des retraites et du marché du travail, même si elles ne sont pas suffisantes au regard des efforts qui devraient être accomplis.
Votre proposition visant à consulter le Haut Conseil sur le programme de stabilité chaque année et non pas tous les huit ans soulève quant à elle la question de la surtransposition de la règle européenne. En tout état de cause, compte tenu de la situation, il serait sans doute utile que nous disposions du plus grand nombre d'avis circonstanciés sur l'évolution des finances publiques.
Le budget de l'État accuse un déficit de 173 milliards d'euros, tandis que le déficit des administrations publiques centrales atteint 155 milliards d'euros, cet écart très significatif restant difficile à appréhender. Des gisements d'économies peuvent-ils être identifiés à ce niveau ?
Concernant le programme de stabilité, un effort accru des collectivités territoriales et des administrations de sécurité sociale est prévu, alors que le budget de l'État devrait subir une moindre réduction : faites-vous la même lecture et quel est votre avis sur ce point ?
M. Thierry Cozic. - Dans votre avis rendu public le 17 avril, vous avez indiqué, en somme, que la trajectoire élaborée par le Gouvernement pour maîtriser le déficit public était comparable à une pente raide, voire impraticable ; vous avez réaffirmé devant nous qu'elle manquait de crédibilité et de cohérence : de la part d'institutions telles que celles que vous présidez, cette appréciation sonne comme un désaveu sévère.
Pour la période 2023-2027, le Haut Conseil chiffre à près de 60 milliards d'euros le montant de l'ajustement budgétaire à réaliser, et souligne que jamais un tel effort n'a été effectué dans le passé. Selon nous, ce montant n'a rien d'anodin, car il équivaut exactement aux recettes fiscales supprimées depuis 2017 par le pouvoir en place.
Au regard de la détérioration des finances publiques, le Haut Conseil indique que le retour du déficit sous la barre des 3 points du PIB en l'espace de trois ans supposerait un ajustement structurel massif, qui « s'appuierait essentiellement sur un effort d'économies en dépenses ». Compte tenu des colossales recettes fiscales supprimées depuis sept ans et des besoins en investissements nécessaires pour appuyer une recherche à même de garantir la compétitivité de la France, le Haut Conseil pense-t-il que la diminution de la dépense représente le premier levier pour redresser le cap ? Si oui, quelles dépenses préconisez-vous de réduire ?
Mme Isabelle Briquet. - Le ministre de l'économie vient de réaffirmer en séance que la politique annoncée n'était pas une politique d'austérité, alors que vous venez d'indiquer que le niveau d'économies envisagé pour réduire le déficit était sans précédent. Si la copie n'est pas revue, nous serons pourtant bien face à un programme d'austérité, qui est la seule méthode proposée. Une politique austéritaire étant contre-productive, n'est-il pas urgent de parler des recettes ?
M. Pierre Moscovici. - S'il est toujours aisé de juger a posteriori que les choses étaient courues d'avance, il est en revanche très difficile de juger à partir de quel moment - et par qui - la dégradation des finances publiques pour l'année 2023 était clairement identifiée. Comme vous l'avez rappelé, ladite dégradation a été officiellement actée en février. La Cour des comptes, comme le HCFP, ne dispose que des éléments qui lui sont transmis sur les prévisions de croissance et de déficit : le Haut Conseil reçoit les prévisions transmises par le SGG, tandis que la Cour des comptes dispose des éléments communiqués par les administrations aux équipes chargées du chapitre dédié aux finances publiques du rapport annuel, ainsi qu'aux équipes chargées du rapport consacré au budget de l'État.
Lorsque j'ai présenté le rapport annuel, j'ai évoqué une « année blanche » en n'excluant pas la possibilité qu'elle prenne la forme d'une année grise, mais nous n'avions pas tous les éléments et ne vous avons rien dissimulé. Une grande partie de l'écart était difficile, voire impossible à prévoir, mais une partie des dérives avait été identifiée.
Dès son avis du 27 octobre 2023 sur le projet de loi de finances de fin de gestion (PLFFG) pour l'année 2023, le HCFP avait en effet relevé que la croissance prévue de la masse salariale marchande non agricole, comme celle des cotisations sociales et des prélèvements sociaux sur les revenus d'activité, était élevée. Dans ce même avis, le Haut Conseil soulignait le risque d'un recul plus fort qu'anticipé par le Gouvernement des droits de mutation à titre onéreux (DMTO).
S'agissant des travaux de la Cour, l'année 2023 nous a prouvé que nous avions besoin d'échanges plus nourris et d'une communication plus transparente avec les administrations : celles-ci doivent lui transmettre les estimations, les notes et les prévisions dont elles disposent, ce qui n'a pas été le cas fin 2023.
Par exemple, la Cour des comptes n'a pas été destinataire de la note des directions du Trésor et du budget datée du 7 décembre 2023 qui évoquait une potentielle dégradation du déficit public jusqu'à 5,2 % du PIB : nous ne l'avons reçue qu'en mars 2024, c'est-à-dire après l'instruction du rapport public annuel. Certes, cette note n'était pas affirmative, évoquait des incertitudes et des possibilités de pilotage de la dépense en fin d'année afin de réduire l'écart autant que possible. Elle n'aurait donc pas pu être utilisée pour documenter précisément un dérapage du déficit public dans notre rapport public annuel, mais cela démontre que nous avons eu raison de parler au conditionnel du respect de la trajectoire dans ce rapport publié le 12 mars, alors même que nous n'avions pas reçu d'éléments permettant de prouver un dépassement du déficit de la part de l'administration. Je pense que cette communication des documents doit être systématique, pour vous comme pour nous : je rappelle que notre rapport public annuel est remis au Président de la République et présenté au Parlement.
J'en viens aux hypothèses de croissance : nous avions formulé, dans nos avis relatifs au PLF pour 2024 et à la LPFP, des remarques extrêmement précises sur le caractère élevé des prévisions gouvernementales. L'écart était particulièrement significatif dans le cadre du PLF pour 2024 : le Gouvernement avait retenu une prévision de croissance de 1,4 %, alors que le consensus des économistes tablait davantage sur une croissance de 0,8 %. La prévision gouvernementale a ensuite été ramenée à 1 % dans un laps de temps très bref, de décembre à février. Vaut-il mieux une loi de finances correctement prévue ou un décret d'annulation de crédits ? Je laisserai chacun juger, n'ayant aucune intention de prendre position dans ce débat.
J'insiste également sur le fait que, nonobstant les économies considérables qui sont prévues sans être documentées, les prévisions de croissance restent très élevées, en particulier pour les années 2026 et 2027. Nous serions ainsi très au-dessus de notre potentiel de croissance - plus proche de 1 % que de 1,3 %, en vérité - après avoir réalisé des économies en dépenses très importantes, qui ne peuvent pas être, à notre sens, sans conséquence sur le niveau de la croissance.
Concernant les économies à privilégier, je rappelle que trois pistes peuvent être envisagées pour réduire le déficit. Tout d'abord, la croissance, qu'il convient de ne pas fragiliser : si nous devons toucher à des dépenses, il faudra cibler celles qui sont de faible qualité, dont la diminution ne l'affectera pas. Les recettes, ensuite, renvoient au débat sur le taux de prélèvements obligatoires, déjà très élevé. Pour autant, le débat démocratique pourrait conduire à ne pas exclure toute forme d'imposition ; en outre, le Haut Conseil préconise de remettre en question les baisses d'impôts prévues, soit en y renonçant, soit en les assortissant d'économies.
Le troisième levier, celui des économies en dépenses, reste le principal moyen d'action. Il faut ainsi maîtriser leur évolution spontanée par le biais des revues de dépenses, qui doivent insister sur la qualité. Cet exercice a commencé en 2023, avec un faible impact ; il se poursuit en 2024, mais manque de transparence à ce stade. La Cour des comptes publiera, quant à elle, ses revues de dépenses dès qu'elles seront produites : comment s'assurer, en effet, de l'efficacité de cet instrument si les travaux ne sont pas partagés dans la durée et s'ils ne font pas l'objet d'un débat démocratique ? C'est la méthode que nous suggérions, et il me semble qu'elle demeure valide. Au-delà de la volonté, il faudra du courage - les économies sont impopulaires - et de l'intelligence, car il faudra aller chercher les économies au bon endroit.
Quant au terme « accident » et à la bonne exécution des dépenses publiques, il est exact que la dépense publique a été légèrement inférieure à la prévision en 2023, en rappelant toutefois que les dépenses exceptionnelles ont été surcompensées et que la trajectoire était peu ambitieuse. En outre, peut-être a-t-on eu tort de spéculer sur un niveau systématiquement élevé des recettes et qu'une forme de retour à la normale est en cours.
Sur un autre point, le point de PIB reste une unité de mesure pertinente en ce qu'il permet des comparaisons européennes, par exemple sur le niveau de prélèvements obligatoires.
Pour ce qui est de la certification, je m'étonne que les réserves émises par la Cour des comptes n'aient pas été mentionnées dans le débat, alors que ladite certification a été votée par le Parlement après avoir mobilisé une vingtaine de personnes qui ont accompli un travail remarquable. Quelle entreprise procéderait ainsi, en ne mentionnant pas l'avis de son commissaire aux comptes ?
S'agissant des enjeux de surtransposition, je rappelle que les institutions budgétaires indépendantes existent dans tous les pays européens et qu'elles disposent presque toutes de mandats et de moyens plus importants que les nôtres. Il vous reste à évaluer si vous souhaitez prévoir un rendez-vous parlementaire annuel. Une fois encore, ne pas faire ce choix reviendrait, pour vous comme pour nous, à ne pas suivre l'exécution du programme : je parlerais donc plutôt d'une bonne information que d'une surtransposition.
Par ailleurs, agir sur la dépense reste nécessaire : avec des dépenses publiques qui représentent 57 % du PIB, soit huit points de plus que la moyenne des pays de la zone euro, je reste persuadé que certaines dépenses publiques sont de moindre qualité que d'autres. Les revues de dépenses devraient permettre de les identifier, tous les efforts d'économies n'étant pas douloureux, nocifs ou infondés. À cet égard, il importe de préserver la croissance et la qualité du service public, voire de l'améliorer.
Autrement dit, certaines dépenses fonctionnent sans doute mal et pourraient être plafonnées dans le temps, comme l'a suggéré le député Marc Ferracci. Nous avons formulé une suggestion similaire en matière d'aides aux entreprises, dont certaines ont été votées il y a fort longtemps, à tel point qu'on ne sait plus à quoi elles correspondent : les plafonner dans le temps et les évaluer régulièrement me paraîtrait relever d'une démarche de bonne gestion. À l'inverse, certains investissements, en faveur des Ehpad par exemple, devraient être musclés.
Une politique d'austérité est-elle prévue ? Je ne le crois pas, même si, incontestablement, l'effort en dépenses annoncé est très important et sans précédent. C'est pourquoi nous avons souligné les problématiques de cohérence et de crédibilité : pour reprendre une image, la descente de l'escalier de la dépense devrait s'effectuer en empruntant des marches extrêmement hautes, dans un contexte économiquement et politiquement difficile.
J'insiste sur le manque de cohérence que nous avons relevé. Certes, Bruno Le Maire et Thomas Cazenave assument une tâche ardue, comme j'ai pu l'expérimenter lorsque j'occupais leurs fonctions. Le débat mérite cependant d'être posé : si l'on entend privilégier absolument le taux de croissance, le déficit sera très probablement supérieur à 2,9 % du PIB, quand bien même je n'ai jamais nourri d'inquiétudes quant à notre capacité de financement de notre dette, la France n'étant pas la Grèce.
En revanche, une charge de la dette élevée nous prive des capacités d'action publique, ce qui ne nous permettra pas de faire face aux problèmes macroéconomiques, ni aux investissements nécessaires pour préparer l'avenir : in fine, on s'appauvrit en s'endettant.
À l'inverse, si la réduction du déficit est bien l'objectif prioritaire, la croissance en pâtira puisqu'il s'agira d'opérer un prélèvement sur l'économie à hauteur de 20 milliards d'euros par an qui aura nécessairement des répercussions sur le PIB.
Il faudra donc poser clairement ce débat relatif à la cohérence entre la macroéconomie et les finances publiques devant les Français, afin de dire la vérité et de faire des choix.
En conclusion, et même si je n'ai pas à qualifier nos propres avis, je note que nous n'avions jamais évoqué un « manque de cohérence » jusqu'à présent. Je ne parlerai pas d'« insincérité », mais c'est effectivement la première fois que nous employons cette formule, qui traduit le franchissement d'un seuil supplémentaire.
M. Claude Raynal, président. - Merci, monsieur le Premier président. Nous partageons votre opinion selon laquelle il n'est plus seulement question de technique financière ou budgétaire, mais de choix et de décisions politiques qui se déclinent ensuite sur le plan budgétaire. Nous sommes en effet plus proches d'un débat politique général sur les ambitions et les priorités du pays que sur des ajustements.
Cette audition a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 17 h 20.