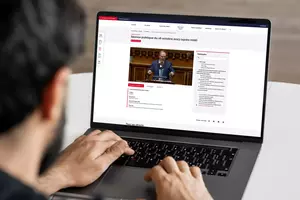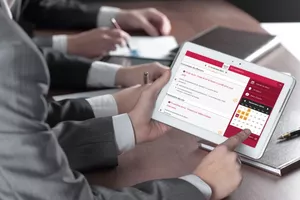M. Jean-Michel Arnaud. Monsieur le secrétaire d’État, en l’état actuel du droit, et notamment du code de l’environnement, il est prévu que, dans les zones de montagne, l’atterrissage et la dépose des aéronefs à des fins de loisirs sont interdits, sauf sur un aérodrome désigné ou sur les emplacements autorisés par la police administrative.
Il fallait évidemment bannir ce genre d’activité, particulièrement dommageable à l’environnement et contraire à la conception que nos concitoyens se font de la protection de celui-ci. La loi Climat et Résilience a donc logiquement renforcé ces interdictions en prohibant les vols de transport de passagers à des fins de loisirs.
Cependant, dans le droit en vigueur, les termes « zones de montagne » et « à des fins de loisirs » restent imprécis, laissant une marge d’interprétation à l’administration, en particulier à la direction générale de l’aviation civile (DGAC) et à l’autorité préfectorale.
Cette situation crée des difficultés pour les professionnels, qui se trouvent confrontés à des interprétations variées, faisant courir le risque d’un traitement inéquitable.
Le 8 avril 2022, j’avais saisi le ministère de la transition écologique de cette question. Celui-ci m’avait notamment précisé que les « activités à des fins de loisirs », qui incluent la dépose de skieurs, de randonneurs ou de touristes en dehors des aérodromes, ainsi que la dépose à titre personnel, c’est-à-dire sans but professionnel, ne peuvent être réalisées en dehors des plateformes autorisées par l’autorité administrative.
À ce jour, ces interprétations posent des difficultés pour l’activité quotidienne de nos entreprises.
Monsieur le secrétaire d’État, de quelle manière le Gouvernement envisage-t-il de prendre des mesures réglementaires permettant d’établir un cadre pour interdire l’atterrissage et la dépose des aéronefs à des fins de loisirs, tout en maintenant le droit à l’activité d’entreprises particulièrement importantes dans mon département ?
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Hervé Berville, secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité. Monsieur le sénateur Jean-Michel Arnaud, la définition de la notion de « zone de montagne » remonte à la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite loi Montagne.
Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée par décret à l’un des massifs déterminés par la loi. La liste des communes classées totalement ou partiellement en zone de montagne est ainsi fixée par plusieurs arrêtés interministériels pris entre 1974 et 1985.
Cette notion, qui existe depuis 1983, n’a pas posé de problème d’application. Certes, vous ne sous-entendez pas le contraire, mais cette précision me permet d’en venir à l’utilisation d’aéronefs à des fins de loisirs.
L’édiction d’une définition différente des « zones de montagne » pour les aéronefs à moteur emporterait des conséquences sur l’ensemble des législations auxquelles la loi Montagne renvoie. Dans le souci d’assurer la clarté de la règle de droit, cela n’apparaît pas opportun.
Ainsi que vous l’avez souligné, la protection de l’environnement et de la biodiversité est un enjeu crucial, raison pour laquelle nous devons apporter des précisions sur les autorisations d’atterrissage et de décollage.
En outre, si la notion de loisir n’est pas définie dans un texte de droit français, la jurisprudence en a précisé les contours. Il ne semble pas que les activités relatives à la formation et au maintien de compétences, notamment pour le vol en montagne, soient ainsi visées.
L’interdiction de décoller et d’atterrir s’applique néanmoins si la finalité de l’embarquement ou du débarquement des passagers a un caractère récréatif ou sportif. Tel est le cas, par exemple, des activités sportives en montagne ou du transport à destination ou en provenance d’un restaurant d’altitude ou d’une résidence de villégiature en montagne.
En ce qui concerne les activités économiques, cœur de votre question, il faudrait que vous définissiez ce que vous entendez par ce terme. En effet, on pourrait considérer que des activités de loisirs sont des activités économiques, auquel cas l’interdiction s’y appliquerait, sauf si ces activités relèvent de la formation ou du maintien des compétences.
Tant sur la définition des zones de montagne que sur celle des activités de loisir, les textes sont plutôt clairs. Je reste à votre disposition si vous souhaitez des précisions supplémentaires.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Michel Arnaud, pour la réplique.
M. Jean-Michel Arnaud. Il se trouve que mon département est entièrement classé en zone de montagne, alors qu’il s’étage entre 500 mètres d’altitude, en plaine, où se trouvent les aérodromes, et 4 200 mètres d’altitude.
Il semble clair que les activités spécifiques de la société Hélicoptères de France, partenaire du Tour de France, ne sont pas sujettes aux interdictions de dépose. (M. le secrétaire d’État le confirme.)
Monsieur le secrétaire d’État, je vois que vous approuvez mes propos. Il vous suffirait de l’indiquer aux administrations concernées, tant à la DGAC qu’aux autorités administratives, afin que la couverture médiatique du Tour de France ainsi que les occupations professionnelles et économiques qui en découlent ne rencontrent aucune difficulté l’été prochain.
pollution de l’île-de-france
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Souyris, auteure de la question n° 1260, adressée à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Mme Anne Souyris. Monsieur le secrétaire d’État, les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), ou polluants éternels, sont des substances chimiques qui contaminent notre environnement, nos vies, et qui nous intoxiquent.
Le 30 mai prochain, nous pourrons les interdire lors de l’examen, au Sénat, d’une proposition de loi écologiste déjà adoptée par l’Assemblée nationale. D’ici là, je souhaite interroger le Gouvernement au sujet de la pollution de l’Île-de-France à ces substances.
Le 20 novembre 2023, l’agence régionale de santé (ARS) publiait les conclusions d’une étude menée dans vingt-cinq poulaillers domestiques, à la suite des alertes lancées par le collectif 3R. Elle confirmait une contamination ubiquitaire en polluants organiques persistants (POP) et en PFAS et recommandait d’éviter la consommation d’œufs de poule issus d’élevages domestiques parisiens.
Cette étude nous interroge de facto quant à l’exposition de la population francilienne aux POP et aux PFAS, notamment à proximité des incinérateurs.
Par ailleurs, dans le même temps, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) menait une étude sur la présence de dioxines dans le lait maternel en Île-de-France. Monsieur le secrétaire d’État, avez-vous connaissance des résultats de cette étude ?
Se pose ensuite la question de l’origine de cette pollution. L’incinération de déchets ménagers a-t-elle participé à sa diffusion ? Si tel était le cas, l’alerte sanitaire devrait être étendue à tous les territoires situés à proximité d’usines similaires, c’est-à-dire à une grande part du territoire national. Quels moyens le Gouvernement met-il en œuvre pour expertiser la situation en Île-de-France, qui revêt un intérêt national ?
Enfin, la presse s’est fait l’écho de défauts du contrôle des rejets de dioxines par l’incinérateur d’Ivry-Paris XIII, en indiquant que des centaines d’heures d’opérations de l’usine n’auraient pas été contrôlées. Ce dysfonctionnement jette la suspicion sur l’ensemble des opérations de contrôle des installations classées pour l’environnement.
Monsieur le secrétaire d’État, comptez-vous saisir les inspections compétentes ? Surtout, à quand des contrôles indépendants ?
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Hervé Berville, secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité. Madame la sénatrice Anne Souyris, un rapport de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a effectivement établi la contamination des sols et des œufs de poulaillers domestiques situés dans l’agglomération parisienne par divers polluants organiques.
L’ARS n’a cependant pas mesuré de concentrations plus importantes à proximité d’incinérateurs. Elle indique que cette contamination est probablement due à de multiples sources, comme la circulation routière ou les brûlages de déchets à l’air libre.
Ainsi que vous le savez, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, accorde une importance particulière à ce que les incinérateurs remplissent leurs fonctions de traitement de déchets sans induire de risque sanitaire ou environnemental – nous partageons cette exigence.
S’il est vrai que ces incinérateurs peuvent émettre des polluants, leurs rejets sont strictement encadrés par une réglementation continuellement renforcée, qui impose des valeurs limites d’émission de polluants de plus en plus basses.
Soucieux de la bonne mise en œuvre de cette réglementation, le ministère a diligenté en 2024 une action de contrôle spéciale de l’inspection des installations classées sur certains incinérateurs.
Plus généralement, les grands incinérateurs, tels que celui d’Ivry-sur-Seine, font l’objet d’un contrôle assidu, avec une inspection au moins une fois par an en bonne et due forme.
Les contrôles réalisés sur l’incinérateur d’Ivry montrent que les exigences réglementaires de surveillance des dioxines ont été respectées. Les durées d’indisponibilité de la surveillance mentionnées par les associations sont surestimées, car elles comprennent des périodes pendant lesquelles l’incinérateur était à l’arrêt, en maintenance ou en phase de démarrage sans qu’aucun déchet soit présent dans son four.
Sur le sujet plus particulier des PFAS, je souhaite rappeler que le Gouvernement est fortement mobilisé pour répondre aux enjeux environnementaux et sanitaires liés à ces substances. Il a publié le 5 avril 2024 un plan d’action interministériel sur les PFAS, qui inclut notamment l’obligation de mesurer ces substances dans les émissions des incinérateurs et qui organise la mobilisation des administrations publiques concernées en s’appuyant sur l’expertise de nombreux opérateurs et agences de l’État.
situation des ligneurs de la pointe de bretagne
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, auteur de la question n° 1181, adressée à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité.
M. Jacques Fernique. Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite pointer la situation insoutenable dans laquelle se trouvent les ligneurs de la pointe de Bretagne, que ma collègue eurodéputée Caroline Roose a rencontrés.
Ces pêcheurs artisans nous alertent depuis des années sur l’état des populations de lieu jaune. Ils ont proposé des mesures de sauvegarde, comme la définition d’une période de repos biologique pour permettre leur reproduction ou l’augmentation de la taille des captures, mais celles-ci ont été systématiquement rejetées.
En décembre dernier, des quotas de pêche draconiens ont été adoptés par l’Union européenne. Il est positif tant pour les pêcheurs que pour la préservation de cette espèce de réduire la quantité totale de lieu jaune pêché ; mais ce qui l’est moins, c’est la répartition des quotas par bateau.
De nombreux ligneurs se retrouvent sans autorisation de pêcher ce poisson, alors que d’autres navires pourront en pêcher plusieurs dizaines de tonnes. En effet, pour l’essentiel, les demandes de quotas adressées par les pêcheurs à la ligne auprès des organisations de producteurs ont été refusées.
Pour la plupart, ces jeunes pêcheurs ont adopté des pratiques respectueuses de l’environnement. Ils ont emprunté pour financer leur activité et sont confrontés à des risques sérieux de faillite.
Cette situation est injuste : les droits de pêche historiques, issus d’une politique de surpêche, constituent le principal critère retenu pour l’attribution des quotas, tandis que les critères environnementaux et sociaux sont à peine utilisés, au mépris de l’article 17 du règlement européen relatif à la politique commune de la pêche.
Il en résulte une marginalisation systématique des pêcheurs artisans défendant de meilleures pratiques de pêche. Ce système récompense ceux qui ont la plus grande part de responsabilité dans l’effondrement des populations de poissons.
Donner quelques miettes aux pêcheurs artisans et concéder l’écrasante majorité des droits de pêche aux industriels, c’est acter la mort de la petite pêche.
Monsieur le secrétaire d’État, que faites-vous pour protéger les ligneurs de lieu jaune ou les pêcheurs artisans de thon rouge ? Où en est l’application de l’article 17 de la politique commune ?
Il y va de l’avenir des pêcheurs aux méthodes les plus responsables : ne les laissez pas couler !
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Hervé Berville, secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité. Monsieur le sénateur Jacques Fernique, chaque année, au mois de décembre, le Conseil des ministres européen définit sur la base d’avis scientifiques les possibilités de pêche de l’Union européenne par espèce, avant que celles-ci ne soient réparties entre les différents pays.
Cette année, au regard de la baisse de la ressource de lieu jaune, ces possibilités de pêche ont été réduites de 87 % dans la Manche, la mer Celtique et la mer d’Irlande.
Cette chute a des effets particulièrement importants pour les pêcheurs artisans, que je connais bien. Je pense notamment aux canneurs-ligneurs de Bretagne, pour lesquels les quotas pour 2024 sont tombés à six tonnes, alors qu’en moyenne ces dernières années ils avoisinaient les trente-cinq tonnes.
Face à cette situation, le Gouvernement a demandé aux organisations de producteurs d’effectuer un transfert de quotas au profit des navires non adhérents pour permettre à ces derniers de poursuivre leurs activités.
Ce transfert entre professionnels a permis la réouverture de la pêche au lieu jaune pour les navires n’appartenant pas à des organisations de producteurs dès le 8 mai prochain. Ceux-ci sont donc assurés de pouvoir pêcher pendant la période de pêche de juin et juillet : voilà une réponse concrète pour les pêcheurs artisans.
Pour autant, le sujet est bien celui de la règle de répartition des quotas. Mon ministère a engagé depuis deux ans un travail de fond sur les critères d’attribution de la réserve nationale d’antériorités, constituée par les droits récupérés lors de changements d’armateurs ou de destructions de navires. Cette réserve a été alimentée à la suite de la mise en place du plan individuel d’accompagnement lié au Brexit, particulièrement pour le lieu jaune pêché dans la zone 7.
En lien avec les professionnels, ces travaux visent à intégrer des critères environnementaux et sociaux, voire à prendre en compte la crise économique, pour couvrir les besoins des navires les plus dépendants, notamment ceux qui adoptent des méthodes artisanales de pêche.
Ces travaux se poursuivent et je vous assure que nous les conduirons à leur terme. Nous avons répondu à l’urgence en répartissant différemment les quotas, pour permettre aux pêcheurs artisans de poursuivre leur activité. Et surtout, nous continuerons le travail de fond, auquel vous êtes invité à participer.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, pour la réplique.
M. Jacques Fernique. Monsieur le secrétaire d’État, j’entends vos paroles et votre volonté de mener ces travaux à leur terme. Mais dans les actes, vous faites appel de la décision administrative du tribunal de Montpellier qui annulait l’arrêté relatif à la répartition du quota français de pêche de thon rouge. Ce tribunal avait jugé que ce système n’est ni transparent, ni objectif, ni conforme à la législation. Les pêcheurs artisans ne tiendront plus longtemps si vous ne les soutenez pas mieux !
M. Hervé Berville, secrétaire d’État. Cela n’a rien à voir avec le lieu jaune !
modalités d’affectation de la dotation de solidarité rurale
Mme la présidente. La parole est à Mme Sylviane Noël, auteure de la question n° 1195, adressée à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité.
Mme Sylviane Noël. Monsieur le secrétaire d’État, le code général des collectivités territoriales dispose que la dotation de solidarité rurale (DSR) est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d’arrondissement de moins de 20 000 habitants.
La première fraction de la DSR est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 % de la population du canton, aux communes sièges des bureaux centralisateurs ainsi qu’aux communes chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014.
Cependant, l’article L. 2334-21 du même code précise que, lorsqu’une commune chef-lieu de canton au 1er janvier 2014 a aujourd’hui dépassé le seuil de 10 000 habitants, les communes situées dans son unité urbaine ne peuvent plus être éligibles à la DSR, et perçoivent au titre d’une garantie de sortie non renouvelable une attribution égale à la moitié de la somme perçue l’année précédente.
C’est dans cette situation que se trouve la commune de Groisy, en Haute-Savoie. Comptant 3 500 habitants au dernier recensement, elle est rattachée pour l’attribution de la DSR à la commune nouvelle de Fillière, issue d’une fusion de communes ayant eu lieu en 2017, du fait de laquelle le chef-lieu de canton en 2014, Thorens-Glières, a dépassé le seuil de 10 000 habitants.
En 2024, Groisy perdra ainsi 130 000 euros, soit près de 5 % de son budget de fonctionnement.
Cette situation pénalise lourdement les communes rurales situées dans l’unité urbaine d’un chef-lieu de canton ayant dépassé le seuil de 10 000 habitants. Ces communes, qui font face à des charges spécifiques liées à leur situation géographique et à leur faible densité de population, se voient privées d’une ressource financière essentielle à leur fonctionnement.
Aussi, je souhaite savoir si le Gouvernement entend modifier les modalités de calcul de cette dotation, notamment dans les cas où l’augmentation de population en cause résulte d’une fusion de commune ou, à défaut, s’il envisage de compenser le manque à gagner pour les communes concernées.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Hervé Berville, secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité. Madame la sénatrice Sylviane Noël, la première fraction de la dotation de solidarité rurale, dite bourg-centre, est destinée, par des attributions importantes, à soutenir de manière ciblée les communes supportant des charges de centralité en milieu rural.
Les critères d’exclusion appliqués à cette dotation visent à prioriser les communes exerçant ce type de fonction de centralité. Tel est bien le cas des communes de plus de 10 000 habitants chefs-lieux de canton, qui assument davantage que les autres communes dudit canton les fonctions liées au maintien de services publics en milieu rural au-delà de leur seul territoire. Venant d’un territoire rural – les Côtes-d’Armor –, je sais parfaitement de quoi il retourne.
C’est pour cette raison que, lorsqu’un chef-lieu de canton compte plus de 10 000 habitants, les autres communes du canton ne peuvent être éligibles à la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale.
La création de communes nouvelles a pour objectif de créer des pôles d’attractivité dynamiques à l’échelon local, notamment en mutualisant et en centralisant les services de proximité. De ce fait, il est cohérent que le dépassement du seuil de population par la commune nouvelle chef-lieu résultant d’une fusion entraîne l’inéligibilité des autres communes du canton.
Par ailleurs, madame la sénatrice, je vous rappelle qu’un nouveau mécanisme en faveur des communes nouvelles a été mis en place à compter de 2023. Il permet à toutes les communes nouvelles de plus de 10 000 habitants, qui seraient considérées comme rurales au sens de la grille de densité de l’Insee, d’être potentiellement éligibles aux trois fractions de la DSR.
Pour autant, on ne peut pas totalement se satisfaire de cette situation, qui conduit dans certains cas à l’exclusion de certaines communes auxquelles incombent toujours des charges de centralité.
Pour cette raison, je souhaite que ce sujet soit traité dans le cadre des travaux de refonte de la dotation globale de fonctionnement lancés en début d’année, conformément aux annonces du Président de la République, auxquels je sais que vous participerez. Ceux-ci permettront de soutenir notre centralité et nos territoires ruraux, ainsi que les élus locaux, qui s’impliquent au quotidien pour la vitalité de la ruralité.
Mme la présidente. La parole est à Mme Sylviane Noël, pour la réplique.
Mme Sylviane Noël. Monsieur le secrétaire d’État, je suis heureuse que vos travaux n’éludent pas totalement cette question. Le fait qu’un chef-lieu de canton dépasse le seuil de 10 000 habitants ne change rien au budget des communes concernées.
procurations tardives
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen, auteur de la question n° 1266, adressée à M. le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
M. Pierre-Jean Verzelen. Madame la secrétaire d’État, alors que nous sommes appelés à nous rendre aux urnes dans quelques semaines pour les élections européennes, ma question a pour sujet les demandes de procuration de vote.
Depuis un certain nombre d’années, tout est fait pour faciliter et assouplir l’obtention de celles-ci – et c’est tant mieux.
Pour la première fois, lors des prochaines élections européennes, la procédure de demande de procuration pourrait être entièrement dématérialisée. Là encore, c’est tant mieux, mais un certain nombre de mairies sont confrontées à des difficultés pour actualiser leurs listes d’émargement.
Je m’explique : la mairie a la main sur le répertoire électoral unique (REU) et reçoit les informations lui permettant de mettre celui-ci à jour. Toutefois, comme il n’y a pas de date limite pour déposer une demande de procuration, certaines mairies doivent réaliser cette opération le matin même des élections. Malheureusement, toutes les communes ne disposent pas des ressources humaines nécessaires pour actualiser ainsi leurs listes d’émargement au dernier moment.
Cela a conduit à des difficultés lors des dernières élections, notamment dans des communes rurales, où un certain nombre d’électeurs munis de procurations n’ont pas pu voter pour les personnes qui les leur avaient confiées.
Le Gouvernement a-t-il prévu des mesures en la matière, par exemple en prévoyant une date limite pour le dépôt des demandes de procuration de vote ?
J’étais maire lors des dernières élections européennes, en 2019. Il y avait à l’époque trente-quatre listes candidates, contre déjà vingt-deux listes aujourd’hui, alors que la date limite de dépôt n’est pas encore atteinte. Les mairies sont dans l’obligation de gérer l’affichage public des candidats. En 2019, cela avait posé des problèmes très importants, qui se poseront de nouveau cette année, car le matériel nécessaire n’est pas toujours disponible dans les communes.
Il faut donc faire passer un message d’une grande souplesse pour les mairies qui rencontreront des difficultés à s’organiser en la matière.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Marina Ferrari, secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du numérique. Monsieur le sénateur Verzelen, la mise en service de la téléprocédure Maprocuration en avril 2021 a permis de simplifier la procédure d’établissement des procurations de vote et d’engager sa dématérialisation.
Grâce à l’interconnexion de la téléprocédure au répertoire électoral unique depuis le 1er janvier 2022, les procurations établies en ligne sont désormais automatiquement contrôlées et transmises aux communes.
La gestion centralisée et informatisée des procurations dans le REU allège ainsi considérablement la charge des communes en la matière, puisque l’intervention de la mairie pour vérifier l’inscription des électeurs sur la liste électorale concernée n’est plus nécessaire, les procurations étant automatiquement inscrites sur la liste d’émargement éditée à partir du REU.
Dès lors qu’aucune disposition du code électoral n’impose aux électeurs de date limite pour établir une procuration à l’occasion d’un scrutin donné, il est en théorie possible d’établir une procuration jusqu’au jour des élections. En effet, cela peut impliquer de mobiliser les communes afin de vérifier la validité des procurations établies tardivement et n’apparaissant pas sur les listes d’émargement.
Comme vous le soulignez, la téléprocédure Maprocuration constitue une évolution majeure en faveur de l’accès au vote, plébiscitée par les électeurs. Le droit de vote constitue un droit essentiel de nos concitoyens, qui souhaitent disposer de davantage de souplesse dans l’établissement d’une procuration.
Dans ce contexte, alors que malheureusement l’abstention augmente de manière continue, instaurer d’une date limite pour les demandes de procuration serait perçu comme un recul difficilement compréhensible, notamment au regard des efforts déployés en faveur de la participation électorale.
Dès lors, le Gouvernement n’envisage pas d’imposer une date limite pour l’établissement des procurations. Cependant, des modalités pratiques d’accompagnement des communes dans la prise en compte des procurations tardives seront mises en place pour les élections européennes du 9 juin prochain, au travers d’une permanence assurée par un agent de préfecture le jour du scrutin.
En ce qui concerne votre interrogation au sujet de la présentation des listes des candidats aux élections européennes, les services préfectoraux feront bien évidemment preuve de souplesse vis-à-vis des communes.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen, pour la réplique.
M. Pierre-Jean Verzelen. Madame la secrétaire d’État, vous comprenez bien la réalité de la situation : dans une commune de 200 habitants, la liste d’émargement est imprimée la veille des élections et ne peut pas l’être le dimanche matin.
Toutefois, j’entends vos propos, et je me réjouis que la préfecture fasse preuve de souplesse pour autoriser les personnes disposant de procuration à voter.
avenir de l’otan
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Demilly, auteur de la question n° 1167, adressée à M. le ministre des armées.