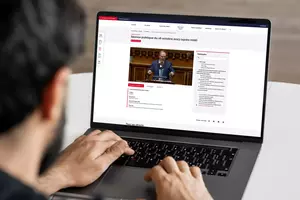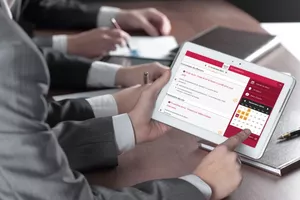Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Madame la sénatrice Poncet Monge, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser mon collègue Stéphane Séjourné, dont je me ferai la porte-parole.
Depuis le début du conflit à Gaza, la France est mobilisée pour soutenir les besoins humanitaires de la population palestinienne. Ces besoins sont immenses.
Au-delà des opérations de soutien humanitaire global, plusieurs actions spécifiquement destinées aux enfants de Gaza ont été menées. Celle à laquelle vous faites référence, qui permet la prise en charge d’enfants gravement blessés au sein de nos hôpitaux, constitue sans nul doute la plus complexe. Elle doit, je crois, faire la fierté de la France.
Il est important de préciser comment s’organisent concrètement ces évacuations de la bande de Gaza, qui doivent être suivies d’un transfert médicalisé, avant de déboucher sur une prise en charge hospitalière. Il s’agit d’un processus à la fois long, difficile, voire dangereux pour les personnes concernées, et très complexe sur le plan technique.
Ce processus répond à plusieurs conditions.
La première est l’accord explicite des parents ou des ayants droit des enfants concernés. Nous devons, à cet égard, être en mesure de vérifier les liens de parentalité et nous assurer que le consentement a bien été donné.
La deuxième est l’accord des autorités israéliennes, qui décident de qui peut entrer ou sortir de la bande de Gaza.
La troisième est l’intérêt médical d’une prise en charge en France plutôt qu’ailleurs.
À ce jour, 14 enfants, accompagnés d’un de leurs parents au moins, ont pu être admis au sein de nos hôpitaux. Ce chiffre, qui peut vous paraître modeste, constitue pourtant une réussite importante. S’il n’est pas plus élevé, ce n’est pas parce que nous l’avons voulu – bien au contraire –, mais parce que l’hospitalisation en Égypte, ou ailleurs dans la région, est souvent privilégiée par les parents eux-mêmes, pour des raisons objectives de proximité.
Nous sommes disposés et prêts à accueillir 50 enfants, comme cela avait été annoncé. De nouvelles opérations d’évacuation sont d’ailleurs en train d’être menées, en lien avec des ONG françaises qui ont sollicité notre appui pour prendre en charge des enfants nécessitant des soins lourds.
La réussite de ces opérations ne doit pas être jugée à l’aune d’un seul chiffre, mais plutôt de notre capacité à organiser une intervention depuis une zone de guerre.
Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour la réplique.
Mme Raymonde Poncet Monge. Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre, mais j’ai pu vérifier qu’il existait une liste d’enfants qui prend en compte les conditions que vous venez d’évoquer.
Avoir accueilli 14 enfants seulement depuis novembre dernier, au vu de la situation que connaît Gaza, ce n’est pas sérieux… Il faut accélérer ! Ces 50 lits doivent être véritablement actifs, et la France doit tenir sa promesse.
baisse de l’indice de parité de pouvoir d’achat dans plusieurs circonscriptions consulaires en 2024
Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret, auteure de la question n° 1205, adressée à M. le ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l’attractivité, de la francophonie et des Français de l’étranger.
Mme Hélène Conway-Mouret. La pérennité de notre système de solidarité envers les familles françaises qui ont besoin de bourses scolaires est en danger.
Nous observons que les leviers pour réaliser des économies ont tous été activés : tout d’abord, l’augmentation de 2 à 7 points de la contribution progressive de solidarité a entraîné une baisse des quotités ; ensuite, l’annulation de 11,5 millions d’euros des crédits du programme 151 ; enfin, plus récemment, la baisse de l’indice de parité de pouvoir d’achat (Ippa) dans de nombreuses circonscriptions consulaires pour la campagne 2024-2025 augmente mécaniquement le reste à charge des familles.
À titre d’exemple, mais je pourrais citer bien d’autres cas, l’indice est passé de 75, en 2023, à 63 cette année à Hô Chi Minh-Ville, ce qui représente une baisse de plus de 8 points de quotité, alors que le taux d’inflation a atteint 4 % dans le pays.
L’opacité de cette décision, prise par le ministère sur la base de données confidentielles fournies par une agence privée, suscite l’incompréhension des conseillers des Français de l’étranger chargés d’examiner les dossiers et empêche les parlementaires d’exercer leur mission de contrôle de l’action du Gouvernement.
Elle semble davantage motivée par des raisons budgétaires que par l’évolution réelle des parités de pouvoir d’achat entre la France et les pays concernés.
Ce faisant, elle va à l’encontre de l’esprit même de notre système d’aide à la scolarité, conçu pour garantir l’accès de tous les élèves français à notre enseignement, quelles que soient leurs ressources financières, et pour préserver la mixité sociale au sein de l’école républicaine. Elle est même contraire aux objectifs affichés par le Président de République lui-même, qui entend toujours doubler le nombre d’élèves d’ici à 2030.
Madame la ministre, quels sont les critères sur lesquels s’appuie ce nouveau mode de calcul de l’Ippa ?
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Madame la sénatrice Conway-Mouret, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser mon collègue Franck Riester, dont je me ferai la porte-parole.
Par votre question, vous sollicitez une clarification des critères mesurant l’indice de parité de pouvoir d’achat, l’Ippa, utilisé dans le barème des bourses scolaires. Cet indice est calculé à partir de données objectives fournies annuellement pour chaque poste par l’agence Mercer Consulting. Il est constitué à hauteur de 70 % de l’indice de coût de la vie et de 30 % de l’indice de coût du logement, sur la base d’un indice 100 pour Paris.
Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères calcule les Ippa par poste et les transmet à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), qui les communique aux postes diplomatiques et consulaires et les intègre au logiciel Scola de gestion des bourses scolaires.
La variation de l’Ippa a une conséquence mécanique sur la valeur des aides à la scolarité qui sont versées. En effet, le contexte inflationniste mondial a entraîné en 2023 de très fortes variations. Sur 176 pays, 52 ont connu une évolution à la hausse supérieure ou égale à 10 points. Cette variation haussière a ainsi été favorable aux familles dans l’attribution des bourses scolaires pour la campagne passée.
La baisse constatée dans certains postes en 2024, principalement en Afrique et en Asie, fait suite à une actualisation de la méthode de calcul des indices de coût de la vie. Celle-ci a procédé, d’une part, à une mise à jour du contenu du panier de biens et de services servant au calcul de l’indice de coût de la vie et, d’autre part, à une prise en compte des charges courantes – eau, gaz, électricité, internet – plus fidèle à la réalité de la consommation des ménages au niveau local.
Les Ippa connaissent ainsi régulièrement des évolutions à la hausse ou à la baisse selon les pays, qui n’ont aucun lien avec des mesures budgétaires. La plupart des pays concernés par ces baisses en 2024 retrouvent en fait un indice proche de celui de la campagne 2022-2023.
Les données utilisées dans le calcul de cet indice sont acquises par le ministère dans le cadre d’un marché avec Mercer Consulting, une entreprise privée. Elles ne peuvent donc pas faire l’objet d’une communication publique, car le ministère n’en est pas propriétaire.
Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret, pour la réplique.
Mme Hélène Conway-Mouret. Je vous remercie, madame la ministre, de ces éléments de réponse, qui arrivent un peu tardivement, puisque les conseils consulaires chargés d’attribuer les bourses scolaires se sont déjà tenus, dans le flou le plus total.
Pour ce qui concerne la baisse arbitraire de l’Ippa et les interrogations des conseillers des Français de l’étranger – d’ailleurs passées sous silence, puisque, dans de nombreux pays, leurs déclarations liminaires n’ont pas été inscrites au procès-verbal –, il serait appréciable que le Gouvernement fasse preuve de davantage de transparence vis-à-vis des élus locaux et des parlementaires.
difficultés matérielles d’exercice des missions de lieutenant de louveterie
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, auteur de la question n° 821, adressée à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité.
M. Philippe Bonnecarrère. Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur les difficultés matérielles d’exercice des missions confiées aux lieutenants de louveterie.
Les lieutenants de louveterie sont des bénévoles qui assurent des missions d’intérêt général, en l’occurrence relatives à la faune sauvage, lorsque celle-ci porte atteinte aux biens ou aux personnes. Leurs interventions se font dans le cadre du code de l’environnement. L’État exige d’eux une disponibilité et un équipement spécifique, avec des tenues obligatoires, l’entretien d’au moins quatre chiens, une mobilité…
La mission des lieutenants de louveterie est une mission de service public, qui ne relève pas du tout d’une pratique de plaisir, et, à ce titre, elle n’est pas une action de chasse.
L’État fait de plus en plus appel à ces bénévoles, notamment pour l’application du plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage, dans un contexte où l’exercice de cette mission n’est pas psychologiquement aisé. Parallèlement, leurs charges augmentent, et ils ont des difficultés à assurer la conservation des meutes.
Pour résumer, on leur demande de faire plus, alors que leurs conditions d’exercice se dégradent et que l’on a de plus en plus besoin d’eux, pour mener à bien leurs missions traditionnelles, ainsi que de nouvelles missions. Comment entendez-vous résoudre cette contradiction et leur permettre d’exercer leur activité ?
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Hervé Berville, secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité. Monsieur le sénateur Philippe Bonnecarrère, je vous remercie de votre question, qui me permet de saluer l’ensemble des lieutenants de louveterie, ces bénévoles qui assurent des missions de service public, à la demande des préfets de département, au profit des collectivités et des agriculteurs.
Ils jouent un rôle essentiel en matière de régulation des espèces sauvages, de répression du braconnage et de lien social dans cette ruralité que vous connaissez bien, et cela depuis Charlemagne ; il s’agit donc de l’un des services publics les plus anciens.
Avec le retour du loup dans nos territoires et l’expansion de sa présence, les louvetiers sont de nouveau fortement mobilisés pour la défense des troupeaux. Ils jouent, comme vous l’avez indiqué, un rôle central dans la mise en œuvre des tirs dérogatoires dans le cadre du plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage.
Dans le cadre des missions relatives au loup, le défraiement et le remboursement des frais kilométriques des louvetiers sont effectifs depuis 2011. Néanmoins, en vue du renouvellement à venir des lieutenants de louveterie et de la préparation du plan national d’actions sur le loup, le Gouvernement a conduit une mission, afin d’identifier des leviers pour améliorer leur accompagnement.
J’ai reçu les conclusions de cette mission en mars, et je puis vous annoncer, monsieur le sénateur, que je les rendrai publiques dans les prochains jours ; bien évidemment, vous en serez destinataire. Nous pourrons ainsi réfléchir ensemble à la façon d’améliorer les conditions d’exercice des louvetiers, dont les missions sont en effet plus nombreuses.
Ces recommandations seront prises en compte dès cette année, lors du renouvellement des louvetiers. Parmi celles-ci, un consensus a été trouvé sur la nécessité de recentrer et d’alléger leurs missions pour adapter leurs activités aux priorités actuelles, notamment celles qui sont relatives à la gestion du loup ou du sanglier.
Une réflexion est par ailleurs en cours concernant la prise en charge financière de l’équipement des louvetiers.
Enfin, sont envisagés des accords avec les employeurs pour faciliter l’aménagement du temps de travail des louvetiers et généraliser l’utilisation d’un outil numérique unique de transmission des rapports.
Les travaux menés au Sénat et à l’Assemblée nationale nourriront nos réflexions et nous permettront d’améliorer la situation des louvetiers.
absence de réponse de l’agence nationale de l’habitat au défenseur des droits
Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, auteur de la question n° 965, adressée à M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Mme Nadia Sollogoub. Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur l’absence de réponse de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) aux sollicitations du Défenseur des droits.
À la fin de 2022, le Défenseur des droits faisait état d’environ 500 réclamations de la part d’usagers souhaitant solliciter le dispositif MaPrimeRénov’. L’accès à cette aide financière est totalement dématérialisé pour l’usager.
Il a été constaté que, faute d’équipements informatiques et d’une connexion internet pour l’ensemble des foyers français, ce seul moyen d’accès au dispositif constitue une rupture d’égalité devant le service public. Mais les difficultés ne s’arrêtent pas là. Les usagers ne sont pas les seuls à rencontrer des difficultés avec les modalités électroniques de traitement des dossiers.
En effet, comme le site internet service-public.fr encourage à le faire, les usagers peuvent saisir le Défenseur des droits dans le cadre de litiges avec l’administration. Ainsi celui-ci est-il sollicité par les usagers qui subissent certains aléas dans la gestion de leur demande d’aide au titre de MaPrimeRénov’.
Cependant, les représentants du Défenseur des droits dans les territoires rencontrent un problème majeur : ils sont également soumis à un accès dématérialisé pour conduire leur mission. Ici, la difficulté rencontrée n’est pas celle de l’absence de matériel ou de réseau, mais simplement l’absence de réponse à leurs demandes…
Face à ce constat affligeant, je souhaite vous interpeller, afin que l’Anah s’organise pour répondre aux sollicitations du Défenseur des droits, et ce dans des délais raisonnables.
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Hervé Berville, secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité. Madame la sénatrice Nadia Sollogoub, je vous remercie de votre question. Elle me permet de rappeler que, depuis la mise en œuvre du dispositif MaPrimeRénov’, plus de 2,3 millions de ménages ont perçu une aide pour rénover leurs logements, pour un montant total de près de 10 milliards d’euros.
Lancé dans le contexte particulier de la crise de la covid-19 et du plan France Relance, ce dispositif d’aide au financement des travaux de rénovation des logements est accompagné depuis le 1er janvier 2022 par le déploiement de France Rénov’, le service public de la rénovation de l’habitat, qui permet à nos concitoyens, notamment aux ménages, d’être informés, conseillés et orientés dans plus de 580 espaces-conseil présents sur l’ensemble du territoire.
J’en viens au sujet que vous avez soulevé très justement. Afin de renforcer cette proximité, l’Anah et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) ont noué depuis le 1er janvier 2024 un partenariat avec plus de 2 700 maisons France Services implantées partout dans nos territoires.
Depuis 2020 et le lancement de l’aide, le Défenseur des droits a saisi l’Anah de 1 341 dossiers, soit 0,0005 % des dossiers déposés.
Sur l’ensemble de ces dossiers, 88 % ont donné lieu à une réponse. Tous les autres dossiers signalés font l’objet d’un traitement et d’une prise de contact directe avec les usagers, afin que soit trouvée une solution adaptée à chaque situation.
Les équipes de l’Anah échangent également de manière régulière avec celles du Défenseur des droits au niveau national. Ce dernier a fait savoir à l’Anah, en mars 2024, que ce dispositif connaissait ses premiers succès et donnait satisfaction aux équipes sur le terrain. Ces échanges continuent.
J’entends parfaitement votre question : il faut continuellement s’améliorer, répondre à toutes les situations et apporter des solutions à nos concitoyens. Je tiens à cet égard à remercier les services mobilisés, qui agissent au mieux, avec une grande efficacité.
Mme la présidente. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour la réplique.
Mme Nadia Sollogoub. Manifestement, monsieur le secrétaire d’État, nous ne disposons pas des mêmes chiffres ! On m’a ainsi signalé un certain nombre de dossiers restant en instance.
Dans mon département, la Nièvre, on est plutôt adeptes du bon sens et du terrain. Beaucoup d’habitants n’ont pas d’ordinateur : remplir le dossier est déjà compliqué ; quand cela cafouille, on s’adresse au Défenseur des droits, et là, rebelote, ses représentants ne reçoivent pas de réponse…
L’État semble donc déconnecté et lointain, et nos concitoyens, dans de tels cas, risquent tout simplement de renoncer à faire valoir leurs droits.
congés frauduleux donnés par les propriétaires à l’occasion des jeux olympiques.
Mme la présidente. La parole est à M. Ian Brossat, auteur de la question n° 1159, adressée à M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
M. Ian Brossat. Monsieur le secrétaire d’État, les jeux Olympiques (JO) auront lieu bientôt ; c’est la promesse d’un grand événement populaire, que les Français attendent.
Or à Paris, mais aussi dans d’autres communes, notamment en Seine-Saint-Denis, nous constatons la multiplication du nombre de congés frauduleux : des propriétaires voyous se débarrassent de leurs locataires à l’approche des jeux Olympiques, pour louer leur logement pendant cette période sur des plateformes de location touristique de type Airbnb.
Ces locataires, qui se retrouvent donc à la porte de leur appartement, ne trouvent pas, dans le contexte actuel de tension sur le marché immobilier, d’autre solution de logement dans leur ville.
Ce nombre de congés frauduleux est passé en deux ans, à Paris, de 19 % à 28 %, selon l’agence départementale d’information sur le logement (Adil) de Paris.
J’avais eu l’occasion d’interpeller le ministre du logement sur ce phénomène qui nous inquiète. Ma question est donc très simple : quels moyens l’État met-il en œuvre pour éviter ces congés frauduleux et permettre à ces locataires, qui sont dans leur droit, de continuer à vivre dans leur logement, sans en être chassés par des propriétaires désireux de faire un profit maximum pendant la période des JO ?
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Hervé Berville, secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité. Monsieur le sénateur Ian Brossat, je vous remercie de votre question, qui est essentielle pour ce qui concerne la capacité de nos concitoyens à se loger dignement durant la période des jeux Olympiques. Celle-ci, si enthousiasmante soit-elle, ne doit pas donner lieu à des dérives.
Vous le savez, l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 encadre drastiquement les possibilités pour un bailleur de donner congé à son locataire. Il ne peut le faire qu’à l’échéance du bail, et seulement dans trois cas de figure.
Premier cas : le bailleur souhaite reprendre le logement pour l’occuper à titre de résidence principale ou y loger un proche. Il doit alors justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Deuxième cas : le bailleur souhaite vendre le logement inoccupé. Dans le cas d’un logement non meublé, le locataire est prioritaire pour acquérir le logement. Le bailleur doit lui donner congé en lui indiquant le prix et les conditions de la vente ; cela constitue une offre de vente.
Troisième cas de figure : le bailleur met fin au bail pour un motif légitime et sérieux – non-respect par le locataire de l’une de ses obligations, retard répété de paiement des loyers, défaut d’entretien du logement, trouble de voisinage.
En outre, la loi prévoit la possibilité pour le locataire de saisir le juge pour contester le congé. Ce dernier peut alors, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé. Il peut notamment le déclarer non valide si la non-reconduction du bail ne lui apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni par une amende pénale. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de ce préjudice.
Il découle de tous ces éléments que la réglementation actuellement en vigueur sur le congé est très protectrice des locataires et présente de nombreux garde-fous pour limiter les abus.
Il y aura toujours des gens qui fraudent, mais, en face, il y aura toujours l’État, le Gouvernement et les élus que vous êtes pour répondre présent et protéger les locataires. Les moyens seront mis en œuvre et la loi – rien que la loi, mais toute la loi – s’appliquera.
Mme la présidente. La parole est à M. Ian Brossat, pour la réplique.
M. Ian Brossat. Monsieur le secrétaire d’État, vous avez eu raison de rappeler la loi, mais force est de constater qu’elle ne s’applique pas ! Aujourd’hui, très peu de locataires vont devant le juge pour faire valoir leurs droits. J’y insiste, le dispositif ne fonctionne pas.
Je suis d’autant plus inquiet que le ministre du logement passe plus de temps à expliquer comment il veut expulser que comment il compte loger. Vous lisez ses interviews comme moi : tous les jours, il nous explique comment il va faciliter les expulsions locatives.
Je n’ai toujours pas compris les moyens qu’il allait mettre en œuvre pour faire en sorte qu’il soit possible de se loger dans notre pays, alors même que 330 000 personnes sont à la rue et que le nombre d’expulsions locatives a enregistré un record cette année !
Il est grand temps de s’occuper du logement dans ce pays ; ce n’est pas encore le cas. (Mme Cathy Apourceau-Poly applaudit.)
gratuité de l’autoroute a62 et avenir des concessions autoroutières
Mme la présidente. La parole est à M. Hervé Gillé, auteur de la question n° 1204, adressée à M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports.
M. Hervé Gillé. Monsieur le secrétaire d’État, en Sud-Gironde, nombreux sont celles et ceux qui doivent se déplacer vers la métropole bordelaise pour y travailler. Ils prennent leur voiture et empruntent alors l’autoroute A62. En plus du coût de leur véhicule et de l’essence, pour un trajet de Langon à Bordeaux, ils paient 4,60 euros de péage aller-retour, soit 92 euros par mois, ce qui représente plus de 1 000 euros par an et par travailleur. Cette somme est énorme et injuste !
Elle est injuste, tout d’abord, à l’échelle du département, car l’accès à la métropole bordelaise est gratuit sur les autres axes reliant Bordeaux.
Elle est injuste, ensuite, au regard du chiffre d’affaires réalisé par les gestionnaires d’autoroutes privés : Vinci Autoroutes, qui détient la société Autoroutes du sud de la France (ASF), gestionnaire de l’A62, s’offrait 2,2 milliards d’euros de profit en 2022.
Les élus du Sud-Gironde, Laurence Harribey et moi-même, avons déjà fait part de ces injustices. Votre réponse a été que la gratuité d’une portion de l’A62 était « juridiquement impossible », mais que nous pouvions être rassurés, car vous aviez « demandé » aux concessionnaires des efforts sur les abonnements et le covoiturage. Finalement, c’est le statu quo que vous privilégiez.
À quelques années de la fin des contrats, il est urgent que l’État ait une politique volontariste, notamment en faveur des salariés interconnectés avec les métropoles.
Monsieur le secrétaire d’État, ma question est donc la suivante : êtes-vous favorable à l’évolution des cahiers des charges des sociétés concessionnaires pour permettre la gratuité de ces tronçons, ou a minima en diminuer significativement les coûts ?
Dans la perspective désormais urgente de la préparation du renouvellement de ces concessions, seriez-vous favorable à une réduction expérimentale des coûts pour les automobilistes qui n’ont pas d’autres choix, en particulier sur l’axe Bordeaux-La Réole avec l’A62 ?
Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d’État.
M. Hervé Berville, secrétaire d’État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la mer et de la biodiversité. Monsieur le sénateur Hervé Gillé, je vous remercie de votre question ; elle est importante pour nos concitoyens qui doivent emprunter ces autoroutes pour aller travailler. Dans le cadre des enjeux de pouvoir d’achat que nous connaissons, votre interrogation est parfaitement légitime.
Vous le savez, le modèle de la concession réside dans le financement de l’infrastructure par ses usagers. En particulier, le contrat de concession d’ASF, que vous avez mentionné, repose sur un péage payé par les usagers de l’autoroute A62.
Toute réduction ou suppression de ce péage conduirait, ce qui est logique, à la mise en œuvre de l’obligation contractuelle de compenser le concessionnaire des pertes de recettes induites en augmentant ailleurs les péages. Le ministre vous a déjà fait cette réponse, et je la réitère, car les conditions n’ont pas changé. Pour faire simple, cela reviendrait donc à déplacer le problème.
S’ajouterait à cela une fragilisation du péage, qui doit être proportionnel au service rendu. Or la mise à péage de cette section a été instaurée pour financer, justement, la construction de l’autoroute.
Ainsi, la gratuité de l’A62 jusqu’à La Réole conduirait à faire payer par les usagers empruntant d’autres trajets sur cette autoroute des travaux portant sur une section qu’ils n’utilisent pas. Il n’est donc pas possible d’envisager, comme vous le souhaitez, la gratuité de l’autoroute A62 entre Langon et Bordeaux dans le contexte actuel, comme cela vous a été indiqué par le ministre des transports.
Pour réduire l’impact du péage pour les usagers qui empruntent quotidiennement l’autoroute, par exemple lors des trajets domicile-travail, les sociétés ont mis en place depuis des années, sur la demande du Gouvernement, des formules d’abonnement. Ainsi, les usagers fréquents – ceux qui réalisent plus de dix allers-retours sur un trajet – peuvent bénéficier d’une réduction de 30 % du péage sur ce trajet.
Le Gouvernement partage, en revanche, votre avis sur la nécessité d’anticiper la gestion du réseau autoroutier actuellement concédé après la fin des concessions historiques entre 2031 et 2036.
Sur le volet financier, une telle réflexion doit permettre d’appréhender les enjeux d’aménagement du réseau routier en termes de meilleur service aux usagers, d’accompagnement du report modal et d’adaptation aux changements climatiques.