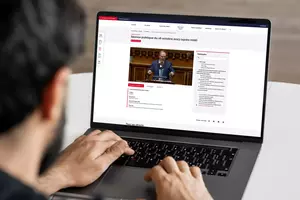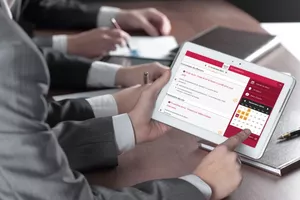Mme la présidente. La parole est à Mme Céline Brulin, auteure de la question n° 1274, adressée à Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Mme Céline Brulin. Monsieur le ministre, depuis novembre dernier, l’Ehpad Les Escales du Havre, qui est le plus grand Ehpad public de France, regroupant plusieurs établissements et plus de 600 lits, est placé sous administration provisoire. La dette de l’établissement s’élève à 12,5 millions d’euros.
L’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux propose la suppression d’une centaine de postes sur les 566 équivalents temps plein. Cela suscite évidemment et légitimement de très grandes inquiétudes parmi les soignants, qui sont déjà soumis à une charge de travail très lourde en raison de leur sous-effectif.
Avec une infirmière pour 120 patients, certaines unités fonctionnent en permanence en mode dégradé, ce qui affecte la qualité des soins. L’unité qui vient d’être construite fonctionnera, elle, avec un ratio d’une aide-soignante pour 24 patients. Ce n’est pas tenable !
Les soignants sont épuisés physiquement et psychologiquement. Ils – le plus souvent, elles, vous le savez bien – souffrent de ne pouvoir assumer convenablement l’accompagnement dû aux résidents.
À ces problèmes structurels, des dysfonctionnements et des problèmes de gestion et de management se sont ajoutés, conjugués à un manque extrême de communication en direction des agents. La restructuration en cours ne fait qu’aggraver des conditions de travail déjà difficiles, avec des horaires modifiés, des personnels en moindre effectif, notamment avec le retrait annoncé du personnel de bionettoyage.
La situation est vraiment délétère ; j’y insiste. Les professionnels de santé de l’établissement subissent un très grand mal-être, et je crois qu’il est urgent que des mesures concrètes soient prises pour garantir la sécurité des patients et du personnel.
Monsieur le ministre, quels soutiens, quelles actions et quels moyens entendez-vous mobiliser à titre tout à fait exceptionnel pour cet établissement, qui traverse de très grandes difficultés ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Frédéric Valletoux, ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention. Madame la sénatrice Céline Brulin, l’Ehpad des Escales, vous l’avez rappelé, est un établissement public autonome accueillant plus de 600 résidents sur 6 résidences situées dans la ville du Havre.
Sa situation financière est telle que vous l’avez décrite : elle était maîtrisée jusqu’en 2020, quand le budget annuel était de 32 millions d’euros. Dès le début de l’année 2023, l’agence régionale de santé (ARS) et le conseil départemental ont mis en place un accompagnement de cet établissement, compte tenu de sa singularité – son nombre de résidents, sa taille absolument unique, ses lieux multiples –, dans la transformation de son organisation et de son fonctionnement.
Les tutelles ont été alertées sur une dégradation de sa situation financière dès le mois de septembre 2023. Dès lors, l’ARS, le conseil départemental et la ville se sont mobilisés lors de réunions hebdomadaires avec l’établissement et le groupe. L’ARS a apporté des aides exceptionnelles, de plus de 3,4 millions d’euros en 2023 et de plus de 5,5 millions d’euros en 2024.
Face à cette situation et au départ de la directrice, la décision des tutelles de placer l’Ehpad sous administration provisoire a été prise, en coordination avec le président du conseil d’administration.
Des engagements sont prévus. Ainsi, des crédits pérennes de l’ARS, pour le développement de trois pôles d’activité et de soins adaptés, à hauteur de 200 000 euros, ont été actés, de même que des crédits pérennes du département, de l’ordre de 750 000 euros, pour le renfort de certains effectifs et des actions de formation dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM).
Une action a été engagée pour l’amélioration du taux d’occupation des établissements. Une nouvelle évaluation de la charge en soins et dépendance pour mieux valoriser l’activité des professionnels, en lien avec la lourdeur de certains accompagnements, est en cours. Une action a été engagée au titre de la récupération de la TVA dans le cadre du chantier de travaux. Enfin, des partenariats ont été activés avec tant les acteurs du domicile que les établissements médico-sociaux.
Des actions de réduction des dépenses étant également nécessaires, tous les groupes de dépenses sont analysés. En matière d’exploitation, l’objectif est d’optimiser l’organisation et le fonctionnement des fonctions supports. Pour ce qui concerne le personnel, l’objectif est de se rapprocher des ratios, tout en assurant la qualité et la sécurité des accompagnants.
Je vous annonce que l’administration provisoire donnera lieu à une prorogation à compter du 14 mai 2024, pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois. En tout état de cause, toutes les actions engagées visant à pérenniser l’offre d’accueil seront maintenues et mises en œuvre par les acteurs qui concourent à la gestion de ce site.
Mme la présidente. La parole est à Mme Céline Brulin, pour la réplique.
Mme Céline Brulin. Je regrette que vous n’ayez pas répondu sur les emplois, monsieur le ministre.
Vous comprenez bien que, compte tenu des difficultés qu’il rencontre, l’établissement ne peut fonctionner avec des effectifs moindres. Au-delà, je vous invite à réfléchir sur les mouvements de fusion d’établissements. Ce cas précis nous rappelle que fusionner de la misère n’a jamais produit de la richesse !
difficultés rencontrées par les établissements de santé privés
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, auteure de la question n° 1277, adressée à M. le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention.
Mme Marie-Do Aeschlimann. Monsieur le ministre, la Fédération de l’hospitalisation privée et les syndicats de médecins libéraux seront en grève totale et reconductible à compter du 3 juin prochain. Vous pouvez empêcher cela !
Ils déplorent la hausse de 0,3 % des tarifs hospitaliers privés en 2024, un chiffre jugé dérisoire, voire désobligeant, face aux 4,3 % concédés au secteur public.
Cette augmentation est dérisoire, car l’hôpital privé supporte la même inflation, les mêmes contraintes réglementaires et des besoins d’investissement et d’innovation importants.
Elle est désobligeante, dans la mesure où le privé prend sa part dans l’offre de soins en étant présent dans 90 départements. Il est même parfois majoritaire, comme dans le département où je suis élue, les Hauts-de-Seine, mais aussi en Corse, dans les Alpes ou dans le Nord-Est, où l’hôpital situé à trente minutes est un hôpital privé.
Avec seulement 18 % des financements publics, le millier d’hôpitaux privés accueille 9 millions de patients et assure la moitié de la chirurgie, 33 % de l’activité hospitalière et 40 % de la chirurgie du cancer. Il participe aux urgences, intervient en aval, grâce aux collaborations public-privé, appréciées sur le terrain, qui limitent l’attente et optimisent les plateaux techniques.
Alors que l’hôpital public est en crise, que les déserts médicaux se multiplient, que 10 % de la dette de soins héritée de la crise sanitaire est absorbée par le rebond de l’activité privée, est-il judicieux d’opposer les deux systèmes ?
Alors que 50 % des cliniques privées ont enregistré un déficit en 2023, qui peut croire que l’asphyxie du privé suffira à réoxygéner le public ?
Les patients en seront les premières victimes, avec plus de renoncements, d’inégalités d’accès, de réductions de services, la concentration de l’offre de soins et la financiarisation dont nous ne voulons pas. Les soignants emboîteront le pas, car, en niant les efforts de gestion, en différenciant les traitements selon les exercices professionnels, l’attractivité des métiers reculera.
Monsieur le ministre, les secteurs publics et privés ne sont pas concurrents : ils sont complémentaires, et la ruine de l’un ne sauvera pas l’autre.
Dans mon département des Hauts-de-Seine, les cliniques renforcent l’hôpital public dans les services de chirurgie pédiatrique, de cancérologie ou de recherche. Mais elles jetteront l’éponge si vous maintenez votre arbitrage.
Monsieur le ministre, vous êtes pragmatique. Accepterez-vous une juste convergence tarifaire pour préserver le fragile équilibre du système hospitalier français ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Frédéric Valletoux, ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention. Madame la sénatrice, depuis plusieurs années, l’État marque son engagement financier en faveur des établissements de santé, qu’ils soient publics ou privés. L’intention n’a jamais été d’opposer les uns aux autres.
Depuis 2019, les ressources versées aux cliniques privées par l’assurance maladie au titre de leur activité en médecine, chirurgie et obstétrique ont augmenté de 2,2 milliards d’euros. Depuis 2021, ce sont au total 3,5 milliards d’euros de financements publics qui ont été attribués aux cliniques privées pour accompagner leurs activités et financer une partie des revalorisations salariales de leur personnel.
Pour mémoire, sous la majorité précédente, entre 2013 et 2017, les tarifs pour le secteur privé lucratif ont évolué à la baisse chaque année, et cela pendant six ans. Ce n’est pas le cas cette année, même si la hausse – 0,5 % – est modeste. Il s’agit même de la sixième année de progression consécutive des tarifs applicables au secteur privé lucratif depuis 2019, avec une augmentation de 5,3 % pour les tarifs du privé en 2023.
Face aux difficultés que vous mentionnez, les cliniques privées comme les établissements publics ont également bénéficié en février 2024 du dispositif de soutien exceptionnel en appui à la reprise d’activité, pour un montant global de 500 millions d’euros pour l’ensemble du secteur.
Le geste n’a donc rien de dérisoire ni de désobligeant pour les cliniques privées, ces dernières ne faisant l’objet d’aucune discrimination. Pour fixer les tarifs applicables aux activités des différents secteurs cette année, ce sont les mêmes critères, j’y insiste, qui ont été appliqués aux hôpitaux publics et aux cliniques privées.
L’écart entre les évolutions des tarifs hospitaliers des deux secteurs en 2024 reflète essentiellement l’impact des revalorisations salariales importantes décidées depuis l’été 2023 par le Gouvernement. Ces dernières ciblent notamment les personnels travaillant la nuit dans les hôpitaux publics, les gardes et astreintes ayant été sérieusement accompagnées et rehaussées en septembre dernier.
Cet écart des tarifs entre public et privé s’explique également par le soutien apporté par l’État à certaines activités structurellement sous-financées, qui n’ont pas retrouvé, depuis la crise sanitaire, un niveau à la hauteur des besoins de santé de la population.
Vous conviendrez sans doute que les tarifs de la pédiatrie, des maternités, de la médecine, des greffes et des soins palliatifs méritaient d’être levés.
Mme la présidente. Il faut conclure, monsieur le ministre délégué !
M. Frédéric Valletoux, ministre délégué. Ces activités, essentiellement assurées par le secteur public, expliquent également cet écart entre les tarifs.
réforme de l’allocation spécifique de solidarité et compensation du transfert de charges vers les départements
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Anglars, auteur de la question n° 1198, adressée à M. le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention.
M. Jean-Claude Anglars. Madame la présidente, monsieur le ministre, l’allocation de solidarité spécifique (ASS) est gérée par France Travail et financée par l’État. Elle a été instaurée en 1984 pour les demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits à l’assurance chômage.
Au début du mois de février dernier, lors de son discours de politique générale, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé la suppression de l’ASS pour les chômeurs en fin de droits, en les redirigeant vers le revenu de solidarité active (RSA).
Cette décision soulève des préoccupations quant aux effets qu’elle pourrait entraîner sur la précarité financière des demandeurs d’emploi. Elle a également fait l’objet de très vives critiques de la part des départements.
Tout d’abord, il s’agit une nouvelle fois d’une décision unilatérale de l’État vis-à-vis des collectivités territoriales, qui n’étaient pas au courant de ce projet de transfert. Cette réforme n’a donc pas été concertée avec les collectivités concernées, ce qui ne manque pas d’interpeller sur le peu de considération que le Gouvernement porte aux départements et à la décentralisation.
Ensuite, et surtout, le transfert des personnes concernées par l’ASS vers le RSA aura des conséquences sur les départements. Il est en effet estimé que 300 000 personnes bénéficient de cette allocation, pour un montant de 2,1 milliards d’euros. Il n’est donc pas raisonnable de penser que ce transfert de charges se fasse sans transfert de moyens !
En effet, la charge financière supplémentaire que cette décision ferait peser sur les finances départementales n’est pas supportable par les départements, qui connaissent déjà « une situation d’étranglement » de leurs finances selon les termes de l’Association des départements de France.
Pour l’Aveyron, le coût de cette réforme est estimé entre 6 et 7 millions d’euros par an, sans compter les moyens humains supplémentaires qui seront nécessaires à la mise en œuvre du dispositif.
Monsieur le ministre, cette annonce est-elle toujours d’actualité ? Les départements seront-ils consultés ? L’État s’engage-t-il à compenser en intégralité le transfert de charges vers les départements ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Frédéric Valletoux, ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention. Monsieur le sénateur Jean-Claude Anglars, le Gouvernement s’est engagé dans un vaste chantier de modernisation et de simplification de notre système de solidarité.
C’est la réforme de la solidarité à la source, qui est guidée par trois principes : rendre notre système plus équitable, faciliter l’accès à nos prestations de ceux qui y ont droit et, surtout, veiller à l’accompagnement vers l’emploi de leurs bénéficiaires.
Or l’ASS ne respecte pas ces conditions. Ainsi, contrairement au RSA, cette prestation ne peut se cumuler avec un revenu d’activité pendant plus de trois mois. En revanche, elle peut se cumuler avec des revenus du patrimoine. Est-ce logique ou équitable ?
L’ASS est aujourd’hui la seule prestation de solidarité qui donne des droits à retraite. Or ses conditions d’éligibilité sont complexes, et une même personne peut, ou non, avoir droit à l’ASS et aux trimestres de retraite associés, en fonction des revenus de son conjoint. Cela n’est pas équitable et cela n’incite pas, au sein des couples, à travailler plus.
Comme l’a dit le Premier ministre, nous avons une conviction : la retraite doit être le fruit du travail. Mais la suppression de l’ASS se fera progressivement et ne concernera que les personnes qui pourraient entrer dans le dispositif, et non celles qui y sont déjà. C’est donc une réforme qui ne fera pas de perdants. Personne ne verra sa situation changer brutalement.
J’entends enfin l’inquiétude des départements sur la charge financière supplémentaire qui leur incomberait.
D’une part, je le répète, cette suppression se fera de façon très progressive. L’impact sur les départements n’est donc pas immédiat.
D’autre part, cette réforme doit être analysée de façon globale, en lien avec celle de la solidarité à la source, qui conduira à la fois à faire baisser le non-recours au RSA et à lutter contre la fraude et les indus, ce qui représentera aussi des économies pour les départements.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Anglars, pour la réplique.
M. Jean-Claude Anglars. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse.
Les départements sont attentifs à vos propos. L’Aveyron est l’un des départements d’expérimentation des nouvelles modalités de l’accompagnement des allocataires du RSA. Nous aurons donc l’occasion d’en discuter de nouveau.
risque d’augmentation de la surpopulation carcérale durant les jeux olympiques
Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, auteure de la question n° 1247, adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Mme Corinne Narassiguin. Monsieur le ministre, ma question porte sur les risques d’augmentation de la surpopulation carcérale durant les jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024.
En effet, comme l’a récemment documenté l’Observatoire international des prisons (OIP), tous les ingrédients semblent réunis pour faire craindre une hausse substantielle des incarcérations : multiplication des patrouilles de police dans les transports à Paris, augmentation des audiences de comparution immédiate dans toutes les villes où se tiendront des épreuves et création de nouveaux délits passibles de prison au Parlement, avec la récente proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports.
Parmi les établissements qui risquent d’être particulièrement touchés figure la maison d’arrêt de Villepinte en Seine-Saint-Denis. La situation y est pourtant déjà dramatique. Lorsque j’ai exercé mon droit de visite le 8 avril 2024, accompagnée de la bâtonnière de Seine-Saint-Denis, cette prison opérait avec un taux d’occupation de 180 %.
L’administration pénitentiaire, que j’ai interrogée au cours de cette visite, a évoqué l’objectif de « libérer 120 places » d’ici à l’ouverture des JOP. Pour ce faire, il était notamment question de transferts vers la nouvelle structure d’accompagnement vers la sortie (SAS) de Noisy-le-Grand.
L’administration pénitentiaire compterait également sur l’ouverture du nouveau quartier centre de détention (QCD) de Fleury-Mérogis.
Il semblerait qu’un partenariat avec d’autres directions interrégionales des services pénitentiaires soit enfin envisagé, pour y transférer, au besoin, une cinquantaine de personnes détenues volontaires.
Monsieur le ministre, ce plan d’action répond-il à des instructions nationales émises par le ministère de la justice ou à des instructions régionales émises par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris ?
Le garde des sceaux pourra-t-il me transmettre des informations précises bimensuelles jusqu’à la mi-septembre 2024 sur les flux entrants et sortants au sein du centre pénitentiaire de Villepinte ?
Enfin, le Gouvernement entend-il prendre en compte la demande de mise en place d’un mécanisme contraignant de régulation carcérale, pour réellement lutter contre la surpopulation ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Frédéric Valletoux, ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention. Madame la sénatrice, je vous remercie de cette question, qui me permet de mettre en lumière le travail chaque jour accompli par les services centraux et déconcentrés de l’administration pénitentiaire, afin d’optimiser les taux d’occupation des établissements français et de réduire la densité carcérale.
En lien avec l’ensemble des structures pénitentiaires, les dix directions interrégionales des services pénitentiaires (DISP) déploient une politique volontariste d’orientation des publics condamnés vers les établissements pour peine qui répond à une stratégie nationale. À ce titre, elles mettent en œuvre les opérations de désencombrement auxquelles vous faites référence.
La direction interrégionale de Paris dispose de plus de 1 500 places ouvertes en droit de tirage, lui octroyant ainsi des places au sein des centres pénitentiaires d’autres DISP. Plus qu’un partenariat, ce droit permet de remédier aux déséquilibres qui peuvent exister entre les capacités d’accueil des établissements du ressort de chaque DISP.
La direction de l’administration pénitentiaire (DAP) réalise aussi des opérations de désencombrement des maisons d’arrêt suroccupées vers les maisons d’arrêt ou les établissements pour peine des DISP limitrophes, lorsque c’est envisageable.
Vous me demandez des données précises, bimensuelles, sur les flux entrants et sortants concernant la maison d’arrêt de Villepinte jusqu’à la mi-septembre 2024. Pour votre parfaite information, il n’existe pas de données prévisionnelles de ces flux pour les mois à venir, car il n’est pas possible d’anticiper le nombre de personnes qui seront condamnées à une peine d’emprisonnement et affectées dans cet établissement.
La rénovation de l’ancien quartier pour mineurs du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis en quartier centre de détention a permis l’ouverture de 406 places.
Les personnes détenues remplissant les conditions d’affectation sont quant à elles orientées vers des structures d’accompagnement vers la sortie (SAS), telles que les SAS d’Osny et de Meaux, qui ont été livrées l’année dernière.
Enfin, la SAS de Noisy-le-Grand que nous avons inaugurée ensemble la semaine dernière compte 120 nouvelles places disponibles sur le ressort de la DISP de Paris.
Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour la réplique.
Mme Corinne Narassiguin. Je ne demande pas au garde des sceaux des prévisions sur les flux de la prison de Villepinte, mais la communication des chiffres en temps réel jusqu’à la mi-septembre 2024 !
Par ailleurs, il serait bon de réfléchir à une véritable stratégie de réduction de la population carcérale.
suppression de postes dans l’enseignement public à paris à la rentrée 2024
Mme la présidente. La parole est à Mme Colombe Brossel, auteure de la question n° 1112, adressée à Mme la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Mme Colombe Brossel. Alors que les enseignants, les personnels de l’éducation nationale, les familles et les élus locaux ne cessent de vous alerter, vous continuez à attaquer l’enseignement public, à fermer des classes et à supprimer des postes, sans autre ambition qu’une logique comptable.
Chaque fois que vous êtes interpellé sur ce sujet, votre seul argument est celui de la baisse démographique. Aussi, crevons l’abcès immédiatement : oui, le nombre d’enfants scolarisés dans l’académie de Paris diminue. Mais là où cette baisse aurait pu vous conduire à entamer une révolution pédagogique, en réduisant pour tous les niveaux le nombre d’enfants par classe, et à permettre un maximum de dédoublements et de petits groupes au collège, vous fermez des classes, encore et encore.
Quel est le résultat ? Des situations absurdes et dénoncées par un certain nombre d’élus. L’éducation nationale crée elle-même les conditions de classes surchargées l’année prochaine dans des écoles où tout fonctionnait pourtant formidablement bien cette année !
Plus aucun territoire n’est épargné, ni les écoles et collèges en réseaux d’éducation prioritaire (REP), ni ceux qui sont situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), là où, pourtant, le service public a encore plus besoin qu’ailleurs de moyens supplémentaires. L’an dernier, vous avez fermé brutalement 178 classes dans les écoles primaires publiques et supprimé 182 postes d’enseignants dans le second degré.
Pour la rentrée 2024, vous vous obstinez. Vous annoncez la fermeture de 137 classes dans le premier degré et de 58 divisions dans les collèges publics, sans compter la baisse des dotations horaires globales (DHG), qui contraint à des choix pédagogiques à rebours de l’ambition que les enseignantes et les enseignants ont pour la réussite de leurs élèves.
Les collèges et lycées publics, niveau où se creusent les inégalités avec l’enseignement privé, ont pourtant plus que jamais besoin de votre soutien.
Monsieur le ministre, où vont mener ces fermetures de classes sans fin, ces saignées, année après année, ces suppressions de moyens ?
Écoutez ceux qui vous alertent et annulez ces suppressions de postes. Samedi dernier à Paris, nous étions encore nombreux à nous mobiliser à l’appel de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) et des organisations syndicales, pour protester contre le tri social des groupes de niveau, le prétendu « choc des savoirs » et les fermetures de classes, car nous croyons en l’école publique et nous la défendons.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Frédéric Valletoux, ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention. Madame la sénatrice Colombe Brossel, la ministre de l’éducation nationale m’a transmis plusieurs chiffres, qui renvoient à des réalités incontournables.
Dans l’académie de Paris, la baisse démographique s’accélère depuis plus de dix ans et affecte tous les niveaux d’enseignement. Cette déprise démographique est un phénomène structurel qui va se poursuivre. Depuis dix ans, l’académie de Paris a perdu 30 000 élèves dans le premier degré public, soit une diminution de 22 % des effectifs. Après une baisse de 2 690 élèves à la rentrée 2023, ce sont 2 031 élèves de moins qui sont attendus à la prochaine rentrée scolaire.
Pour autant, l’académie de Paris détient, avec la Corse, le meilleur taux d’encadrement de France métropolitaine, avec 6,6 postes d’enseignants pour 100 élèves en 2023, contre 5,1 en 2013. Très supérieur à la moyenne nationale de 6, ce taux ferait pâlir de jalousie bien d’autres territoires.
Ce taux devrait se maintenir malgré la baisse des moyens prévue et pérenniser de bonnes conditions d’enseignement pour les élèves et les professeurs. De même, le nombre moyen d’élèves par classe reste très favorable, avec 19,9 élèves en moyenne, contre 24,6 en 2013.
Dans le second degré public, à l’échelle nationale, 574 créations d’emplois permettent notamment la couverture de la démographie des académies devant connaître une évolution positive.
Or, à Paris, les effectifs d’élèves ont diminué de 1 443 élèves en 2023, et une nouvelle baisse de 1 276 élèves est prévue en 2024.
Le nombre moyen d’heures d’enseignement par élève de l’académie de Paris, qui mesure la palette horaire dont bénéficient effectivement tous les élèves, est le reflet quasi parfait de ce même taux d’encadrement national : 1,34, contre 1,35. Les moyens déployés permettront la mise en œuvre des mesures du choc des savoirs et la poursuite de l’effort en faveur de l’école inclusive, avec l’ouverture de dix unités localisées pour l’inclusion scolaire (Ulis) et les évolutions de la voie professionnelle.
Enfin, comme à la rentrée 2023, chaque établissement disposera également d’une dotation dans le cadre du pacte enseignant, qui permettra la mise en place de dispositifs d’accompagnement et de soutien au bénéfice des élèves.
L’académie de Paris est pleinement mobilisée, afin que tous les élèves et l’ensemble du personnel abordent la rentrée scolaire prochaine le plus sereinement possible.
difficultés des municipalités concernant la délivrance d’autorisations d’instruction en famille