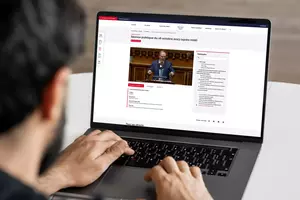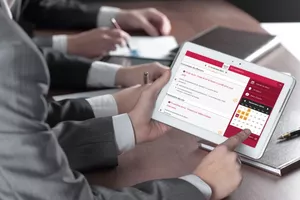compte rendu intégral
Présidence de Mme Sylvie Vermeillet
vice-présidente
Secrétaires :
Mme Véronique Guillotin,
M. Philippe Tabarot.
1
Procès-verbal
Mme la présidente. Le compte rendu intégral de la séance du mardi 30 avril 2024 a été publié sur le site internet du Sénat.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté.
2
Questions orales
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.
régularisation des médecins étrangers hors union européenne
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, auteur de la question n° 1049, adressée à Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Stéphane Sautarel. Monsieur le ministre, comme vous le savez, les praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue) qui veulent exercer en France doivent passer par une lourde et longue procédure administrative avant de pouvoir pratiquer librement leur profession : épreuves de vérification des connaissances (EVC), parcours de consolidation des compétences (PCC) – celui-ci nécessite d’effectuer deux ans de fonctions hospitalières en qualité de praticien associé –, puis demande d’autorisation d’exercice de la profession en France.
C’est seulement à l’issue de ce long processus administratif et pratique que les médecins étrangers peuvent exercer librement dans notre pays.
Le Président de la République s’est engagé le 16 janvier dernier à sécuriser la situation des Padhue. Celle des candidats non lauréats fait encore l’objet de décisions dérogatoires et temporaires et fait suite à la fin d’un régime dérogatoire qui existait jusqu’au 31 décembre 2023.
Cependant, la situation de ces médecins étrangers ne peut plus faire l’objet de régimes dérogatoires successifs : il faut des mesures efficaces et définitives.
Dans le Cantal, alors que nous manquons cruellement de médecins et que nous sommes confrontés à des déserts médicaux, comme bien d’autres territoires ruraux, des médecins ou des dentistes étrangers candidats à l’installation rencontrent des difficultés pour exercer et en sont souvent empêchés.
Leur installation est pourtant une véritable solution d’urgence pour pallier ou tenter de pallier le manque de médecins. Cela permettrait de rendre un véritable service à nos populations, qui ont droit, comme tous les Français, à un accès aux soins.
Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour assouplir et faciliter le travail des médecins étrangers à diplôme hors Union européenne, ainsi que pour accélérer et simplifier leur installation ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Frédéric Valletoux, ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention. Monsieur le sénateur Stéphane Sautarel, l’autorisation d’exercice pour les praticiens à diplôme hors Union européenne est à la fois un enjeu individuel pour les intéressés et une mesure permettant de garantir, dans de nombreux territoires, le maintien d’une offre de soins.
La loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, que j’ai portée en tant que député, permet une réforme structurelle du dispositif pour faciliter le parcours administratif des praticiens appelés Padhue.
Il n’existe qu’une seule voie d’accès permettant l’obtention du plein exercice : les praticiens à diplôme hors Union européenne doivent se présenter aux épreuves de vérification des connaissances et, à leur issue, réaliser un parcours de consolidation des compétences de deux ans. Ce concours a lieu chaque année.
Une refonte de la procédure concernant les Padhue est actuellement engagée, afin de fluidifier leur parcours de demande d’autorisation d’exercice.
Depuis la loi du 27 décembre dernier, les praticiens peuvent disposer d’une autorisation temporaire d’exercice de treize mois en attendant de passer le concours, et celle-ci est renouvelable une fois en cas d’échec.
Par ailleurs, les praticiens qui exerçaient déjà en France au moment des résultats du concours de 2023 ont pu bénéficier d’une affectation prioritaire sur leur établissement employeur.
D’autres évolutions seront mises en œuvre à compter de la saison 2024. Ainsi, les épreuves de vérification des connaissances qui auront lieu à l’automne permettront notamment de prendre en compte l’expérience acquise sur le territoire français par ces praticiens.
Par ailleurs, en application de l’article 36 de la loi du 27 décembre 2023, la durée et le parcours de consolidation des compétences seront aménagés. Le praticien lauréat du concours pourra se voir délivrer une autorisation de plein exercice à la suite d’un stage d’évaluation, après l’examen de son dossier par une commission d’autorisation d’exercice.
Par toutes ces mesures, j’ai la conviction que nous facilitons la régulation et la régularisation des praticiens à diplôme hors Union européenne tout en veillant à la qualité de leurs compétences, gage de la qualité des soins.
Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour la réplique.
M. Stéphane Sautarel. Je vous remercie, monsieur le ministre, de ces éléments de réponse.
En effet, un certain nombre de décisions récentes, à l’initiative desquelles vous avez été, permettent d’accélérer et de fluidifier l’installation des Padhue – je l’ai souligné dans ma question.
Il n’en reste pas moins que la gestion du stock, si je puis m’exprimer ainsi, mériterait de nouveaux assouplissements. J’espère que les orientations que vous avez mentionnées les permettront.
Aujourd’hui, nous connaissons tous des praticiens qui sont en situation d’exercer, qui donnent pleinement satisfaction, dont les compétences ne sont pas remises en cause et qui répondent aux besoins de nos territoires. J’espère donc que nous pourrons apporter une solution administrative à cette difficulté.
Mme la présidente. Monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, je salue la présence dans nos tribunes d’une délégation de la caserne Parmentier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
J’en profite pour les remercier de leur engagement. (Applaudissements.)
dispositif « cantine à 1 euro »
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy, auteur de la question n° 1184, adressée à Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
M. Christian Redon-Sarrazy. Monsieur le ministre, en mars dernier, plusieurs communes de Haute-Vienne ont été informées que, en raison du plan d’économies gouvernemental, les dépenses exécutées sur les programmes du ministère du travail, de la santé et des solidarités étaient suspendues, dans l’attente de la finalisation des arbitrages par le cabinet du Premier ministre.
Cette décision affecte directement le remboursement du dispositif « cantine à 1 euro ». Cette mesure de tarification sociale mise en place par l’État en avril 2019, à destination des communes rurales de moins de 10 000 habitants, permet aux enfants des familles modestes de déjeuner dans les cantines scolaires pour 1 euro maximum.
Depuis le mois de février dernier, le ministère n’a pu abonder la trésorerie du dispositif. Les demandes de remboursement sont donc suspendues, en attendant d’être traitées par l’Agence de services et de paiement (ASP), qui gère ce dispositif.
Il a été précisé aux maires concernés que la reprise des paiements interviendrait dès que possible, avec un retour à la normale qui avait alors été projeté, sans garantie, avant la fin du mois de mars. Or nous sommes aujourd’hui le 7 mai, et, d’après les informations que j’ai prises auprès des élus concernés, la situation demeure la même. Rien n’a avancé !
Il avait été précisé aux élus locaux que le principe de remboursement ne serait pas remis en cause. Compte tenu de cet important retard et de l’absence totale d’informations régulières délivrées sur l’évolution de la situation, les élus sont en droit de craindre le pire, à savoir que cette suspension de paiement ne soit le prélude à une suppression du dispositif.
Monsieur le ministre, êtes-vous en mesure de nous indiquer quand les arbitrages attendus seront rendus, et si ce dispositif reprendra son fonctionnement normal dans la foulée ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Frédéric Valletoux, ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention. Monsieur le sénateur Christian Redon-Sarrazy, le dispositif de soutien des communes rurales dans la mise en place d’une tarification sociale est un succès.
Pour preuve, en 2023, ce sont près de 2 500 communes ou regroupements de communes qui ont reçu une subvention de 3 euros par repas, servi à un tarif social de 1 euro ou moins.
Autre chiffre significatif, plus de 15 millions de repas servis à tarif social ont été subventionnés par l’État et, en moyenne, quelque 194 000 élèves ont pu rester ou retourner à la cantine grâce au dispositif sur l’année scolaire 2022-2023.
Comme votre question le souligne, une évolution supplémentaire vient enrichir la mesure depuis janvier 2024, avec le versement d’une subvention qui peut passer de 3 à 4 euros par repas – c’est « le bonus Égalim » – lorsque la collectivité s’engage à tout mettre en œuvre pour atteindre l’objectif de la loi Égalim visant à introduire dans les cantines 50 % de denrées locales et de qualité, dont 20 % de bio.
Cette bonification peut être demandée dès maintenant par les communes qui bénéficient d’ores et déjà du dispositif ou par de nouvelles communes qui y sont candidates.
Par ailleurs, la prolongation de cette mesure, qui fait ses preuves, est inscrite au pacte des solidarités annoncé, le 18 septembre 2023, par la Première ministre Élisabeth Borne et, à ce titre, est confortée jusqu’en 2027.
L’Agence de services et de paiement gère ce dispositif pour le compte de l’État. C’est avec cette agence que les communes passent la convention pluriannuelle et que les services de l’État ont préparé la prolongation et l’évolution de la mesure, pour être en ordre de marche dès janvier 2024.
Il est confirmé, tout d’abord, que les collectivités qui ont déjà passé une convention pluriannuelle peuvent la renouveler auprès de l’Agence de services et de paiement au moment de son échéance, sous réserve de continuer à respecter les critères d’éligibilité, et, ensuite, que les collectivités le souhaitant peuvent signer à tout moment un avenant à la convention en cours pour bénéficier du bonus Égalim, sous réserve d’avoir pris connaissance des engagements qui y sont associés.
Toutes ces informations et les modèles d’avenant peuvent être obtenus auprès de l’Agence de services et de paiement.
Mme la présidente. La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy, pour la réplique.
M. Christian Redon-Sarrazy. Monsieur le ministre, je pense que les communes qui attendent les versements de l’ASP sont au clair quant à toutes ces procédures !
Le problème est que des sommes qui sont dues ne sont pas versées. Je suis bien conscient que les erreurs de calcul du Gouvernement concernant les dépenses publiques le conduisent aujourd’hui à trouver des économies dans la panique… Je vous mets néanmoins en garde contre la tentation de mettre une fois de plus en difficulté les collectivités locales et nos concitoyens !
La tarification sociale des cantines est une mesure juste, à laquelle de nombreuses communes rurales ont recours, et elle est destinée à bénéficier aux enfants des familles modestes. Les priver d’un tel dispositif serait aller à l’encontre de la justice sociale.
Si l’État a besoin d’argent, s’il connaît des difficultés de trésorerie, qu’il taxe les riches et les superprofits, non les plus fragiles, et qu’il cesse de faire les poches des collectivités !
encadrement des centres de santé dentaire
Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, auteur de la question n° 1244, adressée à M. le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention.
Mme Dominique Estrosi Sassone. Monsieur le ministre, les dérives commerciales récentes d’un certain nombre de centres de santé dentaires ont eu de graves conséquences, tant sur la qualité et la sécurité des soins bucco-dentaires que sur leur coût pour l’assurance maladie. Parmi elles, je citerai des cas de mutilation et la réalisation d’actes non nécessaires et même, parfois, fictifs.
Le Parlement a adopté la loi du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Mais pour que ce texte soit pleinement efficace, encore faut-il que les six mesures réglementaires qui l’accompagnent soient appliquées rapidement… Or, à ce jour, elles n’ont pas été mises en œuvre.
La loi votée l’année dernière accroît les missions de contrôle des agences régionales de santé (ARS), avec notamment le rétablissement de la procédure d’agrément préalable des centres. Cette procédure avait été supprimée, faute de moyens suffisants pour les ARS, par la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite HPST, du 21 juillet 2009.
Cette suppression a sans aucun doute favorisé les dérives constatées ces dernières années, dénoncées par les professionnels de santé chirurgiens-dentistes. Il convient donc de ne pas reproduire les mêmes erreurs et de traduire l’esprit de la loi en actes.
Afin de m’assurer que le texte voté l’année dernière ne soit pas privé d’effets, je souhaite savoir, monsieur le ministre, à quelle échéance seront publiées les mesures réglementaires d’application et quels sont les moyens financiers et humains qui ont été alloués aux ARS pour conduire les opérations qui leur ont été confiées par le législateur sur les centres de santé.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Frédéric Valletoux, ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention. Madame la sénatrice, vous m’interrogez sur l’encadrement nécessaire des centres de santé, en particulier à la suite de dérives constatées dans certains centres – vous avez cité les centres dentaires, mais on pourrait évoquer également les centres d’ophtalmologie. Ces dérives portent atteinte à la solidarité nationale, comme vous l’avez rappelé.
Vous avez pu constater que nous avons d’ores et déjà agi. L’assurance maladie a ainsi décidé de sanctionner une dizaine de centres de santé dentaires dans certaines grandes villes à compter de la mi-mai.
Ainsi que vous l’avez indiqué, ces dérives portent parfois sur la qualité des soins pour nos concitoyens. C’est pour cette raison que la loi du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé, que vous avez citée, instaure d’importantes mesures de régulation et de sanction de ces centres de santé.
Les textes d’application ont été élaborés et concertés avec les acteurs concernés : représentants des centres de santé, syndicats des professionnels médicaux et dentaires, salariés des centres de santé, ordres des médecins et chirurgiens-dentistes, ainsi que l’Union des centres de santé dentaires. Le décret d’application de la loi devrait être publié d’ici au mois de juillet 2024.
Puisque vous m’appelez, dans votre question, à être précis, je le serai ! Ce décret fait actuellement l’objet de consultations obligatoires, tout d’abord de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), qui doit rendre son avis le 16 mai prochain, ensuite du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), qui se prononcera le 6 juin, et, enfin, des caisses d’assurance maladie.
Je tiens à vous rassurer sur un point : dans les missions qui leur sont dévolues par la loi, les agences régionales de santé sont accompagnées, sur les plans méthodologique et juridique, par les services du ministère, ce qui permettra aux ARS d’appréhender au mieux le traitement des dossiers de demande d’agrément et l’instruction des pièces justificatives demandées.
Madame la sénatrice, soyez assurée de l’engagement du Gouvernement en faveur de l’accès à des soins de qualité. De même, nous serons d’une très grande fermeté à l’égard des établissements qui ne respectent pas la loi.
Mme la présidente. La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour la réplique.
Mme Dominique Estrosi Sassone. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, qui semble rassurante.
Je pense que les professionnels de santé, plus particulièrement les chirurgiens-dentistes, feront preuve de vigilance quant à la publication du décret d’application qui est annoncé pour le mois de juillet 2024.
Les dérives qu’il s’agit d’éviter portent aujourd’hui lourdement atteinte à l’accès aux soins d’un certain nombre de nos concitoyens. J’espère donc véritablement que les annonces seront suivies par des actes.
situation des infirmiers et infirmières du réseau de l’action de santé libérale en équipe
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Duranton, auteur de la question n° 1251, adressée à Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Mme Nicole Duranton. Monsieur le ministre, je suis alertée par des infirmières et des infirmiers délégués à la santé publique (IDSP) et par des infirmières en pratique avancée (IPA) de mon département de l’Eure, qui travaillent pour l’association Asalée (Action de santé libérale en équipe), une association nationale qui s’appuie sur des antennes départementales. J’en profite pour saluer le travail remarquable qu’ils réalisent.
Ces infirmières et infirmiers, qui exercent sur tout le territoire, permettent aux populations les plus isolées d’avoir accès à des soins réguliers – notamment aux patients diabétiques, aux patients présentant des facteurs de risque cardiovasculaires et aux patients âgés souffrant de troubles cognitifs et d’autres pathologies.
Leur rôle est essentiel. Ils collaborent avec des médecins généralistes et avec tous les acteurs des soins primaires pour prendre en charge au plus près les patients, dans le cadre d’un exercice coordonné. Cette collaboration est particulièrement importante dans notre département, qui est malheureusement devenu, au fil des années, un désert médical.
Cette collaboration est importante pour plusieurs raisons : elle redonne de l’autonomie aux patients sur la prise en charge de leur santé ; elle permet aux médecins généralistes de libérer du temps de consultation ; elle diminue les coûts en matière de santé.
La présence de ces infirmières et infirmiers est d’un grand soutien pour les patients et elle permet aux équipes médicales de gagner un temps précieux en cas de problème grave.
Or l’association Asalée, dispositif qui a fait ses preuves, est actuellement dans la tourmente compte tenu du désengagement financier de la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam). Des négociations sont en cours, mais Asalée est en difficulté pour payer ses salariés.
La situation est paradoxale : la Cnam soutient officiellement Asalée, mais, dans le même temps, elle ne verse pas les dotations en temps et en heure !
Je suis convaincue que le Gouvernement continuera de soutenir et d’accompagner le dispositif Asalée, essentiel pour nos territoires ruraux. Monsieur le ministre, quelles sont les mesures que vous comptez déployer pour venir en aide à cette association ? Et où en sont les négociations avec la Cnam ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Frédéric Valletoux, ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention. Madame la sénatrice Nicole Duranton, vous m’interrogez sur l’avenir du dispositif Asalée. C’est effectivement un sujet qui inquiète beaucoup aujourd’hui les élus, tant nationaux que territoriaux.
Je suis d’accord avec vous sur l’intérêt de ce dispositif, qui appelle également toute mon attention.
Le Gouvernement est pleinement convaincu de l’intérêt majeur du dispositif Asalée et de la réponse efficace qu’il apporte aux besoins des patients. En effet, il permet une prise en charge de qualité et facilite l’accès aux soins.
Ce dispositif a fait ses preuves, tant scientifiquement qu’en matière de santé publique. Il fonctionne et, je veux répéter ici très nettement ce que j’ai déjà eu l’occasion de dire, il n’est pas question de le remettre en cause.
Les pouvoirs publics ont accompagné le projet depuis sa création et dans sa croissance, avec un financement intégral du dispositif par l’assurance maladie. Le montant annuel important versé à l’association pour faire fonctionner ce dispositif national est important – il est supérieur à 80 millions d’euros.
Les montants investis par les pouvoirs publics sont alloués aux soins. En revanche, la convention actuelle entre l’association et l’assurance maladie ne prévoit pas de prise en charge des loyers, contrairement à ce que souhaite l’association. En effet, le souci constant du ministère comme de l’assurance maladie est de garantir la bonne utilisation de l’argent public ; je pense que les membres de cette assemblée le partagent.
L’assurance maladie n’a donc pas suspendu ses financements à l’association, qui reçoit quelque 6 millions d’euros par mois.
Néanmoins, une convention doit effectivement être signée. Ce texte, permettant de financer 1 500 emplois à temps plein pour l’année 2024, a été proposé le 2 mai dernier, c’est-à-dire il y a quelques jours, à la signature de l’association, dont nous attendons le retour.
J’espère qu’Asalée signera très vite cette convention, afin de regagner en lisibilité et de retrouver la plénitude de son fonctionnement.
Soyez assurée, madame la sénatrice, de l’engagement du Gouvernement en faveur de l’accès aux soins et du soutien tout particulier qu’il accorde à ce dispositif, dont je redis qu’il est efficace et utile et qu’il appelle un soutien plein et entier de l’État, nonobstant le règlement des quelques questions de gestion qui ont été évoquées.
campagne de vaccination contre le papillomavirus dans les collèges
Mme la présidente. La parole est à Mme Patricia Demas, auteure de la question n° 1206, adressée à M. le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention.
Mme Patricia Demas. Monsieur le ministre, ma question porte sur la vaccination contre le papillomavirus des jeunes dans notre pays.
Le papillomavirus est une infection responsable chaque année de 6 000 nouveaux cas de cancers et de 30 000 lésions précancéreuses du col de l’utérus. Un vaccin est disponible et il est très efficace, d’autant plus quand la vaccination a lieu tôt, c’est-à-dire dès le collège. À cet âge, deux doses suffisent aux jeunes pour être protégés, alors que trois doses sont nécessaires à partir de 15 ans.
Le vaccin étant coûteux – autour de 100 euros la dose –, c’est une raison supplémentaire pour vacciner tôt, monsieur le ministre !
À l’échelle nationale, la couverture vaccinale des jeunes contre le papillomavirus est globalement en progression notable, bien qu’elle soit largement inférieure à celle des pays voisins. Elle se fait principalement hors du cadre scolaire.
À la fin de l’année 2023, la première dose avait été administrée à 55 % des collégiennes et à seulement 41 % des collégiens. La couverture vaccinale doit encore être améliorée, car, pour être totalement efficace, elle doit atteindre un taux de 80 %, dont nous sommes encore bien loin.
Et si l’on se réfère aux résultats très décevants de la première campagne de vaccination, menée dans les collèges en septembre 2023, seuls 10 % des jeunes y avaient reçu une première injection. Il y a matière à se demander pourquoi, à l’aube de la deuxième campagne, programmée pour la rentrée 2024…
Je souhaite donc savoir, monsieur le ministre, si le Gouvernement dispose enfin d’un bilan précis de cette première campagne vaccinale dans les collèges, pour identifier les freins à la vaccination et en affiner les leviers.
Par ailleurs, pouvez-vous m’assurer de votre détermination à conduire efficacement les campagnes à venir ?
Enfin, dans la mesure où les taux semblent différer très sensiblement d’une région à l’autre, je souhaite comprendre les inégalités entre les territoires. La région Sud, par exemple, est identifiée comme l’une des moins bien couvertes. Pour quelles raisons ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Frédéric Valletoux, ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention. Madame la sénatrice Patricia Demas, la première campagne de vaccination contre les infections à papillomavirus humain (HPV) au collège a permis de progresser dans trois champs. Je tiens à le réaffirmer devant vous.
Tout d’abord, son déploiement dans tous les collèges publics et dans les collèges privés volontaires est un succès. Au total, ce sont plus de 117 000 élèves de cinquième qui ont reçu leur première dose de manière sûre, gratuite et facile d’accès et qui s’apprêtent à recevoir la seconde dose.
Ensuite, nous avons informé efficacement les jeunes et leurs parents de l’importance d’être vaccinés contre toute exposition au papillomavirus.
Enfin, nous constatons un véritable effet d’entraînement de cette campagne au collège sur la vaccination spontanée en ville.
Au total, et pour répondre très précisément à votre question, plus de 400 000 adolescents âgés de 12 ans en 2023 ont reçu au moins une dose en ville ou au collège, soit 48 % de la classe d’âge. C’est 17 points de plus que la génération précédente – celle qui avait 12 ans en 2022.
Forte de ces résultats encourageants, la campagne sera renouvelée dans les collèges dès la rentrée prochaine. Notre objectif reste le même : vacciner 80 % d’une tranche d’âge d’ici à 2030, pour éradiquer les cancers liés aux HPV.
Nous avons mené une évaluation interne auprès des agences régionales de santé et allons adapter le dispositif, afin de le rendre encore plus souple et plus opérationnel.
Nous allons notamment renforcer l’information et la communication à plusieurs niveaux. Les parents d’élèves de sixième recevront un premier courrier d’information d’ici à la fin de ce mois de mai, et des séances d’information et de sensibilisation à destination de ces élèves seront menées dans les collèges en juin, pour la vaccination qui aura lieu à partir de la rentrée. En outre, à la rentrée en cinquième, un second courrier d’information sera envoyé aux parents d’élèves.
Parallèlement, une large campagne de communication grand public et à destination des professionnels de santé sera déployée à la rentrée scolaire.
Pour ce qui concerne, enfin, les différences territoriales, elles ne s’expliquent que par l’adhésion au vaccin, puisque cette démarche est proposée à l’ensemble des élèves, quel que soit leur lieu d’habitation.
situation de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « les escales » au havre